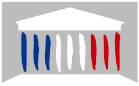N° 987
______
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 24 avril 2013.
RAPPORT
FAIT
AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES SUR LA PROPOSITION DE LOI tendant à interdire les licenciements boursiers et les suppressions d’emplois abusives,
PAR M. André CHASSAIGNE,
Député.
——
Voir le numéro :
Assemblée nationale : 869.
A. LES EFFETS SUR L’EMPLOI DE LA FINANCIARISATION DE L’ÉCONOMIE 9
B. UNE PRESSION DÉCONSTRUCTIVE EXERCÉE SUR LE DROIT DU LICENCIEMENT ÉCONOMIQUE 12
C. DES LICENCIEMENTS ÉCONOMIQUES ARBITRAIRES OU DISSIMULÉS, SOUS COUVERT DE SAUVEGARDE DE LA COMPÉTITIVITÉ ET PERMIS PAR DES CONVENTIONS DÉROGATOIRES AU DROIT DU LICENCIEMENT 14
II.- RÉHABILITER LE DROIT DU LICENCIEMENT 19
A. CONTRE L’ARBITRAIRE DES LICENCIEMENTS BOURSIERS, UNE EXIGENCE JURIDIQUE DE MOTIFS LÉGITIMES POUR TOUT LICENCIEMENT ÉCONOMIQUE 19
1. La loi doit fixer la liste des motifs de licenciement économique 19
2. La loi doit bannir les licenciements boursiers 20
3. Le juge doit pouvoir apprécier la réalité et le sérieux des motifs de licenciement allégués et sanctionner les abus 21
B. LA SUPPRESSION DES DÉROGATIONS CONVENTIONNELLES 22
Article 1er(art. L. 1233-3 du code du travail) : Motivation juridique des licenciements économiques 41
Article 2 (art. L. 1233-2 du code du travail) : Présomptions irréfragables d’absence de cause réelle et sérieuse de licenciements économiques 49
Article 3 (art. L. 1235-14 du code du travail) : Remboursement des aides publiques perçues par un employeur qui procède à des licenciements économiques sans cause réelle et sérieuse 52
Article 4 (art. L. 1235-10 du code du travail) : Causes matérielle et formelle de la nullité des procédures collectives de licenciements économiques 54
Article 5 (art. L. 1233-25 du code du travail) : Application des procédures de licenciements collectifs aux refus collectifs de modification de contrats de travail 58
Article 6 (art. L. 1222-8 du code du travail) : Application des procédures de licenciements aux refus collectifs de modification des contrats de travail, même en cas d’accord de réduction du temps de travail 59
Article 7 62
(art. L. 1237-11 à L. 1237-16, L. 1231-1 et L. 12133-3 du code du travail) : Abrogation de la rupture conventionnelle du contrat de travail 62
Article 8 (art. L. 2323-61 du code du travail) : Abrogation d’une dérogation conventionnelle aux modalités légales d’information des comités d’entreprise 63
Désormais, les entreprises licencient leurs salariés pour des raisons financières, même quand elles gagnent de l’argent et distribuent des dividendes. Les licenciements qualifiés de boursiers ont un but unique : préserver le taux de rentabilité du capital. Le grand public a découvert les conséquences dommageables, pour les salariés, de cette conception purement financière et rentière de l’économie lors de l’affaire Michelin. En 1999, la direction de ce groupe annonçait, dans le même temps, une augmentation de ses bénéfices, une distribution généreuse de dividendes et 7 500 suppressions d’emploi.
Pour justifier ces suppressions d’emplois, le groupe alléguait le risque d’une offre publique d’achat hostile. Afin de maintenir la confiance des investisseurs et d’éloigner les prédateurs financiers à la recherche d’un groupe industriel à démanteler et à vendre à l’encan, la direction de Michelin assumait une stratégie de réduction des coûts de production et de gonflement des marges, destinée à relever le cours de bourse et à empêcher les prises de participation hostiles.
Ce scénario est sans cesse repris pour justifier les restructurations des entreprises françaises. Pour celles qui ne sont pas cotées, le risque d’une acquisition hostile est remplacé par celui d’un conflit avec les banques et les créanciers de l’entreprise, pouvant conduire au défaut de trésorerie. S’ensuivent plans de restructuration, plans sociaux, plans de sauvegarde de l’emploi qui aboutissent à des fermetures de sites, à des centaines de milliers d’emplois perdus par l’économie française, principalement dans l’industrie, à des déserts économiques, privant nombre de familles de tout revenu d’activité.
Ces stratégies désastreuses, qui accompagnent l’internationalisation des grandes entreprises françaises et la délocalisation de leurs sous-traitants dans des pays à faible coût de main d’œuvre, sont source d’incompréhension et de colère. L’opinion publique attend des autorités politiques, administratives et judiciaires, qu’elles agissent pour défendre la production et les emplois. La politique suivie depuis plus de dix ans consiste au contraire à se soumettre aux injonctions patronales de dérèglementation de l’activité économique et d’alignement progressif des couts salariaux et des conditions de travail français sur le moins disant européen ou mondial, censé permettre une reprise spontanée de la croissance économique et industrielle, en dépit des signaux de plus en plus explicites d’un risque de déflation.
Cette politique est inspirée par une doctrine économique libérale qui soutient qu’une entreprise est constituée pour l’avantage exclusif des détenteurs de son capital social et qu’il n’appartient qu’à ces derniers d’apprécier les évolutions attendues de son activité. Selon cette doctrine, les gains de compétitivité doivent servir à rehausser les marges des entreprises jusqu’à des taux de rentabilité propres à attirer les fonds d’investissement internationaux. Pour atteindre des taux de rentabilité de 15 %, il faut réduire la masse salariale, par des licenciements, des suppressions de postes et des accords collectifs de réduction des salaires.
Cette doctrine ne se contente pas d’inspirer les décisions politiques qui plongent et replongent le pays dans la récession. Elle s’insinue jusqu’au cœur du droit du travail français. Pour parvenir à ses fins, elle utilise deux moyens : le démontage du droit du licenciement économique et un contournement de ce droit par des conventions dérogatoires.
Pour démonter le droit du licenciement économique, on se sert de l’argument prétorien de la sauvegarde, par anticipation, de la compétitivité des entreprises. Ces anticipations économiques hypothétiques et invérifiables autorisent les stratégies financières les plus cyniques, que le Conseil constitutionnel fait interdiction au juge du licenciement économique d’apprécier.
Le contournement du droit du licenciement économique par les conventions dérogatoires passe par une parodie de dialogue social qui masque un véritable chantage à l’emploi : la menace d’un licenciement économique ou d’une délocalisation qui permet aux employeurs d’obtenir des salariés et de leurs représentants qu’ils consentent à des baisses de salaires et à un durcissement de leurs conditions de travail.
Le débat récent sur le projet de loi relatif à la sécurisation de l’emploi illustre comment ces deux moyens s’articulent. Non seulement, par un renversement de la hiérarchie des normes, la primauté des accords majoritaires d’entreprise ou de groupe sur les dispositions protectrices du droit du travail fait voler en éclats le principe de faveur qui régissait ces dérogations conventionnelles mais, pour éviter que la jurisprudence judiciaire ne corrige cette orientation, les dernières dispositions adoptées retirent aussi au juge naturel du droit du travail le contentieux du licenciement collectif.
Il est encore temps d’opposer à cette fuite en avant dans la dérégulation une volonté déterminée de préserver l’emploi par le droit et d’arracher les entreprises à l’empire de la financiarisation, en rappelant à leurs dirigeants que l’activité économique n’a pas pour finalité la rentabilité du capital mais le bien être des producteurs, la sécurité de l’emploi et de la formation, la satisfaction des besoins des citoyens et la préservation de l’environnement. Seules ces considérations doivent guider leurs décisions stratégiques.
Plusieurs initiatives législatives ont été prises en ce sens. Une majorité de gauche avait introduit, dès juin 2001, dans le projet de loi sur la modernisation sociale, un amendement précisant la définition légale du licenciement économique pour empêcher qu’elle puisse servir de justification à des licenciements boursiers. Le Conseil constitutionnel s’est opposé à cette initiative en faisant prévaloir la liberté d’entreprise sur le droit au travail et sur l’autorité du juge du licenciement.
L’orientation libérale de la jurisprudence du Conseil a trouvé, dans les années suivantes, des relais auprès des gouvernements et des majorités successives. Le compte rendu du conseil des ministres du 17 avril 2013 dispose par exemple que « la restauration de la compétitivité perdue au cours des dix dernières années repose à la fois sur une baisse du coût du travail et sur un soutien à l’investissement productif ». La baisse du coût du travail est donc pleinement assumée par le Gouvernement actuel. Cependant, des députés et sénateurs de gauche continuent de défendre les droits des salariés et d’appeler les assemblées et les magistrats à la raison, en déposant des propositions de loi pour interdire les licenciements boursiers et l’abus des pratiques dérogatoires au droit du licenciement.
Celle qui est soumise à votre approbation poursuit les mêmes objectifs : résister à la tentation pernicieuse d’un démontage du droit du licenciement ; refuser les licenciements boursiers ; mettre un terme aux abus qu’autorisent l’allégation juridique de la sauvegarde anticipée de la compétitivité des entreprises ; abroger les dérogations conventionnelles au droit du travail qui, sous prétexte que des salariés désemparés et abandonnés y ont majoritairement consentis, les privent tous de protection juridique contre les menaces de licenciement et de délocalisation de leurs emplois.
I.- LA TENTATION D’UN DÉMONTAGE DU DROIT DU LICENCIEMENT
A. LES EFFETS SUR L’EMPLOI DE LA FINANCIARISATION DE L’ÉCONOMIE
La crise économique, provoquée par les sociétés bancaires et financières, qui frappe tout particulièrement les pays européens depuis 2008 a conduit, en France, à des destructions massives d’emplois et à une forte hausse du chômage. Comprenant que cette crise n’était pas conjoncturelle mais traduisait des modifications profondes dans les échanges internationaux et dans la répartition mondiale de la production, les entreprises françaises exposées, à la concurrence étrangère, se sont engagées dans des stratégies de réorganisation et de délocalisation de leurs activités.
Ces stratégies internationales ignorent les intérêts des populations comme des États, pour ne servir que celles de groupes financiers anonymes et transfrontières et, par leur intermédiaire, celles de rentiers sensibles aux mirages et au panurgisme de la finance internationale.
La financiarisation de l’économie mondiale a encouragé le déplacement de fonds flottants d’une entreprise à une autre, au gré des anticipations des dividendes immédiatement récupérables. Les entreprises sont réduites à des centres de profits, c’est-à-dire des points géographiques et sectoriels d’installation momentanée d’un capital flottant. Ces points sont substituables à l’échelle mondiale, au gré des mouvements de capitaux et de la manipulation, par les groupes, de l’offre et de la demande de produits manufacturés et de services.
Les substitutions mobilisent une mécanique d’allocation et de transfert de leurs capitaux fortement mathématisée, déplacent des activités ou réorientent celles de groupes économiques. Elles relèvent du choix exclusif des détenteurs du capital de groupes et d’investisseurs indifférents aux effets externes de leurs décisions sur les économies locales, les bassins d’emploi, les populations et les environnements, qui s’en tiennent à un calcul à court terme de la rentabilité de leurs investissements.
Cette course internationale effrénée à la valorisation du capital financier alimente des déséquilibres économiques régionaux que la crise révèle et accentue. Des pans entiers de l’économie productive disparaissent dans les anciens pays industrialisés au profit des pays à faible coût de main d’œuvre, nouvellement intégrés dans les circuits d’échanges internationaux. Ces transferts s’accompagnent d’un changement de l’organisation juridique des entreprises, afin de mettre en concurrence les fiscalités et les droits nationaux.
À mesure que les sociétés s’internationalisent, elles peuvent rattacher leurs profits de manière plus ou moins fictive à des sites de production exotiques, par le jeu des transferts de valeur ajoutée dans des processus d’intégration de plus en plus opaques et prétexter du même coup de la faible rentabilité de certains sites pour obtenir leur fermeture.
Les fonds d’investissement, quand ils ne placent pas à la tête des groupes productifs des dirigeants qui leur sont favorables, s’attirent les faveurs des équipes managériales par des indemnisations et des distributions d’actions, afin d’obtenir d’elles qu’elles maintiennent un taux de rentabilité d’au moins 15 %. Les directions d’entreprises doivent anticiper en permanence les variations de l’activité de leurs centres de profit afin de maintenir leurs marges et le taux de rentabilité exigé.
Soumises ou acquises d’avance aux stratégies d’optimisation financière des investisseurs, les équipes dirigeantes perdent de vue les intérêts à long terme de l’entreprise et focalisent leur attention sur des indicateurs de rentabilité de court terme. Elles entrent dans des cycles de restructurations permanentes qui visent des bénéfices d’exploitation immédiats, quitte à sacrifier l’emploi et les savoir-faire.
Pire, en période de stagnation économique, elles s’abandonnent à des stratégies malthusiennes de réduction des activités. La progression ou le maintien de la rentabilité du capital accumulé n’est plus alors le résultat d’une croissance de l’activité, portée par le développement économique et l’innovation technique, mais celui d’une captation, aux dépends de la rémunération du travail, d’une valeur ajoutée qui ne progresse plus.
Les entreprises du secteur industriel payent le plus lourd tribut à la mondialisation. Une étude de l’INSEE de 2010 évalue à 1,9 million le nombre d’emplois supprimés dans l’industrie française entre 1980 et 2007, soit un tiers des effectifs dès avant la crise. Depuis 2008, selon les chiffres publiés par le ministère du redressement productif, 400 000 postes supplémentaires ont été perdus dans un secteur industriel qui n’emploie plus que 3,2 millions de salariés fin 2012.
Ces destructions d’emplois ne concernent pas seulement les entreprises qui connaissent des difficultés mais également celles qui dégagent d’importants profits. Chaque année, des annonces de plans sociaux, faites par de grands groupes qui n’en continuent pas moins de verser des dividendes, rendent publiques ces stratégies entrepreneuriales inspirées par la recherche d’une maximisation du profit des actionnaires.
En décembre dernier, les députés membres de la commission des affaires sociales ont pu découvrir en détail le mécanisme de ces restructurations et leurs conséquences sur l’emploi en France lors de l’audition des coordonnateurs syndicaux de Sanofi. Cette société avait réalisé 33 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2011 et dégagé près de 9 milliards d’euros de bénéfices, reversant la moitié de cette somme, soit l’équivalent de sa masse salariale en France, à ses actionnaires. Le 5 juillet 2012, sa direction annonçait un plan de restructuration de ses activités de recherche, dit plan Transforming. Ce plan prévoit des centaines de suppressions de postes, en particulier dans la recherche, alors même que l’entreprise avait bénéficié de 126 millions de crédits d’impôt recherche.
La direction de l’entreprise, entendue par la commission, justifie sa stratégie par la défense de la compétitivité des unités industrielles du groupe. Selon M. Christian Lajoux, président de Sanofi-Aventis France, « 97 % des vaccins produits en France sont destinés aux marchés étrangers. Or, les prix pratiqués sur les marchés émergents, où se trouve le potentiel de croissance de nos ventes de vaccins, sont très bas, et les marges s'en trouvent sensiblement dégradées. Certains produits sont même vendus par nos concurrents – qu'ils soient européens ou provenant de pays émergents – à des prix proches de nos coûts de revient industriels. » Il condamne ainsi implicitement ses sites de production à la fermeture, sauf à abaisser leurs coûts de production pour restaurer les marges.
L’argument des coûts de production, et plus particulièrement le coût d’un salarié français, est ainsi toujours mis en avant. Dès avant la crise financière, les cas analogues de Michelin, en 1999, ou de Lu-Danone en 2001, avaient révélé la manière dont l’argument de la défense de la compétitivité ne sert pas tant à surmonter des difficultés de production ou de commercialisation d’un produit, du fait de changements technologiques ou d’une réorientation de la demande vers des produits concurrents, qu’à optimiser, au niveau mondial, la répartition des sites de production en fonction des variations de change monétaire, d’écarts de coûts salariaux ou de législation sociale, fiscale ou environnementale.
Ces arbitrages n’ont fait que s’accentuer depuis le début de la crise puisque les entreprises anticipent un ralentissement prolongé voire une stagnation des économies européennes, qui se révèlent les plus affectées par cette crise née aux États-Unis. Ils ne concernent plus seulement les grands groupes industriels mais aussi de très nombreuses entreprises de taille moyenne, séduites par le modèle d’optimisation à l’échelle mondiale qu’offrent les plus grandes, quand elles ne sont pas emportées par les conséquences des décisions de ces donneurs d’ordres sur leurs sous-traitants.
Les salariés européens, qui ont vu leurs revenus stagner, quand ils n’ont pas été emportés par la hausse vertigineuse du chômage due aux récessions successives engendrées par la crise financière, sont encore les principales victimes de ces stratégies d’optimisation de la rentabilité des entreprises. À mesure que l’appareil économique et surtout industriel de leur pays se dégrade, la pression s’accroît pour supprimer méticuleusement les acquis sociaux obtenus de haute lutte au cours de la longue période de croissance qui a suivi la seconde guerre mondiale, en baissant les niveaux de revenus et de protection sociale et juridique, dans une logique d’alignement sur le moins disant social au niveau européen voire mondial, sous la menace de délocalisations des activités de production les plus mobiles.
C’est par la mobilisation des travailleurs des sites sacrifiés que l’opinion publique prend conscience des conséquences économiques et sociales de ces évolutions. Aux contestations légitimes élevées par les opinions publiques, principalement en Europe, contre ces stratégies capitalistiques destructrices, un argument lancinant est systématiquement opposé : celui de la sauvegarde de la compétitivité qui sert de justification à une déconstruction méthodique du droit du travail et en particulier du droit du licenciement économique, considéré comme un obstacle aux restructurations des entreprises exigées par les rentiers.
B. UNE PRESSION DÉCONSTRUCTIVE EXERCÉE SUR LE DROIT DU LICENCIEMENT ÉCONOMIQUE
Le modèle économique américain, structuré par les doctrines et les thèses libérales et capitalistes, domine la mondialisation des échanges et l’internationalisation des entreprises. Ce modèle exige une mobilité géographique et professionnelle des salariés impraticable en Europe. Cette mobilité correspond à un marché du travail unitaire et flexible. Elle se traduit, en droit, par l’absence de formalités d’embauche et de licenciement des salariés. C’est ce modèle qui est présenté aux populations européennes comme la solution au chômage endémique qui les frappe depuis plus de trente ans.
Mais à défaut de pouvoir déplacer les populations des régions économiques déshéritées vers des zones plus heureuses et d’abolir les frontières administratives, linguistiques et culturelles des pays européens, les tenants de cette solution farfelue s’en prennent au principal obstacle à l’adoption du modèle américain : le droit continental du travail, patiemment élaboré depuis un siècle et demi en Europe par la politique et la législation sociales, la jurisprudence, la négociation collective et avant tout par les luttes sociales.
Les promoteurs des stratégies d’internationalisation des entreprises, qui s’inspirent des exemples de législation du travail qui leur sont favorables et en particulier du droit américain pour réclamer des infléchissements du droit français du travail, confortent la doctrine de la maximisation de la valeur actionnariale anticipée, sans aucune considération pour les autres intérêts sociaux de l’entreprise.
Or, le droit français du licenciement repose sur des principes très différents de ceux du droit américain, en particulier en matière de rupture unilatérale du contrat de travail par un licenciement économique. La subordination et la possibilité d’une rupture unilatérale sans faute, caractéristiques du contrat de travail, heurtent les principes généraux du droit des contrats. Ils manifestent une inégalité des parties au contrat de travail que le droit américain ignore. L’employeur a, en particulier, la faculté de rompre un contrat de travail à durée indéterminé par une décision de licenciement économique, non seulement en l’absence d’une faute commise par le salarié mais parfois en raison même d’une faute de gestion ou à tout le moins d’une incapacité de cet employeur à anticiper favorablement les événements économiques susceptibles d’affecter l’exécution du contrat.
Cette inégalité dans la relation d’emploi est compensée, en droit français, par trois obligations imposées à l’employeur qui souhaite licencier des salariés pour des raisons économiques : l’obligation de motiver le licenciement par l’exposé d’une cause réelle et sérieuse, l’obligation, en cas de licenciements collectifs, de se soumettre à une procédure permettant de prévenir ces licenciements et d’inciter les entreprises à adopter des mesures préventives de formation et de reclassement des salariés dont les postes de travail sont menacés et l’obligation, en cas de licenciement économique jugé irrégulier, de reprendre ou d’indemniser le salarié injustement licencié.
Les tenants de l’ultra-libéralisme dominant nient cette inégalité dans la relation du travail. Leur doctrine, que la France avait déjà expérimentée au XIXe siècle, sous l’influence du droit britannique, jusqu’à ce que cent ans de luttes sociales parviennent à rétablir l’équilibre entre les droits des travailleurs et ceux des propriétaires qui exploitent leur force de travail, s’est à nouveau insinuée, par le biais de l’Union européenne, qui fait sienne les thèses et la doctrine libérale, en profitant des crises économiques et de la fascination exercée par le modèle économique américain.
Après l’abrogation, en 1986, de l’autorisation administrative de licenciement établie en 1975, le juge judiciaire et les conseils de prud’hommes ont su tirer du droit du travail une interprétation favorable aux salariés et au maintien de l’emploi, tout en ménageant l’autonomie de décision des directions d’entreprise, et plus encore les différents intérêts qui composent l’objet social de l’entreprise.. La jurisprudence a été désorientée par des lois contradictoires qui ont laissé les magistrats en première ligne face aux revendications des entreprises et aux dégradations de la situation des salariés. Ces législations révèlent tantôt l’échec des élus et des Gouvernements à influencer dans une perspective sociale la politique économique des entreprises, tantôt une volonté délibérée de faciliter des stratégies économiques délétères.
En désespoir de cause, c’est au juge que les salariés s’adressent pour apprécier la légitimité des mesures drastiques qui leur sont imposées par les plans sociaux et les plans dits de sauvegarde de l’emploi ou pour obtenir une indemnisation des dommages qu’entraîne leur licenciement.
Mais les protections juridiques auparavant efficaces contre les abus du droit du licenciement économique, sur un marché national soumis à une seule autorité judiciaire, deviennent inopérantes quand les entreprises leur opposent d’une part des anticipations d’activité et de rentabilité établies au plan mondial, selon des schémas de répartition des marges et des coûts de production invérifiables par les juges et, d’autre part, des revendications à plus de flexibilité portées par des inégalités de situations criantes de conditions sociales, de travail et de rémunération de leurs salariés d’un pays à l’autre.
Prenant conscience de la situation nouvelle créée par la financiarisation et l’internationalisation des stratégies d’entreprise, le juge judiciaire a hésité sur l’attitude à adopter, les partisans d’une défense résolue du droit social et des droits des salariés, prêts à examiner en détail les motifs économiques allégués par les employeurs pour licencier leurs salariés, étant retenus par une jurisprudence plus prudente de la Cour de cassation.
Désavouée par les décisions du Conseil constitutionnel, qui soutiennent, parfois aveuglément, parfois de manière ambiguë, la libre disposition de l’entreprise par les propriétaires de son capital pour interdire aux juges d’apprécier la stratégie de leurs dirigeants, alors même qu’elle nuit à l’emploi et aux salariés, les juges judiciaires, qui restait dans l’ensemble attentive aux intérêts sociaux de l’entreprise au-delà de la seule maximisation du profit, viennent finalement d’être en partie dépouillés du contentieux du licenciement collectif par le projet de loi relatif à la sécurisation de l’emploi, adopté par l’Assemblée nationale le 24 avril dernier.
Rétrospectivement, l’ajout d’un motif prétorien de licenciement économique, inspiré par la notion économique de compétitivité, à la liste légale des causes de licenciements, apparaît comme une initiative maladroite pour intégrer les anticipations économiques dans l’appréciation des motifs de licenciement, dont les usages abusifs ont rapidement révélé les faiblesses juridiques.
Cette initiative fut moins malheureuse cependant que celles du législateur qui, se prenant à vouloir réduire le coût du travail et déréguler le licenciement économique, a introduit dans le code du travail des dérogations conventionnelles au droit du licenciement économique, particulièrement défavorables aux salariés, en particulier à ceux qui n’y ont pas consenti et qui se voient reprocher comme une faute leur refus d’accepter l’application de clauses dérogatoires à leur contrat de travail.
C. DES LICENCIEMENTS ÉCONOMIQUES ARBITRAIRES OU DISSIMULÉS, SOUS COUVERT DE SAUVEGARDE DE LA COMPÉTITIVITÉ ET PERMIS PAR DES CONVENTIONS DÉROGATOIRES AU DROIT DU LICENCIEMENT
En contrepartie de la faculté de licencier les salariés, sans faute de leur part, le droit du travail impose à l’employeur l’obligation de motiver sa décision de licenciement par une cause réelle et sérieuse qu’il appartient ensuite au juge naturel du licenciement de vérifier. Comment faire admettre, en droit, un licenciement économique qui n’a d’autre cause que le maintien du taux de rentabilité du capital, en d’autres termes un licenciement boursier ? Voilà le problème posé aux tenants de la doctrine libérale par le droit du travail français.
Un premier artifice juridique avait été trouvé dans un motif de licenciement ajouté par la jurisprudence aux deux motifs légaux mentionnés à l’article L. 1233-3 du code du travail. Cet article cite, comme causes licites de licenciement, l’adaptation de l’entreprise à des difficultés immédiates ou à des mutations technologiques.
La jurisprudence judiciaire a ajouté d’autres motifs, la cessation d’activité et surtout la réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise. Cette cause de licenciement, apparue en 1992, a rapidement donné lieu à des allégations abusives de la part de groupes intégrant plusieurs entreprises, qui ont joué des écarts de coûts de production entre des établissements situés dans des pays différents, dans un contexte de concurrence internationale, pour délocaliser ou supprimer des activités. L’utilisation du prétexte de défaut de compétitivité a dépassé toute mesure lorsque les entreprises ont commencé à justifier leurs projets de licenciements par des anticipations de conjonctures et de mutations technologiques.
La justification des licenciements boursiers était alors toute trouvée. Puisque le cours de bourse et plus généralement la valeur du capital des entreprises ne sont pas déterminés principalement par les bénéfices réalisés mais par ceux qui sont anticipés, il devenait possible de justifier des mesures de licenciement économique par une prédiction de moindres profits à venir. Le droit du licenciement économique s’est retrouvé confronté à une ultima ratio, tirée d’une notion de compétitivité empruntée à une théorie mercantile, notion purement prospective, instable et obscure, qui s’accorde bien mal avec l’exigence juridique d’une motivation réelle et sérieuse des licenciements.
C’est le Conseil constitutionnel qui a soutenu cette interprétation très extensive du motif prétorien de sauvegarde de la compétitivité et entraîné la Cour de cassation dans son sillage. Il l’a fait en 2002, en opposition radicale avec le législateur qui venait d’adopter une première mesure visant à limiter les licenciements boursiers et l’abus des motivations prétoriennes de ces licenciements. Mais il l’a fait dans des termes ambigus qui faisaient valoir la défense de l’emploi et la nécessité de limiter licenciements en prenant des mesures anticipées d’adaptation des entreprises.
Le Conseil constitutionnel a cru pouvoir, tout à la fois et sans préjudice pour la cohérence du raisonnement par lequel il prétendait justifier sa décision, invoquer le droit de chacun d’obtenir un emploi établi par le préambule de la Constitution de 1946, confirmer que la création et le maintien d’emplois salariés relèvent de l’objet social d’une entreprise et faire prévaloir l’intérêt des propriétaires du capital, relayé par le chef d’entreprise, au point de justifier des stratégies de licenciement par des pures anticipations économiques, qui ouvrent plusieurs scénarios d’adaptation de l’entreprise, parmi lesquelles la direction arbitre en fonction des intérêts que chaque scénario maximise, tout en interdisant au juge d’apprécier le bien-fondé de ce choix.
Soit les licenciements doivent être motivés par une cause réelle et sérieuse comme le prévoit le code du travail et le juge doit pouvoir évaluer la réalité et le sérieux des causes qui allèguent des contraintes futures. Soit l’exigence de motivation est purement formelle et l’allégation d’une sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise suffit à justifier un licenciement sans contestation possible. Choisir, comme l’a fait le Conseil, la seconde option, c’est consacrer une justification arbitraire des licenciements qui prive de force juridique l’obligation de les motiver et qui évoque le bon plaisir couvrant une raison inavouable, le Conseil allant jusqu’à suggérer que l’employeur choisirait spontanément le scénario le plus favorable au maintien de l’emploi, à condition de ne pas y être contraint en droit.
Cette atteinte portée au droit du licenciement économique a, depuis lors, été largement surpassée par les initiatives du législateur, mal inspiré par deux accords nationaux interprofessionnels, celui du 11 janvier 2008, transposé par la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 et celui du 11 janvier 2013, en cours de transposition par le projet de loi dit de sécurisation de l’emploi.
Pour tourner la résistance opposée par les magistrats, saisis des projets de licenciements économiques collectifs, aux abus tirés de leurs motifs les plus arbitraires, le législateur a codifié deux innovations juridiques rompant avec les principes du droit du travail français, celle de la rupture conventionnelle d’un contrat de travail et celle de conventions dérogatoires au droit commun du licenciement.
Le premier procédé consiste tout bonnement à nier, à la mode américaine, l’inégalité caractéristique des relations d’emploi, en substituant à la procédure unilatérale de licenciement une convention de rupture du contrat de travail. Ce procédé sauve les apparences puisque le législateur ne modifie pas la partie du code du travail relative au droit du licenciement. Il se contente d’ouvrir une voie alternative au licenciement, entièrement contraire aux principes du droit du travail, mais particulièrement efficace.
Comme espéré, cette procédure a permis de ramener le nombre des licenciements économiques à un étiage de 14 000 par mois, comparable à celui observé en 2007 et inférieur de moitié au nombre de licenciements économiques enregistrés en 2009, au plus fort de la crise. En contrepartie, le nombre des ruptures conventionnelles n’a cessé de progresser, passant de 16 000 par mois au premier semestre 2009 à près de 32 000 au second semestre 2012. Il est très improbable que les ruptures conventionnelles se substituent à des démissions qui ne seraient pas souhaitées par l’employeur, puisque ce dernier n’aurait aucune raison de les indemniser.
C’est donc un substitut soit à un licenciement pour faute personnelle, soit à un licenciement économique. En introduisant, dans le code du travail, une procédure de rupture du contrat de travail contraire aux principes du licenciement, le législateur est parvenu à ses fins, à la grande satisfaction des tenants de la doctrine libérale : supprimer les garanties offertes aux salariées par ces procédures et faciliter les licenciements économiques.
Il ne s’agit plus que de convaincre le salarié, dont l’emploi est menacé par les projets de restructuration de l’entreprise, d’accepter de partir de lui-même, en contrepartie d’une indemnité immédiate, équivalente à celle versée lors d’un licenciement économique régulier, sachant qu’il pourra bénéficier de l’assurance chômage. L’employeur peut alors gagner du temps dans la réorganisation de ses activités et de ses postes de travail, en s’exonérant des obligations d’études, d’information et de consultation prévues par les procédures de licenciement. Il peut aussi espérer que ce licenciement déguisé, accepté par le salarié, ne sera pas contesté en justice et qu’il n’aura pas à verser les indemnités compensatoires prévues en cas de licenciement jugé irrégulier.
Cette pratique était auparavant en usage pour les cadres qui ne voulaient pas compromettre la suite de leur carrière après un licenciement économique vécu comme un indicent de parcours, en traînant leur précédent employeur en justice. Elle s’est généralisée auprès de tous les salariés que la perspective de plusieurs mois voire plusieurs années de procédure, même devant le conseil des prud’hommes, dissuade de porter en justice leur licenciement, surtout quand ils ne sont pas soutenus par un collectif qui les accompagne dans leurs démarches.
Ce n’est souvent qu’après leur départ, lorsque les indemnités de rupture et de chômage sont épuisées, qu’ils regrettent de n’avoir pas lutté contre les intentions de leur employeur, alors qu’il n’est plus temps d’ester en justice.
Particulièrement pernicieuse, la procédure de rupture conventionnelle se pare des atours du consentement mutuel de parties égales s’accordant sur les termes d’une convention mutuellement avantageuse. En réalité, cette procédure soumet individuellement des salariés désemparés à l’iniquité d’un rapport de force économique et financier qui leur est particulièrement défavorable en période de crise économique, de chômage de masse et d’impuissance des pouvoirs publics à maîtriser la financiarisation des stratégies d’entreprises et l’internationalisation de leur forme juridique. Le droit du travail, par cette procédure inique, est repassé du côté du plus fort.
La chambre sociale de la Cour de cassation a bien essayé de limiter les licenciements économiques déguisés et le détournement à cette fin des ruptures conventionnelles, sur le fondement de l’article L. 1237-16 du code du travail, qui exclut que les ruptures de contrats de travail résultant des accords collectifs de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, d’une part, et des plans de sauvegarde de l'emploi, de l’autre, puissent donner lieu à des conventions individuelles afin de préserver les apparences de la démocratie sociale et les formes des procédures de licenciement collectif.
La chambre n’a ainsi pas hésité, dans un arrêt du 9 mars 2011, à requalifier en licenciement économique collectif une série de ruptures conventionnelles ayant une cause économique et s'inscrivant dans un processus de réduction des effectifs. Mais ce contrôle prétorien se heurte aux mêmes limites que celui de la réalité et du sérieux des motifs de licenciement allégués et en particulier à l’impossibilité, pour les juges, d’apprécier les stratégies d’anticipation des entreprises prétendant agir pour la sauvegarde de leur compétitivité.
Les chiffres des ruptures conventionnelles parlent d’eux-mêmes. Le taux de refus d’homologation des conventions par l’administration, à laquelle elles sont obligatoirement soumises, n’est que de 6 à 8 %. La progression du nombre de ruptures homologuées a suivi une courbe inverse de celle des licenciements économiques. Les recensements qualitatifs des intentions des parties ne laissent pourtant pas de doute : ces ruptures sont des licenciements déguisés.
Comme si ces coups portés au droit du licenciement ne suffisaient pas, comme si le rapport de force n’était pas déjà suffisamment défavorable aux salariés, le législateur ajoute encore un second procédé de contournement des garanties offertes, par le code du travail, aux salariés licenciés pour motif économique, en autorisant que des conventions collectives, souvent nommées accords de méthode, dispensent leurs employeurs des formalités d’information et de consultation des représentants des salariés ou des comités d’entreprise prévues par le droit du licenciement collectif.
Ces conventions, comme les accords de réduction du temps de travail, tiennent lieu de loi à ceux qui n’y ont pas consenti par la voie de leurs représentants, puisqu’elles bénéficient des privilèges et de l’autorité de la puissance publique. Admises auparavant, par voie d’extension réglementaire, au cas par cas, lorsqu’elles étaient plus favorables aux tiers que le droit commun, elles s’imposent désormais par le seul fait majoritaire et peuvent être dommageables à des salariés minoritaires, que la loi va jusqu’à priver de recours judiciaire.
Contre ces atteintes successives portées, par des licenciements boursiers, arbitraires ou déguisés et par des dérogations conventionnelles, aux droits des salariés au maintien de leur emploi et aux garanties offertes par les procédures de licenciement économique, il est urgent de remettre le droit au service de la justice sociale, de rétablir, dans la loi, les principes juridiques de cette justice et de soumettre à leur autorité les conventions iniques qui prétendent y déroger.
II.- RÉHABILITER LE DROIT DU LICENCIEMENT
L’abandon des populations européennes aux ravages de la mondialisation financière n’est pas une fatalité. Il ne tient qu’à la puissance publique de réagir et à la représentation nationale de se saisir à nouveau de cette question. Les premières tentatives de mettre un terme aux abus des licenciements boursiers se sont heurtées à la jurisprudence du Conseil constitutionnel en 2000 et en 2002. Depuis, la crise économique l’aura peut-être ramené à une plus juste appréciation des circonstances. Il est encore temps de rétablir l’autorité de la loi sur les stratégies entrepreneuriales, en commençant par fixer, dans le code du travail, les motifs admissibles et inadmissibles de licenciement économique puis en confiant à leur juge naturel le soin de faire respecter l’obligation de motivation de ces licenciements.
A. CONTRE L’ARBITRAIRE DES LICENCIEMENTS BOURSIERS, UNE EXIGENCE JURIDIQUE DE MOTIFS LÉGITIMES POUR TOUT LICENCIEMENT ÉCONOMIQUE
1. La loi doit fixer la liste des motifs de licenciement économique
Les licenciements boursiers sont défendus par l’allégation d’une nécessaire adaptation des entreprises à des contraintes économiques anticipées, hypothétiques et invérifiables. Cette allégation se fonde sur une faiblesse rédactionnelle de l’article L. 1233-3 du code du travail qui définit le licenciement économique et les motifs qui peuvent le justifier en droit. Cette faiblesse doit être corrigée. La loi doit poser une liste exhaustive et indiscutable de motifs légitimes.
Trois motifs sont suffisants : la cessation d’activité, les difficultés économiques et les mutations technologiques. Le premier reprend un motif prétorien. Les deux autres sont ceux qui figurent déjà dans le texte de l’article L. 1233-3 du code. Les difficultés et les mutations sont incontestables lorsqu’elles sont immédiates et attestées par des pièces comptables, par des constats partagés et par des éléments d’information qu’il appartient à l’employeur de porter à la connaissance du juge en cas de contestation.
Elles ne sauraient être anticipées qu’à condition d’apporter une preuve de réalité suffisante, manifestant l’existence d’une menace pour la pérennité de l’entreprise qui exige des mesures d’adaptation préventives, preuve qui doit être soumise à l’appréciation éclairée des représentants des personnels menacés de perdre de leur emploi, à celle des comités d’entreprise et, en dernier ressort, à celle du juge du licenciement.
Le principal argument opposé à l’adoption d’une telle liste est le risque de voir les entreprises adopter des solutions juridiques leur permettant d’échapper aux procédures et aux contrôles des licenciements économiques, en recourant à la sous-traitance au lieu du salariat, en soumettant leurs contrats de travail à un droit étranger ou en se divisant juridiquement en petites sociétés mises en cessation d’activité en cas d’anticipation de difficultés ou mutations. Le dépôt de bilan autorise en effet le juge commissaire du tribunal de commerce à licencier par ordonnance les salariés sans contrôle de la réalité et du sérieux du motif de ces licenciements.
Cet argument est pour le moins fragile. La requalification, par le juge, des contrats de sous-traitance douteux en contrat de travail de droit français ne fait pas difficulté. La sanction pénale des faillites frauduleuses, des abus et des détournements de biens sociaux peuvent empêcher les détournements de la procédure de cessation d’activité, à condition que les dirigeants qui s’en rendent responsables soient sous la main de la justice française. A défaut, la sanction de l’irrégularité des licenciements peut être imputée à une faute ou bien la légèreté blâmable des dirigeants de ces sociétés.
La jurisprudence reste sur ce dernier point encore incertaine. La doctrine tirée de l’arrêt Brinon de la chambre sociale de la Cour de cassation du 31 mai 1956, selon lequel « l’employeur qui porte la responsabilité de l’entreprise est seul juge des circonstances qui le déterminent à cesser son exploitation et aucune disposition ne lui fait l’obligation de maintenir l’activité à la seule fin d’assurer à son personnel la stabilité de son emploi, pourvu qu’il observe, à l’égard de ceux qu’il emploie, les règles édictées par le code du travail » est désormais contestée par des juges du fond, comme ceux de la cour d’appel de Lyon qui ont rendu, le 30 juin 2003, un arrêt condamnant la délocalisation d’une entreprise aux Philippines, en exigeant que la cessation d’activité soit motivée par des contraintes comparables à celles qui justifient un licenciement économique.
2. La loi doit bannir les licenciements boursiers
Hésitante devant les conséquences, pour l’économie et la société, d’une déréglementation complète du droit du licenciement, la jurisprudence attend du législateur des orientations. Non seulement la loi doit fixer clairement les motifs admissibles de licenciements économiques mais elle doit aussi guider les juges dans leur appréciation des difficultés que rencontrent les entreprises et dans la vérification des motifs qu’elles allèguent pour surmonter ces difficultés, lorsqu’il s’agit de suppressions d’emploi et non de mesures de formation et de reclassement des salariés.
C’est pourquoi, en complément de la liste des motifs de licenciement économique, la loi doit poser des présomptions irréfragables d’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement qui repèrent, isolent et sanctionnent comme abusives, des justifications de difficultés ou de mutations fallacieuses, démenties par des éléments comptables ou financiers objectifs.
Une entreprise qui fait des bénéfices et qui a les moyens de distribuer des dividendes ou des stock-options n’a pas de motifs de licencier pour des raisons économiques et a les moyens d’adapter, par la formation et le reclassement, les postes de travail de ses salariés à ses orientations stratégiques.
3. Le juge doit pouvoir apprécier la réalité et le sérieux des motifs de licenciement allégués et sanctionner les abus
La jurisprudence du Conseil constitutionnel a dépassé celle de la Cour de cassation en faisant défense au juge du licenciement de « substituer son appréciation à celle du chef d'entreprise quant au choix entre les différentes solutions possibles » pour adapter l’entreprise non seulement aux difficultés économiques qu’elle rencontre, mais aussi à celles qu’elle prétend anticiper.
Cette interdiction, inhabituelle en droit, tiendrait à l’incapacité du juge du contrat de travail à apprécier la situation économique d’une entreprise, en raison de son incompétence supposée en la matière, de la volonté de préserver le secret des affaires ou, plus vraisemblablement, de la crainte que les injonctions du juge adressées au chef d’entreprise restent lettre morte et nuisent à l’autorité de la chose jugée.
Cette prudence devient excessive lorsque les emplois des salariés et donc les intérêts sociaux de l’entreprise sont en jeu et aux prises avec l’intérêt exclusivement financier qui accaparent toujours davantage l’attention des dirigeants d’entreprise. Elle se justifie encore moins lorsque le secret de la délibération des stratégies d’entreprises cède la place aux mesures de publicité exigées par le droit boursier, en vue de leur appréciation par les experts et les agences de notation, afin d’orienter en toute connaissance de cause les choix des investisseurs. Sur ce point, la financiarisation de l’économie se retourne non plus contre les seuls salariés mais aussi contre l’ancienne souveraineté des dirigeants d’entreprise.
La doctrine libérale elle-même n’admet pas que le secret des affaires fasse obstacle à la délibération publique des stratégies entrepreneuriales, afin d’atteindre l’optimum économique dans l’allocation des capitaux. Le droit du travail qu’elle influence et qui s’entiche de prévisions économiques, sait désormais enjoindre aux entreprises de dresser des plans de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ou de sauvegarde de l’emploi. Le Conseil constitutionnel reconnaît lui-même que l’employeur peut anticiper des licenciements et prendre des dispositions pour en limiter le nombre.
Puisque des plans sont dressés, des scénarios d’adaptation établis qui sont destinés à l’information des investisseurs, ils peuvent aussi bien être portés à la connaissance des salariés, de leurs représentants et des comités d’entreprise, aux fins d’examen contradictoire et de négociation, comme ensuite à la connaissance du juge. Puisque le Conseil constitutionnel reconnaît lui-même que, parmi ces scénarios, il est à la portée de l’employeur de choisir le plus favorable à l’emploi, puisque c’est aussi de sa responsabilité, rien ne s’oppose à ce que le juge vérifie que ce critère objectif de choix a bien été respecté.
Afin de permettre au juge d’apprécier les motifs des plans de licenciement économique en examinant les scénarios alternatifs établis par l’employeur et négociés avec les représentants des salariés, la proposition de loi soumise à votre approbation prévoit que l’employeur justifie de manière précise l’ensemble des mesures prises afin de limiter les suppressions d’emplois ainsi que le respect de ses obligations de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.
Elle prévoit aussi que la consultation et l’information des salariés et de leurs représentants sur ses projets soit loyale, sincère et utile, de telle sorte que toutes les alternatives économiques envisageables pour l’adaptation de l’entreprise à des difficultés soient exposées, discutées au besoin avec l’aide d’experts payés par le comité d’entreprise et négociées. Ce sont les termes de ces négociations qui indiqueront au juge si le critère de moindre suppression d’emplois à bien prévalu sur celui de rentabilité maximale du capital dans l’arbitrage de l’employeur.
Pour que la réhabilitation du droit du licenciement économique soit effective, il ne suffit pas d’en rétablir les principes dans le code du travail, il faut encore que les abus de ce droit et l’irrégularité des procédures collectives de licenciement soient plus sévèrement sanctionnés, en particulier pour les entreprises qui ont bénéficié d’aides publiques au maintien de l’emploi.
Ces entreprises qui licencient abusivement des salariés alors qu’elles ont bénéficié d’exonérations ou de réduction de cotisations sociales et de crédits d’impôts pour maintenir leurs emplois doivent être condamnées à rembourser les aides qu’elles ont reçues. La sanction la plus sévère, à savoir, la nullité des procédures de licenciement économique, déjà prévue pour des irrégularités de forme, doit être a fortiori prononcée en l’absence de motif légitime de licenciement, comme l’a suggéré la cour d’appel de Paris dans son récent arrêt Viveo France.
B. LA SUPPRESSION DES DÉROGATIONS CONVENTIONNELLES
Il serait illusoire de conforter le droit du licenciement économique si l’on laissait substituer dans le code les procédures alternatives qui permettent de le contourner, par des conventions qui dérogent à ses dispositions et aux garanties qu’il accorde aux salariés. Ces conventions léonines, moins favorables que les garanties légales de droit commun, auxquelles le législateur abandonne les salariés depuis une dizaine d’années ne sont pas seulement une incongruité juridique.
Elles témoignent surtout du désarroi et de l’égarement d’une puissance publique qui ne parvient plus à imposer des principes et des règles à une économie qui échappe à son autorité. Le législateur se défausse sur les partenaires sociaux, en feignant d’oublier l’inégalité de leurs positions dans les négociations menées en pleine crise, sous la menace des délocalisations et sous la pression d’un chômage de masse.
Il faut marquer un coup d’arrêt au démontage légal et pseudo-conventionnel du droit du travail, en réhabilitant ses principes fondateurs, en particulier ceux qui n’admettent de rupture du contrat à l’initiative de l’employeur que par la voie d’un licenciement, encadré par des procédures qui garantissent les droits des salariés et qui protègent leurs emplois, en particulier dans les situations économiques difficiles et face à des employeurs irresponsables.
La présente proposition de loi abroge la rupture conventionnelle du contrat de travail ainsi que l’accord de méthode qui exonère les entreprises de plus de 300 salariés des procédures d’information et de consultation du comité d’entreprise. Elle étend la protection du droit du licenciement économique aux salariés qui ont moins de deux ans d’ancienneté dans l’entreprise et à ceux qui sont employés dans des entreprises de moins de onze salariés. Elle donne le caractère de licenciement économique à des licenciements prononcés à la suite du refus de plusieurs salariés d’accepter une modification de leur contrat de travail, même et en particulier pour conformer ce contrat à un accord de réduction du temps de travail.
La Commission examine, sur le rapport de M. André Chassaigne, la proposition de loi de M. André Chassaigne et plusieurs de ses collègues tendant à interdire les licenciements boursiers et les suppressions d’emplois abusives (n° 869).
M. Jean-Patrick Gille, président. Je rappelle que le groupe GDR a inscrit cette proposition de loi à l’ordre du jour de sa niche parlementaire du 16 mai prochain.
M. André Chassaigne, rapporteur. Désormais, les entreprises licencient leurs salariés pour des raisons financières, même lorsqu’elles réalisent des bénéfices et distribuent des dividendes. La préservation du taux de rentabilité du capital constitue l’unique objectif de tels licenciements, dits boursiers. Le grand public a découvert les conséquences néfastes pour les salariés de cette conception purement financière et rentière de l’économie en 1999, avec l’affaire Michelin : la direction du groupe avait annoncé, dans le même temps, une augmentation de ses bénéfices, une distribution de dividendes généreux à ses actionnaires et la suppression de 7 500 emplois. Pour justifier ces suppressions, elle avait allégué un risque d’offre publique d’achat hostile sur les titres du groupe. Dès le lendemain, le cours de bourse de l’entreprise avait fait un bond de 12 %. Le même scénario a été rejoué par la suite par Air France, Valeo, Pétroplus, Continental, Carrefour, Unilever, Arcelor, E.ON France, PSA, Sanofi, Renault, Goodyear, et j’en passe.
Afin de maintenir la confiance des investisseurs et d’éloigner les prédateurs financiers qui recherchent un groupe fragile pour le démanteler et le vendre à l’encan, les directions des grands groupes assument une stratégie de réduction des coûts de production et de gonflement des marges, destinée uniquement à relever le cours de bourse et à empêcher les prises de participation hostiles. S’ensuivent plans de restructuration, plans sociaux et plans de sauvegarde de l’emploi, qui aboutissent à des fermetures de sites, à la perte de centaines de milliers d’emplois pour l’économie française, principalement dans l’industrie, et à la formation de déserts économiques, de nombreuses familles se trouvant privées de tout revenu d’activité.
Ces stratégies désastreuses, qui accompagnent l’internationalisation des grandes entreprises françaises et la délocalisation de leurs sous-traitants dans des pays à bas coûts salariaux, suscitent incompréhension et colère. L’opinion publique attend que les autorités politiques, administratives et judiciaires agissent pour défendre la production et les emplois. Au lieu de cela, la politique suivie depuis plus de dix ans consiste à s’en remettre au fol espoir d’une reprise spontanée de la croissance industrielle, qui serait favorisée par un alignement progressif des coûts salariaux français sur le moins-disant à l’échelle mondiale.
Le compte rendu du conseil des ministres du 17 avril dernier indique que « la restauration de la compétitivité perdue au cours des dix dernières années repose à la fois sur une baisse du coût du travail et sur un soutien à l’investissement productif ». Vous avez bien entendu, mes chers collègues : l’objectif du Gouvernement est de baisser les salaires ! La compétitivité, toujours la compétitivité, telle est, selon lui, la formule miracle.
En baissant les salaires – je n’évoque même pas le caractère injuste d’une telle mesure sur le plan social –, le Gouvernement risque de plonger l’économie tout entière dans la déflation. Il semble d’ailleurs assumer ce risque. Mais il ne fait là qu’appliquer la théorie économique libérale, en vertu de laquelle une baisse des salaires doit faire spontanément disparaître le chômage et, surtout, permettre aux entreprises de rétablir leurs marges et d’atteindre des taux de rentabilité propres à attirer les fonds d’investissement internationaux. Selon cette doctrine, une entreprise est constituée pour l’avantage exclusif des détenteurs de son capital social et il appartient exclusivement à ceux-ci d’apprécier les évolutions attendues de son activité.
Ce dogme non seulement inspire les décisions politiques qui, les unes s’ajoutant aux autres, plongent le pays dans la récession, mais s’insinue également au cœur du droit du travail français. Pour parvenir à leurs fins, les tenants de cette doctrine utilisent deux moyens : ils démontent le droit du licenciement économique, d’une part, et permettent son contournement par des conventions dérogatoires, d’autre part.
L’argument d’autorité invoqué pour démonter le droit du licenciement économique est celui de la sauvegarde, par anticipation, de la compétitivité des entreprises. Ce raisonnement, fondé sur des anticipations économiques hypothétiques et invérifiables, autorise les stratégies financières les plus cyniques, qu’il est interdit au juge du licenciement économique d’apprécier, en vertu de la jurisprudence du Conseil constitutionnel.
Quant au contournement du droit du licenciement économique par les conventions dérogatoires, il passe par une parodie du dialogue social. Sous couvert d’un tel dialogue, les employeurs exercent un chantage au licenciement économique ou à la délocalisation et obtiennent que les salariés les moins combatifs, sinon les plus fragiles, ou leurs représentants consentent à des baisses de salaires et à un durcissement de leurs conditions de travail. Cependant, selon le code civil, les conventions conclues sous la menace sont réputées nulles. Aussi est-il apparu nécessaire de contourner le droit, ce que fait le projet de loi dit de sécurisation de l’emploi en interdisant désormais au juge naturel du contrat de travail de connaître de ces conventions. Laisser faire, laisser passer, telle est la doctrine libérale… et sociale-libérale !
Il est encore temps d’opposer à cette fuite en avant dans la dérégulation une volonté déterminée de préserver l’emploi au moyen du droit et d’arracher les entreprises à l’emprise de la financiarisation de l’économie, en rappelant à leurs dirigeants que leurs décisions stratégiques ne doivent pas être uniquement guidées par le souci de la rentabilité du capital.
Plusieurs initiatives législatives ont déjà été prises pour prévenir les licenciements boursiers. Dès juin 2001, une majorité de gauche avait introduit, dans le projet de loi de modernisation sociale, un amendement précisant la définition légale du licenciement économique, afin d’empêcher qu’elle ne serve de justification à des licenciements boursiers ou abusifs. Le Conseil constitutionnel s’était alors opposé à cette disposition en faisant prévaloir la liberté d’entreprendre sur le droit au travail et sur la compétence du juge du licenciement. Pourtant, il s’agissait non pas de restreindre la liberté d’entreprendre, mais de concilier deux droits constitutionnels : celui d’avoir un emploi et celui de créer des emplois. Au nom de la libre disposition du capital des entreprises par ses propriétaires, le Conseil constitutionnel impose, dans sa jurisprudence, des limites au droit à l’emploi. Cette argumentation d’orientation libérale a été reprise par des gouvernements et des majorités successifs.
Il est temps de revenir à la raison ! Des députés et sénateurs de gauche tentent d’ouvrir les yeux aux gouvernements, à leurs collègues parlementaires et aux membres du Conseil constitutionnel sur les conséquences désastreuses de leurs choix. À cette fin, ils déposent des propositions de loi tendant à interdire les licenciements boursiers et l’abus des pratiques dérogatoires au droit du licenciement. Ils le font pour défendre le droit des salariés.
Avec la présente proposition de loi, je vous invite à résister à la tentation pernicieuse d’un démontage du droit du licenciement, à refuser les licenciements boursiers, à mettre un terme aux abus que permet, sur le plan juridique, l’allégation d’une sauvegarde anticipée de la compétitivité des entreprises. Une fois le droit du licenciement restauré, il conviendra encore d’empêcher l’extorsion, à des salariés désemparés, abandonnés et soumis aux menaces de licenciement et de délocalisation, d’un consentement majoritaire à des conventions qui les privent des protections du droit du licenciement.
L’article 1er pose une définition du licenciement économique dénuée d’ambiguïté, afin d’empêcher l’interprétation extensive de l’article L. 1233-3 du code du travail qui permet aux employeurs de justifier des licenciements au nom d’une sauvegarde, par anticipation, de la compétitivité de l’entreprise, même si celle-ci n’est pas immédiatement menacée. Trois motifs de licenciement économique demeureront licites : la cessation d’activité de l’entreprise – il paraît naturel de prévoir un tel cas –, les difficultés économiques de l’entreprise – qui sont, parfois, bien réelles – et les mutations technologiques. L’employeur devra néanmoins apporter la preuve des difficultés économiques ou des mutations technologiques et préciser les mesures qu’il prend pour limiter les suppressions d’emplois. Cet article reprend – j’y insiste – une disposition de la proposition de loi présentée par les sénateurs communistes et votée par l’ensemble de la gauche sénatoriale en février 2012.
À cet égard, je ne suis pas de ceux qui suivent la maxime « vérité en deçà des élections, erreur au-delà », pour paraphraser Blaise Pascal.
L’article 2 vise à interdire les licenciements économiques abusifs car dépourvus de cause réelle et sérieuse, en particulier ceux pratiqués par des entreprises qui ont réalisé des bénéfices au cours des deux derniers exercices comptables. De la même façon, la distribution de dividendes, d’options sur titres
– stock-options – ou d’actions gratuites, ainsi que les rachats d’actions, seront considérés comme des preuves irréfragables d’un licenciement économique dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Si les entreprises peuvent à bon droit anticiper des difficultés économiques, celles-ci ne peuvent justifier des licenciements qu’à la condition d’être prouvées et soumises, en cas de contentieux, à l’appréciation du juge, qui en vérifiera la réalité et le sérieux. Afin de ne pas exclure entièrement la possibilité de telles anticipations, je vous proposerai néanmoins un amendement qui vise à autoriser à licencier les entreprises qui ont constitué des réserves en vue de financer un plan social.
Aux termes de l’article 3, une entreprise qui aura procédé à des licenciements économiques ou supprimé des emplois sans cause réelle et sérieuse devra rembourser les aides publiques qu’elle aura éventuellement perçues pour le maintien des emplois en question. Sont particulièrement visés les exonérations de cotisations sociales dites Fillon et le crédit d’impôt compétitivité et emploi (CICE) adopté en décembre dernier.
L’article 4 donne la possibilité au juge d’apprécier non plus seulement la forme, mais le fond des licenciements économiques collectifs qui lui seront soumis. Il devra notamment s’assurer que l’employeur a respecté ses obligations en matière de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Il vérifiera également la sincérité et la loyauté de l’information fournie aux représentants du personnel. La nullité sanctionnera désormais les procédures de licenciement jugées irrégulières non seulement pour vice de forme, comme aujourd’hui, mais aussi pour des raisons de fond. La cour d’appel de Paris a statué dans ce sens dans son arrêt Viveo France. Je vous soumettrai un amendement rédactionnel à ce sujet.
En résumé, les articles 1er à 4 rétablissent le droit du licenciement économique dans ses principes. Les articles suivants visent à empêcher son contournement par des conventions dérogatoires au code du travail.
Ainsi, les articles 5 et 6 tendent à mettre fin aux licenciements économiques déguisés. Tel est le cas lorsque l’employeur n’applique pas, alors qu’il le devrait, la procédure prévue pour le licenciement de plus de dix salariés, ou lorsqu’il fait passer les licenciements pour des refus individuels d’accepter une modification du contrat de travail en application, par exemple, d’un accord de réduction du temps de travail. Je vous proposerai un amendement de clarification à l’article 6.
L’article 7 abroge la procédure de rupture conventionnelle des contrats de travail, qui constitue l’archétype des dérogations aux principes du droit du travail et est utilisée par les entreprises, dans la plupart des cas, pour licencier sans avoir à se soumettre aux procédures qui garantissent les droits des salariés.
L’article 8 abroge la disposition qui permet aux entreprises de plus de 300 salariés d’adapter, par un accord collectif, les modalités d’information du comité d’entreprise et, partant, de ne plus lui faire connaître complètement et loyalement ses éventuels projets en matière de licenciement économique, au prétexte qu’elle en informe directement les salariés.
Ces dispositions de bon sens, conformes aux principes européens du droit du travail et aux valeurs de la gauche dans son ensemble, recueilleront, je l’espère, un large soutien au sein de la majorité et, peut-être, au-delà. Elles visent en effet à dissiper les mirages libéraux qui contraignent nos politiques, entraînent les économies européennes dans l’abîme et condamnent les peuples au désespoir et à la colère.
M. Jean-Patrick Gille, président. Je vous remercie, monsieur le rapporteur, pour votre présentation claire et franche. Néanmoins, votre proposition de loi télescope le projet de loi relatif à la sécurisation de l’emploi, dont nous examinerons ce soir le texte issu des travaux de la commission mixte paritaire.
M. le rapporteur. Ce dernier texte sera voté au Sénat le 14 mai seulement, soit deux jours avant l’examen de ma proposition de loi par l’Assemblée en séance publique. Les bousculades que nous avons connues chez nous ont semble-t-il été freinées par la sagesse sénatoriale !
Mme Annie Le Houérou. La multiplication des plans sociaux, des licenciements et des suppressions d’emplois nous donne, comme à vous, le vertige. Vous avez raison : il est impératif de réagir fortement pour enrayer ce processus. Cette situation est la conséquence d’un déficit de stratégie industrielle : l’État n’a pas su prendre, au cours des années passées, les décisions qui auraient permis à notre économie de s’adapter et à notre pays de préserver des emplois durables et non délocalisables.
Comme vous le soulignez, la composition des groupes est complexe et la marge de manœuvre des filiales est faible. Cela rend plus difficile la caractérisation des licenciements économiques. De plus, la procédure du licenciement économique, censée protéger les salariés, est davantage utilisée par les entreprises pour renforcer leur compétitivité, dans l’intérêt des actionnaires. Elle sert à anticiper d’éventuelles difficultés, qui ne sont pas toujours avérées. L’annonce de plans sociaux ou de suppressions d’emplois permet parfois d’augmenter les cours de bourse et les dividendes.
Comme vous le relevez, le juge a été amené, à plusieurs reprises, à constater l’absence de difficultés économiques prévisibles et à requalifier le motif des licenciements. On peut citer, à cet égard, les affaires LU, Aubade ou Michelin.
Votre proposition de loi vise à anticiper les difficultés et à empêcher les licenciements économiques abusifs, c’est-à-dire dépourvus de cause réelle et sérieuse. Votre préoccupation est tout à fait légitime. Nous la partageons, mais souhaitons y apporter des réponses différentes.
François Hollande a pris devant les Français l’engagement suivant – c’est le trente-cinquième de ses soixante engagements – : « Je mettrai en place, en concertation avec les partenaires sociaux, la sécurisation des parcours professionnels, pour que chaque salarié puisse se maintenir dans l’entreprise ou l’emploi. Pour dissuader les licenciements boursiers, nous renchérirons le coût des licenciements collectifs pour les entreprises qui versent des dividendes ou rachètent leurs actions, et nous donnerons la possibilité aux salariés de saisir le tribunal de grande instance dans les cas manifestement contraires à l’intérêt de l’entreprise. »
Son élection à la présidence de la République et celle d’une nouvelle majorité à l’Assemblée ont changé la donne : nous avons adopté une nouvelle méthode, qui consiste à promouvoir le dialogue social et à le réintroduire au sein des entreprises, là où il avait disparu.
Tel a été le sens de la grande conférence sociale lancée en juillet 2012. La négociation entre partenaires sociaux a abouti à la signature de l’accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013, qui a été repris dans le projet de loi toujours en discussion et que l’Assemblée nationale a voté au début du mois d’avril.
Le projet de loi constitutionnelle relatif à la démocratie sociale adopté le 13 mars 2013 par le Conseil des ministres précise cette nouvelle approche, que l’on peut résumer ainsi : « la négociation sociale précède et inspire les lois sociales ». Le législateur est, certes, souverain en matière sociale, mais la loi doit être précédée d’une phase de consultation et, si les partenaires sociaux le souhaitent, de négociation.
La question des licenciements boursiers et de leur éventuelle interdiction a été largement débattue par l’Assemblée lors de l’examen du projet de loi relatif à la sécurisation de l’emploi. À cette occasion, les principales dispositions de votre proposition de loi, monsieur Chassaigne, ont été reprises par des amendements du groupe GDR portant notamment sur l’article 13. Or tous ces amendements ont été rejetés en séance publique. Mais vous ne baissez pas les bras et avez décidé de présenter votre texte.
De plus, les partenaires sociaux ne se sont pas saisis de cette question dans le cadre de la négociation de l’accord du 11 janvier, alors qu’ils auraient très bien pu le faire. Cet accord est un texte de compromis et constitue une étape dans la sécurisation de l’emploi. Vous proposition de loi arrive à un moment où le projet de loi n’est pas encore définitivement adopté, ni a fortiori entré en vigueur. Il n’a donc pas pu encore porter ses fruits.
Or ce texte instaure déjà certains garde-fous. Il prévoit notamment le retour de l’État comme garant de la protection des salariés dans la procédure de licenciement économique. Ainsi, son article 13 prévoit qu’un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) devra soit recueillir l’accord majoritaire des salariés, soit être homologué par l’administration, qui se voit ainsi confier une nouvelle responsabilité. Son article 14 oblige toute entreprise qui envisage la fermeture d’un de ses sites à rechercher un repreneur.
En outre, conformément au cinquante-cinquième engagement de François Hollande, les représentants des salariés seront désormais présents avec voix délibérative dans les conseils d’administration des grandes entreprises et participeront ainsi à la définition de leur stratégie. Cela permettra aux entreprises de mieux anticiper et de saisir à temps certaines opportunités. Une consultation sur les orientations stratégiques sera désormais obligatoire chaque année. L’entreprise devra tenir à jour une base de données relatives à sa stratégie, présentée de manière pédagogique et accessible en permanence aux représentants du personnel.
S’agissant du contrôle des aides publiques, notamment du crédit d’impôt compétitivité emploi (CICE), le projet de loi de sécurisation de l’emploi instaure un droit d’alerte : il crée une procédure d’information et de consultation, au cours de laquelle le comité d’entreprise peut demander des explicitations avec l’appui éventuel d’un expert.
Tels sont les éléments qui devraient dissuader le recours aux licenciements boursiers. Nous faisons confiance à la négociation et au dialogue social au sein même des entreprises.
Enfin, nous devrions disposer très rapidement d’un deuxième outil pour prévenir les licenciements boursiers et les éventuelles dérives : le Gouvernement présentera prochainement un projet de loi sur la reprise des sites rentables, qui complétera le dispositif de sécurisation de l’emploi.
Notre économie est en pleine mutation et nos entreprises doivent s’adapter sans recourir systématiquement à des fermetures de sites ou à des licenciements. Cela nous impose de redéfinir notre conception des liens sociaux au sein de l’entreprise. Il convient de construire une culture de la confiance : elle seule nous permettra d’anticiper les évolutions, de préserver l’emploi et d’éviter les licenciements abusifs, en particulier les licenciements boursiers. Le groupe SRC n’est donc pas favorable à votre proposition de loi.
Mme Véronique Louwagie. La question des licenciements et des plans sociaux est un sujet grave, qui préoccupe les Français et chacun d’entre nous. Je vous rejoins tout à fait sur ce point, monsieur Chassaigne. Pour autant, il convient d’être vigilant : des idées révolutionnaires en apparence peuvent avoir des effets désastreux sur le terrain.
Il est impératif de mieux anticiper les plans sociaux et d’intervenir en amont. À cet égard, le projet de loi relatif à la sécurisation de l’emploi, qui reprend l’accord du 11 janvier, vise à renforcer le rôle des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE). Il convient d’abord de mettre en œuvre cette disposition intéressante et de constater ses effets. Il n’est pas temps d’envisager des mesures plus radicales, telles que celles que vous proposez. Votre proposition de loi télescope en effet, comme l’a dit le président, le projet de loi relatif à la sécurisation de l’emploi que nous examinons actuellement.
De plus, les plans sociaux abusifs sont d’ores et déjà sanctionnés par le juge. Il n’existe aucun vide juridique en la matière : vous écrivez vous-même à juste titre dans l’exposé des motifs que « la justice n’est pas impuissante ».
Votre proposition de loi tend à interdire les licenciements dits boursiers. Mais existe-t-il aujourd’hui une définition juridique de cette notion ? Vous indiquez que l’article 1er en donne une qui est dénuée de toute ambiguïté. Sa rédaction me laisse cependant perplexe.
Surtout, vous introduisez dans cette proposition de loi, de manière audacieuse et insidieuse, la suppression du dispositif de rupture conventionnelle, qui n’a pourtant rien à voir avec les licenciements boursiers.
En somme, votre proposition de loi repose sur une vision totalement erronée de l’économie de marché. La mise en place d’un dispositif coercitif serait une démarche antiéconomique : pour produire, une entreprise a besoin non seulement de salariés, mais également de moyens de production. Il convient de laisser les entreprises atteindre un niveau de capitalisation qui leur permette d’investir. De trop nombreuses entreprises françaises souffrent en réalité d’une sous-capitalisation, qui bride leur développement et leurs exportations. L’investissement dans une entreprise est un risque qui doit être rémunéré à sa juste valeur.
Les dispositions de votre proposition de loi ne manqueraient pas d’avoir des effets pervers. Premièrement, elles décourageraient l’embauche et se révéleraient ainsi contre-productives au regard de l’objectif de lutte contre le chômage, que nous partageons tous.
Deuxièmement, elles préserveraient des emplois peu rentables et favoriseraient des entreprises moins performantes. Aux termes de l’article 2, serait dépourvu de cause réelle et sérieuse tout licenciement pour motif économique pratiqué par une entreprise qui a constitué des réserves ou réalisé un résultat net positif au cours des deux derniers exercices comptables. C’est là une vision très restrictive de l’économie.
Troisièmement, elles détourneraient les investisseurs étrangers de la France, alors qu’ils contribuent à créer des emplois.
Quatrièmement, elles inciteraient les entreprises françaises à s’implanter et à produire à l’étranger.
Avec cette proposition de loi, vous niez la réalité économique et risquez de compromettre l’efficacité de nos entreprises. Vous caricaturez outrageusement les entrepreneurs de notre pays qui, en règle générale, cherchent à développer leur activité, à conquérir de nouveaux marchés, à innover. Lorsqu’une entreprise licencie, elle y est souvent contrainte et le fait pour mieux s’organiser, s’adapter aux mutations, retrouver la croissance et, à terme, réembaucher.
Enfin, votre proposition de loi encourt la censure du Conseil constitutionnel : elle ferait peser sur les entreprises des contraintes excessives et, en définitive, nie la réalité du droit français, déjà protecteur des salariés. Le tribunal de grande instance de Troyes a ainsi annulé un plan social, en février 2011, en raison de l’absence de motif économique.
Pour l’ensemble de ces raisons, le groupe UMP est opposé à cette proposition de loi.
M. Jean-Louis Roumegas. Monsieur Chassaigne, la lecture de l’intitulé de votre proposition de loi nous laisse dubitatifs en même temps qu’elle nous rend enthousiastes. Oui, il faut réagir aux drames que vous avez décrits, d’autant que la gauche a promis de le faire ! Mais nous nous interrogeons aussi sur la notion de licenciement boursier, et sur celle « d’interdiction », dans une économie ouverte de marché.
Il ne faut toutefois pas en rester à un titre car les mesures que vous proposez sont à la fois réalistes, modérées, parfaitement applicables, et adaptées à la situation actuelle. Certes, vous n’êtes pas passé par une négociation telle que celle qui a abouti à la signature de l’accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013, néanmoins votre texte et le projet de loi relatif à la sécurisation de l’emploi ne sont pas contradictoires ; ils sont plutôt complémentaires.
Afin d’éviter le recours abusif au licenciement pour motif économique, l’article 1er de la proposition de loi restreint à trois le nombre de causes pouvant justifier la mise en œuvre de cette procédure : la cessation d’activité, les difficultés économiques et une mutation technologique. Cet article est justifié, car en recevant les syndicats et la direction de Sanofi, la Commission a constaté que ces comportements existaient bel et bien.
L’article 2 précise qu’un licenciement pour motif économique sera « dépourvu de cause réelle et sérieuse » lorsque, dans la même période, l’entreprise aura augmenté les dividendes versés à ses actionnaires. Madame Louwagie, vous ne pouvez pas nier que de tels cas se sont produits. Pour notre part, nous n’acceptons pas que certaines entreprises en bonne santé licencient pour motif économique en prétextant la nécessité d’une adaptation au marché ou de prétendues difficultés futures.
L’article 3 prévoit le remboursement des aides publiques lorsque le licenciement pour motif économique aura été jugé sans cause réelle et sérieuse. Dans votre texte, seules sont citées les aides d’État comme le crédit d’impôt recherche et le crédit d’impôt compétitivité et emploi (CICE) : pourquoi ne pas avoir également prévu d’inclure les aides versées par les collectivités locales ?
Les sujets abordés par les articles 4, 5 et 6 ont déjà fait l’objet de débats lors de l’examen du projet de loi relatif à la sécurisation de l’emploi. Le groupe écologiste avait alors soutenu des amendements qui allaient dans le sens de ces articles, il n’a évidemment pas changé de position.
En revanche, la suppression pure et simple de la rupture conventionnelle du contrat de travail proposée par l’article 7 nous semble aller très loin ; vous auriez pu vous contenter de mieux encadrer cette procédure et laisser une chance au dialogue entre employeur et salarié. Il est un peu dommage de jeter le bébé avec l’eau du bain.
Au final, le groupe écologiste est néanmoins favorable à cette proposition de loi.
Mme Isabelle Le Callennec. Monsieur Chassaigne, le moins que l’on puisse dire, c’est que le Front de gauche a de la constance et de la cohérence ! Je comprends parfaitement que vous défendiez un tel texte : non seulement l’opinion publique a pu être choquée par des licenciements dans des entreprises qui font des bénéfices et versent des dividendes – et par l’effet immédiatement positif sur la Bourse –, mais vos propositions reprennent une promesse du candidat Hollande.
Cela dit, nous ne vivons pas dans une économie fermée : la mondialisation est une réalité, et si elle peut poser des problèmes, elle constitue aussi une chance pour certaines entreprises. Nous n’avons pas fait assez de pédagogie en matière économique auprès des salariés. L’économiste Joseph Schumpeter a parfaitement analysé le processus de « destruction créatrice » : des entreprises meurent lorsque d’autres se créent. Il nous appartient d’accompagner les mutations de l’économie et du travail – ce que nous avons fait en transposant l’accord du 11 janvier –, ainsi que les salariés dont l’emploi est supprimé.
Monsieur Chassaigne, vous avez établi un lien direct entre la diminution du coût du travail et celle des salaires. Pouvons-nous revenir sur cette analyse que je ne partage pas ?
Par ailleurs, à l’article 7, la suppression de la rupture conventionnelle me semble excessive. Si cette procédure a pu avoir quelques rares effets négatifs, son impact global est positif. Une évaluation avait été envisagée ; peut-être faudrait-il la mener à bien avant d’abroger purement et simplement les articles du code du travail concernés.
Une question pour conclure : croyez-vous vraiment que l’interdiction des licenciements sera de nature à permettre le maintien de l’industrie dans notre pays ? Élue d’une circonscription où 42 % des salariés travaillent dans l’industrie, je sais que celle-ci fait vivre les services, et je me sens, comme vous, extrêmement concernée par les licenciements que vous évoquez, mais je ne crois vraiment pas que votre proposition puisse les éviter.
M. Denys Robiliard. Il est essentiel de savoir de quoi l’on parle : 7 % des entrées à Pôle emploi font suite à un licenciement pour motif économique. De plus, le taux de recours après l’application de cette procédure n’est que de 2,8 %, soit quasiment dix fois inférieur au taux de 25 % enregistré pour les licenciements pour motif personnel.
Les licenciements boursiers existent ! Dans le cadre de la financiarisation de l’économie, les détenteurs du capital des entreprises ont exigé de celles-ci des taux de rentabilité qu’elles ne pouvaient pas atteindre. Dans ma propre circonscription, deux entreprises ont fermé alors même qu’elles étaient bénéficiaires, parce qu’elles n’avaient pas atteint la rentabilité exigée !
Toutefois, si le problème que vous soulevez est bien réel – nous avons commencé à le traiter dans le projet de loi relatif à la sécurisation de l’emploi –, votre proposition de loi ne permettrait pas de le résoudre.
Nous nous heurtons d’abord à un problème en termes de méthode. L’article L. 1 du code du travail, issu de la loi Larcher du 31 janvier 2007, rend obligatoire la consultation préalable des partenaires sociaux en cas d’inscription à l’ordre du jour d’un projet de loi relevant du champ de la négociation sociale. L’Assemblée nationale a proposé de mettre en œuvre la même procédure pour les propositions de loi dans le protocole adopté par la Conférence des présidents du 16 février 2010.
Ensuite, il me semble prématuré de modifier des dispositions qui sont encore en discussion devant le Parlement. La commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les mesures du projet de loi relatif à la sécurisation de l’emploi restant en discussion est parvenue à un accord hier, mais les deux chambres doivent encore se prononcer, et vous voudriez que nous amendions déjà des dispositifs avec lesquels votre texte ne s’articule même pas – je pense à son article 4 !
Enfin, à la lecture de votre propre commentaire de l’article 1er de la proposition de loi, il apparaît que celle-ci ne respecte pas la Constitution. La décision du Conseil constitutionnel du 12 janvier 2002, fondée sur la défense de la liberté d’entreprendre, telle qu’elle résulte de l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme de 1789, aurait dû vous pousser à déposer une proposition de loi constitutionnelle.
Pour l’ensemble de ces raisons, la proposition de loi ne me paraît pas acceptable en l’état.
M. Jean-Patrick Gille, président. La commission des affaires sociales a toujours été attachée à la négociation des partenaires sociaux en amont du travail législatif. Nos anciens collègues Jean Mallot et Alain Vidalies avaient déposé une proposition de loi afin de rendre cette consultation obligatoire pour les textes d’origine parlementaire. Un accord entre la majorité de l’époque et l’opposition s’était traduit, grâce au travail de l’ancien président de notre Commission, M. Pierre Méhaignerie, par l’adoption en Conférence des présidents du protocole du 16 février 2010. Demain, le projet de loi constitutionnelle relatif à la démocratie sociale déposé sur le bureau de notre assemblée le 14 mars dernier pourrait élever cette concertation préalable au niveau constitutionnel.
Monsieur Chassaigne, même si vous souhaitez manifestement aller plus loin que la loi de sécurisation de l’emploi, il faut tout de même tenir compte de ce texte et au moins attendre qu’il soit adopté.
La suppression pure et simple de la rupture conventionnelle que vous proposez est d’autant moins évidente que ce dispositif a fait l’objet d’un accord entre les partenaires sociaux avant d’être repris dans la loi. À la surprise de tous, cette procédure a rencontré un vif succès : elle est à l’origine de beaucoup plus d’entrées à Pôle emploi que les licenciements économiques collectifs. La Commission devra donc sans doute travailler sur ses éventuels effets pervers, mais il paraît difficile de supprimer la rupture conventionnelle de façon aussi brutale.
Mme Jacqueline Fraysse. Pendant que nous adoptons des textes pour sauver ou créer quelques milliers d’emplois – je pense aux emplois d’avenir ou aux contrats de génération –, les grandes entreprises annoncent des suppressions d’emplois encore plus nombreuses. Air France, Valéo, Continental, Carrefour, Unilever, Arcelor, PSA, Renault et les autres bénéficient pourtant d’aides publiques : exonérations de cotisations sociales, crédits d’impôt… ! Comble de l’anomalie, ces entreprises peuvent licencier même si elles sont en bonne santé, font des bénéfices et distribuent des dividendes ! Sanofi, par exemple, qui a réalisé 40 milliards d’euros de bénéfices sur cinq ans, dont plus de 8,5 milliards l’année dernière, et à qui le crédit d’impôt pour la compétitivité et emploi rapportera 47 millions, annonce la suppression de 2 000 emplois. Quelque chose ne va pas !
Il est urgent de changer de cap : le pays n’en peut plus de ce gâchis humain et financier ! On ne relancera pas l’économie en baissant le coût du travail sans enrayer l’augmentation sans limite du coût des dividendes, véritable machine infernale qui fonctionne au détriment de l’intérêt général. La course folle à l’argent pourrit profondément notre système !
Pour conclure, je rappelle à mes collègues du groupe socialiste que leurs homologues du Sénat se sont prononcés le 16 février 2012 en faveur de dispositifs semblables à ceux des articles 1er et 2 de cette proposition de loi ; je ne peux imaginer que leur avis puisse être différent aujourd’hui !
Mme Véronique Besse. Monsieur Chassaigne, je m’étonne que votre proposition de loi ne traite pas du protectionnisme européen. Certains licenciements s’expliquent en effet par le manque de compétitivité de nos entreprises et par l’entrée en France de produits qui ne sont pas taxés.
M. le rapporteur. Ce n’est que la deuxième fois que je siège au sein de la commission des affaires sociales, mais je reste impressionné par la qualité des interventions de ses membres, quelle que soit leur appartenance politique. Vous avez tous eu la volonté de répondre sur le fond et d’argumenter sans balayer d’un revers de main une proposition de loi dont vous ne souhaitez pas forcément qu’elle soit appliquée en l’état, même si je constate que le diagnostic est partagé par la plupart d’entre vous.
Annie Le Houérou et Denys Robiliard m’ont fait grief de ne pas tenir compte d’une nouvelle conception du dialogue social, et Denys Robiliard, se fondant sur la décision du Conseil constitutionnel du 12 janvier 2002 relative à la loi de modernisation sociale, a même ajouté que cette proposition de loi était inconstitutionnelle. Certains aujourd’hui veulent que soit reconnue la primauté de la négociation sociale sur la loi ; en quelque sorte celle de la volonté syndicale sur la volonté générale. Pourtant, selon l’article 34 de la Constitution, les principes fondamentaux du droit du travail, du droit syndical et de la sécurité sociale relèvent bien de la seule compétence du Parlement, et le Conseil constitutionnel considère « qu’il incombe au législateur d’exercer pleinement la compétence que lui confie la Constitution et, en particulier, son article 34 ». C’est donc le transfert de facto du pouvoir législatif aux partenaires sociaux qui est inconstitutionnel, et pas ma proposition de loi. Pour nous, la loi doit rester prédominante ; elle l’emporte sur des accords d’entreprise.
Madame Louwagie, la question de la définition du licenciement boursier se pose, vous n’avez pas tort. C’est précisément pour cela que les articles 1er et 2 de notre texte ne reprennent pas exactement la proposition de loi examinée par le Sénat le 16 février 2012. Alertés par les salariés de Sanofi, nous avons en particulier pris conscience de l’importance de tenir compte des « suppressions d’emplois boursières ». Des mesures alternatives d’accompagnement au départ, de mobilité, de retraite anticipée permettent ainsi de faire disparaître des milliers de postes pour tenter d’atteindre des taux de rentabilité toujours plus élevés – 25 % chez Sanofi – en jouant sur le coût du travail. Notre proposition de loi vise à battre en brèche ces stratégies financières des grands groupes.
J’en profite pour rappeler que même si nos propos peuvent parfois laisser penser que nous sommes des adversaires du monde de l’entreprise, nous ne voulons pas diaboliser les chefs d’entreprises qui travaillent sur nos territoires. Dans nos circonscriptions, nous connaissons bien les capitaines d’industrie qui dirigent les PME et qui ne cherchent qu’à préserver leur outil de travail, sauvegarder l’emploi de leurs salariés, et faire vivre nos régions. Ils sont eux-mêmes victimes d’un système qui les asphyxie car, lorsqu’ils sont sous-traitants, les donneurs d’ordre les poussent à travailler dans des conditions terribles et les amènent à rencontrer les pires difficultés. De fait, il y a une convergence objective entre leurs intérêts et ceux de leurs salariés, et nous ne les mettons pas sur le même plan que les multinationales. Croyez-moi, les chefs d’entreprises de ma circonscription ne considèrent pas mes propositions législatives comme des agressions !
Chaque mois, on compte actuellement près de 14 000 licenciements pour motif économique et près de 32 000 ruptures conventionnelles ! Ce dernier procédé est incontestablement instrumentalisé pour habiller des licenciements qui sont de fait imposés à des salariés affaiblis ou qui ne peuvent s’appuyer sur une organisation syndicale forte. Nous avons tous rencontré, dans nos permanences, des salariés qui ont dû signer une rupture conventionnelle sur le coin d’un bureau – elle leur était imposée, même si les pressions exercées pouvaient s’accompagner d’avantages financiers. Il faut donc abroger ce dispositif !
Monsieur Roumegas, nous verrons comment inclure dans le texte, le cas échéant par voie d’amendement, votre excellente proposition relative aux aides des collectivités locales. Plusieurs départements et régions ont déjà installé des commissions de contrôle de l’utilisation des fonds publics, et certaines régions se retournent contre des entreprises qui ne respectent pas leurs engagements alors qu’elles ont bénéficié d’aides publiques. De plus en plus, les régions interviennent pour renforcer le tissu économique local ; et dans ce domaine aussi, l’on constate des dérives. Il serait donc bon de réfléchir à une moralisation de l’attitude des collectivités locales, qui se font parfois concurrence en utilisant les aides pour attirer, un peu comme on se sert dans un rayon de supermarché, des entreprises implantées dans d’autres territoires qu’elles vident ainsi au profit du leur. L’Association des régions de France s’est penchée sur ce problème.
En ce qui concerne le protectionnisme européen, madame Besse, la proposition de loi ne contient pas toutes les dispositions envisageables, mais il faudrait de toute façon s’interroger sur le niveau auquel il convient d’instaurer des mesures de protection. Pour notre part, nous ne souhaitons pas ériger des murs autour de l’Union européenne, car l’économie mondialisée exige échanges, coopération et mutualisation. Réfléchissons à ce qu’impliquerait la démondialisation dont certains parlaient pendant la pré-campagne électorale et ne perdons pas de vue la réalité des échanges économiques, qui ne se satisfont pas de slogans. En revanche, la taxation des différentiels sociaux et environnementaux serait bienvenue, mais dans le cadre d’une coopération planétaire qui passe notamment par les échanges bilatéraux. Elle ne saurait être imposée par des mesures adoptées au niveau d’un seul État.
Enfin, j’ai écouté avec attention l’intervention de deux députées bretonnes, Annie Le Houérou et Isabelle Le Callennec. J’ai vu la semaine dernière le match entre Rennes et Saint-Étienne – dont je suis supporteur – et je me réjouis que dans vos réponses, mesdames, vous n’ayez pas botté en touche !
M. Jean-Patrick Gille, président. Je vous remercie, monsieur le rapporteur, de l’hommage que vous avez rendu aux qualités d’écoute et au travail de notre commission. J’ai moi-même apprécié la tonalité de votre seconde intervention – je n’en dirai pas autant de la première, qui accusait le Gouvernement d’organiser la déflation salariale !
Nous avons auditionné les représentants tant de la direction que des salariés de Sanofi. J’en ai retiré une impression étrange : il n’y avait pas au départ de plan de licenciements et l’on pouvait se demander pourquoi la direction communiquait au sujet de la restructuration, sinon pour envoyer des signes aux actionnaires. Ce dossier n’est pas clos.
Enfin, nous sommes d’accord : le code du travail prime sur les accords d’entreprise. Au demeurant, l’accord du 11 janvier ne déroge pas au code du travail. C’est ce qui distingue le projet actuel des propositions formulées par l’ancienne majorité au cours de la précédente législature.
Article 1er
(art. L. 1233-3 du code du travail)
Motivation juridique des licenciements économiques
La directive 75/129/CEE du Conseil européen du 17 février 1975, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux licenciements collectifs, remplacée par la directive n° 98/59/CE du 20 juillet 1998 relative aux licenciements collectifs, établit une procédure minimale de consultation préalable des salariés et d’information de l’autorité publique lorsque l’entreprise forme un projet de licenciement économique collectif. Cette directive ne limite pas la faculté pour les États d'introduire une législation plus favorable aux travailleurs et, en particulier, d’imposer aux employeurs des procédures comparables pour encadrer les licenciements économiques individuels.
Les articles L. 1232-1 et L. 1233-2 du code du travail imposent à l’employeur l’obligation de motiver les projets de licenciement de salariés qu’il forme, qu’ils soient individuels ou collectifs, pour motif personnel ou pour motif économique. Dans les deux cas, le licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, ce qui autorise le juge du contrat de travail à examiner les motifs du licenciement. Ce contrôle s’exerce sur les faits objectifs et précis portés à la connaissance du juge et sur la relation de causalité entre ces faits et la conséquence qu’en tire l’employeur sur le contrat de travail.
Lorsque les motifs de licenciement ne sont pas personnels, ils sont réputés avoir une cause économique. L’article L. 1233-3 du code du travail définit le licenciement pour motif économique non pas par une seule cause mais par l’enchaînement de deux causes, l’une immédiate et nécessaire, l’autre plus lointaine et seulement suffisante. La cause immédiate doit relever de l’une des trois catégories posées par l’article, à savoir la modification ou bien la suppression du poste pour lequel le contrat de travail a été conclu, ou bien encore un refus, opposé par le salarié, d’accepter une modification d’un élément essentiel de son contrat de travail.
Cette première cause nécessaire doit elle-même avoir une origine économique. Cette origine n’est pas aussi nettement définie par l’article du code que la cause immédiate du licenciement. Elle se divise en plusieurs conditions introduites par l’adverbe notamment, qui ne sont, de ce fait, ni exclusives ni limitatives mais seulement exemplaires et suffisantes. L’article L. 1233-3 cite deux conditions pouvant justifier un licenciement : des difficultés économiques et des mutations technologiques. La jurisprudence leur a ajouté la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise et la cessation d’activité.
Ces ajouts prétoriens, particulièrement favorables à la justification des licenciements boursiers, ont été débattus au cours des travaux préparatoires de la loi du 17 janvier 2002 de modernisation sociale et le Conseil constitutionnel, dans sa décision sur ce texte, a donné de la motivation des licenciements économiques une interprétation plus favorable à la liberté d’entreprendre qu’au maintien de l’emploi.
La remise en cause de la jurisprudence de la Cour de cassation sur les motifs prétoriens de licenciement économique ne figurait pas dans le projet de loi initial du Gouvernement. C’est au cours de la deuxième lecture du texte à l’Assemblée nationale, le 23 mai 2001, à la suite des affaires Michelin et Danone, que quatre amendements ont ouverts un débat sur l’article L. 312-1 du code du travail, devenu depuis lors l’article L. 1233-3. Ces quatre amendements concurrents avaient été déposés afin, d’une part, de lever l’ambiguïté introduite par l’adverbe notamment dans la liste des motifs économiques de licenciement, pour que cette liste soit exhaustive et non plus seulement indicative et exemplaire et afin, d’autre part, de décider du sort à réserver aux motifs supplémentaires dégagés par la jurisprudence de la Cour de cassation.
La commission des affaires culturelles, familiales et sociales était à l’époque divisée sur cette initiative. Certains souhaitaient s’en tenir à la jurisprudence de la Cour, dans la mesure où celle-ci, tout en admettant, parmi les causes réelles et sérieuses de licenciement économique, la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise, refusait de considérer que l’augmentation des profits ou la suppression de droits acquis, favorables aux salariés, puissent relever de cette sauvegarde. D’autres insistaient pour restreindre les motifs de licenciements à ceux initialement posés par le code du travail.
Une majorité s’est formée en séance publique pour adopter, dans des conditions que le compte rendu de la séance ne permet pas d’éclairer entièrement, un amendement qui, après le mot « consécutives », introduisant les motifs économiques d’un licenciement, supprimait l’adverbe « notamment », qualifiait les difficultés économiques et les mutations technologiques et ajoutait une cause nouvelle, inspirée de la jurisprudence de la Cour, celle des « nécessités de réorganisation indispensables à la sauvegarde de l'activité de l'entreprise ».
L’article du code du travail se trouvait, à la suite de ces débats, rédigé de la manière suivante :
« Art. L. 321-1. - Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives à des difficultés économiques sérieuses n'ayant pu être surmontées par tout autre moyen, soit à des mutations technologiques mettant en cause la pérennité de l'entreprise, soit à des nécessités de réorganisation indispensables à la sauvegarde de l'activité de l'entreprise.
« Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des trois causes énoncées à l'alinéa précédent.»
Les qualifications, ajoutées par le texte de l’Assemblée, aux motifs de licenciement économique aboutissaient à restreindre le champ des licenciements que ces motifs pouvaient justifier, tout en obligeant l’employeur à apporter de nouvelles preuves susceptibles de les justifier, en exposant la démarche, la stratégie et le raisonnement qui le conduisaient à s’en remettre en dernier ressort à des suppressions d’emplois.
Les difficultés économiques précédemment invoquées ne devaient pas seulement être sérieuses, ce que l’obligation d’une cause réelle et sérieuse de licenciement imposait déjà. Ces difficultés devaient en outre n’avoir pu être surmontées par tout autre moyen que des licenciements. L’employeur ne pouvait plus invoquer ces difficultés sans exposer, en regard, les moyens alternatifs aux licenciements qu’il avait cherchés et choisis pour les surmonter. La décision de s’en remettre à des licenciements devait résulter d’un arbitrage entre moyens alternatifs, dont le juge pouvait et devait apprécier l’étendue et la balance.
De la même manière, les mutations technologiques ne pouvaient plus être invoquées à l’appui d’un licenciement économique sans prouver qu’elles mettaient en cause la pérennité de l’entreprise et non pas seulement sa compétitivité ou sa profitabilité. Enfin, si le texte de l’Assemblée rassemblait les motifs prétoriens de cessation d’activité et de la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise dans un motif composite de sauvegarde de l’activité de l’entreprise, c’était en assortissant ce motif de deux conditions supplémentaires, l’une imposant que cette sauvegarde passât par des mesures de réorganisation nécessaires et non pas opportunes ou facultatives, l’autre que ces mesures ne soient pas seulement favorable à la sauvegarde de l’activité de l’entreprise mais indispensables à cette sauvegarde. Ces modalités restrictives auraient eu pour effet d’orienter l’examen du juge des licenciements vers un contrôle de la stratégie de l’entreprise, des alternatives offertes par son secteur d’activité et des arbitrages rendus en interne par ses dirigeants.
Au Sénat, lors de la deuxième lecture du texte en séance publique, le 9 octobre 2001, l’argument cité par le rapporteur, selon lequel « la définition plus restrictive du licenciement économique peut favoriser le contournement de la loi et réduire ainsi les droits et protections contenus dans les plans sociaux, au détriment des salariés licenciés », a conduit la majorité à adopter une rédaction plus libérale et plus proche de la jurisprudence de la Cour de cassation, en rétablissant l’adverbe notamment et en affaiblissant la qualification modale des motifs économiques de licenciement.
Le texte du Sénat conservait la mention des difficultés économiques sérieuses mais supprimait l’obligation de comparaison avec des moyens alternatifs. Il conservait aussi la mention des mutations technologiques mais n’exigeait plus qu’elles mettent en cause la pérennité de l’entreprise. Il suffisait qu’elles aient des conséquences importantes sur l'organisation du travail dans l'entreprise. Enfin le texte du Sénat reprenait le motif prétorien des réorganisations destinées à sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, sans exiger qu’elles soient nécessaires ou indispensable au maintien de son activité.
Les deux assemblées ont maintenu leurs positions respectives en nouvelle lecture, après l’échec de la commission mixte paritaire et l’Assemblée nationale a fait prévaloir sa rédaction de l’article en lecture définitive.
Le Conseil Constitutionnel a été saisi de cette disposition lors de son examen de la loi adoptée, par une requête estimant que la nouvelle définition de licenciement économique, introduite dans le code du travail, portait, par l’usage de notions vagues, une atteinte disproportionnée à la liberté d'entreprendre, qu’elle écartait des solutions imposées par le bon sens et qu’elle permettait au juge de s'immiscer dans le contrôle des choix stratégiques de l'entreprise qui relèvent, en vertu de la liberté d'entreprendre, du pouvoir de gestion de la direction.
Le Conseil, mettant en balance la liberté d'entreprendre qui découle de l'article 4 de la Déclaration de 1789 et le droit de chacun d'obtenir un emploi cité par le Préambule de la Constitution de 1946, a fait droit à cette requête dans sa décision n° 2001-455 DC du 12 janvier 2002. Il a estimé que le législateur avait « porté à la liberté d'entreprendre une atteinte manifestement excessive au regard de l'objectif poursuivi du maintien de l'emploi », parce que les restrictions apportées aux causes licites d’un licenciement économique, limitant à trois cas les possibilités de licenciement pour motif économique « à l'exclusion de toute autre hypothèse » et, parmi ces trois cas, exigeant que les licenciements prévus soient indispensables à la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise et non pas seulement nécessaires à cette sauvegarde, interdisaient « à l'entreprise d'anticiper des difficultés économiques à venir en prenant des mesures de nature à éviter des licenciements ultérieurs plus importants ».
Quant à la disposition qui précisait que les difficultés économiques de l’entreprise ne pouvaient motiver des licenciements qu’à condition de ne pouvoir « être surmontées par tout autre moyen », le Conseil l’a également estimée excessive parce qu’elle conduisait « le juge non seulement à contrôler, comme c'est le cas sous l'empire de l'actuelle législation, la cause économique des licenciements décidés par le chef d'entreprise à l'issue des procédures prévues par le livre IV et le livre III du code du travail, mais encore à substituer son appréciation à celle du chef d'entreprise quant au choix entre les différentes solutions possibles. »
Le Conseil a enfin écarté, par une considération de principe, les contraintes légales qui ne permettent à l’entreprise de licencier « que si sa pérennité est en cause », sans toutefois que les dispositions censurées puissent être, selon cette interprétation, individuellement assimilées à de telles contraintes, le Conseil censurant moins chaque disposition que leur cumul, utilisant une notion de cumul sujette, par sa nature même, à des appréciations au cas par cas. Un autre cumul que celui qui résultait des dispositions en cause, reprenant par exemple certaines d’entre elles en les amodiant comme l’avait fait le texte du Sénat, aurait peut-être pu lui paraître moins excessif.
Afin d’inviter le Conseil Constitutionnel et, par son intermédiaire, la Cour de cassation, à revoir leur jurisprudence en matière de définition et de motivation des licenciements économiques, de telle sorte que le juge du contrat puisse en examiner le bien-fondé au vu de la situation économique réelle de l’entreprise, de son secteur d’activité, des profits qu’elle dégage et de l’usage qu’elle leur réserve, pour s’assurer que la recherche de leur maximisation non seulement ne contrevienne ni ne nuise à l’objet social de l’entreprise et mais aussi que la balance entre les bénéfices attendus pour l’entreprise des mesures de licenciements et les effets dommageables externes qu’ils ne manqueront pas de produire ne soit pas excessivement déséquilibrés à l’avantage de la première, l’article premier de la proposition de loi propose une nouvelle définition légale des licenciements économiques, inspirée par celles avancées mais non retenues au cours des débats de l’Assemblée nationale sur la loi de modernisation sociale ainsi que par la proposition de loi n° 1621 de Mme Marie-George Buffet, visant à prendre des mesures urgentes de justice sociale en faveur de l’emploi, des salaires et du pouvoir d’achat et le rapport de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales n° 1686, déposé par M. Daniel Paul sur cette proposition de loi sous la précédente législature.
L’article premier supprime l’adverbe « notamment » et restreint les causes licites de licenciements économiques à la cessation d’activité, aux difficultés économiques et aux mutations technologiques. En distinguant nettement les motifs de difficultés économiques et ceux de mutations technologiques, la proposition de loi écarte l’extension interprétative de la notion de sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise introduite par la jurisprudence de la Cour de cassation, dans ses arrêts Pages Jaunes du 11 janvier 2006, à la suite de la position prise par le Conseil constitutionnel en 2002.
Dans ces arrêts, l’anticipation de difficultés économiques susceptibles de provenir d’une mutation technologique annoncée a justifié une réorganisation de l’entreprise conduisant à des licenciements économiques. Ceux-ci ont été jugés nécessaires à la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise. La Cour précise qu’il « ne pouvait être reproché à l’employeur d’avoir anticipé des difficultés économiques prévisibles et mis à profit une situation financière saine pour adapter ses structures à l’évolution de son marché dans les meilleures conditions. »
S’agissant de la prédiction de contraintes futures, la démonstration de leurs conséquences prévisibles ne peut reposer que sur des hypothèses fragiles et ne peut être attestée par des pièces comptables, des bilans et des preuves matérielles manifestes et incontestables. A fortiori, les scénarios présentés par l’entreprise pour s’adapter à des situations futures hypothétiques ne peuvent qu’être conjecturaux. La Cour de cassation s’est rendue compte de son audace malheureuse en faisant publier, par son service de documentation et d’études, sur son site Internet, un communiqué précisant que « la source des difficultés futures doit être démontrée et appelle des mesures d’anticipation. »
Faute de pouvoir apprécier la réalité de la menace alléguée en l’absence d’éléments de preuve tangibles, si le juge n’est pas non plus habilité à apprécier à tout le moins les moyens mis en œuvre pour bâtir des scénarios d’adaptation de l’entreprise à cette menace, à juger les intentions révélées par ces scénarios et à s’assurer que le scénario retenu est le plus favorable au maintien de l’emploi, une telle jurisprudence aurait purement et simplement vidé de son contenu matériel le droit du licenciement pour ne maintenir que des prescriptions formelles.
Cette audace se croyait autorisée par le raisonnement suivi par le Conseil constitutionnel dans le considérant 47 de sa décision du 12 janvier 2002 sur la loi de modernisation sociale. Mais, à le considérer attentivement, ce raisonnement apparaît suffisamment ambigu pour qu’une nouvelle interprétation vienne en corriger les contradictions latentes :
« 47. Considérant, en deuxième lieu, qu'en ne permettant des licenciements économiques pour réorganisation de l'entreprise que si cette réorganisation est " indispensable à la sauvegarde de l'activité de l'entreprise " et non plus, comme c'est le cas sous l'empire de l'actuelle législation, si elle est nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, cette définition interdit à l'entreprise d'anticiper des difficultés économiques à venir en prenant des mesures de nature à éviter des licenciements ultérieurs plus importants. »
Le raisonnement du Conseil conforte le motif prétorien de sauvegarde de la compétitivité au nom de l’anticipation des difficultés. Il va même au-delà de la jurisprudence précédente de la Cour de cassation qui, en l’absence de difficultés économiques immédiates ou de mutations technologiques, n’admet les licenciements économiques destinés à sauvegarder la compétitivité d’une entreprise que dans le cadre d’une réorganisation indispensable. Pour le Conseil, les mesures de licenciement n’ont pas besoin d’être indispensables. Il suffit qu’elles minimisent les licenciements anticipés dans les autres scénarios d’adaptation. Cette extension interprétative est suivie par la Cour dans ses arrêts Pages Jaunes.
Mais, pour les besoins de son argumentation, le Conseil réintroduit une comparaison entre stratégies entrepreneuriales et un critère objectif de choix parmi les scénarios, à savoir celui qui est le plus favorable au maintien de l’emploi, critère qu’il s’autorise à poser et dont il tire la justification de sa décision, alors qu’il prétend, tout comme la jurisprudence de la Cour de cassation posée en assemblée plénière par l’arrêt SAT du 8 décembre 2000, l’interdire au juge, en lui défendant d’apprécier le choix fait par l’entrepreneur entre les différentes solutions possibles d’adaptation de son entreprise aux difficultés.
Comme le souligne le rapport n° 1686 de M. Christian Paul sur la proposition de loi n° 1621 déposée sous la précédente législature, selon l’arrêt SAT, « l’employeur peut choisir, sans que le juge puisse juger de la pertinence et remettre en cause ce choix au nom de la préservation de l’emploi, la solution qui entraîne le plus grand nombre de licenciement. L’employeur, en l’espèce, qui aurait pu choisir de limiter le nombre de licenciements à 86, a pu valablement licencier 318 salariés. »
À l’inverse, tout aussi favorable à la liberté d’entreprise que soit la jurisprudence du Conseil constitutionnel, elle dément implicitement sur ce point précis celle de la Cour et autorise le législateur à ordonner les critères selon lesquels l’employeur choisit une stratégie d’adaptation de l’entreprise à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques, en reconnaissant une position éminente, parmi ces critères, à la limitation des suppressions d’emploi, le juge étant alors habilité non pas à substituer son appréciation à celle de l’employeur, mais à vérifier que sa décision a respecté l’ordre des critères. Ce n’est qu’entre deux solutions également favorables à l’emploi que l’employeur peut choisir souverainement sans avoir à justifier son choix.
L’article premier de la présente proposition de loi répond à cette interprétation la plus cohérente de l’argumentation du Conseil constitutionnel ainsi qu’à la lettre du considérant 47 de sa décision, pour lever les ambiguïtés de la jurisprudence de la Cour de cassation tirée de cette décision. À la suite de la définition du licenciement économique, au premier alinéa de l’article L. 1233-3 du code du travail, il ajoute une obligation, pour l’employeur, de « justifier de manière précise l’ensemble des mesures prises afin de limiter la suppression d’emploi ».
Il s’agit de motiver le licenciement en apportant des éléments de preuve permettant aux salariés, à leurs représentants, à l’autorité publique et, en dernier ressort, au juge du contrat, de vérifier que les mesures dommageables qui résulteront des licenciements n’ont pas d’alternatives plus favorables pour les salariés. Cette obligation ne conduit pas le juge « à substituer son appréciation à celle du chef d'entreprise quant au choix entre les différentes solutions possibles », ce que le Conseil constitutionnel a indiqué désapprouver dans sa décision du 12 janvier 2002. Elle lui permet de s’assurer que des solutions sérieuses, alternatives au licenciement, ont bien été instruites par l’employeur dès que les difficultés pouvaient être prévues et que l’employeur ne s’est pas soustrait à l’obligation de moyens qui lui est faite, la préférence devant aller de droit, parmi ces solutions, à celles qui préservent le plus l’emploi, suivant un critère objectif.
Par la précision qu’il apporte, cet alinéa répond aussi à l’objection élevée par le même Conseil constitutionnel contre une disposition de portée plus limitée, figurant dans la loi du 19 septembre 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail. Cette disposition ne concernait que les plans sociaux et avait pour but de limiter le nombre de licenciements collectifs en incitant les employeurs à leur trouver, par la négociation, dans la réduction du temps de travail, une alternative.
Le Conseil avait estimé non pas que le législateur avait excessivement porté atteinte à la liberté d’entreprendre mais qu’à l’inverse, il n’avait pas pleinement exercé sa compétence en ne précisant pas suffisamment cette procédure préalable aux plans sociaux, devant permettre d’en limiter les conséquences sur l’emploi, en « laissant aux autorités administratives et juridictionnelles le soin de déterminer si cette obligation est une condition de validité du plan social, et si son inobservation rend nulles et de nul effet les procédures de licenciement subséquentes. »
L’alinéa ajouté, conformément aux vœux du Conseil, établit nettement que l’obligation de limiter les suppressions d’emploi prévaut sur la faculté de licencier des salariés pour des motifs économiques et qu’elle en est une cause d’empêchement équivalente aux causes positives susceptibles de justifier ces licenciements. Leur motivation doit être, pour l’employeur, l’objet des mêmes soins et d’une même précision, l’examen des alternatives au licenciement ne devant pas être ignoré dans la définition des stratégies de l’entreprise.
Cette obligation faite à l’employeur ne concerne pas seulement les licenciements prévus par des plans sociaux mais tous les licenciements pour motifs économiques, qu’ils soient individuels ou collectifs. Elle conforte l’impératif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences que l’article L. 2242-15 n’applique qu’aux grandes entreprises. Si, pour ces dernières, l’anticipation des conséquences des évolutions économiques et technologiques sur la qualification des catégories d’emplois doit être réalisée dans le cadre d’une procédure négociée, cette anticipation s’impose également aux autres employeurs.
En l’absence d’une telle anticipation, l’employeur, confronté à des difficultés prévisibles pouvant le conduire à des licenciements économiques, serait exposé au grief de légèreté blâmable s’il n’avait pas tenté de prévenir ces difficultés. Devant conduire dans l’urgence des études de solutions alternatives alors que ces difficultés se seront imposées, il appartiendra au juge d’examiner le sérieux, l’étendue et la précision des différentes solutions étudiées par l’employeur au regard de ce grief. Incluses ou conduites à l’occasion de l’élaboration d’un plan de sauvegarde de l’emploi, lorsque le nombre de salariés de l’entreprise et le nombre de licenciements prévus l’imposent, ces études n’en seront pas moins requises en dehors d’un tel plan.
*
La Commission rejette l’article 1er.
Article 2
(art. L. 1233-2 du code du travail)
Présomptions irréfragables d’absence de cause réelle et sérieuse de licenciements économiques
L’article L. 1233-2 du code du travail impose que les licenciements économiques soient motivés par une cause réelle et sérieuse. Si l’appréciation de ces deux critères dépend du cas d’espèce, étant entendu que les causes licites sont définies par l’article suivant du code, le législateur peut néanmoins guider l’appréciation faite par le juge du contrat en posant des présomptions irréfragables d’absence d’une telle cause.
C’est pourquoi l’article 2 de la proposition de loi introduit, par deux alinéas ajoutés à l’article L. 1233-2, deux présomptions irréfragables d’absence de cause réelle et sérieuse de licenciement économique, susceptibles d’être opposées non seulement à la motivation d’un licenciement économique individuel ou collectif, mais aussi, par extension, à celle de toute suppression d’emploi consécutives à des départs en retraite non remplacés, à des ruptures conventionnelles ou bien intervenant dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi ou d’un plan de départs volontaires.
Ces deux présomptions irréfragables orientent le contrôle que le juge exerce sur la réalité des difficultés économiques alléguées par l’entreprise en définissant des éléments de preuve incontestables de l’absence manifeste de telles difficultés. Elles se fondent sur une hiérarchisation des intérêts qui constituent l’objet social de l’entreprise qui conforte la position éminente du maintien de l’emploi par rapport à celle, subalterne, de la maximisation des profits pour les détenteurs du capital social de l’entreprise, le développement et l’adaptation de l’activité aux difficultés économiques et aux mutations technologiques occupant une position intermédiaire.
La première présomption concerne l’entreprise qui « a constitué des réserves ou réalisé un résultat net ou un résultat d’exploitation positifs au cours des deux derniers exercices comptables. » La jurisprudence de la Cour de cassation considère déjà que la volonté d’améliorer la compétitivité d’une entreprise en supprimant des postes, la volonté de privilégier le niveau de rentabilité de l’entreprise au détriment de la stabilité de l’emploi ou la réorganisation d’une entreprise en vue d’accroître des marges positives ne sauraient justifier des licenciements économiques.
Même l’appréciation de difficultés économiques alléguées pour justifier des licenciements a fait l’objet d’une interprétation jurisprudentielle restrictive. Plusieurs arrêts de la Cour ont établi que la réalisation d’un chiffre d’affaires moindre au cours des deux derniers exercices, la dégradation des marges et la baisse des bénéfices réalisés ne suffisaient pas à prouver des difficultés économiques justifiant des licenciements.
Le texte proposé ne fait que conforter cette jurisprudence en ajoutant une preuve a contrario d’absence de difficultés économiques, d’autant plus aisée à établir qu’elle se fonde sur le compte de résultat de l’entreprise. Seule celles qui réalisent des pertes d’exploitation qui ne sont pas compensées par un excédent financier ou exceptionnel ou par l’existence, dans le bilan, de réserves facultatives, seraient fondées à procéder à des licenciements économiques.
Cette présomption vise à restreindre l’extension interprétative donnée par la jurisprudence à la motivation de licenciements économiques par l’allégation de difficultés économiques non pas attestées mais seulement anticipées. La difficulté à prouver au cas par cas la réalité des menaces anticipées, alors même que les comptes de l’entreprise ou les statistiques publiques portant sur les secteurs d’activité ne peuvent les attester qu’après coup pour les uns et à très court terme pour les autres, conduit à abuser de ce motif de licenciement.
On peut néanmoins admettre que des difficultés économiques et des mutations technologiques, anticipées et prouvées, puissent être prévenues par des mesures qui limiteraient les suppressions d’emplois prévisibles, comme le suggère la jurisprudence. L’une des preuves de cette anticipation serait la constitution de réserves dans une entreprise en vue de financer la formation, le reclassement et, au pire, l’indemnisation des salariés dont les postes sont menacés.
Cette constitution de réserves peut donner lieu à des abus et elle ne peut être avancée comme preuve de l’anticipation des difficultés ou de mutations réelles et sérieuses qu’à condition que les plans d’adaptation et de réorganisation de l’entreprises soient soumis à l’appréciation du juge, afin de vérifier que les mesures, que ces réserves sont destinées à financer, sont exclusivement favorables au maintien de l’emploi. Sous cette condition, votre rapporteur a proposé un amendement visant à retrancher les mots « des réserves ou » dans l’alinéa 2 de l’article 2.
La seconde présomption irréfragable d’absence de cause réelle et sérieuse de licenciement économique atteint l’entreprise qui a, « au cours des deux derniers exercices comptables, distribué des dividendes ou des stocks options ou des actions gratuites ou procédé à une opération de rachat d’actions. »
Une disposition analogue a été adoptée par la commission des affaires sociales du Sénat lors de l’examen, le 8 février 2012, de la proposition de loi de Mme Annie David tendant à interdire les licenciements boursiers. Elle avait précédemment été proposée à l’Assemblée nationale par l’article premier de la proposition de loi n° 1621 de Mme Marie-George Buffet.
Les licenciements dits boursiers illustrent les effets pernicieux de la financiarisation de l’économie qui conduit à faire prévaloir l’intérêt à court terme du détenteur momentané du capital social sur les autres intérêts qui composent l’objet social de l’entreprise. C’est en abusant de l’anticipation de prétendues menaces pesant sur la rentabilité de l’entreprise que les propriétaires de ce capital et les dirigeants de l’entreprise qui entrent dans leurs vues justifient les licenciements économiques et les suppressions d’emplois prononcés au nom de la sauvegarde de la compétitivité, c’est-à-dire de la rentabilité du capital et du taux de profit des actions.
Le risque sans cesse agité, indépendamment de toute difficulté actuelle de l’entreprise ou de toute évolution technologique prévisible susceptible de troubler son activité, est celui d’une prise de contrôle du capital par des investisseurs ayant intérêt à démanteler l’entreprise et à vendre ses actifs pour rentrer dans leurs frais, en escomptant que la valeur patrimoniale de ces actifs serait supérieure aux coûts d’acquisition de la majorité de son capital, ce coût d’acquisition ne dépendant que des évolutions anticipées du taux de rentabilité marginal de ce capital.
C’est le risque mis en avant en 1999 par Michelin ou en 2001 par Danone pour justifier des restructurations entraînant des suppressions d’emplois dans des groupes largement bénéficiaires et distribuant des dividendes généreux à leurs actionnaires. L’objectif visé par les directions de ces entreprises, qui tient lieu de critère d’évaluation de leur compétitivité, n’est ni leur rentabilité nette ni les perspectives d’évolution de leurs activités, mais le taux de marge relatif de chacune d’elle puisque ce taux détermine le cours de bourse du groupe et le rapport entre le montant des dividendes qui seront distribués et la part du capital du groupe que représente l’activité en cause. Lorsqu’une activité réduit les dividendes attendus du capital du groupe, il devient avantageux de liquider la part du capital investie dans cette activité, la restructuration étant le plus souvent synonyme de cessation d’activité.
Non seulement les investisseurs récupèrent leur mise mais les détenteurs du reste du capital du groupe en profitent également, puisque le cours de leurs actions se redresse et met le groupe à l’abri d’une nouvelle prise de participations hostile. Lorsque le taux de rentabilité du capital investi, mesuré par le montant des dividendes attendus à court terme, devient le critère d’évaluation de la compétitivité d’une entreprise et que la concurrence mondiale met aux prises des économies ayant des structures de coûts de production disparates, la poursuite d’objectifs purement financiers conduit à des délocalisations brutales des productions mobiles.
L’un des moyens de limiter ces transferts est de relever le coût des licenciements économiques abusifs en introduisant une présomption irréfragable d’absence de menace pesant sur l’activité d’une entreprise, lorsque celle-ci est en mesure de distribuer des dividendes à ses actionnaires, de rémunérer ses dirigeants par des stocks options qui confirment qu’ils anticipent une hausse de la valeur de bourse de l’entreprise, d’allouer des actions gratuites qui diluent la valeur du capital en l’absence d’une hausse de la rentabilité de l’entreprise ou d’augmenter cette valeur par des rachats d’actions.
*
La Commission examine l’amendement AS 1 du rapporteur.
M. le rapporteur. Il s’agit de ne pas exclure les motifs de licenciement économique tirés de l’anticipation de difficultés économiques ou de mutations technologiques en prévision desquelles l’entreprise a constitué des réserves, et de permettre au juge d’apprécier la réalité et le sérieux des menaces alléguées sur l’activité des entreprises.
La Commission rejette l’amendement AS 1.
Puis elle rejette l’article 2.
Article 3
(art. L. 1235-14 du code du travail)
Remboursement des aides publiques perçues par un employeur qui procède à des licenciements économiques sans cause réelle et sérieuse
Le code du travail prévoit que des sanctions sont infligées aux employeurs qui procèdent à des licenciements économiques irréguliers, soit parce qu’ils sont injustifiés, soient parce qu’ils n’ont pas été prononcés conformément aux procédures légales. Ces sanctions sont de deux types. Les sanctions générales prévues par les articles L. 1235-3 et L. 1235-4, applicables aux deux catégories de licenciements, pour motif personnel ou économique, prévoient la réintégration du salarié ou, à défaut, son indemnisation et le remboursement, par l'employeur fautif, des indemnités de chômage versées au salarié licencié.
Les articles L. 1235-11 à L. 1235-13 leur ajoute des sanctions qui ne s’appliquent qu’aux licenciements économiques irréguliers. L’article L. 1235-11 prévoit la réintégration et, à défaut, l’indemnisation du salarié dont le licenciement économique est déclaré nul. Les articles L. 1235-12 et L. 1235-13 autorisent l’indemnisation d’un salarié dont le licenciement, sans être nul, est déclaré irrégulier pour des raisons formelles, à savoir l’absence de consultation, par l’employeur, des représentants du personnel ou l’absence d'information de l'autorité administrative ou bien encore le non-respect de la priorité de réembauche du salarié irrégulièrement licencié.
Les articles L. 1235-5 et L. 1235-14 épargnent toutefois aux employeurs de moins de 11 salariés les sanctions des deux types. Ils privent également les salariés qui ont moins de deux ans d’ancienneté dans l’entreprise de la contrepartie avantageuse de ces sanctions, à savoir leur réintégration ou leur indemnisation. Ce privilège d’immunité accordé aux petites entreprises et ce défaut de protection qui expose les salariés ayant peu d’ancienneté se justifient d’autant moins dans le cas d’un licenciement économique que la personnalité du salarié n’est pas en cause. C’est pourquoi l’article 3 de la proposition de loi met fin à l’exemption des sanctions et des protections instaurée aux bénéfices des unes et au détriment des autres par l’article L. 1235-14 du code du travail.
Les petites entreprises seront assujetties au régime de droit commun de la sanction des irrégularités dans le respect des procédures de licenciement. Les salariés n’ayant pas deux ans d’ancienneté dans une entreprise, qu’elle soit petite ou grande, auront droit aux mêmes protections et aux mêmes réparations des préjudices subis en cas de licenciement irrégulier, abusif ou nul, que les autres salariés.
L’article 3 de la proposition de loi ne s’en tient pas là. Afin d’inciter davantage les entreprises à respecter les procédures de licenciement prévues par le code et de ne pas y recourir sans un motif économique réel et sérieux, il ajoute des sanctions supplémentaires à celles prévues par les articles L. 1235-11 à L. 1235-13. L’employeur qui s’est rendu coupable d’un licenciement économique abusif ou qui a supprimé des emplois sans cause réelle et sérieuse, alors même qu’il aura auparavant, par un effet d’aubaine, bénéficié, pour maintenir ces emplois, de la réduction dégressive des cotisations sociales à la charge de l'employeur assises sur les gains et rémunérations inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 60 %, dite « réduction Fillon », définie par l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, sera condamné à rembourser les sommes correspondantes aux organismes de sécurité sociale.
Le remboursement des aides perçues par l’employeur ne portant que sur les cotisations dues pour les emplois faisant l’objet du licenciement abusif ou de la suppression sans cause économique réelle et sérieuse, son prononcé peut être de droit sans atteinte à la proportionnalité et à l’individualité des peines et sanctions.
L’article 3 de la proposition de loi prévoit également qu’en cas de licenciement économique non pas seulement abusif mais déclaré nul, le juge prive l’employeur, pour cinq ans du bénéfice des crédits d’impôts accordés pour des dépenses de recherche effectuées par les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles ou pour la compétitivité et l'emploi, selon les termes des articles 244 quater B et quater C du code général des impôts. Si l’employeur a déjà bénéficié de ces crédits d’impôts, le juge a la faculté d’exiger de lui leur remboursement à l’Etat.
*
M. Denys Robiliard. Comme je l’ai expliqué, ainsi que Annie Le Houérou, la position du groupe SRC ne porte pas sur le fond ; elle découle d’un problème de méthode : la non-application du protocole Accoyer, pendant à l’Assemblée nationale du protocole Larcher. En outre, toute la proposition de loi devrait être reprise à la lumière des modifications que va apporter au code du travail la loi sur la sécurisation de l’emploi. Cela dit, le groupe GDR n’est bien sûr pas responsable de cette situation qui résulte du calendrier parlementaire, lequel aurait dû être modifié pour que nous puissions discuter en connaissance de cause et de manière utile.
M. Jean-Louis Roumegas. Le groupe écologiste est favorable à l’article 3, dont l’enjeu excède celui de la proposition de loi. À nos yeux, les aides publiques aux entreprises devraient toujours être conditionnées, sans quoi l’on est fondé à s’interroger sur leur efficacité. L’article a le mérite de permettre cette conditionnalité a posteriori, en cas de licenciement.
La Commission rejette l’article 3.
Article 4
(art. L. 1235-10 du code du travail)
Causes matérielle et formelle de la nullité des procédures collectives de licenciements économiques
Le code du travail définit des procédures de licenciement de plus en plus contraignantes à mesure que le nombre de salariés de l’entreprise et le nombre de ceux qu’elle prévoit de licencier augmentent. Il sanctionne par une sévérité proportionnée les irrégularités commises par les entreprises qui ne respectent pas ces procédures.
Les articles L. 1235-10 à L. 1235-13 et L. 1235-15 fixent les régimes de sanctions applicables aux irrégularités qui entachent le respect, par les entreprises, des procédures de licenciement collectif pour motif économique. L’article L. 1235-10 applique la sanction la plus sévère, à savoir le prononcé de la nullité de la procédure de licenciement collectif, aux entreprises qui ne respectent pas une obligation d’information des représentants du personnel à propos du plan de reclassement inclus dans le plan de sauvegarde de l’emploi définie par l’article L. 1233-61.
Cet article oblige les entreprises de plus de 50 salariés qui envisagent de licencier, pour un motif économique, plus de dix d’entre eux dans une même période de trente jours à « établir et mettre en œuvre un plan de sauvegarde de l’emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre. » Le plan de reclassement doit être « présenté par l'employeur aux représentants du personnel, qui doivent être réunis, informés et consultés ».
Une controverse jurisprudentielle récente a opposé la cour d’appel de Paris à la Cour de cassation sur cet article. Dans son arrêt n° 1299 du 3 mai 2012 sur l’affaire Viveo France, la chambre sociale de la Cour de cassation a cassé l’arrêt rendu le 12 mai 2011 par la cour d’appel de Paris, qui établissait que la nullité de la procédure de licenciement, prévue pour des irrégularités de forme par l’article L. 1235-10 du code du travail, emportait par principe la même nullité pour une irrégularité de fond déterminante, à savoir l’absence de cause économique réelle et sérieuse des licenciements prévus par cette procédure, puisque cette cause est le fondement même et l’élément déclenchant de la procédure.
La Cour de cassation n’a pas suivi le raisonnement de la cour d’appel et a préféré s’en tenir à la lettre de l’article du code. Seule l’absence ou l’insuffisance du plan de sauvegarde de l’emploi soumis aux représentants du personnel entraîne la nullité de la procédure de licenciement, que les licenciements prévus soient ou non dûment motivés. L’irrégularité de forme est ainsi plus sévèrement sanctionnée que l’irrégularité de fond, pourtant plus importante pour juger du bien-fondé de la procédure de licenciement contestée.
Pour se justifier, la Cour a publié un communiqué selon lequel la nullité ne peut être appliquée que pour des irrégularités de forme et non de fond : « cette délimitation du champ de la nullité résulte de la prise en compte de la volonté du législateur qui, par la loi du 27 janvier 1993, entendait faire du plan de sauvegarde de l’emploi le moyen d’éviter des licenciements, l’absence de cause économique n’ouvrant droit qu’au paiement de dommages-intérêts au bénéfice du salarié licencié, en application des articles L. 1235-3 et L.1235-5 du code du travail. »
Le défaut manifeste du raisonnement suivi par la Cour se couvre d’une référence faite à la lettre du code et surtout à la volonté du législateur. Pour redresser cette jurisprudence malheureuse, le législateur doit donc préciser sa volonté. L’article 4 de la proposition de loi l’invite à reprendre à son compte le raisonnement tenu dans l’affaire Viveo France par la cour d’appel de Paris. Le texte proposé prévoit que l’irrégularité de fond principale, à savoir l’absence de motif économique d’un licenciement collectif de plus de dix salariés, en trente jours, dans une entreprise d’au moins 50 salariés, emporte, tout autant que l’irrégularité de forme concernant la consultation des représentants du personnel, la nullité de la procédure de licenciement. L’absence de motif économique est établie par référence à la définition de ces motifs donnée par l’article L. 1233-3 du code, dont l’article premier de la proposition de loi avance une nouvelle formulation.
La rédaction retenue par l’article 4 de la proposition de loi présente toutefois une faiblesse qui renverse l’intention de son auteur. Elle subordonne la cause formelle de nullité du licenciement à une condition préalable ajoutée au texte actuel, tenant au motif du licenciement, et aboutit ainsi à restreindre les cas de nullité aux seuls licenciements dûment motivés mais formellement irréguliers, au lieu de sanctionner la nullité dans les deux cas d’irrégularité, matérielle et formelle.
En indiquant que « lorsque le projet de licenciement dont le motif doit être conforme aux dispositions de l’article L. 1233-3 concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, la procédure de licenciement est nulle tant que le plan de reclassement… n’est pas présenté… », cette rédaction suggère que la nullité pour défaut d’information ne s’applique plus qu’aux licenciements dûment motivés. Cette rédaction serait en retrait par rapport au régime de sanction actuel instauré par le premier alinéa de l’article L. 1235-10. Elle laisserait dans l’incertitude le sort des procédures formellement irrégulières mais indûment motivées.
On ne saurait admettre comme conforme à l’intention de l’auteur de la proposition de loi de ne pas sanctionner au moins aussi sévèrement une double irrégularité, matérielle et formelle, qu’une simple irrégularité formelle. C’est pourquoi votre rapporteur a présenté un amendement qui met sur un même plan les deux irrégularités et les sanctionne d’une égale sévérité. L’alinéa amendé serait ainsi rédigé :
« Art. L. 1235-10 – Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciements concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, la procédure de licenciement est nulle si son motif n’est pas conforme aux dispositions de l’article L. 1233-3 et tant que le plan de reclassement des salariés prévu à l’article L. 1233-61 et s’intégrant au plan de sauvegarde de l’emploi n’est pas présenté par l’employeur aux représentants du personnel, qui doivent être réunis, informés et consultés. »
À la suite de cet alinéa, l’article 4 de la proposition de loi ajoute une précision relative au périmètre d’appréciation des motifs économiques du licenciement qui reprend une hiérarchie à trois niveaux, l’entreprise, l’unité économique et sociale puis le groupe, conforme à la jurisprudence confirmée par la Cour de cassation. Le texte reprend ensuite un alinéa qui figure actuellement dans l’article L. 1235-10 et précise les moyens d’appréciation du plan de sauvegarde de l’emploi, selon un périmètre identique à celui fixé précédemment pour l’appréciation des motifs économiques du licenciement.
L’article 4 de la proposition de loi introduit ensuite dans l’article L. 1235-10 du code deux alinéas supplémentaires. Le premier étend les critères d’appréciation de la validité du plan de sauvegarde de l’emploi au « respect des obligations en matière de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ». Cette condition s’inspire d’une jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation qui tient compte de la volonté du législateur de prévenir des licenciements économiques. Selon cette jurisprudence, l’employeur doit utiliser tous les moyens de formation et d’adaptation des salariés à la modification des emplois requise par l’évolution qu’il anticipe de l’activité de son entreprise.
La Cour n’a pas osé faire de l’obligation triennale de négocier sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences une condition de la validité d’un plan de sauvegarde de l’emploi, tout en suggérant que des licenciements économiques pourraient être considérés comme une défaillance de cette gestion destinée à les prévenir.
La Cour a cependant renversé, dans un arrêt du 21 novembre 2006, l’usage habituellement fait de la notion de sauvegarde, par anticipation, de la compétitivité pour imposer le respect de cette obligation de négociation et prévenir, par ce moyen, des licenciements futurs : « une nouvelle organisation mise en place qui procédait d’une gestion prévisionnelle des emplois destinée à prévenir des difficultés économiques à venir et leurs conséquences sur l’emploi était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise. » Au lieu de justifier des licenciements, cette notion pourrait aussi bien imposer de les prévenir.
Le texte de la proposition de loi prend au mot cette jurisprudence et invite le juge du plan de sauvegarde de l’emploi à apprécier sa validité au regard d’une démarche de prévention des licenciements suivie par l’entreprise qui commence par des négociations en matière de gestion prévisionnelle, lesquelles imposent une information régulière des représentants du personnel et des comités d’entreprise sur la situation économique de l’entreprise, ses perspectives d’évolution et plus encore sur les stratégies envisagées par ses dirigeants, ce que l’article 4 traduit par « la nécessité d’informer le plus en amont possible les représentants du personnel ».
Dans la même logique, le second alinéa inséré par l’article 4 de la proposition de loi dans l’article L. 1235-10 du code du travail ajoute trois conditions requises pour que les obligations d’information et de consultation des représentants du personnel sur le plan de reclassement, fixées par le premier alinéa de l’article à peine de nullité de la procédure, puissent être considérées par le juge comme satisfaites. La première condition est que l’information et la consultation revêtent un caractère loyal. La deuxième condition impose qu’elles soient également sincères. La troisième condition exige que la consultation ait un effet utile. Ces trois conditions impliquent que les informations communiquées soient complètes et fiables, fussent-elles couvertes au besoin par une clause de confidentialité. Elles nécessitent aussi que les informations soient transmises dans des délais qui permettent la tenue des consultations et des négociations.
À la différence du caractère matériel des obligations d’information et de consultation, qui est attesté sans contestation factuelle, leur caractère loyal et sincère relève d’une appréciation des intentions dont le défaut ne peut être prouvé de la même manière. Les conséquences sur l’irrégularité de la procédure du défaut de loyauté et de sincérité, de même que l’évaluation de l’effet utile doivent être laissées à l’initiative du juge du fond. L’annulation de la procédure pourra être prononcée pour ces motifs mais ne le sera pas de droit comme celle qui sanctionne les irrégularités définies par le premier alinéa de l’article.
L’appréciation de la loyauté et de la sincérité de l’information et de la consultation des représentants des salariés par le juge n’a cependant rien de subjective. Elle reste factuelle et s’exerce conformément aux dispositions fixées par la directive 2002/14/CE. Les représentants des salariés doivent pouvoir, soit d’eux-mêmes, soit avec l’aide d’experts mandatés par le comité d’entreprise, entrer dans une négociation permettant de comparer les solutions alternatives qui s’offrent à l’entreprise, d’améliorer le projet qui a la préférence de la direction et, le cas échéant, de soumettre à cette dernière une contre-proposition. Ces trois modalités définissent l’effet utile de la consultation qui est prouvé par ses résultats, principalement en matière de limitation des suppressions d’emplois.
Le dernier alinéa de l’article, qui épargne la sanction de nullité aux licenciements collectifs irréguliers décidés dans des entreprises en redressement ou liquidation judiciaires, est maintenu sans changement.
*
La Commission rejette l’amendement rédactionnel AS 2 du rapporteur.
Puis elle rejette l’article 4.
Article 5
(art. L. 1233-25 du code du travail)
Application des procédures de licenciements collectifs aux refus collectifs de modification de contrats de travail
Les articles L. 1233-8 à L. 1233-57 du code du travail définissent les procédures applicables au licenciement collectif de salariés pour motif économique pendant une même période de trente jours, en particulier les modalités d’information et de consultation des représentants du personnel et des comités d’entreprise ou d’établissement. Ces procédures sont plus contraignantes pour l’entreprise si le nombre de salariés concernés est égal ou supérieur à dix. Les représentants du personnel doivent être réunis plusieurs fois et le comité d’entreprise peut obtenir l’assistance d’un expert-comptable rémunéré par l’employeur, tandis que l’administration, informée du projet de licenciement par avance, a le temps nécessaire pour agir s’il lui semble irrégulier.
Alors que l’article L. 1233-3 du code du travail étend la définition du licenciement économique à la modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, l’article L. 1233-25 n’accorde aux salariés menacés d’un licenciement économique pour cette raison la protection des procédures légales qu’à partir d’un seuil de dix salariés concernés pendant une période de trente jours. Les articles L. 1233-26 et L. 1233-27 prévoient toutefois d’étendre cette protection dès lors que des licenciements successifs en moindre nombre s’accumulent sur un trimestre ou une année civile. Ils instaurent des mesures de contrôle de ce seuil sur des périodes plus longues que les trente jours consécutifs, permettant de faire bénéficier les salariés licenciés individuellement ou par groupes moins nombreux des garanties prévues pour les licenciements collectifs de plus de dix salariés.
Le seuil de dix salariés licenciés pendant une même période de trente jours a des conséquences lourdes pour l’employeur qui peut être tenté de s’y soustraire. Pour éviter de se soumettre aux procédures de licenciement collectif, l’employeur peut être tenté de présenter les mesures économiques d’adaptation de l’entreprise à des difficultés ou à des mutations comme des modifications des contrats de travail individuels inacceptables pour les salariés. Leur refus devient alors un motif légal de licenciement non plus d’un groupe de salarié mais de chacun d’eux individuellement, l’employeur pouvant soutenir qu’il n’avait pas d’intention de tous les licencier mais qu’il s’y trouve contraint par leur refus.
Pour qu’un tel artifice ne permette pas à l’employeur de se soustraire aux obligations du licenciement collectif, l’article L. 1233-25 du code du travail prévoit que « lorsqu'au moins dix salariés ont refusé la modification d'un élément essentiel de leur contrat de travail, proposée par leur employeur pour l'un des motifs économiques énoncés à l'article L. 1233-3 et que leur licenciement est envisagé, celui-ci est soumis aux dispositions applicables en cas de licenciement collectif pour motif économique. »
Cette rédaction aboutit toutefois à ce que les modifications en chaîne, pour un motif économique et non personnel, de moins de dix contrats de travail, dès lors qu’elles sont refusées par les salariés concernés, restent considérées en droit comme des causes de licenciement économique individuelles et non collectives, l’employeur n’ayant pas l’obligation d’informer des licenciements les représentants des salariés, le comité d’entreprise et l’administration.
Aux mêmes fins que précédemment, l’article 5 de la proposition de loi modifie la rédaction de l’article L. 1233-25 pour établir que plusieurs modifications de contrat de travail pour motifs économiques, refusées par les salariés, caractérisent suffisamment une intention implicite de l’employeur de procéder à leur licenciement. Elles doivent à ce titre être considérées comme formant un projet de licenciement économique collectif, soumis aux mêmes obligations légales que les projets de licenciement collectif explicitement annoncés. L’article 5 tire la conséquence de la suppression du seuil des dix salariés dans l’intitulé du paragraphe 2 qui introduit l’article L. 1233-25.
*
La Commission rejette l’article 5.
Article 6
(art. L. 1222-8 du code du travail)
Application des procédures de licenciements aux refus collectifs de modification des contrats de travail, même en cas d’accord de réduction du temps de travail
L’article 6 de la proposition de loi suit la même logique que l’article 5, en considérant que plusieurs refus de modification d’un contrat de travail caractérisent une intention implicite de l’employeur de licencier les intéressés, tout en se soustrayant aux obligations légales posées par les procédures de licenciement collectif. Cet article ne concerne plus le cas général des modifications d’un élément essentiel du contrat de travail, visé par l’article L. 1233-25 du code, mais le cas particulier des modifications induites par un accord de réduction du temps de travail.
L’article 1233-25 ne couvre pas toutes les modifications apportées au contrat de travail mais seulement celles qui affectent un élément essentiel du contrat. Cette restriction est destinée à préserver le pouvoir de direction de l’employeur qui, en vertu de la subordination à laquelle le salarié consent par son contrat de travail, dispose à son égard de la faculté de fixer et de changer ses conditions de travail en fonction de l’activité de l’entreprise, alors même que le contrat est supposé définir ces conditions.
Cette restriction a d’abord été posée par la jurisprudence de la Cour de cassation, qui a distingué les modifications substantielles des modifications accessoires puis, parmi les premières, celles qui affectent les éléments essentiels ou non essentiels du contrat. Les termes de cette restriction ont ensuite été modifiés par l’article 73 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale qui a retenu l’expression d’élément essentiel du contrat de travail.
La portée de cette notion reste néanmoins indéterminée et laissée à l’appréciation du juge du contrat. En revanche l’article L. 1222-7 du code du travail, issu de l’article 30 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail, lui donne une portée précise à l’égard des modifications du contrat de travail emportées par un accord de réduction du temps de travail. Cet article déclare que : « la seule diminution du nombre d'heures stipulé au contrat de travail en application d'un accord de réduction de la durée du travail ne constitue pas une modification du contrat de travail. »
Selon le rapport au fond n° 1826 sur la première lecture du projet de loi, établi au nom de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales sous la XIe législature, « la démarche de réduction négociée du temps de travail étant présumée favorable aux salariés, notamment du fait de ses modalités de négociation, le projet de loi propose donc de dénier au seul changement du nombre d'heures fixées au contrat de travail la qualité de modification dudit contrat. Le changement du nombre d'heures sera donc considéré comme une simple modification des conditions de travail du salarié qui ne pourra le refuser sans commettre une faute susceptible de conduire à son licenciement. »
La ministre a précisé, lors des débats en première lecture à l’Assemblée le 15 octobre 1999, de manière plus nuancée que tous les refus de modification des horaires de travail ne sauraient être assimilés à une faute et que : « si seule la réduction du temps de travail motive le refus du salarié, s'il n'y a pas d'atteinte à sa rémunération, pas de changement des jours de travail etc. on ne peut parler de modification du contrat de travail. Sinon des salariés désireux de partir ailleurs pourraient en profiter pour se faire licencier aux frais de l'employeur. Si, en revanche, l'accord collectif entraîne des modifications des horaires de travail qui changent la vie du salarié, ou diminuent sa rémunération, alors il y a rupture du fait de l'employeur, sans qu'on puisse parler pour autant de licenciement économique. C'est un licenciement sui generis, qui donne droit à des indemnités de licenciement. »
La jurisprudence de la Cour de cassation, confirmée par plusieurs arrêts en 2004 et 2005, laisse le juge du contrat apprécier si des considérations familiales démontrées sont de nature à justifier le refus d’une modification des horaires stipulée par le contrat de travail, mais même dans ce cas, si la faute grave est écartée, ce refus reste assimilable à une faute simple, constituant une cause réelle et sérieuse de licenciement pour motif personnel. Il en va de même, selon l’article L. 1222-8, lorsque plusieurs salariés de l’entreprise se trouvent dans la même situation.
L’article L. 1222-8 du code du travail présume en effet qu’un accord de réduction du temps de travail exclut que les salariés qui refusent que cet accord modifie leur contrat de travail puissent bénéficier de procédures légales de licenciements collectifs pour motif économique, quand bien même le nombre des salariés menacés de licenciement pour leur refus dépasserait le seuil d’application de cette procédure. L’article retranche du même coup les modifications du temps de travail des salariés des causes de licenciement économique pour en faire une cause réelle et sérieuse de licenciement pour motif personnel, réduisant du même coup les protections légales et les indemnisations ouvertes aux salariés.
L’article 6 de la proposition de loi vise à réintégrer de plein droit les licenciements consécutifs au refus, opposé par un ou plusieurs salariés, d’une modification de leur contrat de travail du fait d’un accord de réduction du temps de travail, parmi les licenciements individuels ou collectifs pour motif économique.
Joint à l’article précédent, qui étend le bénéfice des protections procédurales aux licenciements pour refus d’une modification du contrat dès lors que ces licenciements ne sont pas strictement individuels, le dispositif proposé rétablit l’homogénéité de traitement entre les différentes causes de licenciements économiques, en supprimant la présomption de refus injustifié que l’article L. 1222-8 faisait peser sur les salariés défavorables à l’application à leur contrat d’un accord de réduction de temps de travail.
L’article 6 propose pour cela d’abroger l’article L. 1222-8 du code du travail. En laissant cependant inchangé l’article L. 1222-7, il laisse subsister une double incertitude, livrée à l’appréciation du juge du contrat, sur le caractère fautif du refus opposé par le salarié voire sur son caractère de faute lourde susceptible de le priver de son préavis et de ses indemnités et sur la nature personnelle ou économique du motif du licenciement tiré de ce refus.
Afin de lever cette incertitude, votre rapporteur a proposé un amendement visant à renverser la rédaction de l’article L. 1222-7 du code afin que la modification des horaires à la suite d’un accord de réduction du temps de travail soit assimilée à une modification d’un élément essentiel du contrat de travail. L’article L. 1222-7serait rédigé comme suit : « Lorsqu'un ou plusieurs salariés refusent une modification de leur contrat de travail résultant de l'application d'un accord de réduction de la durée du travail, leur licenciement est un licenciement pour motif économique. »
*
La Commission rejette l’amendement rédactionnel AS 3 du rapporteur, puis elle rejette l’article 6.
(art. L. 1237-11 à L. 1237-16, L. 1231-1 et L. 12133-3 du code du travail)
Abrogation de la rupture conventionnelle du contrat de travail
L’article 5 de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail a introduit, dans le chapitre VII du titre III du livre II de la première partie du code du travail, sur les cas de ruptures du contrat de travail à durée indéterminé distincts d’un licenciement ou d’une démission, une procédure de rupture conventionnelle reprise de l’accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008. Cet accord ayant été étendu par un arrêté du 23 juillet 2008, sa transposition législative et réglementaire n’a eu pour but que de compléter le code du travail pour en faciliter l’application. Cette transposition autorise par contrecoup le législateur à se saisir à nouveau de cette disposition pour en réexaminer le bien-fondé.
La convention de rupture accorde au salarié une indemnité spécifique partiellement exonérée d’impôts. Le salarié peut en outre bénéficier des allocations chômage. Cette disposition ouvre à l’entreprise une voie de suppression d’emplois qui peut échapper aux procédures prévues pour les licenciements. Tant la Direction générale du travail, par son instruction du 23 mars 2010 relative à l'incidence d'un contexte économique difficile sur la rupture conventionnelle d'un contrat à durée indéterminée, que la Cour de cassation, dans ses arrêts du 16 décembre 2008 et du 9 mars 2011, ont tenté d’éviter que les entreprises n’empruntent cette voie pour contourner les règles du licenciement collectif.
La Direction générale du travail s’appuie sur l’homologation obligatoire, par l’administration, des conventions, pour vérifier que le nombre de celles conclues sur des périodes de trente jours, d’un trimestre ou d’une année civile, par un employeur confronté à un contexte économique difficile, ne dissimule pas en fait un plan de licenciement collectif. L’administration enjoint, dans ce cas, l’employeur à renoncer à son projet de convention et à suivre les procédures de licenciements, en respectant en particulier les obligations relatives aux accords collectifs de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ainsi qu’aux plans de sauvegarde de l’emploi, qui sont incompatibles avec des ruptures conventionnelles selon les articles L. 2242-15 et L. 1237-16 du code du travail.
La jurisprudence, établie par la Cour de cassation dans son arrêt du 9 mars 2001, rattache la rupture conventionnelle du contrat de travail non pas au régime civil de la rupture d’un contrat par commun accord ou mutuus dissensus, mais à celui d’une transaction, qui aménage les conséquences d’un licenciement. C’est pourquoi elle prête à la convention de rupture une cause implicite relevant soit d’un motif personnel, soit d’un motif économique. Elle réintègre, dans les procédures individuelles comme dans les seuils de déclenchement des procédures collectives de licenciement économique, les conventions « qui ont une cause économique et s’inscrivent dans un processus de réduction des effectifs dont elles constituent la ou l’une des modalités. »
Ces garanties n’ont cependant pas empêché la multiplication des ruptures conventionnelles dans les entreprises qui déguisent ainsi des licenciements économiques et s’exonèrent, au détriment de l’emploi, des coûts et des contraintes qui pèsent sur ces licenciements. C’est pourquoi l’article 7 de la proposition de loi propose d’abroger ce dispositif et de tirer les conséquences de cette abrogation sur la rédaction des articles L. 1231-1, qui définit les modalités générales de rupture d’un contrat de travail à durée indéterminée, et L. 1233-3, qui définit les licenciements pour motif économique.
*
M. Jean-Louis Roumegas. Le groupe écologiste s’abstiendra lors du vote de cet article.
M. Denys Robiliard. En ce qui concerne la rupture conventionnelle du contrat de travail, nous espérons que l’étude en cours annoncée par M. Sapin permettra de disposer de données objectives. En effet, lorsque, dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2013, nous avons soumis au forfait social les indemnités versées lors d’une rupture conventionnelle du contrat de travail, nous avons constaté que, selon la seule étude existante, cette rupture était d’origine patronale dans deux tiers des cas ; mais cette étude n’était pas assez poussée pour que nous puissions légiférer sur son seul fondement. Dès que nous disposerons de la nouvelle étude, nous pourrons remettre l’ouvrage sur le métier, en consultant les partenaires sociaux puisque la procédure de rupture conventionnelle résulte de l’application d’un accord national interprofessionnel datant de 2008.
La Commission rejette l’article 7.
Article 8
(art. L. 2323-61 du code du travail)
Abrogation d’une dérogation conventionnelle aux modalités légales d’information des comités d’entreprise
Le code du travail comprend plusieurs dispositions qui autorisent des dérogations conventionnelles aux obligations du droit du licenciement légalement posées, dérogations qui s’appliquent non seulement aux parties à la convention mais qui, du fait de leur extension par voie réglementaire, ont également des effets sur les tiers.
Il existe par exemple, dans les articles L. 1233-21 à L. 1233-24, un ensemble de dispositions relatives à des accords de méthode permettant de déroger par une convention collective aux modalités légales d’information et de consultation des comités d’entreprise en cas de licenciement économique collectif.
Lors de la discussion en première lecture à l’Assemblée nationale du projet de loi pour le développement de la participation et de l’actionnariat salarié, le président et rapporteur de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales de l’époque avaient déposé et fait adopter par la commission un amendement permettant notamment de substituer, par voie conventionnelle, dans les grandes entreprises, la transmission d’un rapport annuel à celle des informations et documents à caractère économique, social et financier, dont la communication au comité d’entreprise est prévue par plusieurs dispositions du code du travail, en particulier par celles relatives au droit du licenciement.
L’article introduit par amendement, devenu l’article L. 2323-61 du code du travail trouvait une justification dans son dernier alinéa qui faisait allusion à une information directe des salariés pour simplifier les formalités d’information du comité d’entreprise.
Cette justification distingue nettement les accords qui relèvent de l’article L. 2323-61 des accords de méthode conclus en application des articles L. 1233-21 à L. 1233-24 qui, en pratique, ont plutôt pour objet d’aménager favorablement les conditions dans lesquelles les membres du comité d’entreprise et en particulier les représentants des salariés peuvent prendre connaissance, débattre et négocier les termes d’un plan de restructuration ou de sauvegarde de l’emploi, voire d’une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Il n’est pas rare que ces accords de méthode détaillent les conditions d’un recours à un expert-comptable, à un avocat ou à des conseils rémunérés par l’entreprise.
L’intention exprimée par le dernier alinéa de l’article L. 2323-61, qui rejaillit sur l’ensemble de l’article, est exactement inverse. Implicitement, le texte de l’article suggère que l’information précise et détaillée d’un comité d’entreprise, transmise dans des conditions et des délais qui favorisent une prise de connaissance approfondie des plans de l’entreprise par les membres du comité et en particulier par les représentants des salariés, est moins favorable à ces derniers qu’une distribution large d’un rapport de synthèse annuel simplifié, même en cas de projet de licenciements collectifs, une partie majoritaire de leurs représentants en ayant d’une certaine manière eux-mêmes convenu en acceptant l’accord de méthode qui prévoit cette simplification.
Afin de maintenir un dialogue social loyal, serein, sincère et exhaustif dans l’entreprise, en favorisant la médiation, éclairée voire soutenue par des accords de méthodes, des représentants des salariés, l’article 8 de la proposition de loi abroge cet article du code du travail afin de supprimer cette dérogation conventionnelle aux modalités légales d’information des comités d’entreprise.
*
La Commission rejette l’article 8.
*
En raison du rejet de tous les articles, il n’y a pas lieu pour la Commission de se prononcer sur l’ensemble de la proposition de loi.
*
En conséquence, aux termes de l’article 42 de la Constitution, la discussion en séance publique aura lieu sur le texte initial de cette proposition de loi.
TABLEAU COMPARATIF1
___
Dispositions en vigueur ___ |
Texte de la proposition de loi ___ |
Texte de la Commission ___ |
Code du travail |
Proposition de loi tendant à interdire les licenciements boursiers et les suppressions d’emplois abusives |
Aucun texte adopté’ |
Article 1er |
||
L’article L. 1233-3 du code du travail est ainsi modifié : |
||
Art. L. 1233-3. – Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. |
1° Au premier alinéa, le mot : « notamment » est remplacé par les mots : « à une cessation d’activité ou » ; |
|
2° Après le premier alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
||
« L’employeur doit justifier de manière précise l’ensemble des mesures prises afin de limiter la suppression d’emplois. » |
||
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants, résultant de l'une des causes énoncées au premier alinéa. |
||
Article 2 |
||
L’article L. 1233-2 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés : |
||
Art. L. 1233-2. – Tout licenciement pour motif économique est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. |
||
Il est justifié par une cause réelle et sérieuse. |
||
« Est réputé dépourvu de cause réelle et sérieuse tout licenciement pour motif économique ou toute suppression d’emploi sous quelque forme que ce soit, décidé par un employeur dont l’entreprise a constitué des réserves ou réalisé un résultat net ou un résultat d’exploitation positifs au cours des deux derniers exercices comptables. |
||
« Est également dépourvu de cause réelle et sérieuse tout licenciement pour motif économique ou toute suppression d’emploi sous quelque forme que ce soit, décidé par un employeur dont l’entreprise a, au cours des deux derniers exercices comptables, distribué des dividendes ou des stocks options ou des actions gratuites ou procédé à une opération de rachat d’actions. » |
||
Article 3 |
||
L’article L. 1235-14 du même code est ainsi rédigé : |
||
Art. L. 1235-14. – Ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et au licenciement opéré par un employeur employant habituellement moins de onze salariés, les dispositions relatives à la sanction : 1° De la nullité du licenciement, prévues à l'article L. 1235-11 ; 2° Du non-respect de la procédure de consultation des représentants du personnel et d'information de l'autorité administrative, prévues à l'article L. 1235-12 ; 3° Du non-respect de la priorité de réembauche, prévues à l'article L. 1235-13. Le salarié peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi. |
« Art. L. 1235-14. – Lorsque le juge constate que le licenciement pour motif économique ou les suppressions d’emploi sont dépourvus de cause réelle et sérieuse, il ordonne le remboursement du montant de la réduction de cotisations sociales patronales mentionnée à l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale* dont a bénéficié l’entreprise pour les salariés concernés par le licenciement ou la suppression d’emploi envisagés. « Dès lors que le juge prononce la nullité du licenciement pour motif économique ou de la suppression d’emploi, l’employeur perd le bénéfice des dispositifs prévus aux articles 244 quater B* et 244 quater C du code général des impôts* si son entreprise en est déjà bénéficiaire, ou l’opportunité d’en bénéficier, pour une période ne pouvant excéder cinq ans. Le juge peut également condamner l’em-ployeur à rembourser tout ou partie du montant dont son entreprise a bénéficié au titre de ces dispositifs. » |
|
Article 4 |
||
L’article L. 1235-10 du même code est ainsi rédigé : |
||
Art. L. 1235-10. – Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciements concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, la procédure de licenciement est nulle tant que le plan de reclassement des salariés prévu à l'article L. 1233-61 et s'intégrant au plan de sauvegarde de l'emploi n'est pas présenté par l'employeur aux représentants du personnel, qui doivent être réunis, informés et consultés. |
« Art. L. 1235-10. – Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciements dont le motif doit être conforme aux dispositions de l’article L. 1233-3* concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, la procédure de licenciement est nulle tant que le plan de reclassement des salariés prévu à l’article L. 1233-61* et s’intégrant au plan de sauvegarde de l’emploi n’est pas présenté par l’employeur aux représentants du personnel, qui doivent être réunis, informés et consultés. |
|
« La réalité et le sérieux du motif économique sont appréciés au niveau de l’entreprise ou, de l’unité économique et sociale ou du groupe. |
||
La validité du plan de sauvegarde de l'emploi est appréciée au regard des moyens dont dispose l'entreprise ou l'unité économique et sociale ou le groupe. |
« La validité du plan de sauvegarde de l’emploi est appréciée au regard des moyens dont dispose l’entre-prise ou l’unité économique et sociale ou le groupe. |
|
« Le respect des obligations en matière de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ainsi que la nécessité d’informer le plus en amont possible les représentants du personnel doivent être également pris en compte. |
||
« La nullité du licenciement peut être prononcée par le juge dès lors que l’information et la consultation ne revêtent pas un caractère loyal et sincère ou lorsqu’elles ne comprennent pas un effet utile lié à la consultation. |
||
Le premier alinéa n'est pas applicable aux entreprises en redressement ou liquidation judiciaires. |
« Le premier alinéa n’est pas applicable aux entreprises en redressement ou liquidation judiciaires. » |
|
Article 5 |
||
I. – Le début de l’article L. 1233-25 du même code est ainsi rédigé : |
||
Art. L. 1233-25. – Lorsqu'au moins dix salariés ont refusé la modification d'un élément essentiel de leur contrat de travail, proposée par leur employeur pour l'un des motifs économiques énoncés à l'article L. 1233-3 et que leur licenciement est envisagé, celui-ci est soumis aux dispositions applicables en cas de licenciement collectif pour motif économique. |
« Art. L 1233-25. – Lorsque plusieurs salariés ont … (le reste sans changement). » |
|
Première partie Les relations individuelles de travail Livre II Le contrat de travail Titre III Rupture du contrat de travail à durée Chapitre III Licenciement pour motif économique Section 4 Licenciement de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours Sous-section 1 Dispositions générales Paragraphe 2 Modifications du contrat de travail |
II. – Après le mot : « à », la fin de l’intitulé du paragraphe 2 de la sous-section 1 de la section 4 du chapitre III du titre III du livre II de la première partie du même code est ainsi rédigée : « plusieurs refus ». |
|
Article 6 |
||
Art. L. 1222-8. – Lorsqu'un ou plusieurs salariés refusent une modification de leur contrat de travail résultant de l'application d'un accord de réduction de la durée du travail, leur licenciement est un licenciement qui ne repose pas sur un motif économique. Il est soumis aux dispositions relatives à la rupture du contrat de travail pour motif personnel. |
L’article L. 1222-8 du même code est abrogé. |
|
Article 7 |
||
Le code du travail est ainsi modifié : |
||
« Art. L. 1237-11. – L'employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie. « La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties. « Elle résulte d'une convention signée par les parties au contrat. Elle est soumise aux dispositions de la présente section destinées à garantir la liberté du consentement des parties. » « Art. L. 1237-12. – Les parties au contrat conviennent du principe d'une rupture conventionnelle lors d'un ou plusieurs entretiens au cours desquels le salarié peut se faire assister : « 1° Soit par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise, qu'il s'agisse d'un salarié titulaire d'un mandat syndical ou d'un salarié membre d'une institution représentative du personnel ou tout autre salarié ; « 2° Soit, en l'absence d'institution représentative du personnel dans l'entreprise, par un conseiller du salarié choisi sur une liste dressée par l'autorité administrative. « Lors du ou des entretiens, l'employeur a la faculté de se faire assister quand le salarié en fait lui-même usage. Le salarié en informe l'employeur auparavant ; si l'employeur souhaite également se faire assister, il en informe à son tour le salarié. « L'employeur peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise ou, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, par une personne appartenant à son organisation syndicale d'employeurs ou par un autre employeur relevant de la même branche. » « Art. L. 1237-13. – La convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle qui ne peut pas être inférieur à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9. « Elle fixe la date de rupture du contrat de travail, qui ne peut intervenir avant le lendemain du jour de l'homologation. « À compter de la date de sa signature par les deux parties, chacune d'entre elles dispose d'un délai de quinze jours calendaires pour exercer son droit de rétractation. Ce droit est exercé sous la forme d'une lettre adressée par tout moyen attestant de sa date de réception par l'autre partie. » « Art. L. 1237-14. – À l'issue du délai de rétractation, la partie la plus diligente adresse une demande d'homologation à l'autorité administrative, avec un exemplaire de la convention de rupture. Un arrêté du ministre chargé du travail fixe le modèle de cette demande. « L'autorité administrative dispose d'un délai d'instruction de quinze jours ouvrables, à compter de la réception de la demande, pour s'assurer du respect des conditions prévues à la présente section et de la liberté de consentement des parties. À défaut de notification dans ce délai, l'homologation est réputée acquise et l'autorité administrative est dessaisie. « La validité de la convention est subordonnée à son homologation. « L'homologation ne peut faire l'objet d'un litige distinct de celui relatif à la convention. Tout litige concernant la convention, l'homologation ou le refus d'homologation relève de la compétence du conseil des prud'hommes, à l'exclusion de tout autre recours contentieux ou administratif. Le recours juridictionnel doit être formé, à peine d'irrecevabilité, avant l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la date d'homologation de la convention. » « Art. L. 1237-15. – Les salariés bénéficiant d'une protection mentionnés aux articles L. 2411-1 et L. 2411-2 peuvent bénéficier des dispositions de la présente section. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 1237-14, la rupture conventionnelle est soumise à l'autorisation de l'inspecteur du travail dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre Ier du livre IV, à la section 1 du chapitre Ier et au chapitre II du titre II du livre IV de la deuxième partie. Dans ce cas, et par dérogation aux dispositions de l'article L. 1237-13, la rupture du contrat de travail ne peut intervenir que le lendemain du jour de l'autorisation. « Pour les médecins du travail, la rupture conventionnelle est soumise à l'autorisation de l'inspecteur du travail, après avis du médecin inspecteur du travail. » « Art. L. 1237-16. – La présente section n'est pas applicable aux ruptures de contrats de travail résultant : « 1° Des accords collectifs de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences dans les conditions définies par l'article L. 2242-15 ; « 2° Des plans de sauvegarde de l'emploi dans les conditions définies par l'article L. 1233-61. » |
1° Les articles L. 1237-11 à L. 1237-16 sont abrogés ; |
|
« Art. L. 1231-1 – Le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié, ou d'un commun accord, dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre. « Ces dispositions ne sont pas applicables pendant la période d'essai. » |
2° Au premier alinéa de l’article L. 1231-1, les mots : « , ou d’un commun accord, » sont supprimés ; |
|
« Art. L. 1233-3 – Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. |
||
« Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants, résultant de l'une des causes énoncées au premier alinéa. » |
3° Au dernier alinéa de l’article L. 1233-3, les mots : « à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants, » sont supprimés. |
|
Article 8 |
||
« Art. L. 2323-61 – Sans préjudice des obligations de consultation du comité d'entreprise incombant à l'employeur, un accord collectif de branche, d'entreprise ou de groupe peut adapter, dans les entreprises d'au moins trois cents salariés, les modalités d'information du comité d'entreprise et organiser l'échange de vues auquel la transmission de ces informations donne lieu. « Cet accord peut substituer à l'ensemble des informations et documents à caractère économique, social et financier prévus par les articles L. 2323-51, L. 2323-55 à L. 2323-57 et L. 3123-3, un rapport dont il fixe la périodicité, au moins annuelle, portant sur : « 1° L'activité et la situation financière de l'entreprise ; « 2° L'évolution de l'emploi, des qualifications, de la formation et des salaires ; « 3° Le bilan du travail à temps partiel dans l'entreprise ; « 4° La situation comparée des conditions générales d'emploi et de formation des femmes et des hommes ; « 5° Les actions en faveur de l'emploi des travailleurs handicapés dans l'entreprise. « Les membres du comité d'entreprise reçoivent ce rapport quinze jours avant la réunion. « Le rapport, modifié le cas échéant à la suite de la réunion du comité d'entreprise, est transmis à l'inspecteur du travail, accompagné de l'avis du comité, dans les quinze jours qui suivent. « L'accord définit également les conditions dans lesquelles les salariés sont directement informés sur la situation économique, sociale et financière de l'entreprise et sur les matières mentionnées aux articles L. 1233-21 à L. 1233-24, L. 242-15 et L. 2242-16. |
L’article L. 2323-61 du même code est abrogé. |
Dispositions citées à l’article 3
Code général des impôts - Art. 244 quater B. – I. – Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 decies, 44 undecies, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 quindecies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année. Le taux du crédit d'impôt est de 30 % pour la fraction des dépenses de recherche inférieure ou égale à 100 millions d'euros et de 5 % pour la fraction des dépenses de recherche supérieure à ce montant. Pour les dépenses mentionnées au k du II, le taux du crédit d'impôt est de 20 %.
Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L ou groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés, le crédit d'impôt peut, sous réserve des dispositions prévues au dernier alinéa du I de l'article 199 ter B, être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements.
…………………………………………………………………………………………………..
Code général des impôts - Art. 244 quater C. – I. – Les entreprises imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A et 44 decies à 44 quindecies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt ayant pour objet le financement de l'amélioration de leur compétitivité à travers notamment des efforts en matière d'investissement, de recherche, d'innovation, de formation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés, de transition écologique et énergétique et de reconstitution de leur fonds de roulement. L'entreprise retrace dans ses comptes annuels l'utilisation du crédit d'impôt conformément aux objectifs mentionnés à la première phrase du présent I. Le crédit d'impôt ne peut ni financer une hausse de la part des bénéfices distribués, ni augmenter les rémunérations des personnes exerçant des fonctions de direction dans l'entreprise. Les organismes mentionnés à l'article 207 peuvent également bénéficier du crédit d'impôt mentionné au présent alinéa au titre des rémunérations qu'ils versent à leurs salariés affectés à leurs activités non exonérées d'impôt sur les bénéfices. Ces organismes peuvent également en bénéficier à raison des rémunérations versées aux salariés affectés à leurs activités exonérées après que la Commission européenne a déclaré cette disposition compatible avec le droit de l'Union européenne.
…………………………………………………………………………………………………..
Code de la sécurité sociale - Art. L. 241-13. – I. – Les cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales qui sont assises sur les gains et rémunérations inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 60 % font l'objet d'une réduction dégressive.
II. – Cette réduction est appliquée aux gains et rémunérations versés aux salariés au titre desquels l'employeur est soumis à l'obligation édictée par l'article L. 5422-13 du code du travail et aux salariés mentionnés au 3° de l'article L. 5424-1 du même code, à l'exception des gains et rémunérations versés par les particuliers employeurs.
Cette réduction n'est pas applicable aux gains et rémunérations versés par les employeurs relevant des dispositions du titre Ier du livre VII du présent code, à l'exception des employeurs relevant des régimes spéciaux de sécurité sociale des marins, des mines et des clercs et employés de notaires.
…………………………………………………………………………………………………..
Dispositions citées à l’article 4 :
Code du travail - Art. L. 1233-3. – Cf. article 1er
Code du travail - Art. L. 1233-61. – Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, l'employeur établit et met en œuvre un plan de sauvegarde de l'emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre.
Ce plan intègre un plan de reclassement visant à faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité, notamment celui des salariés âgés ou présentant des caractéristiques sociales ou de qualification rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile.
AMENDEMENTS EXAMINÉS PAR LA COMMISSION
Amendement AS 1 présenté par M. André Chassaigne, rapporteur
Article 2
À l’alinéa 2, supprimer les mots : « constitué des réserves ou ».
Amendement AS 2 présenté par M. André Chassaigne, rapporteur
Article 4
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 2 de cet article :
« Art. L. 1235-10. – Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciements concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, la procédure de licenciement est nulle si son motif n’est pas conforme aux dispositions de l’article L. 1233-3 et tant que … (le reste sans changement) ».
Amendement AS 3 présenté par M. André Chassaigne, rapporteur
Article 6
Avant l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« I. – L’article L. 1222-7 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 1222-7. – Lorsqu'un ou plusieurs salariés refusent une modification de leur contrat de travail résultant de l'application d'un accord de réduction de la durée du travail, leur licenciement est un licenciement pour motif économique. ».