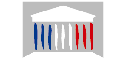______
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 29 mai 2013
RAPPORT
FAIT
AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES SUR LA PROPOSITION DE RÉSOLUTION EUROPÉENNE sur le mandat de négociation de l’accord de libre-échange entre les États-Unis d’Amérique et l’Union européenne,
PAR Mme Seybah DAGOMA
Députée
_____________________________________________________________________
Voir les numéros : 1020 et 1060.
.
Avertissement
La proposition de résolution européenne (n° 1020) de M. Bruno Le Roux, Mme Seybah Dagoma, Mme Estelle Grelier, M. Jean-Paul Bacquet, M. Patrick Bloche, M. François Brottes, M. Michel Destot, M. Olivier Faure, M. Jean Glavany, Mme Élisabeth Guigou, Mme Danielle Auroi et M. Philip Cordery sur le mandat de négociation de l’accord de libre-échange entre les États-Unis et l’Union européenne, a été examinée par la commission des affaires étrangères et par la commission des affaires européennes.
Les rapports publiés par la commission des affaires européennes et par la commission des affaires étrangères sont donc identiques, sous réserve de l’insertion dans ces rapports des comptes-rendus de leurs travaux respectifs. De plus, le texte de la proposition de résolution tel qu’adopté successivement par les deux commissions diffère légèrement, compte tenu de l’adoption de trois amendements rédactionnels par la commission des affaires étrangères.
SOMMAIRE
___
Pages
INTRODUCTION 5
I. LE CONTEXTE : LA MULTIPLICATION DES ACCORDS COMMERCIAUX BILATÉRAUX 9
II. LA PORTÉE PARTICULIÈRE D’UN ÉVENTUEL ACCORD DE LIBRE-ÉCHANGE TRANSATLANTIQUE 15
A. Des échanges commerciaux considérables entre les deux rives de l’Atlantique 15
B. Les gains économiques potentiels d’un accord transatlantique 18
C. Les enjeux d’une négociation centrée sur les « barrières non-tarifaires » 20
1. Des préférences collectives différentes, qui s’expriment en particulier sur les choix alimentaires 23
a. Des tensions récurrentes entre les États-Unis et l’Union européenne en matière agricole et agroalimentaire 24
b. Pour un résultat ambitieux sur les indications géographiques 25
c. Pour une exclusion explicite des préférences collectives européennes 27
d. Pour un traitement spécifique des produits agricoles sensibles 28
e. Pour une approche offensive sur la convergence réglementaire en matière sanitaire et phytosanitaire 28
2. Des conceptions très différentes sur les biens et services culturels et la propriété intellectuelle 29
3. Les services financiers : des obstacles à l’accès au marché américain et une convergence réglementaire retardée avec de lourds enjeux pour les entreprises 31
4. Les transports maritimes et aériens : un marché américain fermé par des réglementations protectionnistes 32
5. La sphère publique : une Amérique clairement protectionniste 32
a. Les marchés publics, une ouverture dissymétrique 32
b. Le cas particulier de la défense : des marchés fermés et de tailles très différentes 34
c. Une préférence européenne : l’attachement aux services publics 35
6. La complexité intrinsèque de la « convergence réglementaire » 36
7. L’occasion de faire progresser la dimension sociale et environnementale dans les accords commerciaux, voire d’y insérer de nouvelles exigences ? 38
III. UN PROJET DE MANDAT QUI DOIT ÊTRE CLAIR ET PRÉCIS 41
A. L’importance déterminante du mandat de négociation 41
B. Les insuffisances du projet proposé par la Commission 42
1. Des points inacceptables 43
a. L’absence d’exclusion du secteur des biens et services culturels du champ de la négociation 43
b. L’inclusion des marchés de défense et de sécurité dans le champ de la négociation 43
c. L’inclusion des « préférences collectives » dans le mandat de négociation 44
d. Le renvoi à l’arbitrage pour régler les litiges entre investisseurs et États 44
2. Des points essentiels passés sous silence, comme l’omission de la spécificité des services publics 44
3. Des éléments plus satisfaisants, mais qui doivent parfois être renforcés 45
a. L’équilibre entre les différents volets de la négociation : un élément essentiel qui doit être valorisé 45
b. Le choix d’objectifs ambitieux en matière de convergence réglementaire 45
c. La recherche d’un accord s’appliquant à tous les niveaux de gouvernement 46
d. Une exigence forte quant à l’ouverture des marchés publics 46
e. La reconnaissance de la nécessité de préserver une protection tarifaire pour certains produits sensibles 46
f. Une rédaction à renforcer sur la reconnaissance et la protection des indications géographiques 47
g. Le développement durable et les normes sociales et environnementales : comment donner du contenu aux exigences ? 47
h. La prise en compte des intérêts propres des PME : un projet de mandat trop lapidaire 48
C. La position du Parlement européen : un accord au lancement des négociations, mais sous conditions 48
D. La présente proposition de résolution européenne 50
1. Le cadre général de la négociation d’un accord transatlantique 51
2. Des conditions strictes à cette négociation 51
3. Le contrôle démocratique 53
TRAVAUX DE LA COMMISSION 55
AMENDEMENTS EXAMINÉS PAR LA COMMISSION 69
ANNEXE : LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES PAR LA RAPPORTEURE 71
Mesdames, Messieurs,
L’idée d’une zone de libre-échange entre les États-Unis et l’Union européenne est ancienne. Déjà en 1997, le ministre des affaires étrangères, Hubert Védrine, redoutait l’hégémonie d’une hyper-puissance américaine. Nos réticences à l’égard du projet de partenariat transatlantique du commissaire européen au commerce de l’époque, Sir Leon Brittan, s’expliquaient par notre conception du multilatéralisme : nous considérions qu’un tel accord aurait pu affaiblir l’Organisation mondiale du commerce (OMC) et l’organisme de règlements des différends que nous avions tous appelé de nos vœux.
Le contexte est aujourd’hui extrêmement différent. Les discussions multilatérales du cycle de Doha sont enlisées. Parmi les multiples raisons de blocage, il y a l’attitude des pays émergents qui revendiquent toujours le bénéfice du régime de traitement spécial et différencié, à l’origine destiné à permettre une meilleure intégration des pays en développement dans le commerce international, et refusent toute réciprocité en matière d’accès aux marchés. Cette évolution du rapport de forces a eu pour conséquence de renforcer la convergence euro-américaine notamment au sein de l’OMC.
L’enlisement du cycle de Doha a aussi conduit l’Union européenne à changer de position. Contrairement aux États-Unis qui depuis longtemps, privilégient le bilatéralisme dans leurs relations commerciales, l’Union européenne était restée jusque récemment fidèle à la démarche multilatérale. Aujourd’hui, elle développe des accords avec ses principaux partenaires, tels que la Corée du Sud, le Japon, le Canada et peut-être demain avec les Etats-Unis.
La perspective d’un accord transatlantique a été ouverte en novembre 2011 lors d’une rencontre entre le président du Conseil européen, Herman Van Rompuy, le président de la Commission européenne, José Manuel Barroso, et le président des États-Unis, Barack Obama, qui ont décidé la mise en place d’un groupe de travail de haut niveau sur la croissance et l’emploi. Ce groupe a rendu un rapport en février 2012, qui conclut à l’opportunité d’un accord transatlantique global sur le commerce et l’investissement.
Jamais sans doute, la perspective d’un accord de libre-échange n’aura suscité autant d’intérêt et de réactions. Le processus est aujourd’hui à une étape cruciale, celle de la définition du mandat de négociation. En mars dernier, la Commission européenne, après une phase de travaux préparatoires, menés sans grande concertation, il faut l’avouer, a transmis aux gouvernements des États membres un projet de mandat qui l’autoriserait à négocier un accord transatlantique au nom de l’Union et fixe le cadre de la négociation. Le Conseil des ministres européens du commerce extérieur doit se prononcer sur ce projet le 14 juin prochain. La semaine dernière, le Parlement européen a donné son feu vert, sous conditions, au lancement des négociations, en adoptant la proposition de résolution du président de sa commission du commerce international, Vital Moreira.
La première question qui se pose à nous est une question de principe : l’Union européenne doit-elle ou non s’engager dans une négociation commerciale ambitieuse avec les États-Unis ?
Sur le plan économique, la politique commerciale est l’un des principaux leviers de croissance dont dispose une Europe qui en a bien besoin. Les études d’impact, certes contestables à divers points de vue mais convergentes, mettent en avant des possibilités de gains économiques significatifs pour les deux parties (et, en Europe, pour la France en particulier). Sur le plan politique, cet accord pourrait être l’occasion pour l’Union européenne de forger une nouvelle cohésion en définissant une position de négociation commune et d’affirmer, au plan international, le rôle de créateur de normes (rôle de régulation) qu’elle a toujours porté. Eu égard au déclin inexorable du poids économique relatif de l’Europe dans le monde, du fait de la montée des émergents, cette négociation avec une autre « superpuissance » économique confrontée à la même évolution est peut-être l’une des dernières occasions d’affirmer cette vocation normative.
Toutefois, un accord transatlantique ne peut représenter un réel progrès que sous conditions. Le choix affiché par les autorités européennes et légitimé par les études d’impact est celui de la recherche d’un accord global et ambitieux, comprenant en particulier des avancées très substantielles sur la réduction des barrières dites non-tarifaires : convergence des multiples réglementations s’appliquant aux différents produits et services et des procédures liées à ces réglementations, amélioration de l’accès aux marchés publics, etc. Mais l’on sait bien que des progrès sur des questions de ce type sont plus compliqués à obtenir qu’une simple réduction des droits de douane, car le contenu et le mode d’élaboration des réglementations renvoient à des intérêts légitimes – protéger la santé, la sécurité, l’environnement, les consommateurs… – et, plus fondamentalement, rendent compte de « préférences collectives » et de modes de fonctionnement et de pensée profondément ancrés dans les sociétés.
Assez paradoxalement, s’il sera peut-être difficile d’acter des avancées importantes dans la négociation à venir, c’est parce que les échanges et l’intégration économique sont déjà intenses entre les deux rives de l’Atlantique, que les droits de douane pratiqués de part et d’autre sont déjà faibles en général, que les sociétés sont culturellement et politiquement plus proches que d’autres : les points de divergence et de conflit sont souvent des « points durs », connus depuis longtemps et sur lesquels aucune des partie n’envisage réellement de concession.
On peut aussi avoir le sentiment que cette négociation risque de s’ouvrir avec plusieurs asymétries :
– une première asymétrie quant à l’envie de négocier. Dans son discours sur l’état de l’Union, le président Obama a déclaré que l’Union européenne était plus en demande de négociation que son pays et le fait est que les États-Unis ont mis dix-huit mois à se mettre à la table de négociation. Il est vrai que leur position est la plus forte économiquement, dans la mesure où ils ont renoué avec une croissance de 2 %, favorisée par la révolution énergétique liée notamment à l’exploitation à grande échelle du gaz de schiste ;
– une seconde asymétrie sur l’affichage des priorités et des interdits de la négociation : l’Union européenne va le faire avec le projet de mandat, quand les États-Unis n’ont pas officiellement de lignes directrices, même si l’on peut deviner leurs intérêts offensifs et défensifs essentiels.
Pour autant, l’Europe n’a pas à aborder cette négociation en position de faiblesse. Elle est la première force de marché mondial avec 500 millions de consommateurs à fort pouvoir d’achat et, en tant que zone intégrée, le premier PIB mondial. Il s’agit de négocier un partenariat entre partenaires qui ont des relations égalitaires, représentant des parts sensiblement égales de la production et du commerce mondiaux. Les États-Unis ne doivent pas considérer qu’ils vont entamer les négociations en jouant du rapport de forces, comme ce fut le cas pour l’ALENA.
Le mandat de négociation qui sera éventuellement donné à la Commission européenne doit donc être clair, précis et exigeant. Or, le projet préparé par la Commission, qui est l’objet de la présente proposition de résolution, comporte des formulations souvent « molles », des lacunes et quelques points qui ne sont pas acceptables. L’Europe doit tenir bon – et cela doit apparaître dès le mandat de négociation – sur quelques points essentiels : la recherche d’un accord équilibré sur les différents volets de négociation, comprenant notamment des avancées importantes sur les obstacles réglementaires au commerce ; le fait que l’accord devra engager toutes les administrations des deux parties, y compris les États fédérés américains et les autorités et agences indépendantes de ce pays ; l’exclusion de la négociation des biens et services culturels, des préférences collectives, de même que des marchés de défense et de sécurité ; l’exigence de la réciprocité dans l’ouverture des marchés publics…
La proposition de résolution qui vous est présentée reprend ces points, avant de conclure sur la nécessité d’un cadre de négociation qui permette le contrôle démocratique : au-delà de la question du mandat, la Représentation nationale devra naturellement être associée au suivi de toute la négociation.
Votre rapporteure a défini plusieurs « lignes rouges » pour la France : l’exception culturelle, l’exclusion des marchés publics de défense et de sécurité, l’exclusion des préférences collectives, enfin le refus de la mise en place d’un système d’arbitrage pour les différends entre les investisseurs et les États.
A défaut d’exclusion de celles-ci, la France ne devrait pas donner son feu vert à l’ouverture des négociations.
I. LE CONTEXTE : LA MULTIPLICATION DES ACCORDS COMMERCIAUX BILATÉRAUX
Après la deuxième guerre mondiale, partant du constat que les politiques de repli et de « chacun pour soi » de la plupart des pays avaient contribué à aggraver la crise économique des années trente et portaient de ce fait une large responsabilité dans le déclenchement de la guerre, les pays occidentaux avaient décidé de renforcer le multilatéralisme. Pour ce faire, la charte de La Havane de 1948 avait prévu la création de l’Organisation internationale du commerce. Faute d’avoir été ratifiée par les États-Unis, elle n’est jamais entrée en vigueur.
A. UN MULTILATÉRALISME COMMERCIAL EN PANNE
À défaut d’une organisation internationale, c’est sous l’égide du GATT (General agreement on tariffs and trade) que se sont déroulés, à partir de 1947, huit grands cycles de négociations dont les premiers portaient exclusivement sur la réduction des droits de douane industriels et les mesures antidumping. Les deux derniers – cycles de Tokyo (1973-1979) et d’Uruguay (1986-1994) – allaient au-delà des droits de douane industriels ; ils ont traité des mesures non tarifaires et ont établi des disciplines multilatérales en matière de subventions, d’obstacles techniques au commerce, de marchés publics, de propriété intellectuelle.
Le passage de la guerre froide à la mondialisation a abouti en 1994 à la création de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) afin de réguler les échanges commerciaux internationaux. Après l’échec de la conférence de Seattle en 1999 et pour répondre à la crise de légitimité de l’OMC, le cycle de Doha a été lancé en 2001, peu après les attentats du 11 septembre 2001. L’idée sous-tendant ces négociations était que le commerce pouvait servir à la paix en le liant aux enjeux de développement. L’agenda de Doha a été progressivement réduit par le retrait, lors de la conférence de Cancún en 2003, de trois des quatre sujets dits de Singapour (les questions d’investissements, de concurrence et de marchés publics ont été exclues alors que la facilitation des échanges demeure à l’ordre du jour). Il est pourtant demeuré ambitieux. Le périmètre classique des négociations a en effet été élargi pour traiter de régulations sur les subventions, la propriété intellectuelle, les mesures phytosanitaires. La vaste ambition de ce cycle a d’ailleurs été une des raisons de l’enlisement des négociations dans la mesure où pouvaient être remis en cause les systèmes souverains de régulation. Le projet d’accord entre les États-Unis et l’Union européenne devra tirer les leçons de ces difficultés d’aboutir à une convergence réglementaire.
Après l’échec des conférences ministérielles successives – Cancun en 2003, Hong Kong en 2005 –, le cycle s’est définitivement enlisé après celle de Genève en 2008.
Les raisons de l’échec de Doha sont multiples (1). Elles ont été largement analysées : trop de sujets de négociations, difficultés liées à l’engagement unique et à la règle du consensus, effets de capture par certains émergents au détriment des pays en développement, impuissance d’une institution qui appartient à une autre histoire et qui n’a pas su s’adapter aux nouvelles configurations géopolitiques internationales, défaillance générale du multilatéralisme et des institutions multilatérales (Fonds monétaire international, Banque mondiale).
Les États-Unis portent une large part dans l’échec de Doha même s’ils en reportent la faute sur l’insuffisante part prise par les pays émergents dans leurs responsabilités mondiales, notamment la Chine qui a intégré l’OMC en 2001 au moment où les négociations du cycle commençaient. Le différend de dernière minute, lors de la conférence de Genève de 2008, sur la clause de sauvegarde agricole proposée par l’Inde, n’a fait que souligner l’opposition substantielle entre les États-Unis et les pays émergents et qui porte sur les gains à l’ouverture des échanges. Le fait que le cycle ne puisse se conclure à leur avantage (2) a largement pesé dans la décision des États-Unis de ne pas prendre les initiatives nécessaires à la conclusion de toute négociation de cette envergure. Ce sont eux qui ont prononcé l’acte de décès de Doha. Ainsi, le représentant permanent des États-Unis à l’OMC, M. Michael Punke, avait admis en juillet 2011 (3), que « le cycle de Doha est au point mort. Il vaut mieux ne pas avoir d’accord plutôt qu’un mauvais accord ».
B. DES ACCORDS BILATÉRAUX DE PLUS EN PLUS NOMBREUX
Le cadre multilatéral n’est pas le seul lieu de négociations commerciales. De 1947 à 1994, le GATT a reçu 123 notifications d’accords commerciaux régionaux. Depuis la création de l’OMC, plus de 300 accords ont été modifiés. Après l’échec de la conférence de Cancún, on a assisté à la multiplication de ces accords, comme le montre le tableau suivant.
ÉVOLUTION DU NOMBRE D’ACCORDS COMMERCIAUX RÉGIONAUX DANS LE MONDE DE 1948 À 2012
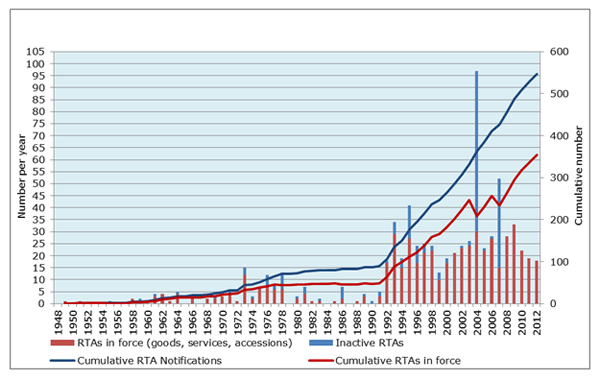
Source : secrétariat de l’OMC.
Les inconvénients de ce bilatéralisme ne sont pas négligeables. Ils tiennent d’abord au risque de marginalisation des pays qui ne font pas partie du processus, en l’occurrence les pays du Sud les plus fragiles. Les conséquences pour les pays en développement d’un accord de libre-échange entre les États-Unis et l’Union européenne, conséquences liées notamment à l’érosion des préférences accordées à ces pays par l’Europe dans le cadre de régime préférentiel comme TSA (« tout sauf les armes »), ne doivent pas être sous-estimées. Elles devront être prises en considération.
Par ailleurs, dans le bilatéralisme, les rapports de force ne sont pas en faveur de la partie la plus faible. Ainsi, dans le traité de libre-échange nord-américain (ALENA) entre les États-Unis, le Canada et le Mexique, il est prévu qu’en cas de différend entre les États-Unis et le Mexique, les tribunaux américains seraient compétents.
1. Les États-Unis : un tropisme bilatéral
Les États-Unis ont toujours eu une préférence marquée pour le bilatéralisme. Ils sont liés par des accords de libre-échange, bilatéraux ou régionaux, avec vingt partenaires commerciaux. Onze accords bilatéraux sont actuellement en vigueur, dont les derniers ont été signés avec la Corée du Sud, le Panama et la Colombie en 2007 (entrés en vigueur en 2012). En outre, les États-Unis sont partie à deux accords de libre-échange régionaux : l’ALENA entré en vigueur en 1994 et l’accord de libre-échange avec l’Amérique centrale et la République dominicaine (CAFTA) entré en vigueur en 2006.
Les États-Unis participent, depuis décembre 2009, aux négociations du projet transpacifique (Trans-pacific partnership-TPP), projet d’accord de libre-échange entre neuf pays de l’Asie pacifique (4) dont les négociations avaient été lancées par le président George Bush. Ce projet s’inscrit dans le cadre de la politique américaine de promotion de ses exportations dont un des éléments majeurs est l’ouverture des marchés asiatiques. Ces négociations suscitent de fortes attentes : l’accord deviendrait un modèle pour ceux à venir et pourrait être une étape vers la mise en œuvre d’un plus vaste projet de zone de libre échange en Asie-Pacifique. En outre, le Canada, le Mexique et le Japon ont manifesté leur volonté de rejoindre les négociations. La question de la participation chinoise se posera aussi à terme mais, pour l’heure, elle est exclue dans la mesure où les simulations montrent clairement que dans ce cas, ce serait la Chine qui serait gagnante à l’accord. L’administration Obama a fait de ces négociations l’emblème d’une politique commerciale rénovée.
Même si le projet d’accord avec l’Union européenne est présenté par les États-Unis comme pouvant lui permettre de « marcher sur deux jambes », la priorité américaine est aujourd’hui de conclure l’accord transpacifique. L’Europe n’apparaît pour les États-Unis ni comme une solution, ni comme un problème. Les États-Unis n’ont pas montré d’enthousiasme au lancement des négociations et dans les travaux du groupe à haut niveau, ils se sont tenus sur la réserve. Dans son discours sur l’état de l’Union, le président Obama a présenté l’Union européenne comme plus désireuse (« hungrier ») que les États-Unis d’engager des négociations. Le risque existe donc pour l’Europe d’apparaître comme demandeuse et dans ce cas de figure, d’avoir à faire plus de concessions.
Cependant, la négociation transatlantique est la seule grande négociation lancée par l’administration Obama qui est soucieuse de laisser un héritage avant la fin du mandat actuel. Le président Obama a indiqué être désireux d’engager les négociations sur une dynamique et de les terminer, selon son expression lors de son discours sur l’état de l’Union le 12 février dernier, avec un « seul plein d’essence ».
2. L’Union européenne : un changement de position
L’Union européenne est traditionnellement le « bon élève » du multilatéralisme. Elle a posé, et pose encore, la conclusion des négociations multilatérales en haut des priorités de sa politique commerciale. Dans la communication sur la politique commerciale de novembre 2010 (5), la Commission insistait sur le fait que « malgré la lenteur des progrès, l’aboutissement du cycle de Doha reste notre première priorité ». Elle a ainsi fait, par avance, sa réforme de la politique agricole commune en adoptant en 2003 le principe d’aides découplées afin de pouvoir entrer dans la catégorie des subventions non distorsives (dites de la « boîte verte »).
Cependant, anticipant sur un échec annoncé du cycle de Doha, l’Union européenne a envisagé dès 2006 la négociation d’accords bilatéraux dans la mesure où il lui fallait défendre ses intérêts offensifs et défensifs (6). L’accord avec la Corée du Sud, entré en vigueur en 2011, a été un des premiers accords dits « de deuxième génération », au sens qu’il allait bien au-delà de l’élimination des tarifs douaniers et portait sur les mesures sanitaires et phytosanitaires, les marchés publics, la propriété intellectuelle, les services. Il a été très controversé, notamment pour ses conséquences sur l’emploi industriel en Europe (secteur automobile) et comporte des clauses de sauvegarde.
Une fois pris acte de l’échec du cycle de Doha, l’Union européenne n’a plus eu à faire valoir son argumentaire consistant à ne rien faire au risque de porter atteinte aux chances de faire aboutir le processus multilatéral. Elle a ainsi approfondi la stratégie commerciale amorcée en 2006 : la communication précitée de novembre 2010 axe sa politique commerciale autour de partenaires stratégiques ainsi définis : « en raison de la taille et du potentiel de leur économie et compte tenu de leur influence sur l’économie mondiale, les États-Unis, la Chine, la Russie, le Japon, l’Inde et le Brésil doivent faire l’objet d’une attention particulière dans la cadre de notre politique commerciale ».
Cette stratégie a été confortée par la profondeur de la crise économique : la politique commerciale constitue une des solutions les plus immédiates à la disposition de l’Europe pour trouver des marges de croissance. C’est, on le verra, une des principales motivations mises en avant pour le lancement des négociations avec les États-Unis. Le coup d’envoi des négociations avec le Japon a été donné en mars 2013.
Par ailleurs, se pose la question de savoir quel modèle de normes l’emportera au niveau mondial. L’Europe a clairement une opportunité, même si assez limitée, pour faire valoir son modèle. Elle représente maintenant 23 % du PIB mondial, mais ce poids relatif va continuer à diminuer et, selon les perspectives généralement admises, se réduira de près de moitié d’ici 2030. À condition qu’il soit suffisamment ambitieux sur la convergence des normes, un accord entre les États-Unis et l’Union européenne pourrait avoir des effets systémiques sur le commerce mondial.
Il est possible enfin que le lancement de ces négociations permette de relancer un processus multilatéral en berne. Les pays tiers, au premier rang desquels la Chine mais aussi des pays comme la Turquie, s’inquiètent en effet des effets d’éviction que pourrait avoir un tel accord. La prochaine conférence de l’OMC qui se tiendra à Bali en décembre prochain pourrait en bénéficier.
II. LA PORTÉE PARTICULIÈRE D’UN ÉVENTUEL ACCORD DE LIBRE-ÉCHANGE TRANSATLANTIQUE
La portée de la négociation qui est envisagée doit être appréciée au regard du poids économique et commercial des deux entités concernées, car c’est l’importance de ce poids qui explique les enjeux de cette négociation : les conséquences économiques d’un accord de libre-échange transatlantique sont potentiellement considérables pour les deux partenaires, mais aussi pour le monde entier. Un tel accord, au regard du poids cumulé que représentent les économies américaine et européenne, aurait également un impact sur l’ensemble des négociations commerciales dans le monde (qu’elles soient ou non multilatérales) ; pour le meilleur ou pour le pire, il aurait vraisemblablement un effet « normatif » dans la mesure où les règles sur lesquelles les deux parties s’accorderaient s’imposeraient sans doute largement aux tiers.
En effet, l’Union européenne et les États-Unis représentent encore ensemble, en 2012, 45 % du PIB mondial, même si, il faut en être conscient, la croissance économique rapide des pays émergents réduit rapidement cette prédominance : ce ratio atteignait encore presque 60 % en 2005 (7). Les deux entités réalisent également les deux tiers des dépenses mondiales de recherche et développement ; à cet égard, un accord de libre-échange comprenant des éléments substantiels de convergence normative pourrait leur permettre, dans les activités à forte valeur ajoutée où l’effort de recherche et développement est élevé, de mieux faire face à l’inexorable montée en force des émergents. Europe et États-Unis ont enfin un poids énorme dans le commerce international.
A. DES ÉCHANGES COMMERCIAUX CONSIDÉRABLES ENTRE LES DEUX RIVES DE L’ATLANTIQUE
1. Les échanges euro-américains
L’Union européenne, prise globalement, est le premier exportateur et le premier importateur mondial (avec, en 2010, près de 15 % du total des exportations mondiales et près de 17 % du total des importations mondiales (8), en ne prenant pas en compte le commerce intracommunautaire) ; les États-Unis restent le deuxième importateur mondial mais ne sont plus que le troisième exportateur, étant dépassés par la Chine. Ensemble, les deux entités assurent environ 28 % des flux commerciaux mondiaux (en considérant l’Union européenne comme une entité commerciale et en ne prenant donc pas en compte les flux de commerce intracommunautaires – en prenant en compte ces flux, c’est plus de 40 %).
Le commerce bilatéral est considérable : les États-Unis ont absorbé, en 2012, 17,3 % des exportations européennes de marchandises (hors flux intracommunautaires), ce qui en fait le premier client de l’Union européenne, et fourni 11,5 % des importations européennes, ce qui en fait le deuxième fournisseur de l’Union, derrière la Chine (9). S’agissant des montants, ils ont atteint, selon les statistiques européennes, 292 milliards d’euros pour les exportations européennes de marchandises vers les États-Unis en 2012, et 206 milliards pour les importations dans l’autre sens, soit un total de flux annuels proche de 600 milliards d’euros et un excédent de 86 milliards d’euros au bénéfice de l’Union. Du point de vue des États-Unis, le déficit avec l’Union européenne est donc important, même si les statistiques américaines l’évaluent pour 2012 à un niveau un peu plus faible que les statistiques européennes : 70,5 milliards de dollars (environ 55 milliards d’euros). En tout état de cause, ce déficit est tout de même beaucoup plus faible que celui du commerce américain avec la Chine, qui a atteint en 2012 le montant record de 315 milliards de dollars (environ 245 milliards d’euros), soit 43 % du déficit commercial américain total.
En intégrant également les échanges de services, les flux annuels entre les États-Unis et l’Union européenne dépassent 700 milliards d’euros. Il est toutefois à noter que le poids relatif de ce commerce transatlantique dans le commerce européen recule : en 2002, les États-Unis recevaient encore près de 28 % des exportations européennes (de biens) et fournissaient près de 20 % des importations de l’Union.
S’agissant de la structure du commerce transatlantique, les statistiques européennes font apparaître un poids assez limité des produits agricoles et agro-alimentaires : dans la catégorie « produits alimentaires, boissons et tabac » (10), le débouché américain n’a absorbé en 2012 que 13,5 % des exportations européennes (soit une part moindre des États-Unis que dans l’ensemble des exportations européennes de marchandise) et, surtout, les États-Unis ne sont l’origine que de 7,1 % des importations européennes. Cette catégorie de produits génère donc un commerce transatlantique limité, mais avec un fort déséquilibre au bénéfice de l’Union européenne (13,5 milliards d’euros d’exportations vers les États-Unis pour 6,5 milliards d’importations depuis ce pays). Le commerce transatlantique est plus centré sur les produits industriels, notamment les produits chimiques – catégorie pour laquelle les États-Unis représentent environ le quart des flux du commerce extérieur de l’Union –, ainsi que les matériels de transport.
Depuis 2007 et d’après nos statistiques douanières, notre commerce bilatéral avec les États-Unis connaît un déficit croissant, qui a atteint en 2012 un montant de 6,3 milliards d’euros. On observe cependant que, selon les statistiques américaines, la situation est différente : selon ces statistiques, c’est la France qui dégagerait avec les États-Unis un excédent de près de 11 milliards de dollars (environ 8,5 milliards d’euros), à comparer il est vrai à un excédent allemand avec les États-Unis qui avoisinerait les 60 milliards de dollars (46 milliards d’euros).
En 2012, selon nos statistiques, la France a exporté pour 26,5 milliards d’euros de marchandises à destination des États-Unis, soit 6,1 % du total de nos exportations. Les États-Unis sont notre sixième débouché et restent notre premier marché extracommunautaire. Comme les années précédentes, les matériels de transports, les équipements mécaniques, les matériels électriques, électroniques et informatiques et les produits chimiques et pharmaceutiques composent, dans l’ordre décroissant d’importance, l’essentiel de ces exportations (65 %). S’agissant des produits agroalimentaires, nos exportations vers les États-Unis se sont élevées à 2,7 milliards de dollars. D’après des chiffres un peu plus anciens (2010), les États-Unis sont enfin le premier débouché extracommunautaire pour les exportations françaises de services : ils en absorbent plus de 18 %.
Les exportations françaises de marchandises vers les États-Unis ont été en 2012 en forte augmentation par rapport à l’année précédente (+ 13,4 %), principalement grâce au dynamisme de nos ventes de produits industriels. Cependant, la France stagne en termes de parts de marché aux États-Unis, avec 1,8 % du total des importations américaines (selon les statistiques américaines) et perd une place dans le classement des fournisseurs de ce pays, à la 9ème position. À titre de comparaison, l’Allemagne et le Royaume-Uni occupent respectivement les 5ème et 8ème places dans ce classement avec des parts de marchés de 4,8 % et 2,4 %.
En 2012, les importations françaises en provenance des États-Unis se sont élevées à 32,8 milliards d’euros, en hausse de 12,3 % sur l’année précédente. Les États-Unis sont notre cinquième fournisseur et plus précisément notre deuxième fournisseur extracommunautaire, après la Chine (mais pas très loin derrière, puisque les importations depuis ce pays, Hong-Kong compris, se sont élevées en 2012 à 42 milliards d’euros). Par ordre décroissant d’importance, les matériels de transport, les équipements mécaniques, les matériels électriques, électroniques et informatiques, les produits pharmaceutiques et, enfin, les produits pétroliers raffinés et le coke représentent 72 % du total des importations depuis les États-Unis. Les importations de produits pétroliers raffinés et de coke ont doublé entre 2011 et 2012, expliquant la dégradation de notre solde bilatéral avec ce pays.
Un point doit enfin être signalé : si, d’après les statistiques douanières, les États-Unis sont pour la France un partenaire commercial bien moins important que nos grands voisins européens, à commencer par l’Allemagne (avec laquelle les échanges sont presque trois fois plus importants), les analyses sur le contenu des échanges en valeur ajoutée donnent un résultat différent. D’après les calculs effectués dans le cadre du dispositif TiVA (11) de l’OMC et de l’OCDE, les États-Unis seraient (du moins étaient pour l’année 2009) en termes de valeur ajoutée le premier partenaire commercial de la France, tant pour les importations que pour les exportations (car une grande part du commerce avec nos partenaires européens a pour origine principale ou pour destination principale les États-Unis).
Les États-Unis demeurent la première destination des investissements directs à l’étranger (IDE) français, avec un stock de 165 milliards d’euros en 2011, la France restant le 7ème investisseur historique dans ce pays.
La France reste attractive pour les entreprises américaines. Les États-Unis sont le premier investisseur étranger en France, avec un stock de 86 milliards d’euros. En 2012, encore, s’agissant des flux, les États-Unis ont été le premier pays d’origine des IDE en France, avec 156 opérations réalisées durant cette année, correspondant à 5 500 emplois créés ou sauvegardés. Notre pays est le 13ème pays destinataire des IDE américains (derrière, en Europe, les Pays-Bas, le Royaume-Uni, le Luxembourg, l’Irlande et l’Allemagne).
La relation bilatérale est particulièrement profitable en termes de création d’emplois. Les investissements américains sont à l’origine de près de 450 000 emplois en France et les entreprises françaises en représentent au moins autant sur le territoire américain.
B. LES GAINS ÉCONOMIQUES POTENTIELS D’UN ACCORD TRANSATLANTIQUE
Un éventuel accord de libéralisation du commerce transatlantique trouve sa justification dans les gains économiques qu’il est supposé apporter aux deux partenaires, et même aux pays tiers. Cette perspective de gains économiques repose sur une analyse classique des effets positifs du commerce international : l’accroissement du commerce résultant d’une libéralisation permettrait une plus grande efficacité économique, les producteurs les plus efficaces étant favorisés grâce à un accès élargi à leurs produits, entraînant un accroissement de leurs revenus ainsi que du niveau de vie des consommateurs (par le biais de la baisse des prix des produits que permet l’accès à ceux produits le plus efficacement, baisse qui augmente le niveau de vie des consommateurs à revenu constant).
Les travaux préalables menés en vue de l’ouverture d’une négociation commerciale transatlantique, dont plusieurs études économétriques prospectives, confirment les gains potentiels dus à un accord de libre-échange transatlantique.
La perspective de cette négociation a en effet été ouverte lors d’une réunion au sommet, le 28 novembre 2011, réunissant le président de la Commission José Manuel Barroso, le président du Conseil européen Herman Van Rompuy et le président américain Barack Obama. Ils avaient alors institué un groupe de travail de haut niveau sur l’emploi et la croissance (GTHN), qui a conclu, dans un rapport publié le 13 février 2012, à l’opportunité d’un accord transatlantique global sur le commerce et l’investissement, qui comprendrait notamment des démarches nouvelles et innovantes pour réduire l'incidence négative des obstacles non-tarifaires.
Une étude d’impact a également été commanditée par la Commission européenne (12), étude selon laquelle un tel accord pourrait entraîner une hausse allant jusqu’à 28 % des exportations européennes vers les États-Unis (soit une hausse de 6 % de l’ensemble des exportations européennes). L’étude annonce aussi un gain potentiel allant jusqu’à 119 milliards d’euros par an pour l’Union européenne et 95 milliards pour les États-Unis, soit un supplément de revenu disponible de 545 euros pour chaque famille européenne et 655 euros pour chaque famille américaine. Ce gain ne serait pas obtenu aux dépens du reste du monde, qui connaîtrait aussi un surcroît de revenu suite aux effets d’un accord transatlantique. Ce gain ne serait pas non plus obtenu aux dépens des travailleurs européens et américains et, en particulier, la libéralisation du commerce transatlantique n’accroîtrait que marginalement la rotation de l’emploi (0,2 % à 0,5 % seulement des travailleurs européens pourraient être amenés à changer d’emploi en conséquence de ce processus).
Une autre étude (13), réalisée à la demande de l’administration française et ayant l’avantage d’évaluer aussi les effets d’un accord pour notre pays, est également très positive : envisageant divers scénarios de libéralisation plus ou moins grande du commerce transatlantique, elle conclut en tout état de cause à une forte augmentation de ce commerce qui serait particulièrement favorable à la partie européenne (et, notamment, à notre pays) : les balances commerciales européenne et française s’amélioreraient (tandis qu’on observerait une dégradation aux États-Unis) et l’on verrait des gains significatifs de PIB en Europe et en France. Les gains européens se concentreraient plutôt dans les services ainsi que dans l’agriculture, sous réserve que les États-Unis fassent des concessions importantes dans ce domaine sur les barrières non-tarifaires.
Cependant, ce type d’analyses a également suscité des critiques, portant en particulier sur l’étude d’impact communautaire, qui a été largement diffusée et commentée (14) :
– les calculs de cette étude sont fondés sur un modèle économique mondial qui est nécessairement simplificateur (seuls vingt secteurs économiques sont décrits et le monde est divisé en onze zones ; l’incidence des mouvements spéculatifs et de la volatilité des marchés sont ignorés, bien que ces effets de la libéralisation des marchés puissent avoir des conséquences très nuisibles pour l’économie) et est inspiré par les conceptions les plus libérales (la concurrence est supposée pure ; les inégalités de revenu et la répartition des gains de revenu entre riches et pauvres sont ignorés) ;
– l’incertitude est accrue par le fait que, comme on y reviendra, l’enjeu essentiel de la négociation et des gains éventuels portera sur les barrières non-tarifaires, plutôt que sur des droits de douane déjà faibles, sauf exceptions. Or, d’une part les avancées seront plus difficiles dans ce domaine, d’autre part, ces barrières non-tarifaires sont par définition plus difficiles à quantifier – leur prise en compte dans un modèle économique impliquant le calcul d’un « équivalent droit de douane » sur la base d’hypothèses nécessairement contestables ;
– surtout, les résultats avancés reposent sur des hypothèses ambitieuses quant au contenu de l’accord éventuel, puisque, pour atteindre les niveaux de gains économiques avancés supra, il est envisagé la suppression de tous les droits de douane transatlantiques et une baisse de 25 % des barrières non-tarifaires ;
– enfin, quand bien même les gains économiques susmentionnés se réaliseraient, il convient de les relativiser car cela représenterait au mieux à terme, si l’on prend le cas de l’Union européenne, un surcroît global de PIB de l’ordre de 0,5 %, gain étalé sur de nombreuses années et donc quasi-imperceptible.
C. LES ENJEUX D’UNE NÉGOCIATION CENTRÉE SUR LES « BARRIÈRES NON-TARIFAIRES »
Les droits de douane appliqués par les États-Unis et l’Union européenne sont déjà faibles : en moyenne respectivement 3,5 % et 5,3 % (données 2011, OMC), même s’il subsiste de part et d’autre des « pics tarifaires », voire des restrictions quantitatives aux échanges, notamment dans le domaine agricole, mais aussi sur certains produits industriels. Par exemple, les États-Unis appliquent des taux élevés, pouvant excéder 20 %, voire, dans certains cas, 30 % ou 40 %, à divers produits des industries textiles, des industries du cuir, aux céramiques et verreries – l’Union européenne applique également des droits significatifs à ces produits, mais moins élevés que les droits américains. Dans le domaine agricole et agro-alimentaire, les pics et contingents tarifaires (un quota d’importations à droits faibles ou nuls est alloué, au-delà duquel est appliqué un tarif douanier prohibitif) restent naturellement beaucoup plus fréquents et ne concernent pas que l’Union européenne : les États-Unis conservent ainsi une protection tarifaire élevée de leur secteur laitier.
Dans ce contexte de droits globalement faibles et de pics tarifaires très localisés, les études économétriques susmentionnées montrent logiquement que la baisse, voire la suppression, des tarifs douaniers existants ne sont pas l’enjeu principal de la négociation à venir, même si certains secteurs économiques, par exemple la chimie, mettent en avant les gains qui résulteraient d’un tel démantèlement (bien qu’en l’espèce les taux soient déjà faibles). Un accord transatlantique qui porterait uniquement sur ces tarifs aurait un impact limité, sauf dans quelques secteurs.
La négociation d’un accord de libre-échange entre les États-Unis et l’Union européenne ne doit donc pas être « business as usual » : une négociation purement commerciale comme le souhaitaient les entreprises américaines pour lesquelles l’accord aurait dû porter uniquement sur des réductions tarifaires sur les produits industriels. Une telle limitation ne serait d’ailleurs pas compatible avec les principes de l’OMC, qui exigent qu’un accord de libre-échange bilatéral ne comporte pas seulement des clauses tarifaires.
Au contraire, la négociation devrait porter principalement sur les « barrières non-tarifaires », vocable sous lequel on peut regrouper toutes sortes de dispositifs. Certaines réglementations existantes, notamment aux États-Unis, assument ouvertement leur caractère, sinon protectionniste, du moins « patriotique », en favorisant explicitement les entreprises et les produits locaux. Mais surtout, plus généralement, l’Union européenne comme les États-Unis appliquent dans les différents secteurs économiques un ensemble de standards, de procédures, de normes qui répondent à de multiples objectifs légitimes – protection de la santé, des consommateurs, des travailleurs, de l’environnement... –, mais découragent souvent les entreprises étrangères. De ce fait, ces réglementations – au demeurant parfois délibérément détournées à des fins protectionnistes – peuvent être perçues comme des barrières au commerce.
Il est à noter que dans le cadre de la consultation menée en mars dernier par le ministère français du commerce extérieur sur la perspective d’un accord de libre-échange transatlantique, le défaut de reconnaissance mutuelle des standards a été la principale difficulté mentionnée par les entreprises et organisations professionnelles participantes (par 50 % de celles faisant état de difficultés), s’agissant des relations commerciales avec les États-Unis, bien loin devant les droits de douane (8 % des réponses). D’après les éléments transmis par le ministère du commerce extérieur, les sujets réglementaires ont effectivement été signalés comme prioritaires dans la plupart des secteurs, bien plus que les sujets tarifaires : dans l’industrie, normes techniques (chimie, pharmacie, cosmétique, textile, industrie ferroviaire), harmonisation des définitions des ingrédients et des étiquetages (cosmétiques), facilitation des échanges (chimie) et des certifications (industries mécaniques), meilleure protection de la propriété intellectuelle (pharmacie, textile) ; dans le secteur agricole, nécessité que les produits américains respectent les mêmes exigences (sanitaires, sociales, environnementales et en matière de bien-être animal) que celles établies par la réglementation européenne et revendication d’une levée des barrières non-tarifaires qui bloquent l’accès au marché américain... Les auditions menées par votre rapporteure ont illustré cette réalité : notamment dans les secteurs industriels et de services, les problèmes réglementaires viennent en tête des préoccupations. Dans des secteurs comme ceux des industriels de la santé (médicaments, mais aussi dispositifs médicaux, dispositifs de diagnostic, optique, etc.) ou des équipementiers automobiles, des agendas précis de convergence sont déjà identifiés : coopération des autorités de réglementation, rapprochement et reconnaissance mutuelle des systèmes de contrôle et d’enregistrement, élaboration de règles communes sur l’identification des produits…
Les tableaux ci-après, qui s’efforcent de quantifier les coûts liés aux barrières non-tarifaires, montrent bien l’ampleur des coûts qu’ils peuvent représenter (en comparaison de droits de douane moyens de l’ordre de 3 % ou 5 %).
Estimation des équivalents tarifaires des obstacles aux services (en %) | |||||||
Télécoms |
Construction |
Commerce |
Transports |
Finances |
Services aux entreprises |
Autres | |
Pays développés |
24 |
42 |
31 |
17 |
34 |
24 |
26 |
Asie |
33 |
25 |
17 |
8 |
32 |
15 |
17 |
UE 25 |
22 |
35 |
30 |
18 |
32 |
22 |
27 |
États-Unis |
29 |
73 |
48 |
14 |
41 |
34 |
7 |
Pays en développement |
50 |
80 |
47 |
27 |
57 |
50 |
34 |
Total moyen |
35 |
58 |
38 |
21 |
44 |
35 |
29 |
Max |
119 |
119 |
95 |
53 |
103 |
101 |
54 |
Coûts commerciaux des OBSTACLES NON TARIFAIRES (mnt) aux États-Unis et dans l’Union européenne (en % équivalent tarif), pour les marchandises | ||
Secteur |
Coûts MNT dans l’UE |
Coûts MNT aux États-Unis |
Produits chimiques |
23,9 |
21 |
Produits pharmaceutiques |
15,3 |
9,5 |
Cosmétiques |
34,6 |
32,4 |
Électronique |
6,5 |
6,5 |
Matériel de communication et bureautique |
19,1 |
22,9 |
Industrie automobile |
25,5 |
26,8 |
Secteur aérospatial |
18,8 |
19,1 |
Aliments et boissons |
56,8 |
73,3 |
Métaux |
11,9 |
17 |
Textile et habillement |
19,2 |
16,7 |
Produits du bois et du papier |
11,3 |
7,7 |
Source : Commission européenne, direction générale du commerce.
La difficulté de la négociation sur ces réglementations est qu’il ne s’agit évidemment pas de les supprimer ou de les aligner vers le bas (comme on peut le faire de tarifs douaniers), puisqu’elles répondent à des intérêts publics évidents – santé, environnement...– et plus généralement à des choix collectifs effectués par les sociétés, des « préférences collectives » des citoyens. Il s’agit donc de trouver les moyens d’une convergence par le haut, ou du moins d’une meilleure reconnaissance mutuelle des règlementations et des procédures, ce qui sera nécessairement complexe : au-delà de la difficulté de concilier des préférences collectives différentes, cela impliquera aussi un rapprochement entre les autorités à l’origine des normes et réglementations et plus fondamentalement dans la manière d’élaborer celles-ci.
Compte tenu du poids économique qui reste celui de l’Europe et des États-Unis, on doit enfin observer qu’une convergence réglementaire, a fortiori la définition dans certains domaines de normes communes, influeraient nécessairement lourdement sur la fixation des normes internationales.
Les représentants de certains secteurs économiques rencontrés par votre rapporteure ont valorisé cet aspect des choses, d’autres en observant toutefois les limites, voire le caractère contreproductif. C’est ainsi qu’un secteur comme celui des industries de la santé est d’ores et déjà engagé dans une démarche active de recherche de convergence réglementaire transatlantique dans une optique clairement « mondiale » : l’objectif est de faire primer au niveau mondial des conceptions communes de la propriété intellectuelle (et plus généralement des réglementations) dans un secteur où les pays émergents font actuellement une entrée en force. En revanche, du point de vue des constructeurs d’automobiles, une convergence transatlantique n’a guère de chances de se produire dans des conditions satisfaisantes, puisqu’actuellement s’affrontent dans le monde deux grands systèmes normatifs en la matière, qui sont justement l’européen et l’américain : les Européens ont fait le choix de s’inscrire dans une démarche interétatique de normalisation menée dans le cadre des Nations-Unies, celle du « forum mondial de l’harmonisation des règlements concernant les véhicules-WP.29 », à laquelle la plupart des pays développés extra-européens adhèrent, à une exception notable près, les États-Unis ; une convergence transatlantique risquerait donc de se faire a minima, voire de remettre en cause le processus d’harmonisation dans le cadre onusien.
Cette capacité qu’aura vraisemblablement un accord transatlantique à avoir en quelque sorte un impact « normatif » mondial est une autre raison d’attacher la plus grande importance à sa négociation : au-delà de l’intérêt économique évident des deux partenaires à être à l’origine de normes s’imposant mondialement, un tel accord pourrait ainsi être l’opportunité pour faire valoir dans le commerce international un certain nombre d’exigences fondamentales, notamment sociales et environnementales.
1. Des préférences collectives différentes, qui s’expriment en particulier sur les choix alimentaires
Dans son rapport sur la réforme de la politique agricole commune après 2013, la Commission des affaires européennes de l’Assemblée nationale notait : « en raison de l’impasse dans laquelle se trouvent les négociations multilatérales au sein de l’OMC, l’Union européenne a engagé des négociations bilatérales avec des partenaires identifiés comme "stratégiques". Dans ces négociations, le risque est grand de voir les négociateurs européens sacrifier les intérêts agricoles aux intérêts offensifs en matière de marchés publics ou de services. Un accord avec les pays du Mercosur risquerait ainsi de déstabiliser profondément une filière bovine déjà fragilisée. Les négociations avec le Canada ont largement buté sur les questions agricoles, le Canada voulant préserver notamment son secteur laitier. Dans la perspective de négociations d’un accord entre l’Union européenne et les États-Unis, les questions agricoles seront un point dur de la négociation, d’autant qu’à la question quantitative de l’ouverture des marchés, s’ajoutera celle de la compatibilité avec les préférences collectives des consommateurs européens, en particulier sur la question des organismes génétiquement modifiés ou des hormones » (15).
a. Des tensions récurrentes entre les États-Unis et l’Union européenne en matière agricole et agroalimentaire
Lors du cycle de négociations multilatérales du cycle d’Uruguay, les débats étaient focalisés sur le démantèlement des outils de la politique agricole commune, notamment sur les subventions à l’exportation européennes qui avaient permis à l’Europe de prendre aux États-Unis des parts de marché. Ce type de questions est traité dans le cadre de l’Organisation mondiale du commerce. La deuxième vague des enjeux agroalimentaires ont à voir avec les préférences collectives des consommateurs européens, sur fond de contentieux à l’OMC (organismes génétiquement modifiés, bœufs aux hormones, poulets lavés à l’eau de javel). Une partie de ces contentieux se superposent d’ailleurs avec ceux qui opposent l’Union européenne et le Canada, pays avec lequel les négociations finales de l’accord de libre-échange butent sur les questions agricoles. Le règlement de ces questions avec le Canada devra être examiné attentivement dans la mesure où le résultat servira de précédent – à une échelle multipliée – pour les négociations entre les États-Unis et l’Union européenne.
L’agriculture constituera l’un des principaux sujets de difficultés de la négociation, d’autant que la force du lobby agricole américain est suffisante pour bloquer l’adoption d’un accord commercial. L’objectif clairement affiché par le farm bureau est l’accroissement des flux commerciaux agricoles des États-Unis vers l’Europe. Cela nécessiterait la conclusion d’un accord « SPS plus (16) » qui serait très offensif de la part des Américains avec une demande de levée des restrictions européennes sur les viandes traitées aux hormones de croissance (ractopamine) et sur les traitements antimicrobiens ou de réductions des agents pathogènes (acide, eau de javel), l’absence d’étiquetage spécifique des produits contenant des OGM et la réduction des délais d’autorisation pour introduire du soja OGM sur le marché européen de l’alimentation humaine ou animale.
De façon générale, les États-Unis sont opposés au principe européen de précaution, en arguant que seules peuvent être retenues les réglementations soutenues par des arguments scientifiques. Les exploitants agricoles ne sont pas enclins à changer leurs modes de production et, pour atteindre le marché européen, l’objectif clairement affiché est de porter atteinte au principe de précaution ainsi qu’aux indications géographiques.
Les conceptions américaine et européenne s’opposent sur le concept des indications géographiques dont la protection repose soit sur le droit des marques (États-Unis), soit sur un système d’enregistrement des dénominations établissant un lien entre un produit et un terroir, lien qui ne constitue pas une propriété individuelle. Les États-Unis ne protègent pas les indications européennes et, de surcroît, les considèrent comme des entraves au commerce. L’intérêt offensif pour l’Union européenne est d’obtenir une reconnaissance et une protection effective des principales indications géographiques (IG), sans se limiter aux vins (17). En effet, ces produits sont tous à forte valeur ajoutée et leurs exportations sont donc bénéfiques pour les producteurs. Le marché américain présente un potentiel d’exportation important, en particulier pour les fromages et les vins. Ce développement des exportations ne sera possible que si les usurpations cessent. C’est particulièrement le cas des produits qui subissent la concurrence des produits dits semi génériques tolérés aux États-Unis, comme le California Champagne. La suppression de ces semi génériques est donc indispensable, en plus de la reconnaissance de nos principales IG.
Aux États-Unis, la pression est grande de la part des groupes de pression agroalimentaires, qui ont adressé plusieurs courriers aux membres de la Chambre des représentants pour exclure les indications géographiques des négociations. L’exclusion des IG constituerait un renoncement inacceptable et un précédent dommageable pour les autres négociations commerciales. L’Union européenne ne serait alors plus légitime pour promouvoir son modèle dans le cadre des autres négociations commerciales. Notons que la Chine et l’Europe se sont mises d’accord, en décembre 2012, sur la protection mutuelle de dix appellations (18) de part et d’autre. Il ne s’agit pas dans le cadre d’un accord avec les États-Unis de reconnaître une dizaine d’appellations mais de faire admettre les indications géographiques comme un principe d’action.
LA PROTECTION DES INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES : DEUX LOGIQUES JURIDIQUES OPPOSÉES
Dans le système international, deux modèles s’opposent. Le droit américain assure une forme de protection des indications géographiques fondamentalement éloignée de celle reconnue en Europe. La protection américaine des indications repose essentiellement sur le droit privé des marques, qui diffère par nature du système d’enregistrement des dénominations. On peut noter trois grandes différences de philosophie entre les dénominations américaines et européennes. En Europe, les indications géographiques établissent un lien structurel, qui n’est pas reconnu aux États-Unis, entre trois éléments clés : un terroir, un savoir-faire et la réputation d’un produit. Ensuite, en Europe, ces indications, et plus encore les appellations d’origine, n’appartiennent pas à celui qui en fait usage : il s’agit d’une propriété collective, indisponible et incessible, détenue dans une zone définie, par l’ensemble des producteurs, à la différence des marques qui sont une propriété personnelle. Ces produits doivent enfin respecter des conditions de production définies par la réglementation ou des cahiers des charges.
Les règles de l’OMC relatives à la protection des indications géographiques ne départagent pas les conceptions européenne et américaine. La notion d’indication géographique est effectivement protégée par l’accord ADPIC (accord sur la propriété intellectuelle touchant au commerce). Ainsi, les membres de l’OMC doivent-ils fournir les moyens juridiques permettant d’empêcher l’existence de toute désignation ou de toute présentation d'un bien qui pourrait tromper le public quant à son origine géographique et de prévenir toute utilisation constituant un acte de concurrence déloyale. L’accord définit de la manière suivante les indications géographiques : « des indications qui servent à identifier un produit comme étant originaire du territoire d’un membre, ou d’une région ou localité de ce territoire, dans les cas où une qualité, réputation ou autre caractéristique déterminée du produit peut être attribuée essentiellement à cette origine géographique ». Toutefois, chaque pays reste libre de protéger ses indications géographiques selon la méthode qu’il juge la plus appropriée, droit des marques à l'américaine ou registre à l’européenne. De ce fait, les appellations ne bénéficient, au regard des règles multilatérales, d’aucune présomption de supériorité par rapport aux marques.
S'agissant des vins et spiritueux, les membres de l'OMC ont convenu d'assurer une « protection additionnelle », c’est-à-dire un niveau de protection plus élevé pour les indications géographiques relatives à ces produits : en vertu de l'article 23 de l’accord, ils sont tenus d’empêcher l’utilisation de ces indications pour les vins qui ne proviennent pas du lieu indiqué, même si une utilisation abusive ne risque pas d’induire le consommateur en erreur. Le deuxième paragraphe de cet article indique que l’enregistrement d’une marque pour des vins ou des spiritueux qui contient une indication géographique identifiant des vins ou des spiritueux doit être « refusé ou invalidé », soit d’office si la législation du membre le permet, soit à la requête d'une partie intéressée, en ce qui concerne « les vins ou spiritueux qui n’ont pas cette origine ». Cependant, l’accord ADPIC comporte deux exceptions, qui réduisent la portée de cette protection additionnelle. Premièrement, il prévoit une exception lorsqu’une indication est devenue un nom commun ou générique. Toutefois, le privilège ainsi accordé ne vaut que sur le territoire du membre où il est fait usage d'un terme générique, non sur les marchés à l’exportation. Deuxièmement, aux termes de l'article 24,§4, un membre de l’OMC ne peut exiger d’un autre membre qu’il empêche « un usage continu et similaire d’une indication géographique d’un autre membre identifiant des vins et spiritueux », à condition que l’indication ait été utilisée au moins dix ans avant la signature de l’accord ADPIC, qui remonte au 10 avril 1994, ou de bonne foi pendant une période, plus courte, précédant cette date. Cette disposition, dite « clause du grand-père », a donc conféré aux États-Unis, à la fin du cycle d'Uruguay, le droit de continuer à utiliser les appellations européennes protégées, comme le Champagne ou le Chablis.
Par ailleurs, la protection des indications offerte par l’accord ADPIC, tel que transposé dans la législation américaine, reste, encore aujourd’hui, incertaine aux États-Unis. En effet, les États-Unis, non seulement ne partagent pas la philosophie européenne concernant cet aspect des droits de propriété intellectuelle, mais encore considèrent que la législation communautaire applicable constitue, en fait, une restriction déguisée au commerce. Ils ont ainsi déposé, en août 2003, une plainte devant l’Organe de règlement des différends de l’OMC pour obtenir la condamnation du règlement (CE) n° 2081/92 du 14 juillet 1992 relatif à la protection des indications géographiques. Le rapport du « panel » de jugement adopté en mars 2005 a défendu, à la satisfaction de l'Europe, la possibilité que puissent coexister, pour un produit portant le même nom, une indication géographique et une marque antérieure. Mais ce verdict n’était qu’une demi-victoire, dans la mesure où il continue d’autoriser l’usurpation d’appellations européennes mondialement réputées, comme le « parmesan » par exemple, par les producteurs américains, sous le couvert de marques déposées auprès des autorités fédérales. Les dispositions de la loi fédérale dite Lanham act mettant en œuvre celles de l’accord ADPIC n’apportent pas de réelles garanties juridiques aux producteurs européens, car il n’existe dans cette loi aucune définition de ce qu’est une indication géographique et il n’existe aucune procédure spécifique permettant au détenteur d’une indication géographique européenne de la faire reconnaître en tant que telle sur le territoire des États-Unis.
Les consommateurs européens ont fait le choix de préférences collectives fortes qui recouvrent des sujets faisant l’objet d’incertitudes scientifiques et de réticences, dans les domaines tels que les organismes génétiquement modifiés (OGM), les facteurs de croissance, la décontamination chimique des viandes ou le clonage des animaux. Ces choix se sont exprimés au travers de politiques européennes qui ne doivent pas être remises en cause par des accords de libre-échange. L’Europe s’est toujours opposée à la présence d’anabolisants dans les viandes, alors que la majeure partie de la viande bovine américaine susceptible d’être exportée est issue d’élevages dans lesquels sont utilisés des hormones. La réglementation européenne en matière de sécurité alimentaire, qui repose sur le principe de contrôle sur l’ensemble de la chaîne alimentaire, ne serait pas compatible avec l’importation d’animaux clonés dont les États-Unis ont reconnu qu’ils pouvaient entrer dans la chaîne alimentaire.
Les différences d’approche sont particulièrement sensibles en matière d’OGM, qui sont cultivés à grande échelle aux États-Unis alors qu’ils sont strictement réglementés en Europe du point de vue de la culture (la seule culture permise est celle du maïs MON 810, la culture de la pomme de terre Amflora n’étant pas destinée à l’alimentation mais réservée à la production industrielle) comme de l’étiquetage informatif. L’hostilité de l’opinion publique à l’égard des OGM est très forte, surtout dans certains pays qui ont pris des mesures d’interdiction (Allemagne, Autriche, Belgique, France…). Les défaillances du système d’étiquetage de l’autre côté de l’Atlantique sont patentes alors que toute la réglementation européenne sur l’étiquetage vise à informer le consommateur sur la présence d’OGM.
Un accord ne devra en aucun cas amener l’Europe à remettre en cause son modèle alimentaire et ces acquis en termes de protection des choix et des intérêts des citoyens et des consommateurs. Le respect des choix de société et la liberté pour chaque partie d’analyser et de gérer les risques devront être reconnus. Sur ce point, on peut s’inquiéter de la concession faite en avance par la Commission européenne d’autoriser la pratique américaine consistant à nettoyer les carcasses de viande à l’acide lactique (19).
L’agriculture européenne est un atout majeur des exportations européennes et des secteurs dépendent du dynamisme des exportations (vins et spiritueux, fromages). Cependant, certaines filières européennes ne sont pas aussi compétitives que les filières américaines en raison de disparités de coûts de production, liées notamment à l’exigence des normes sociales, environnementales et de bien-être animal (qui font notamment partie des règles dites de conditionnalité pour l’attribution des aides de la politique agricole commune). Ces règles résultent de choix sociétaux clairs. Ainsi, la réforme de la PAC actuellement en discussion prévoit-elle de mettre des conditions supplémentaires pour l’octroi de ces aides (un « paiement vert » lié au respect de normes environnementales plus strictes comme le respect de la rotation des cultures ou le maintien de surfaces d’intérêt écologique). Ces différences de coût de production ont été accentuées par le différentiel du coût de l’énergie qui pèsent largement sur les producteurs européens, notamment d’élevage. Mentionnons aussi le recours aux travailleurs clandestins mexicains qui allègent ces coûts aux États-Unis.
Une libéralisation totale aurait un impact négatif majeur, en termes de parts de marché et d’emplois, sur ces filières indispensables à notre souveraineté alimentaire et à l’équilibre des territoires. C’est particulièrement patent pour les filières d’élevage qui se trouvent actuellement en situation économique fragilisée : le différentiel de revenus entre les céréaliers et les éleveurs est de l’ordre de un à cinq. À l’heure où la réforme de la PAC pose comme priorité le maintien des prairies permanentes, le danger d’une « végétalisation » de la France existe. Il est donc indispensable de pouvoir exclure du champ de l’accord ces produits sensibles (filières d’élevage, amidon…) et à tout le moins, de prévoir des contingents et des clauses de sauvegarde.
e. Pour une approche offensive sur la convergence réglementaire en matière sanitaire et phytosanitaire
L’accès au marché américain pour certains produits agricoles européens est difficile, du fait d’une réglementation américaine complexe et des procédures d’autorisation des importations longues (clause d’habilitation pour les entreprises pour obtenir l’entrée sur le territoire américain). Elles sont souvent motivées par des exigences sanitaires ; ainsi aucune entreprise européenne n’a-t-elle obtenu l’autorisation d’exporter des œufs aux États-Unis. Ces véritables entraves au commerce, qui pèsent sur la compétitivité de la production agricole européenne, sont renforcées par la structure fédérale des États-Unis. Cet accord devrait donc être l’occasion d’aboutir à une reconnaissance de l’équivalence entre les réglementations sanitaires et phytosanitaires afin que l’Union européenne puisse faire valoir ses intérêts offensifs sur des produits à forte valeur ajoutée. L’accord devra en particulier reprendre les acquis de l’accord vétérinaire existant entre l’Union européenne et les États-Unis.
On retrouve en matière agricole la nécessité évoquée précédemment d’un accord qui aille bien au-delà des seuls tarifs douaniers. Sur ce point, un angle mort de la négociation tient à ce que les Américains sont sur le point de revoir l’ensemble de leurs normes de sécurité alimentaire. Depuis une dizaine d’années, ils travaillent sur l’adoption d’un modèle qui se rapprocherait de la philosophe européenne s’agissant de la traçabilité et de l’identification des différentes phases de risques dans la chaîne alimentaire. Sur le papier, la démarche est positive et pourrait se faire conjointement à un mouvement de réciprocité et de rapprochement normatif entre les deux parties, sauf que les textes d’application ne sont toujours pas parus. À cet élément d’incertitude sur le contenu réel de ce qui sera adopté, s’ajoute le fait qu’il est envisagé que le surcoût découlant de l’institution de nouvelles normes pourrait être financé par des taxes sur les importations.
2. Des conceptions très différentes sur les biens et services culturels et la propriété intellectuelle
Alors que les Américains voient dans le secteur audiovisuel et la culture d’abord une industrie, l’Union européenne y voit la garantie de la diversité et de l’identité des États membres. Ainsi, l’Union a-t-elle fait de la diversité culturelle un des fondements de la construction européenne, qui s’est prolongée, notamment, par l’adhésion, en 2005, à la convention de l’UNESCO pour la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles. En conséquence, il est essentiel que les services audiovisuels soient exclus du champ de la négociation, dans le respect du principe de neutralité technologique qui donne la primauté aux contenus culturels, quel que soit le mode de diffusion.
Cette exclusion des services audiovisuels des chapitres services et investissements des différents accords commerciaux conclus par l’Union européenne, comme par exemple, celui avec la Corée, est constante depuis quinze ans. Il ne serait donc pas dans la ligne générale d’adopter une position différente, d’autant que les intérêts offensifs des États-Unis dans le secteur audiovisuel sont bien connus, en particulier dans le domaine des nouvelles technologies de l’information et de la communication. Les États-Unis sont en effet très sensibles à ce que les acteurs américains, tels que Netflix, Amazon ou encore iTunes, aient la possibilité d’accéder au marché européen, et ce sans qu’il soit possible d’exiger de leur part de soutien à la diversité culturelle ni de partage de la valeur. Cela pourrait conduire à placer les opérateurs européens dans une situation de concurrence inéquitable face aux opérateurs américains.
Le lancement des négociations d’un accord transatlantique ne doit pas menacer l’avenir de la diversité culturelle en Europe, ni permettre l’accès sans restrictions des services audiovisuels américains au marché intérieur européen, ce qui mettrait gravement en péril la pérennité même de l’industrie cinématographique et audiovisuelle européenne. Il y va non seulement de la cohérence de la position de l'Union européenne, mais également :
– du maintien d'une industrie cinématographique et audiovisuelle en Europe, qui est gage d’une partie du rayonnement européen ;
– de sa capacité à se représenter elle-même en donnant une voix à ses artistes, mais aussi à entrer avec succès dans l’ère numérique en créant de l'activité et des emplois ;
– de la possibilité même de maintenir et développer l’acquis communautaire en matière de politique audiovisuelle (directive sur les services de médias audiovisuels) et de soutien à la culture et à l’audiovisuel en Europe (programmes CULTURE et MEDIA et bientôt « Europe créative ») ; plus largement encore, de la capacité de l'Union européenne et de ses États membres à arrêter des objectifs de politique publique, notamment pour répondre aux défis posés à l’ère numérique.
Tel est l’objet de la proposition de résolution européenne présentée par Mme Danielle Auroi au nom de la commission des affaires européennes et par M. Patrick Bloche au nom de la commission des affaires culturelles de l’Assemblée nationale (20). Cette position a été confortée par les conclusions de la mission de M. Pierre Lescure sur « l’acte II de l’exception culturelle » de mai 2013 selon laquelle « les services audiovisuels doivent rester exclus de manière absolue et inconditionnelle de tout engagement de libéralisation. Conformément au principe de neutralité technologique, les services audiovisuels qui utilisent des outils numériques (vidéo à la demande par exemple) doivent bénéficier des mêmes règles protectrices que les services audiovisuels "traditionnels" (télévision, cinéma). À défaut, cela signifierait l’arrêt de mort des politiques culturelles et audiovisuelles des États européens ».
Or la position de la Commission européenne est loin d’être claire. Son président, M. José Manuel Barroso, a indiqué au Président de la République française qu’il fallait respecter l’exception culturelle et le droit des États à légiférer dans ce domaine, sans pour autant accéder à la demande française d’exclusion des services audiovisuels. Hors permettre la prise d’engagements individuels de chaque État limite grandement les possibilités de définir une politique culturelle européenne. La position française n’est d’ailleurs pas isolée comme l’a dit le commissaire européen au commerce Karel De Gucht. Treize ministres européens de la culture, dont les ministres allemand, espagnol et italien ont en effet cosigné, avec la ministre française, une lettre demandant que le secteur audiovisuel soit exclu de l’accord de libre-échange.
Cette exclusion sera un préalable majeur de la négociation.
3. Les services financiers : des obstacles à l’accès au marché américain et une convergence réglementaire retardée avec de lourds enjeux pour les entreprises
S’agissant des services financiers, une première difficulté générale doit être soulignée : compte tenu de la répartition des compétences entre État fédéral, États fédérés et autorités de régulation indépendantes – par exemple, les États gardent la haute main sur toute la réglementation des assurances –, les engagements pris au niveau fédéral pour l’ouverture des activités financières américaines aux entreprises étrangères restent limités par de nombreuses restrictions subfédérales, qui ont pour effet de cloisonner fortement le marché pour les opérateurs étrangers.
Des problèmes d’accès au marché américain, dus à des réglementations discriminatoires, subsistent par ailleurs. Par exemple, les réassureurs étrangers sont soumis à des exigences spécifiques de garanties financières. Une loi fédérale de 2011 en a certes réduit la portée, mais, d’une part elle n’est appliquée que par deux États fédérés, d’autre part elle ne vaut que pour les sociétés relevant de « juridictions qualifiées », statut qui a été reconnu au Royaume-Uni, à l’Allemagne, à la Suisse et aux Bermudes, mais pas à la France et aux autres pays de l’Union européenne. On a donc une situation de discrimination entre entreprises européennes.
L’intérêt d’une négociation transatlantique globale intégrant les services financiers serait donc tout à la fois d’obtenir, si c’est possible, que les engagements des États-Unis valent aussi pour les États fédérés et les autorités de régulation, et que les traitements différents vis-à-vis des pays européens soient interdits.
Un dernier sujet porte directement sur la convergence réglementaire générale. Suite à la crise financière, née, faut-il le rappeler, du comportement irresponsable d’institutions financières américaines, le G20 de Londres, en avril 2009, avait acté des engagements forts de ses membres, tels que le renforcement des réglementations financières et l’adoption de nouvelles normes comptables plus strictes.
Mais, plus récemment, on a appris que l’adoption par les États-Unis des normes comptables IFRS (International financial reporting standards) serait reportée de plusieurs années, après une période de convergence. Les États-Unis ont également renoncé à imposer à court terme à leurs banques les obligations prudentielles renforcées (en termes de montants et de qualité des fonds propres) dites « Bâle III », à la différence de l’Union européenne. Ceci place les institutions financières des deux rives de l’Atlantique dans des conditions de concurrence qui sont faussées.
4. Les transports maritimes et aériens : un marché américain fermé par des réglementations protectionnistes
Les États-Unis pratiquent ouvertement un « patriotisme économique » qui n’a pas son pendant dans l’Union européenne, du moins dans les institutions européennes, au sein desquelles domine généralement l’idéologie d’ouverture généralisée à la concurrence, qui conduit à admettre par principe les intervenants des pays tiers sur les marchés européens, indépendamment de préoccupations de réciprocité. Le secteur des transports maritimes et aériens constitue un bon exemple de protectionnisme assumé par les États-Unis et l’Union européenne gagnerait naturellement à une libéralisation.
Ainsi, le « Jones act » réserve-t-il le droit de navigation entre deux ports soumis à la juridiction américaine aux seuls navires battant pavillon américain, entièrement fabriqués aux États-Unis et dont l’équipage est composé au moins à 75 % de citoyens américains. De nombreux lobbys se battent pour l’industrie de la construction navale aux États-Unis dont le Maritime cabotage task force – qui défend bec et ongles le Jones act. Le lobby du transport maritime dépense 17 millions de dollars par an pour représenter ses intérêts à Washington.
S’agissant du cabotage aérien, l’article 7 de la convention de Chicago relative à l’aviation civile accorde aux États-Unis la faculté de refuser que des compagnies aériennes étrangères fassent du cabotage à l’intérieur des États-Unis.
5. La sphère publique : une Amérique clairement protectionniste
Le même « patriotisme économique » est pratiqué par les États-Unis dès lors qu’il s’agit d’achats de la puissance publique.
Les marchés publics européens peuvent être considérés comme potentiellement presque complétement ouverts aux entreprises étrangères.
D’une part, en effet, l’Union européenne a pris des engagements très larges d’ouverture dans le cadre de l’accord plurilatéral sur les marchés publics (AMP). Cet accord, signé dans le cadre de l’OMC en 1994, regroupe un nombre limité de pays (essentiellement les principaux pays développés) et repose sur des engagements unilatéraux d’ouverture des marchés publics (obligations de transparence et de traitement non-discriminatoire des entreprises étrangères). Au titre de l’AMP, 85 % des marchés publics de l’Union font l’objet d’une ouverture transparente, contre 32 % pour les États-Unis (et 28 % au Japon, 16 % au Canada, rien dans les grands pays émergents).
D’autre part et surtout, les textes communautaires relatifs aux marchés publics vont même au-delà en prévoyant une ouverture totale des marchés de l’Union aux entreprises non communautaires, indépendamment de l’adhésion ou non de leurs pays de rattachement à l’AMP (ou à un accord bilatéral avec l’Union). De ce fait, nos partenaires commerciaux n’ont aucune incitation à prendre des engagements d’ouverture de leurs marchés ou à respecter ceux qu’ils ont pris, les marchés européens leur étant in fine totalement ouverts.
Il est toutefois à noter qu’afin de se doter d’un moyen de pression pour les négociations commerciales internationales, la Commission européenne a présenté, le 21 mars 2012, un projet de règlement « concernant l’accès des produits et services des pays tiers au marché intérieur des marchés publics de l’Union et établissant des procédures visant à faciliter les négociations relatives à l’accès des produits et services originaires de l’Union aux marchés publics des pays tiers ». Il s’agit de se donner les moyens juridiques d’imposer une réciprocité dans l’ouverture des marchés publics, à travers deux instruments :
– la faculté pour les États membres d’engager une procédure, encadrée par la Commission, d’exclusion de leurs marchés des offres composées de plus de 50 % de produits issus d’un pays dont les marchés publics du même secteur sont fermés ;
– la faculté pour la Commission, après enquête sur l’ouverture effective des marchés publics de pays tiers, puis négociation infructueuse pour ouvrir les marchés fermés, de demander au Conseil des mesures restrictives à l’encontre des entreprises des pays en cause.
Ce projet de règlement reste en discussion dans les institutions européennes, les positions étant très partagées sur son principe.
La Commission européenne estime qu’actuellement, environ 85 % des marchés publics européens au-dessus des seuils de l’AMP font l’objet d’une ouverture transparente (352 milliards d’euros de marchés annuels sur un total de 420 milliards de marchés excédant ces seuils, et un total global de marchés publics européens estimé à 2 350 milliards). Toutefois, la part des marchés attribués à des entreprises étrangères reste évidemment beaucoup plus faible. En 2009, la part des marchés publics européens attribués à des entreprises implantées dans un autre État (y compris un État de l’Union) était de 3,6 % et celle des marchés attribués à des filiales nationales d’entreprises étrangères de 13,9 % ; la part des marchés attribués à des entreprises non communautaires est plus difficile à évaluer, mais a récemment été estimée à 2,7 % par des chercheurs français.
Les marchés publics de nos partenaires sont nettement moins ouverts, notamment aux États-Unis. Sur les 556 milliards d’euros de marchés publics américains fédéraux supérieurs aux seuils de l’AMP, seuls 178 milliards sont en principe ouverts en application de l’accord, soit 32 %. Au niveau des États fédérés, ce taux est inférieur à 10 % ; treize de ces États ne sont pas engagés par l’AMP, non plus qu’aucune collectivité (même les grandes villes) ou agence de niveau plus bas, ni les entreprises et services de transport et les projets routiers financés sur fonds fédéraux ; même parmi les États fédérés couverts par l’AMP, les engagements d’ouverture sont inégaux et, en particulier, dans douze d’entre eux, ne s’appliquent pas aux marchés portant sur l’acier de construction, les véhicules à moteur et le charbon.
En outre, au-delà de la faiblesse des engagements d’ouverture, diverses législations favorisent les producteurs locaux dans les marchés publics : le Buy american act de 1933, s’appliquant aux marchés fédéraux de biens (mais pas de services), pénalise les offres qui ne comportent pas 50 % de contenu local (en termes de prix) dans les composants de produits finis, lesquels doivent en outre être assemblés aux États-Unis ; le Buy America act de 1982 exige 60 % de contenu local pour les marchés de matériel ferroviaire à financement fédéral ; l’American recovery and reinvestment act (ARRA) de 2009, véhicule législatif du plan de relance adopté suite à la crise financière, impose même que la totalité des produits sidérurgiques et manufacturés utilisés par les États fédérés et collectivités locales pour les projets de construction d’infrastructures financés par le budget fédéral soient produits aux États-Unis ; diverses autres lois fédérales ou locales comportent des obligations de même nature. Ces diverses mesures, même si elles sont partiellement contournées par les grands groupes transnationaux (qui créent des filiales aux États-Unis pour respecter les obligations de contenu local), sont manifestement efficaces : l’analyse des contrats publics passés au titre de la loi ARRA susmentionnée montre que les entreprises européennes ont obtenu moins de 50 millions de dollars de ces contrats, sur un total de 37 milliards, soit 0,1 % (21).
La défense nationale reste considérée des deux côtés de l’Atlantique comme un domaine de souveraineté où les marchés sont légitimement soumis à des règles très spécifiques et où la préférence nationale joue très souvent et ouvertement.
L’Union européenne ne s’est engagée que récemment dans un processus d’ouverture des marchés de défense et de sécurité entre États membres, avec une directive de 2009 (22), laquelle vise, selon ses considérants, « l’établissement progressif » d’un marché européen des équipements de défense, en vue du « renforcement de la base industrielle et technologique de défense européenne ». Ces considérants relèvent également que les marchés de cette nature ne sont pas couverts par les engagements pris dans le cadre de l’AMP et en conséquence reconnaissent explicitement la prérogative des États membres à décider d’ouvrir ou non ces marchés à des pays tiers. On peut penser qu’une telle ouverture, qui n’est donc pas imposée, irait généralement à l’encontre de l’objectif affiché par la directive, à savoir renforcer une base industrielle et technologique européenne dans le domaine de la défense.
Aux États-Unis, la loi prévoit un régime renforcé d’application de la préférence nationale en matière de défense (23). Bien sûr, des industriels européens peuvent espérer éviter cette réglementation en produisant sur le sol américain une part suffisante des matériels qui feraient l’objet d’un marché, mais, même dans ce cas de figure, l’expérience montre que leurs chances seraient faibles face à des industriels locaux qui ont des relais politiques très puissants. On se souvient à cet égard des mésaventures d’EADS, qui, après avoir réussi dans un premier temps à obtenir un très gros contrat (35 milliards de dollars) pour la fourniture d’avions ravitailleurs au Pentagone (avions qui auraient été assemblés sur le sol américain), a finalement perdu ce contrat au profit de Boeing en 2011.
Un dernier point doit être souligné s’agissant des marchés de défense : leur taille très inégale des deux côtés de l’Atlantique (ces marchés devant encore être appréciés au niveau national en Europe, car leur ouverture intra-européenne débute à peine). Quand les États-Unis ont dépensé, en 2012, 682 milliards de dollars pour leur défense (24), les deux pays européens qui maintiennent un effort de défense important, le Royaume-Uni et la France, en ont dépensé chacun environ 60 milliards, l’Allemagne 45 milliards, et les dépenses militaires cumulées des membres de l’Union européenne se sont élevées à 274 milliards de dollars… La différence énorme de volume des commandes de matériel militaire qui en résulte entraîne inévitablement, pour les industriels américains, des avantages très importants en termes d’économies d’échelle. De ce fait, en cas d’ouverture des marchés militaires de part et d’autre, la concurrence serait très difficile pour les entreprises européennes du secteur.
Il est toutefois un domaine rattaché à la sphère publique où l’Europe fait valoir une spécificité qui doit être préservée, c’est la notion de « service public ». Plus souvent appelés dans les textes communautaires « services d’intérêt général » ou « services d’intérêt économique général » quand ne sont envisagés que ceux rendus dans un cadre marchand, les services publics font partie des valeurs auxquelles les citoyens européens sont attachés et pour lesquelles les Gouvernements et le Parlement français se sont particulièrement engagés. Ces services sont désormais mentionnés dans plusieurs textes fondamentaux de l’Union européenne – aux articles 14 et 93 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, au protocole n° 26 qui y est annexé, à l’article 36 de la charte des droits fondamentaux : leur rôle « dans la promotion de la cohésion sociale et territoriale de l’Union » et leur appartenance à ses « valeurs communes » sont ainsi nommément reconnus ; l’Union et les États membres doivent en conséquence veiller à ce qu’ils puissent « accomplir leurs missions ».
Toute négociation commerciale, en l’espèce celle envisagée avec les États-Unis, doit comprendre des garanties de protection des services publics de qualité dont bénéficient les citoyens européens, conformément aux textes fondamentaux susmentionnés.
6. La complexité intrinsèque de la « convergence réglementaire »
Au-delà des grands champs de divergence mentionnés dans les matières non-tarifaires – les préférences collectives en matière d’alimentation, la reconnaissance des indications géographiques, le statut des biens et services culturels, l’ouverture des marchés publics… –, il faut aussi relever, de manière plus transversale, la difficulté intrinsèque des démarches de réduction des barrières réglementaires, qui impliquent une « convergence réglementaire », un rapprochement ou une reconnaissance mutuelle des réglementations grâce à une coopération accrue des autorités compétentes.
Or, cette coopération réglementaire sera compliquée par le fait que les modèles américain et européen sont très différents en la matière. À la différence du processus de détermination européen des normes qui relève principalement de la Commission européenne, le processus américain s’appuie plutôt sur des besoins exprimés par le secteur privé, selon une approche dite ascendante (« bottom up approach ») qui privilégie le recours aux normes et standards privés. Le législateur américain se borne le plus souvent à ne tracer que les grandes lignes des objectifs à atteindre et laisse le soin aux régulateurs – soit les agences exécutives fédérales (25), soit les agences indépendantes (26) créées par une loi d’habilitation – de rédiger en détail et formellement les normes.
En pratique, la fragmentation de la compétence normative et la délégation de l’évaluation de la conformité au secteur privé qui caractérisent le modèle américain pourraient constituer les obstacles les plus importants à la convergence réglementaire. L’administration dispose de l’autorité en matière de coordination des actions normatives des agences exécutives fédérales, mais seule une implication de l’Office of information and regulatory affairs lié directement à l’Office of management and budget dépendant directement de la Maison blanche serait à même d’influer sur le processus de convergence réglementaire. S’agissant des agences indépendantes, leurs pouvoirs et leurs compétences sont définies par le Congrès, et l’administration ne dispose d’aucun levier. L’implication du Congrès sera donc cruciale. Comme l’analyse le service économique régional de l’ambassade de France aux États-Unis, « les efforts de l’administration et du Congrès, dont il faudra s’assurer, devront également être accompagnés d’une action de communication ordonnée et systématique de la Commission européenne, des États membres et du secteur privé européen à destination des régulateurs américains. Leur participation au processus de négociation déterminera l’ampleur du résultat obtenu ».
LES DIFFICULTÉS D’UNE CONVERGENCE RÉGLEMENTAIRE
Sur le fond, une véritable convergence réglementaire au cas par cas (secteur par secteur, norme par norme) reste un objectif idéal, mais sera difficile à atteindre en pratique. Les progrès en la matière dépendront de l’implication d’une part de l’administration et du Congrès, d’autre part des secteurs professionnels américains et européens et de leur capacité à convaincre les régulateurs à aller vers davantage de convergence réglementaire. Certaines filières apparaissent d’ores et déjà mieux préparées que d’autres.
La perspective d’accords de reconnaissance mutuelle semble également limitée à un nombre réduit de filières. Une approche plus globale impliquerait de réconcilier des logiques normatives et d’appréhension des risques parfois très éloignées : en substance, une régulation américaine favorable à la maximisation du profit, un système européen plus sensible en apparence au bien-être du consommateur.
C’est certainement par anticipation de ces difficultés à venir que l’administration américaine et la Commission envisagent déjà un accord « vivant » qui permettrait de poursuivre en dehors du cadre des négociations et sur le long terme les objectifs de convergence réglementaire. Si elle paraît pragmatique, cette proposition semble d’ores et déjà, alors que les négociations n’ont pas encore commencé, abandonner l’ambition affichée du Partenariat.
Source : service économique régional de l’ambassade de France aux États-Unis.
Il faut aussi compter sur le fait que de nombreuses compétences de réglementation sont exercées au niveau des États et non au niveau fédéral, par exemple en matière de réglementations financières, comme on l’a vu, mais aussi s’agissant des normes environnementales applicables aux véhicules.
Dans un domaine voisin, celui des normes de sécurité pour les véhicules, les professionnels de l’automobile et des équipements automobiles, auditionnés par votre rapporteure, ont mis en lumière un autre exemple éclairant de différence fondamentale entre les systèmes de réglementation, qui correspond à des pratiques profondément ancrées dans les cultures politiques. Dans les pays européens, ont-il expliqué, la mise sur le marché des véhicules reste soumise à homologation par une autorité publique, laquelle vérifie le respect des normes de sécurité, avec pour avantage qu’ensuite la responsabilité des constructeurs et des équipementiers est largement déchargée. Au contraire, le système américain repose sur l’auto-certification, avec ensuite des enjeux de responsabilité pénale et civile qui peuvent être extrêmement lourds si un contrôle révèle une défaillance des véhicules en circulation, a fortiori en cas de contentieux suite à un accident. Il n’est guère vraisemblable qu’un accord transatlantique mette fin à cette divergence fondamentale de méthode ; un tel accord pourrait certes porter sur le contenu des règles de sécurité et admettre une équivalence entre celles des deux parties, mais, dans cette hypothèse, quelles garantie aurait-on que les tribunaux américains admettent cette équivalence et ne condamnent pas un constructeur européen qui arguerait de cette équivalence pour justifier de ne pas avoir suivi à la lettre la réglementation américaine ?
7. L’occasion de faire progresser la dimension sociale et environnementale dans les accords commerciaux, voire d’y insérer de nouvelles exigences ?
Enfin, un éventuel accord transatlantique devra absolument être très exigeant sur l’affirmation d’un certain nombre de normes qui concourent à l’établissement d’un juste échange.
Cette exigence est d’abord nécessaire pour garantir que l’accord, notamment du fait de son volet sur l’investissement, n’entraîne pas d’effets pervers. À ce titre, la négociation ne devra en aucun cas conduire à l’abaissement de l’acquis communautaire à des fins d’attractivité et de compétitivité. Cet aspect est d’autant plus à souligner que les États fédérés américains disposent de larges marges de manœuvre pour accorder aux entreprises qui s’installent sur leur territoire des aides souvent conséquentes. Celles-ci sont à l’origine de délocalisations à l’intérieur du territoire américain et pourraient être l’occasion de délocalisations d’entreprises européennes. Ces préoccupations rejoignent la recommandation du groupe de travail de haut niveau invitant l’Union et les États-Unis à « tenir compte des aspects liés à l'environnement et à l'emploi qui relèvent du commerce et du développement durable ».
Cette exigence est également justifiée par le caractère « normatif » qu’aura un éventuel accord transatlantique pour l’ensemble des négociations commerciales internationales futures.
La vigilance apparaît donc essentielle dans ce domaine, d’autant que les États-Unis apparaissent parfois à la traîne pour prendre au niveau international des engagements dans les domaines social et environnemental.
Dans le premier, on connaît le rôle de l’Organisation internationale du travail (OIT). Son fonctionnement repose sur l’élaboration de conventions internationales qui garantissent les droits des travailleurs dans différents domaines. Les membres de l’organisation sont ensuite libres d’adhérer ou non à ces conventions, qui sont au nombre de 190 environ. On constate que les États-Unis n’ont ratifié que 14 de ces conventions, ce qui est très peu au regard des engagements pris par les nations européennes. Ainsi, parmi les grands pays européens, l’Espagne a-t-elle ratifié 133 des conventions de l’OIT, la France 123, l’Italie 111, la Pologne 91, le Royaume-Uni 86 et l’Allemagne 83 (27)… De plus, l’OIT a adopté en 1998 une « déclaration relative aux principes et droits fondamentaux au travail » qui met en exergue quatre types de droits fondamentaux des travailleurs, que l’ensemble de ses membres doivent selon ce texte respecter, même s’ils n’ont pas ratifié les conventions qui en traitent. En effet, huit des conventions de l’organisation, traitant de ces droits, sont également identifiées comme fondamentales. Ces droits fondamentaux, selon l’OIT, sont : la liberté syndicale et la reconnaissance effective du droit de négociation collective ; l’élimination de toute forme de travail forcé ou obligatoire ; l’abolition effective du travail des enfants ; l’élimination de la discrimination en matière d’emploi. L’ensemble des membres de l’Union européenne ont ratifié les huit conventions fondamentales sur ces droits, les États-Unis, deux seulement.
En matière d’environnement, les États-Unis font également partie des rares nations à ne pas avoir ratifié certains engagements fondamentaux, comme le protocole de Kyoto sur les changements climatiques ou la convention sur la diversité biologique du 5 juin 1992.
Les organisations non gouvernementales américaines attendent de l’Union européenne qu’elle ne baisse pas la garde sur les enjeux sociaux et environnementaux. Elles citent souvent, par exemple, le cadre européen de gestion des substances chimiques (REACH) (28) comme un exemple de réglementation favorable aux citoyens qui devrait être étendue. De même, il existe de la part de certaines industries américaines, comme celles de la fédération des produits du bois, une forte opposition aux options européennes de protection de l’environnement (en l’espèce à la directive européenne n° 2009/28/CE du 24 octobre 2009 sur les énergies renouvelables) et une volonté d’harmonisation sur un modèle américain à laquelle il faudra résister.
Quant au sujet sensible de la protection des données personnelles, le modèle européen découlant de l’application de la directive n° 95/46/CE du 24 octobre 1995 doit être préservé de la tentation que représente pour le monde des affaires américain la mise à disposition de données personnelles des citoyens européens.
L’Union européenne serait d’autant moins fondée à faire des concessions aux États-Unis sur les enjeux sociaux, environnementaux ou sociétaux que, face aux orientations libérales et isolationnistes et aux pressions des intérêts économiques qui expliquent la position de retrait des États-Unis sur un certain nombre d’engagements internationaux, tout une partie de la société civile et du monde politique américains est naturellement très sensible à ces enjeux.
Le fait est d’ailleurs que, sous la pression des parlementaires du Parti démocrate et des ONG, les États-Unis se sont mis à intégrer dans leurs accords commerciaux en vigueur des clauses sociales et environnementales, avec une référence croissante au corpus des engagements internationaux en la matière et notamment à la « déclaration de l’OIT ».
Ainsi l’accord de libre-échange nord-américain (ALENA) signé en 1992 a-t-il été le premier accord de cette nature conclu par les États-Unis à comporter des clauses environnementales : affirmation de la supériorité de certains accords internationaux concernant l’environnement sur les clauses de l’ALENA lui-même, engagement des parties à ne pas abaisser leurs normes environnementales afin d’attirer les investissements étrangers. Lui ont en outre été annexés un « accord nord-américain de coopération dans le domaine de l’environnement », lequel institue notamment une commission pour la coopération environnementale qui est chargée de régler les différends et peut recevoir des plaintes de citoyens ou d’entreprises, ainsi qu’un « accord nord-américain sur la coopération dans le domaine du travail ». Plus récemment, en 2007, l’administration républicaine a dû trouver un arrangement (29) avec la majorité démocrate du Congrès pour faire ratifier les accords de libre-échange qui étaient en suspens avec quatre pays d’Amérique latine : les clauses de ces accords ont été renforcées en matière de droit du travail (exigence d’une protection des droits des travailleurs tels que posés par la « déclaration de l’OIT », engagement contraignant des États à ne pas réduire ces droits, mécanisme de règlement des différends…), d’environnement (obligation des respecter une liste d’accords internationaux), d’accès aux médicaments…
De son côté, l’Union européenne veille également à intégrer des clauses sociales et environnementales dans ses accords commerciaux. Par exemple, celui conclu en 2011 avec la Corée du Sud comprend des engagements des parties d’appliquer les standards de l’OIT, de poursuivre la ratification des textes de l’OIT, de mettre en œuvre les conventions OIT ou environnementales qu’elles ont ratifiées, etc. Une instance bilatérale ad hoc, un « comité sur le commerce et le développement durable », est mise en place pour contrôler le respect de ces engagements.
Trouver avec les États-Unis un accord ambitieux en matière de clauses sociales et environnementales apparaît donc tout à fait envisageable, si l’Union européenne en fait une priorité.
On pourrait même imaginer que le futur accord transatlantique intègre des clauses dans des domaines novateurs, où il pourrait influencer l’ensemble des négociations commerciales internationales. Votre rapporteure pense notamment à la question de la lutte contre le dumping monétaire.
III. UN PROJET DE MANDAT QUI DOIT ÊTRE CLAIR ET PRÉCIS
L’objet de la présente proposition de résolution est le projet de mandat de négociation dont la Commission européenne souhaite bénéficier pour conduire la négociation au nom de l’Union. Compte-tenu du fonctionnement de celle-ci, il est déterminant que ce document soit clair et précis. Or, le projet élaboré par la Commission comporte quelques points inacceptables et surtout un certain nombre de lacunes ou de formulations qui doivent être renforcées.
A. L’IMPORTANCE DÉTERMINANTE DU MANDAT DE NÉGOCIATION
En application des articles 207 et 218 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), la politique commerciale est une compétence exclusive de l’Union. Il revient à la Commission européenne de conduire les négociations après que le Conseil ait adopté le mandat de négociation (30). Pendant les négociations, le comité de politique commerciale, au sein duquel sont représentés les États membres, a un rôle d’assistance à la Commission.
Une fois le mandat donné, la Commission européenne dispose donc d’une large capacité de négociation même si elle conduit les négociations en consultation avec le comité de politique commerciale, d’où l’importance de bien calibrer le document. Dans un premier temps, dans le cadre notamment des travaux du groupe à haut niveau, c’est la Commission européenne qui a réalisé le travail de configuration, sans consulter véritablement les États membres et elle a joué sa propre partition. Même si dans toute négociation commerciale, tout ne peut être mis sur la place publique, on ne peut que déplorer un manque de transparence dans la définition des objectifs ou même un double langage, comme en matière de défense de l’exception culturelle.
Le mandat doit être suffisamment clair dans la mesure aussi où, au sein de l’Union européenne, les positions ne sont pas homogènes. La Grande-Bretagne souhaiterait que tout soit « mis sur la table » et verrait sans doute dans cet accord une occasion de remettre en cause des politiques européennes qui ne lui conviennent pas. L’Allemagne, poussée par ses entreprises exportatrices, est très allante. La France a défini des lignes rouges, qui sont l’exception culturelle, l’exclusion des marchés publics de défense et de sécurité, l’exclusion des préférences collectives, enfin le refus de la mise en place d’un système d’arbitrage pour les différends entre les investisseurs et les États. La définition d’un mandat clair doit permettre à l’Europe d’unifier ses positions. Ainsi, les préférences collectives ne sont pas défendues seulement par la France : les OGM ne sont pas acceptés dans nombre de pays européens comme l’Allemagne ou l’Autriche. S’agissant des modalités de règlement des différends en matière d’investissement, la Grande-Bretagne et l’Allemagne rejoignent la France dans la préoccupation de ne pas voir les États se dessaisir d’une part de leur souveraineté.
L’enseignement des négociations avec le Canada, qui n’aboutissent pas en raison des différends sur les questions agricoles, doit être tiré : tout ce qui n’est pas traité en début se retrouve en fin de négociation et est source de difficultés. La Commission européenne avait à l’époque sous-estimé les sources de contentieux. Le mandat doit donc décliner des priorités fortes, voire essentielles en faisant la balance entre intérêts offensifs et défensifs. L’exercice est compliqué par le fait qu’officiellement, les États-Unis n’ont pas de lignes rouges. Cependant, on peut les deviner même si elles sont non écrites (sur les services financiers, les intérêts agricoles, les transports aériens et maritimes).
Un mot doit d’ailleurs être dit, par symétrie, de la procédure de négociation commerciale du côté américain. L’enjeu, en l’espèce, est la mise en œuvre ou non de la procédure de « Trade promotion authority » (TPA), dite « fast track », par laquelle le Congrès peut déléguer au Président des États-Unis des prérogatives pour négocier certains accords commerciaux, puis en obtenir une ratification rapide et sans amendement. Une TPA est un document public qui définit les objectifs de négociations que doit poursuivre l’administration.
La dernière TPA, votée en 2002, a expiré en 2007. L’administration américaine, poussée par la nécessité liée à la multiplication des négociations commerciales, envisage de demander au Congrès l’octroi d’une nouvelle TPA. La procédure est cependant controversée, notamment au sein du Parti démocrate, qui a toujours une attitude réservée quant aux bénéfices réels de la libéralisation des échanges commerciaux. Le calendrier éventuel d’adoption d’une prochaine TPA n’est pas connu (la date de l’été est évoquée) et le champ final reste à définir. Elle devrait englober les négociations d’accords transpacifique et transatlantique, ainsi que le projet d’accord multilatéral sur les services.
Il est nécessaire que le mandat européen insiste sur le vote d’un tel texte, dans la mesure où, en tout état de cause, la conclusion d’un accord ambitieux dans les délais ne sera pas possible sans TPA.
B. LES INSUFFISANCES DU PROJET PROPOSÉ PAR LA COMMISSION
Le projet de document que nous appelons « mandat de négociation », transmis par la Commission le 13 mars 2013, prend la forme d’une « recommandation de décision du Conseil » (des ministres chargés du commerce extérieur) « autorisant l’ouverture de négociations sur le commerce et l’investissement, appelé partenariat transatlantique de commerce et d’investissement » avec les États-Unis. Il comprend :
– un exposé des motifs ;
– le projet de décision du Conseil lui-même, texte très bref qui autorise simplement la Commission à négocier au nom de l’Union européenne un accord global sur le commerce et l’investissement avec les États-Unis, sur la base de « directives de négociation » ;
– un projet de texte définissant ces « directives », qui, après un préambule, est lui-même divisé en trois sous-parties consacrées respectivement : à l’accès au marché ; aux questions réglementaires et obstacles non-tarifaires ; aux « règles » (cette sous-partie listant un ensemble de matières du droit ou de types de clauses que l’accord transatlantique devrait intégrer).
C’est sur la rédaction de ces « directives » que porte le débat entre les États membres. Le texte du projet rédigé par la Commission est à cet égard inacceptable sur plusieurs points et trop silencieux ou ambigu sur d’autres, même s’il est beaucoup plus satisfaisant sur d’autres questions.
Le projet de directives de négociation de la Commission est très succinct sur la question des biens et services culturels. Il se borne en effet à indiquer, parmi les objectifs de l’accord transatlantique, que celui-ci « ne devra contenir aucune disposition risquant de porter atteinte à la diversité culturelle et linguistique de l’Union, notamment dans le secteur audiovisuel » (§8). Il ne comporte aucune exclusion de tout ou partie des biens et services culturels du champ de la négociation.
Cette position n’est pas acceptable, pour les raisons qui ont été développées supra dans le présent rapport. L’ensemble des politiques communautaires et nationales développées en Europe seraient remises en cause si, en particulier, les services audiovisuels n’étaient pas d’entrée de jeu écartés d’une négociation menée avec le pays qui a, compte tenu de la puissance de son industrie en la matière, les intérêts les plus offensifs et les plus divergents de ceux de l’Union dans ce domaine !
Le projet de directives de négociation vise expressément les secteurs de la défense et de la sécurité parmi ceux qui doivent être l’objet d’une ouverture des marchés publics négociée avec les États-Unis (§17).
Comme votre rapporteure a pu l’indiquer supra, l’Union européenne ne s’est pourtant engagée que récemment dans un processus d’ouverture des marchés de défense et de sécurité entre États membres, avec une directive de 2009, sans envisager alors de l’étendre aux pays tiers. En effet, une telle ouverture ne serait pas compatible avec l’ambition, affichée dans cette directive de 2009, de « renforcement de la base industrielle et technologique de défense européenne ». Ce serait a fortiori le cas si cette ouverture concernait les États-Unis, qui ont de loin le premier budget militaire du monde et donc l’industrie d’armement la plus puissante, avec laquelle les industriels européens du secteur ne peuvent rivaliser.
Les marchés de défense et de sécurité doivent être écartés du champ de la négociation.
En particulier dans le domaine alimentaire, les citoyens européens expriment des préférences collectives très claires, qui les conduisent, comme on l’a vu, à rejeter un certain nombre de produits et de pratiques : OGM, bétail cloné, usage des hormones de croissance, décontamination chimique de la viande, etc.
La rédaction du projet de directives de négociation n’est pas suffisamment explicite sur l’obligation impérative d’exclure ces préférences, qui sont fondées sur la perception de risques, notamment pour la santé. Elle mentionne certes que la recherche d’une compatibilité accrue entre les réglementations européennes et américaines « ne fera pas obstacle au droit de réglementer en fonction du niveau de protection de la santé, de la sécurité, des travailleurs, de l’environnement et de la diversité culturelle que chaque partie juge approprié, ou de manière à atteindre des objectifs réglementaires légitimes… » (§18). Il est indispensable de revoir cette rédaction, afin qu’il soit clair que l’accord devra exclure les préférences collectives.
Selon le projet de directives de négociation (§16), « l’accord devrait viser à inclure un mécanisme efficace et moderne de règlement des différends entre les investisseurs et l’État [reposant sur des] structures d’arbitrage… ». Cette option pour l’arbitrage n’est pas souhaitable et ne devrait pas figurer dans le projet de mandat, car ce type de dispositif est contestable dans sa mise en œuvre (risque de coûts très élevés pour les États) comme dans ses implications politiques (remise en cause de la capacité à légiférer des État).
2. Des points essentiels passés sous silence, comme l’omission de la spécificité des services publics
Le projet de directives de négociation inclut explicitement le domaine des services publics dans le champ de l’ouverture accrue qui doit être négociée s’agissant des marchés publics. Pour le reste, il ne comporte aucune garantie quant à la préservation de cette spécificité européenne, alors même que des engagements d’ouverture en matière de commerce des services et d’investissements pourraient affecter le mode de fonctionnement actuel des services publics et les grands principes qui les régissent. Ce point devrait donc être corrigé.
3. Des éléments plus satisfaisants, mais qui doivent parfois être renforcés
a. L’équilibre entre les différents volets de la négociation : un élément essentiel qui doit être valorisé
On l’a dit, la plus grande partie des gains économiques que l’on peut attendre d’un accord transatlantique résulterait de l’abaissement des barrières non-tarifaires plutôt que de celui des droits de douane. Mais les progrès sur les aspects non-tarifaires seront aussi, on le sait, plus difficiles à obtenir.
Le projet de directives de négociation montre que la Commission européenne est bien consciente de cet enjeu. Il dispose, dès ses paragraphes liminaires, que les différents volets « seront négociés en parallèle et feront partie d’un engagement unique garantissant un résultat équilibré entre la suppression des droits et la suppression des obstacles réglementaires superflus » (§5). Toutefois, l’obligation de parallélisme entre réduction des droits de douane et réduction des barrières non-tarifaires, qui est essentielle, pourrait utilement être affirmée plus clairement.
Par ailleurs, le projet de directives de négociation présente l’intérêt d’afficher des objectifs ambitieux et détaillés en termes de progrès sur les questions non-tarifaires : il s’agirait notamment de favoriser « un niveau ambitieux de compatibilité réglementaire pour les biens et les services, y compris par la reconnaissance mutuelle, l’harmonisation ou d’autres moyens d’accroître la coopération entre régulateurs » et, pour ce faire, « d’accroître l’ouverture, la transparence et la convergence des méthodes et exigences réglementaires et des processus connexes d’élaboration de normes ainsi que, notamment, de réduire les exigences redondantes et pesantes en matière d’essais et de certification, de favoriser la confiance de chaque partie dans les organismes d’évaluation de la conformité de l’autre et d’accroître la coopération en matière d’évaluation de la conformité et de normalisation » (§18).
Il est également proposé que l’accord comporte des engagements supplémentaires de compatibilité réglementaire pour une liste de biens et services définis d’un commun accord, qui pourrait comprendre « l’automobile, les produits chimiques, les produits pharmaceutiques et les autres secteurs de la santé, les technologies de l’information et de la communication ainsi que les services financiers ». Dans un certain nombre de ces secteurs, on l’a dit, les entreprises européennes sont en effet confrontées en effet à des problèmes de réglementation et de normes dans le développement de leurs activités aux États-Unis. S’agissant des services financiers, le projet de mandat spécifie également, ce qui est positif, qu’il faudrait aller vers une « coopération prudentielle » (§18).
Plus spécialement en matière d’échanges de services, il est enfin envisagé que les États-Unis et l’Union européenne prennent « des engagements contraignants en vue d’assurer la transparence, l’impartialité et la régularité des procédures en ce qui concerne les exigences et les procédures en matière de licences et de qualifications » (§13).
De manière un peu contradictoire, puisque l’Union européenne reste constituée d’États souverains, le caractère fédéral des États-Unis fait qu’en matière d’engagements commerciaux, de réglementations diverses, de marchés publics, les États fédérés ne sont pas nécessairement engagés par la signature de l’État fédéral, alors qu’en Europe les matières concernées relèvent en général d’une compétence exclusive de l’Union ou du moins d’une compétence partagée permettant à l’Union d’imposer une harmonisation aux États membres et le respect de ses engagements internationaux.
Comme on l’a vu en particulier pour ce qui est de l’ouverture des marchés publics ou les questions de réglementation, il est donc déterminant, dans une négociation commerciale avec les États-Unis, d’obtenir que la signature fédérale engage tous les niveaux d’administration. Ce point apparaît clairement dans le projet de directives de négociations : il est affirmé d’un point de vue général – « les obligations de l’accord seront obligatoires à tous les niveaux de gouvernement » (§4) – et réitéré pour le cas particulier des marchés publics – « l’accord visera à accroître l'accès mutuel aux marchés publics à tous les niveaux administratifs (national, régional et local) » (§17).
De manière plus générale, les dispositions du projet de mandat relatives à l’ouverture des marchés publics posent en principe un niveau élevé d’exigence : « l’accord devra être le plus ambitieux possible et compléter les résultats des négociations relatives à la révision de l’accord sur les marchés publics en ce qui concerne son champ d’application (entités contractantes, secteurs, valeurs de seuil et contrats de services, notamment pour les travaux publics de construction) ».
e. La reconnaissance de la nécessité de préserver une protection tarifaire pour certains produits sensibles
Le projet de directives de négociation vise « la suppression progressive de tous les droits de douane, à l'exception des plus sensibles, à brève échéance. Lors des négociations, les deux parties examineront des options pour le traitement des produits les plus sensibles, y compris les contingents tarifaires » (§9). Un objectif de démantèlement des droits de douane qui subsistent est donc posé, mais avec des exceptions pour certains produits.
Cette possibilité d’exception est tout à fait nécessaire, notamment pour certaines filières agricoles (en particulier les filières d’élevage) et agroalimentaires qui ne sont pas en Europe aussi compétitives que les filières américaines, notamment en raison d’importantes différences de normes sociales, environnementales et de bien-être animal.
Les indications géographiques reconnues et protégées sont, dans le domaine agricole, un facteur essentiel de valorisation des productions européennes et de préservation des terroirs agricoles. Elles contribuent donc grandement aux politiques d’emploi, d’aménagement du territoire et d’environnement.
On a expliqué que les États-Unis n’ont pas les mêmes conceptions que l’Union européenne en la matière, n’hésitant pas à utiliser pour leurs productions locales des appellations géographiques qu’ils considèrent comme génériques (champagne, bourgogne, chianti, madère, etc.). Certes un accord a pu été trouvé en 2006, mais il n’est pas satisfaisant vu son champ réduit (il ne concerne que les vins) et les engagements limités pris par les États-Unis.
Il est donc très important d’obtenir que les indications géographiques soient reconnues et protégées, au titre de la propriété intellectuelle, dans un futur accord transatlantique, aussi bien pour développer les marchés des producteurs européens que dans la perspective de la négociation d’autres accords commerciaux bilatéraux ou multilatéraux.
La rédaction actuelle du projet de directives de négociations prend en compte cette question, mais dans des termes peu impératifs qui pourraient certainement être renforcés : « les négociations devraient garantir une protection accrue, grâce à l’accord, des principales indications géographiques de l’UE » (§22).
g. Le développement durable et les normes sociales et environnementales : comment donner du contenu aux exigences ?
Le projet de directives de négociation apparaît relativement complet et ambitieux en matière de normes sociales et environnementales. Il mentionne notamment (§23 à 25) :
– que « l’accord devrait établir que les parties ne favoriseront pas les échanges ou les investissements directs étrangers en réduisant la portée de la législation et des normes internes en matière d'environnement, d'emploi ou de santé et sécurité au travail » ;
– que seront examinées des « mesures destinées à faciliter et encourager le commerce de biens, services et technologies respectueux de l’environnement et économes en ressources, y compris par les marchés publics écologiques, ainsi qu’à permettre aux consommateurs de prendre leurs décisions d'achat en connaissance de cause » ;
– que « l’accord contiendra également des dispositions encourageant l’adhésion aux normes et accords internationalement reconnus dans les domaines du travail et de l'environnement, ainsi que leur mise en œuvre effective, comme condition indispensable au développement durable ». La déclaration de 1998 de l’OIT, ainsi que certains enjeux environnementaux tels que « la promotion du commerce de ressources naturelles durables obtenues légalement, telles que le bois, la faune sauvage ou les produits de la pêche », sont nommément cités.
Il est enfin prévu que, parallèlement à la négociation de l’accord, sera réalisée « une évaluation de l’impact dur le développement durable », qui devra être achevée avant la conclusion de l’accord.
Enfin, il est souhaitable que le futur accord prenne en compte les difficultés particulières des PME et ETI qui veulent se développer à l’international. Plus que les grandes entreprises, elles sont en effet particulièrement rebutées par certains types d’obstacles (formalités administratives, problèmes de normes…). À cet égard, le projet de directives de négociations contient seulement une formule lapidaire, en quelque sorte « pour mémoire », qui mériterait certainement d’être précisée : « l’accord contiendra des dispositions concernant les aspects des petites et moyennes entreprises qui touchent au commerce » (§29).
C. LA POSITION DU PARLEMENT EUROPÉEN : UN ACCORD AU LANCEMENT DES NÉGOCIATIONS, MAIS SOUS CONDITIONS
Le Parlement européen est l’expression des citoyens européens. C’est pourquoi, même son avis sur le mandat n’est que consultatif, la Commission européenne devra en tenir compte. Ceci d’autant plus que le Parlement européen s’est montré, à plusieurs reprises, par exemple dans la discussion du projet d’accord de libre-échange avec la Colombie sur la question des droits de l’homme, soucieux d’exercer les nouvelles prérogatives en matière de politique commerciale qui découlent des nouvelles dispositions du traité de Lisbonne. Il souhaite être impliqué dans le déroulé des négociations commerciales aux différentes étapes de la procédure.
L’article 218 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) définit de nouvelles modalités de conclusion des accords internationaux. Ainsi, l’alinéa 9 de cet article prévoit-il que le Parlement européen donne désormais son approbation ; auparavant, il ne s’agissait que d’un assentiment. Le Parlement doit donc soit approuver, soit rejeter en bloc un accord. Afin que le Parlement européen puisse donner son approbation en toute connaissance de cause, l’article 207 du TFUE prévoit que le Parlement européen doit être informé de la même manière que le comité de politique commerciale. Le précédent du rejet du projet de traité anti-contrefaçon (ACTA) montre qu’il ne faut pas sous-estimer l’opposition potentielle du Parlement européen à un accord qui ne respecterait pas les intérêts européens.
Le Parlement européen s’est prononcé dans une résolution, dès le 23 octobre 2012, sur les relations commerciales et économiques avec les États-Unis dans la perspective d’un accord de libre-échange une résolution (31).
Puis, sa commission du commerce international a adopté le 25 avril dernier un projet de résolution sur ces négociations à proprement parler (32), dont le rapporteur était M. Vital Moreira.
Le vote en séance plénière est intervenu le 23 mai. Le Parlement européen a donné son feu vert au lancement des négociations par 460 voix pour, 105 contre et 28 absentions.
Le Parlement a clairement indiqué que cet accord au lancement des négociations était conditionné au fait que les négociateurs tiennent le Parlement pleinement et immédiatement informé à tous les stades de la négociation. Il souligne qu’aucun accord ne pourra prendre effet sans son approbation et que ses positions devront être prises en considération aux différentes phases de la négociation. Les précédents des autres négociations et les travaux préliminaires à la définition du mandat prouvent que le rappel de ces impératifs n’est pas inutile eu égard à la tendance naturelle de la Commission à la rétention de l’information – inhérente certes à toute négociation commerciale mais qui doit trouver sa limite dans les impératifs de l’information démocratique du Parlement.
Les potentialités d’un tel accord sont soulignées, avec des perspectives d’augmentation du PIB européen. Le Parlement pose un certain nombre de conditions et balises pour que l’accord soit bénéfique. C’est d’ailleurs la condition de sa future approbation : il ne donnera son feu vert en fin de négociations que si l’accord aboutit « à une issue positive pour les entreprises, les travailleurs et les citoyens ».
Le Parlement définit des intérêts offensifs de l’Europe et insiste sur l’importance particulière pour les petites et moyennes entreprises de retirer un bénéfice réel de l’accord. L’ouverture réciproque des marchés publics constitue une des priorités ainsi que la levée des restrictions dans les domaines des transports maritime et aérien ainsi que les services financiers.
Le Parlement européen considère que l’essentiel de la négociation doit porter sur la convergence réglementaire et sur la lutte contre les barrières non- tarifaires, qui sont les entraves au commerce transatlantique les plus significatives. L’accord ne doit pas être l’occasion d’abaisser le niveau d’ambition des normes sociales et environnementales qui sont la base des réglementations européennes. Il insiste ainsi sur le respect du principe de précaution en matière de sécurité alimentaire, qui doit prévaloir dans des domaines comme les organismes génétiquement modifiés ou le clonage des animaux.
Il met en avant l’intérêt offensif pour l’Europe de faire reconnaître son système européen d’indications géographiques et de droit de la propriété intellectuelle et de préserver un haut niveau de protection des données personnelles.
Un amendement demandant l'exclusion du secteur de la défense a été rejeté, alors qu’il n’existe aucun précédent de négociations commerciales conduites par la Commission incluant ce domaine très sensible.
La question de l’exception culturelle a fait l’objet de débats intenses. Le rapporteur Vital Moreira avait en effet déclaré : « une telle exclusion n’est ni nécessaire, ni utile dans la négociation, car elle envoie un mauvais signal aux Américains qui vont demander des concessions dans d’autres domaines ». Deux amendements émanant du groupe socialiste français au texte de la résolution ont été adoptés en commission du commerce international. Le premier soulignait que « l’accord ne doit comporter aucun risque pour la diversité culturelle et linguistique de l’Union, notamment dans le secteur des services culturels et audiovisuels ». Le deuxième estimait « indispensable que l’Union et ses États membres maintiennent la possibilité de préserver et de développer leurs politiques culturelles et audiovisuels, et ce dans le cadre de leurs acquis législatifs, normatifs et conventionnels ; demande donc que l’exclusion des services de contenus culturels et audiovisuels, y compris en ligne, soit clairement stipulée dans le mandat de négociation ».
En séance plénière, cette question de l’exception culturelle a fait l’objet d’un vote séparé et les députés européens ont décidé d’exclure les services culturels et audiovisuels du mandat de négociation (381 voix pour, 191 voix contre et 17 abstentions, la majorité étant donc moins forte que pour l’adoption du projet de mandat).
D. LA PRÉSENTE PROPOSITION DE RÉSOLUTION EUROPÉENNE
Cette proposition de résolution commence, selon le schéma classique, par le visa des textes auxquels elle se réfère (alinéas 2 à 20), suivi de considérants explicatifs (alinéas 21 à 44), avant que n’arrive le dispositif à proprement parler (alinéas 45 à 68, correspondant aux paragraphes 1 à 24).
Sans présenter dans le détail l’ensemble des dispositions de la résolution, car elles sont justifiées par le rapport qui précède, on doit en souligner les principales articulations.
1. Le cadre général de la négociation d’un accord transatlantique
Les premiers considérants de la proposition de résolution présentent le cadre général qui justifie la recherche d’un accord commercial transatlantique :
– la priorité qui doit être donnée aux négociations multilatérales (dans le cadre de l’OMC) n’exclut pas la conclusion d’accords bilatéraux sous réserve qu’ils soient plus approfondis et complémentaires des règles multilatérales (alinéas 21 et 22) ;
– compte tenu de l’ampleur des échanges commerciaux de l’Union européenne et des États-Unis et de leurs flux d’investissements croisés et au regard des résultats des travaux d’analyse menés en amont, un accord global entre les deux entités doit être recherché (alinéas 23 à 28).
On peut lire les trois premiers paragraphes du dispositif (alinéas 45 à 47, §1 à 3) en lien avec ces considérants d’opportunité générale, qui rappellent notamment les résultats de l’étude d’impact : il est demandé dans ces paragraphes que le mandat de négociation – dont le projet, comme on l’a vu, comprend déjà des mentions en ce sens – soit très clair sur la nécessité de progresser parallèlement sur les différents volets de la négociation (accès aux marchés, barrières non-tarifaires et règles communes pour répondre aux défis du commerce mondial) et insiste sur la réduction des obstacles non-tarifaires.
2. Des conditions strictes à cette négociation
Les considérants qui suivent dans la proposition de résolution développent les motifs pour lesquels il est nécessaire de poser un certain nombre de conditions dans la négociation d’un accord transatlantique :
– les alinéas 29 et 30 rappellent certains des droits fondamentaux des citoyens européens inscrits dans la charte du même nom, qui correspondent à autant de politiques de l’Union européenne figurant dans ses textes fondateurs : diversité culturelle, protection des données personnelles, protection de la santé, de l’environnement, des consommateurs et des travailleurs… En conséquence, ces droits et ces politiques ne sauraient être remis en cause dans le cadre d’une négociation commerciale ;
– les considérants suivants développent les plus sensibles de ces éléments. Il s’agit tout d’abord d’un certain nombre d’engagements de solidarité internationale. Ainsi l’alinéa 31 souligne-t-il l’ampleur des engagements internationaux des États européens en matière de droits des travailleurs et d’environnement (en opposition implicite au caractère beaucoup plus limité des engagements américains dans ce domaine, comme on l’a vu) ; en complément, l’alinéa 32, issu d’un amendement de votre rapporteure, pointe les risques résultant de la volatilité des prix et de l’instabilité des marchés agricoles, en particulier pour les pays du Sud, tandis que l’alinéa 38, issu d’un amendement de Mme Chantal Guittet, affirme la primauté des enjeux sanitaires sur les enjeux commerciaux en matière de propriété intellectuelle (sur les produits pharmaceutiques). Introduits par l’alinéa 33, les alinéas 34 et 35 mettent en avant deux points qui doivent constituer, du point de vue de votre rapporteure, des « lignes rouges » dans la négociation : le refus d’assimiler les biens et services culturels à des marchandises comme les autres ; la non-remise en cause des « préférences collectives » qu’expriment les consommateurs, en particulier dans leur alimentation – il est rappelé à cet égard que les réglementations protégeant ces choix collectifs trouvent aussi leur source dans un principe du droit national qui a valeur constitutionnelle depuis 2005, le principe de précaution. Les alinéas 36 et 37 mettent enfin en lumière deux autres préférences européennes : la reconnaissance des indications géographiques et l’existence de services publics de qualité ;
– les alinéas 39 et 40 abordent la question des marchés publics. Partant du constat du degré très différent d’ouverture de ces marchés sur les deux rives de l’Atlantique, ils fondent la revendication d’une ouverture plus équilibrée. L’alinéa 41 traite du cas particulier du secteur de la défense, rappelant les motifs pour lesquels une ouverture transatlantique des marchés dans ce domaine n’est pas souhaitable ;
– enfin, l’alinéa 42 évoque la situation des activités financières, domaine dans lequel le choix de normes prudentielles et comptables différentes en Europe et aux États-Unis, ainsi que les pratiques discriminatoires qui subsistent dans ce pays vis-à-vis des établissements européens, ont de lourdes conséquences.
En lien avec ces considérants, les paragraphes 4 à 20 du dispositif (alinéas 48 à 64) développent les exigences qui doivent s’imposer dans la négociation :
– la réciprocité et l’équilibre des engagements, particulièrement en matière d’ouverture des marchés publics (§4, alinéa 48), étant par ailleurs précisé, ce qui concerne en premier lieu les marchés publics, que les engagements pris dans l’accord par l’État fédéral américain devraient aussi s’appliquer aux États fédérés (§20, alinéa 64) ;
– un haut niveau d’exigence quant aux normes sociales et environnementales (§5, alinéa 49) ;
– l’exclusion, qui doit figurer dans le texte du mandat, des services audiovisuels du champ de la négociation (§6, alinéa 50) ;
– l’exclusion des préférences collectives des Européens (§7, alinéa 51) ;
– la recherche d’une protection solide de la propriété intellectuelle, comprenant la reconnaissance et la protection effective, par les États-Unis, des indications géographiques (§8, alinéa 52) ;
– la recherche d’un haut niveau de protection des données personnelles (§9, alinéa 53) ;
– la préservation de la qualité des services publics européens (§10, alinéa 54) ;
– la référence explicite à la multifonctionnalité de l’agriculture, avec en conséquence, en matière tarifaire, la prise en compte des surcoûts dus aux choix de l’Union européenne dans sa politique agricole, ainsi que la protection tarifaire, voire des clauses de sauvegarde, pour les produits et filières sensibles (§11, alinéa 55) ;
– suite à un amendement de votre rapporteure adopté par la commission des affaires européennes, la prise en compte des risques de déséquilibre et d’instabilité accrus des marchés agricoles du monde, avec pour conséquence potentielle une aggravation des famines et de la malnutrition (§12, alinéa 56) ;
– l’exclusion des marchés de défense et de sécurité du champ de la négociation (§13, alinéa 57) ;
– la prise en compte des problématiques propres aux activités financières, telles que des approches différentes des réglementations (§14 à 16, alinéas 58 à 60). Cette partie du dispositif a été renforcée en commission par plusieurs amendements, à l’initiative notamment de votre rapporteure et de Mme Estelle Grelier, afin d’insister sur le caractère discriminatoire de certaines réglementations américaines, de prendre en compte le secteur des assurances et de souligner la nécessité d’une application par les États-Unis des normes prudentielles « Bâle III » ;
– l’exclusion d’un éventuel mécanisme spécifique de règlement des différends entre investisseurs et États (§15, alinéa 61).
Enfin, les paragraphes 18 et 19 (alinéas 62 et 63) demandent à ce que la négociation soit ouverte sur des champs ignorés (ou traités sommairement) dans le projet de mandat de la Commission européenne : les difficultés propres aux PME dans le commerce international ; la lutte contre le dumping monétaire, suite à un amendement de votre rapporteure.
Les quatre derniers paragraphes du dispositif (§21 à 24, alinéas 65 à 68) concernent le déroulement de la négociation, qui doit notamment être compatible avec l’exercice du contrôle démocratique. Ils doivent être lus en lien avec les alinéas 43 et 44 des considérants, qui rappellent que le Parlement français serait amené à se prononcer sur un éventuel accord de partenariat transatlantique (car ce serait un « accord mixte » traitant de compétence partagées entre l’Union et les États membres) et font référence à la procédure dite « fast track ».
Il est donc souhaité :
– que l’on prenne le temps de la négociation ;
– que la Représentation nationale puisse assurer un suivi des négociations, à travers une information régulière par le Gouvernement ;
– qu’une étroite coopération puisse être établie avec le Parlement européen et que les parlements nationaux de l’Union soient associés au « dialogue transatlantique des législateur » ;
– que le Président des États-Unis se voie conférer l’autorité de négocier avec l’Union européenne sous le régime du « fast track », afin, comme on l’a dit, que la négociation ait des chances réelles d’aboutir à un accord et que cet accord soit ratifié en bloc par la partie américaine.
La commission examine, sur le rapport de Mme Seybah Dagoma, la proposition de résolution européenne sur le mandat de négociation de l’accord de libre-échange entre les États-Unis et l’Union européenne (n° 1060), au cours de sa première séance du mercredi 29 mai 2013.
Après l’exposé de la rapporteure, un débat a lieu.
M. Hervé Gaymard. Je tiens à féliciter la rapporteure pour son excellent travail, qu’il s’agisse de son rapport écrit ou de la présentation orale qu’elle vient d’en faire.
S’agissant des relations commerciales multilatérales, la question du mandat de négociation est essentielle. Faute d’avoir été vigilants au début des années 1990, notamment sur les questions agricoles, nous avons eu beaucoup de mal à remonter la pente par rapport aux positions, imprudentes mais délibérées, du négociateur européen. Cette expérience nous a appris combien il était important d’encadrer strictement le mandat de négociation. Cela le sera d’autant plus en l’espèce que les États-Unis sentent l’Union européenne plus « affamée » qu’eux-mêmes de cet accord. Mais est-ce vraiment les nations européennes qui en ont faim ou tel responsable actuellement en poste qui poursuit une stratégie et un intérêt personnel ? Il ne s’agit pas de critiquer le président de la Commission en lui-même, mais ne soyons pas naïfs. Il faut être extrêmement ferme et vigilant sur le mandat de négociation.
Méfions-nous également des données macro-économiques brandies comme argument en matière de négociations commerciales multilatérales. En effet, l’avenir est systématiquement présenté comme radieux avec une augmentation des échanges, de la croissance et des créations d’emplois à en attendre. Mais cet argument d’autorité, en général asséné comme une vérité d’évidence, n’a jamais été prouvé. Souvenons-nous de ce qui fut dit en son temps du coût de la non-Europe ou des arguments avancés en faveur du cycle de Doha. Les négociations dans le cadre de l’OMC ont achoppé. Le monde ne s’est pas écroulé pour autant et le protectionnisme ne s’est pas généralisé. Il faut donc raison garder. Vous citez avec justesse dans votre projet de rapport, madame, les travaux approfondis du Mouvement pour une organisation mondiale de l’agriculture (MOMAGRI) qui montrent qu’il faut se méfier de ces projections généralistes, souvent produites seulement pour impressionner.
Vous avez parfaitement recensé les intérêts de l’Union européenne en cette affaire. L’agriculture tout d’abord. Sur ce point, la négociation avec le Canada peut constituer un utile round d’observation, qu’il faut suivre de très près car elle pourrait faire jurisprudence. Il y a bien sûr aussi la défense de l’exception culturelle et tout ce qui concerne l’ouverture des marchés publics.
Au total, je n’ai rien à redire à ce projet de résolution qui liste parfaitement les sujets sur lesquels il nous faut être vigilant.
M. Jean-Pierre Dufau. La qualité du rapport de Seybah Dagoma et la limpidité de sa présentation autorisent que nous soyons brefs dans nos interventions. Je la félicite également de la diligence avec laquelle ce rapport a été élaboré.
Le mandat de négociation qui sera donné à la Commission européenne doit être impératif. Il y va de la défense des intérêts de l’Union, et de ceux de la France.
S’agissant des préférences collectives, je rappelle que le principe de précaution a valeur constitutionnelle en France.
Dernière remarque : j’aurais apprécié qu’on n’utilise pas d’expressions anglo-saxonnes dans ce projet de résolution. Pourquoi, aux alinéas 42, 44 et 68, invoquer la procédure intitulée « trade promotion authority » ou « fast track » ou bien les « international financial reporting standards » ? Je propose donc trois amendements rédactionnels pour supprimer ces expressions. Ce serait le début d’une contre-attaque en faveur de la langue française.
M. Jacques Myard. Très bien !
Mme Danielle Auroi. Hier, la commission des affaires européennes a adopté le rapport de Seybah Dagoma à l’unanimité. Les quelques modifications que nous avons souhaité y apporter y ont déjà été intégrées.
La Commission européenne s’est lancée de manière imprudente en cette affaire, sans tirer les leçons de la négociation en cours avec le Canada, où un mandat flou avait été donné, si bien que maintenant les négociations achoppent presque sur chaque point. Ne commettons pas de nouveau la même erreur avec les États-Unis.
Pur ce qui concerne l’exception culturelle, on a l’impression que la Commission choisit elle-même d’aller à Canossa. Pourquoi irions-nous nous pendre alors que les États-Unis ne nous ont même pas donné la corde ? Steven Spielberg lui-même n’a-t-il pas rendu hommage à l’exception culturelle européenne lors du dernier festival de Cannes ? Au-delà de l’exception culturelle, il y va du modèle européen tout entier et de tout ce à quoi les citoyens européens sont attachés. Il faut tenir compte des différences dans la façon de travailler, de produire, de penser même, entre l’Europe et les États-Unis. Sur les gaz de schiste, dont, nous, écologistes, mais aussi d’autres, jugeons des plus contestables les techniques d’exploitation, les États-Unis n’hésitent pas à foncer. Cela leur permet de disposer provisoirement d’une énergie bon marché, ce qui profite immédiatement au consommateur américain. C’est le seul point qu’ils prennent en considération. Tant pis si du fait de l’exploitation du gaz de schiste, la mythique route 66 de Jack Kerouac, qui les traverse de part en part, s’est effondrée ! Ils ne soucient plus non plus de leurs centrales nucléaires. Ce n’est pas du tout la logique européenne, beaucoup plus régalienne.
M. Jacques Myard. Vous êtes donc favorable aux centrales nucléaires ?
Mme Danielle Auroi. Je ne suis favorable ni au nucléaire ni aux gaz de schiste. Je milite pour les énergies et les techniques propres, ainsi que pour l’efficacité énergétique, ce qui permettrait de surcroît de créer des emplois.
La commission des affaires européennes a voté ce projet de résolution à l’unanimité parce qu’il est prudent et qu’il donne à la Commission un mandat très restrictif, dans le respect de l’identité et de la diversité européenne.
M. Paul Giacobbi. Je souligne à mon tour l’exceptionnelle qualité du travail de la rapporteure.
Peut-on aujourd’hui défendre des présupposés idéologiques allant à l’encontre de l’expérience et de ce que nous a appris la science économique depuis un siècle et demi ? Prétendre que les vertus du libre-échange ne sont vantées que par « des modèles économiques réducteurs aux présupposés libéraux », c’est faire fi du mouvement de pensée, qui a débuté avec David Ricardo, Stuart Mill et Adam Smith, dont les idées ont fait leurs preuves de manière incontestée, comme en atteste l’exemple de l’Angleterre où est née la révolution industrielle et de l’Empire britannique. Votre argument, madame la rapporteure, risque de ne pas rencontrer grand succès dans une négociation internationale. En outre, l’arbre ne doit pas cacher la forêt. La liberté des échanges a certes conduit, je ne le conteste pas, à des effets pervers, des inégalités, voire des drames. Pour autant, l’expérimentation inverse, que nous avons connue avec l’économie fermée et le rouble non convertible de l’Union soviétique, n’a eu que des succès bien moindres. Ne risquons donc pas le ridicule ! Un accord de libre-échange entre les États-Unis et l’Union européenne est une chance pour les deux entités.
Pour ce qui est de la localisation des investissements, notre commission pourra travailler dans le cadre de la mission commune créée avec la commission des affaires économiques sur l’investissement étranger, présidée par notre collègue François Scellier.
Il faut se garder d’énormes contre-sens sur les différences entre l’Europe et les États-Unis en matière fiscale et sociale. Les charges sociales conventionnelles sur le travail ne sont pas outre-Atlantique ce que l’on a tendance à croire en France, le droit du travail américain non plus. La CGT n’oserait même pas proposer la clause d’exclusivité syndicale (« union shop »), en vigueur dans un grand nombre d’États fédérés américains !
Vous avez raison, madame la rapporteure, de faire allusion aux différences de politique monétaire entre les deux rives de l’Atlantique, et vous abordez le sujet avec justesse. Il y a le rôle des banques centrales, les politiques de change, mais surtout des différences structurelles fondamentales. L’appel public à l’épargne représente 80 % du concours à l’économie aux États-Unis et les concours bancaires 20 %. C’est l’inverse en Europe, ce qui rend difficile toute comparaison.
Ce qui est demandé à l’alinéa 64 du projet de résolution reviendrait à exiger une réforme fondamentale de la Constitution des États-Unis, puisque cela remet en cause rien moins que leur structure fédérale. Je doute donc de la possibilité d’atteindre l’objectif !
Enfin, s’agissant des recommandations du comité de Bâle, dites Bâle III, les États-Unis et l’Europe ont une approche très différente. Les États-Unis souhaitent en théorie interdire le trading pour compte propre. C’était l’un des objectifs du Glass-Steagall Act. En France, le projet de loi de séparation et de régulation des activités bancaires n’a, hélas, introduit cette disposition que de façon homéopathique. Cela étant, les États-Unis n’ont pas encore appliqué la Volcker Rule, introduite dans le Dodd-Franck Act de juillet 2010 et qui vise à limiter les investissements spéculatifs des banques.
M. Michel Terrot. À mon tour, j’adresse mes compliments à notre rapporteure pour la qualité et la pertinence de ses analyses. Le marché transatlantique favorise les fusions-acquisitions d’entreprises, si bien que les multinationales contrôlent de plus en plus l’économie et la finance. En 2005, les 500 plus grandes entreprises au monde contrôlaient déjà la moitié du commerce mondial. Le futur accord de libre-échange ne risque-t-il pas d’accentuer cette tendance, au détriment des PME et des indépendants ? Quelle est la position des représentants du patronat sur cet accord ? Vous les avez certainement auditionnés.
M. François Asensi. Je salue moi aussi le travail de la rapporteure. Pour autant, je ne partage pas le consensus général. Je ne crois pas à un mandat impératif que le Parlement français pourrait donner à l’exécutif, et encore moins au mandat impératif que l’exécutif français pourrait imposer à Bruxelles.
La négociation sera inégale et extrêmement difficile avec les États-Unis, entité économique et politique soudée, alors que les 27 États-membres de l’Union ont des positions divergentes sur de nombreux points. Pensons à l’attitude du Royaume-Uni ou de la Pologne.
Il aurait fallu dresser un bilan préalable du libre-échangisme et du libéralisme et analyser leurs conséquences sur les politiques européennes. On espère que le développement des relations économiques avec les États-Unis permettra de gagner quelques points de croissance. Il est étonnant que l’Union européenne, première économie mondiale, s’en remette ainsi aux États-Unis pour la relance de sa croissance.
Je souscris en revanche au projet de résolution. Je suis d’accord sur les limites à poser, mais ne pense pas, hélas, que ce texte puisse infléchir en quoi que ce soit l’attitude du Conseil européen ni ultérieurement la négociation. Or, il est inquiétant que M. Barroso défende l’idée d’inclure le secteur audiovisuel dans le champ de la négociation ou que M. Cameron souhaite que tout soit mis sur la table. Nous avons raison de résister et de tenter d’imposer un mandat offensif, à défaut qu’il puisse être impératif. Bon courage aux négociateurs pour obtenir des États-Unis qu’ils ouvrent leurs marchés publics ! Nul n’ignore non plus que des mesures protectionnistes y ont été prises dans plusieurs secteurs, comme celui de l’acier. On sait aussi ce qui est advenu du marché des avions ravitailleurs.
Bien qu’ils en partagent la philosophie, les députés du Front de gauche ne voteront pas ce projet de résolution, convaincus que l’avis, fût-il généreux, de notre Parlement ne comptera pas.
M. Pierre Lellouche. Je crains de partager l’avis de M. Asensi sur ce projet de résolution, qui risque de n’être pas d’un grand poids. Je n’en félicite pas moins Mme Dagoma, que j’ai eu la chance de connaître lorsqu’elle était élue municipale dans la première circonscription de Paris dont je suis l’élu. Elle vient de nous présenter avec beaucoup d’intelligence et compétence un rapport d’une très grande technicité.
Je milite depuis longtemps en faveur d’un accord de libre-échange transatlantique. Depuis l’échec du cycle de Doha, le commerce international s’organise par le biais d’accords régionaux, sub-régionaux et inter-régionaux. Il est indispensable que les deux zones historiquement liées que sont l’Union européenne et les États-Unis aillent au-delà des accords de défense de l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord (OTAN) afin de consolider une relation économique, déterminante pour l’économie européenne et pour l’économie française, qu’il s’agisse des exportations ou des investissements.
Le commerce extérieur est, hélas, une compétence totalement fédéralisée en Europe. Une fois la position française arbitrée au niveau interministériel et après notre intervention – pour autant que nous ayons le temps pour cela –, elle sera transmise à Bruxelles. Une fois connus les différents mandats que chacun des États membres souhaite donner à la Commission, le commissaire Karel de Gucht arbitrera et élaborera le mandat de négociation européen. Il est donc fondamental que nous fassions connaître préalablement d’éventuelles lignes rouges. En effet, la négociation aura ensuite lieu hors du contrôle des États et bien sûr des Parlements nationaux. À cet égard, je souhaiterais savoir de l’équipe de Bercy si tous les secteurs-clés de l’économie française ont bien été consultés en amont. Je crains que quelques-uns n’aient été oubliés, tant on s’est saisi tardivement du sujet.
L’attitude de certains partenaires européens, quand les intérêts de leur pays sont en jeu, m’inquiète. Je pense par exemple à ce qui s’est passé en Allemagne lors de la visite du Premier ministre chinois en Allemagne la semaine dernière. Après des années d’hésitation sur la question des panneaux solaires – la France avait plaidé, sans succès, en faveur d’un durcissement de la position européenne – et devant l’effondrement de son industrie en ce domaine, l’Union européenne a décidé d’augmenter de 40 % les droits de douane sur les panneaux en provenance de Chine, après que les États-Unis ont, eux, décidé de les taxer à 250 %. Mais d’éventuelles sanctions ont été bloquées par l’Allemagne, qui exporte l’essentiel de ses véhicules en Chine, ces exportations représentant plus de la moitié des 180 milliards de son excédent commercial.
M. Jacques Myard. Nous n’avons pas tous les mêmes intérêts et nous voulons faire l’Europe ! Le découvrez-vous seulement aujourd’hui ?
M. Pierre Lellouche. Plusieurs responsables français, dont la ministre du commerce extérieur, sont tentés d’exclure a priori certains secteurs comme l’agriculture et les biens culturels. Cela serait contre-productif. En effet, le Congrès américain fera alors de même de son côté, et le champ de la négociation se réduira comme peau de chagrin. Dussé-je être le seul de cet avis ici, je pense qu’il faut tout mettre sur la table des négociations, notamment le secteur de la défense. Ne nous leurrons pas, il n’y pas de marché unique pour l’industrie militaire en Europe, seulement des morceaux d’industries nationales qui sont en train d’être rachetés par les États-Unis. Si nous voulons pouvoir intervenir demain sur le marché américain, il faut faire tomber les barrières non tarifaires. Cet accord le permettra. Sinon, autant renoncer de suite à cet objectif !
Il faudrait éviter que le projet de résolution n’énonce une série de vœux pieux. Que les États-Unis ne jouent pas du niveau du dollar en fait partie. Qui pourrait croire que cet accord est de nature à modifier la politique de change des États-Unis ou à les conduire à réviser leur Constitution ? Si on trouve l’euro trop fort, c’est à la Banque centrale européenne qu’il faut demander d’intervenir ! Et si on veut ouvrir les marchés de tel ou tel État fédéré, il suffit d’appliquer le principe de réciprocité. Il faut en avoir la volonté politique et faire pression sur la Commission. On fait bien jouer cette clause avec le Canada, lorsque Bombardier gagne des marchés de renouvellement des trains en banlieue parisienne et que la France ne peut toujours pas exporter les siens dans certaines régions canadiennes.
J’en viens au suivi parlementaire. Le Congrès américain suit de très près tous les accords commerciaux internationaux et les parlementaires n’hésitent jamais à réclamer une mesure protectionniste pour protéger une production de leur État. Je souhaiterais que nous fassions de même. Madame la présidente, notre commission peut se donner les moyens de suivre étroitement la négociation. Il suffit d’en avoir la volonté politique. Mettons en place une sous-commission qui en sera spécifiquement chargée. À défaut, ne nous plaignons pas que le Congrès américain soit plus efficace que nous !
En conclusion, il me paraît bien tardif de traiter seulement aujourd’hui de ce sujet alors que le Conseil européen doit se prononcer le 14 juin. Je ne suis pas certain non plus que tout le travail de concertation en interne côté français ait été fait. Il faudra négocier fermement à Bruxelles pour que d’autres États ne risquent pas d’imposer des points que nous refusons. Il faudra ensuite assurer le suivi parlementaire étroit que j’appelle de mes vœux. Enfin, ne nous berçons pas d’illusions, plus de secteurs auront été exclus du champ de la négociation, plus cela sera favorable aux États-Unis. Il faut au contraire tout mettre sur la table et ensuite ne pas hésiter à faire des « deals ».
Mme la présidente Élisabeth Guigou. Soyez rassuré, cher collègue, un suivi est bien prévu, aux modalités duquel nous réfléchissons.
M. Michel Destot. Je m’associe aux félicitations déjà adressées à Seybah Dagoma. Au-delà de cet accord de libre-échange et du mandat de négociation à donner à la Commission européenne, regardons le cadre plus général dans lequel tout cela s’inscrit. On ne joue pas aux billes, mais aux échecs. C’est une guerre commerciale. Cet accord aura des répercussions sur les pays émergents, notamment la Chine, la Russie, l’Inde et le Brésil. Sa perspective préoccupe d’ores et déjà les autorités chinoises. Avons-nous une véritable stratégie permettant de parvenir à terme à réguler vraiment l’ensemble du marché mondial ?
M. Noël Mamère. À mon tour de féliciter Seybah Dagoma pour la qualité de sa proposition de résolution. Comme mon collègue François Asensi, je doute fort qu’en dépit de sa qualité, ce texte puisse influencer la position du Conseil des ministres européen, d’autant que le président Barroso pousse cet accord pour des raisons n’ayant rien à voir avec la libéralisation des échanges.
Nous nous sommes battus à la fin des années 1990 contre l’accord multilatéral sur les investissements (AMI), que le Premier ministre Lionel Jospin avait, à juste titre, stoppé. Nous sommes aujourd’hui face à un accord du même type par lequel les États-Unis espèrent modifier certains règlements afin de pouvoir pénétrer plus facilement le marché chinois et également nous envahir de certains produits. Ils sont en train d’utiliser cet accord sur le dos de l’Union européenne. L’exemple de l’ALENA est éclairant. Aujourd’hui, une entreprise peut se battre contre un État, alors que les règles de l’OMC exigent que les différends soient réglés d’État à État. Avec le futur accord transatlantique, des multinationales pourront s’attaquer directement à des États au motif qu’elles ne peuvent pas faire tous les profits qu’elles souhaiteraient ou engager des plans sociaux à leur convenance.
Le groupe Vert au Parlement européen se battra avec détermination contre ce projet d’accord qui, en réalité, ne vise pas à accroître les échanges de part et d’autre de l’Atlantique puisqu’un tiers du commerce mondial déjà est transatlantique et que les barrières tarifaires ne sont pas très élevées, mais à modifier les normes et les règlements. Danielle Auroi a évoqué les OGM. On pourrait citer aussi l’exception culturelle, pour la défense de laquelle nous nous sommes trouvé un allié formidable en la personne de Steven Spielberg, président du dernier festival de Cannes !
Qu’on ne s’y trompe pas, les États-Unis cherchent à pénétrer les marchés européens, pas seulement dans le domaine agricole. Pour nous, la priorité devrait être à l’intégration européenne. Comment favoriser une Europe qui soutienne l’industrie et l’innovation, qui produise moins de CO2 et donc contribue moins au réchauffement climatique, qui soit capable d’éradiquer les paradis fiscaux en son sein et d’aller vers l’harmonisation fiscale, qui ait les moyens de stopper des crimes contre l’humanité, ce qui se suppose qu’elle se dote d’une véritable politique étrangère et d’une politique de défense commune ? Là est la priorité.
Je suis hostile à cet accord qui, sous un habit différent, ressemble à s’y méprendre au défunt AMI. Nous ferons tout pour nous y opposer. En revanche, je voterai le projet de résolution, même si j’en connais les limites – comme vous d’ailleurs, madame la rapporteure.
Mme Marie-Louise Fort. Beaucoup de choses ont déjà été dites que je partage, notamment par Hervé Gaymard. On a raison de balayer un champ assez vaste dans ce projet de résolution. Plus nous fournirons d’éléments à la Commission, plus nous aurons de chances d’en voir retenus.
L’Union européenne part avec un handicap dans cette négociation. Ayant accompagné la rapporteure la semaine dernière aux États-Unis, j’ai pu constater que nous y sommes perçus comme demandeurs. Les parlementaires que nous avons rencontrés sont plus préoccupés pour l’instant par l’accord transpacifique.
Il y a des lignes rouges à ne pas franchir, dans le domaine de l’agriculture et du cinéma – que les États-Unis appréhendent comme une industrie, alors que nous l’abordons, nous, plutôt sous l’angle de l’exception culturelle. Le monde agricole français s’inquiète de la préservation de la souveraineté alimentaire de l’Europe. Les éleveurs sont très inquiets.
Il faut tendre à une convergence réglementaire entre les États-Unis et l’Union européenne. Les droits de douane étant déjà très faibles, l’essentiel de l’enjeu porte sur la suppression des barrières non tarifaires qui pèsent sur la compétitivité des entreprises européennes et constituent autant d’obstacles au commerce. Cela dit, l’industrie automobile française est extrêmement réservée sur cet accord.
Pour le reste, il serait présomptueux de penser pouvoir obtenir des États-Unis qu’ils modifient la répartition des compétences entre État fédéral et États fédérés. Au travers de nos rencontres avec diverses organisations professionnelles et ONG américaines, nous avons ressenti qu’elles comptaient sur l’Union européenne pour faire avancer leurs problématiques. Pour autant, elles ne se font pas d’illusions. Les OGM aussi bien que le gaz de schiste sont vraiment entrés dans les mentalités américaines, et on aura beaucoup de mal à peser sur ces sujets-là aux États-Unis.
Pierre Lellouche a raison, nous nous y prenons un peu tard par rapport à la date du 14 juin. Mais dans l’esprit des Américains, il est clair que la négociation prendra du temps et que Barack Obama aura sans doute terminé son mandat avant qu’elle ne soit bouclée.
M. Jacques Myard. Bon an mal an, le commerce mondial croît d’environ 7 % chaque année. Ne faisons donc pas croire que ce type d’accords de libre-échange serait indispensable à sa santé. Indépendamment de tous accords, il se porte bien. Et s’il y a actuellement des difficultés En Europe, c’est plutôt à cause de la récession dans la zone euro. Ne perdons jamais de vue que le commerce extérieur représente 10 % du PIB aux États-Unis, contre 23 % à 24 % chez nous.
Je suis effaré par les propos que j’entends ce matin s’agissant du mandat de négociation de la Commission. Vous avez tous voté les traités européens. Ne venez pas déplorer maintenant le fonctionnement fédéral de l’Union européenne ! Soyez cohérents ! « Dieu se moque de ceux qui chérissent les causes de leurs malheurs », écrivait Bossuet. Ou bien on accepte une Union fédérale, ou bien on exerce son droit de veto. Ce qui s’est passé récemment avec l’Allemagne montre que les règles adoptées ne sont pas appliquées.
S’agissant des industries de défense, je suis en désaccord total avec Pierre Lellouche. Libéraliser ce secteur, ce serait condamner les industries d’armement européennes à disparaître. Les États-Unis ont en effet d’importants surplus et ils gagneront toujours les marchés, comme ils l’ont fait en Pologne, parce que leurs prix sont imbattables grâce à leur complexe militaro-industriel.
Si on se contente de signer un accord avec le département d’État sans qu’il soit ratifié par le Congrès, cela ne sera que poudre de perlimpinpin car il ne liera pas les États fédérés. Si nous ne pouvons modifier la Constitution américaine, nous pouvons exiger que l’accord soit sanctionné par un vote du Congrès.
Il faut absolument que la réglementation bancaire issue de Bâle III figure dans la négociation. Les États-Unis viennent d’interdire aux banques européennes, considérées comme des banques étrangères, de lever des dollars américains. Ce n’est autre que du protectionnisme.
En conclusion, ne nous lamentons pas sur le fonctionnement de l’Union européenne. Vous l’avez voulu, moi pas. Ne nous étonnons pas aujourd’hui de nous retrouver Gros-Jean comme devant.
M. Philippe Cochet. Je félicite moi aussi la rapporteure pour la présentation de son rapport, assurément l’un des plus beaux que nous ayons eu à examiner depuis le début de la législature.
Même s’il est arrivé que l’Union européenne fasse preuve de naïveté, ne soyons pas naïfs aujourd’hui, mais pragmatiques. La situation respective des balances commerciales des États-Unis et de l’Union européenne est aussi différente que celle des différents États membres de l’Union. Or, l’analyse de chacun dépend d’abord de la situation de son commerce extérieur.
Un mandat de négociation constitue une opportunité. Encore faut-il avoir confiance dans les négociateurs. Pour le reste, des inconnues importantes demeurent, notamment sur l’application des normes et la traçabilité. La Chine, qui ne participe pas à cette négociation, se tient à l’affût, prête à tirer les marrons du feu.
M. Nicolas Dupont-Aignan. J’adresse moi aussi mes félicitations à la rapporteure. La question n’est pas de savoir si on est pour ou contre le libre-échange, mais si on continue à signer des accords déséquilibrés instaurant un libre-échange déloyal qui tue notre économie. Être naïf dix fois de suite, c’est un suicide. Le problème est que le mandat de négociation va être confié à des personnes qui ne défendent pas les intérêts européens, mais sont soumises à des intérêts extérieurs et défendent une vision personnelle. Je vois un symbole dans le fait que nous examinions cette proposition de résolution en ce 29 mai, alors que voilà huit ans, jour pour jour, le peuple français rejetait le projet de Constitution européenne. Le pouvoir est certes passé outre ce rejet en signant le traité de Lisbonne qui a supprimé le droit de veto des nations, qui était pourtant le seul levier d’action et qui a permis en son temps de sauver certaines négociations.
Pour le reste, je suis ravi que l’on défende l’exception culturelle, mais il m’étonnera toujours que dans notre pays, les ouvriers n’aient pas la chance d’être défendus comme les acteurs. J’aimerais que l’on étende le protectionnisme qui a sauvé le cinéma français au reste de l’économie, au lieu de se contenter de défendre un pré carré.
Une fois n’est pas coutume, je rejoins Noël Mamère. Ce projet de résolution, aussi louable soit-il, ne suffira pas. Il ne s’agit pas d’aménager cet accord transatlantique, mais de le combattre ainsi que ses présupposés. Ce sera l’un des éléments-clés du débat politique dans les années à venir, car sa négociation va durer. Ce sera l’occasion de voir si les États démocratiques peuvent encore s’opposer aux multinationales qui font les normes. Ne laissons pas la Commission européenne continuer de ruiner nos nations.
M. Serge Janquin. J’adresse tous mes compliments à notre rapporteure pour la densité et la lucidité de son rapport. Elle a bien mis en évidence le haut degré d’exigence qui doit être le nôtre dans la négociation. Il est un point néanmoins sur lequel je nous trouve timorés. L’Union européenne arrivera à la table des négociations avec une position commune, espérons-le. Les États-Unis, eux, pourront toujours trouver des échappatoires par le biais des États fédérés pour ne pas appliquer l’accord, leur droit constitutionnel leur permettant de jouer entre le niveau fédéral et le niveau des États. Ce n’est pas acceptable. Pourquoi serait-il impensable de faire évoluer la Constitution américaine ? Qu’y aurait-il d’infâmant à dire aux États-Unis que pour qu’il soit possible de conclure un accord avec eux, il faudrait qu’à l’instar de ce que fera l’Union européenne, ils aient une position unique, commune à tous leurs États ?
M. Patrick Balkany. Je remercie Mme Dagoma pour son rapport. La presse a essentiellement mis en avant les exclusions que la France et ses partenaires européens souhaitent dans cet accord, comme celles des biens culturels et de l’audiovisuel. Cette proposition de résolution demande que soient également exclus les secteurs de la défense et de la sécurité et que les dispositions communautaires relatives au clonage du bétail, à l’utilisation des hormones de croissance dans les élevages, aux OGM ou bien encore à la décontamination chimique des viandes ne soient pas remises en question. Les États-Unis de leur côté souhaitent-ils exclure certains secteurs du champ de la négociation ? Sait-on déjà les points de blocage qui pourraient freiner la négociation, sachant que sa durée probable est aujourd’hui estimée à deux ans ?
Mme Estelle Grelier. L’administration américaine semble souhaiter exclure les services financiers.
Je souscris à la philosophie consistant à instaurer des garde-fous et établir des lignes rouges dans cette négociation asymétrique, comme l’a excellemment rappelé la rapporteure. Je salue son travail et l’approche collective qu’elle a permise sur ces sujets.
Nous soutiendrons le Gouvernement français dans sa demande que les services et biens culturels, les préférences collectives et les industries de défense soient exclus. Nous sommes très attachés à ce que tous les volets de la négociation – barrières tarifaires, barrières non tarifaires et ouverture des marchés publics – soient examinés parallèlement. Rien ne doit être conclu sur aucun point tant que tout n’a pas été traité.
Le projet de mandat du commissaire Karel de Gucht est extrêmement large, n’excluant aucun domaine du champ de la négociation. La semaine dernière, le Parlement européen a adopté un projet de résolution, à la demande des parlementaires socialistes français, qui en exclut le secteur culturel, donc protège l’exception culturelle, point qui ne figurait pas initialement dans le projet de mandat. Une résolution du Parlement européen pèse peut-être davantage qu’un ensemble de résolutions des États membres. Il faudrait donc mieux se coordonner avec les députés européens. Comment travailler avec eux ? C’est indispensable pour être plus efficace.
M. Pierre Lequiller. Nous souscrivons au rapport qui nous est présenté et que nous aurions pu cosigner. Il est important que les secteurs des biens et services culturels, de l’agriculture et de la défense soient exclus du champ de la négociation de cet accord – auquel je suis favorable. Un important travail a été mené au Parlement européen entre le Parti populaire européen (PPE) et le Parti socialiste européen (PSE) sur le sujet de l’exception culturelle et c’est à une très large majorité que le Parlement s’est prononcé en faveur de la position française. Il faudra en effet voir comment assurer le suivi de cet accord en liaison avec les députés européens.
Mme la présidente Élisabeth Guigou. Un suivi sera organisé, en liaison avec les parlementaires européens. Nous réfléchissons à ses modalités. Le groupe de travail qui est en place est tout à fait désigné pour en être le lieu. Un point sur l’état d’avancement des négociations sera aussi régulièrement fait devant notre commission.
Mme la rapporteure. Je remercie l’ensemble des intervenants. Monsieur Giacobbi, nous ne sommes pas en Corée du Nord ! Nous ne sommes pas hostiles aux échanges mondiaux. Nous considérons simplement qu’ils doivent être justes et la situation actuelle ne nous paraît pas satisfaisante.
Les accords commerciaux sont normalement votés à la majorité qualifiée au sein de l’Union. Mais comme cet accord transatlantique touche aux aspects commerciaux de la propriété intellectuelle et aux investissements directs, il semblerait qu’une décision à l’unanimité soit requise. La question est en débat. De toute façon, comment pourrait-on avancer si la France d’emblée posait son veto ?
Nous demandons dans ce projet de résolution que soit adoptée la procédure de fast track – je vous prie d’excuser cette expression anglo-saxonne, monsieur Dufau –, qui habilite le président des États-Unis à négocier l’accord, le Congrès, qui a compétence en matière de commerce international, ne pouvant ensuite que l’approuver ou le refuser, sans pouvoir l’amender.
Je ne partage pas le point de vue selon lequel, au motif que le libre-échange est critiquable, mieux vaudrait pratiquer la politique de la chaise vide. Il faut entrer dans la négociation et y défendre nos intérêts. J’entends bien l’argument selon lequel les États-Unis ne vont pas réformer leur Constitution pour conclure un accord de libre-échange. Mais si aucune réciprocité n’est possible, il faudra être dur. Telle est en tout cas ma position.
Je ne reviens pas sur le recours à l’arbitrage. Il doit absolument être exclu du mandat de négociation.
Comment cet accord s’inscrit-il dans le contexte mondial ? Les parlementaires américains que nous avons rencontrés ne nous ont pas caché que leur priorité était l’accord transpacifique, auquel seront parties tous les États de la zone, sauf la Chine. Or, le déficit commercial des États-Unis vis-à-vis de la Chine s’élève à 315 milliards de dollars. Nous avons, pour notre part, un accord de libre-échange en négociation avec le Japon, partie prenante à l’accord transpacifique. Le Japon se trouvera donc en quelque sorte en position d’arbitre.
Je ne partage pas du tout l’avis de M. Lellouche selon lequel tout devrait être mis sur la table des négociations, y compris le secteur de la défense. Il doit absolument en être exclu.
Lors de nos auditions, nous avons rencontré les représentants des PME, notamment la CGPME. Ils nous ont exposé les problèmes structurels qu’ils rencontrent pour exporter et ont insisté sur le coût que représentent les barrières non tarifaires, notamment les procédures administratives.
Monsieur Giacobbi, si j’ai qualifiée de « réducteurs » les modèles sur lesquels se fondent les études d’impact, c’est que seulement vingt secteurs ont été décrits et que le monde y a été divisé en onze zones. Quant aux « présupposés libéraux » de ces études, c’est que la concurrence y est supposée « pure et parfaite » et que la question des inégalités de revenus comme celle de la répartition des gains éventuels du libre-échange y sont totalement ignorées.
La traçabilité est un sujet important. Pour l’alimentation, notre système repose sur une traçabilité et des contrôles « de la fourche à la fourchette ». Le système américain est totalement différent : on s’y moque de l’étape de la production mais à l’autre bout de la chaîne, on décontamine à l’eau de Javel. Nos conceptions sont radicalement opposées. Il faudra tenir bon sur les nôtres.
Les négociateurs américains disent pour l’instant que tout est mis sur la table. Je pense pourtant que le secteur financier sera exclu, de même que ce qui touche aux transports maritimes et aériens. La négociation sera aussi très dure sur l’ouverture des marchés publics.
En conclusion, je pense qu’il faut entrer dans cette négociation. La France ne peut pas s’isoler en la refusant seule. Mais le mandat doit être strict et exigeant. Nous verrons bien ensuite ce qui adviendra. Nous défendrons nos intérêts, les États-Unis défendront les leurs. Après les auditions que nous avons eues là-bas, je pense que si l’accord devait être conclu aujourd’hui, il ne faudrait pas, en l’état, le signer. Mais négocions. Il sera toujours temps de prendre position à la fin des négociations.
Mme la présidente Élisabeth Guigou. Nous vous remercions pour ce travail remarquable.
La commission adopte les amendements rédactionnels AE 1, AE 2 et AE 3 de M. Jean-Pierre Dufau.
La commission adopte l’article unique de la proposition de résolution ainsi modifiée.
AMENDEMENTS EXAMINÉS PAR LA COMMISSION
Article unique
Amendement n° AE1, présenté par M. Jean-Pierre Dufau
À l’alinéa 42, substituer aux mots :
« IFRS (International financial reporting standards) »,
les mots :
« dites "normes internationales d’information financière" ».
Amendement n° AE2, présenté par M. Jean-Pierre Dufau
À l’alinéa 44, supprimer les mots :
« intitulée "trade promotion authority" ou "fast track" ».
Amendement n° AE3, présenté par M. Jean-Pierre Dufau
À l’alinéa 68, substituer aux mots :
« du "fast track" »,
les mots :
« de la procédure de ce pays permettant que l’accord soit ensuite approuvé ou refusé par le Congrès sans pouvoir être amendé ».
ANNEXE : LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES PAR LA RAPPORTEURE
(par ordre chronologique)
– M. Hubert Védrine, ancien ministre des affaires étrangères
– M. Jean-Louis Beffa, président d’honneur de Saint-Gobain
– Confédération paysanne : M. Christian Boisgontier, membre du comité national
– Coordination rurale : M. François Lucas, premier vice-président
– Fédération nationale syndicats d’exploitants agricoles (FNSEA) : M. Claude Soude, sous-directeur des politiques agricoles, et Mme Nadine Normand, chargée des relations parlementaires
– Association interprofessionnelle du bétail et des viandes (INTERBEV) : M. Baptiste Buczinski, chargé des affaires européennes, et Mme Marine Colli, chargée des relations parlementaires
– Association nationale des industries agroalimentaires (ANIA) : M. Jean-Luc Pelletier, président du groupe « OMC et négociations bilatérales » et délégué général de l’Union des syndicats des industries des produits amylacés et de leurs dérivés (USIPA), et Mme Diane Doré, directrice des échanges extérieurs à l’ANIA
– Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) : M. Jean Fergon et Mme Béatrice Brisson, responsable des affaires européennes et internationales
– Fédération française des sociétés d’assurance (FFSA) : Mme Nathalie Quintart-Clerc, du département international, et M. Jean-Paul Laborde, directeur des affaires parlementaires
– Fédération française des industries de santé (FEFIS) : M. Christian Parry, vice-président du Syndicat de l’industrie du diagnostic in vitro (SIDIV)
– Comité des constructeurs français d’automobiles (CCFA) : Mme Laurence Massenet, directrice des affaires internationales
– Fédération des industries des équipements pour véhicules (FIEV) : M. Arnaud de David-Beauregard, vice-président en charge des opérations
– Union des industries chimiques (UIC) : M. Pascal Perrochon, responsable des affaires internationales