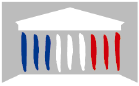
N° 1806
______
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 19 février 2014.
RAPPORT
FAIT
AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES SUR LA PROPOSITION DE LOI relative aux effets de la prise d’acte de rupture du contrat de travail par le salarié,
PAR M. Thierry BRAILLARD,
Député.
——
Voir le numéro :
Assemblée nationale : 1199.
___
Pages
INTRODUCTION 5
I. LA PRISE D’ACTE : UN MODE DE RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL SPÉCIFIQUE… 5
A. UN PROCESSUS TRÈS ENCADRÉ PAR LA JURISPRUDENCE… 5
B. …MAIS RISQUÉ POUR LE SALARIÉ 9
1. Les conséquences de la prise d’acte pour le salarié 9
2. La prise d’acte et les autres modes de rupture du contrat de travail à l’initiative du salarié 11
II. …QUI DOIT FAIRE L’OBJET D’UN EXAMEN SPÉCIFIQUE PAR LES CONSEILS DE PRUD’HOMMES 13
A. UNE PROCÉDURE PRUD’HOMALE INADAPTÉE 13
1. Une tentative de conciliation sans impact sur l’issue du litige 13
2. Des délais d’examen trop longs 15
B. UNE ÉVOLUTION NÉCESSAIRE 17
1. L’introduction d’une procédure dérogatoire par la proposition de loi 17
2. Les améliorations apportées lors de l’examen en commission 18
TRAVAUX DE LA COMMISSION 19
Article unique (art. L. 1237-1-1 [nouveau] du code du travail) : Procédure d’examen des prises d’acte de rupture du contrat de travail par les conseils de prud’hommes 31
Titre 35
La prise d’acte de la rupture du contrat de travail constitue une voie de rupture du contrat de travail alternative aux modes de rupture réglementés par le code du travail, que sont le licenciement, la démission et la rupture conventionnelle.
La prise d’acte est une construction jurisprudentielle qui caractérise une situation de fait : celle dans laquelle le salarié, considérant que le comportement de son employeur rend impossible le maintien du contrat de travail, prend acte de la rupture du contrat et quitte l’entreprise tout en imputant la responsabilité de cette rupture à l’employeur. Il incombe alors au juge de déterminer quelle est la partie à l’origine de la rupture du contrat.
Ainsi, concrètement, la prise d’acte consiste, pour un salarié, à annoncer à son employeur qu’il quitte l’entreprise, en raison, par exemple, du non-respect par l’employeur de ses obligations contractuelles ou d’un comportement fautif de ce dernier. Le salarié n’est toutefois pas tenu de justifier son départ, dont les motivations seront examinées par la juridiction prud’homale. Si les griefs invoqués à l’encontre de l’employeur sont considérés comme fondés, la prise d’acte sera qualifiée de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; a contrario, si le conseil de prud’hommes estime les griefs infondés, la prise d’acte produira les effets d’une démission.
La prise d’acte est aujourd’hui une notion très bien encadrée par la jurisprudence, mais sa mise en œuvre reste risquée pour le salarié à la fois en raison de son issue incertaine et parce qu’elle se traduit par une cessation immédiate du contrat de travail, interrompant le versement du salaire et n’ouvrant droit que sous des conditions très restrictives au versement d’une indemnisation au titre de l’assurance chômage.
La Cour de cassation a défini le régime juridique de la prise d’acte dans plusieurs arrêts du 25 juin 2003, sans que cette définition ne varie depuis. Aux termes de cette décision, la Cour estime que « lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison des faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire, d’une démission ».
Cette décision constitue un revirement, la jurisprudence antérieure considérant qu’en aucun cas, la prise d’acte ne pouvait être considérée comme une démission, quand bien même les griefs du salarié n’étaient pas fondés. Ainsi, la rupture s’analysait toujours en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Désormais, l’employeur ne peut se voir imputer la responsabilité de la rupture que si le juge constate que les faits qui lui sont reprochés sont fondés. Il appartient donc au juge du fond de déterminer si les faits invoqués justifient ou non la rupture du contrat et d’en déduire si cette dernière produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou d’une démission. Le juge des référés n’a en effet pas le pouvoir de se prononcer sur l’imputabilité de la rupture du contrat de travail, cette compétence relevant uniquement du pouvoir des juges du fond (Cass. soc. 11 mai 2005).
Relevons également qu’il découle des mêmes arrêts du 25 juin 2003 que la prise d’acte ne peut être mise en œuvre que par le salarié et non par l’employeur, qui est tenu d’engager une procédure de licenciement pour rompre le contrat de travail d’un salarié. L’employeur qui prend l’initiative de rompre le contrat de travail, ou qui le considère comme rompu du fait du salarié, doit mettre en œuvre la procédure de licenciement : à défaut, la rupture s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse (Cass. soc. 20 avril 2005). Le licenciement est donc la seule solution dont dispose l’employeur qui entend se séparer d’un salarié.
Aucun formalisme n’est attaché à la prise d’acte. Celle-ci peut notamment résulter d’une démission jugée équivoque et requalifiée ensuite par le juge : ainsi, lorsque le salarié prend l’initiative de la rupture du contrat de travail et démissionne, tout en faisant valoir (sur le moment ou, ensuite, au cours de la procédure judiciaire) qu’il a été contraint d’agir de la sorte en raison du comportement de son employeur, il s’agit d’une prise d’acte (Cass. soc. 13 décembre 2006). Un même raisonnement peut être tenu en cas de départ à la retraite (Cass. soc. 15 mai 2013).
L’écrit par lequel le salarié a pris acte de la rupture du contrat de travail ne fixe donc pas les limites du litige : le juge est en effet tenu d’examiner les manquements de l’employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit (Cass. soc. 29 juin 2005). En revanche, la Cour de cassation a précisé dans un arrêt du 9 octobre 2013 que le salarié ne pouvait invoquer devant le juge un manquement de l’employeur certes antérieur à la prise d’acte mais connu du salarié postérieurement à celle-ci.
Enfin, tous les griefs invoqués par le salarié ne sont pas susceptibles de justifier la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur. Il appartient en effet au salarié d’apporter la preuve de l’existence de faits réels et suffisamment graves à l’encontre de son employeur (Cass. soc. 28 novembre 2006). Afin d’apprécier la portée des faits invoqués, la Cour de cassation exige en effet un contrôle, par les juges du fond, de la « gravité suffisante » des manquements de l’employeur (Cass. soc. 16 novembre 2004). Depuis un arrêt du 30 mars 2010, la Cour de cassation exige même que les manquements reprochés à l’employeur fassent obstacle à la poursuite du contrat de travail : ainsi, la prise d’acte ne permet au salarié de rompre le contrat de travail aux torts de l’employeur qu’en cas de « manquement suffisamment grave de l’employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail ».
Depuis 2003, la Cour de cassation a caractérisé un certain nombre de situations susceptibles de constituer des prises d’acte devant s’analyser comme un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, telles que :
– l’existence de faits de harcèlement (Cass. soc. 19 janvier 2012) ou de mesures discriminatoires (Cass. soc. 12 décembre 2012) ;
– une atteinte à la dignité du salarié (Cass. soc. 7 février 2012) ;
– des manquements de l’employeur à son obligation de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, par exemple en l’absence de mesures de reclassement mises en œuvre à la suite d’une déclaration d’inaptitude (Cass. soc. 14 octobre 2009) ou en cas de violences exercées sur le lieu de travail (Cass. soc. 15 décembre 2010) ;
– le non-respect par l’employeur de ses obligations contractuelles telles que la non-fourniture de travail (Cass. soc. 31 octobre 2006), la modification de la rémunération (Cass. soc. 18 janvier 2012), le non-paiement du salaire (Cass. soc. 6 juillet 2004), ou le non-respect des dispositions relatives au salaire minimal conventionnel (Cass. soc. 5 mai 2010).
On notera que la Cour de cassation a même récemment étendu sa jurisprudence aux agissements de l’employeur commis en dehors du temps et du lieu de travail (Cass. soc. 23 janvier 2013).
La prise d’acte entraîne la rupture immédiate du contrat de travail. La Cour de cassation a en conséquence jugé qu’elle ne pouvait être rétractée (Cass. soc. 14 octobre 2009). Cette jurisprudence diverge ainsi de la solution retenue pour la démission où, quand la volonté du salarié de démissionner n’est pas clairement définie et que celle-ci est suivie d’une rétractation, sa validité est appréciée par les juges du fond.
Il résulte de cette jurisprudence que, dès lors que le conseil de prud’hommes a été saisi, le litige ne peut prendre fin qu’une fois tranchée la question de l’imputabilité de la rupture, cette dernière déterminant les effets juridiques de la prise d’acte, différents selon l’appréciation faite par les juges de la légitimité des griefs invoqués par le salarié (1). La prise d’acte de la rupture du contrat produira ainsi :
– soit les effets d’un licenciement abusif si les griefs invoqués contre l’employeur sont fondés,
– soit les effets d’une démission si les juges estiment que les faits sont infondés.
En cas de licenciement abusif, l’employeur sera condamné à verser au salarié :
– l’indemnité compensatrice de préavis (qui est calculée en se basant sur le salaire que le salarié aurait touché s’il avait travaillé pendant la période du préavis) et l’indemnité compensatrice de congés payés ;
– l’indemnité de licenciement, calculée en fonction de l’ancienneté du salarié (à la date de la prise d’acte) et de la taille de l’entreprise ;
– l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou pour licenciement nul. Signalons à cet égard que, dans le cadre d’une prise d’acte, l’alternative qui s’offre habituellement au salarié en cas de licenciement nul (soit demander une indemnisation au moins égale à six mois de salaire, soit demander sa réintégration et le paiement des salaires correspondant à la période comprise entre le licenciement et la réintégration), n’est pas ouverte : la prise d’acte étant d’effet immédiat et non rétractable, la réintégration est exclue (Cass. soc. 29 mai 2013) ;
– le cas échéant, une indemnité relative à la perte des droits au DIF (droit individuel à la formation) ;
– s’il y a lieu, une indemnité pour préjudice distinct, « le fait pour un salarié de prendre acte de la rupture de son contrat de travail n’[étant] pas exclusif d’un comportement fautif de l’employeur à l’occasion de la rupture du contrat » (Cass. soc. 16 mars 2010) ;
– une indemnité spécifique pour inaptitude professionnelle, lorsque la prise d’acte émane d’un salarié déclaré inapte suite à un accident du travail ;
– les intérêts légaux. Le salarié peut également bénéficier d’intérêts, au taux légal, qui courent à compter de l’exigibilité des sommes sur lesquelles ils portent, c’est-à-dire à compter de la prise d’acte.
En revanche, si la prise d’acte est qualifiée de démission, le salarié est redevable de l’indemnité correspondant au préavis qu’il n’a pas exécuté (Cass. soc. 17 février 2004). À noter que cette indemnité est due dès lors que l’employeur en réclame le paiement, même en l’absence d’un quelconque préjudice (Cass. soc. 8 juin 2011). Le salarié peut également être condamné à des dommages et intérêts si la prise d’acte s’est accompagnée d’un comportement déloyal créant un préjudice pour l’employeur, tel que le détournement de clientèle (Cass. soc. 17 février 2004).
Comme indiqué précédemment, la prise d’acte est d’effet immédiat : elle entraîne la cessation immédiate du contrat de travail, la date de la prise d’acte étant considérée comme la date de rupture de la relation contractuelle (Cass. soc. 19 décembre 2007). La rupture du contrat de travail se traduit donc par une grande précarité financière pour le salarié, qui ne perçoit plus son salaire. En effet, les obligations contractuelles de l’employeur prenant fin avec la prise d’acte, aucun salaire n’est dû pour la période postérieure à celle-ci (Cass. soc. 12 décembre 2012).
L’employeur est en revanche tenu de remettre au salarié qui a pris acte de la rupture de son contrat :
– une attestation Pôle emploi ;
– un certificat de travail ;
– et un reçu pour solde de tout compte.
L’employeur ne peut repousser la délivrance de ces documents au salarié, par exemple, à la fin du préavis, qui n’a pas à être exécuté (2) : il doit les lui remettre immédiatement. À défaut, le refus de l’employeur constitue un trouble manifestement illicite qui justifie l’intervention du juge des référés.
La délivrance de l’attestation Pôle emploi ne permet toutefois pas nécessairement au salarié de bénéficier d’une indemnisation au titre du chômage. L’attestation doit en effet mentionner le motif de rupture. Or, même si l’employeur est tenu par les motifs de la prise d’acte tels qu’ils ont été présentés par le salarié (3), ce dernier peut se contenter de mentionner comme motif de rupture : « Prise d’acte de la rupture du contrat de travail ». Ainsi, au moment où Pôle emploi reçoit l’attestation, il n’est pas en mesure de savoir si cette rupture va produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse (ouvrant droit aux allocations de chômage) ou d’une démission (privative de ces mêmes allocations) et doit donc attendre la décision judiciaire.
Dans l’attente du jugement, le salarié ne peut bénéficier de l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) que dans quelques cas très restreints. Il s’agit tout d’abord des situations dans lesquelles la rupture du contrat peut être assimilée à un des cas de démission légitime reconnus par l’accord d’application n° 14 de l’Unédic. Rappelons en effet qu’à l’exception des démissions légitimes, le chômage consécutif à une rupture du contrat de travail à l’initiative du salarié est considéré comme volontaire et donne lieu à une décision de rejet de la demande d’allocation d’aide au retour à l’emploi.
Parmi la liste des démissions légitimes établie par l’Unédic, deux cas de figure peuvent correspondre à une prise d’acte :
– la démission intervenue pour cause de non-paiement des salaires par l’employeur pour des périodes de travail effectuées, à condition que l’intéressé justifie d’une ordonnance de référé lui allouant une provision de sommes correspondant à des arriérés de salaires ;
– la démission intervenue à la suite d’un acte susceptible d’être délictueux dont le salarié déclare avoir été victime à l’occasion de l’exécution de son contrat de travail. Le salarié doit alors justifier avoir déposé une plainte devant le Procureur de la République.
Enfin, en vertu de l’accord d’application n° 12 de l’Unédic, tout demandeur d’emploi non indemnisé qui n’est pas reclassé après 121 jours de chômage peut solliciter un réexamen de sa situation. Ainsi, quatre mois après avoir pris acte de la rupture de son contrat, le salarié peut s’adresser à l’instance paritaire régionale de Pôle Emploi (IPR) afin d’être admis au bénéfice des allocations de chômage. La décision est individuelle et tient compte de plusieurs éléments. Aux termes de la circulaire Unédic n° 2011-25 du 7 juillet 2011, l’examen de la situation de l’intéressé porte ainsi sur les efforts accomplis par le salarié en vue de son reclassement, ses éventuelles reprises d’emploi de courte durée et ses démarches pour entreprendre des actions de formation, de réinsertion ou de requalification. Les motifs du départ du salarié ne doivent en revanche pas être pris en considération. Si l’instance paritaire régionale estime que les efforts de reclassement accomplis par l’intéressé attestent que sa situation de chômage se prolonge contre son gré, elle prend alors une décision d’admission au 122e jour de chômage.
Comme le montrent les exemples cités précédemment ainsi que les précisions apportées par la jurisprudence, la prise d’acte répond à une situation dans laquelle le maintien du salarié dans l’entreprise et la poursuite du contrat de travail ont été rendus impossibles.
Aussi, bien qu’elle se traduise par une plus grande précarité financière pour le salarié et que son issue soit incertaine, la prise d’acte s’impose-t-elle dans les cas les plus difficiles, de préférence à une action en justice en exécution du contrat de travail (en cas de manquement de l’employeur à une obligation contractuelle) ou à une demande de résolution judiciaire du contrat de travail, qui impliquent le maintien du salarié à son poste.
La résolution judiciaire du contrat de travail
— Définition et effets
Tout salarié peut demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail auprès du conseil de prud’hommes compétent localement, s’il estime que les manquements reprochés à l’employeur le justifient.
En effet, aux termes de l’article L. 1221-1 du code du travail, le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun, c’est-à-dire aux règles du droit civil. Or, l’article 1184 du code civil prévoit qu’une condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, « pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement ». La résolution du contrat doit alors être demandée en justice.
Dans l’attente du jugement du conseil des prud’hommes, le salarié continue néanmoins de travailler dans les conditions habituelles. En outre, si le juge prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail, celui-ci prend fin à la date du jugement, mais si le juge refuse la résiliation judiciaire, le contrat de travail est censé se poursuivre normalement.
Par ailleurs, si le salarié est licencié alors qu’une demande de résiliation judiciaire est en cours, le juge doit d’abord rechercher si la demande était justifiée : le juge ne vérifie le bien fondé du licenciement que si la résiliation judiciaire n’est pas justifiée.
Si la résiliation judiciaire est prononcée, elle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou d’un licenciement nul à la date de la décision judiciaire. L’employeur doit verser au salarié l’indemnité de licenciement, les indemnités compensatrices de congés payés et de préavis, l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou pour licenciement nul et l’indemnité liée à la perte de chance d’utiliser les droits acquis au titre du droit individuel à la formation (DIF). L’employeur doit en outre remettre au salarié, à l’issue du contrat de travail, un certificat de travail et l’attestation Pôle emploi.
— Résiliation judiciaire et prise d’acte
Comme l’ont confirmé à votre rapporteur les avocats auditionnés par celui-ci dans le cadre des travaux préparatoires à l’examen de la présente proposition de loi, les conseils des salariés ont tendance à les orienter vers une procédure de résiliation judiciaire, moins risquée pour leurs clients qu’une prise d’acte. En effet, dans le cadre d’une résiliation judiciaire, non seulement le salarié continue à percevoir son salaire, mais son contrat se poursuit même si la justice lui donne tort. Dans le cadre d’une prise d’acte, le salarié n’est plus rémunéré et n’a pas accès à une allocation de chômage mais si, en outre, les griefs invoqués à l’appui de sa demande sont jugés infondés, la rupture du contrat produira in fine les effets d’une démission.
Les avocats interrogés reconnaissent toutefois que, dans la réalité, il est rare qu’un salarié ayant demandé la résiliation judiciaire de son contrat soit réellement en mesure de poursuivre son contrat de travail « dans les conditions habituelles ». Nombreux sont les salariés qui se retrouvent ainsi en congé maladie, lorsque leur maintien en poste s’avère impossible : c’est alors la collectivité qui prend en charge les conséquences de la non-rupture du contrat de travail dans l’attente du jugement du conseil de prud’hommes.
Il n’est pas rare non plus qu’une résiliation judiciaire se transforme in fine en prise d’acte lorsque la situation du salarié resté en poste s’avère intenable, en raison de la durée de la procédure.
Depuis 2008, en cas de simple désaccord, employeur et salarié peuvent convenir d’une rupture amiable du contrat de travail sous la forme d’une rupture conventionnelle. Si la rupture conventionnelle permet d’éviter le recours à un licenciement personnel ou à une démission, elle ne peut en revanche se substituer à la prise d’acte dont le fondement réside dans un manquement grave ou un comportement fautif de l’employeur et dont l’issue ne peut être que judiciaire. La jurisprudence considère d’ailleurs que la rupture conventionnelle est nulle si le consentement des parties, ou à tout le moins le consentement du salarié, est vicié par dol, violence ou erreur : c’est notamment le cas lorsque le salarié est victime de harcèlement moral (Cass. soc. 30 janvier 2013). De même, le consentement des parties sera nécessairement entaché d’un vice si un litige les oppose au moment de la conclusion de la convention de rupture (Cass. soc. 23 mai 2013).
Enfin, si la prise d’acte peut avoir pour origine une démission, les deux formes de rupture ne doivent pas être confondues. Une démission ne saurait en effet être volontaire lorsqu’elle est motivée par des faits reprochés à l’employeur. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle la jurisprudence admet très largement que des ruptures du contrat de travail initialement présentées comme des démissions puissent être assimilées à des prises d’actes et in fine qualifiées de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Soulignons en outre qu’une simple démission impliquerait du salarié qu’il renonce aux indemnités de rupture du contrat de travail ainsi qu’au bénéfice d’une indemnisation par le régime d’assurance chômage, et ce alors même que sa démission ne serait pas « volontaire » mais motivée par un manquement de son employeur à ses obligations contractuelles ou à une conduite fautive de celui-ci.
La prise d’acte appelle une intervention du conseil de prud’hommes afin de trancher la question de l’imputabilité de la rupture du contrat de travail. Ce type de litiges ne fait aujourd’hui l’objet d’aucune procédure particulière.
Rappelons que le conseil de prud’hommes est compétent pour tous les litiges individuels nés à l’occasion du contrat de travail. Il s’agit d’une juridiction élue et paritaire, chaque conseil, chaque section (4) et chaque chambre (5) comprenant des salariés et des employeurs en nombre égal.
Au sein de chaque section, ou de chaque chambre, se trouvent au moins un bureau de conciliation (un conseiller employeur, un conseiller salarié) et un bureau de jugement (au moins deux conseillers employeurs, deux conseillers salariés). Chaque conseil de prud’hommes comprend en outre une formation de référé commune à l’ensemble des sections, composée d’un conseiller employeur et d’un conseiller salarié.
La procédure prud’homale se déroule en deux phases distinctes :
– la tentative de conciliation, obligatoire – sauf exceptions – pour tous les litiges (article L. 1411-1 du code du travail) ;
– le jugement, qui intervient lorsque la conciliation n’a pas abouti ou n’a été que partielle.
Dans le cadre des litiges prud’homaux, une procédure de conciliation est en principe préalable à tout procès. L’affaire n’est renvoyée à une audience de jugement que si cette procédure ne débouche sur aucun accord entre les parties. À noter qu’en cas d’accord partiel, le renvoi de l’affaire devant le bureau de jugement ne porte que sur les points qui restent litigieux. Si le bureau de conciliation est un passage obligé, les parties ne sont toutefois pas tenues de trouver un accord.
Concrètement, pendant l’audience de conciliation, les parties peuvent convenir de mettre un terme à leur litige en trouvant un accord spontanément ou sur proposition du bureau de conciliation. L’accord trouvé fait l’objet d’un procès-verbal qui met fin au conflit. Si aucun accord n’a pu être trouvé, l’affaire est renvoyée devant le bureau de jugement. Aujourd’hui, 10 % seulement des affaires se terminent effectivement devant le bureau de conciliation, contre 16 % en 2004 (6). On peut néanmoins considérer que le développement de la conciliation en amont de la rupture du contrat de travail, avec, depuis 2008, la possibilité de recourir à une rupture conventionnelle, a pu contribuer à faire baisser ces statistiques.
Dans le cas précis qui nous occupe, l’issue de la phase de conciliation n’a toutefois pas la moindre importance. Car si le bureau de conciliation entend les parties et s’efforce de les concilier, il n’a pas compétence pour trancher le litige. Or, la prise d’acte étant d’effet immédiat et non rétractable, dès lors qu’une demande de qualification de la rupture a été déposée auprès du conseil de prud’hommes, le litige ne pourra prendre fin qu’avec le jugement au fond. Comme indiqué précédemment, il appartient en effet uniquement au bureau de jugement de se prononcer sur l’imputabilité de la rupture et donc de déterminer les effets juridiques de la prise d’acte. Quelle que soit l’issue de la conciliation, celle-ci ne saurait avoir pour conséquence que le salarié se rétracte, cette possibilité n’étant pas admise par la jurisprudence. La conciliation apparaît donc, dans ce cas de figure, d’autant moins indispensable que l’affaire sera nécessairement portée in fine devant le bureau de jugement, ce dernier étant en outre contraint, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, de condamner l’employeur à verser au salarié les indemnités de rupture prévues par la loi ou la convention collective.
La phase de conciliation pourrait donc être supprimée, comme c’est le cas pour d’autres types de litiges prud’homaux. En effet, la législation prévoit d’ores et déjà un certain nombre de dérogations à l’obligation de concilier, qui permettent de passer directement devant le bureau de jugement, pour régler des litiges qui appellent une décision urgente nécessitant que les juges se prononcent sur le fond. Outre les affaires portées par le demandeur devant le juge des référés, il existe ainsi un certain nombre de litiges dont la loi permet qu’ils soient directement portés devant le bureau de jugement :
– les recours contre les refus de congés spéciaux par l’employeur (7) ;
– les contestations portant sur le relevé des créances en matière de redressement ou liquidation judiciaire (article L. 625-5 du code de commerce) ;
– les demandes de requalification de contrats précaires (contrats à durée déterminée, contrats de travail temporaire) en contrats à durée indéterminée (articles L. 1245-2 du code du travail).
Dans ce dernier cas, on notera que non seulement la loi prévoit l’examen de l’affaire directement par le bureau du jugement mais qu’elle impartit également un délai maximal – d’un mois à compter de la saisine du conseil de prud’hommes, pour que le litige soit tranché : « Lorsque le conseil de prud’hommes est saisi d’une demande de requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l’affaire est directement portée devant le bureau de jugement qui statue au fond dans un délai d’un mois suivant sa saisine » (premier alinéa de l’article L. 1245-2 précité).
Signalons par ailleurs qu’il existe d’autres exemples dans lesquels la procédure prud’homale est enserrée dans des délais contraints : c’est notamment le cas des contestations portant sur des licenciements économiques (7 mois à compter de la saisine du conseil de prud’hommes).
Enfin, sur un plan plus procédural, on notera également que l’article L. 1454-2 du code du travail dispose qu’en cas de partage, l’affaire est reprise dans le délai d’un mois.
Aujourd’hui, la prise d’acte de rupture du contrat de travail par le salarié ne fait l’objet d’aucune procédure spécifique, en dépit de la précarité de la situation du salarié dans l’attente du jugement.
Or, les durées de traitement des litiges devant les conseils de prud’hommes ont tendance à s’allonger, comme l’ont constaté Mmes Guillonneau et Serverin, auteures d’un rapport sur l’activité des conseils de prud’hommes de 2004 à 2012 pour le pôle d’évaluation de la justice civile (septembre 2013).
Ainsi, en 2012, les demandes formées au fond devant les conseils de prud’hommes ont été traitées en moyenne en 15 mois. Cette durée varie en outre considérablement selon la formation à l’origine de la décision : en 2012, les affaires terminées devant le bureau de conciliation ont ainsi été traitées en 2,5 mois, celles terminées devant le bureau de jugement en 15,2 mois et les affaires ayant fait l’objet d’un départage ont enregistré une durée moyenne de 27,3 mois. Les référés sont en revanche traités en moyenne en 1,9 mois.
Extraits du rapport sur l’activité des conseils de prud’hommes
de 2004 à 2012
En 2012, 175 714 demandes ont été portées devant les juridictions prud’homales. Ces affaires ont été introduites majoritairement (169 189, soit 96,3 %) à la demande d’un salarié « ordinaire ». Les recours des salariés « ordinaires » devant les conseils de prud’hommes se font essentiellement dans un contexte de rupture de contrat de travail (166 233 demandes sur 169 189 demandes de salariés « ordinaires », soit 98 %) et leurs demandes principales visent majoritairement à contester le motif de licenciement (8 demandes sur 10).
Entre 2004 et 2012, les recours formés devant les CPH se sont modifiés en volume et en nature.
Quantitativement, les affaires introduites devant les conseils de prud’hommes (CPH) ont diminué de 10 %, passant de 207 770 affaires en 2004 à 175 714 en 2012. Cette baisse s’est accentuée depuis 2009, date à partir de laquelle le nombre de recours devant les CPH a diminué de 23 %.
Pour prendre la mesure de cette baisse, il faut rapporter le nombre de recours devant les CPH au nombre de nouveaux inscrits à pôle emploi. Alors que l’évolution du nombre d’affaires introduites devant les CPH était fortement corrélée à celle du nombre de nouveaux inscrits à pôle emploi sur la période 2004-2009 (+0,92 sur la période citée), on constate en 2009 un décrochage entre les deux courbes : le nombre annuel de nouveaux inscrits à pôle emploi a continué à progresser (+ 3 % entre 2009 et 2012), tandis que le nombre d’affaires introduites devant les CPH enregistre un net recul (– 23%).
Ces mouvements contradictoires peuvent s’expliquer pour partie par l’introduction, par la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail, d’un nouveau mode de rupture de contrat de travail à durée indéterminée, la rupture conventionnelle (RC). Ce dispositif permet à l’employeur et au salarié de convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée qui les lie, et aboutit à la signature d’une convention. Le nombre élevé de RC (320 000 homologuées en 2012), peut avoir eu pour effet, en développant la négociation de la rupture en amont, de réduire les motifs de contestation judiciaire.
Qualitativement, les CPH sont saisis de plus en plus fréquemment au fond (79 % en 2004 contre 83 % en 2012) par des salariés « ordinaires » qui contestent leur motif de licenciement autre qu’économique. Ce type de demandes fondait 66 % des affaires introduites en 2004. Il concerne 78 % des affaires introduites en 2012.
En 2012, les décisions rendues par les CPH tranchent le litige dans 60 % des affaires au fond, mais seulement dans 49 % des référés. Lorsque la décision tranche le litige, c'est généralement en faveur du demandeur : 72 % au fond, 88 % en référé.
En 2012, 80 % des demandes introduites au fond se sont terminées devant le bureau de jugement. Cette part s'est accrue depuis 2004 mais surtout depuis 2009, où elle était de 74 %.
Enfin, en 2012, le taux d’appel contre les décisions rendues au fond par les conseils de prud’hommes s’élève à 64 %. Les litiges liés au travail génèrent donc toujours de nombreux recours devant les cours d’appel. Les affaires prud’homales représentent en 2012 un quart des affaires déférées devant les cours d’appel.
Le rapport rappelle qu’entre 2004 et 2009, les durées au fond oscillaient entre 12 et 13 mois, et en référé autour de 1,5 mois. Il conclut ainsi : « alors que le nombre de recours formés devant les conseils de prud’hommes enregistrait une baisse importante à partir de 2009 (– 23 %), les durées de traitement n’ont cessé d’augmenter, en lien avec l’accroissement de la part des décisions rendues au fond et au recours au bureau de jugement de plus en plus fréquent. Tout se passe donc comme si les juridictions prud’homales devaient faire face, depuis 2009, à des affaires certes moins nombreuses mais de plus en plus conflictuelles, eu égard aux délais, à la formation de jugement et à la nature de la décision rendue ».
Les évolutions décrites dans le rapport de Mmes Guillonneau et Serverin appellent de profonds changements tant dans l’organisation des conseils de prud’hommes que dans le déroulement de la procédure prud’homale. Notre assemblée a eu l’occasion d’évoquer ces différents aspects lors d’un débat organisé à l’initiative du groupe GDR le 28 février 2013 (8). Si le problème est aigu et une solution attendue, on ne saurait toutefois agir sur les différents paramètres en jeu par le biais d’une simple proposition de loi. C’est pourquoi, si votre rapporteur soutient la nécessité pour le législateur d’intervenir en la matière, il considère que le présent texte ne doit pas excéder l’objet qui est le sien : améliorer la procédure applicable aux prises d’acte de rupture du contrat de travail. Il espère néanmoins que la proposition de loi constituera un signal supplémentaire en faveur d’une réforme de la prud’homie.
Forte du double constat dressé précédemment de la nécessité d’une décision judiciaire rapide visant à mettre fin à l’incertitude entourant les effets juridiques de la prise d’acte, tant pour le salarié que pour l’employeur, et de l’inutilité de la procédure de conciliation en pareils cas, la présente proposition de loi vise à introduire une procédure dérogatoire d’examen des prises d’acte de rupture du contrat de travail par les conseils de prud’hommes.
Pour ce faire, elle s’inspire des dispositions précitées de l’article L. 1245-2 du code du travail relatif aux demandes de requalification de contrats à durée déterminée en contrats à durée indéterminée. L’objectif est ainsi de supprimer la phase de conciliation de la procédure prud’homale de manière à ce que le litige soit examiné directement au fond par le bureau de jugement.
Le texte reprend également la mention prévue par l’article L. 1245-2 du délai d’un mois laissé à la juridiction prud’homale pour statuer, en dépit de la contrainte très forte que cela fera peser sur les conseils de prud’hommes, et du risque éventuel de condamnation de l’État pour non-respect de ce délai. Comme votre rapporteur l’a souligné, le constat de la nécessité d’un renforcement des moyens de la justice prud’homale et d’une rénovation de sa procédure (meilleure articulation entre procédure orale et respect du contradictoire, respect des délais de communication des pièces, mise en état de la procédure) a été dressé, une réforme s’impose : il n’en appartient pas moins au législateur de poser le principe d’une justice diligente.
Les dispositions ainsi prévues sont introduites au sein d’une nouvelle sous-section et d’un nouvel article L. 1237-1-1 du code du travail, situés dans la section relative aux ruptures du contrat de travail à l’initiative du salarié. Votre rapporteur tient toutefois à souligner que la rédaction du dispositif n’introduit sciemment aucune définition, qui pourrait s’avérer restrictive, de la prise d’acte : l’objectif du présent texte est en effet avant tout de régler un problème de procédure, et non de créer une nouvelle catégorie de rupture du contrat de travail, par opposition aux catégories existantes, et ce d’autant plus qu’il n’apparaît pas souhaitable de revenir sur la jurisprudence de la Cour de cassation ou de brider ses évolutions futures en la matière.
Après avoir entendu de nombreux praticiens en audition (tant des avocats en droit du travail que des juges prud’homaux), votre rapporteur a souhaité apporter deux améliorations au texte proposé.
Conforté dans l’idée de ne pas définir la prise d’acte dans le code du travail, il a néanmoins été alerté sur deux aspects complémentaires qui lui ont paru essentiels : d’une part, sur la nécessité de ne pas faire apparaître la prise d’acte de rupture du contrat de travail en tant que notion spécifique parmi les « ruptures du contrat de travail à l’initiative du salarié » et, d’autre part, en raison de l’absence même de cette notion dans le code du travail, sur l’importance de s’y référer de la manière la plus claire et la plus exacte possible, notamment en s’appuyant sur la jurisprudence de la Cour de cassation. C’est la raison pour laquelle, votre rapporteur a proposé à la commission :
– de déplacer les dispositions prévues au sein de la partie du code du travail relative à la procédure prud’homale, permettant ainsi de ne pas inscrire la prise d’acte parmi les différents modes de rupture du contrat de travail à l’initiative du salarié, la crainte étant, notamment, que cette « catégorisation » ne soit utilisée ensuite pour dénier aux salariés démissionnaires la possibilité de voir leur démission requalifiée en prise d’acte ;
– et d’introduire une périphrase définissant la prise d’acte sans avoir à utiliser le terme même de « prise d’acte » et ce, en reprenant la définition qu’en a donné la Cour de cassation dans ses arrêts du 25 juin 2003 : « rupture du contrat de travail à l’initiative du salarié en raison de faits qu’il reproche à l’employeur ».
La Commission des affaires sociales examine, sur le rapport de M. Thierry Braillard, la proposition de loi relative aux effets de la prise d’acte de rupture du contrat de travail par le salarié lors de sa séance du mercredi 19 février 2014.
Mme la présidente Catherine Lemorton. Nous examinons aujourd’hui la proposition de loi de M. Thierry Braillard relative aux effets de la prise d’acte de rupture du contrat de travail par le salarié. En l’état actuel de la législation, cette forme de rupture du contrat de travail soulève en effet des difficultés quant à ses conséquences, de sorte que le salarié concerné et l’employeur se trouvent plongés dans l’incertitude jusqu’à la décision du conseil de prud’hommes. Dans le cas où ce dernier est saisi d’une telle demande par le salarié, il est donc proposé que l’affaire soit directement portée devant le bureau de jugement, lequel devra statuer au fond dans un délai d’un mois suivant sa saisine. Il s’agit d’un dispositif technique que va nous exposer notre rapporteur.
M. Thierry Braillard, rapporteur. Un contrat de travail peut être rompu de trois façons différentes. Tout d’abord, il peut l’être à l’initiative de l’employeur : c’est ce que l’on appelle le licenciement. Ce dernier peut survenir sans que le salarié ait commis de faute, par exemple en cas d’inaptitude à exercer son emploi à la suite d’une maladie. Lorsqu’il est prononcé pour un motif personnel, le licenciement doit reposer sur ce que le code du travail appelle une cause réelle et sérieuse, c’est-à-dire objective, exacte et d’une certaine gravité. Si ce motif est d’ordre disciplinaire, la faute peut être qualifiée de simple, grave ou lourde, avec des conséquences diverses en termes d’indemnités de départ.
Ensuite, le contrat de travail peut être rompu à l’initiative des deux parties. C’est ce que l’on appelait auparavant un « licenciement à l’amiable », devenu, depuis quelques années, « rupture conventionnelle ». Après signature par l’employeur et le salarié, et à l’issue d’un délai de réflexion, un tel acte doit être validé par l’inspection du travail, qui ne s’intéresse toutefois qu’aux modalités de la rupture et n’examine pas le dossier au fond. Cette procédure, qui a concerné près de 1,3 million de contrats entre 2008 et 2013, a l’avantage d’éviter les contentieux et de permettre au salarié de bénéficier d’une prise en charge par l’assurance chômage.
Enfin, l’initiative peut venir du salarié. Les formes de la démission n’ont pas été définies par le code du travail ; le salarié doit seulement manifester de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin à son contrat. Mais, dans ce cas, il doit respecter un délai de préavis, ce qui n’est jamais facile. C’est pourquoi la jurisprudence a créé la notion de la prise d’acte de rupture – par laquelle le salarié qui reproche des manquements fautifs à son employeur prend acte de la rupture de son contrat. Il appartient au conseil de prud’hommes de qualifier cette prise d’acte : si elle correspond à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié aura droit à des indemnités de départ et à sa prise en charge par Pôle emploi ; si elle est qualifiée de démission par le juge, il n’aura droit à rien.
Rappelons que la procédure prud’homale est divisée en deux étapes principales, la conciliation et le jugement. L’audience devant le bureau de conciliation ne vise pas à entrer dans le fond du dossier : elle consiste en une discussion sur les conditions d’un arrangement amiable pouvant mettre un terme à la procédure. Faute de conciliation – qui concerne aujourd’hui 10 à 15 % des cas –, l’affaire est renvoyée devant le bureau de jugement qui va statuer au fond. Toute cette procédure demande aujourd’hui des délais très longs. Sur ce point, je citerai l’exemple assez représentatif d’un cadre licencié en juillet 2013 pour des motifs qu’il jugeait très discutables : il a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre en septembre de la même année et, le 10 février 2014, faute de conciliation, on lui a annoncé que son affaire serait plaidée devant le bureau de jugement le 8 septembre 2016. Et ce ne sera pas fini : suite aux plaidoiries, les juges mettront l’affaire en délibéré, ce qui demande un délai de huit semaines en moyenne. La décision ne sera donc pas prise avant la fin de l’année 2016, pour une affaire entamée en 2013. Tel est l’état actuel de la justice prud’homale !
Si un salarié décide, à la suite de manquements fautifs de son employeur, de prendre acte de la rupture de son contrat au sens donné par la Cour de cassation en 2003 et de saisir le conseil de prud’hommes, il risque donc d’attendre plus de trois ans pour savoir si son acte est qualifié de licenciement ou de démission par le juge. Le problème est que, dans l’intervalle, il ne bénéficiera pas d’une prise en charge de l’assurance chômage, car, au moins dans un premier temps, Pôle emploi considérera son acte comme une démission. C’est pourquoi les salariés dans une telle situation finissent souvent par vivre du revenu de solidarité active (RSA), à défaut d’autres ressources, et connaissent une grande précarité.
Lorsque les salariés concernés prennent conseil avant d’engager toute action, on les dissuade de recourir à la prise d’acte de rupture, jugée trop dangereuse pour leur situation personnelle. On leur conseille de ne pas quitter leur emploi et de formuler auprès du conseil de prud’hommes une demande de résiliation judiciaire du contrat. Ainsi, le temps que le conseil statue sur l’existence d’un manquement fautif de la part de l’employeur, le salarié reste au sein de l’entreprise. En théorie, il doit même conserver son emploi si sa demande est finalement rejetée, c’est-à-dire si le juge estime qu’aucun élément ne légitime la résiliation du contrat.
Bien entendu, la réalité est tout autre : la plupart du temps, les salariés qui entreprennent une telle démarche ne peuvent plus poursuivre leur activité sous le regard de l’employeur, au risque de subir des pressions. Beaucoup finissent en arrêt maladie pour syndrome anxio-dépressif. Et, à l’issue de l’affaire, qu’ils gagnent ou qu’ils perdent, il leur faut du temps pour se remettre de l’épisode et retourner sur le marché du travail.
La procédure actuelle paraît donc trop longue et inadaptée à la prise d’acte de rupture du contrat de travail. Il est nécessaire d’en instituer une autre, spécifique et plus rapide. C’est l’objet de la proposition de loi qui vous est présentée. Si elle est adoptée, en cas de prise d’acte de la rupture d’un contrat de travail par le salarié, l’affaire sera jugée par le conseil de prud’hommes dans un délai d’un mois suivant la saisine. Une telle procédure serait similaire à celle déjà applicable aux demandes de requalification d’un contrat de travail à durée déterminée (CDD) en contrat à durée indéterminée (CDI).
Cette proposition a reçu le soutien de l’ensemble des organisations syndicales. En ce qui concerne les organisations patronales, le Medef a exprimé son opposition, tandis que la CGPME s’est montrée plus mesurée. En effet, certains employeurs apprécient peu la procédure de prise d’acte de rupture qui les oblige à provisionner dans leur bilan la somme réclamée par le salarié pendant la durée de la procédure.
De même, cette proposition a reçu l’assentiment de tous les praticiens du droit du travail que nous avons pu consulter, qu’ils défendent des salariés ou des employeurs. Tous ont souligné le caractère inadéquat de la procédure de résolution judiciaire, tout en reconnaissant souvent que, faute de mieux, ils la conseillaient à leurs clients.
Le président du Conseil supérieur de la prud’homie, M. Merle, qui a participé à la rédaction du nouveau code du travail, a également apprécié cette proposition, tout en nous invitant à ne pas faire de la prise d’acte une catégorie de rupture du contrat de travail à part entière et à nous placer sur le terrain strictement procédural. Un amendement rédigé avec Denys Robiliard vous sera présenté pour tenir compte de ses remarques. Un autre amendement, rédactionnel, concerne le titre de la proposition de loi.
Ce texte est attendu par les professionnels du droit, les organisations syndicales et les juges prud’homaux. Il constitue une nouvelle occasion de discuter de la procédure prud’homale, laquelle mérite que notre assemblée se penche sur le sujet. On ne peut en effet admettre que des juges n’appliquent pas la loi. Or certaines dispositions, surtout d’ordre procédural, ne sont aujourd’hui pas appliquées. De même, on ne peut accepter de voir des questions de procédure empêcher certains salariés en détresse de relancer leur parcours professionnel.
M. Denys Robiliard. La proposition de loi vise à résoudre un problème bien connu des praticiens du droit du travail, celui posé par la prise d’acte de la rupture d’un contrat de travail. C’est au conseil de prud’hommes qu’il revient de dire à qui elle doit être imputée. Soit elle relève de la seule responsabilité du salarié qui en a pris l’initiative, soit elle est imputable à l’employeur, auquel cas elle produit les effets d’un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse : le préavis et l’indemnité conventionnelle de licenciement sont alors dus, de même que d’éventuels dommages et intérêts.
Comme l’a bien montré le rapporteur, le salarié qui use de cette voie risque de rencontrer d’importantes difficultés. Dans la mesure où il est à l’origine de la rupture du contrat de travail, il ne bénéficie pas de l’allocation de retour à l’emploi, à une exception, toutefois : s’il peut produire une ordonnance en référé du conseil de prud’hommes démontrant qu’il n’a pas été payé, Pôle emploi, présumant que la rupture est imputable à l’employeur, liquidera les droits de la même façon qu’en cas de licenciement.
Le problème est que le juge du référé est juge de l’évidence et de l’incontestable. Le salarié peut donc se voir débouté malgré la solidité de ses arguments. En outre, le référé n’est pas adapté à toutes les situations, notamment en cas de rupture intervenue à l’initiative du salarié à la suite d’un harcèlement dont il aurait fait l’objet.
La proposition de loi vise donc à remédier à ce problème en s’inspirant de la procédure utilisée pour requalifier un CDD en CDI : l’affaire serait directement portée devant le bureau de jugement, lequel devrait statuer dans un délai d’un mois.
Bien sûr, il ne faut pas se leurrer. La proposition de loi est certes de nature à améliorer significativement la situation des personnes prenant acte d’une rupture de leur contrat de travail, et peut permettre aux employeurs de connaître plus rapidement les conséquences financières d’une telle situation. Mais les conseils de prud’hommes ont déjà le plus grand mal à tenir le délai d’un mois prévu pour requalifier un contrat à durée déterminée. En outre, ils ne statuent qu’en premier ressort : dans l’immense majorité des cas, l’examen par la chambre sociale d’une cour d’appel aura pour conséquence de prolonger le délai de jugement.
Même si tous les conseils de prud’hommes ne sont pas dans la situation de celui de Nanterre, cité par le rapporteur, l’examen de cette proposition de loi ne doit pas nous dispenser de nous pencher non seulement sur la situation des juridictions prud’homales, mais plus largement sur celle des juridictions sociales – comme le tribunal des affaires de sécurité sociale. Une réforme profonde est probablement nécessaire dans ce domaine, faute de quoi l’adoption de cette proposition de loi ne serait qu’un coup d’épée dans l’eau. Ainsi, dans certains conseils de prud’hommes – notamment en Île-de-France –, il n’est pas rare qu’un renvoi allonge d’un an le délai de jugement d’une affaire. Dans un tel cas, l’obligation de statuer dans un délai d’un mois n’aurait plus de sens.
Pour le groupe socialiste, cet examen constitue donc une première étape dans une entreprise plus large de réforme de la prud’homie.
M. Gérard Cherpion. Bien qu’elle ne comprenne qu’un seul article, cette proposition de loi a un caractère très complexe, parce qu’elle a recours à un procédé particulier, s’inscrivant de manière particulière dans le code du travail.
Ce texte, qui vient en réponse à un problème plus large se posant à l’ensemble des juridictions sociales, n’aurait pas lieu d’être si la prise d’acte de rupture pouvait être qualifiée par le juge dans des délais raisonnables. Il est vrai que la situation actuelle place le salarié comme l’employeur dans une situation d’insécurité, même si le premier peut, au bout du quatrième mois, réclamer à Pôle emploi le versement d’indemnités – quitte à devoir les rembourser en cas de jugement défavorable. Mais la réponse ici présentée est-elle vraiment appropriée ? Après avoir entendu l’ensemble des personnes auditionnées, je m’interroge, au nom du groupe UMP.
Tout d’abord, que devient l’audience de conciliation dans la procédure proposée ? Un délai d’un mois présente l’avantage de garantir une réponse rapide à la question posée, mais il ne laisse pas de temps pour la recherche d’un règlement amiable, ce qui me semble regrettable.
Ensuite, le choix de calquer la procédure sur celle de la requalification d’un CDD en CDI me semble problématique. Non seulement la complexité des affaires n’est pas la même, mais, comme le prévoit l’article R. 1245-1 du code du travail, lorsqu’un conseil de prud’hommes est saisi d’une demande de requalification en application de l’article L. 1245-2, « sa décision est exécutoire de droit à titre provisoire », ce qui n’est pas prévu par la proposition de loi et laisse donc, à nouveau, planer une incertitude sur l’issue du contentieux.
Certes, cette proposition est intéressante dans la mesure où elle se donne pour objectif de permettre au salarié comme à l’employeur d’obtenir une réponse rapide, sans remettre en cause l’ensemble de la procédure prud’homale. Pour autant, je ne suis pas certain qu’elle constitue une bonne solution. Mais, surtout, elle ne répond pas au problème de fond rencontré par les juridictions sociales.
M. Jean-Louis Roumegas. Cette proposition de loi arrive pour moi à point nommé dans la mesure où, à partir de cas similaires survenus dans ma circonscription, mon attention a été appelée sur ce qui constitue une forme de vide juridique. Ainsi, un salarié dont le salaire n’était plus versé depuis plusieurs mois s’est retrouvé privé d’indemnités de chômage après avoir adressé à son employeur, sur le conseil de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRRECTE), un courrier prenant acte de la rupture de son contrat. Ce n’est que grâce au soutien de sa famille qu’il peut aujourd’hui payer son loyer. Sa situation professionnelle, dont il n’est pourtant nullement responsable, a ainsi des conséquences catastrophiques sur sa vie personnelle. De nombreux salariés se retrouvent dans une impasse comparable, peut-être plus du fait de la jurisprudence ou de la pratique judiciaire qu’à cause de la loi.
La proposition de loi constitue une réponse nécessaire et le groupe écologiste votera en sa faveur. Mais est-elle suffisante ? Il est vrai que la prise d’acte de rupture du contrat de travail peut avoir des causes très différentes – harcèlement moral, manquements aux obligations relatives à la médecine du travail, non-respect du repos hebdomadaire, absence de versement du salaire, etc. –, et tous ne peuvent pas être mis sur le même plan en termes d’urgence. Ne faudrait-il pas prévoir dans certains cas – je pense notamment au non-paiement du salaire – une prise en charge plus systématique des salariés par Pôle emploi et l’ouverture, ne serait-ce qu’à titre provisoire, des droits à l’indemnité de chômage ?
Mme Dominique Orliac. Au nom du groupe RRDP, je salue l’excellent travail fourni par notre collègue Thierry Braillard en qualité de rapporteur.
Cette proposition de loi est d’abord un signal destiné à appeler l’attention sur la durée des procédures prud’homales, tellement importante dans certains conseils qu’elle conduit parfois à des condamnations de l’État français devant des juridictions civiles. Certaines dispositions procédurales ne sont même pas appliquées. Par exemple, l’article R. 1454-29 du code du travail prévoit que, en cas de partage des voix, l’affaire est renvoyée à une audience ultérieure du bureau de conciliation ou du bureau de jugement, présidée par le juge départiteur et qui est tenue dans le mois suivant le renvoi. Or ce délai est loin d’être respecté : lors de la rentrée solennelle du conseil de prud’hommes de Marseille, en janvier dernier, on a appris que la durée moyenne d’une procédure était de 14,8 mois, et même de 29,9 mois en cas de départage.
C’est d’ailleurs pour cette raison que nos collègues du groupe GDR avaient réclamé, et obtenu le 28 février dernier, un débat sur la procédure prud’homale. À cet égard, et même si son objet peut paraître marginal, cette proposition de loi va dans le bon sens. Elle représente un signe envoyé aux salariés qui, malgré le comportement fautif de leur employeur, n’osent pas, à défaut d’une prise en charge par Pôle emploi, rompre leur contrat de travail de peur de se retrouver dans une situation de précarité.
Dans la mesure où le conseil de prud’hommes, statuant au fond, est seul juge de l’imputabilité de la rupture, et compte tenu de la situation précaire dans laquelle est placé le salarié dans l’attente de son jugement, il paraît nécessaire de mettre en place une procédure spéciale qui permette au juge de statuer dans de brefs délais. C’est pourquoi la proposition de loi prévoit de porter directement l’affaire devant le bureau de jugement, qui devra statuer en un mois.
Mais que pourriez-vous répondre, monsieur le rapporteur, à ceux qui estiment ce délai trop court, et donc intenable par des bureaux de jugement déjà surchargés ?
Mme Isabelle Le Callennec. Comme l’a expliqué le rapporteur, la prise d’acte de rupture du contrat de travail constitue pour le salarié une réponse à ce qu’il considère comme un manquement grave commis par son employeur. Je trouve cette proposition de loi intéressante même si, en écoutant mes collègues, j’ai conscience qu’elle est loin de résoudre tous les problèmes, à commencer par les délais de jugement des conseils de prud’hommes, sources d’attente insupportable pour les salariés comme pour les employeurs.
Combien de prises d’acte sont effectuées chaque année ? L’instauration de la rupture conventionnelle a-t-elle eu pour effet d’en augmenter ou d’en diminuer le nombre ?
Les exemples cités – harcèlement, atteinte à la dignité du salarié, manquement de l’employeur à ses obligations de sécurité – sont graves. Ils justifient que l’on sache le plus rapidement possible si la rupture peut être requalifiée en démission ou en licenciement. Et, dans l’hypothèse où elle peut être imputée au chef d’entreprise, il est légitime que le salarié concerné puisse bénéficier d’indemnités. Mais quel serait l’effet de la proposition de loi sur l’assurance chômage ?
Mme Véronique Louwagie. La proposition de loi s’intéresse au cas particulier de la rupture du contrat de travail effectuée à l’initiative du salarié, mais une réflexion plus générale sur la durée des procédures devant les juridictions sociales – notamment les conseils de prud’hommes – serait utile. Il faut résoudre ce problème qui laisse les salariés dans l’insécurité et sans ressources.
Par ailleurs, la proposition suscite un certain nombre de questions.
En premier lieu, ne risque-t-elle pas de produire un appel d’air en incitant les salariés désireux de quitter rapidement leur emploi sans accomplir la durée de préavis à recourir à la prise d’acte de rupture du contrat de travail ?
Deuxièmement, les conseils de prud’hommes sont-ils vraiment en mesure de respecter le délai d’un mois prévu par l’article unique ? Et, si c’est le cas, ne risquent-ils pas de traiter en priorité les demandes de qualification d’une prise d’acte de rupture du contrat de travail, au détriment des autres types de demande, dont le traitement, en conséquence, prendrait du retard ?
En troisième lieu, je m’interroge sur le sort du salarié qui aurait bénéficié d’indemnités à la suite d’une qualification de la rupture de son contrat de travail en licenciement, et qui se verrait débouté en seconde instance. Devra-t-il rembourser ces indemnités ?
M. Dominique Tian. Je rappelle que l’opposition de l’époque avait voté contre la rupture conventionnelle.
Mme la présidente Catherine Lemorton. Non, monsieur Tian : le groupe socialiste s’était abstenu.
M. Dominique Tian. En tout cas, vous n’y étiez pas favorable.
Une telle procédure, qui a connu un grand succès, puisque 1 300 000 de ces ruptures ont été mises en œuvre depuis leur création, aurait dû permettre de désencombrer les prud’hommes. Il n’en fut rien. À Marseille, par exemple, il faut compter à peu près deux ans et demi pour obtenir un jugement !
Je partage l’inquiétude de mes collègues : la rupture conventionnelle a du succès, tout comme la résiliation judiciaire du contrat de travail qui est à l’origine d’une jurisprudence fournie. Pourquoi créer une procédure supplémentaire ? Cela ne fera qu’aggraver l’embouteillage des prud’hommes, le bureau de jugement étant, dans ce nouveau cas de figure, obligé de statuer dans un délai d’un mois. Nous devons nous attendre à un effet d’aubaine, et les autres affaires ne seront pas jugées plus rapidement.
La situation est en effet scandaleuse dans certains tribunaux, où des salariés licenciés doivent attendre un jugement pendant deux ou trois ans. Dans ces conditions, avez-vous pensé, pourquoi ne pas imaginer une procédure plus rapide ? Vous appliquez donc à la justice prud’homale la procédure de la comparution immédiate – que vous avez pourtant souvent contestée. Ce faisant, vous supprimez la phase de conciliation, ce qui est regrettable. En outre, avec des délais plus serrés, les salariés n’auront pas le temps de constituer un dossier pour prouver leur bonne foi : c’est une remise en cause de leurs droits. Ainsi, faute d’avoir le courage de vous attaquer à la réforme des prud’hommes, vous mettez en place une justice quelque peu expéditive.
M. Bernard Accoyer. Cette proposition de loi, qui risque bel et bien de créer un appel d’air, nous détourne des vrais problèmes des juridictions prud’homales. Plus globalement, alors que le code du travail a grand besoin de simplification, on lui ajoute un nouvel article. En 1973, il en comptait 600 ; aujourd’hui, 10 000 ! Saluons l’inventivité des parlementaires et des gouvernements de droite comme de gauche. Reste que la complexification administrative constitue un lourd handicap pour notre pays, notre économie et pour l’emploi. Chaque fois que l’on introduit un article dans le code du travail, nous devrions essayer d’en supprimer un.
Mme la présidente Catherine Lemorton. Je voudrais rappeler le contexte dans lequel notre groupe s’est abstenu sur la rupture conventionnelle : bien que les partenaires sociaux, à l’exception d’un syndicat, aient donné leur accord, le groupe socialiste avait émis des doutes sur les risques de contournement d’une telle procédure. Certes, on a assisté ensuite à une rapide montée en charge des ruptures conventionnelles, et on a pu croire qu’elles répondaient à une demande des partenaires sociaux. Mais, en pleine crise économique, nous avons vu que nos réserves étaient fondées : certaines ruptures conventionnelles, pour ne pas dire nombre d’entre elles, n’étaient que des licenciements économiques déguisés et une façon de dissimuler la faute de l’employeur. Cela a été prouvé par les prud’hommes, et les chiffres sont clairs.
M. Jean-Patrick Gille. En effet, nous ne nous étions pas opposés à la rupture conventionnelle, mais nous en avions indiqué les limites. Ainsi, il arrive souvent qu’une rupture conventionnelle ne soit qu’une préretraite déguisée : il suffit, pour s’en convaincre, d’étudier les statistiques qui font apparaître un pic de ruptures conventionnelles à cinquante-huit ans, c’est-à-dire à l’âge où un salarié peut bénéficier des trois ans d’indemnisation de l’UNEDIC ; après quoi, à soixante et un ans, un autre dispositif lui assure une prolongation d’une année.
Mme la présidente Catherine Lemorton. Monsieur le rapporteur, je voudrais vous interroger sur une phrase qui figure dans l’exposé des motifs de votre proposition de loi : « Durant cette période d’attente que le juge statue sur les effets de cette rupture, le salarié ne bénéficie d’aucune protection sociale. » Je suppose que vous ne visez que les indemnités chômage et que le salarié a toujours droit aux prestations de soins de santé ?
M. le rapporteur. En effet.
Je répondrai à M. Accoyer que, lorsqu’il a voté les dispositions relatives à la rupture conventionnelle, il a ajouté des articles au code du travail. De même, nous en avons ajouté hier soir en examinant la proposition de loi visant à renforcer la responsabilité des maîtres d’ouvrage et des donneurs d’ordre dans le cadre de la sous-traitance et à lutter contre le dumping social et la concurrence déloyale. Mais il faut savoir : soit il vote pour, et il assume ; soit il vote contre, et il assume…
Monsieur Robiliard, il est exact que la conférence sur « La justice du XXIe siècle » a évoqué la réforme prud’homale, notamment la constitution d’une juridiction sociale intégrant les prud’hommes et les tribunaux des affaires de sécurité sociale.
Par ailleurs, si j’approuve l’ensemble de vos propos, je tiens à apporter une précision : le référé permet de trancher dans l’urgence et à titre provisoire. Le juge des référés n’étant pas juge de l’imputabilité, ce n’est pas à lui d’apprécier au fond la rupture du contrat de travail.
Monsieur Cherpion, vous avez dit que, si les délais étaient normaux, ma proposition de loi n’aurait pas lieu d’être, et vous vous êtes interrogé sur l’avenir de l’audience de conciliation. Mais, lorsqu’il y a prise d’acte de rupture et que le salarié a saisi le conseil des prud’hommes sur l’imputabilité de la rupture, à quoi pourrait servir cette audience ? Le salarié demande que la rupture soit jugée imputable à son employeur – ce qui lui permettra ensuite, par exemple, de demander des dommages-intérêts pour rupture abusive. Le bureau de conciliation a pour mission de rapprocher les parties, mais n’a pas le pouvoir de dire, à cette étape de la procédure, qui a raison ou qui a tort. Voilà pourquoi, dans le cas précis d’une prise d’acte de rupture, l’audience de conciliation n’a pas d’utilité. Autant aller directement, dans le mois qui suit, devant le bureau de jugement, qui est seul juge de l’imputabilité et qui pourra dire si la rupture est une démission ou un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Monsieur Roumegas, il est précisé, dans l’exposé des motifs, que Pôle emploi peut prendre en charge le salarié en cas de défaut de paiement de salaire. Encore exige-t-il que le salarié saisisse auparavant la formation des référés des prud’hommes, pour se présenter avec une ordonnance de référé condamnant l’employeur à payer le salaire qui lui est dû – conformément à l’accord d’application n° 14 de l’UNEDIC. Dans ces conditions, Pôle emploi lui versera une allocation de chômage dans l’attente du jugement qui interviendra sur la prise d’acte de rupture. Le salarié est ainsi obligé de lancer deux procédures aux prud’hommes, une procédure en référé et une procédure au fond, alors même qu’il rencontre des difficultés et qu’il n’est pas forcément pris en charge par l’aide juridictionnelle. Ce n’est pas simple, mais c’est la seule méthode possible.
Madame Orliac, vous vous êtes interrogée à propos du délai d’un mois, que certains considèrent comme intenable. Il est vrai que tout le monde devra y mettre du sien, y compris les avocats, qui gagneraient à modifier un peu leurs habitudes : il serait sans doute utile que, au moment où ils saisissent la juridiction, ils fournissent des explications écrites – ce qu’ils ne font pas à ce jour – pour éviter des renvois et l’allongement de la procédure.
Madame Le Callennec, je n’ai pas la prétention de résoudre le problème des juridictions prud’homales avec cette proposition de loi. Mais celle-ci pourrait constituer un signal, comme le disait Mme Orliac, une occasion de montrer que nous sommes conscients de la réalité du problème et de la nécessité d’y remédier.
Ensuite, ni la Chancellerie ni le ministère du travail ne nous ont fourni de statistiques sur le nombre de prises d’acte de rupture. Nous n’en possédons que sur le nombre de ruptures conventionnelles, fournies par les DIRRECTE. Quant aux conseils de prud’hommes, ils ne précisent pas les motifs des recours engagés – licenciement, prise d’acte de rupture, etc.
Enfin, je répondrai par la négative à votre question sur l’impact que pourrait avoir cette proposition de loi sur l’assurance-chômage. Une plus grande rapidité dans le traitement des dossiers ne changera rien, dans la mesure où le fait de dire s’il s’agit d’une démission ou d’un licenciement continuera à relever de la libre appréciation des juges prud’homaux.
Madame Louwagie, vous avez craint que cette proposition constitue un appel d’air : mais, je le répète, c’est au juge qu’il appartient de trancher.
Sur les délais, il faut signaler que lorsqu’un salarié saisit le conseil de prud’hommes de Lyon ou celui de Paris d’une demande de requalification, il est convoqué en bureau de jugement dans le mois qui suit, voire dans les six semaines, conformément à la procédure. C’est ensuite que le traitement du dossier diffère. À Lyon, dans 99 % des cas, le renvoi, s’il est demandé, a lieu dans le mois qui suit. À Paris, le président du conseil de prud’hommes nous a dit que, si le renvoi était demandé, c’était que l’une des parties n’avait pas été diligente et que, par conséquent, le dossier était renvoyé à un an. Il est insupportable de constater que, pour une même demande, le dossier est traité différemment, selon que l’on se trouve à Lyon ou à Paris – d’autant que les différences de délais ne s’entendent pas en mois, mais en années…
Monsieur Tian, je ne peux pas vous laisser dire que les conseils de prud’hommes ne fonctionnent pas. Je veux saluer leurs juges, qui travaillent parfois dans des conditions difficiles et font de leur mieux. Pour autant, je pense qu’il y a des efforts d’organisation à faire, afin de respecter les délais.
Enfin, ne confondons pas la rupture conventionnelle qui est une procédure amiable, avec la prise d’acte ou la résiliation qui supposent l’existence d’un litige, ce qui signifie que l’on n’est pas capable de signer une rupture conventionnelle. On ne peut pas les traiter de la même façon.
Article unique
(art. L. 1237-1-1 [nouveau] du code du travail)
Procédure d’examen des prises d’acte de rupture du contrat de travail
par les conseils de prud’hommes
Le présent article vise à introduire une procédure dérogatoire d’examen par les conseils de prud’hommes des prises d’acte de rupture du contrat de travail afin de permettre une résolution plus rapide des contentieux afférents.
En effet, dans l’attente de la décision du bureau de jugement appelé à statuer au fond sur l’imputabilité de la rupture, salariés et employeurs sont dans une situation délicate. Le salarié, qui a pris acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur et introduit une action devant le conseil de prud’hommes en vue de faire valoir ses droits, peut se retrouver en grande précarité, sans salaire ni allocation chômage. Quant à l’employeur, qui ignore si sa responsabilité dans la rupture du contrat de travail va être retenue, il ne peut tirer aucune conclusion du départ de son salarié et est contraint de provisionner afin de faire face aux éventuelles conséquences financières de la décision de justice à venir.
Le présent article prévoit donc que les cas de prises d’acte de rupture du contrat de travail soumis à la juridiction prud’homale seront désormais directement portés devant le bureau de jugement, qui devra statuer au fond dans un délai maximal d’un mois.
a. Le régime juridique de la prise d’acte
La Cour de cassation a défini le régime juridique de la prise d’acte dans un arrêt du 25 juin 2003. Aux termes de cette décision, la Cour estime que « lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison des faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire, d’une démission ».
La prise d’acte entraîne la rupture immédiate du contrat de travail et ne peut être rétractée (Cass. soc. 14 octobre 2009). Ainsi, dès lors que le conseil de prud’hommes a été saisi, le litige ne peut prendre fin qu’une fois tranchée la question de l’imputabilité de la rupture, cette dernière déterminant les effets juridiques de la prise d’acte, différents selon l’appréciation faite par les juges de la légitimité des griefs invoqués par le salarié.
Il appartient ainsi au juge de déterminer si les faits invoqués justifient ou non la rupture du contrat et d’en déduire si cette dernière produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse (voire, dans certains cas, d’un licenciement nul) ou d’une démission. Dans cette perspective, les juges du fond doivent exercer un contrôle de la « gravité suffisante » des manquements de l’employeur (Cass. soc. 16 novembre 2004). Depuis un arrêt du 30 mars 2010, la Cour de cassation exige même que les manquements reprochés à l’employeur fassent obstacle à la poursuite du contrat de travail : ainsi, la prise d’acte ne permet au salarié de rompre le contrat de travail aux torts de l’employeur qu’en cas de « manquement suffisamment grave de l’employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail ».
Lorsque la prise d’acte produit les effets d’un licenciement abusif, l’employeur est alors condamné à verser aux salariés diverses indemnités dont, à tout le moins, l’indemnité compensatrice de préavis et l’indemnité compensatrice de congés payés, l’indemnité de licenciement et l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou pour licenciement nul. Si elle produit effets d’une démission, c’est le salarié qui est condamné à payer à l’employeur l’indemnité correspondant au préavis qu’il n’a pas exécuté ; il peut en outre être condamné à des dommages et intérêts si la prise d’acte a créé un préjudice pour l’employeur.
b. La procédure prud’homale
La procédure prud’homale se déroule en deux phases distinctes :
– la tentative de conciliation, obligatoire en principe pour tous les litiges (article L. 1411-1 du code du travail) ;
– le jugement, qui intervient lorsque la conciliation n’a pas abouti ou n’a été que partielle.
Aujourd’hui, la prise d’acte de rupture du contrat de travail par le salarié ne fait l’objet d’aucune procédure spécifique, en dépit de la précarité de la situation du salarié dans l’attente du jugement.
Force est cependant de constater que la tentative de conciliation est sans objet dans ce type de contentieux, dans la mesure où il appartient uniquement au bureau de jugement de se prononcer sur l’imputabilité de la rupture et donc de déterminer les effets juridiques de la prise d’acte. La conciliation apparaît donc, dans ce cas de figure, d’autant moins indispensable que l’affaire sera nécessairement portée in fine devant le bureau de jugement.
Or, non seulement, aujourd’hui la procédure de conciliation, est bel et bien mise en œuvre, mais le jugement au fond prend un temps considérable. Ainsi, d’après le rapport de Mmes Guillonneau et Serverin sur l’activité des conseils de prud’hommes de 2004 à 2012 (9), en 2012, les demandes formées au fond devant les conseils de prud’hommes ont été traitées en moyenne en 15 mois.
c. Le dispositif proposé par la présente proposition de loi
Le présent article vise à inscrire l’examen des prises d’acte de rupture du contrat de travail par le conseil de prud’hommes dans une procédure dérogatoire permettant la saisine directe du bureau de jugement et enserrant le règlement du litige dans un délai d’un mois.
Pour ce faire, il est créé une nouvelle sous-section (1 bis) intitulée « Prise d’acte de rupture », comprenant un article unique, l’article L. 1237-1-1, au sein de la section 1 « Rupture à l’initiative du salarié » du chapitre VII « Autres cas de rupture » du titre III « Rupture du contrat de travail à durée indéterminée » du livre II « Le contrat de travail » de la première partie « Les relations individuelles de travail » du code du travail.
L’article L. 1237-1-1 reprend, en les adaptant à la prise d’acte, les dispositions de l’article L. 1245-2 du code du travail qui prévoit la saisine directe du bureau de jugement pour toute demande de requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et fixe à un mois le délai dans lequel la décision doit être rendue.
Ainsi, toute « demande de qualification [soit en démission soit en licenciement sans cause réelle et sérieuse] d’une prise d’acte de rupture du contrat de travail par le salarié » ne devrait plus désormais faire l’objet de la phase de conciliation prévue dans le cadre de la procédure prud’homale classique mais être examinée directement par le bureau de jugement.
Enfin, le texte reprend également la mention prévue à l’article L. 1245-2 du délai d’un mois laissé à la juridiction prud’homale pour statuer.
Eu égard à l’objectif poursuivi par le présent texte, qui est avant tout de régler un problème de procédure, votre rapporteur souhaite apporter deux modifications au dispositif proposé. Il s’agit :
– d’une part, de déplacer les dispositions prévues au sein de la partie du code du travail relative à la procédure prud’homale, où il a plus naturellement sa place ;
– d’autre part, d’introduire une définition de la prise d’acte, en référence aux arrêts de la Cour de cassation du 25 juin 2003, qui permette de ne pas faire directement référence à cette notion dans le code du travail alors qu’elle en est absente aujourd’hui.
*
Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement AS1 de suppression de l’article de M. Dominique Tian.
Elle examine ensuite l’amendement AS5 du rapporteur.
M. le rapporteur. Cet amendement vise à déplacer les dispositions de la proposition de loi de l’article L. 1237-1-1 du code du travail, dans la partie relative à la rupture du contrat de travail à l’initiative du salarié, à l’article L. 1451-1, dans la partie relative à la procédure devant le conseil des prud’hommes. L’objet de ce texte est bien de préciser la procédure prud’homale applicable, et non de créer ou de reconnaître une nouvelle modalité de rupture du contrat de travail à l’initiative du salarié.
Dans cette perspective, cet amendement reformule également le texte, afin d’expliciter la notion de prise d’acte, sans introduire pour autant dans le code du travail le terme même de « prise d’acte », qui est une construction jurisprudentielle.
Mme Isabelle Le Callennec. Certes, le bureau du jugement devra statuer dans le délai d’un mois. Mais vous ne dites rien des recours qui pourront être interjetés ensuite, et qui risquent d’allonger la procédure.
M. le rapporteur. Premièrement, rien n’empêche le juge d’ordonner l’exécution provisoire. Ensuite – et je réponds en même temps à la question de Mme Louwagie –, le salarié peut gagner en première instance et perdre en deuxième instance : cela vaut pour n’importe quel litige. Si le salarié a récupéré une somme dans le cadre de l’exécution provisoire, mais que la Cour d’appel décide de tout remettre à plat, il sera obligé de rembourser. Cela arrive dans tous les tribunaux. Ce n’est pas une nouveauté.
M. Denys Robillard. L’exécution provisoire est de droit pour une partie des sommes. En effet, à partir du moment où il a été jugé que la rupture était imputable à l’employeur, l’indemnité de préavis et l’indemnité conventionnelle ou légale de licenciement sont dues au salarié. Or ces indemnités, dans la limite de neuf mois de salaire, sont exécutoires de droit par provision. Par conséquent, une partie de la décision sera de plein droit assortie de l’exécution provisoire.
Ensuite, on peut considérer que, si Pôle emploi, sur la base d’une ordonnance de référé, accepte de considérer que la rupture est imputable à l’employeur et de faire produire à cette rupture les effets d’un licenciement, il n’y a pas de raison que, sur la base d’un jugement du conseil des prud’hommes statuant au fond, il n’adopte pas la même analyse. Cela me paraîtrait suffire à préserver le droit des salariés à être rapidement indemnisés et pris en charge au titre du chômage – qui est l’objectif de cette proposition de loi.
M. le rapporteur. Je rajouterai que, nonobstant l’exécution provisoire de droit, sur la base de l’article 515 du code de procédure civile, le salarié peut faire une demande d’exécution provisoire sur l’intégralité du jugement.
M. Dominique Tian. J’ai bien conscience que, si l’amendement AS5 est adopté, mon amendement AS2 tombera : j’aimerais néanmoins l’évoquer en quelques mots. Lorsque l’employeur envisage de rompre le contrat d’un salarié, il le convoque d’abord à l’entretien préalable, afin de lui faire part des griefs à son encontre et d’en discuter. Cet entretien peut aboutir à revenir sur la rupture envisagée. Selon moi, il est anormal qu’il en soit autrement dans le cadre d’une prise d’acte, par le salarié, de la rupture de son contrat qui, en l’état actuel de la jurisprudence, laisse l’employeur dans l’ignorance des griefs du salarié jusqu’à un éventuel contentieux. Voilà pourquoi j’avais proposé, par souci d’équilibre, que l’employeur soit informé des manquements graves que lui reproche le salarié.
La Commission adopte l’amendement AS5.
L’article unique est ainsi rédigé.
En conséquence, les amendements AS2 et AS3 de M. Dominique Tian tombent.
La Commission adopte l’amendement de cohérence AS4 du rapporteur.
Puis elle adopte l’ensemble de la proposition de loi modifiée.
*
* *
En conséquence, la Commission des affaires sociales demande à l’Assemblée nationale d’adopter la présente proposition de loi dans le texte figurant dans le document annexé au présent rapport.
___
Dispositions en vigueur ___ |
Texte de la proposition de loi ___ |
Texte adopté par la Commission ___ |
Proposition de loi relative aux effets de la prise d’acte de rupture du contrat de travail par le salarié |
Proposition de loi relative à la procédure applicable devant le conseil des prud’hommes dans le cadre d’une prise d’acte de rupture du contrat de travail par le salarié Amendement AS4 | |
Article unique |
Article unique | |
Après l’article L. 1237-1 du code du travail, il est inséré une sous-section 1 bis ainsi rédigée : |
« Au chapitre Ier du titre V du livre IV de la première partie du code du travail, il est inséré un article L. 1451-1 ainsi rédigé : | |
« Sous-section 1 bis |
Alinéa supprimé | |
« Prise d’acte de rupture |
Alinéa supprimé | |
« Art. L. 1237-1-1. – Lorsque le conseil de prud’hommes est saisi d’une demande de qualification d’une prise d’acte de rupture du contrat de travail par le salarié, l’affaire est directement portée devant le bureau de jugement qui statue au fond dans un délai d’un mois suivant sa saisine. » |
« Art. L. 1451-1. – Lorsque … … qualification de la rupture du contrat de travail à l’initiative du salarié en raison de faits que celui-ci reproche à son employeur, l’affaire … …saisine. » | |
Amendement AS5 |
ANNEXE :
LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES PAR LE RAPPORTEUR
Ø Ministère de la justice – Mme Stéphanie Kretowicz, conseillère Droit de la famille, aide aux victimes et droit de l’environnement au cabinet de Mme Christiane Taubira, et M. Hervé Roberge, rédacteur au bureau du droit processuel et du droit social de la Direction des affaires civiles et du sceau
Ø Barreau de Paris – M. Louis Degos, avocat à la Cour, membre du Conseil de l’Ordre des avocats de Paris, délégué du Bâtonnier de Paris aux affaires publiques, et M. Aurélien Boulanger, avocat à la Cour, membre du Conseil de l’Ordre des avocats de Paris
Ø Table ronde réunissant les membres de la Commission permanente du Conseil supérieur de la prud’homie :
- Confédération française démocratique du travail (CFDT) – M. Laurent Loyer
- Confédération française de l’encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) – M. Bernard Vincent, secrétaire national
- Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) – M. Denis Lavat
- Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) – M. Richard Muscatel
- Confédération générale du travail (CGT) – M. Bernard Augier
- Mouvement des entreprises de France (MEDEF) –M. Jacques-Frédéric Sauvage, vice-président du Conseil des prud’hommes de Paris, Mme Sandra Aguettaz, directrice de mission à la direction des relations sociales, et Mme Ophélie Dujarric, chargée de mission senior à la direction des affaires publiques
- Confédération générale du travail Force Ouvrière (FO) – M. Didier Porte, secrétaire confédéral secteur juridique (contribution écrite)
Ø Conseil supérieur de la prud’homie – M. Jean-François Merle, président, ancien membre du Conseil d’État
Ø Ministère du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social – M. Benjamin Raigneau, conseiller technique Dialogue social et droit du travail au cabinet de M. Michel Sapin, et Mme Élise Texier, cheffe du bureau des relations individuelles du travail à la Direction générale du travail
Ø Conseil national des barreaux – M. Stéphane Lallemand, membre du bureau, avocat à Nantes, M. Nicolas Sanfelle, membre, avocat à Versailles
1 () Le licenciement prononcé après la prise d’acte du salarié doit ainsi être considéré comme « non avenu » (Cass. soc. 19 janvier 2005). Suivant la même logique, la Cour de cassation considère que le comportement du salarié postérieurement à sa prise d’acte est également sans incidence sur la rupture.
2 () La faute de l’employeur invoquée par le salarié à l'appui de sa prise d'acte justifie l'impossibilité pour l'employeur de se prévaloir de l'existence d'un préavis (Cass. soc. 4 juin 2008).
3 () À cet égard, l’inexécution par l'employeur de son obligation de délivrer au salarié une attestation destinée à Pôle emploi, indiquant le motif exact de la rupture du contrat de travail, tel qu’il ressort de la prise d'acte du salarié, cause nécessairement à ce dernier un préjudice (Cass. soc. 7 mars 2012).
4 () Chaque conseil de prud’hommes est divisé en cinq sections autonomes compétentes respectivement pour les litiges concernant les salariés qui en relèvent : section de l’encadrement ; section de l’industrie ; section du commerce et des services commerciaux ; section de l’agriculture ; section des activités diverses (employés de maison, concierges, gardiens d’immeubles…).
5 () Plusieurs chambres peuvent être constituées au sein d’une même section.
6 () Rapport de Mmes Guillonneau et Serverin sur l’activité des conseils de prud’hommes de 2004 à 2012, Pôle d’évaluation de la justice civile, septembre 2013.
7 () Congé sabbatique (article L. 3142-97 du code du travail), congé de création d’entreprise (même article), congé de formation économique, sociale et syndicale (article L. 3142-13 du code du travail), congé de solidarité internationale (article L. 3142-34 du même code) et congé de représentation (article L. 3142-54 du même code).
8 () Débat sur le fonctionnement des juridictions prud’homales après la réforme de la carte judiciaire.
9 () Pôle d’évaluation de la justice civile, septembre 2013.