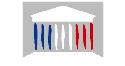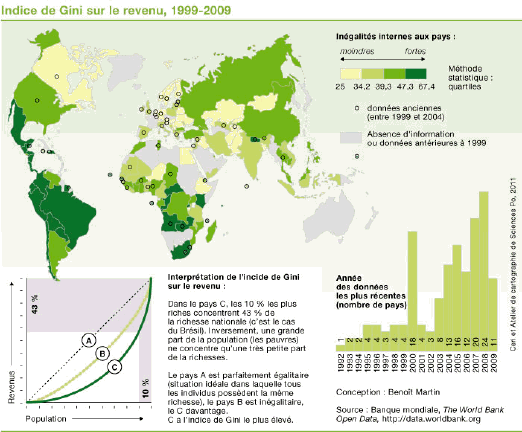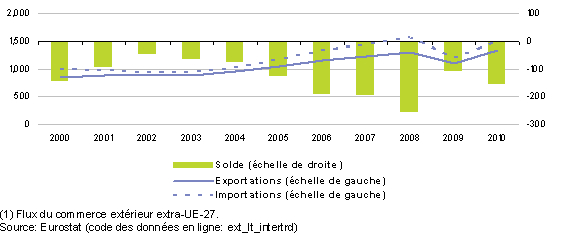______
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 26 février 2014
RAPPORT
FAIT
AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES SUR LA PROPOSITION DE RÉSOLUTION EUROPÉENNE sur le « juste échange » au plan international,
PAR Mme Seybah DAGOMA
Députée
____________________________________________________________________
Voir le numéro : 1771.
SOMMAIRE
___
Pages
INTRODUCTION 7
I. LE LIBRE ÉCHANGE A PERMIS LA RÉDUCTION DES INEGALITÉS INTERNATIONALES ET L’ÉMERGENCE DE NOUVELLES PUISSANCES, MAIS N’A PAS PERMIS D’ASSURER DES ÉCHANGES JUSTES 13
A. LE LIBRE-ÉCHANGE S’EST IMPOSÉ COMME L’HORIZON DOCTRINAL DE LA MONDIALISATION 13
1. L’abaissement des barrières douanières a favorisé la mondialisation 13
2. L’économie mondiale est plus que jamais dépendante des échanges commerciaux 14
B. LA STRUCTURE DES ÉCHANGES INTERNATIONAUX S’EST CONSIDÉRABLEMENT MODIFIÉE AU COURS DES DERNIÈRES DÉCENNIES 15
1. Une nouvelle division internationale du travail 15
2. La fragmentation des chaînes de valeur : une transformation majeure des conditions des échanges 16
3. Le poids des entreprises multinationales 20
C. LES BÉNÉFICES DE LA MONDIALISATION SONT TRÈS INÉGALEMENT RÉPARTIS 22
1. Pour les économies développées : un enrichissement global mais une désindustrialisation subie et une menace sur le modèle social 23
a. Une désindustrialisation subie 23
i. La baisse des emplois industriels n’est-elle due qu’à la mondialisation ? 24
ii. Dans ces pertes d’emplois, quel est l’impact des délocalisations ? 25
b. Une menace sur le modèle social 26
2. Pour les pays en développement 27
a. Une diminution des inégalités sur le plan international mais une augmentation des inégalités internes. 27
b. Les « laissés pour compte » de la mondialisation 29
3. Les puissances émergentes, « grands vainqueurs » de la mondialisation ? 31
a. Les émergents ne sont pas une catégorie homogène 31
b. Le nouveau partage du marché mondial 33
c. Un déplacement du centre de gravité économique mondial vers les pays émergents ? 34
d. De nouvelles puissances aux politiques commerciales souvent restrictives 40
i. Le Brésil, un acteur stratégique encore peu ouvert 40
ii. L’Inde : une puissance économique en devenir, des mesures protectionnistes à lever 43
iii. La Chine, un pays en mutation, un rééquilibrage des relations avec l’Europe indispensable 46
D. FACE À CES LIMITES DU LIBRE-ÉCHANGE, LA TENTATION PROTECTIONNISTE 49
1. Des règles du multilatéralisme non respectées 49
2. Des manquements aux engagements 50
3. Le recours à l’arme monétaire 54
E. L’UNION EUROPÉENNE, « IDIOT DE LA MONDIALISATION » ? 57
1. Le libre-échange a été un des principes fondateurs de l’Union européenne 57
2. La part prédominante des échanges intra-européens 58
3. Une politique commune réduite à la portion congrue, du fait de divergences entre États membres 61
4. Une utilisation timide des outils de défense commerciale 62
II. PROMOUVOIR LE JUSTE ÉCHANGE : UNE AMBITION MAJEURE POUR L’UNION EUROPÉENNE 65
A. LE RESPECT DE NORMES SOCIALES ET ENVIRONNEMENTALES, BASE DU JUSTE ÉCHANGE 65
1. Les fondements théoriques : des « biens publics mondiaux », mais des « responsabilités communes mais différenciées » 67
2. Une meilleure prise en compte des normes sociales au plan multilatéral 69
a. La difficulté de poser un cadre normatif 69
b. Un socle commun de normes sociales minimales à garantir 71
3. Une gouvernance environnementale équitable face aux défis du changement climatique 72
a. Mieux articuler normes environnementales et règles commerciales 72
b. Parvenir à un accord climatique mondial équitable 76
c. Créer une taxe carbone européenne aux frontières ? 78
4. Redonner force à la volonté politique et mettre les entreprises multinationales face à leurs responsabilités sociale et environnementale 81
a. Les limites d’une responsabilité sociale non contraignante pour les entreprises 81
b. Amener les entreprises à assumer un devoir de vigilance 84
B. L’UNION EUROPÉENNE DOIT SE DOTER D’UNE STRATÉGIE COMMUNE, OFFENSIVE, COHÉRENTE ET EXIGEANTE 86
1. L’Union européenne doit tracer une ligne d’intérêts communs sur la base du principe de réciprocité 87
a. Promouvoir le principe de réciprocité dans les accords plurilatéraux sur les services et sur les marchés publics 87
b. Instaurer un instrument unilatéral de réciprocité sur les marchés publics 88
2. L’Union européenne doit infléchir ses politiques de l’investissement et de la concurrence pour rééquilibrer les relations avec ses partenaires 89
a. Une politique de l’investissement assurant la réciprocité dans l’accès aux marchés tiers et la défense des intérêts stratégiques européens 90
b. Une politique de la concurrence adaptée à la mondialisation 94
3. L’Europe doit défendre ses intérêts offensifs et défensifs dans les négociations bilatérales 96
4. L’Europe doit tenir compte équitablement du différentiel de développement de ses partenaires commerciaux 98
a. Des systèmes de préférences tarifaires graduées et conditionnelles 98
b. La négociation d’accords de partenariat économiques favorisant l’intégration régionale et le développement 99
5. L’Union européenne doit utiliser les négociations d’accord de libre-échange comme leviers du développement durable 100
a. Généraliser et renforcer les chapitres relatifs au développement durable 101
b. Mieux les évaluer et en contrôler l’application 102
C. L’UNION EUROPÉENNE DOIT S’IMPOSER COMME LA FIGURE DE PROUE D’UN MULTILATÉRALISME RÉNOVÉ 103
1. Repenser une gouvernance commerciale multilatérale en crise 103
a. L’alternative du bilatéralisme est insatisfaisante pour un juste échange 103
b. La Conférence ministérielle de Bali n’a sauvé que les apparences 105
2. Redéfinir les règles multilatérales pour un juste échange 107
a. Réformer le traitement spécial et différencié en tenant compte des nouveaux équilibres économiques internationaux 108
b. Revoir la réglementation sur les subventions aux exportations 108
c. Garantir un meilleur accès aux matières premières 109
d. Assurer la convergence des normes 112
e. Promouvoir la sécurité alimentaire 112
3. Assurer une coordination monétaire multilatérale et mettre en œuvre une politique européenne de change, pour limiter les risques de dumping monétaire 115
CONCLUSION 121
TRAVAUX DE LA COMMISSION 123
ANNEXE : LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES PAR LA RAPPORTEURE 129
Délocalisations, accroissement des inégalités, concurrence déloyale, dérégulation financière font pêle-mêle partie des critiques de la mondialisation émises par de nombreux citoyens européens. Celles-ci ont pris une acuité particulière ces dernières années où l’Europe n’apparaît plus, ni comme un pôle de stabilité, ni comme un bouclier, mais au contraire comme le cheval de Troie de la mondialisation. La conséquence est une dégradation de la confiance vis-à-vis d’elle pour certains, la tentation du repli et/ou des extrêmes pour d’autres.
Si cette progression de la défiance s’explique par la crise économique et financière, force est de constater que le sentiment d’insécurité économique a été accentué par le « basculement du monde ». En effet, la mondialisation a significativement transformé les contours de l’économie mondiale, notamment avec la montée en puissance des grands émergents.
L’ensemble des pays du Sud, qui assuraient le tiers de la production mondiale en 1990, en produisent près de la moitié aujourd’hui. Nous sommes loin de 1950, où la Chine, l’Inde et le Brésil ne représentaient que 10 % de la production économique mondiale, alors que les six puissances traditionnelles du Nord comptaient pour plus de la moitié.
Ce grand basculement du monde se traduit de façon amplifiée dans les échanges commerciaux, qui représentent désormais 30 % du PIB mondial. Il y a vingt ans, 60 % de ces échanges s’effectuaient entre les pays du Nord, 30 % étaient orientés Nord-Sud et 10 % étaient réalisés entre les pays du Sud ; aujourd’hui, les proportions sont d’un tiers dans chaque sens.
Le constat s’impose de lui-même : la mondialisation et la libéralisation des échanges internationaux ont radicalement changé la donne.
Les positions acquises ont été remises en cause : nouvelle division du travail, éclatement des chaînes de valeur, affaiblissement d'un monopole de la puissance jusqu'alors largement détenu par les États, accroissement du rôle des multinationales. La crise de 2008 a accéléré ces transformations en portant un coup à la double hégémonie des États-Unis et de l’Union européenne.
Désormais, le dynamisme économique a changé de camp. Même si les taux de croissance n’atteignent plus ceux à deux chiffres d’il y a quelques années, les pays du Sud s’en sortent finalement mieux.
Les gisements de croissance sont au Sud : d’ici à 2020, 90 % de la croissance économique globale devrait être le fait des pays situés hors de l’Union européenne. Ce différentiel de croissance entre le Nord et le Sud devrait se poursuivre avec l’arrivée de pays actuellement en phase de « pré–émergence », notamment en Afrique.
S’ajoute à cela le contraste entre les perspectives démographiques de l’Europe et celles des puissances émergentes, qui est saisissant. Alors que la population des 28 États membres de l’Union européenne devrait atteindre 520 millions en 2030 et tomber à 515 millions en 2050, la Chine, l’Inde et le continent africain devraient avoir une population de 1,5 milliard chacun d’ici à 2030 (dont de nombreux jeunes) : ensemble, ils représenteraient plus de la moitié de la population mondiale en 2030-2050, contre le tiers en 1980.
Au regard de ces perspectives, l’Europe se doit de tirer pleinement parti de ses atouts sur le plan mondial. Première zone d’exportations et d’importations, premier investisseur et premier destinataire des investissements mondiaux, l’étendue et le pouvoir d’achat de son marché de consommation, ainsi que la capacité de production et d’innovation qu’elle conserve, assurent à l’Europe une masse critique qui lui permettrait de jouer un rôle moteur dans les transformations du commerce international. Si elle le veut.
En effet, alors que sa demande intérieure est bridée par la baisse de la consommation et la dégradation des finances publiques dans de nombreux États membres, le commerce, destiné à répondre à la demande mondiale, est un moteur qui peut alimenter la croissance de l’Europe. Faire des émergents une chance pour l’Europe est une nécessité, d’autant que la mondialisation est entrée dans une nouvelle phase caractérisée par la montée en puissance d’une classe moyenne mondiale. Celle-ci représentera sans doute plus de 4 milliards d’individus dans dix ans, dont plus de la moitié résideront en Asie.
Cependant, si le développement du commerce peut constituer une opportunité, il ne peut devenir un but en soi mais seulement un moyen. Encore faut-il qu’il soit loyal, équitable, respectueux des normes internationales, en un mot, conforme aux exigences d’un « juste échange ».
Il faut l’admettre d’emblée, la définition de ce qui est juste ou injuste dans les rapports économiques et commerciaux n’est pas aisée. Cette notion de « juste » implique, en effet, une connotation morale. Or, d’aucuns considèrent que dans les affaires, ce qui est juste est ce sur quoi les parties prenantes se sont mises d’accord. Autrement dit, leur référence est le contrat.
Ceci posé, le juste échange vise à réguler le libre-échange. En effet, celui-ci a été la toile de fond doctrinale de la mondialisation avec l’abaissement des barrières et l’application de la théorie des avantages comparatifs. Il a constitué un des points majeurs du « Consensus de Washington », imposé aux pays en développement par les grandes institutions financières internationales dans les années 1990. Cependant, pour ces pays, il n’a pas apporté de réponse pleinement satisfaisante à leurs difficultés économiques. Par ailleurs, l’utilisation des avantages comparatifs, particulièrement ceux liés à la faible réglementation environnementale et aux faibles coûts de la main d’œuvre, a conduit aux délocalisations des activités les plus polluantes des entreprises des pays industrialisés dans les pays en développement et par là même les a transformés en « havres de pollution ». De plus elle a généré des conditions de travail contraires à la dignité humaine, comme le montre le drame du Rana Plaza, survenu en avril 2013 au Bangladesh.
Si le libre-échange est un concept abondamment documenté, le juste échange n’est pas une notion académique du point de vue de la théorie économique. Elle n’est pas utilisée en tant que telle dans le droit commercial international, notamment dans le corpus de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) dont le fondement est la réciprocité. Le juste échange n’y est reconnu qu’indirectement, dans la possibilité de mesures dites « antidumping » et « anti-subventions », puisque leur objet est de rétablir des conditions de concurrence équitables et de lutter contre les exportations qui ne se feraient pas à leur juste valeur. Le contenu intellectuel de la notion de juste échange s’inscrit davantage dans la tradition scolastique de Saint Thomas d’Aquin de l’égalité dans l’échange.
Les négociations commerciales internationales manifestent pourtant une attente indéniable de juste échange. Ainsi, le juste échange a-t-il sous-tendu implicitement les critiques sur les conditions des échanges et les revendications d’un développement durable qui avaient émergé lors de la Conférence ministérielle de l’OMC de Seattle en 1999. La déclaration de Doha sur l’accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle touchant au commerce (ADPIC) et la santé publique de 2001, qui permet aux pays en développement, n’ayant pas les capacités de fabrication suffisantes, d’avoir accès à des médicaments de façon abordable, découle directement de ces revendications de justice. Le lancement du cycle de Doha pour le développement, s’il s’est réduit à des négociations commerciales classiques autour de réductions de droits de douane, correspondait à cette même préoccupation d’une répartition plus juste des bénéfices du commerce mondial. L’Organisation internationale du travail (OIT) plaide pour une mondialisation plus juste, c'est-à-dire plus régulée, qui s’est exprimée par l’adoption, le 10 juin 2008, de la Déclaration sur la justice sociale pour une mondialisation équitable.
Pour votre rapporteure, le juste échange s’entend sous une triple acception.
En premier lieu, la notion de juste échange implique que chacun prenne la part qui lui revient dans l’effort commun et suppose l’émergence d’un accord sur des « règles du jeu universelles ». Cette conception du juste échange s’appuie notamment sur la notion de biens publics mondiaux, le phénomène de mondialisation ayant multiplié les problèmes et les intérêts communs à l’ensemble de la planète. Au nombre de ces biens publics mondiaux, figurent la préservation de l’environnement, un système monétaire stable, la protection de la biodiversité ou des conditions de travail décentes. Cette approche en termes de biens publics mondiaux met en évidence la nécessité d’une action publique et d’une gouvernance multilatérale. Il est nécessaire de concilier cette conception du juste échange avec le principe des « responsabilités communes mais différenciées » adopté lors du Sommet de Rio en 1992 et fondé sur l’idée qu’il serait inéquitable de soumettre les pays en développement aux mêmes obligations que les pays développés.
En second lieu, le juste échange suppose la loyauté dans les échanges et le respect des règles internationales dont principalement celles de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), qui compte en son sein la quasi-totalité des nations, dont la Chine (depuis 2001) et la Russie (depuis 2011). La notion de justice rejoint là celles de réciprocité dans l’échange et d’équité dans les concessions mutuelles. Or trop souvent, l’Europe et les grands émergents ne combattent pas à armes égales. Les gouvernements de ces pays protègent leur marché intérieur, imposent des taux de contenu local et des transferts de technologie et constituent des oligopoles compétitifs de firmes publiques au service desquels sont mis des capacités d’investissement considérables. Il est donc temps de rééquilibrer les choses.
En troisième lieu, l’Europe doit s’affirmer comme la figure de proue d’un multilatéralisme rénové, qui permettrait de rééquilibrer les bénéfices des échanges internationaux au profit des nations jusqu’alors restées à l’écart de la mondialisation.
C’est une Union européenne portée par un consensus fort qui doit promouvoir le juste échange. Malheureusement sur une carte stratégique mondiale en pleine mutation, l’Europe peine aujourd’hui à parler d’une seule voix au nom de l’intérêt commun. Alors que l’Union européenne avait naguère su exister en tant qu’entité unie dans les négociations commerciales multilatérales, elle parvient difficilement à surmonter les différences de situations entre États membres. Les pays du Nord de l’Europe, dotés d’un appareil productif efficace, fondent leur prospérité sur les exportations, tandis que les États du Sud sont en prise à de nombreuses difficultés structurelles. Aujourd’hui, la question du juste échange implique de poser le débat sur ce que les États membres veulent faire de l’Europe alors qu’il existe des divergences accentuées par la crise. Il est nécessaire que l’Europe s’engage dans un processus visant au diagnostic de ses faiblesses et de ses atouts. Défendre un juste échange suppose pour les États européens de ne pas adopter de stratégies « gagnants /perdants » et d’endosser une responsabilité normative commune particulière : tout à la fois respecter et faire respecter une forme exigeante de réciprocité, ainsi que les règles existantes (y compris multilatérales, plurilatérales et bilatérales), et promouvoir des normes, en particulier environnementales et/ou sociales, rendues opposables au commerce.
A l’heure où les citoyens manifestent un désintérêt, voire une opposition croissante vis-à-vis de l’Union européenne, à l’heure où l’Euroscepticisme fait trop souvent place à une forme d’europhobie, encouragée et nourrie par des forces politiques qui gagnent un peu partout du terrain, la promotion déterminée du « juste échange » constituerait un véritable projet fédérateur pour l’Europe. D’une part, parce que l’adoption d’un modèle commercial international fondé sur la réciprocité et le respect de normes sociales et environnementales font parti des conditions du maintien de l’influence économique de l’Union et de chacun des pays qui la composent dans le monde de demain, et, d’autre part, parce qu’une Europe qui promouvrait et imposerait le « juste échange » jouerait de nouveau son rôle de protection des citoyens, qui ne perçoivent aujourd’hui majoritairement, en France et dans de nombreux pays de l’UE, que les effets inégalitaires d’une mondialisation non maîtrisée dont ils sont convaincus d’être les victimes.
Pour votre rapporteure, il est donc crucial que l’Europe parle enfin d’une seule voix et affirme son leadership dans la définition et la mise en place d’une mondialisation mieux régulée et plus équilibrée.
La proposition de résolution qui vous est présentée dessine les contours d’un juste échange, qui constituerait le cadre de cette impérative régulation.
I. LE LIBRE ÉCHANGE A PERMIS LA RÉDUCTION DES INEGALITÉS INTERNATIONALES ET L’ÉMERGENCE DE NOUVELLES PUISSANCES, MAIS N’A PAS PERMIS D’ASSURER DES ÉCHANGES JUSTES
Après avoir façonné le développement des échanges commerciaux qui ont conduit à la première mondialisation de 1850-1914, le libre-échange a constitué l’horizon doctrinal du commerce international depuis les Trente Glorieuses. Les mesures protectionnistes et les dévaluations compétitives ayant été tenues pour responsables de la régression du commerce international et donc de la crise économique, les pays de l’OCDE (Organisation de coopération et de développement économique) ont décidé de pratiquer une politique volontariste de libre-échange, dans le cadre toutefois régulé d’une organisation internationale. C’est ainsi qu’a été créée en 1994 l’Organisation mondiale du commerce (OMC), qui a succédé au General Agreement on Tariffs and Trade (GATT). À la base du contrat liant les pays membres de cette organisation est inscrite la notion de réciprocité (article XXVIII) selon lequel « les pays doivent s’efforcer de maintenir un niveau de concessions réciproques et mutuellement avantageuses ». Deux autres principes se superposent à elle : la clause de la nation la plus favorisée et le traitement spécial et différencié.
La principale fonction du GATT puis de l’OMC est de libéraliser les échanges, c’est-à-dire faire en sorte que le commerce soit aussi libre que possible. Cela passe principalement par l’abaissement des barrières au commerce.
C’est au regard de cet objectif que les grands cycles de négociations du GATT de 1947 à 1996 ont eu pour objet presque exclusif le démantèlement des tarifs douaniers qui, depuis la fin de la deuxième guerre mondiale, ont été divisés par huit.
Le taux moyen des droits de douane est aujourd’hui inférieur à 5 %.
Cette limitation des barrières tarifaires a favorisé la phase de mondialisation qui a débuté lors de l’intégration des pays d’Asie dans les accords du GATT : le Japon dans les années 1950 et 1960 et les « Dragons d’Asie » dans les années 1980. Aujourd’hui, tous les pays développés ont un niveau de protection douanière très faible : les taux moyens sont respectivement de 1,6 %, 1,8 %, 1,6 % et 1 % pour l’Union européenne, les États-Unis, le Japon et le Canada. Les pays émergents ont également abaissé leurs barrières douanières. Parmi ces derniers, la Chine qui, en accédant à l’OMC en 2001, a dû procéder à des concessions tarifaires : ses droits moyens sont passés de 19,6 % en 1996 à 4,2 % en 2009 tandis que ceux de l’Inde sont passés de 20,1 % à 8,2 %.
Les « véritables » barrières au commerce sont désormais les barrières non tarifaires.
A l’heure actuelle, l’économie mondiale est fortement dépendante des échanges commerciaux. Ceux-ci se caractérisent par une forte croissance et représentent aujourd’hui plus de 30 % du produit intérieur brut mondial (voir graphique ci-après). Cette croissance, accompagnée par les institutions multilatérales, en particulier par l’OMC, a été favorisée par les mouvements des facteurs de production (main d’œuvre, capitaux, technologies) et par les progrès techniques (rapidité des échanges d’information et de paiement, homogénéisation des moyens de transports et réduction de leurs coûts), qui ont facilité le commerce et réduit de façon considérable les coûts des échanges.
Ratio des exportations mondiales de marchandises et de services commerciaux au PIB mondial, 1980-2012
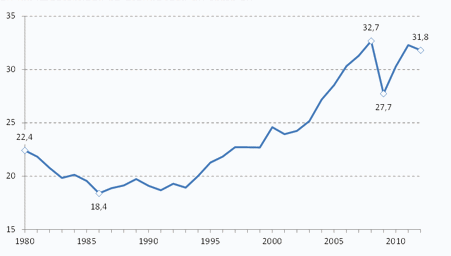
Sources : FMI pour le PIB mondial, Secrétariat de l'OMC pour le commerce des marchandises, Secrétariat de l'OMC et CNUCED pour les services commerciaux.
Croissance, en volume, du commerce mondial des marchandises et du PIB, (2005-2014) (variation annuelle en %)
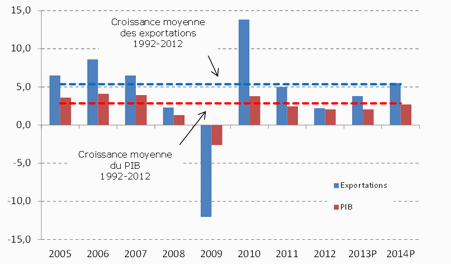
Source : Organisation mondiale du commerce.
Le commerce mondial devrait enregistrer une hausse de plus de 4,5 % en 20141.
B. LA STRUCTURE DES ÉCHANGES INTERNATIONAUX S’EST CONSIDÉRABLEMENT MODIFIÉE AU COURS DES DERNIÈRES DÉCENNIES
Le commerce international est indissociable d’une division internationale du travail (DIT), c’est-à-dire d’une spécialisation des économies nationales dans des activités particulières. C’est cette spécialisation qui entraîne l’essor des échanges commerciaux.
La levée des obstacles au commerce a conduit à une nouvelle DIT. En effet, la DIT traditionnelle était le reflet de la domination et de l’avance des pays européens qui achetaient des produits primaires et exportaient des produits issus de leur industrie. Autrement dit, les pays pauvres étaient spécialisés dans les produits agricoles et les matières premières alors que les pays riches, pour la majorité d’entre eux, fabriquaient des produits manufacturés.
Avec la libéralisation croissante des échanges, la donne va changer. Les échanges intra-branche vont se développer. En effet, contrairement à la DIT traditionnelle qui reposait sur une spécialisation interbranche (un pays ne peut pas exporter et importer le même produit), la nouvelle DIT va favoriser les échanges croisés de produits différenciés (un pays peut exporter et importer le même type de produits). Parmi les autres transformations découlant de l’ouverture massive des échanges, il y a le fait que les pays en développement, en particulier les pays émergents (Chine, Brésil, Inde…) vont progressivement exporter des produits manufacturés (ordinateurs, automobiles, vêtements…). L’organisation des entreprises multinationales va également contribuer à la nouvelle DIT (cf. infra). Enfin, les échanges de services jouent aussi un rôle dans ce changement.
Parvenir au juste échange n’est possible qu’en appréhendant les changements du commerce international liés à la fragmentation géographique du processus de production et des chaînes de valeur.
Cette tendance lourde de l’évolution récente des structures industrielles s’inscrit à rebours du principe qui consistait à produire la totalité d’un produit dans un même lieu. Elle consiste à décomposer la fabrication d’un produit dans des lieux différents, puis à les réunir pour l’assemblage final. Par cette pratique, l’entreprise exploite les avantages comparatifs propres à chaque pays au sein d’une stratégie élaborée à l’échelle internationale. Elle peut le faire en ayant recours à des entreprises partenaires ou à des filiales au sein d’un même groupe.
Les entreprises multinationales ont fortement contribué à cette fragmentation, notamment en procédant à des échanges au sein du même groupe. En effet, certaines d’entre elles ont décomposé la production d’un produit en spécialisant chaque filiale sur un élément du produit pour assembler le tout dans un autre pays. Cela a notamment eu pour conséquence d’augmenter la part des biens intermédiaires dans les importations mondiales de biens. Autrement dit, les biens et services sont désormais composés d'intrants provenant de divers pays et une part importante des importations intermédiaires est utilisée pour produire des exportations.
Dans la plupart des économies, environ un tiers des importations de produits intermédiaires sont destinées au marché de l’exportation. Selon les chiffres avancés par l’OMC2, près de 30 % du total des échanges consistent en réexportations de biens intermédiaires, ce pourcentage ayant augmenté de dix points depuis le milieu des années quatre-vingt-dix.
Aux États-Unis et au Japon – où la part des importations intermédiaires incorporées dans les exportations est parmi les plus faibles de la zone OCDE – elle atteint respectivement 17 et 23 % globalement, mais elle est nettement plus élevée dans certaines industries fortement intégrées. Au Japon, par exemple, près de 40 % des importations intermédiaires totales de matériel de transport finissent en exportations. Au sein de l’Union européenne, la fragmentation internationale de la production – calculée par la part des consommations intermédiaires importées dans la production – a progressé moins rapidement en France qu’en Allemagne, ce qui explique en partie les écarts de performance entre les deux pays3.
Situation comparée de la France et de l’Allemagne
En 2007, les importations allemandes de biens intermédiaires venant des pays à bas salaires s’élevaient à 90 milliards d’euros, soit près de quatre fois plus que pour la France. Rappelons qu’en 1994, les deux pays importaient environ 10 milliards de biens intermédiaires en provenance du Sud.
Selon MM. Yvon Jacob et Serge Guillon dans leur rapport En finir avec la mondialisation déloyale, « 450 entreprises françaises seraient implantées en République tchèque, alors que le nombre d’entreprises allemandes s’élèverait à 4 500 ». Ils précisent que « pour l’Allemagne, les nouveaux États membres de l’Est présenteraient plusieurs avantages par rapport à des pays à bas salaires situés sur d’autres continents :
– les biens qu’ils fournissent peuvent incorporer plus de recherches et développement ;
– les progrès de productivité qu’ils réalisent sont relativement élevés, ce qui favorise a priori une certaine sagesse des prix des biens qu’ils vendent ;
– leur proximité géographique peut offrir la perspective d’atténuer les tensions de prix que pourraient connaître les transports pour différentes raisons parmi lesquelles la hausse prévisible des coûts de l’énergie ».
En conséquence, les mesures classiques des échanges internationaux ne reflètent pas les mouvements des biens et services qui circulent au sein de ces chaînes de production mondiales. Les balances commerciales bilatérales peuvent ainsi être assez différentes quand on les mesure en valeur ajoutée, bien que la balance commerciale totale demeure inchangée. Ainsi, calculé en termes de valeur ajoutée, l’excédent commercial de la Chine avec les États-Unis diminue de plus de 40 milliards de dollars c'est-à-dire de 25 % en 2009. Cet écart reflète en partie la part plus élevée des importations de valeur ajoutée des États-Unis dans la demande finale chinoise, mais s’explique également par le fait qu’une proportion considérable (un tiers) des exportations de la Chine incorpore un contenu étranger – il s’agit du phénomène « Made in world ». Ainsi, un iPhone assemblé en Chine contient moins de 4 % de valeur ajoutée chinoise et plus de 16 % de valeur ajoutée produite en Europe.
La France dans les chaînes de valeur mondiales (CVM)
Pour la France, dans l’ensemble, la méthodologie des chaînes de valeur mondiale (CVM) ne modifie pas le diagnostic des parts de marché. Ainsi, la France participe de manière active aux CVM manufacturières dans les secteurs des produits chimiques et du matériel de transport et est très présente dans certains secteurs des services, en particulier les services aux entreprises. Près de 40 % de la valeur des exportations manufacturières de la France représente la valeur ajoutée des services. La méthode d’évaluation en CVM permet de constater que :
– la progression de la valeur ajoutée étrangère dans les exportations de la France est de 7 points entre 1995 et 2009, ce qui illustre l’intégration croissante de la France dans les CVM ;
– toutefois, la part de la France dans les exportations mondiales est globalement la même en données brutes, ou en valeur ajoutée, soit 4 % des exportations mondiales ;
– la capacité d’un pays à tirer avantage de la participation aux CVM est fonction de sa capacité d’exploiter la valeur ajoutée tout au long de la chaîne de valeur. À ce titre, l’indicateur final est le rapport entre la valeur ajoutée créée par le secteur national et étranger dans la satisfaction de la demande finale. En France, ce rapport est de 76 % de la valeur ajoutée locale et de 24 % de valeur ajoutée créée à l’étranger. À titre de comparaison, ce rapport est de 90 % au Japon, 85 % aux États-Unis et de 70 % en Allemagne ;
– l’utilisation d’intrants intermédiaires étrangers dans les exportations de la France, c'est-à-dire sa participation en amont, est légèrement supérieure à l’utilisation d’intrants intermédiaires français dans les exportations d’autres pays. Les intrants étrangers comptent pour 25 % des exportations françaises alors que moins de 20 % des exportations françaises alimentent les exportations des pays tiers (aval de la CVM).
Valeur ajoutée par secteurs dans la production des biens destinés à la consommation mondiale (France)
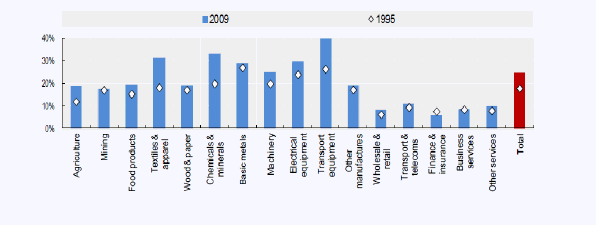
L’initiative conjointe de l'OCDE et de l'OMC sur les échanges en valeur ajoutée4 aborde cette question en s'intéressant à la valeur ajoutée par chaque pays impliqué dans la production des biens et des services destinés à la consommation mondiale. Cette orientation est utile dans la mesure où l’essor des échanges s’accompagnera vraisemblablement d’une progression de la sous-traitance internationale, ainsi que l’analyse le rapport du groupe Europe mondialisation du diagnostic stratégique France 2025 du Conseil d’analyse stratégique : « le développement de réseaux mondiaux de production aujourd’hui plus marqué pour les secteurs de moyenne et haute technologie ( aéronautique, TIC, pharmacie), plus internalisés, devrait concerner tous les secteurs manufacturiers… L’externalisation ne concernera plus seulement des secteurs d’activité, mais aussi des tâches et des métiers le long d’une chaîne de valeurs modularisée ».
Cette approche par les valeurs ajoutées comporte toutefois des limites dans la mesure où elle ne prend pas en compte les paramètres qualitatifs tels que l’intensité en emplois des échanges, l’empreinte environnementale ou le degré d’élaboration des normes sociales.
Cette transformation des échanges commerciaux est majeure et a une conséquence sur les stratégies commerciales ainsi que le note M. Pascal Lamy, ancien directeur général de l’OMC : « le mode de fonctionnement des chaînes de production – fondé sur le fait que la moitié de nos exportations dépendent de nos importations – retire à peu près toute pertinence au vieux concept mercantiliste en vertu duquel les exportations sont un élément positif et les importations, un élément négatif. De fait, ce sont les pays qui exportent le plus qui importent le plus et ce sont ceux qui importent le plus qui tirent de leur participation au commerce international la plus grosse partie de la croissance de leur économie »5. Ainsi, il est difficile d’envisager une augmentation du coût des importations par la voie d’une augmentation des droits de douane qui se répercuteraient de facto sur le prix des exportations. Deux tiers des importations européennes sont en effet des matières premières et des composants nécessaires au processus de production européen.
Ce processus de fragmentation de la production doit aussi être pris en compte dans la définition des stratégies économiques.
En découlent en effet, pour les pays développés, plusieurs questions cruciales :
– quelles industries devons-nous garder ?
– quelles industries devons-nous faire émerger ?
– quelle part des chaînes de valeur de la production globale devons-nous conserver et/ou conquérir6 ?
Pour les pays du Sud, une meilleure insertion dans les chaînes de valeur est au cœur de leur décollage et de leur développement. S’agissant des pays émergents, ils ont d’abord été appelés à servir d’ateliers pour la fabrication de biens à basse technologie (textiles) ou pour l’assemblage de biens à moyenne et haute technologie (électronique) destinés à la réexportation. Mais, désormais, ils ont acquis des savoirs, des savoir-faire et les technologies, de sorte qu’ils ont remonté les filières et diversifié leur offre. La Chine ou l’Inde sont toujours cités, mais d’autres exemples pourraient l’être, comme le Costa Rica qui a commencé par l’assemblage de moyenne gamme et la maintenance en aéronautique et qui aujourd’hui fabrique des équipements, ce processus s’étant appuyé sur une active politique de l’éducation. Pour les pays en développement, on assiste à un mouvement de délocalisations des activités peu qualifiées, en Afrique notamment, au fur et à mesure que les coûts salariaux augmentent dans les pays émergents.
La notion traditionnelle de commerce est dépassée : celle-ci mesure ce qui s’échange entre les frontières alors que les échanges se font de plus en plus au sein d’une même organisation multinationale.
Dans les phases plus anciennes d’expansion du commerce mondial, les sociétés commerciales restaient dans la dépendance d’un État (compagnie des Indes, banques, compagnies pétrolières ou de chemin de fer). Aujourd’hui, ce n’est plus le cas. Tous les discours qui établissaient un lien entre les points forts d’une nation et ses avantages comparatifs doivent être relativisés. Car en réalisant des investissements directs à l’étranger et en transférant des savoir-faire et savoirs, les multinationales bouleversent cette relation.
Multinationales, les sociétés s’émancipent donc des tutelles étatiques. Elles sont le vecteur de la mondialisation, c’est à dire d’un processus d’imbrication croissante des différentes économies nationales. Des secteurs industriels comme le textile, l’automobile, l’électronique, l’informatique ou la pharmacie sont mondialisés.
Trois déterminants sont généralement mis en avant pour expliquer la multinationalisation des entreprises :
● La demande est une des motivations de l’investissement à l’étranger. En effet, l’implantation à l’étranger permet de se rapprocher des consommateurs étrangers, et dans le cas où d’importantes barrières protectionnistes subsisteraient, de les contourner. Dans le développement de la Chine, les sociétés partagées ou «joint-ventures » ont joué un rôle déterminant. S’il y a eu la mondialisation, c’est qu’il y a eu des mondialisateurs. Les gains de part de marché de la Chine sont largement le fait des entreprises à capitaux étrangers. « La puissance chinoise, c’est d’abord la puissance des entreprises européennes, japonaises et américaines en Chine », comme l’illustre le graphique ci-dessous.
Les exportations chinoises en pourcentage des exportations mondiales
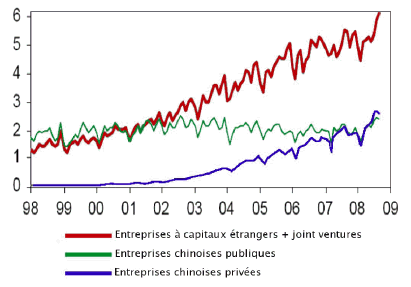
Source : Natixis, janvier 2009.
● L’entreprise peut chercher à améliorer la compétitivité de l’offre. Parmi les objectifs recherchés, il peut y avoir la volonté de produire au moindre coût, d’accéder à une technologie, d’obtenir une plus grande sécurité dans les approvisionnements, de contourner des législations environnementales contraignantes. Le dernier objectif cité s’explique par le fait que depuis trois ou quatre décennies, les pays industrialisés ont adopté des réglementations environnementales qui pèsent sur les coûts de production de leurs entreprises. Certaines entreprises procèdent, de ce fait à des délocalisations de leurs activités les plus polluantes. C’est dans ce contexte que la notion de dumping environnemental a été élaborée notamment par les économistes Baumol et Oates. Ils ont modélisé les conséquences de la libéralisation des échanges entre pays appliquant des normes environnementales différentes. L’application de normes environnementales plus strictes dans les pays développés transformerait les pays en développement en lieux d’accueil des industries polluantes qui deviendraient des « havres de pollution ». Si aucune étude générale n’a été réalisée pour en prendre la mesure, il est clair que des phénomènes de délocalisations d’industries particulièrement polluantes se sont produits. Deux secteurs sont emblématiques : la tannerie et l’exploitation minière. La tannerie qui est source de rejets très polluants pour l’environnement est aujourd’hui largement délocalisée dans les pays du Sud. Quant à l’exploitation minière, il est incontestable que les différences considérables de législation environnementale ont joué un rôle dans les décisions des entreprises.
● L’entreprise peut chercher une meilleure position concurrentielle. Autrement dit, elle peut espérer gagner un temps d’avance sur ses concurrentes en s’implantant la première à l’étranger dans un marché oligopolistique, tout en décourageant les entreprises locales. Et ce, en raison des lourds investissements à réaliser pour lutter à armes égales.
Aujourd’hui, les entreprises multinationales sont à l’origine de près des deux tiers du commerce mondial.
Par leur action, elles modifient la nature de ce commerce. D’abord, par la mise en place d’une division internationale du processus productif, mais aussi en commerçant au sein de leur groupe, soit entre filiales ou entre les filiales et la société mère sur la base d’un prix de transfert. C’est à dire d’un prix qui diffère d’un prix de marché fixé par la confrontation de l’offre et de la demande. Bien souvent, cet échange « hors marché » est réalisé dans un objectif d’optimisation fiscale afin que les profits les plus importants soient situés dans les pays où l’imposition est moindre.
Part des échanges intragroupes dans les échanges totaux des États-Unis, du Japon et de la France (en %)
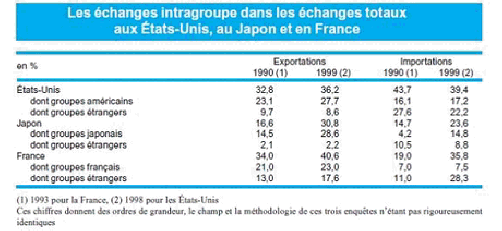
Source : rapport sur le commerce mondial, OMC, 2008.
La question du juste échange devra donc prendre en compte les stratégies d’investissement des sociétés multinationales.
Les conditions de l’échange peuvent être considérées comme injustes quand la répartition des bénéfices résultant du développement considérable des échanges internationaux est déséquilibrée. La croissance de la production et la redistribution ont permis à des centaines de millions de personnes de sortir de la pauvreté, même si l’on peut constater une augmentation des inégalités au sein des États et si des pays en développement sont restés en retrait du développement des échanges. Les pays développés ont quant à eux été impactés par la mondialisation mais certains États ont cependant mieux résisté à la désindustrialisation.
1. Pour les économies développées : un enrichissement global mais une désindustrialisation subie et une menace sur le modèle social
Le choix d’un modèle économique fondé sur l’insertion dans le commerce international a largement réussi aux économies développées, qu’il s’agisse de celles de l’Amérique du Nord, de l’Europe ou des économies asiatiques les plus avancées. Les Trente glorieuses ont été pour l’Europe occidentale une période de croissance sans précédent et, même après les chocs pétroliers, le revenu par habitant a continué à s’accroître. Dans l’autre sens, les modèles économiques dits autocentrés, qu’ils aient été appliqués à des économies industrielles dans le bloc soviétique ou dans certains pays du Sud après leur indépendance, ont le plus souvent échoué. Mais ces constats d’évidence ne peuvent masquer les coûts humains et sociaux de la mondialisation.
L’Europe a maintenu ses parts de marché sur les biens manufacturés. Hors énergie, l’excédent commercial de l’Union européenne sur les biens manufacturés est ainsi passé de 260 milliards d’euros en 2011 à 365 milliards en 2012. De janvier à novembre 2013, cet excédent a atteint 354 milliards d’euros (contre 322 de janvier à novembre 2012). L’industrie européenne regroupe encore 2,3 millions d’entreprises, emploie 37 millions de salariés et produit plus de 1 900 milliards d’euros de valeur ajoutée par an. Elle a mieux résisté que d’autres régions ou pays à l’émergence de nouvelles puissances dans le commerce international. Mais cela repose principalement sur un pays, l’Allemagne, et sur quelques secteurs que sont notamment la pharmacie, la chimie ou encore l’automobile.
Maintien des parts de marché en Europe ne signifie pas obligatoirement maintien de l’emploi. Tous les économistes y compris M. Paul Krugman qui a longtemps considéré que la mondialisation n’était pas coupable7, reconnaissent le rôle de la globalisation commerciale dans l’aggravation des inégalités et les pertes d’emplois. Mais cette désindustrialisation a frappé de façon inégale, selon les pays et selon les secteurs. Ainsi, la France est devenue le pays le moins industrialisé des grands pays de la zone euro (après l’Allemagne, l’Espagne et l’Italie) ; entre 1980 et 2011, les emplois industriels sont passés de 24 à 13 % de l’ensemble des emplois.
La désindustrialisation, c’est-à-dire la baisse de la part de l’industrie dans la valeur ajoutée, n’est d’ailleurs pas seulement l’apanage des pays développés. Des pays comme le Brésil connaissent une désindustrialisation précoce. Une étude de 2012 montre que, si les économies d’Amérique latine ont su tirer bénéfice des exportations des matières premières, elles ont néanmoins négligé le développement d’une industrie de pointe, contrairement aux émergents d’Asie. On assiste donc à une « reprimarisation » relative de l’économie et à une « désindustrialisation précoce ». Selon l’auteur de cette étude, la désindustrialisation proviendrait d’un manque de compétitivité dont souffrent les pays d’Amérique latine, ainsi que de l’incapacité des États à maîtriser l’appréciation du taux de change8.
Selon une étude de la direction générale du Trésor9, sur la période 1980-2007, l'industrie française est passée de 5,3 à 3,4 millions d'emplois, soit une baisse de 36 %. La part de l'industrie dans l'emploi total a reculé de 11 points (passant de 24 % à 13 %) alors que parallèlement celle des services marchands a augmenté de 12 points (passant de 32 % à 44 % de la population active).
Cette étude explique qu’une partie de la baisse de l’emploi industriel s'explique par un recours croissant à l'externalisation d'activités productives du secteur industriel vers le secteur des services. Cette baisse de l'emploi industriel reflète ainsi un transfert d'emplois vers les services, sans véritable changement de leur contenu. Ces transferts d'emplois sont estimés à 25 % des pertes d'emplois industriels sur la période 1980-2007.
Une autre partie des pertes d'emplois s'explique par la déformation de la structure de la demande au cours du temps et aux gains de productivité dans l'économie :
– en premier lieu, les gains de productivité réalisés dans l'ensemble de l'économie entraînent une hausse du revenu des agents, qui se traduit, dans les pays développés, par une modification de la structure des dépenses des ménages au profit des services et au détriment des biens industriels ;
– en second lieu, les gains de productivité enregistrés dans l'industrie conduisent à réduire les besoins de main-d'œuvre dans ce secteur. Ces gains de productivité induisent certes, en contrepartie, une baisse des prix des biens industriels et, par suite, une hausse de leur demande, mais cet effet ne compense que partiellement l'effet premier de réduction de main-d'œuvre en raison d'une substituabilité limitée entre ces produits et les autres biens de l'économie. Cet effet contribuerait à près de 30 % des pertes d'emplois.
Enfin, l'impact de la concurrence étrangère a contribué à la baisse de l'emploi industriel en France et expliquerait, au minimum, 13 % des pertes d’emplois sur la période 1980-2007 et 28 % sur la période 2000-2007.
Ainsi, si les entreprises françaises sont confrontées à la concurrence étrangère, force est de constater que la baisse des emplois industriels n’est pas seulement due à la mondialisation.
Pour M. François Bourguignon, « le problème n’est pas tant celui de la délocalisation que celui de la fermeture d’unités devenues non concurrentielles, suivie de la délocalisation à l’étranger de nouvelles capacités de production. Sur 700 000 emplois détruits par an dans l’industrie manufacturière française entre 1980 et 2007, moins de 10 % pourrait résulter de telles opérations de délocalisations directes vers les pays émergents, tandis que plus de 30 % pourraient être attribués à la concurrence internationale en général (abandon d’activités sans relocalisation, création de nouvelles activités à l’étranger), 30 % aux gains de productivité et à la baisse de la demande intérieure, et 30 % à la sous-traitance de certaines tâches vers les services » .
Selon une étude de l’INSEE10, entre 2009 et 2011, 4,2 % des sociétés marchandes non financières de 50 salariés ou plus implantées en France ont délocalisé des activités. Les secteurs les plus concernés sont l’industrie manufacturière et les services de l’information et de la communication. Les sociétés qui délocalisent sont le plus souvent exportatrices ou déjà présentes à l’étranger par le biais de filiales. Elles appartiennent souvent à un groupe et délocalisent en majorité au sein de ce dernier.
Proportion de sociétés de 50 salariés ou plus ayant délocalisé des activités entre 2009 et 2011, en France
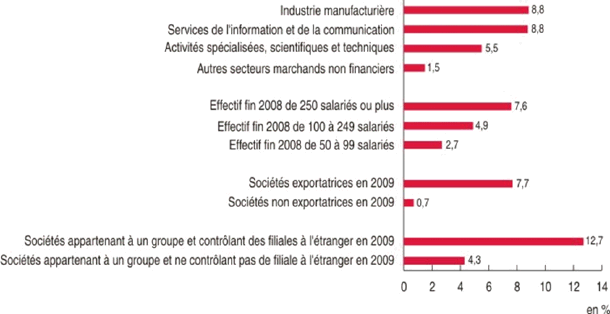
Lecture : 7,7 % des sociétés marchandes non financières de 50 salariés ou plus et exportatrices en 2009 ont délocalisé, totalement ou partiellement, au moins une activité.
Champ : sociétés marchandes non financières de 50 salariés ou plus (fin 2008) implantées en France.
Source : Insee
Il est important de noter que la même étude montre que sur cette période, le nombre des suppressions directes de postes en France dues à des délocalisations est estimé à 20 000. Or, la majorité les délocalisations s’est faite au sein de l’Union européenne : 38 % vers l’Union européenne des quinze (UE15) et 22 % vers les nouveaux États membres. Quant aux délocalisations vers la Chine (18%) ou l’Inde (18%), moins importantes, elles sont motivées par une réduction des coûts, mais pas seulement salariaux, ainsi que la recherche de nouveaux marchés.
La théorie des avantages comparatifs à la base du libre-échange explique le processus de mondialisation comme « un état du monde où les acteurs économiques conçoivent leur stratégie du point de vue mondial et non plus seulement du point de vue national ou régional. Cela concerne donc non seulement l’approvisionnement en biens et services, mais aussi les créations d’unité de production ou leur relocalisation, les stratégies financières, les politiques économiques »11.
Reposant sur le postulat de capitaux fixes, la théorie classique des avantages comparatifs est revisitée. En effet, la mondialisation est aussi celle des capitaux. Aussi, dès lors que ceux-ci sont mobiles, les normes sociales, environnementales et fiscales jouent un rôle décisif dans les décisions d’implantation des entreprises.
De ce fait, la mondialisation a donné un avantage comparatif aux pays ayant une main d’œuvre bon marché, et une fiscalité attractive et à ceux ayant une réglementation moins rigoureuse en matière environnementale. Elle provoque donc des ajustements difficiles dans les pays développés, en particulier pour les entreprises qui ne sont pas restées à la pointe de la technologie et de l’innovation ou qui n’ont pas développé une spécialisation faisant que les biens qu’elles produisent ne sont pas substituables. Mais également pour les salariés, notamment les moins qualifiés.
Le fait que les entreprises s’installent dans des pays où elles jugent les conditions plus favorables a bouleversé l’équilibre entre le rôle de l’État et des marchés : la régulation assurée par les politiques publiques est en partie remise en cause.
C’est pourquoi la mondialisation est perçue comme une menace. En effet, elle a aggravé les inégalités devant l’emploi, remettant en cause le modèle social et en particulier le modèle de répartition secondaire des richesses au sein de l’État nation (par les prestations sociales, les salaires minimum ou l’âge de la retraite).
Certains pays ont fait très tôt le choix de sacrifier le modèle social. Dans les années 2000, l’Allemagne a paru s’engager dans cette voie, avant que l’accord passé entre le SPD et la CDU le 27 novembre 2013 ne prévoie l’instauration d’un salaire minimum national.
Une des raisons des inquiétudes est l’incertitude sur la pérennité du modèle social européen. Il convient de rappeler que l’Europe pèse pour 25 % de la richesse mondiale avec 8 % de la population mondiale et réalise près de 50 % des dépenses sociales mondiales.
L’impact ressenti ou réel de la mondialisation sur l’emploi et sur le modèle social est le catalyseur des craintes des populations face à l’insécurité économique.
a. Une diminution des inégalités sur le plan international mais une augmentation des inégalités internes.
L’un des objectifs de l’Organisation mondiale du commerce est de faire en sorte que le système commercial international bénéficie à tous, y compris aux pays les plus pauvres, en contribuant à leur développement. Force est de constater que cet objectif n’est que partiellement atteint.
Les pays en développement qui ont réussi à s’intégrer dans le commerce international ont connu une réduction de la pauvreté grâce à l’incorporation de millions de travailleurs dans les échanges internationaux. Ils ont également acquis des techniques parmi les plus avancées qui leur permettent d’entrer en concurrence avec les entreprises de pays développés, même sur des marchés à haute valeur ajoutée (aéronautique, informatique, pharmacie). Les inégalités internationales pondérées par la population se sont ainsi réduites, pour l’essentiel du fait de l’émergence et du rattrapage rapide de l’économie chinoise (1,35 milliard d’habitants en 2012) et, dix ans plus tard, de l’économie indienne (1,24 milliard d’habitants en 2012).
Dans un rapport sur la mondialisation, le Bureau international du travail faisait l’analyse suivante : « Comme le soulignait déjà le rapport de la Commission mondiale sur la dimension sociale de la mondialisation, il est en effet incontestable que la mondialisation n’est pas un phénomène de génération spontanée. Il s’agit bel et bien d’un phénomène qui s’inscrit dans le cadre de certaines règles et institutions, parmi lesquelles les disciplines du commerce multilatéral. Or, il est également incontestable que ces règles et ce régime ont entraîné une redistribution des richesses entre les grandes puissances industrielles et un certain nombre de pays émergents ou émergés qui est sans doute plus tangible que toutes les revendications et les efforts déployés au nom du droit au développement (y compris les deux décennies dites du développement patronnées par les Nations Unies) »12.
Cependant, le rapport du PNUD sur le développement humain publié en 2013 fait observer que les pays les plus pauvres n’ont pas vraiment entamé leur processus de rattrapage. Par ailleurs, la diminution des inégalités entre pays va de pair avec un accroissement des inégalités internes. Comme l’analyse M. François Bourguignon : « le développement plus rapide des pays émergents et, dans une moindre mesure, des pays en développement contribue à diminuer l’inégalité des niveaux de vie entre habitants de la planète. Mais la hausse des inégalités dans les territoires nationaux tend au contraire à l’augmenter »13. L’évolution des inégalités internes est plus contrastée dans les pays pauvres et émergents. En Chine et en Inde, les inégalités ont augmenté rapidement, à mesure que la croissance s’accélérait. Par exemple, en Chine, elles ont une dimension sociale mais aussi régionale puisque l'industrialisation du pays a d'abord eu lieu dans les provinces côtières. Parmi des pays émergents plus inégalitaires à l’origine, certains comme le Brésil, ont mis en place des politiques volontaristes de lutte contre la pauvreté, ce qui a permis une diminution des inégalités de revenus. Le coefficient de Gini14 du Brésil (0,54 en 2009 selon la Banque mondiale) comme celui du Mexique (0,47 en 2010 selon la Banque mondiale) restent cependant très élevés. De manière générale, on peut constater que les inégalités de revenus dans les pays pauvres et émergents sont particulièrement élevées en Amérique latine et en Afrique subsaharienne. Elles le sont moins en Asie15.
Si l’ouverture aux échanges a été positive pour certains pays, pour d’autres et malgré le principe d’une discrimination positive en faveur des pays en développement dans l’application des règles commerciales multilatérales, le commerce n’a que fort peu contribué à leur développement.
Ainsi, les 49 pays les moins avancés (PMA) réalisent à peine plus de 1 % du commerce mondial. Cette faible participation au commerce international s’illustre très symboliquement par le fait qu’aucune saisine de l’Organe de règlement des différends de l’OMC n’a été le fait de l’un de ces PMA, faute d’expertise juridique, d’avocats et d’équipes techniques.
S’agissant des gains attendus du cycle de Doha et de l’ouverture aux échanges, les études, même les plus prometteuses qui escomptaient un gain global de 500 milliards de dollars pour l’économie mondiale16, mettent l’accent sur le fait que la répartition de ces gains serait de facto inégale. Dans la réalité, selon une étude de la Banque mondiale17, les bénéfices globaux du cycle se seraient élevés au maximum à 96 milliards de dollars en 2015, dont 16 milliards au bénéfice des pays en développement. Parmi les pays en développement, la moitié des bénéfices était supposée profiter à huit pays : Argentine, Brésil (environ 23 % des bénéfices du cycle), la Chine, l’Inde, le Mexique, la Thaïlande, la Turquie et le Vietnam.
Dans la première décennie du XXIème siècle, la plupart des PMA ont augmenté leurs exportations en volume (en moyenne de 7 à 8 %) mais beaucoup moins en valeur. Le taux de couverture des exportations par les importations a considérablement diminué (de 7 à 8 points sur la décennie). Ces pays sont en conséquence très sensibles au ralentissement de l’économie mondiale, eu égard à leur dépendance aux produits de base et la concentration des exportations. Leurs importations de denrées alimentaires se sont accrues, augmentant ainsi leur dépendance et leur vulnérabilité.
Il s’ensuit que le modèle de croissance tiré par les exportations qui a largement sous tendu la plupart des stratégies de développement des PMA est un échec partiel. Il ne s’est globalement traduit ni par une amélioration des balances commerciales, ni par une forte hausse de l’investissement et de la formation de capital.
Les dispositifs de préférences tarifaires (comme le régime « Tout sauf les armes » européen ou l’ « African Growth and Opportunity Act »-AGOA) qui facilite l’accès de certains pays africains au marché américain), sont sous-utilisées en raison des problèmes de compétitivité des économies, de la complexité et de la rigueur des règles d’origine. S’ajoutent des contraintes liées aux normes notamment privées (très présentes dans les domaines sanitaire et phytosanitaire, ce qui pose la question de la validité de normes édictées par des entités non-gouvernementales), et aux standards et barrières non tarifaires des pays développés qui sont vécus comme autant de mesures protectionnistes par les pays en développement. Si la part de traitement préférentiel en franchise de droits pour les importations en provenance des PMA est passée de 35 % environ à la fin des années 1990 à 50 % en 2010, dans les faits, ces traitements différentiels n’ont fait que compenser les coûts logistiques et de transaction plus élevés auxquels les exportateurs sont confrontés. De plus, les abaissements de droits de douane décidés de façon générale dans le cadre de l’OMC ou des accords bilatéraux de libre-échange ont contribué à l’érosion des préférences (du fait de l’application de la clause de la nation la plus favorisée). Les parts de marché que les PMA ont gagnées, notamment dans les pays émergents, sont essentiellement le fait des exportations de combustibles et autres minéraux alors qu’ils ont perdu des parts sur les produits industriels transformés.
La revendication d’un juste échange pour ces pays ne peut passer sous silence l’exploitation des ressources naturelles et du secteur primaire par les pays occidentaux dans les périodes coloniales et néocoloniales, qui n’ont pas profité aux populations locales. Les cultures vivrières locales ont été réorientées vers des productions exportatrices comme le café, les bananes, l’hévéa ou le coton. Les retombées économiques, sociales et financières des industries extractives n’ont pas été mises au service des besoins de développement. L’exploitation d’hydrocarbures tend à fragiliser le tissu économique, la cohésion sociale et les institutions politiques des pays producteurs. De plus, la réduction des normes environnementales a été utilisée par les gouvernements afin d’attirer les entreprises internationales18. L’exploitation des richesses du sous-sol est souvent associée à la misère des populations locales, à la mauvaise gouvernance et à la dégradation de l’environnement, si bien que l’on a pu parler de la « malédiction des ressources naturelles »19.
En conséquence, la situation des pays en développement et leur faible degré d’intégration dans le commerce international conduit à s’interroger sur le bien-fondé de l’approche en termes de chaînes de valeur mondiale pour leur développement. Ceux-ci ne peuvent tirer parti des possibilités d’accès au marché s’ils n’ont pas la capacité de produire et d’exporter. A cet égard, la Déclaration ministérielle de Hong Kong en décembre 2005 insistait sur l’importance de l’aide au commerce. De la même manière, il est à noter qu’un rapport commun de l’OCDE, de l’OMC et de la CNUCED, publié à l’occasion de la tenue du G20 à Saint Petersburg en septembre 201320, rappelle qu’il reste à éliminer des obstacles spécifiques à la participation effective des pays en développement aux chaînes de valeur mondiales.
Le concept d’émergence appliqué à un groupe de pays apparait dès 1981 et caractérise des pays où les investissements sont rentables en raison d’une croissance rapide. En 2001, un rapport de la banque d’investissement Goldman Sachs21 utilise pour la première fois l’acronyme « BRIC » pour décrire les nouvelles puissances émergentes que sont le Brésil, la Russie, l’Inde et la Chine. Dans une étude de 200322, la banque annonçait que ces quatre pays qui ne rassemblaient que 15 % du PIB des pays du G6 (États-Unis, Allemagne, Japon, France, Royaume-Uni et Italie) dépasseraient en 2050 le PIB total des six pays réunis. En avril 2011, le terme devient BRICS, après l’ajout de l’Afrique du Sud.
Taux de croissance du PIB des BRICS (en % par an) (2008-2012)
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 | |
Brésil |
5,2 |
-0,3 |
7,5 |
2,7 |
0,9 |
Chine |
9,6 |
9,2 |
10,4 |
9,3 |
7,8 |
Inde |
3,9 |
8,5 |
10,5 |
6,3 |
3,2 |
Russie |
5,2 |
-7,8 |
4,5 |
4,3 |
3,4 |
Afrique du Sud |
3,6 |
-1,5 |
3,1 |
3,5 |
2,5 |
Source : secrétariat de l’OMC.
Si les BRICS figurent parmi les émergents les mieux identifiés, d’autres catégories ont été établies par la suite. Ainsi, le terme de CIVETS désigne la Colombie, l’Indonésie, le Vietnam, l’Égypte, la Turquie et l’Afrique du Sud, pays dont le taux de croissance annuel moyen est évalué à 5 % pour les vingt prochaines années.
Taux de croissance du PIB des CIVETS (en % par an) (2008-2012)
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 | |
Colombie |
3,5 |
1,7 |
4,0 |
6,6 |
4,0 |
Égypte |
7,2 |
4,7 |
5,1 |
1,8 |
2,2 |
Indonésie |
6,0 |
4,6 |
6,2 |
6,5 |
6,2 |
Turquie |
0,7 |
-4,8 |
9,2 |
8,8 |
2,2 |
Viet Nam |
6,3 |
5,3 |
6,8 |
6,0 |
5,0 |
Afrique du Sud |
3,6 |
-1,5 |
3,1 |
3,5 |
2,5 |
Source : secrétariat de l’OMC.
Les BENIVM regroupent le Bangladesh, l’Éthiopie, le Nigeria, l’Indonésie, le Vietnam et le Mexique. Selon l’économiste Laurence Daziano, « le Vietnam, le Nigeria, le Mexique et l’Indonésie […] présentent une croissance économique soutenue, une industrie manufacturière dynamique et des perspectives de développement très significatives ». Elle ajoute à ces quatre pays, régulièrement cités comme pays émergents, le Bangladesh et l’Éthiopie qui ont « une forte croissance démographique accompagnée d’une urbanisation accélérée, un potentiel de croissance élevé et des économies déjà diversifiées et industrielles. Ces deux pays ont également un potentiel énergétique important, notamment avec l’hydroélectricité ». 23
Toutefois, ces pays ne présentent pas une unité. Il n’est qu’à se reporter au classement réalisé par la Banque mondiale sur les différents niveaux de revenus. En 2012, le PIB par habitant était de 6 090 dollars en Chine, de 3 557 dollars en Indonésie, de 1 755 dollars au Vietnam, de 1 555 dollars au Nigeria, de 752 dollars au Bangladesh et de 454 dollars en Éthiopie.
Une typologie peut aussi être établie en fonction de leur intégration à la mondialisation. Il faut ainsi distinguer les émergents les plus puissants, qui concurrencent les pays du Nord : la Chine, le Brésil et l’Inde. Mais au sein de ces trois pays, des problématiques spécifiques existent : la Chine connaît un ralentissement des gains de productivité tandis que le Brésil et l’Inde sont confrontés à des déficits en infrastructures et de main d’œuvre qualifiée. Certains pays pétroliers comme le Nigeria connaissent une forte expansion mais accompagnée de fortes inégalités sociales. Des pays comme l’Indonésie, le Vietnam ou le Mexique font figure de nouveaux pays industrialisés. D’autres présentent des situations très variées, avec une intégration incomplète à la mondialisation, avec de grandes disparités sociales et une grande dépendance vis-à-vis de l’extérieur. C’est le cas de nombreux pays africains.
L’Afrique, un continent d’avenir
Entre 2000 et 2012, le taux de croissance moyen de l’Afrique a été de 5,1 %, malgré la crise qui avait fait chuter ce taux à 2,5 % en 2009. Selon le rapport de la mission présidée par M. Hubert Védrine remis le 4 décembre 2013 à l’occasion du Forum pour un nouveau modèle de partenariat économique entre la France et l’Afrique, le PIB du continent africain devrait connaître une croissance de 5,6 % en 2013 et de 6,1 % en 2014. Les pays africains dont la croissance a été la plus forte en 2013 sont répartis sur l’ensemble du continent : Mozambique (8,4 %), Côte d’Ivoire (8 %), Libéria (8 %), Rwanda (7,6 %), Ghana (6,9 %), Éthiopie (6,5 %), Niger (6,2 %), Angola (6,2 %). L’Afrique est encore dépendante des exportations en matières premières mais si le secteur pétrolier a connu une croissance de 7 % au cours de la décennie passée, le tourisme, la construction, les transports et les télécommunications ont connu des taux de progression similaires.
Les secteurs tels que les télécommunications et la distribution comptent parmi les secteurs à plus forte croissance. Entre 1960 et 2007, la part de l’industrie dans le PIB est passée de 17 à 32 %24.
Pour autant, l’Afrique souffre d’un déficit d’insertion dans le commerce mondial Alors que sa population active devrait passer de 560 millions en 2030 à 900 millions en 2050, ce qui lui donnera une place fondamentale dans l’activité mondiale, un processus de rééquilibrage des implantations industrielles sur ce continent est une condition du juste échange. Celui-ci dépendra de mesures internes autant que de la mise en place de stratégies coopératives extérieures dont l’Union européenne peut être le pivot. Cette localisation des industries en Afrique se fera aussi en fonction du changement de la compétitivité –coût du travail lié à l’augmentation des salaires en Chine. Ainsi, un rapport du Sénat préconise de « structurer une démarche internationale par géographies et par secteurs qui correspondent aux besoins des marchés africains, renforcer nos moyens de soutien aux entreprises dans les pays les plus dynamiques tels que l’Afrique du Sud, le Nigéria, la Côte d’Ivoire, et le Kenya, mais également l’Éthiopie, le Ghana, le Botswana, la Tanzanie ou le Mozambique25 ».
L’évolution dans la production industrielle se traduit dans le partage du marché mondial. Après avoir été l’apanage des pays développés, les courants commerciaux se concentrent dans les zones en expansion, Asie-Pacifique en tête. Cette zone représentait, fin 2011, près de 32 % du commerce mondial contre 25 % en 2001. La part des pays émergents dans les exportations mondiales est passée de 31 % au début des années 1990 à 36 % au début des années 2000, pour atteindre le seuil symbolique de 50 % en mars 2011 (voir tableau infra).
Très significativement, il y a vingt ans, 60 % des échanges s’effectuaient entre les pays du Nord, alors que 30 % étaient orientés Nord-Sud et 10 % étaient réalisés entre les pays du Sud. Aujourd’hui, les proportions sont d’un tiers dans chaque sens. Nous sommes entrés dans une nouvelle phase de la mondialisation.
Alors que la première phase était marquée par la production par les pays émergents à destination des pays développés, un rééquilibrage s’opère au profit des pays émergents, au sein desquels les consommateurs sont de plus en plus nombreux. La production se fait aussi pour ces consommateurs et on a pu parler d’une phase de mondialisation de la classe moyenne des pays émergents. En effet, le dernier rapport du PNUD sur le développement humain 2013 note que « dans les pays du Sud, la classe moyenne connaît un essor rapide en termes de revenus et de perspectives »26. Ce rapport estime que ce phénomène de rattrapage va se poursuivre. Cependant, en tenant compte d’une décélération progressive à long terme, il faudra une trentaine d’années pour que le revenu par habitant en Chine atteigne le niveau observé aujourd’hui dans les pays les moins riches de l’OCDE. Le dernier rapport de l’Organisation internationale du travail sur les salaires en 2012-2013 montre que les différentiels de salaires s’estompent même s’il s’agit d’un mouvement très progressif. Ainsi les hausses de salaires en Chine sont à l’origine de mouvement de délocalisations vers des pays à moindre coût salarial comme le Vietnam ou le Bangladesh ou certains pays africains.
Si les économies développées comptent pour encore la moitié des exportations mondiales de marchandises, leurs exportations ont baissé de 3 % en 2012 alors que celles pays en développement ont augmenté de 4 %. C’est chez les BRICS que cette croissance a été la plus forte, à hauteur de 4,5 %.
Sur les cinq dernières années, les BRICS ont, en effet, connu des taux de croissance élevés, la Chine et l’Inde étant les pays qui connaissent les taux les plus élevés (respectivement un taux de croissance moyen de croissance du PIB de 9,3 % et 6,5 %). De ce fait, ces pays attirent les capitaux étrangers. Ainsi, en 2013, la Chine est le deuxième pays d’accueil des investissements directs à l’étranger (IDE), avec 127 milliards de dollars, devant la Russie, troisième pays d’accueil avec 94 milliards de dollars, le Brésil est le septième avec 63 milliards de dollars et l’Inde la seizième. Ces IDE participent à l’industrialisation de ces pays, couplés aux avantages comparatifs que constitue notamment une main d’œuvre à plus faible coût27.
Enfin, ces pays se caractérisent par la mise en place de dispositifs protectionnistes sous différentes formes : pics tarifaires ciblés, barrières à l’entrée des importations, réglementation contraignante pour les investissements étrangers, politiques d’accès préférentiel pour les marchés publics, mesures fiscales discriminatoires. Leur développement économique s’est appuyé sur une politique de champions nationaux dans des secteurs stratégiques clés, la baisse des charges et des tarifs administrés pour les entreprises avec des plans d’investissement dans les secteurs d’infrastructures.
La part respective des grands ensembles géoéconomiques dans le PIB mondial traduit les modifications des zones de production. Ainsi les États-Unis et l’Europe représentaient encore 60 % du PIB mondial en 2005. La montée des pays émergents a ramené ce taux à 45 % en 2012. Si l’Union européenne pèse encore pour 17 %, les perspectives pour 2030 estiment qu’elle n’en représentera plus que 12 %.
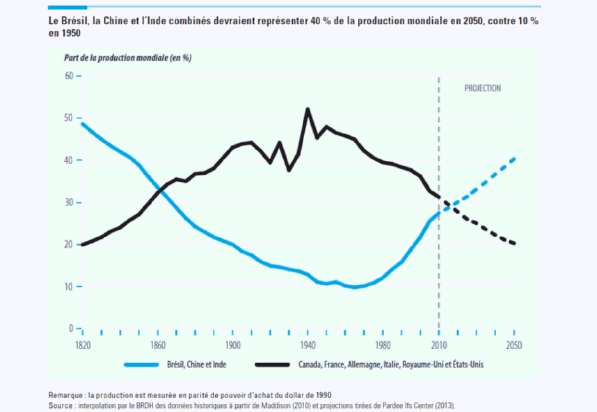
Contributions à la croissance des importations mondiales (en %)
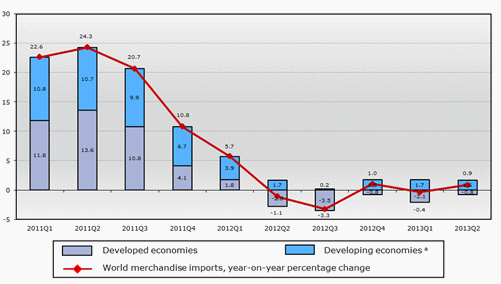
Source : Rapport de l’OMC, décembre 2013.
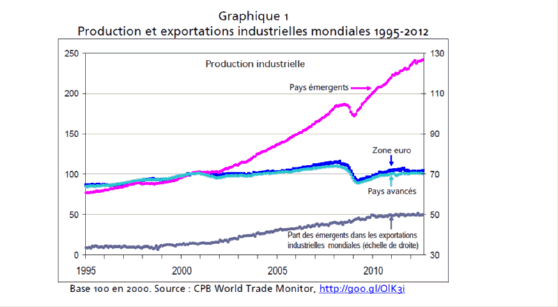
La croissance de l’économie mondiale est maintenant réalisée pour l’essentiel dans les pays émergents et non dans les pays anciennement développés. Ce changement date du début des années 2000. Entre 2000 et 2007, la production industrielle a augmenté annuellement de 8,4 % dans les pays émergents contre 1,5 % dans les pays développés. Depuis la crise de 2009, l’écart se creuse : la production industrielle augmente de 9,9 % dans les pays émergents et de 2,5 % dans les pays développés (voir tableau infra). D’ici à 2020, 90 % de la croissance économique devrait être générée en dehors de l’Europe.
Croissance de la production industrielle par zone géographique
Janvier 2000- décembre 2007 |
Janvier 2009-août 2012 | |
Pays avancés |
1,5 |
2,5 |
États-Unis |
1,3 |
2,9 |
Japon |
1,7 |
3,8 |
Zone euro |
2,1 |
2,5 |
Pays émergents |
8,4 |
9,9 |
Asie |
11,4 |
12,4 |
Europe centrale et orientale |
6,4 |
6,0 |
Amérique latine |
3,2 |
4,5 |
Afrique et Moyen-Orient |
3,1 |
2,7 |
Monde |
4,1 |
6,2 |
Source: CPB World Trade Monitor
Cette situation s’explique par des mouvements de fond : la population, donc les ressources humaines, qui sont le déterminant principal du succès économique, se situent et se situeront de plus en plus dans les pays du Sud.
Évolution de la population du monde par grandes régions
1950-2050
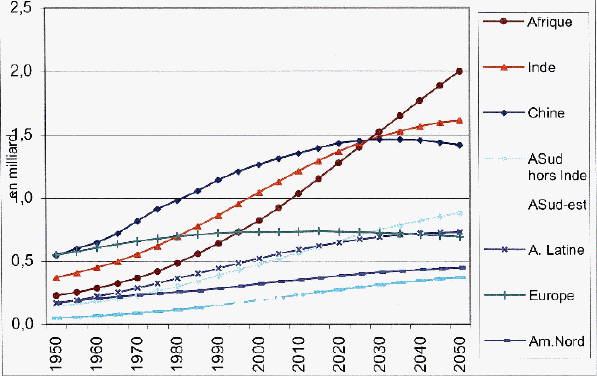
Source : Division de la population, Nations Unies, 2010.
En fait, pour être plus précis sur les liens entre démographie et décollage économique, il faut insister sur la corrélation entre l’achèvement de la « transition démographique » dans les pays concernés et l’arrivée de phases de croissance économique rapide. La transition démographique signifie en effet baisse de la mortalité, puis de la natalité. Une société où la natalité baisse après avoir été forte, c’est pendant quelques décennies une société où le pourcentage d’adultes dans la population sera maximal, car le nombre d’enfants diminue et celui de personnes âgées n’est pas encore aussi élevé que dans les « vieux pays ». C’est donc une société où le pourcentage d’actifs, de travailleurs potentiels, atteint un pic. On le voit bien sur les graphiques ci-après.
Évolution du nombre de jeunes âgés de 15 à 24 ans
(en millions) 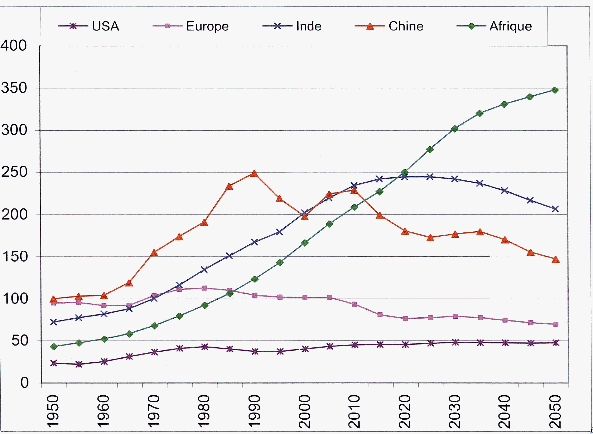
Source : Division de la population, Nations Unies, 2010.
Corrélation entre transition démographique et décollage économique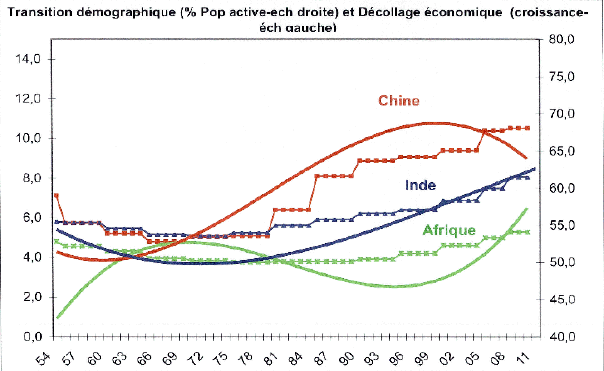
Source : Jean-Joseph Boillot, Stanislas Dembinski, Chindiafrique, janvier 2013.
Il faut aussi tenir compte de la qualification de ces ressources humaines, qui détermine très largement leur productivité et donc le PIB potentiel par habitant. Le graphique ci-dessous montre bien le phénomène progressif de double accumulation du capital physique et du capital humain qualifié, quantifié par le nombre cumulé d’années d’études.
Évolution du nombre d’années d’études moyens des plus de 15 ans (à droite) – évolution du stock de capital (à gauche) : le « double gain »
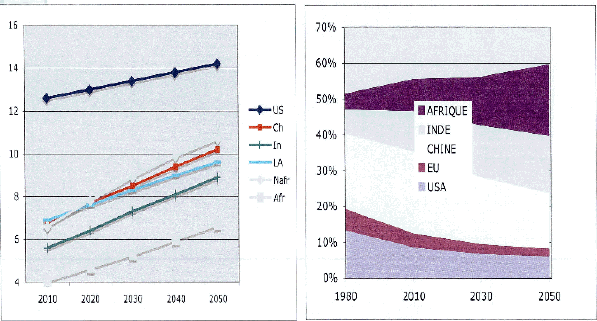
Source : Barro-Lee et Cepii 2010, projections de Jean-Jacques Boillot et Stanislas Dembinski, Chindiafrique, janvier 2013.
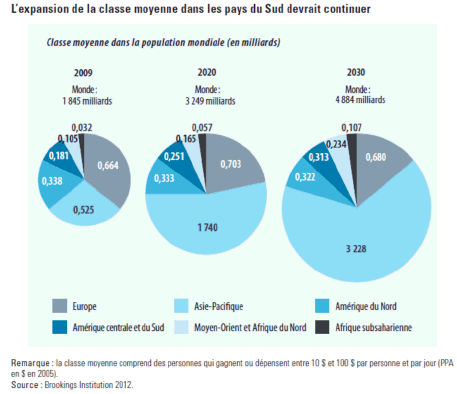
L’élévation parallèle du niveau de vie et du niveau d’étude signe l’émergence des nouvelles classes moyennes. Compte tenu de cette émergence et de la vitalité démographique de pays ou de continents comme l’Inde ou l’Afrique, qui contraste avec le vieillissement inévitable en Europe, celle-ci doit tirer parti de la hausse de la consommation intérieure de ces pays qui se traduira par une augmentation de leurs importations. Au moment où les exportations des pays développés se contractent – par exemple, la part de l’Union européenne dans les exportations mondiales d’automobiles est passée sous le seuil de 50 % en 2012 – la capacité de l’Europe à trouver des débouchés se fera dans les pays émergents en s’appuyant sur une production adaptée aux réalités locales et dont pourront bénéficier notamment ces classes moyennes.
On doit enfin relever, à propos de ces nouvelles puissances que sont les grands émergents, que même si leurs succès sont largement liés à la mondialisation, leurs politiques commerciales ne peuvent guère être qualifiées de « libre-échangistes ». Les exemples du Brésil, de l’Inde et de la Chine sont à cet égard éclairants.
Par ses dimensions et ses ressources naturelles, le Brésil est un pays émergent stratégique, 7ème PIB mondial en 2012. Si sa croissance a été de 0,9 % en 2012, le Brésil constitue un marché de 200 millions de personnes qui accèdent à la consommation, grâce à des politiques de redistribution de revenus menées depuis dix ans et qui ont fait sortir 40 millions de citoyens de la pauvreté. Sur la période 2007-2012, les importations brésiliennes ont enregistré une progression annuelle moyenne de 13,1 %. Cette progression a même atteint 42 % en 2010 et encore 24,5 % en 2011 (soit la 6ème progression mondiale). Ainsi, la part du Brésil dans le total des importations mondiales a quasiment doublé depuis 2003.
Toutefois, le Brésil est un pays encore peu ouvert. Grand exportateur, grâce à la demande mondiale adressée aux matières premières agricoles et minérales qu’il produit, ce pays a toujours privilégié un modèle de développement basé sur la protection de son économie et de son industrie domestiques. Les conditions dans lesquelles les échanges extérieurs sont réalisés sont donc déséquilibrées, le Brésil se considérant avant tout comme un pays émergent qui protège son industrie de la concurrence extérieure. Si ce pays attache une importance particulière à sa participation au système commercial multilatéral qui peut lui permettre d'atteindre ses objectifs de développement, la difficulté de mettre en place des échanges plus justes avec le Brésil est bien réelle.
● Des droits de douane élevés
Pour protéger son industrie, le Brésil applique des droits de douanes exclusivement ad valorem, avec un taux s'échelonnant entre 0 % et 55 %, selon le dernier rapport d’examen de la politique commerciale du Brésil réalisé en juin 2013 par l’organe d’examen de l’OMC. En plus des droits de douane, les importations sont soumises à un certain nombre de taxes intérieures qui varient selon le type de produit, l'administration compétente et le statut fiscal de l'importateur, d'où la complexité du système de taxation brésilien.
● Des marchés publics souvent fermés
S’agissant des marchés publics, le Brésil se distingue au titre des nombreuses mesures restrictives à l’égard des entreprises étrangères. Pays non signataire de l’Accord plurilatéral sur les marchés publics, le Brésil est exonéré de toute contrainte au regard des règles de l’OMC en la matière. Ainsi, dans le cadre de la loi de 1993 portant sur l’attribution des marchés publics, le Brésil a mis en place une clause de préférence pour les biens et services qui prévoit qu’à égalité de conditions, préférence est donnée d’abord aux biens et services produits dans le pays, puis aux produits fournis par des entreprises brésiliennes et enfin aux produits fournis par des entreprises qui investissent en recherche et développement au Brésil.
Le Brésil a traversé la crise de 2009 de manière relativement indemne (avec une contraction de son PIB de « seulement » 0,6 %). Le gouvernement s’était abstenu de mettre en place de nouvelles barrières, respectant en cela l’engagement pris par les chefs d’Etats et de gouvernements lors du sommet du G20 à Washington en novembre 2008. Toutefois, une marge de préférence de 25 % pour les entreprises nationales a été entérinée par la loi du 15 décembre 2010 qui réforme le droit des marchés publics en y introduisant des mesures destinées à favoriser le commerce intérieur des biens et services nationaux. Par ailleurs, un décret du 2 août 2011 établit une marge de préférence de 25 % dans les marchés publics pour les systèmes et biens technologiques de l’information et de la communication, étendant le champ des biens couverts par la marge de préférence nationale. Le plan « Brasil Maior », dévoilé le 3 août 2011, définit des secteurs prioritaires devant bénéficier des marges de préférence : santé, défense, textile, confection, chaussure et TIC. Les décrets de mise en œuvre font l’objet d’une publication progressive. C’est le cas de la « MP 544 », mesure provisoire adoptée le 29 septembre 2011, qui définit de nouvelles mesures de préférence nationale pour les acquisitions dans le secteur de la défense. Les entreprises non brésiliennes désireuses d’y participer doivent répondre à deux critères principaux : 60 % de capitaux nationaux et 2/3 des membres du conseil d’administration constitués de ressortissants brésiliens.
Une barrière supplémentaire à l’accès aux marchés publics au Brésil réside dans la non-reconnaissance des normes étrangères et des tests réalisés en dehors du Brésil. Le surcoût induit par la réalisation de nouveaux tests de certification au Brésil peut être prohibitif pour des PME et se traduire par une exclusion de fait des marchés publics. S’agissant des marchés d’infrastructures, au niveau des « projetos básicos » et « projetos executivos » (étape postérieure aux études préliminaires et antérieures aux appels d’offre opérationnels), le cadre reste néanmoins assez dissuasif : la procédure de validation des offres par les CREA (Conseils régionaux d’ingénierie et d’agronomie, présents dans chaque État fédéré), constitue une protection de fait réservant les marchés aux professionnels brésiliens. La rédaction des appels d’offre internationaux exclut de fait les entreprises étrangères qui souhaitent soumissionner directement, dans la mesure où sont demandés des documents, comme le CA (« Certificat d’approbation »), qui est délivré par le ministère du Travail exclusivement aux entreprises brésiliennes.
● De nombreuses autres barrières réglementaires et techniques
Le Brésil a également mis en place des barrières réglementaires et techniques :
– l’Agence nationale du pétrole, gaz naturel et biocombustibles (ANP) impose des règles de contenu local au niveau de la production et de l’exploration pétrolière, pour lesquelles doivent être utilisés 37 % d’équipements locaux ;
– le PROMEF (Programme de modernisation et d’expansion de la flotte de Transpetro – filiale transport de Petrobras), créé en 2004, impose la construction de navires pétroliers au Brésil, ce qui n’est pas sans poser problèmes, puisque le João Cândido, 1er pétrolier de construction entièrement nationale, se trouve littéralement en cale sèche en raison de problèmes structurels ayant déjà retardé de deux ans sa mise en service ;
– dans le domaine des technologies de l’information et de la communication, des mesures ponctuelles de plus en plus restrictives envisagées par les cahiers des charges rédigés par l’ANATEL, l’agence de régulation des télécoms, viennent s’ajouter à la législation générale. En juin 2012, l'ANATEL a mis aux enchères le spectre radioélectrique pour les services mobiles commerciaux en demandant aux soumissionnaires retenus qu'ils s'engagent à acheter des marchandises, du matériel, des systèmes et des réseaux de données issus de technologies nationales, et qu'ils fassent en sorte qu'après cinq ans 50 % du matériel, des systèmes de télécommunications et des réseaux soient produits localement et 20 % soient produits avec une technique conçue au Brésil. Ces diverses exigences impactent de façon différente les entreprises selon leur business model et semblent surtout avoir un effet sur les fabricants d’équipements. L’agence semble sortir de son rôle de régulateur en imposant des mesures qui s’apparentent à une politique industrielle, répondant à la volonté gouvernementale de mener une stratégie de développement national. Le ministère de la science, technologie et innovation (MCTI) joue également un rôle central car il émet les certificats de contenu local octroyés aux entreprises.
● Un interventionnisme de plus en plus assumé ces dernières années
L’arrivée au pouvoir de Mme Dilma Rousseff en janvier 2011 a marqué une inflexion dans le discours et les politiques mises en œuvre par le gouvernement brésilien. Sous couvert d’une stratégie de promotion des champions nationaux dans des secteurs variés (pétrole, chimie, défense, aéronautique, construction navale, BTP, TIC, etc.), la politique brésilienne se montre plus interventionniste.
Parmi les mesures mises en place en 2012, on peut citer :
– une hausse de 30 points de l’impôt sur les produits industrialisés (IPI) sur les véhicules importés et la mise en place d’un nouveau régime automobile. Ce régime prévoit qu’en contrepartie d’investissements en recherche et développement et dépenses d’ingénierie au Brésil, les constructeurs étrangers pourront abaisser le niveau d’IPI acquittée. Pour pouvoir en bénéficier, les constructeurs doivent justifier, dans un premier temps, de la réalisation au Brésil de 8 des 12 étapes de production définies et au minimum de 10 en fin de programme. En matière d’efficacité énergétique et d’émission de polluants, les constructeurs devront être en mesure d’étiqueter 25 % de leurs véhicules selon les normes d’émission définies par l’INMETRO (Institut national de métrologie) dès 2013, et 100 % d’ici 2017 ;
– un relèvement des droits de douane sur 100 produits importés. Le gouvernement brésilien a annoncé le 4 septembre 2012 le relèvement des droits de douane sur une liste de cent produits, dans la limite du plafond consolidé à l’OMC.
Par ailleurs, le Brésil a souvent recours à des mesures correctives commerciales, notamment des mesures antidumping. Pendant les 9 premiers mois de 2012, selon l’OMC, le Brésil a ouvert 47 nouvelles enquêtes, contre seulement 40 en 2010. L’OMC mettait en évidence 83 mesures antidumping en vigueur à la mi-2012, alors qu’elle n’en dénombrait que 63 en octobre 2008. Ainsi, le Brésil a pris un certain nombre de mesures de renforcement de la défense commerciale. Ce constat est réaffirmé par la Commission européenne, dans son « Dixième rapport sur les mesures risquant de limiter les échanges ». Elle cite le Brésil comme l’un des pays ayant adopté 20 nouvelles mesures entre mai 2012 et mai 2013, et un total de 59 mesures entre octobre 2008 et juin 2013.
Dans le cadre de la promotion d’un juste échange, les mesures protectionnistes du Brésil (barrières tarifaires et non tarifaires, mesures antidumping, certificats de contenu local…) doivent être envisagées avec la plus grande fermeté de la part de l’Union européenne.
Par sa population (1,24 milliards d’habitants en 2012) et ses perspectives démographiques, l’Inde est une puissance économique en devenir. Si son taux de croissance a atteint son plus bas niveau en 2012, à 3,8 %, en raison d’un ralentissement de la demande et d’une politique budgétaire restrictive, elle était en 2012 la 10ème économie mondiale. Alors que la Chine a axé son développement économique sur son industrie manufacturière, l’Inde a privilégié le secteur des services. Sa politique commerciale est conçue comme devant permettre de protéger les industries naissantes dans les secteurs considérés comme stratégiques et de réduire la dépendance du pays vis-à-vis des importations de produits industriels chinois.
● Par un recours actif à des dispositifs restrictifs et des outils de défense commerciale, la politique commerciale pénalise les exportateurs étrangers
Membre du GATT depuis son origine, l’Inde n’a jamais dû procéder à une révision de sa politique commerciale. Ainsi, elle utilise des barrières tarifaires. La mise en place de ces dernières se traduit notamment par une protection des produits agricoles plus forte que la moyenne (droits appliqués de 33 %). Un droit de douane de 150 % est appliqué ad valorem aux boissons alcoolisées (vins et spiritueux). Il constitue l’une des barrières les plus fortes et les plus handicapantes pour les exportateurs français. Au-delà des mesures tarifaires, les dispositifs restrictifs sont nombreux et concernent plusieurs secteurs. Ainsi, les dispositifs recensés sont les suivants :
– des délais excessifs pour l’obtention de licences d’importation dans la plupart des secteurs ;
– des normes sans rapport avec la réglementation internationale technique ;
– un système de fiscalité indirecte différent d’un État à l’autre et par conséquent peu lisible : il existe des droits d’accise qui s’appliquent à certains produits importés et parfois de manière contraire au principe de traitement national de l’OMC mais aussi des octrois (entry tax) et des taxes sur la valeur ajoutée (central sales tax) ;
– le système du droit de douane additionnel (Countervailing duty) renchéri par les prix selon un mode de calcul très complexe, qui nuit à la compétitivité des produits importés ;
– des procédures anti-dumping, notamment la certification par le Bureau of Indian Standards ;
– des licences d’importation.
L’Inde fait également un usage extensif des instruments de défense commerciale : interdictions d’importation, licences d’importation, quotas, mesures d’urgence. Le Directorate general of anti-dumping and allied duties (DGAD) rattaché au ministère du commerce indien a recensé le nombre de mesures anti-dumping : 209 procédures anti dumping entre 2006 et 2010 dont 27 % ont visé la Chine, 5 % l’Union européenne, 8 % la Thaïlande. Les secteurs concernés sont ceux qui sont considérés comme stratégiques dans le cadre de la politique industrielle : 17 % des procédures concernaient la métallurgie, 21 % l’industrie mécanique et électrique, 37 % l’industrie chimique.
● L’Inde a mis en place des restrictions non tarifaires qui nuisent à une réciprocité dans les relations commerciales
Les restrictions non tarifaires mises en œuvre par l’Inde consistent essentiellement en normes techniques, licences ou certificats obligatoires, tests dans les laboratoires indiens qui s’appliquent en raison de la non-reconnaissance de la certification européenne.
En matière agricole, l’Inde met en place de telles restrictions non tarifaires à l’entrée. La conséquence est saisissante : ce pays vend quatre fois plus de produits alimentaires à l’Union européenne qu’il ne lui en achète. Et la balance commerciale agricole franco-indienne est structurellement défavorable à la France avec un solde négatif de 393 millions d’euros en 2012. L’Inde a triplé la valeur de son excédent commercial agricole en 4 ans, passant de 8 à 25,5 milliards de dollars en 2012. En outre, des obstacles non-tarifaires sanitaires et phytosanitaires (SPS) s’ajoutent à ces barrières à l’entrée. Ces normes SPS sont des réglementations indiennes en contradiction avec les normes internationales, qu’il s’agisse de l’OMC, ou encore des règles définies à l’Organisation mondiale de la santé.
La réglementation est contraignante pour les investissements directs à l’étranger. Le ministère de l’industrie et du commerce recourt à deux outils pour limiter la possibilité pour des investisseurs d’investir dans l’économie indienne :
– l’obligation d’obtenir dans certains cas une approbation par le Foreign Investment Promotion Board (FIPB) ;
– la limitation de la part de capital pouvant être détenue par des investisseurs de court et/ou de long terme.
● L’ouverture inégale des marchés indien et européen rend difficile la mise en place d’un juste échange
S’agissant du commerce bilatéral entre l’Union européenne et l’Inde, l’excédent commercial de l’Union européenne (+5,5 milliards de dollars en 2012) masque une ouverture inégale entre les marchés indien et européen. Bénéficiaire du système de préférences généralisées (SPG) de l’UE, l’Inde dispose de nombreuses réductions de droits. Le nouveau SPG 2014-2016 entré en vigueur le 1er janvier 2014 a exclu certains pays émergents, mais l’Inde en bénéficie toujours. Le constat d’un déséquilibre entre les niveaux de protection indiens et européens est frappant : par exemple, alors que les droits de douane ad valorem appliqués par les Indiens sur les véhicules de passagers s’échelonnent entre 75 % et 125 %, les droits appliqués par l’UE sur les véhicules indiens (classés pourtant dans la catégorie des produits sensibles) ne sont que de 6,5 %. Il est difficile pour l’Union européenne de réduire davantage un droit très faible et les Indiens ne sont pas incités à corriger une situation qui leur est favorable explique la situation de blocage des négociations de l’Accord de libre-échange (ALE) entre Européens et Indiens.
S’agissant des marchés publics, l’Inde est observatrice de l’AMP depuis février 2010, mais n’a pas l’intention d’en devenir membre. Elle n’a cessé, au cours de négociations sur l’ALE avec l’Union européenne, de vouloir limiter les secteurs exonérés. Sa position est de refuser toute contrainte d’origine multilatérale qui contraindrait les procédures de marchés publics appliqués par les PED. Il semblerait que les marchés publics soient utilisés comme l’instrument central de la « nouvelle politique manufacturière » lancée en 2011 et un seuil de tolérance de 10 % ou 20 % sur le prix bénéficie aux entreprises indiennes. Les secteurs qui concentrent la plupart des inquiétudes de la part des opérateurs sont les secteurs de l’électronique et des télécommunications. La Telecom Regulatory Authority of India (TRAI) a recommandé en 2011 que pour des raisons de sécurité nationale des exigences de contenus local soient imposées aux fournisseurs et aux acheteurs. En pratique, quand un besoin d’expertise et de technologie est requis, les contrats sont signés d’autant plus facilement que le fournisseur étranger est allié à un partenaire local.
Face à ces différentes mesures protectionnistes, l’Union européenne doit durcir sa position vis-à-vis de l’Inde pour instaurer un véritable juste échange. En effet, aujourd’hui, l’Inde refuse de lier sujets sociaux ou environnementaux et négociations commerciales, voyant derrière ces normes une forme de protectionnisme déguisé. Qu’il s’agisse du niveau multilatéral, plurilatéral ou bilatéral, cette position indienne demeure constante. Par exemple, dans les accords de libre-échange que l’Inde a signés avec Singapour (2005), la Corée (2009) et le Japon (2011), les mentions relatives à l’environnement et aux normes sociales restent marginales. Si l’Inde a régulièrement introduit dans ses accords une clause rappelant le droit de chaque partie d’invoquer l’article XX de l’accord du GATT de 1994 – cet article permet de se prévaloir de mesures « nécessaires à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux ou se rapportant à la conversation des ressources naturelles » – des efforts restent à faire pour garantir des échanges réciproques entre l’Inde et l’Union européenne.
La Chine est aujourd’hui la deuxième économie mondiale et le premier partenaire commercial de l’Europe. Premier détenteur de réserves de change (3 400 milliards de dollars en 2012), elle est devenue en 2009 le premier exportateur mondial devant l’Allemagne. La Chine a connu des taux de croissance de 10,4 % en 2010, de 9,2 % en 2011, et 7,8 % suite au ralentissement de 2012.
Pourtant, ce pays a des fragilités bien identifiées : risque d’éclatement de la bulle immobilière et du système financier, absence de protection sociale, faiblesse du niveau de consommation par rapport à celui de l’épargne, inégalités accrues, crises environnementales et sanitaires, grandes inégalités de développement entre les provinces. En outre, la croissance du PIB chinois est fortement dépendante de la demande extérieure. A cela s’ajoute un important déséquilibre lié à un vieillissement accéléré de sa population qui conduit la Chine à réorienter son modèle de développement.
● Un accès difficile des entreprises étrangères au marché chinois
Au-delà des obstacles rencontrés par les entreprises privées chinoises liés à la défaillance du système bancaire et de l’interventionnisme de l’Etat dans l’économie, ce sont les entreprises étrangères qui sont confrontées à de nombreuses barrières pour accéder aux marchés chinois.
S’agissant des marchés publics, selon l’OCDE, ils représentaient en 2011 un montant de 1 100 milliards d’euros, soit 20 % du PIB chinois. Leur accès demeure extrêmement difficile pour les entreprises étrangères, sauf à accepter l’implantation des centres de technologies et à transférer la propriété intellectuelle. L’existence de barrières réglementaires et d’un défaut d’application des lois visant à encadrer ces marchés complique en effet leur intégration.
Le cadre légal des marchés chinois est régi par deux lois :
– la Government Procurement Law (GPL), entrée en vigueur en 2002, qui encadre les marchés publics des entités gouvernementales de tout niveau, soit 12 % du total des marchés publics ;
– la Bidding & Tendering Law (BL), adoptée en 1999, qui concerne les marchés passés par les entreprises publiques, soit 88 % du total des marchés publics.
Ce cadre général est complété par des réglementations spécifiques par secteurs telles que des prérequis pour les entreprises candidates (licences, certifications professionnelles) et des normes créant des barrières supplémentaires à l’entrée sur un marché (protection de l’environnement, protection de l’innovation). Dans ces deux lois, un accès prioritaire est donnés aux produits domestiques que la loi GPL définit comme les produits « fabriqués en Chine et dont les coûts manufacturiers domestiques sont supérieurs ou égaux à un certain pourcentage du prix final ». Si ce critère ne peut à lui seul pénaliser une entreprise étrangère présente en Chine dont les produits sont considérés comme 100 % chinois, certaines entreprises ont fait l’objet de discrimination en ce sens.
Les entreprises étrangères subissent des pratiques discriminatoires telles que des exigences de contenu local, un système de certification ou des différences dans les standards. Les discriminations sont également nombreuses dans le secteur des services. En matière de propriété intellectuelle, les procédures de législation sont longues et coûteuses. Les entreprises chinoises et étrangères sont faiblement protégées et le phénomène de copie et de contrefaçon aggrave cette dégradation du climat des affaires, même si des avancées sont toutefois à noter en matière de protection des indications géographiques.
S’agissant de la concurrence des entreprises chinoises, le rôle d’Exim Bank of China est à souligner. Fondée en 1994, entièrement détenue par l’État chinois, elle prête à des conditions avantageuses au gouvernement et aux entreprises chinoises afin de soutenir le développement économique et commercial du pays. En finançant les exportations des entreprises chinoises, elle leur donne un avantage concurrentiel dont ne disposent pas les entreprises étrangères.
● Un catalogue chinois des investissements étrangers qui oriente et restreint les investissements
Pendant longtemps, les investissements étrangers étaient limités aux joint-ventures dans des secteurs spécifiques. Mais depuis l’adhésion de la Chine à l’OMC (2001), les choses ont changé. Désormais, un catalogue des investissements étrangers existe, qu’en décembre 2011 la Commission nationale pour le développement et la réforme (NDRC) et le ministère du commerce (MofCOM) ont mis à jour. Il permet de diriger les investissements vers des secteurs prioritaires et classer les secteurs économiques en trois catégories :
– les investissements encouragés : ils bénéficient de politiques d’incitation (hautes technologies) et correspondent à la stratégie de développement économique chinoise ;
– les investissements restreints : soumis à des contraintes spécifiques, ils regroupent des secteurs à protéger de la concurrence étrangère. Dans cette catégorie, créer une joint-venture contrôlée majoritairement par la partie chinoise (exploitation minière, fret ferroviaire, etc…) est obligatoire ;
– les investissements interdits : sont interdits aux investissements étrangers, services postaux, construction et gestion de réserves naturelles, exploitation minière dans certains secteurs, fabrication d’armes ou de munitions.
Ce catalogue joue un rôle fondamental dans l’approbation des projets d’investissements étrangers. Il permet aux autorités chinoises de mieux orienter le développement économique du pays. Ainsi, chaque actualisation reflète les priorités stratégiques du Parti Communiste chinois (PCC). Notons donc que cette dernière version est conforme aux objectifs du 12ème plan quinquennal (2011-2015) qui promeut une meilleure prise en compte des problématiques environnementales. Il s’ensuit que le nombre de « secteurs encouragés » a augmenté, par exemple les services en matière de propriété intellectuelle, les services à domicile ainsi que les services de formation professionnelle. Les activités de franchise et de gestion d’entreprise sont désormais autorisées. Cependant, le contrôle des investissements étrangers s’est tout de même accentué pour certains secteurs et notamment le secteur de l’agriculture (achat de produits alimentaires, établissement et gestion de marché de gros de produits agricoles font désormais partie des investissements « restreints »).
Il est à noter qu’une difficulté réside dans le fait que le traitement de la procédure d’autorisation préalable peut donner lieu à des interprétations divergentes selon les administrations ou les provinces concernées.
En raison de la libéralisation d’un nombre limité de nouveaux secteurs, les observateurs ont jugé l’actualisation décevante.
● Vers des relations économiques plus équilibrées ?
Le rapport du 18ème Congrès du Parti communiste chinois a proposé d’assurer que toutes les entités économiques, qu’elles soient entreprises d’État ou entreprises privées, chinoises ou étrangères, aient un accès égal aux facteurs de production en accord avec la loi, et soient en concurrence selon des règles du jeu équitables. Ce rapport témoigne d’une évolution de la position chinoise.
A l’heure actuelle, les relations commerciales entre l’Europe et la Chine sont déséquilibrées, ce fait est mis en évidence par une balance commerciale très déficitaire (le déficit a atteint 26 milliards d’euros en 2012). Il convient de souligner qu’en mai 2013, la Commission européenne a demandé aux Etats membres un mandat pour lancer des négociations sur un accord sur les investissements avec la Chine. Le juste échange devra pour vos rapporteurs être au cœur de cette négociation.
Au plan international, il est important de noter que la Chine accomplit des gestes en faveur d’une plus grande équité dans les échanges commerciaux. C’est notamment par la réévaluation et l’internationalisation du yuan que la Chine introduit progressivement qu’il existe des raisons d’espérer la mise en place effective d’un juste échange à terme.
Le mouvement de libéralisation des échanges après la Deuxième Guerre mondiale s’est accompagné d’une volonté d’en assurer la régulation par la création d’organisations internationales au premier rang desquelles l’OMC, qui a succédé au GATT en 1994, afin d’établir en quelque sorte une mise en pratique de la théorie kantienne de la paix du commerce.
Cette organisation vise à instituer un système de règles visant à garantir une « concurrence ouverte, loyale et exempte de distorsions »28.
Cette formule signifie d’abord que le système commercial doit être exempt de discrimination : aucun pays ne devrait établir de discriminations entre ses partenaires commerciaux, ni entre ses propres produits, services et ressortissants d’une part et les produits, services et ressortissants étrangers auxquels doit être appliqué le traitement national.
Ensuite, le système commercial doit être prévisible, ce qui implique que les sociétés, les investisseurs et les gouvernements étrangers doivent avoir l’assurance que les obstacles au commerce ne soient pas appliqués de façon arbitraire.
Enfin, il doit être concurrentiel : il s’agit de prohiber des pratiques déloyales.
Pour l’application de ces principes, sont mis en place un ensemble d’accords et disciplines portant sur des domaines larges : agriculture, textiles, marchés publics, normes industrielles et sécurité des produits, propriété intellectuelle, normes sanitaires et phytosanitaires (SPS), obstacles techniques au commerce (OTC) ou subventions et mesures compensatoires. Les États doivent s’y conformer.
Ainsi les normes sanitaires et phytosanitaires applicables par les États membres doivent respecter le corpus élaboré par des instances internationales comme le Codex alimentarius ou l’OIE (Organisation mondiale de la santé animale) et ne doivent pas entraîner de distorsions de concurrence.
Un « mécanisme d'examen des politiques commerciales » (MEPC) a pour objet de s’assurer que les États se conforment à leurs obligations. Il ne s’agit toutefois pas d’un mécanisme contraignant, aucune sanction n’y étant associée. Dans le cadre de l’examen des politiques commerciales, tous les membres de l'OMC font l'objet d'un examen, dont la fréquence varie en fonction de leur part dans le commerce mondial. Ces évaluations portent régulièrement sur différents pays.
Enfin, l'une des avancées majeures de l'OMC par rapport au système du GATT a été la création d'un mécanisme contraignant de règlement des différends commerciaux entre États, sous la forme d'un organe permanent doté d'une juridiction propre, l'Organe de règlement des différends (ORD). Compte tenu de la lourdeur de la procédure, les États membres saisissent l’ORD dans des affaires importantes ou posant des questions de principe et les manquements « courants » au juste échange ne sont pas soumis à l’ORD, relevant davantage de l’examen des politiques commerciales mentionné supra.
Comme nous l’avons évoqué, les barrières tarifaires sont aujourd’hui faibles. Les pics tarifaires sont somme toute limités, et se justifient par un souci de protection de secteurs sensibles comme l’agriculture pour des motifs de souveraineté alimentaire. Ils sont admis par les règles de l’OMC.
L’essentiel des déséquilibres des échanges actuels réside donc non pas dans les concessions tarifaires, mais dans des comportements liés à la mise en œuvre de dispositifs non tarifaires entravant le commerce. L’OMC parle ainsi de « mesures de substitution » par lesquelles les pays contournent leurs obligations : les mesures non tarifaires sont substituées à des droits de douane.
Dans le rapport conjoint de l’OMC, de l’OCDE et la CNUCED rendu public le 18 décembre 201329, il est indiqué que les principales économies mondiales ont mis en place entre mai et novembre 2013, 116 nouvelles mesures restrictives contre 109 les six mois précédents. Ces nouvelles mesures affectent près de 1,1 % des importations de marchandises des pays du G20, soit près de 0,9 % du total des importations dans le monde.
Selon le rapport de l’OMC sur le commerce mondial en 2012, les États puisent dans une large panoplie de mesures qualifiées d’obstacles non tarifaires qui peuvent « fausser les échanges internationaux ». Il en existe deux types principaux. Le premier consiste à influer directement sur le prix, via les subventions à l'exportation ou le remboursement des droits de douane, les droits compensatoires et antidumping, les méthodes d'évaluation des importations, les surtaxes douanières, les longues procédures douanières, les réglementations sanitaires, la fixation de prix minimaux à l'importation, les normes déraisonnables et les procédures d'inspection.
Le second type d’obstacles non tarifaires vise à influencer les prix indirectement, notamment par des licences d'importation, des quotas d'importation ou des restrictions à l'exportation. Ces mesures peuvent s'accompagner de restrictions dans la distribution ou d'autres pratiques non concurrentielles, ainsi que d'interdictions également susceptibles de fausser les échanges commerciaux.
L’OMC, par le biais de son mécanisme d’examen des politiques commerciales, a ainsi indiqué, dans le rapport concernant la Chine en 2011, qu’il pouvait être reproché des mesures anti-concurrentielles.
Toutefois, la Chine n’a aucunement le monopole des comportements qui faussent les échanges30. Ainsi, la Russie, un an après son adhésion à l’OMC, a du mal à respecter l’ensemble des disciplines auxquelles elle avait souscrit en faisant son offre d’adhésion, ce qui a entraîné des tensions avec l’Union européenne notamment. Ces tensions se sont manifestées, en septembre 2012, et ont eu pour conséquence une taxe dite de recyclage sur les importations de véhicules, notamment européens31. Elles se sont également manifestées à l’occasion de la suspension des importations de produits laitiers lituaniens pour des raisons sanitaires en septembre 2013.
La Commission européenne a par ailleurs demandé en décembre 2013 des consultations à l’OMC sur des mesures fiscales auxquelles recourt le Brésil pour discriminer les produits importés et fournir une aide aux exportateurs (exonérations sélectives et allégements de taxes sur des biens produits localement, par exemple, une hausse de 30 % de la taxe appliquée par le Brésil aux véhicules à moteur mais dont sont exemptés les voitures et camions de fabrication nationale. Des mesures similaires existent pour d’autres biens, comme les ordinateurs et les semi-conducteurs).
Dans son Dixième rapport sur les mesures risquant de limiter les échanges32, la Commission européenne dresse un état des lieux des mesures potentiellement dommageables pour le commerce mises en œuvre par les principaux partenaires de l’Union européenne entre le 1er mai 2012 et le 31 mai 2013.
Ce rapport établit que 154 nouvelles mesures de restrictions aux échanges ont été instaurées. Les mesures appliquées directement aux frontières se sont multipliées (relèvement des droits à l’importation, les plus fortes hausses de droits de douane ayant été constatées au Brésil, en Argentine, en Russie et en Ukraine). Les mesures imposant l’utilisation de biens nationaux et les relocalisations d’entreprises ont continué leur progression, en particulier dans le secteur des marchés publics. Les mesures de relance passant notamment par un soutien aux exportations sont maintenues. Certains pays continuent de préserver certaines industries nationales de la concurrence étrangère, le Brésil et l’Indonésie donnant les exemples les plus flagrants. Lors de la réunion du comité de l’OMC sur le commerce le 11 juillet dernier, l’Union européenne avait fait part de ses préoccupations concernant l’imposition par l’Ukraine de droits de sauvegarde sur les automobiles, ce pays ayant par ailleurs fait une demande de renégociation de ses tarifs de douane consolidés à l’OMC. Elle a aussi réitéré ses préoccupations concernant l’utilisation par le Brésil de la fiscalité indirecte pour protéger ses industries locales, incluant des exigences de contenu local. Les griefs européens se sont aussi portés sur le Japon et son programme de relance pour le bois qui vise à stimuler l’offre et l’utilisation des produits forestiers nationaux, ainsi que sur les licences d’importation de l’Indonésie. De telles mesures ne sont pas limitées au domaine industriel. Alors que la Commission européenne a décidé de réduire unilatéralement ses soutiens à l’exportation (« restitutions »), ce qui a particulièrement affecté la filière volaille, les principaux partenaires de l’Europe, en premier lieu le Brésil, ont dans le même temps augmenté leurs aides à l’exportation.
Aucun pays, aucune zone géographique n’a le monopole de ces comportements et l’Europe elle-même n’est pas exempte de tout reproche quand il s’agit des restitutions aux exportations agricoles qui ont déséquilibré pendant longtemps les filières vivrières africaines, ou les réglementations techniques qui sont trop contraignantes pour permettre à certains pays en développement à accéder au marché européen. De nombreux pays qualifient de mesures protectionnistes les mesures prises par l’Union européenne en matière bancaire ou de réglementation automobile.
Toutes ces analyses ont été rappelées par l’OMC dans son rapport sur les mesures commerciales prises par les pays du G2033. Elle constate, que contrairement aux engagements pris au sommet de Los Cabos au Mexique en juin 2012, les pays du G2034 ont adopté entre mi –septembre 2012 et mi-mai 2013, plus de 100 mesures restrictives, englobant près de 0,5 % des importations de marchandises du G20 et près de 0,4 % des importations à l’échelle mondiale. 77 % de ces nouvelles entraves au commerce concernent les produits industriels et 23 % les produits agricoles.
A ces obstacles, on peut ajouter le protectionnisme de la norme : réglementations techniques, normes minimales et systèmes de certification liés à la santé et à la sécurité des consommateurs. Ce type d’obstacles non tarifaires est constitué de mesures techniques, complexes et politiquement délicates, car elles sont souvent mises en œuvre par les gouvernements au nom de l'intérêt général et l’OMC admet leur légitimité dans le cadre de l’espace de souveraineté des États.
Certains pays pratiquent ce que l’on peut qualifier de protectionnisme culturel. Le Japon, par exemple, recourt à un protectionnisme sous la forme de réglementations techniques et sanitaires. Ainsi, ne sont autorisés dans ce pays qu’un faible nombre d'additifs alimentaires, ce qui restreint l’accès au marché pour nombre de produits du secteur agro-alimentaire. Dans le secteur médical et pharmaceutique, les normes sont particulièrement restrictives. L’enjeu essentiel d’un accord de libre-échange avec le Japon portera sur ces barrières non tarifaires et sur la convergence réglementaire. Le même souci devra guider les négociations entre l’Europe et les États-Unis. Un autre exemple de ce protectionnisme est la pratique américaine portant sur les transports maritimes : le cabotage entre ports américains est réservé aux seuls navires battant pavillon américain, entièrement fabriqués aux États-Unis et dont l’équipage est composé au moins à 75 % de citoyens américains.
Autre mode de concurrence déloyale qui représente en outre un danger pour la santé et la sécurité des consommateurs : la contrefaçon35. Cette pratique a pris une dimension considérable, amplifiée par les occasions qu’offre la vente sur Internet. Longtemps limitée aux secteurs de biens de luxe, elle n’épargne aujourd’hui plus aucun secteur économique. Il ressort du rapport annuel de la Commission européenne sur les actions douanières visant à assurer le respect des droits de propriété intellectuelle (DPI) que les douanes de l'Union européenne ont saisi, en 2012, près de 40 millions de produits soupçonnés d’enfreindre ces DPI. Même si le nombre d'interceptions est moindre qu'en 2011, la valeur des marchandises interceptées, estimée à près d'un milliard d'euros, demeure élevée. En ce qui concerne la provenance des marchandises contrefaites, la Chine est restée la principale source. Cependant, d'autres pays figuraient en tant que première source pour des catégories de produits spécifiques, comme le Maroc pour les denrées alimentaires, Hong Kong pour les CD/DVD et d'autres produits du tabac (essentiellement les cigarettes électroniques et leurs recharges liquides ) et la Bulgarie pour les matériaux d'emballage.
La monnaie étant à la base de toute relation commerciale, un autre manquement au juste échange peut résider dans la sous-évaluation du taux de change par les autorités monétaires nationales, afin d’améliorer la compétitivité –prix.
La valeur d’équilibre d’une monnaie est déterminée par les fondamentaux de l’économie d’un pays. Or, les désalignements des cours par rapport à cette valeur d’équilibre peuvent être la cause d’une asymétrie des coûts faussant la concurrence et peuvent s’apparenter à des pratiques déloyales influant sur la compétitivité comparative des pays.
Alors que l’on négocie sur la baisse de quelques points de droits de douane, les variations de taux de change peuvent avoir des incidences bien plus grandes. De plus, ces variations peuvent créer les déséquilibres macro-économiques dans la mesure où elles sont adossées à des politiques monétaires expansionnistes.
Pour éviter les tentations de variations de taux de change, dans le cadre de l’OMC, a été adopté l’article XV du GATT qui stipule que les pays doivent « s’abstenir de toute mesure de change qui irait à l’encontre des dispositions du commerce international ». Selon la Déclaration sur la contribution de l’OMC à une plus grande cohérence dans l’élaboration des politiques économiques adoptée dans le cadre des accords de Marrakech fondant l’OMC du 15 avril 1994, « une plus grande stabilité des changes, grâce à davantage d’ordre dans les conditions économiques et financières fondamentales, devrait contribuer à l’expansion du commerce, à la croissance et au développement durables et à la correction des déséquilibres extérieurs ». Cependant, l’OMC n’a aucune compétence régulatrice en la matière et est tenue de renvoyer à l’avis du FMI toute question relative aux régimes de change, aux réserves et à la balance des paiements.
L’article 4 des statuts du Fonds monétaire international (FMI) interdit de manipuler les taux de change pour obtenir des avantages comparatifs, ce qui est une référence explicite à la notion d’échanges équitables. Pour articuler cet article avec les dispositions de l’article XV du GATT, un accord de coopération a été signé en 1996 entre les deux institutions, posant la base de consultations régulières et de rapports de surveillance communs. Cet accord est réduit à la portion congrue, seul un groupe de travail commun ayant été constitué. Ces dispositions n’ont jamais eu l’occasion d’être interprétées, ni appliquées.
Une note récente du Conseil d’analyse économique36 analyse les limites des dispositions actuelles de l’OMC et du FMI : « un taux de change est considéré comme "manipulé" si le pays a mis en œuvre des interventions ou des contrôles de change destinées à maintenir durablement une sous-évaluation du change par rapport à son niveau fondamental, et si l’objectif de cette sous-évaluation est de stimuler les exportations. Ces deux conditions sont très restrictives, d’autant qu’il est recommandé d’accorder à l’État membre le bénéfice du doute. En outre, le FMI n’a pas sur ce sujet de pouvoir de sanction. Finalement, aucun pays n’a jamais été sanctionné pour manipulation de son taux de change car la coordination est limitée entre FMI et OMC, mais aussi parce que les preuves de manipulation sont difficiles à réunir et le FMI hésite à pointer les pays "manipulateurs", surtout lorsqu’ils sont des membres importants ».
Même si on est loin des dévaluations compétitives et de l’instabilité monétaire qui ont précédé la Deuxième guerre mondiale, la problématique des valeurs relatives des monnaies est récurrente depuis la fin des taux de changes fixes et la décision de flottement généralisé des monnaies en 1973. Elle s’est, au cours de la dernière décennie, cristallisée autour du différend entre les États-Unis et la Chine. La Chine a maintenu la compétitivité de ses exportations en pratiquant une sous-évaluation de sa monnaie grâce à un lien au dollar (peg) avec une marge étroite de fluctuation jusqu’en 2005, suivi de réévaluations qui n’ont toutefois pas corrigé la totalité de la sous-évaluation. Les États-Unis ont dénoncé cette concurrence déloyale mais il faut souligner l’ambivalence de l’attitude de l’administration américaine. En effet, les initiatives du Congrès visant à imposer des droits de douane compensatoires aux importations de produits chinois pour contrecarrer une sous-évaluation de la monnaie chinoise (« Currency Reform For Fair Trade Act ») n’ont jamais été soutenues jusqu’au bout. Il est possible de s’interroger sur le fait de savoir si cela n’est pas dû à la dépendance des États-Unis à l’égard de la Chine qui est le plus important détenteur étranger de la dette américaine.
Les déséquilibres monétaires concernent également d’autres zones. Ainsi, un pays comme le Brésil, dont les taux d’intérêt élevés attirent des capitaux spéculatifs et volatils, a dénoncé une surévaluation de sa monnaie. Les pays de la zone pacifique s’inquiètent des conséquences de la politique monétaire expansionniste, aux fins de relance et de stimulation des exportations menée par le Premier ministre japonais Shinzo Abe (« Abenomics ») depuis décembre 2012. Ayant consisté au rachat par la Banque du Japon d'actifs financiers afin d'encourager les investissements des entreprises et la consommation des ménages, la politique monétaire accommodante s’est traduite le maintien des taux directeurs dans la fourchette de 0 à 0,1 % afin de permettre un accroissement de la masse monétaire. En conséquence, le yen a chuté de plus de 15 % face au dollar entre novembre 2012 et février 2013. Le gouverneur de la Banque d’Angleterre a, quant à lui, explicitement indiqué que la livre sterling devrait se déprécier afin de contribuer à relancer une croissance atone dans ce pays.
S’agissant de l’euro, si son niveau fait débat, c’est parce que sa valeur n’est que le reflet d’un relatif équilibre des comptes extérieurs de la zone euro mais n’est, en revanche, pas en adéquation avec les performances économiques de l’ensemble des États. L’euro est fort par rapport à un dollar faible en raison de la crise budgétaire. La liberté monétaire que donne aux États-Unis le privilège du dollar comme monnaie de paiement international a conduit à une surévaluation de l’euro par rapport au dollar qui a subi une dévaluation de 28 % sur la dernière décennie. Depuis le printemps 2013, l’euro a gagné près de 9 %, se situant à 1,38 dollar (le niveau record ayant été atteint en 2008, à 1,59 dollar).
La dépréciation du dollar provoque une baisse relative du prix de travail américain par rapport à l’euro, ce qui a des répercussions sur la valeur relative des échanges avec les pays liés au dollar comme la Chine. Le cas de l’Airbus dont les prix sont libellés en dollars et les coûts en euros est une illustration de ce phénomène.
S’agissant de la zone euro, la sensibilité aux variations de change n’est pas la même dans tous les pays. L’Allemagne est ainsi moins vulnérable à la réévaluation de l’euro pour plusieurs raisons. Tout d’abord, se situant sur des créneaux « haut de gamme », la réaction de la demande à une variation de prix est faible. Ensuite, si l’assemblage final des produits se fait en Allemagne, beaucoup d’unités de production se situent dans des pays d’Europe centrale et orientale qui ne sont pas encore entrés dans l’euro. L’Allemagne profite indirectement de la surévaluation de l’euro dans la mesure où près de 56 % de son excédent commercial est généré dans la zone euro et près de 80 % dans l’Union européenne.
La France est quant à elle plus sensible aux variations de taux de change, de telle sorte que la baisse du dollar pèse sur ses exportations37 . Selon une étude de la direction générale du Trésor, les mouvements des taux de change de l’euro ont eu une incidence sur les exportations françaises : « au total de 1999 à 2008, l'appréciation de l'euro aurait renchéri en moyenne de 1 point par an les prix des exportations françaises par rapport aux prix des exportations des principaux pays partenaires. La tendance à la dépréciation de l'euro de 2008 à 2012 aurait, à l'inverse, diminué les prix relatifs des exportations françaises de 1 point par an en moyenne »38. Dans la note précitée du Conseil d’analyse économique, l’impact d’une dépréciation de 10 % de l’euro sur le PIB est estimé, pour ce qui est de la France, à 0,6 % après un an et 1 % au bout de deux ans : les gains à l’export l’emportent sur l’effet négatif du renchérissement des importations. Et on peut craindre un effet plus ou moins symétrique en cas d’appréciation de l’euro.
M. Louis Gallois chiffrait le « vrai » cours de la monnaie européenne à 1,15 ou 1,20 dollar. Il précisait : « Un euro fort peut être l’ennemi de l’euro. Son taux d’équilibre est à 1,15, 1,20 dollar, sa cotation actuelle à 1,35 le situe aux abords d’une zone dangereuse. L’appréciation trop rapide de l’euro peut remettre en cause les progrès que l’on essaye de faire sur la compétitivité. On me dit que l’Allemagne supporte très bien l’euro fort. C’est vrai, je l’ai dit dans mon rapport : l’euro fort renforce les forts et affaiblit les faibles ! Il privilégie ceux qui ont réussi à échapper à la compétition par les prix, en se plaçant sur le haut de gamme. Alors qu’en France, nous sommes trop souvent sur des productions milieu de gamme, plus concurrencées, plus sensibles aux prix et aux évolutions monétaires »39 . Une étude de la Deutsche Bank40 a calculé le « seuil de douleur » de l’euro qui se situerait à 1,37 dollar pour un euro sur l’ensemble de la zone. Cette étude établit que l’Allemagne pourrait résister à un euro à 1,76 dollar tandis qu’avec un seuil fixé à 1,24 pour l’une et 1,17 dollar pour l’autre, la France et l’Italie souffrent déjà du niveau actuel de la monnaie unique.
Il faut toutefois souligner qu’un euro fort a contribué à alléger la facture énergétique de l’Europe qui importe l’essentiel de son pétrole dont le prix est négocié en dollar. De plus, l’euro fort allège le coût des produits importés, ce qui permet, du fait de la fragmentation des chaînes de valeur, de réduire le coût de fabrication de certains produits. Cependant, cet argument est à double tranchant dans la mesure où les achats hors zone euro font aussi perdre des parts de marché.
La création européenne a reposé sur le choix de la paix du commerce contre la guerre, en substituant aux rivalités nationalistes et mercantilistes des échanges commerciaux pacifiques. Les échanges y étaient garantis par un droit commun et des institutions communes. Le libre-échange de la Communauté économique européenne (CEE) a assuré une croissance économique qui a effacé les destructions des deux guerres mondiales successives, donné du travail à une population en forte croissance, permis de rattraper en partie l’avance technique et le niveau de vie des États-Unis et compensé partiellement la perte des marchés captifs des anciens pays colonisés.
Ce projet politique a vu son aboutissement dans la création du marché unique, de la libre circulation des biens, des services et des personnes, de la monnaie unique et dans l’ouverture du marché européen aux échanges mondiaux. Cette ouverture est présentée comme favorable aux consommateurs, grâce à une baisse des prix et une extension de l’offre : ces arguments continuent à être développés par la Commission européenne41. L’Union européenne s’est ainsi fortement impliquée dans le mouvement de libéralisation du commerce, des transports, des flux de capitaux et des échanges de biens manufacturés. Sa participation aux négociations multilatérales de suppression des barrières douanières a été très active au cours des différents cycles de négociations du GATT depuis 194742. Alors que les États-Unis accusaient l’Europe de s’ériger en forteresse lorsque le « grand marché intérieur » a été créé en 1992, l’Union européenne s’est largement ouverte au commerce international au point qu’elle a pu être qualifiée « d’idiot du village mondial ».
La balance commerciale de l’Union européenne est globalement déficitaire, ainsi que le montre le graphique ci-dessous.
Balance commerciale de l’Union européenne
À partir de ce graphique, trois remarques peuvent être faites sur cette situation de déséquilibre :
● D’abord, le solde négatif de la balance commerciale de l’Union est largement dû à la facture énergétique, qui a dépassé en 2011 le solde positif sur les biens industriels et de service, ainsi que le montre le graphique ci-après. La hausse de l’excédent européen en matière de produits manufacturés et de services a plus que contrebalancé le doublement du déficit dû à la facture énergétique entre 2000 et 2010. Le déficit européen en matière de biens et services a été divisé par deux depuis 2000 (moins 74 milliards d’euros). Ce poids de la facture énergétique dans le commerce européen doit être pris en compte dans les réflexions sur le taux de change de l’euro, puisqu’ un euro moins fort alourdirait encore cette facture.
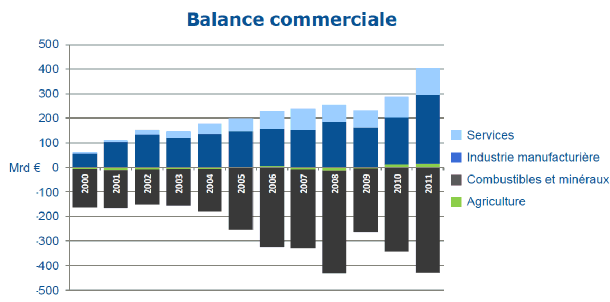
Source : Commission européenne « Stratégie commerciale de l’UE : saisir les opportunités ». Présentation de M. José Manuel Barroso, Président de la Commission européenne, au Conseil européen des 7 et 8 février 2013.
● Ensuite, si l’Union européenne est le principal importateur et exportateur mondial, ses membres subissent inégalement les conséquences de la concurrence internationale. Les performances des États sont extrêmement diverses. Alors qu’en 2012, seize États ont subi une dégradation de leurs balances commerciales, à hauteur globale de 189 milliards d’euros, onze États ont amélioré leurs balances commerciales, à hauteur de 164 milliards d’euros. Certains comme la Grande Bretagne ou l’Italie étant plus dépendants du marché extra-communautaire.
Les chiffres du commerce au mois de décembre 2013 indiquent que le commerce de l’Union européenne à 28 avec les pays tiers enregistre un excédent de 8,2 milliards d’euros par rapport à décembre 2012 où le déficit était de 2,4 milliards d’euros. De janvier à novembre 2013, le déficit en matière d’énergie s’est réduit (-351,4 milliards d’euros contre -388,4 milliards d’euros sur la même période en 2012) pendant que l’excédent en produits manufacturés a augmenté (+354 milliards d’euros contre +322,8 milliards d’euros). Le déficit avec la Chine s’est réduit (-121,6 milliards d’euros contre -136,8 milliards d’euros en 2012). L’Allemagne affiche le plus fort excédent (+185,5 milliards d’euros), suivie des Pays Bas (+50,6 milliards d’euros) et de l’Irlande (+34,6 milliards d’euros), tandis que le Royaume-Uni affiche le plus fort déficit (-78,6 milliards d’euros), suivi de la France (-69,9 milliards d’euros) et de la Grèce (-17,9 milliards d’euros).
● Enfin, le reste du monde ne représente qu’une part minoritaire dans le commerce européen. En effet, il se déroule pour les deux tiers entre ses États membres, comme l’illustre le graphique infra. C’est donc dans le commerce intracommunautaire que se sont creusés les écarts de performance économique entre les États membres. Depuis dix ans, seize États membres ont subi une dégradation de leur balance commerciale et cette dégradation est due à hauteur de plus de 70 % à leur déficit intracommunautaire. La France réalise pour sa part environ 60 % de son commerce extérieur avec le reste de l'Union. Si l'on ajoute les autres pays européens non membres de l’Union et les États-Unis, cela représente les trois quarts de son commerce. L’essentiel des déséquilibres viennent donc des relations commerciales entre les pays européens eux-mêmes.
UE- 27 et pays membres : commerce intra et extra européen, 2010
(Importations et exportations en % du commerce total)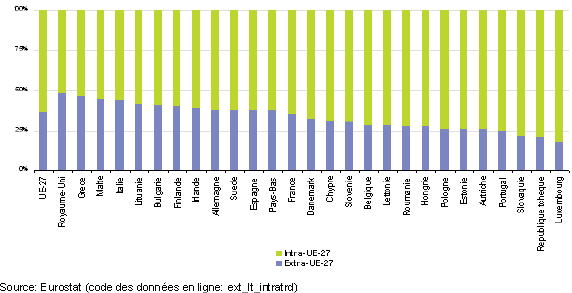
Balances commerciales intra et extracommunautaires des pays de
l’Union européenne
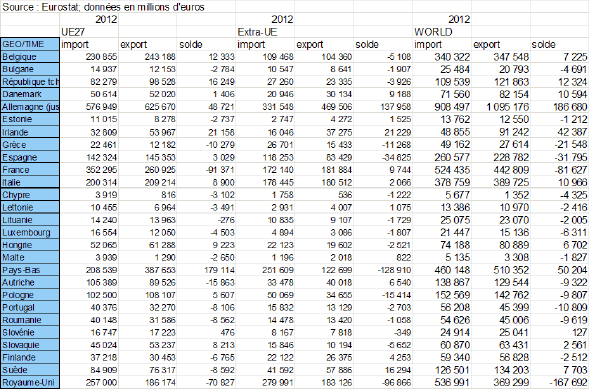
La politique commerciale est depuis le Traité de Rome une compétence exclusive de l’Union exercée de facto par la Commission européenne. Alors que l’Union européenne constitue un ensemble relativement homogène économiquement et dispose d’une capacité de consommation importante avec 500 millions de consommateurs, ce qui lui permet d’avoir la masse critique nécessaire pour peser face à des partenaires commerciaux, les vingt-huit États membres ne présentent pas un front uni.
Les divergences tiennent d’abord aux différences d’appréciation sur les bienfaits du libre-échange. Les pays du Nord de l’Europe y sont très favorables alors que les pays du Sud sont réputés être plus interventionnistes. Pour ces derniers, l’Europe a trop largement ouvert ces frontières.
A ce clivage idéologique, se superpose le déséquilibre entre les pays dont la balance commerciale est excédentaire et ceux qui ont vu leur balance se dégrader, cette différence étant le révélateur de différentiels de compétitivité. Les pays du Nord, dotées d’un appareil productif efficace, fondent leur prospérité sur les exportations, tandis que la France s’est désindustrialisée assez rapidement et est en situation de déficit commercial. S’ajoutent à cela les divergences de normes sociales ou fiscales qui peuvent avoir un effet déterminant. De la même manière, la diversité des situations industrielles est particulièrement éloquente.
Selon le rapport de MM Jacob et Guillon cité précédemment, l’écart de coût horaire moyen de la main d’œuvre en euros varie de 1 à 15 (la Bulgarie et la Suède). La part de l’industrie dans la valeur ajoutée s’étale de 8 % (Luxembourg) à plus de 25 % (Slovaquie et République tchèque). Celle de l’industrie dans l’emploi connaît également des différences : de 10 % (Chypre) à plus de 27 % (République Tchèque).
Dans ces conditions, l’Union européenne a du mal à définir un socle d’intérêt commun. La politique commerciale européenne est au mieux un consensus mou. Le plus souvent, elle porte la marque de ces divergences d’appréciation et d’intérêts.
Les relations avec la Chine portent illustrent parfaitement ces contradictions et ces insuffisances : « La relation commerciale avec la Chine révèle toutes les faiblesses de la machine de l’Union européenne, avec une Commission qui n’est pas le centre d’impulsion et ne peut donc se doter d’un agenda ferme grâce auquel elle pourrait avoir plus de légitimité et de poids. Quand il s’agit de mettre en œuvre une relation complexe avec un partenaire comme la Chine, les défauts de la construction européenne sont rapidement mis en évidence. Il manque à l’Union européenne les attributs d’une puissance globale pour définir une stratégie commune et pouvoir négocier en position de force »43.
Les divergences au sein de l’Union européenne ont été récemment mises à jour dans les débats sur les politiques visant à rétablir les conditions de base d’une concurrence loyale, comme l’utilisation des instruments de défense commerciale que sont les droits antidumping, dans l’action de la Commission européenne contre les panneaux solaires et les équipementiers de télécommunications Huawei et ZTE.
Autre exemple, les États européens ont abordé la délicate négociation de l’accord transatlantique en ordre dispersé, les divergences s’étant cristallisées, avant même le début des négociations, autour de l’exception culturelle.
La politique commerciale européenne est en conséquence souvent réduite à la mise en œuvre timide de dispositifs juridiques unilatéraux de défense commerciale.
L’Union européenne dispose, pour défendre ses intérêts en cas de manquements de ses partenaires commerciaux, de plusieurs instruments. Sur le plan multilatéral, elle peut saisir l’Organe de règlement des différends. Elle dispose par ailleurs des instruments unilatéraux de défense commerciale (IDC).
S’agissant de l’ORD, l’Union européenne en est un utilisateur actif. Mais si elle ouvre des panels à l’égard de pays émergents comme la Chine, elle le fait souvent en suivant la voie ouverte par d’autres pays.
Ainsi, quand l’Union européenne a saisi l’ORD des restrictions d’accès aux matières premières rares faites par la Chine en 2011, elle l’a fait à la suite des États-Unis. Dans ce dernier litige, l’envolée des prix des matières premières comme la bauxite, le zinc, le magnésium et autres minéraux a contribué à l’augmentation des prix en bout de chaîne sur les produits finis. Tous ces minéraux entrent en effet dans la fabrication des équipements médicaux, des voitures hybrides, des réfrigérateurs et de nombreux matériels électroniques. Les États-Unis et l’Union européenne ont fait valoir que les quotas et les droits d’exportation fixés en début d’année par Pékin sur les matières premières auraient entrainé une distorsion de concurrence permettant aux compagnies chinoises de bénéficier de prix plus compétitifs. L’ORD n’a pas retenu l’argument de la Chine qui avançait la nécessité de la protection de l’environnement44 et a fait droit aux arguments des États-Unis, du Japon et de l’Union européenne. En 2013, ces pays ont engagé un nouveau recours contre les quotas d’exportation sur d’autres terres rares.
L’Europe ne doit pas se priver de l’utilisation de ces mécanismes pour faire trancher des questions de principe et il semble que la Commission européenne se soit récemment engagée dans une défense plus active des intérêts européens.
Ainsi, elle a déposé une plainte et demandé le 16 août 2013 à l’OMC d’arbitrer dans le dossier des taxes antidumping mises en place par la Chine en novembre 2012 contre les exportations européennes de tubes sans soudure. La Commission européenne assimile ces droits à une mesure de représailles dépourvue de preuves de violation des règles commerciales. L’Union européenne a par ailleurs saisi l’OMC le 9 juillet 2013 au sujet d’une taxe imposée par les autorités russes sur les voitures importées : il s’agit du premier contentieux opposant l’Union européenne à la Russie depuis l’accession de ce pays à l’OMC en août 2012. La Commission européenne estime que la taxe en question est incompatible à la règle fondamentale de l’OMC interdisant la discrimination à l’égard des importations.
S’agissant des instruments unilatéraux de défense commerciale (IDC)45, le commissaire au commerce Karel De Gucht en a souligné le caractère « vital ». Cependant, en comparaison avec les autres membres de l’OMC, l’Union européenne apparaît comme une utilisatrice modérée. À la fin de l’année 2012, 102 mesures antidumping et 10 mesures antisubventions étaient en vigueur au sein de l’Union européenne. Les pays comme les États-Unis ou les pays émergents utilisent plus largement ce système (300 aux États-Unis et 200 en Inde), parfois à titre de rétorsion comme le montre la récente décision de la Chine de lancer une enquête sur les subventions sur les vins européens ou d’ouvrir une enquête pour entraves à la concurrence sur les aides de la politique agricole commune au secteur du lait.
Même si ces mesures ont une incidence sur moins de 1 % des importations européennes, les divisions des États membres se sont cristallisées autour de l’utilisation de ces instruments. Sous une apparence technique, leur mise en œuvre, décidée à la majorité simple, relève souvent d’arbitrages politiques et de défense de certains intérêts commerciaux. La ligne de fracture passe entre les pays volontaristes face à des pratiques qu’ils estiment déloyales et les pays favorables idéologiquement au libre-échange ou craignant des représailles.
Ces divisions apparaissent au grand jour quand il s’agit d’utiliser ces instruments à l’encontre de la Chine. Ce pays sait en effet parfaitement tirer avantage des divisions des Européens pour peser sur les décisions d’application des IDC, à tel point qu’on a pu dire que, lors de ces votes, elle était le « vingt neuvième membre » de l’Union européenne. Citons pour exemple, l’enquête sur les panneaux solaires où en décidant de l’application de droits d’un montant de 37,2 % à 67,2 % sur les produits importés, la Commission était passée outre l’opposition de l’Allemagne. Le Commissaire au commerce avait déclaré à cette occasion que « la Commission reprend son rôle de défenseur indépendant de l’industrie européenne face aux pratiques commerciales déloyales des pays tiers. Nul besoin de vous rappeler que la règle de droit est le principe fondamental au cœur de l’Union européenne ». Lors de sa riposte, la Chine a joué sur les divisions entre États membres : en entamant une enquête sur les importations de vins européens, elle a ciblé les États les plus en pointe sur la controverse dans cette affaire (France, Espagne et Italie). À la fin du mois de juillet 2013, un accord a été conclu entre l’Union européenne et la Chine, prévoyant l’abandon des taxes provisoires européennes sur les panneaux solaires chinois en échange d’engagements sur les prix des producteurs locaux.
Une inflexion de l’attitude de la Commission européenne est également perceptible dans les modalités d’utilisation des IDE. Ainsi, il y a de plus en plus de plaintes ex officio, c’est à dire par initiative propre de la Commission et non en réponse à une demande du secteur industriel concerné. C’est le cas de l’action décidée dans le domaine des télécommunications.
Ces instruments unilatéraux peuvent contribuer à rétablir les conditions d’un juste échange.
Le juste échange ne consiste pas à appliquer les mêmes règles sociales et environnementales à tous les acteurs du commerce international afin d’établir un level playing field (c'est-à-dire un environnement dans lequel tous les acteurs du marché mondial devraient suivre les mêmes règles). Au contraire, il implique notamment de prendre en compte le niveau de développement des pays et la productivité de la population active.
Depuis 50 ans, la productivité des pays développés européens a été multipliée par quatre. Les bénéfices de cette augmentation se sont traduits par un revenu par tête supérieur (multiplié par plus de trois pendant la même période), de plus grands profits, les dépenses publiques plus importantes incluant des filets de sécurité sociaux et de meilleures infrastructures. Même si elle augmente à un rythme soutenu pour certains pays émergents, elle n’atteint pas ce niveau. Par exemple, le niveau de productivité de la Chine est encore inférieur de 20 % à celui des pays développés.
C’est pourquoi, face à l’argument de dumping social, les pays émergents et les pays en développement font valoir leurs avantages comparatifs. Pour eux, ces disparités s’expliquent par un différentiel de compétitivité. Toute tentative de gouvernance sociale afin de limiter cet avantage, au nom du rétablissement de conditions de juste échange, s’est heurtée à la ferme opposition des pays en développement qui a culminé lors de la Conférence de Singapour de l’OMC en 1996 au cours de laquelle les pays développés ont voulu inscrire le principe de l’articulation entre les règles du commerce et les normes sociales dans les règles de cette organisation. Ceci posé, en matière sociale, des accidents tragiques comme celui qui est survenu dans l’usine textile du Rana Plaza au Bangladesh en avril 2013, ne peuvent nous laisser indifférent.
Le détachement des travailleurs en Europe
Il faut noter que, même si elles ne sont pas de même nature et de même ampleur, les distorsions de concurrence en matière sociale ne sont pas limitées aux relations entre pays développés et pays émergents. Ainsi, la directive 96/71/CE du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services, conçue à l’origine comme protectrices des droits des salariés nationaux, est devenue un « outil d’optimisation sociale et de dumping social et est l’objet de nombreuses fraudes qui mettent en péril notre modèle social, nos comptes sociaux, ainsi que le projet européen lui-même, qui en est discrédité »46. Alors que les travailleurs détachés sont censés bénéficier du salaire et des conditions de travail du pays d’accueil, certains employeurs contournent la loi, à moindre coût dans la mesure où les cotisations sociales sont payées dans le pays d’origine. La France est ainsi le deuxième pays d’accueil européen avec 144 411 travailleurs détachés, ce nombre ayant fortement augmenté depuis 2006 où il était de 40 000. Les secteurs d’accueil de ces travailleurs détachés sont à 44 % le bâtiment et les travaux publics, 22,7 % les entreprises de travail temporaire, 17 % l’industrie et 5,3 % l’agriculture. Aussi, votre rapporteure se félicitent de l’accord auquel les États membres sont parvenus le 9 décembre dernier afin de renforcer les contrôles et lutter contre les dérives générées par le recours à la main d’œuvre détachée47, ainsi que de la résolution votée par l’Assemblée nationale le 25 février 2014 qui vise à responsabiliser les maîtres d’ouvrage et les donneurs d’ordre vis-à-vis des travailleurs détachés employés pour leur compte
En matière environnementale, au moment où le cinquième rapport du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) a posé un diagnostic aggravé sur la hausse possible des températures, la question de la prise en compte des normes environnementales se pose également avec acuité.
Normes environnementales et compétitivité
L’impact des mesures environnementales sur la compétitivité des secteurs économiques est un thème récurrent et crucial dans la mise en œuvre d’une gouvernance mondiale environnementale. Il a constitué l’argument principal des États-Unis lors de leur retrait du Protocole de Kyoto en 2001. L’Union européenne, dans le cadre de ce protocole signé en 199748, s’est engagée à réduire ses émissions de gaz à effet de serre (GES). Afin d’appuyer ses engagements internationaux, l’Union européenne a élaboré le « paquet énergie climat » qui est un plan d’action visant à mettre en œuvre une politique commune de l’énergie et de lutte contre le changement climatique. Il devrait lui permettre d’atteindre l’objectif de réduction de 20 % des GES, cette réduction de 20 % concernant les secteurs industriels. La mise en œuvre de ce paquet énergie climat repose sur un système de quotas de CO2 qui instaure un marché des droits à polluer qui couvre les secteurs manufacturier et énergétique. La réglementation en matière de réduction des émissions de CO2 pour les voitures neuves a ainsi été à la une de l’actualité, les groupes allemands voulant différer les nouvelles contraintes d’émissions décidées en juin 2013. Pour les autres secteurs (services, agriculture, transports routiers et maritimes, bâtiment…), les objectifs de réduction sont fixés par les États membres. Les entreprises européennes sont soumises à d’autres normes environnementales strictes comme par exemple le règlement REACH (système intégré d’enregistrement, d’évaluation, d’autorisation et de restrictions de substances chimiques). Certains partenaires commerciaux de l’Europe n’ont pas de telles contraintes. Or, il apparaît que les mesures en faveur de l’environnement pour lutter contre le changement climatique peuvent être source d’amélioration de la productivité et ainsi constituer un avantage pour les pays qui ont des normes plus contraignantes.
Tant pour la problématique sociale qu’environnementale, il s’agit de déterminer quel est le niveau pertinent de régulation - multilatéral, bilatéral, ou même privé par la responsabilisation des entreprises - et quels instruments devraient être mis en œuvre.
Taxer les produits qui ne répondent pas aux critères sociaux et environnementaux est a priori une idée séduisante. Mais outre le risque qu’une telle mesure ne soit pas compatible avec les règles de l’OMC, elle se heurterait à plusieurs obstacles. D’abord, l’argument selon lequel si les pays industriels peuvent se targuer d’émettre moins de polluants, c’est en raison de la localisation de ces activités dans les pays en développement ou émergents. A cet égard, un récent rapport identifie les dix filières les plus toxiques dans le monde (recyclage des batteries au plomb, production du plomb, activités minières, tanneries, sites de décharges industriels et municipaux, sites industriels, orpaillage, industries manufacturières, pétrochimie et teinture). Ensuite, celui lié aux chaînes de valeur dans le commerce mondial (développé dans la première partie) qui reviendrait à taxer des importations.
1. Les fondements théoriques : des « biens publics mondiaux », mais des « responsabilités communes mais différenciées »
La mondialisation a multiplié les problèmes et les intérêts communs à l’ensemble des pays, qu’il s’agisse de règles sociales minimales, d’environnement, de santé, de stabilité financière, d’accès à des ressources de base comme l’eau ou d’accès au savoir.
Le débat sur ces problèmes globaux a été renouvelé par le recours au concept de « biens publics mondiaux », formulé par l’économiste Paul Samuelson49.
D’un point de vue théorique, le bien public est défini comme un bien dont les caractéristiques, non rivalité et non exclusion50, rendent improbable une prise en charge de leur production dans la mesure où il est difficile d’établir des droits de propriété ou d’usage sur ces biens.
Les biens publics mondiaux identifiés en premier lieu par la Communauté internationale furent liés aux risques environnementaux globaux et à leurs externalités globales (problème du réchauffement climatique, pollution des mers, pluies acides). Le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) a proposé de regrouper les biens publics mondiaux en trois grandes catégories :
– les biens publics mondiaux naturels comme la stabilité climatique et la biodiversité qui posent le problème de leur surutilisation ;
– les biens publics mondiaux d’origine humaine, comme les connaissances scientifiques pour lesquels l’enjeu est leur sous-utilisation ou leur utilisation inégalitaire ;
– les biens publics dénommés « résultats politiques globaux », au nombre desquels la paix, la stabilité du système financier international.
Alors que la libéralisation des échanges a été basée sur les avantages tirés du fonctionnement libre des marchés, la notion de bien public mondial met l’accent sur le fait que l’on ne peut pas compter sur les seules forces du marché pour assurer un niveau de protection suffisant de ces biens. Seule une prise de conscience et une coopération internationale peut permettre de les protéger. La gestion des biens publics mondiaux suppose de prendre en compte une dimension universelle, d’articuler les préférences collectives, donc de fonder une équité internationale.
Cependant, équité ne signifie pas traiter également des partenaires inégaux. L’équité doit se concilier avec le principe de responsabilités communes mais différenciées. Ce principe posé lors de la Conférence de Rio en 1992, dispose que « les États doivent coopérer dans un esprit de partenariat mondial en vue de conserver, de protéger et de rétablir la santé et l’intégrité de l’écosystème. Étant donné la diversité des rôles joués dans la dégradation de l’environnement mondial, les États ont des responsabilités communes mais différenciées. Les pays développés admettent la responsabilité qui leur incombe dans l’effort international en faveur du développement durable, compte tenu des pressions que leurs sociétés exercent sur l’environnement mondial et des techniques et des ressources financières dont ils disposent ». Il s’agissait de rééquilibrer les rapports entre le Nord et le Sud dans la balance des droits et des devoirs internationaux.
Ce principe a été à l’origine appliqué à la protection de l’environnement et il s’est élargi, au nom de l’effort international pour le développement durable, aux objectifs sociaux tels que l’équité, l’élimination de la pauvreté et le développement lors du sommet mondial sur le développement durable de Johannesburg en 2002.
Pour les pays développés, l’aspiration à une gouvernance sociale afin de rétablir les conditions d’un juste échange répond à plusieurs niveaux de préoccupations, sociales et économiques. Aux inquiétudes liées au risque de nivellement par le bas des normes sociales pour les salariés desdits pays (la problématique de la course vers l’abîme, « Race to the bottom ») résultant de l’utilisation par les entreprises des systèmes sociaux nationaux les moins coûteux, se superposent les inquiétudes liées à l’absence de progrès social pour les travailleurs du Sud, voire d’un accroissement des formes de travail dégradantes.
Du point de vue économique, de bas salaires ou des conditions de travail moins protectrices qui pèsent sur les coûts de production constitueraient un dumping social par analogie avec le concept de dumping commercial tel que défini à l’article VI du GATT qui établit le droit d’un pays à prendre des mesures compensatoires « lorsqu’un produit exporté est introduit sur le marché d’un pays importateur à un prix inférieur à sa valeur normale ».
Déjà en 1881, la Fédération des syndicats américains exerça des pressions sur le Congrès américain pour obtenir des mesures de protection contre la concurrence des pays à bas salaires. Le principe fut alors posé de « cost equalization », c'est-à-dire l’annulation, par le jeu des droits de douanes, de l’avantage concurrentiel procuré par les bas coûts de main d’œuvre. La notion de dumping social est apparue pour la première fois lors d’une conférence organisée par la Société des Nations (SDN) sur l’économie mondiale en 1922 et a été invoquée pour justifier les tarifs douaniers protectionnistes mis en place par les États-Unis de 1922 à 1930. La Charte de La Havane de 1948 prévoyait la création d'une Organisation internationale du commerce (OIC) totalement intégrée à l'ONU dont l’article 2 était consacré à l’emploi et insistait sur la nécessité de faire respecter des « normes de travail équitables ».
Pour les pays émergents et en développement, le juste échange ne réside pas dans l’application des mêmes règles en matière salariale ou de niveau de protection sociale. Dans la mesure où les différences de salaires renvoient à une différence de niveaux de développement ainsi qu’à un différentiel de productivité, ils font valoir que ces disparités sont un élément de leurs avantages comparatifs. De fait, le dernier rapport de l’Organisation internationale du travail sur les salaires51 fait état d’une augmentation des salaires dans certains pays émergents, dont la Chine,52 mais rappelle toutefois que des disparités importantes demeurent.
Dans ce contexte, un soupçon de protectionnisme a pesé sur les pays développés. C’est la raison pour laquelle, les pays en développement se sont toujours opposés à l’intégration de normes sociales dans les règles du commerce international.
À l’issue du cycle d’Uruguay qui a vu la création de l’OMC en 1994, une action conjointe de la France et des États-Unis avait inscrit la question de l’articulation entre le commerce et les normes sociales à l’ordre du jour de la Conférence de Singapour en 1996. Du fait de la très vive opposition des pays en développement, la déclaration finale de cette conférence a seulement rappelé l’attachement des membres au respect des normes de travail internationalement reconnues, tout en soulignant que l’avantage comparatif des pays en développement ne devait en aucune façon être remis en cause. Il était également précisé que l’Organisation internationale du Travail (OIT) était seule compétente pour connaître de ces questions. La question, à nouveau soulevée lors de la Conférence de Seattle en 1999, a été rayée de l’ordre du jour du cycle de Doha.
Il n’y a donc aucune référence aux normes sociales dans le corpus de l’OMC. Cette mise à l’écart des préoccupations sociales est illustrée dans le traitement de la question par l’Organe de règlement des différends. Lorsqu’il s’est trouvé confronté à un risque de conflit entre normes, c'est-à-dire à chaque fois qu’une norme internationale a été utilisée pour justifier une éventuelle infraction au droit de l’OMC, le juge de l’OMC a écarté la règle extérieure au profit de l’application exclusive des accords de l’OMC. De même, le juge de l’OMC fait une application très restrictive de la possibilité qui lui est donnée d’interpréter les règles de l’OMC à la lumière d’autres normes internationales. De façon générale, il n’a pas interprété l’article XX du GATT qui pose un objectif global de « développement durable » comme devant inclure les normes sociales.
De même, le principe de séparation des institutions internationales fait que les relations entre l’OMC et l’OIT compétente en matière sociale ne se situent qu’à un niveau technique et ne se traduisent concrètement que par la publication de quelques études conjointes.
Il apparaît donc qu’au plan multilatéral, le traitement des normes sociales est de la compétence de l’Organisation internationale du travail (OIT). Au sein de laquelle a été adoptée en 1998 la Déclaration relative aux principes et droits fondamentaux du Travail consacrant quatre types de droits fondamentaux des travailleurs, que sont :
– la liberté d’association et reconnaissance effective du droit de négociation collective ;
– l’élimination de toute forme de travail forcé ou obligatoire ;
– l’abolition effective du travail des enfants ;
– l’élimination de la discrimination en matière d’emploi.
Le respect de ces droits sociaux fondamentaux est envisagé comme une obligation inhérente à la qualité de membre de l’OIT, quel que soit le niveau de développement de l’État. Un mécanisme de suivi est par ailleurs institué permettant d’évaluer chaque année les efforts déployés par les États membres qui n’ont pas encore ratifié les conventions consacrées aux quatre droits fondamentaux. Bien qu’il n’existe au sein de l’OIT aucun mécanisme de sanction en cas de non-respect des conventions signées par ses membres, ce qui limite fortement leur force normative, ces principes constituent le noyau dur, tant des accords bilatéraux de commerce que des principes de responsabilité sociale des entreprises. C’est ainsi que, pour prendre sa décision de rétablir en 201353 les préférences généralisées au Myanmar (ex Birmanie) qu’elle lui avait retirées en 1997, la Commission européenne s’est appuyée sur une résolution de la Conférence internationale du Travail – organe de l’OIT –, qui avait, dans un rapport, considéré que les violations des principes des conventions de l’OIT n’étaient plus « graves et systématiques » et avaient en conséquence recommandé le rétablissement des préférences.
Assurer les conditions d’un juste échange implique que la violation des normes de travail fondamentales ne puisse être utilisée pour attirer les investissements internationaux. Cela suppose de considérer un degré de protection sociale et de normes de travail décentes comme un bien public mondial. Ce qui signifie que certains comportements sont hors cadre dès lors qu’ils ne respectent pas les droits fondamentaux des salariés et leur dignité.
La question se pose de savoir si l’OMC est tenue par ces principes, alors même que sa mission est d’assurer la stabilité des relations commerciales.
Le développement durable étant inscrit dans l’article XX du GATT, d’aucuns considéraient qu’il pouvait être modifié pour faire mention des préoccupations relatives aux normes sociales minimales inscrites dans la Déclaration relative aux principes et droits fondamentaux du travail de l’Organisation internationale du travail de 1998, dont le non-respect pourrait entraîner des sanctions commerciales.
Cela leur apparaissait séduisant car seule l’OMC dispose d’un pouvoir incitatif et coercitif par le mécanisme de règlement des différends. Elle pourrait donc imposer une adaptation des règles nationales en la matière, par exemple, en considérant que la violation des normes constitue une subvention déguisée. Les limites à cette approche sont rapidement apparues : elle a été refusée par les États membres qui estiment que le commerce n’est qu’un des vecteurs et non le principal pour promouvoir le développement durable. De fait, à chaque fois, que l’ORD s’est trouvé confronté à un risque de conflit entre une norme juridique internationale, le juge a écarté la règle extérieure au profit de l’application exclusive du corpus de règles de l’OMC.
Il s’ensuit que l’OIT est l’institution la plus à même de faire prévaloir la notion de travail décent.
Par ailleurs, face au besoin de régulation sociale, il manque à l’OIT une juridiction, qui interpréterait les normes qu’elle édicte. En effet, l’organe de contrôle du Bureau international du Travail (BIT) - secrétariat permanent de l’OIT- n’a aucun pouvoir juridique d’interprétation des conventions, qui appartient à la seule Cour internationale de justice. Celle-ci n’étant jamais saisie par les États, les organes de contrôle internes du BIT jouent un rôle prépondérant.
L’interprétation des règles se fait donc par les organes de contrôle interne du BIT, la direction des normes, ou par la commission des experts. Il s’agit d’une jurisprudence sans juridiction, ce qui n’est pas un facteur de sécurité juridique pour les différentes parties prenantes. Cela rend donc extrêmement difficile la mise en œuvre potentielle d’un mécanisme de question préjudicielle entre l’OIT et l’OMC. Il faudrait en conséquence revenir à la solution initialement prévue dans la Constitution de l’OIT, celle de la création d’une juridiction interprétative des normes du travail. La création d’une telle instance pourrait favoriser la mise en œuvre du mécanisme de plainte déposée par un Membre à l’encontre d’un autre, en cas de violations graves et persistantes des droits sociaux fondamentaux par un État membre.
Enfin, l’OIT pourrait participer activement à l’élaboration des chapitres « développement durable » de l’ensemble des accords de libre-échange négociés notamment par l’Union européenne. Et collaborer davantage avec l’OMC notamment par l’institution d’observateurs croisés.
Le cinquième rapport du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) fait un constat alarmiste sur le réchauffement climatique et sur ses conséquences sur l’atmosphère, les océans, la cryosphère et les événements extrêmes. Le monde émet de plus en plus de gaz à effets de serre et la courbe des émissions s’est installée au-dessus des scénarios pessimistes. En 2013, l’humanité a émis plus de 10,7 milliards de tonnes de carbone (soit 40 milliards de CO2), en hausse de 2,1 % par rapport à 2012.
L’articulation entre normes environnementales et règles commerciales est actuellement minimale. La gouvernance environnementale est assurée dans le cadre des accords multilatéraux pour l’environnement (AME) qui, au nombre d’environ trois cents, s’appliquent à des espaces et des champs très différents.
Ainsi, la Convention sur la commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacés d’extinction (CITES) est le premier en date en 1972 ; la Convention de Vienne pour la protection de la couche d’ozone et le Protocole de Montréal sont relatifs aux substances qui appauvrissent la couche d’ozone ; la Convention de Nairobi traite de la diversité biologique ; le Protocole de Kyoto est adossé à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques ; plus récemment le Protocole de Nagoya de 2010 réglemente la diversité biologique et l’utilisation des ressources génétiques. Aucune coordination n’existe entre ces différents AME, le programme des Nations Unies pour l’environnement n’en assurant pas un suivi coordonné et la plupart d’entre eux ne prévoient aucun mécanisme de sanction.
Lors de la conférence ministérielle de Doha en 2001, les membres de l’OMC avaient convenu d’engager des négociations sur les relations entre les règles de l’OMC et les différents AME. Des négociations ont eu lieu dans le cadre des sessions du commerce et de l’environnement mais elles se sont limitées à l’applicabilité des règles aux membres ayant signé les AME. La préoccupation de l’environnement est de fait une préoccupation marginale de l’OMC même si l’Organe d’appel a permis d’amorcer un mouvement vers une meilleure prise en compte des AME dont des dispositions peuvent influer sur les échanges, comme l’interdiction du commerce de certaines espèces.
Par le biais de l’article XX du GATT posant un objectif de développement durable, l’ORD a considéré comme légitimes les mesures commerciales requises par les AME pour atteindre des objectifs environnementaux, à condition de ne pas être une simple restriction déguisée au commerce international. Ainsi, le différend relatif aux crevettes54 a posé le principe de la compatibilité des règles de l’OMC avec les mesures prises par les membres pour s’acquitter des obligations contractées au titre de la CITES.
L’action de l’OMC ne constitue en tout état de cause pas une forme de régulation multilatérale en faveur de l’environnement, la jurisprudence de l’ORD se limitant à autoriser les membres à prendre des mesures de protection commerciale au nom de l’environnement, pour autant que ces mesures soient justifiées au regard de l’article XX du GATT.
En conséquence, la compétence de l’OMC en matière environnementale est limitée et l’initiative du secrétariat de l’OMC de rédiger un rapport sur le commerce et le changement climatique en 2009 en collaboration avec le Programme des Nations unies pour l’environnement (PNUE) a été vivement critiquée par les pays en développement alors qu’il se limitait à un inventaire de mesures possibles et de leur compatibilité avec les règles de l’OMC, sans établir de préconisations.
Plusieurs mesures seraient de nature à renforcer la place les préoccupations environnementales au sein de l’OMC :
– en premier lieu, dans le cadre du cycle de Doha, il a été convenu de négocier la réduction, voire la diminution des obstacles tarifaires et non tarifaires visant les biens et services environnementaux. Les négociations n’ont pas avancé, notamment du fait des divergences sur la notion même de biens et services environnementaux. Pour certains, ils désignent les biens et services permettant de lutter contre la pollution ; d’autres considèrent qu’ils doivent être entendus comme recouvrant tous les biens fabriqués de telle sorte qu’ils favorisent une gestion durable des ressources (papier recyclé par exemple). La question des biens environnementaux devrait donc être intégrée dans la feuille de route de l’après Bali ;
– en deuxième lieu, les procédures de règlement des différends devraient permettre de mieux articuler les préoccupations environnementales et commerciales. Alors qu’aucun lien n’existe entre l’ORD et le secrétariat des différents accords environnementaux, une procédure de consultation entre les deux institutions permettrait de donner une issue plus équilibrée au litige en permettant que les préoccupations environnementales soient mises sur le même plan que les préoccupations commerciales ;
– en troisième lieu, compte tenu de l’incertitude juridique quant à la compatibilité entre les accords de l’OMC et les AME, l’article XX du GATT devrait être complété afin de reconnaître, au nom du principe du développement durable qui y est affirmé, l’égalité de statut entre les AME et les règles de l’OMC. En cas de conflit de normes, il devrait être possible qu’un état puisse opposer à un état membre de l’OMC les dispositions d’un AME auquel il n’est pas partie. Ce qui n’est actuellement pas possible55.
Une organisation mondiale de l’environnement ?
Depuis le début des années 90, se pose la question de la création d’une organisation mondiale de l’environnement afin, selon l’expression de M. Michel Camdessus, ancien directeur du FMI, de compléter les « îlots manquants de l’archipel international ». En effet, alors que les questions économiques, financières et commerciales sont gérées par des organisations internationales structurées et que les préoccupations sociales et sanitaires sont portées par l’OIT ou l’Organisation mondiale de la santé, aucune organisation internationale spécialisée n’est chargée de la régulation environnementale.
La gouvernance environnementale est de fait lacunaire. Les différents AME ne sont ni coordonnées, ni hiérarchisés. Le Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE), créé en 1972 au sein du système des Nations Unies, a la charge de trois missions : surveiller l’état de l’environnement mondial ; servir de plate-forme aux actions et politiques à mettre en œuvre et préparer les conventions et accords internationaux nécessaires (le PNUE a été à l’origine de la convention de Vienne et du Protocole de Montréal sur la couche d’ozone) ; remplir des fonctions de formation, d’échanges et de diffusion de bonnes pratiques. Mais ces instances n’ont pas réussi à imposer une gouvernance de l’environnement.
Des pays comme la France et l’Allemagne en ont porté le projet alors que les États-Unis ou les pays du Sud comme la Chine y étaient opposés. Les États-Unis estiment que les questions environnementales ayant une incidence sur les échanges doivent être traitées au sein de l’OMC mais plus fondamentalement, ils craignent qu’une telle organisation puisse formuler des contraintes pesant sur leur développement technologique. Les pays du Sud font valoir le risque de normes environnementales trop sévères sur leurs capacités de développement.
Les avantages d’une telle organisation ont été synthétisés par le Conseil d’analyse économique dans les termes suivants : « Cette Organisation mondiale de l’environnement devrait jouer un rôle déterminant dans l’élaboration de la doctrine, serait chargée du suivi des engagements, et de la surveillance de l’état de l’environnement ».
Pourquoi envisager de créer une nouvelle organisation internationale, et ainsi risquer de contribuer à l’inflation institutionnelle ? Et pourquoi la cause de l’environnement serait-elle mieux servie par une institution unique, plutôt que par un ensemble d’accords sectoriels?
La constitution d’une OME serait d’abord cohérente avec le principe de spécialisation. Elle conduirait à doter l’OMC et les autres institutions internationales d’un interlocuteur légitime, et leur permettrait de se concentrer sur leurs missions, plutôt que de devoir traiter, de manière forcément biaisée, des questions environnementales au fur et à mesure de leur apparition.
La création de l’OME répondrait par ailleurs à un double objectif d’efficacité et de rationalisation de la doctrine environnementale. Elle permettrait, d’abord, de réduire les coûts induits par la multiplicité des accords multilatéraux et des secrétariats correspondants, qui sont actuellement dispersés dans une dizaine de capitales, en opérant un regroupement des secrétariats, en créant des outils communs de surveillance et de contrôle, et en mettant en place des organes communs de règlement des différends. « Elle permettrait de développer données et analyses, de structurer un débat, et de faire le pont entre expertise scientifique et consensus politique. Elle contribuerait ensuite à consolider la doctrine internationale dans le domaine environnemental sur la base des principes – pollueur-payeur, précaution, responsabilité, consentement informé, etc. – aujourd’hui déclinés dans les différents accords sectoriels, ainsi que de mieux assurer leur cohérence, celle des instruments associés, et celle des moyens employés pour assurer leur compatibilité avec les règles du commerce international. »56
En France, la création d’une telle Organisation a été récemment soutenue par le Conseil économique, social et environnemental (CESE)57.
S’agissant de sa structure, selon ce conseil, elle pourrait être une agence spécialisée de l’ONU qui se substituerait au Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE) pour regrouper les AME existants et assurer entre eux une meilleure cohérence.
Quant à son rôle, il lui incomberait d’adopter « un corpus fondamental de réglementation environnementale sur la base des AME et d’en assurer le respect ».
En son sein pourrait être définie la portée des responsabilités communes mais différenciées. Mais une fois le principe posé et même en faisant abstraction des difficultés liées à la non ratification de ces conventions par certains pays majeurs, quels instruments pourraient être mis en œuvre pour appliquer ce principe ? Quels critères objectifs adopter (empreinte écologique, indice de développement humain…)? Quelles sanctions pourraient être appliquées dans un ordre juridique international dont l’une des caractéristiques est que les États sont à l’origine de la formation du droit ?
Ladite organisation pourrait être chargée de définir ces critères et être par ailleurs investie d’une mission de surveillance et de suivi des engagements ainsi que le propose le CESE : « Elle serait donc investie d’une mission de surveillance, de prévention des atteintes à l’environnement et de suivi des engagements ». À cette fin, le CESE serait favorable à ce qu’un mécanisme soit institué sur le modèle de l’Organe de règlement des différends de l’OMC. A l’heure où l’on pointe le danger d’une concurrence « par le bas » en termes de normes environnementales, c’est à ce prix que le développement durable pourra devenir une réalité concrète. La création d’une OME répondrait aussi à un impératif de rationalisation et d’efficacité. Bien loin de sanctuariser l’environnement, « il s’agit de se donner les moyens d’une simplification, en passant d’une situation où les accords, programmes et secrétariats sont nombreux à une organisation fédératrice ».
L’Union européenne porte une responsabilité particulière en la matière. Elle a adopté en 2009 le plan d’action dit « Paquet climat-énergie » à l’échéance 202058. La Commission européenne a publié, le 22 janvier 2014, une proposition sur cette politique à l’horizon 2030, qui comprend notamment une réduction des émissions de gaz à effet de serre de 40 % par rapport à leur niveau de 1990 et un objectif contraignant de porter la part des énergies renouvelables à au moins 27 %.
Si l’Europe veut continuer à agir pour la préservation du climat en pariant sur l’effet d’entraînement de son attitude sur l’ensemble des participants aux négociations multilatérales, il lui faut préserver la compétitivité de ses entreprises. En effet, des surcoûts liés au respect des réglementations environnementales et à la tenue de l’objectif de limitation des effets de serre peuvent conduire à des pertes de parts de marché et à des délocalisations progressives de la production. Ceci n’est d’ailleurs globalement pas favorable à la diminution des émissions de CO2 dans la mesure où ce sont les installations non contraintes au titre des émissions qui assureraient la production à l’extérieur de l’Europe. Cependant, il est impératif de prendre aussi en considération, comme le note le Rapport sur l’évaluation des impacts joint à la proposition de politique climatique, que réduire les émissions de CO2 peut créer des emplois dans les secteurs des énergies renouvelables59. Il s’agit donc de trouver le moyen de protéger l’industrie européenne de pertes de compétitivité internationale liées à ce surcoût afin de pouvoir continuer à avancer en termes de politique climatique.
Depuis la Convention sur les changements climatiques issue des travaux de la Conférence de Rio en 1992, la communauté internationale s’efforce de parvenir à une régulation environnementale. Après la prolongation du protocole de Kyoto à la Conférence de Durban en 2011, la Conférence de Doha en décembre 2012 et la Conférence de Varsovie de novembre 2013 se sont heurtées aux difficultés d’évaluation des engagements et de convergences entre les pays industrialisés historiquement responsables du réchauffement climatique et les pays émergents soucieux de ne pas entraver leurs perspectives de développement par des engagements sur des normes environnementales contraignantes, notamment au nom du principe de responsabilité commune mais différenciée.
Il est crucial qu’un accord mondial juridiquement contraignant soit adopté lors de la Conférence de Paris en 2015. En effet, la juxtaposition de politiques nationales, même dynamiques, conformément à la logique du bottom up préconisée par la Chine et les États-Unis en application de laquelle les engagements sont définis par ce que les États veulent faire, ne sera pas à la mesure des enjeux.
La formulation d’un tel accord suppose :
– une réévaluation des responsabilités des grands pays et particulièrement des grands émergents. Le dernier rapport du Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE) montre que les pays en développement contribuent pour 60 % aux émissions mondiales de carbone. La Chine est le premier émetteur à hauteur de 29 % et est passée à une moyenne de 1,9 tonne de carbone par habitant en quelques années, ses émissions ayant augmenté de 6 % en un an. Les États-Unis sont responsables de 17 % des émissions mondiales, à hauteur de 4,4 tonnes de carbone par habitant tandis que l’Union européenne compte pour 11 % des émissions, soit 1,9 tonne de carbone par habitant. Les formules de répartition des efforts devront tenir compte, en équité, du poids économique et démographique des pays ainsi que de leurs responsabilités passées ou futures dans le changement climatique. Mais en tout état de cause, il est indispensable que la Chine et les États-Unis, responsables de la majorité des émissions, soient parties actives à la négociation d’un tel accord ;
– une représentation large de la question du financement pour les pays en développement qui doit englober à la fois la prise en charge des pertes et dommages causés par le changement climatique et le financement de la lutte contre le changement climatique.
Si les négociations multilatérales sur le climat restaient dans une dynamique négative, la question de l’institution d’une taxe carbone aux frontières européennes se poserait.
La Commission européenne s’est toujours montrée opposée au principe d’une telle taxe qui viserait à compenser les distorsions liées au système européen des quotas d’émission, entre les entreprises qui y sont soumises et celles qui en sont exclues.
Sur la base du rapport sur le commerce et le changement climatique en 2009 en collaboration avec le Programme des Nations unies pour l’environnement (PNUE), la Représentation française auprès de l’Union européenne a publié une note sur un mécanisme d’inclusion carbone qui obligerait les importateurs de biens manufacturés hors d’Europe à acheter des permis de polluer dans le cadre du système de quotas d’émissions qui pourrait prendre la forme d’un ajustement à la frontière.
Votre rapporteure estime que l’institution d’un tel mécanisme, dans des conditions compatibles avec les règles de l’OMC, doit être étudiée.
Taxe carbone et Organisation mondiale du commerce
La taxe extérieure carbone viserait à compenser les distorsions nées du système européen des quotas d’émissions, entre les entreprises de l’Union européenne qui y sont soumises et celles qui en sont exclues. Il s’agit plus précisément de protéger l’industrie européenne de pertes de compétitivité internationale qui résulteraient du surcoût lié à la politique de réduction des gaz à effet de serre — via les quotas d’émissions. Les possibilités laissées par l’Organisation mondiale du commerce (OMC) pour compenser ce surcoût ont été étudiées par la mission d’information sur l’effet de serre de l’Assemblée nationale ainsi qu’en 2008 par le ministère de l’écologie, du développement et de l’aménagement durable (Medad).
Une solution consisterait à mettre en place un mécanisme d’ajustement de taxe à la frontière (ATF). Il s’agirait de rembourser aux exportateurs nationaux les taxes qu’ils subissent, en l’occurrence sur le CO2, et de taxer de la même façon les importations. Ce système correspond au régime courant de la TVA.
Le groupe de travail sur les ajustements fiscaux à la frontière du GATT de 1970 a retenu une définition de l’ATF adoptée par l’OCDE. Il s’agit de « toutes mesures fiscales qui donnent effet, complétement ou partiellement, au principe du pays de destination, c’est-à-dire qui permettent d’exonérer, en totalité ou en partie, les produits exportés de la taxe grevant dans le pays exportateur les produits nationaux similaires vendus aux consommateurs sur le marché intérieur et de prélever, en totalité ou en partie, sur des produits importés vendus aux consommateurs la taxe grevant dans le pays importateur les produits nationaux similaires ».
Plusieurs conditions seraient néanmoins nécessaires à la mise en place d’un ATF dans le cadre du régime général de l’OMC.
En premier lieu, pour que le système actuel de quotas de gaz à effet de serre de l’Union européenne puisse être assimilé à une taxe, il faudrait qu’ils soient alloués par mise aux enchères, avec livraison à prix unique.
Mais, dans la mesure où la taxe doit porter sur les produits, en déterminer le montant à en partant du prix des enchères n’est pas chose aisée. En effet, si le marché de quotas assure que le coût marginal de réduction des émissions est le même pour toutes les installations soumises au marché, il n’assure pas que le coût marginal de réduction sur le produit soit le même. Il n’existe pas deux installations émettant les mêmes émissions par unité de production. Face à cette difficulté de fixer un niveau de taxe sur les produits qui serait le niveau à retenir pour les ajustements aux frontières (c’est-à-dire pour le montant de l’exonération et pour celui de la taxe sur les produits importés), le Medad suggère qu’il serait plus facile de taxer les quantités de gaz à effet de serre nécessaires à la fabrication des produits (« émissions spécifiques ») ou d’organiser des marchés de quotas d’émissions spécifiques. Ces deux instruments seraient nécessairement sectoriels.
Une troisième difficulté s’ajoute aux deux premières. L’information sur les émissions générées pour la production d’une unité n’est pas disponible au niveau international. Une solution, proposée par MM. Ismer et Neuhoff (2004), consiste à retenir un niveau équivalent à la meilleure technologie disponible. Cette dernière notion est cependant susceptible d’être contestée au niveau international par tout pays faisant valoir une discrimination entre pays. Il existe de nombreuses technologies pour un même secteur et les industriels seraient obligés de fournir des informations confidentielles sur leurs méthodes de production.
Par ailleurs, au regard de la jurisprudence de l’organe de règlement des différends (ORD), il semble impossible de taxer différemment deux produits ayant les mêmes caractéristiques physiques, comme l’acier par exemple, mais dont la production de l’un engendre des émissions de CO2 bien supérieures à celles de l’autre. C’est le problème des « procédés et moyens de production non incorporés », c’est-à-dire qui ne laissent pas de trace dans le produit final, question sur laquelle les pays de l’OMC sont en désaccord. Plus simplement, afin qu’une tonne d’acier en provenance d’autres pays supporte la même taxe qu’une tonne d’acier européenne, la taxation doit être forfaitaire, indépendamment du contenu carbone de la tonne d’acier de ces pays. La possibilité de taxer des produits, d’après leurs méthodes de production si elles ne laissent pas de trace dans le produit est donc controversée. La jurisprudence de l’ORD dans l’affaire Etats-Unis-taxes sur le pétrole offrirait cependant une incertitude favorable à la taxation de substances ne devant pas nécessairement être incorporées dans le produit final.
Il serait ainsi possible d’imaginer une solution consistant à taxer les importations de manière uniforme, à condition d’établir un niveau standardisé d’émissions spécifiques par secteur (les émissions de la meilleure technologie disponible par exemple), à charge pour l’importateur de démontrer que son produit a généré moins d’émissions de CO2 que le standard pour être exonéré partiellement ou totalement de la taxe. Ces conditions seraient nécessaires, mais pas forcément suffisantes, pour garantir l’acceptation de la mesure par l’OMC.
Enfin, les régimes d’exception de l’OMC concernant l’environnement, via l’article XX du GATT, ouvrent une autre possibilité. Ils permettent aux États membres d’adopter des mesures de sauvegarde de l’environnement (paragraphes b et g). Dans ce cadre, les critères d’acceptation d’un ajustement fiscal aux frontières sont différents. Les deux régimes d’exception prévus respectivement par les paragraphes b) et g) de l’article XX ont une portée différente. Le paragraphe b) mentionne des « mesures nécessaires à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux ». Toutefois, la jurisprudence interprète de manière étroite le critère de nécessité. Ainsi, un État peut difficilement justifier d’une mesure incompatible avec le GATT en la déclarant nécessaire au sens de l’article XX b). En effet, dans le cas où une mesure compatible avec le GATT « n’est pas raisonnablement disponible, l’État a obligation d’utiliser, parmi les mesures dont il dispose raisonnablement », celle qui est la moins incompatible. L’ORD pourrait ainsi considérer que d’autres mesures moins incompatibles avec le GATT que l’ajustement de taxe aux frontières pourraient être envisagées par les États. En effet, le protocole de Kyoto ne prévoit pas de mesures commerciales particulières, mais un large panel de mesures aux fins de lutte contre le changement climatique.
En revanche, d’après la même analyse effectuée par le Medad, le régime du paragraphe g) serait plus favorable à l’instauration d’un ajustement fiscal aux frontières. Il mentionne des « mesures se rapportant à la conservation des ressources naturelles épuisables, si de telles mesures sont appliquées conjointement avec des restrictions à la production ou à la consommation nationales ». D’une part, au regard de la jurisprudence assimilant notamment l’air à une ressource naturelle épuisable, il est permis d’affirmer, selon le Medad, que l’atmosphère pourrait également être qualifiée de ressource naturelle épuisable. D’autre part, le lien entre la mesure commerciale restrictive et son objectif semble être moins contraignant au sens du régime du paragraphe g) qu’aux termes du paragraphe b) qui selon la jurisprudence exige une relation « étroite et réelle » entre la mesure et l’objectif visé. Comme l’objectif premier de la taxe est de rééquilibrer la concurrence, et non pas de réduire les émissions de gaz à effet de serre, il est difficile de savoir si l’ORD considérera la taxe comme « se rapportant à la conservation des ressources naturelles épuisables ».
De plus, l’article XX ne permet pas d’utiliser des mesures commerciales pour corriger directement des problèmes de compétitivité. D’après l’analyse de certains experts, l’ATF pourrait être admis à condition que la taxe soit calculée sur la base des émissions réelles de CO2 de chaque producteur (relation « étroite et réelle » entre l’ATF et l’objectif). Une autre étude du Medad précise cependant qu’il faudrait « que les pays soient capables d’identifier et de surveiller les produits utilisés pour fabriquer les produits importés. Le plus souvent cette identification ne peut être réalisée que par une inspection sur le site, un suivi et une homologation du procédé de production dans le pays exportateur ». Une autre solution serait d’exiger des industriels la communication d’informations sur leurs émissions et procédés de production, qui revêtent un caractère confidentiel.
Par ailleurs, dans le cadre des régimes d’exception de l’article XX, si la jurisprudence de l’organe d’appel dans l’« affaire des crevettes » était maintenue, il serait envisageable, selon l’étude du Medad, de taxer différemment des produits en fonction de leurs procédés et méthodes de production (PMP) « non incorporés » dans le produit final, c’est-à-dire en fonction de leur teneur en carbone.
Il convient en outre de relever que dans le cadre d’allocation gratuite de quotas d’émissions, tout ajustement de taxe à la frontière est incompatible avec l’article XX du GATT, paragraphe g). Celui-ci précise en effet que les mesures doivent « être appliquées conjointement avec des restrictions à la production ou à la consommation nationales ». La restriction imposée à la production « nationale » (c’est-à-dire des pays de l’Union européenne) serait, du fait de l’allocation gratuite, bien inférieure à celle qui serait imposée aux producteurs extérieurs à l’Union européenne.
L’ATF envisagé devra respecter les prescriptions du texte introductif de l’article XX du GATT tel qu’éclairé par la jurisprudence. À titre d’exemple, les États désireux d’instaurer un ATF seront soumis à l’obligation de mener des négociations sérieuses avec leurs partenaires de l’OMC, malgré les négociations multilatérales sur le climat.
Il convient de mentionner que dans la Lettre du Centre d’études prospectives et d’information internationales (CEPII) de mai 2013 consacrée à l’« ajustement carbone aux frontières (ACF) et risques de représailles commerciales : quel coût pour l’UE ? », les auteurs concluent de la façon suivante : « Suite à la mise en place d’un ACF sur ses importations de biens intensifs en énergie, l’UE pourrait être visée par des représailles. Les pertes de revenu réel ou de PIB qu’elle aurait alors à supporter pourraient être marginales. En revanche, les secteurs affectés par les représailles pourraient contester fortement cet ACF ».
4. Redonner force à la volonté politique et mettre les entreprises multinationales face à leurs responsabilités sociale et environnementale
Le rôle et le poids des entreprises multinationales dans le commerce mondial s’est considérablement accru. Elles savent tirer parti des préférences commerciales dont bénéficient les pays dans lesquels elles s’installent. Elles portent sans doute une responsabilité particulière dans les accidents tragiques qui surviennent de plus en plus souvent du fait des pratiques d’intensification de la production et des rythmes de travail imposés aux salariés.
Votre rapporteure déplore que des drames comme celui du Rana Plaza apparaissent comme nécessaires à la prise de conscience, à la sensibilisation et à l’action. Il aura fallu cette tragédie pour que le niveau des salaires soit relevé de 30 à 68 dollars par mois dans l’industrie textile du Bangladesh.
En l’absence de règles internationales contraignantes, l’action des entreprises multinationales peut être encadrée par des instruments de droit souple (« soft law ») dont le principal défi est celui de leur mise en œuvre.
La responsabilité sociale des entreprises (RSE) définie comme « l’intégration volontaire, par les entreprises, de préoccupations sociales et environnementales à leurs activités commerciales et leurs relations avec les parties prenantes », est une des modalités d’encadrement des dérives de la mondialisation.
L’instrument le plus abouti est celui des Principes directeurs à l’intention des entreprises multinationales, élaboré par l’OCDE en 1976 et révisé en 2001 et 2011 afin d’intégrer la protection de l’environnement, les droits de l’homme, la diligence raisonnable et la responsabilité vis-à-vis de la chaîne d’approvisionnement. Ces principes directeurs constituent un ensemble de normes détaillé. Les États sont tenus, pour leur application, de mettre sur pied un point de contact national (PCN) comme instance de plainte. S’il connaît une certaine effectivité grâce à ce mécanisme de suivi, qui permet aux syndicats et aux organisations non gouvernementales de communiquer sur le comportement d’une entreprise, le dispositif atteint rapidement ses limites. L’organisation et les compétences des points de contacts varient selon les pays. La participation des entreprises au processus de médiation est volontaire. Par ailleurs, les procédures manquent souvent de transparence et elles n’impliquent aucune sanction juridique, même si elles peuvent conduire à une condamnation publique crainte par les entreprises soucieuses de leur image de marque. Après l’accident du Rana Plaza, le gouvernement français a saisi le point de contact national qui a rendu un rapport qui fait des préconisations autour de trois axes prioritaires : traçabilité, transparence et juste partage des responsabilités60.
D’autres instruments de RSE existent. Ainsi, le pacte mondial dans le cadre des Nations Unies (« Global compact ») est moins ambitieux que les principes directeurs de l’OCDE. N’instituant aucun mécanisme de contrôle, « son bénéfice se résume sans doute à ce qu’il vient corroborer la possibilité conceptuelle d’une opposabilité directe des droits sociaux fondamentaux, tels qu’ils sont définis par l’OIT, aux entreprises transnationales. Au demeurant, cette possibilité a déjà pu être observée face au développement des mécanismes d’autorégulation adoptés par les entreprises transnationales formant la responsabilité sociale des entreprises »61 .Quant aux principes directeurs de l’ONU adoptés en juin 2011 par le Conseil des droits de l’homme, ils reposent sur trois piliers : l’État a l’obligation de protéger les droits humains, les entreprises ont la responsabilité de respecter ces droits et l’accès à la justice pour la garantie des dommages doit être garanti.
Les lignes directrices de la « norme ISO 26000 », élaborées par l’Organisation internationale de normalisation (organisation non gouvernementale composée d’organismes nationaux de normalisation), précisent l’intégration des normes de responsabilité sociétale, de gouvernance et d’éthique d’une manière élargie. Il ne s’agit pas d’une certification mais d’un guide de bonnes pratiques proposé aux entreprises qui s’articule autour de sept axes centraux que sont la gouvernance de l'organisation, les droits de l'Homme, les relations et conditions de travail, l'environnement, la loyauté des pratiques, les questions relatives aux consommateurs ou encore les communautés et le développement local.
Sur le modèle de ce qui est actuellement recherché en matière d’investissement socialement responsable (ISR), il serait souhaitable que cette norme ISO 26000 tende vers une certification et/ou une labellisation permettant ainsi aux entreprises d’être référencées et soumises à un mécanisme de vérification.
Des progrès sont également possibles en matière d’achats responsables. A ce titre, saluons les initiatives françaises que sont la Charte de la sous-traitance, qui élabore un code de conduite avec un label, et celle de l’Association française de normalisation (AFNOR) qui a élaboré en juillet 2012 une norme proposant des recommandations aux décideurs et aux acheteurs souhaitant maîtriser leurs coûts, tout en anticipant les risques sociaux et environnementaux des achats. Cette norme française devrait être portée au niveau international. En effet, un groupe de travail a été constitué en septembre 2013 avec le Brésil à propos de la norme ISO 26000. L’objectif de cette initiative est de mettre en place des règles internationales sur les achats responsables qui pourraient contribuer à la mise en place d’une labellisation des entreprises respectant les normes internationales en matière d’achats responsables.
Il est important que ce type de pratiques (référentiels, certifications…) puissent se généraliser afin de pouvoir agir sur les sous-traitants et de disposer de moyens de contrôle sur l’ensemble des donneurs d’ordre pour mettre en œuvre des actions correctives si cela s’avère nécessaire.
Enfin, pour répondre à un souci de transparence, l’initiative « Global reporting Initiative » (GRI) incite les entreprises à publier des rapports sur leurs actions en faveur du respect des normes sociales et environnementales.
Outre ces normes internationales de RSE, des entreprises ont adopté des codes de conduite62, soit à titre individuel, soit à titre collectif. Même si ces codes peuvent constituer une garantie d’application minimale de certaines normes, on perçoit vite les limites d’une autorégulation qui s’appuie sur la valeur marchande de valeurs morales. Il est difficile de distinguer le « greenwashing » (affichage environnemental) d’engagements réels. En effet, les codes de bonne conduite sont souvent élaborés par les firmes elles-mêmes, sans participation réelle des parties prenantes (syndicats et salariés). Leur contenu est fréquemment formulé de façon peu précise, sans référence explicite aux normes internationales. Ils ne font pas l’objet d’une information détaillée des personnels et les mécanismes de contrôle sont lacunaires. Ainsi l’alliance de distributeurs et détaillants textiles, « Ethical trading initiative », qui compte dans ses rangs les principaux distributeurs de vêtements fabriqués au Bangladesh avait formulé un tel code de conduite.
Les entreprises multinationales peuvent également participer à des accords collectifs transnationaux. Il en existe actuellement une soixantaine, essentiellement signés par des entreprises originaires de l’Union européenne avec des fédérations syndicales internationales représentant des salariés provenant d’une même activité (métallurgie, chimie, construction, services)63. Mais comme pour les codes de conduite, le champ opératoire de ces accords varie d’un instrument à l’autre et s’ils s’adressent toujours aux salariés des filiales des groupes, ils n’intègrent pas systématiquement les salariés des sous-traitants. En revanche, ils différent des codes de conduite dans la mesure où ils sont construits en référence aux principes des organisations internationales et leur contenu est négocié par des fédérations syndicales internationales favorables à l’utilisation des standards de l’OIT. La grande difficulté de l’application de ces accords transnationaux est liée à leur statut juridique – celui d’un accord collectif – dans des États qui ne reconnaissent pas, dans leur droit interne, les accords collectifs. De fait, l’efficacité d’un accord transnational repose moins sur son applicabilité nationale que sur les procédures de suivi organisées par les fédérations syndicales internationales.
S’agissant de l’Union européenne, elle a depuis le Conseil européen de Lisbonne de mars 2000, inscrit la RSE au rang des priorités politiques et a défini une stratégie globale dans sa communication d’octobre 201164. L’action de l’Europe s’insère dans le cadre général des initiatives menées par les organisations internationales, fait appel à l’ensemble des instruments et s’appuie sur les stratégies nationales. Chaque État membre doit en principe définir des plans d’action de RSE ou à tout le moins, des listes d’actions prioritaires. La France a ainsi transmis en février 2013 un nouveau plan national de développement de la RSE65.
La principale difficulté tient au mode de fonctionnement des chaînes mondiales d’approvisionnement, notamment dans la filière textile-habillement qui est mondialisée, complexe et éclatée et où les relations d’affaires ont des contours imprécis et changeants. La segmentation juridique et géographique des processus de production fait qu’il est difficile de déterminer les responsabilités.
Dans ce contexte, différents outils peuvent être utilisés pour amener les entreprises à respecter les termes d’un juste échange, au sens où elles ne doivent pas exercer une pression sur les coûts de production qui aille à l’encontre de conditions de travail décent :
– l’obligation de vigilance tout au long de la chaîne de production et d’approvisionnement figure dans les principes directeurs de l’OCDE. L’Union européenne pourrait donner un contenu plus contraignant à cette obligation en instaurant un devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre sous forme d’une obligation de moyen de prévention de violation des droits humains ou de dommages environnementaux graves ;
– l’indemnisation juste et complète des victimes d’accidents est une modalité d’application du principe de vigilance. À la suite de l’accident du Rana Plaza, un accord portant sur l’indemnisation a été signé entre des ONG et des donneurs d’ordre. Des entreprises ont versé plusieurs mois de salaires aux familles. Cependant, cette indemnisation repose plus ou moins sur leur bonne volonté. L’Organisation internationale du travail participe à l’élaboration, en liaison avec les syndicats, d’un modèle d’indemnisation en se basant sur la convention 121 de l’OIT relative aux prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles. Ce modèle repose sur les facteurs suivants : niveau antérieur de rémunération, espérance de vie, niveau d’invalidité. Une meilleure assise juridique de l’OIT serait de nature à améliorer les conditions d’indemnisation ;
– l’amélioration de la transparence participe aussi au devoir de vigilance. La Commission européenne a présenté une proposition de directive afin d’accroître la transparence de certaines sociétés en matière sociale et environnementale66. Les sociétés concernées devront publier des informations sur leurs politiques, les risques liés et les résultats obtenus en ce qui concerne les questions environnementales, sociales et de personnel, de respect des droits de l’homme et de lutte contre la corruption. Cette initiative concrétise l’ambition affichée par la Commission européenne dans sa communication de 201167. Augmenter substantiellement le nombre d’entreprises européennes publiant des informations participerait à une meilleure responsabilisation des entreprises quant à l’impact de leurs activités et une meilleure information des actionnaires. Il est donc important que ce texte soit adopté rapidement vu l’urgence de l’adoption d’un cadre harmonisé et contraignant de transparence à l’échelle européenne.
Plusieurs axes d’amélioration du projet de directive peuvent être envisagés :
– la liste des thèmes sur lesquels les informations sont données devrait être plus précise et ne pas se limiter à des thématiques générales (environnement, responsabilité sociale, respect des droits de l’homme et prévention de la corruption). Afin que le dispositif soit plus efficace, pour chacun des thèmes, des informations plus précises devraient être exigées sur des sujets essentiels, par exemple, sur les relations entretenues avec les sous-traitants ou en matière environnementale, l’impact prévisible sur la santé ou la sécurité. A cette occasion, des indicateurs mériteraient d’être définis ;
– la qualité et la crédibilité des informations devraient être renforcées par l’introduction d’un mécanisme de vérification s’appuyant sur l’intervention d’un observateur indépendant ;
– cette obligation de transparence devrait s’appliquer pays par pays et sur les activités et relations avec les sous-traitants et l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement ;
– la pression de l’opinion publique et l’action citoyenne peut être un moyen de pression efficace pour des entreprises pour qui le développement durable est un argument de marketing et fait partie d’une stratégie commerciale. Toutefois, la prudence doit être de mise quant à l’utilisation de certaines mesures comme le boycott des produits qui peut avoir des effets pervers ;
– une politique d’achats publics responsables dans les appels d’offres, par le biais d’organismes tels la COFACE, l’Agence française de développement (AFD) ou la Banque mondiale contribuerait à renforcer la prise en compte des principes directeurs de l’OCDE dans le commerce international. La Banque mondiale a ainsi entamé une réforme des procédures de passation des marchés publics intégrant des exigences environnementales et sociales.
Si l’Europe dispose de la compétence commerciale, elle n’a pas vraiment défini de stratégie. Votre rapporteure pense qu’elle devrait se définir autour du principe de réciprocité.
Au plan multilatéral, la notion de réciprocité est au cœur des principes du GATT puis de l’OMC, mais s’y superposent deux autres concepts : la clause de la nation la plus favorisée instaurée dès le début du GATT (par laquelle les concessions bilatérales sont étendues à l’ensemble des membres) et le traitement spécial et différencié instauré par la clause d’habilitation introduite en 1979 en faveur des pays en développement afin d’assurer leur insertion dans les échanges mondiaux (via une asymétrie des concessions).
Dans les faits, le principe de réciprocité a très vite été abandonné, au profit de la clause de la nation la plus favorisée, sauf dans les d’accords plurilatéraux, où cette dernière clause n’est pas applicable puisque ces accords n’engagent pas la totalité des membres de l’OMC.
Le juste échange suppose par définition des engagements réciproques et des concessions mutuelles. Or, ce n’est que récemment que l’Union européenne s’est engagée dans une démarche exigeant une plus grande réciprocité.
C’est le Conseil européen du 16 septembre 2010 qui a considéré que « l’Europe devait défendre ses intérêts et ses valeurs dans un esprit de réciprocité et de bénéfice mutuel ». Le principe politique ainsi posé, s’est traduit dans la communication du 9 novembre 2010 sur la politique commerciale.
Cette exigence de réciprocité devra se traduire dans les accords plurilatéraux sur les services et sur les marchés publics, par la création d’un instrument de réciprocité sur les marchés publics, et plus généralement, dans le cadre des accords bilatéraux.
1. L’Union européenne doit tracer une ligne d’intérêts communs sur la base du principe de réciprocité
a. Promouvoir le principe de réciprocité dans les accords plurilatéraux sur les services et sur les marchés publics
Dans les négociations lancées en 2011 sur un accord plurilatéral sur les services au sein de l’OMC, l’engagement de réciprocité doit prévaloir. Ce secteur qui représente 30 % des exportations européennes et participe aux trois quarts du PIB et de l'emploi en Europe est stratégique. S’il compte pour 70 % du revenu mondial, il représente seulement un cinquième des exportations, du fait de l’existence de barrières non tarifaires importantes.
Dans le déroulé de la négociation, le recours à la méthode de listes positives d’ouvertures serait de nature sinon à conjurer, du moins à limiter des mesures de restrictions telles qu’appliquées dans l’accord plurilatéral sur les marchés publics.
S’agissant de l’accord plurilatéral sur les marchés publics (AMP) signé en 1994 dans le cadre de l’OMC, il n’applique qu’une réciprocité relative. En effet, si les États membres se sont engagés à ouvrir mutuellement leurs marchés, des restrictions sectorielles ou liées à la structure étatique peuvent être maintenues.
Contrairement à l’Union européenne qui a appliqué strictement le principe de réciprocité et a potentiellement ouvert ses commandes publiques à hauteur de 85 à 90 %, des pays comme les États-Unis ou le Japon ont bloqué l’accès à leurs marchés publics par des mesures discriminatoires.
C’est ainsi que, les marchés publics américains ne sont ouverts aux entreprises européennes qu’à 32 %, ceux du Japon à 28 % et ceux du Canada à hauteur de 16 %68.
La révision de l’AMP, qui a abouti fin 2011 et qui doit maintenant être ratifiée par l’ensemble des parties, dont l’Union européenne, aura pour conséquence l’abaissement des valeurs de seuils des marchés publics et l’adjonction de nouvelles entités et de nouveaux secteurs aux annexes actuelles de l’AMP. Ainsi, les marchés de la construction et ferroviaires s’ouvriront en Corée du Sud. Le Japon a accepté d’ouvrir ses marchés ferroviaires et les fournisseurs extérieurs pourront donc participer à la reconstruction du Japon à la suite du tsunami de mars 2011. Les États-Unis étendront l’accès aux marchés publics des entités centrales, en incluant les agences fédérales importantes. Le Canada ouvrira un accès plus large aux marchés publics des provinces et territoires.
Toutefois, si cette révision offre un accès élargi aux marchés publics des pays signataires de l’AMP, elle ne modifie en rien la problématique de l’accès aux marchés publics des pays non membres de l’accord. Notons que la Chine a fait deux offres d’accession à cet accord plurilatéral, offres pour le moment jugées insuffisantes69.
Dans ce contexte, et compte tenu de l’intérêt majeur des marchés publics pour l’économie européenne, l’institution d’un instrument unilatéral de réciprocité sur les marchés publics reste toujours pertinente.
L’Union européenne n’a jamais transposé l’AMP en droit interne, en prévoyant, comme le permet cet accord de n’ouvrir ses marchés qu’à hauteur des ouvertures consenties par ses partenaires. Elle pensait ainsi, en montrant le bon exemple, obtenir des concessions sur d’autres champs de négociation commerciale comme les indications géographiques. Ceci n’a jamais été le cas. Les marchés publics européens sont de facto, en application de la législation communautaire, ouverts à tous les soumissionnaires originaires de pays signataires ou non de l’AMP.
Les mesures adoptées par certains pays membres ou non de l’AMP pour relancer l’économie lors de la crise de 2008-2009, ainsi que l’affaire du marché public sur l’autoroute en Pologne qui avait dans un premier temps été attribué à une entreprise chinoise, ont relancé la question de la réciprocité de l’accès aux marchés publics.
La plupart des grands partenaires commerciaux ont en effet institué des pratiques restrictives discriminatoires et ferment leurs marchés publics à double tour. Dans ce contexte, à l’initiative de la France, la Commission européenne a présenté en mars 2012 un projet prévoyant la possibilité de fermer les marchés publics européens aux entreprises issues de pays ne garantissant pas aux entreprises européennes un accès équivalent à leurs marchés publics70.
Le dispositif s’appuierait sur deux piliers :
– un pilier décentralisé au niveau des États membres permettant aux pouvoirs adjudicateurs d’exclure les offres sont la valeur est composée à plus de 50 % de produits ou de services issus de pays n’ayant pas signé d’accord avec l’Union européenne pour ouvrir leurs marchés ou exclus des accords signés. Cette exclusion serait applicable sous le contrôle de la Commission qui vérifierait l’absence de réciprocité, et uniquement pour les marchés dont la valeur estimée est supérieure à 5 millions d’euros ;
– un pilier centralisé autorisant la Commission européenne, après enquête, de sa propre initiative ou à la demande d’un État membre ou d’une partie intéressée, à restreindre temporairement l’accès aux marchés publics de l’Union européenne aux entreprises des pays dont les marchés publics ne sont pas ouverts aux entreprises. Cette restriction pourrait prendre la forme d’une limitation ou d’une pénalité.
Si les conclusions du Conseil européen de 28 et 29 juin 2012, renouvelées lors de celui des 18 et 19 octobre 2012, appellent à un examen rapide de la proposition de la Commission, les réticences sont fortes de la part d’États comme l’Allemagne ou la Grande Bretagne, soit pour des raisons idéologiques, soit par crainte des représailles à l’égard d’un instrument qui pourrait être perçu comme protectionniste. Ce texte a été adopté en commission du commerce international le 28 novembre dernier et adopté en séance plénière du Parlement européen 15 janvier 2014, ce qui marque un nouveau pas vers la mise en œuvre d’un juste échange.
Votre rapporteure souligne l’importance de l’adoption de la proposition de la Commission européenne relative à l’instrument législatif européen de réciprocité sur les marchés publics, qui donnerait à l’Union européenne un levier dans les négociations commerciales bilatérales et qui n’est en aucun cas un instrument protectionniste, dans la mesure où le principe réaffirmé est celui de l’ouverture.
2. L’Union européenne doit infléchir ses politiques de l’investissement et de la concurrence pour rééquilibrer les relations avec ses partenaires
La politique commerciale ne peut pas être une politique isolée. Pour être efficace, elle doit être adossée aux politiques internes de l’Europe : politique de l’investissement, politique de la concurrence, politique de l’innovation et de la protection de la propriété intellectuelle.
Réciproquement, l’exemple du « Plan acier » annoncé le 11 juin 2013 par la Commission européenne – trente-six ans après le « plan Davignon » et onze ans après l’expiration du traité CECA71 – montre que la politique commerciale peut venir en appui de la politique industrielle. Ce plan prévoit notamment de soutenir la demande externe sur les marchés tiers en luttant contre les pratiques déloyales – c’est l’objet des recours annoncés auprès de l’ORD contre les taxes antidumping mises en place par la Chine en novembre 2012 pour s’opposer au exportations européennes de tubes sans soudure, dans le cadre de ce qui a été présenté comme « la guerre de l’acier » et à garantir l’accès aux matières premières essentielles.
Deux politiques européennes devraient particulièrement être adaptées aux nouvelles configurations du commerce international : la politique de l’investissement et la politique de la concurrence. En effet, compte tenu du degré d’éclatement atteint par les chaînes de valeur mondiales (voir supra : « La fragmentation des chaînes de valeur : une transformation majeure des conditions des échanges »), la question cruciale est celle de la part des chaînes de valeur de la production à maintenir sur le territoire européen.
Or l’Europe et les pays émergents, comme la Chine, ne combattent pas avec les mêmes armes. Sont constitués des oligopoles et conglomérats compétitifs de quelques firmes publiques (sur le modèle du Japon dans les années 1970, à la différence que ces firmes étaient privées, ou des chaebols coréens) dans des secteurs identifiés comme stratégiques. Ces oligopoles bénéficient de plus de très larges capacités d’investissement, grâce aux fonds souverains et aux réserves de la Banque centrale. Le principe de réciprocité aurait pour conséquence un rééquilibrage des règles du jeu.
a. Une politique de l’investissement assurant la réciprocité dans l’accès aux marchés tiers et la défense des intérêts stratégiques européens
L’accélération des échanges commerciaux au niveau mondial s’est accompagnée, au cours des quinze dernières années, de la mondialisation des mouvements de capitaux et, notamment, du développement des opérations d’investissement à l’étranger (IDE). Ceux-ci font partie intégrante du paysage stratégique des entreprises qui, afin de rester compétitives et de renforcer leurs perspectives commerciales, ne se contentent plus d’exporter les biens et services qu’elles produisent, mais s’implantent et prennent directement des participations dans les entreprises des pays et secteurs-cibles.
Comme mentionné précédemment, un des principes fondateurs de l’Union européenne est la libre circulation des capitaux. L’Europe constitue l’ensemble économique le plus ouvert aux investissements étrangers. L’Europe a reçu environ 296 milliards de dollars en 2013 (contre 207 milliards en 2012)72. Selon Eurostat, en 2012, la provenance de ces investissements était à 60 % européenne, les entreprises venant d’Amérique du Nord comptaient pour 25 % du total, celles d’Asie pour 11 %73.
Si l’essentiel des investissements étrangers en Europe provient des pays développés, les investissements des pays émergents ont connu une croissance de 8 % en moyenne annuelle sur la période 2007-2011 (leur part passant de 3 % en 2007 à 5 % en 2011).
Le maintien de l’attractivité de l’Europe en matière d’investissements directs étrangers constitue donc un enjeu majeur pour sa croissance et sa compétitivité. Ainsi, selon l’INSEE, les entreprises détenues par des investisseurs étrangers en France emploient 13,6 % de la main d’œuvre salariée et produisent 16,8 % de la valeur ajoutée.
Il est essentiel que l’Europe conserve son attractivité mais là aussi, le principe de réciprocité aura lieu de s’appliquer, notamment lors des négociations des accords d’investissements.
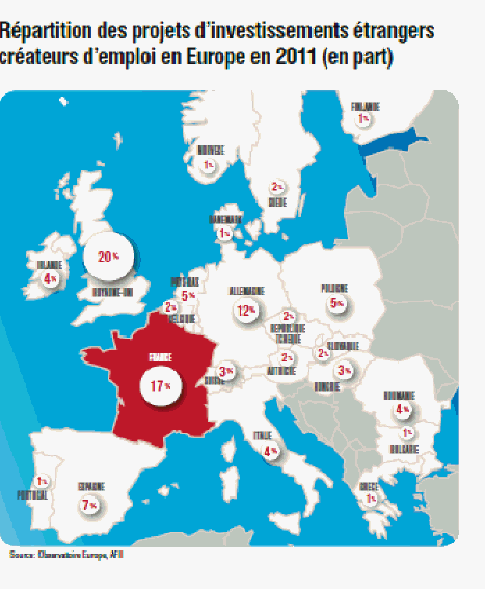
Les investissements étrangers en France
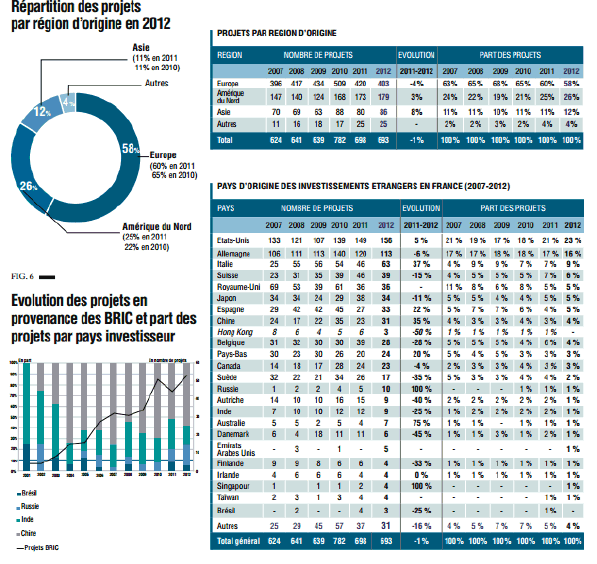
Source : Agence française pour les investissements étrangers (AFII), rapport annuel, mars 2013.
Les accords relatifs à l’'investissement sont une compétence exclusive de l'Union, depuis l'entrée en vigueur du Traité de Lisbonne en 200974, et désormais une composante à part entière de la politique commerciale. Les accords bilatéraux d’investissement, dits accords de protection des investissements passés précédemment par les États membres – 1 300 environ –, seront désormais complétés par des accords européens, soit dans le cadre d’accords généraux de commerce, soit dans le cadre d’accords portant plus spécifiquement sur les investissements.
À l’occasion des négociations d’accords bilatéraux d’investissement75, la double dimension de l’investissement devra être prise en compte : la protection des investissements européens à l’étranger et l’accès au marché.
Sur le premier point, il s’agit d’assurer un cadre juridique aussi stable et prévisible que possible dans le pays hôte, assorti d’un mécanisme efficace de règlement des différends lorsque l’État partenaire ne dispose pas d’un système juridique fiable et impartial. Sur le second point, l’Union européenne devra être particulièrement attentive à l’application des règles de réciprocité dans l’accès au marché et les investissements réalisés par les sociétés détenues ou soutenues par des États.
Certains pays, comme la Russie, établissent des listes de secteurs stratégiques protégés ou limitent les prises de participation étrangères dans ce secteur. De plus, nombre des partenaires commerciaux de l’Union européenne imposent des restrictions sévères aux investissements européens (exigence de capitaux propres, conditions de nationalité, notamment pour les cadres dirigeants, contreparties sous la forme de transfert forcé de recherche et développement...).
C’est dans cette voie que semble s’engager l’Union européenne dans ses négociations sur les investissements avec les pays de l’ANASE (Association des nations de l’Asie du Sud Est).
Les directives de négociations font ainsi mention de l’exigence « d’un traitement juste et équitable, comportant l’interdiction de mesures déraisonnables, arbitraires et discriminatoires »76. Cette ligne devra particulièrement être tenue s’agissant de l’accord potentiel avec la Chine. En mai dernier, la Commission européenne a demandé aux États membres un mandat pour lancer des négociations sur un accord sur l’investissement avec ce pays.
S’agissant des investissements étrangers en Europe, ils pourraient être soumis à l’obligation d’un maintien d’un taux de contenu local et de la valeur ajoutée européenne.
Par ailleurs, certains investissements relèvent d’enjeux stratégiques, comme les technologies de pointe. En 2010, les autorités publiques néerlandaises se sont opposées au dernier moment au rachat par un consortium chinois de l’entreprise Draka, spécialiste européen de la fibre optique. Cet épisode a montré la vulnérabilité de l’Europe à protéger ses technologies de pointe. Alors que de nombreux pays disposent d’instruments pour contrôler les investissements étrangers dans des secteurs stratégiques77, les institutions européennes ne peuvent s’opposer à un investissement étranger que dans la mesure où il porte atteinte à la défense du territoire ou à la sécurité d’approvisionnement énergétique. Cette limite renvoie aux principes fondateurs de l’Union européenne qui s’est construite autour de la notion de libre circulation des biens et des capitaux, même si certains ont pu instituer des mécanismes d’autorisation préalable aux investissements étrangers (France78, Allemagne, Royaume Uni, Italie, Pologne).
En 2011, les commissaires européens en charge du marché intérieur, Michel Barnier, et de l’industrie, Antonio Tajani, ont adressé une lettre au Président de la Commission européenne, José Manuel Barroso, demandant que la Commission européenne puisse examiner si les « effets néfastes de certains investissements étrangers sont avérés » et si tel est le cas, d’envisager un « mécanisme et des critères permettant de les éviter et d’en minimiser les conséquences ».
La politique de la concurrence a elle aussi des répercussions en matière commerciale. En 1970, les autorités européennes avaient déjà réalisé – sans que les conséquences n’en aient jamais été réellement tirées – que la politique industrielle européenne était « une question de vie ou de mort »79. La nécessité de donner une plus grande dimension aux entreprises et de constituer des groupements plurinationaux, particulièrement pour les industries de pointe, est entrée en conflit avec les règles de politique de la concurrence.
Les axes de cette politique sont le contrôle des anti-trust et des cartels ainsi que celui des concentrations et l’encadrement strict des aides d’État.
Or la politique de la concurrence européenne se limite le plus souvent à une application mécanique et rigide de règles, faisant abstraction des réalités économiques internationales. Ce faisant, le contrôle des concentrations empêche la constitution de « champions européens » d’envergure internationale, tandis que le contrôle des aides d’État est un frein aux restructurations des entreprises disposant d’un outil industriel performant.
D’autres pays se sont engagés dans une voie très différente. Ainsi, dans les années 1970-80, les États-Unis, sur la base la notion de « politique commerciale stratégique »80 ont institué des aides publiques offensives ayant pour objectif de conforter la position de « champions nationaux » dans les industries d'avenir. Aujourd’hui, l’innovation technologique est également largement subventionnée par la puissance publique dans plusieurs pays tels que la Corée du Sud ou le Canada.
Comme l’analysent MM. Jean-Paul Beffa et Gerhard Cromme dans leur rapport sur la compétitivité et la croissance en Europe, « axer une initiative de croissance européenne sur l’industrie et les services liés à l’industrie implique que l’Europe adopte une position réaliste sur les marchés mondiaux et face à la mondialisation. La politique de la concurrence doit donc prendre en compte l’environnement international, qui connaît de profonds bouleversements. Les marchés mondiaux sont de plus en plus concurrentiels, la concurrence est non seulement à l’œuvre entre les entreprises privées, mais aussi entre les économies en tant que lieux d’investissement et en tant que nations exportatrices. Des concurrents font leur apparition dans des zones économiques qui ne sont pas soumises aux mêmes restrictions réglementaires de la concurrence ou de directives sur l’aide publique. Avec ou sans aides publiques directes ou indirectes, les entreprises des pays émergents peuvent devenir des acteurs clés sur les marchés européens. C’est la prise de conscience de la dynamique de la concurrence plutôt que de sa nature figée et de l’horizon où elle s’applique, qui met en lumière la mondialisation des marchés et la vitesse de leur développement81 ».
Ils préconisent en conséquence les mesures suivantes :
« – l’Europe doit élargir sa conception de marché pertinent. D’emblée, elle doit prendre en compte l’horizon des marchés mondiaux (et non européens, nationaux ou locaux) ;
« – la capacité de concurrents potentiels non européens à s’attaquer aux positions sur le marché européen doit être prise en compte lors de l’évaluation de l'impact des fusions d’entreprises européennes ;
« – la période d'évaluation pour l'entrée éventuelle de concurrents doit être étendue, tout comme la durée de l'étude des gains d'efficacité résultant d'une concentration ;
« – la France et l’Allemagne doivent faire le point sur l’encadrement général des aides par la Commission européenne, notamment sur le seuil à partir duquel les aides publiques doivent être notifiées à la Commission ;
« – l’Union européenne doit éviter d’introduire de nouvelles propositions législatives susceptibles de nuire aux investissements, comme les procédures d’"actions collectives" dans le cadre de la concurrence européenne ».
Ces inflexions de la politique de la concurrence nécessiteraient un vrai leadership européen s’opposant à la l’orthodoxie de la Commission européenne quant aux règles de la concurrence.
Depuis le blocage persistant des négociations du cycle de Doha, l’Union européenne a élaboré une politique commerciale sur deux piliers, multilatéral et bilatéral. Tout en réaffirmant la priorité du multilatéralisme, elle a résolu de négocier des accords bilatéraux. La multiplication des accords bilatéraux au plan international s’explique notamment par la prédominance de la clause de la nation la plus favorisée. En effet, dans la mesure où cette clause garantit aux États membres l’accès aux marchés de l’ensemble des autres pays dans les mêmes conditions, quel que soit le niveau de leurs concessions, cette clause a des effets pervers, encourageant les comportements de « passagers clandestins ».
Les accords bilatéraux peuvent être l’occasion d’établir une réciprocité des engagements, d’autant qu’il s’agit d’accords dits « OMC plus » permettant d’inclure des sujets non compris dans le champ des négociations multilatérales comme par exemple la propriété intellectuelle, les investissements ou encore les barrières techniques aux échanges. Les accords bilatéraux constituent ainsi un moyen d’obtenir une réciprocité qui ne soit pas uniquement tarifaire.
Le projet de négociations d’un accord de libre-échange entre les États-Unis et l’Union européenne est un condensé de tous ces enjeux82. L’enjeu porte avant tout sur une réduction notable des barrières non tarifaires dans la mesure où les droits de douane sont consolidés à un niveau mondial moyen de 3 à 5 %83. Les tableaux ci-dessous montrent les coûts liés aux barrières non-tarifaires, en comparaison de droits de douane moyens de l’ordre de 3 % ou 5 %.
Coûts commerciaux des obstacles non tarifaires (MNT) aux Etats-Unis et dans l’Union européenne (en % équivalent tarif), pour les marchandises | ||
Secteur |
Coûts MNT dans l’UE |
Coûts MNT aux États-Unis |
Produits chimiques |
23,9 |
21 |
Produits pharmaceutiques |
15,3 |
9,5 |
Cosmétiques |
34,6 |
32,4 |
Électronique |
6,5 |
6,5 |
Matériel de communication et bureautique |
19,1 |
22,9 |
Industrie automobile |
25,5 |
26,8 |
Secteur aérospatial |
18,8 |
19,1 |
Aliments et boissons |
56,8 |
73,3 |
Métaux |
11,9 |
17 |
Textile et habillement |
19,2 |
16,7 |
Produits du bois et du papier |
11,3 |
7,7 |
Estimation des équivalents tarifaires des obstacles aux services (en %)
Télécoms |
Construction |
Commerce |
Transports |
Finances |
Services aux entreprises |
Autres | |
Pays développés |
24 |
42 |
31 |
17 |
34 |
24 |
26 |
Asie |
33 |
25 |
17 |
8 |
32 |
15 |
17 |
UE 25 |
22 |
35 |
30 |
18 |
32 |
22 |
27 |
États-Unis |
29 |
73 |
48 |
14 |
41 |
34 |
7 |
Pays en développement |
50 |
80 |
47 |
27 |
57 |
50 |
34 |
Moyenne |
35 |
58 |
38 |
21 |
44 |
35 |
29 |
Max |
119 |
119 |
95 |
53 |
103 |
101 |
54 |
Source : Commission européenne, direction générale du commerce.
Dans la définition de sa stratégie commerciale bilatérale, l’Union européenne doit défendre fermement ses intérêts offensifs, en particulier son système d’indications géographiques fondé sur un lien fort entre le produit et le terroir, face à un système anglo-saxon axé autour du droit privé des marques. Le dossier est très controversé au sein de l’OMC et il n’est pas certain que l’Europe ait gain de cause sur le plan multilatéral. Dans cette bataille autour de deux logiques de propriété intellectuelle opposées, l’Europe peut s’appuyer sur l’intérêt que suscite son système auprès de pays émergents qui y voient une façon de s’assurer le maintien de la valeur ajoutée. Ainsi, l’Inde est très soucieuse de la protection de certaines de ses productions (thé, riz) et la Chine a, en 2012, fait reconnaître par l’Union européenne dix indications géographiques par le biais d’un accord bilatéral de protection mutuelle.
Lors de la négociation des accords bilatéraux, l’Union européenne doit prêter une attention particulière à :
– la mise en cohérence avec l’ensemble des politiques de l’Union (politique agricole commune, la politique commune de la pêche, innovation) ;
– mesurer soigneusement les effets sur ces politiques, notamment au travers des études d’impact préalables aux négociations en cours, puis au moment de la conclusion afin de faciliter un contrôle a posteriori.
Le Parlement européen devrait pouvoir s’appuyer sur ses pouvoirs en matière commerciale issus du Traité de Lisbonne pour exercer ses prérogatives de contrôle, tant au cours des négociations qu’au moment de l’approbation finale.
4. L’Europe doit tenir compte équitablement du différentiel de développement de ses partenaires commerciaux
Si l’Union européenne doit défendre le principe de réciprocité, celui-ci doit être appliqué de façon modulée en fonction du degré de développement de ses partenaires. Il ne s’agit pas d’appliquer à tous la même norme mais de s’ajuster au niveau de développement. Cette logique a ainsi conduit à une inflexion dans la politique d’aide au développement. Dans ce cadre, sera applicable à partir de 2014 un nouvel instrument financier, dit instrument de partenariat avec les pays industrialisés et émergents, qui ne s’inscrit plus dans une logique d’aide mais de discussion sur des enjeux globaux (climat, migration) et de promotion des intérêts européens.
Cette réciprocité différenciée a lieu de s’appliquer sur la base de l’article XXIV du GATT définissant la « clause d’habilitation », en application de laquelle l’Union européenne a institué, dès 1971, un système de préférences généralisées (SPG). Par ailleurs, le régime « Tout sauf les armes », instauré en 2001, accorde aux 49 pays les moins avancés un accès au marché européen sans droits de douane et sans quota.
Si ces régimes préférentiels ne peuvent pas tout, ils peuvent constituer un utile levier de développement. Le système de préférences généralisées (SPG) devrait cependant être régulièrement révisé afin d’être gradué et conditionnel. C’est la voie dans laquelle s’est engagée l’Europe avec la réforme du dispositif en 2012. Les critères d’attribution du SPG sont renforcés. Pour en bénéficier, un pays ne devra pas être classé par la Banque mondiale comme pays à haut revenu ou revenu intermédiaire pendant les 3 ans précédant le classement sur la liste et ne pas bénéficier d’un accord commercial préférentiel avec l’Union européenne. Par ailleurs, les pays à plus hauts revenus mais dont l’économie est peu diversifiée n’en seront plus bénéficiaires. Le dispositif bénéficie actuellement à 83 pays contre 176 précédemment, y compris le Brésil et la Chine, dans la mesure où ils répondent encore aux critères de revenu84.
b. La négociation d’accords de partenariat économiques favorisant l’intégration régionale et le développement
La signature des accords de partenariat économique avec les pays ACP (Afrique, Caraïbes et Pacifique) constitue un enjeu économique majeur ; l’Union européenne y joue également sa crédibilité politique en Afrique, zone en émergence économique.
Selon l’article XXIV du GATT précité, des préférences commerciales peuvent être accordées à des pays en développement mais sous condition d’être accordées à l’ensemble des pays en développement. Par dérogation, dans le cadre des conventions de Lomé, l’Europe avait obtenu la possibilité d’accorder des préférences asymétriques aux seuls pays ACP. Dans la perspective de l’expiration de cette dérogation au 31 décembre 2007, l’accord de Cotonou du 23 juin 2000 avait prévu la conclusion d’accords de libre-échange réciproques mais asymétriques85 entre l’Union européenne et les pays ACP regroupés en six régions dont quatre en Afrique. Les accords de partenariat économique (APE) avaient donc pour objet de se mettre en conformité avec l’article XXIV qui dispose que « les droits de douane et autres réglementations commerciales restrictives sont éliminés pour l’essentiel des échanges commerciaux …dans un délai raisonnable ».
Le dossier des APE a été mal engagé dès 2007 par une Commission européenne qui a voulu imposer aux pays ACP un schéma de libre-échange86, qui n’était conforme ni à l’esprit des relations qui avaient jusqu’alors prévalu entre l’Union européenne et les pays ACP, ni aux intérêts économiques et de développement de ces pays. La Commission européenne est allée au-delà des exigences de l’OMC. En effet, selon l’article XXIV du GATT, l’ouverture est considérée globalement et peut donc être asymétrique. Il n’est fixé aucun chiffre de libéralisation, seule est fait mention de « l’essentiel des échanges commerciaux ». La Commission européenne a voulu imposer un taux d’ouverture global de 90 % : les marchés européens étant ouverts à 100 %, les marchés des pays ACP devraient en conséquence s’ouvrir à 80 % pour arriver au chiffre de 90 %. Alors que l’article du GATT ne fait mention que d’un « délai raisonnable », les périodes de transition devaient être fixées à 15 ans.
À la fin de 2007, les négociations étaient encalminées. Seul un APE global avec les pays du Cariforum87 était entré en vigueur en 2008. Sept accords intérimaires ont par la suite été signés. Les pays africains ont refusé une libéralisation trop importante, trop rapide et sans compensation significative en termes de mesures d’accompagnement. Ils demandent notamment que soit accordée la priorité aux mesures d’accompagnement pour le développement et la mise à niveau sur le plan commercial, une offre d’accès au marché ne couvrant que 70 % des échanges, un calendrier de libéralisation allant au-delà de quinze ans, le maintien de taxes communautaires au profit de certaines organisations sous -régionales88 et des règles d’origine plus souples.
En 2012, la Commission européenne a présenté une stratégie de « sortie de l’impasse ». Elle a proposé de revoir le règlement « Accès au marché » de 2007. Cette révision vise à exclure, à compter du 1er janvier 2014, du champ du règlement les pays qui n’ont pas pris les mesures nécessaires pour ratifier les accords intérimaires. Ce faisant, la Commission exerce une pression sur les pays ACP qui seront tentés d’accepter les APE, non pour les effets bénéfiques attendus sur leur développement, mais par crainte de voir s’interrompre leurs exportations vers l’Union européenne.
Conformément aux principes et à l’esprit du partenariat entre les pays d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique et l’Union européenne énoncés dans l’accord de Cotonou, les négociations des Accords de partenariat économiques doivent contribuer à l’intégration régionale et pour cela, un solide volet accompagnement et renforcement des capacités commerciales doit être prévu. Les économies africaines ne tireront partie de ces accords que si elles sont compétitives et en mesure d’exporter. C’est pourquoi la signature d’APE doit être accompagnée de mesures favorisant l’insertion des producteurs africains au sein des chaînes de valeur locales, régionales et internationales, tout particulièrement dans les secteurs agricole et manufacturier.
En outre, l’Union européenne doit accepter un degré de flexibilité dans le degré d’ouverture, celui-ci doit être adapté à chaque région sans être a priori fixé à 80 % puis 90 %. Par ailleurs, l’entrée en vigueur du règlement révisé d’accès au marché, initialement prévue en 2014, devrait être reportée à 2016.
5. L’Union européenne doit utiliser les négociations d’accord de libre-échange comme leviers du développement durable
Les accords bilatéraux que négocie l’Union européenne sont l’occasion de faire progresser la dimension sociale et environnementale du commerce : l’ouverture des marchés doit en effet avoir pour corollaire un droit de regard réciproque sur l’existence et le respect de certaines règles.
Si les accords négociés par l’Union européenne contiennent depuis toujours des dispositions sociales, ces références sont de plus en plus normées. Ainsi, le préambule de l’accord avec l’Afrique du Sud en 1999 faisait une simple référence aux normes fondamentales de l’OIT. Dans les négociations des Accords de partenariat économique, entamées en 2002, sont posés comme éléments essentiels de la dimension du développement, les aspects sociaux comme l’emploi et la lutte contre la pauvreté. L’accord avec le Cameroun en 2009 se contente d’un engagement figurant dans le préambule à ne pas abaisser les normes à des fins de compétitivité et une référence à l’OIT et à l’article XX du GATT89.
Les négociations avec la Colombie et le Pérou, lancées en 2007, marquent un tournant important avec l’inclusion de chapitre relatif au « Développement durable », conformément à la stratégie définie dans la communication de la Commission européenne « Une Europe compétitive dans une économie mondialisée »,90 qui met en œuvre la protection des droits et principes fondamentaux au travail sur la base des huit conventions de l’OIT.
Depuis 2007, des chapitres relatifs au développement durable figurent dans tous les accords bilatéraux. Sont posés des objectifs environnementaux d’intérêt commun (lutte contre le changement climatique et contre la perte de la biodiversité) et de mise en œuvre des principes fondamentaux du travail. Ainsi, l’accord conclu en 2011 avec la Corée du Sud comprend des engagements des parties d’appliquer les standards de l’OIT, de poursuivre la ratification des textes et mettre en œuvre les conventions de cet organisme ainsi que les conventions environnementales. Une instance bilatérale ad hoc intitulée « Comité sur le commerce et le développement durable » a été mise en place pour contrôler le respect de ces engagements.
On peut noter une inflexion dans la portée des engagements dans les accords plus récemment signés. Les dispositions visées sont plus précises. Les accords avec la Colombie et le Pérou signés en 2012 font ainsi référence à la protection de la diversité biologique (Convention sur la diversité biologique), à la protection des forêts (CITES)91 et des ressources halieutiques (Organisations régionales des pêcheries). Par ailleurs, ces dispositions sont assorties d’un mécanisme de suivi de la mise en œuvre de l’accord dans lequel la société civile est fortement impliquée, ainsi qu’un mécanisme spécial de règlement des différends reposant sur le recours à des experts choisis pour leur compétence et leur indépendance.
Votre rapporteure souligne la nécessité d’imposer de faire référence aux textes internationaux aussi bien en matière sociale qu’environnementale (Protocole de Kyoto ou droits fondamentaux de l’OIT), et ce quel que soit le pays, y compris les pays développés.
Depuis 2002, les études d’impact de développement durable sont obligatoires dans tous les accords de libre-échange afin de mesurer les conséquences en matière de normes sociales et environnementales. Cependant, elles se révèlent le plus souvent inutiles car elles ne sont connues qu’une fois que la négociation est lancée. De plus, elles ne prennent en compte qu’une partie des aspects du développement durable, selon des référentiels datés qui font notamment l’impasse sur les droits humains.
Il est donc indispensable que les études d’impact soient conduites en amont, selon une méthodologie actualisée et serrée.
Dans son rapport sur « Une meilleure prise en compte du développement durable dans les accords de libre-échange »92, l’agence de notation extra- financière VIGEO a fait les propositions suivantes :
– la nécessité de réaliser ces études d’impact en amont comme en aval des négociations des accords de libre-échange au même titre que les études d’impact économiques, afin de guider les négociateurs tout au long des discussions et d’être également intégrées dans les bilans d’impact réalisés après la mise en œuvre des accords commerciaux ;
– l’élargissement des critères qui font l’objet d’une évaluation et notamment la prise en compte du respect des droits humains tels que prévus dans les conventions internationales. Dans la grille d’analyse, la Commission européenne doit prendre en compte les quatre piliers du développement durable : social, environnemental, économique et humain ;
– rendre ces études plus synthétiques et plus opérationnelles avec une grille d’évaluation permettant rapidement d’identifier les risques et chances de l’accord sur le développement durable ;
– une plus grande association des partenaires sociaux et notamment des acteurs locaux, comme les agences locales de l’Organisation internationale du travail, des Nations Unies et la société civile.
S’agissant de l’effectivité de leur mise en œuvre, la question se pose de savoir s’il faut préférer une logique punitive de sanctions, telle qu’elle existe notamment dans les accords américains, afin de donner une force contraignante aux accords, à une logique rétributive. On a pu reprocher à la logique punitive de jouer sur les rapports de force entre des États inégaux et de ce fait, de servir les intérêts américains93. Notons que cette logique punitive a été abandonnée sous la présidence de George W. Bush, en partie pour ne pas afficher les violations des normes de travail mexicaines par les entreprises américaines.
Le système de préférences généralisées européen combine les deux approches et repose sur un socle de respect des normes, auquel s’ajoute un volet incitatif. Le bénéfice de ces préférences peut être retiré comme cela a été le cas en 1997 pour le Myanmar (ex Birmanie) ou en juin 2007 quand le bénéfice des SPG a été retiré au Belarus en raison de la violation constatée de ses obligations relatives à la liberté syndicale. Par ailleurs, une logique rétributive a été instituée dans le dispositif « SPG plus » qui offre des préférences supplémentaires aux pays vulnérables mettant en œuvre la déclaration de l’OIT de 1998. Cependant, cette approche rétributive est restée limitée dans son efficacité. Peu de pays ont demandé à bénéficier de ce système. Les raisons sont multiples : érosion de l’attractivité des préférences tarifaires du fait des consolidations tarifaires au sein de l’OMC et hostilité des pays à se voir imposer des normes, fusse par la voie de la récompense.
En tout état de cause, quelle que soit la logique retenue, les progrès significatifs ne peuvent venir que d’un suivi effectif par un mécanisme de contrôle des clauses environnementales et sociales. Cela implique notamment des comptes rendus sur le respect des normes par les pays tiers signataires, soit auprès du comité de politique commerciale de l’OMC, soit auprès d’un groupe dédié. Des feuilles de route doivent être prévues et la société civile doit jouer un rôle de surveillance active des manquements. Le renforcement des mécanismes de contrôle passe aussi par une réflexion sur l’application d’amendes et sanctions financières qui pourraient venir abonder un fonds destiné à la protection de l’environnement ou à la protection des travailleurs.
Depuis la Conférence ministérielle de 2008, les négociations du cycle de Doha pour le développement sont au point mort. Mais le mal vient de plus loin. Ce cycle, lancé en 2001, qui se voulait en rupture avec les précédents, parce que dédié à la promotion du développement et d’échanges commerciaux plus justes, souffrait d’un défaut de naissance, né de l’opposition substantielle entre les États-Unis et les pays émergents sur les gains à l’ouverture aux échanges. En effet, l’« orientation en faveur du développement a toujours été en tension avec le multilatéralisme compétitif »94 et la répartition des gains espérés était en tout état de cause toujours défavorable aux pays en développement les moins avancés.
Les interrogations sur la capacité de l’OMC à imposer le multilatéralisme comme source principale de régulation des échanges s’inscrivent dans un contexte plus global de doute sur l’aptitude des institutions internationales multilatérales à répondre au besoin de régulation mondiale. Ainsi, le rôle du Fonds monétaire international (FMI), tant en matière de gestion que de prévention des crises, est largement critiqué. De même, on constate que la Banque Mondiale n’est pas parvenue à tirer de la pauvreté un grand nombre de pays en développement, ce qui met en doute l’efficacité de l’aide telle qu’elle est pratiquée et joue un rôle déterminant dans l’essoufflement très perceptible de l’effort d’aide publique des pays développés.
Depuis une décennie, l’alternative dominante est celle du plurilatéralisme et du bilatéralisme, comme en témoignent le lancement des négociations sur l’accord plurilatéral sur les services ou les négociations d’accords de libre-échange entre l’Union européenne et des partenaires stratégiques (États-Unis, Japon…). Si la tendance actuelle se poursuit, les accords bilatéraux régiront, d’ici dix ans, les deux tiers du commerce mondial.
Évolution des accords commerciaux régionaux dans le monde, 1948-2013
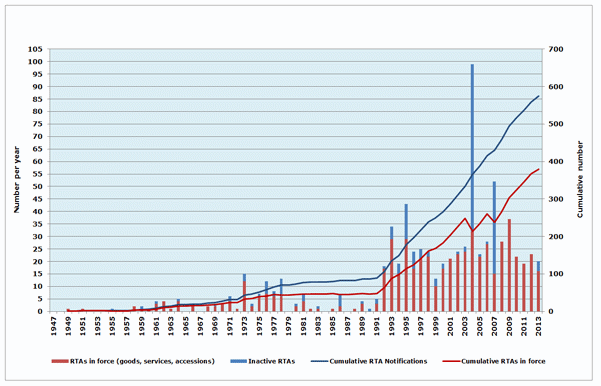
Source: secrétariat de l’OMC.
Outre la perte de crédibilité du système multilatéral, l’affaissement du multilatéralisme commercial conduit à l’éviction de partenaires jugés non intéressants. La constitution de cercles d’échanges restreints, autour de normes qui bloqueront les échanges avec ceux qui n’en font pas partie, risque d’accentuer le phénomène de spécialisation dans la pauvreté. Les entreprises multinationales sont de plus en plus favorables aux accords bilatéraux dans la mesure où elles peuvent négocier des mesures de protection de leur propre marché. Il n’est qu’à voir la liste des entreprises qui ont appelé au lancement des négociations entre l’Union européenne et le Canada.
Alors que le multilatéralisme est le plus apte à rétablir l’équilibre de rapports de force et à donner plus de pouvoir de négociation aux plus faibles, les accords bilatéraux mêlent bien souvent libéralisation sur les sujets les moins sensibles et protectionnisme, à l’avantage des pays les plus puissants. Ainsi, dans le cadre de l’ALENA, il est prévu qu’en cas de différend entre les États-Unis et le Mexique, le droit américain est applicable et les tribunaux américains sont compétents.
La multiplication des accords bilatéraux et régionaux crée par ailleurs un réseau complexe de règles, multipliant les lieux de règlement des différends, le recours aux sanctions unilatérales, voire à l’arbitrage privé. Le risque est grand de voir les règles multilatérales et l’ORD (Organe de règlement des différends de l’OMC) être marginalisés.
Alors qu’aucun accord commercial mondial n’avait été conclu depuis 1994, la dixième Conférence ministérielle de l’OMC qui s’est tenue à Bali en décembre 2013, était la dernière chance de sauver les négociations multilatérales du cycle de Doha. Il a fallu abandonner l’ambition d’un accord sur un cycle global pour se contenter d’un accord partiel autour de sujets limités. L’accord auquel les 159 pays membres de l’OMC sont parvenus a sauvé la crédibilité de cette organisation qui est un des piliers de la mondialisation régulée.
Le compromis comprend trois volets :
– le point central est un accord sur la facilitation des échanges afin de simplifier et alléger les procédures douanières et ainsi faciliter les flux commerciaux. L’accord pourrait diminuer les coûts de transaction de 10 % et générer un gain estimé à 400 milliards d’euros par an. Cette disposition serait favorable à l’ensemble des pays de l’OMC, les pays en développement pouvant en profiter dans la mesure où un tiers du commerce est maintenant orienté Sud-Sud ;
– le deuxième point concerne spécifiquement les pays en développement puisqu’il s’agit d’une disposition dite DFQF (duty free, quota free) consistant en la généralisation du régime européen « Tout sauf les armes »(TSA), c'est-à-dire un accès aux marchés en exemption de droits de douane sur au moins 97 % des lignes tarifaires. S’y ajoutent un assouplissement des règles d’origine et un mécanisme de surveillance pour le traitement spécial et différencié ;
– le troisième sujet porte sur l’agriculture et aurait pu faire échouer tout accord. Il était porté par l’Inde qui en 2008 avait été un des pays qui avait contribué à l’échec de la Conférence ministérielle sur l’institution d’un mécanisme de sauvegarde en matière agricole. La proposition de l’Inde et du G33 (groupe de pays en voie de développement)95 visait à permettre aux pays en développement de constituer des stocks publics de denrées de première nécessité à des fins de sécurité alimentaire, malgré la limite à 10 % de la production imposée par l’OMC aux soutiens internes agricoles. Les États-Unis avaient proposé une « clause de paix » d’une durée de quatre ans qui aurait permis aux pays constituant des stocks de ne pas être menacés par des recours à l’OMC et donc des sanctions commerciales. L’Inde ayant refusé cette clause de paix, une solution « diplomatique » a été trouvée. Les pays membres se sont accordés à mettre en place un mécanisme intérimaire pour ces stocks et à négocier un accord sur une solution permanente pour la constitution de stocks publics à des fins de sécurité alimentaire à adopter lors de la onzième Conférence ministérielle de l’OMC. En attendant qu’une solution permanente soit trouvée, et à condition que certains critères (de notification et de transparence) soient respectés, les autres membres s’abstiendront de recourir au règlement des différends. Autrement dit, si une solution permanente n’est pas trouvée d’ici quatre ans, ce mécanisme se renouvellera automatiquement pour quatre ans.
L’accord trouvé à Bali sauve la face car faute d’accord, l’OMC aurait perdu toute crédibilité et toute possibilité de continuer à produire des normes commerciales. Cependant, si l’OMC est confortée, elle ne l’est que de façon provisoire. La viabilité du système multilatéral dépendra de la suite qui sera donnée à la feuille de route pour 2014, programme de travail à remplir, au-delà des trois points d’accords.
Les dispositions agricoles de l’accord de la Conférence de Bali
• Programmes de stockage pour la sécurité alimentaire : les pays en développement vont pouvoir, à des fins de sécurité alimentaire, prendre des mesures de stockage public des produits agricoles dépassant les limites fixées par l’OMC pour le soutien interne, sans faire l’objet d’une contestation auprès de l’Organe de règlement des différends. Cette dérogation ne s’appliquera qu’aux programmes existants et ne devra pas affecter les échanges ou la sécurité alimentaire dans les autres pays.
• Gestion des contingents tarifaires d’importation pour les produits agricoles : un accès aux contingents d’importation non remplis par les pays développées et une obligation de transparence pour ces quotas sont prévus.
• Subventions à l’exportation : l’objectif d’une élimination de toutes les formes de subventions à l’exportation – qui aurait dû être atteint en 2013 selon la Déclaration de Hong Kong de 2005 – est réaffirmé. L’Union européenne a gardé l’outil des restitutions à l’exportation mais son utilisation est réduite à zéro.
• Les programmes visant à promouvoir le développement rural et la réduction de la pauvreté dans les pays en développement pourront être classés en boîte verte, c'est-à-dire dans la catégorie des soutiens non distorsifs. Il s’agit de programmes tels la restauration de terres, la conservation de sols, la gestion des situations de sécheresse et de lutte contre les inondations, la délivrance de titres de propriété et de programmes de peuplement agricole.
Comme évoqué précédemment, l’Union européenne a toujours mis le multilatéralisme en tête de ses priorités dans un « souci d’architecture en élargissant l’effort de négociation à la politique de la concurrence et à l’investissement direct, souci d’équilibre des normes en cherchant à donner une assise institutionnelle et légale à la prise en compte, par l’OMC, de considérations liées à la protection de l’environnement ou au principe de précaution, souci de rééquilibrer la négociation en faveur des pays en développement, et souci de la compléter par des mesures destinées aux pays pauvres »96. Elle doit donc s’en tenir à cette ligne, conforme à la fonction régulatrice qui lui est reconnue.
Les conditions d’un juste échange ne sont pas dans l’affaissement des règles multilatérales mais dans une redéfinition du champ d’intervention de l’OMC. Celle-ci doit promouvoir un système commercial international qui ne vise pas seulement à être efficace économiquement, mais également à être plus juste socialement et politiquement comme le suggérait le rapport de la « commission Warwick » en 200897. Elle doit développer « sa capacité de gestion des conflits de préférences collectives »98.
L’OMC devra redéfinir les termes des relations entre pays développés, émergents et en développement et élargir sa mission aux problématiques de sécurité alimentaire, d’accès aux matières premières, de normes qui sont aussi importantes que les droits de douane et de subventions.
a. Réformer le traitement spécial et différencié en tenant compte des nouveaux équilibres économiques internationaux
Élaboré dans les années 1960 sous l’impulsion de la CNUCED (Conférence des Nations unies pour le commerce et le développement), le principe d’un traitement spécial et différencié, par dérogation à la clause de la nation la plus favorisée, a été inscrit en faveur des pays en développement dans les règles de l’OMC.
Admettant la nécessité d’adapter les engagements commerciaux en fonction des besoins des pays, les accords de l'OMC comprennent des dispositions qui confèrent des droits spéciaux aux pays en développement et qui donnent aux pays développés la possibilité de leur accorder un traitement plus favorable qu'aux autres membres. Ces dispositions portent également sur des périodes plus longues pour la mise en œuvre des accords et des engagements, des mesures visant à accroître les possibilités commerciales de ces pays, des dispositions exigeant de tous les membres de l'OMC qu'ils préservent les intérêts commerciaux des pays en développement ainsi qu’un soutien destiné à aider ces pays à mettre en place l'infrastructure nécessaire pour participer aux travaux de l'OMC, à gérer les différends et à appliquer les normes techniques99.
L’ensemble de ces dérogations s’applique aux pays en développement visés de façon générique. L’appartenance à cette catégorie repose sur le principe de l’auto-déclaration, chaque pays pouvant choisir ce statut lors de son accession.
Compte-tenu des nouveaux équilibres économiques liés aux progrès des pays émergents, une réforme du traitement spécial et différencié s’impose. Cela suppose d’intégrer la réalité de l’impact des nouvelles grandes puissances afin qu’elles assument des responsabilités communes et différenciées.
Les négociations multilatérales seraient favorisées par cette nouvelle approche du traitement spécial et différencié en donnant à ces pays le leadership et la responsabilité correspondant à leur poids économique.
Plusieurs États apportent à certains de leurs secteurs, notamment industriel, des soutiens actifs. Ceux-ci peuvent revêtir la forme de subventions à l’exportation ou être plus indirects comme la fixation d’un prix de l’énergie plus avantageux ou un accès au crédit dans des conditions favorables. Or, sur toutes ces aides, les disciplines actuelles de l’OMC élaborées dans le cadre de l’Accord sur les subventions et mesures compensatoires (SMC) comportent de nombreuses lacunes. Ainsi, cet accord interdit en principe les subventions à l’exportation mais considère qu’il n’y a subvention que si trois critères sont réunis :
– les pouvoirs publics doivent apporter une contribution financière sous forme de transfert direct ou potentiel (garantie de prêt), de fonds, abandon de recettes publiques ou encore soutien quelconque des revenus et des prix ;
– cette subvention doit en outre conférer un avantage ;
– cette subvention doit être spécifique à certaines entreprises.
Cette réglementation ne porte donc ni sur toutes les subventions, ni sur la mesure de leur ampleur et les trois critères sont susceptibles d’être détournés.
Un rééquilibrage de la réglementation de l’OMC devrait donc porter sur l’adoption de disciplines supplémentaires sur les subventions à l’exportation portant, outre l’amélioration de leur transparence, sur les points suivants :
– la notion de contribution financière étatique doit être élargie car selon l’approche retenue par le SMC, il n’y a pas subvention tant qu’il n’y a pas de dépense imputée sur le budget de l’État. Or certaines interventions de l’État n’impliquent pas forcément de dépenses publiques ;
– la question de l’avantage procuré doit être précisée. En effet, s’il existe des cas dans lesquels l’existence d’un avantage est manifeste et son évaluation aisée, dans d’autres, cela est plus complexe. Par exemple, dans quelles circonstances, un prêt, une participation à un capital social ou l’achat d’un bien par les pouvoirs publics confèrent-ils un avantage ? L’accord SMC ne donne que des orientations partielles et la question de savoir ce que recouvre la notion d’avantage devrait donc être clarifiée ;
– le critère de spécificité devrait être précisé car une mesure ne sera pas visée par l’accord SMC à moins d’avoir été spécifiquement accordée à une entreprise ou une branche de production. Lorsqu’une subvention est accordée à un grand nombre de bénéficiaires, il est présumé que l’affectation des ressources n’est pas faussée.
Dans un monde marqué par la raréfaction des ressources et par la croissance de la consommation énergétique, l’accès aux matières premières deviendra de plus en plus stratégique. Comme le soulignait Mme Laurence Tubiana100, « d’ici à 2030, trois milliards de personnes devraient rejoindre les rangs de la classe moyenne mondiale, avec les conséquences que cela implique en termes de consommation d’énergie et de ressources. Pendant cette période, les besoins de la population mondiale en énergie, eau et en terres agricoles devaient augmenter respectivement de 33 %, 27 % et 41 % »101.
L’Europe possédant peu de réserves énergétiques, il lui faut importer plus de la moitié de son énergie, ce qui pèse lourd dans les balances commerciales des différents États. Outre cet aspect lié à l’approvisionnement, les coûts croissants de l’énergie ont conduit à un déplacement des industries à forte intensité énergétique et par conséquent, à la suppression du premier maillon de la chaîne de valeur industrielle d’ensemble, ce qui constitue un risque en matière de compétitivité et de croissance comme le pointe le rapport « Beffa-Cromme » précité.
Au-delà des évolutions liées à la volatilité des prix et à l’interaction entre les marchés physiques et financiers de produits de base, la question de l’approvisionnement physique en matières premières est donc essentielle afin de préserver les capacités productives des États. Dans sa stratégie commerciale relative aux matières premières définie dans sa communication de 2011102, l’Union européenne se pose comme objectif de garantir des « conditions équitables » en matière d’accès aux matières premières.
L’OMC pourrait participer à cet accès équitable aux ressources. Dans le cadre des disciplines sur les obstacles non tarifaires, sont proscrites les restrictions d’exportations comme les quotas ou les contingents qui s’appliquent aux exportations de matières premières. C’est sur la base de ces disciplines que la Chine a été condamnée par l’Organe de règlement des différends en 2012 pour ses restrictions aux exportations de matières premières rares (contingents et droits de douane) à la suite d’un recours formulé par plusieurs pays dont les États-Unis et l’Europe.
Ces disciplines doivent être améliorées afin de préserver l’intérêt bien compris des pays exportateurs et importateurs. Les questions relatives aux matières premières devraient être intégrées dans les négociations commerciales en cours et à venir et un mécanisme de suivi des restrictions à l’exportation pourrait être instauré au sein de l’OMC.
L’accès aux matières premières peut aussi être vu sous l’angle des pays en développement producteurs. Celles-ci doivent constituer un levier de développement. L’Union européenne doit promouvoir une politique des matières premières plus équitable, qui assure un équilibre entre l’accessibilité des ressources aux populations locales, dans le respect de normes sociales et environnementales, tout en garantissant la production industrielle et la compétitivité de l’Union européenne.
L’Europe, comme le G20, appuie l’Initiative pour la transparence des industries extractives (ITIE), qui repose sur l’engagement des pays producteurs à mettre en œuvre le programme d’action, lequel doit aboutir à la publication des recettes provenant des industries extractives. Cette démarche volontaire atteint rapidement ses limites. Aussi, la démarche de l’Union européenne relative au renforcement des exigences d’information envers les entreprises des industries extractive et forestières, présentée en avril dernier (voir encadré ci-dessous) doit être poursuivie et approfondie. Créer un cadre où tant les entreprises que les gouvernements soient amenés à rendre des comptes quant à l’usage des revenus issus des ressources naturelles est une des conditions d’un juste échange pour ces pays.
Renforcement des exigences de transparence des entreprises des industries extractive et forestière
Le 9 avril 2013, la Commission, le Parlement et le Conseil de l’Union européenne ont signé un accord relatif au renforcement des exigences d’information envers les entreprises des industries extractive et forestière. Ayant vocation à être intégré aux directives comptabilité (78/660/EEC) et transparence (2004/109/EC), il vise à imposer aux sociétés pétrolières, minières, gazières et d’abattage la publication des paiements versés aux gouvernements des pays où elles mènent leurs opérations. Les sociétés soumises à l’obligation d’information seront celles cotées sur un marché européen ou les sociétés européennes remplissant deux des trois critères suivants : chiffre d’affaires annuel supérieur à 40 millions d’euros, actifs cumulés supérieurs à 20 millions d’euros, nombre d’employés supérieurs à 250.
Elles seront tenues de publier tous les paiements supérieurs à 100 000 euros versés aux gouvernements des pays étrangers où elles opèrent. Concrètement, il pourra s’agir des factures d’impôt sur la production et les profits, des frais afférents aux droits de licence et de concessions, des royalties, etc. L’accord du 9 avril prévoit un système de déclaration avec publication du détail des versements réalisés « pays par pays » et « projet par projet ».
Les lois américaines et britanniques avaient déjà acté l’effacement des frontières et des juridictions en matière de prévention de la corruption, en permettant à leurs autorités nationales de connaitre des actes illicites de sociétés étrangères commis hors de leur territoire. Ce nouveau régime de transparence européen participe de cette internationalisation du traitement de la corruption, en employant une méthode originale. En effet, il ne vise pas directement les paiements illicites, mais donne aux populations des pays riches en ressources naturelles un moyen de tenir leurs dirigeants responsables en cas de mauvais usage de fonds légalement recueillis, et accentue la pression sur les États non transparents. Ainsi selon M. Michel Barnier, « la législation européenne peut être un catalyseur du changement dans les pays en voie de développement ».
Cette initiative de l’Union européenne reprend les règles de transparence des industries extractives créées aux Etats-Unis par le Dodd-Frank Act de 2010. L’amendement « Cardin-Lugar » y avait ajouté, à la section 1504, une obligation de divulgation des paiements versés aux gouvernements étrangers, dans le but de « promulguer les principes américains de transparence, d’intégrité et de bonne gouvernance à travers le monde ».
Les normes techniques qu’imposent les États à l’entrée des produits apparaissent de plus en plus comme des mesures de substitution aux droits de douane. Dans son rapport sur le commerce mondial en 2013, l’OMC indique que « la convergence des mesures non tarifaires comme les normes qui sera indispensable pour égaliser les règles du jeu dans l’avenir n’est pas de la responsabilité première de l’OMC. Mais elle devrait être en mesure de promouvoir plus de convergence ».
L’OMC ne peut se désintéresser d’une nécessaire convergence en matière de normes. C’est ainsi que les accords SPS (mesures sanitaires et phytosanitaires) et OTC (obstacles techniques au commerce) préconisent l’utilisation de normes internationales qui sont le moins susceptibles de créer des restrictions de concurrence (normes de l’OIE – Organisation mondiale de la santé animale – ou du Codex alimentarius).
Dans des domaines comme la sécurité sanitaire, la responsabilité sociale des entreprises ou l’économie verte, on assiste au développement de normes privées, c'est-à-dire élaborées par des entités non gouvernementales. Ces normes sont en principe facultatives dans la mesure où elles sont imposées par des sociétés privées mais elles peuvent avoir de facto des incidences importantes sur le commerce. Le travail engagé au sein de l’OMC sur le contrôle et la supervision de ces normes privées doit se poursuivre.
L’agriculture est entrée dans le champ des négociations commerciales internationales depuis l’accord de Marrakech instituant l’OMC. Les postulats du libre-échange appliqués à l’agriculture, fondés sur le raisonnement selon lequel la pauvreté dans les pays en développement étant essentiellement agricole, la libéralisation des échanges participera à sa réduction, n’ont cependant pas résisté à l’épreuve des faits. En témoignent les effets de capture des négociations commerciales par certains émergents qui ont une force de frappe importante en matière agricole, comme le Brésil, et la résistance des pays développées, les États-Unis et l’Union européenne, pour protéger leur agriculture, par le biais de subventions à l’exportation, qui ont contribué aux déséquilibres de certaines filières agricoles vivrières dans les pays en développement. Depuis le début des années 190, la facture alimentaire des pays les moins avancés a été multipliée par cinq ou six du fait d'un manque d'investissement dans l'agriculture vivrière. La promotion continue d'une agriculture d'exportation a, de plus, rendu ces pays très vulnérables à la volatilité des changes et aux flambées des prix sur les marchés internationaux.
M. Olivier De Schutter, rapporteur spécial des Nations Unies sur le droit à l’alimentation, a effectué une mission auprès de l’OMC103, afin de déterminer dans quelle mesure la libéralisation du commerce en agriculture est compatible avec l’obligation qu’ont les membres de l’OMC à l’égard du « droit de l’homme à une nourriture adéquate », tel que reconnu en droit international. Dans ce rapport, il est souligné que la productivité par travailleur actif dans le monde agricole est considérablement plus basse dans les pays en développement. Dans un tel contexte, « l’idée d’établir un marché des matières première agricoles est dénuée de sens, le renforcement de la voie de la libéralisation du commerce n’aura pas pour résultat de donner aux producteurs agricoles dans les pays en développement la capacité de se mesurer aux producteurs des pays industrialisés sur un pied d’égalité, à moins que les salaires et les prix agricoles demeurent fixés à des niveaux très bas pour compenser une productivité beaucoup moins élevée ».
La sécurité alimentaire a été, de façon très significative, un des points clefs de la Conférence de Bali de décembre 2013 : c’est au nom de ce principe que les pays en développement ont obtenu des dérogations aux règles de subventions agricoles pour constituer des stocks agricoles.
En effet, subvenir aux besoins alimentaires des neuf milliards d’êtres humains attendus en 2050 constitue un enjeu majeur. Les crises agricoles et alimentaires des dernières années (émeutes de la faim, restrictions des échanges commerciaux par certains pays exportateurs104) sont dues aux tensions entre la hausse de la demande et le ralentissement de la production.
Les perspectives agricoles de l’OCDE et de la FAO pour 2013-2022 laissent prévoir des tensions accrues sur les équilibres mondiaux qui risquent d’accentuer une volatilité déjà forte des prix agricoles. Ainsi, les prix des produits végétaux et des produits animaux resteront supérieurs aux moyennes antérieures historiques à moyen terme, sous l’effet combiné du ralentissement de la croissance de la production et de la hausse de la demande, biocarburants compris. Les déficits de production, la volatilité des prix et les perturbations des échanges continuent de menacer la sécurité alimentaire mondiale.
L’OCDE et de la FAO avertissent que « tant que les stocks alimentaires demeurent à un faible niveau dans les grandes pays producteurs et consommateurs, le risque de volatilité des prix est amplifié. Une sécheresse de grande ampleur comme celle de 2012, conjuguée à des stocks réduits, pourrait faire augmenter les prix mondiaux de 15 % à 40 % ». Cette volatilité et l’insécurité alimentaire qui en découle ont été aggravées par la financiarisation des marchés agricoles. L’investissement dans les produits dérivés agricoles qui a augmenté fortement depuis les années 2000 a participé à la hausse des prix alimentaires et les marchés financiers ne jouent plus leur rôle de sécurisation des marchés physiques.
Le défi de la sécurité alimentaire sera particulièrement redoutable pour les pays en développement les plus pauvres, où l’on attend une forte croissance démographique et où le réchauffement climatique fera sentir durement ses effets, avec notamment un risque de réduction des rendements potentiels que la FAO estime à moins 15 à 30 % pour l’Afrique Subsaharienne.
L’agriculture manque cruellement de gouvernance, du fait notamment de l’affaissement de la FAO, qui n’a jamais été en mesure de l’exercer. D’aucuns appellent à la création d’une organisation mondiale de l’agriculture105 qui fixerait notamment des prix d’équilibre. Si cette création n’est pas à un ordre du jour à court terme, des mesures plus immédiates seraient à même de participer à la sécurité alimentaire :
– en premier lieu, la lutte contre la volatilité des produits agricoles. Elle a été une priorité de la présidence française du G20 en 2011 et a abouti à un « plan d’action sur la volatilité des prix alimentaires et sur l’agriculture ». Dans ce cadre, plusieurs mesures ont été annoncées comme la création d’un forum de réponse rapide afin de coordonner les décisions politiques pour déjouer les pics des prix sur les marchés, un système d’information sur les marchés agricoles (AMIS) afin d’améliorer la collecte et l’analyse des données agricoles et le développement des stocks d’urgence dans des zones déficitaires comme l’Afrique subsaharienne. L’OMC participe au fonctionnement de ce dispositif, conjointement avec la FAO, la Banque mondiale, l’OCDE et le programme alimentaire mondial. Or, depuis 2011, aucune avancée significative n’a été constatée. Le Forum de réponse rapide n’a jamais été actionné. Seule une partie infime des informations se trouve aujourd’hui partagée dans le cadre de l’AMIS et les stocks régulateurs n’ont jamais vu le jour. Pour traiter durablement de la question de la volatilité des prix agricoles, il est temps de rouvrir le débat dans une enceinte multilatérale telle que l’OMC, en liaison avec le Comité sur la sécurité alimentaire mondiale, qui est un espace onusien légitime pour ces questions ;
– en second lieu, le soutien aux agricultures vivrières et familiales du Sud. Outre les mesures d’appui au développement de ces agricultures, il serait indispensable de renouer avec une forme de protectionnisme au sein de l’OMC. Il s’agirait de « démaquiller le prix mondial qui est souvent prédateur et spéculatif et ne correspond pas à un prix d’équilibre économique, social et environnemental »106. Tel est aussi le sens des propos du rapporteur spécial de l’ONU sur le droit à l’alimentation, M. Olivier De Schutter, qui demande que « les politiques fondées sur la sécurité alimentaire soient totalement exonérées des disciplines de l’OMC et que la sécurité alimentaire et le droit à l’alimentation deviennent un objectif des règles commerciales et non une déviation de ces règles »107. A cette fin, un rééquilibrage des règles de l’OMC relatives à certaines taxes et aux mesures de sauvegarde doit être envisagé afin de permettre aux pays en développement de se préserver de l’hyper volatilité des prix et de stabiliser leurs prix domestiques. L’effet spectaculaire de la protection exercée sur une production agricole ressort très clairement si l’on établit une comparaison entre le Kenya et les pays de l’Union économique et monétaire de l’Ouest africain (UEMOA) : les droits de douane sur la poudre de lait sont passés dans le premier de 25 % à 35 % de 1999 à 2002, puis à 60 % depuis 2004, alors qu’ils sont restés à 5 % dans le second. Le Kenya est maintenant un exportateur net croissant de produits laitiers, avec une consommation intérieure de 112 litres par personne et par an ; à l’inverse, les importations en équivalent lait représentent 64 % de la production de lait de l’Afrique de l’Ouest et la consommation par personne n’y atteint que 35 litres. Les taxes variables sur les importations – interdites dans le cadre des disciplines agricoles de l’OMC – contribueraient à protéger les productions vivrières. Il s’agirait par ailleurs d’encadrer les restrictions d’exportations de la part de grands pays exportateurs ;
– en troisième lieu, la sécurité alimentaire passe par la lutte contre la spéculation sur les marchés dérivés de matières premières agricoles. Dans le cadre de la réforme actuellement en cours de la directive européenne relative aux marchés d’instruments financiers, l’institution de limites de positions pour les activités spéculatives pourrait constituer un outil de régulation de ces marchés dérivés.
– enfin, l’ampleur prise récemment par le phénomène d’appropriations foncières à grande échelle dans les pays du Sud par des États, des fonds souverains ou des entreprises a ravivé les débats sur la sécurité alimentaire, la gouvernance foncière et les modèles de développement du secteur agricole. Un rapport de la FAO108 montre que le phénomène d’achats et locations de terres agricoles à grande échelle date de la fin des années 2000 et a pris de l’ampleur avec la hausse des prix alimentaires. Les investissements se concentrent dans les pays pauvres où la propriété foncière est mal garantie, et ne profitent pas aux pays cibles. L’accaparement des terres porterait approximativement sur 200 millions d’hectares et touche surtout le continent africain avec 62 % des transactions. Le Comité de sécurité alimentaire mondiale a adopté en mai 2012 des « directives volontaires pour une gouvernance responsable des régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts » qui définissent les principes et pratiques souhaitables en la matière. L’Union européenne devrait contribuer activement à leur mise en œuvre.
1. Assurer une coordination monétaire multilatérale et mettre en œuvre une politique européenne de change, pour limiter les risques de dumping monétaire
Contrôler les politiques monétaires des États afin de réduire les risques de guerre des monnaies et de volatilité des taux de change dans un système de changes flexibles se heurte à l’opposition des États dont aucun n’est prêt à renoncer à sa souveraineté.
Par ailleurs, il n’est pas aisé de montrer que les désalignements de taux de change modifient le système des prix relatifs d'un pays, du moins de façon suffisamment durable et suffisamment importante pour générer un transfert de ressources ou avoir des effets quantitatifs ou qu’au contraire finalement, il ne s’agit que d’un jeu à somme nulle. La preuve de la manipulation monétaire est donc difficile à établir.
Pour l’ensemble de ces raisons, les dispositions de l’article XV du GATT selon lequel les États membres doivent s'abstenir de toute mesure de change qui irait à l'encontre de l'objectif des dispositions du GATT et de toute mesure commerciale qui serait contraires à l’article 4 des statuts du FMI, n’ont jamais été appliquées.
On doit rappeler que ces dispositions prenaient en compte deux éléments :
– l’attachement de la communauté du commerce à la stabilité des taux de change ;
– la nécessité pour la communauté de s’assurer que le système commercial ne soit pas entravé par l’utilisation anarchique des restrictions de change ou de taux de change multiple.
Le système de l'OMC, ses politiques et ses règles ne permettent pas de résoudre les principales questions macro-économiques qui influent sur la tenue des monnaies dans le monde et qui requièrent un certain degré de coopération macro-financière associé à des politiques nationales appropriées. Celles-ci relèvent de la compétence du FMI. Mais, comme le souligne M. Michel Camdessus, ancien directeur général du FMI, « alors même que la mondialisation imbrique les économies entre elles et les rend de plus en plus interdépendantes, les politiques économiques et financières menées au niveau national – y compris en matière de changes – ne font l’objet d’aucune mise en cohérence à l’échelle mondiale. Le FMI, censé précisément être le lieu de la coordination monétaire, ne remplit en vérité pas ce rôle. Pendant trop longtemps, on a largement admis qu’il serait suffisant – pour garantir la stabilité mondiale – que chaque pays gère convenablement ses propres affaires et évite de manipuler son taux de change. Cette conception d’une fonction auto-équilibrante des marchés et des économies s’est révélée trop optimiste »109. Le Conseil d’analyse économique, dans l’une de ses plus récentes « notes », déjà citée, relève un risque inhérent à l’incapacité totale du système multilatéral à contrer le dumping monétaire : « devant les hésitations des organisations internationales, le danger est que le concept de manipulation de change ne soit traité au niveau de chaque zone monétaire, avec le risque de déclencher des guerres cette fois commerciales. C’est pourquoi nous pensons qu’il serait bon de réexaminer le concept et son application au niveau multilatéral ».
Lors de la réunion du dernier G20 à Saint Petersburg les 5 et 6 septembre 2013, l’ensemble des pays a convenu de la nécessité d’une meilleure coordination des politiques monétaires sans que cet appel ne comporte aucun engagement concret. Compte tenu de l’importance de la monnaie de facturation internationale, les désajustements de taux de change et la lutte contre leur volatilité passent d’abord par la mise en place d’un système monétaire international plus équilibré, donc multipolaire avec une substituabilité des monnaies. Dans un rapport du Conseil d’analyse économique de 2011110, il est préconisé à cette fin l’internationalisation de la monnaie chinoise ainsi que celle de l’euro. Un tel système multipolaire serait d’ailleurs plus conforme aux nouvelles configurations de l’économie mondiale.
Sur le point des manipulations des taux de change, le G20, bras politique du FMI, pourrait donner mandat à celui-ci pour modifier les critères de l’article 4 des statuts de ce dernier. Cet article stipule que chaque Etat membre « évite de manipuler les taux de change ou le système monétaire international afin d’empêcher l’ajustement effectif des balances des paiements ou de s’assurer des avantages compétitifs inéquitables vis-à-vis d’autres États membres ». Ces critères exigent qu’il y ait une intervention massive de la Banque centrale pour que les manipulations soit avérées et il est par ailleurs nécessaire de prouver que celles-ci ont pour objet de favoriser les exportations. Aucun pays n’est prêt à admettre ces comportements et toute tentative faite pour contrer les actions d’un pays soupçonné se heurte à la vive opposition de son administrateur au FMI. Exiger plus de transparence sur les interventions de change ainsi que sur les situations de comptes courants et des flux de capitaux serait sans doute de nature à diminuer les risques de manipulation. Par ailleurs, selon votre rapporteure, le terme de manipulation, à forte connotation négative, devrait être modifié.
Compte tenu des difficultés auxquelles se heurtera la mise en place d’une coordination monétaire multilatérale, la mise en œuvre d’une politique de change pour la zone euro doit être envisagée. En effet, la question du dumping monétaire se pose en termes spécifiques pour l’Europe. Compte tenu des différentiels de compétitivité, de spécialisations des exportations et des niveaux d’inflation, les taux de change effectifs réels sont différents entre les États de la zone euro111. Taux de change et compétitivité sont deux sujets liés. Cependant, les politiques de change ne peuvent pas tout et ne peuvent pas être une mesure de court terme reportant les réformes structurelles indispensables. Par ailleurs, les effets d’une dévaluation de l’euro ne doivent pas être surestimés.
Auditionnée par votre rapporteure, Mme Agnès Bénassy-Quéré, présidente déléguée du Conseil d’analyse économique, indiquait qu’une dépréciation de l’euro aurait un effet positif de l’ordre de 7 à 8 points sur les exportations hors zone euro qui représentent 11 % du PIB européen mais que cet effet positif serait contrebalancé par un effet négatif sur les importations et sur la facture énergétique. De plus, les effets d’une dévaluation de l’euro auraient des effets asymétriques sur les pays de la zone euro, un euro plus faible étant plus favorable aux pays qui ont l’essentiel de leurs exportations vers la zone euro (Grèce, Espagne)112. Quoiqu’il en soit, il est clair que tant qu’il n’y aura pas une politique de change européenne, les diminutions de quelques points de charges sociales ou les baisses de salaires changeront peu de choses aux compétitivités comparées des différents États de l’Union.
L’Union européenne ne pratique pas de politique de change mais sa politique monétaire, qu’elle met en œuvre et qui fixe les taux d’intérêt, a des effets sur le taux de change. Elle dispose pourtant des instruments juridiques d’une politique de change à proprement parler, au titre de l’article 219 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE)113. Il s’agit d’une compétence partagée que les gouvernements n’ont jamais voulu exercer dans la mesure où leurs intérêts divergent fortement. La question de la mise en œuvre d’une politique de change se pose de façon récurrente. Ainsi, avant la présidence française du G20 en 2011, la commission des affaires européennes de l’Assemblée nationale s’interrogeait : « pourquoi les États membres renonceraient-ils à se servir des instruments mis à leur disposition par le traité pour définir en commun une politique monétaire extérieure, par exemple en instituant une véritable politique de change au niveau de la zone euro ? L’Union européenne se donnerait là les moyens d’améliorer la représentation internationale de la monnaie unique et mener de véritables négociations avec la Chine et les États-Unis »114. Un gouvernement économique de la zone euro ne devrait pas se limiter à être uniquement « un système disciplinaire de contrôle des engagements de rigueur des pays membres. Il devra traiter de la vraie politique économique, c’est-à-dire de la croissance et de la monnaie et des taux de change ». Il faut en outre noter que la situation de très faible inflation (pour ne pas parler de déflation dans certains États membres) qui caractérise la zone euro offre une fenêtre d’opportunité : il existe des marges significatives d’assouplissement de la politique monétaire sans risque d’inflation et donc une politique de change volontariste ne serait pas incompatible, dans le contexte actuel, avec l’objectif de stabilité des prix posé par le TFUE et la priorité absolue donnée dans certains États membres à la maîtrise de l’inflation.
Si les États membres ne convenaient pas d’utiliser la possibilité de mettre en œuvre une politique de change par la Banque centrale européenne, à tout le moins, celle-ci devrait-elle afficher clairement ses objectifs en matière de politique monétaire pour soutenir l’activité économique et lutter contre le risque de déflation qui frappe déjà certains pays de la zone euro, comme le fait la Banque centrale américaine. Une telle attitude influerait indirectement sur le cours de l’euro et pourrait ainsi avoir des effets contra-cycliques. Par ailleurs, compte tenu de l’importance des échanges entre les pays de la zone euro et la Grande Bretagne et de la politique monétaire menée par ce pays, il serait nécessaire que soit appliqué l’article 142 du TFUE qui dispose que « chaque État membre faisant l'objet d'une dérogation traite sa politique de change comme un problème d'intérêt commun. Les États membres tiennent compte, ce faisant, des expériences acquises grâce à la coopération dans le cadre du mécanisme du taux de change »115.
De la même manière qu’elle doit proposer un projet commun et cohérent pour faire de l’Europe le continent pionnier de la transition énergétique, l’Union Européenne doit prendre les rênes de la mise en œuvre du juste-échange à l’échelle internationale.
Cela nécessite un changement de paradigme idéologique et de priorisation des intérêts immédiats, mais les premiers infléchissements se font aujourd’hui sentir.
Cette promotion commune du juste échange est indispensable car :
1/ c’est la condition d’une croissance internationale moins destructrice de ressources et moins créatrice d’inégalités ;
2/ c’est, pour l’Europe même et pour chacun des états membres, la condition du maintien de son influence économique et commerciale dans le monde de demain ;
3/ ce serait un signe fort que l’Europe joue encore (enfin...) son rôle de protection. Dès lors, ce serait l’un des leviers majeurs d’une indispensable réappropriation du projet européen par les citoyens des pays de l’Union.
Tel est le message essentiel de la proposition de résolution que votre rapporteure vous propose d’adopter.
La commission examine, sur le rapport de Mme Seybah Dagoma, la proposition de résolution européenne sur le juste échange au plan international (n° 1771), au cours de sa seconde séance du mercredi 26 février 2014.
Après l’exposé de la rapporteure, un débat a lieu.
Mme Marie-Louise Fort. La proposition de résolution européenne soumise à l’examen de notre commission est issue des travaux effectués au sein de la commission des affaires européennes qui s’est prononcée à l'unanimité. La réflexion de Mme Seybah Dagoma a été nourrie par les auditions que nous avons menées ensemble.
Le juste échange est une idée généreuse, qui repose même sur un présupposé moral hélas parfois bien éloigné de la dureté des relations commerciales. Défendre le juste échange est sans doute nécessaire afin de tempérer les arguments des défenseurs d'un libre-échange à tous crins. Toutefois, au cours de nos auditions, nous avons souvent reçu un accueil poli mêlé d'incompréhension ou de scepticisme sur la teneur même des termes « juste échange ». Ce fut notamment le cas à Bruxelles, à Genève, ou à Washington.
Le juste échange tel qu'il a été défini dans la proposition de résolution européenne me convient très bien. Il doit en effet être bâti sur des notions de réciprocité, de respect des engagements et des règles du commerce international, notamment définies au sein de l’Organisation mondiale du commerce, sur la rénovation du multilatéralisme, l'intégration dans les règles du commerce de la protection des droits humains et environnementaux, la mise en place de responsabilité des sociétés multinationales qui ont largement profité de la mondialisation, et sur la coopération internationale afin de réduire les risques de guerre monétaire.
Me convient également l’idée que l'économie européenne doit rester une économie ouverte afin de tirer parti des échanges internationaux et du potentiel de croissance des économies émergentes, pour autant que celles-ci diminuent leurs dispositifs protectionnistes.
Madame la rapporteure, croyez-vous que la France seule puisse porter le juste échange et l'imposer à ses partenaires européens et, au-delà, au reste du monde ?
Certes, la France n’a pas fait cavalier seul concernant l’instrument de réciprocité sur les marchés publics qui aurait dû s'imposer comme une évidence – elle a reçu le soutien d’autres États. Elle a néanmoins de grandes difficultés à faire admettre ses vues par l'Allemagne. Or ce dispositif n'a de chance d'être adopté que si l'Allemagne accepte de passer outre ses réticences naturelles et sa peur de représailles de la part de la Chine.
Ne devrions-nous pas nous attaquer en priorité aux causes mêmes de nos faiblesses afin que personne ne puisse nous accuser de nous protéger derrière le juste échange ?
Croyez-vous à l'avenir du multilatéralisme, au moment où le Président de la République a appelé à « aller vite » sur le projet d'accord transatlantique qui marque la prédominance des accords bilatéraux de libre-échange alors que le cycle de négociations multilatérales de Doha se trouve dans une impasse prolongée ?
M. Jean-Paul Dupré. Disposons-nous véritablement des moyens d’agir pour que certains États s’engagent à améliorer la condition de millions d’hommes et de femmes aujourd’hui en situation d’esclavage, et pour que ces promesses soient suivies d’effets ?
M. Jacques Myard. Madame Dagoma, puis-je me permettre de vous dire que la proposition de résolution européenne que vous défendez me semble un brin utopiste ?
Les intérêts des États de l’Union européenne divergent dans tous les domaines, y compris en matière de relations commerciales internationales. Le libre-échange s’est imposé mais, faute d’intérêt commun, la notion de réciprocité est évacuée par la direction générale de la concurrence de la Commission européenne. Nous sommes concurrents sur le plan international.
Sur les questions monétaires, vous citez les statuts du FMI. De fait, sur ce point, ils sont totalement obsolètes. Il y a bien longtemps que nous vivons sous un régime de changes flottants. Je rappelle aussi que nous avons laissé la Chine entrer dans l’OMC alors qu’elle dispose d’une monnaie administrée.
En matière d’arbitrage, votre proposition est à mon avis contraire aux engagements internationaux de la France, notamment à la convention de Washington du 18 mars 1965 dite « CIRDI » (Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements) qui permet d’avoir recours à cette méthode de règlement des différends en cas de contentieux entre un État et un investisseur.
Vous souhaitez que l’Union européenne passe des accords internationaux en matière de garantie et de promotion des investissements…
Mme la rapporteure. Ce n’est pas une innovation !
M. Jacques Myard. Il reste que le régime de propriété relève des États. Si la subsidiarité doit s’appliquer, c’est bien en ce domaine. Votre solution en la matière n’est donc pas la bonne.
À l’instar d’Élisabeth Ier s’adressant à Sir Francis Drake, je veux bien saluer « les chercheurs d’aventures », mais je me refuse à considérer que vos propositions pourraient relever du droit positif.
M. Gwenegan Bui. Alors que l’Assemblée a adopté cette semaine une proposition de loi dans la lignée de la directive européenne sur le détachement des travailleurs afin d’éviter que les travailleurs européens soient mis en concurrence entre eux, remercions notre collègue, Mme Seybah Dagoma, d’engager l’opération Restore Hope pour que l’Union européenne regagne les cœurs de nos concitoyens !
La concurrence fiscale, sociale et monétaire devant laquelle nous restons impuissants fait des ravages dans nos économies. Elle alimente le désamour des peuples pour l’Europe devenue le cheval de Troie du libre-échange sur lequel il semblait jusqu’alors impossible de seulement s’interroger. Je suis heureux de constater qu’aujourd’hui l’Assemblée débat d’un sujet qui n’est plus tabou.
Les alinéas 40 et 41 de la proposition de résolution européenne me semblent particulièrement bienvenus. Ils appellent notamment à « un assouplissement de la réglementation européenne sur les aides d’État investies dans l’innovation des entreprises, d’une part, et sur les concentrations d’autre part afin de favoriser la constitution de “champions européens” d’envergure internationale ». Comment pouvons-nous garantir que la Commission européenne appliquera à l’avenir ce principe de bon sens qu’elle n’a de cesse de piétiner aujourd’hui ?
Selon l’alinéa 61, « l’Union européenne doit limiter les prises de positions pour les activités spéculatives sur les marchés dérivés de matières premières agricoles dans le cadre de la réforme de la directive relative aux marchés d’instruments financiers ». La spéculation sur le blé, le colza ou le riz est inacceptable tant sur le plan moral que sur le plan économique. Ces pratiques ont en effet des conséquences directes sur le quotidien des producteurs et des consommateurs. Elles dérégulent les marchés et peuvent susciter des révoltes comme celles qui se sont déroulées au Moyen-Orient. Tout l’objet de la loi de séparation et de régulation des activités bancaires votée l’été dernier consistait d’ailleurs à interdire la spéculation aux banques. Il ne saurait donc être question à mon sens que l’Union européenne se contente de « limiter » de telles activités ; elle doit les interdire. Pouvons-nous remplacer un terme par l’autre ?
M. Guy-Michel Chauveau. L’alinéa 60 de la directive précise que l’Union européenne doit « participer à la lutte contre la volatilité des prix agricoles, en améliorant le suivi des marchés agricoles ». Alors que les prix se forment souvent en dehors de l’Union, les marges de manœuvre ne sont-elles pas limitées en la matière ?
Mme Chantal Guittet. Madame Dagoma, dès lors que nous votons une résolution européenne relative au libre-échange, je tiens à ce qu’il soit fait référence à la possibilité de déroger au droit des brevets en matière de santé publique en ayant recours aux licences obligatoires, conformément à la déclaration de Doha de 2001, mise en œuvre par l’OMC en 2003 au terme de luttes acharnées. En cas de crise sanitaire, il est essentiel qu’un pays puisse fabriquer un médicament sans tenir compte des brevets.
Je soutiens M. Gwenegan Bui qui souhaite que l’Union interdise les prises de positions pour les activés spéculatives sur les matières premières agricoles.
Il est demandé à l’alinéa 54 que les exigences de la proposition de directive renforçant l’obligation de transparence et de publication des informations non financières par certaines grandes sociétés et grands groupes « soient précisées et assorties d’indicateurs quantitatifs, d’instruments de contrôle indépendants et de dispositifs de sanction en cas de violation des conventions et principes internationaux ». Je souhaite que soient également fournis des indicateurs qualitatifs. Je m’interroge par ailleurs sur les « instruments de contrôle indépendants ». À qui pensez-vous ? On connaît l’histoire des Big five devenu les Big four après la faillite de l’un des plus gros cabinets d’audit de la place due aux conflits d’intérêts auxquels il n’avait su résister. Qui sera chargé de sanctionner ceux qui sortiraient des clous ?
Mme la rapporteure. Madame Marie-Louise Fort nous interroge sur notre capacité à imposer le « juste échange ». Je ne fais preuve d’aucune naïveté en la matière. J’ai conscience qu’il s’agit d’un objectif à atteindre et qu’il faudra mener des combats, mais j’ai confiance. Il est en revanche certain que nous n’obtiendrons rien si nous ne nous battons pas. Vous avez raison : nous devons aussi « nous attaquer à nos faiblesses ». Il nous faut mener de front des réformes structurelles en interne, et une action au niveau européen. Le multilatéralisme dont vous nous parlez doit rester notre horizon car le bilatéralisme n’est pas favorable au plus faible. Même si le cycle de Doha a été un échec, et que seules les apparences ont pu être sauvées, nous ne devons pas perdre cet objectif de vue.
Monsieur Dupré, la généralisation de la notion de travail décent constitue un objectif. Nous ne devons jamais admettre les arguments de ceux qui considèrent que les règles minimales que nous souhaitons imposer en matière de protection des travailleurs ne seraient que des mesures protectionnistes visant à mettre fin à un « avantage comparatif ».
Monsieur Myard, même si seulement dix États européens sont aujourd’hui favorables à la réciprocité, je reste persuadée que nous devons nous battre. Votre observation concernant les manipulations monétaires est juste, et il est vrai que les statuts du FMI sont obsolètes sur ce point. Pour ce qui concerne l’arbitrage, je défends une position politique. Quant aux conventions d’investissements, elles résultent d’un transfert de compétences effectué par le traité de Lisbonne de 2009.
Je partage le constat de M. Gwenegan Bui sur l’approche rigide de la Commission qui fait obstacle aux concentrations et aux aides d’État en Europe, alors que les pratiques des États-Unis ou de la Chine sont bien différentes. Sur ce sujet aussi la bataille doit être menée et tout dépend d’un rapport de force. Je ne suis pas défavorable à une rédaction demandant l’interdiction des spéculations sur les matières agricoles. L’interdiction constituait évidemment un objectif même si je m’étais contenté à ce stade de demander une limitation.
Madame Guittet, je ne suis pas opposée à une modification de la rédaction de l’alinéa 54 visant à préciser que les indicateurs devront être quantitatifs et qualitatifs.
La commission passe à l’examen de l’article unique de la proposition de résolution.
La commission est saisie de l’amendement AE3 de la rapporteure.
Mme la rapporteure. Il s’agit, à l’alinéa 40, dans lequel il est demandé à la Commission européenne de veiller dans les négociations commerciales à la cohérence de la politique commerciale avec les politiques européennes internes ainsi qu’aux intérêts des pays et territoire d’outre mer, de préciser que les négociations concernées peuvent être plurilatérales. Un accord plurilatéral sur les services est par exemple actuellement en discussion.
La commission adopte l’amendement.
Elle examine l’amendement AE1 de la rapporteure.
Mme la rapporteure. Alors que l’alinéa 47 demande que le recours à l’arbitrage soit exclu, je propose de le rendre possible « en l’absence de systèmes judiciaires nationaux fiables et impartiaux ».
M. Jacques Myard. Avant de décider de l’installation d’Eurodisney en France, l’entreprise américaine a exigé que le code civil soit modifié pour qu’elle puisse avoir accès à l’arbitrage en cas de conflit juridique sur le sol français. Votre proposition est donc non seulement contraire aux traités mais elle entre également en contradiction avec le droit français en vigueur.
Mme la rapporteure. Je préfère effectuer quelques vérifications avant de vous répondre.
La Commission adopte l’amendement.
Puis elle adopte l’amendement rédactionnel AE2 de la rapporteure.
Elle en vient ensuite à l’amendement AE4 de M. Gwenegan Bui.
M. Gwenegan Bui. Il est souhaitable d’« interdire » les prises de positions pour les activités spéculatives sur les marchés dérivés de matières premières agricoles plutôt que de les « limiter ».
Suivant l’avis favorable de la rapporteure, la Commission adopte l’amendement.
Elle examine l’amendement AE5 de Mme Chantal Guittet.
Mme la rapporteure. Pour des raisons de santé publique, je souhaite que la déclaration sur l’accord sur les aspects des droits de propriété qui touchent au commerce (ADPIC) et la santé, adoptée le 14 novembre 2001 lors de la quatrième conférence ministérielle de l’OMC à Doha, figure parmi les visas de la proposition de résolution européenne.
Suivant l’avis favorable de la rapporteure, la Commission adopte l’amendement.
Puis la commission adopte l’ensemble de la proposition de résolution européenne modifiée.
ANNEXE :
LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES PAR LA RAPPORTEURE
Auditions à Paris :
- Mme Nicole Bricq, ministre du commerce extérieur ;
- M. Arnaud Montebourg, ministre du redressement productif ;
- M. Hubert Védrine, ancien ministre des affaires étrangères ;
- M. Vincent Aussilloux, M. Pascal Lignères, Mme Anna Lipchitz et M. Yohann Petiot, conseillers au cabinet de Mme Nicole Bricq, ministre du commerce extérieur ;
- M. Etienne Oudot de Dainville, sous-directeur de la politique commerciale et de l’investissement, service des affaires multilatérales et du développement, direction générale du Trésor, ministère de l’économie, des finances et de l’industrie ;
- Mme Monique Barbut, conseillère spéciale du directeur général de l’Agence française de développement (AFD) ;
- Mme Agnès Bénassy-Quéré, présidente déléguée du Conseil d’analyse économique (CAE) ;
- M. Alain Bentejac, président du comité du commerce extérieur, Mme Catherine Minard, directrice des affaires internationales, et M. Matthieu Pineda, chargé de mission des affaires publiques, Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;
- M. Antoine Bouët, professeur d’économie à l’université Bordeaux IV et chercheur à l’Institut international de recherche sur les politiques alimentaires (IFPRI) ;
- M. Jean-Christophe Bureau, professeur d’économie à AgroParisTech et conseiller au CEPII ;
- M. Jean-Michel Delisle, vice-président, Mme Corinne Vadcar, responsable du département « économie et commerce international », Mme Béatrice Richez Baum, juriste, et Mme Véronique Etienne-Martin, conseillère parlementaire, Chambre de commerce et d’industrie de Paris (CCIP) ;
- M. Hakim El Karoui, consultant au cabinet Roland Berger ;
- M. Emmanuel Guérin, coordinateur du programme « climat » à l’Institut du développement durable et des relations internationales (IDDRI) ;
- M. Michel Husson, économiste à l’Institut de recherches économiques et sociales (IRES) ;
- M. Sébastien Jean, économiste et conseiller au CEPII ;
- M. Thierry Mayer, professeur d’économie à l’Institut d’études politiques de Paris et conseiller au CEPII ;
- M. Matthieu Pigasse, directeur général délégué de la banque Lazard France ;
- M. Dominique Plihon, économiste, professeur à l’université Paris Nord et président du conseil scientifique d’ATTAC France ;
- M. Jacques Sapir, directeur d’études à l’École des hautes études en sciences sociales (EHESS) ;
- M. Jean-Marc Siroën, professeur de sciences économiques à l’Université Paris Dauphine et auteur, pour la Commission européenne, du rapport : « Les normes de travail dans les traités de libre-échange » ;
- Collectif « Ethique sur l’étiquette » ;
- Collectif « Peuples solidaires ».
Auditions à Bruxelles :
- M. Henri Weber, député européen ;
- M. Jean-Paul Thuillier, ministre conseiller pour les affaires économiques, représentation permanente de la France auprès de l'Union européenne ;
- M. Denis Redonnet, chef de l’unité « stratégie du commerce » à la direction générale du commerce à la Commission européenne ;
- Mme Eleonora Catella, conseillère à la direction des affaires internationales de Businesseurope.
Auditions à Genève :
- M. François Riegert, délégué permanent de la France auprès de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) ;
- Mme Arancha Gonzalez, directrice de cabinet de Pascal Lamy, ancien directeur général de l’OMC ;
- M. Marc Auboin, conseiller à la division de la recherche économique et des statistiques de l’OMC
- M. Alfredo Calcagno, chef du service des politiques macroéconomiques et des politiques du développement, division de la mondialisation et des stratégies de développement, Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED) ;
- Mme Marcia Donner Abreu, ministre conseiller à la représentation permanente du Brésil auprès de l’OMC
- M. Hubert Escaith, économiste à l’OMC ;
- Mme Martine Julsaint-Kidane, administrateur chargé des affaires économiques, division du commerce international des biens et services et des produits de base, CNUCED ;
- Mme Gabrielle Marceau, conseillère à la division des affaires juridiques de l’OMC ;
- M. Joerg Mayer, administrateur chargé des affaires économiques, division de la mondialisation et des stratégies de développement, CNUCED ;
- M. Makane Mbengue, professeur au département de droit international public et des organisations internationales, Université de Genève ;
- M. Jean-Marie Paugam, directeur exécutif adjoint, et M. Bob Trocme, conseiller, Centre du commerce international (CCI) ;
- M. David Shark, représentant permanent adjoint des États-Unis auprès de l’OMC ;
- M. Raymond Torres, directeur, et M. Franz-Christian Ebert, chargé de recherche à l’Institut international d’études sociales du Bureau international du travail (BIT).
Auditions à Washington :
Ø Ambassade de France aux États-Unis :
- M. François Delattre, ambassadeur de France ;
- M. Jean-François Boittin, ministre conseiller pour les affaires économiques et financières ;
- Mme Emmanuelle Ivanov-Durand, conseillère au service économique régional.
Ø Congrès :
- M. Howard Coble, représentant de Caroline du Nord, co-auteur du « Currency Reform for Fair Trade Act », président de la sous-commission propriété intellectuelle de la Chambre des Représentants ;
- M. Mike Michaud, représentant du Maine ;
- M. Christopher Slevin, assistant du sénateur Sherod Brown (Ohio).
Ø Banque mondiale :
- M. Jeffrey Lewis ;
- M. Charles Tellier ;
- M. Thomas Farole.
Ø Fonds monétaire international
- M. Marshall Mills ;
- M. Steven Philipps.
Ø Organisations non gouvernementales et syndicats
- Mme Celeste Drake, spécialiste des questions commerciales et de mondialisation à AFL-CIO (American federation of labor and Congress of industrial organizations) ;
- Mme Ilana Solomon, directrice du programme « commerce responsable », Sierra Club ;
- Mme Lori Wallach, directrice de « Public citizen’s global Trade watch » ;
- M. William Waren, spécialiste des politiques commerciales, « Friends of the Earth ».
Ø Peterson Institute for International Economics
- M. Joseph Gagnon ;
- M. Gary Hufbauer.