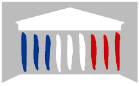N° 2506
______
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 21 janvier 2015.
RAPPORT
FAIT
AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES SUR LA PROPOSITION DE LOI visant à assurer aux patients le respect de leur choix de fin de vie,
PAR Mme Véronique MASSONNEAU,
Députée.
——
Voir le numéro :
Assemblée nationale : 2435.
SOMMAIRE
___
Pages
I. L’ÉLABORATION PROGRESSIVE D’UN CADRE JURIDIQUE 7
A. DE NOUVEAUX DROITS 7
1. Le droit de toute personne malade de pouvoir bénéficier de soins palliatifs 8
2. La sédation en phase terminale 9
3. Le droit de toute personne malade de refuser tout traitement 9
4. L’interdiction de l’obstination déraisonnable par le médecin 10
B. UN CADRE JURIDIQUE MÉCONNU ET MAL APPLIQUÉ 10
1. La mise en œuvre insuffisante des soins palliatifs 10
a. La persistance de disparités territoriales. 11
b. Une absence dans le secteur médico-social 11
c. Le nécessaire renforcement des équipes mobiles 12
2. Une formation médicale centrée sur le curatif 12
II. UNE RÉFLEXION INACHEVÉE 15
A. RECONNAÎTRE LA PRIMAUTÉ DE LA VOLONTÉ DU MALADE 15
B. RENFORCER LES MOYENS DE RESPECTER LA VOLONTÉ DU MALADE 17
TRAVAUX DE LA COMMISSION 21
Article 1er(article L. 1110-9 du code de la santé publique) : Possibilité pour une personne malade de demander à bénéficier d’une euthanasie ou d’une aide au suicide. 45
Article 2 (article L. 1111-10 du code de la santé publique) : Conditions de mise en œuvre des actes d’euthanasie et d’aide au suicide 51
Article 3 (article L. 1111-11 du code de la santé publique) : Amélioration du dispositif des directives anticipées et de la personne de confiance 53
Article 4 (article L. 1111-12 du code de la santé publique) : Possibilité pour une personne malade incapable d’exprimer sa volonté de bénéficier d’une euthanasie si cette demande figurait dans ses directives anticipées. 59
Article 5 (article L. 1111-13 du code de la santé publique) : Procédures de contrôle des actes d’euthanasie et d’aide au suicide 60
Article 6 (article L. 1110-5 du code de la santé publique) : Clause de liberté de conscience du médecin 63
Article 7 : Gage 64
Mesdames, Messieurs,
Comment appréhender la question de la fin de vie dans la cité ?
Définir cette notion peut permettre d’apporter un début de réponse.
L’Observatoire national de la fin de vie insiste sur sa dimension globale : « La fin de vie doit être appréhendée comme un processus plus ou moins long, ponctué de ruptures, au cours duquel les individus tentent, plus ou moins aisément, de faire face à la mort ». Chaque situation est donc unique et renvoie à l’intime. C’est pourquoi, cette proposition de loi permet à chacun de décider de la façon dont il souhaite terminer sa vie, y compris en bénéficiant de l’euthanasie et d’une aide au suicide.
En effet, si l’élaboration progressive d’un cadre juridique sur la fin de vie et les droits des malades ont permis de nettes améliorations sur ce sujet, beaucoup reste à faire.
Aujourd’hui, l’on meurt toujours mal en France, comme le démontre l’étude MAHO (Mort à l’Hôpital), publiée en 2008, selon laquelle les soignants considèrent que seulement 35 % des décès s’y déroulent dans des conditions acceptables.
En outre, la pratique de l’euthanasie a déjà cours en France, mais d’une manière clandestine, soit pour répondre aux attentes légitimes de malades, de patients en fin de vie et en situation de souffrance, mais aussi parfois à leur insu.
Cette proposition de loi vise donc à assurer aux patients en fin de vie le droit de mourir dans la dignité.
La loi doit assurer à chaque patient en fin de vie la possibilité de choisir la solution qui lui convient. La législation doit donc être en mesure d’apporter un cadre à chaque citoyen afin d’offrir à chacun la liberté de choisir sa mort.
La place de la mort dans la société a profondément évolué au cours du siècle dernier en parallèle avec les progrès de la médecine.
Paradoxalement ces avancées médicales ont fait naître une angoisse de la part des citoyens, celle d’être dépossédés de leur fin de vie et d’être victimes d’un acharnement thérapeutique de la part des médecins. « La mort n’effraie pas autant que le mal mourir », comme le relève l’Observatoire national de la fin de vie (1). En effet, ce dernier souligne la primauté de la science dans la médecine contemporaine, ce qui a eu pour conséquence une recherche de la guérison à tout prix qui s’est trop souvent faite au détriment du soulagement des douleurs et de la volonté du patient.
Ce sentiment est renforcé par une particularité française, le fait que la grande majorité des décès se produisent à l’hôpital. Ainsi, une étude menée par l’Observatoire national de la fin de vie en lien avec le centre d’épidémiologie sur les causes médicales de décès de l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) a abouti aux conclusions suivantes : en 2008 58 % des décès étaient survenus à l’hôpital contre 27 % à domicile et 11 % en maison de retraite (2).
À la suite de cas dramatiques médiatisés et face aux interrogations récurrentes de la société, le législateur a donc fixé progressivement un cadre juridique encadrant la fin de vie, créant de nouveaux droits, à la fois pour les praticiens mais aussi pour les personnes malades. Trois textes ont participé à cette évolution :
– la loi n° 99-477 du 9 juin 1999 visant à garantir le droit à l’accès aux soins palliatifs ;
– la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ;
– la loi n° 2005-370 du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie.
Introduit par la loi du 9 juin 1999 précitée, l’article L. 1110-9 du code de la santé publique reconnaît le droit de toute personne malade, « dont l’état le requiert, à accéder à des soins palliatifs et à un accompagnement ». Les soins palliatifs sont définis comme « des soins actifs et continus pratiqués par une équipe interdisciplinaire en institution ou à domicile. Ils visent à soulager la douleur, à apaiser la souffrance psychique, à sauvegarder la dignité de la personne malade et à soutenir son entourage » (3). Leur objectif est donc de chercher à améliorer la qualité de vie du patient et de son entourage.
De même, l’article L. 1110-5 du code de la santé publique dispose, dans son quatrième alinéa, que « Toute personne a le droit de recevoir des soins visant à soulager sa douleur. Celle-ci doit être en toute circonstance prévenue, évaluée, prise en compte et traitée ».
C’est pourquoi, dès 1999, un premier plan triennal de développement des soins palliatifs a été lancé (4). Il entendait créer et diffuser une culture de soins palliatifs à la fois chez les professionnels de santé et dans la société. L’accent a porté sur le développement d’équipes mobiles.
De 2002 à 2005, un deuxième plan a continué les efforts engagés et a fixé comme priorité le développement des soins palliatifs à domicile.
En 2006, le ministre de la santé a installé un Comité national de suivi du développement des soins palliatifs et de l’accompagnement dont la mission est de proposer une politique nationale de développement des soins palliatifs, d’accompagner la mise en œuvre et le déploiement de cette politique (5).
Enfin en 2010 (6), est créé un Observatoire national de la fin de vie qui a pour mission notamment d’identifier des données fiables pour faciliter le débat public et d’éclairer le pilotage , le suivi et l’évaluation des politiques de santé dans le champ de la fin de vie.
L’offre de soins s’est développée ; ainsi le nombre d’unités en soins palliatifs (USP) est passé de 90 en 2007 à 122 en 2012 et le nombre de lits de ces unités a augmenté, en progressant de 942 lits en 2007 à 1 301 en 2012. S’agissant du nombre de lits identifiés de soins palliatifs, il a varié de 3 060 lits en 2007 à 5057 en 2011 (7). Enfin, le nombre d’équipes mobiles est passé de 337 en 2007 à 418 en 2011.
Par ailleurs, la loi du 22 avril 2005 précitée autorise le praticien à utiliser des traitements antalgiques pour soulager la douleur d’une personne malade même si ce traitement peut accélérer son décès.
L’article L. 1110-5 du code de la santé publique prévoit que : « Si le médecin constate qu’il ne peut soulager la souffrance d’une personne, en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable, quelle qu’en soit la cause, qu’en lui appliquant un traitement qui peut avoir pour effet secondaire d’abréger sa vie, il doit en informer le malade, sans préjudice des dispositions du quatrième alinéa de l’article L. 1111-2, la personne de confiance visée à l’article L. 1111-6, la famille ou, à défaut, un des proches. La procédure suivie est inscrite dans le dossier médical. » (8).
Le principe posé par le législateur reste celui du maintien de l’interdiction de donner la mort mais ouvre la possibilité pour le médecin de prescrire certains traitements dont l’effet indirect peut accélérer la survenance du décès. On utilise alors l’expression de risque de double effet des médicaments soulageant la douleur.
Enfin, de manière générale, « Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment ».
De ce principe découle le fait que « le médecin doit respecter la volonté de la personne après l’avoir informée des conséquences de ses choix. Si la volonté de la personne de refuser ou d’interrompre tout traitement met sa vie en danger, le médecin doit tout mettre en œuvre pour la convaincre d’accepter les soins indispensables » (9).
Il peut faire appel à un autre membre du corps médical. Le malade devra, en tout état de cause, réitérer sa décision, qui figurera dans son dossier médical. L’arrêt de ces traitements doit s’accompagner d’un renforcement des soins palliatifs adaptés afin que le malade ne souffre pas.
Lorsque le patient est hors d’état d’exprimer sa volonté, la limitation ou l’arrêt des traitements sont encadrés. La personne de confiance si elle existe, la famille ou à défaut un de ses proches doit être consulté. Si des directives anticipées ont été rédigées, elles doivent être prises en compte. Enfin, cette limitation ou arrêt des traitements requiert une procédure collégiale et doit fait l’objet d’un avis motivé qui figure dans le dossier du patient (10).
S’agissant des personnes en fin de vie, l’article L. 1111-10 du code de la santé publique impose au médecin de respecter la volonté de la personne malade si celle-ci décide de limiter ou d’arrêter tout traitement. Sa décision figure dans son dossier médical. Le médecin assure la dignité du malade en dispensant des soins palliatifs.
Communément dénommée acharnement thérapeutique, cette pratique est prohibée par l’article L. 1110-5 du code de la santé publique qui énonce : « Ces actes (de prévention, d’investigation ou de soins) ne doivent pas être poursuivis par une obstination déraisonnable. ». Ce même article les qualifie et en précise la portée : « Lorsqu’ils apparaissent inutiles, disproportionnés ou n’ayant d’autre effet que le seul maintien artificiel de la vie, ils peuvent être suspendus ou ne pas être entrepris ».
Le code de déontologie médicale confirme cette interdiction. « En toutes circonstances, le médecin doit s’efforcer de soulager les souffrances du malade par des moyens appropriés à son état et l’assister moralement. Il doit s’abstenir de toute obstination déraisonnable dans les investigations ou la thérapeutique et peut renoncer à entreprendre ou poursuivre des traitements qui apparaissent inutiles, disproportionnés ou qui n’ont d’autre objet ou effet que le maintien artificiel de la vie » (11).
Le Conseil d’État dans son arrêt du 14 février 2014 (12) a qualifié de droit fondamental, « le droit du patient de consentir à un traitement médical et de ne pas subir un traitement qui serait le résultat d’une obstination déraisonnable ». Il a jugé que la notion d’obstination déraisonnable s’appliquait également à des personnes dans une phase avancée d’une affection grave et incurable qui sont hors d’état d’exprimer leur volonté et qui ne sont pas en fin de vie.
La diffusion d’une culture et d’une démarche palliative est difficile en France, même si d’indéniable progrès ont été faits.
Si presque chaque région dispose d’une USP, leur implantation s’est faite majoritairement dans le secteur médical ou MCO (médecine, chirurgie, obstétrique) et non en soins de suite ou SSR (soins de suite et de réadaptation). Ainsi, 73 % des lits identifiés en soins palliatifs sont situés dans des services de MCO (13).
Par ailleurs, l’implantation des USP dans les centres hospitaliers universitaires (CHU) a pour conséquence que certains départements n’en possèdent pas lorsqu’ils ne bénéficient pas de ces centres.
Selon le rapport établi par le Comité national de suivi du développement des soins palliatifs et de l’accompagnement (14), 5 des 26 régions concentrent les deux tiers des USP (Île-de-France, Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte-D’azur, Bretagne, Nord-Pas-de-Calais). Le taux d’équipement en soins palliatifs varie de 0,4 lit pour 100 000 habitants à 8,2 lits pour 100 000 habitants.
Par ailleurs, comme le relevaient M. Jean Marc Lapiana, directeur de « La maison », et M. Jean-Claude Ameisen, président du Comité consultatif national d’éthique (CCNE) (15), la différence de tarification entre les lits identifiés en soins palliatifs et les soins palliatifs dans des unités spécialisées privilégie la mise en œuvre de ces soins dans les trois semaines de la fin de vie (16) et n’encourage pas la diffusion d’une démarche palliative dans les services hospitaliers non dédiés.
Le point le plus crucial est la quasi-inexistence de soins palliatifs dans les établissements médico-sociaux et particulièrement dans les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EPHAD).
En outre, 85 % des EPHAD ne disposent pas d’une infirmière de nuit (17).
C’est pourquoi, s’agissant des personnes âgées, sur 17 705 patients décédés en 2012 aux urgences, 9 130 soit 52 % avaient entre 75 ans et 89 ans et 3 990 soit 22 % avaient 90 ans ou plus. 60 % de ces patients ont été hospitalisés pour une pathologie qui aurait nécessité des soins palliatifs (18).
Les syndicats d’infirmiers auditionnés (19) ont souligné le manque de moyens humains et matériels des EPHAD, qui explique, en partie, cette déficience. Par ailleurs, le docteur Charles Joussellin, vice-président de la Société française d’accompagnement des soins palliatifs (SFAP) (20), a relevé que l’isolement du personnel soignant dans ces structures n’encourageait pas la diffusion de la culture et de la démarche palliative. C’est pourquoi, il est favorable à un renforcement des équipes mobiles dans ces institutions. La Rapporteure partage ce point de vue.
Comme le relevait le même docteur Charles Joussellin, la création d’unités spécialisées en soins palliatifs n’encourage pas la diffusion d’une culture palliative au sein des établissements de santé. C’est pourquoi, il plaide pour un accroissement des équipes mobiles dans l’intra-hospitalier ou l’extra-hospitalier afin de permettre une véritable interdisciplinarité et une évolution des mentalités. Les syndicats infirmiers vont dans ce sens et ont indiqué que certaines unités de soins n’acceptaient pas la présence de ces équipes. En effet, il convient de rappeler que les équipes mobiles ne peuvent intervenir que si elles sont sollicitées.
La formation en soins palliatifs
1) Les médecins
– La formation initiale
En premier cycle, les étudiants doivent suivre une unité d’enseignement dénommée « santé, société, humanité » qui aborde les questions du traitement de la douleur, des soins palliatifs et l’éthique (21).
Le deuxième cycle comprend un module « douleur, soins palliatifs, anesthésie » (22) qui figure au programme de l’examen classant national.
S’agissant du troisième cycle, les étudiants qui le souhaitent peuvent se spécialiser en « médecine de la douleur et médecine palliative » grâce à l’obtention sur deux ans d’un diplôme d’études complémentaires spécialisées (DECS).
– La formation continue
Il existe deux diplômes consacrés aux soins palliatifs :
– le diplôme universitaire de soins palliatifs ;
– le diplôme interuniversitaire de soins palliatifs et d’accompagnement.
2) Les infirmiers
Depuis 2009 pour l’obtention du diplôme d’État d’infirmier, les étudiants doivent se former aux questions d’éthique et de soins palliatifs.
Au premier semestre figure l’unité « législation, éthique, déontologie ». Lors du quatrième semestre, ces principes éthiques sont soumis à des cas pratiques et au cours du cinquième semestre, une unité spécifique « soins palliatifs et de fin de vie » apprend aux étudiants à identifier les besoins spécifiques d’un patient et de son entourage et à réaliser des soins particuliers.
Toutes les réflexions entreprises depuis deux ans autour de la question de la fin de vie et les auditions menées par la Rapporteure ont relevé une formation insuffisante des professionnels de santé dans le domaine des soins palliatifs.
Ainsi, dans son rapport sur le débat public concernant la fin de vie (23), le Comité consultatif national d’éthique (CCNE) insiste sur la nécessité de « réaliser un effort massif de formation des médecins et soignants, donnant toute sa place à la réflexion éthique, garantissant la réalité d’un service public en la matière ».
Selon le Collège national des enseignants en soins palliatifs, il n’existe pas de visibilité des soins palliatifs dans les études médicales. Une autre approche fondée sur des compétences relationnelles ou éthiques est nécessaire. Si la mise en place de modules dans la formation initiale des médecins et des infirmières est un premier pas encourageant, ces modules sont plus centrés sur l’acquisition de connaissances cliniques que sur la compétence éthique et l’aptitude à travailler en équipe pluridisciplinaire.
Plus important, la notion d’écoute est primordiale. Le docteur Charles Joussellin, vice-président de la SFAP (24), a souligné que l’expression de la souffrance physique était souvent l’expression d’autres souffrances. Il a affirmé que le médecin devait apprendre à soigner le malade et non le symptôme.
D’autres difficultés ont été relevées :
– le temps consacré au module « douleur, soins palliatifs et accompagnement » est variable selon les facultés, entre 2 heures et 35 heures ;
– la majorité des unités de soins palliatifs ne sont pas reconnues comme lieux de stage validant en troisième cycle ou en diplôme d’études complémentaires spécialisées (DECS) ;
– il n’existe pas de filière universitaire.
Le rapport de la commission de réflexion sur la fin de vie en France (25) a émis plusieurs recommandations dont celle de repenser en profondeur l’enseignement des études médicales, ce qui supposerait :
– de rendre obligatoire un enseignement en soins palliatifs qui aborde en profondeur les différentes situations cliniques ;
– de développer la formation au bon usage des opiacés et des médicaments sédatifs ;
– de susciter un enseignement universitaire et en formation continue sur ce que l’on entend par obstination déraisonnable.
La SFAP plaide pour l’abolition de la frontière entre le soin curatif et le soin palliatif. La mise en place d’un vrai parcours de soins qui intégrerait en amont et de façon précoce les soins palliatifs soulagerait le malade.
Selon la Rapporteure, il importe de diffuser une culture et une démarche palliative, plus qu’une spécialité proprement dite en soins palliatifs, qui risquerait d’isoler encore plus cette pratique. Le développement d’équipes mobiles irait dans ce sens.
La loi du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie précitée ne prend pas suffisamment en compte les droits du patient et ne permet pas à la personne malade d’être entendue sur son choix de fin de vie. C’est pourquoi, il convient d’aller plus loin et de permettre à toute personne malade d’avoir le droit de décider de sa mort. Par ailleurs, les soins palliatifs ne répondent pas à toutes les situations et la possibilité de bénéficier d’une euthanasie ou d’une aide au suicide doit être envisagée.
En l’état actuel de la législation, l’euthanasie et le suicide médicalement assisté sont prohibés en France. Selon le rapport précité de la Commission de réflexion sur la fin de vie en France « les citoyens expriment une angoisse de mourir dans des conditions inacceptables en étant dépossédés de toute autonomie, ce qui conduit à une grande souffrance anticipée. Un certain nombre de demandes d’euthanasie semblent liées à cette angoisse ». La loi du 22 avril 2005 précitée ne répond pas au malade qui souhaite rester maître de son destin. Le texte proposé par la Rapporteure assure le respect de son choix à la personne malade, affirme son principe d’autonomie et son libre-arbitre, qui devient la référence première.
Dans son rapport sur le débat public concernant la fin de vie (26), le CCNE souligne « l’expression forte et unanimement partagée par les personnes, d’une volonté d’être entendues, respectées et de voir leur autonomie reconnue ».
La Cour européenne des droits de l’homme dans sa décision du 30 janvier 2011 (27) a jugé que le droit d’un individu de décider de quelle manière et à quel moment sa vie doit prendre fin, à condition qu’il soit en mesure de former librement sa volonté à ce propos et d’agir en conséquence, est l’un des aspects du droit au respect de sa vie privée au sens de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme.
Le texte introduit dans le code de la santé publique la possibilité pour toute personne atteinte d’une affection grave et incurable, infligeant une souffrance physique ou psychique inapaisable ou qu’elle juge insupportable, de demander à bénéficier d’une euthanasie.
L’Observatoire national de la fin de vie et le CCNE donnent la définition suivante de l’euthanasie : situation où un tiers met intentionnellement fin à la vie d’une personne à sa demande, afin de faire cesser une situation qu’elle juge insupportable. Un tel acte ne peut s’envisager et s’effectuer qu’à la demande de la personne ou de ses représentants ou après avoir recueilli son consentement.
Ce qui caractérise l’euthanasie réside donc dans l’expression d’une demande de la part de la personne concernée.
La difficulté réside dans l’appréciation du caractère libre et éclairé de cette demande.
Trois pays européens, la Belgique, le Luxembourg (28) et les Pays-Bas, ont fait le choix de légaliser l’euthanasie en l’assortissant de garanties.
La législation belge du 28 mai 2002 relative à l’euthanasie exige que le patient soit majeur, conscient, capable de consentir. Ce dernier doit se trouver dans une situation médicale sans issue, résultant d’une « affection accidentelle ou pathologique grave et incurable » et faire état d’une souffrance physique ou psychique constante et insupportable qui ne peut être apaisée. Le médecin doit évoquer avec la personne malade les possibilités thérapeutiques et palliatives. Pour une personne en état d’exprimer sa volonté, la demande doit être volontaire, réfléchie et répétée et sans pression extérieure. Pour une personne inconsciente, la demande doit avoir a été faite sous la forme d’une déclaration anticipée.
Aux Pays-Bas, la loi du 12 avril 2001 sur le contrôle de l’interruption de la vie sur demande et l’aide au suicide a légalisé l’euthanasie. Lorsque la personne est en état d’exprimer sa volonté, la demande doit être jugée volontaire et réfléchie par le médecin. Lorsqu’elle n’est pas consciente, la personne doit avoir effectué cette demande par le biais de directives anticipées. La souffrance de la personne malade doit être insupportable et sans perspective d’amélioration. Enfin, le médecin doit avoir la conviction qu’il n’y a pas d’autre solution raisonnable pour la personne.
Dans ces deux pays, un contrôle déclaratif a posteriori a été mis en place.
La frontière entre euthanasie et suicide médicalement assisté est tenue. D’ailleurs, M. Jean-Claude Ameisen, président du CCNE (29) a souligné que la conférence des citoyens ayant travaillé sur ce sujet avait relevé peu de différence entre ces deux pratiques. Le point de départ est similaire, il s’agit d’une demande explicite de la personne malade, mais dans le cas du suicide, l’assistance du médecin se limitera à prescrire et à fournir les médicaments à la personne malade afin de lui permettre de se donner la mort.
Selon la conférence de citoyens sur la fin de vie, le suicide doit faire l’objet de procédures et d’un accompagnement médical. Elle pose plusieurs conditions :
– une demande explicite et répétée de recourir au suicide ; être informée et libre de son choix ;
– la reconnaissance de l’existence de la situation médicale de fin de vie par une procédure collégiale de médecins ;
– avoir un réel accès à des solutions alternatives ;
– s’assurer de la remontée d’informations.
Lorsque la personne malade n’est pas en mesure d’exprimer sa volonté ou se trouve dans une situation de grande vulnérabilité, le respect de son choix de fin de vie est particulièrement problématique. C’est pourquoi, il est nécessaire que les deux mécanismes existant à ce jour, les directives anticipées et la nomination d’une personne de confiance soient renforcés.
L’article L. 1111-11 du code de la santé publique autorise toute personne majeure à « rédiger des directives anticipées pour le cas où elle serait un jour hors d’état d’exprimer sa volonté » (30).
Ces directives indiquent « les souhaits de la personne relatifs à sa fin de vie concernant les conditions de la limitation ou de l’arrêt des traitements ». Le professeur Didier Sicard, président d’honneur du Comité consultatif national d’éthique a évoqué l’idée de points sur lesquels la personne malade n’accepte pas de transiger (31).
Le contenu de ces directives est particulièrement important. Comme le souligne le CCNE dans son avis n° 121 (32), si elles sont trop précises, elles ne laissent pas de place à l’interprétation médicale, trop générales elles ne permettent pas de s’assurer que la volonté exprimée répond à la situation.
La Rapporteure ne peut que regretter que les recommandations de la commission de réflexion sur la fin de vie de faire élaborer par le ministère de la santé un guide de rédaction n’aient pas été suivies d’effet.
C’est pourquoi, il semble pertinent à la Rapporteure de proposer que ces directives soient rédigées avec l’aide de son médecin traitant. C’est dans cet esprit que le CCNE dans son avis n° 121 précité suggère d’inciter à la rédaction de ces directives pour toute personne malade ou pas et pour toute personne atteinte d’une maladie grave d’être informée de cette possibilité par son médecin traitant.
Le docteur Charles Joussellin, vice-président de la SFAP, a souligné que les directives ne devaient pas nuire à la relation de confiance existant entre le patient et son médecin traitant.
La Rapporteure souhaite que les directives anticipées portent non seulement sur les limitations ou arrêts de traitement, mais également sur les demandes d’euthanasie et de suicide assisté.
La durée de validité de ces directives est limitée. En effet, elles ne sont valables qu’à la condition de dater de moins de trois ans avant l’état d’inconscience de la personne malade. Elles sont révocables à tout moment par le patient conscient.
Le renouvellement tous les trois ans des directives est une démarche contraignante et difficile à mettre en œuvre. C’est pourquoi, la Rapporteure suggère de conférer aux directives une durée de validité illimitée, tout en restant modifiables et révocables à tout moment.
Elles ne constituent pas une injonction au médecin, qui garde la responsabilité de décider de l’arrêt des traitements lorsque le patient est inconscient. Le terme de souhait est à cet égard significatif. L’article L. 1111-11 indique que le médecin « en tient compte pour toute décision d’investigation, d’intervention ou de traitement la concernant ». Les directives anticipées sont donc à prendre en compte parmi d’autres éléments comme le jugement porté par le médecin sur les chances de rétablissement du patient à l’issue des traitements envisagés.
Dans son avis du 8 février 2013, le Conseil national de l’Ordre des médecins rappelle que « les médecins et les membres de l’équipe de soins qui concourent à la prise en charge du malade doivent prendre en compte les directives anticipées et l’avis de la personne de confiance, qui traduisent, dans sa liberté, les dernières volontés conscientes du patient ». Il refuse cependant que ces directives puissent avoir le caractère d’une injonction.
La Rapporteure souhaite que la volonté du malade soit respectée et donc que ces directives s’imposent au médecin.
Enfin, il n’existe pas de fichier national regroupant les directives anticipées comme il peut en exister pour le don d’organes, ce qui empêche leur consultation en cas d’urgence.
Il faudrait au moins que tout médecin puisse avoir connaissance de leur existence. En effet, si le médecin traitant est souvent au courant de l’existence de ces directives, il est rarement contacté en cas d’hospitalisation de son patient.
C’est pourquoi, les directives restent peu utilisées ; en effet, ce dispositif est méconnu des citoyens et des professionnels de santé. Une étude conjointe menée par l’Institut national d’études démographiques (INED) et l’Observatoire national de fin de vie montre que seulement 2,5 % des patients décédés avaient rédigé des directives anticipées et que, lorsqu’elles avaient été formulées, elles avaient été considérées comme utiles dans 72 % des situations.
La Rapporteure propose donc que figure dans la carte vitale de l’intéressé la présence éventuelle de directives anticipées.
L’article L. 1111-6 du code de la santé publique fixe les conditions dans lesquelles une personne majeure et capable peut désigner une personne de confiance. Cette faculté est réservée à des personnes qui ne sont pas soumises à un régime de tutelle. Toutefois si une personne a été désignée antérieurement à sa mise sous tutelle, le juge peut confirmer sa désignation.
La personne de confiance qui peut être un parent, un ami, voire son médecin traitant est unique. Sa désignation s’effectue par écrit et peut être modifiée ou révoquée à tout moment. Cette désignation peut s’effectuer à tout moment, y compris au moment de l’admission en cas d’hospitalisation.
Sa mission évolue en fonction de l’état de santé de la personne malade. Si ce dernier est conscient, son rôle consistera dans un accompagnement, par contre, si la personne est hors d’état d’exprimer sa volonté, elle sera l’interlocuteur des professionnels de santé. Elle doit être consultée avant toute intervention ou investigation (33).
Néanmoins, elle n’a pas accès aux informations contenues dans le dossier médical. La Rapporteure propose donc de remédier à cette lacune.
Comme pour les directives anticipées, ce dispositif est méconnu du personnel hospitalier et des patients. Il n’existe pas de formulaire type et la pratique diffère selon les établissements.
La Commission des Affaires sociales examine la présente proposition de loi lors de sa séance du mercredi 21 janvier 2015.
Mme la présidente Catherine Lemorton. Alors que nous abordons l’examen de la proposition de loi de Mme Véronique Massonneau, je rappelle le contexte du débat. La question de la fin de vie a fait l’objet d’une réflexion approfondie menée par nos collègues Alain Claeys et Jean Leonetti, dont je salue le travail et l’engagement permanent, à la suite d’une mission que leur avait confiée le Gouvernement en juin dernier. C’est sur la base des conclusions qu’ils ont présentées à la mi-décembre que va se dérouler, cet après-midi même, un débat dans l’hémicycle.
Une proposition de loi sera ensuite déposée qui, en l’état actuel de mes informations, devrait être examinée en séance publique début mars. Par ailleurs, l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques (OPECST) a organisé hier une audition publique où notre collègue Jean-Louis Touraine a représenté notre commission, ce dont je le remercie.
Mme Véronique Massonneau, rapporteure. Mes chers collègues, « la mort n’effraie pas autant que le mal mourir » : cette réflexion, qui figure dans le rapport 2013 de l’Observatoire national de la fin de vie, prouve que le débat n’est pas clos. En effet, si l’élaboration progressive d’un cadre juridique sur cette question a permis de nettes améliorations, beaucoup reste à faire.
Si la loi dite « Leonetti » du 22 avril 2005 a représenté un progrès indéniable, elle a aussi montré ses limites. Plusieurs affaires douloureuses se sont retrouvées en une des journaux, la plus médiatisée et tristement connue étant celle de Vincent Lambert. Pourquoi n’y a-t-il que 2 % à 5 % des Français à avoir rédigé leurs directives anticipées ? Comment se fait-il que le médecin décide encore de la fin de vie du patient à la place de ce dernier ?
Les insuffisances de la loi de 2005 n’est plus à prouver. Les Français ne se sentent pas détenteurs de ce nouveau droit dont ils n’ont pas, à juste titre, saisi les contours. L’usage de la sédation est évoqué mais interprété de manière différente selon le médecin ou l’établissement : parfois, elle est entreprise jusqu’à la mort ; d’autres fois, elle est interrompue pour s’assurer que le patient souhaite poursuivre le processus. Ces pratiques doivent être mises à plat, dans l’intérêt premier du patient qui ne doit plus être victime de l’insécurité juridique des médecins. Les tribunaux ne doivent plus être les théâtres de drames familiaux. Un cadre juridique clair doit être défini et les choix de fin de vie des patients doivent enfin être respectés.
Nous devons donc aller plus loin. Le candidat François Hollande en était convaincu, mais il a tardé à donner une concrétisation à son engagement 21. En juin 2013, j’avais rapidement déposé une première proposition de loi visant à assurer aux patients en fin de vie le droit de mourir dans la dignité, souhaitant qu’elle puisse être un outil législatif au service de chacun. En vain. Alors, le groupe écologiste a décidé d’inscrire ce texte complété visant à assurer aux patients le respect de leur choix de fin de vie à l’ordre du jour d’une de ses niches parlementaires. Je me réjouis que la discussion de ce matin vienne enrichir d’autres moments de débats parlementaires, je pense notamment à celui que nous aurons cet après-midi en séance publique.
Notre assemblée s’empare enfin de ce sujet qu’elle avait délaissé depuis 2011, lorsque l’opposition de l’époque avait défendu, sans pouvoir la faire adopter, une proposition de loi similaire à la mienne. Devenue la majorité à laquelle j’appartiens, l’opposition d’alors a désormais les moyens d’adopter un texte qui changerait la vie de nos concitoyens, qui serait à la hauteur de leurs attentes.
Je propose, en premier lieu, d’introduire dans le code de la santé publique le droit pour toute personne malade de demander à bénéficier d’une euthanasie ou d’un suicide médicalement assisté. Cette demande est encadrée et obéit à une procédure qui donne le temps de la réflexion aux praticiens et aux malades. Seules les personnes majeures et capables, atteintes d’une affection grave et incurable – quelle qu’en soit la cause – et subissant des souffrances physiques et psychiques insupportables ne pouvant être apaisées, peuvent en faire la demande. Le médecin doit alors consulter un autre confrère dans un délai maximal de quarante-huit heures. Les médecins pourront invoquer la clause de conscience et l’équipe soignante sera consultée.
L’objectif est de mettre en place une procédure qui permette de vérifier la volonté et la situation médicale de la personne malade. Les médecins devront se livrer à plusieurs vérifications. En premier lieu, ils devront s’assurer de la capacité de la personne malade et de sa volonté de recourir à une euthanasie ou de bénéficier d’un suicide médicalement assisté. En deuxième lieu, ils devront constater la réalité de la situation médicale de la personne malade et l’impasse thérapeutique qui en résulte. La demande de la personne malade doit être libre, éclairée et explicite. Le patient doit réitérer sa demande, qui peut être révocable à tout moment, et il dispose d’un temps de réflexion de deux jours.
Lorsque la personne malade n’est pas en mesure d’exprimer sa volonté, le respect de son choix de fin de vie est particulièrement problématique. C’est pourquoi il est nécessaire que les deux mécanismes existant à ce jour – les directives anticipées et la désignation d’une personne de confiance – soient renforcés.
Je propose que le contenu, la durée de validité et l’opposabilité aux médecins des directives anticipées soient améliorés. Ainsi, les directives anticipées porteront non seulement sur les limitations ou arrêts de traitement, mais également sur les demandes d’euthanasie. Afin que la volonté du malade soit respectée, ces directives s’imposeront au médecin. En outre, je souhaite leur conférer une durée de validité illimitée, étant entendu qu’elles restent modifiables et révocables à tout moment.
Une procédure de contrôle est instituée. Tous les actes d’euthanasie ou de suicide médicalement assisté seront déclarés a posteriori par les médecins dans un délai de huit jours auprès d’une commission régionale de contrôle qui aura pour mission de vérifier si les exigences légales ont bien été respectées. En cas de non-respect de la loi ou en cas de doute, cette commission transmettra le dossier à un organe chargé de trancher en dernier recours – la Commission nationale de contrôle des pratiques en matière d’aide médicale à mourir –, qui sera rattaché aux ministres de la justice et de la santé. Elle pourra également transmettre le dossier à l’autorité judiciaire compétente.
Enfin, pour garantir l’égalité d’accès de tous les citoyens aux soins palliatifs par un meilleur maillage territorial, je propose que le nombre d’unités de soins palliatifs soit conditionné au nombre d’habitants par département.
En conclusion, cette proposition de loi permettra à la personne malade d’assurer le respect de son choix de fin de vie et d’affirmer son principe d’autonomie. Elle protègera aussi celui qui refuse une quelconque aide à mourir. Elle sera un moyen d’apaiser les proches qui sauront les dernières volontés de la personne respectées. L’existence de cette issue possible suffit parfois à rassurer les personnes en fin de vie.
Au-delà des convictions de chacun, que je respecte, l’argument le plus souvent opposé à une telle avancée est le manque criant de places en unités de soins palliatifs. Ce manque est réel et insupportable pour un grand pays comme le nôtre. Je le déplore mais je me refuse à opposer le développement des soins palliatifs à une légalisation de l’euthanasie. Tout d’abord, l’accès universel aux soins palliatifs ne fera pas disparaître toutes les demandes d’euthanasie, car certains ne veulent tout simplement pas de ces soins. Ensuite, si l’on considère la demande d’euthanasie comme un acte de désespoir faute de place en unités de soins palliatifs, alors il faut être cohérent et refuser toute forme de sédation terminale pour le même motif. Par ce texte, il s’agit surtout de refuser d’imposer une situation insupportable à une personne qui souhaite y mettre un terme. Il s’agit d’en finir avec les dogmatismes quels qu’ils soient.
Je vous propose, chers collègues, de comprendre les demandes de nos concitoyens, ce qu’ils vivent, ce qu’ils veulent et ce qu’ils ne veulent pas, et d’accepter leurs choix même s’ils ne sont pas les nôtres. Le respect du choix des autres imprègne les valeurs de notre pays. Soyons à la hauteur des enjeux et des attentes : ne nous contentons pas d’un consensus mou qui ne satisfait personne ; ayons le courage d’accomplir une véritable avancée sociétale, de celles qui sont souvent acquises dans la contestation mais ne sont jamais remises en cause.
Mme Martine Pinville. Beaucoup de Français pensent que notre législation et notre organisation des soins ne permettent pas toujours de finir sa vie dans la dignité. Au cours de cette législature, ce sujet a fait l’objet de deux rapports : l’un, du professeur Didier Sicard, l’autre, de MM. Alain Claeys et Jean Leonetti, qui a donné naissance à une proposition de loi modifiant la loi du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie. Celle-ci comporte trois idées essentielles : le respect absolu par le corps médical des directives anticipées ; l’affirmation du droit du malade à l’arrêt des examens et traitements ; la mise en place d’une sédation profonde et continue jusqu’à la mort, associée à l’arrêt de tous les traitements de maintien en vie lorsqu’un patient, atteint d’une maladie grave et incurable et dont le pronostic vital est engagé, est en proie à une souffrance réfractaire ou s’il décide d’arrêter de lui-même tout traitement. C’est le droit à mourir paisiblement et sans souffrance.
Votre proposition de loi, Véronique Massonneau, a en commun avec cet autre texte de mettre le patient au cœur de la décision. Cet après-midi, le Premier ministre et les groupes parlementaires vont s’exprimer en séance publique, au cours d’un débat qui doit être serein et apaisé, car il porte sur un vrai sujet de préoccupation de nos concitoyens. Compte tenu des travaux engagés et du dépôt annoncé de la proposition de loi de MM. Alain Claeys et Jean Leonetti dont nous pourrons débattre au mois de mars, le groupe socialiste ne votera pas pour celle qui nous est présentée ce matin.
M. Jean Leonetti. Je suis d’accord avec Véronique Massonneau sur le fait que nos lois ne sont pas appliquées et aussi sur la probabilité que le débat sur la fin de vie, aussi vieux que l’humain, se poursuivra tant que l’humain sera capable de se questionner.
En 1999, nous définissions ensemble l’accès pour tous aux soins palliatifs. Or nous constatons que, malgré des avancées considérables, il reste énormément d’insuffisances. En 2002, nous avons franchi une étape supplémentaire en accordant le droit de refuser des traitements, même si cela met la vie de la personne en danger. Force est de constater que l’application de cette mesure reste incomplète. En 2005, nous avons adopté une loi qui condamne l’acharnement thérapeutique. On constate pourtant encore que ce dernier persiste dans les services hospitaliers, même s’il est parfois demandé autant par les malades que par les médecins.
Permettez-moi de souligner que l’affaire Vincent Lambert n’a rien à voir avec le droit à l’euthanasie ou au suicide médicalement assisté : dans n’importe quel pays, quelqu’un qui n’a pas émis de directives pose un problème. Rappelons que la France est le seul pays à avoir inventé une procédure qui permet de mettre fin à ces prolongations artificielles de la vie. Dans les autres pays, y compris dans ceux qui ont légalisé l’euthanasie ou le suicide médicalement assisté, l’affaire Vincent Lambert ne se réglerait pas. Le Conseil d’État a confirmé que l’arrêt des traitements de survie de Vincent Lambert était possible. Cette affaire n’est pas un élément qui doit nous inciter à modifier la loi, sauf à lui faire préciser que les membres de la famille doivent exprimer l’avis de la personne qui ne peut plus le faire et non pas leur avis personnel. Sur les 30 000 et 50 000 arrêts de traitements de survie qui sont décidés chaque année en application de la procédure française, il pourra toujours y avoir un cas où la famille se déchire et qui est soumis aux tribunaux.
Venons-en à la procédure choisie par le Président de la République, le Premier ministre et le Gouvernement. On ne peut pas dire qu’il n’y a pas eu de débat. D’abord, la commission Sicard, créée à l’initiative du Président de la République, a mené des consultations dans toute la France. Ensuite, le Comité consultatif national d’éthique (CCNE) a émis un avis confirmant, à la majorité de ses membres, les conclusions du rapport du professeur Didier Sicard. Enfin, le CCNE a rendu un rapport où étaient bien définis les avancées consensuelles et les points d’affrontement. Le Président de la République a choisi la voie consensuelle – qui n’a rien d’un consensus mou – pour dépasser le problème de manière pragmatique grâce à tous ces travaux. Il a déclaré qu’il faisait siennes les suggestions contenues dans la proposition de loi que nous avons déposée Alain Claeys et moi-même.
Le droit à l’euthanasie ou au suicide médicalement assisté soulève plusieurs problématiques, la première étant la rupture de digue. On part toujours d’un cadre extrêmement strict, et je ne remets pas en cause la sincérité de Véronique Massonneau quand elle veut réserver ce droit aux seuls adultes. Pour autant, on constate qu’en Belgique l’autorisation d’euthanasie existe pour les malades mentaux et les mineurs, et qu’en Suisse 30 % des suicides assistés concernent des personnes qui n’ont pas de maladies graves et incurables mais qui sont seulement âgées et lasses de vivre. Lorsqu’on ouvre un droit de ce type, il est extrêmement difficile de le circonscrire.
Le deuxième argument est d’ordre médical. Dans notre pays où les soins palliatifs se sont installés, la culture médicale est opposée à l’euthanasie pour une raison logique : la mort ne poursuit pas les soins, elle les interrompt.
Ce qui me conduit au troisième argument : il est difficile pour une société de combattre le suicide tout en l’autorisant pour certaines personnes. C’est là un débat éthique dans lequel s’opposent les notions d’autonomie et de vulnérabilité : il faut respecter la volonté de l’individu mais également protéger les personnes vulnérables. Lorsqu’une personne arrive à l’hôpital après une tentative de suicide, elle est réanimée. Toutes les sociétés essaient de lutter contre le suicide, le considérant davantage comme le signe d’une souffrance que comme l’expression d’une liberté individuelle. Comme Robert Badinter, je pense que lorsque l’on touche à des droits fondamentaux tels que le droit à la vie, on prend le risque de fragiliser les plus vulnérables.
Je ne dis pas que la proposition de loi que nous avons déposée, Alain Claeys et moi-même, clôt définitivement le débat. Le Mythe de Sisyphe de Camus commence par cette interrogation philosophique : la vie vaut-elle vraiment la peine d’être vécue ? C’est effectivement la question existentielle fondamentale pour les humains. Pour autant, la proposition de loi est consensuelle et, à certains moments de son histoire, un pays doit savoir se rassembler sur l’essentiel pour continuer à faire vivre la démocratie. Ce débat est utile et je me réjouis qu’il ait lieu à l’Assemblée nationale : les parlementaires pourront améliorer ce texte qui n’est pas parfait mais qui répond à l’attente des Français. Ceux-ci demandent à être mieux écoutés et à ne pas souffrir en fin de vie.
Pour terminer, je citerais la dernière statistique qui n’est ni plus ni moins valable que les autres. Majoritairement, les Français préfèrent mourir tout de suite plutôt qu’après un mois de souffrance. En revanche, ils préfèrent des soins palliatifs qui atténuent la souffrance, quitte à ce qu’ils raccourcissent la vie, plutôt que la mort donnée. Attention aux réponses trop simples sur des problèmes éminemment complexes et divers. Il serait bon que nous essayions, dans le respect de nos différences, d’avancer ensemble dans une direction souhaitée par les Français plutôt que de s’abriter derrière des positions dogmatiques ou personnelles.
M. Michel Piron. Même si je ne suis pas membre titulaire de cette commission, je présente les vœux de bonne année de mon groupe, en préambule aux quelques questions que je souhaite soulever à l’occasion de l’examen de cette proposition de loi.
J’approuve la totalité des propos de Jean Leonetti et, comme beaucoup de membres de mon groupe, je reste perplexe face à l’extrême complexité d’un sujet qui peut donner lieu à des positions très ambivalentes, et face à la très grande difficulté à poser les mots justes quand sont en jeu des choses aussi fondamentales.
Entre mal mourir et mal vivre sa fin, il y a une infime différence mais ce n’est pas du raffinement sémantique. La ligne est aussi mince que celle qui sépare l’euthanasie passive de l’euthanasie active, ou celle qui sépare l’euthanasie active du suicide assisté. L’euthanasie passive est la conséquence très indirecte mais non voulue de traitements qui, pour soulager la souffrance du patient, vont hâter sa fin. Ce n’est pas la même chose que de viser d’abord la fin de vie et de choisir les traitements en conséquence.
Pour avoir participé activement à la mission Leonetti qui a débouché sur la loi de 2005, et suivi une soixantaine des quatre-vingt-une auditions auxquelles elle avait procédé, je me souviens de témoignages bouleversants mais aussi de la méthode tout à fait exemplaire adoptée pour conduire la réflexion. Nous avions commencé par entendre des ethnologues, des historiens, des sociologues, des philosophes et toutes les grandes familles religieuses ou de pensée. Ce n’est qu’après avoir remis en perspective le rapport à la mort dans les différentes sociétés et au cours de l’histoire, que nous avons commencé à entendre les membres du corps médical jusqu’à l’infirmière, à l’aide qui tient la main du mourant. Ce n’est qu’ensuite encore que nous avons entendu les personnes qui fabriquent du droit, de la règle, et qui, au nom de la société, essaient de poser quelques jalons qui pèsent très lourd : ils consacrent un droit de la société sur la mort, cette chose unique qui n’est pas seulement abstraite. On parle rarement bien de la mort parce qu’il est très difficile d’envisager la sienne. Dans cette situation, la plume peut trembler avant qu’on écrive.
Madame la rapporteure, vous avez mentionné le faible nombre de directives anticipées. Comment pourrait-il en être autrement dans une société comme la nôtre où, au fil des années, la mort a été évacuée pour ne pas dire niée, pour des raisons en partie inconscientes ? L’un des ethnologues nous faisait remarquer qu’il n’y a plus de cortèges mortuaires dans les villes, pour des raisons de circulation. Ces cortèges passaient devant des enfants aussi bien que devant des adultes et la mort était présente dans la société. De nos jours, elle en est de plus en plus absente, comme externalisée, de plus en plus médicalisée hors du domicile. Dans ce contexte, il n’y a pas lieu de s’étonner de la faiblesse du nombre de directives anticipées.
Vous n’avez abordé la question des soins palliatifs qu’à la fin de votre intervention. Comme Jean Leonetti, je pense qu’ils devraient être réintégrés dans l’ensemble de la démarche d’accompagnement de ceux qui vont mourir. Si la mort transforme la vie en destin, comme le disait André Malraux, c’est parce que chaque vie qui disparaît est unique. C’est la raison pour laquelle je ne voterai pas pour votre texte, tout en pensant que vos propositions peuvent contribuer à enrichir la réflexion et les débats de cet après-midi.
M. Christophe Cavard. Deux ans et demi après l’élection du Président de la République, l’engagement 21 du candidat François Hollande que « toute personne majeure en phase avancée ou terminale d’une maladie incurable, provoquant une souffrance physique ou psychique insupportable, et qui ne peut être apaisée, puisse demander, dans des conditions précises et strictes, à bénéficier d’une assistance médicalisée pour terminer sa vie dans la dignité » n’en est encore qu’à l’étape d’un débat sans vote. Les Français n’en peuvent plus d’attendre. Leur dignité n’est plus respectée ; leur ultime liberté n’est pas garantie ; leurs dernières volontés ne sont pas entendues. Les écologistes ont donc décidé de mettre leurs propositions sur la table pour qu’enfin nous regardions en face la réalité qu’affrontent nos concitoyens : leur choix de fin de vie.
Comme tous les membres de mon groupe, je regrette que ce texte soit présenté à la faveur d’une simple niche parlementaire. Pour autant, je souhaite saluer la qualité du travail fourni par ma collègue Véronique Massonneau : une vingtaine de personnalités ont été auditionnées ; de très nombreuses tables rondes ont été organisées dans toute la France ; des visites de terrain, notamment dans des unités de soins palliatifs, ont été effectuées ; un grand colloque s’est tenu à l’Assemblée nationale en novembre dernier, au cours duquel Catherine Lemorton a bien voulu s’exprimer en sa qualité de présidente de la commission des affaires sociales et le président Claude Bartolone s’est prononcé en faveur de l’autorisation de l’euthanasie et du suicide assisté dans des cas bien précis, dispositions figurant dans notre proposition de loi.
Le combat est difficile, car l’affect est permanent. C’est l’un de ces combats politiques qui requièrent suffisamment de discernement pour ne pas se laisser guider par ses émotions et oublier les réalités humaines concernées. Tout le monde a un avis et des convictions ; nombreux sont ceux qui ont des certitudes qu’ils aimeraient parfois imposer aux autres. Il n’est pas question de se laisser voler son ultime liberté.
L’objectif de ce texte est de faire en sorte que chacun puisse choisir seul sa fin de vie, tout en respectant le choix des autres. La liberté de choix est une valeur fondamentale que les écologistes défendent depuis toujours. Nous sommes fiers de proposer ce texte et d’essayer de faire progresser cette valeur dans notre société. C’est pourquoi nous souhaitons que nos travaux permettent d’améliorer ce texte et de l’adopter, afin de respecter les engagements que nous avons pris en 2012.
Mme Dominique Orliac. Tout d’abord, je remercie la rapporteure pour son rapport très complet.
Les radicaux de gauche ont toujours été mobilisés sur les questions relatives à la fin de vie. Entre 1997 et 2002, le groupe radical, citoyen et vert avait fait adopter une proposition de loi qui reprenait les idées d’un ancien député et sénateur radical de gauche, Henri Caillavet, alors président de l’Association pour le droit de mourir dans la dignité. Sous la précédente législature, nous avons déposé un texte sur la fin de vie. Au début de cette quatorzième législature, en septembre 2012, nous avons encore déposé un texte. Pour nous, radicaux de gauche, le droit de mourir dans la dignité et le droit de choisir sa mort sont des principes importants.
La présente proposition de loi sera examinée dans l’hémicycle après le débat de cet après-midi et j’aimerais manifester notre mécontentement : consacrer seulement deux heures à un tel débat paraît inimaginable, quand le CCNE et les citoyens se sont réunis pendant des semaines et des mois. Les citoyens sont bafoués. Alors qu’il existe une fenêtre ouverte en séance ce soir, le Gouvernement aurait pu l’utiliser pour allonger la durée des débats.
Mille jours après la proposition du Président de la République, il n’est que temps de se saisir de la question. L’article 50-1 de la Constitution donne au Gouvernement la possibilité, sur un sujet déterminé, d’organiser un débat et de le soumettre à un vote ; le Gouvernement ne l’a pas utilisée, ce qui dénote un certain manque de courage.
Je regrette que la proposition de loi d’Alain Claeys et de Jean Leonetti, qui viendra à l’ordre du jour un peu plus tardivement, ne soit pas un projet de loi. Élaborée par la gauche et la droite dans un certain consensus, elle risque de se réduire à peau de chagrin. Quant à celle que nous étudions aujourd’hui, elle est très proche, voire identique sur certains points, à notre proposition de loi déposée en septembre 2012.
S’agissant de l’article 2, sur les conditions de mise en œuvre des actes d’euthanasie et d’aide au suicide, il faut veiller à ne pas faire porter la responsabilité sur un seul médecin ou même sur deux, sans compter qu’un deuxième avis pourrait être difficile à trouver dans l’urgence, dans un délai de quarante-huit heures. Pour ce genre de décision, il est indispensable de faire appel à un collège de professionnels. Nous constatons avec satisfaction que les directives anticipées – un élément essentiel quand il s’agit de traiter de la fin de vie – sont inscrites à l’article 3. Nous soutenons les dispositions contenues à l’alinéa 8 de l’article 5, qui assimilent le suicide assisté à une mort naturelle. Toutefois, il nous semble administrativement compliqué de demander au médecin de rédiger un rapport exposant les conditions du décès. Nous avons aussi quelques réserves sur les dispositions prévues à l’article 6 concernant le refus pouvant être opposé par un médecin pour ménager sa liberté de conscience. Il risque en effet d’être compliqué de trouver l’accord d’un autre praticien dans un délai de deux jours.
Cette proposition de loi de nos collègues écologistes est tellement proche de celle que nous avions déposée qu’il serait illogique de nous y opposer. Nous attendons de voir l’issue de la commission avant de prendre une décision, mais nous sommes ouverts à la discussion afin de dégager le plus large consensus possible.
Plusieurs sondages récents montrent que les Français, dans leur grande majorité, attendent un texte qui permette enfin de vivre sa mort dans la dignité. Les exemples étrangers doivent nous aiguiller et nous aider à réfléchir. Nous avons attendu ; il est temps désormais de nous donner les moyens législatifs pour permettre aux personnes qui le souhaitent de vivre leur fin de vie dans la dignité, tout en laissant à d’autres le choix d’avoir recours aux soins palliatifs. Loin de s’opposer, ces deux possibilités sont complémentaires.
M. Philip Cordery. Je souhaite tout d’abord remercier la rapporteure pour sa très bonne proposition de loi. La fin de vie est un sujet extrêmement sensible sur lequel nos concitoyens attendent des réponses. Le dernier rapport d’Alain Claeys et de Jean Leonetti propose des avancées importantes que je tiens à saluer.
À ce stade du débat, je pense qu’un éclairage étranger peut nous aider. Je suis le représentant des Français établis dans trois pays – le Benelux – où des lois fondatrices encadrent la fin de vie depuis plus de dix ans, sans que personne ait songé à les remettre en question. Les modèles belge et luxembourgeois sont comparables à celui de la présente proposition de loi.
En quelques mots, je voudrais évoquer ces trois modèles pour montrer que passer du « laisser mourir » au « faire mourir » est possible sans heurts. En Belgique où la loi est entrée en vigueur en 2002, pour bénéficier de l’euthanasie, le patient doit être dans une situation médicale sans issue et faire état d’une souffrance physique ou psychique constante et insupportable, qui ne peut être apaisée et qui résulte d’une affection accidentelle ou pathologique grave et incurable. Il doit formuler sa demande de manière volontaire, réfléchie et répétée. Le médecin a l’obligation de s’entretenir avec lui et d’évoquer la situation, y compris son espérance de vie, les possibilités thérapeutiques et les soins palliatifs. Il doit acquérir la certitude qu’il n’y a aucune solution raisonnable dans la situation considérée et consulter au moins un confrère. Le Luxembourg dispose d’une législation très proche depuis 2009. Aux Pays-Bas, l’euthanasie et le suicide assisté sont autorisés sous six conditions depuis 2001. Le médecin doit acquérir la conviction que le patient a formulé sa demande librement, de façon mûrement réfléchie et constante. Si le patient n’est plus en mesure de formuler sa volonté, les directives anticipées s’appliquent.
Faute de temps pour détailler ces trois modèles, je suggère qu’en prévision de nos futurs débats, la Commission des affaires sociales les reprenne dans une étude de droit comparé. Les dates d’entrée en vigueur de ces lois nous permettent d’avoir un vrai recul sur leur application, et je pense qu’elles doivent nous inspirer. Le contenu de la proposition de loi de Véronique Massonneau reste très proche du modèle belge que je considère comme une avancée importante en ce qu’il laisse le libre choix au patient.
M. Rémi Delatte. Il n’est pas de sujets plus délicats pour le législateur que ceux qui, comme celui-ci, confinent à l’intime, à la conscience et aux convictions personnelles. Plus que jamais, la sagesse doit primer. Or je vois beaucoup d’imprudences dans cette proposition de loi, à propos de laquelle je vais me limiter à deux remarques.
D’abord, comme le Président de la République l’a dit lui-même, ce sujet doit faire l’objet d’un grand débat national. Ce débat a déjà été enrichi de nombreuses contributions, y compris de la part de nos éminents collègues Jean Leonetti et Alain Claeys, dont l’expertise et l’objectivité ne sauraient être contestées. Il a aussi été alimenté par des rapports d’institutions et d’autorités. Aucun de ces rapports ne préconise l’euthanasie et le suicide médicalement assisté, dispositions qui ont conduit les pays qui les ont adoptées à constater un accroissement des pratiques hors champ légal.
Ma deuxième remarque porte sur le principe de collégialité mis à mal par cette proposition de loi. Il ne peut être accepté de confier la décision à un médecin qui ferait appel à un autre praticien de son choix et qui consulterait l’équipe soignante « s’il y a lieu ». C’est vraiment le fait du prince. Nulle part, le texte ne qualifie le médecin chargé d’étudier le dossier. Est-ce le médecin généraliste référent, le médecin chef du service de l’hôpital ou le médecin ayant en charge le patient en cours d’hospitalisation ? Rien n’est précisé. Il y a manifestement un renoncement à la dimension collégiale, qui est pourtant primordiale car elle constitue un rempart à d’éventuelles dérives. Notre assemblée va débattre de manière plus approfondie sur ces sujets dès cet après-midi. Aussi la sagesse doit-elle nous amener à rejeter la proposition de loi de notre collègue Véronique Massonneau.
M. Jean-Louis Touraine. Il s’agit de l’un de ces sujets sur lesquels personne ne peut prétendre détenir de vérité absolue. Il convient de respecter des points de vue divers, fondés sur des philosophies différentes. Nous n’allons pas entreprendre ce matin le débat qui aura lieu dans l’hémicycle cet après-midi. De fait, nous aurons le choix entre plusieurs textes. La proposition de loi Claeys-Leonetti comporte des avancées telles que le droit des patients en fin de vie à être entendus, à ne pas souffrir, et à bénéficier d’une sédation profonde et continue jusqu’au décès. La proposition de loi de Véronique Massonneau préconise, quant à elle, l’euthanasie et le suicide médicalement assisté. Entre les deux, il y a plusieurs possibilités, notamment l’exception d’euthanasie qui a été préconisée lors de la conférence des citoyens, instituée à l’initiative du CCNE. Pour ne pas conclure ce matin, avant le débat parlementaire, je propose de renvoyer l’examen en commission de la proposition de loi analysée aujourd’hui.
Présidence de Mme Martine Carrillon-Couvreur
M. Fernand Siré. Une loi, qui a été étudiée et améliorée, accorde beaucoup de droits dans un domaine très philosophique : aux pesonnes qui ne choisissent pas de naître, on va donner la possibilité de choisir leur manière de mourir. C’est une vieille préoccupation. Chez Jean de La Fontaine, le malade qui appelait la mort n’en voulait plus quand elle s’est présentée. C’est le médecin, généraliste depuis quarante ans, qui vous parle. Parfois, un malade qui souffre me regarde comme si j’allais l’assassiner quand il voit la seringue de morphine que je m’apprête à lui administrer, à cause de cette légende sur l’injection du médecin qui provoque la fin de vie. C’est un regard difficile à supporter. Le rôle du médecin est de soigner, pas de tuer. Tant qu’il s’agit de soigner les patients pour les empêcher de souffrir jusqu’au bout, tous les médecins sont d’accord. Quand il s’agit d’arrêter la vie, c’est un autre problème.
M. Michel Liebgott. La complexité du problème s’accroît avec les progrès de la médecine qui permettent de repousser la mort. Il est important que nous en débattions car il se posera de plus en plus, et l’actualité nous en fournit des exemples : il y a quelques décennies, voire quelques années, les pilotes automobiles Michael Schumacher et Jules Bianchi n’auraient sans doute pas pu être sauvés.
Pour ma part, je suis plutôt scandalisé par le fait que les possibilités offertes par la loi actuelle ne soient pas utilisées : l’accès aux soins palliatifs est insuffisant et beaucoup de malades n’en bénéficient pas ; la prise en charge de la douleur reste nettement insuffisante ; la formation présente des lacunes puisque, semble-t-il, la moitié des médecins ne connaissent pas précisément la loi dite Leonetti.
La proposition de loi Claeys-Leonetti, que nous examinerons dans quelques semaines, apportera des améliorations considérables : la sédation profonde et continue jusqu’au décès, les directives anticipées et la possibilité de désigner une personne de confiance, la prise en compte des droits du patient qui peut refuser tout acharnement thérapeutique. Pour autant, je ne crois pas qu’il faille écarter les propositions de Véronique Massonneau, même si cette étape supplémentaire relève davantage de la liberté individuelle et nous fait entrer dans un autre cadre, comme le montre l’exemple de ce violeur récidiviste belge qui demande l’euthanasie. Doit-on ou non accéder à une telle demande ? Il y a aussi la situation de ces couples très âgés qui, d’un commun accord entre mari et femme, décident d’arrêter de vivre parce qu’ils n’en ont plus envie. Il peut aussi y avoir des jeunes déprimés dont on n’aura pas mesuré la profondeur du désespoir, qui pourraient avoir envie de mourir faute de perspective. Ce sujet intéressant relève de la liberté individuelle et j’ai bien conscience que la loi doit l’encadrer.
M. Dominique Dord. Notre rapporteure a, de façon choquante à mes yeux, qualifié de « dogmatique » la position actuelle de notre société et de notre droit et a également parlé de « consensus mou ». Je pense, au contraire, que cette position se situe sur une ligne de crête entre deux dogmatismes, qu’elle est l’aboutissement du long cheminement d’une société qui a ses racines, sa culture et ses convictions propres. Pour ce qui est du dogmatisme, je ne crois pas que ce sujet soit une affaire technique et administrative que l’on pourrait régler en huit pages et en sept articles, en instituant des délais, des procédures et des organes de contrôle. Ce n’est pas plus une affaire de combat politique, ni de numéro de proposition de campagne présidentielle ou de niche parlementaire. Quant au consensus mou, je pense, au contraire, que nous avons trouvé un consensus respectueux, prudent, délicat et sensible sur une question essentielle. Attachons-nous déjà à faire appliquer la loi en vigueur, qui permet véritablement de mourir dans la dignité.
M. Bernard Perrut. C’est un chantier immense et un grand débat de société que nous avons ouvert sur la question de la fin de vie. Un article de presse révèle que 150 000 personnes sur 550 000 sont décédées dans des conditions difficiles. Légaliser l’euthanasie et le suicide assisté ne résoudrait pas cette situation, qui est due à une offre insuffisante et inégale des soins palliatifs sur notre territoire, en d’autres termes à l’incapacité de notre société à accompagner les personnes en fin de vie.
La responsabilité du politique est de privilégier avant tout une approche palliative qui valorise le malade. En proposant de légaliser l’euthanasie et le suicide médicalement assisté, vous levez un interdit et ouvrez la voie à de plus en plus de transgressions. Il suffit d’observer l’escalade qu’ont connue la Belgique et les Pays-Bas pour s’en convaincre. Souhaitant créer un droit à la fin de vie, vous vous aventurez sur une pente glissante menant à la reconnaissance d’un droit à la mort. Au lieu de légaliser l’euthanasie, mieux vaudrait, au contraire, augmenter l’offre de soins palliatifs sur le territoire et accompagner les mourants dans la dignité. Le médecin doit respecter le malade et le législateur doit garantir l’interdit, fondateur de toute société, du droit à la mort. Ces limites sont inhérentes à notre humanité, humble et fragile au soir de la vie, mais jamais dépouillée de sa dignité intrinsèque.
Il n’y a pas lieu d’adopter aujourd’hui le texte qui nous est proposé mais bien de nous en remettre à l’important travail qu’ont mené nos collègues Alain Claeys et Jean Leonetti. Une loi est déjà en vigueur et un autre texte va être proposé : il doit pouvoir nous réunir autour d’une solution qui permette de respecter la volonté de la personne en fin de vie.
M. Gérard Sebaoun. Sur cette question complexe, intime, et qui implique le droit des patients, de nombreux pays ont légiféré depuis une vingtaine d’années, avec plus ou moins de succès. Le Benelux peut être un exemple en la matière. Sous la précédente législature, le groupe socialiste avait, lui aussi, souhaité aller plus loin que la loi dite Leonetti. Aux États-Unis, trois États ont légiféré en faveur du suicide assisté, chacun définissant des conditions d’application différentes. Nos cousins québécois, après avoir procédé à une étude exhaustive des évolutions intervenues au cours des vingt dernières années sur le plan international, ont fini par instaurer une aide médicale à mourir sous certaines conditions. Témoignant d’un sens de la formule qui devrait nous rappeler à nos devoirs, ils parlent de « soins en fin de vie » dans lesquels ils intègrent non seulement les soins palliatifs, mais aussi la sédation palliative continue et l’aide médicale à mourir.
Pour terminer, j’ai relevé dans l’étude québécoise précitée que lorsque le Grand-Duc Henri du Luxembourg, monarque catholique, compta, pour des raisons de conscience, opposer son veto aux dispositions sur la fin de vie adoptées par le Parlement, ce dernier a décidé de réviser la Constitution pour l’en empêcher et réduire ses pouvoirs législatifs.
M. Olivier Véran. J’ai presqu’envie, étant médecin, de m’excuser d’intervenir dans ce débat que doivent s’approprier, selon moi, non pas les experts ou les professionnels, mais avant tout les citoyens. Il doit traverser la société et interroger le plus grand nombre d’entre nous.
Dès lors qu’on parle de maladie chronique, de souffrance, de fin de vie, il convient de se montrer pondéré. Ces sujets sociétaux sont de ceux qui dépassent largement les clivages politiques traditionnels et doivent nous amener à nous rejoindre. À cet égard, la démarche initiée par le Président de la République et conclue par Alain Claeys et Jean Leonetti m’a semblée tout à fait adaptée à la situation et aux enjeux, la recherche d’un consensus me paraissant la meilleure des solutions possibles.
En pratique, nos soignants manquent aujourd’hui de plusieurs outils dans nos hôpitaux, à commencer par la présence d’équipes de soins palliatifs, en particulier d’équipes mobiles. Lors de l’examen du projet de loi relatif à l’autonomie, j’ai d’ailleurs défendu des amendements visant à rendre systématique l’accessibilité aux soins palliatifs en établissement d’hébergement pour personne âgée dépendante – EHPAD –, où les personnes âgées en souffrance physique ou psychique ne sont pas entendues parce qu’éloignées des centres de soin.
Les soignants pâtissent aussi du recours insuffisant aux directives anticipées, indispensables pour leur permettre d’entendre et de respecter la volonté exprimée par les patients eux-mêmes. Car alors que 95 % des Français se disent prêts à donner leurs organes si la situation l’indiquait, 34 % des familles refusent d’en prendre la décision. Nous perdons ainsi 1 500 greffons par an parce que la famille se sent en porte-à-faux lorsqu’elle doit trancher pour le patient.
Enfin, ils manquent de moyens nouveaux qui leur permettraient, ainsi que l’a proposé le Président de la République au cours de sa campagne, sans parler d’euthanasie, de « soulager les personnes majeures en phase avancée ou terminale d’une maladie incurable qui provoquerait une souffrance physique ou psychique insupportable et qui ne pourrait être apaisée ». Cette solution est prévue par la proposition de loi que nous serons amenés à examiner : elle porte le nom de sédation profonde et continue jusqu’au décès.
Interrogeant ma propre pratique clinique, j’ai réfléchi aux situations dans lesquelles j’ai reçu des demandes d’euthanasie de la part de familles de malades. En toute objectivité, la sédation terminale et les directives anticipées me semblent répondre à la totalité des situations auxquelles j’ai été confronté – même si je n’exclus pas de me trouver un jour dans des circonstances posant d’autres problèmes.
M. Jean-Pierre Barbier. Il est très difficile de s’exprimer en deux minutes sur un sujet aussi complexe. Vous excuserez donc la teneur d’un propos qui aurait pu être plus nuancé.
Je me suis, pour ma part, arrêté sur les trois mots, figurant à l’article 1er, de « suicide médicalement assisté ». Selon moi, le suicide relève d’une décision individuelle, qu’il soit assisté ou pas. Il est vécu comme un constat d’échec, tant par la société que par les familles concernées. Pourquoi en serait-il autrement lorsqu’il s’agit d’une personne en fin de vie ou requérant une assistance ? Le deuxième terme, « médicalement », me rappelle que le médecin est là pour soigner, guérir et soulager, et non pas pour donner la mort. Quant au troisième terme, « assisté », c’est le plus important. L’euthanasie est aussi pratiquée aux États-Unis, notamment dans l’état d’Oregon, mais le suicide n’y est pas assisté : la personne concernée doit se procurer elle-même le sédatif nécessaire. On s’est aperçu que, dans ces conditions, 50 % des personnes n’allaient pas jusqu’au bout de l’acte. L’assistance au suicide soulève donc la question du libre-arbitre – si la personne va jusqu’au bout, sera-ce par sa volonté ? Ces trois termes sont autant de raisons pour moi de voter contre ce texte.
La proposition de loi ouvre grand la porte au suicide médicalement assisté en cas de souffrance psychique. Et demain, qui d’autre encore pourra accéder à cette méthode ? Nous nous devons, dans nos sociétés, de respecter la vie. L’évolution d’une civilisation se mesure aussi à la façon dont elle aborde la question de la fin de vie.
M. Christophe Sirugue. Je ne vous cache pas ma perplexité. Tout en partageant avec Véronique Massonneau le sentiment que l’on n’ose pas aller jusqu’au bout du débat, j’ai aussi l’impression que l’on ne cesse de légiférer. Et si l’on enregistre des avancées, le droit à l’euthanasie ayant été reconnu, celles-ci me paraissent insuffisantes. Dans le même temps, sans doute convient-il de ne pas heurter ceux qui craignent les risques que peut comporter l’essor d’un tel droit.
Il ressort de nombreux travaux sur le sujet que les situations sont inégales sur bien des aspects : du point de vue territorial, selon que l’on a accès ou pas aux soins palliatifs ; du point de vue médical, selon que les équipes soignantes aient l’esprit ouvert ou pas ; du point de vue économique, selon que l’on dispose ou pas de moyens financiers suffisants pour se rendre à l’étranger. Nous ne pouvons pas continuer avec un système aussi inégalitaire.
Pour ma part, je suis favorable à la reconnaissance du droit au suicide médicalement assisté. Mais parce qu’un débat aura lieu cet après-midi, et parce que le texte proposé par Jean Leonetti et Alain Claeys vise au consensus, il me semble que nous devons utiliser le temps parlementaire dont nous disposons pour essayer de faire tendre ce texte vers la reconnaissance de ce droit. Bref, mes convictions m’interdisent de voter contre la proposition de loi de Véronique Massonneau, mais mon souhait de nous voir progresser de manière consensuelle me conduit à m’abstenir.
M. Gilles Lurton. Sur ce sujet si complexe, personne ne détient la vérité, et si j’ai une conviction, c’est qu’il faut rester humble. J’ai pu côtoyer plusieurs personnes en fin de vie, jeunes pour la plupart, et j’ai souvent été frappé par la formidable envie de vivre qui s’emparait d’elles à mesure que leur maladie s’aggravait. C’est pourquoi la notion de directive anticipée me laisse perplexe.
Madame la rapporteure, vous considérez la possibilité de mettre un terme à sa vie comme un droit. J’estime, pour ma part, que le corps médical doit avoir le droit de refuser de mettre un terme à la vie. Car c’est lui qui, in fine, aura la responsabilité de commettre l’acte ultime. Il ne faudrait pas qu’il devienne l’otage de son malade.
Si la reconnaissance d’un droit à la mort obtenue à l’aide d’une tierce personne me laisse perplexe, je suis en revanche convaincu que nous devons consacrer le droit de ne pas souffrir. Le principe de l’accès pour tous aux soins palliatifs a été établi en 1999. Ces soins sont aujourd’hui dispensés par des personnels très dévoués et compétents. Malheureusement, la présence de ces personnels, loin d’être généralisée, est cantonnée à des services particuliers, de sorte que lorsqu’une personne doit passer d’un service de soins hospitaliers à un service de soins palliatifs, elle est prise d’une grande inquiétude. C’est pourquoi je plaide pour que la formation aux soins palliatifs soit généralisée à tous les personnels hospitaliers, afin que ce type de soins puisse être dispensé dans tous les services.
Mme Bernadette Laclais. Nous sommes tous conscients de débattre d’un enjeu particulier aux dimensions complexes, souvent douloureuses, parfois confuses. Un enjeu qui commande de se départir de postures simplistes ou dogmatiques et qui impose d’écouter toutes les positions, même celles que l’on ne partage pas. Les différents groupes politiques l’ont d’ailleurs compris depuis longtemps, et je me souviens que les débats d’avril 2013 s’étaient déroulés dans un climat serein. Je suis donc persuadée que ceux d’aujourd’hui comme ceux de demain se dérouleront, eux aussi, dans cet état d’esprit, conformément aux attentes des Français.
Peu de sujets comportent deux aspects aussi distincts. D’un côté, il y a le droit de l’individu de garder la maîtrise de son destin et de voir ses souhaits respectés au mieux. À cet égard, je salue les avancées du rapport Claeys-Leonetti qui place le patient au cœur de la réflexion, prévoit l’amélioration des directives anticipées et la reconnaissance du droit pour le patient de refuser tout traitement, et affirme le rôle de la personne de confiance. De l’autre côté, il y a le devoir de la société de garantir la protection des plus vulnérables et de prévenir les excès. Or, en la matière, la frontière entre certitude et questionnement se révèle souvent fort fragile.
Il existe dans notre pays un insupportable décalage entre la législation et la réalité. Alors que les textes ont permis une avancée indiscutable, la réalité nous confronte parfois à des cas difficiles auxquels ceux-ci ne permettent pas de répondre. Qui plus est, ils sont méconnus, voire mal appliqués. Chacun sait qu’il nous faut franchir une nouvelle étape. La proposition de loi que vont nous présenter nos collègues Claeys et Leonetti s’inscrit dans cette logique. De surcroît, elle a le mérite de contenir plusieurs propositions qui font consensus – une règle qu’il faut observer pour ne pas diviser nos compatriotes sur ces sujets.
Je souhaite que le débat contribue à nous éclairer sur l’image que notre société véhicule de la mort, le plus souvent en la fuyant et en la cachant, afin que nous acceptions de la voir de façon plus apaisée, comme un aboutissement naturel. Alors nous serons en mesure de garantir à nos compatriotes qu’ils seront, dans ces instants, aidés, respectés dans leur choix d’adultes, accompagnés et aimés. Alors notre société sera en mesure de franchir un nouveau pas.
Je souhaite également que les débats à venir nous permettent d’aborder l’accompagnement en fin de vie en service de néonatalogie et la place des parents, mais aussi les soins palliatifs et la formation des médecins. C’est pourquoi j’inclinerai personnellement à ce que nous poursuivions notre réflexion en examinant la proposition de loi déposée par Alain Claeys et Jean Leonetti, ce qui m’amènera à voter contre le texte qui nous est présenté ce matin.
M. Bernard Accoyer. La loi dite Leonetti a constitué une avancée considérable ; malheureusement, les moyens manquent pour qu’elle soit suffisamment connue et correctement appliquée. Or il est toujours préoccupant de passer à autre chose quand l’étape précédente n’a pas été correctement accomplie.
Je salue le travail accompli une nouvelle fois par Jean Leonetti, de concert cette fois avec Alain Claeys. Le texte qu’ils ont préparé repose sur un fragile équilibre, les notions de « directive anticipée contraignante » et de « sédation prolongée jusqu’à la mort » méritant d’être respectées à la lettre. Je m’inquiète donc qu’aient été déposés des amendements à la proposition de loi que nous examinons aujourd’hui, qui pourraient être repris lorsque le texte Leonetti-Claeys sera inscrit à l’ordre du jour, quand bien même ceux-ci n’apporteraient que des modifications insignifiantes. Nos deux collègues ont accompli un travail d’orfèvre qu’il conviendra de respecter le plus soigneusement possible.
M. Gérard Bapt. Je m’associe aux propos de Martine Pinville, Michel Liebgott et Bernadette Laclais. Le texte qui nous est proposé pose un problème qui a déjà été réglé en Belgique mais qui, chez nous, ne doit l’être qu’une fois que notre société y aura été préparée – objectif qui n’est pas encore atteint.
Bien que n’étant pas encore inscrit à l’ordre du jour, le texte proposé par Alain Claeys et Jean Leonetti va venir en discussion et diffère de la proposition de loi de Véronique Massonneau. Même celui-là posera problème, car le dialogue entre le médecin et la personne de confiance est difficile lorsque le patient est en phase terminale.
Olivier Véran faisait tout à l’heure la distinction entre la sédation d’apaisement et la sédation terminale. Cette distinction est difficile à exprimer pour un médecin. La sédation d’apaisement vise à éliminer la douleur, notamment lorsque cette dernière est irrémissible. Ainsi, pour apaiser les douleurs osseuses d’un patient, il faut parfois le mettre sous morphine jusqu’à l’hallucination. Mais une fois que le pronostic vital du patient est définitivement engagé à brève échéance, il importe de s’assurer que celui-ci mourra dans la dignité. Or cette dignité n’est pas respectée lorsqu’il n’en finit pas de mourir, car le but de la sédation d’apaisement n’est pas d’aider à mourir. Voilà pourquoi ces problèmes seront toujours difficiles à régler. Néanmoins, la proposition de loi Claeys-Leonetti a le mérite de mettre le patient au centre du traitement de la fin de vie en milieu hospitalier. La volonté de la famille et de la personne de confiance doit s’imposer dans certaines circonstances, y compris lorsqu’il s’agit d’aider à abréger la vie, par respect de la dignité du mourant.
M. Jean-Patrick Gille. Je rejette l’expression de « droit à la mort ». Il ne faut pas s’engager dans une telle voie, à moins d’y aller de légiférer de façon franche. Aujourd’hui, ce droit appartient tout entier au médecin, et c’est ce qui n’est plus accepté par une partie de la population. Paradoxalement, cette dernière a le sentiment que la loi dite Leonetti a renforcé ce pouvoir des médecins. Pour reprendre une phrase célèbre, je serais tenté de dire que la question de la mort est trop sérieuse pour être laissée uniquement aux médecins.
Défendant le droit pour chacun de choisir sa fin de vie, je suis favorable à la reconnaissance d’une possibilité de suicide assisté. On nous dit que l’opposabilité des directives anticipées pourrait constituer un début de solution et qu’elle fait consensus. Je souhaiterais en avoir confirmation pour renoncer à aller plus loin en suivant la proposition de Véronique Massonneau, vers laquelle penchait mon choix.
Mme Annie Le Houérou. Notre débat doit déboucher sur une meilleure connaissance et une meilleure application du droit existant, mais aussi sur des évolutions législatives, conformément à l’engagement pris par le Président de la République. Ce sujet de société touche chacun d’entre nous individuellement, au plus profond de son être. Et chacun appréhende la fin de sa vie de manière personnelle.
L’article 1er de la proposition de loi préconise le suicide médicalement assisté en cas d’affection grave et incurable, physique ou psychique, inapaisable ou jugée insupportable. Or comment juger du caractère insupportable d’une souffrance liée aux maladies psychiques ? Le suicide médicalement assisté est une violence pour certains d’entre nous, qui ne sont pas prêts à accepter cet accompagnement au passage à l’acte. La mortalité par suicide est un fléau, tout particulièrement en Bretagne, où l’on enregistre dans certaines zones des taux parmi les plus élevés de France – 72 % pour les femmes, 58 % pour les hommes. Les causes de cet acte de désespoir sont liées à la solitude, notamment chez les personnes âgées, ainsi qu’au contexte économique et social de précarité. Alors que, face à cette surmortalité persistante, la région a fait de la lutte contre le suicide une priorité sanitaire, le texte de Véronique Massonneau a de quoi interroger.
En mettant le patient au cœur de la décision, la proposition de loi accomplit un progrès, car le sujet ne doit pas être laissé aux professionnels. Le rapport Claeys-Leonetti traite aussi de cette question. Le législateur doit tenir compte des conclusions des différents travaux afin d’aboutir à un consensus et de répondre aux attentes des Français. Le débat doit maintenant prendre sa place pour parvenir à une position satisfaisante dans la majorité des situations, afin de ne pas heurter une partie de la population.
Mme Martine Carrillon-Couvreur, présidente. Je vous remercie de la qualité de vos interventions. Chacun a pu montrer combien le sujet nous concernait tous, en fonction de nos chemins et expériences personnels. L’écoute dont nous avons fait preuve ce matin, comme à chaque fois que nous discutons de ces questions, est l’attitude à adopter pour pouvoir avancer dans le débat.
Mme la rapporteure. Un premier objectif au moins est atteint : nous avons débattu de ce sujet dans le calme et la sérénité. Je vous remercie donc, moi aussi, de la qualité de nos échanges. Je ne suis, certes, pas d’accord avec tout ce qui a été dit, mais je respecte les propos de chacun.
Martine Pinville nous a rappelé que la proposition de loi Claeys-Leonetti arriverait en discussion en mars prochain. Je souhaitais néanmoins que la proposition de loi que j’ai déposée il y a dix-huit mois soit débattue. Je précise, en outre, que le débat prévu cet après-midi dans l’hémicycle n’a été inscrit à l’ordre du jour qu’après que nous avons décidé de débattre de mon texte. La proposition de loi Claeys-Leonetti correspond en partie à celle que je défends. Je la voterai, à condition toutefois qu’elle reprenne bien les préconisations du rapport et que le débat parlementaire ne vienne pas la dénaturer. J’y serai vigilante. Il faut savoir que les directives anticipées et la sédation existent déjà. Simplement, nous nous contentons de préciser le contexte dans lequel il doit y être recouru.
Il me semble, monsieur Jean Leonetti, que toute loi évolue. En France, à une certaine époque, les médecins avaient peur d’être accusés de non-assistance à personne en danger. Au XXIe siècle, le paradigme a été complètement inversé de sorte qu’aujourd’hui, c’est justement quand le médecin s’acharne à soigner qu’il peut être inquiété. Chaque groupe, aussi bien le vôtre que le nôtre, peut donc demander que la loi soit modifiée pour répondre aux attentes de la société.
Vous avez évoqué entre 30 000 et 50 000 arrêts de survie. Seulement, ils ne sont pas toujours exécutés en accord avec le patient. Jusqu’ici, les directives anticipées n’étaient pas opposables aux médecins, et la sédation était proposée par le médecin et non pas choisie par le patient. La première partie de la loi qui porte votre nom est suffisamment claire s’agissant de l’accompagnement de la souffrance et du non-acharnement thérapeutique ; sa simplicité et sa précision la rendent applicable sans difficulté. Si j’ai parlé d’un consensus mou, c’est parce que les médecins, les patients et les personnes en bonne santé n’ont pas cru bon de recourir aux directives anticipées en raison de leur caractère consultatif, insuffisant à leurs yeux. Dès lors qu’on les rendra contraignantes, elles se diffuseront largement et seront respectées.
Vous êtes suffisamment informé pour savoir que la loi belge, votée en 2012, ne connaît en aucun cas une dérive mais bien une évolution. Ses termes sont à peu près identiques à ceux de la proposition de loi que je vous soumets. Évidemment, les deux ans d’expérience de l’euthanasie en Belgique ont naturellement conduit à faire évoluer la loi, tout comme votre loi va évoluer aujourd’hui, monsieur Jean Leonetti. Et mon texte, qui sera débattu jeudi prochain, n’aborde pour l’instant ni l’euthanasie des mineurs ni celle des malades mentaux.
M. Jean Leonetti. Vous le ferez dans dix ans !
Mme la rapporteure. S’agissant, Michel Liebgott, de l’affaire du détenu condamné pour viol, la Belgique a pris une décision qui me semble juste et qui ne met pas en cause sa loi sur l’euthanasie : il sera changé d’établissement afin d’être soigné. Les autorités n’ont pas répondu à sa demande d’euthanasie, de sorte que cette affaire n’a rien à voir avec le cadre législatif en vigueur.
Nous sommes tous d’accord quant à la nécessité de développer les soins palliatifs en France, sachant que 80 % des patients qui pourraient y prétendre ne peuvent y accéder. Ayant rencontré de nombreux médecins et personnels soignants travaillant dans ce secteur, j’ai pu constater que d’excellentes initiatives avaient été prises. Je songe notamment à ces services de soins palliatifs ambulatoires qui se rendent dans des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes – EHPAD – et des hôpitaux de proximité. Á l’évidence, il apparaît difficile, à court terme, de doter chaque hôpital d’une unité de soins palliatifs : cela nécessite des moyens et une volonté politique. Mais il est tout aussi évident que former tous les soignants aux soins palliatifs permettrait de mieux répondre aux besoins des personnes souffrantes et de celles qui désirent mourir.
Que l’on parle de « personnes vulnérables » me heurte quelque peu. Ce n’est pas parce que des personnes sont souffrantes et en fin de vie qu’elles sont vulnérables. Cessons de les infantiliser. Certaines d’entre elles restent conscientes jusqu’à la toute fin et savent très bien ce qu’elles veulent. Je rappelle d’ailleurs que les directives anticipées servent lorsque le patient est incapable de défendre son point de vue. Si elles ont leur importance, elles ne permettront pas de résoudre tous les problèmes.
Monsieur Michel Piron, je sais que les points de vue sont partagés au sein du groupe UDI. J’ai, en effet, eu le plaisir d’accueillir l’ancienne sénatrice Muguette Dini, qui avait, elle aussi, signé une proposition de loi co-signée par plusieurs partis, relative à l’aide active à mourir. Je comprends que l’on puisse être perplexe devant la complexité qui entoure le mal-mourir en France, mais il faut arrêter de distinguer l’euthanasie passive de l’euthanasie active : cette distinction n’existe pas ! L’euthanasie est, selon moi, toujours active. Il est regrettable que vous n’ayez assisté qu’aux auditions organisées par Alain Claeys et Jean Leonetti. La distinction à laquelle vous vous efforcez brouille les cartes : aucune voie n’est plus acceptable que l’autre. Aider, c’est toujours un geste actif ; seule la méthode diffère, et les médecins sont très conscients de ce qu’il se passe lorsqu’ils accomplissent un tel geste, y compris lors de la sédation. Pour avoir reçu des philosophes, des sociologues, des juristes, des médecins, des chefs de service de soins palliatifs, du personnel soignant et des patients – trente-quatre personnes au total –, je puis vous assurer que j’ai essayé de faire le tour de la question.
S’agissant du peu d’engouement pour les directives anticipées, il ne me semble pas qu’il signifie un déni de la mort. Si l’on n’y a pas eu recours jusqu’ici, c’est parce qu’elles n’ont pour l’instant qu’une portée consultative. Dès lors qu’elles deviendront contraignantes, elles auront davantage de succès, si je puis dire.
Si ce n’est qu’à la toute fin de ma présentation que j’ai évoqué les soins palliatifs, je les ai néanmoins fait figurer au premier article de ma proposition de loi, estimant qu’il est essentiel de les développer.
Je remercie Philip Cordery de partager mon point de vue. Comme lui, je connais la législation belge et ce que d’aucuns appellent ses dérives, quand ce ne sont pour moi que des évolutions. Pour avoir un autre éclairage, j’ai invité un juriste luxembourgeois à participer à mon colloque. C’est d’ailleurs grâce à cette approche de droit comparé que nous sommes parvenus à rédiger cette proposition de loi.
Jean-Patrick Gille a souligné avec raison que la première loi dite Leonetti a renforcé le pouvoir du médecin. Le nouveau texte qui nous sera soumis est d’un autre ordre.
Madame Annie Le Houerou, veillons, s’il vous plaît, à ne pas faire d’amalgame : le suicide, ce n’est pas du tout la même chose que le suicide médicalement assisté. Sachant que la France détient le taux le plus élevé de suicides des personnes âgées, un sur quatre étant lié à une pathologie, à un moment, il faut agir. Alors qu’une personne qui se suicide est généralement dans la solitude et le désespoir, le suicide assisté peut intervenir en présence de la famille. Le patient choisit d’y recourir parce qu’il n’y a pas d’issue médicale pour sa maladie.
J’ai été heurtée d’entendre Fernand Siré dire qu’un médecin ne tuait pas. L’euthanasie n’a rien à voir avec l’acte de tuer qui a pour synonymes les verbes « abattre », « assassiner », « occire », « exécuter ». Pour citer le dictionnaire, « ce verbe exprime la volonté d’ôter la vie à l’autre avec violence et sans son consentement, dans des circonstances où il n’y a pas d’entente tacite et complice entre celui qui tue et celui qui est tué ». Quoi de commun entre le verbe « tuer » et la démarche altruiste d’aide active à mourir qui répond à une demande ? N’oublions pas que ce terme avait malheureusement déjà été utilisé lors des débats législatifs sur l’interruption volontaire de grossesse. Attention, par conséquent, au vocabulaire que l’on emploie.
M. Jean Leonetti. Attention aux amalgames aussi !
Mme la rapporteure. Bernard Accoyer n’a parlé que de la proposition de loi de Jean Leonetti. Ses propos fort intéressants sont à rattacher à un autre cadre.
Concernant Bernadette Laclais, s’agissant de la distorsion entre les textes et la réalité, j’ai déjà répondu que tant qu’elles garderont une portée consultative, les directives anticipées ne serviront pas à grand-chose, le patient ayant l’impression que sa décision finale ne sera pas respectée.
Monsieur Christophe Sirugue, il ne faut certes pas heurter, mais il convient de respecter le choix de chacun. Vous dénoncez avec raison les inégalités devant les soins palliatifs, mais il y en a également devant la sédation que certains médecins répugnent à pratiquer. Cela ne peut plus continuer.
L’humilité, monsieur Gilles Lurton, je puis vous assurer qu’elle m’a toujours habitée, et que mon souci d’écouter chacun m’a d’ailleurs conduite à modifier ma proposition de loi avant de la déposer. Je considère, en effet, que les auditions doivent venir enrichir le point de vue que l’on adopte et l’éclairer différemment.
Nous sommes tous d’accord pour consacrer le droit de ne pas souffrir. Mais le personnel soignant a beau être dévoué, les moyens manquent, en particulier dans les EHPAD, ainsi qu’on peut le constater à la lecture du rapport de l’Observatoire de la fin de vie. On juge une société à la manière dont on y meurt, a dit Jean-Pierre Barbier ; je puis vous assurer que ce n’est pas brillant en France. C’est un problème auquel nous devrions nous attaquer en parallèle de celui que nous abordons aujourd’hui. Une aide-soignante m’a ainsi raconté qu’elle avait en charge dix-neuf personnes, ce qu’elle considérait comme de la maltraitance. Mettons donc nos moyens au service de nos plus âgés !
La clause de conscience figure dans ma proposition de loi, comme elle existe pour l’interruption volontaire de grossesse, car certains médecins ont des convictions qui les empêchent d’accéder à la demande du patient.
Je remercie Gérard Sebaoun d’avoir participé à toutes les auditions. J’espère qu’elles auront contribué à l’éclairer et, peut-être, à faire évoluer son point de vue.
Olivier Véran, a eu l’humilité de reconnaître qu’étant médecin, il avait sans doute un jugement différent de celui de de nos concitoyens, et que ce débat devait appartenir à la société tout entière.
Jean-Pierre Barbier considère que le suicide est une décision individuelle ; j’ai déjà répondu que, pour moi, les deux termes étaient totalement différents. Selon lui, dans l’Oregon, 50 % des candidats au suicide ne vont pas jusqu’au bout de la démarche parce qu’ils ne sont pas assistés. Même dans les pays qui ont légalisé cette pratique, 50 % des personnes qui ont mis en place des directives anticipées ne vont pas non plus jusqu’au bout. De toute façon, selon le côté où l’on se place, les chiffres donneront toujours lieu à des bagarres d’experts.
Monsieur Bernard Perrut, je ne peux pas laisser parler d’escalade en Belgique et aux Pays-Bas. En France aussi, il y a des dérives, parce qu’il n’y a pas de loi. Tout le monde s’accorde à dire que les 5 000 euthanasies pratiquées chaque année le sont en toute illégalité, et que les médecins et le personnel soignant se trouvent en insécurité juridique, car, parfois, les patients n’ont pas donné leur consentement. On parle de dérive quand on a peu d’arguments sur le fond. Et s’il y en a en Belgique et aux Pays-Bas, c’est parce que chaque loi peut faire l’objet de lectures différentes. Je crois savoir, monsieur Jean Leonetti, que vous avez reçu une lettre des médecins belges qui ne veulent plus vous entendre parler de dérive en Belgique. En réalité, vous faites de la désinformation !
M. Jean Leonetti. Vous ne pouvez pas dire cela ! Un rapport de l’Observatoire national de la fin de vie indique qu’il y a trois fois plus de dérives en Belgique qu’en France !
Mme la rapporteure. Comment peut-il y avoir des dérives en France, alors que la loi n’existe pas ?
Article 1er
(article L. 1110-9 du code de la santé publique)
Possibilité pour une personne malade de demander à bénéficier d’une euthanasie ou d’une aide au suicide.
Cet article renforce l’égalité de l’accès des personnes malades aux soins palliatifs sur le territoire en imposant la présence d’unités adaptées dans chaque département en fonction du nombre d’habitants, y compris outre-mer.
Il complète le code de la santé publique en permettant à une personne malade de demander à bénéficier d’une euthanasie ou d’une aide au suicide, sous certaines conditions.
A. DISPOSITIF EXISTANT
1. l’offre de soins palliatifs
L’article L. 1110-9 du code de la santé publique affirme le droit de toute personne malade à pouvoir accéder à des soins palliatifs et à un accompagnement.
Offre de soins palliatifs
Une circulaire de 2008 (34) organise les soins palliatifs en poursuivant deux objectifs, offrir une offre graduée et adaptée en fonction de la situation des patients et diffuser une démarche palliative au sein de l’hôpital et à domicile.
Les structures hospitalières
– les services hospitaliers non dédiés prennent en charge des situations ne présentant pas de difficulté clinique, sociale ou éthique ;
– les lits identifiés de soins palliatifs (LISP) sont chargés d’assurer une prise en charge de proximité dans des services de soins confrontés à des fins de vie mais dont ce n’est pas l’activité exclusive ;
– les unités de soins palliatifs (USP) sont des unités spécialisées qui ont une activité spécifique et exclusive en soins palliatifs. Elles assurent une triple mission de soins, de formation et de recherche.
S’agissant des missions de soins, elles prennent en charge de façon temporaire ou permanente toute personne atteinte de maladie grave et évolutive, mettant en jeu le pronostic vital, en phase avancée ou terminale lorsque la prise en charge nécessite l’intervention d’une équipe pluridisciplinaire ayant des compétences spécifiques ;
– l’équipe mobile de soins palliatifs (EMSP) est une équipe multidisciplinaire et pluri-professionnelle rattachée à un établissement de santé qui se déplace auprès du malade et du soignant à la demande des professionnels de l’établissement de santé. Elle est chargée de faciliter la mise en place de la démarche palliative et d’apporter un soutien technique et éthique aux équipes de soins et de diffuser les dispositions de la loi précitée du 22 février 2005.
Les structures médico-sociales
Il n’existe pas de dispositif spécifique mais les EMSP peuvent intervenir (35).
L’expérimentation de lieux de répit
Trois maisons d’accompagnement ont été créées en Ardèche, en Haute-Garonne et dans le Doubs afin d’accompagner les malades et leurs proches hors du contexte sanitaire ou médico-social pendant quelques semaines ou quelques jours.
Plusieurs plans ont été élaborés afin d’encourager le développement des soins palliatifs et d’adapter l’offre de soins. Le dernier plan qui s’étalait entre 2008 et 2012 a mis l’accent sur trois objectifs :
– la poursuite du développement de l’offre hospitalière et l’ouverture du dispositif palliatif aux structures non hospitalières, (établissements sociaux et médico-sociaux accueillant des personnes âgées, domicile) ;
– l’amélioration de la qualité de l’accompagnement ;
– la diffusion de la culture palliative au moyen d’une grande campagne de communication à destination des professionnels et surtout du grand public.
Malgré la mise en place de ces actions, 80 % des personnes malades n’auraient toujours pas accès aux soins palliatifs (36).
De plus, l’état des lieux dressé par le Comité national de suivi du développement des soins palliatifs et de l’accompagnement constate que, malgré des progrès, des inégalités territoriales subsistent. S’agissant des unités de soins palliatifs, la moyenne nationale du nombre de lits pour 100 000 habitants se situe à 2,09 mais ce taux d’équipement varie d’aucun lit en Guyane à 5,45 lits dans la région Nord-Pas de Calais. Quant au nombre de lits identifiés en soins palliatifs, ce taux varie de 0 à 18,6 selon les régions. Enfin, le nombre d’équipes mobiles pour 200 000 habitants oscille entre 2,17 en Basse Normandie et 0,54 en Limousin (37).
2. L’interdiction des actes d’euthanasie et de suicide assisté
L’euthanasie qualifiée comme l’acte d’un tiers destiné à mettre délibérément fin à la vie d’une personne à sa demande, afin de faire cesser une situation qu’elle juge insupportable et le suicide assisté défini comme le fait de fournir à une personne les moyens de mettre fin à ses jours sont prohibés.
L’article 221-1 du code pénal qualifie de meurtre le fait de donner volontairement la mort à autrui et si le suicide n’est pas réprimé pénalement, le fait de provoquer au suicide d’autrui est constitutif d’un délit selon l’article 223-13 du code pénal. Par ailleurs, la non-assistance à personne en danger ou l’omission de porter secours sont également poursuivies en vertu de l’article 223-6 du même code.
Bien qu’interdite, la pratique de l’euthanasie existe en France. Selon une enquête de l’INED de 2010 sur les décisions médicales de fin de vie, sur un échantillon de 4 723 décès 0,8 % de ces décès étaient liés à l’administration de médicaments pour mettre délibérément fin à la vie.
Quant au suicide, particulièrement important chez les personnes âgées, le rapport de l’Observatoire national du suicide note que chez les plus de 65 ans, un décès par suicide sur quatre s’accompagne du signalement de pathologies somatiques associées au décès et un cancer est indiqué dans 8 % des cas (38).
B. DISPOSITIF PROPOSÉ
1. Un meilleur accès aux soins palliatifs
L’article L. 1110-9 du code de la santé publique est complété afin de rendre effectif l’accès aux soins palliatifs par un meilleur maillage territorial.
Si chaque région dispose d’au moins une unité de soins palliatifs, certains départements n’en possèdent pas. Ainsi, la région Poitou-Charentes ne dispose que d’une unité au centre hospitalier universitaire de Poitiers. C’est pourquoi, afin de limiter les inégalités territoriales, le dispositif proposé se réfère au département et le nombre d’unités est conditionné au nombre d’habitants.
Par ailleurs, dans son avis n° 121 (39), le CCNE indique « qu’il est indispensable de réaliser rapidement des progrès importants s’agissant des soins de suite… ainsi que dans les établissements médico-sociaux. »
2. La possibilité pour une personne malade de demander à bénéficier d’une euthanasie ou d’une aide au suicide.
Face à la prévalence d’une culture médicale exclusivement curative, certaines personnes malades, souffrant d’affections graves et incurables, craignent d’être victimes d’un acharnement thérapeutique de la part des professionnels de santé. De plus, elles se sentent privées du choix de leur mort.
L’introduction de l’euthanasie et de l’aide au suicide dans le code de la santé publique permettra aux personnes malades de décider de leur fin de vie.
Le dispositif proposé s’inspire de la législation hollandaise qui a légalisé ces deux pratiques en les encadrant. Ainsi, aux Pays-Bas, elles sont soumises aux « critères de minutie » suivants :
– une demande volontaire et claire du patient ;
– des souffrances insupportables du patient et qui ne peuvent être apaisées ;
– une information du patient sur sa situation et sur ses perspectives ;
– l’inexistence d’une alternative raisonnable.
En Belgique ou seule l’euthanasie est légale, des conditions similaires sont exigées :
– être « capable et conscient » ;
– formuler sa demande de façon « volontaire, réfléchie et répétée et être libre de toute contrainte » ;
– se trouver « dans une situation médicale sans issue et [faire] état d’une souffrance physique ou psychique constante et insupportable qui ne peut être apaisée et qui résulte d’une affection accidentelle ou pathologique grave et incurable ».
Le dispositif proposé pose des conditions éthiques et juridiques encadrant la demande de la personne malade.
• Personnes concernées
Le droit de demander l’euthanasie ou de bénéficier de l’aide au suicide s’applique aux personnes majeures et capables. On entend par personne capable une personne qui est apte à exercer et à jouir de ses droits et obligations. Les personnes sous tutelle ne pourraient bénéficier de ce droit.
• Type de pathologie
Les personnes qui pourront prétendre à ce droit sont des personnes malades, atteintes d’une affection, sans condition d’origine (« quelle que soit la cause »).
Par ailleurs, cette affection doit remplir deux conditions, la gravité, et l’incurabilité et occasionner des souffrances tant physiques que psychiques que l’on ne peut apaiser ou jugées insupportables par la personne malade.
*
* *
La Commission est saisie de l’amendement AS7 de la Rapporteure.
Mme la Rapporteure. Je souhaite supprimer la notion de temps que sous-tendent les mots « phase avancée ou terminale » dans une situation insupportable pour le patient et sans amélioration possible du point de vue des médecins. La question n’est plus de savoir combien de temps le patient pourra tenir en vie – personne ne peut y répondre, y compris les médecins. Pour ces derniers, la notion de fin de vie et de phase terminale est très complexe. Souffrant d’une même pathologie, un malade peut vivre encore très longtemps, un autre mourir le lendemain. Parler d’impasse thérapeutique semble plus approprié.
M. Jean-Pierre Barbier. Supprimer la notion de temps, c’est ouvrir grand les portes à tous les abus possibles et imaginables. Le champ des impasses thérapeutiques est tellement vaste ! Est-ce à dire que la loi pourrait s’appliquer à un malade mental dont on sait qu’on ne le guérira pas ? Pour le coup, madame Véronique Massonneau, c’est l’étape suivante dès maintenant que vous nous proposez ; vous voulez aller plus vite encore qu’en Belgique. Votre texte va trop vite et trop loin.
Mme la Rapporteure. La condition d’impasse thérapeutique s’ajoute à toutes celles qui sont déjà précisées dans le texte : il faut être majeur, capable, atteint d’une affection grave et incurable infligeant une souffrance physique et psychique inapaisable que la personne juge insupportable. Arrêtez de simplifier ce que j’ai écrit ! Je défie quiconque de déterminer ce qu’est une phase terminale. Tout le monde a pu se tromper à un moment donné, et les médecins eux-mêmes qui ont été auditionnés ont cité des exemples qui confortent mon propos. Voilà pourquoi je souhaite modifier la rédaction de cet alinéa.
M. Christophe Cavard. Je trouve regrettable l’amalgame que vous faites, monsieur Jean-Pierre Barbier, entre l’amendement de Mme Véronique Massonneau et la question de la maladie mentale. Si vous pensez ce que vous dites, c’est grave ! Si vous voulez utiliser ce genre d’argument dangereux, mieux vaudrait vous renseigner auprès de psychiatres.
M. Jean-Pierre Barbier. C’est précisément parce que je considère que cet amendement est dangereux que j’invite nos collègues à ne pas le voter. Vous proposez que l’euthanasie ou le suicide médicalement assisté puissent s’appliquer à toutes les situations d’impasse thérapeutique. Mais les médecins rencontrent tous les jours ce type de situation, que ce soit dans le cadre de maladies mentales ou neurologiques. Alors, demain, tous ceux qui sont dans une situation d’impasse thérapeutique pourront avoir recours au suicide médicalement assisté ? Et on ne peut pas parler de dérive ? Pour moi, ouvrir la porte au suicide médicalement assisté, c’est aussi admettre qu’on est dans une situation d’échec. C’est dans ce sens qu’il faut entendre mes propos, qui ne visent en rien à stigmatiser une maladie, quelle qu’elle soit.
M. Jean-Louis Touraine. Je comprends tout à fait le sens de l’amendement de Mme Véronique Massonneau. Certaines personnes sont dans une situation d’impasse thérapeutique totale. Je prends l’exemple de certaines dégénérescences neurocérébrales, de certaines maladies génétiques de l’enfant ou, dans les années 1980, du sida, avec des sarcomes de Kaposi généralisés. Même si la maladie évolue, les personnes ne sont pas immédiatement dans les derniers jours de leur vie. Elles sont néanmoins dans une impasse totale, avec à la clé une agonie très longue et très douloureuse, et une souffrance psychique impossible à calmer. Dans ces cas, la discussion pour savoir si l’on donne une aide active à mourir doit porter, non sur les dernières heures de vie, mais sur le moment où l’agonie se prolonge d’une façon excessive. Sur ce point, je partage le sentiment de Mme Véronique Massonneau.
Par contre, le débat en séance publique n’ayant pas encore eu lieu et la proposition de loi sur la fin de vie de MM. Alain Claeys et Jean Leonetti n’ayant pas non plus été discutée, il nous paraît difficile de voter cette proposition de loi. Pour cet amendement, comme pour les autres, je ne vois pas comment les députés qui, comme moi, désirent avoir tous les éléments de réflexion, pourraient se prononcer. Nous serons donc amenés à ne pas apporter notre adhésion, même si nous comprenons fort bien les motifs de plusieurs des amendements.
La Commission rejette l’amendement.
Elle examine ensuite l’amendement AS1 de M. Jean-Louis Roumegas.
M. Christophe Cavard. Le débat a presque eu lieu puisque nous avons eu une discussion sur les mots et sur la façon dont ils peuvent être interprétés. Notre amendement propose de remplacer les mots « d’une euthanasie ou d’un suicide médicalement assisté », qui peuvent donner lieu à débat, par les mots « d’une aide active à mourir ». Cette rédaction semble plus positive et va dans le sens de la proposition de loi.
M. Jean-Pierre Barbier. Sur un tel sujet, il ne faut pas jouer sur les mots, d’autant qu’ils ne changent pas le sens du texte.
Pour en revenir à la notion d’impasse thérapeutique, c’est la situation dans laquelle se trouvaient les malades souffrant d’hépatite C il y a dix ans, et ils terminaient leur vie dans des conditions atroces. Aujourd’hui, l’hépatite C se soigne en deux mois. Les impasses thérapeutiques sont un phénomène temporaire, et il ne faut pas négliger les progrès de la science.
M. Dominique Tian. Certes, les mots ont leur importance, et quand bien même ils pourraient heurter, il faut appeler parler franchement et ne pas les banaliser. Qu’il s’agisse d’euthanasie ou de suicide assisté, l’acte reste grave, ce n’est pas une opération commerciale ou de marketing. Au contraire, il faut heurter les personnes atteintes de maladies graves concernées par le texte, car il s’agit de prendre une décision extrêmement lourde.
Mme la Rapporteure. Monsieur Jean-Pierre Barbier, vous avez toujours en tête que c’est le médecin qui va décider, mais l’impasse thérapeutique vient seulement après toutes les conditions dont j’ai parlé. Il faut appréhender l’article 1er dans son ensemble. Il est très restrictif de ne parler que du dernier mot.
Quant à l’exemple de l’hépatite C, cela n’a strictement rien à voir, sauf si le malade éprouve une souffrance physique ou psychique inapaisable, qu’il juge insupportable. Cessez de restreindre mes propos à l’impasse thérapeutique !
Dans la loi sur l’avortement, monsieur Dominique Tian, le fait d’inscrire les mots « interruption volontaire de grossesse » a permis à certaines personnes de mieux appréhender le texte. Il ne s’agit pas d’hypocrisie. Une fois que l’aide active à mourir sera entrée dans le langage courant, on parlera plus facilement de l’euthanasie et du suicide assisté. Personnellement, ces deux mots ne me posent aucun problème, mais tous ceux qui ont été auditionnés les ont trouvés brutaux et estimé qu’ils pouvaient provoquer une confusion – nous le voyons d’ailleurs ce matin.
J’émets un avis favorable sur cet amendement.
M. Jean-Patrick Gille. Sur le fond, je suis plutôt favorable à cet amendement et je partage le sentiment de Mme la Rapporteure et de M. Christophe Cavard. Or je ne suis pas sûr que tout le monde entende la même chose. Le débat que nous aurons cet après-midi en séance publique pourrait avoir l’avantage de clarifier les termes employés. S’agissant du suicide médicalement assisté, chacun comprend que c’est celui qui se suicide qui décide. En revanche, bien que vous donniez le même sens aux mots « aide active à mourir », le grand public ne le percevra pas ainsi.
La Commission rejette l’amendement.
Puis elle rejette l’article 1er.
Article 2
(article L. 1111-10 du code de la santé publique)
Conditions de mise en œuvre des actes d’euthanasie et d’aide au suicide
Cet article fixe les obligations du médecin et de la personne malade lorsque cette dernière demande à bénéficier d’une euthanasie ou d’une aide au suicide.
A. DISPOSITIF EXISTANT
Le principe du consentement libre et éclairé aux soins
L’article L. 1111-4 du code de la santé publique prévoit qu’aucun acte médical et traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne.
Ce consentement aux soins nécessite une information précise de la part des professionnels de santé qui figure dans le code de déontologie médicale : « Le médecin doit à la personne qu’il examine, qu’il soigne ou qu’il conseille, une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu’il lui propose. Tout au long de la maladie, il tient compte de la personnalité du patient dans ses explications et veille à leur compréhension » ; « Le consentement de la personne examinée ou soignée doit être à rechercher dans tous les cas ». (40)
B. DISPOSITIF PROPOSÉ
La mise en œuvre de l’euthanasie et de l’aide au suicide est encadrée et ménage une période de réflexion à la fois pour les médecins et la personne malade.
● Un processus de délibération collective pour les professionnels de santé
Le médecin est tenu, dans un délai maximal de 48 heures, de solliciter un autre avis d’un confrère de son choix. L’équipe soignante est consultée. L’objectif est de mettre en place une procédure qui permette de vérifier la volonté et la situation médicale de la personne malade.
Le CCNE insiste sur la nécessité d’une procédure collégiale, entendue comme une délibération collective qui devrait être interdisciplinaire et faire la place à des professionnels non médicaux (41).
Un délai de réflexion qui ne pourra excéder quatre jours est accordé aux médecins pour se prononcer.
Les médecins devront se livrer à plusieurs vérifications.
En premier lieu, ils devront s’assurer de la capacité de la personne malade et de sa volonté de recourir à une euthanasie ou à bénéficier d’un suicide assisté.
En deuxième lieu ils devront constater la réalité de la situation médicale de la personne malade et l’impasse thérapeutique qui en résulte.
● Le caractère libre, éclairé, réfléchi et explicite de la demande de la personne malade
La demande est qualifiée d’explicite. Selon la définition de l’Observatoire national de fin de vie, cela signifie qu’elle doit être formulée à plusieurs reprises, avec des termes clairs.
Le CCNE, quant à lui, se réfère à la capacité de compréhension de la personne, à sa capacité d’appréciation, à sa capacité de raisonnement, à sa capacité d’expression et au maintien de son choix et de sa volonté.
Pour pouvoir bénéficier d’une euthanasie ou d’une aide au suicide, la personne malade doit réitérer sa demande. Si elle le souhaite, la personne de confiance peut en témoigner.
● Un temps de réflexion pour la personne malade
Le patient malade bénéficiera d’un temps de réflexion et d’un droit de révocation. Le médecin sera tenu de respecter sa volonté, quelle qu’elle soit.
À compter de sa demande, les médecins disposent d’au moins quatre jours pour donner leur avis et ensuite, la personne malade devra encore attendre deux jours avant de pouvoir bénéficier de l’euthanasie demandée ou de l’aide au suicide, sauf circonstances exceptionnelles.
*
* *
La Commission rejette successivement les amendements rédactionnels AS6 de la Rapporteure, AS2 de M. Jean-Louis Roumegas et AS8 de la Rapporteure.
Puis elle rejette l’article 2.
Article 3
(article L. 1111-11 du code de la santé publique)
Amélioration du dispositif des directives anticipées
et de la personne de confiance
Cet article complète le dispositif des directives anticipées quant à leur contenu, leur opposabilité, leur durée de validité et leur accès et élargit les droits de la personne de confiance.
A. DISPOSITIF EXISTANT
1. Le dispositif des directives anticipées
L’article L. 1111-11 du code de la santé publique autorise la rédaction de directives anticipées afin de prendre en compte la volonté du patient et de permettre au médecin de connaître ses choix thérapeutiques relatifs à sa fin de vie lorsque le patient est inconscient.
Les conditions de forme sont définies par l’article R. 1111-17 du code de la santé publique : le document doit être écrit, daté et signé par son auteur dûment identifié ; lorsque l’auteur, conscient, est dans l’impossibilité d’écrire lui-même, il peut demander à deux témoins, dont la personne de confiance, d’attester que le document est l’expression de sa volonté libre et éclairée ; le dernier alinéa de cet article précise que « le médecin peut, à la demande du patient, faire figurer en annexe de ces directives (…) une attestation constatant qu’il est en état d’exprimer librement sa volonté et qu’il lui a délivré toutes informations appropriées ».
● Leur contenu
Le contenu de ces directives est laissé à l’appréciation de chacun, aucun modèle type n’a été élaboré ni par le ministère de la santé ni par le Conseil national de l’Ordre des médecins. Ainsi, elles peuvent indiquer les souhaits de la personne malade en matière de limitation ou d’arrêt de traitement.
● Leur opposabilité
Le contenu prévaut sur tout autre avis non médical et le médecin doit en tenir compte mais elles n’ont qu’une valeur de souhait. Ainsi le médecin reste libre d’apprécier les conditions dans lesquelles il convient d’en tenir compte tenu de l’évolution médicale et de la situation concrète du patient.
● Leur durée de validité
Les directives sont valides durant trois ans (42). La période de validité de trois ans est renouvelable par simple décision de confirmation signée par leur auteur sur le document. Toute modification intervenue dans le respect des conditions prévues à l’article R. 1111-17 du même code vaut confirmation et fait courir une nouvelle période de trois ans ; dès lors qu’elles ont été établies dans le délai de trois ans précédant l’état d’inconscience de la personne, ces directives demeurent valides quel que soit le moment où elles sont ultérieurement prises en compte.
● Leur accès
Les conditions de conservation sont prévues par l’article R. 1111-19 du code de la santé publique : elles doivent être « aisément accessibles pour le médecin », ce qui constitue plus un conseil pratique qu’une obligation ; en principe, elles doivent être conservées dans le dossier médical de la personne. Toutefois, leur auteur reste libre de les conserver chez lui ou de les remettre à sa personne de confiance, ou encore à un membre de sa famille ou un proche. Il est précisé que toute personne admise dans un établissement de santé ou dans un établissement médico-social peut signaler l’existence de directives anticipées.
Enfin l’article R. 1111-20 du même code précise l’étendue du devoir du médecin lorsque ce dernier envisage de prendre une décision de limitation ou d’arrêt de traitement. Il instaure une obligation pour celui-ci de s’enquérir de l’existence éventuelle de directives anticipées – lorsqu’elles ne sont pas déjà dans le dossier médical – auprès de la personne de confiance, de la famille ou des proches ou auprès du médecin traitant ou du médecin qui lui a adressé la personne malade.
2. Le dispositif de la personne de confiance
L’article L. 1111-6 du code de la santé publique permet à toute personne majeure capable de désigner une personne de confiance, par écrit, qui sera consultée au cas où elle serait hors d’état d’exprimer sa volonté.
● Le choix et le rôle de la personne de confiance
La personne de confiance peut être un parent, un proche ou le médecin traitant. Elle peut être révoquée à tout moment. La personne de confiance peut accompagner le patient et assister aux entretiens médicaux. Elle peut également conseiller le patient dans ses prises de décisions. Elle doit s’exprimer au nom du patient, et non en son nom.
Si le patient est hors d’état d’exprimer sa volonté, aucune intervention ne peut être réalisée sans que la personne de confiance n’ait été consultée, sauf urgence ou impossibilité de la contacter (43).
Elle est consultée sur les souhaits qu’aurait exprimés le patient, s’il n’a pas rédigé de directives anticipées. Son avis doit être pris en compte lors d’une décision de limitation ou d’arrêt de traitement. Son avis prévaut sur tous les avis non médicaux (44). La nature et les motifs de cette décision lui sont communiqués.
● Le secret médical
Le secret médical n’est pas levé vis-à-vis de la personne de confiance qui n’a pas accès au dossier médical. Toutefois, en cas de diagnostic grave, la personne de confiance peut recevoir les informations nécessaires pour soutenir la personne malade, sauf si celle-ci s’y est opposée.
La commission d’accès aux documents administratifs a décidé le 22 janvier 2004 que la personne de confiance désignée par un malade hospitalisé et en mesure d’exprimer sa volonté ne se substitue pas à ce malade dans l’exercice de son droit d’accès au dossier médical (45).
B. DISPOSITIF PROPOSÉ
1. Une amélioration du dispositif des directives anticipées
Plusieurs difficultés sont apparues :
– le dispositif est méconnu des personnes malades et des médecins. Selon une étude de l’INED citée ci-dessus, seulement 2,5 % des patients décédés avaient rédigé des directives anticipées. Dans ses recommandations adoptées le 8 février 2013, le Conseil national de l’Ordre des médecins a d’ailleurs relevé : « Les dispositions de la loi du 22 avril 2005 concernant les directives anticipées et la personne de confiance restent mal connues du public. Il convient qu’une campagne d’information soit faite. Les médecins doivent y participer. » ;
– l’accès à ces directives est compliqué pour le corps médical. Elles figurent dans le dossier médical de la personne mais il n’existe pas de registre national, à l’image de celui pour les dons d’organes, qui les collecte et les conserve. C’est pourquoi, le Conseil national de l’Ordre des médecins recommande que « les directives anticipées soient répertoriées dans un registre national ou sur un support accessible aux soignants membres de l’équipe de soins ».
La conférence de citoyens sur la fin de vie recommande la centralisation des directives dans un fichier informatique national, soumis à la réglementation de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) qui permettrait aux professionnels de santé de pouvoir y accéder.
Le CCNE a également suggéré de repenser les conditions du recueil de ces directives ;
– leur non-opposabilité au corps médical. Les directives anticipées n’ont aucune valeur contraignante, au motif de l’évolution de l’état d’esprit de la personne selon son âge et sa maladie.
L’avis n° 121 du CCNE précité recommande que ces directives aient une valeur obligatoire pour les professionnels de santé et que lorsque les instructions n’auraient pas été respectées, elles soient justifiées par écrit dans le dossier médical de l’intéressé.
Le dispositif proposé remédie à ces difficultés :
● Extension de l’objet de ces directives
Désormais pourront y figurer le droit à bénéficier d’une euthanasie. Il sera obligatoire que figure la personne de confiance chargée de représenter la personne malade.
● Durée de validité
Le renouvellement tous les trois ans des directives est une démarche contraignante et difficile à mettre en œuvre. C’est pourquoi, il est proposé de conférer aux directives une durée de validité illimitée, tout en restant modifiables et révocables à tout moment.
● Accès
Afin de faciliter l’accès aux directives par les professionnels de santé, notamment en cas d’hospitalisation en urgence, cet article fait figurer sur la carte vitale la mention de ces directives lorsqu’elles existent. Un décret prévoira leurs conditions de conservation qui pourra s’effectuer par le biais d’un enregistrement dans un fichier national, sur le modèle de celui existant pour les dons d’organe.
● Opposabilité
Ces directives sont rendues contraignantes pour les professionnels de santé.
2. L’accès de la personne de confiance au dossier médical
Par ailleurs, l’article L. 1111-12 du code de la santé publique est complété afin d’introduire le droit pour la personne de confiance de pouvoir accéder à des informations contenues dans le dossier médical afin qu’elle puisse donner son avis en toute connaissance de cause.
*
* *
La Commission est saisie de l’amendement AS9 de la Rapporteure.
Mme la Rapporteure. Contrairement aux souhaits, qui sont du registre de l’optionnel, du consultatif ou, au mieux, de l’expression d’une préférence, la connotation péremptoire de la volonté ne laisse pas place à l’ambiguïté possible d’un contournement par une éventuelle rhétorique essayant de la discréditer.
La Commission rejette l’amendement.
Elle examine ensuite l’amendement AS10 de la Rapporteure.
Mme la Rapporteure. Un nombre limité d’informations peut être enregistré sur la carte vitale. Il est impossible d’y inscrire l’intégralité des directives anticipées, qui peuvent être parfois très complexes. En revanche, on peut y indiquer le nom de la personne de confiance et l’existence de directives anticipées. C’est pourquoi le terme « mentionnés » est plus approprié que le terme « enregistrés ».
M. Dominique Tian. La carte vitale n’est pas faite pour cela. Nous avons souhaité, au groupe UMP, que la carte vitale devienne un peu plus intelligente, qu’un certain nombre d’informations y figure et qu’elle soit sécurisée. Selon un rapport, il y aurait 5 millions de cartes vitales en trop en France. Cela donne une idée de sa fiabilité ! Il n’y a jamais d’indications sur une carte vitale, qui peut s’échanger ou être volée. Le système n’est absolument pas sécurisé. J’estime donc qu’il ne faut pas inscrire cette mention sur la carte vitale.
Mme la Rapporteure. C’est votre point de vue, monsieur Tian. Cette proposition figure pourtant dans le texte de M. Alain Claeys et de M. Jean Leonetti. J’espère que les cartes vitales seront fiables. Comme on ne peut y inscrire qu’un certain nombre d’informations, il y aura un fichier pour recueillir les directives anticipées.
M. Jean Leonetti. Nous espérons que la carte vitale sera détentrice d’un certain nombre d’informations. Je pense, par exemple, au fichier des refus de dons d’organes. La carte vitale pourrait contenir, non pas les directives anticipées, mais une référence à leur existence, ce qui permettrait d’aller les consulter.
Mme la Rapporteure. C’est exactement le sens de mon amendement.
La Commission rejette l’amendement.
Elle en vient à l’amendement AS11 de la Rapporteure.
Mme la Rapporteure. La personne de confiance est, en réalité, la porte-parole de la personne qui ne peut plus s’exprimer elle-même. C’est elle qui va expliquer les directives anticipées mentionnées sur la carte vitale et enregistrées dans ce fameux fichier. Afin de préserver le secret médical, la personne de confiance ne devrait pas avoir accès à l’ensemble du dossier médical de la personne malade, mais seulement aux éléments lui permettant de respecter ses volontés. Certaines informations inscrites dans le dossier médical peuvent être confidentielles – un avortement, par exemple – et n’avoir aucun rôle à jouer dans la décision concernant la fin de vie. Cette solution a été proposée, lors des auditions, par le Conseil national de l’Ordre des médecins.
La Commission rejette l’amendement.
Puis elle rejette l’article 3.
Article 4
(article L. 1111-12 du code de la santé publique)
Possibilité pour une personne malade incapable d’exprimer sa volonté de bénéficier d’une euthanasie si cette demande figurait dans ses directives anticipées.
Cet article fixe les conditions dans lesquelles une personne incapable d’exprimer sa volonté peut bénéficier d’une euthanasie, à condition que cela résulte d’une volonté exprimée dans ses directives anticipées.
A. DISPOSITIF EXISTANT
Le dispositif existant repose sur le refus de toute obstination déraisonnable pour un malade hors d’état d’exprimer sa volonté
L’article L. 1111-13 du code de la santé publique autorise le médecin à interrompre ou limiter des traitements devenus inutiles ou disproportionnés par rapport à leurs bénéfices pour la personne malade ou qui aboutiraient à un maintien artificiel de la vie lorsque le patient est hors d’état d’exprimer sa volonté. Dans ce cas, la décision prise par les médecins doit être collégiale, les directives anticipées sont prises en compte, si elles existent, et l’avis de la personne de confiance est recherché.
« La décision de limitation ou d’arrêt de traitement est prise par le médecin en charge du patient, après concertation avec l’équipe de soins si elle existe et sur l’avis motivé d’au moins un médecin, appelé en qualité de consultant. Il ne doit exister aucun lien de nature hiérarchique entre le médecin en charge du patient et le consultant. L’avis motivé d’un deuxième consultant est demandé par ces médecins si l’un d’eux l’estime utile. La décision de limitation ou d’arrêt de traitement prend en compte les souhaits que le patient aurait antérieurement exprimés, en particulier dans des directives anticipées, s’il en a rédigé, l’avis de la personne de confiance qu’il aurait désignée ainsi que celui de la famille ou, à défaut, celui d’un de ses proches » (46).
B. DISPOSITIF PROPOSÉ
Le dispositif proposé prévoit la possibilité pour une personne malade de bénéficier d’une euthanasie à condition que cette volonté figure dans ses directives anticipées.
Le dispositif proposé autorise le médecin à pratiquer une euthanasie, même si la personne malade est hors d’état d’exprimer sa volonté, à condition que cela figure dans ses directives anticipées.
Le protocole est similaire à celui observé lors d’une demande directe de la personne malade. Il est encadré par une procédure collégiale qui fait appel à l’avis d’un confrère et à la personne de confiance.
Le médecin est tenu de respecter les volontés du patient si sa situation médicale correspond aux souhaits indiqués dans les directives anticipées et si la personne de confiance donne son accord.
*
* *
La Commission rejette les amendements de coordination AS12 de la Rapporteure et AS3de M. Jean-Louis Roumegas.
Puis elle rejette l’article 4.
Article 5
(article L. 1111-13 du code de la santé publique)
Procédures de contrôle des actes d’euthanasie et d’aide au suicide
Cet article fixe les conditions dans lesquelles les actes d’euthanasie et de suicide assisté sont enregistrés et contrôlés et permet aux médecins de se voir dégager de toute responsabilité pénale.
A. DISPOSITIF EXISTANT
1. La motivation et l’enregistrement des décisions de la limitation et de l’arrêt des traitements
Les décisions de limitation ou arrêt de traitements prises en vertu des articles L. 1111-4 et L. 1111-10 du code de la santé publique doivent être motivées et figurer dans le dossier médical du patient.
« La décision de limitation ou d’arrêt de traitement est motivée. Les avis recueillis, la nature et le sens des concertations qui ont eu lieu au sein de l’équipe de soins ainsi que les motifs de la décision sont inscrits dans le dossier du patient. » (47)
2. La responsabilité pénale
L’article 122-4 du code pénal dispose : « n’est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte prescrit ou autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires ».
B. DISPOSITIF PROPOSÉ
1. Un dispositif de contrôle des actes d’euthanasie et d’aide au suicide
Lorsqu’un médecin pratique une euthanasie ou apporte son concours à un suicide, il doit se soumettre à une procédure déclarative qui fera l’objet d’un contrôle.
● La rédaction d’un compte rendu
Tout praticien qui pratique une euthanasie ou apporte son concours à un suicide assisté doit rédiger un rapport dans un délai de huit jours ouvrables à compter du décès.
Dans ce rapport seront annexés les documents versés au dossier médical qui ont justifié la demande d’euthanasie ou de l’aide au suicide, dont les directives anticipées lorsqu’elles existent.
● Un contrôle a posteriori
Ce rapport est envoyé à la commission régionale dont dépend la personne décédée.
Déclinée au niveau régional, une commission présidée par le préfet est chargée de vérifier l’application de la loi en cas d’euthanasie ou d’aide au suicide. En cas de non-respect de la loi ou en cas de doute, la commission transmet le dossier à un organe chargé de trancher en dernier recours, dénommé Commission nationale de contrôle des pratiques en matière d’aide médicale à mourir, rattaché aux ministres chargés de la justice et de la santé. Elle peut également transmettre le dossier à l’autorité judiciaire compétente.
Les législations belges et hollandaises ont prévu des mécanismes de contrôle.
En Belgique, la loi du 28 mai 2002 relative à l’euthanasie organise un contrôle a posteriori systématique des euthanasies. Dans les quatre jours qui suivent l’acte d’euthanasie, le médecin doit remplir un document et le transmettre à la Commission fédérale de contrôle et d’évaluation.
Cette commission est composée de seize membres nommés pour quatre ans par décret à partir d’une liste présentée par la Chambre des représentants qui comprend :
– huit docteurs en médecine, dont au moins quatre professeurs ;
– quatre juristes (professeurs de droit ou avocats) ;
– quatre membres « issus des milieux chargés de la problématique des patients atteints d’une maladie incurable ».
Dans un délai de deux mois, le contrôle de la commission s’effectue d’abord notamment sur la base des données suivantes :
– « la nature de la souffrance qui était constante et insupportable ;
– les raisons pour lesquelles cette souffrance a été qualifiée d’inapaisable ;
– les éléments qui ont permis de s’assurer que la demande a été formulée de manière volontaire, réfléchie et répétée et sans pression extérieure ;
– si l’on pouvait estimer que le décès aurait lieu à brève échéance ;
– la procédure suivie par le médecin ;
– la manière dont l’euthanasie a été effectuée et les moyens utilisés ».
En cas de doute, la commission décide à la majorité simple de prendre connaissance des autres indications que le médecin a également l’obligation de lui transmettre. Il s’agit essentiellement des références de toutes les consultations qui ont eu lieu lors de la procédure.
Lorsque l’euthanasie n’a pas eu lieu dans les conditions prévues par la loi, la commission décide à la majorité des deux tiers de saisir le ministère public.
Aux Pays-Bas, la loi du 12 avril 2001 relative au contrôle de l’interruption de vie pratiquée sur demande et au contrôle de l’assistance au suicide prévoit que le médecin qui a pratiqué l’euthanasie ou l’aide au suicide adresse un rapport au médecin légiste de la commune de la personne décédée, qui communique ce rapport à la commission régionale de contrôle de l’euthanasie géographiquement compétente.
Au nombre de cinq, ces commissions sont composées d’un juriste, qui préside, d’un médecin et d’un spécialiste des questions éthiques.
Dans un délai de six semaines, elles vérifient le respect des critères de minutie par les médecins, et si les exigences légales n’ont pas été respectées, elles en informent le ministère public.
2. L’absence de mise en cause pénale des praticiens pour avoir pratiqué un acte d’euthanasie ou prêté une assistance médicale à un suicide
Il permet aux praticiens ayant pratiqué une euthanasie ou ayant prêté leur concours à un suicide assisté de ne pas voir leur responsabilité pénale engagée au motif de meurtre ou d’empoisonnement.
De plus, cet article assimile le décès résultant d’une euthanasie ou d’un suicide à une mort naturelle.
*
* *
La Commission rejette les amendements rédactionnels AS13 et AS14 de la Rapporteure, l’amendement AS4 de M. Jean-Louis Roumegas et les amendements rédactionnels AS15 et AS16 de la Rapporteure.
Elle rejette ensuite l’article 5.
Article 6
(article L. 1110-5 du code de la santé publique)
Clause de liberté de conscience du médecin
Cet article préserve la liberté de conscience du médecin.
A. DISPOSITIF EXISTANT
Le médecin dispose du droit de refuser la réalisation d’un acte médical, autorisé par la loi, mais qu’il estimerait contraire à ses propres convictions personnelles, professionnelles ou éthiques.
Le septième alinéa de l’article L.1110-3 du code de la santé publique reconnaît au médecin le droit de se récuser à certaines conditions. Le principe de non-discrimination « ne fait pas obstacle à un refus de soins fondé sur une exigence personnelle ou professionnelle essentielle et déterminante de la qualité, de la sécurité ou de l’efficacité des soins ».
Ce principe est confirmé dans le code de déontologie médicale à l’article R. 4127-47 du code de la santé publique : « Le médecin a le droit de refuser ses soins pour des raisons personnelles ou professionnelles. S’il se dégage de sa mission, il doit alors en avertir le patient et transmettre au médecin désigné par celui-ci les informations utiles à la poursuite des soins ».
Ce principe figure dans le cadre du refus de la stérilisation (48), de l’IVG (49) ou de la recherche sur embryon (50).
B. DISPOSITIF PROPOSÉ
Il est proposé de permettre au médecin de refuser de pratiquer une euthanasie ou de prêter assistance à un suicide en fournissant ou prescrivant un médicament létal. Il doit alors trouver un confrère acceptant de pratiquer une euthanasie ou de prêter assistance à un suicide et lui transmettre le dossier du patient dans un délai de deux jours.
*
* *
La Commission rejette l’amendement rédactionnel AS5 de M. Jean-Louis Roumegas.
Puis elle rejette l’article 6.
Cet article prévoit un gage en raison des charges financières qui pourraient résulter de la mise en œuvre de ces nouvelles dispositions.
*
* *
Enfin, la Commission rejette l’ensemble de la proposition de loi.
___
Dispositions en vigueur ___ |
Texte de la proposition de loi ___ |
Texte adopté par la Commission ___ |
Proposition de loi visant à assurer aux patients le respect de leur choix de fin de vie |
Proposition de loi visant à assurer aux patients le respect de leur choix de fin de vie | |
Code de la santé publique |
Article 1er |
Article 1er |
L’article L. 1110-9 du code de la santé publique est ainsi rédigé : |
Pas de texte adopté par la commission | |
« Art. L. 1110-9. – Toute person-ne malade dont l’état le requiert a le droit d’accéder à des soins palliatifs et à un accompagnement. |
« Art. L. 1110-9. – Toute person-ne malade dont l’état le requiert a un droit universel d’accéder à des soins palliatifs et à un accompagnement. Chaque département, région et collectivité d’outre-mer doit être pourvu d’unités de soins palliatifs en proportion du nombre de ses habitants. » |
|
« Toute personne majeure et capable, en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable, quelle qu’en soit la cause, infligeant une souffrance physique ou psychique inapaisable ou qu’elle juge insupportable, peut demander à bénéficier, dans les conditions strictes prévues au présent code, d’une euthanasie ou d’un suicide médicalement assisté. » |
||
Article 2 |
Article 2 | |
Après l’article L. 1111-10 du même code, il est inséré un article L. 1111-10-1 ainsi rédigé : |
||
« Art. L. 1111-10-1. – Lorsqu’une personne majeure et capable, en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable, quelle qu’en soit la cause, infligeant une souffrance physique ou psychique inapaisable ou qu’elle juge insupportable, demande à son médecin le bénéfice d’une euthanasie ou d’un suicide médicalement assisté, celui-ci doit s’assurer de la réalité de la situation médicale dans laquelle se trouve la personne concernée. |
||
« Après examen du patient, étude de son dossier et, s’il y a lieu, consultation de l’équipe soignante, le médecin doit faire appel, pour l’éclairer, dans un délai maximal de 48 heures, à un autre praticien de son choix. |
||
« Les médecins vérifient le caractère libre, éclairé, réfléchi et explicite de la demande présentée, lors d’un entretien au cours duquel ils informent l’intéressé des possibilités thérapeutiques, ainsi que des solutions alternatives en matière d’accompagnement définies notamment à l’article L. 1110-9 du présent code. |
||
« Les médecins peuvent, s’ils le jugent souhaitable, renouveler l’entretien dans les 48 heures. |
||
« Les médecins rendent leurs conclusions sur l’état de l’intéressé dans un délai de quatre jours au plus à compter de la demande initiale du patient. |
||
« Lorsque les médecins constatent la réalité de la situation médicale, l’impasse thérapeutique dans laquelle se trouve la personne ainsi que le caractère libre, éclairé, réfléchi et explicite de sa demande, l’intéressé doit, s’il persiste, confirmer sa volonté de bénéficier d’une euthanasie ou d’un suicide médicalement assisté, le cas échéant, en présence de la personne de confiance qu’il a désignée. |
||
« Le médecin est tenu de respecter cette volonté. |
||
« L’acte d’euthanasie, pratiqué à la demande du patient sous le contrôle d’un médecin et par ce médecin, ou, dans le cas d’un suicide médicalement assisté, pratiqué à la demande du patient sous le contrôle d’un médecin et par le patient, s’il est en capacité de le faire, en milieu hospitalier ou au domicile du patient, ne peut avoir lieu avant l’expiration d’un délai de deux jours à compter de la date de confirmation de la demande. Les conditions de mise en œuvre de ce bénéfice sont fixées par décret en Conseil d’État. |
||
« L’intéressé peut, à tout moment, et par tout moyen, révoquer sa demande. » |
||
Article 3 |
Article 3 | |
I. – L’article L. 1111-11 du même code est ainsi rédigé : |
||
« Art. L. 1111-11. – Toute personne majeure peut rédiger des directives anticipées pour le cas où elle serait un jour hors d’état d’exprimer sa volonté. Ces directives anticipées indiquent les souhaits de la personne relatifs à sa fin de vie concernant les conditions de la limitation ou l’arrêt de traitement. Elles sont révocables à tout moment. |
« Art. L. 1111-11. – Toute personne majeure et capable peut rédiger des directives anticipées pour le cas où elle serait un jour hors d’état d’exprimer sa volonté. Ces directives anticipées indiquent les souhaits de la personne relatifs à sa fin de vie et prévalent sur tout autre avis, y compris médical, dans les cas où elles s’appliquent. |
|
À condition qu’elles aient été établies moins de trois ans avant l’état d’inconscience de la personne, le médecin en tient compte pour toute décision d’investigation, d’intervention ou de traitement la concernant. |
« Les directives anticipées peuvent également mentionner une personne de confiance désignée par le patient, en application de l’article L. 1111-6 du présent code. |
|
Un décret en Conseil d’État définit les conditions de validité, de confidentialité et de conservation des directives anticipées. |
« Les directives anticipées sont modifiables et révocables à tout moment par l’intéressé. |
|
« Les directives anticipées demeurent valables sans conditions de durée. Le médecin est donc tenu de les respecter pour toute décision d’investigation, d’intervention ou de traitement la concernant. |
||
« Les directives anticipées ainsi que le nom de la personne de confiance sont enregistrés sur la carte vitale des assurés sociaux. » |
||
Un décret en Conseil d’État définit les conditions de rédaction, de validité, de confidentialité et de conservation des directives anticipées. |
||
« Art. L. 1111-12. – Lorsqu’une personne, en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable, quelle qu’en soit la cause et hors d’état d’exprimer sa volonté, a désigné une personne de confiance en application de l’article L. 1111-6, l’avis de cette dernière, sauf urgence ou impossibilité, prévaut sur tout autre avis non médical, à l’exclusion des directives anticipées, dans les décisions d’investigation, d’intervention ou de traitement prises par le médecin. |
II. – L’article L. 1111-12 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
|
« La personne de confiance a le même droit d’accès au médical que le titulaire. » |
||
Article 4 |
Article 4 | |
Après l’article L. 1111-12 du même code, est inséré l’article L. 1111-12-1 ainsi rédigé : |
||
« Art. L. 1111-12-1. – Lorsqu’une personne majeure, en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable, quelle qu’en soit la cause, infligeant une souffrance physique ou psychique inapaisable ou qu’elle juge insupportable, se trouve dans l’incapacité d’exprimer une demande libre et éclairée, peut bénéficier d’une euthanasie, à la condition que cette volonté résulte de ses directives établies dans les conditions mentionnées à l’article L. 1111-11. |
||
« Après examen du patient, étude de son dossier et, éventuellement, consultation de l’équipe médicale soignante, le médecin fait appel pour l’éclairer à un autre praticien de son choix. Le médecin établit dans un délai de quatre jours au plus à compter de leur saisine pour avis un rapport indiquant si la situation médicale de la personne concernée correspond aux conditions exprimées dans ses directives anticipées, auquel cas elles doivent impérativement être respectées. |
||
« Lorsque le rapport conclut à la possibilité d’une euthanasie ou d’un suicide médicalement assisté, la personne de confiance désignée dans les conditions prévues à l’article L. 1111-6 du présent code, si elle existe, doit confirmer la volonté du patient. Alors, le médecin est tenu de respecter cette volonté. L’acte d’euthanasie ne peut intervenir avant l’expiration d’un délai de deux jours à compter de la date de confirmation de la demande. » |
||
Article 5 |
Article 5 | |
La section 2 du chapitre Ier du livre Ier de la première partie du même code est complétée par trois articles L. 1111-14, L. 1111-14-1 et L. 1111-14-2 ainsi rédigés : |
||
« Art. L. 1111-14. – Dans un délai de huit jours ouvrables à compter du décès, le médecin qui a apporté son concours à l’euthanasie ou au suicide médicalement assisté adresse à la commission régionale de contrôle un rapport exposant les conditions du décès. À ce rapport sont annexés les documents qui ont été versés au dossier médical en application du présent article ainsi que les directives anticipées ; la commission contrôle la validité du protocole. Le cas échéant, elle transmet à l’autorité judiciaire compétente. |
||
« En cas de pronostic vital engagé à très brève échéance, le médecin peut, après en avoir informé la commission régionale qui se réserve la possibilité de dépêcher auprès de lui un médecin-conseiller, ramener l’ensemble du protocole à quatre jours. » |
||
« Art. L. 1111-14-1. – Il est institué auprès du Garde des Sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la santé, un organisme dénommé Commission nationale de contrôle des pratiques en matière d’aide médicale à mourir. |
||
« Il est institué dans chaque région une commission régionale présidée par le préfet de région ou son représentant. Elle est chargée de contrôler, chaque fois qu’elle est rendue destinataire d’un rapport d’aide médicale à mourir, si les exigences légales ont été respectées. Si ces exigences ont été respectées, l’article 221-3, le 3 de l’article 221-4 et l’article 221-5 du code pénal ne peuvent être appliquées aux auteurs d’une aide médicale à mourir. |
||
« Lorsqu’elle estime que ces exigences n’ont pas été respectées ou en cas de doute, elle transmet le dossier à la Commission susvisée qui, après examen, dispose de la faculté de le transmettre au Procureur de la République. |
||
« Les règles relatives à la composition ainsi qu’à l’organisation et au fonctionnement des commissions susvisées sont définies par décret en Conseil d’État. Les membres de ces commissions ne peuvent recevoir aucune rémunération due à leur appartenance à ces commissions. » |
||
« Art. L. 1111-14-2. – Est réputée décédée de mort naturelle la personne dont la mort résulte d’une euthanasie ou d’un suicide médicalement assisté mis en œuvre selon les conditions et procédures prescrites par le présent code. » |
||
Article 6 |
Article 6 | |
L’article L. 1110-5 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
||
« Le médecin n’est pas tenu d’apporter son concours à la mise en œuvre de l’euthanasie ou du suicide médicalement assisté ; dans le cas d’un refus de sa part, il doit, dans un délai de deux jours, s’être assuré de l’accord d’un autre praticien et lui avoir transmis le dossier. » |
||
Article 7 |
Article 7 | |
La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 402 bis, 438 et 520 A du code général des impôts. |
||
ANNEXE :
LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES PAR LA RAPPORTEURE
(par ordre chronologique)
Ø Association Ultime liberté – Mme Claude Hury, présidente, et M. François Galichet, vice-président
Ø Table ronde :
– Alliance Vita – Dr Xavier Mirabel, président d’honneur, et M. Henri de Soos, directeur des études et animateur du service d’aide et d’écoute SOS fin de vie
– Fédération des associations JALMALV (jusqu’à la mort, accompagner la vie) et associées – Mme Colette Peyrard, présidente, Mme Laurence Mitaine, vice-présidente, et Mme Jeanne Yvonne Falher, membre du conseil d’administration
Ø Société française d’accompagnement et de soins palliatifs (SFAP) – Dr Charles Joussellin, vice-président
Ø Table ronde :
– Syndicat national des professionnels infirmiers (SNPI) – Mme Marie-Hélène Feuillin, présidente, et M. Thierry Amouroux, secrétaire général
– Coordination nationale infirmière – Mme Nathalie Depoire, présidente, et Mme Sandrine Bouichou, secrétaire adjointe du bureau national
– Fédération nationale des infirmiers (FNI) – M. Philippe Tisserand, président
Ø Association pour le droit de mourir dans la dignité (ADMD) –M. Jean-Luc Roméro, président
Ø Ordre national des médecins – Dr Jean-Marie Faroudja, président de la section Éthique et déontologie
Ø Observatoire national de la fin de vie (ONFV) – Pr Régis Aubry, président
Ø Pr Didier Sicard, président d’honneur du Comité consultatif national d’éthique
Ø Dr Denis Labayle
Ø M. Philippe Bataille, sociologue, directeur d’études à l’EHESS
Ø M. Jean-Marc Lapiana, directeur de « La maison »
Ø Table ronde « Droit comparé » :
– M. Yves de Locht et Mme Christine Serneels, administratrice de l’ADMD Belgique
– Mme Jacqueline Herremans, avocate, Association Lallemand & Legros
Ø Comité consultatif national d’éthique (CCNE) – M. Jean-Claude Ameisen, président