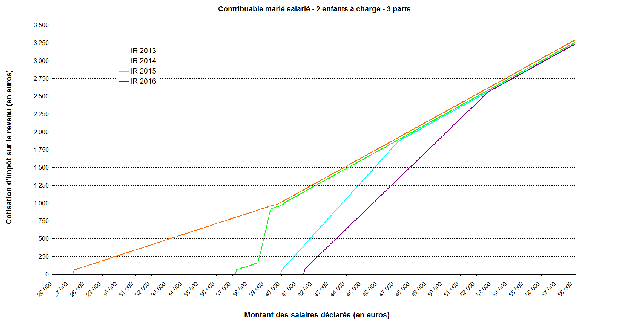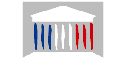
N° 3110
______
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 8 octobre 2015
RAPPORT
FAIT
AU NOM DE LA COMMISSION DES FINANCES, DE L’ÉCONOMIE GÉNÉRALE ET DU CONTRÔLE BUDGÉTAIRE SUR LE PROJET DE loi de finances pour 2016 (n° 3096)
TOME II
EXAMEN DE LA PREMIÈRE PARTIE CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER |
Volume 1 |
Examen des articles |
Par Mme Valérie RABAULT
Rapporteure générale,
Députée
——
SOMMAIRE
___
Pages
EXAMEN DES ARTICLES 7
Article liminaire : Prévision de solde structurel et de solde effectif de l’ensemble des administrations publiques de l’année 2016, de l’exécution 2014 et de la prévision d’exécution 2015 7
PREMIÈRE PARTIE CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER 15
TITRE IER – DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES 15
Article 1er : Autorisation de percevoir les impôts existants 15
B.– Mesures fiscales 21
Article 2 : Baisse de l’impôt sur le revenu des ménages aux revenus moyens et modestes et indexation du barème 21
Après l’article 2 68
Article additionnel après l’article 2 : Abaissement de la condition d’âge pour l’obtention par les anciens combattants d’une demi-part supplémentaire 75
Après l’article 2 76
Article additionnel après l’article 2 : Prorogation de la réduction d’impôt pour les dépenses de restauration d’un immeuble dans les quartiers visés par le programme national de requalification des quartiers anciens dégradés 85
Après l’article 2 86
Article additionnel après l’article 2 : Abrogation de la condition de mixité des programmes immobiliers pour bénéficier du dispositif d’investissement locatif 87
Après l’article 2 90
Article 3 : Abaissement du seuil de soumission à la TVA en France pour les ventes à distance 93
Après l’article 3 99
Article additionnel après l’article 3 : Conditions d’application du taux réduit de TVA aux opérations d’accession sociale à la propriété dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville 105
Article additionnel après l’article 3 : Conditions d’application du taux réduit de 10 % de TVA aux opérations de construction de logements intermédiaires 105
Après l’article 3 106
Article 4 : Limitation des effets de seuils dans les TPE et les PME 107
Article 5 : Augmentation du plafond de la provision déductible de l’impôt sur les sociétés des groupements d’employeurs en pourcentage de la masse salariale 132
Après l’article 5 142
Article additionnel après l’article 5 : Application du doublement des dépenses prises en compte dans le cadre du crédit d’impôt recherche pour les opérations confiées aux instituts technologiques agricoles et aux instituts technologiques agro-industriels 148
Après l’article 5 148
Article 6 : Prorogation du dispositif d’amortissement accéléré applicable au matériel de robotique industrielle 163
Article additionnel après l’article 6 : Abaissement du seuil de déductibilité des rémunérations différées 172
Après l’article 6 174
Article additionnel après l’article 6 : Relèvement du seuil de prise en compte des recettes accessoires dans la détermination du bénéfice agricole 177
Article additionnel après l’article 6 : Fixation à quatre de la limite de nombre d’associés dans un GAEC pris en compte en matière de plafond de recettes accessoires 178
Article additionnel après l’article 6 : Assouplissement du mécanisme d’étalement dans le temps des revenus exceptionnels 178
Après l’article 6 179
Article additionnel après l’article 6 : Application du plafond de crédit d’impôt pour congé à chaque associé d’un GAEC, dans la limite de quatre 181
Article additionnel après l’article 6 : Extension à quatre associés de l’application à un GAEC du crédit d’impôt en faveur de l’agriculture biologique 182
Après l’article 6 182
Article 7 : Exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties et de contribution foncière des entreprises pour les activités pionnières de méthanisation agricole 183
Après l’article 7 190
Article 8 : Suppression de taxes à faible rendement 191
Après l’article 8 205
Article additionnel après l’article 8 : Élargissement de l’assiette de la taxe générale sur les activités polluantes dite « sanction » au gazole routier 217
Article additionnel après l’article 8 : Extension de la taxe sur les transactions financières aux opérations intra-day 218
Après l’article 8 222
Article additionnel après l’article 8 : Exclusion des véhicules mis gratuitement à la disposition des collectivités territoriales de l’assiette sur la taxe sur les véhicules de société 224
Après l’article 8 225
Article 9 : Financement de l’augmentation de la capacité de soutien aux collectivités territoriales et aux établissements publics de santé ayant contracté des « emprunts toxiques » 226
Après l’article 9 246
Article additionnel après l’article 9 : Prolongation de l’exonération de plus-values immobilières pour les cessions en faveur du logement social 248
Après l’article 9 249
Article additionnel après l’article 9 : Conservation des avantages fiscaux « Madelin » et « ISF-PME » en cas de réinvestissement 252
Après l’article 9 253
Article additionnel après l’article 9 : Prolongation de l’abattement de plus-values immobilières en zone tendue 258
Article 10 : Fixation pour 2016 de la dotation globale de fonctionnement (DGF) et des allocations compensatrices d’exonérations d’impôts directs locaux (IDL) 259
Article 11 : Élargissement du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) aux dépenses d’entretien des bâtiments publics 289
Article 12 : Compensation des transferts de compétences aux régions et aux départements par attribution d’une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) et de la taxe spéciale sur les conventions d’assurance (TSCA) 300
Article 13 : Évaluation des prélèvements opérés sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales 310
B.– Impositions et autres ressources affectées à des tiers 316
Article 14 : Mesures relatives à l’ajustement des ressources affectées à des organismes chargés de mission de service public 316
Article 15 : Réforme de l’aide juridictionnelle 345
Après l’article 15 363
C.– Dispositions relatives aux budgets annexes et aux comptes spéciaux 364
Article 16 : Dispositions relatives aux affectations : reconduction des budgets annexes et comptes spéciaux existants 364
Article 17 : Décentralisation et affectation des recettes du stationnement payant 365
Article 18 : Modification du compte de commerce Approvisionnement de l’État et des forces armées en produits pétroliers, biens et services complémentaires 371
Article 19 : Clôture du compte d’affectation spéciale Gestion et valorisation des ressources tirées de l’utilisation du spectre hertzien, des systèmes et des infrastructures de télécommunications de l’État 375
Article 20 : Garantie des ressources de l’audiovisuel public 381
D.– Autres Dispositions 400
Article 21 : Relations financières entre l’État et la sécurité sociale 400
Article additionnel avant l’article 22 : Réduction des frais de recouvrement et de dégrèvement de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises 414
Avant l’article 22 415
Article additionnel avant l’article 22 : Suppression du plafonnement de la décote pour l’aliénation des terrains du ministère de la défense en faveur du logement social 416
Article additionnel avant l’article 22 : Extension de la possibilité d’aliéner un terrain de l’État en faveur du logement social avec une décote aux cas de réhabilitation 417
Avant l’article 22 417
Article 22 : Évaluation du prélèvement opéré sur les recettes de l’État au titre de la participation de la France au budget de l’Union européenne 418
TITRE II – DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES 421
Article 23 : Équilibre général du budget, trésorerie et plafond d’autorisation des emplois 421
Article liminaire
Prévision de solde structurel et de solde effectif de l’ensemble
des administrations publiques de l’année 2016, de l’exécution 2014
et de la prévision d’exécution 2015
Aux termes de l’article 7 de la loi organique n° 2012–1403 du 17 décembre 2012 relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques, l’article liminaire du projet de loi de finances présente « un tableau de synthèse retraçant, pour l’année sur laquelle elles portent, l’état des prévisions de solde structurel et de solde effectif de l’ensemble des administrations publiques, avec l’indication des calculs permettant d’établir le passage de l’un à l’autre ».
SOLDES DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES (en points de produit intérieur brut) | |||
Soldes |
Exécution 2014 |
Prévision d’exécution 2015 |
Prévision 2016 |
Solde structurel |
– 2,0 |
– 1,7 |
– 1,2 |
Solde conjoncturel |
– 1,9 |
– 2,0 |
– 1,9 |
Mesures exceptionnelles et temporaires |
– |
– 0,1 |
– 0,1 |
Solde effectif |
– 3,9 |
– 3,8 |
– 3,3 |
Source : projet de loi de finances pour 2016. | |||
Les objectifs de réduction du déficit fixés dans la loi de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019 et par le programme de stabilité sont les suivants :
TRAJECTOIRE DE SOLDE PUBLIC EFFECTIF (en points de produit intérieur brut) | |||||
Année |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
Loi de programmation des finances publiques 2014-2019 |
– 4,4 |
– 4,1 |
– 3,6 |
– 2,7 |
– 1,7 |
Programme de stabilité d’avril 2015 |
– 4,0 |
– 3,8 |
–3,3 |
– 2,7 |
– 1,9 |
Source : commission des finances. | |||||
La programmation pluriannuelle des finances publiques
Deux types de documents juridiques fixent un cadre pluriannuel pour les finances publiques et déterminent une trajectoire de réduction des déficits public et structurel.
En droit interne, les lois de programmation des finances publiques sont prévues par l’article 34 de la Constituions et « s’inscrivent dans l’objectif d’équilibre des comptes des administrations publiques ». À ce titre, elles déterminent les trajectoires des soldes structurels et effectifs annuels. Leur contenu est précisé par la loi organique n° 2012-1403 du 17 décembre 2012 relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques.
En droit européen, les programmes de stabilité ont été institués par le Pacte de stabilité et de croissance du 7 juillet 1997 comme outil de la surveillance multilatérale des politiques économiques. Ils sont transmis chaque année au mois d’avril à la Commission européenne.
Le déficit public poursuit sa décrue. Le point le plus bas de solde effectif a été atteint en 2009, année qui a suivi la crise financière de 2008, avec un déficit de 7,2 % du produit intérieur brut (PIB).
En 2011, le déficit public atteignait 5,1 % du PIB. En 2014, il a été ramené à 3,9 % du PIB. Ainsi, le déficit public a reculé de 1,2 point de PIB sur l’ensemble des exercices 2012, 2013 et 2014.
DÉFICIT PUBLIC CONSTATÉ DEPUIS 2008 | ||||||||
Année |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
|
Déficit public nominal (en points de produit intérieur brut) |
– 3,2 |
– 7,2 |
– 6,8 |
– 5,1 |
– 4,8 |
– 4,1 |
– 3,9 | |
Déficit public nominal (en milliards d’euros) |
63,5 |
138,9 |
135,8 |
105,0 |
100,4 |
86,4 |
84,1 | |
Source : INSEE. |
||||||||
L’article liminaire constate la poursuite de la réduction du déficit public avec un solde effectif qui sera ramené à – 3,3 % du PIB en 2016, après – 3,8 % en 2015. Le déficit public retrouvera en 2016 sensiblement son niveau d’avant crise (3,2 % du PIB en 2008).
Réduire le déficit public de – 3,8 % du PIB à – 3,3 % du PIB suppose de réduire le déficit de 10 milliards d’euros.
Deux conditions sont nécessaires pour y parvenir :
– le respect des engagements en matière d’effort budgétaire et d’économies. Pour 2016, la « tendance naturelle » de progression des dépenses publiques conduirait à une augmentation de la dépense publique d’environ 30 milliards d’euros. En parallèle, un effort de réduction budgétaire de 16 milliards d’euros est inscrit dans ce projet de loi de finances, ce qui permettrait de réduire la progression à 14 milliards d’euros.
– des rentrées fiscales qui suivraient la dynamique de la croissance économique (+ 1,5 % en volume) et de l’inflation (+ 1 %). Ceci conduirait à 23,9 milliards d’euros supplémentaires, d’après les estimations du ministère des finances.
Pour ce qui concerne la prévision de croissance économique, le Haut Conseil des finances publiques estime que qu’elle « devrait se réaliser » pour 2015 et qu’elle est « atteignable » pour 20016.
Pour ce qui concerne l’élasticité des recettes fiscales, le Haut Conseil a souligné que la prévision de progression des recettes au même rythme que l’activité n’était pas anormale en phase de reprise.
Enfin, la prévision d’inflation est de 0,1 % pour 2015, et d’1 % pour 2016. Le Haut Conseil a estimé que la prévision pour 2015 était « réaliste » mais que la hausse des prix pourrait être inférieure à l’hypothèse retenue pour 2016 en raison de certains facteurs désinflationnistes tels que « les effets retardés de la baisse du prix du pétrole et l’incidence des allégements d’impôts et de cotisation en faveur des entreprises ».
Au total, remplir les deux conditions permet d’envisager une réduction du déficit nominal à 3,3 % du PIB.
Pour assurer un pilotage plus fin des finances publiques dans un contexte de crise, la Commission européenne a adopté en 2005 la notion de « déficit structurel » (« l’effort structurel » correspondant à la réduction du déficit structurel), permettant de considérer le déficit nominal comme la somme de deux composantes : le déficit conjoncturel et le déficit structurel.
Le déficit conjoncturel est le déficit qui provient de la conjoncture, et en l’occurrence de la crise économique et financière qui a touché le continent européen depuis 2007.
Le déficit structurel est le déficit qu’afficherait notre pays si sa croissance était égale à celle qui serait obtenue en mobilisant à 100% tous les facteurs de production et toutes les possibilités de création économique dont dispose la France à l’instant t. Cette croissance est appelée « croissance potentielle ». Dès lors, le niveau de déficit structurel dépend du niveau de croissance potentielle : plus la croissance potentielle est élevée, plus le déficit structurel est faible.
Introduire la notion de déficit structurel permet de comprendre « où le pays se situe dans le cycle économique » : si le déficit public provient majoritairement de sa composante conjoncturelle, il devrait être résorbé une fois la conjoncture économique rétablie. Si au contraire, il provient essentiellement de sa composante structurelle, ceci signifie que la réduction du déficit ne pourra être obtenue que via des « réformes structurelles », c’est-à-dire celles qui permettent de mobiliser toutes les potentialités non utilisées du pays, afin de créer de la richesse qui permettra de résoudre le déficit.
Le volet préventif du pacte de stabilité et de croissance prévoit, depuis 2005 (1), un effort structurel de 0,5% du PIB par an, tant que l’État membre n’a pas atteint son objectif budgétaire de moyen terme, qui lui-même doit être fixé entre
– 0,5 % de PIB et l’excédent structurel selon les règles du traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l’Union économique et monétaire (TSCG).
La « croissance potentielle » étant par définition un indicateur non observable, la détermination de son niveau peut bien entendu donner lieu à débat.
Dans le projet de loi de finances pour 2016, le Gouvernement a retenu comme hypothèse de croissance potentielle celle qu’il avait adoptée à l’occasion de la transmission du programme de stabilité à la Commission européenne le 15 avril 2015. La croissance potentielle pour 2016 a, ainsi, été évaluée à 1,5 % au lieu de 1,3 % du PIB dans la loi de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019.
Ce niveau de croissance potentielle :
– est en ligne avec le vote de notre commission lors de sa séance du 18 juin 2014 via un amendement au projet de loi de finances rectificative pour 2014, vote confirmé par l’Assemblée nationale le 23 juin 2014 (toutefois, l’article liminaire a été rétabli dans sa version initiale par amendement du Gouvernement adopté en nouvelle lecture lors de la séance du 15 juillet 2014) ;
– est supérieur à celui retenu par la Commission européenne comme l’illustre le graphe ci-dessous (le graphe ci-dessous montre le niveau de croissance potentielle estimé pour la France par la Commission européenne, ainsi que les différentes réévaluations) ;
ÉVOLUTION DE LA CROISSANCE POTENTIELLE SELON LA COMMISSION EUROPÉENNE
(en % du PIB)
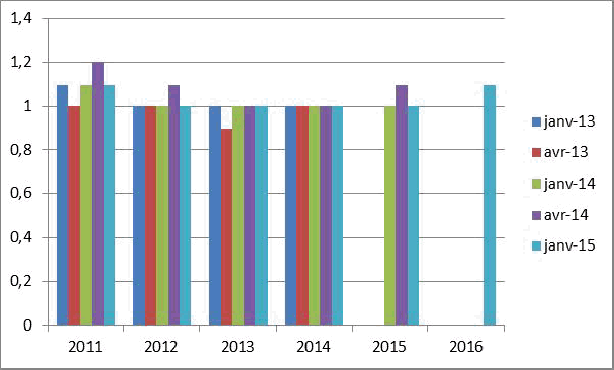
Source : Commission européenne : prévisions économiques d’hiver 2013, 2014 et 2015 ; prévisions économiques de printemps 2013 et 2014.
– ne fait pas l’objet d’un avis par le Haut Conseil des finances publiques, qui ne se prononce pas sur cet indicateur qui est par définition non observable. Toutefois, le Haut Conseil des finances publiques a émis des réserves sur cette révision de la croissance potentielle dans le programme de stabilité au motif qu’elle « ne permet pas de suivre convenablement l’évolution de la composante structurelle du déficit ».
Évaluer la pertinence du niveau de croissance potentielle retenu peut consister à analyser l’écart entre ce niveau et la croissance réalisée.
Selon le rapport annexé à la loi n° 2010-1645 du 28 décembre 2010 de programmation des finances publiques pour les années 2011 à 2014, la croissance effective a décroché de 5 points de PIB par rapport à la croissance potentielle au cours des années 2008 et 2009.
En 2010 et 2011, avec une progression en volume de 2 % et 2,1 %, la croissance effective a été supérieure à la croissance potentielle, évaluée par la même loi à 1,7 % sur la période. Depuis 2012, la croissance effective est inférieure à la croissance potentielle (0,2 % en 2012, 0,7 % en 2013, 0,2 % en 2014) alors que la croissance potentielle avait été évaluée entre 1,4 et 1,5 % sur la période par la loi n° 2012-1558 du 31 décembre 2012 de programmation des finances publiques pour les années 2012 à 2017.
La trajectoire de solde structurel est en avance sur les objectifs de la loi de programmation. Elle est aussi conforme pour 2014, et à 0,1 point de PIB près pour les années 2015 et 2016, à la trajectoire établie dans le programme de stabilité.
TRAJECTOIRE DE SOLDE STRUCTUREL (en points de produit intérieur brut) | |||
Fondement |
2014 |
2015 |
2016 |
Article liminaire du projet de loi de finances pour 2016 |
– 2,0 |
– 1,7 |
– 1,2 |
Loi de programmation des finances publiques du 29 décembre 2014 |
– 2,4 |
– 2,1 |
– 1,8 |
Programme de stabilité d’avril 2015 |
– 2,0 |
– 1,6 |
– 1,1 |
Source : données gouvernementales. | |||
Dans son avis le Haut Conseil aux finances publiques a formulé deux observations résumées dans le tableau ci-dessous :
OBSERVATIONS DU HAUT CONSEIL AUX FINANCES PUBLIQUES (en points de produit intérieur brut) | |
Niveau de déficit structurel |
2016 |
Déficit structurel défini dans l’article liminaire du projet de loi de finances pour 2016 |
– 1,2 |
Déficit structurel qui résulterait du niveau de croissance potentielle inscrit dans la dernière LPFP 2014-2019 |
– 1,3 |
Déficit structurel qui résulterait de l’absence de prise en compte des recettes de la vente des licences 4 G |
– 1,4 |
Le déficit structurel serait toutefois, même dans les deux dernières hypothèses, nettement inférieur à l’objectif de 1,8 % fixé dans la même loi de programmation des finances publiques.
*
* *
La commission est saisie, en discussion commune, des amendements I-CF 68 du président Gilles Carrez et I-CF 101 de M. Charles de Courson.
M. le président Gilles Carrez. Il s’agit d’ouvrir une discussion avec le Gouvernement sur les modalités d’évaluation de la croissance potentielle.
Si le Haut Conseil des finances publiques a indiqué, dans son récent avis, que le Gouvernement avait bien la possibilité de modifier de façon discrétionnaire les données concernant cette dernière, il s’est empressé de préciser que ce n’était pas du tout de bonne méthode. Mon amendement a donc pour objet de réviser l’article liminaire du présent projet de loi de finances en tenant compte des hypothèses de croissance potentielle figurant dans la dernière loi de programmation des finances publiques.
La manipulation de la notion de la croissance potentielle conduit à diminuer le « solde structurel » et à afficher, par conséquent, un « effort structurel » accru, atteignant opportunément le demi-point de PIB requis par le Traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance (TSCG).
M. Hervé Mariton. Madame la Rapporteure générale, depuis combien de temps nous situons-nous, dans le monde réel, en deçà de la croissance potentielle ?
M. Charles de Courson. On est en droit de se demander si, depuis le début de la crise, les traités européens, qui raisonnent en termes de déficits structurels, sont bien adaptés. Je n’ai de cesse de répéter depuis quatre ans que l’écart entre le solde effectif et le solde structurel, qui continue à se creuser, montre qu’un concept fondé sur l’idée d’un trend et d’un cycle économique de six ans est totalement inadapté à la situation économique actuelle. Par provocation, j’ai confondu les deux soldes dans mon amendement, en ramenant le solde conjoncturel à zéro.
Mme Valérie Rabault, Rapporteure générale. Avis défavorable à ces deux amendements. Je dois dire, monsieur le président, que je suis très surprise par le vôtre, car il revient sur la décision prise l’an dernier par notre commission, qui avait adopté un amendement de Karine Berger fixant le taux de croissance potentielle à 1,5 %.
Mme Marie-Christine Dalloz. Dites plutôt : une décision prise par la majorité de la commission !
Mme la Rapporteure générale. Monsieur Mariton, vous me demandez depuis quand nous nous situons en dessous du taux de croissance potentielle. Je n’ai pas de réponse à votre question. Nous pourrions, à la rigueur, rester toute notre vie en dessous – quoique cela puisse finir par poser problème si notre pays ne mobilise pas la totalité de ses potentialités.
Nous avions intégré des estimations révisées de croissance potentielle dans le programme de stabilité. La dernière note de l’INSEE évalue la croissance potentielle de la France entre 1,2 % et 1,9 %. Pour l’heure, l’hypothèse de 1,5 % retenue par le Gouvernement paraît donc réaliste. Le Haut Conseil des finances publiques, au-delà de ses interrogations sur le concept même de croissance potentielle, n’a d’ailleurs pas trouvé d’arguments flagrants à y opposer.
Enfin, sur les cycles économiques, je ne partage pas l’avis de Charles de Courson, comme j’ai déjà eu l’occasion de le lui dire l’an dernier.
Mme Karine Berger. Je ne me prononcerai pas sur la question de savoir si la croissance potentielle est de 1,3 % ou 1,5 % ; j’ai déjà donné mon avis à ce sujet l’année dernière. En revanche, j’invite tous nos collègues à se reporter au rapport économique, social et financier, fort heureusement mis en ligne avant minuit le premier mardi d’octobre, ce qui épargnera au présent projet de loi de finances des problèmes de constitutionnalité… Éric Woerth y trouvera une réponse à ses interrogations puisqu’il y est précisé, comme chaque année, où nous en sommes en matière de croissance effective et de croissance potentielle.
Le rapport souligne, en outre, que l’insuffisance de la croissance effective par rapport à la croissance potentielle date de trois ans. Fait préoccupant, les écarts négatifs observables depuis 2008 se prolongeraient jusqu’en 2019. Cela renvoie à la question de la définition même de la croissance potentielle, puisque jamais un cycle économique n’a duré plus de dix ans en France. C’est un vrai sujet d’inquiétude pour notre commission.
M. Hervé Mariton. Je reviens à ma question, à laquelle Mme la Rapporteure générale a commencé de répondre. Il serait intéressant de savoir, d’ici à la publication du rapport, depuis combien de temps nous nous situons en deçà de la croissance potentielle. Je crains que cela ne fasse fort longtemps et, si l’on retient les perspectives que vient d’évoquer Karine Berger, cela pose un problème de fond. Qu’est-ce, en effet, qu’une croissance potentielle que l’on n’atteindrait jamais ?
M. Olivier Carré. Le graphique de la page 13 du projet de loi de finances montre que l’évolution du solde structurel depuis 2000 épouse celle de la conjoncture, alors qu’elle devrait être beaucoup plus linéaire. À l’évidence, des problèmes de définition se posent. Au moment du creux de 2008-2009, marqué par des écarts croissants entre les recettes, qui s’effondraient, et les dépenses, qui se maintenaient pour assurer l’effet de rebond et faire jouer les stabilisateurs automatiques, on a vu apparaître dans le débat public, européen notamment, des raisonnements tautologiques, un bricolage conceptuel servant à justifier l’évolution rapide de nos endettements.
Reste que l’essentiel, monsieur le président, madame la Rapporteure générale, comme vous vous attachez à le rappeler, c’est le montant nominal que l’on est obligé d’aller chercher sur les marchés financiers pour financer nos dépenses publiques.
M. Charles de Courson. L’évolution soulignée par Karine Berger ne serait-elle pas liée au fait qu’une partie de notre potentiel de production n’est plus compétitif ? N’est-ce pas là une hypothèse à explorer, madame la Rapporteure générale ?
M. Éric Alauzet. C’est un sujet sur lequel j’interviens régulièrement. Il me semble en effet qu’un problème de doctrine se pose, et pas seulement à l’échelle de la France. Cela fait trente ans qu’on se rassure à bon compte en se disant que ça ira mieux demain, alors que le déficit conjoncturel devient, à mon sens, pour partie structurel.
La commission rejette successivement les amendements I-CF 68 et I-CF 101.
Elle adopte l’article liminaire sans modification.
PREMIÈRE PARTIE
CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER
TITRE IER
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
I.– Impôts et ressources autorisés
A.– Autorisation de perception des impôts et produits
Article 1er
Autorisation de percevoir les impôts existants
Le présent article autorise la perception des impôts, produits et revenus affectés à l’État et précise les modalités d’entrée en vigueur des dispositions fiscales de la loi de finances.
ÉVALUATION DES RECETTES DU BUDGET DE L’ÉTAT (en milliards d’euros) | |
Recettes nettes |
301,7 |
dont impôt sur le revenu |
72,3 |
dont impôt sur les sociétés |
32,9 |
dont taxe sur la valeur ajoutée |
144,7 |
dont taxe intérieure sur les produits de consommation sur les produits énergétiques |
15,6 |
dont autres recettes fiscales |
20,5 |
dont recettes non fiscales |
15,7 |
Source : projet de loi de finances pour 2016. |
|
Aux termes de l’article XIV de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, « tous les citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs Représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement (...) ». Découlant du principe ainsi posé en 1789, l’article 1er du projet de loi de finances renouvelle l’autorisation annuelle de percevoir les impôts, élément essentiel de la tradition démocratique en vertu de laquelle l’impôt n’est légitime que parce qu’il est librement consenti par la Nation. Il revient donc au Parlement d’exprimer ce consentement qui, par nature, doit être renouvelé régulièrement.
Compétence exclusive et obligatoire de la loi de finances de l’année, l’autorisation prévue par le I du présent article voit son champ précisé par le 1° du paragraphe I de l’article 34 de la loi organique n° 2011-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF), qui dispose que « la loi de finances de l’année autorise, pour l’année, la perception des ressources de l’État et des impositions de toute nature affectées à des personnes morales autres que l’État ».
L’autorisation n’est accordée que pour l’année, conformément au principe constitutionnel d’annualité repris à l’article 1er de la LOLF.
Elle vise non seulement les recettes fiscales mais également l’ensemble des autres ressources perçues en vue de financer le service public – revenus industriels et commerciaux, rémunération de services rendus, fonds de concours, remboursement de prêts et d’avances, produits de cessions…
Elle couvre les ressources perçues par l’État et celles affectées aux collectivités territoriales, aux établissements publics et aux organismes divers
– publics ou privés – habilités à les percevoir. D’application générale, le principe d’annualité de l’impôt vise à protéger, par cette autorisation, l’ensemble des contribuables, quel que soit l’organisme bénéficiaire de l’imposition.
Pour que le consentement soit libre, encore faut-il qu’il soit éclairé. Les ressources perçues par l’État – recettes fiscales, recettes non fiscales et fonds de concours – ainsi que les dépenses fiscales relatives aux impositions dont le produit est perçu par l’État sont détaillées respectivement dans le premier et le second tome de l’annexe au projet de loi de finances relative à l’évaluation des voies et moyens.
La liste des impositions affectées aux autres organismes publics et la présentation des prélèvements obligatoires par sous-secteurs d’administration publique sont fournies respectivement par le premier tome de cette annexe et par le rapport sur les prélèvements obligatoires, intégré dans le Rapport économique, social et financier depuis la modification de l’article 50 de la LOLF opéré par l’article 25 de la organique n° 2012-1403 du 17 décembre 2012 relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques.
II. LA DATE D’APPLICATION DES DISPOSITIONS FISCALES CONTENUES
DANS LE PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 2016
Le II du présent article prévoit, dans les termes usuels, les conditions d’entrée en vigueur des dispositions fiscales qui ne comportent pas de date d’application particulière.
La règle générale reste l’application des dispositions fiscales à compter du 1er janvier 2016.
Deux exceptions traditionnelles sont prévues : pour l’impôt sur le revenu, la loi de finances s’applique à l’impôt dû au titre de 2015 et des années suivantes ; l’impôt sur les sociétés est dû sur les résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2015 – une mention particulière est nécessaire, en raison à la fois des différences de date de clôture de l’exercice d’une entreprise à l’autre et du mode de recouvrement par acomptes et soldes de cet impôt direct.
À noter que s’agissant de l’impôt sur le revenu, les règles d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions sont appelées à évoluer en 2018 avec l’instauration du prélèvement à la source prévue par l’article 34 du présent projet de loi de finances. En effet, la retenue à la source mettra fin au décalage d’une année entre la perception de l’impôt et la perception du revenu. Il s’ensuit que les lois de finances qui s’appliqueront à compter des années 2018 et suivantes devraient prévoir qu’elles s’appliquent à l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année objet de la loi de finances, et non pas de l’année précédente.
III. LES DÉPENSES FISCALES SONT EN BAISSE MAIS DEMEURENT SUPÉRIEURES AUX OBJECTIFS DE LA LOI DE PROGRAMMATION DES FINANCES PUBLIQUES
Le tome II de l’annexe relative à l’évaluation des voies et moyens définit les dépenses fiscales comme « des dispositions législatives ou réglementaires dont la mise en œuvre entraîne pour l’État une perte de recettes et donc, pour les contribuables, un allégement de leur charge fiscale par rapport à ce qui serait résulté de l’application de la norme, c’est-à-dire des principes généraux du droit fiscal français ».
La notion de dépenses fiscales repose donc sur l’écart à la norme fiscale et englobe l’ensemble des réductions d’impôt (qui diminuent le montant de l’impôt dû) et des crédits d’impôt (qui entraînent, si le montant du crédit est supérieur à celui de l’impôt dû, une restitution en faveur du contribuable concerné).
Selon cette définition, 449 dépenses fiscales sont recensées pour 2016 au lieu de 453 en 2015.
L’article 19 de la loi n° 2014-1653 du 29 décembre 2014 de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019 prévoit que « le montant annuel des dépenses fiscales ne peut excéder 80,6 milliards d’euros en 2015, 81,8 milliards d’euros en 2016 et 86 milliards d’euros en 2017 » (2).
Ces montants intègrent le coût du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE). Cette intégration résulte d’un amendement adopté par l’Assemblée nationale à l’initiative de la Rapporteure générale. Ces montants constituent toutefois un simple objectif de pilotage et n’ont donc pas une valeur normative.
L’exposé des motifs de l’article 1er du présent projet de loi de finances fournit une évaluation de dépenses fiscales dans le but d’informer le Parlement sur le suivi de l’objectif fixé par la loi de programmation.
Aux termes de l’exposé des motifs, le coût des dépenses fiscales pour 2015 et 2016 est légèrement supérieur aux objectifs de la loi de programmation : 84,4 milliards au lieu de 80,6 milliards en 2015 (soit un écart de 3,8 milliards d’euros), et 83,4 milliards d’euros en 2016 au lieu de 81,8 milliards en loi de programmation (soit un écart de 1,6 milliard d’euros).
L’essentiel de l’écart entre les cibles pour 2015 et pour 2016 s’explique par une montée en charge plus rapide qu’anticipée du CICE.
Il apparaît en effet que le coût budgétaire du CICE sera supérieur de 2,5 milliards d’euros en 2015 et de 1,8 milliard d’euros en 2016 par rapport à la prévision budgétaire d’octobre 2014 telle qu’elle a été communiquée à la mission d’information de l’Assemblée nationale sur le CICE (3). Le rythme des imputations et des restitutions s’est accéléré en 2015 selon le dernier rapport France stratégie. Différentes raisons techniques peuvent l’expliquer (comme l’ordre d’imputations du crédit d’impôt sur la déclaration fiscale des entreprises). Le coût en comptabilité nationale, c’est-à-dire le coût du CICE incluant les créances en report, a été revu à la hausse hausse de seulement 0,7 milliard pour 2015 et de 0,5 milliard pour 2016, soit des montants nettement moindres que le coût budgétaire.
COÛT BUDGÉTAIRE DU CICE
(en milliards d’euros)
Coût/année |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
Coût évalué en octobre 2014 |
6,5 |
10 |
11,2 |
15,6 |
18,9 |
20,1 |
Coût évalué en septembre 2015 |
6,4 |
12,5 |
13,0 |
16,5 |
18,6 |
19,6 |
Source : ministère des finances.
Bien que supérieures aux objectifs fixés, les dépenses fiscales pour 2016 sont en baisse d’un milliard d’euros par rapport à 2015, en raison essentiellement de la suppression de la prime pour l’emploi (PPE).
PRINCIPALES ÉVOLUTIONS DU COÛT DES DÉPENSES FISCALES EN 2016
PAR RAPPORT À 2015
(en milliards d’euros)
Suppression de la prime pour l’emploi |
− 2,0 |
Crédit d’impôt au titre des intérêts d’emprunt |
− 0,4 |
Exonération de taxe d’habitation pour les personnes âgées |
− 0,3 |
CICE |
+ 0,5 |
Crédit d’impôt pour la transition énergétique |
+ 0,5 |
Crédit d’impôt recherche |
+ 0,2 |
Suramortissement de 40 % |
+ 0,2 |
Crédit d’impôt en faveur du logement intermédiaire |
+ 0,2 |
Source : projet de loi de finances pour 2016.
*
* *
La commission est saisie de l’amendement I-CF 102 de M. Charles de Courson.
M. Charles de Courson. J’aimerais rappeler à mes collègues du groupe socialiste, républicain et citoyen que le programme du Parti socialiste avait pour ambition d’« annuler 50 milliards d’euros » de dépenses liées aux niches fiscales qu’il jugeait « sans efficacité économique et injuste socialement » et que, dans son « programme de changement », le candidat Hollande, plus modéré, était revenu sur ce chiffre pour ne promettre qu’une réduction de 29 milliards d’euros. Or, le coût des dépenses fiscales devrait passer de 70,9 milliards d’euros en 2012 à 83,4 en 2016, soit près de 13 milliards d’euros d’augmentation !
Toutes les présentations de l’évolution des dépenses budgétaires font apparaître un freinage. Mais ne nous faisons pas d’illusions : nombre de dépenses budgétaires sont transformées en dépenses fiscales, dont la prise en compte ne fait pas du tout apparaître le même résultat. Il faudrait donc intégrer celles-ci dans les objectifs de réduction. Je précise que je ne critique pas cette majorité en particulier, l’ancienne majorité ayant fait la même chose…
J’aimerais connaître la position du Gouvernement en la matière, ainsi que celle de nos collègues socialistes. Pourquoi avoir totalement modifié vos orientations par rapport aux engagements pris devant le peuple français ?
M. le président Gilles Carrez. Je veux souligner la rigueur dont Mme la Rapporteure générale a fait preuve dans sa présentation : elle nous a soumis des tableaux retraçant l’évolution de la dépense publique hors crédit d’impôt et avec crédit d’impôt.
Mme la Rapporteure générale. Monsieur de Courson, j’ai bien compris votre souhait de réduire les dépenses fiscales, mais vous déposez beaucoup d’amendements visant à les augmenter – je vous ferai grâce de leur longue liste… Pour vous épargner cette contradiction, j’émets donc un avis défavorable à cet amendement.
M. le président Gilles Carrez. Si nous voulons avoir une vision claire de la dépense fiscale, il faut mettre à part le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE), qui en est une modalité particulière. Le problème, c’est que, même hors CICE, la dépense fiscale augmente depuis 2012 : de 70 milliards d’euros, elle est passée à 73 ou 74 milliards d’euros. Rappelons ici que les politiques liées à l’environnement ne sont fondées quasiment que sur des dépenses fiscales. Je vous renvoie au crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE).
Compte tenu de la porosité entre dépenses budgétaires et dépenses fiscales, la tentation est grande d’afficher de bons résultats en matière de dépenses budgétaires en procédant à un basculement sur les dépenses fiscales. Il appartient à notre commission de rappeler la nécessité de réduire ces dernières.
Avec Didier Migaud, nous avions engagé contre le gouvernement de l’époque une politique de plafonnement des niches fiscales, prises individuellement et globalement. Nous avons mis en place les instruments sous la précédente législature ; il faut les utiliser. Nous reviendrons sur ce débat la semaine prochaine.
M. Dominique Lefebvre. Je ferai observer que la suppression d’une dépense fiscale est synonyme d’augmentation du taux de prélèvements obligatoires, si rien n’est fait par ailleurs. Le plafonnement global des dépenses fiscales est la méthode à la fois la plus facile et la plus hypocrite : la vraie question est de savoir lesquelles supprimer. Or, depuis le début de ce quinquennat, à chaque fois que nous avons supprimé des dépenses fiscales, vous vous y êtes généralement opposés...
M. le président Gilles Carrez. Vous en avez supprimé si peu que nous n’en avons pas vraiment eu l’occasion !
M. Charles de Courson. J’ai déposé cet amendement, non pour qu’il soit adopté, mais pour montrer la schizophrénie de la classe politique française ! Pourquoi en est-on là ? Pourquoi fait-on, une fois au pouvoir, exactement l’inverse de ce qu’on a annoncé ?
M. Olivier Carré. Ce que vous avez souligné, monsieur le président, était vrai auparavant : il était plus aisé d’afficher un meilleur ratio en diminuant les recettes qu’en augmentant la dépense. Ce n’est plus vrai aujourd’hui, puisque dépenses fiscales et dépenses budgétaires sont considérées à l’identique dans le déficit au sens du traité de Maastricht.
La commission rejette l’amendement I-CF 102.
Elle adopte l’article 1ersans modification.
*
* *
Article 2
Baisse de l’impôt sur le revenu des ménages aux revenus moyens et modestes et indexation du barème
Le présent article poursuit et amplifie l’allégement de l’imposition des ménages aux revenus modestes et moyens qui a été engagé par le Gouvernement dès 2014, d’abord par le biais d’une réduction exceptionnelle d’impôt sur le revenu en première loi de finances rectificative (LFR) pour 2014, puis par la réforme du bas du barème intervenue en loi de finances (LFI) pour 2015.
Alors que des efforts substantiels ont été demandés à l’ensemble des foyers fiscaux français dès 2011 pour faire face à la situation dégradée des finances publiques, la réforme proposée vise à réduire la pression fiscale s’exerçant sur les ménages relevant des déciles médians de revenus, en allégeant le montant de l’imposition due et en rendant à nouveau non imposés des contribuables entrés dans l’impôt au cours des dernières années à revenus inchangés. De même que les deux mesures précédentes, la réforme ne se traduit par aucune hausse d’impôt pour les ménages qui n’en bénéficient pas du fait du niveau de leurs revenus.
Cette mesure s’inscrit dans le cadre du pacte de responsabilité et de solidarité. Elle représente une baisse d’imposition de 2,1 milliards d’euros, qui vient s’ajouter à celle de 3,2 milliards d’euros résultant de la réforme précitée du bas de barème réalisée à l’automne dernier (4). Au total, ce sont plus de 5 milliards d’euros de baisses d’imposition qui viennent soutenir le pouvoir d’achat des ménages aux revenus modestes et moyens depuis 2014, conformément aux engagements du Gouvernement dans le cadre du pacte.
Outre l’indexation du barème de l’impôt sur le revenu sur l’inflation, qui bénéficie à la totalité des contribuables, le présent article procède à une réforme de la décote, afin d’étendre son champ d’application et accroître ses effets. Cette refonte se traduit par un allégement plus important de l’imposition due en application de la décote, par un recul du point d’entrée dans l’impôt et par un adoucissement de la pente d’imposition.
Cette réforme doit concerner 8 millions de foyers fiscaux, pour un gain moyen estimé à 252 euros :
– sur ces 8 millions de foyers fiscaux, 5 millions ont déjà bénéficié de la baisse d’impôt sur le revenu à l’automne 2015 dans le cadre de la réforme du bas de barème, et 3 millions n’en ont pas bénéficié ;
– sur ces 8 millions de foyers fiscaux, environ 1,1 million doivent devenir non imposés du fait de la mesure, les 6,9 millions restants voyant leur impôt réduit.
Au total, en cumulant les deux réductions d’impôt, celle de la loi de finances pour 2015 et celle prévue par le présent article, ce sont plus de 12 millions de contribuables, soit un tiers des foyers fiscaux français, qui sont concernés par l’allégement de la pression fiscale engagé en 2014.
Enfin, cette mesure réduit le taux marginal d’imposition à l’entrée dans le barème progressif. Ainsi 100 euros de revenus supplémentaires seront désormais taxés à 24,5 euros, au lieu de 28 euros aujourd’hui.
La loi de finances pour 2015 (5) a procédé à une réforme approfondie des modalités de calcul de l’impôt sur le revenu, tout d’abord en supprimant la tranche à 5,5 % du barème, ensuite en réalisant une refonte du mécanisme de la décote, conduisant à accentuer fortement ses effets. Elle est venue pérenniser et amplifier les résultats de la réduction d’impôt (RI) exceptionnelle prévue par la première loi de finances rectificative pour 2014 (6), qui prévoyait, pour l’imposition des seuls revenus de 2013, un avantage forfaitaire de 350 euros pour un célibataire et de 700 euros pour un couple, pour les foyers fiscaux dont le revenu fiscal de référence (RFR) était inférieur à certains plafonds (7).
Sans revenir sur les mécanismes d’application du barème au revenu imposable des contribuables (8), il convient de rappeler que la réforme conduite à l’automne dernier a supprimé, selon la formulation généralement retenue, la première tranche du barème (9), au taux de 5,5 %, tout en abaissant la limite inférieure de la tranche suivante, au taux de 14 %. Le barème ainsi modifié ne compte plus que cinq tranches, aux taux de 0 %, 14 %, 30 %, 41 % et 45 % ; les limites des trois dernières tranches n’ont pas été modifiées – hors indexation sur l’inflation –, comme le retrace le tableau ci-dessous :
ÉVOLUTION DU BARÈME DE L’IMPÔT SUR LE REVENU ENTRE 2014 ET 2015
Barème applicable pour l’imposition des |
Barème applicable pour l’imposition des | ||
De 0 à 6 011 euros |
0 % |
− |
− |
De 6 011 à 11 991 euros |
5,5 % |
De 0 à 9 690 euros |
0 % |
De 11 991 à 26 631 euros |
14 % |
De 9 690 à 26 764 euros |
14 % |
De 26 631 à 71 397 euros |
30 % |
De 26 764 à 71 754 euros |
30 % |
De 71 397 à 151 200 euros |
41 % |
De 71 754 à 151 956 euros |
41 % |
Au-delà de 151 200 euros |
45 % |
Au-delà de 151 956 euros |
45 % |
Source : article 197 du code général des impôts.
L’abaissement du seuil d’entrée dans la tranche à 14 %, de 11 991 à 9 690 euros, a été calibré de manière à ce qu’il permette de neutraliser la baisse d’imposition occasionnée par la suppression de la tranche à 5,5 % pour les contribuables qui relevaient de la tranche à 14 % et des tranches suivantes (10) , tout en étant toujours plus favorable pour les contribuables relevant jusqu’alors de la tranche à 5,5 %. Il s’agissait de cibler les bénéficiaires de la réforme, en excluant de son bénéfice les foyers plus aisés, sans pour autant que ces derniers voient leur imposition s’alourdir et ne soient amenés à financer la suppression de la tranche à 5,5 %.
Cette réforme permet ainsi d’alléger ou de supprimer l’imposition des contribuables dont le revenu par part relevait de la tranche à 5,5 % – le gain retiré augmentant avec le nombre de parts au sein du foyer fiscal, et donc avec le nombre de personnes à charge en son sein. À cet égard, la suppression de la tranche à 5,5 % ne trouve pas à s’appliquer pour un célibataire, puisque, du fait de la décote (11) et du seuil de mise en recouvrement (12), le premier revenu déclaré imposable dans cette configuration (soit 13 725 euros pour l’imposition des revenus de 2013) relève d’emblée de la tranche à 14 %. L’allégement d’imposition joue de façon limitée pour des foyers fiscaux comportant une part et demie ou deux parts, pour s’amplifier ensuite au fur et à mesure que le nombre de parts augmente.
Parallèlement à la suppression de la tranche à 5,5 %, la loi de finances pour 2015 a procédé à un profond réaménagement du mécanisme de la décote, qui s’est traduit un fort accroissement de ses effets, à la fois en termes de recul du point d’entrée dans l’imposition et d’allégement de l’impôt dû.
● Défini au 4 du I de l’article 197 du code général des impôts (CGI), le mécanisme de la décote vient s’appliquer à la cotisation d’impôt issue de l’application du barème au revenu net global imposable du foyer fiscal, divisé par le nombre de parts de quotient familial, et après plafonnement de l’avantage retiré du quotient familial, le cas échéant (13).
La décote a été introduite par la loi de finances pour 1982 (14) au bénéfice des contribuables isolés disposant d’une part ou d’une part et demie de quotient familial. Elle se substituait à l’époque à un dispositif d’abattement visant à exonérer d’impôt les salariés rémunérés au SMIC disposant d’une part de quotient familial, au motif que cet abattement introduisait un ressaut d’imposition au franchissement du plafond. Plus avantageuse que l’abattement, la décote a d’abord vu son plafond de référence augmenter (15), avant d’être généralisée aux couples et aux familles par la loi de finances pour 1987 (16). Cette extension du champ d’application de la décote a porté le nombre de ses bénéficiaires de 2,8 millions à 7 millions.
Le mécanisme consistait, jusqu’à l’imposition des revenus de 2013, à réduire le montant de l’impôt résultant de l’application du barème de la différence entre 508 euros et la moitié de son montant. L’avantage issu de la décote est retenu dans la limite du montant de l’imposition et ne donne lieu à aucun remboursement au bénéfice du contribuable.
La décote vient décaler et lisser l’entrée dans le barème de l’impôt sur le revenu : son application peut conduire à rendre non imposables des contribuables qui le seraient sinon en application du barème, ou à retarder la progression de l’imposition en application du barème, de façon dégressive à mesure que l’imposition augmente.
En pratique, l’impôt dû après application de la décote était nul tant que le montant d’impôt dû avant décote était inférieur aux deux tiers de la valeur maximale de celle-ci soit, pour l’imposition des revenus de 2013, un montant d’impôt de 339 euros. En se combinant avec le seuil de mise en recouvrement, l’application de la décote aboutissait à un impôt effectivement acquitté égal à 0 tant que l’imposition due était inférieure à 379 euros.
Au fur et à mesure que l’impôt dû avant décote augmentait au-delà de 339 euros, le montant de la baisse d’imposition diminuait, pour devenir nul à partir d’un niveau d’imposition égal à deux fois la valeur de la décote, soit 1 016 euros (508 × 2).
Exemple : un célibataire a perçu en 2013 des revenus salariaux de 17 500 euros. En application du barème, et après déduction forfaitaire pour frais professionnels, il aurait dû s’acquitter en 2014 d’un impôt de 855 euros.
Au titre de la décote, son impôt est minoré de 81 euros, soit la différence entre 508 et 427 euros (soit 855/2). Il doit donc s’acquitter d’un impôt de 774 euros.
● Le montant de la décote est traditionnellement revalorisé chaque année à hauteur du taux de l’inflation, par l’article de la loi de finances indexant le barème de l’impôt sur le revenu. Il a toutefois été fait exception à cette règle pour l’imposition des revenus de l’année 2011, du fait du gel du barème.
En revanche, l’actuelle majorité a souhaité limiter, pour les contribuables aux revenus modestes, les effets du gel du barème pour l’imposition des revenus de 2012. Pour ce faire, la loi de finances pour 2013 (17) a procédé à une forte augmentation du montant de la décote : celui-ci est passé de 439 à 480 euros, soit une hausse de 9 %. Puis, la loi de finances pour 2014 (18) est venue à nouveau revaloriser la décote au-delà du taux de l’inflation, à hauteur de 5,8 %, pour la porter à 508 euros, afin de cibler les efforts en faveur du pouvoir d’achat sur les contribuables disposant de revenus limités.
Ces deux hausses successives, conjuguées au dégel du barème pour l’imposition des revenus de 2013, se sont traduites par une hausse du seuil de revenus en-deçà duquel un contribuable n’acquitte pas d’impôt sur le revenu, comme l’illustre le tableau ci-dessous (19) :
ÉVOLUTION DU CHAMP D’APPLICATION DE LA DÉCOTE
(en euros)
Nombre de parts |
IR 2012 |
IR 2013 |
IR 2014 (avant réduction exceptionnelle de la LFR 2014-1) |
Dernier revenu déclaré non imposable du fait de la décote fixée à 439 euros (RFR) |
Dernier revenu déclaré non imposable du fait de la décote fixée à 480 euros (RFR) |
Dernier revenu déclaré non imposable du fait de la décote fixée à 508 euros (RFR) | |
1 part |
13 275 (11 947) |
13 490 (12 141) |
13 725 |
1,5 part |
16 677 (15 009) |
17 222 (15 500) |
17 685 |
2 parts |
19 989 (17 990) |
20 534 (18 481) |
21 020 (18 918) |
2,5 parts |
23 302 (20 972) |
23 848 (21 463) |
24 353 (21 918) |
3 parts |
26 614 (23 953) |
27 160 (24 444) |
27 702 (24 932) |
4 parts |
33 249 (29 924) |
33 785 (30 406) |
34 380 (30 942) |
5 parts |
39 875 (35 888) |
40410 (36 369) |
41 060 (36 954) |
Source : direction générale des finances publiques (DGFiP).
Par ailleurs, du fait de ces revalorisations exceptionnelles, les contribuables dont l’imposition ne pouvait être annulée du fait de la décote ont bénéficié d’un allégement d’impôt plus important à l’entrée dans le barème progressif, et ce jusqu’à un point de sortie du dispositif plus élevé.
Outre la suppression de la tranche à 5,5 % du barème, l’article 2 de la loi de finances pour 2015 a procédé à une réforme de la décote, dont les effets ont été ainsi fortement amplifiés.
● En premier lieu, le mécanisme lui-même a été modifié, puisqu’il ne consiste plus à retrancher du montant d’impôt issu du barème une somme égale à la différence entre 508 euros et la moitié de ce montant d’impôt, mais à retrancher la différence entre 1 135 euros et la totalité de ce montant.
Il ne s’agit donc pas d’une nouvelle revalorisation de la décote, s’inscrivant dans la lignée des hausses réalisées en 2013 et 2014, mais d’un changement de mode de calcul – sachant que le principe reste identique, à savoir un allégement de l’imposition de moins en moins important au fil de l’augmentation de l’impôt dû.
De ce fait, l’impôt dû après décote est nul tant que le montant d’impôt dû avant décote est inférieur à la moitié de la valeur maximale de la décote – au lieu des deux tiers auparavant. Avec une décote portée à 1 135 euros, l’impôt acquitté est donc nul tant que l’imposition due est inférieure à 568 euros, soit 1 135 / 2 – et à 598 euros après prise en compte du seuil de mise en recouvrement, au lieu de respectivement 339 et 379 euros auparavant.
La nouvelle décote a donc pour premier effet de reculer fortement l’entrée dans l’impôt sur le revenu.
Ensuite, elle occasionne un allégement d’imposition nettement plus important. Le montant précité de 598 euros correspond à la réduction maximale pouvant être obtenue ; puis la baisse d’impôt s’amenuise au fur et à mesure que l’impôt dû avant décote croît, pour devenir nulle à partir d’un niveau d’imposition égal à 1 135 euros. Dans le dispositif précédent, la réduction maximale pouvant être obtenue se limitait à 379 euros, et décroissait progressivement pour s’annuler à partir d’un niveau d’imposition égal à 1 016 euros.
● En second lieu, la décote a été « conjugalisée », par la fixation d’un montant plus élevé pour les couples que pour les célibataires : l’impôt issu du barème est ainsi diminué de la différence entre 1 870 euros et l’impôt dû pour un couple, au lieu de 1 135 euros pour un célibataire.
De ce fait, l’imposition due après décote par un couple est nulle tant que le montant d’impôt issu du barème est inférieur à 965 euros, compte tenu du seuil de mise en recouvrement, contre 379 euros auparavant. La réduction d’imposition résultant de la décote diminue au fil de l’augmentation de l’impôt dû, pour s’annuler à partir d’un niveau d’imposition de 1 870 euros – contre 1 016 euros auparavant.
Le recul de l’entrée dans l’impôt sur le revenu de même que l’allégement d’impôt induits par le dispositif proposé sont donc encore plus significatifs que pour un célibataire.
La « conjugalisation » de la décote permet d’adapter le mécanisme selon la configuration du foyer fiscal, et de rapprocher le rapport entre « seuil d’imposabilité » pour les célibataires et pour les couples de montants de 1 à 2. Auparavant, le rapport des « seuils d’imposabilité » entre un célibataire et un couple était de l’ordre de 1 à 1,53 (20), alors qu’il est désormais de 1 à 1,88 (21).
● Le tableau ci-après permet de mesurer l’impact de la réforme en termes d’entrée dans l’impôt sur le revenu. Ainsi, entre 2013 et 2015, le niveau de revenus déclarés à partir duquel un contribuable célibataire devient imposable est passé de 13 490 à 15 508 euros. Cette hausse est beaucoup plus sensible pour un couple, avec ou sans enfant, ce qui résulte de la conjugalisation de la décote (22) : l’entrée dans l’impôt intervient à partir de revenus déclarés de 20 534 euros pour un couple sans enfant en 2013, contre 29 196 euros en 2015.
Les seuils d’entrée dans l’impôt s’avèrent systématiquement plus favorables au titre de l’imposition des revenus de 2014, par rapport à l’imposition des revenus de 2013, même en tenant compte de la réduction d’impôt exceptionnelle – cette dernière ayant visé les contribuables aux revenus modestes, proches des seuils d’imposition.
ÉVOLUTION DU CHAMP D’APPLICATION DE LA DÉCOTE
(en euros)
Nombre |
IR 2013 Dernier revenu déclaré non imposable du fait de la décote (RFR) |
IR 2014 - avant RI de la LFR 2014 Dernier revenu déclaré non imposable du fait de la décote (RFR) |
IR 2014 Dernier revenu déclaré non imposable (RFR) |
IR 2015 Dernier revenu déclaré non imposable du fait de la décote (RFR) |
1 part |
13 490 (12 141) |
13 725 (12 353) |
15 369 (13 832) |
15 508 (13 957) |
1,5 part |
17 222 (15 500) |
17 685 (15 916) |
19 496 (17 546) |
20 888 (18 799) |
2 parts |
20 534 (18 481) |
21 020 (18 918) |
28 135 (25 322) |
29 196 (26 276) |
2,5 parts |
23 848 (21 463) |
24 353 (21 918) |
33 492 (30 143) |
34 576 (31 118) |
3 parts |
27 160 (24 444) |
27 702 (24 932) |
37 117 (33 405) |
39 959 (35 963) |
4 parts |
33 785 (30 406) |
34 380 (30 942) |
43 795 (39 415) |
50 725 (45 652) |
5 parts |
40 410 (36 369) |
41 060 (36 954) |
50 475 (45 427) |
61 492 (55 343) |
Source : commission des finances.
La conjugalisation de la décote permet ainsi de réduire le nombre de couples mariés ou liés par un pacte civil de solidarité qui perdent au fait d’être imposés conjointement, dans le cadre du quotient conjugal. En effet, deux personnes dont les revenus respectifs se trouvent en-deçà du seuil d’imposition pour un célibataire, compte tenu de la décote, et qui ne seraient pas imposées à titre individuel, peuvent, lorsque ces mêmes revenus sont additionnés et pris en compte dans le cadre du quotient conjugal, être redevables de l’impôt sur le revenu, puisque le « seuil d’imposabilité » d’un couple est inférieur au double du « seuil d’imposabilité » d’un célibataire. D’un point de vue fiscal, ces deux personnes n’ont pas d’intérêt à être mariées ou à contracter un pacte civil de solidarité, et gagneraient à une imposition séparée de leurs revenus (23). Cet effet induit de la décote est fortement minoré par la réforme, en ce qu’elle a accru le rapport des « seuils d’imposabilité » entre les célibataires et les couples, désormais de 1 à 1,88.
Jusqu’à l’imposition des revenus de 2012, la décote concernait environ 12 millions de foyers fiscaux – ce nombre s’avérant relativement stable depuis 2010 –, pour un coût budgétaire de l’ordre de 2 milliards d’euros, soit un gain moyen oscillant autour de 170 euros.
Le gel du montant de la décote en 2012, pour l’imposition des revenus de 2011, s’est traduit par une nette diminution du nombre de bénéficiaires, passé de 12,3 à 11,75 millions, et de son coût, ramené de 2,11 à 1,99 milliard d’euros. Le rattrapage opéré par la loi de finances pour 2013 est venu compenser pour partie cette évolution, sans permettre de revenir au niveau de 2011 en termes de nombre de bénéficiaires.
ÉVOLUTION DU COÛT ET DU CHAMP D’APPLICATION DE LA DÉCOTE DEPUIS 2012
(effectifs en millions) |
IR 2012 |
IR 2013 |
IR 2014 (*) |
IR 2015 (prévisions) |
Coût budgétaire en recouvrement (en milliards d’euros) |
1,99 |
2,17 |
3,61 |
3,62 |
Nombre de foyers fiscaux bénéficiaires effectifs d’un allégement d’impôt |
11,752 |
12,135 |
12,683 |
10,413 |
Dont imposés devenant non imposés (gain moyen en euros) |
4,108 (207) |
4,391 (216) |
6,658 (348) |
4,523 (407) |
Dont imposés dont l’impôt décroît (gain moyen en euros) |
4,46 (134) |
5,157 (148) |
3,389 (183) |
4,328 (315) |
Dont restitués dont la restitution augmente (gain moyen en euros) |
3,184 (178) |
2,587 (190) |
2,636 (275) |
1,562 (300) |
Gain moyen pour l’ensemble des foyers fiscaux (en euros) |
172 |
181 |
289 |
353 |
(*) Y compris la réduction d’impôt exceptionnelle en faveur des ménages modestes.
Source : fascicule des Voies et moyens, tome II, annexé aux projets de loi de finances 2014 à 2016. Simulations budgétaires sur un échantillon représentatif de 500 000 déclarations d’impôt sur les revenus.
Les effets de la décote au titre de l’imposition des revenus de 2013 sont plus difficiles à appréhender, du fait de la réduction exceptionnelle d’impôt intervenue en 2014. En effet, cette réduction d’impôt et la décote recouvrent un champ quasi analogue et leurs effets sont étroitement imbriqués : en l’absence de décote, l’avantage en impôt procuré par celle-ci se trouverait octroyé par le biais de la réduction d’impôt. Il en résulte que le coût de la décote ne peut être dissocié de celui de la réduction exceptionnelle.
En unissant les effets de ces deux dispositions, il apparaît que le nombre de foyers fiscaux concernés en 2014 est en légère hausse, en s’élevant à 12,68 millions d’euros, tandis que le gain moyen est fortement accru : il s’élève à 289 euros, soit une hausse de 60 %. Au total, le coût budgétaire de la décote et de la réduction d’impôt exceptionnelle s’établit à 3,61 milliards d’euros.
Les premiers chiffres disponibles au titre de l’impôt sur le revenu de 2015, sur la base de la troisième émission de revenus de 2014, montrent que le coût budgétaire de la décote telle qu’issue de la réforme de la loi de finances pour 2015 devrait atteindre 3,62 milliards d’euros, soit le montant du coût cumulé de la décote et de la réduction d’impôt en 2014.
Le fort accroissement du coût de la décote entre 2013 et 2015 traduit le renforcement de ses effets : le gain moyen pour les foyers fiscaux s’établit à 353 euros, soit le double du gain constaté en 2013 et en 2012. En revanche, le nombre de foyers fiscaux bénéficiaires se trouve en retrait par rapport aux années précédentes, en étant ramené à 10,4 millions. Cette évolution, qui peut apparaître contre-intuitive au premier abord, résulte de la suppression de la tranche à 5,5 % du barème, qui annule l’imposition d’un certain nombre de foyers fiscaux avant même l’intervention de la décote.
Ces 10,41 millions de foyers fiscaux bénéficiaires se répartissent comme suit :
– 4,52 millions de foyers fiscaux deviennent non imposés sous l’effet de la décote, pour un gain moyen de 407 euros ;
– 4,33 millions de foyers fiscaux imposés voient leur impôt décroître, pour un gain moyen de 315 euros ;
– 1,56 million de foyers fiscaux bénéficient d’une restitution majorée, pour un gain de 300 euros.
● La répartition des bénéficiaires de la décote par décile de RFR connaît une nette évolution entre 2013 et 2015, comme l’illustrent les tableaux suivants :
VENTILATION DES BÉNÉFICIAIRES DE LA DÉCOTE PAR DÉCILE DE REVENU FISCAL
DE RÉFÉRENCE (RFR), POUR L’IMPOSITION DES REVENUS DE 2012
Borne inférieure (en euros) |
Borne supérieure |
Déciles des foyers fiscaux bénéficiant de la décote (en nombre de foyers) |
Montant de gain moyen retiré par les foyers fiscaux (en millions d’euros) |
0 |
10 353 |
1 212 570 |
158 |
10 353 |
11 803 |
1 212 570 |
227 |
11 803 |
13 294 |
1 212 570 |
247 |
13 294 |
14 381 |
1 212 570 |
198 |
14 381 |
15 454 |
1 212 570 |
159 |
15 454 |
16 578 |
1 212 570 |
125 |
16 578 |
18 760 |
1 212 570 |
190 |
18 760 |
22 009 |
1 212 570 |
197 |
22 009 |
26 795 |
1 212 570 |
162 |
26 795 |
− |
1 212 570 |
125 |
Total |
12 125 700 |
181 | |
Source : direction de la législation fiscale.
VENTILATION DES BÉNÉFICIAIRES DE LA DÉCOTE PAR DÉCILE DE REVENU FISCAL
DE RÉFÉRENCE (RFR), POUR L’IMPOSITION DES REVENUS DE 2013
Borne inférieure de RFR (en euros) |
Borne supérieure de RFR (en euros) |
Déciles des foyers fiscaux bénéficiant de la décote (*) (en nombre de foyers) |
Gain moyen en émission retiré par les foyers fiscaux (en euros) |
0 |
10 184 |
1 268 337 |
160 |
10 184 |
11 695 |
1 268 337 |
245 |
11 695 |
13 220 |
1 268 337 |
337 |
13 220 |
14 446 |
1 268 337 |
339 |
14 446 |
15 552 |
1 268 337 |
167 |
15 552 |
16 690 |
1 268 337 |
133 |
16 690 |
19 264 |
1 268 337 |
237 |
19 264 |
23 088 |
1 268 337 |
287 |
23 088 |
27 454 |
1 268 337 |
505 |
27 454 |
– |
1 268 337 |
480 |
Total |
12 683 370 |
289 | |
(*) y compris incidence de la RI exceptionnelle.
Source : logiciel Orison. Échantillon de 500 000 déclarations d’impôt sur les revenus de 2013.
VENTILATION DES BÉNÉFICIAIRES DE LA DÉCOTE PAR DÉCILE DE REVENU FISCAL
DE RÉFÉRENCE (RFR), POUR L’IMPOSITION DES REVENUS DE 2014
Borne inférieure (en euros) |
Borne supérieure (en euros) |
Déciles des foyers fiscaux bénéficiant de la décote (en nombre de foyers) |
Gain moyen en émission retiré par les foyers fiscaux (en euros) |
0 |
11 622 |
1 041 325 |
152 |
11 622 |
13 091 |
1 041 325 |
364 |
13 091 |
14 566 |
1 041 325 |
502 |
14 566 |
15 859 |
1 041 325 |
325 |
15 859 |
16 953 |
1 041 325 |
217 |
16 953 |
19 994 |
1 041 325 |
239 |
19 994 |
24 797 |
1 041 325 |
318 |
24 797 |
29 085 |
1 041 325 |
570 |
29 085 |
33 209 |
1 041 325 |
402 |
33 209 |
– |
1 041 325 |
441 |
Total |
10 413 250 |
353 | |
Source : logiciel Orison. Échantillon des revenus de 2013 et, majoritairement, 2014.
Les foyers fiscaux bénéficiaires se répartissent sur des niveaux de revenus plus larges, ce qui résulte du recul du point de sortie de la décote : en 2013, 1,21 million de foyers fiscaux bénéficiant de la décote avaient un RFR supérieur à 26 795 euros. En 2015, 2,08 millions de foyers fiscaux bénéficiaires disposent d’un RFR supérieur à 29 085 euros. Ces tableaux permettent de constater également la hausse des gains moyens retirés de la décote entre 2013 et 2015, pour chacun des déciles de RFR.
Traditionnellement, la loi de finances de l’année vient revaloriser les seuils des différentes tranches du barème à hauteur du taux d’inflation des prix hors tabac. Cette indexation du barème s’est appliquée sans interruption depuis 1969. Auparavant, des périodes parfois relativement longues se sont écoulées sans que le barème ne soit indexé. À partir de 1969, l’indexation s’est appliquée de façon continue, mais différenciée selon les tranches du barème. Les quatre premières tranches étaient ainsi revalorisées au-delà du niveau de l’inflation afin d’abaisser plus fortement la pression fiscale pesant sur les contribuables aux revenus modestes et, inversement, les cinq dernières tranches étaient revalorisées en deçà du niveau de l’inflation afin de limiter la correction du niveau d’imposition au regard de l’inflation annuelle.
Ce n’est qu’à compter de 1981 que le principe d’une indexation indifférenciée à l’ensemble des tranches s’est imposé. Depuis cette date, il a constitué une mesure consensuelle de modération de la pression fiscale prise chaque année en loi de finances initiale.
Néanmoins, la dernière loi de finances rectificative pour 2011 (24) a procédé au gel des différents seuils du barème pour l’imposition des revenus de 2011 et de 2012 ; il s’agissait d’accroître les recettes fiscales, compte tenu de l’état dégradé des finances publiques – la mesure de gel se traduisant par des recettes supplémentaires d’impôt sur le revenu de l’ordre de 1,6 milliard d’euros en 2012. La loi de finances pour 2013 n’est pas revenue sur le gel ainsi réalisé pour l’imposition des revenus de 2012, du fait du contexte budgétaire difficile.
En revanche, la loi de finances pour 2014 (25) a renoué avec la pratique traditionnelle d’indexation, et a revalorisé de 0,8 % les seuils du barème applicables à l’imposition des revenus de 2013. La loi de finances pour 2015 (26) a fait de même, en procédant à une revalorisation de 0,5 % de ces seuils applicables au titre des revenus de 2014.
II. LA VOLONTÉ D’ALLÉGER L’IMPOSITION DES MÉNAGES AUX REVENUS MODESTES ET MOYENS APRÈS LES EFFORTS CONSENTIS DEPUIS 2011
Si la part de foyers imposés par rapport à l’ensemble des foyers fiscaux français a varié autour d’un étiage de l’ordre de 50 % au cours de la dernière décennie, elle a néanmoins connu une augmentation continue depuis 2009 – année pour laquelle la proportion de foyers imposés a atteint un point bas de 43,4 %, notamment en raison d’une réduction d’impôt exceptionnelle applicable à l’imposition des revenus de 2008.
ÉVOLUTION DE LA PROPORTION DES FOYERS FISCAUX IMPOSÉS
PARMI L’ENSEMBLE DES FOYERS FISCAUX
(en millions)
Année d’imposition |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
Nombre de foyers fiscaux |
35,08 |
35,46 |
36,04 |
36,39 |
36,6 |
36,96 |
36,39 |
36,72 |
37,11 |
Nombre de foyers imposés |
16,92 |
16,31 |
16,92 |
15,78 |
16,82 |
17,21 |
18,15 |
19,20 |
17,77 |
Nombre de foyers non imposés |
18,16 |
19,15 |
19,11 |
20,61 |
19,78 |
19,75 |
18,24 |
17,52 |
19,34 |
Proportion de foyers imposés |
48,2 % |
46 % |
46,9 % |
43,4 % |
46 % |
46,6 % |
49,9 % |
52,3 % |
47,9 % |
Source : direction de la législation fiscale.
ÉVOLUTION DE LA PART DES FOYERS FISCAUX IMPOSÉS
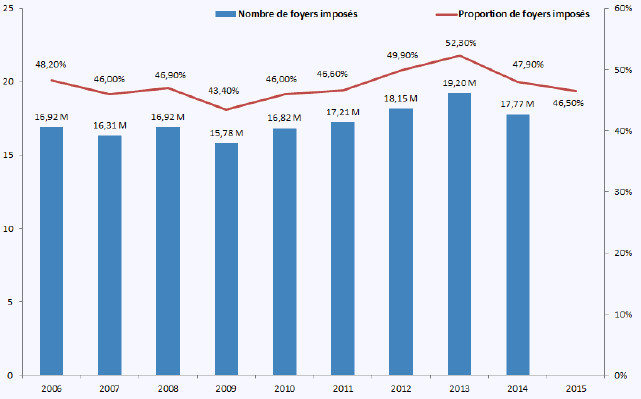
Au-delà des facteurs pouvant influer sur le nombre de foyers fiscaux imposés, notamment l’évolution des revenus et des situations des contribuables, la tendance générale à la hausse retracée dans le graphique présenté supra traduit un accroissement de la pression fiscale depuis 2010, et manifeste une participation importante des foyers fiscaux aux revenus modestes et moyens aux efforts de redressement budgétaire.
Le nombre de foyers fiscaux imposés a notamment connu un ressaut de l’ordre d’un million entre 2011 et 2012, sous l’effet des mesures adoptées sous la précédente législature, puis à nouveau d’un million entre 2012 et 2013, en conséquence des mesures prises par l’actuelle majorité, et ce afin de maîtriser le déficit budgétaire qui s’est fortement creusé entre 2008 et 2010.
Depuis 2010, différentes mesures ont ainsi contribué à accroître à la fois le nombre de contribuables imposés et le montant des recettes d’impôt sur le revenu. Elles sont retracées dans le tableau ci-après :
EFFETS SUR LES RECETTES D’IMPÔT SUR LE REVENU DES DIFFÉRENTES MESURES FISCALES ADOPTÉES DEPUIS 2010
(en milliards d’euros)
Loi de finances |
Intitulé des mesures |
IR 2012 |
IR 2013 |
IR 2014 |
IR 2015 |
LFI 2009 |
Extinction du bénéfice de la demi-part « vieux parents » pour ceux n’ayant pas élevé un enfant seuls au moins cinq années |
0,5 |
0,5 |
− |
− |
LFI 2011 |
Révision des modalités déclaratives de revenu en cas de mariage, pacs, divorce ou dissolution de pacs |
1 |
− |
− |
− |
Réduction de 10 % sur différents avantages fiscaux |
0,4 |
− |
− |
− | |
Aménagement du crédit d’impôt pour le développement durable |
0,9 |
0,2 |
− |
− | |
Contribution de 1 % sur les hauts revenus |
0,1 |
− |
− |
− | |
LFI 2012 |
Contribution exceptionnelle sur les hauts revenus |
0,6 |
− |
− |
− |
Rabot de 15 % sur différents avantages fiscaux |
− |
0,5 |
− |
− | |
LFR 2011-4 |
Désindexation du barème de l’impôt sur le revenu |
1,8 |
1,6 |
− |
− |
Augmentation du prélèvement forfaitaire libératoire (PFL) pour les dividendes, les intérêts et les revenus des capitaux mobiliers (RCM) des non-résidents |
0,5 |
− |
− |
− | |
LFR 2012-2 |
Fiscalisation des heures supplémentaires |
− |
0,6 |
1 |
− |
LFI 2013 |
Baisse du plafond de l’avantage retiré du quotient familial à 2 000 euros |
− |
0,6 |
− |
− |
Création d’une tranche à 45 % au sein du barème de l’impôt sur le revenu |
− |
0,3 |
− |
− | |
Revalorisation de la décote à hauteur de 9 % |
− |
− 0,3 |
− | ||
Imposition au barème des revenus du capital |
− |
1,3 |
− 0,4 |
− 0,2 | |
LFI 2014 |
Baisse du plafond de l’avantage retiré du quotient familial à 1 500 euros |
− |
− |
1 |
− |
Fiscalisation des majorations de pensions pour charges de famille |
− |
− |
1,2 |
− | |
Fiscalisation de la participation des employeurs aux complémentaires santé |
− |
− |
1 |
− | |
Revalorisation de la décote de 5,8 % |
− |
− |
− 0,2 |
− | |
Réforme de l’imposition des plus-values immobilières |
− |
− 0,2 |
− 0,6 |
0,3 | |
Réforme de l’imposition des plus-values immobilières |
− |
− 0,2 |
− 0,3 |
0,1 | |
LFR 2014-1 |
Réduction exceptionnelle d’impôt sur le revenu |
− |
− |
− 1,3 |
1,3 |
LFI 2015 |
Réforme du bas de barème |
− |
− |
− |
− 2,7 |
Réforme du crédit d’impôt pour la transition énergétique |
− |
− |
− |
− 0,2 | |
Total |
5,8 |
4,9 |
1,4 |
− 1,4 |
Source : Rapport économique, social et financier annexé aux projets de loi de finances pour 2014 et pour 2015.
Des dispositions telles que le plafonnement de l’avantage fiscal retiré du quotient familial, la création d’une tranche à 45 % au sein du barème de l’impôt sur le revenu ou le plafonnement global des niches fiscales ne concernent que les contribuables les plus aisés, relevant des neuvième et dixième déciles. Elles n’ont eu par définition aucune incidence sur l’entrée de nouveaux ménages dans l’imposition.
En revanche, d’autres mesures introduites en lois de finances pour 2013 et pour 2014 ont emporté des conséquences pour des contribuables relevant de déciles moins élevés et ont conduit à faire entrer dans l’imposition des foyers fiscaux jusqu’alors non imposés, alors que leurs revenus n’avaient pas évolué. Tel est le cas notamment de l’exonération d’impôt sur le revenu des majorations de pension pour charges de famille ou encore de l’exonération fiscale des heures supplémentaires. Il convient de souligner que ces mesures visaient également, au-delà de l’objectif de rendement budgétaire, à supprimer des dispositifs fiscaux qui s’avéraient anti-redistributifs, en ce qu’ils bénéficiaient d’autant plus à un foyer fiscal que celui-ci percevait des revenus élevés. À titre de rappel, 40 % de l’avantage fiscal résultant de l’exonération des majorations de pensions bénéficiait au dernier décile des foyers fiscaux, tandis que les 20 % de contribuables les plus aisés recevaient 46 % de l’avantage fiscal correspondant à l’exonération des heures supplémentaires.
Pour autant, ces mesures ont conduit à mettre à contribution les contribuables aux revenus modestes et moyens, relevant notamment des cinquième et sixième déciles (c’est-à-dire pour des RFR compris entre 15 430 euros et 22 500 euros). C’est la raison pour laquelle le Gouvernement a mis en œuvre dès 2014 des mesures ciblant ces contribuables, afin de leur restituer une partie des efforts consentis depuis 2011.
● Sous l’effet de la réduction d’impôt exceptionnelle instaurée en première loi de finances rectificative pour 2014, d’un montant de 1,25 milliard d’euros, le nombre de foyers fiscaux imposés a diminué dès 2014 : il est passé de 19,2 millions en 2013 à 17,8 millions en 2014, soit une baisse de 1,4 million (et alors que le nombre de foyers fiscaux a crû parallèlement de 400 000). La proportion de foyers imposés a ainsi été ramenée de 52,3 % à 47,9 %.
Sur les quelque 4 millions de foyers fiscaux ayant bénéficié de la mesure, 2,1 millions sont en effet devenus non imposés, tandis que 1,36 million ont perçu une restitution d’impôt plus élevée (pour un gain moyen de 230 euros). Enfin, 600 000 foyers fiscaux imposés ont bénéficié d’un allégement de leur imposition, d’un montant moyen de 436 euros. Les effets de la mesure sont donc considérables pour les ménages se trouvant dans son champ, tant en termes de sortie de l’imposition que de baisse de l’impôt dû, et ils se traduisent par un gain significatif de pouvoir d’achat.
Le tableau ci-dessous retrace la répartition des foyers fiscaux bénéficiaires de la mesure au sein de l’ensemble des foyers fiscaux ventilés par décile de RFR. Ces déciles de RFR ne prennent pas en compte le nombre de parts au sein du foyer. Or, le bénéfice de la mesure était conditionné à un plafond de RFR majoré en fonction du nombre de demi-parts de quotient familial, pour prendre en compte la composition du foyer. De ce fait, les 1,23 million de foyers fiscaux concernés par la mesure dont le RFR est compris entre 22 726 et 28 490 euros, qui relèvent du septième décile, correspondent pour l’essentiel à des familles avec un ou plusieurs enfants. En revanche, les 1,15 million de foyers fiscaux bénéficiaires dont le RFR est compris entre 12 380 et 15 545 euros, relevant du quatrième décile, sont des contribuables célibataires, veufs ou divorcés.
VENTILATION DES FOYERS FISCAUX EFFECTIVEMENT BÉNÉFICIAIRES
DE LA RÉDUCTION D’IMPÔT PAR DÉCILES DE REVENU FISCAL
DE RÉFÉRENCE DE L’ENSEMBLE DES FOYERS FISCAUX
Borne inférieure (en euros) |
Borne supérieure de RFR (en euros) |
Déciles de l’ensemble des foyers fiscaux (en milliers) |
Nombre de foyers fiscaux effectivement bénéficiaires (en milliers) |
0 |
3 533 |
3 655 |
3 |
3 533 |
8 745 |
3 655 |
ε |
8 745 |
12 380 |
3 655 |
96 |
12 380 |
15 545 |
3 655 |
1 154 |
15 545 |
18 596 |
3 655 |
285 |
18 596 |
22 726 |
3 655 |
554 |
22 726 |
28 490 |
3 655 |
1 231 |
28 490 |
36 452 |
3 655 |
623 |
36 452 |
50 942 |
3 655 |
111 |
50 942 |
3 655 |
1 | |
Total |
36 550 |
4 060 | |
Source : direction générale du Trésor, simulation budgétaire, échantillon de 500 000 déclarations d’impôt sur les revenus de 2012 actualisés 2013, environnement législatif applicable aux revenus 2013.
● L’évolution engagée en 2014 devrait se poursuivre cette année, sous l’effet de la réforme du bas de barème mise en œuvre par la loi de finances pour 2015. Si les chiffres définitifs ne sont pas encore connus, la part des foyers fiscaux imposés devrait être comprise entre 46 % et 46,5 % en 2015. A la troisième émission des revenus de 2014, le nombre de foyers fiscaux imposés s’établissait à 16,84 millions, sur un nombre total de foyers fiscaux de 36,61 millions, soit une proportion de l’ordre de 46 %.
Les données transmises par le Gouvernement permettent de dresser un premier bilan de la réforme conduite à l’automne dernier : celle-ci a concerné 9,3 millions de foyers fiscaux, pour un coût budgétaire estimé à 2,8 milliards d’euros (27), avec un gain moyen par foyer de 301 euros. Ces résultats sont proches des estimations initiales, à savoir 9 millions de foyers bénéficiaires prévus, pour un coût de 2,7 milliards d’euros.
La suppression de la tranche à 5,5 % et la réforme de la décote ont donc permis de faire sortir de l’impôt 3,2 millions de foyers fiscaux – ou d’éviter qu’ils n’y entrent –, tandis qu’elles ont allégé l’impôt de 4,4 millions de foyers fiscaux imposés.
IMPACT DE LA RÉFORME DU BAS DE BARÈME
DE LA LOI DE FINANCES POUR 2015
Type de foyers |
Nombre de foyers fiscaux |
Gain moyen |
Foyers fiscaux devenus non imposés sous l’effet de la réforme |
3,201 millions |
384 euros |
Foyers fiscaux non imposés (avec ou sans la réforme) dont la restitution augmente |
1,643 million |
265 euros |
Foyers imposés dont l’imposition diminue |
4,378 millions |
258 euros |
Source : direction générale des finances publiques.
Les gains à la réforme sont élevés, puisque si 1,4 million de foyers enregistrent un gain inférieur à 100 euros, 5,74 millions de foyers obtiennent un gain supérieur à 200 euros – parmi lesquels 2,17 millions ont un gain supérieur à 400 euros. Le pouvoir d’achat redistribué aux ménages s’avère là encore significatif.
Montant du gain |
Nombre de foyers fiscaux |
Gain inférieur à 100 euros |
1,396 million |
Gain compris entre 100 et 200 euros |
2,178 millions |
Gain compris entre 200 et 300 euros |
2,322 millions |
Gain compris entre 300 et 400 euros |
1,252 million |
Gain compris entre 400 et 500 euros |
0,476 million |
Gain supérieur à 500 euros |
1,693 million |
Source : direction générale des finances publiques.
5,4 millions des foyers fiscaux bénéficiaires de la mesure sont des célibataires, veufs ou divorcés, tandis que 3,9 millions sont des personnes mariées ou ayant contracté un pacte civil de solidarité.
BÉNÉFICIAIRES DE LA RÉFORME SELON LEUR SITUATION FAMILIALE
Situation familiale |
Nombre de bénéficiaires |
Coût de la réforme |
Célibataire |
3 517 052 |
689 635 498 |
Divorcé |
1 192 748 |
234 337 686 |
Marié |
3 579 701 |
1 591 861 172 |
Pacsé |
323 727 |
151 168 383 |
Veuf |
702 827 |
136 823 745 |
Total |
9 316 056 |
2 803 826 484 |
Source : direction générale des finances publiques.
Enfin, le tableau suivant permet de visualiser la ventilation des foyers fiscaux dans le champ de la réforme, au sein de l’ensemble des déciles de RFR. 5,37 millions de foyers fiscaux bénéficiaires, soit 58 %, relèvent des quatrième à sixième déciles. Là encore, comme pour la réduction d’impôt exceptionnelle, les foyers situés dans les déciles élevés correspondent à des couples avec un ou plusieurs enfants, tandis que les contribuables célibataires, divorcés ou veufs relèvent de déciles médians.
VENTILATION DES FOYERS FISCAUX BÉNÉFICIAIRES DE LA RÉFORME DU BARÈME AU SEIN DES DÉCILES DE RFR DE L’ENSEMBLE DES FOYERS FISCAUX
Déciles |
Nombre de foyers fiscaux |
Gain moyen (en euros) |
Nombre de foyers bénéficiaires (en milliers) |
Nombre de foyers devenus non imposés |
01. RFR <=3 645 euros |
3 661 322 |
235 |
1 109 |
500 |
02. 3 645<RFR <= 8 934 euros |
3 661 546 |
88 |
156 |
133 |
03. 8 934<RFR <= 12 599 euros |
3 660 864 |
53 |
187 805 |
47 208 |
04. 12 599 < RFR <=15 690 euros |
3 661 317 |
252 |
2 305 451 |
825 994 |
05. 15 690 < RFR <= 18 769 euros |
3 660 625 |
136 |
1 937 175 |
350 005 |
06. 18 769 RFR <= 23 045 euros |
3 661 185 |
187 |
1 124 530 |
476 146 |
07. 23 045 < RFR <=28 827 euros |
3 660 846 |
478 |
1 497 837 |
797 178 |
08. 28 827 RFR <= 36 885 euros |
3 661 133 |
449 |
1 648 897 |
525 516 |
09. 36 885 < RFR <= 51 503 euros |
3 660 952 |
462 |
570 678 |
165 871 |
10 RFR > 51 503 |
3 661 076 |
487 |
42 418 |
12 648 |
Total |
36 610 867 |
301 |
9 319 056 |
3 201 199 |
Source : direction générale des finances publiques.
Outre la traditionnelle indexation du barème sur l’inflation à laquelle il procède, le présent article s’inscrit dans le prolongement des dispositions de la loi de finances pour 2015, en proposant une nouvelle réforme de la décote, qui vient accroître encore les effets de cette dernière tout en adoucissant la pente d’imposition qui y est associée.
● Le 1° du I procède à l’indexation du barème de l’impôt sur le revenu, en revalorisant chacune des limites des tranches de l’impôt sur le revenu de 0,1 %, soit l’évolution prévisionnelle de l’indice des prix hors tabac en 2015 par rapport à 2014.
Cette disposition permet ainsi de maintenir la pression fiscale – c’est-à-dire la proportion de l’impôt dû par rapport au revenu – à un niveau constant. A contrario, si le barème n’était pas indexé, l’impôt dû par les ménages dont les revenus ont augmenté au même rythme que l’inflation s’accroîtrait : du fait de la progressivité du barème, une part plus importante de leurs revenus serait soumise au taux marginal le plus élevé auquel ils sont assujettis, et leur taux marginal pourrait lui-même augmenter. Le poids de l’impôt acquitté par rapport aux revenus du ménage augmenterait en conséquence d’une année sur l’autre.
La revalorisation des tranches du barème à hauteur de l’inflation s’accompagne corrélativement de celle de différents montants utilisés pour le calcul de l’impôt. Si la décote fait l’objet d’une réforme distincte et n’est pas indexée sur l’inflation (voir infra), les plafonds des avantages fiscaux retirés du quotient familial, tant au titre des demi-parts de droit commun que des demi-parts répondant à des situations particulières, ainsi que le plafond de l’abattement accordé au titre du rattachement d’enfants majeurs mariés ou chargés de famille, sont également augmentés de 0,1 % (2° du I et II).
INDEXATION DE PLAFONDS ET MONTANTS ASSOCIES AU CALCUL DE L’IMPÔT
SUR LE REVENU
(en euros)
Objet de la limite ou du seuil |
Pour l’imposition des revenus de 2014 |
Pour l’imposition des revenus de 2015 |
Plafond de l’avantage retiré de chaque demi-part de droit commun de quotient familial (a du 2° du I du présent article) |
1 508 |
1 510 |
Plafond de l’avantage retiré de la part entière de quotient familial accordée au titre du premier enfant à charge des personnes vivant seules en application du II de l’article 194 du CGI (b du 2° du I) |
3 558 |
3 562 |
Plafond de l’avantage retiré de la demi-part accordée aux personnes célibataires, divorcées ou veuves sans personne à charge ayant élevé seules pendant au moins cinq ans un ou plusieurs enfants en application des a, b et e du 1 de l’article 195 du CGI (c du 2° du I) |
901 |
902 |
Plafond de la réduction d’impôt complémentaire au titre de la demi-part supplémentaire accordée à raison de la qualité d’ancien combattant ou de la situation d’invalidité d’un des membres du foyer fiscal en application des c, d, d bis et f du 1 et des 2 à 6 de l’article 195 du CGI (d du 2° du I) |
1 504 |
1 506 |
Plafond de la réduction d’impôt complémentaire au titre de la part supplémentaire accordée aux contribuables veufs ayant au moins un enfant à charge en application du I de l’article 194 (e du 2° du I) |
1 680 |
1 682 |
Montant de l’abattement accordé en cas de rattachement d’un enfant majeur marié ou chargé de famille en application de l’article 196 B du CGI (II) |
5 726 |
5 732 |
● L’indexation du barème est devenue au cours du temps une référence pour l’évolution conjointe d’autres types de montants, conditionnant selon les cas une exonération ou une minoration d’imposition, ou encore le plafonnement d’un avantage en impôt. Ces montants sont ainsi réputés être indexés chaque année comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu.
Cette indexation emporte de nombreuses conséquences sur les régimes d’imposition spécifiques à certains contribuables ou sur les recettes de différentes impositions.
Les dispositifs indexés comme la limite supérieure de la première tranche de l’impôt sur le revenu dans le domaine de l’impôt sur le revenu |
– la déduction forfaitaire des frais professionnels du revenu brut (3° de l’article 83 du CGI), plafonnée à 12 157 euros au titre de l’imposition des revenus de 2014 |
– l’abattement applicable aux pensions et retraites (a du 5 de l’article 158 du CGI), fixé à 3 707 euros au titre de l’imposition des revenus de 2014 |
– l’abattement forfaitaire sur le revenu en faveur de certaines personnes âgées de plus de soixante-cinq ans ou invalides (article 157 bis du CGI), fixé à 2 344 euros si le revenu du contribuable n’excède pas 14 710 euros ou 1 172 euros si ce revenu est compris entre 14 710 euros et 23 700 euros au titre de l’année d’imposition précitée |
– la réduction d’impôt accordée au titre de certains dons faits par les particuliers et ouvrant droit à une réduction d’impôt à un taux de 75 % (1° ter de l’article 200 du CGI) dans la limite d’un plafond de dons de 526 euros au titre de l’imposition des revenus de 2014 |
– la déductibilité du revenu global d’une somme représentative des avantages en nature des personnes âgées de plus de 75 ans vivant sous le toit du contribuable (2° ter du II de l’article 156 du CGI), fixée à 3 403 euros au titre de l’imposition des revenus de 2014 |
– les modalités d’imputation des déficits agricoles sur le revenu global imposable (1° du I de l’article 156 du CGI, ces déficits étant déductibles à la condition que le total des revenus nets d’autres sources n’excède pas 107 610 euros au titre de l’imposition des revenus de 2014) |
– la retenue à la source sur les traitements, salaires, pensions et rentes viagères de source française servis à des personnes qui ne sont pas domiciliées en France (article 182 A du CGI) |
– l’évaluation forfaitaire minimale du revenu imposable d’après certains éléments du train de vie (1 de l’article 168 du CGI), fixée à 45 358 euros pour l’imposition des revenus de 2014 |
– la limite d’exonération du complément de rémunération résultant de la contribution de l’employeur à l’acquisition par le salarié de titres restaurant (19° de l’article 81 du CGI) fixée à 5,36 euros par titre pour 2014 |
– le seuil d’exigibilité des acomptes provisionnels pour le recouvrement de l’impôt sur le revenu (1 de l’article 1664 du CGI), fixé à 347 euros pour l’imposition des revenus de 2014 |
– l’éligibilité au régime de l’auto-entrepreneur (2° du I de l’article 151-0 du CGI) |
Les dispositifs indexés comme la limite supérieure de la première tranche de l’impôt sur le revenu dans le domaine de la fiscalité locale |
– le plafonnement de la taxe d’habitation, ainsi que les dégrèvements d’office et abattements communs à cette taxe et à la taxe foncière au profit des contribuables qui ne dépassent pas un certain niveau de revenu fiscal de référence mentionné à l’article 1417 du CGI. Ce niveau de revenu gouverne également de nombreuses autres exonérations, dégrèvements et abattements. |
Les dispositifs indexés relatifs à d’autres impositions (liste non exhaustive) |
– le barème de la taxe sur les salaires (2 bis de l’article 231 du CGI) |
– l’exigibilité de la taxe sur les salaires pour les associations (article 1679 A du CGI) |
– le montant des parts de groupements fonciers agricoles et des biens ruraux loués par bail à long terme donnant droit à exonération totale ou partielle d’impôt de solidarité sur la fortune (article 885 H du CGI) |
– les montants de la taxe spéciale d’équipement perçue au profit de l’agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite « des cinquante pas géométriques » en Guadeloupe et en Martinique (articles 1609 C et 1609 D du CGI) |
Exemple de dispositif indexé dans des domaines non fiscaux |
– les montants déterminant l’éligibilité à l’ouverture ou la prolongation d’un compte sur le livret d’épargne populaire (article L. 221-15 du code monétaire et financier). |
S’agissant de l’impôt sur le revenu, il convient de citer, parmi les principaux dispositifs indexés, l’abattement forfaitaire sur le revenu en faveur des personnes âgées de plus de soixante-cinq ans, applicable en fonction de seuils de revenus donnés, ou encore le plafond de l’abattement de 10 % applicable aux pensions et retraites et celui de la déduction forfaitaire de 10 % au titre des frais professionnels.
Par ailleurs, il convient d’observer qu’en application de la loi de finances rectificative pour 2013 (28), certains seuils et plafonds applicables pour l’imposition des professionnels sont désormais actualisés tous les trois ans dans la même proportion que l’évolution triennale de la limite supérieure de la première tranche de l’impôt sur le revenu, alors que leur revalorisation suivait un rythme annuel auparavant – la première revalorisation triennale prenant effet à compter du 1er janvier 2017 (29).
Au titre de la fiscalité locale, les articles 1417 et 1414 A du CGI définissent, pour le premier, des plafonds de revenus et, pour le second, des montants d’abattements, utilisés par une douzaine de régimes d’exonérations ou d’abattements en matière de taxe d’habitation et de taxe foncière sur les propriétés bâties. Or, ces montants sont eux aussi indexés comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu. Cette revalorisation emporte également des conséquences en termes de recettes de contribution à l’audiovisuel public (CAP), puisque les contribuables peuvent bénéficier d’un dégrèvement total de la CAP selon des conditions symétriques à celles retenues pour les exonérations de taxe d’habitation.
Le présent article modifie à nouveau le mécanisme de la décote (3° du I), tout en conservant le principe de sa conjugalisation. Alors que la décote en vigueur consiste à réduire le montant d’impôt résultant du barème de la différence entre 1 135 euros ou 1 870 euros, selon la configuration du foyer fiscal, et la totalité de ce montant d’impôt, la décote telle qu’issue de la réforme proposée consisterait à diminuer le montant d’impôt résultant du barème de la différence entre 1 165 euros ou 1 920 euros, selon la configuration du foyer fiscal, et les trois quarts de ce montant d’impôt.
Le montant retranché de l’impôt issu du barème en application de la décote serait donc toujours plus important :
– en raison de la hausse du montant de la décote, qui passe de 1 135 à 1 165 euros pour un célibataire et de 1 870 à 1 920 euros pour un couple ; cela représente une augmentation de 2,6 %, nettement plus élevée que le taux d’inflation ;
– du fait de la diminution du montant qui est défalqué de la décote : il ne s’agit plus de la totalité de l’impôt dû, mais seulement des trois quarts.
Exemple : un couple disposant d’un revenu de 35 000 euros en 2015 devrait s’acquitter d’un impôt de 1 694 euros en 2016 en application du barème.
Avec la décote applicable aux revenus de 2014, l’impôt dû serait réduit de 176 euros (1870-1694), et donc ramené à 1 518 euros.
Avec la décote telle qu’issue du présent article, l’impôt dû serait réduit de 650 euros (1920 – 0,75 × 1694), et donc ramené à 1 044 euros.
La réforme proposée emporte trois effets : un nouveau recul des seuils d’entrée dans l’imposition ; une diminution plus importante de l’impôt dû pour les foyers fiscaux imposés ; une « dépentification » de l’imposition, c’est-à-dire un taux marginal d’imposition moindre pour les revenus se trouvant dans le champ d’application de la décote.
● La modification du mécanisme de la décote amplifie mécaniquement ses effets, puisque celui-ci permettrait désormais d’annuler l’impôt dû en application du barème par un célibataire jusqu’à un montant de 701 euros – lorsque l’on prend en compte les effets du seuil de mise en recouvrement (30) ; pour l’imposition des revenus de 2014, ce montant était de 598 euros, tandis qu’il s’établissait à 379 euros pour l’imposition des revenus de 2013.
Ainsi, entre 2014 et 2016, le montant d’impôt pouvant être effacé par le biais de la décote doublerait quasiment, en passant de 379 à 701 euros.
Cette évolution est encore plus marquée pour les couples, puisque la décote proposée permettrait d’annuler l’impôt dû en application du barème pour un couple jusqu’à un montant de 1 132 euros (31) – après prise en compte du seuil de mise en recouvrement, contre 965 euros pour l’imposition des revenus de 2014 et toujours 379 euros pour l’imposition des revenus de 2013, soit un triplement en entre 2014 et 2016.
Les montants précités de respectivement 701 euros (pour un célibataire) et 1 132 euros (pour un couple) correspondent à l’allégement maximal d’imposition qui peut résulter de la décote, en nette hausse par rapport aux années précédentes. Puis la baisse d’imposition se réduit au fur et à mesure que l’impôt dû au titre du barème croît : elle devient nulle à compter d’un niveau d’imposition de 1 553 euros pour un contribuable célibataire (32) – contre 1 135 euros en 2015 et 1 016 euros en 2014. Parallèlement, la décote ne joue plus pour un couple au-delà d’un niveau d’imposition dû de 2 560 euros (33) – contre 1 870 euros en 2015 et 1 016 euros en 2014.
Le point de sortie de la décote, en termes de niveau d’impôt sur le revenu, est lui aussi en forte hausse, puisque, entre 2014 et 2016, il est multiplié par 1,5 pour un célibataire et par 2,5 pour un couple.
ÉVOLUTION DU CHAMP DE LA DÉCOTE DEPUIS 2012
(en euros)
Année d’imposition |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 | ||
Pour un célibataire |
Pour un couple |
Pour un célibataire |
Pour un couple | ||||
Plafond de la décote |
439 |
480 |
508 |
1 135 |
1 870 |
1 165 |
1 920 |
Montant maximal d’impôt sur le revenu issu du barème susceptible d’être effacé par la décote |
292 |
320 |
339 |
568 |
935 |
666 |
1 097 |
Montant maximal d’impôt sur le revenu issu du barème susceptible d’être effacé par la décote compte tenu du seuil de mise en recouvrement, et correspondant à l’allégement maximal d’imposition résultant de la décote |
334 |
361 |
379 |
598 |
965 |
701 |
1 132 |
Plafond d’impôt sur le revenu issu du barème à partir duquel la décote ne joue plus |
878 |
960 |
1 016 |
1 135 |
1 870 |
1 553 |
2 560 |
Source : commission des finances.
● Ces évolutions de plafonds d’impôt annulé et de point de sortie de la décote en termes de niveaux d’imposition, trouvent leur traduction en termes de niveaux de revenus, selon les différentes configurations de foyers fiscaux : le seuil de revenu au-delà duquel un foyer fiscal entre dans l’impôt est à nouveau accru, quelle que soit la configuration du foyer fiscal. Ce recul du seuil d’imposition s’effectue de façon linéaire pour les célibataires et pour les couples cette fois, à la différence de l’année précédente.
Le tableau suivant permet de retracer l’évolution des seuils d’entrée dans l’impôt depuis 2013 :
ÉVOLUTION DU POINT D’ENTRÉE DANS L’IMPOSITION SOUS L’EFFET DE LA DÉCOTE
(en euros)
Nombre de parts |
IR 2013 Dernier revenu déclaré non imposable du fait de la décote (RFR) |
IR 2014 Dernier revenu déclaré non imposable du fait de la décote et de la réduction d’impôt (RFR) |
IR 2015 Dernier revenu déclaré non imposable du fait de la décote (RFR) |
IR 2016 Dernier revenu déclaré non imposable du fait de la décote (RFR) |
1 part |
13 490 (12 141) soit 0,98 SMIC |
15 369 (13 832) soit 1,1 SMIC |
15 508 (13 957) soit 1,1 SMIC |
16 341 (14 707) soit 1,16 SMIC |
1,5 part |
17 222 (15 500) soit 1,25 SMIC |
19 496 (17 546) soit 1,4 SMIC |
20 888 (18 799) soit 1,49 SMIC |
21 727 (19 554) Soit 1,54 SMIC |
2 parts |
20 534 (18 481) soit 1,49 SMIC |
28 135 (25 322) soit 2,02 SMIC |
29 196 (26 276) soit 2,08 SMIC |
30 540 (27 486) soit 2,16 SMIC |
2,5 parts |
23 848 (21 463) soit 1,73 SMIC |
33 492 (30 143) soit 2,4 SMIC |
34 576 (31 118) soit 2,46 SMIC |
35 929 (32 336) soit 2,54 SMIC |
3 parts |
27160 (24 444) soit 1,97 SMIC |
37 117 (33 405) soit 2,66 SMIC |
39 959 (35 963) soit 2,85 SMIC |
41 317 (37 186) soit 2,92 SMIC |
4 parts |
33 785 (30 406) soit 2,45 SMIC |
43 795 (39 415) soit 3,14 SMIC |
50 725 (45 652) soit 3,61 SMIC |
52 095 (46 886) soit 3,69 SMIC |
5 parts |
40 410 (36 369) soit 2,93 SMIC |
50 475 (45 427) soit 3,62 SMIC |
61 492 (55 343) soit 4,38 SMIC |
62 873 (56 286) soit 4,45 SMIC |
Source : commission des finances.
Désormais, l’entrée dans l’imposition interviendrait à partir d’un revenu de l’ordre de 1,16 SMIC pour un célibataire, soit environ 1 315 euros de revenus mensuels nets, contre 1,1 SMIC en 2015 et 0,98 SMIC en 2013.
Pour un couple avec deux enfants, soit un foyer comptant trois parts, ce seuil passerait à 2,92 SMIC, soit environ 3 320 euros de revenus mensuels nets, contre 2,85 SMIC en 2015 et 1,97 SMIC en 2013.
Le graphique ci-dessous permet de visualiser le recul de l’entrée dans l’impôt en fonction du nombre de parts au sein du foyer fiscal :
ÉVOLUTION DU NIVEAU DE REVENU ANNUEL À PARTIR DUQUEL UN FOYER FISCAL EST IMPOSABLE, SELON LE NOMBRE DE PARTS FISCALES, ENTRE 2013 ET 2016
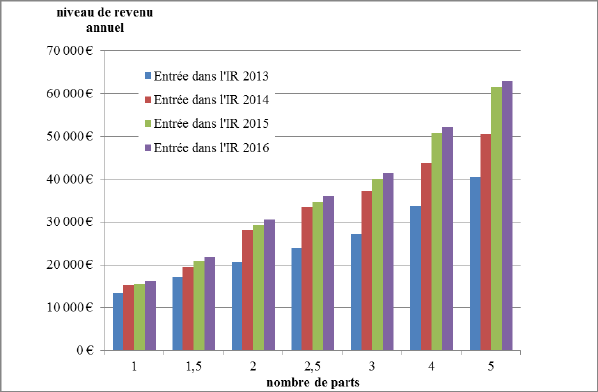
Source : commission des finances.
La forte augmentation du champ d’application de la décote, en termes de montants d’imposition susceptibles d’être réduits, se traduit comme suit en termes de niveau de revenus, selon les différentes configurations de foyers fiscaux :
ÉVOLUTION DU POINT DE SORTIE DE LA DÉCOTE
(en euros)
Nombre |
IR 2013 Dernier revenu déclaré bénéficiant d’un allégement par la décote (RFR) |
IR 2014 Dernier revenu déclaré bénéficiant d’un allégement par la décote (RFR) |
IR 2015 Dernier revenu déclaré bénéficiant d’un allégement par la décote (RFR) |
IR 2016 Dernier revenu déclaré bénéficiant d’un allégement par la décote (RFR) |
1 part |
18 242 (16 418) soit 1,32 SMIC |
18 772 (16 895) soit 1,35 SMIC |
19 766 (21 962) soit 1,4 SMIC |
23 103 (20 793) soit 1,63 SMIC |
1,5 part |
23 557 (21 201) soit 1,71 SMIC |
24 129 (21 716) soit 1,73 SMIC |
25 150 (19 035) soit 1,79 SMIC |
28 492 (25 643) soit 2 SMIC |
2 parts |
28 870 (25 983) soit 2,1 SMIC |
29 484 (26 536) soit 2,11 SMIC |
36 367 (32 730) soit 2,6 SMIC |
41 873 (37 686) soit 2,96 SMIC |
2,5 parts |
34 184 (30 766) soit 2,48 SMIC |
34 841 (31 357) soit 2,5 SMIC |
41 750 (37 575) soit 2,97 SMIC |
47 262 (42 536) soit 3,34 SMIC |
3 parts |
39 260 (35 334) soit 2,85 SMIC |
40 198 (36 178) soit 2,88 SMIC |
47 133 (42420) soit 3,35 SMIC |
52 651 (47 386) soit 3,73 SMIC |
4 parts |
45 896 (41 306) soit 3,33 SMIC |
47 230 (42 507) soit 3,39 SMIC |
57 900 (62 110) soit 4,12 SMIC |
63 429 (57 086) soit 4,49 SMIC |
Source : commission des finances.
Ainsi, au titre de l’imposition des revenus de 2012, pour un contribuable célibataire, la décote trouvait à s’appliquer entre des revenus de 13 490 euros (seuil d’entrée dans l’impôt) et 18 242 euros, tandis qu’au titre de l’imposition des revenus de 2015, elle devrait jouer pour des revenus compris entre 16 341 euros (point d’entrée dans l’impôt) et 23 103 euros. Ces différents seuils, comme l’amplitude entre les deux, sont donc fortement accrus.
De même, au titre de l’imposition des revenus de 2012, pour un couple marié avec deux enfants, la décote venait minorer l’imposition entre des revenus de 27 160 euros (seuil d’entrée dans l’impôt) et de 39 260 euros, tandis qu’au titre de l’imposition des revenus de 2015, elle devrait s’appliquer pour des revenus compris entre 41 317 euros (seuil d’entrée dans l’impôt) et 52 651 euros.
Le mécanisme même de la décote, qui s’applique à la cotisation d’impôt résultant du barème progressif, a pour effet induit d’accroître le taux marginal d’imposition des revenus qui se trouvent dans son champ, parallèlement à l’allégement d’impôt qu’il occasionne. Cela résulte du fait que la décote réduit d’autant moins l’imposition que cette dernière est élevée. Si l’impôt issu du barème augmente, l’effet de la décote est moindre : l’impôt final augmente encore davantage que l’impôt avant décote.
Cette accentuation de la pente d’imposition a été renforcée par la réforme intervenue en loi de finances pour 2015, et le présent article vise à revenir pour partie sur cette évolution, afin d’assurer une entrée plus progressive dans l’imposition.
● Jusqu’à l’imposition des revenus de 2013, la décote se traduisait par une augmentation de 50 % du taux d’imposition marginal des revenus tel qu’il résultait du barème progressif. En effet, le système de la décote pouvait se traduire par la formule arithmétique suivante (sachant que l’impôt initial correspond à l’impôt résultant du barème) :
Impôt dû = impôt initial – (508 – impôt initial/2)
Ce qui revient à écrire : Impôt dû = 1,5 × impôt initial – 508
De ce fait, une augmentation d’un euro de l’impôt issu du barème se traduit par une augmentation de 1,5 euro de l’impôt dû après décote, soit un coefficient de 1,5. Ainsi, pour un foyer fiscal soumis à l’impôt sur le revenu au taux de 5,5 %, la décote portait le taux marginal d’imposition à 8,25 % ; pour un foyer fiscal assujetti au taux de 14 %, la décote portait le taux marginal à 21 % (34).
Exemple 1 : un couple a perçu en 2013 des revenus salariaux de 28 000 euros. Son impôt dû avant décote s’établit à 828 euros en 2014. Son impôt après décote est égal à 734 euros (1,5 × 828 – 508), la baisse résultant de la décote étant de 94 euros (35).
Si ce même couple avait perçu des revenus de 28 111 euros, ce qui correspond à une hausse de revenu imposable de 100 euros (36), son impôt dû avant décote se serait établi à 842 euros, et celui après décote à 755 euros, la baisse résultant de la décote étant de 87 euros.
Avant prise en compte de la décote, le taux marginal d’imposition s’établit logiquement à 14 %, soit le taux de la tranche du barème dont le foyer fiscal relève : 100 euros de revenu imposable supplémentaire se traduit par une hausse d’impôt de 14 euros (842 – 828).
Après prise en compte de la décote, le taux marginal d’imposition est porté à 21 % : 100 euros de revenu imposable supplémentaire aboutit à une hausse d’impôt de 21 euros (755 – 734).
● La réforme intervenue en loi de finances pour 2015, pour l’imposition des revenus de 2014, est venue accroître la pente de la décote : cette dernière vient désormais doubler le taux d’imposition marginal des revenus résultant du barème.
En effet, le système de la décote se traduit désormais par la formule arithmétique suivante :
Impôt dû = impôt initial – (1 135 ou 1 870 – impôt initial)
Ce qui revient à écrire :
Impôt dû = 2 × impôt initial – 1 135 ou 1 870
Une augmentation d’un euro de l’impôt issu du barème conduit à une augmentation de 2 euros de l’impôt dû après décote, soit un coefficient de 2. De ce fait, pour un foyer fiscal soumis à l’impôt sur le revenu au taux de 14 %, la décote porte le taux marginal d’imposition à 28 %, contre 21 % précédemment.
Exemple 2 : un couple avec deux enfants a perçu en 2014 des revenus salariaux de 40 000 euros. Son impôt dû avant décote s’établit à 970 euros en 2015. Son impôt après décote est égal à 70 euros (2 × 970 – 1 870).
Si ce même couple avait perçu des revenus de 40 111 euros, ce qui correspond à une hausse de revenu imposable de 100 euros, son impôt dû avant décote se serait établi à 984 euros, et celui après décote à 98 euros.
Avant décote, le taux marginal d’imposition s’établit à 14 % : 100 euros de revenu imposable supplémentaire se traduit par une hausse d’impôt de 14 euros (984 – 970).
Après décote, le taux marginal d’imposition est porté à 28 % : 100 euros de revenu imposable supplémentaire aboutit à une hausse d’impôt de 28 euros (98 – 70).
Il convient toutefois de souligner que cette accentuation de la pente d’imposition a été associée à un fort allégement de l’imposition due, en raison du renforcement de la décote et de la suppression de la tranche à 5,5 %. Même si la progression de l’imposition en fonction de celle des revenus est plus rapide qu’auparavant, du fait d’une pente de la décote plus raide, le contribuable retire systématiquement un gain de la réforme, en s’acquittant toujours d’un impôt moindre.
Ainsi, pour reprendre l’exemple 2, en conservant le dispositif de la décote applicable aux revenus de 2013, l’imposition due pour un niveau de revenu de 40 000 euros se serait établie à 947 euros (970 × 1,5 – 508), au lieu de 70 euros avec la décote réformée. Le gain est donc de 877 euros.
Certes, le taux marginal d’imposition dans le cadre de la précédente décote ne serait que de 14 %, ce qui porterait, pour un revenu de 45 111 euros, l’imposition due à 961 euros. Dans le cadre de la décote réformée, l’imposition se limite toutefois à 98 euros, même après application d’un taux marginal d’imposition de 28 %. Le gain retiré de la réforme reste très significatif, en s’élevant à 863 euros.
● La réforme proposée procède à une « dépentification » de la décote, et parvient à une situation intermédiaire entre le dispositif applicable avant la réforme de la loi de finances pour 2015 et celui qui en est issu.
La décote issue du présent article se présenterait sous la forme suivante :
Impôt dû = impôt initial – (1 165 ou 1 920 – 0,75 × impôt initial)
Ou encore : Impôt dû = 1,75 × impôt initial – 1 165 ou 1 920
Le taux marginal d’imposition serait donc multiplié par 1,75 dans le cadre de la décote, au lieu de 2 pour l’imposition des revenus de 2014 et de 1,5 pour celle des revenus de 2013. Ainsi, la décote porterait à 24,5 % le taux d’imposition marginal des foyers fiscaux qui, avant décote, relèvent du taux marginal de 14 %.
Exemple 3 : un couple perçoit en 2015 des revenus salariaux de 35 000 euros. Son impôt dû avant décote s’établirait à 1 694 euros en 2016. Son impôt après décote serait égal à 1 044,50 euros, soit 1 045 euros compte tenu de l’arrondi (1,75 × 1 694 – 1 920).
Si ce même couple percevait des revenus de 35 111 euros, son impôt dû avant décote s’établirait à 1 708 euros, et celui après décote à 1 069 euros.
Avant décote, le taux marginal d’imposition s’établit à 14 % : 100 euros de revenu imposable supplémentaire se traduit par une hausse d’impôt de 14 euros (1 708 – 1 694).
Après décote, le taux marginal d’imposition est porté à 24,5 % : 100 euros de revenu imposable supplémentaire aboutit à une hausse d’impôt de 24,50 euros (1 069 – 1 044,5).
Le dispositif proposé permet ainsi d’adoucir la pente d’imposition découlant de la décote, tout en allégeant, dans toutes les configurations de foyer et quel que soit le niveau de revenu, l’imposition due.
Les graphiques ci-dessous permettent de constater visuellement la « dépentification » ainsi opérée par rapport à l’impôt sur le revenu de 2015, ainsi que le gain retiré de la réforme. Pour tous les niveaux de revenus, l’impôt acquitté en application du barème et de la décote est moindre en 2015 et en 2016, par rapport à 2014 et 2013.
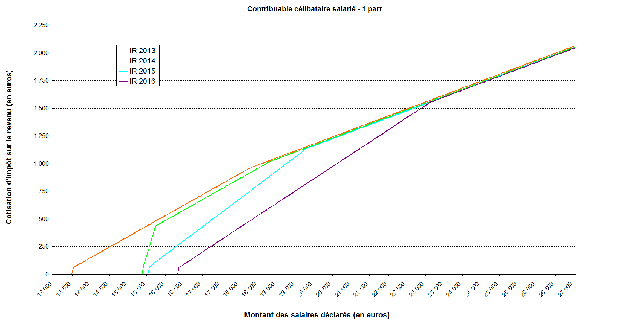
IMPÔT SUR LE REVENU ACQUITTÉ EN 2013, 2014, 2015 ET 2016
EN FONCTION DE SES REVENUS PAR UN CÉLIBATAIRE
IMPÔT SUR LE REVENU ACQUITTÉ EN 2013, 2014, 2015 ET 2016 EN FONCTION DE SES REVENUS PAR UN COUPLE
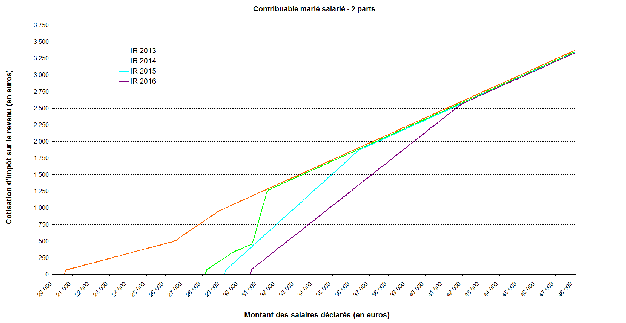
IMPÔT SUR LE REVENU ACQUITTÉ EN 2013, 2014, 2015 ET 2016
EN FONCTION DE SES REVENUS PAR UN COUPLE AVEC DEUX ENFANTS
● Le coût budgétaire de la réforme est chiffré à 2,1 milliards d’euros pour l’année 2016 et les années suivantes. Cette somme correspond au montant des pertes de recettes d’impôt sur le revenu pour l’État, et se répartit entre 100 millions d’euros au titre de l’indexation du barème sur l’inflation, et 2 milliards d’euros au titre de la réforme de la décote.
En revanche, les pertes de recettes pour les collectivités territoriales, au titre de l’indexation du barème sur l’inflation, ne font l’objet d’aucun chiffrage par l’évaluation préalable du présent article. En effet, la revalorisation des plafonds de RFR mentionnés aux articles 1414 A et 1417 du CGI, qui déterminent les conditions d’exonération et d’abattement au titre de la taxe d’habitation et de la taxe foncière, se traduit par des moindres recettes pour les collectivités territoriales dès lors que certains des régimes dérogatoires applicables ne font pas l’objet de compensation par l’État. Les effets de l’indexation du barème à cet égard ne sont donc pas connus, même si l’on peut supposer qu’ils sont limités, compte tenu de la faiblesse du taux d’inflation.
Il convient d’observer que, depuis la loi de financement de la sécurité sociale pour 2015 (37), le bénéfice du taux réduit de CSG et de l’exonération de contribution additionnelle de solidarité pour l’autonomie (CASA) applicables aux revenus de remplacement est désormais conditionné au respect de plafonds de RFR en année N – 2, définis par l’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale, et non plus au fait d’être non imposable l’année précédente. De ce fait, la hausse du nombre de foyers non imposables résultant de la présente réforme n’aura pas d’incidence sur les recettes de la sécurité sociale. Par ailleurs, les plafonds définis par l’article L. 136-8, à la différence de ceux prévus par les articles 1414 A et 1417 du CGI, ne sont pas indexés annuellement comme la limite supérieure de la première tranche de l’impôt sur le revenu, mais se voient appliquer un mécanisme distinct (38).
● La présente réforme se traduit par une hausse significative du coût budgétaire de la décote, qui devrait s’établir à 5,53 milliards d’euros au titre de l’année 2016. Ce coût avait d’ores et déjà enregistré une nette hausse en 2015, en passant à 3,6 milliards d’euros, contre 2,2 milliards d’euros en 2013. En trois années, le coût de la décote devrait ainsi être multiplié par 2,5.
Parallèlement, le gain moyen retiré par les contribuables se trouvant dans son champ a aussi plus que doublé, ce qui découle du plus fort allégement d’imposition qu’elle occasionne.
ÉVOLUTION DU COÛT ET DU CHAMP D’APPLICATION DE LA DÉCOTE
Année |
IR 2012 |
IR 2013 |
IR 2014 |
IR 2015 (prévisions) |
IR 2016 (simulations) |
Nombre de foyers fiscaux bénéficiant de la décote (en millions) |
11,75 |
12,135 |
12,68 |
10,4 |
13,177 |
Gain moyen (en euros) |
169 |
179 |
289 |
349 |
426 |
Coût budgétaire (en milliards d’euros) |
1,99 |
2,17 |
3,61 |
3,6 |
5,53 |
NB : au titre de l’impôt 2014, le coût et le nombre de foyers fiscaux bénéficiaires correspond à la fois à la décote et à la réduction d’impôt exceptionnelle introduite en première LFR 2014, puisque leurs effets ne peuvent être dissociés.
Source : direction générale des finances publiques.
● L’évaluation préalable du présent article indique que la réforme de la décote bénéficiera à 8 millions de foyers fiscaux, pour un gain moyen de 252 euros.
Selon les simulations transmises par le Gouvernement, les foyers fiscaux concernés par la réforme se répartiraient comme suit :
– 1,13 million de foyers fiscaux qui deviennent non imposés ou évitent d’entrer dans l’impôt, et dont le gain moyen s’établirait à 208 euros ;
– 6,9 millions de foyers fiscaux imposés, qui bénéficient d’un allégement de leur imposition, pour un gain moyen de 262 euros.
En tout état de cause, la réforme de la décote ne fait aucun perdant.
La décote telle qu’issue de la présente réforme concernerait 13,2 millions de foyers fiscaux en 2016, contre 10,4 millions en 2015. Ces 13,2 millions de foyers fiscaux bénéficiaires se répartiraient ainsi :
– 5,92 millions de foyers fiscaux seraient non imposés sous l’effet de la décote, pour un gain moyen de 463 euros ;
– 6,42 millions de foyers fiscaux imposés verraient leur impôt décroître, pour un montant moyen de 402 euros ;
– 0,836 million de foyers bénéficieraient d’une restitution majorée, pour un gain de 354 euros.
● Le tableau suivant procède à la répartition des foyers fiscaux bénéficiaires de la réforme au sein des déciles de RFR de l’ensemble des foyers fiscaux, avec, pour chacun de ces déciles, le montant moyen du gain.
Environ 4,75 millions de foyers fiscaux, soit environ 60 % du total, relèvent des quatrième à sixième déciles, et 1,6 million de foyers fiscaux appartiennent au huitième décile. Là encore, la ventilation des foyers fiscaux par décile de RFR ne prend pas en compte le nombre de parts au sein du foyer fiscal. C’est la raison pour laquelle un nombre significatif de foyers fiscaux concernés par la mesure relève du huitième décile : ces derniers correspondent pour l’essentiel aux couples avec plusieurs enfants.
RÉPARTITION DES BÉNÉFICIAIRES DE LA MESURE DÉCOTE PAR DÉCILES DE RFR
DE L’ENSEMBLE DES FOYERS FISCAUX
Borne inférieure (en euros) |
Borne supérieure (en euros) |
Déciles des foyers fiscaux (en nombre de foyers) |
Déciles des foyers fiscaux gagnants (en nombre de foyers) |
Gain moyen en émission (en euros) |
0 |
3 443 |
3 698 963 |
– |
– |
3 443 |
9 025 |
3 698 963 |
– |
– |
9 025 |
12 964 |
3 698 963 |
– |
– |
12 964 |
16 262 |
3 698 963 |
1 534 554 |
202 |
16 262 |
19 465 |
3 698 963 |
2 062 380 |
251 |
19 465 |
24 129 |
3 698 963 |
1 159 193 |
149 |
24 129 |
29 804 |
3 698 963 |
822 109 |
253 |
29 804 |
38 069 |
3 698 963 |
1 596 579 |
343 |
38 069 |
53 058 |
3 698 963 |
787 974 |
318 |
53 058 |
– |
3 698 963 |
64 157 |
268 |
Total |
36 989 630 |
8 026 946 |
252 | |
Source : logiciel Orison. Échantillon des revenus de 2013 et, majoritairement, 2014, vieillis 2015. Environnement LF 2015 sans PPE, indexation barème et seuils de 0,1%.
Le tableau ci-après présente la ventilation des seuls foyers fiscaux bénéficiaires de la réforme par décile de RFR, ainsi que le gain moyen pour chacun de ces déciles :
RÉPARTITION DES BÉNÉFICIAIRES DE LA RÉFORME DÉCOTE
PAR DÉCILES DE RFR
Borne inférieure (en euros) |
Borne supérieure (en euros) |
Déciles des foyers fiscaux gagnants (en nombre de foyers) |
Gain moyen en émission (en euros) |
– |
15 125 |
802 695 |
172 |
15 125 |
16 327 |
802 695 |
237 |
16 327 |
17 581 |
802 695 |
279 |
17 581 |
18 883 |
802 695 |
261 |
18 883 |
20 137 |
802 695 |
149 |
20 137 |
24 569 |
802 695 |
159 |
24 569 |
30 052 |
802 695 |
265 |
30 052 |
34 265 |
802 695 |
403 |
34 265 |
38 510 |
802 695 |
286 |
38 510 |
– |
802 695 |
310 |
Total |
8 026 950 |
252 | |
Source : logiciel Orison. Échantillon des revenus de 2013 et, majoritairement, 2014, vieillis 2015. Environnement LF 2015 sans PPE, indexation barème et seuils de 0,1 %.
● Il convient toutefois de rappeler que la prime pour l’emploi (PPE) a été supprimée à compter de l’imposition des revenus de 2015 par la dernière loi de finances rectificative pour 2014 (39). La ventilation par décile des bénéficiaires de la présente réforme est effectuée par rapport à un environnement fiscal intégrant cette suppression ; pour autant, compte tenu des restitutions d’imposition que la PPE occasionne et de ses effets sur l’entrée des contribuables dans l’imposition, il serait utile de disposer d’un bilan d’ensemble de ces deux réformes, en termes de nombre de foyers fiscaux gagnants et perdants, du strict point de vue de l’impôt sur le revenu.
De fait, une partie des bénéficiaires actuels de la PPE sera éligible, à compter du 1er janvier 2016, à la prime d’activité, nouvelle prestation qui vient remplacer à la fois la PPE et le revenu de solidarité active (RSA) dans son volet « activité ». Ainsi, des contribuables qui ne bénéficieront plus d’une restitution au titre de la PPE en 2016 pourront voir leur perte plus que compensée par le versement de la prime d’activité – qui, du fait de son mode de calcul, s’avère toujours plus élevée que la PPE. Néanmoins, alors que la PPE est quasi automatiquement versée à ses bénéficiaires, du fait de son adossement à la déclaration des revenus (40), le versement de la prime d’activité nécessite une démarche de la part de ses potentiels bénéficiaires. L’étude d’impact du projet de loi relatif au dialogue social et à l’emploi (41) posait comme hypothèse un taux de recours à la prime d’activité de l’ordre de 50 %, lequel a été estimé à partir du taux de recours du RSA-activité, lui-même chiffré à environ 32 %. Il est donc probable qu’une partie des anciens bénéficiaires de la PPE ne percevront pas la nouvelle prestation, alors qu’ils y seraient éligibles, simplement parce qu’ils n’auront pas effectué les démarches nécessaires.
En pratique, compte tenu des plafonds de revenus d’activité et de RFR des contribuables bénéficiaires de la PPE, ces derniers sont le plus souvent non imposés : la PPE se traduit, pour plus de 80 % de son montant, par des restitutions de la part du Trésor public. Sur les 5 millions de foyers bénéficiaires en 2015, environ 4,5 millions de foyers fiscaux ont perçu la PPE sous forme de restitution, soit pour sa totalité, soit en partie – les 500 000 foyers fiscaux restants voyant leur imposition minorée par la PPE.
Pour tous les contribuables percevant la totalité de leur PPE sous forme de restitution, soit la grande majorité des 4,5 millions précités, la réforme de la décote ne permet pas de compenser la suppression de la PPE : les contribuables non imposés en 2015 resteront non imposés en 2016, mais ne recevront plus de chèque du Trésor public.
En revanche, la présente réforme permet de compenser une partie, voire la totalité de la perte occasionnée par la suppression de la PPE, pour les contribuables imposables dont l’impôt était soit minoré, soit annulé par la PPE.
Au-delà de l’impact global de la réforme, il apparaît utile de présenter ses incidences en fonction de la configuration des foyers fiscaux et de leurs niveaux de revenus.
Les tableaux ci-dessous visent à retracer les conséquences de la réforme pour un célibataire, un couple sans enfant et un couple avec deux enfants. Ils permettent de constater que le gain maximal retiré de la réforme s’établit à environ 315 euros pour un célibataire et à 520 euros pour un couple.
● Pour un contribuable célibataire, l’entrée dans l’impôt sur le revenu interviendrait à compter d’un revenu mensuel net de 1 315 euros en 2016, au lieu de 1 250 euros en 2015 (sans prise en compte de la PPE). Le gain retiré de la réforme croîtrait régulièrement à partir de ce revenu mensuel de 1 250 euros, pour atteindre son montant maximal, soit 317 euros, pour un revenu mensuel de 1 590 euros, soit 1,4 SMIC – qui correspond d’ailleurs au point de sortie de la décote actuellement en vigueur.
Le gain obtenu décroîtrait ensuite régulièrement, pour devenir nul pour un salaire mensuel de 1 860 euros, soit 1,63 SMIC, qui correspond au point de sortie de la décote telle qu’issue de la réforme.
En posant comme hypothèse que le contribuable bénéficie de la PPE au titre de l’imposition de ses revenus de 2014, la moindre imposition résultant de la réforme proposée vient partiellement compenser la suppression de la PPE pour des revenus mensuels nets compris entre 1 250 euros et de 1 315 euros, pour la compenser ensuite totalement. C’est à partir de ce montant de revenus de 1 315 euros que le contribuable percevant la PPE en 2015 retire un gain net de la réforme.
EFFETS DE LA RÉFORME POUR UN CÉLIBATAIRE (UNE PART)
(en euros)
Revenu déclaré (revenu mensuel net) |
IR 2015 |
IR 2015 avec bénéfice de la PPE |
IR 2016 |
Gain à la réforme sans prise en compte de la PPE |
Gain ou perte à la réforme avec prise en compte de la PPE |
14 000 (1 126 euros/mois) |
0 |
-666 |
0 |
0 |
– 666 |
15 520 (1 248 euros/mois, soit 1,1 SMIC) Entrée dans l’IR pour IR 2015 |
63 |
– 310 |
0 |
63 |
– 310 |
15 600 (1 254 euros/mois) |
83 |
– 274 |
0 |
83 |
– 274 |
16 000 (1 286 euros/mois) |
184 |
– 97 |
0 |
184 |
– 97 |
16 300 (1 311 euros/mois) |
259 |
37 |
0 |
259 |
37 |
16 350 (1 315 euros /mois soit 1,16 SMIC) Entrée dans l’IR pour IR 2016 |
273 |
61 |
64 |
272 |
– 3 |
16 500 (1 327 euros/mois) |
309 |
125 |
97 |
212 |
28 |
17 000 (1 367 euros/mois) |
435 |
348 |
207 |
228 |
141 |
17 500 (1 407 euros/mois) |
561 |
561 |
317 |
244 |
244 |
18 500 (1 487 euros/mois) |
813 |
813 |
538 |
275 |
275 |
19 500 (1 568 euros/mois) |
1 065 |
1065 |
758 |
307 |
307 |
19 766 (1 589 euros/mois, soit 1,4 SMIC) Sortie de la décote pour l’IR 2015 |
1 134 |
1 134 |
817 |
317 |
317 |
21 000 (1 688 euros/mois) |
1 289 |
1 289 |
1 089 |
200 |
200 |
22 000 (1 769 euros/mois) |
1 415 |
1 415 |
1 310 |
106 |
106 |
23 000 (1 849 euros/mois) |
1 541 |
1 541 |
1 530 |
11 |
11 |
23 103 (1 858 euros/mois, soit 1,63 SMIC) Sortie de la décote pour l’IR 2016 |
1 554 |
1 554 |
1 553 |
1 |
1 |
24 000 (1 930 euros/mois) |
1 667 |
1 667 |
1 666 |
1 |
1 |
NB : compte tenu de la faiblesse de l’inflation, estimée à 0,1 % pour l’année 2015, le calcul de l’imposition pour 2015 et 2016 a été réalisé à revenus constants.
Source : commission des finances.
GAIN RÉSULTANT DE LA RÉFORME POUR UN CÉLIBATAIRE
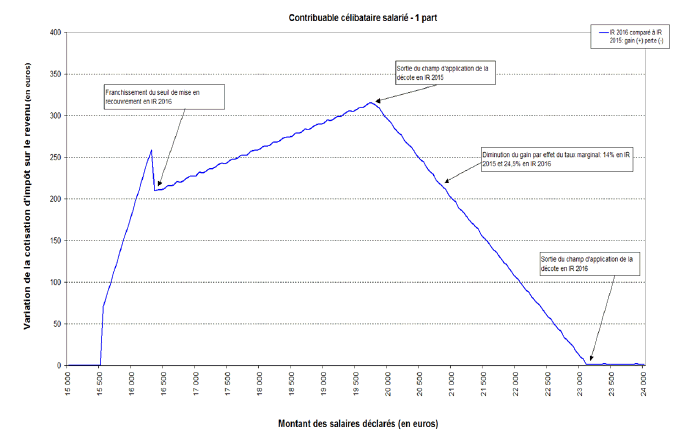
Source : direction générale des finances publiques.
● À compter de 2016, un couple devrait devenir imposable à compter de revenus mensuels nets de 2 455 euros, contre 2 350 euros en 2015 (sans prise en compte de la PPE). Le bénéfice qu’il retirerait de la réforme serait maximal, à hauteur de 523 euros, pour un niveau de revenu mensuel de 2 920 euros, soit 2,6 SMIC, et il décroîtrait progressivement pour s’annuler pour un revenu mensuel net de 3 370 euros, soit le point de sortie de la décote ainsi réformée.
En posant comme hypothèse que les revenus du couple sont répartis également et qu’ils bénéficient tous deux de la PPE au titre de l’imposition de leurs revenus de 2014, il apparaît que la moindre imposition résultant de la réforme proposée vient partiellement compenser la suppression de la PPE pour des revenus mensuels nets compris entre 2 350 euros et 2 650 euros. Au-delà de revenus de 2 650 euros, le couple qui perçoit la PPE en 2015 retire un gain net de la réforme.
EFFETS DE LA RÉFORME POUR UN COUPLE (DEUX PARTS)
(en euros)
Revenu déclaré (revenu mensuel net) |
IR 2015 |
IR 2015 avec bénéfice de la PPE (pour des revenus également répartis) |
IR 2016 |
Gain à la réforme sans prise en compte de la PPE |
Gain ou perte à la réforme avec prise en compte de la PPE |
28 000 (2 251 euros/mois) |
0 |
– 1 332 |
0 |
0 |
– 1 332 |
29 200 (2 348 euros/mois, soit 2,07 SMIC) Entrée dans l’IR pour IR 2015 |
62 |
– 1 038 |
0 |
62 |
– 1 038 |
30 000 (2 412 euros/mois) |
264 |
– 682 |
0 |
264 |
– 682 |
30 540 (2 455 euros/mois, soit 2,16 SMIC) Entrée dans l’IR pour l’IR 2016 |
400 |
– 442 |
61 |
339 |
– 503 |
32 000 (2 573 euros/mois) |
768 |
208 |
383 |
385 |
– 175 |
33 000 (2 653 euros/mois) |
1 020 |
652 |
604 |
417 |
49 |
35 000 (2 814 euros/mois) |
1 524 |
1 524 |
1 045 |
480 |
480 |
36 367 (2 924 euros/mois, soit 2,6 SMIC) Sortie de la décote pour l’IR 2015 |
1 869 |
1 869 |
1 346 |
523 |
523 |
37 000 (2 975 euros/mois) |
1 949 |
1 949 |
1 486 |
464 |
464 |
39 000 (3 136 euros/mois) |
2 201 |
2 201 |
1 927 |
275 |
275 |
41 000 (3 296 euros/mois) |
2 453 |
2 453 |
2 368 |
86 |
86 |
41 873 (3 367 euros/mois soit 2,96 SMIC) Sortie de la décote pour l’IR 2016 |
2 563 |
2 563 |
2 560 |
3 |
3 |
42 000 (3 377 euros/mois) |
2 579 |
2 579 |
2 576 |
3 |
3 |
Source : commission des finances.
GAIN RÉSULTANT DE LA RÉFORME POUR UN COUPLE SANS ENFANT
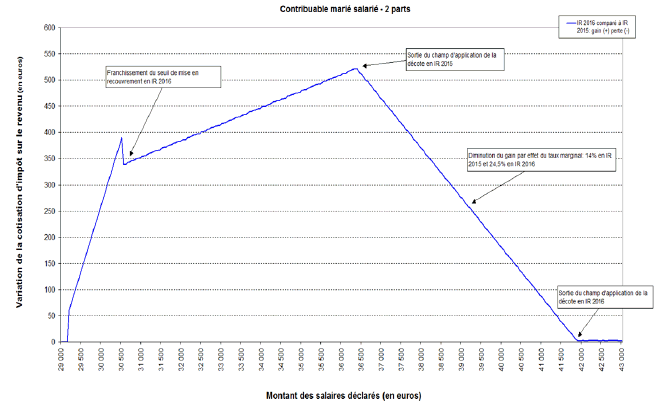
Source : direction générale des finances publiques.
● À compter de 2016, un couple avec deux enfants devrait devenir imposable à compter de revenus mensuels nets de 3 330 euros, contre 3 216 euros en 2015. Le bénéfice qu’il retirerait de la réforme serait maximal, à hauteur de 525 euros, pour un niveau de revenu mensuel de 3 790 euros, soit 2,6 SMIC, et il décroîtrait progressivement pour s’annuler pour un revenu mensuel net de 4 230 euros, soit 3,7 SMIC – qui correspond au point de sortie de la décote ainsi réformée.
COUPLE AVEC DEUX ENFANTS (TROIS PARTS)
(en euros)
Revenu déclaré |
IR 2015 |
IR 2015 avec PPE |
IR 2016 |
Gain à la réforme |
Gain ou perte à la réforme avec prise en compte PPE |
30 000 (2 412 euros/mois) |
0 |
– 1 018 |
0 |
0 |
– 1 018 |
34 000 (2 734 euros/mois) |
0 |
– 246 |
0 |
0 |
– 246 |
38 000 (3 055 euros/mois) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 000 (3 216 euros/mois, soit 2,85 SMIC) Entrée dans l’IR pour IR 2015 |
70 |
70 |
0 |
70 |
70 |
41 000 (3 296 euros/mois) |
322 |
322 |
0 |
322 |
322 |
41400 (3 329 euros/mois, soit 2,92 SMIC) Entrée dans l’IR pour IR 2016 |
423 |
423 |
79 |
344 |
344 |
43 000 (3 457 euros/mois) |
826 |
826 |
432 |
394 |
394 |
45 000 (3 618 euros/mois) |
1 330 |
1 330 |
873 |
457 |
457 |
47 000 (3 779 euros/mois) |
1 834 |
1 834 |
1 314 |
520 |
520 |
47 133 (3 790 euros/mois, soit 3,33 SMIC) Sortie de la décote pour l’IR 2015 |
1 869 |
1 869 |
1 343 |
525 |
525 |
48 000 (3 859 euros/mois) |
1 978 |
1 978 |
1 535 |
444 |
444 |
50 000 (4 020 euros/mois) |
2 230 |
2 230 |
1 976 |
255 |
255 |
52 650 (4 233 euros/mois, soit 3,7 SMIC) Sortie de la décote pour l’IR 2016 |
2 564 |
2 564 |
2 560 |
– 4 |
– 4 |
54 000 (4 342 euros/mois) |
2 734 |
2 734 |
2 730 |
– 4 |
– 4 |
Source : commission des finances.
GAIN RÉSULTANT DE LA RÉFORME POUR UN COUPLE AVEC DEUX ENFANTS
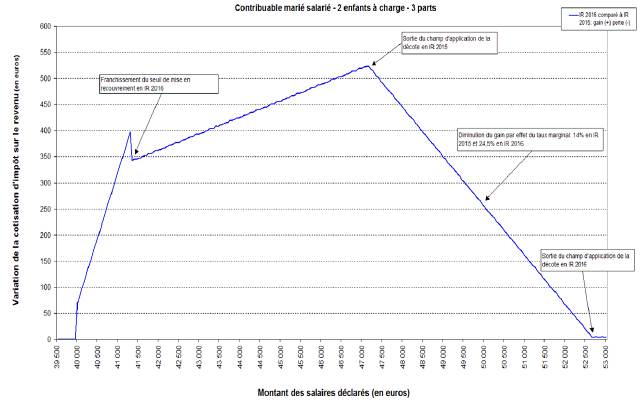
Source : direction générale des finances publiques.
D. QUELQUES ÉCLAIRAGES SUR L’ÉVOLUTION DE L’IMPÔT ACQUITTÉ ENTRE 2012 ET 2016 PAR DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE MÉNAGES
Il apparaît utile de mettre en perspective l’impact de la présente réforme et des précédentes mesures d’allégement, en présentant l’évolution de l’impôt sur le revenu acquitté par quelques catégories de ménages, en fonction de leur niveau de revenu, au cours des quatre dernières années. Cela permet d’apprécier les effets conjugués des mesures ayant conduit à accroître l’imposition depuis 2012, telles que la fiscalisation des majorations de pension ou de la participation employeur aux complémentaires santé (42), et de celles qui viennent la réduire.
● Pour un contribuable retraité de plus de soixante-cinq ans, le tableau suivant permet de constater que l’impôt acquitté enregistre une nette baisse pour des niveaux de revenus annuels inférieurs à 22 000 euros ; la hausse d’imposition entre 2012 et 2013 résultant du gel du barème est ainsi plus que compensée par la suite par les mesures d’allégement. En revanche, ces dernières ne produisent plus d’effet pour des revenus annuels de 24 000 euros et au-delà.
EVOLUTION DE L’IMPÔT ACQUITTÉ EN FONCTION DES REVENUS PAR UN CÉLIBATAIRE RETRAITÉ PLUS DE SOIXANTE-CINQ ANS (en euros) | |||||
Niveau de revenu déclaré |
IR 2012 |
IR 2013 |
IR 2014 |
IR 2015 |
IR 2016 |
Niveau de revenus correspondant à l’entrée dans l’IR |
15 800 |
16 060 |
16 668 |
16 815 |
17 650 |
16 000 |
333 |
352 |
0 |
0 |
0 |
18 000 |
711 |
738 |
720 |
511 |
277 |
20 000 |
1 019 |
1 069 |
1 078 |
1 031 |
732 |
22 000 |
1 271 |
1 326 |
1 337 |
1 344 |
1 189 |
24 000 |
1 523 |
1 584 |
1 596 |
1 604 |
1 606 |
Source : commission des finances | |||||
● Si ce contribuable retraité a eu trois enfants et bénéficie à ce titre d’une majoration de pension, la fiscalisation de cette dernière (43) à compter de l’imposition des revenus de 2013 se traduit par un ressaut d’imposition en 2014. Pour certains niveaux de revenus, cette hausse est partiellement compensée par l’allégement d’impôt intervenu en 2015 puis elle devrait l’être totalement par la baisse de l’impôt dû à compter de 2016. Ainsi, si ce contribuable a perçu une pension annuelle de 18 000 euros en 2011, son impôt est passé de 711 euros en 2012 à 1 052 euros en 2014, sous l’effet de la mesure. En revanche, son impôt a commencé à décroître en 2015, et il devrait repasser en deçà de son niveau de 2012 sous l’effet de la présente réforme, pour s’établir à 686 euros en 2016.
Pour une pension annuelle de 19 000 euros, la hausse d’imposition enregistrée en 2014 n’est pas compensée en 2015, mais devrait l’être par la présente réforme, en 2016.
En revanche, les effets de la fiscalisation des majorations de pension ne sont que partiellement palliés par les mesures d’allégements lorsque les revenus du contribuable atteignent 20 000 euros, et ils ne le sont plus au-delà.
ÉVOLUTION DE L’IMPÔT ACQUITTÉ EN FONCTION DES REVENUS PAR UN CÉLIBATAIRE RETRAITÉ AYANT EU PLUS DE TROIS ENFANTS (HORS EFFET DE LA DEMI-PART « VIEUX PARENTS ») (en euros) | |||||
Niveau de revenu déclaré |
IR 2012 |
IR 2013 |
IR 2014 |
IR 2015 |
IR 2016 |
14 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 000 |
333 |
352 |
642 |
407 |
186 |
18 000 |
711 |
738 |
1 052 |
979 |
687 |
19 000 |
893 |
931 |
1 195 |
1 200 |
938 |
20 000 |
1 019 |
1 069 |
1 337 |
1 344 |
1 189 |
22 000 |
1 271 |
1 326 |
1 622 |
1 630 |
1 631 |
24 000 |
1 523 |
1 584 |
2 070 |
2 081 |
2 083 |
Source : commission des finances. | |||||
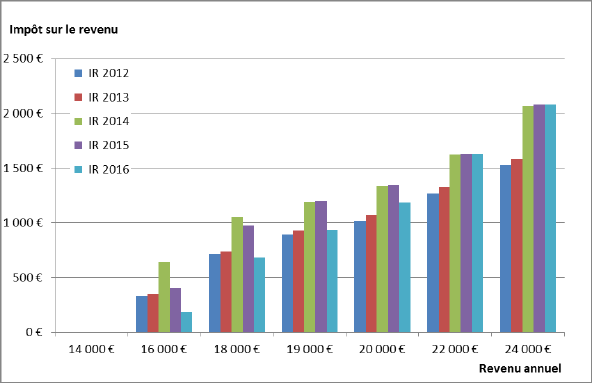
● Si l’on prend le cas d’un couple marié avec deux enfants, dont les conjoints sont tous deux actifs et éligibles à la PPE, le tableau ci-dessous permet de constater la très nette diminution de leur imposition entre 2012 et 2016, jusqu’à des niveaux de revenus de 47 000 euros, après la hausse résultant du gel du barème – hors effet de la suppression de la PPE.
En revanche, s’ils perçoivent des revenus élevés, leur imposition s’est accrue sous l’effet du gel, mais aussi des abaissements du plafond de l’avantage retiré du quotient familial, et ils ne bénéficient pas des mesures d’allégement instaurées depuis 2014.
Il convient par ailleurs de noter que la suppression de la prime pour l’emploi, à compter de 2016, se traduit par une perte de la restitution afférente pour les contribuables concernés. Ces derniers sont toutefois, pour une partie d’entre eux, éligibles à la nouvelle prime d’activité, qui vient remplacer à compter du 1er janvier 2016 la PPE et le RSA activité.
ÉVOLUTION DE L’IMPÔT ACQUITTÉ EN FONCTION DES REVENUS PAR UN COUPLE MARIÉ AVEC DEUX ENFANTS (en euros) | |||||
Niveau de revenu déclaré (réparti à égalité entre les deux conjoints) |
IR 2012 |
IR 2013 |
IR 2014 |
IR 2015 |
IR 2016 |
Seuil d’entrée dans l’imposition |
26 614 |
27 160 |
37 117 |
39 959 |
41 317 |
27 000 |
– 1 508 |
– 1 405 |
– 1 450 |
– 1 424 |
0 |
30 000 |
– 706 |
– 586 |
– 856 |
– 826 |
0 |
32 000 |
– 171 |
– 40 |
– 458 |
– 426 |
0 |
35 000 |
684 |
694 |
0 |
0 |
0 |
37 000 |
833 |
846 |
128 |
0 |
0 |
40 000 |
1 023 |
1 123 |
1 132 |
406 |
73 |
42 000 |
1 275 |
1 380 |
1 392 |
926 |
529 |
45 000 |
1 653 |
1 766 |
1 780 |
1 708 |
1 214 |
47 000 |
1 905 |
2 023 |
2 039 |
2 049 |
1 670 |
50 000 |
2 283 |
2 409 |
2 428 |
2 440 |
2 354 |
100 000 |
11 195 |
12 407 |
13 539 |
13 605 |
13 638 |
200 000 |
42 413 |
44 561 |
45 949 |
46 178 |
46 243 |
Source : commission des finances. |
|||||
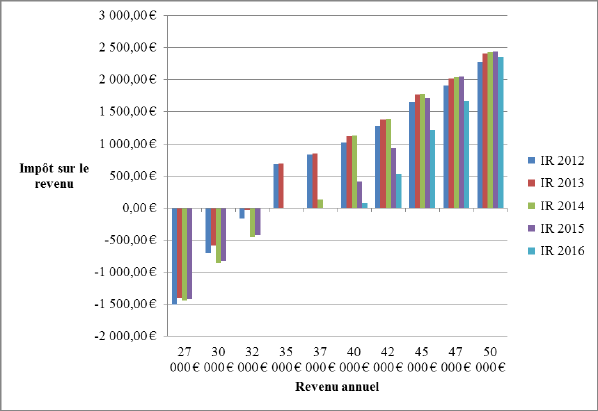
Si ce couple est composé de deux salariés du secteur privé affiliés à une complémentaire santé collective faisant l’objet d’une participation de leur employeur, on peut poser comme hypothèse que la fiscalisation de cette part employeur à compter de l’imposition des revenus de 2013 se traduit par une hausse de leur revenu imposable de l’ordre de 1 000 euros en 2014. Cette mesure occasionne un accroissement de leur imposition en 2014 pour des revenus de 40 000 euros et au-delà, lequel est toutefois rattrapé en totalité dès 2015 jusqu’à des revenus de 42 000 euros. Elle est totalement compensée en 2016 pour des niveaux de revenus allant jusqu’à 47 000 euros, mais ne l’est plus au-delà.
EVOLUTION DE L’IMPÔT ACQUITTÉ EN FONCTION DES REVENUS PAR UN COUPLE MARIÉ AVEC DEUX ENFANTS SE TROUVANT DANS LE CHAMP DE LA FISCALISATION DE LA PART EMPLOYEUR DES COMPLÉMENTAIRES SANTÉ
(en euros)
Niveau de revenu déclaré (réparti à égalité entre les deux conjoints) |
IR 2012 |
IR 2013 |
IR 2014 |
IR 2015 |
IR 2016 |
Seuil d’entrée dans l’imposition hors effet de la PPE |
26 614 |
27 160 |
37 117 |
39 959 |
41 317 |
27 000 |
– 1 508 |
– 1 405 |
– 1 258 |
– 1 230 |
0 |
30 000 |
– 706 |
– 586 |
– 662 |
– 632 |
0 |
32 000 |
– 171 |
– 40 |
– 266 |
– 234 |
0 |
35 000 |
684 |
694 |
0 |
0 |
0 |
37 000 |
833 |
846 |
679 |
0 |
0 |
40 000 |
1 023 |
1 123 |
1 258 |
658 |
294 |
42 000 |
1 275 |
1 380 |
1 518 |
1 178 |
750 |
45 000 |
1 653 |
1 766 |
1 906 |
1 915 |
1 435 |
47 000 |
1 905 |
2 023 |
2 165 |
2 175 |
1 891 |
50 000 |
2 283 |
2 409 |
2 554 |
2 566 |
2 568 |
52 000 |
2 535 |
2 666 |
2 813 |
2 826 |
2 829 |
55 000 |
2 913 |
3 051 |
3 202 |
3 217 |
3 220 |
100 000 |
11 195 |
12 407 |
13 809 |
13 875 |
13 908 |
200 000 |
42 143 |
44 561 |
46 318 |
46 547 |
46 613 |
Source : commission des finances.
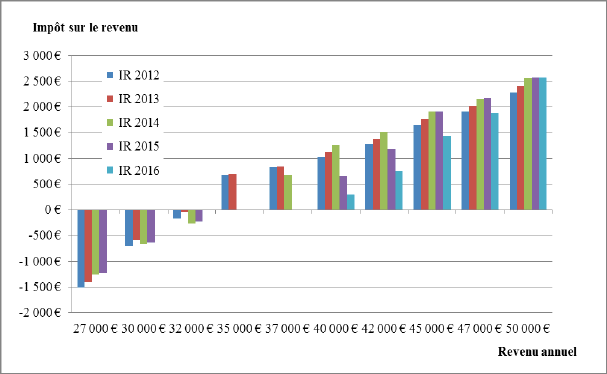
*
* *
La commission examine, en discussion commune, l’amendement I-CF 103 de M. Charles de Courson et l’amendement I-CF 163 de M. Nicolas Sansu.
M. Charles de Courson. Je propose de revaloriser les limites des tranches de l’impôt sur le revenu et de la décote du taux de l’inflation, soit 1 %.
M. Gaby Charroux. Notre amendement est un amendement de principe : nous souhaitons une plus grande progressivité de l’impôt.
Le même principe est aussi affirmé dans l’amendement I-CF 166 qui suit, visant à créer une nouvelle tranche d’imposition pour la fraction des revenus supérieure à 300 000 euros.
Mme la Rapporteure générale. Votre amendement, monsieur de Courson, vise à indexer le barème de l’impôt sur le revenu sur le taux d’inflation prévu pour 2016. Or, le taux qui importe pour l’impôt sur le revenu est celui de l’année 2015, puisque ce sont les revenus de 2015 qui sont imposés. Par ailleurs, le présent article rehausse de 2,6 % les seuils de la décote, soit bien au-delà de l’inflation. Avis défavorable, donc.
Avis défavorable également à l’amendement I-CF 163. Plusieurs réformes ont déjà conduit à renforcer la progressivité de l’impôt sur le revenu, telles que la création de la tranche à 45 % et le plafonnement global des niches fiscales à 10 000 euros. En outre, la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, dite « surtaxe Fillon », continue de s’appliquer.
La commission rejette successivement les deux amendements.
Suivant l’avis défavorable de la Rapporteure générale, elle rejette également l’amendement I-CF 166 de M. Nicolas Sansu.
Elle examine ensuite l’amendement I-CF 65 de M. Hervé Mariton.
M. Hervé Mariton. Cet amendement vise à demander au Gouvernement un rapport sur l’impact des mesures affectant la base imposable de l’impôt sur le revenu, notamment en termes de concentration de celui-ci, qui est une préoccupation de notre groupe.
Mme la Rapporteure générale. Cette préoccupation est tout à fait légitime, mais il me semble inutile de multiplier les documents. Vous trouverez dans mon rapport des données, reprises en grande partie de celles fournies par le ministère des finances, qui vous éclaireront. Avis défavorable.
La commission rejette l’amendement I-CF 65.
Elle examine ensuite l’amendement I-CF 69 du président Gilles Carrez.
M. le président Gilles Carrez. Cet amendement vise à demander au Gouvernement un rapport détaillant l’impact de l’aménagement du mécanisme de la décote. Un point en particulier nous intéresse : l’effet dissuasif sur l’augmentation d’activité – et non pas seulement sur la reprise d’activité – d’un taux de prélèvement marginal trop important.
Mme la Rapporteure générale. Je vous propose, monsieur le président, que nous répondions à ces questions dans mon rapport, et je vous demande donc de bien vouloir retirer votre amendement.
M. le président Gilles Carrez. Je le retire, mais chacun doit être bien conscient que ce mécanisme appelle un éclairage particulier, car il est devenu l’instrument essentiel des réductions d’impôt sur le revenu.
L’amendement I-CF 69 est retiré.
La commission adopte l’article 2 sans modification.
*
* *
La commission est saisie de l’amendement I-CF 74 de M. Laurent Grandguillaume.
Mme Christine Pires Beaune. À la suite des affaires qui ont récemment défrayé la chronique, nous entendons réagir à la pratique dite des « parachutes dorés ». Nous proposons de réduire de moitié l’avantage fiscal dont font l’objet les indemnités de départ : l’exonération fiscale des indemnités serait limitée à un montant fixé non plus à six fois, mais à trois fois le plafond annuel de la sécurité sociale.
Mme la Rapporteure générale. Je partage votre objectif mais, tel qu’il est rédigé, l’amendement n’atteint que partiellement sa cible. Je vous propose donc de le retirer afin de le réécrire avec vous en vue d’un dépôt en séance.
Mme Christine Pires Beaune. J’en suis d’accord.
M. Razzy Hammadi. Nous avons beaucoup travaillé sur ces questions avec Laurent Grandguillaume, et fait des propositions dans le cadre de la précédente loi de finances et de la loi bancaire. Le dispositif actuel comporte un trou, qui réduit l’efficacité des mesures que nous avons pu faire adopter auparavant. Je préférerais que nous adoptions dès maintenant cet amendement, quitte à le modifier en séance.
M. le président Gilles Carrez. Faites donc confiance à Mme la Rapporteure générale, monsieur Hammadi. La limitation à six fois le plafond annuel de la sécurité sociale, qui prévaut actuellement, est issue d’un amendement de Michel Bouvard que j’avais proposé de réécrire avec lui, et qui a été adopté en séance...
L’amendement I-CF 74 est retiré.
La commission examine, en discussion commune, les amendements identiques I-CF 3 de M. Marc Le Fur et I-CF 125 de M. Charles de Courson, ainsi que l’amendement I-CF 126 de M. Charles de Courson.
Mme Marie-Christine Dalloz. Notre amendement vise à revenir sur une mesure qui a eu des conséquences non négligeables pour 3,8 millions de contribuables : la fiscalisation de la majoration de 10 % des pensions des retraités ayant eu trois enfants ou plus. Cette disposition a été ressentie par beaucoup non seulement comme une injustice, mais aussi comme un recul, et vos mesures de baisse de l’impôt sur le revenu ne compenseront pas la perte subie par tous.
M. Charles de Courson. Il ne faut pas oublier que ces majorations ont été conçues à l’origine comme la contrepartie d’un renoncement de mères de famille qui se retiraient temporairement du marché du travail, et qui ont aujourd’hui moins de droits à pension.
Nous aurions pu envisager un plafonnement de l’avantage fiscal, comme je le fais dans mon second amendement, qui est de repli, mais le supprimer totalement est d’une totale iniquité. Jusqu’à la fin de la législature, le groupe de l’Union des démocrates et indépendants s’attachera à vous rappeler les erreurs et les injustices sociales que vous avez commises – je le dis à l’intention de Mme la Rapporteure générale qui ironise volontiers sur mes amendements…
Mme la Rapporteure générale. Je vous renvoie au tableau qui retrace l’évolution de l’impôt sur le revenu d’un retraité non concerné par la demi-part « vieux parents », mais ayant perçu ladite majoration de 10 %, ainsi que l’incidence des mesures de réduction d’impôt prévues par les lois de finances pour 2015 et 2016.
Avis défavorable.
La commission rejette les amendements identiques I-CF 3 et I-CF 125, puis l’amendement I-CF 126.
Elle en vient à l’examen de l’amendement I-CF 4 de M. Marc Le Fur.
Mme Marie-Christine Dalloz. La loi de finances pour 2014 a supprimé l’exonération d’impôt sur le revenu du salaire différé de l’hériter de l’exploitant agricole. Nous voulons rétablir cette disposition afin de ne plus pénaliser les aides familiaux.
Mme la Rapporteure générale. J’ai déjà eu l’occasion d’indiquer l’année dernière que la disposition que vous voulez rétablir concernait très peu de bénéficiaires. En outre, un dispositif transitoire a permis d’éviter que certaines personnes ne se retrouvent dans une situation difficile, tandis que le mécanisme de quotient pour revenus différés permet de limiter les effets de la mesure. Je renouvelle mon avis défavorable, madame Dalloz.
La commission rejette l’amendement I-CF 4.
Elle examine ensuite, en discussion commune les amendements identiques I-CF 5 de M. Marc Le Fur et I-CF 121 de M. Charles de Courson, ainsi que l’amendement I-CF 238 de Mme Marie-Christine Dalloz et l’amendement I-CF 122 de M. Charles de Courson.
Mme Marie-Christine Dalloz. J’associe mes collègues Laurent Wauquiez et Marc Le Fur à ces amendements qui visent à revenir – et nous le ferons inlassablement – sur la suppression de l’exonération des heures supplémentaires instaurée par la loi du 21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat (TEPA). S’il est une mesure qui avait favorisé à la fois le pouvoir d’achat et l’activité, c’est bien celle-ci.
Las, ce gouvernement a choisi la voie d’une augmentation des impôts sans commune mesure avec ce que nous avons connu dans le passé. Il commence d’ailleurs à prendre la mesure des conséquences de ce matraquage, puisque cela fait deux années de suite qu’il s’efforce de faire sortir de l’imposition sur le revenu les contribuables les plus modestes.
Les Français ont le sentiment que vous jouez les apprentis sorciers en matière de fiscalité.
M. Charles de Courson. Jusqu’à la fin de la législature, nous redéposerons à chaque loi de finances ces amendements visant à rétablir une exonération qui était une mesure de pouvoir d’achat, une mesure d’encouragement concentrée sur les gens qui travaillent. Sa suppression a été une énorme erreur, une bonne partie des membres de la majorité le reconnaît d’ailleurs aujourd’hui.
Mme la Rapporteure générale. Nous avons déjà longuement débattu de cette question lors des précédentes lois de finances. Avantager les salariés qui font des heures supplémentaires revient à faire payer le coût de cet avantage fiscal à ceux qui n’en font pas, ce qui est injuste. Par ailleurs, je rappelle que 46 % de l’avantage fiscal bénéficiait à 20 % des ménages les plus favorisés.
Avis défavorable à ces quatre amendements.
M. Éric Alauzet. Je ne sais pas où sont les apprentis sorciers, en revanche je sais où sont les mystificateurs. Il y a une formidable contradiction à affirmer sur les plateaux de télévision, dans les meetings, dans l’hémicycle qu’il faut mettre à bas les 35 heures et, dans le même temps, à continuer de déposer ce genre d’amendements pour réclamer la défiscalisation des heures supplémentaires, lesquelles disparaîtraient avec la suppression de leur seuil de déclenchement.
M. Charles de Courson. Petite remarque, mon cher collègue : mon amendement I-CF 122 propose de réserver le rétablissement de l’exonération fiscale aux salariés gagnant moins de deux fois le SMIC. On ne peut pas dire qu’il s’agisse d’un amendement pour les riches !
M. Éric Woerth. Marie-Christine Dalloz a bien raison de défendre un tel amendement. Je ne vois pas ce qu’il y a de paradoxal à cela. Nous raisonnons à périmètre constant et nous nous adaptons au cadre proposé par l’actuelle majorité. Nous voyons bien qu’elle n’est pas prête à aller plus loin.
Mme Monique Rabin. J’aimerais obtenir une précision technique, qui est aussi politique : quel montant faudrait-il emprunter pour couvrir les dépenses liées au rétablissement de ces exonérations ?
Mme la Rapporteure générale. Il me semble que ce serait de l’ordre de 4,5 milliards d’euros.
La commission rejette les amendements identiques I-CF 5 et I-CF 121 puis, successivement, les amendements I-CF 238 et I-CF 122.
Elle examine ensuite les amendements identiques I-CF 6 de M. Marc Le Fur et I-CF 127 de M. Charles de Courson.
Mme Marie-Christine Dalloz. Notre amendement vise également à revenir sur une disposition de la loi de finances pour 2014 : je veux parler de la suppression de l’exonération fiscale de la participation de l’employeur aux contrats collectifs de complémentaire santé. Elle s’est traduite par une augmentation d’impôt pour 13,2 millions de salariés qui ne peuvent plus déduire de leur revenu imposable la part des contrats payée par leur employeur. Afin de soulager le pouvoir d’achat des salariés concernés, nous proposons tout simplement de revenir sur cette suppression.
M. Charles de Courson. Réintégrer la couverture complémentaire santé négociée avec les employeurs dans l’assiette de l’impôt sur le revenu, voilà bien une mesure incompréhensible pour nos concitoyens. Et le même problème se pose pour la part non déductible de la CSG. Les gens me demandent souvent pourquoi ils sont taxés sur de l’argent qu’ils n’ont jamais touché. Savez-vous répondre à cette question, mes chers collègues ?
Cette mesure est antisociale, ce qui est un comble pour un parti qui prétend défendre les salariés : 76 % de ceux qui bénéficiaient de cette exonération ont été touchés. Elle est, en outre, contraire au dialogue social. Elle est, enfin, incompréhensible pour nos concitoyens qui s’étonnent de l’écart entre l’assiette de l’impôt et ce qu’ils touchent réellement, écart qui ne fait que s’accentuer d’année en année.
J’ai proposé maintes fois, pour rendre le dispositif compréhensible, que l’on résolve le problème de la CSG en la rendant entièrement déductible, quitte à en ajuster le taux. Personne ne veut le faire !
Mme la Rapporteure générale. Avis défavorable à ces amendements. Dans ma présentation liminaire, j’ai évoqué le cas d’un couple marié de salariés qui intègrent dans leur impôt sur le revenu l’avantage que vous visez. Il montre que, jusqu’à 47 000 euros de revenus, ils paieront moins d’impôt qu’en 2012.
M. Dominique Lefebvre. Charles de Courson passe son temps, comme ses amis politiques, à nous expliquer qu’il faut élargir l’assiette de l’impôt sur le revenu, tout en faisant des propositions qui aboutissent à la miter.
Il passe également son temps à interpeller la majorité de gauche pour savoir pourquoi elle met en cause les déductions fiscales. Je vais lui dire pourquoi. C’est le mécanisme fiscal le plus injuste qui soit, puisqu’il s’appuie sur le taux marginal : plus le revenu est élevé, plus l’on bénéficie des effets de la déduction. C’est profondément anti-redistributif. Voilà pourquoi la gauche est opposée, de manière générale, aux déductions fiscales. Je rappelle qu’à sa création la CSG était non déductible. C’est une perversité de l’histoire que de l’avoir rendue déductible.
La commission rejette les amendements identiques I-CF 6 et I-CF 127.
Puis elle examine l’amendement I-CF 385 de la commission des affaires économiques.
M. François Pupponi, rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques. Cet amendement vise à appliquer les conclusions du Comité interministériel à l’égalité et à la citoyenneté.
Afin de ne pas accentuer la concentration de logements sociaux dans les quartiers où il en existe déjà beaucoup, nous proposons que l’abattement de 30 % sur l’imposition des plus-values réalisées lors de la vente d’un terrain destiné à la construction de logements sociaux ne s’applique pas dans les quartiers faisant l’objet d’un programme de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU).
Mme la Rapporteure générale. Je ne doute pas que François Pupponi, président de l’ANRU, maîtrise parfaitement son sujet, mais ce n’est pas mon cas. Les amendements de la commission des affaires économiques ne nous ayant été transmis qu’hier soir, nous n’avons pas eu le temps de les examiner. Je vous propose donc de retirer votre amendement et que nous le réexaminions en séance publique.
M. le rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques. Nous n’avons pas eu plus de temps que vous pour rédiger nos amendements…
L’amendement I-CF 385 est retiré.
La commission en vient à l’amendement I-CF 70 du président Gilles Carrez.
M. le président Gilles Carrez. Lorsque deux époux font l’objet d’une imposition séparée parce qu’ils sont en instance de séparation, la pension versée par l’un à l’autre ne peut être prise en compte que si elle découle d’une décision de justice. Dans les cas où la séparation se déroule à l’amiable, il serait plus judicieux de se contenter d’un acte notarié. C’est une mesure de simplification qui ne devait pas avoir d’effet ravageur sur les finances publiques.
Mme la Rapporteure générale. Cet amendement est plein de bon sens, mais je souhaite davantage d’éléments pour étayer ma décision.
L’amendement I-CF 70 est retiré.
La commission est saisie de l’amendement I-CF 402 de la commission des affaires économiques.
M. le rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques. Cet amendement reprend un article de la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, dite « loi Macron », censuré par le Conseil constitutionnel au motif qu’il s’agissait d’un cavalier législatif.
Il s’agit de permettre que l’avantage fiscal dont bénéficient les monuments historiques s’applique à l’ensemble d’entre eux, y compris ceux détenus en copropriété inscrits à l’Inventaire supplémentaire des monuments historiques ou bénéficiant du label délivré par la Fondation du Patrimoine. Cette mesure, qui permet de financer des travaux de rénovation, avait été approuvée par l’Assemblée nationale et le Sénat.
Mme la Rapporteure générale. Sans doute devriez-vous également préciser que la mesure en question avait été adoptée contre l’avis du Gouvernement… Je souhaite, cela étant, que, lorsqu’on adopte des dispositions fiscales, on en connaisse le coût.
Je propose donc que vous retiriez votre amendement et que nous fassions une évaluation précise de son coût, sans quoi j’émettrai un avis défavorable.
Mme Marie-Christine Dalloz. Je ne comprends pas ce que vient faire cet amendement dans le PLF, dans la mesure où l’Assemblée nationale a adopté hier un projet de loi sur le patrimoine, dans lequel il aurait été plus judicieux d’inscrire ce dispositif.
M. Charles de Courson. L’amendement fait référence aux copropriétés inscrites à l’Inventaire supplémentaire des monuments historiques ou bénéficiant du label délivré par la Fondation du Patrimoine. Je vous mets donc en garde contre le fait que, si nous adoptions cet amendement, un organisme privé pourrait définir l’assiette de l’impôt, ce qui ne me paraît pas constitutionnel.
M. le rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques. Cette mesure coûterait a priori 4 millions d’euros, ce qui correspond au montant des économies réalisées grâce à la modification du dispositif dans la loi de finances de l’an dernier.
Je précise en outre que les copropriétés inscrites à l’Inventaire ou qui bénéficient du label délivré par la Fondation du Patrimoine représentent les deux tiers des monuments historiques.
La commission rejette l’amendement I-CF 402.
Puis elle examine l’amendement I-CF 7 de M. Marc Le Fur.
Mme Marie-Christine Dalloz. La loi de finances pour 2009 prévoyait que serait supprimée à partir de 2014 la demi-part supplémentaire accordée aux contribuables vivant seuls et n’ayant pas eu seuls la charge d’un enfant pendant au moins cinq ans. Nous proposons, par cet amendement de distinguer le cas, d’une part, des célibataires et des divorcés, dont la situation relève d’un choix personnel, et, d’autre part, des veufs.
M. le président Gilles Carrez. Il existe sur ce point une décision explicite du Conseil constitutionnel qui l’interdit.
Mme Marie-Christine Dalloz. Certes, mais nous souhaitons relancer le débat sur ce dispositif qui pénalise de nombreuses veuves ayant de faibles revenus.
M. Henri Emmanuelli. Vous ne manquez pas d’air, c’est vous qui l’avez supprimé !
Mme la Rapporteure générale. Je remercie le président d’avoir rappelé que, dans une décision du 30 décembre 1996, le Conseil constitutionnel a jugée inconstitutionnelle l’introduction d’une distinction entre célibataires, divorcés ou veufs, et je me désole que des députés de la Nation veuillent aller contre la Constitution. Je remercie également Henri Emmanuelli d’avoir rappelé que la suppression de cette demi-part avait été votée par la précédente majorité. Avis défavorable.
M. Charles de Courson. Je rappelle que la demi-part n’a pas été entièrement supprimée puisque, suite à un amendement de votre humble serviteur, nous l’avons maintenue pour les personnes qui ont élevé seules au moins un enfant pendant cinq ans.
La commission rejette l’amendement I-CF 7.
*
* *
Article additionnel après l’article 2
Abaissement de la condition d’âge pour l’obtention par les anciens combattants d’une demi-part supplémentaire
La commission est ensuite saisie de l’amendement I-CF 335 de M. Dominique Baert.
M. Dominique Baert. J’ai à plusieurs reprises proposé d’abaisser l’âge à partir duquel les anciens combattants peuvent bénéficier d’une demi-part supplémentaire, de 75 à 70 ans. Je me borne cette année, compte tenu de l’état de nos finances publiques, à proposer de l’abaisser à 74 ans.
On m’a opposé que cette mesure coûterait cher mais, vu le nombre décroissant chaque année d’anciens combattants, j’ai sincèrement peine à croire qu’elle constituerait pour nos finances une charge abusive. J’estime au contraire qu’il serait raisonnable de faire un geste envers ces combattants.
Mme la Rapporteure générale. La dépense fiscale associée à cette demi-part était en 2007 de 170 millions d’euros ; elle s’élève en 2016 à 550 millions d’euros, ce qui s’explique par le fait qu’en bénéficient désormais les générations ayant fait la guerre d’Algérie. Ne disposant pas du coût exact de cette proposition, je vous suggère de retirer votre amendement pour que nous tâchions de l’évaluer avant la discussion en séance publique.
M. le président Gilles Carrez. Je voudrais à cette occasion souligner l’injustice que constitue le fait que, lorsqu’un ancien combattant décède à 74 ans, sa veuve ne peut prétendre à cette demi-part, à laquelle elle aurait eu droit s’il était mort à 75 ans révolus.
Mme la Rapporteure générale. C’est exact.
M. Razzy Hammadi. La dépense fiscale associée au programme 169 Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant s’élève pour 2016 à 789 millions d’euros, contre 505 en 2013, ce qui peut donner un aperçu de l’évaluation que nous obtiendrons.
Par ailleurs, le PLF pour 2016 comporte déjà des mesures en faveur des anciens combattants, en étendant notamment rétroactivement le bénéfice de la « campagne double » aux soldats ayant participé à ce que l’on ne nomme plus les événements d’Algérie mais bien la guerre d’Algérie. Je sais les pressions qu’exercent certains lobbies sur la représentation nationale, pressions qui ont pour résultat le fait que certaines indemnités mensuelles versées sont supérieures au salaire moyen d’une infirmière, mais je suis pour que l’on en reste aux progrès que comporte déjà le PLF.
Mme Karine Berger. Razzy Hammadi a raison de rappeler tout ce qui a déjà été fait pour les anciens combattants. Je pense aussi que nous avons besoin d’une évaluation, laquelle pourrait ne pas être si élevée, dans la mesure où, la guerre d’Algérie s’étant achevée en 1962, cette mesure ne concerne plus que les dernières classes d’âge qui ont combattu là-bas. Je suis donc plutôt favorable à l’amendement de Dominique Baert, qui s’inscrirait comme un dernier geste envers ces anciens soldats.
M. Dominique Baert. Il ne faut pas tout confondre. Nous parlons ici non de l’aide différentielle, mais de la demi-part prise en compte dans le calcul de l’impôt sur le revenu, qui concerne également les veuves.
Par ailleurs je tiens à préciser à Razzy Hammadi que je ne suis soumis à aucune pression : voilà plus de dix ans que je dépose ces amendements ! Merci de m’en donner crédit.
Enfin, concernant l’évaluation chiffrée de cette mesure, compte tenu de la démographie, elle ne devrait pas excéder une dizaine de millions d’euros.
La commission adopte l’amendement I-CF 335.
*
* *
La commission en vient à l’amendement I-CF 91 de M. Christine Pires Beaune.
Mme Christine Pires Beaune. Je tiens avant tout à remercier Charles de Courson, puisque je viens d’apprendre que c’est grâce à lui que je bénéficie d’une demi-part supplémentaire pour avoir élevé des enfants seule, ce qui est profondément anormal compte tenu de mes revenus. Peut-être pourrions-nous assortir cette mesure d’une condition de revenus, et financer ainsi l’amendement que nous venons d’adopter.
M. le président Gilles Carrez. Proposez-le donc pour la séance publique !
Mme Christine Pires Beaune. Mon amendement va dans le sens de votre précédente observation, monsieur le président : je ne sais pour ma part expliquer à une veuve d’ancien combattant qui a perdu son mari âgé de 74 ans et dix mois qu’elle n’aura pas droit à la demi-part, alors que s’il avait vécu deux mois de plus, elle en aurait bénéficié. C’est un amendement de justice.
Mme la Rapporteure générale. J’entends parfaitement ces arguments, mais je m’en tiens au principe qui consiste à ne pas voter de mesure nouvelle sans une évaluation chiffrée. Je pense par ailleurs que cet amendement serait plus coûteux pour les finances publiques que celui de Dominique Baert. Je propose donc son retrait tant que l’on ne sait pas si son coût est de l’ordre de 10 ou de 100 millions d’euros.
M. le président Gilles Carrez. Selon moi, nous devrions être plus proches de la centaine de millions.
M. Charles de Courson. Pour en revenir à la demi-part accordée aux veuves, sans doute faudrait-il aussi l’assortir de conditions touchant à la durée du mariage !
M. Éric Alauzet. Je fais partie des rares députés qui n’ont pas voté l’amendement précédent. En revanche, je soutiens farouchement celui-ci. Certes, il faut trouver le bon équilibre entre le coût et la pertinence d’une mesure mais, en l’occurrence, cette affaire des 75 ans est parfaitement inexplicable et injustifiable. Je rappelle que l’ensemble des amendements proposés tout à l’heure par l’opposition doit allègrement se chiffrer à quelque 10 milliards d’euros…
L’amendement I-CF 91 est retiré.
La commission examine, en discussion commune, les amendements I-CF 339 et I-CF 340 de M. Razzy Hammadi.
M. Razzy Hammadi. J’annonce d’emblée que je retirerai mes amendements, pour les redéposer en séance afin qu’ils y fassent l’objet d’un débat. Cela étant, ma proposition n’est pas nouvelle ; elle est soutenue depuis longtemps par des élus de toutes sensibilités politiques. Ce qui pourrait modifier les données du débat, c’est la volonté du Gouvernement d’avancer vite et fort sur la télédéclaration, ce qui lèverait l’obstacle technique qu’on oppose à l’instauration de cette contribution universelle.
Par ailleurs, je ne me positionne nullement, à ce stade de la réflexion, sur l’utilisation qui pourrait être faite de cette cotisation civique minimum obligatoire.
J’insiste également sur le fait que, même si beaucoup de foyers sont exonérés aujourd’hui de contribution à l’audiovisuel public – 136 euros –, il n’a pas choqué grand monde que l’on oblige parfois des foyers modestes à acquitter cette redevance qui n’est ni progressive ni proportionnelle. Quant à la CSG, payée par tous les Français, chacun sait qu’il s’agit, à la différence de l’impôt sur le revenu, d’un impôt affecté, en l’occurrence au financement de la sécurité sociale.
Quand on sait que dans certaines villes de Seine-Saint-Denis, sept habitants sur dix ne paient pas l’impôt sur le revenu, le débat sur cette contribution revêt certes des aspects fiscaux et budgétaires, mais il comporte avant tout des enjeux citoyens et républicains.
M. le président Gilles Carrez. Pouvez-vous nous préciser qu’il s’agit bien d’imposer les revenus par part en deça de 9 700 euros à hauteur de 0,01 % – ce qui donne au maximum 96 centimes d’euros – et non de 1 % ?
M. Razzy Hammadi. Il ne s’agit pas du taux mais de la définition de la tranche.
Mme la Rapporteure générale. Je rappelle que chaque Français acquitte la TVA, pour un montant total de 139 milliards d’euros par an, et que nos concitoyens s’acquittent également de la CSG, pour un montant total de 90 milliards d’euros par an. Accréditer l’idée que certains Français ne paieraient pas d’impôt me paraît donc dangereuse.
M. Pierre-Alain Muet. La France a cette particularité d’avoir deux impôts sur le revenu : l’impôt sur le revenu proprement dit, dont les recettes représentent 3,5 % du PIB, et la CSG, dont les recettes atteignent presque 5 % du PIB. En additionnant ces deux impôts, on obtient un total de 8,3 % du PIB, ce qui est proche des taux pratiqués dans les autres pays : 10 % aux États-Unis, 9 % en Allemagne, 9 %, entre 8,5 % et 9 % au Royaume-Uni. Arrêtons donc d’accréditer cette fiction que la moitié des Français ne paieraient pas l’impôt sur le revenu, alors que la moitié des plus modestes de nos concitoyens paient un impôt sur le revenu qui commence à 8 % en taux moyen, c’est-à-dire un taux bien supérieur à ce qui existe dans tous les autres pays.
Dans la réflexion que la gauche mène pour réunifier ces deux impôts, nous ne devons pas oublier qu’en 1959 Antoine Pinay a réunifié l’impôt progressif et les impôts dits cédulaires, ce qui nous a valu de ne plus avoir, jusqu’à la création de la CSG, qu’un seul impôt sur le revenu.
Quoi qu’il en soit, si l’idée d’un impôt citoyen est sympathique, elle ne doit pas nous faire perdre de vue que l’impôt sur le revenu qui produit le plus de recettes, c’est la CSG.
M. le président Gilles Carrez. Si vous vous livrez à des comparaisons internationales, notamment avec l’Allemagne, il convient d’intégrer dans vos calculs la part des cotisations salariales destinées à financer l’assurance maladie.
M. Pierre-Alain Muet. Certes, mais au Danemark ce sont la TVA et l’impôt sur le revenu qui financent toutes les prestations sociales. Dès lors qu’il s’agit de financer des prestations universelles, comparables à n’importe quelle dépense publique, il faut qu’elles soient financées par l’impôt – c’est d’ailleurs ce qui a conduit à la création de la CSG.
M. le président Gilles Carrez. Razzy Hammadi soulève ici un problème auquel de nombreux maires sont confrontés, à savoir l’importance du lien fiscal dans l’expérience de la citoyenneté. Il est vrai que le fait que certains ménages ne paient ni l’impôt sur le revenu ni la taxe d’habitation engendre des comportements qui posent problème, ce qui conduit en effet à penser qu’une contribution explicite ne peut que contribuer à renforcer le sentiment de citoyenneté. Il s’agit là d’un argument qui risque de structurer le débat que nous aurons sur le prélèvement à la source, qui concerne déjà la CSG, alors que l’impôt sur le revenu et la taxe d’habitation sont clairement identifiés comme des prélèvements du fait des avis que l’on reçoit et de ce que l’on verse au Trésor public.
M. Razzy Hammadi. La retenue à la source ne dispensera pas de faire une déclaration l’année suivante pour régularisation, ce qui conservera à l’impôt sur le revenu toute sa visibilité.
Quant à la question de la citoyenneté, je rappelle qu’aujourd’hui le travailleur saisonnier étranger paie la CSG et que le touriste acquitte la TVA. La dimension citoyenne de l’impôt sur le revenu est liée, elle, au fait qu’il est attaché à la résidence sur notre territoire.
Ma problématique n’est pas celle de l’injustice ou de la justice sociale, et je suis même prêt à ce qu’à terme tout ceci se solde par un jeu à somme nulle. Il n’en reste pas moins que chaque impôt a sa légitimité et qu’ils ne sont pas interchangeables. Fusionner en revanche l’impôt sur le revenu et la CSG, ainsi que le suggère Pierre-Alain Muet, va dans le sens de ce que je défends, notamment puisque cela implique un élargissement de l’assiette.
M. Charles de Courson. L’idée de Razzy Hammadi est certes sympathique, mais elle ne résiste malheureusement pas à une approche concrète des faits : avec un taux de 0,01 % certains ménages auront à s’acquitter d’un montant inférieur à quatre euros, ce qui est bien en dessous du seuil de recouvrement.
M. le président Gilles Carrez. Monsieur de Courson, il a été précisé qu’on ne parlait pas ici du taux de l’imposition, et nous avons tous rectifié.
M. Charles de Courson. Quoi qu’il en soit, n’oublions pas les coûts de gestion que va générer une telle mesure, qu’il conviendrait plutôt adosser à la taxe d’habitation.
M. Olivier Carré. Le prélèvement à la source va à l’encontre de la volonté de rendre l’impôt tangible pour les citoyens.
M. Pascal Cherki. Je ne suis pas de ceux qui considèrent que priorité doit être donnée aux économies budgétaires, mais la pertinence d’un impôt dont la perception coûtera davantage que ce qu’il rapportera mérite d’être discutée.
D’autre part, la CSG est aujourd’hui l’impôt direct le plus important, ce qui est problématique dans la mesure où il s’agit d’un impôt proportionnel et non progressif. Or, il me semble que la question de la citoyenneté ne peut être disjointe de celle de la progressivité de l’impôt. Il serait donc préférable de réfléchir à sa fusion avec l’impôt sur le revenu et d’envisager d’établir la progressivité du nouvel impôt.
M. Hervé Mariton. Je ne suis pas sûr qu’il y ait un lien évident entre progressivité et citoyenneté. Je rappelle qu’il est inscrit dans la Déclaration des Droits de l’Homme que l’impôt doit être acquitté « à raison » des capacités contributives, ce qui, dans le langage de l’époque, signifie « en proportion ».
Par ailleurs, contrairement à ce que vous affirmez, la CSG n’est pas payée par la totalité des Français, tant s’en faut. Plusieurs millions de Français – 20 % selon Charles de Courson – n’y sont pas assujettis.
Enfin, il me semble que la déclaration préremplie, la télédéclaration et le télépaiement ne justifient plus que soit instauré un montant de prélèvement minimum de 61 euros, comme le prévoit l’article 1657 du code général des impôts. Supprimer le seuil de mise en recouvrement permettrait ainsi de répondre en partie à la préoccupation de Razzy Hammadi.
M. Alain Fauré. Quand un citoyen utilise des services publics ou qu’il constate les travaux en cours dans l’espace public, il n’est guère informé de l’origine de leur financement. En revanche, chacun sait qu’il contribue au financement de la dépense publique, qu’il s’agisse de services ou de prestations, ne serait-ce qu’en achetant son pain, sur lequel il acquitte un taux de 5,5 % de TVA. Nos débats de riches laisseraient pantois nombre de Français qui ont du mal à se nourrir. Nous devrions donc faire preuve d’un peu plus de décence.
M. Dominique Lefebvre. La vie politique est pavée de bons sentiments, dont il convient de se méfier car ils sont rarement conformes à la réalité. En l’espèce, les amendements défendus par Razzy Hammadi sont motivés par l’idée qu’un certain nombre de Français ne paieraient pas l’impôt. Or c’est faux, tout comme est fausse l’idée que serait mal perçue la contribution fiscale de chacun au financement des charges publiques, ce qui revient à dire qu’il y aurait un bon impôt, celui qui est identifié lorsque l’on signe son chèque au Trésor public, et un mauvais impôt, celui qui est indirect ou prélevé à la source.
Quant aux classes moyennes et supérieures, qui ont le sentiment de payer davantage que ce qu’elles reçoivent en retour, elles se trompent également. Un couple avec deux enfants qui paie la taxe d’habitation et la taxe foncière à Cergy-Pontoise est ainsi plus que remboursé de sa contribution dès lors qu’il inscrit ses deux enfants au conservatoire municipal !
Il n’est donc pas responsable d’alimenter ces confusions en posant mal les problèmes, d’autant qu’il s’agit de questions fort anxiogènes pour nos compatriotes. J’aimerais donc que la majorité se concentre sur le fait que nous baissons les impôts de manière équitable en privilégiant les contribuables relevant des premières tranches, auxquels d’importants efforts ont déjà été demandés. Pour les tranches supérieures, qui ne bénéficient pas de cette baisse, nous considérons, malgré les reproches de l’opposition, que leur capacité à supporter les efforts reste aujourd’hui plus importante.
M. Laurent Grandguillaume. En lieu et place de ce débat, certes intéressant, nous pourrions nous donner pour priorité de réformer les valeurs locatives cadastrales et remédier ainsi aux inégalités qui affectent les contribuables. Nous pourrions également réformer la cotisation foncière des entreprises, taxe forfaitaire à laquelle sont injustement assujettis des micro-entrepreneurs, qui, par leur travail, leurs efforts et leur mérite créent pourtant des richesses.
Les voies de réforme de la fiscalité sont nombreuses et peuvent longtemps alimenter nos débats. Mieux vaut faire preuve de pragmatisme et modifier à travers cette loi de finances certains dispositifs injustes et contreproductifs en termes de création de richesses.
Les amendements I-CF 339 et I-CF 340 sont retirés.
La commission est saisie, en discussion commune, des amendements I-CF205 et I-CF206 de M. Charles de Courson.
M. Charles de Courson. Le dispositif visant à inciter les citoyens à investir dans les PME au travers d’une réduction d’impôt a été instauré de manière consensuelle. Ces amendements proposent de rendre éligibles à cet avantage fiscal les parts de groupements fonciers agricoles (GFA), groupements qui facilitent l’installation des agriculteurs en allégeant le poids du foncier. Une exploitation agricole peut, en effet, être assimilée à une petite ou moyenne entreprise.
Mme la Rapporteure générale. Je regrette que Charles de Courson n’aime pas les additions… Les parts de GFA font l’objet d’une double exonération : à hauteur de 75 % dans l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) et, en cas de transmission, à hauteur de 75 % dans l’assiette des droits de mutation. Je comprends que, par cet amendement, vous cherchez à favoriser les nouveaux entrants dans les GFA.
J’ai demandé le 17 juillet au ministère un bilan global des dispositifs existants en matière de fiscalité agricole. Je ne l’ai pas encore reçu, je ne désespère pas, mais, en attendant, j’émets un avis défavorable à ce nouvel avantage fiscal qui vient s’ajouter à ceux que j’ai cités.
M. Charles de Courson. Votre argument vaut également pour les PME. Mon intention est de rendre le dispositif homogène, ni plus, ni moins.
La commission rejette successivement les deux amendements I-CF 205 et I-CF 206.
Puis elle examine les amendements identiques I-CF 8 de M. Marc Le Fur et I-CF 239 de Mme Marie-Christine Dalloz.
Mme Marie-Christine Dalloz. L’emploi d’une personne à domicile ouvre droit à une réduction d’impôt pour ceux qui paient l’impôt sur le revenu et à un crédit d’impôt pour certains de ceux qui ne sont pas imposables. Or, les retraités sont exclus du bénéfice de ce dernier alors qu’ils sont de plus en plus nombreux à avoir besoin d’aide à domicile. Dans un souci de justice, cet amendement vise à mettre fin à cette distorsion.
Mme la Rapporteure générale. Nous avons débattu à plusieurs reprises de cette proposition, dont le coût s’élève environ à 2 milliards d’euros. Avis défavorable.
M. Hervé Mariton. Historiquement, une réduction d’impôt a d’abord été instaurée pour l’emploi de salariés à domicile avant d’être complétée par un crédit d’impôt pour certaines catégories de contribuables.
La logique qui a présidé à la création de cette réduction d’impôt demeure, on peut le regretter : pour rendre acceptable un impôt très lourd et concentré, des allégements doivent être consentis. En transformant la réduction d’impôt en crédit d’impôt, vous vous écartez de cette logique. C’est la raison pour laquelle le crédit d’impôt est réservé à certains emplois et à certaines catégories.
M. le président Gilles Carrez. Je partage le point de vue d’Hervé Mariton dans ce débat qui nous occupe depuis des années. J’ajoute que les personnes non imposables retraitées peuvent bénéficier de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA).
M. Jean-Louis Gagnaire. Je suis très sensible à ce débat. Les structures d’aide à domicile me l’ont confirmé : certaines personnes, qui ne sont plus assujetties à l’impôt sur le revenu à la faveur des mesures prises depuis 2014, ne font plus appel à leurs services.
J’ai retenu de notre discussion précédente que les retraités ont les mêmes devoirs fiscaux que les actifs. Je considère par conséquent qu’ils ont aussi les mêmes droits. Je crains que la rupture d’égalité entre actifs et retraités – qui pouvaient se justifier autrefois lorsque les retraités bénéficiaient de certains avantages mais ce n’est plus le cas aujourd’hui – ne pose un problème de constitutionnalité.
Christian Eckert, avant d’être ministre, était assez favorable à cette mesure. Il nous objecte aujourd’hui son coût, mais j’ai quelques doutes sur le chiffrage sur lequel il s’appuie. La réduction du plafond proposée mérite aussi d’être évaluée, tout comme les gains en termes d’emplois et de cotisations.
Quant à l’APA, elle n’est pas une solution pour les personnes qui ne sont pas dépendantes mais qui ont besoin de quelques heures d’aide à domicile.
Un certain nombre de retraités devenant non imposables, le phénomène d’éviction que vise à combattre cet amendement risque d’être de plus en plus important, et l’on ne peut opposer pour seule réponse à l’argument de la rupture d’égalité le coût budgétaire de la proposition.
Mme Marie-Christine Dalloz. La sortie de l’impôt d’un certain nombre de contribuables aura un impact sur l’emploi à domicile. La distorsion qui existe aujourd’hui, si elle n’est pas corrigée, risque de favoriser le travail non déclaré et de mettre à mal les structures d’aide à domicile qui emploient du personnel peu qualifié dans nos territoires.
Dans le Jura, l’État rembourse 37,5 % des dépenses de l’APA, 62,5 % restant donc à la charge du département. Comment peut-on continuer ainsi ? Les départements seront bientôt exsangues. Mais l’État persiste à se défausser.
Mme Karine Berger. Madame la Rapporteure générale, il serait peut-être utile de disposer, pour la séance, d’une répartition par tranche d’imposition des bénéficiaires de l’avantage fiscal lié à l’emploi à domicile. Les chiffres non officiels que j’ai pu consulter montrent que les premières tranches d’imposition ne recourent presque pas à la réduction d’impôt. Des données de la part de Bercy seraient le meilleur moyen de clore ce débat.
M. Jean-Louis Gagnaire. Il ne faut pas craindre, me semble-t-il, une demande massive. La mesure s’appliquera très progressivement, les personnes concernées ayant besoin d’en prendre connaissance et de s’approprier son fonctionnement très complexe.
Les chiffres sont à revoir, j’en conviens. D’où tirez-vous celui de 2 milliards d’euros ? Je ne serais pas choqué qu’on abaisse le plafond pour compenser le coût de la mesure. Ce serait faire œuvre de justice.
Mme la Rapporteure générale. Sur cette question importante, je vais essayer de vous présenter des chiffres pour la séance. Certains figurent dans le rapport de décembre 2014 de Martine Pinville et Bérengère Poletti réalisé dans le cadre du Comité d’évaluation et de contrôle, mais ils sont incomplets.
M. Dominique Lefebvre. Le débat comporte deux termes : le coût du travail et la solvabilisation des ménages. Dès lors que les salaires des personnes employées se situent entre 1 et 1,2 fois le SMIC, le coût des charges patronales est quasiment effacé pour les particuliers employeurs.
Une fois l’objectif de solvabilisation atteint, il faut s’assurer que, comme pour d’autres aides, le dispositif n’aboutisse pas à une augmentation des salaires versés.
Le système est très compliqué, mais il doit être équitable. Il ne le serait probablement pas sans le crédit d’impôt. Il faut toutefois être prudent sur les critères choisis, sans quoi l’on risque d’enclencher un cycle infernal dès lors, encore une fois, qu’on a effacé les charges sociales pour les employeurs particuliers.
M. Hervé Mariton. On touche là les limites de la logique fiscale de la majorité, qui décide d’exonérer plus de contribuables de l’impôt sur le revenu et s’inquiète dans le même temps de la disparition de la réduction d’impôt pour les emplois à domicile qui en résulte. Si elle tient absolument à maintenir cet avantage, peut-être doit-elle revoir sa réforme fiscale…
La commission rejette les amendements I-CF 8 et I-CF 239.
Puis elle aborde les amendements identiques I-CF 134 de M. Charles de Courson et I-CF289 de M. Éric Alauzet.
M. Charles de Courson. Il s’agit d’un amendement de coordination. Le projet de loi relatif à l’adaptation de la société au vieillissement instaure un système d’autorisation des organismes de services à domicile pour les personnes fragiles. Or, le code général des impôts ignore la notion de services à la personne autorisés. En l’absence de coordination, les contribuables recourant à des services déclarés ou agréés seraient ainsi privés de l’avantage fiscal alors qu’ils y sont éligibles.
L’attention de plusieurs d’entre nous a été attirée sur ce point par les associations intervenant dans ce domaine.
M. Éric Alauzet. L’article 32 bis du projet de loi relatif à l’adaptation de la société au vieillissement a pour conséquence de supprimer, pour les personnes âgées dépendantes et les personnes handicapées, le bénéfice des avantages fiscaux attachés aux activités de services à la personne, qui passent du régime de l’agrément à celui de l’autorisation.
Il convient de maintenir l’avantage existant, qui menace de disparaître par accident.
Mme la Rapporteure générale. Je suis d’accord avec Charles de Courson et Éric Alauzet sur le fond. Toutefois, l’entrée en vigueur de la disposition que vous visez n’est prévue qu’en 2021. En outre, le projet de loi en question est encore en navette. Je reconnais leur sens aigu de l’anticipation. Mais il ne faut pas confondre anticipation et précipitation. Il est préférable d’attendre de connaître le texte définitif pour remédier au problème. Je vous propose donc de retirer vos amendements.
M. Charles de Courson. Je retire le mien et le redéposerai en vue de la séance afin d’obtenir un engagement du ministre.
Les amendements I-CF 134 et I-CF 289 sont retirés.
*
* *
Article additionnel après l’article 2
Prorogation de la réduction d’impôt pour les dépenses de restauration d’un immeuble dans les quartiers visés par le programme national de requalification des quartiers anciens dégradés
La commission examine l’amendement I-CF 407 de la commission des affaires économiques.
M. le rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques. Cet amendement a un double objet : d’une part, prolonger jusqu’en 2017 le dispositif de réduction d’impôt pour les dépenses de restauration dans les quartiers visés par le programme national de requalification des quartiers anciens dégradés (PNRQAD), qui vient lui-même d’être prolongé, d’autre part, étendre cette réduction d’impôt aux quartiers visés par le nouveau programme national de renouvellement urbain (NPNRU).
Mme la Rapporteure générale. Votre amendement propose une prorogation du dispositif existant et ouvre un nouveau droit. Il me semble qu’il aurait davantage sa place en seconde partie puisqu’il n’est pas d’application immédiate.
En outre, nous ne disposons pas d’une évaluation du coût de la mesure nouvelle que vous proposez pour les quartiers visés par le nouveau programme national de renouvellement urbain.
M. le rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques. Il s’agit de maintenir le dispositif en cours, sur la base duquel des projets ont été validés.
M. Charles de Courson. Un compromis pourrait être trouvé en conservant les deux premiers alinéas de l’amendement, à savoir la prorogation du dispositif existant jusqu’en 2017.
Mme la Rapporteure générale. Le 2° de l’amendement ouvre droit à une dépense fiscale au titre des revenus de 2015 pour des investissements qui n’ont pas pu, par définition, encore être réalisés. C’est la raison pour laquelle je suggérais de le renvoyer à la seconde partie de la loi de finances.
M. Dominique Baert. Je propose de rectifier l’amendement en supprimant la partie de l’amendement relative aux quartiers relevant du programme national de renouvellement urbain.
Mme la Rapporteure générale. Cette mesure nouvelle a en effet vocation à figurer en seconde partie. J’accepte la rectification proposée.
La commission adopte l’amendement I-CF 407 ainsi rectifié.
*
* *
La commission est saisie de l’amendement I-CF 410 de la commission des affaires économiques.
M. le rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques. Les dispositifs d’investissement locatif reposent sur l’engagement de louer pendant une période donnée, un logement dont le loyer est plafonné. Toutefois, la location à des descendants ou ascendants est autorisée. Cet amendement propose de ne pas prendre en compte la durée de location à un descendant au sein de la période sur laquelle l’investisseur s’est engagé. Ce dernier est ainsi contraint de louer à un tiers pendant une durée minimale.
M. Christophe Caresche. Nous avons eu de longs débats lors de la mise en place du dispositif « Pinel », sur lesquels il ne semble pas opportun de revenir : il connaît un net succès, et un certain nombre d’opérations sont en cours de lancement. Ce serait un très mauvais signal adressé aux investisseurs que de le modifier dans le sens que vous proposez.
M. le président Gilles Carrez. J’approuve entièrement les propos de Christophe Caresche. Alors que la reprise de l’investissement est très fragile, la question de la visibilité des dispositifs d’investissement locatif est essentielle. C’est leur instabilité qui explique les très mauvais résultats en matière de construction de logements neufs ces dernières années. La prudence commande de s’en tenir aux dispositions adoptées l’an dernier, après de longs débats.
Suivant l’avis défavorable de la Rapporteure générale, la commission rejette l’amendement I-CF 410.
*
* *
Article additionnel après l’article 2
Abrogation de la condition de mixité des programmes immobiliers pour bénéficier du dispositif d’investissement locatif
La commission examine l’amendement I-CF 167 de M. Christophe Caresche.
M. Christophe Caresche. Cet amendement tend à aménager légèrement le dispositif « Pinel », afin d’encourager la construction, en supprimant la condition de mixité des programmes immobiliers. Selon les professionnels que nous avons reçus, certaines opérations peinent à aboutir car cette condition serait compliquée à satisfaire.
Mme la Rapporteure générale. La disposition que vous proposez de supprimer n’a jusqu’à présent pas fait l’objet de décrets d’application. Mes interlocuteurs m’ont également fait part des difficultés pratiques que vous évoquez. J’émets donc un avis plutôt favorable à votre amendement.
M. le président Gilles Carrez. J’approuve cet amendement. En zone tendue, on éprouve de grandes difficultés à mettre au point ce type de montage. La condition qui est imposée freine la construction.
Mme Karine Berger. Nous n’avons probablement pas les mêmes interlocuteurs. J’ai rencontré un promoteur qui a insisté sur la nécessité de conserver la condition de mixité qui, selon lui, serait le seul moyen d’intégrer du logement intermédiaire dans les programmes. Je suis très défavorable à cet amendement.
M. Christophe Caresche. Dans le dispositif actuel, la construction est conditionnée à l’existence dans le même immeuble de logements qui ne bénéficient pas du dispositif « Pinel », y compris du logement libre. Il s’agit bien de favoriser la construction de logements intermédiaires, en aucun cas de la contraindre.
M. le président Gilles Carrez. En zone tendue, on rencontre les pires difficultés pour développer une offre de logement intermédiaire. Il faut absolument supprimer les dispositions qui entravent la construction de ce type de logement.
Ce problème, j’en conviens, madame Berger, est spécifique aux zones très tendues dans lesquelles il existe un gouffre entre le logement social et le logement privé. Nous ne sommes pas capables de proposer une offre intermédiaire.
M. Hervé Mariton. Une partie de l’offre de logement en France est conditionnée par les avantages fiscaux qui y sont attachés.
La disposition que vous proposez de supprimer présente l’intérêt de déconnecter les programmes immobiliers de l’incitation fiscale alors que l’offre de logement est « droguée » à la fiscalité. Mais, je vous le concède, la situation diffère selon les zones. Dans certaines d’entre elles, elle peut avoir pour effet d’assécher toutes les initiatives qui n’entrent pas dans le cadre du « dispositif Pinel ».
M. le président Gilles Carrez. On se heurte toujours au même problème : des règles générales sont définies pour l’ensemble de la France alors que le loyer dans le parc privé à Cahors est moins élevé que le loyer dans le parc social au Perreux. La politique en matière de logement ne peut pas être la même sur tout le territoire.
Mme Karine Berger. Mon interlocuteur m’entretenait de la situation à Marseille. Selon lui, si les programmes ne comportent pas autre chose que du logement intermédiaire, ils ne se font pas. C’est un problème d’attractivité pour l’ensemble des partenaires, et en particulier pour la ville.
Mme la Rapporteure générale. Si le décret d’application n’est jamais sorti, c’est bien la preuve que les discussions sont compliquées et qu’aucune solution n’a été trouvée à ce jour.
J’ajoute que la suppression de cette condition n’interdit pas la mixité « programmatique », simplement elle ne l’impose pas.
M. Christophe Caresche. Le problème auquel nous sommes confrontés est le suivant : certaines opérations n’aboutissent pas car les opérateurs ne parviennent pas à remplir la condition de mixité. Nous avons intérêt à veiller à la lisibilité des dispositifs car, à force de complexifier, les opérateurs ne suivent plus.
M. Alain Fauré. Ce point ne peut-il pas être examiné dans le cadre du suivi de l’application de la loi ?
M. Dominique Lefebvre. Le logement intermédiaire est destiné aux ménages qui ne peuvent accéder ni au logement social, ni au marché locatif privé, ni à la propriété.
À Cergy, dans le logement social, le loyer est environ de 7 euros le mètre carré, tandis qu’il est entre 16 et 18 euros dans le secteur libre. Entre les deux, les ménages ne trouvent aucun logement.
Le logement intermédiaire est difficile à produire parce que les investisseurs rechignent, faute de réussir à louer facilement les logements ensuite – les loyers s’élèvent à 800 euros pour un F3, contre 1 200 euros dans le privé, ce qui est beaucoup pour des gens qui n’ont pas d’aide au logement. Je soutiens l’amendement de Christophe Caresche. En imposant une condition trop rigoureuse, on ne facilite pas les choses. Néanmoins, il faut permettre au promoteur de mutualiser les risques en lui laissant la possibilité d’inclure du logement locatif privé dans son opération. En revanche, si vous lui imposez de faire du logement locatif social, il ne suivra pas. C’est sans doute pour cela que le décret n’est jamais sorti.
M. le président Gilles Carrez. Je constate la même chose dans ma commune mais le montant des loyers est supérieur de 200 euros – et de 300 ou 400 euros à Paris.
M. le rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques. Cela fait deux ans que nous débattons du logement intermédiaire. Des doutes avaient été émis dès le départ, et il s’avère que cela ne fonctionne pas. Les quelques grands promoteurs et bailleurs sociaux qui ont vendu cette idée devraient s’interroger.
Construire du logement social s’avère compliqué mais, dans certaines communes, c’est indispensable. En revenant sur l’obligation de construire du logement social, à côté du logement intermédiaire, on remet en cause l’équilibre requis. Nous avions proposé l’année dernière d’imposer la construction de logement social non pas dans l’ensemble immobilier, mais sur le territoire de la commune.
Il faut assouplir les règles sans revenir sur celle qui oblige à construire du logement social en même temps que de l’intermédiaire.
M. le président Gilles Carrez. Ce n’est pas le sujet de l’amendement.
M. le rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques. Je veux répondre à Dominique Lefebvre qu’il faut être attentif à la mixité. Ceux qui portent les projets de logement intermédiaire ont ostracisé certaines communes qui n’étaient pas suffisamment intéressantes à leurs yeux, en particulier les plus défavorisées. Je peux d’autant moins l’admettre que 2 milliards d’euros de fonds publics y sont consacrés.
M. Jean-Louis Dumont. Les opérations de vente en l’état futur d’achèvement (VEFA), qui visent à la production aussi bien de logements en accession à la propriété que de logements locatifs intermédiaires, n’ont bien fonctionné au cours de ces dernières années que parce que les opérateurs investissaient : elles ont représenté 30 % des opérations menées en Île-de-France, 40 % des opérations conduites à Paris et 60 % des programmes de la métropole lyonnaise. Il conviendrait donc que nous redéposions en seconde partie du PLF des amendements permettant de monter des opérations correspondant à l’ensemble des besoins. Aujourd’hui, du fait des difficultés financières que nous connaissons, on réalise moins d’opérations d’accession à la propriété – qu’elle soit sociale ou libre. Peut-être serait-il temps de construire davantage de logements locatifs, ce qui pourrait redynamiser l’accession par la suite. Si l’on souhaite que le nombre de logements sociaux corresponde à l’ensemble des besoins, il convient de s’en donner les moyens. Quant à savoir si l’amendement de Christophe Caresche le permet, c’est à notre assemblée de le déterminer.
La commission adopte l’amendement I-CF 167.
*
* *
La commission examine l’amendement I-CF 280 de M. Razzy Hammadi.
M. Razzy Hammadi. Cet amendement d’appel revient sur une discussion que nous avons eue lors de notre précédent débat budgétaire concernant le financement des partis politiques. Il vise notamment un cas particulier ayant conduit le groupe socialiste, républicain et citoyen à demander la création d’une commission d’enquête sur le financement de certains partis politiques par des prêts bancaires en provenance de pays étrangers situés hors de la zone euro. Tout en conservant l’esprit de la loi en vigueur, rappelé dans notre exposé sommaire, nous proposons de faire en sorte que le don d’un particulier à un parti politique financé par des prêts étrangers ne puisse pas ouvrir droit à une réduction d’impôt.
Mme la Rapporteure générale. Mieux vaudrait d’abord saisir la Commission nationale des comptes de campagne afin qu’elle définisse un règlement interdisant le financement des partis par le biais d’emprunts à l’étranger – l’outil fiscal ne me paraissant pas le moyen le plus approprié pour atteindre cet objectif. D’autre part, l’adoption de cet amendement en première partie du projet de loi de finances priverait certains donateurs aux partis politiques de l’avantage fiscal dont ils pourraient bénéficier au titre de l’impôt sur le revenu de 2015. Je vous invite donc à retirer votre amendement.
M. Hervé Mariton. Je n’ai pas de tendresse particulière pour M. Poutine, mais soyons prudents : il existe, symétriquement, des mouvements politiques, en Russie et à Hong Kong par exemple, qui vivent en grande partie grâce à des financements étrangers. Si l’on considère comme totalement illégitime a priori tout financement étranger de partis politiques, cet argument risque d’être utilisé dans des pays moins amis de la démocratie que le nôtre, ce qui me paraît fort délicat.
M. Christophe Premat. Outre la question de l’opportunité de cet avantage fiscal, cet amendement présente des difficultés : en 2013, le Conseil constitutionnel a invalidé l’élection de deux députées des Français de l’étranger, entre autres au motif que des transferts d’argent avaient été effectués au profit de l’une d’elles ayant souscrit un emprunt auprès d’une banque américaine, et ce parce qu’elle ne pouvait régler certains frais de campagne avec une carte bancaire française. Ce point avait pourtant été signalé par son trésorier de campagne à la Commission nationale des comptes de campagne. Par ailleurs, certaines diasporas participent à notre vie politique en dehors de notre territoire.
Je comprends l’objectif de l’amendement, mais les campagnes électorales sont suffisamment compliquées à mener à l’étranger pour que nous n’y ajoutions pas un obstacle supplémentaire. La Commission nationale des comptes de campagne peut très bien exiger un justificatif de remboursement des prêts contractés auprès de banques étrangères.
M. Charles de Courson. Tout d’abord, monsieur Hammadi, vous semblez confondre les partis politiques, visés dans l’amendement, et les candidats aux élections, visés dans l’exposé sommaire, qui cite l’article L. 52-8 du code électoral.
Ensuite, l’amendement s’appuie sur l’hypothèse implicite d’un lien de dépendance politique entre le gouvernement et les établissements financiers de certains pays étrangers, ce qui est tout à fait inexact. Qu’un parti s’endette auprès d’une banque allemande ou belge au lieu d’une banque française, je ne vois pas où est le problème.
Enfin, tel que rédigé, l’amendement empêche un donateur qui s’endetterait auprès d’une filiale de banque française à l’étranger de bénéficier de l’avantage fiscal ici visé. C’est pourquoi cet amendement n’est pas opérant.
D’autre part, il s’agit d’un amendement ad hominem – ou ad mulierem – visant le Front national, parti qui n’est pas interdit en France. Cette proposition est politiquement contre-productive, car si elle est adoptée, les responsables de ce parti ne manqueront pas d’arguer qu’ils sont victimes de discriminations.
M. Razzy Hammadi. Je retire mon amendement, compte tenu du fait qu’il trouverait mieux sa place en seconde partie du projet de loi de finances. Notez cependant, monsieur de Courson, que cet amendement ne concerne que les établissements bancaires situés dans des pays hors de la zone euro.
Enfin, madame la Rapporteure générale, j’observe que la Commission nationale des comptes de campagne ne peut aujourd’hui être alertée, dans le cas où un prêt ne serait jamais remboursé par le parti politique et constituerait donc un apport en nature de la part d’une personnalité physique ou morale étrangère – ce qu’interdit la loi en vigueur –, que par l’établissement prêteur.
L’amendement I-CF 280 est retiré.
Puis la commission examine l’amendement I-CF 72 du président Gilles Carrez.
M. le président Gilles Carrez. Cet amendement est inspiré par le rapport d’information d’Olivier Carré et de Christophe Caresche sur l’investissement productif de long terme. Il vise à placer la réduction d’impôt sur le revenu « Madelin » non plus sous le plafond général de 10 000 euros, mais sous le plafond de 18 000 euros.
Mme la Rapporteure générale. Avis défavorable dans la mesure où nous avons décidé d’abaisser ce plafond applicable à la plupart des avantages fiscaux. À force d’introduire des exceptions, nous viderions cette décision de sa substance.
M. Dominique Lefebvre. Lors de la séance de présentation de ce rapport d’information, que j’ai eu l’honneur de présider, notre collègue Jean-Claude Fruteau a indiqué que si nous créions un plafonnement spécifique pour ce dispositif « Madelin », cela risquerait de désavantager les investissements en outre-mer. Je vous accorde que l’abaissement du niveau global du plafonnement peut soulever des questions, alors même que la réduction d’impôt au titre du dispositif « Malraux » est désormais hors plafond global, et que le dispositif de souscription au capital de sociétés de financement d’œuvres cinématographiques ou audiovisuelles (SOFICA) est placé sous le plafond spécifique de 18 000 euros. Mais une fois que l’on ouvre la boîte de Pandore, on ne s’en sort plus. Je suis donc moi aussi défavorable à cet amendement.
M. le président Gilles Carrez. Je présenterai donc en séance un amendement relatif aux SOFICA…
La commission rejette l’amendement I-CF 72.
Puis elle en vient à l’amendement I-CF 124 de M. Charles de Courson.
M. Charles de Courson. Cet amendement vise à remédier à la forte diminution du nombre d’heures déclarées dans le secteur des services d’aide à domicile. À ces heures se substitue pour partie aujourd’hui le travail au noir. De plus, les conseils départementaux, qui sont en situation difficile, ont durci les conditions d’accès à l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) : certains d’entre eux, financièrement étranglés, ont réduit de 10 %, voire de 20 %, le nombre d’heures accordées, par rapport à l’évaluation initialement effectuée par les médecins.
Autre phénomène auquel on assiste : la réorientation de l’emploi des fonds d’action sanitaire et sociale des caisses de retraite de base et complémentaires.
L’ensemble de ces facteurs entraîne une forte réduction du nombre d’heures déclarées. Il est donc proposé de rehausser le plafond global applicable à la réduction d’impôt au titre de l’emploi de salariés à domicile à 18 000 euros, soit au niveau en vigueur avant le 1er janvier 2013.
Mme la Rapporteure générale. Nous avons déjà eu ce débat. Le placement sous le plafond à 10 000 euros de la réduction d’impôt permet déjà de couvrir un volume horaire important. Je propose donc que nous en restions là.
La commission rejette l’amendement I-CF 124.
*
* *
Article 3
Abaissement du seuil de soumission à la TVA en France
pour les ventes à distance
Cet article abaisse de 100 000 à 35 000 euros, à partir de 2016, le seuil de chiffre d’affaires annuel à partir duquel la vente à distance de biens en provenance d’autres États membres de l’Union européenne doit être soumise à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) en France.
En application du I de l’article 258 du code général des impôts (CGI), les livraisons de biens qui nécessitent une expédition ou un transport à destination de leur acquéreur ne sont actuellement soumises à la TVA en France que si le lieu de départ du bien se trouve en France ou hors de l’Union européenne (bien importés). À l’inverse, si le bien livré en France provient d’un autre État membre de l’Union européenne, il n’est pas soumis à la TVA en France, mais dans l’État membre d’où il provient.
L’article 258 B du même code prévoit, toutefois, une dérogation limitée à ce principe pour certaines ventes à distance, conformément aux articles 33 et 34 de la « directive TVA » (44) : ainsi, est soumise à la TVA en France la vente, à une personne elle-même non redevable de la TVA (45), de biens meubles corporels « expédiés ou transportés en France à partir d’un autre État membre de la Communauté européenne, par le vendeur ou pour son compte », dans deux hypothèses :
– si le montant de ces ventes à distance effectuées par le vendeur en direction de la France a dépassé 100 000 euros (hors TVA) pendant l’année civile de la livraison ou celle qui a précédé ;
– si le vendeur a, indépendamment de son chiffre d’affaires, choisi dans l’État membre où il est établi, que ces livraisons devaient être considérées comme ayant eu lieu sur le territoire français.
Ces critères ne sont toutefois pas applicables aux ventes à distance à des particuliers d’alcools, huiles minérales ou tabacs, qui sont toujours soumises à la TVA en France. Elles ne le sont pas non plus aux livraisons de moyens de transport neufs, ni aux livraisons intracommunautaires de biens d’occasion, œuvres d’art, objets de collection ou antiquités, effectuées par des assujettis-revendeurs – ces opérations étant soumises respectivement, au régime prévu par l’article 138 de la directive TVA et à celui de la marge bénéficiaire prévu par ses articles 312 à 325.
Par conséquent, sous réserve des règles dérogatoires applicables à ces produits particuliers, les ventes à distance provenant d’un autre État membre peuvent actuellement échapper à la TVA française lorsque le chiffre d’affaires annuel du vendeur pour ces activités est resté inférieur à 100 000 euros.
Or, l’article 34 de la directive TVA (voir IV) autorise les États membres à fixer ce seuil à 100 000 euros où à 35 000 euros. Sans être isolée sur ce point au sein de l’Union européenne, la France fait partie, avec l’Allemagne, le Royaume-Uni, les Pays-Bas et le Luxembourg, des rares États dans lesquels le seuil est situé à 100 000 euros ou proche de ce niveau (46). Les vingt-trois autres États membres ont opté le plus souvent pour un seuil égal à 35 000 euros, ou encore pour un seuil encore inférieur (cas de la Roumanie) ou voisin de 40 000 euros (cas de la Pologne et de la République tchèque).
SEUILS DE CHIFFRE D’AFFAIRES AU-DELÀ DESQUELS LES VENTES À DISTANCE DE BIENS SONT SOUMISES À LA TVA DE L’ÉTAT MEMBRE DE DESTINATION
État membre |
Seuil de soumission à la TVA (en euros) |
Allemagne |
100 000 |
Autriche |
35 000 |
Belgique |
35 000 |
Bulgarie |
35 791 |
Chypre |
35 000 |
Croatie |
35 621 |
Danemark |
37 498 |
Espagne |
35 000 |
Estonie |
35 000 |
Finlande |
35 000 |
France |
100 000 |
Grèce |
35 000 |
Hongrie |
35 000 |
Irlande |
35 000 |
Italie |
35 000 |
Lettonie |
35 000 |
Lituanie |
35 000 |
Luxembourg |
100 000 |
Malte |
35 000 |
Pays-Bas |
100 000 |
Pologne |
39 822 |
Portugal |
35 000 |
République tchèque |
41 583 |
Roumanie |
26 700 |
Royaume-Uni |
97 656 |
Slovaquie |
35 000 |
Slovénie |
35 000 |
Suède |
34 366 |
Source : évaluation préalable des articles jointe au projet de loi de finances pour 2016.
Le nombre de personnes déclarant la TVA en France dans le cadre de ventes à distance effectuées à partir d’un autre État membre de l’Union européenne tend à progresser, tout en restant limité : ce nombre est passé de 422 en 2012 à 834 en 2014. De même, les recettes de TVA perçues par l’État à ce titre ont augmenté, passant de 167,2 millions d’euros en 2012 à 293,8 millions d’euros en 2014, ce qui reflète avant tout le dynamisme du commerce en ligne.
Cette évolution favorable devrait se poursuivre aussi grâce à l’élargissement du droit de communication décidé au profit de l’administration fiscale à l’égard des opérateurs de téléphonie et d’internet, décidé dans le cadre de la seconde loi de finances rectificative pour 2014 (47). Ce changement a, en outre, été complété depuis lors par trois actes réglementaires pris, le 16 juillet dernier (48), pour renforcer les moyens de contrôle de l’administration fiscale vis-à-vis de l’activité d’entreprises étrangères procédant à des ventes à distance en direction de la France. Ainsi, la capacité de contrôle des agents de la direction générale des finances publiques (DGFiP) a été, pour le contrôle des entreprises étrangères n’ayant pas leur siège en France mais y réalisant des opérations taxables, étendue à la direction nationale des enquêtes fiscales (DNEF) et aux directions spécialisées du contrôle fiscal (DIRCOFI).
Pour autant, le fait que les entreprises d’autres États membres de l’Union européenne procédant à des ventes à distance en France ne soient pas tenues de se soumettre à la TVA dans notre pays en-deçà de 100 000 euros de chiffre d’affaires prive notre pays de recettes d’autant plus importantes que le commerce en ligne se développe rapidement.
Selon le rapport d’activité 2014-2015 de la Fédération e-commerce et vente à distance (FEVAD), le nombre de sites marchands actifs sur internet s’est établi, en 2014, à 157 300 (en hausse de 14 % par rapport à 2013) et a représenté un chiffre d’affaires de 56,8 milliards d’euros (en hausse de 11 % par rapport en 2013). Cette évolution s’est poursuivie en 2015, puisque les ventes auraient encore progressé de 16 % au cours du deuxième trimestre et qu’il existerait désormais 167 650 sites actifs pour le commerce en ligne. Selon la FEVAD, ce secteur représentait 112 000 emplois en France en 2014 et notre pays serait le sixième plus important au monde pour le chiffre d’affaires du commerce en ligne – les cinq pays où ces transactions représentent les montants les plus importants étant, par ordre décroissant, la Chine, les États-Unis, le Royaume-Uni, le Japon et l’Allemagne.
Cette question doit être étudiée en prenant également en compte l’évolution récente des règles applicables à d’autres achats en ligne – ceux qui ne concernent pas des biens matériels. Ainsi, depuis le 1er janvier 2015, les services électroniques sont toujours soumis à la TVA de l’État membre où se trouve le client, et non plus dans celui où est établie l’entreprise vendant ces services. À cet égard, les systèmes fiscaux en vigueur au sein de l’Union européenne présentent un visage plus cohérent lorsqu’ils tendent à soumettre la vente en ligne de biens à des règles de territorialité proches de celles qui sont désormais applicables pour la vente de services électroniques.
Il convient, enfin, de rappeler que les taux de TVA en vigueur au sein de l’Union européenne sont compris, pour le taux normal, entre 17 et 27 %.
TAUX NORMAL DE TVA APPLICABLE DANS LES ÉTATS MEMBRES
DE L’UNION EUROPÉENNE
État membre |
Taux normal de TVA |
Allemagne |
19 % |
Autriche |
20 % |
Belgique |
21 % |
Bulgarie |
20 % |
Chypre |
19 % |
Croatie |
25 % |
Danemark |
25 % |
Espagne |
21 % |
Estonie |
20 % |
Finlande |
24 % |
France |
20 % |
Grèce |
23 % |
Hongrie |
27 % |
Irlande |
23 % |
Italie |
22 % |
Lettonie |
21 % |
Lituanie |
21 % |
Luxembourg |
17 % |
Malte |
18 % |
Pays-Bas |
21 % |
Pologne |
23 % |
Portugal |
23 % |
République tchèque |
21 % |
Roumanie |
24 % |
Royaume-Uni |
20 % |
Slovaquie |
20 % |
Slovénie |
22 % |
Suède |
25 % |
Source : Commission européenne.
L’article propose, dans son paragraphe I, de modifier ponctuellement le 1° du paragraphe I de l’article 258 B du CGI pour abaisser de 100 000 à 35 000 euros le montant des ventes à distances effectuées en France au-delà duquel le vendeur devra obligatoirement être soumis à la TVA en France. Il procède par ailleurs à un toilettage rédactionnel de ce même article, en substituant la référence à l’Union européenne à celle, obsolète, de « Communauté européenne ».
Il est par ailleurs précisé, dans le paragraphe II de cet article, que ces changements seront applicables aux opérations dont le fait générateur sera intervenu à partir du 1er janvier 2016. Rappelons que le fait générateur, qui est l’événement dont l’existence fonde l’imposition, se situe, pour les livraisons de biens et en application de l’article 269 du CGI, au moment où intervient le transfert du pouvoir de disposer du bien comme un propriétaire, c’est-à-dire lorsque le bien a été reçu par son destinataire.
L’article 258 B du CGI, qui définit les règles de territorialité applicables aux ventes à distance, n’a fait jusqu’ici l’objet que de toilettages techniques. Ceux-ci ont résulté de l’ordonnance du 19 septembre 2000 prise pour dans le cadre du passage du franc à l’euro (49) – avant le 1er janvier 2002, le seuil de soumission à la TVA française était fixé à 700 000 francs –, ainsi que de la loi de finances rectificative pour 2007 du 25 décembre 2007 (50) s’agissant de la mise à jour de la référence à la « directive TVA ».
Le changement proposé ne paraît pas soulever de problème de compatibilité avec le droit de l’Union européenne. En effet, le premier alinéa du 2 de l’article 34 de la directive TVA précise que, pour les ventes à distance effectuées entre États membres, l’État de destination « peut limiter le seuil [de soumission à la TVA sur son territoire] à la somme de 35 000 euros […] dans le cas où cet État membre craint que le seuil de 100 000 euros ne conduise à de sérieuses distorsions de concurrence ». Tel est bien le cas en France pour les ventes à distance, compte tenu des écarts existant entre le taux normal de TVA applicable dans notre pays, lequel est fixé à 20 %, et celui que pratiquent d’autres États membres – ces taux variant de 17 % au Luxembourg (15 % encore en 2014) à 25 % au Danemark, en Croatie et en Suède, et même 27 % en Hongrie.
Cet abaissement du seuil de soumission à la TVA française des ventes à distance de biens meubles devrait avoir un effet économique doublement positif.
En effet, il permettra d’abord, grâce à l’élargissement de l’assiette des biens dont la livraison est soumise à la TVA en France, d’accroître les recettes annuelles de l’État d’un montant que le Gouvernement estime à 5 millions d’euros.
Il aura, surtout, pour grand intérêt de réduire le nombre de ventes à distance susceptibles d’être taxées plus ou moins lourdement en fonction de la fiscalité applicable dans l’État membre de provenance. Grâce à ce changement, les distorsions de concurrence entre entreprises de l’Union européenne vendant le même type de produits seront réduites, ce qui pourra s’avérer positif pour les entreprises françaises subissant actuellement la concurrence d’entreprises établies dans des États, tels que le Luxembourg, où la TVA est plus faible.
Par ailleurs, l’alignement du seuil en vigueur en France, pour la soumission à la TVA du pays de destination, sur le seuil qui prédomine dans les autres États membres contribuera à l’harmonisation européenne de ces règles fiscales – ce qui contribuera à faciliter, dans ce domaine, la révision de la « directive TVA » qui devrait faire l’objet, en 2016, de discussions européennes. En outre, la Commission européenne a annoncé, dans une communication du 6 mai dernier sur le marché numérique en Europe, qu’elle formulerait en 2016 des propositions législatives pour étendre à ces opérations le système électronique d’enregistrement et de paiement unique (dit « mini-guichet »). Enfin, il est prévu que des discussions soient engagées au niveau européen sur une future baisse des seuils de soumission à la TVA applicable aux ventes à distance, ainsi que sur un élargissement de ce dispositif aux ventes à distance de biens en provenance d’États non membres de l’Union européenne. De ce point de vue, le changement proposé par cet article paraît cohérent et s’accorde bien avec les orientations plus largement débattues au niveau européen.
*
* *
La commission adopte l’article 3 sans modification.
*
* *
La commission aborde l’amendement I-CF 146 de M. Hervé Féron.
M. Michel Vergnier. Il s’agit d’un amendement d’appel. À situation exceptionnelle, mesures exceptionnelles. La situation dramatique que connaissent aujourd’hui nos éleveurs pénalise gravement nos territoires, à commencer par les plus fragiles d’entre eux. Nous proposons donc de dispenser ces éleveurs à titre provisoire du remboursement de la TVA sur les ventes d’animaux.
Mme la Rapporteure générale. Je partage l’objectif, poursuivi par Michel Vergnier, de soutien à l’élevage. Cependant, son amendement pose un problème de conformité au droit européen : la directive sur la TVA prévoit, en ses articles 132, 135 et 136, une liste de produits éligibles aux exonérations de TVA, dont est exclue la vente d’animaux. De sorte qu’en cas de recours devant la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), les éleveurs devront rembourser ces exonérations par la suite comme cela s’est produit pour les plants de campagne en arboriculture. J’émets donc un avis défavorable à cet amendement.
M. Charles de Courson. Il serait intéressant de prendre connaissance du dispositif allemand de remboursement de TVA agricole, qui ne me semble pas avoir été remis en cause par l’Union européenne. Nous pourrions ainsi déposer un amendement qui en reprendrait le mécanisme.
M. Michel Vergnier. Je vous remercie de vos réponses. Cet amendement d’appel visait avant tout à mettre en évidence une situation gravissime.
L’amendement I-CF 146 est retiré.
Puis la commission examine, en discussion commune, les amendements I-CF 9 de M. Marc Le Fur, I-CF 241 de Mme Marie-Christine Dalloz et I-CF 219 de M. Charles de Courson.
Mme Marie-Christine Dalloz. Aujourd’hui, seul 15 % du bois de chauffage vendu l’est dans un cadre légal. C’est dire la perte de recettes que représentent pour l’État les 85 % restants. La fixation du taux de TVA à 10 % sur le bois de chauffage est donc une aberration.
Notre amendement, loin de représenter un coût pour le Trésor public, pourrait rapporter des sommes considérables. Paradoxalement, alors qu’au fil des ans, la filière s’est organisée et professionnalisée en créant des labels tels que NF Biocombustibles solides, France Bois Bûche, ONF Énergie Bois, elle ne parvient pas à décoller. C’est pourquoi nous proposons de ramener ce taux de TVA à 5,5 %. Cet amendement aura un impact positif sur les territoires ruraux et les entreprises qui s’y trouvent.
M. Charles de Courson. Vivant dans une zone forestière, j’y constate le développement du travail au noir qui, au niveau national, est évalué à 85 %. Cet amendement coûterait fort peu, voire pourrait rapporter au budget de l’État. Sans parler de la dimension écologique qu’il revêt puisqu’il s’agit d’une énergie renouvelable.
Mme la Rapporteure générale. Avis défavorable. La consommation des autres énergies est soumise à un taux de TVA de 20 %, alors que le bois bénéficie d’un taux de 10 %, soit deux fois moins. Cet avantage paraît suffisant.
M. Alain Fauré. Que le taux de TVA soit fixé à 10 % ou à 5,5 % ne changera rien car, le plus souvent, les vendeurs privés de bois de chauffage ne sont pas des adeptes de la déclaration de TVA, qu’elle soit mensuelle, trimestrielle ou annuelle…
La commission rejette successivement les amendements I-CF 9, I-CF 241 et I-CF 219.
Suivant l’avis défavorable de la Rapporteure générale, elle rejette l’amendement I-CF 86 de M. Laurent Grandguillaume.
Puis elle examine les amendements identiques I-CF 135 de M. Charles de Courson, I-CF 148 de M. Joël Giraud, I-CF 290 de M. Éric Alauzet et I-CF 378 de M. Marc Le Fur.
M. Charles de Courson. Il s’agit d’un amendement de cohérence avec le projet de loi relatif à l’adaptation de la société au vieillissement.
M. Joël Giraud. Cet amendement vise à maintenir le taux réduit de TVA pour les organismes et entreprises entrant dans le champ des services à la personne en vue de l’application, en 2021, du projet de loi précité.
Mme la Rapporteure générale. Comme précédemment, en raison de la date d’application prévue et de la navette parlementaire encore en cours, je vous invite à retirer ces amendements.
Les amendements I-CF 135, I-CF 148, I-CF 290 et I-CF 378 sont retirés.
La commission étudie l’amendement I-CF 341 de M. Razzy Hammadi.
M. Razzy Hammadi. Depuis de nombreuses années, le législateur applique un taux de TVA de 5,5 % à la billetterie du spectacle vivant, mais un taux de 20 % aux concerts de musique électronique – genre musical dans lequel la France est en pointe et dispose d’une attractivité avérée. Cette distinction me paraît à la fois un anachronisme et une incohérence. Qui plus est, les « platinistes » se voient souvent infliger une imposition forfaitaire plutôt que de bénéficier du statut d’intermittent du spectacle, précisément parce que les propriétaires de salle ou d’établissement intègrent la TVA dans le coût de leur prestation. Il s’agit donc d’une mesure de justice, de progrès, de simplification, d’attractivité et d’harmonisation.
Mme la Rapporteure générale. L’amendement vise à un double élargissement du bénéfice du taux de TVA à 5,5 % aux spectacles pendant lesquels il est d’usage de servir de la nourriture ou des boissons aux spectateurs, d’une part, et d’autre part, aux représentations musicales auxquelles participe au moins un artiste, et non plus aux seuls concerts. Il n’existe pas d’obstacle communautaire au bénéfice du taux réduit de TVA pour ces activités. Pour autant, je m’interroge sur la portée réelle de l’amendement, car il me semble qu’il élargirait aussi le bénéfice du taux de 5,5 % à certains cabarets.
M. Razzy Hammadi. Les cabarets bénéficient déjà du taux réduit.
Mme la Rapporteure générale. J’ignore, d’autre part, quel serait le coût d’une telle mesure. J’émets donc un avis défavorable.
Mme Karine Berger. De plus en plus de spectacles vivants de musique classique sont retransmis en direct. C’est d’ailleurs de cette nouvelle source de recettes que provenait, l’an dernier, la quasi-totalité des ressources budgétaires du Metropolitan Opera de New York. La France étant assez timide en la matière, je suis persuadée qu’une mesure prenant en compte la diffusion d’arts vivants se déroulant en direct – tels que le festival off d’Avignon – grâce aux nouvelles technologies serait une avancée. J’entends bien qu’il faille évaluer le coût de la mesure d’ici à la séance publique. Mais ne croyez pas qu’un tel dispositif ne bénéficiera qu’aux seuls disc-jockeys (DJ) – dont le travail est par ailleurs fort respectable.
M. Razzy Hammadi. Par le passé, comme on ne parvenait pas à distinguer entre le spectacle vivant et la représentation dans des lieux particuliers, l’administration fiscale a inventé le critère de consommation pendant la représentation. Aujourd’hui, les spectateurs consomment de la nourriture ou de l’alcool lors de la quasi-totalité des spectacles vivants de sorte que les organisateurs desdits spectacles n’ont pas l’assurance réglementaire de bénéficier du taux réduit de TVA. Je vous propose de simplifier la règle en adoptant une mesure d’harmonisation et de progrès.
M. Dominique Lefebvre. Lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2014, nous avons eu un débat important sur la TVA et le reclassement de ses taux. La structure actuelle en trois taux – de 5,5 %, 10 % et 20 % – me semble plus cohérente que par le passé. Il existe toujours de bonnes raisons de passer son temps à reclasser des produits ou des activités entre les différents taux. D’autres amendements du même ordre suivront d’ailleurs concernant les transports publics ou les parcs à thème – quand il ne s’agit pas du bois de chauffage ou des DJ. Ma position de principe est donc la suivante : moins on modifiera le classement des taux de TVA et plus on s’économisera de tels débats, mieux on se portera – ces débats ne portant in fine que sur des mesures symboliques.
Mme la Rapporteure générale. Je m’en remets à la sagesse de la commission.
La commission rejette l’amendement I-CF 341.
Puis elle se penche sur les amendements I-CF 10 et I-CF 11 de M. Marc Le Fur.
Mme Marie-Christine Dalloz. Dominique Lefebvre affirme que nos amendements sont presque anecdotiques : les personnes concernées apprécieront…
Il s’agit en effet, par l’amendement I-CF 10, de ramener à 5,5 % le taux de TVA applicable aux transports publics de voyageurs au quotidien, qu’ils soient urbains, départementaux ou régionaux – ce qui inclut le transport scolaire et le transport spécialisé pour les personnes en situation de handicap. Le transport scolaire coûte en effet fort cher aux départements qui ont décidé d’en maintenir la gratuité pour alléger le budget des familles.
L’amendement I-CF 11 est analogue, mais concerne les services et programmes fournissant à l’ensemble de la population l’énergie, les systèmes d’assainissement et l’eau.
Mme la Rapporteure générale. Avis défavorable. Le coût du premier amendement est évalué à au moins 500 millions d’euros, le second à quelque 120 millions d’euros.
M. Dominique Lefebvre. Madame Dalloz, il me semble effectivement symbolique d’appliquer un taux de TVA à 5,5 % à la billetterie des parcs à thème, sachant qu’on ne s’y rend pas tous les jours. Quant à vos deux amendements, ils ne sont effectivement pas anecdotiques en termes de recettes de TVA…
Il faudra un jour que les Républicains nous expliquent comment ils comptent supprimer l’impôt de solidarité sur la fortune, baisser l’impôt sur le revenu, en supprimer la tranche à 45 % et diminuer les impôts indirects tout en équilibrant le budget de l’État. De manière générale, ce parti a tendance à promouvoir les impôts indirects : peut-être entend-il relever le taux normal à 21 %, voire à 33 % sur les voitures et produits de luxe, comme le proposait le Parti communiste à une certaine époque.
Mme Marie-Christine Dalloz. Je tiens à vous rassurer, monsieur Lefebvre : le programme des Républicains se construit sans que nous ayons besoin de vous demander votre avis. C’est le rôle de l’opposition que de formuler des propositions divergentes de celles de la majorité.
La commission rejette successivement les amendements I-CF 10 et I-CF 11.
Elle en vient ensuite à l’amendement I-CF 12 de M. Marc Le Fur.
Mme Marie-Christine Dalloz. L’amendement I-CF 12 concerne la distinction entre la vente à emporter et la vente à consommer sur place.
Quant à l’amendement I-CF 13 qui suit, il vise les parcs à thèmes, les zoos, les châteaux et les musées privés et coûte très peu cher d’après Dominique Lefebvre.
Mme la Rapporteure générale. Avis défavorable : l’amendement I-CF 12 entre en contradiction avec les principes de la « directive TVA » consistant à taxer les opérations économiques en fonction de leur nature, et non de la personne qui les effectue.
La commission rejette l’amendement I-CF 12.
Puis elle examine en discussion commune les amendements I-CF 13 de M. Marc Le Fur et I-CF 133 de M. Philippe Vigier.
M. Charles de Courson. Mettant fin à un traitement identique, la loi de finances pour 2014 a porté le taux de TVA des spectacles vivants – théâtres, chansonniers, cirques, concerts – à 5,5 % et celui des parcs à thème à 10 %. Cette évolution n’est guère cohérente.
Mme la Rapporteure générale. Le coût de cet amendement étant évalué à 75 millions d’euros, j’y suis défavorable.
La commission rejette les amendements I-CF 13 et I-CF 133.
Elle aborde ensuite les amendements identiques I-CF 291 de Mme Brigitte Allain et I-CF 391 de la commission des affaires économiques.
Mme Eva Sas. Adoptés par la commission des affaires économiques, ces amendements visent à réduire à 5,5 % le taux de TVA applicable aux plats entièrement « bio ». Jusqu’ici, on nous a toujours opposé l’argument selon lequel nos amendements en la matière étaient trop flous. Nous proposons donc ici une définition très ciblée.
M. le rapporteur de la commission des affaires économiques. Défendu.
Mme la Rapporteure générale. Avis défavorable. Imaginons que certains plats servis au cours d’un même soient issus de l’agriculture biologique et d’autres non : il serait compliqué, d’un point de vue comptable, d’appliquer différents taux de TVA à un même repas.
M. Dominique Lefebvre. Qui plus est, comment contrôler l’application d’une telle mesure ?
La commission rejette les amendements I-CF 291 et I-CF 391.
Elle en vient à l’amendement I-CF 293 de M. Éric Alauzet.
Mme Eva Sas. Cet amendement vise à appliquer un taux réduit de TVA à la gestion des déchets et aux actions de prévention, de collecte sélective et de valorisation des déchets. Il s’agit de préconisations du Comité permanent pour la fiscalité écologique qui permettraient d’encourager les opérations de prévention et de valorisation de la matière dans la gestion des déchets. Cette baisse de TVA serait aussi de nature à créer des emplois dans les filières de recyclage et de prévention des déchets.
Mme la Rapporteure générale. Avis défavorable. Cet amendement présente un risque d’incompétence négative puisqu’il ne définit pas avec précision la notion de prévention des déchets. Le coût du dispositif est estimé entre 60 et 80 millions d’euros.
La commission rejette l’amendement I-CF 293.
*
* *
Article additionnel après l’article 3
Conditions d’application du taux réduit de TVA aux opérations d’accession sociale à la propriété dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville
La commission est saisie de l’amendement I-CF 409 de la commission des affaires économiques.
M. le rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques. Nous avons étendu l’an dernier le bénéfice du taux réduit de TVA aux opérations d’accession sociale à la propriété réalisée dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, mais ce bénéfice était subordonné à la signature d’un contrat de ville. Or, certains promoteurs ont déposé leur permis de construire quelques jours avant cette signature. Nous proposons donc que ce taux réduit de TVA s’applique lors de l’année de signature du contrat de ville.
Mme la Rapporteure générale. Lorsque nous avions abordé ce point en séance publique, le Gouvernement s’était engagé à faire preuve de souplesse au cours des premiers mois de mise en application du dispositif. Je vous propose donc d’interroger directement le ministre des finances à ce sujet.
M. Marc Goua. La signature des nouveaux contrats de ville a pris un retard considérable, dû non pas aux collectivités locales, mais à l’État.
M. Dominique Lefebvre. S’il me paraît normal de conditionner cet avantage à l’existence d’un contrat de ville qui engage les parties, il est absurde d’appliquer la règle en fonction de la date de signature d’un tel contrat, qui dépend de certaines contingences administratives et politiques. Peut-être obtiendrons-nous un engagement du Gouvernement en séance publique, mais, en attendant, je propose que nous adoptions cet amendement.
La commission adopte l’amendement I-CF 409.
*
* *
Article additionnel après l’article 3
Conditions d’application du taux réduit de 10 % de TVA aux opérations de construction de logements intermédiaires
La commission examine l’amendement I-CF 404 de la commission des affaires économiques.
M. le rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques. Aujourd’hui, le taux de TVA de 10 % ne s’applique aux opérations de construction de logements intermédiaires que si celles-ci comprennent également 25 % de logements sociaux. Or, le Gouvernement souhaite qu’il y ait moins de constructions de logements sociaux dans les quartiers qui en comptent déjà une proportion importante. Nous proposons donc que dans les territoires comportant plus de 50 % de logements sociaux ou faisant l’objet d’un programme de rénovation urbaine, il soit possible de construire des logements intermédiaires au taux réduit de TVA sans avoir à réaliser des logements sociaux supplémentaires.
Mme la Rapporteure générale. Je souscris à l’esprit de cet amendement, mais il me faudra en vérifier auprès du Gouvernement la conformité au droit européen. Je m’en remets donc à la sagesse de la commission.
La commission adopte l’amendement I-CF 404.
*
* *
La commission examine l’amendement I-CF 292 de M. Denis Baupin.
Mme Eva Sas. Une entreprise disposant d’une flotte de véhicules de société peut récupérer la TVA si ces véhicules sont équipés d’un moteur diesel, mais pas s’ils roulent à l’essence. Pour des raisons de réglementation européenne, nous ne pouvons empêcher la récupération de la TVA sur les véhicules diesel. Nous proposons donc d’autoriser cette récupération sur les deux types de véhicules. Cela aura certes un coût mais entraînera également une augmentation des recettes de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE), puisque la taxe applicable aux véhicules roulant à l’essence est plus élevée que la celle applicable aux véhicules roulant au diesel.
Mme la Rapporteure générale. Avis défavorable. Passer du jour au lendemain de zéro à 80 % de déductibilité est par trop radical. Par ailleurs, la référence faite aux essences paraît pouvoir correspondre à d’autres carburants mentionnés au tableau du B de l’article 265 du code des douanes, telles que les essences d’aviation : est-ce volontaire ? Enfin, le coût de la mesure dépasserait les 50 millions d’euros.
Mme Eva Sas. Nous ne pouvons plus tergiverser face à une règle aussi aberrante. Nous devons absolument résoudre ce problème.
M. Dominique Lefebvre. Nous allons aborder dans la suite du débat plusieurs amendements portant sur la fiscalité écologique. Je formulerai systématiquement la même recommandation : que ces amendements soient redéposés en vue de la séance, pour nous permettre d’en débattre et d’entendre la réponse du ministre des finances. En revanche, il me paraît inopportun d’adopter, dès maintenant, des mesures alors que l’ensemble de ces sujets devrait être traité dans le cadre du prochain projet de loi de finances rectificative qui sera adopté en Conseil des ministres au début du mois de novembre et discuté dans l’hémicycle en pleine COP21.
La commission rejette l’amendement I-CF 292.
*
* *
Article 4
Limitation des effets de seuils dans les TPE et les PME
Le présent article neutralise les effets de seuils d’effectifs applicables aux TPE et PME pendant les trois ans qui suivent leur franchissement, relève de manière pérenne les seuils de neuf et dix salariés à onze salariés et simplifie les méthodes de calcul des seuils.
Le coût des dispositifs fiscaux concernés est mal connu (cf. tableau infra). Le Gouvernement évalue le coût de ces mesures à 152 millions d’euros par an (cf. tableau du II.B.), en année pleine, ce qui est certainement un minorant. Ce surcoût sera supporté par l’État (105 millions d’euros), la sécurité sociale (27 millions d’euros) et les collectivités territoriales. Pour ces dernières, il est toutefois jugé marginal. En outre, la collecte au profit de la formation professionnelle serait réduite à hauteur de 20 millions d’euros.
Ce dispositif s’inscrit dans la suite du conseil restreint sur l’emploi et l’activité dans les TPE et les PME, au cours duquel le Premier ministre a présenté, le 9 juin 2015, dix-huit « mesures fortes pour lever les freins, les incertitudes, simplifier la vie des TPE et des PME et donc encourager l’embauche ».
TABLEAU RÉCAPITULATIF
Dispositif concerné |
Prélèvement concerné |
Base légale |
Coût 2016 (en millions d’euros) |
Personnes concernées |
Existence d’un mécanisme de sortie progressive avant la réforme |
Mesure de seuil proposée |
Exonération d’impôt sur les bénéfices dans les zones de revitalisation rurale (ZRR) pour les entreprises de moins de dix salariés |
IS IR CFE CVAE TFPB |
Article 44 quindecies du CGI |
7* |
Entreprises de moins de dix salariés |
Mécanisme de « sortie en sifflet » en huit ans |
Relèvement du seuil de dix à onze salariés et neutralisation temporaire des effets de seuils |
Exonération de cotisation foncière des entreprises pour les petits commerces installés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) |
CFE |
I septies de l’article 1466 A du CGI |
nc |
Entreprises commerciales de moins de dix salariés |
L’exonération dure cinq ans et est pourvue d’un mécanisme de « sortie en sifflet » de trois ans |
Relèvement du seuil de dix à onze salariés |
Crédit de CFE en faveur des très petites entreprises situées dans une zone de restructuration de la défense (ZRD) |
CFE |
Article 1647 C septies du CGI |
3 |
Entreprises de moins de dix salariés |
Aucun |
Relèvement du seuil de dix à onze salariés et neutralisation temporaire des effets de seuils |
Participation des employeurs de moins de dix salariés au financement de la formation professionnelle continue (FPC) |
Participation à la FPC |
Articles 235 ter D et 235 ter KA du CGI |
nc |
Entreprises de moins de dix salariés |
Taux réduit pendant trois ans suivi d’un mécanisme de « sortie en sifflet » pendant trois ans |
Relèvement du seuil de dix à onze salariés |
Non-assujettissement des employeurs de moins de dix salariés au forfait social |
Forfait social |
Article L. 137-15 du code de la sécurité sociale |
nc |
Employeurs de moins de dix salariés |
Aucun |
Relèvement du seuil de dix à onze salariés et neutralisation des effets de seuils |
Exonération de versement transports pour les employeurs de moins de neuf salariés |
Versement transport |
Articles L. 2333-64 et L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales |
nc |
Employeurs de moins de neuf salariés |
Exonération pendant trois ans suivie d’un mécanisme de « sortie en sifflet » pendant trois ans |
Harmonisation des seuils à onze salariés |
Option pour le régime des sociétés de personnes pour les entreprises de moins de cinquante salariés |
IS IR |
Article 239 bis AB du CGI |
nc |
Entreprises de moins de cinquante salariés |
Aucun |
Neutralisation temporaire de l’effet de seuil |
Crédit d’impôt sur les primes d’intéressement pour les entreprises de moins de cinquante salariés |
IR IS |
Article 244 quater T du CGI |
29 |
Entreprises de moins de cinquante salariés |
Neutralisation du franchissement du seuil d’assujettissement à la participation pendant trois ans introduit par l’article 156 de la loi du 6 août 2015 pour la croissance et l’activité |
Neutralisation temporaire de l’effet de seuil |
Abattement de cotisation de taxe sur les salaires pour les mutuelles de moins de trente salariés |
TS |
Article 1679 A du CGI |
nc |
Mutuelles de moins de trente salariés |
Aucun |
Neutralisation temporaire de l’effet de seuil |
Déduction forfaitaire applicable en matière de cotisations sociales dues au titre des heures supplémentaires |
Cotisations sociales patronales |
Article L. 241-18 du code de la sécurité sociale |
nc |
Entreprises de moins de vingt salariés |
Mécanisme de neutralisation de l’effet de seuil pour les entreprises le franchissant en 2013, 2014 et 2015. |
Neutralisation temporaire de l’effet de seuil |
Exonération de CFE pour les micro-coopératives agricoles |
CFE |
Article 1451 du CGI |
nc |
Coopératives agricoles de trois salariés au plus ; mutuelles agricoles de deux salariés au plus |
Les coopératives agricoles qui ne bénéficient pas de l’exonération ont tout de même un abattement de 50 % (article 1468 du CGI) |
Neutralisation temporaire de l’effet de seuil |
IS : impôt sur les sociétés. IR : impôt sur le revenu. TF : taxe foncière. CFE : contribution foncière des entreprises. TS : taxe sur les salaires. CGI : code général des impôts.
(*) Chiffre 2014 (évaluation préalable).
Source : commission des finances, d’après l’évaluation préalable.
I. L’ÉTAT DU DROIT
Le plan gouvernemental de lissage des effets de seuil concerne douze dispositifs qui soutiennent aujourd’hui les petites et très petites entreprises dans leur installation en zones prioritaires, dans leur développement ou dans la mise en œuvre du droit social.
A. LES SEUILS DE NEUF ET DIX SALARIÉS SUSCEPTIBLES D’ÊTRE RELEVÉS
Le relèvement des seuils à proprement parler concerne six dispositifs. Il permet d’harmoniser à onze les seuils voisins mais formulés différemment de neuf et dix salariés.
1. L’exonération d’impôt sur les bénéfices dans les zones de revitalisation rurale pour les entreprises de moins de dix salariés
Les exonérations d’impôt sur les bénéfices pour les entreprises nouvelles font partie intégrante de la politique d’aménagement du territoire depuis 1995.
En application de l’article 44 quindecies du code général des impôts (CGI), les entreprises de moins de dix salariés créées ou reprises entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2015 dans les zones de revitalisation rurale (ZRR) sont exonérées d’impôt sur les bénéfices totalement pendant cinq ans, puis partiellement pendant trois ans : exonération à hauteur des trois quarts la première année, de la moitié la seconde année et du quart la troisième année suivant la période d’exonération totale. Sont exclues du dispositif les entreprises exerçant une activité bancaire, financière, d’assurances, de gestion ou de location d’immeubles et de pêche maritime, ainsi que les filiales d’autres entreprises et les extensions d’activités préexistantes.
TAUX D’EXONÉRATION SUR LES BÉNÉFICES DANS LES ZONES DE REVITALISATION RURALE POUR LES ENTREPRISES FRANCHISSANT LE SEUIL DE DIX SALARIÉS
(en %)
Année |
N |
N + 1 |
N + 2 |
N + 3 |
N + 4 |
N + 5 |
N + 6 |
N + 7 |
N + 8 |
Taux |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
75 |
50 |
25 |
– |
Prévu initialement jusqu’au 31 décembre 2013, le dispositif a été prorogé par l’article 47 de la seconde loi de finances rectificative pour 2014 (51) jusqu’au 31 décembre 2015.
Le coût du dispositif a été évalué à 3 millions d’euros en 2011 pour 1 948 entreprises bénéficiaires, 6 millions d’euros en 2012 et 9 en 2013. Selon le rapport d’évaluation du dispositif de revitalisation rurale publié en juillet 2014 (52), le dispositif a fait la preuve de son efficacité pour inciter les petits entrepreneurs à reprendre des activités artisanales ou commerciales, en compensant en partie leurs difficultés d’accès au crédit. Le dispositif est également attractif pour les professions libérales, en particulier médicales. Il était donc recommandé de proroger le dispositif à compter du 1er janvier 2015 et pour une période d’au moins trois ans (recommandation n° 3).
La réforme proposée par le Gouvernement vise à augmenter le seuil de dix à onze salariés et à neutraliser temporairement les effets de seuils pendant trois ans et pour trois ans (cf. infra).
2. L’exonération de cotisation foncière des entreprises pour les petits commerces installés dans les quartiers prioritaires de la politique
de la ville
La cotisation foncière des entreprises (CFE) est l’une des deux composantes de la contribution économique territoriale (CET) avec la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE). Contrairement à la taxe professionnelle, dont elle reprend l’essentiel des règles, la CFE est basée uniquement sur les biens soumis à la taxe foncière. Cette taxe est due dans chaque commune où l’entreprise dispose de locaux et de terrains.
L’article 1466 A du CGI prévoit plusieurs exonérations de CFE au titre de l’aménagement du territoire et de la politique de la ville. Certaines de ces exonérations sont décidées à l’initiative des communes et des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), d’autres sont applicables par défaut, sauf délibération contraire de la commune ou de l’EPCI.
L’exonération de CFE dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) relève de la deuxième catégorie. Elle est prévue au I septies de l’article 1466 A du CGI.
Institués par la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, dont l’objectif était de simplifier les nombreux zonages accumulés depuis vingt ans, les QPV se sont substitués aux 751 zones urbaines sensibles (ZUS) et aux 416 zones de redynamisation urbaine (ZRU) à compter du 1er janvier 2015. La nouvelle géographie prioritaire est plus concentrée pour mieux cibler les moyens publics : 1 300 territoires sont concernés, dont plus d’une centaine pour la première fois, contre 2 600 auparavant. L’identification des nouveaux quartiers prioritaires se fonde sur le critère unique de la pauvreté, c’est-à-dire la concentration des populations ayant des ressources inférieures à 60 % du revenu médian.
Ce dispositif a été prorogé jusqu’au 31 décembre 2017 par l’article 49 de la loi du 29 décembre 2014 de finances rectificative précitée.
Il concerne les entreprises commerciales de moins de dix salariés qui font l’objet d’une création ou d’une extension entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2020 ainsi que celles déjà créées au 1er janvier 2015. Aucune condition d’effectif n’est exigée par la suite. Il suffit que l’effectif soit inférieur à dix salariés au moment de l’entrée de l’entreprise dans le dispositif.
Les bénéficiaires sont exonérées de CFE dans la limite du montant de base nette imposable, fixée, pour 2015, à 77 089 euros et actualisé chaque année en fonction de la variation de l’indice des prix.
L’exonération dure cinq ans et est pourvue d’un mécanisme de « sortie en sifflet » pendant trois ans : la base nette imposable des bénéficiaires fait alors l’objet d’un abattement. Le montant de cet abattement est égal, la première année, à 60 % de la base exonérée de la dernière année d’application de l’exonération ; puis 40 % et 20 % pour les années suivantes. Cet abattement ne peut réduire la base d’imposition de l’année considérée de plus de 60 % de son montant la première année, 40 % la deuxième année et 20 % la troisième.
ABATTEMENT DE LA BASE NETTE IMPOSABLE POUR LES PETITS COMMERCES ASUJETTIS À LA CFE, INSTALLÉS DANS LES QPV ET FRANCHISSANT LE SEUIL
DE DIX SALARIÉS
(en %)
Année |
N |
N + 1 |
N + 2 |
N + 3 |
N + 4 |
N + 5 |
N + 6 |
N + 7 |
N + 8 |
Abattement |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
60 de la base N + 4 plafonné à 60 de la base N + 5 |
40 de la base N + 4 plafonné à 40 de la base N + 6 |
20 de la base N + 4 plafonné à 20 de la base N + 7 |
− |
En application de l’article 1586 nonies du même code, les bénéficiaires peuvent aussi être exonérés de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), sauf délibération contraire de la commune.
Par ailleurs, en application de l’article 1383 C ter du même code, les immeubles existant au 1er janvier 2015 et rattachés à cette même date à un établissement remplissant les conditions pour bénéficier de l’exonération de CFE prévue au I septies de l’article 1466 A ainsi que les immeubles rattachés, entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2020, à un établissement remplissant les mêmes conditions sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties.
Le seuil de dix salariés serait porté à onze par la réforme.
3. Le crédit de CFE en faveur des très petites entreprises situées dans une zone de restructuration de la défense
L’article 34 de la loi de finances rectificative pour 2008 (53) a créé plusieurs régimes de faveur afin d’aider le développement économique des territoires concernés par le redéploiement des armées, autrement dit des zones de restructuration de la défense (ZRD), définies par cette même loi. Ces zones se caractérisent par la perte d’au moins cinquante emplois directs du fait de la réorganisation des unités militaires et établissements du ministère de la défense ; un taux de chômage supérieur de trois points à la moyenne nationale ; une démographie en baisse. Un rapport entre la perte d’emplois directs du fait de la réorganisation des armées et la population locale salariée doit être d’au moins 5 %.
Ainsi a été institué un crédit de CFE, pris en charge par l’État, en faveur des très petites entreprises commerciales et artisanales situées dans ces zones.
En application de l’article 1647 C septies du CGI, les entreprises de moins de dix salariés et réalisant un chiffre d’affaires annuel ou total de bilan inférieur ou égal à 2 millions d’euros peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt égal à 750 euros par salarié employé depuis au moins un an dans un établissement situé dans une ZRD, sous réserve du respect de certaines conditions, notamment la préservation de l’emploi local.
Le crédit d’impôt s’applique pendant trois ans à compter du 1er janvier de l’année au titre de laquelle la commune est reconnue comme ZRD. La condition d’effectif s’apprécie au 1er janvier de chaque année d’application du crédit d’impôt.
À titre d’exemple, n arrêté du 28 mai 2015 relatif à la délimitation des ZRD a reconnu la commune de Châlons-en-Champagne comme ZRD au titre de l’année 2015. Dans cette commune, le crédit d’impôt de CFE est susceptible de s’appliquer aux entreprises éligibles pour les années 2015, 2016 et 2017.
Le seuil de dix salariés serait porté à onze par la réforme. Les effets du franchissement du seuil seront neutralisés pour trois ans (cf. infra).
4. La participation des employeurs de moins de dix salariés au financement de la formation professionnelle continue
L’obligation, pour l’employeur, de participer à la formation professionnelle continue est codifiée aux articles L. 6331-1 et suivants du code du travail ainsi qu’aux articles 235 ter C et suivants du CGI.
Modifié par l’article 10 de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale, l’article L. 6331-1 indique désormais plus clairement que deux obligations s’imposent à l’employeur :
– le financement direct d’actions de formation listées aux articles L. 6313-1 et L. 6314-1 ;
– le versement des contributions pour le développement de la formation professionnelle continue.
La participation au développement de la formation professionnelle continue, assise sur la masse salariale de l’entreprise, voit son taux varier en fonction de l’effectif de l’entreprise apprécié au 31 décembre de l’année civile. En application de l’article L. 6331-2, un taux réduit de 0,55 % est applicable aux entreprises de moins de dix salariés. Il est porté à 1 % au-delà (1,3 % pour les entreprises de travail temporaire).
Le dispositif est pourvu d’un mécanisme de « sortie en sifflet ». L’augmentation de taux est neutralisée au titre de l’année du franchissement du seuil de dix salariés et des deux années suivantes, l’entreprise bénéficiant ensuite d’un taux minoré les troisième et quatrième années suivant celle du franchissement (0,7 % puis 0,9 %).
TAUX DE PARTICIPATION
AU DÉVELOPPEMENT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE
POUR LES ENTREPRISES FRANCHISSANT LE SEUIL DE 10 SALARIÉS
(en %)
Année |
N |
N + 1 |
N + 2 |
N + 3 |
N + 4 |
N + 5 |
Taux |
0,55 |
0,55 |
0,55 |
0,7 |
0,8 |
1,0 |
Ce seuil à dix salariés serait porté à onze, en cohérence avec les autres mesures proposées par le Gouvernement.
Dans un souci de cohérence, la réforme imposerait aussi de modifier le seuil de dix salariés prévu à l’article 8 de l’ordonnance n° 2015-380 du 2 avril 2015 relative au portage salarial.
5. Le non-assujettissement des employeurs de moins de dix salariés au forfait social
En application de l’article L. 137-15 du code de la sécurité sociale, les employeurs de moins de dix salariés ne sont pas assujettis au forfait social au taux de 8 %, dû au titre des contributions des employeurs au financement des dispositifs de prévoyance.
Pour mémoire, la contribution sur les rémunérations ou gains assujettis à la contribution sociale généralisée (CSG) mais exclus de l’assiette des cotisations sociales (« forfait social ») avait été créé par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 (article 13) (54).
Entré en vigueur le 1er janvier 2009, l’article L. 137-15 du code de la sécurité sociale pose le principe selon lequel l’ensemble des éléments de rémunération qui sont soumis à la CSG (article L. 136-1 du code de la sécurité sociale) et exclus de l’assiette des cotisations de sécurité sociale (articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime) sont soumis à une contribution à la charge de l’employeur. Autrement dit, le principe devient l’assujettissement, toute nouvelle exonération d’un élément de rémunération répondant à ces mêmes critères entrant dans l’assiette du forfait social, sans qu’il soit besoin de le prévoir expressément.
Le taux de cette contribution, fixé à 2 % par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009, a depuis lors été porté à 4 % pour 2010, puis à 6 % pour 2011, puis à 8 % pour 2012 (article L. 137-16 du code de la sécurité sociale), en application d’une recommandation du comité d’évaluation des dépenses fiscales et des niches sociales de juin 2011.
Une dérogation pour le financement de prestations complémentaires de prévoyance a été conservée lors de cette réforme en faveur des employeurs de moins de dix salariés.
Ce seuil à dix salariés serait porté à onze, en cohérence avec les autres mesures proposées par le Gouvernement. En outre, les effets du franchissement du seuil seraient neutralisés pendant trois ans et pour trois ans (cf. infra).
6. L’exonération de versement transports pour les employeurs de moins de neuf salariés
La règle d’assujettissement au versement transport des employeurs de plus de neuf salariés a été instituée par la loi créant ce versement du 24 février 1996.
Sont assujettis au versement transport les employeurs de plus de neuf salariés ayant leur lieu de travail dans un périmètre où ce versement a été institué. L’article L. 2333-64 du code général des collectivités territoriales (CGCT) concerne les métropoles et la métropole de Lyon tandis que l’article L. 2531-2 est propre à la région Île-de-France.
Il existe, en outre, un dispositif de neutralisation pendant trois ans pour l’entreprise qui atteint dix salariés pour la première fois. Elle est d’abord dispensée pendant trois ans puis bénéficie ensuite d’une réduction du versement de 75 % la quatrième année, de 50 % la cinquième année et de 25 % la sixième année.
RÉDUCTION DU VERSEMENT TRANSPORT POUR LES ENTREPRISES AYANT FRANCHI EN ANNÉE N LE SEUIL DE DIX SALARIÉS
(en %)
Année |
N |
N + 1 |
N + 2 |
N + 3 |
N + 4 |
N + 5 |
Exonération |
100 |
100 |
100 |
75 |
50 |
25 |
Ce seuil à dix salariés serait porté à onze, en cohérence avec les autres mesures proposées par le Gouvernement.
B. LES SEUILS DONT LE FRANCHISSEMENT SERAIT TEMPORAIREMENT NEUTRALISÉ
La neutralisation temporaire des effets de seuils concerne neuf dispositifs, dont trois, présentés supra, font aussi l’objet d’un relèvement de seuil. L’exonération d’impôt sur les bénéfices dans les zones de revitalisation rurale pour les entreprises de moins de dix salariés, le crédit de CFE en faveur des très petites entreprises situées dans une zone de restructuration de la défense et le non-assujettissement des employeurs de moins de dix salariés au forfait social.
Les entreprises franchissant les seuils prévus par ces huit dispositifs au titre des années 2016, 2017 et 2018 pourront encore bénéficier des régimes prévus pendant trois années.
1. L’option pour le régime des sociétés de personnes pour les entreprises de moins de cinquante salariés
Prévue à l’article 239 bis AB du CGI, l’option pour le régime des sociétés de personnes pour les entreprises de moins de cinquante salariés permet aux jeunes entreprises dont les résultats seraient déficitaires d’imputer les déficits sociaux sur leurs propres revenus.
L’option n’est valable que cinq ans et suppose le respect de certaines conditions :
– la société ne doit pas être cotée ; elle doit exercer à titre principal une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ; elle doit employer moins de cinquante salariés et avoir réalisé au cours de l’exercice un chiffre d’affaires annuel ou un total de bilan inférieur à 10 millions d’euros ; elle doit avoir été créée depuis moins de cinq ans ;
– le capital et les droits de vote des associés doivent être détenus au moins à 50 % par des personnes physiques, et au moins à hauteur de 34 % par un ou plusieurs dirigeants ainsi que par les membres de leur foyer fiscal.
La condition relative à l’âge de la société s’apprécie à la date d’effet du régime : la société doit avoir moins de cinq ans à la date d’ouverture du premier exercice d’application du régime. Les autres conditions tenant à la détention du capital, à l’activité et à la taille de la société doivent être respectées tout au long des exercices couverts par l’option.
L’option doit être notifiée au cours des trois premiers mois du premier exercice auquel l’option s’applique. Elle est valable pour une période de cinq exercices sauf révocation de manière anticipée par l’entreprise. Elle prend obligatoirement fin à l’issue de cette période et ne peut pas être renouvelée.
L’option prévue à l’article 239 bis AB du CGI est particulièrement utile pour les créateurs d’entreprises innovantes qui accumulent parfois des déficits plusieurs années consécutives avant d’être rentables.
L’obligation de respecter un seuil de moins de cinquante salariés tout au long des exercices couverts par l’option pour le régime des sociétés de personnes peut être un frein pour des entreprises en forte croissante en privant leurs créateurs du double avantage lié à cette option :
– un avantage juridique qui limite leur responsabilité à leurs apports ;
– un avantage fiscal qui leur permet d’imputer immédiatement les déficits de début d’activité sur les revenus du foyer fiscal des associés au lieu d’être reportés dans le temps sur les bénéfices futurs.
Le Gouvernement propose donc un mécanisme temporaire de neutralisation de l’effet de seuil pendant trois ans et pour trois ans.
2. Le crédit d’impôt sur les primes d’intéressement pour les entreprises de moins de cinquante salariés
Les entreprises de moins de cinquante salariés échappent au régime obligatoire de la participation prévu par les articles L. 3322-1 et suivants du code du travail. Elles peuvent néanmoins mettre en place un intéressement, défini aux articles L. 3312-1 et suivants du même code, qui permet d’associer financièrement les salariés aux résultats de l’entreprise ou à la réalisation d’objectifs de performance.
L’article 2 de la loi n° 2008-1258 du 3 décembre 2008 en faveur des revenus du travail a institué un crédit d’impôt destiné à encourager les entreprises, notamment celles de moins de cinquante salariés, à conclure des accords d’intéressement avant le 31 décembre 2014.
Les articles 129 et 131 de la loi de finances pour 2011 (55) ont élargi le bénéfice de ce crédit d’impôt à des entreprises bénéficiant de certains régimes spécifiques d’exonération (56) tout en le réservant aux entreprises de moins de cinquante salariés. En outre, les modalités de calcul du crédit d’impôt ont été modifiées : son taux a augmenté de 20 % à 30 % et le bénéfice du crédit d’impôt plafonné à 200 000 euros dans le cadre du régime de minimis pour les aides d’État défini par le droit européen.
L’article 20 de la deuxième loi de finances rectificative pour 2011 (57) a modifié ce dispositif, de façon à ménager une transition pour les entreprises de plus de cinquante salariés. L’ancien dispositif est demeuré applicable aux entreprises dont les effectifs sont compris entre quarante-neuf et deux cent cinquante salariés, pour les primes dues en application d’accords d’intéressement conclus ou renouvelés avant le 1er janvier 2011 et donc jusqu’au 31 décembre 2014.
L’obligation de respecter un seuil de moins de cinquante salariés tout au long des exercices couverts par l’accord d’intéressement freinerait l’emploi et la croissance des entreprises à fort potentiel en les privant, du fait du dépassement d’un tel seuil, du bénéfice du crédit impôt imputable sur l’impôt sur les bénéfices.
À l’occasion de la discussion de la loi du 6 août 2015 pour la croissance (58), un article additionnel, devenu l’article 156 dans le texte voté, a été introduit à l’initiative de Mme Catherine Deroche, Rapporteure de la commission spéciale du Sénat, afin de lutter contre les effets de seuils.
Il résulte de la nouvelle rédaction de l’article L. 3322-3 du code du travail qu’une entreprise ayant conclu un accord d’intéressement et sur le point de franchir le seuil d’assujettissement à la participation n’aurait l’obligation de mettre en place un mécanisme de participation qu’au troisième exercice clos après le franchissement du seuil, si l’accord est appliqué sans discontinuité pendant cette période. À cette date, un accord de participation peut être conclu dans les conditions de l’article L. 3324-2 sur une base de calcul et de répartition reprenant celle de l’accord d’intéressement ayant expiré.
Le Gouvernement propose en outre un mécanisme temporaire de neutralisation de l’effet de seuil relatif au crédit d’impôt pendant trois ans et pour trois ans.
3. L’abattement de cotisation de taxe sur les salaires pour les mutuelles de moins de trente salariés
En application de l’article 1679 A du CGI, les associations régies par la loi du 1er juillet 1901, les syndicats professionnels et leurs unions ainsi que les mutuelles qui emploient moins de trente salariés bénéficient d’un abattement annuel de cotisation de taxe sur les salaires d’un montant de 20 262 euros. Cet abattement, initialement fixé à 6 000 euros a été porté à 20 000 euros par l’article 67 de la quatrième loi finances rectificative pour 2012 (59) pour soutenir le secteur associatif.
Le montant de cet abattement est relevé chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu.
Le franchissement du seuil de trente salariés pour les mutuelles n’est assorti d’aucun mécanisme de sortie progressive du dispositif.
Le Gouvernement écarte la possibilité de supprimer ce seuil, une solution trop coûteuse pour les finances publiques. De plus, sa suppression bénéficierait à toutes les mutuelles, y compris celle de grandes tailles, alors que les entreprises d’assurances, qui exercent des activités analogues, en sont exclues.
Le Gouvernement propose donc un mécanisme temporaire de neutralisation de l’effet de seuil pendant trois ans et pour trois ans.
4. La déduction forfaitaire applicable en matière de cotisations sociales dues au titre des heures supplémentaires
En application de l’article L. 241-18 du code de la sécurité sociale, les entreprises de moins de vingt salariés bénéficient d’une déduction forfaitaire pour les heures supplémentaires effectuées par leurs salariés éligibles aux allégements généraux de cotisations sociales (« allégements Fillon »), régie par l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale. Le montant de la déduction forfaitaire par heure supplémentaire est égal à 1,50 euro.
Cette déduction forfaitaire s’applique :
– à la rémunération des heures supplémentaires des salariés soumis à la durée légale du travail ;
– à la rémunération des heures de travail effectuées au-delà de 1 607 heures pour les salariés relevant de conventions de forfait en heures sur l’année ;
– au titre des heures supplémentaires effectuées dans le cadre d’un accord collectif d’annualisation du temps de travail ;
– à la rémunération des jours de repos auxquels renoncent les salariés cadres employés au forfait annuel en jour. Ces jours de travail supplémentaires sont ceux effectués au-delà du plafond annuel de 218 jours et dans la limite de 235 jours annuels.
L’article 48 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie avait introduit un mécanisme de neutralisation des effets de seuils temporaire pour toutes les entreprises franchissant pour la première fois le seuil de vingt salariés au 31 décembre 2012. Il permettait aux entreprises concernées de bénéficier encore de la déduction forfaitaire pour les années 2013, 2014 et 2015.
C’est un mécanisme similaire que le Gouvernement propose de mettre en place pour neutraliser pendant trois ans et pour trois ans les effets du franchissement du seuil de vingt salariés.
5. Le taux réduit et l’assiette minorée pour la contribution au Fonds national d’aide au logement
En application de l’article L. 834-1 du code de la sécurité sociale, les entreprises de moins de vingt salariés sont soumises à une contribution versée au Fonds national d’aide au logement (FNAL).
À la suite de la refonte des modalités de prélèvement au profit du FNAL par la loi de financement de la sécurité sociale rectificative pour 2014 (60) et par la seconde loi de finances rectificative pour 2014 (61), les entreprises sont aujourd’hui soumises à une contribution unique, qui distingue uniquement les entreprises de moins de vingt salariés et les autres.
Pour les entreprises de moins de vingt salariés, la contribution est calculée par l’application d’un taux de 0,1 % à la part des rémunérations perçues dans la limite du plafond de la sécurité sociale mentionné au premier alinéa de l’article L. 241-3 du même code. Les autres entreprises acquittent une contribution de 0,5 % sur la masse salariale déplafonnée.
Le Gouvernement propose de neutraliser les effets du franchissement du seuil de vingt salariés pendant trois ans et pour trois ans.
6. L’exonération de CFE pour les micro-coopératives agricoles
L’exonération prévue à l’article 1451 du CGI a été instituée par l’ordonnance n° 45-2522 du 19 octobre 1945 relative aux impôts directs et aux taxes assimilées perçus au profit des départements, des communes et des régions. Elle a été maintenue lors du remplacement de la taxe professionnelle par la CET en 2010.
En application de l’article précité, sont exonérées de façon permanente de la CFE :
– les sociétés coopératives agricoles et leurs unions ainsi que les sociétés d’intérêt collectif agricole qui emploient au plus trois salariés ou qui se consacrent à certaines activités : électrification, habitation ou aménagement rural, utilisation de matériel agricole, insémination artificielle, lutte contre les maladies des animaux et des végétaux, vinification, conditionnement des fruits et légumes, organisation des ventes aux enchères ;
– les coopératives agricoles et vinicoles, pour leurs activités autres que la vinification, lorsque l’effectif salarié correspondant n’excède pas trois personnes ;
– les caisses locales d’assurances mutuelles agricoles qui ont au plus deux salariés ou mandataires rémunérés.
La période à considérer pour le calcul du nombre de salariés est la période de référence retenue pour la détermination des bases de la CFE. Dans la généralité des cas, la période de référence est constituée, en vertu des dispositions de l’article 1467 A du CGI, par l’avant-dernière année civile précédant celle de l’imposition ou le dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l’année civile.
L’effet de seuil est relativement atténué du fait des dispositions prévues à l’article 1468 du CGI. En application de celui-ci, en effet, les coopératives agricoles et unions de coopératives agricoles qui ne bénéficient pas de l’exonération prévue à l’article 1451 du CGI bénéficient d’un abattement de 50 % de la base d’imposition à la CFE.
Le Gouvernement propose de neutraliser les effets du franchissement des seuils de deux et trois salariés pendant trois ans et pour trois ans, sans les remettre en cause.
II. LES MODIFICATIONS PROPOSÉES
A. LE DISPOSITIF
• Le I a trait aux modifications apportées au code général des impôts (CGI).
Le 1° concerne l’exonération d’impôt sur les bénéfices dans les ZRR pour les entreprises de moins de dix salariés prévue à l’article 44 quindecies du CGI.
Le a) relève le seuil de dix à onze salariés.
Le b) neutralise le franchissement du seuil de onze salariés pendant trois ans (pour les exercices clos entre le 31 décembre 2015 et le 31 décembre 2018) et pour trois ans.
Les deux illustrations suivantes permettent de mieux comprendre les effets de cette double mesure.
● Premier cas : une entreprise reprise en 2010 dans une zone de revitalisation rurale et comptant neuf salariés bénéficie aujourd’hui d’une exonération d’impôt totale sur les bénéfices. À partir de 2016, le taux d’exonération passera à 75 %. Le chef d’entreprise pourra recruter deux voire trois nouveaux salariés sans sortir du dispositif. En 2017, le taux d’exonération passera bien à 50 %. En 2018, il sera de 25 %.
● Deuxième cas : une entreprise de dix salariés créée en 2015 dans une ZRR pourra bénéficier d’une exonération totale d’impôt sur les bénéfices, même si elle recrute un salarié supplémentaire. Elle peut profiter de la mesure temporaire pour financer sa croissance en embauchant immédiatement cinq nouveaux salariés : elle continuera de bénéficier d’une exonération totale pendant trois ans.
L’exonération conserve néanmoins sa durée de vie limitée prévue au I de l’article 44 quindecies précité. Ces nouvelles mesures ne bénéficieront qu’aux entreprises créées ou reprises avant le 31 décembre 2015.
Le 2° concerne la participation de l’employeur due au titre de la formation professionnelle continue. Il modifie les articles 235 ter D et 235 ter KA du CGI pour substituer au seuil de dix salariés un seuil de onze salariés.
Le 3° concerne le régime d’option des sociétés à l’IS pour le régime des sociétés de personnes prévu à l’article 239 bis AB du CGI. Il neutralise pendant trois ans (à compter du 31 décembre 2015 et clos au plus tard le 31 décembre 2018) et pour trois ans les effets du franchissement du seuil de cinquante salariés, dans la limite de la durée maximale de cinq exercices consécutifs. Les deux illustrations suivantes permettent de mieux comprendre les effets de cette mesure.
● Premier cas : dans l’état du droit, une entreprise soumise à l’IS a opté pour le régime des sociétés de personnes dans les conditions prévues à l’article 239 bis AB du CGI en 2012. Elle envisage de recruter en 2016 mais elle atteindrait alors le seuil dirimant de cinquante salariés. Elle décide d’attendre jusqu’en 2017 la fin de ses cinq années d’option. Grâce à la nouvelle mesure, elle va pouvoir recruter dès 2016.
● Deuxième cas : deux jeunes diplômés sont porteurs d’un projet de plateforme numérique offrant d’abord des services gratuits, pour se faire connaître, puis un abonnement payant (freemium). S’ils optent pour le régime des sociétés de personnes en 2016 et que leur entreprise atteint dès 2018 le seuil de cinquante salariés, ils pourront conserver leur option jusqu’en 2020, soit deux années de plus qu’avant l’adoption de la mesure. Si leurs résultats sont déficitaires dans les premières années de l’entreprise, ils pourront imputer les déficits sociaux sur leurs propres revenus tout en poursuivant leur croissance.
Le 4° concerne le crédit d’impôt sur les primes d’intéressement prévu à l’article 244 quater T du CGI. Le I est complété par un alinéa neutralisant le franchissement du seuil de cinquante salariés à compter des exercices clos entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2017. La date retenue pour la clôture des exercices est celle du 1er janvier et non du 31 décembre pour ne pas défavoriser les entreprises qui clôturent leur exercice à cheval sur l’année 2015. Les bénéfices de la mesure seront ainsi plus rapides.
Le 5° concerne l’exonération de CFE applicable aux micro-sociétés coopératives agricoles et leurs unions, aux sociétés d’intérêt collectif agricole et aux organismes agricoles divers. Il neutralise pour trois années le franchissement des seuils de deux ou trois salariés qui interviendraient pendant les périodes de références retenues pour les impositions établies de 2016 à 2018.
Le 6° concerne l’exonération de CFE dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville prévue au I septies de l’article 1466 A du CGI. Un seuil de onze salariés remplace le précédent seuil de dix salariés.
Le 7° procède à une nouvelle rédaction de l’article 1647 C septies du CGI relatif au crédit de CFE en faveur des entreprises commerciales et artisanales de moins de dix salariés situées dans une ZRD.
En vertu des dispositions modifiées, les entreprises concernées pourront désormais bénéficier du crédit d’impôt jusqu’à onze salariés, les autres conditions de chiffre d’affaires ou d’activité restant inchangées.
Le cas particulier des groupes est prévu par l’article dans sa nouvelle rédaction qui précise que le chiffre d’affaires de la société mère est apprécié en faisant la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
Le chiffre d’affaires pris en compte est celui de l’avant-dernière année précédant celle de l’imposition ou le dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l’année civile, éventuellement corrigé pour correspondre à une année pleine.
Un second alinéa prévoit que le franchissement du seuil de onze salariés pour les impositions établies au titre des années 2016 à 2018 ne fera pas perdre le bénéfice du crédit d’impôt aux entreprises concernées.
Le 8° concerne l’abattement de cotisation de taxe sur les salaires pour le secteur associatif. Il neutralise pour trois ans les effets du franchissement du seuil de trente salariés intervenu entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2018 pour les mutuelles visées à l’article 1679 A du CGI.
• Le II modifie le code du travail
Le 1° procède à l’adaptation des articles du titre III du livre III de la sixième partie du code du travail consacré au financement de la formation professionnelle continue. Seules les dispositions relatives aux contributions des entreprises sont modifiées ; les dispositions relatives aux droits des salariés restent inchangées.
Les règles et modalités de la collecte ainsi que les modalités de répartition du produit de la collecte (sections du plan de formation, alimentation du Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels) sont modifiées afin de relever les seuils de dix à onze salariés.
Les organismes collecteurs paritaires agréés (OPCA) des employeurs de dix salariés et plus seront désormais agréés pour les employeurs de plus de onze salariés. Les OPCA des micro-entreprises verront possiblement le nombre de leurs contributeurs augmenter tandis que le montant total de la collecte au titre de la formation professionnelle continue pourrait légèrement diminuer, du fait que plus d’entreprises cotiseront à taux réduit.
Les articles L. 6331-15 et suivants du code du travail relatifs à la prise en compte d’un accroissement d’effectifs sont adaptés au changement de seuil mais maintenus, de sorte que le franchissement du seuil restera neutralisé pour trois ans, de manière pérenne.
Le 2° modifie les intitulés des sections du chapitre 1er du titre III du livre III de la sixième partie du code du travail en conséquence.
• Le III modifie le code de la sécurité sociale
Le 1° concerne le non-assujettissement des employeurs de moins de dix salariés au forfait social prévu à l’article 137-15 du code de la sécurité sociale.
Le a) relève le seuil de non-assujettissement au forfait social de dix à onze salariés.
Le b) neutralise pour trois ans les effets du franchissement du seuil de onze salariés intervenu en 2016, 2017 ou 2018.
Le 2° complète l’article L. 241-18 du même code relatif à la déduction forfaitaire applicable en matière de cotisations sociales dues au titre des heures supplémentaires. Les entreprises franchissant le seuil de vingt salariés au titre des exercices 2016, 2017 ou 2018 pourront continuer pendant trois ans à se voir appliquer la déduction forfaitaire applicable aux entreprises de moins de vingt salariés (1,50 euro par heure supplémentaire).
Le 3° complète l’article L. 834-1 du même code relatif au taux réduit et l’assiette minorée pour la contribution au FNAL. Le nouvel alinéa permettra aux entreprises franchissant le seuil de vingt salariés au titre des exercices 2016, 2017 ou 2018 pourront continuer à bénéficier pendant trois ans du taux réduit et de l’assiette minorée, à savoir 0,1 % à la part des rémunérations perçues dans la limite du plafond de la sécurité sociale mentionné au premier alinéa de l’article L. 241-3 du même code.
• Le IV modifie le code général des collectivités territoriales
Le CGCT se caractérise par la persistance de seuils de niveau voisins mais différents. Ainsi, certains dispositifs sont applicables « jusqu’à » un niveau de neuf ou dix salariés tandis que d’autres sont réservés aux entreprises « de moins » de neuf salariés. Cette absence d’harmonisation altère la lisibilité du droit. Le présent titre procède à une harmonisation de la définition des seuils au sein de ce code et en cohérence avec les autres codes.
Le 1° modifie l’article L. 2333-64 relatif aux modalités du versement transport dans les métropoles hors de la région Île-de-France. Il harmonise les différentes formulations retenues dans l’article pour instituer un seuil unique à onze salariés.
Le 2° procède aux mêmes modifications à l’article L. 2531-2 du CGCT relatif au versement transport en Île-de-France.
• Le V modifie l’ordonnance du 2 avril 2015 relative au portage salarial
Le V procède à une modification de l’article 8 de l’ordonnance du 2 avril 2015 précitée. Par cohérence avec les dispositions modifiées relative au financement de la formation professionnelle continue, le seuil de dix salariés est relevé à onze.
• Le VI compense les pertes de recettes résultant des dispositions introduites au IV
Le VI institue un prélèvement sur recettes de l’État afin de compenser les pertes de recettes résultant des dispositions introduites au IV pour les autorités organisatrices de la mobilité et la métropole de Lyon. Cette compensation est égale à la différence entre le produit du versement transport recouvré et celui qui aurait été perçu si les articles L. 2531-2 et L. 2333-64 du CGCT étaient appliqués dans leur version en vigueur au 1er janvier 2015. Elle est versée selon une périodicité trimestrielle.
• Le VII précise les dates d’entrée en vigueur de certaines dispositions
Le relèvement du seuil d’exonération d’impôt sur les bénéfices dans les ZRR pour les entreprises de moins de dix salariés prévu à l’article 44 quindecies du CGI s’appliquera aux exercices clos à compter du 31 décembre 2015.
Le relèvement du seuil de dix salariés à onze pour l’exonération de CFE dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville et pour le crédit de CFE en faveur des entreprises commerciales et artisanales situées dans une zone de restructuration de la défense s’appliquera à compter des impositions établies au titre de l’année 2016.
Enfin, les changements de seuils relatifs au financement de la formation professionnelle continue s’appliqueront pour la collecte des contributions dues au titre de l’année 2016 et des années suivantes.
B. LE COÛT POUR LES FINANCES PUBLIQUES
Le coût pérenne de la mesure est évalué à 152 millions d’euros par an. Il pourrait être plus élevé.
INCIDENCE BUDGÉTAIRE POUR LES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES (APU)
(en millions d’euros)
Administration publique |
2016 |
2017 |
2018 |
Coût pérenne |
État |
– 78,75 |
– 105 |
– 105 |
– 105 |
Collectivités locales |
– |
– |
– |
– |
Sécurité sociale |
– 27 |
– 27 |
– 27 |
– 27 |
Autres administrations publiques |
– 20 |
– 20 |
– 20 |
– 20 |
Total pour l’ensemble des APU |
– 125,75 |
– 152 |
– 152 |
– 152 |
Source : évaluation préalable.
Seules certaines dépenses fiscales ont fait l’objet d’une évaluation. Par voie de conséquence, seules les mesures correspondantes ont pu faire l’objet d’une estimation chiffrée.
ESTIMATION DU COÛT DES MESURES DU PRÉSENT ARTICLE
(en millions d’euros)
Dépense fiscale |
Coût |
Exonération de l’impôt sur les bénéfices en ZRR |
7 |
Relèvement du seuil et neutralisation des effets de seuil pendant trois ans et pour trois ans |
0,5 |
Crédit de CFE en faveur des entreprises commerciales et artisanales de moins de dix salariés situées dans une zone de restructuration de la défense |
2 |
Relèvement du seuil |
Marginal |
Crédit d’impôt sur les primes d’intéressement |
29 |
Neutralisation des effets de seuil pendant trois ans et pour trois ans |
Marginal |
Versement transport |
|
Relèvement des seuils |
105 |
Exonération de forfait social |
|
Neutralisation des effets de seuil pendant trois ans et pour trois ans |
7 |
Relèvement du seuil |
20 |
Participation de l’employeur à la formation professionnelle continue |
|
Relèvement des seuils |
20 |
Source : évaluation préalable.
L’impact des autres mesures sur les finances publiques n’a pas été évalué.
C. L’IMPACT ÉCONOMIQUE
1. Une simplification pour les entreprises
À la suite de la réforme, le nombre de seuils légaux d’effectifs sera réduit de neuf à six. Après la fusion des seuils de neuf, dix et onze salariés, le droit positif reconnaît toujours des seuils de trois, onze, vingt, trente, cinquante et deux-cent-cinquante salariés.
Les seuils de trois et trente salariés correspondent à des situations spécifiques (coopératives agricoles, mutuelles). Les seuils de droit commun seront donc surtout ceux de onze, vingt, cinquante et deux-cent-cinquante salariés.
Tous les dispositifs modifiés seront désormais pourvus de mécanismes d’atténuation des effets de seuils, au moins pendant trois ans. Toutefois, les mécanismes tels qu’ils résulteront de la réforme seront hétérogènes (cf. tableau récapitulatif en tête du présent commentaire) :
– six des douze dispositifs sont pourvus de mécanismes pérennes de « sortie en sifflet » ;
– huit dispositifs sont concernés par la neutralisation temporaire des effets de seuils introduite par le Gouvernement, dont quatre étaient déjà pourvus de mécanismes atténuant plus ou moins les effets de seuils.
Les mécanismes temporaires de neutralisation des effets de seuils introduits par le Gouvernement sont eux-mêmes différents. Si le franchissement de seuil est en général neutralisé pendant trois ans (2016, 2017 et 2018) et pour trois ans, le présent article ménage une exception pour le crédit de CFE en faveur des très petites entreprises situées dans une ZRD. Aux termes du présent article « le franchissement du seuil de onze salariés pour les impositions établies au titre des années 2016 à 2018 ne fera pas perdre le bénéfice du crédit d’impôt aux entreprises concernées ».
2. Un impact difficile à évaluer sur l’emploi
La problématique des effets de seuils comme frein possible à la croissance et à l’emploi a été évoquée à de nombreuses reprises dans divers rapports, notamment les rapports Camdessus (2004) (62), Aghion (2007) (63) et Attali (2008) (64).
Dans son évaluation préalable, le Gouvernement indique que l’existence même des seuils d’effectifs aurait une incidence sur la taille des entreprises françaises et découragerait l’embauche de salariés supplémentaires. Par le présent article, il entend réduire des biais défavorables à l’emploi.
Selon l’évaluation préalable, le Gouvernement s’appuie sur plusieurs rapports et études :
– l’étude de Pierre Cahuc et Francis Kramarz de 2005 (65), qui signale que les seuils d’effectifs sont une caractéristique du tissu économique français ;
– une étude de l’institut allemand Institut für Wirtschaftsforschung (IFO) relative à l’effet sur l’emploi des seuils sociaux en France et en Allemagne (2015), commandée par la délégation aux entreprises du Sénat, qui souligne que la part des entreprises avec quarante-huit et quarante-neuf salariés est 1,8 fois plus importante en France qu’en Allemagne ;
– les données fiscales de 2005 analysées dans une étude de l’INSEE intitulée L’impact des seuils de 10, 20 et 50 salariés sur la taille des entreprises françaises (66) montrent également de nettes discontinuités dans la distribution aux alentours de certains seuils.
Une lecture attentive de ces rapports et études permet toutefois de douter que la mesure ait des effets significatifs sur l’emploi.
Ainsi, MM. Pierre Cahuc et Francis Kramarz, dans le rapport précité, après avoir relevé la singularité de la France concernant la prépondérance des petites entreprises, excluaient que les effets de seuil, à eux seuls, puissent expliquer le déficit d’emploi en France (annexe 1 du rapport, page 165). Ils concluaient que les seuils avaient « apparemment, une importance relative minime » et que d’autres études statistiques précises seraient nécessaires pour conclure définitivement.
L’étude conduite en 2010 par l’INSEE (précitée) sur les données fiscales et sociales 2005 aboutit à la même conclusion. Des discontinuités dans la distribution et la dynamique des entreprises autour des seuils apparaissent très fortes avec les données fiscales mais faibles ou inexistantes avec les données plus précises issues des déclarations automatisées des données sociales (DADS) et les données des Urssaf.
Même en s’appuyant sur les données fiscales, les effets globaux sont de faible ampleur. La proportion d’entreprises entre zéro et neuf salariés diminuerait de 0,4 point en l’absence de discontinuités administratives, tandis que la proportion d’entreprises entre dix et dix-neuf salariés et celle d’entreprises entre vingt et deux cent cinquante salariés augmenteraient de 0,2 point.
Les auteurs de l’étude concluaient que « ces effets sont ainsi loin de rendre compte des différences de taille d’entreprises entre la France et l’Allemagne, pour lesquelles d’autres explications doivent être recherchées ».
Plusieurs économistes de l’Observatoire français des conjonctures économiques (OFCE) doutent des effets de seuils d’effectifs sur l’emploi. Selon Gérard Cornilleau, économiste à l’OFCE (67), « quand bien même il y aurait un effet emploi avec le lissage ou la suppression des seuils, il faut réfléchir en termes macroéconomiques. C’est-à-dire que les postes créés dans les petites entreprises pourraient être détruits dans les plus grandes ».
*
* *
La commission est saisie de l’amendement I-CF 104 de M. Charles de Courson.
M. Charles de Courson. Lorsque le Gouvernement a donné son accord pour relever les seuils, le groupe UDI, qui a toujours défendu cette thèse, avait proposé de reporter les seuils de neuf et dix salariés à vingt et un, et de cinquante à soixante. Nous félicitons le Gouvernement d’aller dans la bonne direction et d’amplifier le mouvement.
Mme Valérie Rabault, Rapporteure générale. Monsieur de Courson, c’est un amendement d’inflation puisque vous augmentez le nombre de seuils. Nous allons en rester à la disposition prévue à l’article 4. Avis défavorable.
La commission rejette l’amendement I-CF 104.
Puis elle est saisie de l’amendement I-CF 105 de M. Charles de Courson.
M. Charles de Courson. Cet amendement vise à élever le seuil applicable à la désignation d’un délégué syndical, aux calculs des heures de délégation, à l’installation d’un comité d’entreprise, d’un comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) et à la mise en place d’une participation aux résultats dans l’entreprise. Augmenter les seuils est une chose. Encore faudrait-il les harmoniser…
Suivant l’avis défavorable de la Rapporteure générale, la commission rejette l’amendement I-CF 105.
Puis elle examine, en discussion commune, les amendements I-CF 106 et I-CF 108 de M. Charles de Courson.
M. Charles de Courson. Il s’agit d’amendements de repli.
L’amendement I-CF 106 vise à porter à vingt et un salariés le seuil d’élection des délégués du personnel.
L’amendement I-CF 108 a le même objectif, mais l’application des dispositions est limitée à une durée d’un an à compter de la promulgation de la présente loi. L’un des problèmes de l’article est qu’il fixe la limite à trois ans. Sait-on comment revenir, au bout de trois ans, au seuil antérieur ? Les gens ont besoin de visibilité. Cette limite fixée à trois ans n’est pas cohérente. Ces mesures ne seront pas efficaces, alors que, pour une fois, elles vont dans la bonne direction.
Suivant l’avis défavorable de la Rapporteure générale, la commission rejette successivement les amendements I-CF 106 et I-CF 108.
Puis elle adopte l’article 4 sans modification.
*
* *
Article 5
Augmentation du plafond de la provision déductible de l’impôt sur les sociétés des groupements d’employeurs en pourcentage de la masse salariale
Le présent article permet aux groupements d’employeurs (GE) de déduire de leur impôt sur les sociétés le montant d’une réserve de précaution constituée afin de financer la responsabilité solidaire entre les membres de ces groupements jusqu’à 2 % de la masse salariale.
Cette mesure s’insère dans un ensemble de mesures destinées à promouvoir les GE, qui s’inscrit lui-même dans le cadre du plan « Tout pour l’emploi dans les TPE et les PME » annoncé par le Premier ministre le 9 juin 2015.
Le montant de cette mesure est évalué entre 1 et 2 millions d’euros.
Les groupements d’employeurs sont constitués dans le but de mettre à la disposition de leurs membres des salariés liés à ces groupements par un contrat de travail, dans le cadre de l’application d’une même convention collective (article L. 1253-1 du code du travail). Le groupement devient par ces dispositions l’employeur de droit, se substituant par là même aux utilisateurs.
En application de l’article L. 1253-2 du code précité, les groupements d’employeurs sont constitués sous la forme d’associations ou de sociétés coopératives.
• Un outil de mutualisation encouragé par les pouvoirs publics
Les GE ont été formellement reconnus par les articles 46 et suivants de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre social, afin d’encourager la coopération entre employeurs et l’organisation des activités saisonnières. À l’origine, il s’agissait de permettre à des entreprises de petite taille, le plus souvent agricoles et connaissant de fortes activités saisonnières, d’embaucher des salariés dont le coût aurait été trop élevé pour chacune des entreprises prises individuellement.
Les avantages du dispositif en termes d’emploi ont conduit à sa généralisation. Le seuil d’effectifs pour adhérer à un groupement d’employeurs a été relevé de dix salariés en 1985 à trois cents en 1993 (68) puis assouplie par la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail, dite « loi Aubry III » et enfin supprimée par la loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011 pour le développement de l’alternance et la sécurisation des parcours professionnels. Depuis lors, les entreprises de taille intermédiaire (ETI) ou des grandes entreprises peuvent donc, le cas échéant, être membres fondateurs d’un groupement ou adhérer ultérieurement à un groupement existant.
La loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux a permis aux entreprises de constituer des groupements avec des collectivités territoriales (article 59) à certaines conditions, assouplies par la loi du 28 juillet 2011 précitée. Les collectivités territoriales ne doivent pas être majoritaires dans le groupement. Les tâches confiées aux salariés du groupement mis à disposition d’une collectivité territoriale ne peuvent constituer l’activité principale du groupement. Le temps consacré par chaque salarié aux tâches effectuées pour le compte des collectivités territoriales adhérentes ne peut excéder, sur l’année civile, la moitié de la durée du travail contractuelle ou conventionnelle ou, à défaut, légale, calculée annuellement.
Les GE se sont vus reconnaître un champ d’intervention croissant. Les spécificités des « groupements d’employeurs pour l’insertion et la qualification » (GEIQ) ont ainsi été reconnues par l’article 20 de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale, afin d’encourager le développement de ces groupements qui organisent des parcours d’insertion et de qualification pour des salariés rencontrant des difficultés d’insertion.
• Une réalité encore mal connue
Les groupements d’employeurs sont insuffisamment connus : les services de l’État ne disposent pas de données statistiques précises sur le nombre, la composition, l’état financier et les pratiques de gestion des groupements d’employeurs, autre que les données partielles fournies par des fédérations nationales de groupements d’employeurs.
Le dénombrement des GE pose des difficultés puisque nombre de GE mono-sectoriels ne se déclarent pas avec l’activité « groupement d’employeurs » pour activité principale (code APE de l’INSEE). À l’inverse, certaines structures référencées avec le code APE de groupements d’employeurs n’en sont pas.
Une étude quantitative et qualitative est en cours, sous l’égide de la direction générale de l’emploi et de la formation professionnelle (DGEFP) du ministère de l’emploi, avec la participation de la direction générale des entreprises (DGE), de la direction générale des finances publiques (DGFiP) et du ministère de l’agriculture.
Les organisations de représentation ou d’animation des groupements d’employeurs sont nombreuses. À la fin des années 1990, plusieurs organisations ont été créées sous statut associatif : des associations à vocation régionale (Centres de ressources de Poitou-Charentes, des Pays de la Loire, de l’Aquitaine, de la Bretagne, du Languedoc Roussillon et de l’Auvergne) ou sectorielle (Fédération nationale des groupements d’employeurs agricoles et ruraux, Fédération nationale profession sport et loisirs). L’Union des groupements d’employeurs de France (UGEF) fut la première association à vocation nationale. Deux syndicats créés respectivement en 2014 et 2015 complètent ce paysage : la Fédération nationale des groupements d’employeurs (FNGE), qui revendique 81 adhérents après un an d’existence, soit 4 365 adhérents utilisateurs (entreprises adhérentes aux groupements) pour 2 397 équivalent temps plein, et le Syndicat national des groupements d’employeurs (SNGE), créé en janvier 2015, qui revendique 22 adhérents aujourd’hui.
Selon l’UGEF, reprise dans l’évaluation préalable du Gouvernement, il existe aujourd’hui 4 500 GE, dont environ 4 000 groupements agricoles, environ 100 GEIQ et environ 300 groupements à vocation économique (hors GE agricoles et GEIQ). L’ensemble représenterait 26 000 emplois. La plupart des groupements d’employeurs à vocation économique sont intersectoriels. L’assujettissement des groupements à la TVA, dès lors qu’un de leurs membres y est assujetti, a conduit à la création de groupements « hors TVA », dans le secteur associatif par exemple.
Selon le Centre de ressources pour les groupements d’employeurs (CRGE), autre organisation professionnelle, le nombre total de GE déclarés au Journal officiel des associations et des fondations d’entreprises atteindrait 5 065, dont 400 GE « classiques » (13 000 emplois), 165 GEIQ (2 600 emplois) et 4 500 GE agricoles (19 000 emplois). L’ensemble représenterait ainsi 34 600 emplois et un chiffre d’affaires de 650 millions d’euros environ. Ces chiffres sont des majorants, une partie des GE déclarés au Journal officiel étant en sommeil ou ayant disparu.
Selon les éléments recueillis par la DGE, les adhérents des groupements d’employeurs sont souvent de petites entreprises (TPE, PME, associations). Très peu d’ETI ou de grandes entreprises y participent. Le nombre moyen de mis à disposition en équivalents temps plein serait compris, le plus souvent, entre deux-trois salariés et quelques dizaines, voire une centaine de salariés. La structure type d’un groupement d’employeurs est composée d’un directeur – en général un spécialiste des ressources humaines –, un assistant et un secrétaire.
Exemples de groupements d’employeurs
1er cas : un groupement de taille moyenne.
– Effectif : 19 équivalents temps plein ;
– Masse salariale annuelle chargée brut : 402 000 euros ;
– Dernier bénéfice connu avant impôt sur les sociétés (IS) : 5 000 euros.
2e cas : un groupement multisectoriel de grande taille par rapport à la moyenne.
– Effectif : 74 équivalents temps plein (ETP) ;
– Masse salariale annuelle chargée brut : 1 950 000 euros ;
– Dernier bénéfice connu avant IS : 13 000 euros.
3e cas : un groupement multisectoriel de grande taille par rapport à la moyenne avec une dominante industrielle.
– Effectif : 84 équivalents temps plein ;
– Masse salariale annuelle chargée brut : 3 175 000 euros ;
– Dernier bénéfice connu avant IS : 60 000 euros.
Source : direction générale des entreprises.
Données agrégées sur six groupements
Une étude menée en Pays de la Loire sur la structure financière de six groupements de taille relativement importante a dégagé les données suivantes (en données agrégées pour les six groupements étudiés ) :
– chiffre d’affaires agrégé : 6,35 millions d’euros ;
– charges : 4,28 millions d’euros de salaires, 1,25 million d’euros de charges sociales (dont 351 812 euros pour les salaires des permanents et 113 820 euros pour les charges de structure) ;
– tranche d’impôt sur les sociétés : 15 % ;
– montant total d’impôt et taxes acquittés : 137 234 euros pour 2013.
Source : direction générale des entreprises.
• La possibilité de constituer une réserve de précaution défiscalisée pour le paiement des salaires
Les membres du groupement sont solidairement responsables des dettes à l’égard des salariés et des organismes créanciers de cotisations obligatoires (article L. 1253-8 du code du travail). Par dérogation, les statuts des groupements d’employeurs peuvent prévoir, sur la base de critères objectifs, des règles de répartition de ces dettes entre les membres du groupement, opposables aux créanciers. Ils peuvent également prévoir des modalités de responsabilité spécifiques pour les collectivités territoriales membres du groupement.
L’article 57 de la loi du 23 février 2005 précitée a créé la possibilité pour les groupements d’employeurs de constituer une réserve de précaution défiscalisée. Il s’agissait de favoriser la solidarité financière au sein des groupements d’employeurs en cas de défaillance temporaire de l’un des membres.
En effet, en application des articles L. 1253-1 et suivants du code précité, le contrat de travail du salarié est conclu avec le groupement d’employeurs de sorte qu’il revient à ce dernier de payer le salarié, quand bien même l’entreprise auprès de laquelle le salarié est mis à disposition ne peut plus rémunérer la prestation de service. L’assurance de garantie des salaires, apportée par l’Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS), ne peut donc être mise en œuvre au bénéfice des salariés du groupement que si le groupement lui-même connaît une défaillance.
Autre facteur de fragilité : le groupement d’employeurs est un créancier simple, autrement dit non prioritaire, vis-à-vis de ses adhérents car la créance n’est pas de nature salariale ; elle est considérée comme la contrepartie d’une prestation de services.
Cette provision défiscalisée finance donc la mise en œuvre de la responsabilité solidaire des groupements d’employeurs, prévue à l’article L. 1253-8 précité. Elle a depuis été codifiée au 8° du 1 de l’article 214 du code général des impôts (CGI), lors de la recodification de 2008 (69), et n’a pas été modifiée depuis.
Conformément aux dispositions du CGI, les groupements d’employeurs peuvent, à la clôture de l’exercice, déduire de leur bénéfice imposable, de manière extra-comptable, et dans la limite de 10 000 euros, les sommes provenant des recettes de l’exercice et inscrites à un compte d’affectation spéciale ouvert auprès d’un établissement de crédit afin de faire face à la mise en œuvre de la responsabilité solidaire pour le paiement des dettes salariales prévue à l’article L. 1253-8 précité.
Tous les GE sont visés, à savoir :
– les groupements d’employeurs mentionnés aux articles L. 1253-1 à L. 1253-18, c’est-à-dire les groupements de PME désireuses de recruter un même salarié à temps partagé pour occuper une fonction économique dont le volume ne peut justifier, du fait de la taille de l’entreprise, la création d’un emploi ;
– les groupements d’employeurs agricoles mentionnés à l’article R. 1253-14 du même code, permettant le remplacement des chefs d’exploitations ou d’entreprises agricoles ainsi que des membres non salariés de leur famille travaillant sur l’exploitation en cas d’absences temporaires (maladie, accident, maternité, formation professionnelle, etc.) ;
– les groupements d’employeurs composés à la fois de personnes physiques ou morales de droit privé et de collectivités territoriales ou de leurs établissements publics et mentionnés à l’article L. 1253-19.
L’épargne doit être déposée sur un compte bancaire spécifique ouvert au nom du groupement d’employeurs. Elle doit être inscrite à l’actif du bilan et provenir des recettes de l’exécution. Le compte bancaire retrace les opérations aux sommes épargnées dans le cadre de la déduction mais peut aussi recevoir des sommes épargnées qui n’ont pas bénéficié de celle-ci.
L’épargne accumulée est pourvue d’une sorte de « date de péremption ». Les entreprises membres du groupement doivent utiliser les sommes épargnées au cours des cinq exercices qui suivent leur versement. À défaut, ces sommes seront « refiscalisées », c’est-à-dire que la déduction sera rapportée aux résultats du cinquième exercice suivant celui au titre duquel elle a été versée.
Si l’épargne constituée est utilisée pour un autre objectif que la mise en œuvre de la responsabilité solidaire, les déductions relatives aux sommes utilisées sont rapportées au résultat de l’exercice au cours duquel cette utilisation a été effectuée.
Il est possible pour les groupements d’employeurs de constituer une provision plus importante, l’avantage fiscal restant, en tout état de cause, plafonné à 10 000 euros.
Selon la DGE, compte tenu de leur taille réduite, le montant d’impôt sur les sociétés acquitté par les groupements d’employeurs est déjà faible. La plupart des groupements sont imposés à taux réduit (15 %). Pour mémoire, le taux réduit d’impôt concerne les entreprises dont le chiffre d’affaires est inférieur à 7,63 millions d’euros. Le montant du bénéfice imposable au taux réduit d’impôt sur les sociétés à 15 % est plafonné à 38 120 euros par exercice comptable de 12 mois.
Les dispositions en vigueur présentent deux limites principales :
– le plafond actuel des sommes déductibles de 10 000 euros par exercice pendant cinq ans paraît insuffisant pour faire face à des dettes durables et simultanées des membres d’un groupement, ce qui réduit l’incitation à former des groupements d’employeurs ;
– il n’est pas exprimé en pourcentage de la masse salariale, ce qui n’incite pas à augmenter le nombre de salariés.
• Un plafond insuffisant en période de difficultés économiques
Selon la DGE du ministère de l’économie, les retours d’expérience recueillis en Poitou-Charentes et dans les Pays de la Loire montrent que les groupements d’employeurs provisionnent en général, par précaution, le maximum possible, soit 10 000 euros sur cinq ans, dès qu’ils parviennent à une taille importante, soit une dizaine d’entreprises adhérentes et autant de salariés mis à disposition, en équivalents temps plein (ETP).
Il s’agit de parer à des défaillances financières simultanées de plusieurs adhérents qui ne peuvent plus payer les factures pour le paiement des salariés mis à disposition. La provision évite de faire appel à la solidarité des entreprises adhérentes solvables.
La DGE a transmis à la Rapporteure générale des exemples réalistes de situations où le maximum de provision peut paraître trop limité pour couvrir la dette.
● Premier cas : un groupement d’employeurs composé de seize entreprises adhérentes et comptant huit salariés, dont la masse salariale est inférieure à 500 000 euros.
Ce groupement s’est développé dans plusieurs domaines d’activité, il est donc multisectoriel. Cinq salariés, en contrat à durée indéterminée (CDI) au sein du groupement d’employeurs, sont mis à disposition chez un premier adhérent de janvier à mai ; de juin à décembre, ils sont mis à disposition auprès d’un second adhérent. Leurs parcours sont donc construits en temps partagé auprès de plusieurs adhérents. Les cinq postes ne sont pas identiques, il y a un magasinier, un cadre, une secrétaire administrative, un ouvrier polyvalent, un administrateur de site internet. Le premier adhérent est subitement placé en liquidation judiciaire et ne peut pas payer les factures des trois derniers mois de mises à disposition. Le montant de l’impayé se monte à 45 000 euros (sur la base d’un salaire d’environ 2 000 euros, auquel s’ajoutent environ 1 000 euros de charges, multiplié par trois mois d’impayés et par cinq salariés).
Dans ce cas, on constate que le groupement utilise la quasi-totalité de sa provision pour risque.
● Deuxième cas : la même situation se produit dans un groupement d’employeurs de quarante salariés qui met à disposition dix salariés en temps partagé entre un premier adhérent pendant cinq mois de l’année et un second adhérent les sept mois restants. Le premier adhérent est placé en liquidation judiciaire et ne peut pas payer les factures des trois derniers mois. Le montant de l’impayé se monte cette fois à 90 000 euros pour les dix salariés suivant la même méthode de calcul.
● Troisième cas : il en serait de même avec deux fois cinq salariés mis à disposition de deux adhérents qui connaîtraient tous deux des difficultés sérieuses pour honorer leur créance.
Dans les deux derniers exemples, le montant maximum de 50 000 euros provisionné sur cinq ans est insuffisant.
• Un plafond qui n’est pas corrélé à la masse salariale
La deuxième limite invoquée par le Gouvernement dans son évaluation préalable à l’appui d’un changement de plafond a trait au caractère forfaitaire de ce dernier. Exprimé de la sorte, il inciterait à limiter le nombre de salariés par groupement.
Le plafonnement de la déduction en pourcentage de la masse salariale permettrait de relever le montant maximal de la provision tout en la proportionnant à la taille du groupement d’employeurs. Associée à l’obligation d’utiliser les sommes provisionnées dans les cinq années et dans le but fixé, cette solution contribuerait à lutter contre d’éventuels effets d’aubaine.
À l’issue d’un conseil restreint sur l’emploi et l’activité dans les très petites et les moyennes entreprises (TPE-PME), le Premier ministre a présenté, le 9 juin 2015, dix-huit « mesures fortes pour lever les freins, les incertitudes, simplifier la vie des TPE et des PME et donc encourager l’embauche ». En matière fiscale, certaines mesures annoncées avaient l’ambition de rendre plus attractif les groupements d’employeurs :
– adapter le régime de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) des groupements d’employeurs au sens du code du travail pour les services rendus aux adhérents non assujettis à cette taxe ;
– relever le plafond en déduction d’impôt de la provision de responsabilité solidaire du groupement envers les adhérents défaillants en permettant d’appliquer un plafond calculé sur la masse salariale (2 %) ;
– confirmer l’application aux groupements de moins de vingt salariés de la déduction de cotisations patronales sur les heures supplémentaires des entreprises de cette taille.
Le présent article ne substitue pas au plafond de 10 000 euros un nouveau mode de calcul fondé sur la masse salariale mais offre une alternative.
Il modifie le premier alinéa du 8° du 1 de l’article 214 du CGI, de sorte que les groupements pourront provisionner au moins 10 000 euros, quelle que soit leur masse salariale, et jusqu’à 2 % du montant de leur masse salariale majorée des cotisations salariales.
Les rémunérations prises en compte sont les salaires bruts, c’est-à-dire les salaires nets et les cotisations salariales.
Cette rédaction garantit ainsi une provision minimale aux groupements composés des plus petites entreprises. A contrario, pour un groupement dont la masse salariale s’élève à un million d’euros par an, la réforme permettra de provisionner deux fois plus qu’aujourd’hui. Pour une masse salariale de 800 000 euros, la provision pourra atteindre 16 000 euros par an.
Ce pourcentage de 2 % est celui qu’ont proposé les organisations de groupements d’employeurs. Il n’est pas apparu opportun d’aller au-delà. À cet égard, la DGE estime qu’il ne serait pas aisé de provisionner plus de 100 000 euros sur cinq ans pour de petites structures, qui ont une trésorerie limitée.
Il restera toujours possible pour un groupement de provisionner au-delà de 2 %, le dégrèvement fiscal restant en tout état de cause plafonné à 2 % de la masse salariale. Il est également possible, en cas de défaillance particulièrement grave, de solliciter directement les autres adhérents qui restent tenus à une solidarité financière.
• Un coût pour les finances publiques difficile à évaluer
D’après l’Évaluation des voies et moyens annexée au projet de loi de finances pour 2015, la dépense fiscale n° 320122 correspondant à la provision déductible de l’impôt sur les sociétés des groupements d’employeurs « coûte » actuellement 6 millions d’euros par an au budget de l’État.
À partir des déclarations de résultats déposées par les redevables au titre des exercices clos en 2013 et dont la forme juridique est codifiée « groupement d’employeurs », il a été possible d’identifier 2 400 groupements d’employeurs sur les 4 500 estimés.
Sur ces 2 400 redevables, 200 déclarent un montant de masse salariale et de cotisations sociales supérieur à 500 000 euros. Ces 200 redevables sont donc susceptibles de bénéficier d’une provision de plus de 10 000 euros après la réforme (500 000 × 2 %).
L’estimation est réalisée en posant la double hypothèse selon laquelle les 200 redevables ont déjà atteint une provision de 10 000 euros et qu’ils déclareront après la réforme une provision égale à 2 % de la masse salariale.
Le surplus de provision est estimé à 5 millions d’euros, ce qui donne un surcoût pour l’État de 0,75 million d’euros après application d’un taux moyen d’impôt sur les sociétés de 15 %. Extrapolée à l’ensemble des 4 500 groupements d’employeurs, cette hypothèse conduit à un coût majorant de 1,5 million d’euros. L’évaluation préalable retient donc une fourchette entre 1 et 2 millions d’euros.
Ce calcul est évidemment valable toutes choses égales par ailleurs. Le but de la mesure étant d’encourager et de développer la formule du groupement d’employeurs, un écart à la hausse pourrait être observé. A contrario, la DGE souligne que les petites entreprises n’ont pas intérêt à provisionner des montants trop importants, ce qui les inciterait plutôt à la modération sauf si les risques qu’elles perçoivent sont élevés.
• Un effet bénéfique sur l’emploi difficile à apprécier
Les bénéfices en termes d’emploi du présent article ne sont évalués ni par la DGE ni par les fédérations et syndicats des groupements d’employeurs.
Aujourd’hui selon l’UGEF, les groupements d’employeurs représentent 26 000 emplois. Le CRGE avance le chiffre de 34 600.
L’objectif des trois mesures annoncées par le Gouvernement est de développer le recours aux groupements d’employeurs qui permettent à des salariés de partager leur temps entre plusieurs entreprises tout en ayant un emploi stable et à temps plein.
L’expression du plafond de la provision déductible de l’impôt sur les sociétés en pourcentage de la masse salariale vise à ne pas décourager les groupements d’employeurs qui voudraient embaucher davantage de salariés.
*
* *
La commission adopte l’article 5 sans modification.
*
* *
La commission est saisie de l’amendement I-CF 295 de Mme Eva Sas.
M. Éric Alauzet. Une catégorie de jeunes, un peu plus qualifiés que ceux visés par le dispositif, n’est pas concernée par le système des emplois d’avenir. Avec un coût de 6 000 euros par an et par emploi – contre 10 000 pour un emploi d’avenir –, cette mesure serait de nature à faciliter l’embauche de ces jeunes et à leur mettre le pied à l’étrier.
Mme la Rapporteure générale. Vous proposez d’octroyer un crédit d’impôt sur les sociétés à des organismes qui en sont exonérés, ce qui revient à une subvention brute. Vous m’opposerez qu’un dispositif de même type existe déjà en faveur des organismes s’occupant de logement social en outre-mer, mais nous souhaitons éviter de répéter ce schéma.
Cet amendement a déjà été rejeté l’an dernier. Avis défavorable.
La commission rejette l’amendement I-CF 295.
Elle examine ensuite, en discussion commune, les amendements I-CF 364 à I-CF 366 de M. Alain Fauré.
Mme Christine Pires Beaune. Ces trois amendements visent à revenir sur le dispositif plus communément connu sous le nom de « niche Copé ». L’amendement I-CF 365 vise à substituer au taux de 8 % le taux de 19 %. Les deux autres sont de repli.
Mme la Rapporteure générale. Je suis favorable à l’esprit des amendements que vous proposez. Toutefois, ces amendements sont placés dans la première partie du projet de loi de finances, ce qui est inadéquat. Ils devraient être déposés en seconde partie pour éviter l’application du dispositif dès les revenus générés en 2015.
Concernant les différents taux que vous proposez, il faut que nous approfondissions un peu plus ces amendements. Soit vous les retirez maintenant pour les redéposer en séance, soit, à ce stade, je donne un avis de sagesse.
Mme Christine Pires Beaune. Je retire les amendements.
M. le président Gilles Carrez. Placés en première partie, ces amendements ne seront pas rétroactifs, mais ils relèveront de ce que l’on appelle la « petite rétroactivité », c’est-à-dire qu’ils s’appliqueront aux exercices clos à compter du 31 décembre 2015, et donc à la totalité des exercices civils sur l’année 2015. C’est très ennuyeux pour des opérations patrimoniales qui ont été faites sous l’empire d’une certaine fiscalité et qui n’auraient pas eu lieu si cette fiscalité avait été – comme en l’occurrence – multipliée par quatre.
M. Charles de Courson. Nous avons débattu de la question pendant des années. Que l’on soit pour ou contre l’« amendement Copé », on doit avoir conscience que, si l’on revient sur cette mesure, cela aura pour conséquence un gel total des opérations. Les grands groupes ne feront plus leurs opérations en France et cela accentuera la délocalisation des sièges.
M. le président Gilles Carrez. Madame Pires Beaune, je vous invite à relire le rapport que Lionel Jospin avait commandé à Michel Charzat en 2001 et à la suite duquel cette décision avait été prise. Jusque-là, les opérations de cession de titres de participation se faisaient systématiquement à l’étranger, notamment aux Pays-Bas.
Les amendements I-CF 364 à I-CF 366 sont retirés.
La commission en vient à l’amendement I-CF 129 de M. Charles de Courson.
M. Charles de Courson. Au lieu de se concentrer sur la contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S), il eût été préférable que le Gouvernement prenne des mesures en faveur des petites et moyennes entreprises (PME) en réduisant progressivement le taux de l’impôt sur les sociétés de 15 à 10 %, dans la limite du plafond de la première tranche des bénéfices, et qu’il n’y touche plus ensuite. Tout le monde reconnaît que ce sont, en grande partie, les petites et moyennes entreprises qui créent des emplois et développent ce pays. Au lieu de construire des usines à gaz, encourageons les PME !
Mme la Rapporteure générale. Cet amendement, qui cible les PME, est intéressant. J’en avais déposé un dans le même esprit il y a deux ans : il visait à étendre à toutes les PME la taxation à 15 % des premiers 38 000 euros de résultat net. Aujourd’hui, elle ne concerne que les entreprises ayant un chiffre d’affaires de moins de 7,6 millions d’euros.
Toutefois, je vais donner un avis défavorable à votre amendement, monsieur de Courson, car de nombreux dispositifs ont été mobilisés. Ce matin, vous nous avez appelés à la vigilance sur l’ensemble des finances publiques. Des choix ont été faits qui profitent aux PME. Le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE) étant ciblé jusqu’à 2,5 SMIC, il profite d’abord aux PME et aux très petites entreprises (TPE). L’effort consenti par la Nation en faveur de ces entreprises est déjà considérable et l’état de nos finances publiques ne nous permet pas d’accepter votre proposition.
M. Dominique Lefebvre. Le problème de cet amendement, c’est qu’il propose un allégement de la fiscalité sur les entreprises financé par un alourdissement significatif de la fiscalité sur les ménages – avec l’augmentation des droits sur le tabac. Si vous estimez, monsieur de Courson, que votre proposition est plus pertinente que d’autres, il eût été préférable d’indiquer, parmi les mesures que nous nous apprêtons à voter en faveur des entreprises, celle qui devrait être reportée ou différée pour financer celle que vous proposez.
J’en profite pour rappeler que, en 2016, les augmentations de fiscalité qui ont été votées par la précédente majorité et par la nôtre et qui ont pesé sur les entreprises depuis 2011 auront été effacées. À ce stade, nous avons de bonnes raisons de maintenir l’allégement, prévu en 2016, d’environ 1 milliard d’euros de C3S qui va toucher énormément de PME et de TPE, s’agissant d’un impôt sur le chiffre d’affaires dont tout le monde constate que ce n’est pas le plus intelligent. Je rappelle que, dans le pacte de responsabilité et de solidarité, la baisse du taux de l’impôt sur les sociétés est prévue pour 2017.
Nous proposons cette année un paquet de 9 à 10 milliards d’euros d’allégements pour les entreprises en 2016 en ne reconduisant pas la surtaxe d’impôt sur les sociétés de 2,5 milliards d’euros. Nous aurons, en 2017, à débattre en particulier de la dernière tranche de C3S : si la mesure est votée par notre assemblée, il restera 3,5 milliards de C3S pour 20 000 entreprises. On peut poursuivre dans cette voie, on peut également annoncer que l’on va réfléchir à la manière de redistribuer ces sommes, soit par une baisse du taux général de l’impôt sur les sociétés, soit par une baisse ciblée sur les PME. Pour cela, je vous donne rendez-vous plutôt l’année prochaine.
M. Charles de Courson. J’ai eu ce débat en privé avec M. Sapin. Je lui ai dit que je ne comprenais pas ses choix fiscaux. Il est beaucoup plus intelligent et beaucoup plus efficace, avec la même somme, de baisser le taux de l’impôt sur les sociétés pour les PME et de revenir progressivement à des taux plus proches de la moyenne européenne, au-delà du seuil des 30 000 euros et quelques, que de s’échiner à éliminer la C3S. Il est vrai que c’est un impôt imbécile, mais, quand on n’a pas de marge de manœuvre, il faut se fixer des priorités.
Je prends acte de ce qu’a dit Dominique Lefebvre et j’espère que, l’année prochaine, il m’appuiera pour en finir avec la C3S et passer à l’impôt sur les sociétés, en commençant par les PME, à coût inchangé.
La commission rejette l’amendement I-CF 129.
Puis elle examine, en discussion commune, les amendements I-CF 313 et I-CF 311 de Mme Eva Sas.
M. Éric Alauzet. Nous proposons d’abaisser le plafond de la fraction des dépenses éligibles au taux de 30 % du crédit d’impôt recherche (CIR) de 100 à 50 millions d’euros. Moins de 2 % des entreprises déclarent plus de 20 millions d’euros de recherche et développement (R&D) en France. A contrario, cela veut dire que près de 98 % des entreprises déclarent moins de 20 millions d’euros de R&D. Le plafond de 100 millions d’euros n’a donc de facto aucune raison d’être, alors qu’il occasionne une perte de revenu de 500 millions d’euros pour l’État. L’impact global de cet amendement se chiffrerait à hauteur de 1 milliard d’euros, somme qui pourrait être utilisée notamment pour financer la recherche publique.
Le dispositif du CIR est considéré au niveau européen comme une mesure de dumping fiscal, alors que nous sommes engagés dans la lutte contre l’évasion fiscale générée par les pratiques déloyales de certains pays. Le CIR nous permet de garder un certain nombre d’entreprises sur notre territoire, mais ce n’est pas très loyal non plus.
Mme la Rapporteure générale. Vous ne pouvez à la fois déposer un amendement pour que l’on apprécie le plafond de dépenses au niveau du groupe consolidé, afin qu’il n’y ait pas de filiales qui multiplient à l’envi le plafond de 100 millions d’euros, et déposer celui-ci pour redescendre le plafond à 50 millions d’euros. Pour certaines entreprises industrielles, ce n’est pas raisonnable au regard de l’effort de recherche qu’elles font. C’est du point de vue économique que je ne partage pas votre sentiment. Avis défavorable.
M. Jean-Louis Gagnaire. Nous devons vivre avec le CIR tel qu’il existe jusqu’à la fin de la législature. Dans un contexte hyperconcurrentiel, nous n’avons pas intérêt à changer une virgule au système actuel, car toute déstabilisation pourrait avoir des conséquences extrêmement graves sur les investissements d’un certain nombre d’entreprises dans le domaine de la recherche et du développement.
On peut toujours en contester le bien-fondé, y compris dans le cas des grands groupes qui calculent le CIR à travers leurs filiales, mais il faut savoir que, s’il n’y avait pas ces dispositions, certains grands groupes ne pourraient pas mener à bien leur activité de recherche et développement dans des filiales dites « mineures ».
Le crédit d’impôt recherche est mal nommé : il s’agit en réalité d’un CICE pour les ingénieurs et les techniciens supérieurs. Il permet de rendre la masse salariale plus supportable, grâce à une réduction du coût des ingénieurs. Ceux qui l’ont conçu souhaitaient redonner de la compétitivité à la R&D dans les entreprises. L’objectif du CIR n’a jamais été de faire de la recherche académique, mais il a permis aux entreprises françaises les plus innovantes de rester en vie et d’être concurrentielles au niveau international.
Ne déstabilisons pas un système que nous envient de nombreux pays et qui rend la France très attractive. Certes, il faut se demander ce que nous ferons ensuite avec les start-up, car il s’agit bien de financer l’innovation. Je serais tenté de donner un coup de rabot sur le CIR, parce qu’il manque de l’argent ailleurs – notamment à la Banque publique d’investissement (BPI) et dans les pôles de compétitivité. Mais, pour l’instant, ne touchons pas au système.
M. Dominique Lefebvre. À la constance de ceux de nos collègues qui, à chaque projet de loi de finances, déposent des amendements visant à modifier le CIR, répondra celle du groupe socialiste, républicain et citoyen, qui, depuis le début de la législature, a choisi de le maintenir en l’état et s’opposera à tous ces amendements.
Mme Karine Berger. Lors du dernier débat sur le sujet dans l’hémicycle, nous avons appris que, du fait des règles encadrant le marché commun, toute dépense de recherche réalisée dans l’Union européenne était éligible au crédit d’impôt recherche en France. J’espère bien que le CIR n’est pas le CICE des entreprises de technologie, et que vous n’allez pas m’apprendre qu’embaucher des gens en République tchèque donne droit au CICE en France – ce qui n’est pas le cas aujourd’hui. Madame la Rapporteure générale, avez-vous pu avoir connaissance des sommes couvertes par un CIR alors qu’elles ne sont pas dépensées sur le territoire français ?
Mme la Rapporteure générale. C’est un point crucial. Suite à la dernière loi de finances, j’ai fait plusieurs demandes concernant le CIR. Il s’élevait à 470 millions d’euros en 2002, à 3,4 milliards d’euros en 2012 et à 5,3 en 2015. Force est de constater que les dépenses de recherche n’ont pas progressé dans cette proportion.
J’ai en vain demandé à Bercy un tableau décomposant le montant du CIR entre ce qui est payé à des entreprises en France pour faire de la recherche en France et ce qui est payé pour faire de la recherche l’étranger. On m’a simplement communiqué les montants de CIR des cinquante premières entreprises qui le perçoivent : ce document, couvert par le secret fiscal, est imprimé sur cinquante pages et enfermé dans un coffre de la commission des finances. J’ai expliqué à Bercy que le Gouvernement encourageant la simplification et la productivité, il serait bon qu’on me fasse parvenir ces informations sous forme d’un fichier informatique, qui me permettrait de faire le tri entre ce qui est payé en France et qui l’est à l’étranger.
M. Charles de Courson. Bercy a-t-il fait le calcul ?
Mme la Rapporteure générale. Je l’ignore.
M. Charles de Courson. Je croyais qu’il y avait un accord entre tous les groupes politiques pour ne plus toucher au crédit d’impôt recherche. Ne bougeons plus jusqu’à la fin de la législature et réfléchissons.
Je confirme ce qu’a dit la Rapporteure générale : il n’est pas interdit à une entreprise de sous-traiter pour partie sa recherche dans un institut tchèque ou allemand, et d’être éligible au CIR.
M. Éric Alauzet. L’amendement I-CF 311 propose de consolider les dossiers des différentes filiales au niveau du groupe pour éviter les cumuls et le découpage du CIR à travers l’ensemble des filiales. Il s’agit de centraliser les demandes et de réduire le CIR en conséquence.
Mme la Rapporteure générale. J’y suis favorable. Mais, si l’on veut éviter la petite rétroactivité, mieux vaudrait déposer cet amendement en seconde partie du projet de loi de finances. Pour cette raison, je vous suggère de retirer l’amendement.
M. Charles de Courson. Nous avons eu ce débat pendant des années. Il est vrai que le fait de calculer entreprise par entreprise pose un problème au regard des groupes. Mais soyons pragmatiques ! Un tel amendement pénaliserait les grandes entreprises françaises les plus performantes, comme Airbus ou les groupes automobiles. Tout cela est très compliqué : il faut définir le périmètre du groupe, consolider l’ensemble des dépenses ; il peut y avoir des échanges de recherche à l’intérieur d’un groupe ; des centres de recherche financés par plusieurs entreprises du groupe ; la recherche peut se faire en interne ou en externe. On ne peut que souhaiter la neutralité de l’organisation des groupes au regard des impôts que nous votons. Cela étant, j’appelle votre attention sur les conséquences d’un tel amendement, qui vise à économiser 500 millions d’euros.
Mme Arlette Grosskost. Ce que souhaitent nos entreprises, les petites comme les grandes, c’est la stabilité fiscale. Si nous touchons à ce dispositif, nous en revenons à l’instabilité. De grâce, arrêtons ! Redonnons confiance à nos entreprises !
M. Dominique Lefebvre. L’année dernière, notre commission a adopté à la majorité des amendements remettant en cause le CIR, lesquels ont finalement été rejetés dans l’hémicycle. Cette manœuvre a eu pour seul effet de générer des interrogations sur la permanence du dispositif. Je n’ai aucun élément qui me laisse penser que la position du groupe socialiste, républicain et citoyen ait changé par rapport à l’an dernier. Aussi, mieux vaut éviter d’adopter en commission des amendements qui seront rejetés dans l’hémicycle par le Gouvernement et par notre groupe.
M. Éric Alauzet. Je redéposerai l’amendement I-CF 311 en seconde partie.
L’amendement I-CF 311 est retiré.
La commission rejette l’amendement I-CF 313.
Puis elle en vient à l’amendement I-CF 314 de Mme Eva Sas.
M. Éric Alauzet. Cet amendement propose de conditionner le CIR d’un montant supérieur ou égal à 1 million d’euros à la création d’un poste à destination d’un docteur. Dans la plupart des pays de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), le doctorat est considéré comme un passeport pour les postes à responsabilité dans le secteur privé, du fait de l’autonomie des réseaux académiques et de l’ouverture à l’international de ces diplômes. En France, la séparation entre universités et grandes écoles a contribué à éloigner les chercheurs de la R&D, si bien que 9 % des titulaires d’un diplôme de doctorat sont en recherche d’emploi trois ans après leur soutenance de thèse, contre 2 à 4 % dans les autres pays de l’OCDE. C’est un gâchis énorme pour le développement économique de notre pays.
Mme la Rapporteure générale. S’agissant du CIR, le dispositif « jeunes docteurs » existe déjà, avec la prise en compte des rémunérations des jeunes docteurs pour le double de leur montant dans l’assiette du CIR. Il convient de laisser un peu de liberté aux entreprises en ce qui concerne leur manière de mener leur R&D.
Avis défavorable.
La commission rejette l’amendement I-CF 314.
Article additionnel après l’article 5
Application du doublement des dépenses prises en compte dans le cadre du crédit d’impôt recherche pour les opérations confiées aux instituts technologiques agricoles et aux instituts technologiques agro-industriels
La commission en vient à l’amendement I-CF 217 de M. Charles de Courson.
M. Charles de Courson. C’est un petit amendement dont le coût est estimé à 3 millions d’euros. Après de longs débats, nous avons intégré dans le code de la recherche les centres techniques industriels (CTI). Mais nous avons oublié leurs équivalents dans le domaine de l’agriculture : les instituts technologiques agricoles (ITA) et les instituts technologiques agro-industriels (ITAI). Au total, ils sont trente. Cet amendement propose de rendre éligible au crédit d’impôt la recherche faite dans ces instituts.
Mme la Rapporteure générale. Charles de Courson a raison. Cet avantage a été reconnu aux CTI uniquement via des rescrits fiscaux. Je confirme également le montant de 3 millions d’euros. Avis favorable.
La commission adopte l’amendement I-CF 217.
*
* *
La commission examine l’amendement I-CF 312 de Mme Eva Sas.
M. Éric Alauzet. Cet amendement vise à supprimer la possibilité de cumuler CIR et CICE.
Nous aurions intérêt à conduire une évaluation englobant le CIR et le CICE, puisque les deux dispositifs montent en puissance. Au total, nous allons arriver à un montant de 25 ou 26 milliards d’euros.
Mme la Rapporteure générale. Nous avons déjà eu le débat l’an dernier. Les deux dispositifs ne visent pas tout à fait les mêmes objectifs. Avis défavorable.
La commission rejette l’amendement I-CF 312.
La commission est saisie de l’amendement I-CF 128.
M. Charles de Courson. Il s’agit d’un amendement « hollandiste », qui vise à appliquer ce qu’a annoncé le Président de la République : le CICE est trop compliqué et il faut le remplacer par une baisse des cotisations sociales. Je partage entièrement cette thèse, que je défends depuis vingt-deux ans. Je cite les propos tenus le 6 novembre 2014 par le Président de la République : « Nous allons faire le CICE pendant trois ans ; ça va monter en régime, et après, en 2017, tout ce qui a été mis sur l’allégement du coût du travail, ça sera transféré en baisse de cotisations sociales pérennes ». Je ne puis qu’approuver de tels propos et je propose simplement d’anticiper d’un an. Je suis un « super hollandiste » !
M. le président Gilles Carrez. Quel est le coût de ce dispositif ?
M. Charles de Courson. Le coût est nul puisqu’on supprime le CICE pour pouvoir baisser les cotisations sociales.
M. Olivier Carré. Vous dites qu’il y a une montée en puissance, mais il y a toujours un recul. Les montants dus cette année aux entreprises seront effectivement délivrés dans deux ans.
Nous sommes aujourd’hui pris dans une mécanique infernale. L’État a une créance envers les entreprises et les derniers montants dus au titre de l’exercice 2012 seront versés en 2016. La transition ne peut se faire que sur une impasse de l’ordre de 25 milliards d’euros. La même année, l’État devra deux montants : celui dû à la sécurité sociale pour compenser la baisse des cotisations et la créance envers les entreprises au titre de l’exercice précédent. Il y a donc un écart très significatif. C’est au Gouvernement et au législateur de décider ensuite s’il doit être payé tout de suite ou en cinq ans. Vous pouvez ne pas payer la créance aux entreprises, mais cela ne rassurera personne. Je n’ose pas imaginer que c’est ce qu’avait en tête le Président de la République.
Mme la Rapporteure générale. Avis défavorable.
M. Charles de Courson. L’argument d’Olivier Carré est très conservateur. Si l’on poussait sa thèse jusqu’au bout, aucune modification ne serait possible. En réalité, il y a au moins deux moyens de basculer du CICE vers de moindres charges sociales. D’une part, il est possible d’appliquer dès le 1er janvier 2017 de moindres cotisations, en gelant le système du CICE pour 2016 ; d’autre part, comme pour la TVA, il est possible de geler la créance liée au CICE et de la dégeler graduellement.
M. Olivier Carré. Il n’y aurait certes rien d’original à étaler ainsi une créance. Mais je considère qu’il s’agit d’une question de loyauté de l’État vis-à-vis des entreprises qui ont déjà inscrit cette créance dans leurs comptes.
M. Dominique Lefebvre. Nul ne contestera les propos du Président de la République. Dans son rapport sur la sécurité sociale, la Cour des comptes a consacré un chapitre entier au bouleversement que constituerait, pour la structure de financement de la sécurité sociale, ce basculement présenté comme inéluctable.
Dans un rapport, France Stratégie a constaté que le dispositif du CICE monte en charge et que les entreprises s’en saisissent. En changeant de système, nous bouleverserions leurs décisions en matière d’investissement et d’embauche, en raison des incertitudes qui en découleraient et qui engendreraient à leur tour de la paralysie et affecteraient finalement l’emploi. Misons plutôt sur la stabilité et la lisibilité de la législation.
Je note cependant avec intérêt, monsieur de Courson, que vous soutiendriez le Président de la République s’il devait, dans une campagne pour sa réélection, proposer cette mesure.
Mme Véronique Louwagie. Substituer une baisse des cotisations sociales au CICE aurait immédiatement un effet positif sur l’emploi. La baisse de cotisations est en outre plus simple à mettre en pratique que le CICE, qui nécessite une déclaration particulière et représente ainsi une contrainte administrative supplémentaire.
Enfin, il s’agit de transparence. Alors que le CICE apparaît dans les comptes des entreprises qui paient l’impôt sur les sociétés, il n’en va pas de même quand il est imputé sur d’autres types d’impôts, tels que l’impôt sur le revenu. Il serait bon que le montant du crédit d’impôt soit connu de tous, quel que soit l’impôt sur lequel il est imputé.
M. Olivier Carré. Je partage l’analyse de Véronique Louwagie. Au comité de suivi des aides publiques aux entreprises, nous avons aussi constaté que les entreprises préféreraient une baisse sèche de charges, même si le CICE est entré dans leurs habitudes.
De multiples ambiguïtés affectent également le dispositif. Elles disparaîtraient si les transferts de la branche famille étaient par exemple retirés de la feuille de paie.
La commission rejette l’amendement I-CF 128.
Elle examine ensuite l’amendement I-CF 370 de M. Éric Woerth.
Mme Véronique Louwagie. Je pourrais reprendre l’argumentation que j’ai développée à propos de l’amendement précédent. Cet amendement vise quant à lui à instituer une baisse des cotisations salariales et patronales de 15 % sur les 500 premiers euros de salaire. Produisant un effet immédiat, cette mesure aurait aussi l’avantage de la simplicité et de la transparence. Elle serait gagée par la mise en place d’une TVA sociale.
Mme la Rapporteure générale. Avis défavorable. Une taxe supplémentaire ne ferait que compliquer le dispositif. S’agissant de votre argumentaire précédent : pour les entreprises qui s’acquittent de l’impôt sur le revenu, le CICE n’apparaît pas dans leur compte de résultat, c’est vrai. C’est pourquoi j’avais, par des amendements aux précédents projets de loi de finances, proposé qu’il puisse être versé sur un compte distinct de celui du contribuable.
La commission rejette l’amendement I-CF 370.
Elle examine ensuite, en discussion commune, les amendements I-CF 14 de M. Marc Le Fur, I-CF 132 de M. Charles de Courson et I-CF 46 de M. Marc Le Fur.
M. Marc Le Fur. L’amendement I-CF 14 pourrait être une illustration de l’avantage que présenterait une baisse de charges par rapport au CICE, qui ne touche pas toutes les entreprises. Ainsi, les compagnies maritimes de commerce, qui emploient parfois jusqu’à 2 000 marins, ne bénéficient pas du dispositif, car les armateurs ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés. Tel est le cas de Brittany Ferries.
À défaut de baisse des charges, il faut donc aller vite. Des amendements semblables sont également défendus par nos collègues socialistes ; le sujet dépasse donc les clivages partisans. Je veux cependant souligner l’intérêt d’aller vite pour décider une baisse de charges générale, mesure claire, cohérente et définitive, qui éviterait les scories telles que celles visées par le présent amendement.
M. le président Gilles Carrez. Cette question s’est posée dès l’origine du CICE.
Mme la Rapporteure générale. S’agissant du passage du forfait au réel…
M. Marc Le Fur. Il s’agit d’un tout autre sujet ! Les armateurs s’acquittent d’une taxe au tonnage, non de l’impôt sur les sociétés.
Mme la Rapporteure générale. Précisément, ils peuvent exercer une option en faveur d’une taxe sur le tonnage réel, plutôt que de s’acquitter de l’impôt sur les sociétés.
M. Olivier Carré. J’ai étudié le sujet avec notre collègue Yves Blein. L’option au tonnage réel est en effet plus favorable aux compagnies maritimes que l’impôt sur les sociétés. Toutefois, depuis le CICE, elles préféreraient payer l’impôt sur les sociétés, sur lequel le crédit d’impôt pourrait être imputé. Lorsque la question s’est posée, la période où l’option pouvait être exercée était fermée. Il s’agissait donc de savoir s’il était possible de la rouvrir. Le ministère des finances était d’accord.
Mme la Rapporteure générale. J’en étais également restée à l’idée que ces entreprises pouvaient exercer un choix entre le régime réel au tonnage et l’impôt sur les sociétés. Nous pourrons faire le point en séance publique, mais il me semble que l’article 74 de la seconde loi de finances rectificative pour 2014 a rouvert le délai d’option.
M. le président Gilles Carrez. Monsieur Le Fur, vous pourriez donc déposer à nouveau cet amendement en vue de la séance publique.
L’amendement I-CF 14 est retiré.
M. Charles de Courson. Le CICE exclut les entreprises soumises au régime forfaitaire d’imposition, telles que celles qui sont aujourd’hui touchées par la crise de l’élevage. Ce serait faire un geste à leur égard que de les faire bénéficier du dispositif. Tel est le premier objet de l’amendement I-CF 132.
Par ailleurs, je voudrais qu’on en finisse avec l’usine à gaz que constituent les sociétés fiscalement translucides – sociétés mixtes dont tous les porteurs de part ne sont pas des exploitants agricoles. Assis sur la masse salariale de la société mixte, le CICE est recalculé au prorata des parts, mais il n’est versé qu’aux exploitants agricoles pour les parts qu’ils détiennent.
Je plaide donc à la fois pour l’extension du CICE aux entreprises soumises au régime forfaitaire d’imposition, et pour une simplification du régime applicable aux sociétés fiscalement translucides.
M. Marc Le Fur. Voici encore un cas dans lequel la baisse des charges simplifierait tout par rapport à l’application du CICE !
Mme la Rapporteure générale. Avis défavorable. Nous avons déjà étudié des amendements de ce type.
La commission rejette successivement les amendements I-CF 132 et I-CF 46.
Puis elle examine, en discussion commune, les amendements I-CF 16 et I-CF 17 de M. Marc Le Fur.
Mme la Rapporteure générale. Ces amendements sont déjà satisfaits.
Les amendements I-CF 16 et I-CF 17 sont retirés.
La commission examine ensuite l’amendement I-CF 149 de M. Pascal Cherki.
M. Pascal Cherki. Cet amendement vous a déjà été présenté l’an dernier et l’année précédente. Il est certes normal que l’État aide à renforcer le tissu économique et productif, y compris au moyen de dépenses fiscales, tels les crédits d’impôt. Mais toutes les dépenses fiscales que nous décidons doivent être compensées, et, comme nous avons décidé de réduire le déficit, nous ne pouvons guère recourir qu’à la réduction des dépenses publiques, en diminuant le financement de ministères utiles, comme le ministère de l’agriculture, ou à des hausses d’impôt. Dès lors que nous avons choisi de dépenser plusieurs milliards d’euros pour renforcer le tissu productif, encore faut-il mobiliser cet instrument à bon escient.
Par cet amendement, je propose donc d’exclure les sociétés cotées sur les marchés du champ des entreprises éligibles au CICE, et de n’en faire bénéficier que les TPE, PME et entreprises de taille intermédiaire (ETI), qui représentent près de 83 % des entreprises françaises et forment la trame de notre tissu économique : elles ont besoin de trésorerie et ne peuvent faire appel à des financements issus des marchés.
Mme la Rapporteure générale. Avis défavorable. Il n’est pas possible d’établir de discrimination qui reposerait sur le mode de financement des entreprises, que ce soit par action, par augmentation de capital ou par souscription de dette. Ce n’est pas sur cette base qu’on peut établir leur niveau de richesse et leur besoin de soutien.
M. Olivier Carré. Ce que vise le CICE, c’est un soutien à la compétitivité de l’emploi en France, de sorte que les groupes mondialisés cotés à Paris ne sont soutenus qu’en fonction de leurs emplois en France. Les PME et TPE bénéficient des mêmes avantages, dans les mêmes conditions et pour les mêmes raisons. Votre proposition est donc économiquement absurde, sans même aborder la question sous l’angle de la jurisprudence constitutionnelle.
M. Pascal Cherki. Nous mènerons de nouveau le débat en séance publique. Il y aurait un parallèle à tracer avec la loi sur les 35 heures. Fallait-il prévoir une compensation pour toutes les entreprises, qu’il s’agisse de Saint-Gobain ou d’une petite PME ? Je reste persuadé que, à l’heure où chacun doit se serrer la ceinture, il est problématique de venir en aide aux entreprises du CAC 40, car elles ont une surface financière qui ne justifie pas ce soutien.
M. le président Gilles Carrez. Quand le CICE aura été remplacé par une baisse de charges, nos débats seront beaucoup plus courts… Allons même plus loin et barémisons-la, c’est-à-dire intégrons-la dans un barème. Ainsi, nous n’en parlerions plus. Aujourd’hui, certaines cotisations ne sont pas prélevées, mais le taux apparent est tout de même conservé.
M. Olivier Carré. Il conviendrait aussi de les plafonner ! Dans un travail mené avec M. Jean Pisani-Ferry, nous nous sommes aperçus qu’il y a des problèmes sur les salaires plus importants, chez les salariés très qualifiés.
M. Marc Le Fur. Quand il était encore possible de poser des questions écrites sans limitation, j’avais interrogé le Gouvernement pour savoir quel est le montant de CICE attribué au groupe Carrefour. Je n’ai jamais eu la réponse.
M. le président Gilles Carrez. Le secret fiscal existe.
La commission rejette l’amendement I-CF 149.
Elle examine ensuite les amendements I-CF 130, I-CF 131 et I-CF 200 de M. Charles de Courson, qui peuvent faire l’objet d’une présentation commune.
M. Charles de Courson. Par l’amendement I-CF 130, je propose que les travailleurs indépendants puissent également bénéficier du CICE. Ne représentent-ils pas 10 % de la force de travail de la France ?
L’amendement I-CF 131 propose que les travailleurs indépendants agricoles puissent également en bénéficier.
Enfin, l’amendement I-CF 200 propose que le travail non salarié agricole soit pris en compte, dans la limite d’un plafond équivalent à deux fois et demie le SMIC. Et ne me dites pas que les travailleurs indépendants ne sont pas soumis à la concurrence internationale !
Mme la Rapporteure générale. Je vous répondrai sur un autre terrain. Ces amendements nous avaient déjà été présentés l’an dernier. Mais la situation a changé depuis lors, car, depuis le 1er janvier 2015, les travailleurs indépendants bénéficient d’une réduction de charges de 1 milliard d’euros. Cette mesure me semble plus avantageuse. Votre objectif est donc déjà atteint. Avis défavorable.
M. le président Gilles Carrez. Il s’agit même d’une baisse directe de cotisations !
M. Charles de Courson. Avez-vous du moins chiffré le coût de l’amendement I-CF 130 ? L’application générale du CICE coûterait-elle plus ou moins que le milliard d’euros que vous évoquez ?
La commission rejette successivement les amendements I-CF 130, I-CF 131 et I-CF 200.
Elle examine ensuite l’amendement I-CF 315 de Mme Eva Sas.
Mme Eva Sas. Voici un amendement qui pourrait, me semble-t-il, emporter l’adhésion de nombre de nos concitoyens. Interrogés par sondage, les Français s’y déclareraient certainement favorables. Il s’agit en effet de moduler le taux du CICE en fonction de la taille de l’entreprise, en favorisant les TPE et les PME.
Mme la Rapporteure générale. Avis défavorable. Le soutien aux PME et TPE est un objectif louable. Mais le CICE est déjà concentré sur ces entreprises, en raison de leur structure de salaires.
Mme Véronique Louwagie. Nous regrettons cependant l’existence de seuils : ce sont des freins au développement de l’économie française, qui aurait intérêt à ce que les PME deviennent des ETI. N’amplifions pas encore le phénomène avec des éléments supplémentaires, qui renforceraient ces seuils, voire en créeraient de nouveaux.
M. Charles de Courson. Il y a un argument supplémentaire contre cet amendement. S’il était adopté, un salarié n’ouvrirait pas droit au même montant de CICE selon que l’entreprise où il est employé est grande ou petite. Il y a de grandes entreprises où les salaires ne sont pas élevés et méritent d’être soutenus – la grande distribution en est un exemple.
Mme Eva Sas. Certes, le rapport d’application sur le CICE a mis en évidence qu’il est plus favorable aux PME et aux TPE. Mais pourquoi ne pas amplifier ce phénomène grâce à un taux plus important ?
Madame Louwagie, si le tissu économique français manque d’ETI, il faut précisément les favoriser grâce à un taux préférentiel.
Mme Karine Berger. Monsieur de Courson, je voudrais tout de même rappeler que ce ne sont pas les salariés qui touchent le CICE.
M. Olivier Carré. Sauf s’il facilite des augmentations de salaire !
Mme Karine Berger. J’ajoute que le Conseil constitutionnel estime que nos textes fondamentaux permettent de tolérer une modulation des baisses de cotisations patronales en fonction de la taille des entreprises. Je comprends parfaitement la démarche d’Eva Sas. Il serait mille fois plus utile de soutenir les PME et ETI que les grandes entreprises qui captent 8 milliards d’euros grâce au CICE.
La commission rejette l’amendement I-CF 315.
Elle examine ensuite l’amendement I-CF 316 de M. Éric Alauzet.
M. Éric Alauzet. Cet amendement vise à réduire de moitié le CICE d’une entreprise, lorsqu’elle verse à ses actionnaires des dividendes qui représentent plus de 12 % du bénéfice imposable. Dans son intention, il rejoint donc l’amendement I-CF 149 défendu tout à l’heure par Pascal Cherki.
Certes, le versement du CICE n’est pas soumis à des conditions. Mais nous avons tout de même inscrit dans la loi qu’il ne peut servir ni à rémunérer les actionnaires par des dividendes ni à augmenter les salaires des dirigeants des entreprises. Nous aurions pu ajouter qu’il ne peut servir non plus à des transferts fiscaux.
Bien sûr, pour expliquer l’effondrement des marges, il faut prendre en compte la concurrence internationale ou la question du coût des salaires français par rapport aux salaires des autres pays. Mais il ne faut pas oublier de considérer aussi la rémunération parfois éhontée du capital, qui peut atteindre 12, 13 ou 14 %. L’année dernière, j’avais proposé un seuil à 10 %. Cette année, j’essaye 12 %. Je tenterai 14 % l’année prochaine. Nous verrons jusqu’à quel niveau nous sommes prêts à supporter ces rémunérations.
Mme la Rapporteure générale. Avis défavorable. Votre amendement pose la question de savoir comment les marges des entreprises doivent être utilisées. Je tiens à vous signaler que son adoption priverait la plupart des entreprises du CAC 40 de son bénéfice. Le taux de distribution de dividendes oscille en effet entre 35 % et 45 %.
Entre fin 2013 et fin 2014, les marges des entreprises sont passées de 29,4 % à 31 %. Rapporté à la valeur ajoutée, leur excédent brut d’exploitation équivaut, en montant, au soutien que leur ont apporté le CICE et le pacte de responsabilité. Je soumets ces éléments à votre réflexion. Il n’en demeure pas moins que, si nous voulons un peu de stabilité de la législation, nous ne saurions adopter cet amendement.
La commission rejette l’amendement I-CF 316.
Elle examine ensuite l’amendement I-CF 201 de M. Charles de Courson.
M. Charles de Courson. Cet amendement concerne de nouveau les sociétés fiscalement translucides, qui font l’objet d’une discrimination infondée. Je souligne qu’il ne s’agirait que d’une petite dépense.
Suivant l’avis défavorable de la Rapporteure générale, la commission rejette l’amendement I-CF 201.
Elle examine ensuite, en discussion commune, les amendements I-CF 317 de Mme Brigitte Allain et I-CF 406 de la commission des affaires économiques.
Mme Eva Sas. L’amendement I-CF 317 est issu d’un rapport parlementaire, salué par tous, sur les circuits courts et la relocalisation des filières agroalimentaires. Il apparaît que nous manquons d’abattoirs de proximité multi-espèces ; ils bénéficieraient ainsi d’un crédit d’impôt sur les sociétés. Un amendement semblable a été adopté par la commission des affaires économiques.
M. François Pupponi, rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques. Je confirme que l’amendement I-CF 406, identique, a été adopté par la commission des affaires économiques. Trop d’abattoirs ont déjà fermé et les éleveurs doivent désormais parcourir des distances trop longues.
Mme la Rapporteure générale. Vous mentionnez les « dépenses d’aménagement et de fonctionnement nécessaires » et les « filières de proximité » sans clairement définir ni les unes ni les autres. On est alors dans le champ de l’incompétence négative, ce qui nous serait reproché par le Conseil constitutionnel. Avis défavorable.
M. Charles de Courson. Mes chers collègues, vous affirmez qu’il y a eu, au cours des dernières années, une concentration massive et une spécialisation des abattoirs. C’est au contraire l’insuffisance de la concentration qui nous pose des problèmes : en France, l’abattage coûte environ 1 euro par kilo de plus qu’en Allemagne, ce qui nuit à la compétitivité d’une partie de l’élevage de notre pays. Dans le grand Est, les transformateurs de viande envoient en masse les animaux en Allemagne afin de profiter de cette différence de prix d’abattage. Votre proposition est anti-économique et elle ne pourrait que contribuer à accentuer encore la dégradation de l’élevage français. C’est l’inverse qu’il faut faire.
M. François André. Pour m’en tenir au raisonnement économique qui sous-tend l’amendement, je m’étonne aussi de ce que vous affirmez. En Bretagne, la région que je connais le mieux, la disparition d’abattoirs est directement liée à la baisse de la production animale. C’est la reconquête de l’élevage qui permettra d’accroître les capacités d’abattage, et non l’inverse.
M. Razzy Hammadi. L’amendement d’Eva Sas, soutenu par la commission des affaires économiques, est certes fiscal et budgétaire, mais il a aussi à voir avec la stratégie de développement économique. Je suis en total désaccord avec Charles de Courson. La compétitivité par les coûts – fondée sur le développement de très grosses structures et une course au moins-disant qui conduit à payer les salariés 2 euros de l’heure en Allemagne – est un échec dans ce domaine. Pour le bétail comme pour la volaille, les modèles qui réussissent sont ceux qui ont promu la petite exploitation de très bonne qualité. On peut mener une stratégie de filière dans certaines régions, en veillant au respect d’un équilibre entre les exploitations de diverses tailles. Il nous faut aussi une stratégie budgétaire et fiscale pour encourager la qualité, le circuit court. Pour ne citer que cet exemple, le Label Rouge n’a aucun problème depuis 1955. Cette réussite contredit les propos que vous venez de tenir. Pour cette raison, je soutiendrai cet amendement.
M. Charles de Courson. Je n’aurai pas la cruauté de dire que Montreuil, ce n’est pas vraiment la France agricole…
M. Razzy Hammadi. S’il vous plaît, monsieur de Courson, n’employez pas ce type d’arguments. Sinon, dès que vous parlerez de politique de la ville, je vous demanderai de vous taire !
M. le rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques. Contrairement à ce que notre collègue de Courson peut penser, le problème de l’abattage et des abattoirs concerne également Montreuil et Sarcelles ! Certains de nos compatriotes, qui veulent abattre des animaux, en particulier des moutons, vont en Angleterre, parce qu’il n’y a pas d’abattoir local.
M. le président Gilles Carrez. Où sont les moutons chez vous ?
M. le rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques. Nous en avons, nous en élevons ! Je vous invite à venir visiter les élevages de moutons à Sarcelles. Je ne plaisante pas !
Pour en revenir à l’amendement, j’entends vos arguments concernant l’est de la France ou la Bretagne. La France agricole est diverse. En montagne, où la bonne charcuterie se fait pendant l’hiver, les agriculteurs sont parfois obligés de parcourir des centaines de kilomètres pour trouver un abattoir. Nous souhaitons favoriser le maintien d’abattoirs de proximité pour les agriculteurs qui travaillent en circuit court, sans mettre en péril l’équilibre économique. Ne nous racontons pas d’histoires : les agriculteurs qui ne peuvent pas aller à l’abattoir régional tuent sur place en ne respectant aucune règle d’hygiène. Dans certaines régions, il y a besoin d’abattoirs de proximité.
M. Joël Giraud. Pour abonder dans le même sens, en prenant ma casquette de président de la commission permanente du Conseil national de la montagne, je puis vous assurer que les abattoirs de proximité sont indispensables dans certaines régions.
Si vous n’avez pas entendu parler de crise dans certains endroits, notamment dans les territoires de montagne, c’est tout simplement parce que l’utilisation exclusive des circuits courts a tiré les prix vers le haut, ce qui a permis de développer une filière dont la reconnaissance est liée aux signes de qualité. Quand je parle aux agriculteurs de ma circonscription des négociations en cours sur le prix du porc, ils m’expliquent qu’ils vendent leurs animaux trois fois plus cher que le prix minimum dont il est question. Ils travaillent dans une autre logique économique, celle des filières courtes. Ils ne me parlent que d’un risque : la fermeture éventuelle de certains abattoirs de proximité. C’est pourquoi je voterai pour cet amendement qui correspond à une agriculture variée. Pour les filières courtes, il est absolument indispensable que les abattoirs de ces petits territoires puissent subsister.
M. Alain Fauré. Pour renchérir sur les propos de mes collègues, je dirai qu’il ne peut pas y avoir un seul type d’abattoir, mais des entreprises adaptées à chaque situation. En Ariège, nous avons deux petits abattoirs qui fonctionnent très bien, sans être déficitaires. Ils offrent une prestation de qualité et permettent le maintien de circuits courts rentables : les producteurs tuent, transforment et vendent eux-mêmes. Ces abattoirs sont certes subventionnés, mais ils permettent de conserver des emplois et contribuent à la valorisation du territoire.
M. Dominique Lefebvre. Je ne m’aventurerai pas dans un débat de fond sur la politique des abattoirs, d’autant que je n’étais pas de ceux qui, à la Cour des comptes, ont rendu un rapport sur le secteur – et sont revenus traumatisés de leurs édifiantes visites sur le terrain.
À mes collègues de la commission des affaires économiques, qui posent un intéressant débat de politique publique, je signale que nous sommes ici en commission des finances. À chacun son rôle ! Tout comme moi, notre Rapporteure générale s’est bien gardée d’intervenir sur le fond, mais, à l’appui de son avis négatif, elle a évoqué l’incompétence négative. Existe-t-il un décret qui détermine ce qu’est une filière de proximité ou un abattoir multi-espèces ? Quoi qu’il en soit, dans votre amendement, vous ne faites pas référence à la détermination par décret.
Même si cet amendement franchissait le cap de la commission des finances puis du débat dans l’hémicycle, je suis à peu près certain qu’il n’irait guère au-delà : tel que rédigé, il sera sans portée. La commission des affaires économiques l’a adopté : il reviendra donc dans l’hémicycle. Le ministre des finances s’exprimera. Peut-être le ministre de l’agriculture viendra-t-il aussi. Mais, à la commission des finances, on ne peut pas adopter un dispositif de crédit d’impôt qui n’est pas opérationnel.
M. le rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques. J’entends ce que dit Dominique Lefebvre. S’agissant de la forme, il a été demandé à la commission des affaires économiques de remettre un rapport sur la fiscalité agricole, ce qui a été fait. Dans un monde normal, la commission des affaires économiques et la commission des finances auraient travaillé ensemble à la mise en œuvre d’une partie des mesures proposées dans ce rapport. Je peux admettre que cet amendement soit mal rédigé et je suis prêt à le reprendre pour l’améliorer.
M. le président Gilles Carrez. Ce travail sur la fiscalité agricole a été conduit par notre collègue François André.
M. le rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques. Oui, et c’est la commission des affaires économiques qui essaie de faire en sorte que les propositions contenues dans ce rapport ne restent pas lettre morte.
Mme la Rapporteure générale. C’est ce qu’a fait François André.
M. le rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques. Et ce que nous avons fait nous aussi. Cet échange montre que nous avons sûrement besoin de mieux travailler ensemble sur ces sujets : nous sommes compétents sur le fond et, comme l’a dit notre collègue Lefebvre, vous êtes compétents en matière de finances. Je propose que nous retirions cet amendement et que nous en présentions en séance publique une version améliorée grâce aux lumières des commissaires aux finances.
M. François André. Un rapport sur la fiscalité agricole a été élaboré à l’initiative de la commission des finances, dont certaines propositions ont été reprises dans le projet de loi de finances et le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Des amendements qui vont être discutés dans quelques minutes – et je l’espère adoptés – vont venir enrichir le projet de loi de finances. Mais la mesure que vous présentez dans votre amendement ne fait pas partie des propositions retenues par les membres de la mission d’information.
M. le rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques. Nous avons travaillé tous seuls dans notre coin sur le sujet.
Mme Eva Sas. Pour poursuivre dans la même veine que mes collègues Hammadi, Pupponi et Giraud, je voudrais insister sur la nécessité de repenser notre modèle agricole. Monsieur de Courson, je vous invite à réfléchir à l’agriculture d’aujourd’hui, qui n’est pas celle d’hier. Nous ne devons pas forcément aller vers une concentration accrue et des abattoirs géants. En tout cas, ce n’est pas le modèle que nous proposons.
Puisqu’une majorité semble approuver le fond de cet amendement, peut-être pourrions-nous en améliorer la forme avant la séance publique, avec l’aide de la Rapporteure générale et des services de la commission ? Je peux admettre que sa rédaction pose un problème, mais son objectif doit demeurer le même : encourager fiscalement les abattoirs de proximité, car c’est ce dont nous avons besoin actuellement en France.
M. Éric Alauzet. Monsieur le président, il y a des gens qui ont travaillé sur le fond de ce sujet. Ici, nous n’avons pas forcément la science infuse en ce qui concerne la pertinence d’un tel modèle. Nous avons peut-être plus de compétences que d’autres sur les finances, mais, pour évaluer le modèle économique, nous ne sommes peut-être pas les meilleurs.
M. le président Gilles Carrez. Monsieur Alauzet, la Rapporteure générale s’est bornée à expliquer que l’amendement n’était pas correctement rédigé et posait notamment des problèmes d’incompétence négative.
M. Éric Alauzet. Mais il y a eu d’autres interventions. D’aucuns évoquent l’Est ou l’Ouest, mais ces régions ne sont pas uniformes et la France est diverse. Ma région est à l’est aussi, un peu plus au sud que celle de Charles de Courson. Nous avons pu y sauver de petits abattoirs, diversifiés ou spécialisés, qui s’intègrent dans le cadre d’une économie locale. Je pense à un abattoir de porcs destinés à la fabrication de la saucisse de Morteau, par exemple. Toutes les étapes sont traitées sur le territoire, et tout le monde gagne sa vie le long de la chaîne.
Un modèle paraît incontournable : la concurrence mondiale, les salariés allemands payés à 4 ou 5 euros de l’heure, les produits cotés sur les marchés internationaux. Si c’est notre seul horizon, nous courons à l’échec : à la fin, tout le monde sera mort. Il faut savoir réagir.
M. Étienne Blanc. Nous avons tous dans nos régions de petits abattoirs en situation difficile. Vous proposez une mesure fiscale pour les aider à se mettre aux normes. Mais nous savons tous que ce qui leur permet de se mettre aux normes, ce sont les subventions accordées par les départements et les régions. Sans cette perfusion, ils n’y parviendraient pas. Voyez ce qu’a perçu l’abattoir de Morteau. Ce que vous proposez n’est pas à la hauteur des enjeux des mises aux normes imposées par l’Union européenne.
Les amendements I-CF 317 et I-CF 406 sont retirés.
La commission examine l’amendement I-308 de M. Éric Alauzet.
M. Éric Alauzet. Je reviens sur le CICE qui, il est vrai, encombre nos débats. Je rappelais ce qu’il ne doit pas faire, en défendant mes amendements sur les dividendes et sur les hauts salaires. On peut aussi se demander s’il est bien opportun d’accorder le bénéfice du CICE à des entreprises qui font de l’optimisation fiscale agressive. Les entreprises doivent remettre tous les ans aux services fiscaux une description générale de la politique de prix de transfert du groupe auquel elles appartiennent. Cet amendement propose de réduire le CICE de celles qui ne remplissent pas cette obligation.
Mme la Rapporteure générale. Lors des débats sur la loi du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière, nous avons adopté un amendement présenté par Pierre-Alain Muet, Sandrine Mazetier et Karine Berger sur les prix de transfert. Vous en étiez d’ailleurs aussi signataire, si mes souvenirs sont exacts. Toutes les entreprises dont le chiffre d’affaires est supérieur à 400 millions d’euros doivent transmettre annuellement à l’administration fiscale la description générale de toute leur politique de prix de transfert. C’est une obligation. Peut-être allez-vous me dire qu’il faut abaisser le seuil de chiffre d’affaires ou supprimer le CICE si ces obligations ne sont pas remplies ? Il y a déjà eu beaucoup d’actions concernant ces prix de transfert.
Incidemment, je signale que d’autres mesures vont être proposées dans le cadre de la mise en œuvre des quinze recommandations de l’OCDE qui tendent à éviter l’évasion et l’optimisation fiscale agressive.
J’émets donc un avis défavorable à votre amendement. Il faut éviter de tout mélanger et de tout rattacher au CICE, dont les objectifs sont un peu différents.
M. Éric Alauzet. Mon amendement s’appuie précisément sur le dispositif prévu par la loi du 6 décembre 2013, qu’il cherche à rendre plus opérationnel. Quand une obligation n’est pas assortie d’éventuelles sanctions, elle peut ne pas être très opérante. Le CICE nous offre l’occasion d’intervenir. Le jour où il disparaîtra, remplacé peut-être par un allégement de charges, nous ne nous poserons plus toutes ces questions.
Même s’il encombre nos discussions, ce débat sur le CICE nous conduit à être plus vigilants sur la manière dont les entreprises utilisent l’argent public. Cet argent est souvent bien utilisé, si l’on en juge par les propos de notre Rapporteure générale sur la reconstitution des marges qui serait parallèle au montant du CICE, mais j’aimerais savoir ce qu’il en est en fonction de la taille des entreprises.
La commission rejette l’amendement I-CF 308.
Puis elle examine, en discussion commune, les amendements I-CF 296 et I-CF 297 de Mme Eva Sas.
Mme Eva Sas. L’amendement I-CF 296 vise à promouvoir l’apprentissage. Cet après-midi dans l’hémicycle, Mme Myriam El Khomri, ministre du travail, a redit à quel point l’apprentissage – et l’alternance en général – était la meilleure voie d’entrée des jeunes dans le monde du travail et un élément essentiel et prioritaire des politiques de l’emploi à l’égard des jeunes. Cet amendement d’appel avait déjà été déposé l’année dernière et il ne lui avait manqué que quatre voix pour être adopté en séance publique. Il propose de faire bénéficier les entreprises d’un crédit d’impôt sur les sociétés de 500 euros par mois et par apprenti. Il s’agit d’insister sur la nécessité de passer de la parole aux actes en la matière, car, rappelons-le, l’apprentissage a reculé en 2014.
M. Éric Alauzet. L’amendement I-CF 297 est plus qu’un amendement d’appel et tend à répondre à une difficulté particulière : pour d’innombrables raisons, nombre de jeunes entrent de plus en plus tard dans l’apprentissage, ce qui va bien avec l’idée de la deuxième chance, mais ils coûtent beaucoup plus cher aux chefs d’entreprise qui les embauchent. Il s’agit ici d’ajuster les aides publiques à l’âge de l’apprenti, afin que cette catégorie ne soit pas exclue pour cette raison de surcoût.
Mme la Rapporteure générale. Dans le tome I du rapport que nous mettrons en ligne, nous allons refaire un point sur l’apprentissage. Les politiques de soutien à l’apprentissage ont fait le yo-yo, mais un très gros effort a été consenti au cours des deux dernières années. Une entreprise de moins de onze salariés, qui prend un apprenti pendant quatre ans, perçoit 12 000 euros d’aides, celles de la région incluses. Son apprenti payé au SMIC lui coûte en réalité 525 euros par mois. Les apprentis mineurs représentant environ les trois quarts du total, les aides sont concentrées sur eux. Quand l’apprenti est majeur, elles sont moins élevées. Nous ferons un point précis sur les entreprises de moins de onze salariés qui emploient des apprentis mineurs ou majeurs. Mais il me semble que le soutien aux entreprises n’a jamais atteint de tels montants.
J’émets donc un avis défavorable à ces deux amendements.
M. Olivier Carré. Il serait intéressant de rapprocher ces mesures de dispositions existant par ailleurs, qui peuvent relever de la commission des affaires sociales ou de voies réglementaires, et du durcissement de l’environnement du code du travail. D’un côté, la position de l’exécutif a fait un aller-retour au cours du quinquennat, et c’est heureux. De l’autre, l’inflation normative s’est poursuivie, complexifiant encore la vie de l’entrepreneur, et de celui qui doit encadrer le jeune. Si ma mémoire est bonne, un risque pénal est même apparu. Résultat, quand on les rencontre sur le terrain, en dehors de la question du coût, les chefs d’entreprise mettent en avant les risques liés à l’environnement réglementaire du travail et se plaignent de ne pas avoir d’apprentis à former.
Mme Eva Sas. Un travail est effectué sur l’apprentissage et des efforts ont été accomplis au cours des deux dernières années, dites-vous, madame la Rapporteure générale. Dans ce cas, pourquoi le nombre de nouveaux contrats d’apprentissage a-t-il baissé de 3,2 % en 2014 ? Quels sont les chiffres récents ? Quelle dynamique est mise en œuvre ? Il est urgent de faire le point. À notre avis, les mesures sont insuffisantes. Mais peut-être aurons-nous des réponses dans votre rapport.
La commission rejette successivement les amendements I-CF 296 et I-CF 297.
*
* *
Article 6
Prorogation du dispositif d’amortissement accéléré
applicable au matériel de robotique industrielle
Le présent article proroge d’une année – jusqu’en 2016 – le dispositif d’amortissement exceptionnel sur vingt-quatre mois prévu par la loi de finances pour 2014 pour encourager la robotisation dans l’industrie.
L’amortissement est une notion comptable, qui correspond à la prise en compte de la dépréciation d’un actif du fait de son utilisation. Les deux principaux modes d’amortissement admis sont le système linéaire, régime de droit commun, et le système dégressif, réservé à certaines catégories de biens.
• L’amortissement linéaire, de droit commun
Le système linéaire répartit de manière égale le prix de revient sur la période d’amortissement. Par exemple, l’amortissement d’une machine d’une valeur de 100 utilisable pendant cinq ans ouvre droit à la déduction d’un montant de 20 pendant cinq exercices. La première annuité est réduite prorata temporis en cas d’acquisition en cours d’exercice. Le point de départ de l’amortissement est situé à la date de mise en service. La dernière annuité est aussi réduite prorata temporis si le bien est cédé en cours d’exercice.
• L’amortissement dégressif, pour encourager l’investissement productif
Le système de l’amortissement dégressif a été introduit pour des raisons économiques. Il incite l’entreprise au renouvellement de ses investissements. Il consiste à appliquer un taux constant à la valeur résiduelle. Ainsi, les premières annuités sont plus élevées que les dernières, ce qui permet de dégager plus rapidement de la trésorerie pour renouveler l’immobilisation.
En application de l’article 39 A du code général des impôts (CGI), l’amortissement dégressif ne concerne que certaines catégories de biens d’équipements, généralement industriels, ainsi que certains immeubles limitativement énumérés. La durée d’utilisation du bien doit être supérieure ou égale à trois ans. Le bien doit avoir été acquis à l’état neuf.
Les matériels et outillages utilisés pour les opérations industrielles de fabrication et de transformation sont éligibles à l’amortissement dégressif, prévu à l’article 39 A du CGI. Ainsi les robots industriels peuvent être amortis soit selon le mode linéaire soit selon le mode dégressif.
L’annuité d’amortissement se calcule en multipliant la valeur nette comptable de l’immobilisation (c’est-à-dire la différence entre la valeur d’origine et l’amortissement) par un taux contant. Comme la valeur nette comptable diminue chaque année, les annuités sont nécessairement dégressives. Le taux constant est égal au produit du taux linéaire normal par un coefficient qui est de :
– 1,25 si la durée d’utilisation est de trois ou quatre ans ;
– 1,75 si la durée d’utilisation est de cinq ou six ans ;
– 2,25 la durée d’utilisation est supérieure à six ans.
Le coefficient applicable en cas d’amortissement dégressif sur cinq ans est de 2,25, soit un taux d’amortissement de 45 % (soit 20 % × 2,25). Pour un bien de valeur 100, l’application de ce taux permet de déduire 45 la première année, 24,75 la deuxième année (45 % de [100 – 45]), 13,6 la troisième année
(45 % de [100 – 45 – 24,75]). On utilise cette formule jusqu’à que le taux d’amortissement dégressif soit inférieur au taux d’amortissement linéaire.
Le coefficient est parfois majoré pour certains biens, notamment les matériels destinés à économiser l’énergie, en application de l’article 39 AA du CGI.
Comme pour l’amortissement linéaire, la première annuité est réduite prorata temporis en cas d’acquisition en cours d’exercice. Mais le point de départ de l’amortissement est situé à la date d’acquisition et non à la date de mise en service. Sur le plan comptable, l’amortissement ne peut être pratiqué qu’à compter de la mise en service ; le supplément d’amortissement fiscal n’est déductible que par le truchement des amortissements dérogatoires. La première annuité se calcule en mois ; le mois d’acquisition est retenu pour sa totalité.
• Des mécanismes d’amortissement exceptionnels ou dérogatoires, pour des incitations ciblées
Diverses mesures législatives ou réglementaires ont prévu des amortissements exceptionnels en faveur de certains investissements (équipement informatique, matériels écologiques) qui s’apparentent à des mesures fiscales d’aide à l’investissement.
Par exemple, les entreprises qui acquièrent un logiciel informatique peuvent procéder à l’amortissement intégral de celui-ci sur douze mois, réparti prorata temporis sur l’exercice d’acquisition et l’exercice suivant.
Les amortissements accélérés, qu’ils soient dégressifs ou exceptionnels, procurent à l’entreprise un avantage de trésorerie, et génèrent en contrepoint un coût de trésorerie pour l’État. En effet, il s’agit d’anticiper la déduction d’une charge qui aurait été déduite ultérieurement.
• Des investissements en robotique encore insuffisants
Les investissements des entreprises françaises sont insuffisamment tournés vers l’amélioration de leurs processus de production et les technologies d’avenir.
D’après l’évaluation préalable de l’article, la France a pris un retard certain en matière de robotisation, avec seulement 32 300 robots industriels en fonctionnement en 2013, qui ont une moyenne d’âge élevée, contre 59 000 en Italie et 167 600 en Allemagne. Même en calculant le nombre de robots par tranche de 10 000 personnes employées dans l’industrie (pour corriger les effets de taille), la France est loin du peloton de tête des pays industrialisés, avec seulement 125 robots industriels pour 10 000 salariés de l’industrie, là où l’Espagne en compte 141, Taïwan 142, les États-Unis 152, le Danemark 166, la Belgique 169, l’Italie 170, la Suède 174, l’Allemagne 282, le Japon 323 et la Corée du Sud 437.
En 2013, le nombre de robots industriels achetés en France a même chuté de 27 % (2 160 robots) alors que ce nombre a progressé en Italie de 7 % (4 700 robots), en Espagne de 37 % (2 800 robots) et en Allemagne de 4 % (18 300 robots).
La robotique industrielle a pourtant considérablement évolué depuis dix ans. Les robots dits « cartésiens » – quatre axes de déplacement et six axes couplés aux différents systèmes de préhension (pince, aspiration, ventouse…), de pesage et de vision – n’ont quasiment pas de limites. Ils peuvent travailler dans des espaces extrêmement restreints et manipuler tous types de produits (froids ou chauds, petits ou gros, durs ou mous) pour les mettre en boîte, les ranger, les trier, les décorer ou encore les étiqueter.
Dans son évaluation préalable, le Gouvernement estime que, dans l’ensemble de l’industrie, la robotisation permettra de gagner en compétitivité, en qualité des produits et de diminuer la pénibilité du travail de certains opérateurs. Les entreprises qui investissent en robotique industrielle sont plus compétitives, accroissent leur chiffre d’affaires et réalisent des embauches pour accompagner leur croissance. Ainsi, dans le domaine de la mécanique, il existe de nombreux exemples, grâce à des investissements en robotique, de relocalisation en France de la production à bas coûts, initialement délocalisée en Tunisie ou au Maroc par exemple.
Le plan « Robotique » fait partie des trente-quatre plans pour la Nouvelle France Industrielle. La France s’est fixée pour objectif de compter parmi les cinq nations chefs de file de la robotique dans le monde d’ici à l’horizon 2020 particulièrement en matière de robotique de service à usage personnel et professionnel, de développer une offre française mondiale en matière de robotique et de machines intelligentes et d’accroître ses parts dans un marché en forte croissance dans les années à venir.
• Le dispositif introduit à l’article 39 AH du CGI
L’article 20 de la loi de finances pour 2014 (70) a créé une nouvelle mesure dérogatoire à l’article 39 AH du CGI permettant l’amortissement accéléré sur vingt-quatre mois du matériel de robotique industrielle pour les robots industriels acquis ou créés par les PME (moins de cinquante salariés) entre le 1er octobre 2013 et le 31 décembre 2015.
Cette date limite était notamment justifiée par un souci de bonne gestion des finances publiques. L’article 16 de la loi de programmation des finances publiques pour les années 2012 à 2017 (71) prévoyait en effet que toute dépense fiscale nouvellement créée ou étendue devait avoir une durée de vie limitée.
L’aide est soumise au plafond du régime européen de minimis relatif aux aides d’État : elle ne peut excéder 200 000 euros sur trois exercices.
Lors de la présentation du projet de loi de finances pour 2014, le coût de la mesure était estimé à 4 millions d’euros en 2014, 12 en 2015 et 22 en 2016. D’après l’Évaluation des voies et moyens annexée au projet de loi de finances pour 2015, le coût de la mesure s’est élevé à 4 millions d’euros en 2014 et était estimé à 16 millions pour 2015.
• Les autres mesures prises par le Gouvernement en faveur des investissements en robotique
D’autres mesures ont été prises par le Gouvernement pour soutenir les investissements dans le domaine de la robotique industrielle.
Dans le cadre des programmes d’investissements d’avenir, la Banque publique d’investissement Bpifrance propose des prêts de développement « robotique » à taux bonifié de plus de trois ans à destination des PME et des entreprises de taille intermédiaire (ETI), pour des montants compris entre 100 000 et 5 millions d’euros. En 2014, 300 millions d’euros ont été consacrés à ces prêts qui doivent être accompagnés d’un crédit d’égal montant consenti par une banque commerciale. D’une durée de sept ans, ces prêts sont consentis sans prendre de garantie sur l’entreprise, avec un différé d’amortissement en capital de deux ans.
Les entreprises s’équipant en robotique pourront également bénéficier du dispositif exceptionnel de suramortissement de 40 % prévu par l’article 142 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015sur la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques. Pour un investissement de 100 euros, l’entreprise pourra déduire (sur la période d’amortissement) 140 euros de son résultat fiscal contre 100 euros actuellement. Au lieu de lui procurer un gain net d’impôt sur les sociétés (IS) de 33,33 euros (un tiers de 100 euros), une entreprise soumise au taux de droit commun de l’IS bénéficiera d’un gain net d’IS de 46,66 euros (un tiers de 140 euros). En d’autres termes, la mesure de suramortissement assurera à cette entreprise une réduction fiscale de plus de 13 % de la valeur de l’investissement – soit un tiers de 40 %.
Un an après l’adoption de la mesure, le Gouvernement constate que des besoins importants de robotisation persistent, en particulier sur des postes spécifiques (conditionnement, lignes de production).
La filière automobile fait de la robotisation l’une des voies de la consolidation de la sous-traitance du secteur et le moyen de garantir aux grands clients la compétitivité de leurs fournisseurs grâce à une meilleure efficacité opérationnelle. Mais l’insuffisance de l’investissement en robotique est encore plus patente dans les autres secteurs industriels : travail des métaux-mécaniques, ferroviaire, naval, chimie-pneus-plastiques, agroalimentaire, électrique-électronique.
Le Gouvernement considère que l’incitation fiscale devrait améliorer la compétitivité des industries de tous les secteurs mais aussi favoriser le développement d’une filière performante de robotique industrielle. Si la France manque d’acteurs dominants de dimension mondiale, elle dispose d’entreprises d’ETI et de PME performantes en matière de robotique industrielle et peut compter sur des intégrateurs et équipementiers de haut niveau, sur des entreprises de pointe positionnées sur des marchés très spécialisés. En outre il est rappelé que l’achat d’un robot entraîne une dépense complémentaire égale à trois fois le prix du robot auprès des ingénieristes et intégrateurs qui sont pour la plupart français. La France est enfin forte de pôles de compétitivité travaillant dans le domaine de la robotique.
Le 1° du présent article remplace la date limite du 31 décembre 2015 par celle du 31 décembre 2016.
Le 2° actualise les références des textes européens relatifs aux aides d’État qui régissent la mesure.
Le Gouvernement ne produit pas, à l’appui de cette prorogation, d’évaluation de l’impact de la mesure sur le comportement d’investissement des entreprises. Il est néanmoins précisé dans l’évaluation préalable que la direction générale des entreprises assurera un suivi pour actualiser les données sur les investissements en robotique industrielle.
Le coût moyen d’un robot industriel est estimé à 120 000 euros. La durée normale de vie est d’environ dix ans. En 2013, les entreprises françaises (grandes entreprises, ETI, PME) ont acheté 2 160 robots (au lieu de 2 950 en 2012). Les robots sont majoritairement détenus par les grands groupes et les ETI.
Le calcul repose sur l’hypothèse selon laquelle 10 % des robots achetés en France le sont par les PME françaises. Ce chiffre est considéré comme un majorant, étant donné qu’en Allemagne, pays très avancé dans le domaine, les PME détiennent environ 1 % du parc des robots.
Dans cette hypothèse, les PME françaises achèteraient 220 robots (10 % de 2 160) et l’acquisition interviendrait au 30 juin de l’année (demi-année). Ainsi, 220 robots seraient donc achetés au 30 juin 2016.
Par ailleurs, les robots industriels bénéficient d’un amortissement dégressif sur une durée de vie normale de dix ans, soit 10 % × 2,25 = 22,5 % calculé chaque année sur leur valeur nette comptable restante.
En supposant que les entreprises clôturent au 31 décembre, les 220 robots acquis à la mi-2016 bénéficieront au titre de l’exercice 2016 de six mois d’amortissement exceptionnel (sur une durée d’amortissement de deux ans, soit un taux annuel de 50 %) au lieu de l’amortissement dégressif.
Le complément d’amortissement ainsi généré par la mesure est estimé à :
– au titre de l’exercice 2016 à : (220 × 120 000 euros × 50 % × 6/12) – (220 × 120 000 euros × 22,5 % × 6/12) = 3,63 millions d’euros ;
– au titre de l’exercice 2017 à : (220 × 120 000 euros × 50 %) – [220 × (120 000 euros – 13 500 euros) × 22,5 %] =7,93 millions d’euros ;
– au titre de l’exercice 2018 à : (220 × 120 000 euros × 50 % × 6/12) –[220 × (120 000 euros – 13 500 euros – 23 963 euros) × 22,5 % × 6/12] = 2,51 millions d’euros.
La chronique des différentiels d’amortissements est la suivante jusqu’en 2025.
DIFFÉRENTIELS D’AMORTISSEMENTS PAR EXERCICE
(en millions d’euros)
Année |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Acquisitions 2016 |
3,63 |
7,93 |
2,51 |
– 3,2 |
– 2,5 |
– 1,9 |
– 1,6 |
– 1,6 |
– 1,6 |
– 1,6 |
)
Source : évaluation préalable.
Le dispositif ne s’appliquant qu’aux PME au sens communautaire, un taux moyen d’imposition à l’impôt sur les sociétés de 20 % est retenu.
En considérant que les entreprises anticipent l’impact de l’amortissement exceptionnel sur leurs acomptes, le coût budgétaire de la mesure est estimé comme suit.
IMPACT FINANCIER DE LA MESURE PAR RAPPORT AU DROIT EXISTANT
(en millions d’euros)
2016 |
2017 |
2018 | |
Impact sur les finances publiques |
-0,7 |
-1,6 |
-0,5 |
Source : évaluation préalable.
S’agissant d’un amortissement accéléré, la mesure ne fait qu’anticiper la déduction d’une charge : il s’agit d’une mesure de trésorerie, neutre budgétairement sur le long terme.
La Rapporteure générale souscrit aux ambitions du Gouvernement pour le développement de la robotisation. On peut néanmoins s’interroger sur l’impact qu’aura la prorogation de cette mesure d’amortissement exceptionnel d’une année, compte tenu du temps nécessaire pour élaborer un projet de robotisation dans une petite entreprise – environ dix-huit mois, d’après les organisations professionnelles.
*
* *
La commission examine l’amendement I-CF 109 de M. Charles de Courson.
M. Charles de Courson. Les entreprises françaises, en particulier les PME, ont un très gros retard par rapport à leurs homologues allemandes en matière de robotique. Le Gouvernement nous propose de prolonger d’un an le dispositif d’amortissement accéléré du matériel robotique, applicable du 1er octobre 2012 au 31 décembre 2015. Plutôt que des dispositions ponctuelles, nous devons prendre des mesures stables et permanentes. Mon amendement vise donc à rendre pérenne ce dispositif spécifique d’amortissement : ce n’est pas en un ou deux ans que la France et ses PME vont rattraper leur retard ; il faudra dix ou quinze ans. Il me semble d’ailleurs, madame la Rapporteure générale, que le coût de cette mesure n’est pas considérable.
Mme la Rapporteure générale. Une prorogation de deux ans est demandée par les professionnels. Vous qui êtes toujours généreux, monsieur de Courson, préférez une pérennisation. À ce stade, je vais émettre un avis défavorable à votre amendement, car je ne connais pas le coût de la mesure. Je m’en tiens à ma position de ce matin : je trouve dangereux d’adopter des mesures dont on ne connaît pas le coût.
M. Charles de Courson. On peut reprendre les déclarations du Gouvernement à l’époque où le dispositif avait été adopté, mais seule l’administration fiscale peut fournir le chiffre. Qu’en est-il des études d’impact ? On me dit qu’elles viennent d’arriver et sont en distribution, mais je ne les ai toujours pas vues. Mettons 2017 au lieu de 2016, si Mme la Rapporteure générale y tient, mais je pense que l’on gagnerait à avoir une stratégie fiscale stable pendant plusieurs années.
Mme la Rapporteure générale. Vous pouvez retirer votre amendement et le redéposer en séance : entre-temps, je vous aurai communiqué le coût de la mesure.
M. Charles de Courson. Voulez-vous que je le redépose en l’état, madame la Rapporteure générale, ou en mettant 2017 ?
Mme la Rapporteure générale. En mettant 2017.
M. Charles de Courson. Ce sera fait.
Cependant, dans l’étude d’impact, que l’on vient de m’apporter, j’ai la réponse à votre question : la mesure coûterait 1 à 2 millions d’euros, ce qui est très peu.
L’amendement I-CF 109 est retiré.
La commission est saisie des amendements identiques I-CF 222 de M. Charles de Courson et I-CF 298 de M. Éric Alauzet.
M. Charles de Courson. L’amendement I-CF 222 a pour objet d’encourager le développement du gaz naturel (GNV) et du biométhane carburant (bioGNV) dans les PME françaises. Les véhicules fonctionnant avec ces carburants, dont l’usage se développe, représentent de 10 % à 15 % de la flotte des PME.
M. Éric Alauzet. Il s’agit, avec l’amendement I-CF 298, d’étendre le dispositif de suramortissement prévu pour les investissements industriels, les machines-outils en particulier, à l’acquisition de moyens de transport au gaz GNV ou au biométhane.
Mme la Rapporteure générale. Comme vous, monsieur le président, je n’ignore pas qu’il y a beaucoup de demandes d’intégration dans ce dispositif de suramortissement, concernant essentiellement les transports. Je ne connais pas le coût – qui pourrait être assez important – de cette mesure. J’émets donc un avis défavorable.
M. Éric Alauzet. Ces amendements ne portent pas sur n’importe quel type de transports, mais ciblent ceux qui participent à la transition énergétique. C’est évident pour les véhicules qui fonctionnent au biométhane, et même pour ceux qui utilisent le GNV, une énergie transitoire entre le pétrole et les énergies renouvelables. Dans la dépense publique, nous devons être plus sélectifs par rapport à la transition énergétique. Or, nous ne tenons pas suffisamment compte du coût global et des externalités.
La commission rejette les amendements I-CF 222 et I-CF 298.
Puis elle adopte l’article 6 sans modification.
*
* *
Article additionnel après l’article 6
Abaissement du seuil de déductibilité des rémunérations différées
La commission est saisie de l’amendement I-CF 71 de M. Laurent Grandguillaume.
M. Pascal Terrasse. Cet amendement revient sur la question des « parachutes dorés ». Lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2009, nous avions adopté à l’unanimité un amendement prévoyant le plafonnement de la déductibilité du bénéfice imposable de ce type d’indemnités de départ. Il faisait suite à un rapport que vous aviez remis, monsieur le président.
Au vu de l’actualité récente, les dispositions que nous avions prises à l’époque paraissent insuffisantes. La déductibilité maximale est aujourd’hui fixée à six fois le plafond annuel de la sécurité sociale, soit 228 240 euros au 1er janvier 2015. Par le présent amendement, nous proposons de diviser cet avantage fiscal par deux.
Comment justifier l’usage des « parachutes dorés » ? Beaucoup de chefs d’entreprise possèdent des parts sociales, acquises tout au long de leur carrière professionnelle par le biais de stock-options qui font partie de leur rémunération. Cela me paraît suffisant. Je pense que cette accumulation – salaire, stock-options, « parachute doré », retraite chapeau – pose un problème moral.
Mme la Rapporteure générale. Ce matin, nous avons examiné un amendement I-CF 74, similaire à celui-ci, au titre de l’impôt sur le revenu. La commission était largement acquise à la réduction du plafond, mais se posait un problème d’écriture : la cible visée n’était pas celle que nous souhaitions. J’ai proposé qu’il soit retiré et retravaillé avant d’être représenté en séance. Je vous fais la même proposition.
M. le président Gilles Carrez. Et ces amendements doivent être présentés en seconde partie pour éviter la rétroactivité.
M. Razzy Hammadi. Avec mon collègue Laurent Grandguillaume et comme d’autres ici, nous travaillons sur le sujet depuis des mois. Nous avons étudié les rythmes d’acquisition des droits, nous avons plafonné, conditionné et introduit un droit de regard des syndicats et des représentants des salariés. Mais le dispositif est d’une complexité folle. Chaque fois que nous parvenons à faire adopter une mesure, nous nous rendons compte qu’il reste un trou dans la raquette. Je comprends qu’on nous demande de retirer et de retravailler cet amendement, mais, jusqu’à la fin de la législature, nous aurons des amendements sur les golden hello et les retraites chapeau, car nous tenons à remettre en cause des pratiques qui ne sont pas moralement acceptables.
Mme Karine Berger. Je ne suis pas le raisonnement de la Rapporteure générale. À part le thème, quel est le rapport entre l’amendement de ce matin et celui de cet après-midi ?
M. le président Gilles Carrez. Ce matin, il était question de seuil d’imposition ; cet après-midi, nous parlons de déductibilité.
Mme Karine Berger. Je ne vois pas quel est le problème de rédaction. Contrairement à l’amendement dont nous avons discuté ce matin, celui-ci vise parfaitement la cible. Si cet amendement que j’ai cosigné était retiré, je le reprendrais immédiatement.
M. Dominique Lefebvre. Nous pourrions reprendre tout cela en seconde partie. Ce dont j’aimerais être absolument certain, c’est qu’il y a adéquation entre la mesure prévue, qui peut se justifier, et ce qui, dans l’exposé des motifs, fait référence à des exemples récents. Pour les Français, les exemples les plus scandaleux sont à des niveaux tels que la modification proposée du plafond de la sécurité sociale ne changera pas grand-chose. Que l’on cible ceux dont les indemnités de départ sont comprises entre trois et six fois le plafond de la sécurité sociale, je peux le comprendre. Ceux qui se situent à des niveaux interstellaires, qui perçoivent des primes de 8 ou 14 millions d’euros, sont hors sujet. Que ce soit déductible ou pas, cela ne change strictement rien. L’amendement concerne des personnes dont les indemnités de départ se situent à 200 000 ou 300 000 euros. Mais on permet à une grande entreprise internationale de faire un chèque de 8 ou 14 millions d’euros à un dirigeant qui s’en va. À mon avis, certains vont se sentir incompris, à juste titre.
Mme la Rapporteure générale. Il est ici question d’un avantage fiscal : ce sera payé par le contribuable français.
M. Olivier Carré. Notre collègue Hammadi a jugé certaines pratiques moralement inacceptables tout en constatant qu’il y avait toujours des trous dans nos dispositifs fiscaux. Si vous voulez faire de la morale, il faut passer par d’autres moyens – le code du travail ou un autre – et décider une interdiction stricte de telle ou telle pratique. Quand il veut faire de la morale par le biais de la fiscalité, le législateur déclenche des phénomènes d’optimisation qu’il passe son temps à essayer de corriger, au risque de perturber le fonctionnement global de l’économie et d’affaiblir notre tissu productif national. Si la majorité considère que cette moralisation est un sujet politique fort, ce que je peux comprendre, qu’elle active d’autres textes de loi que ceux qui portent sur la fiscalité !
M. Razzy Hammadi. Je pense au contraire qu’il est possible de faire à la fois de la fiscalité et de la morale, et même de faire de la fiscalité morale. En travaillant sur le sujet, nous nous sommes rendu compte que des centaines de milliers de Français étaient concernés, mais nous ne nous sommes pas attaqués spécifiquement aux « parachutes » les plus scandaleux : nous avons, dans un premier temps, mis en place des dispositifs épargnant ceux qui partent avec un chèque de 10 000, 15 000 ou 20 000 euros de manière légitime dès lors que ces personnes ont passé beaucoup de temps dans l’entreprise, ont cotisé, et peuvent faire état de performances et de résultats. Il faut à présent faire évoluer l’assiette.
M. le président Gilles Carrez. Le Premier ministre a pris l’engagement que la loi ne pratiquerait plus de « petite rétroactivité » et il a raison, car il est malsain de prendre des mesures fiscales rétroactives. Comme nous l’avons prévu ce matin au sujet de l’impôt sur le revenu, nous pourrons avoir le présent débat en seconde partie, car les mesures s’appliqueront alors aux revenus distribués ou aux dépenses engagées à partir du 1er janvier 2016. Sur le fond, notre commission est d’accord pour réduire ce plafond, même si l’amendement n’est pas – Dominique Lefebvre a raison de le souligner – de nature à apporter une réponse aux dizaines de millions d’euros qui ont récemment défrayé la chronique.
M. Razzy Hammadi. Ne peut-on rectifier l’amendement ?
Mme la Rapporteure générale. Si l’amendement est rectifié, avec les bonnes dates, il sera de facto reclassé en seconde partie.
Mme Karine Berger. Je propose de rectifier l’amendement en prévoyant une application au 1er novembre 2015 : il n’y a plus de « petite rétroactivité » dans ce cas.
La commission adopte l’amendement I-CF 71 ainsi rectifié.
*
* *
La commission examine les amendements I-CF 183 et I-CF 184 de M. Philippe Vigier, qui peuvent faire l’objet d’une présentation commune.
M. Charles de Courson. Le dispositif de jeune entreprise innovante (JEI) étant actuellement plafonné à 50 millions d’euros, l’amendement I-CF 183 prévoit de remonter ce plafond, ce qui s’avérerait d’ailleurs peu coûteux. L’amendement I-CF 184 vise quant à lui à allonger la période d’exonération d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés, de deux à trois ans, car la plupart de ces entreprises ne commencent à gagner de l’argent que la troisième année. Cela ne coûtera pas beaucoup non plus.
Mme la Rapporteure générale. Le seuil de 50 millions d’euros a le mérite d’être conforme au seuil de définition des PME au sens communautaire. Alors que vous nous avez tout à l’heure invités à fusionner les seuils, vous en proposez là de nouveaux. Ce n’est pas très cohérent. En ce qui concerne la prolongation de la période d’exonération, vous n’apportez aucun chiffrage. Avis défavorable.
L’amendement I-CF 183 est retiré.
La commission rejette l’amendement I-CF 184.
Elle examine ensuite l’amendement I-CF 212 de M. Charles de Courson.
M. Charles de Courson. L’agriculture subissant des variations de revenus de plus en plus fortes, cet amendement vise à permettre une variabilité des dotations aux amortissements en fonction de la variabilité des résultats. En d’autres termes, dans une bonne année, l’agriculteur amortira beaucoup, dans une mauvaise année il amortira peu. Le solde est nul sur la moyenne période, mais cela donnera davantage de souplesse aux exploitations, dans la limite d’une modulation fixée à 50 % du montant déductible.
Mme la Rapporteure générale. La série d’amendements sur la fiscalité agricole qui débute avec celui-ci fait suite à une mission d’information conduite au mois de juillet. Cet amendement, monsieur de Courson, reprend une proposition que vous aviez émise dans le cadre de cette mission, mais qui n’a pas été retenue. Avis défavorable.
J’en profite pour signaler que j’ai demandé au ministère des finances, le 17 juillet dernier, l’ensemble des montants d’exonération existant dans l’agriculture, selon une distribution par décile, afin de savoir si ces mesures fiscales sont concentrées sur certains types d’exploitation ou non. J’espère que je recevrai ces données un jour.
M. François André. En tant que rapporteur de la mission d’information sur la fiscalité agricole, je n’ai pas retenu cette proposition, lui préférant un dispositif de déduction pour aléa. C’est le choix de la mission d’information pour traiter le problème de la volatilité des résultats.
La commission rejette l’amendement I-CF 212.
Elle examine ensuite, en discussion commune, les amendements I-CF 33 et I-CF 36 de M. Marc Le Fur.
M. Marc Le Fur. La mission d’information sur la fiscalité agricole est parvenue à des propositions consensuelles, que ces amendements reprennent en ce qui concerne la déduction pour aléas (DPA). La DPA est une auto-assurance : au cours d’une bonne année, l’agriculteur est autorisé à mettre de l’argent de côté, de façon qu’il puisse le réintroduire dans ses comptes lors des mauvaises années. La dernière crise agricole a révélé que l’aléa – la variation du climat, mais aussi des prix – était de plus en plus important ; c’est même devenu l’obsession du monde agricole. L’idée est donc de renforcer la DPA. Dans l’immédiat, cela ne coûtera rien, car il s’agit de retirer de l’argent des comptes dans les bonnes années, et nous traversons justement une très mauvaise année, mais cela enverrait au monde agricole le signal très positif qu’il pourra à l’avenir recourir à des mécanismes d’atténuation des aléas.
Ces amendements visent donc à rendre le recours à la DPA plus facile et plus souple, afin que l’atténuation de l’aléa passe principalement par ce dispositif fiscal, qui est moins cher qu’une assurance, car il n’y a pas d’intermédiaire, et plus avantageux que la déduction pour investissement (DPI).
M. le président Gilles Carrez. Certains amendements relatifs à la DPA ont été reportés en seconde partie, car ils traitaient de la réintégration, qui se fait au cours des exercices suivants, tandis que ceux qui traitent de la déduction elle-même affectent l’exercice 2016 et ont donc été conservés en première partie.
M. François André. Nous aurons donc un débat saucissonné et, en termes de lisibilité, c’est bien dommage. Le sujet – la crise l’a révélé – mériterait de faire l’objet d’une mesure dans le prochain projet de loi de finances rectificative (LFR).
M. Charles de Courson. La DPA ne fonctionne pas. Elle a même été construite pour ne pas fonctionner, en raison notamment de conditions d’entrée et de sortie extrêmement restrictives. Dans la mission d’information, nous sommes tombés d’accord pour assouplir l’entrée et la sortie, mais nous différons en ce qui concerne l’ampleur de cet assouplissement. J’étais le plus libéral, et le rapporteur le plus restrictif. Je trouve moi aussi très dommage que la discussion soit tronçonnée, car nos collègues n’y pourront rien comprendre. Je pense toutefois qu’il faut voter ces amendements, car cela permettra au Gouvernement de nous indiquer où en sont les arbitrages.
M. Marc Le Fur. Il serait en effet préférable de discuter tous les amendements ensemble, mais cela peut se faire en seconde partie. Cela ne me dérange donc pas de les retirer à ce stade.
M. François André. Je souscris à cette proposition. Ce serait plus lisible.
M. le président Gilles Carrez. Nous pouvons discuter l’ensemble en seconde partie, début novembre – et il vaut mieux en effet avoir une discussion globale, car le sujet est très compliqué –, si vous rédigez les amendements de façon qu’ils s’appliquent au 1er janvier 2017. Depuis 2002, des amendements tendant à modifier le régime de la DPA sont présentés dans chaque loi de finances, et j’ai du mal à comprendre pourquoi ce régime subit une telle instabilité fiscale.
M. Marc Le Fur. C’est un régime qui n’a jamais fonctionné et qui ne coûte presque rien, car, comme l’a expliqué Charles de Courson, les conditions ont été définies de façon à décourager les agriculteurs d’y recourir. La crise agricole est due à des aléas d’une ampleur qui était inconnue du temps où il existait une gestion européenne des marchés. Le régime a été modifié à plusieurs reprises, car il n’a jamais fonctionné.
M. le président Gilles Carrez. C’est dommage, car il avait fallu une suspension de séance et une réunion de deux heures en salle Colbert, en pleine nuit, pour le créer.
Les amendements I-CF 33 et I-CF 36 sont retirés.
Les amendements I-CF 40 à I-CF 42 de M. Marc Le Fur sont également retirés.
*
* *
Article additionnel après l’article 6
Relèvement du seuil de prise en compte des recettes accessoires dans la détermination du bénéfice agricole
La commission examine les amendements identiques I-CF 147 de M. Hervé Pellois et I-CF 390 de la commission des affaires économiques.
M. Michel Vergnier. Il s’agit de régler un problème de seuil pour les exploitants agricoles qui exercent plusieurs activités. L’agritourisme doit rester une activité complémentaire, mais nous proposons que le seuil de recettes passe de 50 000 à 80 000 euros afin de permettre aux exploitants qui le souhaitent et dont l’activité marche bien de bénéficier de revenus plus importants.
M. le rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques. L’amendement identique I-CF 390 a été voté par la commission des affaires économiques.
Suivant l’avis favorable de la Rapporteure générale, la commission adopte les amendements I-CF 147 et I-CF 390.
L’amendement I-CF 30 de M. Marc Le Fur n’a plus d’objet.
*
* *
Article additionnel après l’article 6
Fixation à quatre de la limite de nombre d’associés dans un GAEC pris en compte en matière de plafond de recettes accessoires
La commission examine les amendements identiques I-CF 192 de M. François André et I-CF 397 de la commission des affaires économiques.
M. François André. Nous abordons une série d’amendements sur les groupements agricoles d’exploitation en commun (GAEC). L’amendement I-CF192 prévoit que le principe de transparence, en matière de recettes accessoires, sera apprécié à l’échelle du GAEC, jusqu’à quatre associés, et non plus, comme c’est le cas depuis une jurisprudence du Conseil d’État de 2009, au niveau à la fois du GAEC et de chaque exploitant. Cette jurisprudence est peu précise, et nous souhaitons donc inscrire le principe de transparence dans la loi, en précisant qu’il s’applique à l’échelle du groupement.
Mme la Rapporteure générale. Avis favorable à ces amendements identiques.
M. Charles de Courson. Nous bricolons ! Le nombre maximal d’associés avait été fixé à deux, puis il est passé à trois, et l’on propose aujourd’hui un petit pas pour le porter à quatre. Ne serait-il pas plus simple de ne pas prévoir de plafond du tout ? Il y a d’ailleurs très peu de GAEC dépassant quatre associés. Raison de plus pour se passer de plafond.
La commission adopte les amendements I-CF 192 et I-CF 397.
*
* *
Article additionnel après l’article 6
Assouplissement du mécanisme d’étalement dans le temps des revenus exceptionnels
La commission examine les amendements identiques I-CF 189 de M. François André et I-CF 392 de la commission des affaires économiques.
M. François André. L’amendement I-CF 189 vise à assouplir le mécanisme d’étalement des revenus exceptionnels en permettant une intégration par fractions inégales. Aujourd’hui, quand un exploitant agricole dégage un résultat exceptionnel, il existe un mécanisme de lissage de l’intégration de ce revenu sur plusieurs exercices, pour un maximum de sept ans et par fractions égales. Nous souhaitons permettre que cette intégration se fasse, à l’intérieur des sept ans, selon le libre choix de l’exploitant.
Mme la Rapporteure générale. Cette proposition a été avancée par la mission d’information et j’y suis à ce titre favorable. Cela ne coûtera d’ailleurs pas grand-chose, le coût total de la DPA n’excédant pas 16 millions d’euros.
M. Charles de Courson. J’y suis tout à fait favorable, car c’est conforme au principe de liberté que j’ai défendu au sein de la mission, mais le Gouvernement cherchera comme d’habitude à enserrer le dispositif dans un tunnel.
M. Jean-Claude Buisine. C’est une méthode utilisée dans le cadre de l’impôt sur le revenu, mais cela peut être contraire à la progressivité de l’impôt. Je suppose qu’il s’agit d’un étalement sur les années à venir et non sur les années passées. Or, on pourrait opposer à un tel système celui de la variabilité de l’impôt en fonction des bénéfices.
Mme la Rapporteure générale. Je suis d’accord avec vous. L’INSEE a publié, il y a quelques années, une étude montrant que, pour un revenu de cinq fois le SMIC, un agriculteur payait moins d’impôt sur le revenu qu’un salarié. Quel objectif entendons-nous assigner à la fiscalité agricole ? Un objectif de progressivité et un objectif d’atténuation des aléas peuvent aboutir à des contradictions qui ne sont pas résolues par des amendements de ce type. Il faudrait sans doute remettre les choses sur la table de manière plus globale, mais laisser un peu de liberté aux agriculteurs, à l’intérieur des sept ans, me paraît une bonne chose.
La commission adopte les amendements I-CF 189 et I-CF 392.
*
* *
La commission examine l’amendement I-CF 349 de M. François Pupponi.
Mme la Rapporteure générale. Les écrivains, artistes et sportifs peuvent choisir d’étaler l’imposition de leurs bénéfices sur trois ou cinq ans. L’amendement, qui prévoit de déduire des revenus générés avant le choix d’une option, me semble un peu compliqué. Avis défavorable.
La commission rejette l’amendement I-CF 349.
Elle examine ensuite l’amendement I-CF 215 de M. Charles de Courson.
M. Charles de Courson. La déduction fiscale intégrale des salaires des conjoints des adhérents des organismes de gestion agréés a été supprimée l’an dernier. Cet amendement vise à le rétablir, car je n’ai jamais compris la raison de cette discrimination selon que les gens sont mariés ou non.
M. le président Gilles Carrez. C’était un amendement que j’avais présenté dans la droite ligne d’un rapport de la Cour des comptes.
M. Charles de Courson. La Cour des comptes a commis là, me semble-t-il, une erreur. Que l’on prévoie un plafond pour éviter les faux salariés conjoints dans l’entreprise, d’accord, mais l’élimination du principe même n’est pas compréhensible.
Mme la Rapporteure générale. Le principe de la déduction n’est pas éliminé, on rentre dans le droit commun qui plafonne la déduction à 13 800 euros par an. La déduction ne disparaît pas, elle est maintenue à un niveau moindre.
M. le président Gilles Carrez. Le raisonnement a été que l’avantage principal conféré aux adhérents des centres de gestion agréés – la non-majoration de 20 % de leurs revenus – était suffisant. Pour le reste, il a été décidé de revenir au droit commun et de supprimer ces microniches fiscales.
M. Charles de Courson. Mais pourquoi plafonne-t-on la déductibilité du salaire du conjoint à 13 800 euros, soit à peine plus de 1 000 euros par mois ? Ça ne représente même pas le SMIC : le SMIC brut est à 1 500 euros, 1 700 euros avec les charges.
Au nom de quoi plafonne-t-on ? Imaginons le cas d’un indépendant qui travaille avec sa femme, salariée dans sa petite entreprise, et à qui l’on annonce qu’il n’a pas le droit de la rémunérer plus de 13 800 euros par an. Ça mérite un divorce !
Mme la Rapporteure générale. Vous pouvez rémunérer votre conjoint plus de 13 800 euros par an : c’est la déductibilité qui est limitée à ce plafond. Le droit commun s’applique alors que, auparavant, quatre avantages se cumulaient.
La commission rejette l’amendement I-CF 215.
Puis elle examine l’amendement I-CF 216 de M. Charles de Courson.
M. Charles de Courson. Cet amendement vise à instaurer une réduction d’impôt pour frais de comptabilité et d’adhésion à un organisme de gestion agréé, qui a été supprimée dans le système actuel.
Mon amendement prévoit une réduction très modeste, plafonnée à 500 euros par an. Le coût en est estimé à 30 millions d’euros. Il est de l’intérêt de l’État d’améliorer sa connaissance des revenus des TPE.
Mme la Rapporteure générale. Avec l’amendement adopté l’an dernier, il est toujours possible de déduire les frais de comptabilité. De mémoire, cela porte sur un peu plus de 900 euros. Vous revenez donc sur une réduction d’impôt alors qu’il est possible, avec ce qui a été adopté l’an dernier, de déduire les frais de comptabilité.
M. le président Gilles Carrez. L’an dernier, nous avons réussi à supprimer trois microniches fiscales, en considérant que l’avantage fiscal d’une non-majoration de 20 % du revenu, dès lors que l’on est membre d’un centre de gestion agréé, se suffisait à lui-même.
Pour le plafonnement de la déductibilité du salaire du conjoint, la déductibilité des frais de comptabilité et le reste, nous avons décidé de revenir au droit commun.
La commission rejette l’amendement I-CF 216.
*
* *
Article additionnel après l’article 6
Application du plafond de crédit d’impôt pour congé à chaque associé d’un GAEC, dans la limite de quatre
Puis elle examine, en discussion commune, les amendements I-CF 90 de Mme Christine Pires Beaune, et les amendements identiques I-CF 190 de M. François André et I-CF 393 de la commission des affaires économiques.
Mme Christine Pires Beaune. Il existe aujourd’hui un crédit d’impôt pour permettre aux agriculteurs de faire appel à des services de remplacement, qui est limité à quatorze jours. Mais, dans les GAEC où deux ou trois personnes travaillent, ces quatorze jours sont divisés par le nombre d’associés. Cet amendement vous propose donc d’étendre ce crédit d’impôt en tenant compte du nombre d’associés.
M. François André. L’amendement que je présente est presque identique. Celui de Christine Pires Beaune limite le nombre d’associés à trois, c’est-à-dire qu’elle s’inscrit dans le cadre actuel de l’application du principe de transparence. Le mien, dans la logique des autres amendements GAEC que j’ai proposés, porte la mesure à quatre associés.
Mme la Rapporteure générale. En cohérence avec ce que nous avons voté tout à l’heure, je suis favorable aux amendements I-CF 190 et I-CF 393, et demande le retrait de l’amendement I-CF 90.
L’amendement I-CF 90 est retiré.
La commission adopte les amendements I-CF 190 et I-CF 393.
*
* *
Article additionnel après l’article 6
Extension à quatre associés de l’application à un GAEC du crédit d’impôt en faveur de l’agriculture biologique
La commission examine les amendements identiques I-CF 191 de M. François André et I-CF 395 de la commission des affaires économiques.
M. François André. Il s’agit toujours de l’application du principe de transparence aux GAEC. Il est ici proposé de l’étendre concernant le crédit d’impôt en faveur de l’agriculture biologique.
Suivant l’avis favorable de la Rapporteure générale, la commission adopte les amendements I-CF 191 et I-CF 395.
*
* *
La commission en vient à l’amendement I-CF 202 de M. Charles de Courson.
M. Charles de Courson. Le régime de l’assiette annuelle, par le décalage existant entre l’année d’assiette et l’année de couverture, entraîne une imputation fiscale à contresens très pénalisante en cas de variation de résultats.
Il s’agit du problème des cotisations. J’avais proposé, dans le cadre du groupe de travail, de rouvrir l’option de l’année n, qui a existé pendant sept ans et qui existe pour tous les autres régimes d’indépendants non agricoles. Il est plus facile d’expliquer aux gens qu’ils paieront beaucoup de cotisations lorsqu’ils ont beaucoup de revenus, et peu quand leur revenu est plus faible. Ce dispositif a existé jusqu’en 2001.
Mme la Rapporteure générale. Vous proposez un mécanisme d’à-valoir. Un exploitant agricole peut payer ses cotisations sociales pour l’année n+1 en année n en cas de bonne année, pourvu que cela soit fait dans les six mois avant la clôture de l’exercice : si la clôture est au 31 décembre, il faut le faire avant le 30 juin de l’année n. C’est un cas très rare en droit fiscal.
Concernant plus précisément cet amendement, la mission d’information de notre commission sur la fiscalité agricole ne l’a pas retenu. L’à-valoir reste une démarche volontaire, et la rédaction que vous proposez le rendrait automatique, ce qui n’est pas conforme à la philosophie du dispositif. L’à-valoir va d’ailleurs être assoupli, suivant une recommandation de la mission d’information, à l’article 13 du projet de loi de financement de la sécurité sociale, puisqu’il est prévu que son plafond passe de 50 % à 75 %.
Enfin, vous mentionnez dans cet amendement la date du 31 décembre, qui n’est pas inscrite dans la loi fiscale.
Avis défavorable.
La commission rejette l’amendement I-CF 202.
*
* *
Article 7
Exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties
et de contribution foncière des entreprises pour les activités pionnières
de méthanisation agricole
Le I du présent article prévoit un dégrèvement de plein droit, pour les impositions dues au titre de 2015, de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB), de cotisation foncière des entreprises (CFE) et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) afférentes aux installations et activités de méthanisation agricole antérieures au 1er janvier 2015.
Le II étend, à compter des impositions dues au titre de 2016, aux installations et activités de méthanisation agricole antérieures au 1er janvier 2015 le bénéfice des exonérations de plein droit de TFPB et de CFE accordées, pour une durée de sept ans, aux installations et activités de méthanisation agricole postérieures au 1er janvier 2015.
Le III supprime, en conséquence, l’exonération facultative, sur délibération des collectivités territoriales, de TFPB et de CFE dont peuvent bénéficier les installations et activités de méthanisation antérieures au 1er janvier 2015.
Avec l’adoption de cet article, le coût global des exonérations de plein droit de TFPB et de CFE dont bénéficieraient les unités de méthanisation peut être évalué pour les montants mentionnés dans le tableau qui suit.
ÉVALUATION DU COÛT GLOBAL DES EXONÉRATIONS DE PLEIN DROIT DE TFPB ET DE CFE POUR LES UNITÉS DE MÉTHANISATION
(en millions d’euros)
Méthanisation agricole |
2016 |
2017 |
2018 |
Coût pour l’État |
4 |
– |
– |
Coût pour les collectivités territoriales |
8,8 |
11,7 |
11,5 |
Total |
12,8 |
11,7 |
11,5 |
Source : commission des finances à partir des données des évaluations préalables annexées au projet de loi de finances pour 2015 et au projet de loi de finances pour 2016.
En l’état du droit, les méthaniseurs pionniers, c’est-à-dire ceux ayant débuté leur activité avant le 1er janvier 2015, ne bénéficient pas de l’exonération de plein droit des impôts fonciers locaux (TFPB et CFE) et de la CVAE dont bénéficient les autres méthaniseurs au titre de leurs sept premières années d’activité.
Sur délibération des collectivités territoriales prise avant le 31 décembre 2014, ils peuvent cependant bénéficier, en application du code général des impôts (CGI), d’une exonération temporaire de TFPB au titre de leurs cinq premières années d’activité.
L’état du droit est résumé dans le tableau qui suit.
EXONÉRATION EN FAVEUR DES INSTALLATIONS ET DES ACTIVITÉS DE MÉTHANISATION | ||
Impôt |
Méthaniseurs pionniers |
Autres méthaniseurs |
TFPB |
Article 1387 A du CGI |
Article 1387 A bis du CGI |
Exonération facultative de 5 ans à compter de l’année qui suit l’achèvement des installations |
Exonération de plein droit de 7 ans à compter de l’année qui suit l’achèvement des installations | |
CFE et CVAE |
Aucune exonération |
Article 1463 A du CGI |
7 ans à compter de l’année qui suit le début de l’activité | ||
Source : commission des finances. | ||
Aux termes des premiers alinéas des articles 1387 A, 1387 A bis et 1463 du CGI, l’énergie produite doit satisfaire aux critères posés par l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime pour bénéficier des exonérations. Autrement dit, la méthanisation doit être issue pour au moins 50 % des matières provenant des exploitations agricoles selon le critère posé par l’article 59 de loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l’agriculture et de la pêche. À défaut, l’activité ne peut pas être qualifiée de méthanisation agricole et relève de la fiscalité applicable aux activités industrielles.
Extraits de l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime
« Sont réputées agricoles (… la production et, le cas échéant, (…) la commercialisation, par un ou plusieurs exploitants agricoles, de biogaz, d’électricité et de chaleur par la méthanisation, lorsque cette production est issue pour au moins 50 % de matières provenant d’exploitations agricoles. Les revenus tirés de la commercialisation sont considérés comme des revenus agricoles, au prorata de la participation de l’exploitant agricole dans la structure exploitant et commercialisant l’énergie produite. »
Par ailleurs, les exonérations ne sont pas mises en œuvre automatiquement. Aux termes du quatrième alinéa de l’article 1387 A, du troisième alinéa de l’article 1387 A et du deuxième alinéa de l’article 1463 A du CGI, elles nécessitent une déclaration spécifique de l’exploitant avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable. En cas de déclaration tardive, l’exonération ne s’applique qu’à compter de l’année suivant celle de la déclaration, et uniquement pour la durée restant à courir.
Les exonérations d’impôts fonciers locaux en faveur des unités de méthanisation ont pour finalité d’inciter au verdissement de notre agriculture.
L’historique des différentes mesures permet d’expliquer la raison de la distinction des régimes d’exonération d’impôts fonciers locaux entre méthaniseurs pionniers et méthaniseurs ayant débuté leur activité à compter du 1er janvier 2015.
La doctrine fiscale a exclu les installations et bâtiments dédiés à la méthanisation agricole de l’exonération en faveur des bâtiments ruraux. Le raisonnement tenu par l’administration a consisté à écarter la qualification agricole des bénéfices générés par l’activité de méthanisation pour examiner uniquement si l’activité exercée entre dans les usages habituels et normaux de l’agriculture et conclure que, à défaut, l’activité de méthanisation doit être regardée comme présentant un caractère industriel. Aussi cette activité est-elle susceptible d’être qualifiée d’activité industrielle, même quand elle est réalisée par un exploitant agricole.
L’assimilation des installations et bâtiments dédiés à la méthanisation agricole à des établissements industriels a pour conséquence un changement de méthode pour calculer la valeur locative sur laquelle sont assises la TFPB et la CFE. La valeur locative des établissements industriels est, en effet, évaluée par application de la méthode prévue à l’article 1499 du CGI, appelée « méthode comptable ». Celle-ci aboutit à retenir un taux de 12 % appliqué à un prix de revient comptable, qui inclut :
– pour les terrains, les dépenses d’appropriation (déblaiement, aplanissement, consolidation, assainissement, etc.) et de viabilité ;
– pour les installations et les bâtiments, le coût de la construction ou de l’acquisition et de pose des canalisations faisant corps avec la construction.
Or, la méthanisation agricole suppose des investissements importants ; les montants de la TFPB et de la CFE à acquitter sont donc élevés et peuvent mettre en péril ces entreprises. Il pouvait paraître inopportun que l’activité de méthanisation à la ferme soit taxée comme la méthanisation industrielle, alors que sa rentabilité est bien moindre et qu’elle nécessite beaucoup plus d’aires de stockage, notamment parce que la méthanisation d’origine agricole ne peut pas fonctionner à flux tendus comme la méthanisation industrielle.
C’est dans ce contexte que l’article 51 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 a instauré, sur délibération des collectivités territoriales, une exonération facultative et temporaire de TFPB au titre des installations et bâtiments affectés à la méthanisation agricole pour une durée de cinq ans.
Cette exonération est codifiée à l’article 1387 A du CGI.
Là où l’exonération a été instituée en 2014 par les collectivités territoriales, elle s’applique aux installations et bâtiments de production achevés avant le 1er janvier 2015, à compter de cette date et pour la durée restant à courir de la période de cinq années suivant celle de l’achèvement des installations et bâtiments.
L’exonération est donc applicable au titre de la taxe foncière 2015 si l’organe délibérant de la collectivité concernée a pris une délibération en ce sens en 2014.
2. La transformation en exonération de plein droit pour une durée de sept ans et une extension de l’exonération à la CFE réservées aux nouveaux méthaniseurs
L’article 60 de la loi n° 2014 1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 a créé des exonérations temporaires de sept ans de TFPB et de CFE/CVAE pour les nouvelles méthanisations crées à compter du 1er janvier 2015. La durée de sept ans a été préférée à celle de cinq ans car elle correspondrait mieux à la période théorique d’amortissement d’une unité de méthanisation.
Le bénéfice de ces mesures d’exonération a été réservé aux nouveaux méthaniseurs car leur finalité était incitative. Or, la mesure n’aurait aucun effet incitatif sur les anciens méthaniseurs puisque, par définition, ces derniers sont déjà en activité.
Corrélativement, le A du I de l’article 60 de la loi de finances pour 2015 limite l’exonération facultative de taxe foncière aux installations de méthanisation agricole achevées avant le 1er janvier 2015. L’exonération temporaire facultative de cinq années perdait, en effet, son objet et sa raison d’être avec l’instauration d’une exonération de plein droit pour sept ans.
Dans le cadre du « plan énergie méthanisation autonomie azote » (EMAA) présenté en mars 2013, le Gouvernement a expressément manifesté son soutien au développement de l’activité de méthanisation agricole.
L’objectif du gouvernement est de développer en France, à l’horizon 2020, 1 000 méthaniseurs à la ferme. Cela mobiliserait près 2 milliards d’euros d’investissement selon les chiffres prévisionnels et permettrait de créer environ 2 000 emplois.
La méthanisation à la ferme contribue, en effet, à répondre aux enjeux environnementaux et énergétiques, notamment dans la gestion de l’azote, et s’inscrit pleinement dans la transition énergétique engagée en augmentant la production d’énergie renouvelable à partir de déchets, d’effluents d’élevage et de productions agricoles. Une unité de méthanisation adossée à une activité agricole peut non seulement être source d’un revenu complémentaire pour l’exploitant mais aussi améliorer le bilan gaz à effet de serres de l’exploitation.
Le modèle économique de la méthanisation à la ferme est toutefois fragile, notamment parce que les unités de méthanisation sont constituées d’immeubles qui ont une surface importante (digesteurs, fosses de stockage, etc.), aboutissant à une charge de taxe foncière et de cotisation foncière considérable. L’imposition à la TFPB et à la CFE dès le démarrage de l’activité peut constituer une charge importante au regard de sa rentabilité.
Tel a été l’objet des exonérations de plein droit d’impôts locaux fonciers (TFPB et CFE) et de la CVAE pour les nouvelles activités de méthanisation. Cependant, les méthaniseurs pionniers ne bénéficient pas des mêmes avantages fiscaux.
Or, les unités de méthanisation qui ont été achevées avant le 31 décembre 1994 sont au nombre d’environ 160 selon l’évaluation préalable du présent article annexé au de projet de loi de finances.
III. LES MODIFICATIONS PROPOSÉES : ÉTENDRE AUX PIONNIERS DU SECTEUR LES AVANTAGES FISCAUX DE LA MÉTHANISATION AGRICOLE
La réforme proposée consiste à étendre aux méthaniseurs pionniers les exonérations de plein droit dont bénéficient les autres méthaniseurs.
Ainsi, l’article 60 de la loi de finances pour 2015, qui fixe dans son II les modalités d’entrée en vigueur de l’exonération de plein droit de TFPB et de CFE, est modifié pour couvrir explicitement les unités de méthanisations antérieures au 1er janvier 2015. Ces dernières pourront ainsi bénéficier des exonérations d’impositions dues au titre de 2016 et des années suivantes jusqu’à leur septième année.
Le cas particulier de l’année 2015 est réglé par le I du présent article. Une mesure d’exonération n’étant plus possible à ce stade de l’année, il est prévu une mesure de dégrèvement pour les unités de méthanisations antérieures au 1er janvier 2015.
Parallèlement, la date limite de dépôt de la déclaration pour bénéficier de l’exonération est repoussée, pour la seule année 2016, du 1er janvier au 1er mars. Ce report est justifié par le fait que le projet de loi de finances pour 2016 n’entrera en vigueur qu’en fin d’année 2015 et qu’il convient de laisser un délai supplémentaire aux méthaniseurs concernés pour prendre connaissance de ces nouvelles exonérations.
Cette réforme est conforme aux recommandations de la mission d’information de la commission des finances sur la fiscalité agricole :
« La double exonération prévue par la loi de finances pour 2015 ne s’applique, à ce jour, qu’aux nouvelles installations réalisées à partir du 1er janvier 2015. Cette non-rétroactivité du dispositif d’exonération risque de créer une distorsion de concurrence importante entre nouvelles et anciennes unités de méthanisation.
« Le rapporteur est donc favorable à une mesure visant à appliquer la double exonération temporaire aux unités déjà installées depuis moins de sept ans, et pour la durée restante de l’exonération. À titre d’exemple, une unité créée depuis trois ans pourra bénéficier de la double exonération pendant les quatre années restantes. » (72)
Selon l’évaluation préalable du présent article, la mesure bénéficiera à environ 160 unités de méthanisation pour un gain annuel moyen de 24 000 euros sur la durée de l’exonération. Pour celles des unités qui ne supportent que la TFPB, le gain annuel moyen est évalué à 11 000 euros sur la durée totale d’exonération. Pour les unités qui supportent à la fois la TFPB et la CFE, le gain annuel moyen devrait atteindre 45 000 euros sur la durée totale d’exonération.
Sur la période 2016-2021, le coût total des exonérations de TFPB et de CFE devrait s’élever à 18 millions d’euros pour les collectivités territoriales concernées.
Le coût annuel est dégressif dans la mesure où le nombre de méthaniseurs pionniers bénéficiaires est appelé à diminuer chaque année au fur et mesure qu’ils atteindront leur septième année d’ancienneté.
INCIDENCE BUDGÉTAIRE POUR LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES (en millions d’euros) | |||||||
Année |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
Total |
TFPB |
2,1 |
2,1 |
1,9 |
1,8 |
1,1 |
0,7 |
9,7 |
CFE |
1,7 |
1,6 |
1,6 |
1,5 |
1,2 |
0,7 |
8,3 |
Total |
3,8 |
3,7 |
3,5 |
3,3 |
2,3 |
1,4 |
18 |
Source : évaluations préalables annexées au projet de loi de finances pour 2016. | |||||||
Ces exonérations à la charge des collectivités territoriales ne feront pas l’objet de compensation de la part de l’État.
En revanche, la mesure de dégrèvement relative à l’année 2015 est à la charge de l’État. Le coût pour l’État de la mesure de dégrèvement au titre de l’année 2015 est évalué à 4 millions d’euros. Les demandes de dégrèvement à la charge de l’État seront probablement déposées et traitées en 2016. L’impact budgétaire de la mesure de dégrèvement au titre de l’année 2015 devrait donc intervenir en 2016. La mesure affecte donc l’équilibre budgétaire de l’État de l’année 2016. C’est ce qui justifie son rattachement à la première partie du projet de loi de finances pour 2016, conformément au 2° du I de l’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF).
La Rapporteure générale rappelle qu’en sus de ces dispositifs la méthanisation bénéficie aussi d’un tarif de rachat par EDF plus attractif (compensée par la contribution au service public de l’électricité), des prêts bonifiés ou à taux zéro, des subventions de l’agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME), ou encore des primes pour la méthanisation des effluents qui relèvent du ministère de l’agriculture.
La Rapporteure générale a interrogé le Gouvernement pour connaître le montant total de ces différentes aides. À ce jour, les chiffres ne lui ont pas encore été communiqués.
*
* *
La commission examine l’amendement I-CF 218 de M. Charles de Courson.
M. Charles de Courson. Nous avons déjà parlé de ce problème. Dans les installations de méthanisation, tout le monde pensait que les installations constituaient de l’équipement, et n’étaient donc pas assujetties à la taxe sur le foncier bâti. Mais l’administration fiscale le considère comme de l’immobilier par destination.
Deux voies étaient alors ouvertes : requalifier ces installations en équipement, mais cela semblait poser des problèmes au regard d’autres dispositions sur l’immobilisation par destination ; ou distinguer les immeubles uniquement affectés au stockage des matières entrantes et du digestat, qui bénéficieront de l’exonération, et tous les autres immeubles directement affectés au process de méthanisation agricole, pour lesquels il est proposé une exonération temporaire automatique de taxe foncière, étendue à sept ans.
Mme la Rapporteure générale. Nous avons eu l’année dernière un très long débat en séance sur cet amendement. Les méthaniseurs pionniers, qui font l’objet de l’article 7 du projet de loi, bénéficient actuellement d’une exonération facultative de cinq ans de taxe foncière, mais pas d’exonération sur la cotisation foncière des entreprises (CFE) ni sur la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE).
Quant aux méthaniseurs à partir du 1er janvier 2015, ils bénéficient d’une exonération de taxe foncière de sept ans à compter de l’achèvement de l’installation, et d’une exonération de CFE et de CVAE de sept ans également, dès que l’activité a commencé.
Votre amendement, monsieur de Courson, propose une exonération permanente sur les bâtiments de stockage, et non pas limitée à sept ans.
La mission d’information n’a pas retenu cette piste, qui avait été évoquée. Il me semble par ailleurs que, ce matin, vous nous avez invités à limiter toutes les dépenses, puisque vous vouliez même baisser le plafond des dépenses fiscales.
Enfin, vous introduisez un peu plus de complexité puisque le stockage serait éternellement exonéré, tandis que le reste du méthaniseur ne le serait que sur sept ans, même si son activité continue. Pour ces trois raisons, je suis défavorable à votre amendement.
M. François André. En effet, la mission n’a pas retenu cette proposition. L’année dernière, nous avons déjà décidé du passage à sept ans de la durée d’exonération de taxe, qui paraissait plus proche de la durée d’amortissement des installations. Je ne vois pas ce qui pourrait justifier économiquement une exonération ad vitam aeternam.
M. Jean-Louis Gagnaire. Sept ans, c’est déjà généreux, car, si l’on réintègre toutes les aides sur ces installations, les durées d’amortissement tombent à quatre ans et demi ou cinq ans.
La commission rejette l’amendement I-CF 218.
*
* *
Article 8
Suppression de taxes à faible rendement
Cet article supprime, à compter de 2016, trois taxes sectorielles qui, en raison de leur faible rendement (inférieur ou égal à 25 millions d’euros) et de leur complexité de gestion, alourdissent inutilement l’activité économique.
Cet effort ciblé de simplification de notre système fiscal fait suite au rapport remis au Gouvernement par l’Inspection générale des finances, au mois de février 2014, sur 192 taxes dont le rendement est inférieur à 150 millions d’euros Il complète la suppression de sept « petites taxes » décidée, à la suite de ce même rapport, dans le cadre de la loi de finances pour 2015 (73). Rappelons ainsi qu’en application de l’article 20 de cette dernière, ont déjà été supprimées la redevance due par les titulaires de concessions de stockage souterrains d’hydrocarbures, la taxe sur les appareils automatiques, la cotisation de solidarité sur les graines oléagineuses, la taxe dite « Grenelle II » (74), une partie des droits d’enregistrement sur les mutations à titre onéreux de meubles corporels, la taxe dite « de trottoirs » et la taxe pour la gestion des eaux pluviales urbaines. Il s’agissait alors, plus encore que pour le présent article, de taxes dont le produit était anecdotique, puisqu’elles rapportaient au total moins 2,3 millions d’euros.
Les trois taxes supprimées par cet article sont les suivantes :
– la composante de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) portant sur les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), qui rapporte actuellement chaque année environ 25 millions d’euros à l’État (paragraphe I de l’article) ;
– la taxe sur les premières ventes de produits cosmétiques, dont le produit annuel au profit de la sécurité sociale est inférieur à 7 millions d’euros (paragraphes II et III de l’article) ;
– la taxe administrative sur les opérateurs de communication électronique, dont les recettes, reversées à l’État par l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP), sont inférieures à 4 millions d’euros par an (paragraphes IV et V de l’article).
I. SUPPRESSION DE LA COMPOSANTE DE LA TAXE GÉNÉRALE SUR LES ACTIVITÉS POLLUANTES (TGAP) PORTANT SUR LES INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (ICPE)
Le paragraphe I de cet article abroge, en tout ou partie, les articles 266 sexies, 266 septies, 266 nonies et 266 terdecies du codes douanes afin de supprimer, à compter du 1er janvier 2016, la composante de la TGAP qui frappe les ICPE.
La taxation des ICPE est ancienne, puisqu’elle a été mise en place par la loi du 19 juillet 1976 relative à ces installations (75). L’existence de règles de droit spécifique pour les ICPE s’explique par les risques environnementaux particuliers que peut faire courir la création ou l’activité de telles installations. Ces risques concernent principalement l’émission de produits polluants dans l’eau ou l’air, la production de déchets, la consommation d’énergie et les risques d’accidents (incendie, explosion, rejets accidentels de produits notamment). En pratique, la réglementation des ICPE concerne par exemple l’industrie chimique, pétrolière, agroalimentaire, les traitements des déchets, ou encore les carrières et les élevages intensifs.
Dès l’origine, la taxation des ICPE a pris la forme, d’une part, d’une taxe forfaitaire due, lors de l’autorisation ou de la déclaration de leurs activités, par les établissements industriels et commerciaux dont certaines installations sont classées et, d’autre part, d’une redevance annuelle perçue auprès des établissements qui « font courir des risques particuliers à l’environnement et requièrent de ce fait des contrôles approfondis et périodiques ».
Cette taxe et cette redevance ont disparu en tant que telles lorsqu’elles ont été intégrées, en 2000 (76), à une taxe plus large, la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP), qui avait été précédemment créée par la loi de finances pour 1999 (77). La TGAP a d’abord regroupé une série de taxes préexistantes frappant, en proportion de leur impact sur l’environnement, diverses installations, substances ou produits polluants (installations présentant un risque environnemental, déchets, émissions polluantes, huiles usagées et produits lubrifiants, lessives et matériaux d’extraction). Le régime de cette taxe est, d’une manière générale, fixé par les articles 266 sexies à 266 terdecies du code des douanes, et son produit est essentiellement versé à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME), dans la limite d’un plafond fixé en loi de finances (449 millions d’euros en 2014) – le surplus de recettes alimentant le budget général de l’État.
En 2014, le produit total de la TGAP s’est élevé à 644,4 millions d’euros, ce montant étant réparti de la manière suivante entre ses différentes composantes :
– 423,4 millions d’euros pour la TGAP sur les déchets ;
– 69 millions d’euros pour la TGAP sur les matériaux d’extraction ;
– 53,1 millions d’euros pour la TGAP sur les émissions polluantes ;
– 50,3 millions d’euros pour la TGAP sur les lessives ;
– 25 millions d’euros pour la TGAP sur les ICPE ;
– 23,6 millions d’euros pour la TGAP sur les lubrifiants.
La composante de la TGAP qui pèse actuellement sur les ICPE, régies par le titre Ier du livre V du code de l’environnement, n’a pas connu de changement notable depuis sa création, même si la liste des activités et produits entrant dans le champ de cette taxe a fait l’objet de mises à jour régulières. Ainsi, selon le principe déjà retenu en 1976, la taxation conduit à imposer les exploitants de deux types d’établissements industriels ou commerciaux :
– ceux dont certaines installations sont soumises à autorisation en application des dispositions du code de l’environnement propres aux ICPE (cas prévu par le 8 a du paragraphe I de l’article 266 sexies du code des douanes) ;
– ceux dont les activités figurent sur une liste spécialement établie par décret en Conseil d’État parce qu’en raison de leur ampleur ou de leur nature, elles font courir des « risques particuliers à l’environnement » (cas prévu par le 8 b du paragraphe I du même article).
Par ailleurs, le 8 de l’article 266 septies précise que le fait générateur de cette composante de TGAP est constitué de la délivrance de l’autorisation pour les établissements de la première catégorie (pour lesquels l’exploitant paye la taxe une fois pour toutes), mais de l’exploitation même de l’établissement pour ceux de la deuxième catégorie : en raison des risques environnementaux spécifiques qui s’attachent à leur activité, l’exploitant de ces établissements doit acquitter une taxe chaque année. Le champ d’application de la taxe annuelle fait toutefois l’objet d’une restriction au profit des entreprises artisanales : le 5 du paragraphe II de l’article 266 sexies prévoit que la taxe ne s’applique pas lorsque l’exploitant de l’ICPE est une entreprise inscrite au répertoire des métiers.
Les tarifs de la taxe, prévus aux alinéas 27 à 31 du tableau figurant au B du 1 de l’article 266 nonies, s’élèvent à :
– 2 525,4 euros pour la taxe ponctuelle due au titre de la délivrance d’une autorisation d’exploiter une nouvelle ICPE, ce montant étant toutefois abaissé à 501,6 euros lorsque l’exploitant de l’installation est un artisan qui n’emploie pas plus de deux salariés, ou encore à 1 210,8 euros pour les entreprises employant davantage de salariés qui sont inscrites au répertoire des métiers ;
– 339,4 euros par an pour la taxe annuelle due au titre de la poursuite de l’exploitation d’une ICPE présentant des risques environnementaux particuliers.
En outre, le 7 du même article dispose que, pour obtenir, pour chaque établissement, le montant de taxe dû, il est nécessaire d’appliquer à chacun de ces tarifs de base un coefficient multiplicateur fixé par décret en Conseil d’État, ce coefficient étant « compris entre un et dix pour chacune des activités exercées dans les installations classées ».
Enfin, en application de l’article 266 terdecies du code des douanes, cette taxe est liquidée, recouvrée et contrôlée par les services chargés de l’inspection des ICPE, c’est-à-dire les directions régionales de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL). Il s’agit ici d’une organisation administrative qui déroge au schéma retenu pour toutes les autres composantes de la TGAP, selon lequel ces missions reviennent uniquement aux agents de la direction générale des douanes et des droits indirects (DGDDI).
Selon les informations transmises à la Rapporteure générale, le nombre d’autorisations accordées pour de nouvelles ICPE s’est élevé à 1 133 en 2013 et à 951 en 2014. Par ailleurs, le nombre d’établissements pour lesquels la taxe annuelle a été appelée au titre de la poursuite de l’exploitation d’ICPE présentant des risques environnementaux spécifiques s’est élevé à 11 452 en 2013 et 10 573 en 2014. Une majorité d’installations entrant dans le champ d’application de cette taxe exercent actuellement des activités industrielles.
L’évaluation préalable de cet article jointe au présent projet de loi de finances estime que cette composante de TGAP ne permet pas réellement d’inciter à réduire les pollutions et autres risques environnementaux, car le niveau de taxation des exploitations poursuivant leur activité ne dépend ni de l’importance des émissions de produits polluants, ni des mesures prises par l’exploitant pour réduire ces rejets : le seul moyen pour les exploitants d’éviter la taxation consiste donc, actuellement, à renoncer à leur projet économique ou à le conduire à l’étranger. Par ailleurs, l’évaluation préalable souligne que cette taxe serait « très complexe à recouvrer », ce qui s’explique à la fois par l’intervention des DREAL – qui n’interviennent pas habituellement en matière d’accises – et par les dizaines de coefficients modulant le niveau de taxation selon le type d’installation ou d’activité (ces coefficients, fixés par décret en Conseil d’État, devant faire l’objet de mises à jour régulières).
Enfin, le Gouvernement souligne que le rendement de la taxe demeure faible au regard de la charge administrative que représenterait sa gestion et des inconvénients économiques qui s’y attacheraient. Ainsi, le produit de cette composante de la TGAP est évalué par le Gouvernement à 25 millions d’euros par an, dont plus de 90 % proviennent de la taxation annuelle des installations, présentant des risques environnementaux particuliers, qui poursuivent leur activité. La Rapporteure générale remarque que ce montant est loin d’être dérisoire, contrairement au produit des autres « petites taxes » dont la suppression a été décidée dans le cadre de la loi de finances pour 2015.
L’article abroge l’ensemble des dispositions fixant le régime législatif de cette composante de la TGAP, qu’il s’agisse de son champ d’application (8 du paragraphe I et 5 du paragraphe II de l’article 266 sexies du code des douanes), de la définition du fait générateur de la taxation (8 de l’article 266 septies du même code des douanes), des tarifs et modalités de calcul de la taxe (lignes 27 à 31 du tableau du B du 1 et 7 de l’article 266 nonies), ou encore des modalités de liquidation, de recouvrement et de contrôle de la taxe (article 266 terdecies).
Il en résulterait une suppression de la taxe dès l’entrée en vigueur de la loi de finances, ce qui signifie que les établissements jusqu’ici redevables de cette composante de la TGAP en seraient dispensés dès 2016, ce qui ne paraît pas soulever de difficulté juridique particulière.
La suppression de cette taxe, qui figurait parmi les cinquante-deux mesures de simplification rendues publiques, le 1er juin 2015, dans le cadre des propositions du Conseil de la simplification pour les entreprises, permettrait certes d’alléger la charge administrative des DREAL ainsi que la fiscalité pesant sur plusieurs milliers d’exploitations industrielles et agricoles.
D’un point de vue écologique, cette composante de la TGAP se caractérise effectivement par des tarifs forfaitaires, qui ne sont pas directement liés aux efforts déployés par les exploitants pour réduire les risques environnementaux, ou encore aux résultats qu’ils ont obtenus dans ce domaine. En principe, il serait plus efficace, pour favoriser une évolution des comportements vers des modes de production plus respectueux de l’environnement, de s’appuyer sur des taxes assises sur les émissions constatées, en fonction de leur dangerosité, à l’instar de l’actuelle composante « air » de la TGAP. Il ne serait donc pas absurde, d’un point de vue écologique, de privilégier une fiscalité fondée sur les résultats écologiques obtenus, ce qui permettrait alors de supprimer cette taxation forfaitaire des ICPE, dont la relative complexité et le caractère peu incitatif sont soulignés.
Toutefois, le Gouvernement ne propose ni de réformer cette composante de la TGAP pour la rendre plus incitative, ni de la remplacer par une imposition plus simple et plus incitative, portant spécifiquement sur la création et la poursuite d’activité de telles installations présentant des risques environnementaux importants. Dès lors, le choix de supprimer cette taxe, dont le rendement de 25 millions d’euros n’a rien de négligeable, ne paraît pas plus convaincant cette année qu’il ne l’était dans le cadre du projet de loi de finances pour 2015. Il vous est donc proposé, comme le Parlement l’avait déjà décidé l’an dernier, de revenir sur la mesure de suppression proposée par le Gouvernement et, ainsi, de préserver cette composante de la TGAP, qui a à la fois un sens écologique et un intérêt budgétaire.
Les paragraphes II et III de cet article visent à supprimer la taxe sur les premières ventes de produits cosmétiques, en abrogeant les articles 1600-0 P et 1600-0 Q du code général des impôts (CGI), qui définissent l’assiette, le taux et les modalités de déclaration, de recouvrement et de contrôle de cette taxe, et en apportant des modifications de conséquence à l’article 1647 du même code et à l’article L. 5121-18 du code de la santé publique.
La taxe sur les premières ventes de produits cosmétiques est relativement récente, puisque sa création avait été décidée par l’article 26 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2012 (78), à la suite de l’adoption, avec l’accord du Gouvernement de l’époque, d’un amendement du sénateur Alain Milon. Ce dernier avait alors indiqué que cette taxe avait pour objet de financer les actions de vigilance menées par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) (79) « pour surveiller les effets indésirables résultant de l’utilisation de produits cosmétiques » (80) – comme elle le fait à l’égard des produits pharmaceutiques.
Le régime de cette taxe, qui a depuis lors fait l’objet de simples modifications de coordination, repose essentiellement sur l’article 1600-0 P du CGI, relatif à l’assiette, au fait générateur et au taux de la taxe, et sur l’article 1600-0 Q du même code, consacré à ses modalités de recouvrement et de contrôle.
En application de ces articles, la taxe porte sur les premières ventes de produits cosmétiques (importés ou fabriqués en France) qui sont effectuées, sur le territoire national, par des entreprises assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), une définition précise de ces produits étant donnée par l’article L. 5131-1 du code de la santé publique (81). À l’inverse, la vente de ces produits n’entre pas dans le champ d’application de la taxe lorsque ceux-ci sont exportés ou expédiés hors du territoire national, que l’État de destination appartienne ou non à l’Union européenne.
Le taux de la taxe, actuellement fixé à 0,1 %, s’applique au montant total des ventes, hors TVA, qui ont été effectuées en France au cours de l’année civile précédant celle de l’imposition, la taxe étant exigible au moment de ces ventes. La taxe due par les assujettis doit être déclarée sur une annexe à la déclaration de TVA remise au titre du mois de mars ou du premier trimestre de l’année civile suivant celle des opérations, et son règlement doit intervenir simultanément. Elle doit également donner lieu, avant le 31 mars de l’année suivant celle des ventes, à une déclaration auprès de l’ANSM, dont la forme est fixée par décision du directeur de cette agence. Toutefois, il est prévu une dispense de déclaration et de paiement de la taxe lorsque son montant ne dépasse pas 300 euros.
Les modalités applicables à la liquidation, au recouvrement et au contrôle de la taxe sont alignées sur celles de la TVA – étant précisé que, si le redevable de la taxe n’est établi ni en France, ni dans un État membre de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen, les formalités et le paiement de la taxe incombent à son représentant, assujetti à la TVA en France et accrédité par l’administration fiscale. Le produit de la taxe, destiné au financement de la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS), fait l’objet, en application du paragraphe II bis de l’article 1647 du CGI, d’un prélèvement de 0,5 % au profit de l’État, au titre des frais d’assiette et de recouvrement.
Le nombre de fabricants ou importateurs de produits cosmétiques redevables de cette taxe s’est élevé à 544 en 2012, 605 en 2013 et 493 en 2014. Parmi ces redevables, les entreprises étrangères ont été au nombre de 12 en 2012, 13 en 2013 et 17 en 2014.
Par ailleurs, le produit de cette taxe, reversé par l’État à la sécurité sociale (CNAMTS), demeure très limité : le produit annuel de cette taxe s’est élevé à 5,6 millions d’euros en 2012, à 6 millions d’euros en 2013, à 6,7 millions d’euros en 2014 et devrait atteindre 7 millions d’euros en 2015.
Le faible rendement de cette taxe avait déjà conduit l’Inspection générale des finances, dans son rapport sur les taxes à faible rendement, remis au Gouvernement au mois de février 2014, à l’analyser et à préconiser sa suppression.
Les paragraphes II et III de cet article prévoient, précisément, de supprimer cette taxe, en abrogeant les deux articles qui en fixent les grandes caractéristiques (articles 1600-0 P et 1600-0 Q du CGI) et en apportant les coordinations ponctuelles requises à l’article 1647 du même code ainsi qu’au premier alinéa de l’article L. 5121-18 du code de la santé publique.
Aucun texte européen n’obligeant la France à disposer d’une telle taxe dans sa législation fiscale, il n’existe pas d’obstacle juridique à sa suppression. S’agissant des modalités de mise en œuvre de la suppression, on peut noter qu’en l’absence de précision quant à la date d’application de la mesure, les changements législatifs proposés produiront pleinement leurs effets dès le 1er janvier 2016
– ce qui signifie qu’aucune taxe sur les produits cosmétiques ne pourra être recouvrée par l’État en 2016 sur les ventes effectuées pendant l’année 2015.
Le Gouvernement n’a pas prévu, en raison de l’enjeu budgétaire limité, de compenser financièrement la perte de recettes résultant en 2016, pour l’assurance maladie, de la suppression de cette taxe.
La suppression proposée aura pour effet d’alléger légèrement la taxation des entreprises vendant en France ces produits cosmétiques, tout comme les démarches administratives qu’elles doivent actuellement effectuer tant auprès des services des impôts que de l’ANSM. Compte tenu du taux actuellement très faible de cette taxe, cette suppression ne pourra pas bénéficier directement aux consommateurs finaux des produits : un produit cosmétique actuellement vendu hors taxe à 30 euros, donnant lieu à la perception de 3 centimes d’euros au titre de cette taxe et de 6 euros au titre de la TVA, verrait son prix théoriquement baisser à 29,97 euros si l’entreprise répercutait entièrement cette mesure sur ses prix.
En revanche, cette suppression s’inscrit dans une logique de simplification de notre système fiscal, trop complexe, et à cet égard va dans le bon sens. Elle ne peut que contribuer au dynamisme économique du secteur des cosmétiques, en évitant de faire peser sur la même assiette à la fois un impôt général, la TVA, et un impôt sectoriel peu rentable.
Enfin, selon les informations transmises à la Rapporteure générale, l’ANSM devrait pouvoir poursuivre l’exercice de sa mission après la suppression de cette taxe, son financement étant assuré par une subvention pour charges de service public.
III. SUPPRESSION DE LA TAXE ADMINISTRATIVE PESANT SUR LES OPÉRATEURS DE COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES
Les paragraphes IV et V de cet article abrogent partiellement l’article 45 de la loi de finances pour 1987 (82) et l’article L. 33-1 du code des postes et des télécommunications, afin de supprimer la taxe administrative, relativement complexe et peu rentable, qui frappe les opérateurs de communications électroniques.
L’article 45 de la loi de finances pour 1987, dont la rédaction a fait l’objet de multiples adaptations au fil des évolutions technologiques, prévoyait initialement la taxation forfaitaire des communications audiovisuelles et des installations radioélectriques, selon des modalités tenant compte des caractéristiques techniques des installations et des fréquences hertziennes utilisées. En application de son paragraphe VII, les opérateurs exerçant des activités de communication électronique sont tenus, depuis 2005, d’acquitter une taxe administrative fixée, sauf exception, à 20 000 euros par an. Cette taxe est exigible le 1er mai de l’année suivant celle au cours de laquelle l’activité a été exercée et bénéficie au budget de l’État.
L’article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques, auquel renvoie l’article 45 de la loi de finances pour 1987, soumet la « fourniture au public de services de communications électroniques » à une série de règles et de spécifications techniques – ces règles concernant essentiellement la qualité, la sécurité, la disponibilité du service, la confidentialité des données, la protection de l’ordre public, de la santé et de l’environnement, l’information des consommateurs, ou encore l’interconnexion des réseaux et l’interopérabilité des services. Le m) du paragraphe I de cet article fait actuellement figurer parmi ces règles l’obligation, pour les personnes exerçant ces activités, d’acquitter des taxes dont la finalité et de « couvrir les coûts administratifs » liés à la gestion des autorisations et autres modalités d’encadrement applicables à ces communications.
Les règles d’exonération et de calcul de la taxe résultent de modifications apportées à l’article 45 de la loi de finances pour 1987 par la loi de finances rectificative pour 2003 du 30 décembre 2003 (83). Ainsi, cette taxe n’est, en réalité, pas acquittée par tous les opérateurs, car le 1° du paragraphe VII de l’article 45 prévoit actuellement deux cas d’exonération :
– l’exonération des opérateurs dont le chiffre d’affaires (hors taxes) a été inférieur à 1 million d’euros pendant l’année considérée ;
– l’exonération des opérateurs n’ayant exercé des activités de communications électroniques qu’à titre expérimental et pour une durée maximale de trois ans.
Par ailleurs, pour les opérateurs redevables de cette taxe, son montant, en principe forfaitaire, peut être modulé à plusieurs égards :
– si le chiffre d’affaires annuel du redevable est compris entre 1 et 2 millions d’euros, le montant de la taxe due est obtenu en appliquant une décote destinée à éviter un effet de seuil trop brutal à l’entrée dans le dispositif (le c) du 1° du VII de l’article précité prévoyant que le montant est obtenu en divisant par 50 le chiffre d’affaires hors taxe lié aux activités, puis en soustrayant 20 000) ;
– si l’opérateur n’exerce ses activités que dans les départements d’outre-mer (DOM) ou dans un unique département métropolitain, le montant de la taxe est divisé par deux ;
– à l’inverse, le montant de la taxe est multiplié par quatre si l’opérateur, d’une part, figure dans la liste des « opérateurs réputés exercer une influence significative sur un marché du secteur des communications électroniques » établie par l’ARCEP en application du 8° de l’article L. 36-7 du code des postes et des communications électroniques et, d’autre part, réalise un chiffre d’affaires annuel supérieur à 800 000 euros.
Ces différentes formes de modulation du montant de la taxe, au profit des petits opérateurs et aux dépends des plus importants, permettent donc d’introduire un peu de progressivité et, en principe, d’atténuer les inconvénients économiques liés à son caractère forfaitaire.
Le dynamisme du secteur des communications électroniques est devenu particulièrement important pour la croissance de notre économie depuis une quinzaine d’années, du fait du développement des technologies de l’information et de la communication, de leur large diffusion dans l’ensemble de la société et des opportunités qu’elles présentent pour la recherche et les gains de productivité. Il paraît donc préférable de ne pas faire peser sur ce secteur d’activité une taxe spécifique, à moins que celle-ci ne remplisse un rôle réellement utile à son bon fonctionnement. La croissance du nombre d’opérateurs de communications électroniques au cours des trois dernières années confirme d’ailleurs qu’il s’agit d’un secteur d’activité dynamique : de 2012 à 2014, le nombre d’opérateurs dont le chiffre d’affaires est inférieur à 1 million d’euros (et doivent à ce titre être exonérés de la taxe) est passé de 913 à 1216, et celui des opérateurs dont le chiffre d’affaires est supérieur à ce seuil est passé de 306 à 360.
ÉVOLUTION DU NOMBRE D’OPÉRATEURS DE COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES DE 2012 À 2014
Opérateurs concernés |
2012 |
2013 |
2014 |
Évolution 2012-2014 |
Opérateurs exonérés en raison de leur chiffre d’affaires (inférieur à 1 million d’euros) |
913 |
1 063 |
1 216 |
+ 33,2 % |
Opérateurs au chiffre d’affaires compris entre 1 et 2 millions d’euros (taxation à un tarif compris entre 1 et 20 000 euros) |
72 |
52 |
62 |
– 13,9 % |
Opérateurs au chiffre d’affaires compris entre 2 et 800 millions d’euros (taxation forfaitaire à un tarif de 20 000 euros sauf exception) |
229 |
275 |
292 |
+ 27,5 % |
Opérateurs au chiffre d’affaires supérieur à 800 000 euros (taxation forfaitaire majorée, à un tarif de 80 000 euros sauf exception) |
5 |
5 |
6 |
+ 20 % |
Total des opérateurs taxés |
306 |
332 |
360 |
+ 17,6 % |
Total des opérateurs (taxés ou exonérés) |
1 219 |
1 395 |
1 576 |
+ 29,3 % |
Source : ministère des finances et des comptes publics, direction du budget.
Or, la taxe administrative dont la suppression est envisagée n’a pas de vocation incitative particulière et son rendement est très limité. Ainsi, selon l’évaluation préalable de cet article, son produit reste chaque année inférieur à 5 millions d’euros. Plus précisément, selon les données transmises à la Rapporteure générale par le ministère des finances et des comptes publics, pour les années 2010 à 2014, les recettes encaissées par la régie de recettes de l’ARCEP et reversées chaque mois au budget général de l’État ont été comprises entre 3,2 et 3,8 millions d’euros. Sa suppression, qui conduirait donc à diminuer d’autant les recettes annuelles de l’État à compter de l’année 2016, ne devrait donc avoir qu’un impact très marginal sur le budget général de ce dernier.
ÉVOLUTION DU PRODUIT ET DU RECOUVREMENT DE LA TAXE ADMINISTRATIVE SUR LES OPÉRATEURS DE COMMUNICATION ÉLECTRONIQUES DEPUIS 2010
Année |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
Recettes encaissées (en milliers d’euros) |
3 197 |
3 682 |
3 601 |
3 744 |
3 825 |
Taux de recouvrement (en %) |
74,7 |
74,9 |
78,9 |
74,7 |
73,2 |
Source : ministère des finances et des comptes publics, direction du budget.
L’article abroge, d’une part, le paragraphe VII de l’article 45 de la loi de finances pour 1987, qui prévoit l’existence de cette taxe et précise ses caractéristiques, et, d’autre part, le m) du paragraphe I de l’article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques, qui subordonne la fourniture de services de communications électroniques à l’obligation, pour les exploitants, d’acquitter une telle taxe.
La mesure sera applicable à la taxe établie au titre de l’année 2015, qui aurait été exigible au 1er mai 2016. Sa suppression concernera donc le chiffre d’affaires de l’année 2015, sans être pour autant rétroactive quant au recouvrement de la taxe. Elle permettra, ainsi, d’alléger les démarches et l’imposition des opérateurs dès l’année 2016.
Il convient par ailleurs de souligner qu’une éventuelle simplification de la taxe, consistant à ne la faire porter que sur les plus grands opérateurs qui seraient alors tenus d’acquitter un même montant de taxe (absence de modulation), soulèverait des difficultés au regard du droit de l’Union européenne, et ne peut donc être réellement envisagée. En effet, la directive du 7 mars 2002 relative à l’utilisation de réseaux et de services de communications électroniques (84) impose, dans son article 12, que de telles taxes, lorsqu’un État membre décide de les instituer (85), soient réparties entre les entreprises concernées selon un principe de proportionnalité, c’est-à-dire en faisant varier le montant en fonction de l’importance du chiffre d’affaires. De ce fait, il ne semble guère possible, juridiquement, de simplifier cette taxe autrement qu’à la marge – la suppression pure et simple de la taxe apparaissant alors plus efficace.
Cette taxe administrative se caractérise par un faire rendement et par une relative complexité, si l’on tient compte à la fois des diverses exonérations et modulations prévues et des difficultés rencontrées pour son recouvrement. Ainsi, le taux de recouvrement n’a jamais dépassé 79 % au cours des cinq dernières années (voir tableau précédent), essentiellement en raison des nombreuses réclamations adressées par les petits opérateurs lorsque ceux-ci sont taxés d’office – cette situation survenant lorsqu’ils n’ont pas transmis à l’ARCEP leur déclaration de chiffre d’affaires dans les délais impartis (en principe avant le 30 avril de l’année suivant celle au cours de laquelle le chiffre d’affaires a été réalisé (86)).
En outre, cette taxe ne présente pas d’intérêt économique particulier, puisqu’elle n’avait été instituée que pour couvrir les frais de gestion des autorisations administratives exigées pour l’exercice d’activités de communications électroniques, et ne comporte aucun aspect incitatif. Son caractère forfaitaire revient parfois à faire peser une charge excessive sur de petits opérateurs dont le chiffre d’affaires dépasse de peu 2 millions d’euros, sans tenir compte de leur bénéfice qui peut être limité – le tarif de 20 000 euros ne pouvant pas être considéré comme négligeable pour de tels cas.
Dans ces conditions, l’abrogation de cette taxe apparaît effectivement comme une mesure de simplification pertinente, de nature à alléger les démarches des opérateurs comme des administrations et à conforter le dynamisme de ce secteur économique.
*
* *
La commission examine les amendements identiques I-CF 413 de la Rapporteure générale et I-CF 310 de Mme Eva Sas.
Mme Eva Sas. L’année dernière, nous avions abrogé la disposition qui, sous prétexte de simplification, visait à alléger la fiscalité des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) en les exonérant de taxe générale sur les activités polluantes (TGAP). J’aimerais que la commission des finances maintienne cette TGAP sur les ICPE. Elle représente effectivement une petite recette, mais elle est utile, car nous avons besoin que ces installations soient les plus sécurisées possible.
Mme la Rapporteure générale. Effectivement, nous avions déjà repoussé cette suppression de taxe l’an dernier. Cela représente une recette de 25 millions d’euros, alors que les autres taxes supprimées dans cet article représentent des recettes de l’ordre de 5 millions d’euros.
La commission adopte les amendements I-CF 413 et I-CF 310.
Elle examine ensuite l’amendement I-CF 287 de M. Razzy Hammadi.
M. Razzy Hammadi. Il existe un problème de distorsion de concurrence dans le domaine des farines. Le rendement de la taxe qui leur est appliquée a été critiqué dans le rapport annuel de la Cour des comptes pour 2014, et cette taxe répond en tout point aux critères de l’article 8, qui porte sur les taxes dont le rendement est faible et qui présentent des coûts de gestion élevés.
Par ailleurs, la distorsion de concurrence est de plus en plus forte, les meuniers se sont exprimés de manière répétée à ce sujet.
Deux autres arguments militent en faveur de l’abolition de cette taxe : du point de vue de l’aménagement du territoire, les meuniers sont généralement les garanties bancaires des boulangeries ; et, évidemment, il existe une distorsion de concurrence immense. Les écarts de prix vont de 10 % à 15 %, et la taxe peut avoir un effet de 6 % à 7 % sur le chiffre d’affaires, pour un rendement bas et un coût de gestion élevé.
Mme la Rapporteure générale. Cette taxe rapporte 62 millions d’euros par an. Et ces 62 millions d’euros vont à la Mutualité sociale agricole (MSA). Je ne sais pas si vous avez rencontré ses représentants pour leur annoncer que vous souhaitiez qu’ils ne disposent plus de cette somme, mais je crains qu’ils ne demandent bien légitimement qu’elle soit remplacée.
Par ailleurs, il s’agit d’un montant significatif. Même si nous le supprimions, rapporté au nombre de baguettes vendues chaque année, l’impact sur le prix serait insignifiant. J’avoue ne pas avoir examiné le compte de résultat du secteur de la farine en France, mais votre proposition constitue un problème à l’égard de la sécurité sociale.
M. Razzy Hammadi. Le problème n’est pas le prix de la baguette, mais celui de la farine. Il faut savoir si nous allons continuer à faire appel à des fournisseurs de l’autre côté de la frontière.
M. Charles de Courson. Notre collègue soulève un problème : trois ou quatre taxes dont l’eurocompatibilité est mise en question sont discriminatoires et perturbent le marché de la farine et de la semoule. Cet amendement est gagé sur la recette tabacs, mais nous savons que celle-ci n’est pas affectée. Il faudrait trouver une recette de substitution et ne pas se contenter d’éliminer la taxe sur la farine, mais toutes les taxes au quantum qui alimentent la MSA.
M. Razzy Hammadi. Je sais que le tabac est souvent utilisé pour gager, mais cette recette de substitution a toute sa pertinence dans notre cas. Lorsque nous avons débattu du tabac et du nouveau calcul l’année dernière, il nous a été dit qu’il n’y aurait pas de gain fiscal pour l’industrie du tabac. Or, il y a, semble-t-il, eu un gain estimé à 60 millions d’euros. Le gage sur le tabac n’est donc pas simplement technique. Je préfère aider l’industrie de la farine en rétablissant la justice fiscale qui nous avait été promise sur le tabac et qui n’a pas été maintenue.
La commission rejette l’amendement I-CF 287.
Puis elle adopte l’article 8 modifié.
*
* *
La commission examine, en discussion commune, les amendements I-CF 286, I-CF 301, I-CF 302 et I-CF 288 de Mme Eva Sas, I-CF 304 de M. Éric Alauzet, I-CF 388 de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire, I-CF 230 de M. Olivier Faure et I-CF 303 de Mme Eva Sas.
Mme Eva Sas. Nous abordons une série d’amendements sur la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE), la question de l’avantage fiscal du diesel et la contribution climat-énergie.
L’amendement I-CF 286 a pour objet de traduire dans la loi de finances l’article de la loi sur la transition énergétique qui fixe la trajectoire de la contribution climat-énergie à 56 euros par tonne de carbone en 2020. Nous nous sommes étonnés que cette avancée de la loi sur la transition énergétique ne soit pas traduite dans la loi de finances pour 2016.
Mme la Rapporteure générale. Le Gouvernement souhaite que l’ensemble de ces dispositions soit abordé dans le projet de loi de finances rectificative, pour leur donner une visibilité lors de la COP21.
Quant au fond, vous proposez d’augmenter de 3 centimes par an la taxation du fioul domestique, ce qui représente une augmentation plus forte que celle décidée pour 2015 ; et, pour les carburants, de faire progresser la TICPE de manière plus rapide que ce qui est exigé par l’objectif de 56 euros par tonne de CO2 en 2020.
Pour ces deux raisons, avis défavorable.
Mme Eva Sas. Dès lors que le Gouvernement s’engage à ce que cet objectif soit effectivement traduit dans les lois de finances, peu importe que ce soit dans le projet de loi de finances ou dans le projet de loi de finances rectificative. Mais cela ne doit pas rester lettre morte.
Les deux amendements suivants, I-CF 301 et I-CF 302, combinent cet objectif de 56 euros par tonne de carbone en 2020 avec la convergence progressive des fiscalités du diesel et de l’essence. Je précise, en réponse aux quelques tweets qui ont circulé cet après-midi, que nous proposons de réaliser cette convergence par une baisse de la fiscalité sur l’essence. Nous souhaitons éviter les accusations récurrentes d’« écolo-taxeurs » : notre objectif est de réduire l’écart entre l’essence et le diesel, pas d’augmenter la fiscalité à tout prix.
Sur le même modèle, l’amendement I-CF 288 fait plusieurs propositions au Gouvernement pour qu’il puisse choisir de réaliser la convergence de l’essence et du diesel en réduisant le prix de l’essence et en augmentant celui du diesel, ou en augmentant simplement le diesel, ce qui serait plus intéressant pour les recettes fiscales.
L’amendement I-CF 304 propose d’augmenter la fiscalité du diesel de 2 centimes par litre en 2016, comme l’an dernier. Si nous ne le faisions pas, le rythme de la convergence ralentirait fortement.
M. Jean-Yves Caullet, rapporteur pour avis de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire. L’amendement I-CF 388 est identique, à une petite mention technique près, à celui que présentera Olivier Faure. Il a été adopté par la commission du développement durable, qui s’est saisie pour avis de cette question.
Nous avons séparé la question de la trajectoire de la part carbone de la TICPE de celle de la fiscalité des différents carburants.
Cet amendement propose d’augmenter la fiscalité sur le gazole de 2 centimes, celle des différentes essences – y compris l’essence avec plomb qui ne figure pas dans l’amendement d’Olivier Faure – de 1 centime ; et de baisser de 1 centime de la fiscalité du super 95-E10, qui incorpore 10 % de carburant renouvelable, en l’occurrence du super-éthanol.
Il s’agit de créer une recette qui permette le financement des infrastructures – d’où l’effort demandé sur l’ensemble des carburants, y compris le moins polluant – et de rattraper le différentiel entre le gazole et l’essence, ce qui permettra de financer l’évolution du parc vers des modèles plus vertueux, tant pour les véhicules légers que pour les véhicules lourds, en commençant par inciter les propriétaires des véhicules les plus anciens, souvent les personnes les plus modestes et qui en ont le plus besoin, notamment à la campagne, et qui pourront être orientées facilement vers des véhicules plus propres.
En ce qui concerne les poids lourds, je me permets de faire le lien avec un débat précédent : il serait sain d’orienter le parc de poids lourds vers des moteurs à gaz. Les industriels français accusent un léger retard technologique en la matière, et une perspective sur plusieurs années leur permettrait de se mettre à niveau en ce domaine.
M. Olivier Faure. Je voudrais aborder la question sous un angle moins technique que Jean-Yves Caullet, puisque nous présentons deux amendements presque identiques.
La question est assez simple : à quoi servons-nous ? Depuis le début de cette législature, nous avons demandé à Philippe Duron, dans le cadre d’une mission Mobilité 21, d’établir la liste des infrastructures prioritaires à financer pour les quinze années qui viennent. Cette liste a fait l’objet d’un consensus assez large, et a permis d’avancer sur la feuille de route en matière d’édification d’infrastructures de transport pour les prochaines années.
Aujourd’hui, suite à la décision de ne pas réaliser l’écotaxe poids lourds – dans laquelle nous avons tous une responsabilité, car nous avons tous voté cette taxe, et nous avons tous accepté de ne pas la mettre en place l’an dernier – l’Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF) n’a pas les moyens de mener la politique que nous avions pourtant définie en début de législature. Je rappelle qu’elle a besoin de 2,5 milliards d’euros par an pour financer le scénario 2 du rapport Duron ; or, aujourd’hui, elle ne dispose que de 1,8 milliard d’euros.
Je souhaite que la commission adopte mon amendement, et nous verrons ensuite quelle est la position du Gouvernement. Nous comprenons qu’il préférerait que la loi de finances rectificative serve de support à une évolution de la fiscalité sur le gazole. Mais j’aimerais que cette discussion se fasse sur la base d’une double utilisation des recettes.
Comme vient de le dire Jean-Yves Caullet, deux utilisations de cette recette sont possibles : financer l’AFITF et accompagner les utilisateurs qui ne peuvent pas avoir recours aux transports collectifs pour l’achat de véhicules propres, ou encourager la dépollution de leurs véhicules grâce aux filtres à particules. C’est très différent de ce que j’entends de la part du Gouvernement ou de ce que je lis dans d’autres amendements. Le Gouvernement annonce par exemple qu’il souhaite augmenter la fiscalité du gazole pour diminuer celle sur l’essence. Cela revient à faire les poches des diésélistes pour remplir celles de ceux qui circulent à l’essence ! Cela aurait un effet terrible, car ceux qui sont obligés de conserver un véhicule diesel sont les plus modestes d’entre nous. Proposer qu’ils financent ceux qui ont la capacité d’acheter un nouveau véhicule ou qui avaient déjà celle de rouler à l’essence, c’est une mesure très curieuse et qu’il est difficile de soutenir.
Pour la première fois depuis longtemps, tous les astres sont presque alignés : les prix des carburants sont exceptionnellement bas, et il existe, autour de la COP21, une prise de conscience mondiale de la nécessité de lutter contre le réchauffement climatique. Si, dans un tel moment, nous n’arrivons pas à augmenter de 2 centimes d’euros la fiscalité du gazole – soit 20 centimes pour dix litres et 2 euros pour cent litres, ce qui permet de parcourir près de mille kilomètres – si nous ne pouvons pas demander cela aux Français pour financer la lutte contre le réchauffement climatique, la conversion du parc automobile et la réalisation d’infrastructures de transport de qualité, alors je ne sais pas quand nous le ferons.
Mme Eva Sas. Lorsque nous proposons d’augmenter la fiscalité, on nous accuse d’assommer les ménages, comme on nous l’a dit à demi-mot dans l’hémicycle cet après-midi ; lorsque nous proposons de l’alléger, on nous reproche de privilégier les ménages aux revenus aisés. On trouve toujours des arguments pour s’opposer aux propositions des écologistes – mais nous y sommes habitués.
Je ne comprends pas que l’on ne veuille réduire que de 1 centime l’écart entre le diesel et l’essence, alors qu’il existe un consensus autour du fait que le diesel constitue un problème de santé publique. L’Organisation mondiale de la santé a reconnu en 2012 que c’était un cancérigène certain. Le récent scandale Volkswagen montre que le diesel propre est une imposture. Il faut accélérer la réduction de l’écart entre le diesel et l’essence. On ne peut pas attendre 2050 pour que la fiscalité soit identique. La moindre des choses est de cesser d’encourager le diesel.
Quoi qu’il en soit, nous soutiendrons tout ce qui va dans le bon sens, et, si la commission décidait d’augmenter la fiscalité du diesel de 2 centimes, les écologistes voteraient cette proposition.
Mme la Rapporteure générale. De très nombreux amendements ont été présentés. Je ferai figurer au rapport un petit tableau que nous avons réalisé sur le resserrement de l’écart de TICPE entre l’essence sans plomb 95 et le gazole. En 2014, l’écart était de 17,81 centimes, il devrait être de 15,31 centimes en 2016 en application des précédentes lois de finances. Un effort a donc déjà été fait. L’amendement qui fixe l’objectif de réduction le plus ambitieux propose 12,31 centimes par litre. Cela tendrait à faire converger les deux à l’horizon 2020 si l’on tenait le rythme proposé.
L’amendement d’Olivier Faure n’est pas à somme nulle, puisqu’il dégage sans doute de l’ordre de 650 millions d’euros de recettes supplémentaires. Étant donné l’importance du montant, cette mesure doit s’inscrire dans le débat global que propose le Gouvernement dans le PLFR. Sans doute, nous avons déjà voté des amendements à 650 millions d’euros, mais il n’est pas forcément judicieux de recommencer. Je préférerais donc que ces amendements soient retirés et qu’un débat lors de l’examen du projet de loi de finances rectificative (PLFR) permette d’avoir une vision globale. Comme le disait Eva Sas, lorsque l’on traite de ce sujet, il faut songer aux questions de pouvoir d’achat et de stratégie industrielle.
Par ailleurs, ces questions sont aussi liées à la réforme de la contribution au service public de l’électricité (CSPE) qu’impose le droit communautaire et qui sera étudiée dans le PLFR. Avis défavorable.
M. le président Gilles Carrez. Je voudrais vérifier un point auprès de d’Olivier Faure. En 2015, la majoration de 2 centimes sur le diesel a été intégralement fléchée sur l’AFITF. Il semblerait qu’elle ne le soit plus que partiellement en 2016, et que 400 ou 500 millions d’euros soient dérivés vers le budget de l’État.
Votre souci est donc aussi lié au financement de l’AFITF, compte tenu de la baisse du financement mis en place à partir de 2015. J’avais compris que les 2 centimes d’euros étaient mis en place pour 2015 et les années suivantes.
M. Olivier Faure. Nous avons également déposé, après l’article 14, l’amendement I-CF 234 qui vise à augmenter la part du produit de la TICPE affectée à l’AFITF. De sorte que, si la commission adopte l’amendement I-CF 230, on abonde non pas les caisses de l’État, mais le budget de l’AFITF.
Je comprends très bien que l’on veuille faire converger les fiscalités sur l’essence et le gazole, sans privilégier ce dernier. Cependant, nos administrés nous reprochent d’avoir nous-mêmes privilégié le gazole pendant des années et de les punir tout d’un coup pour avoir suivi nos conseils. Avant de les punir, mieux vaudrait créer des solutions alternatives.
Tel est l’avantage que présente l’amendement I-CF 230 : il n’est pas à somme nulle, ainsi que l’a relevé la Rapporteure générale, et offre deux solutions alternatives. D’une part, il permet de financer les transports collectifs, solution de repli pour les automobilistes, qui obtiennent ainsi quelque chose en échange de l’augmentation de la fiscalité sur les carburants. D’autre part, nous disons aux propriétaires de véhicules diesel que nous pouvons les accompagner. À l’intention de ceux qui ont suffisamment d’argent pour changer de véhicule, nous augmentons les bonus pour l’achat d’une voiture électrique ou hybride. Quant à ceux qui n’ont pas ces moyens – ils sont nombreux –, nous les accompagnons, comme cela se fait en Allemagne, pour l’achat non pas d’un nouveau véhicule, mais d’un filtre à particules qui permet de réduire très largement les émissions polluantes. À Berlin, les véhicules équipés d’un tel filtre peuvent circuler dans les zones à faibles émissions.
En résumé, nous donnons un signal clair en direction du marché, mais sans punir – le prélèvement supplémentaire se limite à 2 centimes par litre de gazole – et en accompagnant ceux qui ont fait un choix précédemment encouragé par l’État.
Pour toutes ces raisons, je souhaite que la commission adopte cet amendement. Cela étant, je comprends très bien que le Gouvernement préfère que le débat soit tranché lors de l’examen du PLFR, et je m’engage à retirer cet amendement en séance publique. Mais il s’agit d’engager le débat en ayant créé un rapport de forces. Je souhaite vérifier que l’intention du Gouvernement n’est pas simplement de diminuer la fiscalité sur un carburant pour augmenter celle sur l’autre. Avec la commission du développement durable, Jean-Yves Caullet, son rapporteur pour avis, et Philippe Duron, nous défendons un autre projet : celui de financer l’AFITF. À défaut, tout ce que nous avons mis sur la table depuis trois ans s’évanouira en fumée ! Nous avons fait un travail suivi, et ce n’est pas la peine de produire des rapports année après année si c’est pour les brûler à la fin de chaque législature ! Si nous ne servons à rien, autant se le dire !
L’Assemblée élabore régulièrement des rapports de sa propre initiative. Ce qui est nouveau, en l’espèce, c’est que le rapport a été demandé à Philippe Duron par le Gouvernement lui-même. Il s’agissait d’en finir avec le schéma national des infrastructures de transport (SNIT), qui était le miroir de nos désirs les plus fous, puisqu’il aurait fallu trois siècles pour les satisfaire ! Conformément au souhait du Gouvernement, le rapport Duron a identifié un certain nombre de projets prioritaires, de telle sorte qu’ils soient finançables sur quinze ans. Si ces projets prioritaires ne sont pas mis en œuvre, quelle est la crédibilité de la parole publique, tant celle du Parlement que du Gouvernement ?
Je souhaite que nous avancions en posant les bases d’un débat clair avec le Gouvernement. Évitons de nous faire balader dans un débat flou jusqu’à la loi de finances rectificative !
Mme Eva Sas. Lorsque, l’année dernière, nous avons voté l’augmentation de 2 centimes de la taxation sur le gazole, le Gouvernement a pris l’engagement de maintenir le budget de l’AFITF à 1,9 milliard d’euros. C’est bien ce que prévoit le présent projet de loi de finances. La question d’une nouvelle augmentation de 2 centimes et celle du financement de l’AFITF sont donc distinctes. D’autre part, le Gouvernement justifie le plafonnement de la part du produit de la TICPE affectée à l’AFITF par le fait que celle-ci a une charge en moins cette année : elle n’a pas à verser, comme l’année dernière, d’indemnités à Écomouv’.
Monsieur Faure, ne caricaturez pas les propos des uns et des autres ! Je propose de faire converger la fiscalité sur l’essence et celle sur le gazole, soit en diminuant la première, soit en augmentant la seconde. Nous partageons le même objectif, mais l’un de mes amendements me paraît plus facile à adopter que le vôtre : celui qui vise à augmenter de 2 centimes la taxation sur le gazole sans augmenter celle sur l’essence. Ainsi, nous resserrerons davantage l’écart entre les deux. D’une manière générale, je vous invite à adresser votre discours en priorité au secrétaire d’État chargé du budget, qui s’oppose à toute augmentation de la fiscalité sur les carburants, considérant qu’elle frapperait trop les ménages dans cette période difficile.
Quant aux recettes, elles doivent en effet être affectées à l’AFITF. À ce titre, le Premier ministre Jean-Marc Ayrault avait déclaré très clairement en 2013, je le rappelle, que le budget de l’AFITF devait atteindre 2,5 milliards d’euros. Or, aujourd’hui, il est encore de 1,9 milliard. En outre, j’aimerais apporter une nuance : l’AFITF finance majoritairement les transports collectifs et les modes alternatifs à la voiture individuelle, mais elle a également classé comme prioritaires un certain nombre de projets routiers, avec lesquels nous ne sommes pas nécessairement d’accord. Il n’en reste pas moins qu’il faut absolument abonder son budget.
M. Marc Le Fur. Je suis un peu surpris de cette agressivité à l’égard des automobilistes qui roulent au diesel. Ils n’ont pas à être les victimes de la faute commise par une entreprise allemande bien connue, événement extérieur qui a rouvert le débat.
Je ne vois aucune étude de l’impact de ces dispositions sur les automobilistes qui roulent au diesel. Souvent, ceux-ci n’ont pas de solution alternative en termes de transports en commun, en tout cas, pour certains d’entre eux, pas aux horaires auxquels ils travaillent, soit qu’ils commencent tôt le matin, soit qu’ils terminent tard le soir. On nous explique généralement que les automobilistes doivent payer pour financer un certain nombre de transports publics. Or, je ne saisis pas la raison d’un tel lien : je comprends parfaitement que les transports publics soient financés en partie par l’impôt, mais pourquoi les faire payer précisément par ceux qui n’en sont pas les usagers potentiels ?
M. le président Gilles Carrez. L’AFITF finance également des investissements routiers.
M. Marc Le Fur. Je ne vois rien non plus concernant l’impact sur les entreprises françaises, en particulier sur le groupe PSA, pour lequel les conséquences pourraient être très lourdes, dans la mesure où il est en pointe pour les moteurs diesel, domaine dans lequel il a d’ailleurs fait des efforts remarquables. Du fait des évolutions récentes, l’usine PSA de Rennes s’est réduite comme une peau de chagrin : elle compte à peine 3 000 salariés contre plus de 12 000 naguère, lorsqu’elle était l’une des plus importantes du groupe. C’est dire si ces effets peuvent être redoutables.
S’il y a des efforts à faire, peut-être faut-il qu’ils portent prioritairement sur les véhicules anciens, qui sont souvent les plus polluants, qu’il s’agisse des voitures particulières, des poids lourds ou des véhicules de transport en commun – nous pouvons tous constater dans nos rues qu’un certain nombre de bus sont extrêmement polluants. Nous pourrions imaginer des mesures visant à favoriser la modernisation du parc, tel qu’il en a existé par le passé. Ce serait d’ailleurs aussi un élément de relance. En tout état de cause, je m’opposerai avec la dernière énergie à tout ce qui peut concourir à pénaliser les automobilistes qui ont fait le choix du diesel.
M. le rapporteur pour avis de la commission du développement durable. L’impact, monsieur Le Fur, je le mesure tous les jours : j’habite à la campagne et je roule, comme beaucoup de nos compatriotes, avec un véhicule diesel, non pas parce que j’ai choisi un carburant moins cher, mais parce que je fais beaucoup de kilomètres et que j’ai préféré un moteur qui s’use moins vite. Cela restera d’ailleurs, à fiscalité égale, l’un des critères du choix en faveur de telle ou telle motorisation, chacune ayant ses qualités intrinsèques. La fiscalité n’est pas le seul élément qui oriente les décisions d’investissement des particuliers et des entreprises.
Les écarts dont nous parlons sont près de dix fois inférieurs à ceux qui existent entre les prix de différentes pompes à l’intérieur d’un même département. L’impact des mesures que nous envisageons est donc très limité, du fait de la conjoncture pétrolière.
Si nous incitons efficacement nos compatriotes équipés de véhicules anciens à les moderniser, ils supprimeront une pollution et réduiront dans le même temps leur consommation de carburant, ce qui compensera le surcoût, très modeste, que nous proposons.
Eva Sas a raison : l’AFITF finance non seulement des transports publics, mais aussi des projets routiers. C’est précisément ce qui justifie que l’on instaure aussi une petite contribution sur l’essence, ces infrastructures routières étant utilisées par tous les véhicules.
La commission du développement durable avait proposé un calendrier de rattrapage sur dix ans de l’écart entre les fiscalités sur le gazole et l’essence. Il s’agissait non pas de faire la chasse aux moteurs diesel, mais de donner un signal clair quant à la réduction de cet avantage fiscal qui n’a plus lieu d’être aujourd’hui dans son principe. Le rythme modeste que nous avions prévu permettait aux automobilistes et aux industriels de s’adapter.
M. Dominique Lefebvre. Au nom du groupe politique majoritaire, j’indique que nous n’avons nullement l’intention d’échapper au débat sur la fiscalité dans le cadre de la transition énergétique, à laquelle sont liés les engagements de la France au titre de la COP21, et que nous assumerons nos responsabilités. Telle est également, selon moi, l’approche du Gouvernement : lorsque l’on décide, de manière cohérente, de renvoyer l’ensemble des dispositions en matière de fiscalité énergétique au projet de loi de finances rectificative, lequel passera en Conseil des ministres au début du mois de novembre et sera débattu dans l’hémicycle au début du mois de décembre, c’est-à-dire en pleine COP21 à Paris, ce n’est pas pour évacuer le débat et ne rien faire, bien au contraire !
Par ailleurs, la présente discussion montre que le débat n’est pas stabilisé entre nous. Je ne vois pas quels arguments pourraient conduire à recommander la construction d’un rapport de forces entre l’Assemblée et le Gouvernement, alors que ni la position du Gouvernement ni celle du groupe politique majoritaire ne sont connues. Ce dernier n’a d’ailleurs pas encore débattu du sujet.
En revanche, à ce stade de la réflexion, eu égard à la sensibilité de la question, à la compréhension ou à l’incompréhension de nos concitoyens, ainsi qu’aux postures adoptées par certains, notamment par Marc Le Fur, il est important, selon moi, que nous ayons un débat dans l’hémicycle avant les décisions et les arbitrages ministériels. Il y a deux manières d’obtenir un tel débat : soit la commission adopte, ainsi que le propose Olivier Faure, l’un des amendements en discussion ; soit les auteurs des amendements les retirent maintenant mais les déposent à nouveau en vue de la séance. Dans les deux cas, nous aurons exactement le même type de débat, et le ou les amendements pourront être retirés en séance publique en fonction de ce que dira le Gouvernement.
Cependant, j’appelle votre attention sur un point, mes chers collègues : pour nos concitoyens comme pour les médias qui m’interpellent depuis le début de l’après-midi pour savoir si les députés socialistes voteront l’augmentation de 2 centimes de la fiscalité sur le gazole, un amendement adopté par la commission des finances n’est pas quelque chose d’anodin : c’est une décision entérinée. J’en appelle donc à la raison et à la responsabilité de chacun.
Je le répète : nous mènerons ce débat et nous aurons un dialogue avec le Gouvernement. Le cas échéant, s’il devait y avoir un désaccord avec celui-ci – nous ne connaissons pas aujourd’hui sa position –, il sera toujours temps pour le groupe politique majoritaire et pour l’ensemble des parlementaires de reprendre la main dans l’hémicycle lors de l’examen du projet de loi de finances rectificative.
M. Patrice Carvalho. C’est un peu un faux débat : ce n’est pas par le prix du gazole que nous changerons fondamentalement les choses. Le prix du gazole a d’ailleurs fortement progressé, beaucoup plus que celui de la baguette de pain.
Pourquoi les gens continueront-ils à acheter des véhicules diesel ? Parce que le moteur diesel est plus résistant que le moteur à essence et qu’il permet de faire trois à quatre fois plus de kilomètres. Il est aussi plus facile et donc moins coûteux à entretenir, et résiste mieux au froid. Sans parler du fait qu’il consomme moins. Et c’est un mécanicien qui vous le dit !
Nous parlons du diesel, mais pourquoi ne parlons-nous pas du kérosène, qui est beaucoup plus polluant ? Des dizaines de millions de mètres cubes de kérosène sont rejetés chaque année dans l’atmosphère, et les avions ne sont pas équipés de filtres à particules !
La commission du développement durable a auditionné le président-directeur général de PSA Peugeot Citroën. Celui-ci a expliqué que l’air absorbé par un moteur diesel contenait davantage de particules que l’air rejeté par ce même moteur lorsqu’il était équipé d’un filtre à particules. Il s’est dit prêt à financer une étude sur la question, en nous laissant désigner les experts de notre choix. C’est plutôt cela qu’il faudrait faire. Lorsque l’on entend le débat actuel sur le diesel, on a l’impression qu’il est question du moteur Indenor, qui n’existe plus depuis trente ans ! Dans le même temps, on ne fait rien pour régler le problème des camions et des véhicules de transport en commun, qui polluent à fond la caisse ! Car on ne va pas demander aux patrons de changer tous leurs camions en quelques mois !
M. Charles de Courson. Nous mélangeons au moins trois dossiers. Le premier porte sur l’opportunité de taxer l’essence et le gazole à parité énergétique, c’est-à-dire de mettre fin à cette disposition remontant à plus de cinquante ans qui a favorisé la diésélisation du parc. Il y a, semble-t-il, une majorité pour aller dans cette direction. Nous avons commencé à le faire l’année dernière en augmentant la fiscalité sur le gazole de 2 centimes par litre. À partir de là, la question est de savoir à quelle vitesse il faut aller. Tous ceux qui se sont penchés sur la question estiment qu’il faut prévoir un temps long : sept à dix ans, c’est-à-dire une augmentation de 1 à 2 centimes par an au maximum. Je précise que taxer à parité énergétique, comme le fait le Royaume-Uni par exemple, cela ne signifie pas instaurer la même taxe pour les deux carburants, car 1 litre d’essence libère 5 % d’énergie en plus que 1 litre de gazole. En outre, il existe plusieurs manières d’atteindre la parité fiscale entre l’essence et le diesel, dont nous pouvons discuter.
Le deuxième débat porte sur le financement de l’AFITF. Son budget s’élevant actuellement à 1,9 milliard d’euros, il lui manque, pour faire simple, 600 à 700 millions d’euros. Certains préconisent d’augmenter à la fois la fiscalité sur le gazole et celle sur l’essence, et d’affecter le produit correspondant à l’AFITF, ce qui pourrait faire en effet à peu près 700 millions, en fonction du rythme de la hausse.
Le troisième débat, marginal par rapport aux deux premiers, porte sur l’opportunité de donner un avantage fiscal aux carburants « oxygénés ». Ainsi, les amendements I-CF 388 et I-CF 230 visent à diminuer de 1 centime par litre la taxation sur l’essence SP95-E10 et à augmenter de 1 centime par litre celle sur l’esssence SP95. Cette mesure est neutre du point de vue budgétaire.
Mme la Rapporteure générale. Plusieurs débats se posent : le pouvoir d’achat, la manière de faire converger les fiscalités sur le gazole et l’essence, le financement de l’AFITF et la contribution climat-énergie. Il me paraîtrait plus logique d’avoir une discussion globale sur l’ensemble des propositions du Gouvernement lors de l’examen du projet de loi de finances rectificative. Je maintiens ma position : j’invite les auteurs des amendements à les retirer ; à défaut, je donnerai un avis défavorable à chacun d’eux.
M. Olivier Faure. Pour répondre à Dominique Lefebvre, je suis plutôt un commissaire discipliné, qui essaie d’être cohérent avec l’action du Gouvernement. Mais il y a des sujets sur lesquels le Gouvernement est plus ou moins cohérent.
M. Marc Le Fur. Heureusement qu’il est discipliné !
M. Olivier Faure. Cela n’empêche pas d’être libre, monsieur Le Fur ! Pour votre gouverne, je vous rappelle que vous avez vous-même souhaité la réalisation d’un certain nombre d’infrastructures dans le cadre du rapport Duron. Vous pourrez expliquer au cours de la campagne pour les régionales que vous ne savez pas comment les financer. C’est bien de faire des promesses, c’est mieux de les tenir !
On peut dire que nous ne connaissons pas la position du Gouvernement. Pour ma part, je crois que je la connais depuis au moins un an : l’écotaxe n’a pas été mise en place et, depuis lors, nous ne savons pas comment financer nos infrastructures de transport. La ministre de l’écologie a déclaré aujourd’hui – ce n’est pas neutre – qu’il faudrait parvenir, à terme, à une convergence des fiscalités sur l’essence et le gazole, en finançant la baisse de l’une par l’augmentation de l’autre. Je ne cherche pas à forcer la main de la commission, mais je pense que nous ne devons pas partager cette position, car elle ne résout pas la question que nous posons avec la commission du développement durable.
Je souhaite que nous adoptions mon amendement, afin d’adresser un signal clair et d’être mieux armés pour la discussion dans l’hémicycle. Ainsi que l’a souligné Dominique Lefebvre, lorsque la commission des finances vote un amendement, cela a un sens pour tout le monde. Quelle que soit la position du Gouvernement, je m’engage dès à présent à retirer mon amendement en séance publique pour le déposer à nouveau lors de l’examen du projet de loi de finances rectificative. Nous accepterons donc de continuer la discussion avec le Gouvernement, de manière calme, mais en ayant une position affirmée.
Mme Eva Sas. Je retire mes amendements au profit de l’amendement I-CF 230 de M. Faure, que je soutiens.
M. Olivier Faure. Je retire mon amendement au profit de l’amendement I-CF 388 de la commission du développement durable. Ainsi, les deux commissions auront adopté le même amendement, ce qui lui donnera encore plus de poids.
Les amendements I-CF 286, I-CF 301, I-CF 302, I-CF 288, I-CF 304, I-CF 230 et I-CF 303 sont retirés.
La commission rejette l’amendement I-CF 388.
La commission est saisie de l’amendement I-CF 177 de M. Patrice Carvalho.
M. Patrice Carvalho. Il s’agit de corriger une inégalité de traitement qui découle de l’application de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) aux déchets non dangereux réceptionnés dans les installations de stockage prévues à cet effet.
À cette fin, l’amendement tend à modifier l’article 266 nonies du code des douanes, sur le fondement d’une réserve d’interprétation émise par le Conseil constitutionnel le 17 septembre dernier, en réponse à une question prioritaire de constitutionnalité.
Aujourd’hui, les déchets susceptibles de produire du biogaz bénéficient de tarifs réduits de TGAP. Les mêmes installations recueillent des déchets non fermentescibles, c’est-à-dire non susceptibles de produire du biogaz ; pourtant, le même tarif leur est appliqué. En revanche, si ces déchets non fermentescibles sont réceptionnés dans une installation ne produisant pas de biogaz et destinée à les accueillir spécifiquement, un taux plus élevé de TGAP leur est appliqué, soit 30 euros la tonne au lieu de 14 dans le premier cas.
C’est à cette inégalité qu’il convient de remédier en distinguant ces déchets, comme le propose le Conseil constitutionnel. L’amendement tend, par conséquent, à créer un taux de TGAP spécifique aux déchets non fermentescibles, afin d’encourager l’enfouissement identifiable de ces déchets. En compensation, les tarifs de TGAP applicables aux installations les plus polluantes seraient relevés, pour inciter au recyclage et à la valorisation.
À l’heure actuelle, la mise en œuvre de la TGAP favorise ceux qui ne valorisent ni ne recyclent et pénalise ceux qui le font. Le coût de ce traitement vertueux des déchets est majoré de 30 euros la tonne : c’est catastrophique. On incite les collectivités à recourir à l’incinération, à rebours du sens de l’histoire.
Mme Valérie Rabault, Rapporteure générale. Si je comprends bien, vous proposez d’encourager fiscalement le stockage séparé des déchets non fermentescibles, non leur recyclage ?
M. Patrice Carvalho. Tout est recyclé. Dans ma commune, il y a cinq types de poubelles. Reste la poubelle grise dont le contenu va faire l’objet d’un traitement nouveau. Ce sont environ 20 % de la poubelle qui restent.
Mme la Rapporteure générale. Mais les déchets visés au A1, c’est-à-dire « stockés dans un casier destiné exclusivement au stockage de déchets insusceptibles de produire du biogaz », ne sont pas traités.
M. Patrice Carvalho. Les autres non plus, mais ils ne paient pas la TGAP !
Mme la Rapporteure générale. Quoi qu’il en soit, tel qu’il est rédigé, votre amendement présente un risque juridique. En effet, une seule installation bénéficierait du réaménagement tarifaire que vous proposez, sans que cette différence de traitement entre installations soit justifiée. On peut donc craindre que le Conseil constitutionnel n’y voie une rupture d’égalité devant les charges publiques.
M. Patrice Carvalho. C’est le régime actuel qui crée une inégalité de traitement.
Mme la Rapporteure générale. Actuellement, le tarif est le même pour tous les redevables valorisant leurs déchets sous forme de biogaz.
M. Patrice Carvalho. Non, dans la mesure où la TGAP applicable aux déchets enfouis est réduite.
Mme la Rapporteure générale. La loi prévoit actuellement une TGAP plus faible lorsqu’il existe un processus de transformation des déchets et non lorsqu’ils sont seulement stockés.
En outre, votre amendement pose un problème financier.
Je vous propose d’en rediscuter avec le ministère des finances, sans quoi le problème juridique que représente l’inégalité vis-à-vis des charges publiques ne pourra être surmonté.
M. Patrice Carvalho. Le Conseil constitutionnel a pourtant été clair.
Mme la Rapporteure générale. Je comprends que cet amendement vise à traiter un problème bien particulier. Je vous suggère de le retirer pour le redéposer en vue de la séance. D’ici là, nous aurons pu demander davantage de précisions aux services.
L’amendement I-CF 177 est retiré.
*
* *
Article additionnel après l’article 8
Élargissement de l’assiette de la taxe générale sur les activités polluantes dite « sanction » au gazole routier
La commission aborde l’amendement I-CF 383 de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire.
M. Jean-Yves Caullet, rapporteur pour avis de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire. Nous proposons d’étendre le régime de la TGAP dite « sanction » à tous les types de gazole, routier et non routier. En pratique, cette taxe sur le gazole non routier sera vouée à ne pas être payée puisque les distributeurs feront en sorte d’atteindre la proportion requise d’énergies renouvelables à incorporer dans les carburants.
Mme la Rapporteure générale. Sagesse.
La commission adopte l’amendement I-CF 383.
*
* *
Article additionnel après l’article 8
Extension de la taxe sur les transactions financières aux opérations intra-day
La commission examine ensuite, en discussion commune, les amendements identiques I-CF 152 de M. Pascal Cherki, I-CF 231 de M. Marc Goua, I-CF 284 de M. Jean-François Mancel et I-CF 381 de la commission du développement durable, et l’amendement I-CF 228 de M. Éric Alauzet.
M. Pascal Cherki. L’amendement I-CF 152 a pour objet d’étendre la taxe sur les transactions financières aux transactions dites intra-day, c’est-à-dire dénouées au cours d’une seule et même journée. Je ne discuterai pas de l’utilité de ces transactions, mais leur multiplication au cours des dernières années peut poser question.
La mesure permettra de dégager des recettes fiscales supplémentaires, notamment en vue de mieux financer la solidarité internationale. On est loin, en effet, d’atteindre l’objectif de 0,7 % du revenu national brut (RNB), partagé par la communauté internationale. Or, cet effort est aujourd’hui indispensable, comme le prouve le drame des migrants. Les associations actives dans ce secteur s’en inquiètent et le Président de la République lui-même s’est engagé à accroître l’aide publique au développement de 4 milliards d’euros d’ici à 2020.
Il faut donc trouver les moyens d’y parvenir ; cette taxe, supportée par le système bancaire, peut nous les fournir alors même qu’elle représente un effort minime. À cet égard, la France est malheureusement très en retard. Le Royaume-Uni, pour ne citer que lui, a déjà atteint l’objectif de 0,7 % du RNB.
La taxe devant aussi permettre de mieux lutter contre le changement climatique, ce petit effort serait bienvenu l’année où nous accueillons la conférence sur le climat, sachant qu’il n’est évidemment pas question de le faire peser sur le contribuable.
Je souhaite que la commission des finances manifeste clairement, au moins à ce stade de la discussion, l’importance qu’elle accorde au financement de la solidarité internationale.
M. Marc Goua. L’amendement I-CF 231 est identique. On sait que les transactions intra-day sont les plus spéculatives. Et que l’on ne nous oppose pas l’impossibilité de les détecter : les établissements bancaires savent très bien le faire.
M. le rapporteur pour avis de la commission du développement durable. L’amendement I-CF 381, présenté par notre collègue Bertrand Pancher, a été adopté à une très large majorité par la commission du développement durable, pour les mêmes raisons.
M. Jean-François Mancel. Mon amendement I-CF 284 est identique.
Je me réjouis que des députés d’horizons très différents aient tous déposé le même amendement : cela confirme son importance. Dès 2010, la suppression du trading à haute fréquence était proposée par la commission d’enquête présidée par Henri Emmanuelli et dont j’étais le rapporteur. Son rapport avait été adopté à l’unanimité par la commission d’enquête. La Commission européenne est également favorable à la taxation du trading à haute fréquence.
Par ailleurs, comme l’a très bien dit mon collègue Pascal Cherki, de manière peut-être un peu plus diplomatique, notre aide publique au développement s’effondre littéralement. Au rythme actuel, son montant sera réduit de 25 % sur la durée du quinquennat ! Il nous faut donc trouver des recettes dont cette taxe juste et équitable fait partie.
M. Éric Alauzet. L’amendement I-CF 228 a le même objet. Ces transactions très nombreuses en un temps extrêmement réduit n’ont aucun intérêt économique mais représentent un risque financier colossal, sans même parler d’éthique : cette pratique est insensée.
Mme la Rapporteure générale. Ces amendements soulèvent plusieurs problèmes.
D’abord, le fait générateur de la taxe sur les transactions financières est le règlement-livraison des titres. Or, la rédaction de l’amendement supprime le transfert de propriété auquel l’acquisition donne lieu. Cela ne revient-il pas à annuler la taxe sur les transactions financières dans sa forme actuelle ?
Ensuite, si au Royaume-Uni l’assiette de la taxe est plus large qu’en France, la taxe n’y est pas appliquée aux transactions intra-day. De fait, l’identification du détenteur du titre pose problème.
Rappelons, enfin, que le Gouvernement n’est pas favorable à la mesure. Évidemment, la commission des finances peut avoir son propre avis.
Quant à l’aide publique au développement, le présent projet de loi de finances prévoit que le produit de la taxe passera de 700 à 900 millions d’euros environ entre 2015 et 2016, ce qui revalorisera mécaniquement l’aide au développement si le même taux d’affectation est maintenu. En outre, des amendements tendent à accroître la fraction du produit de la taxe affectée à l’aide au développement en relevant son plafond.
Pour toutes ces raisons, je m’en remets à la sagesse de la commission.
M. le président Gilles Carrez. Lorsque nous avons créé la taxe sur les transactions financières, on pensait qu’elle serait rapidement généralisée, ce qui n’a pas été le cas. Elle n’a toujours pas été instaurée en Allemagne. Quant au stamp duty, s’il existe depuis longtemps, il ne s’applique pas aux transactions intra-day, comme l’a indiqué la Rapporteure générale.
L’extension de cette taxe, que nous sommes les seuls à appliquer, aura pour unique conséquence de transférer à Londres des centaines, voire des milliers d’emplois à forte valeur ajoutée ! Lorsqu’il ne consiste qu’à créer des mesures que personne ne veut reprendre, le prétendu exemple français nous coûte très cher. Quand il nuit aux intérêts du pays et à l’emploi, quand il déstabilise les rares secteurs dans lesquels nous sommes encore compétitifs, il y a lieu de s’interroger. La compagnie Air France, dont il a malheureusement beaucoup été question ces derniers jours, paie à elle seule le tiers de la taxe sur les billets d’avion, elle aussi affectée à l’aide au développement !
Je suis résolument défavorable à ces amendements.
M. Pascal Cherki. Je remercie la Rapporteure générale de son avis de sagesse. Je ne partage pas ses craintes ; toutefois, si celles-ci se révélaient fondées, le Gouvernement pourrait toujours proposer une rectification en séance. Le but est de créer un instrument efficace et le débat ne s’arrête pas au stade de l’examen en commission.
Quant à votre argument, monsieur le président, je l’entends, mais je vous sais trop fin connaisseur de la fiscalité et trop politique pour le reprendre entièrement à votre compte. À la moindre petite avancée, on nous objecte systématiquement que toutes les banques vont fermer et que la place boursière va s’écrouler ! Il n’est pas question d’interdire les transactions intra-day : elles continueront, puisque c’est d’elles que dépend la liquidité du marché financier. Il s’agit simplement d’opérer un prélèvement minime sur le flux sans qu’il soit besoin de rappeler l’histoire de la taxe Tobin.
Vous n’avez pas indiqué comment pourrions-nous financer l’aide publique au développement sans ce prélèvement. La France est membre du Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations unies, ce qui nous donne une responsabilité à l’échelle mondiale. Notre effort en matière de développement contribue à l’image de notre pays dans le monde. Nous ne pouvons pas nous permettre d’être encore en deçà de l’objectif de 0,7 % dans quelques années ! Il faut donc que nous dégagions des ressources ; or, les moyens de le faire ne sont pas infinis. Faut-il accroître substantiellement les crédits de l’aide publique au développement ? Mais nous nous accordons tous sur la nécessité de maîtriser les dépenses budgétaires. Dès lors, il est légitime de mettre raisonnablement à contribution l’un des principaux acteurs de la mondialisation, à savoir la finance.
Je remercie notre collègue Jean-François Mancel d’avoir rappelé que cette taxe suscitait le consensus de tous ceux qui ont réfléchi à la question, notamment les organisations non gouvernementales et les économistes. Des députés de tous horizons ont déposé le même amendement. La commission du développement durable l’a adopté.
Si la commission des finances le votait à son tour, nous verrions bien ce qu’en dira le Gouvernement. Nous ne sommes pas des irresponsables : si le Gouvernement nous oppose des éléments significatifs, nous aviserons. Mais nous devons montrer qu’il n’est pas question d’en rester là s’agissant du financement de l’aide publique au développement.
M. Dominique Baert. La taxation proposée relève du fantasme ; en outre, c’est une source potentielle de complications diplomatiques. En effet, la France a entrepris avec plusieurs pays européens de définir les frontières de la taxe sur les transactions financières. En votant ces amendements, nous donnerions l’impression de faire cavalier seul : l’effet serait déplorable.
Ensuite, il ne suffit pas de taxer des volumes considérables pour obtenir une masse financière considérable. En réalité, l’unique conséquence de cette taxation, si nous sommes seuls à l’appliquer, sera la disparition de la matière taxable, donc des recettes. Soyons donc très prudents.
Je vous invite à rejeter ces amendements.
M. Charles de Courson. Cela fait des années que l’on discute de cette affaire, avec beaucoup d’hypocrisie : tant que l’on ne sera pas parvenu à un accord international extrêmement large, l’échec est assuré. Pourquoi, en effet, la transaction aurait-elle lieu dans le seul pays qui applique la taxe ? Notre collègue Dominique Baert a parfaitement raison : on peut bien voter tout ce que l’on veut ; il n’y aura plus d’assiette ! Si donc l’objectif était de se procurer des recettes nouvelles, il ne sera pas atteint.
Quant à l’affectation de la taxe à l’aide au développement, c’est la vieille idée de M. Tobin, qui était tout sauf un gauchiste et qui a d’ailleurs dénoncé la manière dont son nom a été utilisé. Au demeurant, ce n’est pas grâce à l’aide internationale que les peuples se développent, mais grâce à leur bonne organisation.
Bref, nous pouvons toujours nous faire plaisir en votant cette disposition : elle n’aura aucun effet, sinon quelques conséquences négatives : au lieu de recettes supplémentaires, des recettes en moins ! Faisons plutôt un accord international – ça, c’est du sérieux –, comme nous y sommes finalement parvenus, au bout de vingt ans, en matière fiscale.
M. le président Gilles Carrez. En mars 2012, j’étais rapporteur général de la loi de finances rectificative qui instituait la taxe. À l’époque, le Gouvernement m’avait assuré que la taxe serait mise en œuvre dès la fin de l’année en Allemagne. Elle n’y est toujours pas appliquée aujourd’hui !
Mme Christine Pires Beaune. Il est ici proposé d’étendre l’assiette d’une taxe qui existe déjà. Mais sait-on si, depuis sa création en 2012, elle a entraîné un changement de comportement de la part des opérateurs ?
M. le président Gilles Carrez. Il est très difficile de répondre à cette question, car les transferts d’équipes financières sont totalement confidentiels : il faudrait pouvoir les suivre de l’intérieur. Mais on nous a parlé de transferts assez importants vers Londres.
M. Jean-François Mancel. Le 12 septembre dernier, la Commission européenne a confirmé qu’elle préparait une directive sur le sujet, et les onze États qui composent la coopération renforcée en la matière se sont mis d’accord pour que l’on instaure la taxe sur les transactions brutes. Ce n’est pas négligeable : nous n’avançons pas seuls dans cette affaire.
M. Charles de Courson. Vous oubliez le Royaume-Uni et quelques autres…
La commission adopte les amendements I-CF 152, I-CF 231, I-CF 284 et I-CF 381.
En conséquence, l’amendement I-CF 228 tombe.
*
* *
La commission aborde, en discussion commune, les amendements I-CF 56, I-CF 57 et I-CF 58 de M. Joël Giraud.
M. Joël Giraud. L’application de la taxe sur les transactions financières à l’échelle européenne, dotée d’une assiette large et d’un taux faible, est reportée au 1er janvier 2017 ; c’est regrettable compte tenu des enjeux. Elle reste toutefois à l’ordre du jour.
Dans l’intervalle, il paraît d’autant plus pertinent de relever le taux de notre stamp duty national à assiette restreinte que son rendement, dont on nous annonçait en 2013 qu’il atteindrait 1,5 milliard d’euros, plafonne à 700 millions d’euros.
Je propose donc de porter ce taux à 0,4 %, ce qui permettrait d’obtenir le rendement initialement annoncé. Nous serions encore très en deçà du taux appliqué au Royaume-Uni, qui aboutit à une collecte de 3 milliards de livres par an, sans, me semble-t-il, vider la place de Londres. À défaut, l’amendement de repli I-CF 57 tend à passer ce taux à 0,35 % et le I-CF 58 à 0,30 %.
Mme la Rapporteure générale. Je rappelle que le taux de la taxe sur les transactions financières a déjà été doublé en 2012, en loi de finances rectificative. En outre, dans la perspective d’une harmonisation au niveau européen, des questions subsistent quant à l’assiette de la taxe, même si son principe a fait l’objet du premier article du contrat de coalition entre la CDU et le SPD.
La France a déjà beaucoup œuvré en la matière. Je ne veux pas dire qu’elle ne devrait pas être en avance mais il nous faut aussi convaincre nos partenaires européens.
Je suis donc défavorable à ces amendements.
La commission rejette successivement les amendements I-CF 56 à I-CF 58.
Puis elle en vient à l’amendement I-CF 408 de la commission des affaires économiques.
M. François Pupponi, rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques. Cet amendement, cher à notre collègue Daniel Goldberg, tend à créer une contribution de solidarité urbaine applicable à toutes les cessions de biens immobiliers dont le prix de cession est supérieur à 10 000 euros par mètre carré.
A Paris, ces transactions représentaient un montant total de 260 millions d’euros en 2002 contre 4,8 milliards d’euros en 2012. Ces patrimoines de grande valeur pourraient avantageusement alimenter le Fonds national d’aides à la pierre auquel il est proposé d’affecter la nouvelle contribution.
Mme la Rapporteure générale. Nous avons examiné le même amendement l’année dernière. Je vous répondrai donc de nouveau que l’assiette proposée est probablement inconstitutionnelle. Supposons que le bien vendu ait auparavant été acheté 20 000 euros le mètre carré : s’il est revendu 10 000 euros le mètre carré, le vendeur sera assujetti à la taxe même s’il a réalisé une moins-value.
Je suis donc défavorable à cet amendement.
M. Charles de Courson. Quel est le but de cet amendement ? Apporter des recettes à la ville de Paris ou à celle de Nice ?
M. le rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques. Il vise davantage à abonder le Fonds national d’aides à la pierre, c’est-à-dire à soutenir la construction de logements en France.
M. Charles de Courson. À 9 900 euros le mètre carré on ne paierait rien, et, au-delà de 10 000 euros le mètre carré, on paierait 10 % de la différence entre le prix de vente et ce prix de référence ? Je n’en vois pas bien l’intérêt.
La commission rejette l’amendement I-CF 408.
*
* *
Article additionnel après l’article 8
Exclusion des véhicules mis gratuitement à la disposition des collectivités territoriales de l’assiette sur la taxe sur les véhicules de société
La commission est ensuite saisie des amendements identiques I-CF 156 de M. Romain Colas, I-CF 221 de M. Charles de Courson et I-CF 367 de M. Alain Fauré.
M. Romain Colas. L’amendement I-CF 156 tend à exclure de l’assiette de la taxe sur les véhicules des sociétés (TVS) ceux qui sont mis gratuitement à la disposition des collectivités locales.
L’administration fiscale, faisant une interprétation large de la notion d’« utilisateur des véhicules », a commencé à redresser certains opérateurs. Pourtant, ce sont des collectivités, elles-mêmes exclues du champ d’application de la TVS, qui les utilisent.
Bref, il s’agit de tenir compte de la réalité de la situation dans les territoires. En outre, l’assujettissement à la TVS casserait le modèle économique qui permet la mise à disposition gratuite de ces véhicules.
M. Charles de Courson. Mon amendement I-CF 221 est identique. J’ai découvert le problème grâce à des loueurs de véhicules. Il semble que la situation ne soit pas du tout homogène sur le territoire français : l’administration ne soulève le problème que dans certains départements. Or la République est une !
M. Alain Fauré. J’ajouterai, pour défendre mon amendement I-CF 367, qu’à ce jour les redressements n’ont donné lieu à aucune rentrée fiscale puisqu’une seule société a été taxée et qu’elle forme des recours incessants depuis. Et c’est pour cela que l’on met en péril cette fragile activité, qui ne concerne que quelques sociétés mais rend de grands services aux communes, par exemple pour les déplacements sportifs ou les transports vers les cantines.
Mme la Rapporteure générale. Je l’avoue, c’est en découvrant que des amendements avaient été déposés par tous les groupes que j’ai pris conscience du fait qu’il y avait un problème.
M. Dominique Lefebvre. Ou un lobbying efficace !
Mme la Rapporteure générale. Je n’osais le dire !
Je me propose de m’en remettre à la sagesse de la commission en attendant d’avoir pu étudier ce problème avec le ministère des finances, auquel je l’ai déjà signalé.
M. Alain Fauré. Il y va de 6 millions d’euros jamais encaissés et qui font l’objet d’incessants recours !
La commission adopte les amendements I-CF 156, I-CF 221 et I-CF 367.
Puis elle examine l’amendement I-CF 306 de M. Denis Baupin.
M. Éric Alauzet. Cet amendement propose d’augmenter la taxe sur les véhicules des sociétés lorsque ceux-ci fonctionnent au gazole, et ce d’autant plus que les véhicules sont plus anciens. Actuellement, ces véhicules sont choisis en priorité ; il s’agit donc de modifier les habitudes au profit des véhicules à essence.
Mme la Rapporteure générale. Cet amendement a déjà été présenté dans le cadre du projet de loi de finances pour 2015. Je ne reviens pas sur notre débat d’alors, non plus que sur la discussion que nous avons eue plus tôt à ce sujet.
Avis défavorable.
La commission rejette l’amendement I-CF 306.
Puis elle est saisie de l’amendement I-CF 318 de Mme Eva Sas.
M. Éric Alauzet. Ce sont des considérations liées au dérèglement climatique qui ont conduit à accorder un avantage aux véhicules diesel, mais il faut cesser de négliger la question sanitaire, et notamment celle des rejets d’oxydes d’azote (NOx). Aujourd’hui, le bonus accordé aux véhicules diesel peut laisser croire à un acheteur candide qu’il fait une bonne action – mais il n’y a pas que l’effet de serre, il y a aussi la santé ! Cet amendement propose donc un malus NOx qui, pour ces véhicules, compenserait l’avantage donné par le bonus carbone.
Mme la Rapporteure générale. Malheureusement, nous ne savons pas mesurer les NOx de manière fiable. Avis défavorable.
M. Éric Alauzet. Les Américains, eux, savent !
Mme la Rapporteure générale. Vous avez raison, j’aurais dû dire : les Européens ne savent pas, aujourd’hui, le mesurer de façon fiable. Mais, une nouvelle réglementation européenne sur les émissions polluantes est prévue pour 2017.
La commission rejette l’amendement I-CF 318.
*
* *
Article 9
Financement de l’augmentation de la capacité de soutien aux collectivités territoriales et aux établissements publics de santé ayant contracté des « emprunts toxiques »
Les emprunts à risque dits « structurés » combinent dans un même contrat un prêt bancaire classique dont le taux d’intérêt varie au fil du temps avec plusieurs paramètres de marché (taux de change, différentiel entre un taux long et un taux court, écart de valeur entre deux indices d’inflation).
Du fait de l’évolution des paramètres de marché, certains prêts ont vu leur taux d’intérêt multiplié par dix ou quinze, ce qui a fait grimper les charges financières des collectivités locales les ayant souscrits.
Cette situation a amené deux difficultés :
– éviter que les collectivités locales et les hôpitaux concernés ne deviennent asphyxiés avec des charges financières exponentielles. Pour y répondre, un fonds de soutien a été créé et la SFIL a été créée le 1er février 2013 pour, entre autres, assurer aux collectivités locales concernées, un refinancement de leurs prêts les plus « toxiques ». L’objet du présent article est d’augmenter le montant total du fonds de soutien de 1,5 milliard à 3 milliards, via une augmentation de la taxe pour le financement du fonds de soutien aux collectivités territoriales, prévue par l’article 235 ter ZE bis du code général des impôts (CGI).
– déboucler les prêts les plus « toxiques » dans des conditions financières acceptables. Les dispositions pratiques concernant ce second point sont pour l’heure toujours en discussion.
Crédits structurés ou toxiques : de quoi parle-t-on ?
Les crédits « structurés » sont constitués par la combinaison d’un prêt et d’un ou plusieurs instruments financiers. Parmi ces crédits structurés, on trouve différents produits :
– les produits structurés à barrière : crédits dont le taux demeure fixe et inférieur aux taux fixes classiques, tant que le taux de référence (l’Euribor) ou l’Indice sous-jacent (écart de valeur entre deux indices d’inflation ou entre deux monnaies par exemple) ne dépasse pas une barrière consistant en un taux déterminé ;
– les produits de pente : produits dont le taux est fonction d’une fourchette de variation entre les taux courts et les taux longs ;
– les produits de courbe : produits dont le taux est déterminé par l’écart entre deux indices exprimés dans des devises différentes et/ou sur des marchés distincts sans avoir nécessairement la même maturité ;
– les produits à effet de structure cumulatif (« snow-ball ») : produits présentant un effet cliquet dans la mesure où le taux payé à chaque échéance est déterminé sur la base d’une incrémentation cumulative par rapport au taux de la ou des échéances précédentes, qui servent ainsi de base pour la détermination des taux suivants, de telle sorte que le taux supporté ne peut qu’augmenter ou se stabiliser.
La notion de crédits « sensibles » désigne certains crédits structurés dont la formule de taux présente un risque particulier ou des crédits libellés ou Indexés sur des monnaies étrangères classés hors de la Charte « Gissler ». Les crédits structurés sensibles sont des crédits dont le taux calculé dépend de références éloignées de celles usuellement employées par les emprunteurs publics français (un cours de change. un écart entre deux Indices de taux. un français l’autre étranger) et selon une formule de calcul comportant, dans la plupart des cas, des barrières et des effets de levier.
Adoptée le 7 décembre 2009, la charte de bonne conduite dite « Charte Gissler », prévoit que les banques ne commercialisent plus que des produits correspondant à la typologie suivante :
Indices-sous-jacents |
Structures | ||
1 |
Indices zones euros |
À |
– Échange de taux fixe contre taux variable ou inversement – Échange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique) – Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) |
2 |
Indices inflation française ou inflation Zone euro ou écart entre ces indices |
B |
Barrière simple sans effet de levier |
3 |
Écarts d’indices Zone euro |
C |
Option d’échange (swpation) |
4 |
– Indices hors Zone euro – Écart d’indice dont l’un est un indice hors zone euro |
D |
– Multiplicateur jusqu’à 3 – Multiplicateur jusqu’à 5 et taux plafonné |
5 |
Écart d’indices hors Zone euro |
E |
Multiplicateur jusqu’à 5 |
Source : mission IGF-IGAS. | |||
Toutefois, des prêts ne répondant pas à ces critères ont été commercialisés par les banques avant l’entrée en vigueur de ladite charte (au plus tard le 1er janvier 2010). Ils sont qualifiés de prêts « hors charte » et recouvrent les produits financiers :
– qui comportent un risque de change pour les emprunteurs qui n’ont pas de ressources dans la devise d’exposition ;
– dont les taux évoluent en fonction d’index tels que les indices relatifs aux matières premières, aux marchés d’actions ;
– dont les taux évoluent par une référence à la valeur relative de devises ;
– dont la première phase de bonification d’intérêt est supérieure à 35 % du taux fixe équivalent ou de l’Euribor à la date de proposition et d’une durée supérieure à 15 % de la maturité totale ;
– qui ont des effets de structure cumulatifs ou qui présentent un risque sur le capital.
Sources : mission IGF-IGAS, Évaluation du financement et du pilotage de l’investissement hospitalier n° RM2013-032P, mars 2013 ; Mission d’évaluation et de contrôle des lois de financement de la sécurité sociale, Rapport d’information : l’hôpital public malade de sa dette ?, Assemblée nationale, XIVe législature, n° 2944, juillet 2015.
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rap-info/i2944.asp#P1718_345830.
On pourra se référer également, pour une typologie plus complète, au rapport de la commission d’enquête de l’Assemblée nationale créée sous la précédente législature relative aux produits financiers à risque souscrits par les acteurs publics locaux, présenté le 6 décembre 2011 (87).
I. L’ÉTAT DU DROIT
A. LA CRÉATION DU FONDS DE SOUTIEN AUX COLLECTIVITÉS AYANT SOUSCRIT DES EMPRUNTS STRUCTURÉS
L’article 92 de la loi du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 (88) a créé un fonds de soutien destiné à aider les collectivités territoriales ayant souscrit des emprunts structurés avant l’entrée en vigueur de cette loi.
Le fonds de soutien peut bénéficier à l’ensemble des collectivités territoriales, à leurs groupements, aux établissements publics locaux (EPL) et aux services départementaux d’incendie et de secours (SDIS) ayant souscrit certains emprunts structurés et instruments financiers, à condition qu’ils en aient fait la demande avant le 30 avril 2015.
L’aide du fonds est calculée par référence à l’indemnité de remboursement anticipée (IRA) due au titre de ces emprunts, allégeant d’autant le coût associé à leur remboursement anticipé. Les assemblées parlementaires et les collectivités territoriales sont associées au comité national d’orientation et de suivi (CNOS) du fonds de soutien.
L’article 92 de la loi du 29 décembre 2013 précitée prévoit de doter le fonds de 1,5 milliard d’euros à terme, à raison de 100 millions d’euros par an pour une durée maximale de quinze ans. Ce montant a été calibré de façon à correspondre à 45 % des IRA des emprunts structurés les plus sensibles, estimées au moment du projet de loi de finances pour 2014 à 3,4 milliards d’euros par le Gouvernement.
L’article 111 de la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) (89) a relevé à 75 % le plafond du taux de prise en charge par le fonds. Il a également prolongé le délai de dépôt des demandes d’aide du 15 mars au 30 avril 2015. Une contrepartie est imposée aux collectivités sollicitant l’aide du fonds : le bénéfice de l’aide au titre d’un contrat de prêt souscrit auprès d’un établissement de crédit est subordonné à la conclusion d’une transaction, au sens de l’article 2044 du code civil. Une collectivité sollicitant une subvention pour un emprunt structuré doit ainsi, pour bénéficier de l’aide, renoncer à contester devant les juridictions civiles les contrats de prêt conclus avec cette banque, dès lors qu’ils font effectivement l’objet du versement d’une aide par le fonds de soutien.
B. LA TAXE POUR LE FINANCEMENT DU FONDS DE SOUTIEN AUX COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
Afin de faire participer les banques à la résolution d’un problème qu’elles ont en partie créé en commercialisant, pour certaines, les « emprunts toxiques », ce fonds a été initialement financé pour plus de moitié, par le secteur bancaire, à travers deux mécanismes :
– d’une part, l’article 35 de la loi du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 a relevé le taux de la taxe sur les risques systémiques (TRS), afin d’alimenter le fonds à hauteur de 50 millions d’euros par an ;
– d’autre part, Dexia et la SFIL, qui détiennent toujours la majeure partie du stock d’emprunts toxiques, contribuent au total à hauteur de 150 millions pour la SFIL et de 37,5 millions d’euros pour Dexia (22,5 millions via une « contribution volontaire » et 15 millions via la taxe systémique).
L’État apporte le solde.
La taxe pour le financement du fonds de soutien aux collectivités territoriales, dont les modalités sont codifiées à l’article 235 ter ZE bis du code général des impôts, a été instituée par l’article 26 de la loi du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 (90). Elle s’est substituée à la TRS à compter du 1er janvier 2015. La durée de vie du fonds étant limitée à quinze ans, l’abrogation de l’article 235 ter ZE bis est prévue à compter du 1er janvier 2029.
L’assiette de la taxe, qui n’a pas été modifiée, est constituée par les exigences minimales en fonds propres permettant d’assurer le respect des ratios de couverture ou du niveau de fonds propres adéquat prévus par la réglementation prudentielle. Cette assiette est la même que celle de la contribution pour frais de contrôle. Elle peut être révisée par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR). Le taux a été fixé à 0,026 %.
La taxe est due par dix-sept banques relevant de la compétence de l’ACPR, soumises à des exigences minimales en fonds propres égales ou supérieures à 500 millions d’euros et qui représentent 96 % des exigences en capitaux propres du secteur. La taxe n’est pas déductible de l’impôt sur les sociétés.
C. LE DISPOSITIF D’ACCOMPAGNEMENT DES HÔPITAUX
Le 23 avril 2014, le Gouvernement a annoncé la mise en place d’un dispositif ad hoc d’accompagnement des hôpitaux les plus exposés aux emprunts structurés, les emprunts toxiques représentant, pour ces derniers, un encours de 1,1 milliard d’euros, soit 4 % de leur encours total, au 31 décembre 2012. Les IRA correspondant à ces prêts s’élevaient, quant à elles, à 1,4 milliard d’euros.
Le montant des aides accordées dans le cadre de ce nouveau dispositif d’accompagnement devait atteindre 100 millions d’euros pour une durée de trois ans, soit un calibrage comparable à celui du fonds de soutien des collectivités territoriales proportionnellement au montant relatif des encours toxiques. Ce dispositif était financé par un abondement volontaire des banques les plus concernées – SFIL et Dexia – à hauteur de 25 millions d’euros et pour les trois autres quarts par l’objectif national des dépenses d’assurance maladie (ONDAM), à hauteur de 75 millions d’euros.
Les aides accordées abondent les fonds d’intervention régionaux (FIR) par des crédits nationaux délégués aux agences régionales de santé (ARS).
D’abord destiné aux établissements publics de santé (EPS) ayant un budget inférieur à 100 millions d’euros et ayant au moins un contrat de prêt classé hors charte en cours d’amortissement fin 2014, le dispositif a ensuite été élargi aux EPS dont le produit est compris entre 100 et 200 millions d’euros.
La doctrine d’attribution est proche de celle du fonds de soutien aux collectivités territoriales. Les aides versées sont ciblées sur les établissements les plus exposés, c’est-à-dire des hôpitaux locaux, de petite taille, dont les emprunts risqués forment une part importante de leur encours et pour lesquels les coûts de sortie du prêt sont hors d’atteinte de leur budget. L’attribution des aides est conditionnée à une transaction globale sur l’ensemble des prêts souscrits et à la renonciation à tout recours contentieux. Le montant des aides versé à chaque établissement était initialement plafonné à 45 % des IRA. Comme pour les collectivités, ce plafond a été relevé à 75 %.
D. LA VALIDATION LÉGISLATIVE DE CERTAINS CONTRATS STRUCTURÉS FAISANT L’OBJET DE CONTENTIEUX
La loi du 29 juillet 2014 relative à la sécurisation des contrats de prêts structurés souscrits par les personnes morales de droit public (91) a validé certains contrats de prêts pour les mettre à l’abri d’une annulation par le juge civil, prenant en compte la censure, par le Conseil constitutionnel, de premières dispositions en ce sens proposées par la loi du 29 décembre 2013 précitée.
Une confirmation de jugement du tribunal de grande instance de Nanterre des 8 février 2013 et 7 mars 2014 aurait fait peser un risque considérable sur les finances publiques. Sans validation de l’absence ou de l’erreur de taux effectif global (TEG) et de taux de période et/ou durée de période, le risque financier maximum pour l’État était estimé à 17 milliards d’euros, dont 9 milliards d’euros se seraient matérialisés dès la fin 2014 ou le début 2015. Sur ce total, 7 milliards d’euros correspondaient au risque indirect lié au coût de la mise en extinction de la SFIL, laquelle devenait probable si de telles pertes s’étaient matérialisées.
L’État étant respectivement actionnaire à 75 % et 44 % de la SFIL et Dexia, la sécurisation des contrats de prêts répondait à un motif impérieux d’intérêt général.
II. LE CONTEXTE ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET BUDGÉTAIRE
A. L’ENDETTEMENT DES COLLECTIVITÉS
Selon l’Observatoire des finances locales, l’encours de dette des collectivités a atteint 141,5 milliards d’euros en 2014, en hausse de 3 %. La dette des départements et surtout celle des régions progressent plus rapidement que celle du secteur communal (+ 1,3 %), qui représente 60,8 % de l’encours total. Le taux d’endettement, mesuré par le ratio dette/recettes de fonctionnement atteint 73,2 % en 2014 pour l’ensemble des collectivités. Il est particulièrement élevé pour le secteur communal (82,1 %) et pour les régions (97,1 %).
Toutefois, le flux net de dette a diminué entre 2013 et 2014 : les emprunts nouveaux contractés en 2014, à hauteur de 16,2 milliards d’euros, enregistrent un recul de 3,9 % sur un an.
En l’absence de données précises sur l’encourt total d’emprunts toxiques dans la dette des collectivités, il est possible de se référer aux données figurant dans le rapport n° 2093 présenté au nom de la commission des finances par M. Christophe Castaner, sur le projet de loi relatif à la sécurisation des contrats de prêts structurés souscrits par les personnes morales de droit public, le 2 juillet 2014 (92).
ENCOURS DES EMPRUNTS STRUCTURÉS EN 2013 (SFIL UNIQUEMENT)
(en millions d’euros)
Collectivité |
Tous emprunts sensibles (S1, S2, S3, S4, S5 (1)) |
Emprunts très sensibles (S1, S2, S3) | ||||
Capital restant dû |
Indemnité de remboursement anticipé |
Nombre |
Capital restant dû |
Indemnité de remboursement anticipé |
Nombre | |
Communes de <10 000 habitants |
627 |
514 |
181 |
237 |
386 |
74 |
Communes de >10 000 habitants |
2 728 |
1 642 |
296 |
1 264 |
1 213 |
149 |
EPCI <10 000 habitants |
30 |
24 |
8 |
13 |
15 |
3 |
EPCI >10 000 habitants |
773 |
487 |
91 |
339 |
370 |
42 |
Départements |
1 303 |
849 |
32 |
790 |
722 |
19 |
Régions |
345 |
227 |
8 |
208 |
194 |
7 |
Total collectivités |
5 807 |
3 743 |
616 |
2 851 |
2 901 |
294 |
(dont -10 000 habitants) |
657 |
538 |
189 |
250 |
401 |
77 |
Autres groupements |
756 |
589 |
71 |
427 |
496 |
38 |
Établissements publics de santé |
1 254 |
869 |
132 |
611 |
688 |
52 |
Organismes du logement social |
465 |
192 |
40 |
104 |
95 |
10 |
Total |
8 282 |
5 392 |
859 |
3 993 |
4 180 |
394 |
(1) Le périmètre des emprunts très sensibles correspond aux catégories S1, S2 et S3 de la SFIL. Il comprend les emprunts hors charte Gissler et les emprunts classés 3E, 4E et 5E, dont la composante optionnelle est activée. | ||||||
Source : Rapport sur le projet de loi relatif à la sécurisation des contrats de prêts structurés souscrits par les personnes morales de droit public, Assemblée nationale, XIVe législature, n° 2093, 2 juillet 2014. | ||||||
Au 30 avril 2015, 676 collectivités ont déposé au moins une demande d’aide auprès du fonds de soutien pour un prêt éligible, sur un total d’environ 850 collectivités concernées, soit 80 % d’entre elles. Deux tiers sont des communes, dont 40 % comptent moins de 10 000 habitants.
RÉPARTITION DES COLLECTIVITÉS AYANT DÉPOSÉ
UNE DEMANDE D’AIDE AU FONDS DE SOUTIEN
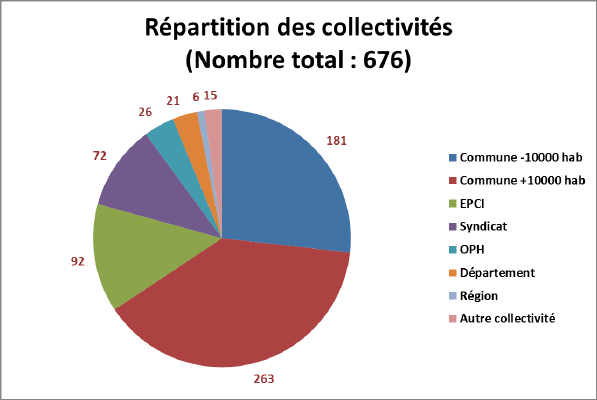
Source : ministère des finances et des comptes publics.
B. L’ENDETTEMENT DES HÔPITAUX
De 2003 à 2012, la dette hospitalière a triplé, passant de 9,8 milliards d’euros courants à 29,3 milliards. Elle a encore progressé d’un milliard d’euros en 2013. Partant du constat d’un retard d’investissements dans le secteur hospitalier, les pouvoirs publics ont mis en place deux plans d’investissement ambitieux : Hôpital 2007 et Hôpital 2012, dont l’ampleur et les modalités de financement ont conduit à un accroissement important de l’endettement des établissements publics de santé. Pour les hôpitaux publics, le financement reposait quasi exclusivement sur des dettes contractées auprès du secteur bancaire classique à des taux d’intérêt supérieurs d’environ 1 % à ceux de la dette de l’État. Leur durée de vie résiduelle est encore aujourd’hui de dix-huit ans. Pour profiter de taux apparemment attractifs, les établissements de santé ont souscrit massivement des emprunts structurés que l’on a qualifiés ultérieurement de toxiques.
La mission d’évaluation et de contrôle des lois de financement de la sécurité sociale de l’Assemblée nationale (MECSS) a publié le 8 juillet 2015 un rapport d’information sur la dette des établissements publics de santé, présenté par Mme Gisèle Biémouret (93). Selon la MECSS, les emprunts à risque élevé représentent 2,5 milliards d’euros, soit 9 % de l’encours total des dettes hospitalières. « Les emprunts particulièrement délétères représentent pour leur part environ un milliard d’euros, soit 4 % des encours. Selon les données de la Société de financement local (SFIL), qui a repris à Dexia son portefeuille d’emprunts, les hôpitaux connaissent un niveau de risque équivalent à celui des collectivités locales : 34 % des encours des établissements publics de santé auprès de la SFIL correspondent à des emprunts structurés, contre 35 % pour les collectivités locales. Ces emprunts structurés représentent donc une part importante de l’encours de la dette hospitalière, et sont d’autant plus dangereux qu’ils sont concentrés sur un nombre limité d’établissements. »
LA MECSS évalue le coût de sortie des emprunts structurés – soit le rachat des options liées à ces emprunts toxiques – en cas de remboursement anticipé, à une dépense de l’ordre de 1,5 milliard d’euros.
Fin 2013, 84,3 % de l’encours de dette était composé de prêts dits non structurés (classé 1A dans la matrice de risque « Gissler »), soit environ 24,5 milliards d’euros.
Parmi les emprunts structurés (soit 15,7 % de l’encours de dette), le niveau de risque de taux varie selon la nature du contrat de prêt et la formule d’indexation du taux. Les emprunts structurés dits hors charte, les plus risqués, représenteraient presque 1 milliard d’euros, soit 3,4 % de l’encours. Les prêts structurés très sensibles mais conformes à la « charte Gissler » (cotés 3E, 4E et 5E) représenteraient 2,7 % de l’encours soit environ 800 millions d’euros. Enfin, les autres emprunts structurés, dits moins sensibles, représenteraient 9,7 % de l’encours soit 2,7 milliards d’euros.
La MECSS décrit comme suit la diminution progressive du niveau de risque des emprunts :
« – l’encours des emprunts non structurés (1A : non risqués) a augmenté de + 4,4 %, passant de 20,9 milliards d’euros en 2012 (81,7 % des encours) à 21,8 milliards d’euros en 2013 (84,0 %) ;
« – en parallèle, l’encours des emprunts structurés (autres catégories de risque : de faible à très élevé) a diminué de 11,1 %, passant de 4,7 milliards d’euros en 2012 (18,3 %) à 4,2 milliards d’euros en 2013 (16,0 %). En particulier l’encours des emprunts structurés à risque très élevé (6F, dits « hors charte ») a diminué de 5,0 %, passant de 906 millions d’euros en 2012 (3,5 %) à 861 millions d’euros en 2013 (3,3 %). »
C. L’IMPACT DE L’ÉVOLUTION DU COURS DU FRANC SUISSE
La décision de la Banque nationale suisse, en janvier 2015, de laisser s’apprécier la devise helvétique, a eu de lourdes conséquences pour les collectivités et les EPS.
L’exemple de contrat HELVETIX, cité dans le rapport de la commission d’enquête de l’Assemblée nationale sur les produits financiers à risque souscrits par les acteurs publics locaux en décembre 2011 (94), permet d’illustrer l’exposition de certains de ces contrats structurés au risque de change.
Quelques exemples d’emprunts structurés
Les emprunts structurés combinent, de manière étroite, trois catégories de produits : les swaps, les contrats d’option et les contrats à terme
● Les contrats d’option par lesquels une partie accorde à une autre le droit (mais non l’obligation) de lui acheter ou de lui vendre un actif, durant une période ou à une date précise, moyennant le versement d’une prime ; grâce à ces instruments – le plus simple est le cap qui permet de faire face à une hausse excessive des taux – l’acquéreur peut se couvrir de manière conditionnelle contre un risque.
Ce sont les produits dans lesquels la formule correspondant au taux d’intérêt est construite avec une condition – ils se reconnaissent aisément par la présence de la conjonction « si » dans les contrats.
Comme leurs concurrents, les caisses d’épargne ont également commercialisé un contrat-type HELVETIX dont les annuités reposaient, après une phase bonifiée (quatre années au taux fixe de 2,74 %, dans le cas du contrat souscrit par Melun en 2007), sur la formule suivante :
– si la parité entre l’euro et le franc suisse est supérieure ou égale à 1,44 alors le taux d’intérêt applicable sera un taux fixe de 2,74 % ;
– sinon, le taux d’intérêt est égal à [2,74 % + 0,6 × (EUR/CHF au jour de souscription – EUR/CHF)/(EUR/CHF)].
De tels contrats, basés sur des indices hors zone euro, sont exclus de la « charte Gissler » (classés « hors charte » ou 6F).
Source : commission d’enquête sur les produits financiers à risque souscrits par les acteurs publics locaux, Assemblée nationale, décembre 2011.
Certaines collectivités se trouvent fragilisées, avec parfois un doublement de leurs IRA.
Il est fait état, dans le rapport précité de la MECSS, de la forte volatilité des indemnités de remboursement anticipé, illustrée par l’exemple de l’hôpital du Nord-Essonne, dont la situation financière est profondément affectée par des emprunts structurés à hauteur de 12,8 millions d’euros de capital, indexés sur le taux de change euro-franc suisse jusqu’en 2038. Le taux d’intérêt annuel recalculé sur la base des nouveaux taux de change a doublé, passant de 13 % à 26 %, impliquant un coût annuel pour l’hôpital de l’ordre de 2,6 millions d’euros, soit 10 % du chiffre d’affaires de l’établissement. L’indemnité de remboursement anticipée qui avait été estimée à l’automne 2014 à hauteur de 21 millions d’euros s’élèverait désormais, selon un chiffrage de l’établissement, à 35 millions d’euros, soit une hausse du montant de la soulte de 66 %.
Le Gouvernement a annoncé, le 24 février 2015, le doublement des capacités d’intervention du fonds de soutien, évoquant des ressources supplémentaires d’un montant de 1,5 milliard d’euros sur quinze ans, apportées pour moitié par l’État et pour moitié par les banques et établissements financiers.
Après s’être fortement apprécié, le taux de change évolue à nouveau dans un sens moins défavorable aux collectivités et aux établissements publics de santé. La décision du Gouvernement de doubler le montant du fonds, a été prise sur le fondement des encours au 28 février 2015.
Pour les mêmes raisons, le Gouvernement a décidé d’augmenter la capacité du dispositif dédié aux établissements de santé, prévoyant 300 millions d’euros supplémentaires sur dix ans pour le soutien aux hôpitaux. Ce montant doit être intégralement financé par les banques, sans nouvelle contrainte sur l’ONDAM.
Les surcoûts liés à l’appréciation du franc suisse ont été estimés entre 200 et 400 millions d’euros pour les hôpitaux.
Plus d’un tiers des prêts structurés souscrits par les collectivités ayant déposé une demande d’aide sont impactés par la parité du franc suisse vis-à-vis de l’euro ou du dollar.
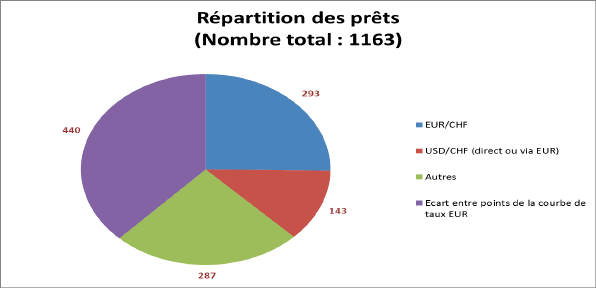
Source : ministère des finances et des comptes publics.
III. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
A. LE DOUBLEMENT DU MONTANT DU FONDS
L’alinéa 1er (I) du présent article propose de doubler le montant annuel du fonds de soutien destinés aux collectivités territoriales et à leurs groupements, en le portant de 100 à 200 millions d’euros, sans modifier la durée maximale du fonds, fixée à quinze ans.
B. LA HAUSSE DU TAUX DE LA TAXE
L’alinéa 2 (II) porte le taux de la taxe pour le financement du fonds de soutien aux collectivités territoriales, actuellement fixé à 0,026 %, à 0,0642 % pour les années 2016 à 2025 et à 0,0505 % pour les années 2026 à 2028.
La hausse du taux doit permettre, en 2016, un rendement supplémentaire de 50 millions d’euros (croissant jusqu’en 2028) pour le fonds de soutien aux collectivités territoriales et de 28 millions d’euros affectés à la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés (CNAM-TS) au profit des établissements publics de santé de 2016 à 2025, date du terme de la période d’aide pour ces établissements.
Ce produit permettra d’augmenter le soutien financier aux collectivités et aux établissements publics de santé ayant contracté des emprunts structurés affectés par l’évolution de la parité entre le franc suisse et l’euro ou le dollar, tant par la hausse des échéances d’intérêt 2015 que par la hausse potentielle des IRA. Les contrats de prêts à taux fixe en francs suisse ne sont pas éligibles.
Le produit de la hausse de taux prévu par le présent article s’élève, pour le fonds de soutien, à 790 millions d’euros sur treize ans.
RENDEMENT DE LA MESURE
(en millions d’euros)
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 | |
Rendement au taux de 0,0642 % Rendement au taux de 0,0505 % |
78 |
80 |
82 |
84 |
86 |
88 |
90 |
93 |
95 |
97 |
64 |
66 |
67 |
dont rendement collectivité |
50 |
52 |
54 |
56 |
58 |
60 |
62 |
65 |
67 |
69 |
64 |
66 |
67 |
dont rendement CNAMTS |
28 |
28 |
28 |
28 |
28 |
28 |
28 |
28 |
28 |
28 |
|||
Source : évaluation préalable. | |||||||||||||
Dans le rapport de la MECSS précité, la Rapporteure, notre collègue Gisèle Biémouret, indiquait que la dotation de 300 millions d’euros risquait d’être insuffisante, appelant à revoir peut-être la clé de répartition des contributeurs entre la profession bancaire, l’assurance maladie et les hôpitaux, qui seront eux aussi soumis à d’importants efforts financiers pour réussir leur désensibilisation.
IV. L’IMPACT ÉCONOMIQUE ET BUDGÉTAIRE
A. POUR LES COLLECTIVITÉS
1. Crédits du fonds de soutien votés en lois de finances
La contribution de l’État au fonds de soutien est inscrite au programme 344 Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats financiers structurés à risque de la mission Engagements financiers de l’État.
1,5 milliard d’euros en autorisations d’engagement a été consommé en 2015, dont 61,5 millions d’euros reportés de 2014. 1,5 milliard d’euro supplémentaire devrait être inscrit dans le projet de loi de finances rectificative pour 2015 et reporté pour consommation en 2016. Le fonds dispose en 2015 et devrait disposer en 2016 de crédits de paiement et autres moyens de paiement répartis comme suit, pour un total de 278 millions d’euros :
– 43,5 millions d’euros provenant du fonds de soutien antérieur ;
– 50 millions d’euros de crédits inscrits en loi de finances pour 2014 et reportés sur 2015 ;
– 50 millions d’euros de crédits inscrits en loi de finances pour 2015 ;
– 100 millions d’euros de crédits inscrits dans le présent projet de loi de finances ;
– 34,5 millions d’euros de fonds de concours SFIL et Dexia (11,5 millions d’euros pour chacune des années 2014, 2015 et 2016).
2. Calendrier de notification des aides aux collectivités
L’instruction individuelle des dossiers des 676 collectivités et établissements ayant déposé une demande d’aide est achevée depuis la mi-septembre 2015.
Il est procédé aux notifications d’aides principalement en fonction des dates de dépôt des demandes d’aides en préfecture. Les caractéristiques des emprunts pourront être prises en compte, à titre secondaire, (sensibilité aux variations de la parité du franc suisse prioritaire, vulnérabilité de la situation financière du demandeur, notamment pour les communes de petite taille, situations particulières tenant par exemple à la mise en place de nouvelles modalités d’organisation territoriale).
Certaines collectivités, cherchant à renégocier des prêts, souhaiteraient que le taux d’usure applicable aux nouveaux emprunts soit celui qui était applicable lorsque l’emprunt toxique a été consenti. Le taux d’usure est actuellement de 3,5 % tandis qu’il était alors de 6 à 7%. Au prix d’une charge d’intérêt plus importante, le volume de dette les collectivités peut être réduit.
Les notifications seront étalées dans le temps sur une durée maximale de six mois pour faciliter l’exécution des opérations financières organisant le refinancement des prêts concernés (soit en moyenne 400 à 500 millions d’euros par mois), car seule une minorité de bénéficiaires potentiels (de 25 à 30 % environ) semble, à ce jour, avoir procédé au remboursement anticipé de ses prêts à risque.
Depuis le 1er janvier 2014, toute collectivité ou établissement éligible au fonds de soutien peut à tout moment, et sans perdre aucun de ses droits à l’aide, procéder, en accord avec la banque prêteuse, au remboursement d’un ou plusieurs prêts à risque et à leur refinancement, se protégeant ainsi contre toute dégradation ultérieure de l’IRA. Cette opération est sans incidence sur le taux d’aide, qui est calculé sur la valeur validée de l’IRA au 28 février 2015, ni sur les modalités de calcul de l’aide finale. Au moins 25 % des bénéficiaires du fonds de soutien ont d’ores et déjà procédé au refinancement de leurs emprunts à risque.
Les premières notifications d’aide sont intervenues le 21 septembre 2015 et se poursuivront jusqu’au premier trimestre 2016. Elles proposent la prise en charge d’une part (en moyenne d’environ 50 % mais pouvant aller jusqu’à 75 %) de l’IRA.
B. POUR LES HÔPITAUX
Le Gouvernement a demandé aux établissements d’abandonner la voie contentieuse pour résoudre le problème du désengagement des emprunts toxiques. Une vingtaine de contentieux seraient toutefois menés par les établissements de santé. Fin octobre 2014, la SFIL avait reçu douze assignations de la part d’hôpitaux, de taille très variable. Fin juin 2015, aucun des contentieux conduits par un établissement public de santé n’avait fait l’objet d’un jugement définitif.
Jusqu’à fin 2014, la SFIL a accordé des abandons de créance aux petits hôpitaux, de manière à ramener leur taux d’intérêt payé à un niveau soutenable (6 à 8 %) en attendant la mise en place du dispositif d’aide. La SFIL a décidé de mettre un terme à cette politique en raison de la mise en place cette année du dispositif d’aide à la sortie des emprunts structurés qui a pour objectif prioritaire d’aider ces mêmes petits établissements, d’autant qu’elle contribue au dispositif (18 millions d’euros sur trois ans).
Les efforts consentis par les établissements de crédit
a) Pour ce qui concerne l’avenir, la signature de la charte de bonne conduite élaborée en décembre 2009, exclut de poursuivre la distribution de prêts structurés aux collectivités territoriales, avec une extension aux EPS ;
b) Des propositions de sortie des emprunts toxiques :
– La SFIL a indiqué avoir conclu 48 opérations de désensibilisation avec 44 clients pour un montant de 238 millions d’euros ;
– BPCE a indiqué avoir, depuis 2011, « sécurisé » totalement 115 millions d’euros d’encours pour 17 prêts hors charte, et partiellement 181 millions d’euros pour 22 prêts ;
– le Crédit agricole a indiqué formuler des propositions de désensibilisation à tous les hôpitaux publics concernés, qu’ils n’ont cependant pas tous retenues. 10 prêts ont fait l’objet d’une désensibilisation totale depuis 2011 pour 65 millions d’euros, et 3 pour 19 millions d’euros, avec évolution vers des taux fixes, ou des taux variables mais indexés sur les taux monétaires ;
– la Société générale n’a plus de prêts hors charte à son bilan, mais, entre 2011 et 2014, elle a sécurisé totalement 171 millions d’euros pour 23 opérations, avec retour à taux fixe, et, partiellement ou temporairement, 107 millions d’euros pour 18 opérations ;
– Dexia est la seule à n’avoir pas répondu sur ce point.
c) L’apport de liquidité pour refinancer à taux bas les IRA : SFIL refinance ainsi les IRA à 1 %.
d) Des abandons de créance.
La SFIL a abandonné 1,30 million d’euros en 2013 et 3 millions d’euros en 2014 pour des hôpitaux publics de moins de 250 lits. Les autres banques n’ont pas évoqué d’abandons de créance.
e) Le financement du fonds d’accompagnement des établissements publics de santé dans la sécurisation de leurs prêts structurés, mis en place par l’instruction interministérielle du 22 décembre 2014, en contrepartie de la validation par la loi des contrats de prêts.
Source : MECSS, rapport précité, juillet 2015.
Pour tenir compte des difficultés de constitution des dossiers de demande d’aide liées aux perturbations des marchés financiers intervenues en janvier 2015, la date limite pour le dépôt des demandes d’aide est fixée au 18 mai 2015 pour les dossiers de la première vague et au 30 octobre 2015 pour les établissements nouvellement éligibles au dispositif.
*
* *
La commission examine d’abord les amendements de suppression I-CF 73 du président Gilles Carrez et I-CF 110 de M. Charles de Courson.
M. le président Gilles Carrez. Je m’étais déjà opposé à la création du fonds de soutien aux collectivités territoriales. À mon sens, il déresponsabilise tant l’emprunteur que le prêteur : il me semblerait plus judicieux de laisser les procédures judiciaires suivre leur cours. Chacun sait que, si l’État est venu à la rescousse, c’est parce que l’un des prêteurs est une banque publique, sur laquelle pèse un énorme risque.
Cet article étend le bénéfice de ce fonds aux hôpitaux. Ma position n’a pas changé.
M. Charles de Courson. Vous allez me prendre pour un vieux radoteur, mais je vais rappeler les grands arguments qui plaident pour la suppression de l’article 9.
Ce dispositif aboutit à déresponsabiliser les banques ; il établit une sanction – une taxe – pour toutes, même pour celles qui avaient fait leur boulot. Il déresponsabilise également les élus : comment peut-on, dans de telles conditions, défendre la démocratie locale ? Certes, de petits maires ont été trompés, mais la justice a alors condamné les banques pour défaut de conseil. En revanche, de très grandes collectivités locales, disposant d’un directeur financier et de conseils nombreux, ne peuvent pas si facilement se plaindre d’avoir été abusées. Cette affaire, du point de vue de la régulation, est épouvantable.
Et maintenant, on étend ce dispositif aux établissements de santé ! Car, oui, certains hôpitaux ont « fumé la moquette » et se sont endettés jusqu’au cou. Or, ils avaient une tutelle : qu’a-t-elle fait ?
Le jour où l’on aboutit à une société déresponsabilisée, c’est la dictature qui s’instaure.
Mme la Rapporteure générale. Je m’étais déjà longuement exprimée sur ce sujet lorsque ce fonds a été créé, par l’article 92 de la loi de finances initiale pour 2014.
Toutefois, aujourd’hui, le principe de réalité nous impose de tenir compte des situations financières délicates. Certains ont signé des prêts structurés en croyant que les arbres montaient jusqu’au ciel : ce n’est pas le cas. Mais ils n’ont pas été les seuls à le croire…
Avis défavorable.
M. Razzy Hammadi. Je comprends très bien l’esprit dans lequel sont déposés ces amendements. Certains hôpitaux ont été gérés de façon absolument désastreuse : c’est le cas de l’hôpital intercommunal situé dans ma ville, Montreuil – l’État a dû « remettre au pot », depuis 2012, 27 millions d’euros, sans même parler de l’emprunt toxique. Il y a là des responsabilités gigantesques : partout ailleurs dans la République, de tels engagements financiers, aboutissant à une situation de quasi-faillite, mettraient en jeu la responsabilité pénale. Il faut donc bien réfléchir.
Mais, en effet, le principe de réalité doit s’imposer ; les enfants qui naissent dans cet hôpital ne sont pas responsables des erreurs commises par les décideurs locaux au cours des vingt dernières années. Je voterai donc contre ces amendements, mais j’en comprends très bien la logique.
M. Marc Goua. Il faut voir comment ces emprunts ont été vendus ! Ils étaient censés ne présenter aucun risque, et il fallait vraiment être un expert pour voir le problème. Le nombre de collectivités et d’hôpitaux pris dans cette tourmente est d’ailleurs important.
De plus, monsieur le président, ces pratiques n’étaient pas, comme vous l’écrivez dans l’exposé des motifs de votre amendement, le fait d’une seule banque : il y en a eu d’autres, qui sont en train de régler les problèmes un à un – car il est vrai qu’ils n’ont pas eu la même ampleur pour celles-ci. Aujourd’hui, sans l’intervention du fonds, certaines collectivités seraient en état de cessation de paiement : on retrouverait le problème de toute façon.
Le fonds a été créé, puis son montant a doublé. Conservons-le. J’ajoute que les collectivités vont payer une bonne partie de ce qu’elles doivent : elles ne sont pas entièrement déresponsabilisées.
La commission rejette les amendements I-CF 73 et I-CF 110.
Elle examine ensuite l’amendement I-CF 1 de M. Marc Goua.
M. Marc Goua. Le but du fonds est d’aider les collectivités à sortir de ces emprunts dangereux. Or, cela entraîne des frais : les pénalités sont relativement importantes et, malgré l’intervention du fonds, certaines communes pourraient être amenées à réemprunter des sommes relativement importantes – ce qui pourrait entraîner de nouvelles difficultés.
Le taux usuraire est aujourd’hui de 3,4 %, ce qui est sans commune mesure avec le taux en vigueur lorsque les prêts ont été contractés : avec cet amendement, on pourrait refinancer en considérant le taux d’usure en vigueur lorsque le contrat d’origine a été signé
– en général, aux alentours de 5 %. Cela permettrait d’étaler la charge, et de ne pas réemprunter, ou presque pas. Les collectivités seraient ainsi soulagées.
Je peux apporter une information, qui m’a été transmise par le secrétaire général du fonds. Celui-ci travaille actuellement à une modification réglementaire qui permettrait de ne pas prendre en compte dans l’endettement les sommes qui seront réempruntées. En effet, certaines collectivités risquent de connaître des grandes difficultés pendant encore de longues années.
Cet amendement, je le précise, a reçu l’aval du fonds lui-même.
Mme la Rapporteure générale. Je ne suis plus très sûre d’avoir compris…
Les prêts structurés posent différents problèmes. Ainsi, pour déboucler un prêt structuré, il faut payer un prix qui varie en fonction des paramètres utilisés pour le construire – taux de change entre le franc suisse et l’euro, par exemple. Or, j’aimerais disposer d’une simulation de la valeur de ces prêts en fonction des différents paramètres de marché. Céder un prêt quand il vaut 100 ou le céder quand il vaut 300, ce n’est pas tout à fait la même chose, notamment pour le fonds. Je regrette que cette évaluation ne soit pas clairement faite, et je suis en train de préparer un amendement pour demander qu’elle le soit. La dynamique d’un produit structuré n’est pas du tout, à ma connaissance, intégrée à la logique du fonds.
Le problème que pose cet amendement est différent ; mais je ne comprends pas le rôle que joue le taux usuraire.
M. Marc Goua. Pour répondre à votre première remarque, je note que le fonds peut intervenir de deux façons différentes : il peut financer la soulte demandée pour se dégager, ou bien il peut permettre d’écrêter le taux pendant trois ans, cette période étant renouvelable une fois. Je me félicite de vos propos, madame la Rapporteure générale, parce que je crois que choisir l’écrêtement coûterait deux fois moins cher à l’État ! Or, le secrétaire d’État au budget m’a dit hier qu’il préférait la première solution, parce que le Gouvernement voulait se débarrasser du problème au plus vite.
Mme la Rapporteure générale. Évidemment, il vaut mieux attendre un peu, si l’on pense raisonnablement y gagner, plutôt que de brader tout de suite. C’est pourquoi je vais demander cette évaluation. D’autres États, qui ont rencontré les mêmes problèmes, agissent de cette façon, pourquoi pas la France ?
M. Marc Goua. C’est d’autant plus vrai que le taux de change de l’euro contre le franc suisse est passé en peu de temps de 1 à 1,09 – ce qui change très sensiblement le calcul de la soulte. Je suis entièrement d’accord avec vous, et j’ai essayé de convaincre Bercy – si vous essayez à votre tour, peut-être réussirons-nous. Ainsi, beaucoup de prêts étaient fondés sur la parité entre dollar et franc suisse : aujourd’hui, ils se traitent, à l’échéance, à 4,20 % ou 4,30 % – ce ne sont pas les taux d’aujourd’hui, mais ce sont les taux que les emprunteurs auraient obtenu lorsqu’ils ont souscrit le prêt. L’écrêtement serait un filet de sécurité ! Mais on m’a dit hier que cette modalité, prévue par la loi, serait en pratique inaccessible. J’ai écrit sur ce sujet au secrétaire d’État au budget, aujourd’hui même.
L’Allemagne a agi de façon complètement différente : d’abord, le gouvernement est allé voir les banques, qui sont les grandes banques américaines, pour leur dire qu’il n’était pas question de payer les sommes astronomiques réclamées ; ensuite, il a trouvé un fonds de défaisance américain qui a racheté une partie de la créance, et il en a apporté une autre. Au total, cela lui a coûté deux fois moins cher.
Mme la Rapporteure générale. C’est bien à l’exemple allemand que je faisais référence.
M. Marc Goua. Aujourd’hui, des négociations sont en cours. Certaines collectivités pourraient, au lieu de verser une soulte de 1 million d’euros, la payer sur la durée en l’intégrant dans le taux. La faiblesse des taux en ce moment est une chance à saisir : elle permet pratiquement d’éliminer la soulte.
J’avais présenté cet amendement l’an dernier, et il avait été rejeté ; le secrétaire général du fonds m’a confirmé cette année qu’il apporterait pourtant des solutions à des problèmes aujourd’hui insolubles.
Mme la Rapporteure générale. Avis favorable à l’amendement. Cela permettra au moins d’en débattre en séance publique avec le Gouvernement.
La commission adopte l’amendement I-CF 1.
Puis elle en vient à l’examen, en discussion commune, des amendements I-CF 59, I-CF 60 et I-CF 61 de M. Joël Giraud et des amendements I-CF 244 et I-CF 245 de Mme Marie-Christine Dalloz.
M. Joël Giraud. La récente décision du Gouvernement de doubler le fonds de soutien aux collectivités va dans le bon sens. Toutefois, il apparaît que le calibrage du relèvement de la taxe qui l’alimente tend à plafonner la participation des banques au financement du fonds de soutien des collectivités et au financement annuel de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) à hauteur d’environ 55 % sur les treize prochaines années. Ces amendements tendent à faire supporter par le système bancaire – c’est-à-dire ici, rappelons-le, les banques soumises à des exigences minimales en fonds propres supérieures à 500 millions d’euros – une part plus importante du fonds de soutien et de l’aide directe à la CNAMTS, à hauteur d’environ 75 %.
De plus, deux d’entre eux tendent à faire bénéficier la CNAMTS d’une aide annuelle de 30 millions d’euros, au lieu des 28 prévus par le projet de loi.
Mme la Rapporteure générale. Avis défavorable. Vous dites qu’il manque 30 millions d’euros au fonds, mais ils sont versés par la Société de financement local (SFIL) pour ce qui concerne les prêts souscrits par les hôpitaux. De plus, le projet de loi relève déjà le taux de la taxe pour le financement du fonds de façon conséquente.
M. Charles de Courson. Ce fonds s’élevait à 1,5 milliard d’euros ; nous en sommes à 3 ; où s’arrête-t-on ?
Mme la Rapporteure générale. C’est la question que je posais tout à l’heure à Marc Goua.
M. Marc Goua. Nous en resterons à 3 milliards d’euros ; mais Areva, à la suite également d’erreurs de gestion, commises par des gens très intelligents, c’est 7 milliards d’euros…
Si nous prenions le temps, je le redis, tout cela nous coûterait moins cher. Nous n’avons pas vu venir le coup ; et la peur bleue qu’ils ont eue pousse nos dirigeants à résoudre la crise à la va-vite. Enfin, cela sera toujours moins coûteux que les 15 milliards d’euros du Crédit lyonnais…
M. le président Gilles Carrez. Je ne vois pas là un motif de satisfaction !
M. Joël Giraud. Je n’ai jamais dit qu’il manquait 30 millions d’euros. J’ai seulement mentionné que la mesure telle qu’elle est prévue plafonne la participation des banques ; je propose de relever cette dernière.
Ce sont le Président de la République et le Gouvernement qui ont déclaré que la CNAMTS bénéficierait d’une aide de 30 millions d’euros, et je n’en vois ici inscrits que 28. Voilà j’ai pourquoi j’ai proposé de rétablir ce montant de 30 millions d’euros.
M. Hervé Mariton. Notre collègue Marc Goua évoque la situation d’Areva, madame la Rapporteure générale. Si l’État recapitalise Areva en n’agissant manifestement pas en investisseur avisé, j’imagine que ces sommes seront considérées comme aggravant le déficit. Il s’agirait bien là d’une dépense budgétaire comparable à une subvention, et de nature à aggraver le déficit, n’est-ce pas ?
Mme Marie-Christine Dalloz. Je vais dans le sens exactement inverse de celui proposé par Joël Giraud. À l’origine, le fonds était financé à parité par l’État et par les acteurs bancaires. Aujourd’hui, on prévoit une part plus importante pour les seconds.
Une partie du fonds sera affectée directement à la CNAMTS. Or, la Cour des comptes a insisté, dans son rapport consacré à la dette des établissements publics de santé, sur la responsabilité des gestionnaires hospitaliers, à qui « la dette a pu paraître un argent facile », mais aussi des pouvoirs publics.
Ces amendements proposent donc de revenir à un partage paritaire entre l’État et le système bancaire des contributions au fonds pour les hôpitaux.
L’amendement I-CF 245 est un amendement de repli, avec des taux légèrement différents.
Mme la Rapporteure générale. Ces choses doivent se construire patiemment. Or, ce que vous proposez serait un retour en arrière. Avis défavorable.
La commission rejette successivement les amendements I-CF 59, I-CF 60, I-CF 61, I-CF 244 et I-CF 245.
Suivant l’avis favorable de la Rapporteure générale, elle adopte ensuite l’amendement I-CF 342 de M. Razzy Hammadi.
Puis elle adopte l’article 9 modifié.
*
* *
La commission se saisit de l’amendement I-CF 154 de M. Pascal Cherki.
M. Pascal Cherki. Cet amendement revient sur un point soulevé par Karine Berger lors de la discussion de la « loi Macron », qui a créé une nouvelle niche fiscale applicable à la distribution d’actions gratuites aux salariés d’une entreprise. En effet, aucune distinction n’est établie entre les actions gratuites qui reviennent aux salariés ordinaires ou aux cadres moyens, et celles qui reviennent aux cadres dirigeants. Or, le moins que l’on puisse dire est qu’au cours des dernières années, nous avons assisté à quelques abus en ce domaine.
Alors que le Gouvernement souhaite, pour tenir ses engagements européens, encadrer la dépense publique, alors que nous devons dégager, essentiellement par des redéploiements dans des ministères socialement utiles, de nouveaux moyens pour assurer la sécurité de nos concitoyens, il paraît curieux de créer une nouvelle niche fiscale, qui pourrait coûter 500 millions d’euros et qui profiterait en tout cas essentiellement aux cadres dirigeants.
Cet amendement tend donc à revenir à une situation antérieure à la « loi Macron ». Je souhaite que la commission l’adopte, ce qui adresserait un message très clair au Gouvernement : s’il souhaite alléger la fiscalité de la distribution d’actions gratuites, il doit limiter cet allègement aux cadres moyens et aux employés. Que les cadres dirigeants des grands groupes soient concernés me paraît franchement choquant.
Le Gouvernement doit nous proposer un dispositif plus abouti. Je regrette que nous n’ayons pas pu parvenir à ce compromis nécessaire lors des débats de la « loi Macron », peut-être faute de temps.
Mme la Rapporteure générale. Lors de l’examen de la « loi Macron », j’avais déposé un amendement de suppression de cette disposition prévoyant le doublement de l’avantage fiscal lors de la distribution d’actions gratuites, quel que soit le bénéficiaire. Je serai donc cohérente : avis favorable.
M. Dominique Lefebvre. Il me paraît absolument inopportun de revenir sur une loi que nous venons juste de voter.
M. Charles de Courson. J’ai assisté récemment à un colloque sur l’épargne salariale, où l’on s’est beaucoup félicité des avancées de la « loi Macron » – que certains considèrent d’ailleurs comme insuffisantes. Et l’on voudrait y revenir à nouveau ! Je partage entièrement l’avis du porte-parole du groupe socialiste : ne changeons plus les règles, au moins jusqu’à la fin de la législature.
La commission rejette l’amendement I-CF 154.
Elle examine ensuite l’amendement I-CF 213 de M. Charles de Courson.
M. Charles de Courson. Cet amendement porte sur le financement participatif, nouveau dispositif sympathique en plein développement. Toutefois, la fiscalité applicable à ces opérations suit celle des livrets dont l’épargne est garantie, contrairement au financement participatif. L’amendement propose donc d’aligner la fiscalité du financement participatif sur celle des valeurs mobilières, qui prévoit la possibilité d’imputer les moins-values sur les plus-values pendant dix ans. Il s’agirait de pouvoir déduire, pour le calcul de l’impôt sur le revenu, les pertes en capital des intérêts perçus.
Mme la Rapporteure générale. Vous souhaitez, en quelque sorte, donner un avantage fiscal au crowdlending.
M. Charles de Courson. Il s’agit d’un alignement sur l’investissement direct dans une entreprise !
Mme la Rapporteure générale. C’est donc un avantage fiscal. Par ailleurs, une ordonnance visant à sécuriser ce type d’opération est en préparation en application de la « loi Macron ». Afin d’éviter une interférence, je donne donc un avis défavorable à cet amendement.
M. Charles de Courson. Vous êtes favorable à cet amendement à condition qu’il figure dans une ordonnance ? J’en ris !
Je représenterai l’amendement en séance pour entendre le Gouvernement confirmer les propos de Mme la Rapporteure générale.
L’amendement I-CF 213 est retiré.
La commission en vient à l’amendement I-CF 361 de Mme Bernadette Laclais.
Mme Bernadette Laclais. J’ai déjà présenté cet amendement l’an dernier.
Il est fréquent, dans la vie des entreprises, de procéder à un apurement des pertes accumulées avant d’engager une recapitalisation. Une augmentation de capital est précédée d’une réduction de capital par imputation des pertes accumulées ; les titres annulés disparaissent et de nouveaux titres sont créés. Or, c’est cette dernière date de création qui est prise en compte pour calculer la durée de détention dans le calcul de l’imposition des plus-values, alors que la détention réelle est plus ancienne. Cette situation crée un frein à l’assainissement et à l’apurement des pertes des entreprises, pour de simples considérations fiscales.
Je vous propose donc de considérer les opérations d’annulation de titres comme des opérations intercalaires pour le décompte de la durée de détention.
Mme la Rapporteure générale. Je crains de vous faire la même réponse que l’an dernier : le terme d’« apurement des pertes » est trop général et risque d’entraîner des abus ou à tout le moins des optimisations. Avis défavorable.
M. Charles de Courson. Ne serait-il pas possible de rectifier simplement l’amendement en écrivant « la nécessité de recapitaliser » au lieu de « l’apurement des pertes » ?
Mme la Rapporteure générale. Il faut vérifier. Je propose le retrait de l’amendement, afin d’en proposer une nouvelle rédaction qui pourrait tenir compte de la suggestion de Charles de Courson.
Mme Bernadette Laclais. J’entends vos remarques, même s’il me semble que la suite du paragraphe est très précise sur les conditions dans lesquelles l’apurement peut être réalisé. Je proposerai donc une nouvelle rédaction en vue du débat en séance publique.
L’amendement I-CF 361 est retiré.
*
* *
Article additionnel après l’article 9
Prolongation de l’exonération de plus-values immobilières pour les cessions en faveur du logement social
La commission est saisie de l’amendement I-CF 400 de la commission des affaires économiques.
M. le rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques. Un dispositif est en vigueur qui exonère de l’imposition sur les plus-values immobilières les particuliers qui vendent un terrain pour qu’on y construise des logements sociaux. Or, il prend fin le 31 décembre prochain. Il est proposé de le proroger jusqu’au 31 décembre 2018 afin de favoriser la construction de logements sociaux. Je rappelle que j’ai un autre amendement visant à ne pas appliquer cette règle dans les quartiers où se trouvent déjà de nombreux logements sociaux.
Mme la Rapporteure générale. François Pupponi a déjà déposé cet amendement l’an dernier pour prolonger le dispositif jusqu’au 31 décembre 2015. Je m’en remets à la sagesse de la commission dans la mesure où nous ne connaissons pas le coût de cette mesure.
La commission adopte l’amendement I-CF 400.
*
* *
La commission examine l’amendement I-CF 211 de M. Charles de Courson.
M. Charles de Courson. Les dispositifs existants visant à neutraliser les incidences fiscales des échanges d’immeubles ruraux ne sont applicables qu’à la condition que les immeubles échangés se situent dans un périmètre géographique limité au canton et aux communes limitrophes du canton.
Cette disposition, adaptée voici cinquante ans, ne l’est plus du tout aujourd’hui. C’est pourquoi je propose de supprimer la condition de proximité géographique pour l’application des dispositifs de faveurs aux opérations d’échanges d’immeubles ruraux, opérations dont les coûts diminueront.
Quant à l’incidence financière de cette disposition, elle devrait être très faible, de l’ordre de quelques centaines de milliers d’euros.
Mme la Rapporteure générale. Vous voulez transformer la notion de « remembrement » en notion d’« échange ». Votre amendement permettrait de neutraliser les incidences fiscales d’un échange de parcelles entre Lille et Montauban ! Vous supprimez en effet toute référence au canton alors qu’un remembrement suppose une certaine proximité géographique.
M. Charles de Courson. Le dispositif en vigueur, vous en conviendrez, est devenu complètement inadapté. Suggérez-moi, dès lors, de préciser que l’échange doit avoir lieu dans le périmètre limité au département limitrophe.
Mme la Rapporteure générale. Soit.
M. Charles de Courson. Alors je retire mon amendement pour le redéposer en séance.
L’amendement I-CF 211 est retiré.
La commission en vient à l’amendement I-CF 210 de M. Charles de Courson.
M. Charles de Courson. Lorsqu’un exploitant a l’opportunité d’acquérir une parcelle plus proche du centre de son exploitation, mais qu’il ne peut financer cette acquisition qu’en revendant une parcelle éloignée, les incidences fiscales de cette opération, à savoir, d’une part, le paiement du droit d’enregistrement au taux de 5,09 % sur le prix d’acquisition de la parcelle proche et, d’autre part, l’éventuelle imposition de la plus-value réalisée lors de la vente de la parcelle éloignée, sont susceptibles de le dissuader de réaliser cette opération.
C’est pourquoi il est proposé d’instituer un dispositif de report d’imposition de la plus-value constatée lors de la vente d’un bien exploité en cas de réemploi du prix dans l’achat d’un autre bien affecté à l’exploitation.
Un tel dispositif existe pour les successions.
Mme la Rapporteure générale. Vous faites fort, monsieur de Courson ! Avec cet amendement, vous proposez le report de l’imposition de la plus-value retirée de la cession à titre onéreux d’immeubles ! Supposons que je vende un appartement à Paris pour acheter des terres agricoles…
M. Charles de Courson. Je parle d’immeubles fonciers !
Mme la Rapporteure générale. Votre amendement ne le précise pas et mon exemple de vente d’un appartement à Paris est valide. Si votre amendement était voté, la plus-value éventuelle que je réaliserais serait exonérée d’impôts si j’achetais un terrain agricole à Montauban.
Avis défavorable.
M. Charles de Courson. Je retire l’amendement et je préciserai qu’il s’agit d’immeubles fonciers.
L’amendement I-CF 210 est retiré.
La commission examine, en discussion commune, les amendements I-CF 360, I-CF 359 et I-CF 363 de Mme Bernadette Laclais.
Mme Bernadette Laclais. Je me suis autorisée, avec l’amendement I-CF 360, à reprendre la proposition n° 3 du rapport de nos collègues Olivier Carré et Christophe Caresche, qui suggère d’augmenter les plafonds et les taux des avantages « ISF-PME » et « Madelin » dans la perspective de la mise en conformité de ces dispositifs avec le droit européen – ce qui conduira certainement à les revoir dans un sens restrictif. Il nous semble nécessaire de renforcer la portée de ces deux avantages fiscaux pour accompagner le redémarrage de l’activité économique. Dans certains cas, en effet, ils ont, pour de multiples raisons, perdu de leur intérêt.
Mme la Rapporteure générale. Vous proposez deux mesures : porter le taux de réduction de l’impôt sur le revenu dite « Madelin » de 18 % à 25 %, et placer cette niche fiscale sous le plafonnement global à 18 000 euros. Si la seconde proposition se trouve bien dans le rapport Carré-Caresche, ce n’est pas le cas de la première.
Le « dispositif Madelin » coûte tout de même 150 millions d’euros par an. Si votre proposition est bien de nature à favoriser l’investissement, elle aurait d’importantes conséquences budgétaires. Donc avis défavorable.
Mme Bernadette Laclais. Si j’ai déposé cet amendement, ainsi que les suivants, c’est pour connaître la position de la commission sur ces questions. J’ai bien conscience que le présent dispositif a un coût budgétaire – c’est pourquoi je veux bien retirer le premier des trois amendements –, mais nous devons envoyer un signe positif, et tel est bien l’esprit des deux autres amendements. J’insiste sur le fait que nous reprenons-là à notre compte des préconisations de deux collègues appartenant à deux groupes politiques différents, préconisations qui, me semble-t-il, n’avaient pas reçu d’avis négatif de la commission.
M. le président Gilles Carrez. Ce sont les arguments que j’ai invoqués ce matin quand j’ai proposé d’aligner le plafond sur celui des sociétés de financement de l’industrie cinématographique et de l’audiovisuel (SOFICA), à savoir 18 000 euros ; mais Mme la Rapporteure générale s’y est opposée, ma chère collègue.
Mme la Rapporteure générale. J’entends que ces amendements visent à soutenir l’investissement dans les PME. Le Gouvernement est en train de discuter avec la Commission européenne afin de vérifier la conformité des mécanismes envisagés avec le droit européen. À ma connaissance, il envisage d’aborder ces sujets à l’occasion de l’examen du projet de loi de finances rectificative.
Il est vrai, j’y insiste, qu’en relevant le taux de réduction d’impôt et son plafond, l’amendement I-360 implique une augmentation substantielle du coût du dispositif. Les deux amendements suivants reprennent, en effet, certaines propositions – pas toutes – du rapport Carré-Caresche. On peut en examiner certaines. À ce stade, je le répète, le Gouvernement souhaite en présenter à l’occasion de l’examen du projet de loi de finances rectificative. Je vous suggère donc soit de retirer vos amendements, soit de les représenter en séance – le ministre sera alors à même de vous renseigner sur l’état de ses discussions avec la Commission européenne.
Mme Bernadette Laclais. Je n’ignore pas que le Gouvernement entend faire des propositions dans le cadre du collectif budgétaire. Autant je retirerais volontiers, étant donné le contexte actuel, un amendement qui n’est pas sans incidence financière, autant j’aimerais que la commission donne un avis sur les deux autres qui ne coûtent rien ou presque. Or les retirer pour les représenter en séance ne me permettra pas de connaître cet avis.
M. Jean-Louis Gagnaire. Comment la commission entend-elle défendre devant le ministre les préconisations que deux de nos collègues ont formulées dans leur rapport ? Sinon, comme l’a souligné en d’autres occasions Olivier Faure, à quoi sert-il de rédiger des rapports ?
Mme la Rapporteure générale. Quand, dans un rapport, vous faites des propositions qui parfois se recoupent, cela n’implique pas qu’on doive nécessairement toutes les reprendre. Or l’application de toutes les préconisations du rapport Carré-Caresche aurait un impact budgétaire important.
Les amendements I-CF 360, I-CF 359 et I-CF 363 sont retirés.
*
* *
Article additionnel après l’article 9
Conservation des avantages fiscaux « Madelin » et « ISF-PME » en cas de réinvestissement
La commission examine ensuite l’amendement I-CF 362 de Mme Bernadette Laclais.
Mme la Rapporteure générale. Contrairement aux amendements précédents, j’estime que l’amendement I-CF 362 pourrait être adopté par la commission.
Mme Bernadette Laclais. Je vous remercie pour votre réponse, madame la Rapporteure générale. Vous aurez constaté que, par rapport à l’amendement présenté l’année dernière, j’ai fait un effort de présentation puisque j’ai ramené de cinq à deux ans la période pendant laquelle l’avantage fiscal concerné peut être conservé aux conditions actuelles.
Je suis très satisfaite, et si cet amendement I-CF 362 reçoit l’avis favorable de la commission, je l’interprète comme la volonté de sa part de prendre en considération les préconisations de nos collègues Olivier Carré et Christophe Caresche.
J’ai retiré les autres amendements, mais je les représenterai tout de même en séance, suivant en cela le conseil de la Rapporteure générale, afin d’en discuter avec le Gouvernement.
Suivant l’avis favorable de la Rapporteure générale, la commission adopte l’amendement I-CF 362.
La commission en vient à l’amendement I-CF 357 de Mme Bernadette Laclais.
Mme Bernadette Laclais. Il s’agit, là aussi, de reprendre une recommandation du rapport Carré-Caresche qui ne doit pas avoir un coût trop important. La réduction d’ISF au titre des dons a été étendue par le décret du 7 avril 2011 aux dons effectués au profit de trois associations reconnues d’utilité publique. Nos collègues Olivier Carré et Christophe Caresche ont suggéré qu’il y en ait davantage – c’est l’objet de notre proposition.
Mme la Rapporteure générale. Le dispositif en vigueur relatif au mécénat d’entreprise permet déjà d’obtenir une réduction de l’impôt sur les sociétés pour les dons aux organismes d’aide au financement et à l’accompagnement des PME. Il semble qu’une fédération d’associations puisse également bénéficier de ce dispositif – c’est le cas de France Angels. Je vous propose de vous en assurer directement auprès du ministre en redéposant votre amendement pour la séance. Dans le cas où la doctrine en la matière ne serait pas établie, le dépôt d’un amendement serait dès lors justifié.
M. Charles de Courson. Combien coûterait cette petite niche ? Très peu, n’est-ce pas : 500 000 euros, 1 million ?
Mme la Rapporteure générale. Nous allons nous en informer.
Mme Bernadette Laclais. J’aimerais, là aussi, puisqu’il s’agit de la reprise d’une proposition du rapport Carré-Caresche, que la commission donne son avis, d’autant que je ne pense pas que la disposition alourdirait le budget…
M. Alain Fauré. Nous venons de travailler à faire en sorte que les réseaux des chambres de commerce et d’industrie, notamment départementaux, soient mieux organisés. Si c’est pour créer de nouvelles organisations dont nous ne sommes pas sûrs de l’efficacité pour stimuler l’activité des entreprises, je ne voterai pas cet amendement.
Mme Monique Rabin. J’ai l’impression que l’on nous incite à soutenir l’animation de réseaux et non pas l’économie réelle. Je suis dubitative.
Mme la Rapporteure générale. Cette proposition ne figurait pas dans le rapport Carré-Caresche. À ma connaissance, nos deux collègues en avaient discuté avec le ministre des finances qui leur avait répondu que, le dispositif s’appliquant aux associations, il pouvait également s’appliquer aux fédérations d’associations. Ce point reste néanmoins à vérifier avec le Gouvernement.
Mme Bernadette Laclais. À moins que nous n’ayons pas lu le même texte, madame la Rapporteure générale, cette proposition figure bel et bien dans le rapport Carré-Caresche.
Mes collègues comparent des choses qui ne sont pas comparables. L’action dans les territoires des fédérations en question n’est plus à démontrer. Je trouve dommage que certains d’entre vous ne connaissent pas les business angels car, souvent, dans vos départements, il s’agit d’acteurs qui jouent un rôle très important dans la création d’entreprises, dans leur développement et dans la création d’emplois. Aussi, je regrette le jugement qui vient d’être porté et qui tend à discréditer des fédérations reconnues et qui ont, du reste, été auditionnées à plusieurs reprises par la mission Carré-Caresche.
M. Jean-Louis Gagnaire. Il est bel et bien question d’économie réelle. Nous n’avons certes pas affaire aux réseaux traditionnels, mais ceux dont il est ici question permettent de mobiliser les ressources d’un territoire pour financer les entreprises. Des précisions doivent sans doute être apportées pour savoir si les fédérations peuvent intervenir, mais, en cas de réponse positive, le dispositif n’est en rien redondant avec celui en vigueur : les réseaux qui ont le plus pignon sur rue ne sont pas nécessairement les plus efficaces au quotidien. Je connais une région, à l’est de la région Rhône-Alpes, où des réseaux plus discrets le sont, eux, vraiment, et leur absence représente un vrai déficit pour le territoire où ils n’opèrent pas.
M. Marc Goua. J’atteste que ces réseaux – je pense en particulier à France Initiative – sont vraiment efficaces. Le réseau bancaire ne fait pas toujours confiance aux entreprises et, très souvent, une rupture survient à partir de la troisième année alors qu’elles ont besoin de fonds de roulement ; c’est alors que l’on retrouve ces réseaux, capables de mobiliser de l’argent de proximité. J’y crois beaucoup et d’autant plus que nous n’évoquons pas là une idée stratosphérique mais bien des actions de terrain.
La commission rejette l’amendement I-CF 357.
Elle examine ensuite, en discussion commune, les amendements I-CF 203 et I-CF 204 de M. Charles de Courson.
M. Charles de Courson. Lorsque des terres ou vignes louées à long terme font l’objet d’une transmission à titre gratuit, elles bénéficient d’une exonération de droits de mutation de 75 %, plafonnée à 101 897 euros, l’exonération étant de 50 % au-delà de cette limite. L’amendement I-CF 203 vise à supprimer ce plafond et l’amendement I-CF 204, de repli, à l’actualiser en fonction de l’évolution du prix moyen des terres agricoles louées, en le portant à 120 000 euros.
Suivant l’avis défavorable de la Rapporteure générale, la commission rejette successivement les amendements I-CF 203 et I-CF 204.
Elle est ensuite saisie de l’amendement I-CF 372 de M. Éric Woerth.
Mme Véronique Louwagie. Cet amendement propose tout simplement de supprimer l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF). En effet, cet impôt pénalise le monde économique. Avant même de frapper les particuliers, les foyers, il touche les actions des entreprises – or, n’évoquions-nous pas, à l’instant, les difficultés que ces dernières éprouvent pour se financer ? On cherche à renouer avec la croissance, avec la compétitivité, d’où la nécessité de trouver des financements importants pour renforcer nos entreprises. La suppression de l’ISF serait compensée par la création d’une taxe additionnelle.
M. le président Gilles Carrez. À tous les collègues qui souhaitent s’exprimer, je propose que nous n’ouvrions pas la discussion sur la question.
Suivant l’avis défavorable de la Rapporteure générale, la commission rejette l’amendement I-CF 372.
Elle en vient à l’amendement I-CF 207 de M. Charles de Courson.
M. Charles de Courson. Dans le dispositif actuel, le cercle familial qui permet l’application de l’exonération d’ISF pour les baux agricoles à long terme comprend les frères et sœurs du redevable, mais bizarrement ni les conjoints des frères et sœurs, ni leurs descendants. De ce fait, lorsqu’un propriétaire a loué ses biens à son frère ou à sa sœur avec la perspective de bénéficier de l’exonération, il perd le bénéfice de celle-ci, en tout ou partie, si l’exploitation est transmise au conjoint ou au descendant du preneur comme le permet l’article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime.
Cette situation est pénalisante pour le bailleur qui n’a pas le pouvoir de s’opposer à une telle transmission. C’est pourquoi il est proposé d’élargir la définition du cercle familial pour y inclure le conjoint et les descendants des frères et sœurs.
Mme la Rapporteure générale. Le droit en vigueur prévoit que si vous donnez à bail des terres pendant dix-huit ans à votre cercle familial proche, ces terres n’entrent pas dans l’assiette de l’ISF. Or, monsieur de Courson, vous voudriez élargir le cercle familial aux neveux et nièces.
Je suis favorable à ce que nous en restions au dispositif en vigueur.
M. Charles de Courson. Vous êtes consciente que si le propriétaire a loué à son frère, que celui-ci cesse son activité à soixante-cinq ans et que la belle-sœur reprend l’affaire, le propriétaire n’a plus le bénéfice de la disposition. C’est tout de même inexplicable ! Il en est de même si le propriétaire a loué à sa sœur et que c’est le beau-frère qui reprend l’activité : l’avantage fiscal cesse !
M. Hervé Mariton. Vous n’avez pas souhaité, monsieur le président, que nous entamions un débat de fond sur l’ISF. J’observerai seulement que les taux en vigueur sont complètement déconnectés du taux de rendement du capital. Le taux d’inflation que le projet de loi de finances prend en compte rend les taux de l’ISF surréalistes. Or, la majorité vit cela plutôt aimablement et l’on se demande si, au cas où, par malheur, elle devait rester longtemps en place, elle se posera un jour la question – à moins que cette dernière ne demeure interdite.
M. le président Gilles Carrez. La majorité est sereine, monsieur Mariton, parce qu’elle a mis en place un plafonnement qui coûte beaucoup plus cher que le bouclier fiscal : 920 millions d’euros en 2014 !
M. Hervé Mariton. Cela ne résout pas toutes les situations, monsieur le président.
Mme la Rapporteure générale. J’invite Hervé Mariton à aller voir du côté de San Francisco ou de Los Angeles où la taxe foncière est un pourcentage de la valeur de votre bien. Ainsi un appartement de 1 million de dollars taxé à 1,5 % vous coûtera 15 000 dollars par an – il s’agit donc d’une taxe dynamique, largement supérieure à nos taxes foncières et même aux taux de l’ISF.
M. Hervé Mariton. Voilà qui tombe bien, madame la Rapporteure générale. Je reviens tout juste d’une réunion de Français de l’étranger qui, pour certains, faisaient valoir qu’à une époque, le rendement du capital, dans des pays où un système de retraite par capitalisation est en vigueur, leur aurait permis de rentrer en France et d’y vivre avec leur capital. Or, compte tenu du taux de rendement du capital actuel et du taux de l’ISF, ils n’imaginent plus rentrer au moment de leur retraite.
La commission rejette l’amendement I-CF 207.
Elle en vient à l’amendement I-CF 208 de M. Charles de Courson.
M. Charles de Courson. Cet amendement vise à satisfaire une vieille revendication des jeunes agriculteurs. Il est proposé d’étendre le dispositif d’exonération d’ISF existant pour les baux à long terme consentis dans le cadre familial à de jeunes agriculteurs en phase d’installation.
Suivant l’avis défavorable de la Rapporteure générale, la commission rejette l’amendement I-CF 208.
Elle examine ensuite l’amendement I-CF 209 de M. Charles de Courson.
M. Charles de Courson. J’espère qu’au moins la gauche votera pour cet amendement, qui vise à inciter les anciens exploitants, sans successeur familial, à louer les biens ruraux qu’ils possèdent à un ancien salarié de leur exploitation, ce qui permet d’améliorer l’avenir professionnel de ce salarié, menacé par le départ à la retraite de son employeur.
Suivant l’avis défavorable de la Rapporteure générale, la commission rejette l’amendement I-CF 209.
Puis elle est saisie de l’amendement I-CF 89 de Mme Christine Pires Beaune.
Mme Christine Pires Beaune. Il s’agit de permettre aux entreprises solidaires qui produisent des énergies renouvelables soumises aux tarifs de rachat réglementés, de bénéficier des dispositifs « Madelin » et « ISF-PME ».
Mme la Rapporteure générale. Je comprends bien la logique de l’amendement mais je suggérerais que l’ensemble des propositions d’élargissement du dispositif « ISF-PME » soit débattu à l’occasion de l’examen du projet de loi de finances rectificative, même si je reconnais que nous avons voté tout à l’heure un tel élargissement sur les réinvestissements. Il nous faut envisager les choses dans leur globalité.
Mme Christine Pires Beaune. Je retire mon amendement et le présenterai donc à nouveau dans le cadre du projet de loi de finances rectificative.
L’amendement I-CF 89 est retiré.
La commission est saisie de l’amendement I-CF 358 de Mme Bernadette Laclais.
Mme Bernadette Laclais. J’imagine que la Rapporteure générale va m’adresser la même réponse qu’à Christine Pires Beaune. Il s’agit d’élargir la palette de titres éligibles au PEA et au PEA-PME aux bons de souscription d’actions et aux obligations convertibles, et, afin d’éviter tout abus, de ne laisser cette possibilité qu’à des titres émis par des sociétés non cotées sur des marchés organisés et réglementés.
Mme la Rapporteure générale. Vous allez me dire que j’ai mal lu le rapport Carré-Caresche, mais je croyais que sa proposition se limitait aux PEA-PME.
L’élargissement au PEA que vous proposez est assez substantiel, et j’y suis défavorable. Quant au PEA-PME, la question se pose, en effet, des résultats assez limités enregistrés depuis sa mise en place donc l’idée de pouvoir y déposer des titres de dettes me semble intéressante. Si l’amendement ne portait que sur le PEA-PME, je donnerais un avis de sagesse.
M. Charles de Courson. Élargir le dispositif aux obligations convertibles me paraît contraire à l’esprit même du PEA-PME, cette première proposition est à écarter. En ce qui concerne le second point, ma chère collègue, connaissez-vous beaucoup de PME ayant émis des bons de souscription d’actions (BSA) ? Il s’agit avant tout de sociétés cotées, aussi y serais-je plutôt défavorable.
Mme Bernadette Laclais. J’ai entendu la réponse de la Rapporteure générale. Je retire l’amendement et le rectifierai en vue de la séance publique.
L’amendement I-CF 358 est retiré.
*
* *
Article additionnel après l’article 9
Prolongation de l’abattement de plus-values immobilières en zone tendue
La commission examine, en discussion commune, les amendements I-CF 398 de la commission des affaires économiques et I-CF 379 rectifié de la Rapporteure générale.
M. le rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques. L’année dernière nous avions voté en loi de finances un article permettant un abattement de 30 % sur les plus-values attachées à des terrains vendus pour la construction de logements. Nous considérons qu’une année n’est pas suffisante et qu’il conviendrait de prolonger ce dispositif en y ajoutant la dégressivité de l’abattement qui passerait de 50 % en 2016 à 30 % 2017 et à 15 % en 2018. Nous disposerions alors d’une visibilité sur trois ans pour inciter les propriétaires de terrains à bâtir à les céder pour la construction de logements.
Mme la Rapporteure générale. Il s’agit là d’un amendement hors de prix, monsieur Pupponi : un abattement qui passe de 30 % à 50 % et sur une période courant de 2015 à 2018, cela représente un montant que l’on peut évaluer à 500 millions d’euros. Avis défavorable.
L’amendement I-CF 379 rectifié vise à prolonger d’un an l’abattement exceptionnel de 30 % sur les plus-values immobilières voté l’année dernière uniquement pour les zones tendues ayant connu une augmentation des taxes foncières. J’estime le coût de la mesure entre 10 et 20 millions d’euros.
M. le rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques. Je pense effectivement que cela va dans le bon sens. En revanche, tous les professionnels s’accordent à dire qu’un an n’est pas suffisant : le temps que la mesure soit votée, qu’elle soit mise en œuvre et les textes publiés, les délais sont trop courts. Nous souhaitons donner de la visibilité sur une durée plus longue, même avec un abattement limité à 30 %, pour que le dispositif soit efficace et incite les gens à vendre des terrains à bâtir.
M. Charles de Courson. C’est la carotte après le bâton ! Est-ce la sortie du « 5 euros » qui était aussi fait pour obliger à vendre en zone tendue ? Je n’ai pas vu d’amendement à ce sujet.
M. le président. Il ne s’agit ni du même périmètre ni des mêmes transactions. La taxe de 5 euros concerne des terrains assujettis au foncier non bâti ; or, en zone tendue, l’essentiel des terrains est déjà construit et relève donc du foncier bâti.
La commission rejette l’amendement I-CF 398 et adopte l’amendement I-CF 379 rectifié.
*
* *
A.– Dispositions relatives aux collectivités territoriales
Article 10
Fixation pour 2016 de la dotation globale de fonctionnement (DGF) et des allocations compensatrices d’exonérations d’impôts directs locaux (IDL)
Le présent article fixe le montant de la dotation globale de fonctionnement (DGF) à 33,108 milliards d’euros, soit une baisse de 3,5 milliards d’euros par rapport à 2015 conformément au plan de réduction annoncé par le Gouvernement. La DGF supporte en 2016 l’intégralité de l’effort demandé aux collectivités territoriales pour le redressement des comptes publics dans le cadre de la programmation pluriannuelle. La portée de cette mesure ne peut être complètement appréciée qu’en lien avec l’article 58 du présent projet de loi de finances. Rattaché à la mission Relations avec les collectivités territoriales (RCT), qui fait l’objet d’un rapport spécial annexé au présent rapport général, l’article 58 précité vise :
– à mettre en œuvre la réforme de la DGF du bloc communal ;
– à fixer le montant de la contribution au redressement des finances publiques pour 2016 pour les trois catégories de collectivités ;
– à prévoir la hausse de la péréquation au sein de la DGF.
À la date du 4 octobre 2015, la simulation de l’effet de chacun des trois volets de l’article 58, pour les 36 658 communes et 2 133 établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) n’était pas rendue publique.
Pour pouvoir prendre connaissance d’une version, provisoire, la Rapporteure générale a procédé à un contrôle sur place au ministère de l’intérieur, le 1er octobre 2015. Les données n’étaient que provisoires : fondées sur le périmètre des EPCI au 1er janvier 2015, elles n’intégraient pas l’évolution des métropoles du Grand Paris et d’Aix-Marseille Provence, dont le périmètre au 1er janvier 2016, désormais connu, peut être pris en compte dans les bases de données.
Une analyse complète sera publiée par la Rapporteure spéciale en charge de la mission RCT. La Rapporteure générale fournira également des éléments d’analyse dans son rapport sur la deuxième partie.
La DGF, instituée par la loi du 3 janvier 1979 (95), est un prélèvement opéré sur les recettes de l’État (PSR), versé aux collectivités locales pour la première fois en 1979. Cette dotation vise à compenser les charges supportées par les collectivités, à contribuer à leur fonctionnement et à corriger certaines inégalités de richesses entre les territoires. Son montant est établi chaque année par la loi de finances et sa répartition s’opère à partir des données physiques et financières des collectivités.
La DGF se compose actuellement de douze dotations (quatre pour les communes, deux pour les EPCI, quatre pour les départements et deux pour les régions), parfois elles-mêmes déclinées en plusieurs sous-composantes, réparties en fonction d’une cinquantaine de critères. Pour chacune de ces sous-composantes, l’éligibilité des collectivités et la répartition des crédits sont fonction de critères différents, éventuellement combinés. Onze critères de ressources et dix-neuf critères de charges sont utilisés pour calculer la DGF des communes et des EPCI, six critères de ressources et neuf de charges pour les départements, six critères de ressources et trois de charges pour les régions.
Le tableau page suivante présente l’architecture actuelle de la DGF.
ARCHITECTURE DE LA DGF EN 2015
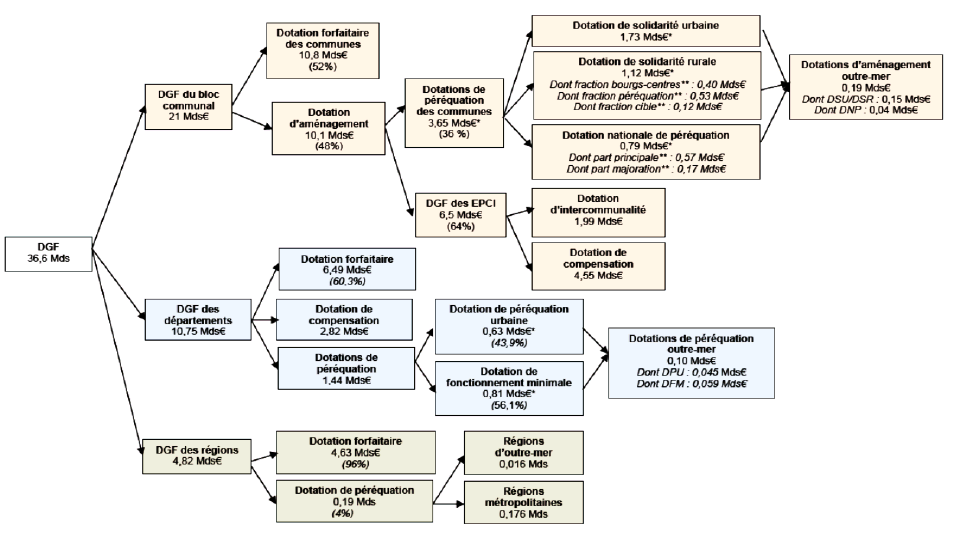
Source : Pour une dotation globale de fonctionnement équitable et transparente : osons la réforme. Rapport établi par Mme Christine Pires Beaune et M. Jean Germain, le 15 juillet 2015.
Depuis sa création en 1979, la DGF a fait l’objet de trois réformes principales, à un rythme quasi décennal, en 1985, 1993 et 2004. Elle fait presque chaque année l’objet d’ajustements.
PRINCIPALES MODIFICATIONS DE LA DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT (DGF) | |
1979 |
Création de la DGF des communes et des départements en remplacement du versement représentatif de la taxe sur les salaires |
1985 |
Première réforme : modification de la DGF des communes et des départements |
1991 |
Création de la dotation de solidarité urbaine (DSU). |
1993 |
Deuxième réforme : prise en compte de l’intégration intercommunale, création de la dotation de solidarité rurale (DSR). |
1996 |
Création de « l’enveloppe normée ». |
2004 |
Troisième réforme : création de la DGF des régions et de la dotation nationale de péréquation (DNP) |
2011 |
Instauration d’une fraction « cible » de la DSR pour les communes les plus défavorisées |
2015 |
Consolidation de la dotation forfaitaire des communes |
Source : Mme Christine Pires Beaune et M. Jean Germain, Pour une dotation globale de fonctionnement équitable et transparente : osons la réforme, 15 juillet 2015. | |
La dernière modification de cette architecture résulte de l’article 107 de la loi de finances pour 2015 (96), qui a procédé à une consolidation des trois dotations de la dotation forfaitaire des communes.
Compte tenu des objectifs de maîtrise de dépenses publiques, les concours financiers de l’État ont pour la première fois fait l’objet de mesures de maîtrise dans la loi de finances pour 2008 (97) : leur progression a été réduite à celle de l’inflation. L’évolution des dotations dont les taux de croissance étaient supérieurs à l’inflation était compensée par la baisse corrélative de certaines dotations, « les variables d’ajustement », dont le montant était ajusté en conséquence.
Conformément aux conclusions du premier rapport du Conseil d’orientation des finances publiques, la loi de finances pour 2009 (98) a étendu le nombre de ces variables de manière à répartir plus équitablement la charge entre elles. Elle a aussi modifié la règle d’indexation des dotations d’investissement qui sont stabilisées en valeur depuis 2009. Ces variables d’ajustement ont été élargies et incluent désormais la totalité des compensations d’exonération de fiscalité directe locale.
Les lois de finances pour 2011, 2012 et 2013 ont mis en application les engagements de maîtrise des dépenses traduits par la loi de programmation des finances publiques pour les années 2011 à 2014 (99). Son article 7 prévoyait en effet la stabilisation en valeur et à périmètre constant des concours de l’État hors fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) et dotations de compensation de la réforme de la taxe professionnelle.
Enfin, la loi de programmation des finances publiques pour les années 2012 à 2017 (100) a prévu une baisse des concours financiers de l’État aux collectivités en 2014, concentrée sur la DGF. Fixée à 750 millions d’euros dans la loi de programmation du 31 décembre 2012, cette baisse a été portée à 1,5 milliard d’euros par la loi de finances pour 2014 (101). Le pacte de confiance et de responsabilité conclu entre l’État et les collectivités du 16 juillet 2013 a parallèlement prévu des mesures de compensation au bénéfice des départements, confrontés à une hausse des dépenses sociales et une baisse des droits de mutation, dont les départements ont été autorisés à relever les taux.
La compensation des exonérations de fiscalité locale par l’État a un impact budgétaire important pour les collectivités.
EXONÉRATIONS DE FISCALITÉ LOCALE ET COMPENSATION PAR L’ÉTAT
(en millions d’euros)
AGRÉGAT |
2014 |
2015 |
2016 |
Total des exonérations de fiscalité locale décidées au niveau national |
n.c. |
n.c. |
n.c. |
Total des allocations compensatrices et dotations de compensation |
2 814 |
2 735 |
2 415 |
n.c. : le Gouvernement n’a pas été en mesure de transmettre ces informations demandées par la Rapporteure générale.
Source : annexe au projet de loi de finances pour 2016.
II. LE CONTEXTE BUDGÉTAIRE : UN EFFORT DE REDRESSEMENT DES COMPTES PUBLICS PARTAGÉ PAR L’ENSEMBLE DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES
Aux termes de l’article 11 de la loi de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019 (102), « les collectivités territoriales contribuent à l’effort de redressement des finances publiques, selon des modalités à l’élaboration desquelles elles sont associées ».
L’effort de réduction de 11 milliards d’euros de la dépense locale en trois ans s’inscrit dans un plan plus vaste de 50 milliards d’économies entre 2014 et 2019, partagées entre l’État, à hauteur de 18 milliards d’euros, et les autres administrations publiques. L’effort des administrations de sécurité sociale est de 10 milliards d’euros pour l’assurance maladie et 11 milliards d’euros pour la protection sociale.
Comme l’indique l’Observatoire des finances locales (OFL) dans son dernier rapport, les dépenses de fonctionnement des collectivités locales ont poursuivi leur augmentation en 2014, au rythme de 2,3 %, alors que les dépenses totales des collectivités diminuaient de près de 0,4 %.
ÉVOLUTION DES DÉPENSES TOTALES DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
(en milliards d’euros)
Année |
Communes et EPCI |
Départements |
Régions |
Total |
2009 |
117,7 |
68,5 |
28,0 |
214,2 |
2010 |
118,0 |
68,4 |
26,5 |
212,9 |
2011 |
122,6 |
69,6 |
27,2 |
219,4 |
2012 |
126,8 |
71,6 |
28,0 |
226,4 |
2013 |
132,5 |
72,4 |
28,7 |
233,6 |
2014 |
130,6 |
73,5 |
29,3 |
233,4 |
Source : Rapport de l’Observatoire des finances locales, Les finances des collectivités locales en 2015.
Pour les années suivantes, l’objectif d’évolution de la dépense publique locale exprimé en comptabilité générale s’établit comme suit :
TAUX D’ÉVOLUTION DE LA DÉPENSE LOCALE EN VALEUR | ||||
(en %) | ||||
Année |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
Objectif d’évolution de la dépense publique locale |
1,2 |
0,5 |
1,9 |
2,0 |
La dépense publique locale, exprimée en valeur, est définie comme la somme des dépenses réelles en comptabilité générale des sections de fonctionnement et d’investissement, nettes des amortissements d’emprunts.
Le taux d’endettement, mesuré par le ratio « dette/recettes de fonctionnement », atteint 73,2 % pour l’ensemble des collectivités. Il progresse pour tous les niveaux de collectivités depuis trois ans. Son niveau est particulièrement élevé pour le secteur communal (82,1 %) en 2014.
III. LE DISPOSITIF PROPOSÉ : BAISSE DE 3,5 MILLIARDS D’EUROS DU MONTANT DE LA DGF ET MINORATION DES ALLOCATIONS COMPENSATRICES DE FISCALITÉ DIRECTE LOCALE
Le présent projet de loi de finances propose de fixer les concours financiers de l’État aux collectivités territoriales à 50,939 milliards d’euros. Ces concours financiers regroupent les crédits de la mission RCT (3,828 milliards d’euros en autorisations d’engagement et 2,962 milliards d’euros en crédits de paiement) et les PSR en faveur des collectivités (47,111 milliards d’euros). Dotation de fonctionnement libre d’emploi, la DGF constitue la dotation la plus importante attribuée aux communes, EPCI, départements et régions.
Elle représentait 68 % des concours financiers de l’État aux collectivités prévus par la loi de finances pour 2015 (103), tandis que les crédits de la mission RCT n’en représentent que 5 %. Elle ne représente plus que 65 % de ces concours dans le présent projet de loi de finances.
Les alinéas 1eret 2 (I) de cet article inscrivent dans la loi le volume global de la DGF, à 33,108 milliards d’euros en 2016.
ÉVOLUTION DU MONTANT DE LA DGF | |||||
(en milliards d’euros) | |||||
2010 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
41,2 |
41,4 |
41,5 |
40,1 |
36,6 |
33,1 |
Source : Observatoire des finances locales. |
|||||
La répartition de la DGF entre les différents niveaux de collectivités est stable depuis 2015 :
RÉPARTITION DE LA DGF PAR CATÉGORIE DE COLLECTIVITÉ | |||||
(en milliards d’euros) | |||||
Loi de finances |
Communes |
EPCI |
Départements |
Régions |
Total |
LFI 2015 |
14,5 |
6,5 |
10,8 |
4,8 |
36,6 |
PLF 2016 |
13,2 |
5,9 |
9,6 |
4,4 |
33,1 |
Source : projet de loi de finances pour 2016, Observatoire des finances locales. | |||||
Comme l’an dernier, la fixation des montants affectés aux départements et aux régions (104) est renvoyée en seconde partie de la loi de finances, en l’espèce à l’article 58, qui détaille parallèlement la répartition de l’effort de 3,67 milliards d’euros à l’intérieur de chacun des trois niveaux de collectivités.
En revanche, les niveaux des diverses composantes internes à la dotation ne sont pas fixés en loi de finances, même si le Gouvernement peut faire connaître ses vœux. C’est en effet au Comité des finances locales (CFL), dont les prérogatives ont été restaurées par la loi de finances pour 2012 (105), qu’il appartient de décider – généralement au mois de février – de la répartition annuelle de la DGF.
La DGF supporte l’intégralité de l’effort de réduction de 3,67 milliards d’euros – en 2016 comme en 2015 – des concours financiers de l’État aux collectivités territoriales.
RÉPARTITION DES ÉCONOMIES SUR LES CONCOURS FINANCIERS DE L’ÉTAT
AUX COLLECTIVITÉS EN 2016
(montants en milliards d’euros, sauf mention contraire)
Recettes |
Bloc communal |
Départements |
Régions |
Total |
Recettes totales 2013 (fonctionnement et investissement) |
129,62 |
71,82 |
28,23 |
229,67 |
Part dans les recettes totales |
56 % |
31 % |
13 % |
100 % |
Montant de la baisse de la DGF en 2016 |
2,071 |
1,148 |
0,451 |
3,670 |
Source : évaluation préalable.
ÉVOLUTION DE LA CONTRIBUTION DES COLLECTIVITÉS AU REDRESSEMENT DES FINANCES PUBLIQUES ENTRE 2015 ET 2016 (en millions d’euros) | ||||
Année |
Régions |
Départements |
Bloc communal |
Total |
2015 |
433 |
1 108 |
2 129 |
3 670 |
2016 |
451 |
1 148 |
2 071 |
3 670 |
Source : évaluation préalable. | ||||
Les règles d’application de la minoration de DGF sont les mêmes que celles prévues par les lois de finances pour 2014 et 2015. La répartition de la contribution des collectivités au redressement des finances publiques s’effectuera pour le bloc communal au prorata des recettes réelles de fonctionnement, pour les départements en intégrant un dispositif de péréquation et pour les régions au prorata des recettes totales, avec la définition d’une quote-part pour les régions d’outre-mer.
En conséquence, le montant de la DGF atteindra 33,108 milliards d’euros (contre 36,607 milliards l’an dernier et 40,121 milliards d’euros en 2013), soit une baisse de 9,6 % sur un an. La baisse s’accélère logiquement : elle était de 8,8 % l’an dernier. La baisse de 3,67 milliards d’euros des concours financiers de l’État aux collectivités représente 1,89 % des recettes réelles de fonctionnement des collectivités en 2014 (I du présent article).
Le décalage apparent entre l’effort de réduction des concours financiers supporté par la DGF et la diminution réelle de celle-ci (à hauteur de 3,499 milliards d’euros) s’explique par un besoin de financement de la DGF de 171,5 millions d’euros, dont les éléments figurent dans le tableau ci-après.
Une partie de ce besoin de financement (la moitié de l’effort de péréquation verticale, l’évolution des dotations du fait de la hausse de population et de l’achèvement de la carte intercommunale en Île-de-France) est compensée par les mécanismes d’écrêtement internes. Ceux-ci font l’objet d’une réforme, proposée par l’article 58 du présent projet de loi de finances. Ainsi, la dotation forfaitaire rénovée ne pourrait, avant minoration pour contribution au redressement des finances publiques, être supérieure ou inférieure de 5 % à la dotation forfaitaire de l’année précédente. De plus, les communes dont le potentiel fiscal par habitant est supérieur à 75 % de la moyenne nationale verront leur dotation forfaitaire spontanée écrêtée, dans la limite de 3 % de leur dotation forfaitaire de l’année précédente.
L’autre partie du besoin de financement supplémentaire pour la DGF atteint 171 millions d’euros. La clé de passage de 2015 à 2016 de la DGF s’établit ainsi :
CLÉ DE PASSAGE DE LA DGF 2015–2016
(en millions d’euros)
Mesures |
Montants |
DGF loi de finances pour 2015 |
36 607,053 |
Financement de la moitié de la progression des dotations de péréquation verticale |
+ 158,5 |
Augmentation de la DGF effectivement répartie en 2015 par rapport à la loi de finances pour 2015 |
+ 11,4 |
Achèvement des missions de préfiguration confiées aux métropoles du Grand Paris et d’Aix-Marseille Provence |
+ 2,5 |
Recentralisation de la politique de vaccination publique en Martinique |
− 0,9 |
Effort de réduction des concours financiers de l’État aux collectivités |
− 3 670,000 |
Total inscrit à l’article 10 du présent projet de loi de finances |
33 108,514 |
Source : projet de loi de finances pour 2016. | |
1. Le besoin de financement de la DGF et des autres concours financiers sera absorbé par les variables d’ajustement afin de ne pas remettre en cause l’économie attendue de 3,67 milliards d’euros
Les alinéas 3 à 34 (II) du présent article déterminent les variables d’ajustement. L’alinéa 35 (III) leur applique un taux de minoration permettant de respecter le montant de la contribution des collectivités au redressement des finances publiques.
Outre le besoin de financement de la DGF précité, les variables d’ajustement devront gager, en 2016, les montants suivants, au sein des concours financiers :
– évolution tendancielle du FCTVA en 2016 (hausse de 12 millions d’euros) ;
– évolution tendancielle du prélèvement sur recettes de compensation des pertes de base de contribution économique territoriale (CET) et de redevance des mines en 2016 (hausse de 50,7 millions d’euros) ;
– évolution tendancielle de la mission RCT (hausse de 30,7 millions d’euros).
Certaines évolutions à la baisse doivent également prises en compte. Il s’agit :
– de la baisse spontanée des variables d’ajustement par rapport à la précédente loi de finances (192,1 millions d’euros). Cette diminution est due à la fin de la mesure temporaire d’exonération de la taxe d’habitation (TH) pour certains redevables aux revenus modestes, conformément à l’article 28 de la seconde loi de finances rectificative pour 2014 (106)) et donc à la fin de l’incidence budgétaire issue de sa compensation en 2015 ;
– de la suppression du PSR alimentant le fonds de solidarité contribuant à la réparation des dégâts causés aux biens des collectivités par des évènements climatiques ou géologiques graves, dit « fonds CatNat » (5 millions d’euros).
a. Les compensations d’exonérations et dotations de compensations d’exonérations représentent plus de 2,5 milliards d’euros en 2016
Le présent article reprend les variables d’ajustements utilisées l’année dernière, lesquelles résultent en grande partie des choix opérés dans les lois de finances pour 2008 et 2009 et étend leur périmètre à la compensation de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) et à l’exonération de CET pour les créations et extensions d’établissements dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. La compensation de l’abattement de 30 % pour les logements locatifs situés dans ces quartiers sera également soumise à minoration.
Au contraire des dégrèvements qui évoluent en fonction de l’augmentation des bases exonérées et des mesures nouvelles d’allégement de fiscalité locale, les compensations d’exonérations de fiscalité locale ne varient en principe que marginalement en fonction des taux de fiscalité locale car la plupart des compensations sont calculées sur la base de taux figés.
L’exonération de taxe d’habitation pour les personnes de condition modeste, de loin la plus importante (1,4 milliard d’euros en 2015) évolue en fonction des taux et des bases votés. Depuis 2011, la réforme de la fiscalité directe locale a affecté tant le panier d’allocations compensatrices allouées à chaque catégorie de collectivités territoriales que le calcul des allocations liées aux impôts économiques locaux et le montant global d’allocation attribué.
Il existe trois types de compensations d’exonération. La première est liée à la fiscalité directe locale en vigueur, et les deux autres résultent de la réforme de la fiscalité directe locale de 2010 pour les départements et les régions d’une part, et pour les communes d’autre part.
Comme chaque année, les compensations d’exonérations de fiscalité directe locales inscrites au projet de loi de finances sont calculées selon deux modalités différentes : les compensations auxquelles est appliqué le taux de minoration et les autres compensations.
Au total, selon la loi de finances pour 2015 (107), les compensations et les dotations de compensations s’élèvent à 2,7 milliards d’euros. Conformément au présent projet de loi de finances, elles s’élèveraient à 2,5 milliards d’euros en 2016.
Les deux tableaux ci-dessous dressent la liste des variables d’ajustement et mettent en évidence les évolutions divergentes des deux compartiments de la dotation d’exonération de fiscalité directe locale :
– le compartiment des allocations considérées comme non ajustables, qui se caractérise par son moindre dynamisme ;
– le compartiment des allocations ajustables.
L’ASSIETTE DES VARIABLES D’AJUSTEMENT EN 2015 ET 2016
(montants et prévisions en millions d’euros)
Impôts et dotations concernés |
Compensations d’exonérations et fraction |
Alinéas du présent article |
Prévision 2015 |
PLF 2016 |
Dotation |
Toutes les composantes sont ajustables |
|||
Fraction afférente à la part communale et intercommunale de la dotation de compensation de la taxe professionnelle (DCTP) définie au IV de l’article 6 de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 de finances pour 1987 figée à sa valeur 2010 |
26 et 27 (L) |
193 |
171 | |
Fraction afférente à la part communale et intercommunale de la dotation de compensation de la réduction de la fraction imposable des recettes dans la base de taxe professionnelle des titulaires de bénéfices non-commerciaux (BNC) définie à l’article 26 de la loi n° 2002-1575 du 30 décembre 2002 de finances pour 2003 figée à sa valeur 2010 |
||||
Dotation pour transfert des compensations d’exonérations de fiscalité directe locale (DTCE-FDL) |
Compartiment ajustable |
|||
Fractions des compensations d’allocations perçues jusqu’en 2010 par les départements en matière de taxe foncière sur les propriétés non-bâties et de taxe professionnelle mentionnées au dernier alinéa du XVIII du 8 de l’article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 et relatives : – aux dispositifs énumérés ci-avant (cf. CFE et DUCS-TP) en matière de taxe professionnelle – au I de l’article 9 de la loi n° 92-1376 du 30 décembre 1992 de finances pour 1993 s’agissant de l’exonération de part départementale et régionale de taxe foncière sur les propriétés non-bâties |
28 à 30 (1° du M) |
172 |
153 | |
Fractions des compensations d’allocations perçues jusqu’en 2010 par les régions en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties, de taxe foncière sur les propriétés non-bâties et de taxe professionnelle mentionnées au dernier alinéa du XIX du 8 de l’article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 et relatives : – aux dispositifs énumérés ci-avant en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe professionnelle (cf. CFE et DUCS-TP) – au I de l’article 9 de la loi n° 92-1376 du 30 décembre 1992 de finances pour 1993 s’agissant de l’exonération de part départementale et régionale de taxe foncière sur les propriétés non-bâties |
31 et 32 (2° du M) | |||
Compartiment non ajustable |
||||
– Taxe d’habitation (TH) : compensations auparavant versées aux départements ; – TFB : compensations auparavant versées aux régions ; – Taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB) : compensations auparavant versées aux régions et aux départements |
Non modifié |
483 |
483 | |
|
Compensation d’exonérations de FDL (allocations compensatrices) |
Compartiment ajustable |
|||
Voir tableau ci-dessous |
9 à 25 (D à K) |
245 |
244 | |
Compartiment non ajustable |
||||
– TFPNB : exonération des terres agricoles (part communale), zone franche globale d’activité dans les DOM ; – TFPB : zone franche globale d’activité dans les DOM ; – TH : personnes de condition modeste – CFE : zone franche globale d’activité dans les DOM, zone franche en Corse, allégement des bases de 25 % en Corse, investissement PME en Corse |
Non modifié |
155 9 1 451 45 |
139 9 1 184 47 | |
Montant total des variables ajustables |
610 |
568 |
Source : direction du budget, commission des finances.
Comme l’an dernier, les minorations ne concerneront donc pas :
– pour la cotisation foncière des entreprises (CFE) : les compensations des pertes de bases et de redevances des mines, des exonérations dans les zones franches globales d’activités des départements d’outre-mer (ZFGA-DOM) et des exonérations spécifiques à la Corse (investissement dans les PME et allégement de 25 %) ;
– pour la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) : les exonérations associées aux exonérations de CFE énoncées ci-dessus ;
– pour la TFPB : les compensations des abattements de 30 % de certains logements faisant l’objet de travaux antisismiques dans les DOM (travaux antisismiques) et des exonérations ZFGA-DOM ;
– pour la TFPNB : les compensations des exonérations des parts communales et intercommunales des terres agricoles et des exonérations dans les ZFGA-DOM ;
– pour la TH : la compensation de l’exonération des personnes de conditions modestes.
LE COMPARTIMENT AJUSTABLE DE LA DOTATION DE COMPENSATION D’EXONÉRATIONS DE FISCALITÉ DIRECTE LOCALE EN 2016
(en millions d’euros) | ||||
Impôts et dotations |
Compensations d’exonérations et fraction de dotations concernées |
Alinéas du dispositif en PLF 2016 |
Prévi |
PLF 2016 |
Taxe foncière |
Exonérations des immeubles professionnels situés dans les zones franches urbaines : articles 7 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville, 27 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances |
9 à 12 (D) |
2 |
2 |
Exonération des logements pris à bail dans les conditions des articles L. 252-1 à L. 252-4 du code de la construction et de l’habitat : articles 1384 B et 1599 ter E du code général des impôts |
5 et 6 (B) |
53 |
49 | |
Exonération des personnes de condition modeste : article 21 de la loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991 de finances pour 1992 |
7 et 8 (C) |
87 |
79 | |
Exonération de longue durée (10, 15, 20, 25 et 30 ans) relatives aux constructions neuves de logements sociaux et de 15 ans pour l’acquisition de logements sociaux : articles L. 2335-3, L. 5214-23-2, L. 5215-35 et L. 5216-8-1 du code général des collectivités territoriales |
3 et 4 (A) |
34 |
31 | |
Taxe foncière |
Exonération des terrains plantés en bois : article 6 de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d’orientation sur la forêt |
17 et 18 (G) |
4 |
4 |
Exonération des terrains situés dans un site « Natura 2000 » : article 146 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux |
||||
Exonération des terrains situés dans certaines zones humides ou naturelles : article 137 de la loi du 23 février |
||||
Cotisation foncière des entreprises |
Dotation de compensation de la réduction pour création d’établissements (RCE) : article 6-IV-bis de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 de finances pour 1987 |
19 et 20 (H) |
65 |
79 |
Exonération dans les zones de revitalisation rurale (ZRR) : articles 95 de la loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997 de finances pour 1998, 52 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire |
21 et 22 (I) | |||
Exonération dans les zones de revitalisation urbaine (ZRU) : articles 4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville | ||||
Exonération dans les zones franches urbaines (ZFU) : articles 4 de la loi du 14 novembre 1996, 27 de la loi du 1er août 2003, 29 de la loi du 31 mars 2006 précitées | ||||
Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises |
Exonérations de zones associées aux exonérations de CFE : I de l’article 33 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 |
24 et 25 K | ||
Source : direction du budget, commission des finances.
L’article 146 de la loi du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux (108), qui prévoit l’exonération de TFNB pour les terrains Natura 2000 qui font l’objet d’un engagement de gestion, a encore toute sa place dans le présent article, son abrogation, proposée par l’alinéa 15 de l’article 47 du présent projet de loi de finances ne devant entrer en vigueur qu’au 1er janvier 2021.
Les alinéas 13 et 14 (E du II) du présent article étendent ce périmètre à la compensation de l’abattement de 30 % de TFPB des logements à usage locatif situés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville prévu par l’article 1388 bis du code général des impôts (CGI). La compensation de l’abattement de 30 % de TFPB pour les logements locatifs situés dans les zones urbaines sensibles (ZUS) est déjà soumise à minoration.
Les alinéas 15 et 16 (F du II) étendent ce périmètre à la compensation de l’exonération de TFPB prévue par l’article 1383 C ter du CGI pour les immeubles situés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville pour une durée de cinq ans.
L’alinéa 23 (J du II) étend ce périmètre à la compensation de l’exonération de cotisation foncière des entreprises mentionnée au I septies de l’article 1466 A du CGI pour les établissements qui font l’objet d’une création ou d’une extension entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2020 dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville définis à l’article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, ainsi que les établissements existant au 1er janvier 2015 situés dans ces mêmes quartiers sont exonérés de cotisation foncière des entreprises dans la limite du montant de base nette imposable fixé, pour 2015, à 77 089 euros et actualisé chaque année en fonction de la variation de l’indice des prix.
L’ajustement du périmètre, c’est-à-dire la minoration que le présent article propose d’appliquer aux variables, est égal à la différence entre l’ensemble de ces variables en valeur 2015 et le montant disponible pour le même ensemble dans le périmètre pour 2016, après progression de tous les autres concours.
Le taux de minoration des variables se déduit donc de l’ensemble des autres mouvements qui affectent les composantes de l’enveloppe normée ; les éventuels changements de périmètre ne sont, en revanche, pas reportés sur les variables.
L’alinéa 35 (III) du présent article détaille la clé de passage entre le montant total des variables tel que chiffré dans la prévision d’exécution pour 2015, et le montant nécessaire pour stabiliser l’enveloppe normée, soit 524,3 millions d’euros. La différence, soit 30 millions d’euros, constitue le montant de minoration des variables d’ajustement en 2015 et il permet de déduire un taux de minoration de qui devrait être de 5,4 %, exprimé par référence au montant des variables inscrit en loi de finances pour 2015, c’est-à-dire 554,3 millions d’euros.
Ce taux de 5,4 % est très largement inférieur au taux de 39 % prévu par la loi de finances pour 2015. En 2014, ce taux avait atteint 36 %.
La différence tient largement à la baisse spontanée des variables d’ajustement par rapport à la précédente loi de finances de 192,1 millions d’euros. Cette diminution est due à la fin de la mesure temporaire d’exonération de la taxe d’habitation pour certains redevables aux revenus modestes.
Les effets du taux de 5,4 % se cumulent avec ceux votés les années précédentes. Les alinéas 3 à 34 (II) appliquent ce taux à chacune des variables. Ils consistent en l’inscription uniforme d’une règle de minoration dans chacun des dispositifs juridiques prévoyant une compensation d’exonération ajustée, ou dans chacune des dotations ajustées.
La Rapporteure générale observe que le montant total voté des variables atteignait encore 1 037,1 millions d’euros en 2013 et 837,7 millions en 2014. Il était de 554,4 millions d’euros en 2015 et serait de 524,3 millions d’euros en 2016.
Le dispositif proposé par l’article 58 du présent projet de loi de finances, rattaché à la mission RCT, vise d’abord à réduire les écarts de dotation les moins légitimes, largement hérités de la stratification des réformes successives de la DGF et de la fiscalité locale. Il s’agit de mieux prendre en compte les charges de ruralité et les charges centralité des communes et des EPCI, ces dernières étant appréciées au niveau local. La réforme vise ensuite à inciter les territoires à renforcer leur intégration, fiscale comme fonctionnelle et les mutualisations. Enfin, la nécessité de simplifier l’architecture de la DGF fait consensus.
Ces mesures reprennent largement les propositions de la mission conduite par le sénateur Jean Germain et notre collègue Christine Pires Beaune (109), publiées le 15 juillet 2015.
● La dotation forfaitaire rénovée des communes comprendrait trois composantes :
– une dotation de base calculée pour chaque commune en fonction d’un montant unitaire par habitant, identique pour toutes les communes, fixé à 75,72 euros ;
– une dotation pour charges de ruralité sur la base de la densité démographique des communes, avec un montant moyen de 20 euros par habitant ;
– une dotation pour charges de centralité, appréciée au niveau local (EPCI et ensemble de ses communes membres), sur la base de la population d’une commune rapportée à la population de l’EPCI d’appartenance.
● Les dotations de péréquation des communes seraient revues.
– La dotation nationale de péréquation (DNP) serait supprimée et ses montants redistribués au profit de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale (DSU) et de la dotation de solidarité rurale (DSR). Dans la répartition 2015, seules 79 communes sont éligibles uniquement à la DNP.
– Le ciblage de la DSU et de la DSR serait renforcé : la part des communes de plus de 10 000 habitants éligibles à la DSU et de moins de 10 000 habitants éligibles à la DSR passerait des trois quarts aux deux tiers.
– La DSR serait composée de deux et non plus de trois fractions : la fraction en faveur des bourg-centres serait maintenue, tandis que les fractions cible et péréquation seraient fusionnées. Des critères différents seraient pris en compte pour l’éligibilité à cette fraction fusionnée et l’attribution de son montant.
– La DSU se composerait d’une dotation de base égale au montant perçu l’année précédente et d’un reliquat (la hausse annuelle de DSU) réparti en fonction de critères multiples.
● S’agissant des EPCI, la dotation d’intercommunalité et la dotation de compensation seraient fusionnées en une dotation globale de fonctionnement des EPCI, également répartie en trois composantes :
– une dotation locale de centralité calculée au niveau du territoire de l’EPCI (653 millions d’euros en 2016) ;
– une composante péréquatrice (3,2 milliards d’euros en 2016) ;
– une composante favorisant l’intégration (1,4 milliard d’euros en 2016).
Cette fusion permettrait de faire peser la contribution au redressement des finances publiques sur une assiette plus large.
La réforme consacrerait l’abandon du calcul d’enveloppes différentes en fonction des catégories juridiques d’EPCI. Elle prendrait en compte le coefficient d’intégration fiscale (CIF) pour le calcul et la répartition des trois dotations.
● Pour les communes et les EPCI, le dispositif proposé est encadré par une garantie et un plafonnement à 95 % et 105 % de la DGF perçue l’année précédente.
Un plafonnement spécifique est par ailleurs prévu pour certaines dotations : ainsi, l’attribution de la fraction péréquation rénovée de la DSR ne peut représenter moins de 95 % et plus de 120 % du montant perçu l’année précédente au titre des fractions cible et péréquation de la DSR ainsi que de la DNP.
ARCHITECTURE DE LA DGF DU BLOC COMMUNAL EN 2016
APRES RÉFORME
(en millions d’euros) | ||
Dotation |
Montant | |
DGF du bloc communal |
19 904 | |
Dotation forfaitaire des communes |
9 221 | |
dont |
dotation de centralité |
1 650 |
dotation de ruralité |
272 | |
dotation de base |
5 359 | |
garantie de baisse limitée et de hausse limitée |
3 538 | |
financement de la péréquation |
– 148,5 | |
contribution au redressement des finances publiques |
– 1 450 | |
Dotation d’aménagement |
9 873 | |
dont |
dotations de péréquation |
3 947 |
dont DSU |
2 251 | |
dont DSR |
1 696 | |
dont |
DGF des EPCI |
5 926 |
|
dont dotation de centralité |
653 |
dont dotation de péréquation |
3 235 | |
dont dotation d’intégration |
1 387 | |
dont garantie de baisse limitée et de hausse limitée |
1 272 | |
dont contribution au redressement des finances publiques |
– 621 | |
Source : projet de loi de finances pour 2016. | ||
2. La réforme pour le bloc communal atténue l’impact de la contribution au redressement des finances publiques et réduit les écarts-types de dotation forfaitaire par habitant en 2015
Le détail de l’impact de la réforme proposée par l’article 58 précité figure dans le rapport spécial consacré à la mission RCT.
Le cumul de la réforme de la DGF du bloc communal et de la contribution au redressement des finances publiques (CRFP) implique une baisse moyenne de DGF de 1,65 % des recettes réelles de fonctionnement (RRF) des communes.
5 415 communes verront leur DGF augmenter en 2016 malgré la CRFP. À l’inverse, 31 329 communes subiront une baisse de DGF. Pour 20 897 communes, la baisse sera inférieure ou égale à 1,84 % des RRF.
Pour 72 % des communes, la progression de la péréquation et la réforme de la DGF permettent de réduire la CRFP. Pour 28 % des communes, la baisse de DGF 2016 est comprise entre 1,84 % et 5 % des RRF. Pour 94 communes, la baisse de DGF est supérieure à 5 % des RRF.
S’agissant des EPCI, la baisse moyenne de la DGF représente 2,51 % de leurs RRF. La baisse est inférieure à cette moyenne pour 1 703 EPCI, soit 80 % d’entre eux. 423 EPCI enregistreraient une baisse de DGF comprise entre 2,51 % et 5 % de leurs RRF et dix EPCI une baisse de DGF de plus de 5 % de leurs RRF.
IV. IMPACT ÉCONOMIQUE : LA BAISSE DES CONCOURS FINANCIERS DE L’ÉTAT AUX COLLECTIVITÉS TERRITORIALES POURRAIT PÉNALISER L’INVESTISSEMENT PUBLIC
Comme l’indique le dernier rapport de l’Observatoire des finances locales (110), les dépenses de fonctionnement des collectivités locales ont poursuivi en 2014 leur augmentation, au rythme de 2,3 %, alors que les dépenses totales des collectivités diminuaient de près de 0,4 %. L’évolution des dépenses de fonctionnement marque toutefois un ralentissement par rapport aux trois années antérieures.
ÉVOLUTION DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
(en milliards d’euros)
Année |
Communes et EPCI |
Départements |
Régions |
Total |
2009 |
75,7 |
50,3 |
15,5 |
141,5 |
2010 |
77,0 |
52,1 |
15,8 |
144,9 |
2011 |
79,1 |
53,5 |
16,1 |
148,7 |
2012 |
81,7 |
55,3 |
16,6 |
153,6 |
2013 |
84,4 |
56,7 |
17,0 |
158,1 |
2014 |
89,3 |
59,3 |
17,8 |
166,5 |
Source : Rapport de l’observatoire des finances locales, Les finances des collectivités locales en 2015.
Depuis trois ans, les dépenses de personnel restent le poste le plus dynamique. Elles progressent à un rythme plus rapide en 2014 (+ 4,1 %), alors que les transferts de compétences liés à la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales (111) sont achevés et que le point d’indice de la fonction publique reste également gelé en valeur depuis juillet 2010. Cette hausse des frais de personnel est imputable pour plus des deux tiers à la hausse des taux de contributions à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) et à la revalorisation des carrières des agents des catégories B et C. La Rapporteure générale souligne toutefois que les effectifs des collectivités territoriales ont continué à progresser en 2013 et en 2014. Cette progression, tient en partie, à la mise en place des nouveaux rythmes scolaires.
En 2014, les dépenses d’investissement des collectivités locales se sont élevées à 54,1 milliards d’euros (hors remboursement de la dette). Ce montant traduit une baisse de 7,8 %, particulièrement prononcée dans le secteur communal (– 11,4 %). Seul l’investissement des régions a progressé (+ 4,1 %).
Si l’année qui suit les élections municipales est généralement marquée par une baisse de l’investissement réalisé, la diminution des investissements tient aussi à une baisse de l’épargne brute. Les collectivités locales doivent s’endetter pour financer leur investissement. Leur endettement a cru de 2,9 % en 2014, atteignant 141,5 milliards d’euros.
Les premières indications disponibles sur les budgets locaux 2015, mentionnées dans un avis du Conseil économique, social et environnemental présenté en juillet 2015 par M. Didier Ridoret (112), montrent un tassement des dépenses de fonctionnement (+ 2,3 % en 2014 et + 1,7 % prévu pour 2015), une hausse des dépenses d’intervention sociale (+ 2,8 % en 2014 et + 2,2 % anticipé pour 2015), mais surtout un vif recul de l’investissement, qui plus est, deux années de suite (− 8,6 % en 2014, puis encore − 7,3 % en 2015).
Sur la base des observations passées, la Rapporteure générale craint que l’année 2016 puisse être marquée par la poursuite de la baisse de l’investissement des collectivités locales.
ÉVOLUTION DES DÉPENSES D’INVESTISSEMENT DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
(en milliards d’euros)
Année |
Communes et EPCI |
Départements |
Régions |
Total |
2009 |
39,2 |
17,4 |
12,0 |
68,6 |
2010 |
38,3 |
15,5 |
10,2 |
64,0 |
2011 |
40,6 |
15,2 |
10,5 |
66,3 |
2012 |
42,1 |
15,3 |
10,8 |
68,2 |
2013 |
45,2 |
14,7 |
11,1 |
71,0 |
2014 |
41,2 |
14,2 |
11,4 |
66,8 |
Evol. 2014/2013 |
− 9,6 % |
− 4,2 % |
+ 2,8 % |
− 6,5 % |
Source : Observatoire des finances locales.
Les associations d’élus du bloc communal attribuent à la diminution de la DGF la baisse de l’investissement des communes et des intercommunalités de 12,4 % en 2014, avec une perte sèche de 4,3 milliards d’euros pour le tissu économique local. Elles estiment qu’à droit constant, l’investissement du bloc communal devrait chuter de 30 % environ d’ici 2017, du fait de la baisse des dotations et du poids croissant des normes. Leur autofinancement diminuerait fortement, de de 9,7 milliards d’euros en 2013 à un milliard en 2017. La perte pourrait s’élever à 0,6 % du PIB.
Auditionné par la commission d’enquête visant à évaluer les conséquences sur l’investissement public et les services publics de proximité de la baisse des dotations de l’État aux communes et aux EPCI, créée par l’Assemblée nationale pour six mois le 23 juin 2015, M. Alain Piquet, vice-président de la Fédération française du bâtiment (FFB) indiquait qu’en 2014, la commande publique des collectivités territoriales représentait 20 % de l’activité des entreprises du secteur, occupant 240 000 des 1 200 000 salariés, intérimaires compris. La même année, le secteur du bâtiment a perdu 9 à 10 % de l’activité en commande publique, soit à peu près 20 000 salariés. Il attribuait la moitié des pertes d’emploi que le secteur du bâtiment a connues en 2014 à la baisse de la commande publique. Se fondant sur des projections réalisées à la fin mai 2015, il estimait que la commande publique perdrait à nouveau entre 8 à 13 % de son volume en 2015, dans que les commandes privées ne prennent le relais.
Tout en admettant la difficulté d’apprécier exactement l’impact de la baisse des dotations, M. Bruno Cavagné, président de la Fédération nationale des travaux publics (FNTP), soulignait dans le même cadre que l’activité en France des entreprises de travaux publics représente 40 milliards d’euros, dont 45 % en réponse à des marchés passés par les collectivités. En 2014, leur activité a baissé de 5 %. La baisse est estimée à 8 % en 2015 comme en 2016.
Afin de préserver l’investissement des collectivités territoriales, le Gouvernement et le Parlement ont décidé de plusieurs mesures, applicables dès 2015 :
− majoration de 200 millions d’euros de la dotation d’équipement pour les territoires ruraux (DETR) ;
− augmentation du taux de remboursement du FCTVA, à l’initiative de la Rapporteure générale, pour un montant estimé à 300 millions d’euros en année pleine ;
Plusieurs mesures concourraient à soutenir à l’investissement en 2016 :
– création d’un fonds de soutien à l’investissement local doté d’un milliard d’euros, consacré à 50 % au financement de grandes priorités : mobilité, rénovation thermique, énergies renouvelables, équipement numérique, accueil de populations nouvelles et à 50 % aux territoires ruraux et aux villes petites et moyennes, notamment à la revitalisation des bourgs-centres (article 59 du présent projet de loi de finances) ;
− élargissement du FCTVA aux dépenses d’entretien des bâtiments publics, pour 143 millions d’euros en année pleine (article 11 du présent projet de loi de finances) ;
− mise en place d’un fonds de 100 millions d’euros pour les maires bâtisseurs, destiné à soutenir la construction de logements au-delà du taux de croissance normal du parc existant (1 %) ;
– l’État contractualisera une enveloppe totale de 12,5 milliards d’euros pour les contrats de plan État-régions, qui mobiliseront 25 milliards d’euros jusqu’en 2020.
*
* *
La commission étudie l’amendement I-CF 162 de M. Laurent Baumel.
M. Laurent Baumel. Cet amendement vise à rétablir le montant de la dotation globale de fonctionnement (DGF) à son niveau de 2014. Il procède de la conviction que cette politique de stagnation puis de baisse des dotations aux collectivités, qui a commencé sous la présidence de Nicolas Sarkozy et se poursuit sous celle de François Hollande, est erronée. Elle est préjudiciable à notre économie et à notre société.
Sur le plan intellectuel, je récuse la justification de cette politique par la rhétorique de l’effort partagé entre les collectivités locales pour réduire les déficits. Dans cette période, l’État ne fait pas que réduire les déficits, il baisse aussi de façon massive les impôts et cotisations des entreprises. Je veux redire ici que le choix d’attribuer des milliards d’euros à des entreprises qui n’en ont pas forcément besoin et n’en font pas forcément un usage utile, par des baisses de dotations à des collectivités dont les dépenses d’investissement sont vitales dans nos territoires pour le secteur du BTP, reste, à mes yeux, la marque d’une politique économique irrationnelle et dont on constate qu’elle n’est pas réellement efficace.
Je récuse également l’approche quelque peu paternaliste, voire punitive, consistant à considérer que cette baisse des dotations aux collectivités locales trop dispendieuses sera l’occasion de les obliger à ordonner leurs propres dépenses. Les quelques exemples de gabegie exhumés par les médias ne doivent pas masquer la réalité de ces milliers de petites et moyennes collectivités locales qui se battent au quotidien depuis des années avec des budgets serrés pour tenter de préserver et d’améliorer la qualité de vie de nos concitoyens.
Sur un plan plus politique, je suis attristé de constater que ma propre famille politique, qui a géré avec passion et succès depuis des décennies nombre de communes et de régions, se résigne peu à peu à mettre en œuvre la vision d’une technostructure d’État coupée des réalités de terrain. Lorsqu’il y a une inondation ou un problème dans un quartier, ce ne sont pas ceux qui rédigent des rapports sur la nécessaire maîtrise des dépenses locales qui se lèvent la nuit pour être aux côtés des populations, mais les milliers d’élus locaux qui font la force et la cohésion du tissu social français. Ils ont aujourd’hui besoin d’être résolument encouragés et soutenus plutôt que découragés ou montrés du doigt.
J’entends qu’il y aura dans ce projet de loi de finances pour 2016 une réforme de la péréquation et un nouveau fonds d’aide à l’investissement. Mais plutôt que de passer beaucoup de temps à corriger à la marge les erreurs des lois de finances précédentes, à redonner d’une main une petite partie des sommes que nous prenons de l’autre, je propose que nous fassions collectivement le choix politique, en tant que représentants de la Nation, d’apporter à nos collectivités locales le soutien qu’elles méritent et attendent de nous.
Mme la Rapporteure générale. Je ne reprendrai pas l’argument de l’équilibre budgétaire, engagé par cet amendement qui coûte 7 milliards d’euros et qui nous ferait largement dévier de la trajectoire que nous avons adoptée ce matin dans l’article liminaire. Avis défavorable.
M. Alain Fauré. Je peux entendre les arguments avancés par Laurent Baumel, je veux bien la dramatisation, mais pas les allusions à ceux qui ne se lèveraient pas la nuit. Qu’il parle de lui seulement !
En ce qui concerne l’amélioration de la gestion des collectivités, puisqu’il se déplace sur les territoires, je l’invite à compter le nombre d’hectares équipés qui attendent en vain des entreprises, et bien d’autres choses de cet ordre. Il y a donc bien lieu d’être attentif aux dépenses sur notre territoire. D’ailleurs, dans le cadre des auditions que conduit la commission d’enquête visant à évaluer les conséquences sur l’investissement public et les services publics de proximité de la baisse des dotations de l’État aux communes et aux EPCI, nous entendons des collectivités et des associations qui reconnaissent être plus efficaces lorsque la dépense est contrainte. Je ne peux donc pas partager cette présentation des choses et voterai contre cet amendement.
M. Pascal Cherki. Certains collègues s’offusquent, mais la commission des finances ne traite pas que de sujets techniques ; il est normal et pas du tout choquant que nous ayons parfois des discussions politiques. Cet amendement concerne la question essentielle de l’intervention des collectivités locales et des concours que l’État est susceptible de leur apporter. Sur ce sujet, les nuances et désaccords sont connus. Je soutiens mon collègue Laurent Baumel qui pose, dès l’examen en commission, un débat qui aura aussi lieu dans l’hémicycle. Il est inutile de se crisper, et je constate d’ailleurs que cette question concerne les rangs de toutes les formations politiques.
La commission rejette l’amendement I-CF 162.
Puis elle est saisie de l’amendement I-CF 111 de M. Charles de Courson.
M. Charles de Courson. Nous sommes des gens raisonnables. Lorsque nous étions dans la majorité, je préconisais une baisse lente, de 1 % ou 2 % ; dans l’opposition, nous ne changeons pas de position : au lieu de 10 %, nous proposons une baisse continue qui permet de s’ajuster et de faire les réformes, ce qui est une position sage.
Suivant l’avis défavorable de la Rapporteure générale, la commission rejette l’amendement I-CF 111.
Elle examine ensuite les amendements identiques I-CF 75 du président Gilles Carrez et I-CF 64 de M. Hervé Mariton.
M. le président Gilles Carrez. Cet amendement vise à prendre en compte, dans la réduction de la DGF, les dépenses qui ont été imposées aux collectivités locales par l’État. Ces dépenses résultent soit de décisions telles celles concernant les rythmes scolaires, soit de normes continuant de déferler sur les collectivités locales. Chaque année, elles sont évaluées de façon précise par la Commission consultative d’évaluation des normes (CCEN), et ma proposition consiste à diminuer la réduction de DGF à hauteur de ces dépenses nouvelles imposées aux collectivités locales depuis l’extérieur.
Je m’inscris là dans la position que j’ai toujours défendue dans cette commission. Dès 2002, j’ai été partisan de freiner l’évolution des dotations, car je l’estimais trop rapide. À plusieurs reprises, j’ai déploré que l’on s’expose à une situation qui, malheureusement, est advenue. À force de ne pas traiter le sujet en amont et de façon très progressive, on en vient à des réductions d’une brutalité inouïe – 11 milliards d’euros en trois ans –, qui ne permettent pas aux collectivités de s’adapter. Dans l’urgence, c’est dans les dépenses d’investissement que l’on coupe. Les chiffres de l’investissement commencent à être très préoccupants : ils ont chuté de près de 10 % en 2014 alors que la réduction de DGF n’avait été que de 1,5 milliard d’euros ; en 2015, je crains que les 10 % soient dépassés, mais ce sont 10 % d’une base déjà réduite d’autant par rapport à 2013. J’ai toujours considéré qu’en matière de finances locales, chi va piano va sano est le précepte à adopter pour faire évoluer les choses. Faute de quoi, nous sommes confrontés à une brutalité, aggravée par le fait, qu’au même moment, des dépenses nouvelles sont imposées, et cela est insupportable.
M. Hervé Mariton. Nous sommes nombreux à penser qu’il y a aujourd’hui un problème de rythme et d’ampleur, tout en convenant que la participation des collectivités locales à un mouvement général de maîtrise de la dépense publique a un sens et est nécessaire. Simplement, l’évolution des normes et la complexité administrative constituent un problème à prendre en compte.
Nous disposons du travail de la Commission consultative d’évaluation des normes ainsi que des travaux très documentés de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) sur le coût de la complexité administrative dans notre pays. Il serait cohérent que le Gouvernement, en même temps qu’il demande un effort aux collectivités, se dote d’une feuille de route précise, évaluée et opérationnelle d’engagement d’actions de simplification des normes. Je ne crois pas que cet engagement existe ; la Rapporteure générale peut-elle nous renseigner à ce sujet ? Quelle est notre capacité à obtenir davantage du Gouvernement dans ce domaine ?
Mme Christine Pires Beaune. S’agissant des normes, il me semble que l’engagement serait tenu : pour le premier semestre 2015, l’accroissement se limiterait à 18 millions d’euros, à rapporter au milliard d’euros de l’année précédente.
M. Alain Fauré. Puisque notre débat est public, chacun se souviendra de cet appel à un adoucissement de la participation des collectivités locales au redressement des finances publiques. Après cela, il va être assez surprenant d’accompagner des baisses de 120 ou 130 milliards d’euros de budgets prévues dans les programmes développés par les formations politiques des uns et des autres et diffusés dans la presse. Il faudra bien trouver où y procéder. Prenons garde à ne pas faire de promesses que nous ne pourrions pas tenir !
Cette diminution des dotations fait suite à la suppression de la taxe professionnelle qui alimentait les collectivités. Dans les communes où il y avait de l’investissement qui apportait du dynamisme, celui-ci était accompagné de recettes. Hélas ! en 2010, des choses ont été changées. On l’a dit, il faut être prudent lorsque l’on prend des décisions, même si, sur le plan des activités industrielles, cela avait un sens.
Le Gouvernement demande un effort mesuré, qui ne va pas au-delà du supportable et est étalé dans le temps. Pour ces raisons, je me prononcerai contre l’amendement comme, probablement le groupe socialiste, républicain et citoyen.
M. Michel Vergnier. L’affaire est sérieuse, et nous ne réclamons pas des choses que nous ne maîtrisons pas au fond. La gestion des collectivités locales, nous connaissons, et depuis longtemps pour certains. Pour ma part, je connais sur le bout des doigts la situation financière de la ville que j’ai l’honneur de gérer. Les demandes d’atténuation et d’allongement dans le temps étaient justifiées.
Cela dit, j’ai vu avec plaisir le Gouvernement se saisir de la réforme de la DGF et j’attends avec impatience le résultat de ce travail. Il ne s’agit pas de se plaindre en faisant des collectivités une généralité. On a un peu trop oublié que chacune d’entre elle est un cas particulier, par sa situation géographique, sa richesse et ses ressources. On ne peut pas traiter par la DGF les collectivités territoriales de la même façon, alors que l’effort demandé était uniforme – je dis « était », car il me semble que les choses aient changé. Il faut que les collectivités participent à l’effort national, personne n’a jamais dit le contraire. Mais il faut aussi que leur situation soit prise en compte, peut-être pas de façon individuelle, mais par strates de population, en tenant compte des charges de centralité, des choses qui s’imposent à nous, des charges que l’État nous a imposées.
Dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires, certaines collectivités territoriales ont choisi la facilité en ne mettant rien en place, sinon la garde d’enfants qui ne coûte pas cher. D’autres, et c’est notre cas, en ont profité pour en faire un vecteur de lutte contre les inégalités sociales. Ainsi, aujourd’hui, 90 % de nos enfants participent aux activités périscolaires alors que beaucoup n’y avaient pas accès auparavant. Nous ne rechignons pas, nous estimons même que cela constitue un progrès social important.
Je félicite le Gouvernement pour sa réforme de la DGF. J’en attends des résultats d’équité pour les collectivités, car il faut réformer dans la justice. C’est une phrase que j’ai entendue dans la bouche du Président de la République, et elle me convient très bien.
M. Jean-Louis Gagnaire. Il faudra considérer les effets de la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, dite « NOTRe ». Ce texte prévoit des transferts de compétences des départements aux régions, par exemple, qui ne sont pas totalement financés, et les transferts de fiscalité d’un niveau à l’autre ne couvrent pas toutes les dépenses.
Le transfert au 1er janvier 2016 de l’accompagnement du développement économique et de l’innovation, si l’on n’y prend pas garde, sera en panne. De fait, ni les agglomérations, ni les intercommunalités, ni les régions ne seront en capacité d’accomplir ce que les départements ne pourront plus faire. Lors de l’examen du projet de loi, la ministre avait indiqué que la loi de finances prévoirait des transferts de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE). Cela ne suffira pas et les régions évaluent les besoins à au moins 500 millions d’euros. Il faut donc réfléchir aux transferts de l’État vers les collectivités, mais aussi aux transferts importants entre collectivités résultant de la mise en œuvre de la « loi NOTRe ».
Cela doit avoir lieu dans un contexte de réduction des dépenses, et toute structure bien gérée doit pouvoir réduire ses dépenses de fonctionnement. Or, la réalité des chiffres n’est pas toujours celle qui est présentée par telle ou telle association d’élus ou de collectivités.
La commission rejette les amendements I-CF 75 et I-CF 64.
Suivant l’avis défavorable de la Rapporteure générale, elle rejette ensuite l’amendement I-CF 112 de M. Charles de Courson.
Puis elle discute de l’amendement I-CF 347 de M. François Pupponi.
M. Marc Goua. Certaines communes présentent la particularité d’avoir beaucoup de logements sociaux ; elles sont éligibles à la dotation de solidarité urbaine (DSU) cible. Ces 250 communes de plus de 10 000 habitants et les trente premières communes dans la tranche de 5 000 à 9 999 habitants ont bénéficié d’un abattement de 30 % sur la taxe foncière au profit des organismes HLM et bailleurs sociaux. Or, alors que ces communes sont déjà en grande difficulté, elles subiront et la baisse de la compensation et la diminution de la DGF. L’effort de péréquation prévu ne suffira pas à compenser, aussi demandons-nous que cette compensation soit appliquée comme par le passé.
Mme la Rapporteure générale. L’objectif du Gouvernement est plutôt d’élargir le champ des variables d’ajustement que de le réduire, mon avis est donc défavorable.
M. le président Gilles Carrez. Cet amendement aurait aussi pour effet d’augmenter la DSU.
M. Marc Goua. Il est tout de même paradoxal que des collectivités avec des taux importants de logements sociaux, et tous les problèmes que cela peut parfois poser, se voient appliquer une double, voire triple, peine en étant contraintes de prendre des exonérations en charge. Cela est totalement contraire à l’engagement pris par le Premier ministre lors de la présentation du programme de stabilité, selon lequel ces collectivités seraient exonérées de l’effort global demandé.
M. le rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques. Nous votons des exonérations et des abattements censés être compensés. Or, la compensation de 17 % dont on nous parle, ce n’est plus une compensation. De fait, ce sont les collectivités locales qui paient. Que l’on décide d’exonération à la place des collectivités territoriales, particulièrement pour les communes les plus pauvres, me pose problème : soit l’État compense complètement, et il peut alors décider l’exonération, soit il ne le fait pas, et la commune concernée doit au moins disposer d’un droit de veto. Certaines communes peuvent, en effet, refuser de perdre des recettes au profit des bailleurs sociaux ; cela relève de leur choix. En l’occurrence, on procure des avantages fiscaux aux bailleurs sociaux sur le dos des communes.
Cette pratique pose un problème juridique et déontologique. Dans ces conditions, qu’on ne parle plus de compensation et qu’on assume de décider pour la commune ! Il faudrait au moins que l’exonération ou l’abattement soit utilisé avec l’accord du maire, sinon l’État décide à la fois de l’abattement et de l’utilisation de la somme avec le bailleur, tout cela avec de l’argent qui provient du budget des communes. Nous proposons qu’il y ait une compensation au moins pour les communes les plus pauvres, puisqu’elles sont pénalisées par l’abattement. Qui plus est, l’effort fait à travers la DSU est neutralisé par la baisse de la compensation.
La commission rejette l’amendement I-CF 347.
Puis elle est saisie de l’amendement I-CF 348 de M. François Pupponi.
M. Marc Goua. Nous demandons que soit maintenue intégralement la compensation de l’exonération de la taxe foncière sur les logements sociaux prévue à l’article 1383 C du code général des impôts. En conséquence, nous proposons de supprimer la minoration de cette compensation prévue à l’article 10. Sinon, les communes qui hébergent 50 % ou 60 % de ces logements connaîtront de graves difficultés.
M. le rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques. L’année dernière, en séance publique, la compensation intégrale avait été votée après accord du Gouvernement. Aujourd’hui, au détour de l’article 10, on revient sur cet engagement. Ce n’est pas très correct.
Mme la Rapporteure générale. Monsieur Pupponi a raison, et je me souviens de l’engagement pris. Qui dit compensation, dit répartition du montant sur d’autres ; cela est toujours payé par quelqu’un. Je pensais avoir compris que le montant de la compensation de 34 millions d’euros serait diminué de 1,8 million d’euros. Confirmez-vous ce chiffre ?
M. le rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques. Une des difficultés rencontrées est que la direction générale des finances publiques (DGFiP) n’est pas en mesure d’apprécier le montant précis des abattements par commune, et donc de calculer la compensation. Les chiffres présentent la globalité de la masse des abattements et la façon dont ils sont compensés. La DGFiP n’est pas capable d’établir le détail des montants concernés, elle ne sera pas en mesure de vous les fournir. Cela est problématique, car nous devrions savoir qui est exonéré ou qui bénéficie d’abattement, immeuble par immeuble et quel est le montant de la compensation. Non seulement, à l’échelon national, la compensation est théorique et largement inférieure à l’exonération, mais, localement, personne n’est en mesure de dire comment on fait.
Mme la Rapporteure générale. Je m’en remets à la sagesse de la commission.
Mme Véronique Louwagie. Il y a là une question de moralité : si un engagement de compensation intégrale a été pris l’année dernière par le Gouvernement, il doit être respecté.
Nous parlons ici de quartiers prioritaires de la politique de la ville. Il faut conserver à l’esprit que les communes comprenant ce type de quartiers connaissent déjà des difficultés sur tout ou partie de leur territoire. Si, d’un côté, on les aide en leur ouvrant droit à toutes les aides de la politique de la ville, et que, d’un autre côté, on les pénalise par d’autres dispositions, où est la logique ?
La commission adopte l’amendement I-CF 348.
Elle est ensuite saisie de l’amendement I-CF 346 de M. François Pupponi.
M. Marc Goua. Dans la même logique que l’amendement précédent, l’amendement I-CF 346 vise à geler l’exonération de cotisation foncière consentie aux entreprises pour faciliter leur implantation dans les zones franches urbaines-territoires entrepreneurs.
M. le président Gilles Carrez. Ce n’est pas la même chose : en la matière, il n’y a pas eu d’engagement.
Mme la Rapporteure générale. Cet amendement ne s’inscrit effectivement pas tout à fait dans la même logique que le précédent, puisqu’aucun engagement n’a été pris sur le sujet auquel il se rapporte. Je vous invite, par conséquent, à le retirer pour le redéposer ultérieurement en séance.
M. Marc Goua. N’est-il pas normal que les zones franches exonérées par l’État bénéficient d’une compensation par l’État ? Si c’est aux collectivités, déjà confrontées à des difficultés, qu’il revient d’effectuer cette compensation, cela risque d’être difficile. Nous retirons cet amendement et le représenterons plus tard.
L’amendement I-CF 346 est retiré.
La commission examine ensuite l’amendement I-CF 345 de M. François Pupponi.
M. Marc Goua. Cet amendement est encore inspiré par la même logique, appliquée cette fois aux quartiers prioritaires de la politique de la ville, pour lesquels un engagement a bien été pris.
Mme la Rapporteure générale. Sagesse.
M. Charles de Courson. Mes chers collègues, vous devez avoir conscience que l’adoption de ces amendements va forcément se traduire par des durcissements sur d’autres postes, puisqu’ils se trouvent tous dans une enveloppe fermée.
M. Marc Goua. Il ne s’agit pas d’une dépense supplémentaire, mais d’une suppression de la minoration de compensation prévue.
M. Charles de Courson. Cela va bien s’imputer sur une enveloppe fermée, et nécessitera de réduire d’autres dotations en compensation.
La commission rejette l’amendement I-CF 345.
Puis elle adopte l’article 10 modifié.
*
* *
Article 11
Élargissement du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) aux dépenses d’entretien des bâtiments publics
Via le fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA), l’État rembourse aux collectivités locales la TVA qu’elles acquittent sur leurs dépenses d’investissement.
Le présent article vise à étendre la liste des dépenses éligibles à cette compensation, aux dépenses d’entretien des bâtiments jusqu’alors inéligibles. Le montant est estimé à 12 millions d’euros en 2016, 109 millions d’euros en 2017 et 143 millions d’euros en 2018.
La commission a adopté un amendement y ajoutant les dépenses d’entretien de voirie.
I. L’ÉTAT DU DROIT
A. COMPENSANT L’ABSENCE DE DROIT À DÉDUCTION DE TVA DES COLLECTIVITÉS, LE FCTVA CONCOURT À LEURS DÉPENSES D’INVESTISSEMENT
Les collectivités territoriales, qui ne sont pas assujetties à la TVA, ne disposent pas d’un droit à déduction de cette taxe qui a grevé leurs achats, comme tout consommateur final.
Le FCTVA a été créé par la loi de finances pour 1978 (113), succédant au Fonds d’équipement des collectivités locales (FECL). Il vise à compenser, de manière forfaitaire, la TVA supportée par les collectivités territoriales et certains établissements publics locaux (114), en fonction de leurs dépenses réelles d’investissement éligibles, sous réserve, notamment, que la TVA n’ait pas été récupérée par la voie fiscale, c’est-à-dire acquittée par un tiers. Il ne peut donc pas être considéré, en droit, comme un remboursement de la TVA, ce qui serait contraire à la directive du 28 novembre 2006 relative au système commun de TVA (115), mais comme une subvention d’aide à l’investissement des collectivités territoriales.
Les collectivités bénéficient comme toutes les personnes morales des taux réduits fixés par la loi (notamment les taux de 5,5 % et 10 % de TVA) et le cas échéant des taux particuliers applicables sur certains territoires (taux normal de TVA de 8,5 % dans les départements d’outre-mer et de 10 % en Corse). Toutefois, le FCTVA est fondé sur un taux forfaitaire qui s’applique sur les dépenses d’investissement éligibles hors taxes des collectivités, sans considération du taux de TVA ayant réellement grevé les opérations d’investissement.
Le FCTVA apporte une contribution importante à l’investissement des collectivités.
MONTANT DU FCTVA RAPPORTÉ AUX DÉPENSES D’INVESTISSEMENT DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES | |||||
(en milliards d’euros) | |||||
Année |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
Montant du FCTVA |
5,492 |
5,523 |
5,910 |
5,961 |
5,978 |
Dépenses d’investissement |
68,2 |
71,1 |
66,8 |
− |
ODEDEL + 0,9 % |
ODEDEL : Objectif d’évolution de la dépense publique locale. Source : Observatoire des finances locales. | |||||
Considéré du point de vue de la comptabilité budgétaire comme une diminution de recettes et assimilé en comptabilité nationale à une dépense, le FCTVA représente dans la comptabilité générale de l’État une dépense non plafonnée, en forte hausse depuis les années 2000.
Chaque année, il représente environ 75 % des concours d’investissement versés par l’État aux collectivités territoriales.
Le bloc communal est le premier bénéficiaire du FCTVA (76 % des versements 2013), du fait du poids des communes et de leurs groupements dans l’investissement local. Les communes perçoivent à elles-seules 51 % du montant du fonds en 2013. Cette proportion était de 55,6 % en 2014.
B. LE TAUX DE REMBOURSEMENT A ÉTÉ AUGMENTÉ PAR LA LOI DE FINANCES POUR 2015
Le taux de compensation forfaitaire est fixé par l’article L. 1615-6 du CGCT à 15,761 % pour les dépenses éligibles réalisées à compter du 1er janvier 2014 et à 16,404 % pour celles réalisées à compter du 1er janvier 2015.
La détermination du taux de 15,761 % correspond à la prise en compte d’un investissement toutes taxes comprises (TTC) sur la base d’un taux forfaitaire retenu au taux normal de 20 %. 20 % appliqué sur un montant hors taxes d’un investissement équivaut à 16,7 % de son montant TTC. Le taux de 16,7 % est ensuite diminué du montant de la part de TVA versée par la France au budget de l’Union européenne.
La formule de calcul du taux de 15,761 % se pose ainsi :
Taux FCTVA = ((20 / (100+20)) × 100) – 0,905
Le dernier taux de 16,404 % résulte d’un amendement présenté par la Rapporteure générale au projet de loi de finances pour 2015. Afin de préserver l’investissement public porté par les collectivités territoriales et de soutenir l’activité économique qui en dépend, le taux de remboursement du FCTVA doit assurer aux collectivités des conditions analogues à celles que connaissent les entreprises exerçant leur droit à déduction de TVA.
Depuis le 1er janvier 1997, le taux de remboursement du FCTVA supportait une réfaction de 0,905 point. Le Gouvernement de l’époque avait tenu à justifier le niveau de cette réfaction par l’incidence sur les recettes de TVA du prélèvement institué sur celles-ci au bénéfice du budget de la Communauté européenne. Or, la part de la contribution française assise sur la ressource TVA telle qu’elle ressort du budget européen n’a cessé de diminuer depuis lors. Elle atteint désormais 2,9 milliards d’euros, pour une base harmonisée de 955,6 milliards d’euros, ce qui correspond à un taux d’appel apparent de 0,31 % et donc à une réfaction de 0,262 point « en-dedans ».
L’article 24 de la loi de finances pour 2015 (116) a ajusté le taux de remboursement du FCTVA aux évolutions du mode de financement de l’Union européenne. Ce taux a ainsi été porté de 15,761 % à 16,404 %, soit une augmentation de 4 % des remboursements versés via le FCTVA aux collectivités qui réalisent des dépenses d’investissement.
La perte de recettes correspondante, pour l’État, a été évaluée à 26 millions d’euros en 2015 et 246 millions d’euros à partir de 2017, à rythme de remboursement inchangé.
C. UN REMBOURSEMENT EFFECTUÉ EN ANNÉÉ N, N+1 OU N+2
Pour le calcul du droit à FCTVA, les dépenses réelles d’investissement prises en considération sont en principe celles afférentes à la pénultième année. Mais ce principe tend désormais à devenir l’exception :
– les communautés de communes (CC) et d’agglomération (CA) ainsi que les communes nouvelles issues de la fusion de deux entités communales perçoivent le FCTVA l’année même de réalisation de la dépense ;
– les collectivités ; autres que les communautés de communes et d’agglomération, qui se sont engagées en 2009 et 2010 à accroître leurs dépenses d’investissement dans le cadre du dispositif de versement accéléré du FCTVA au titre du plan de relance pour l’économie, et qui ont respecté leur engagement, perçoivent le FCTVA l’année suivant celle de la réalisation de la dépense (les dépenses d’investissement de ces collectivités représentent plus des deux tiers de l’ensemble des dépenses éligibles au FCTVA) ;
– les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) qui mettent en commun de la dotation globale de fonctionnement (DGF) perçoivent le FCTVA l’année suivant celle de la réalisation de la dépense.
Dès lors, les collectivités ne pouvant prétendre à l’une de ces exceptions perçoivent le FCTVA selon les principes du droit commun, deux années après la réalisation de la dépense.
Les bénéficiaires du FCTVA peuvent ainsi être classés en trois catégories, en fonction du régime de versement auquel ils sont soumis. Le poids relatif de chacun de ces blocs est très contrasté.
MONTANTS DE REMBOURSEMENT DU FCTVA SELON L’ANNÉE DE RÉALISATION | |||||
(en millions d’euros) | |||||
Montants de remboursement |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
Montant total du FCTVA |
5 492 |
5 523 |
5 843 |
5 961 |
5 979 |
Part correspondant à l’investissement dont la TVA est remboursée en année N |
643 |
649 |
749 |
n.c. |
n.c. |
Part correspondant à l’investissement dont la TVA est remboursée en année N-1 |
3 813 |
3 768 |
3 813 |
n.c. |
n.c. |
Part correspondant à l’investissement dont la TVA est remboursée en année N-2 |
1 036 |
1 106 |
1 281 |
n.c. |
n.c. |
n.c. : Le Gouvernement n’a pas été en mesure de transmettre ces informations demandées par la Rapporteure générale. Source : Observatoire des finances locales. | |||||
L’article 133 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) a introduit une précision relative aux dépenses réelles d’investissement à prendre en compte pour les communautés urbaines qui se substituent à des communautés d’agglomération et les régions issues d’un regroupement (respectivement afférentes à l’exercice en cours ou à l’exercice précédent).
II. CONTEXTE ÉCONOMIQUE ET BUDGÉTAIRE : LA NÉCESSITÉ DE SOUTENIR L’INVESTISSEMENT DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
A. LA BAISSE DES DÉPENSES D’INVESTISSEMENT
Selon le dernier rapport de l’Observatoire des finances locales, de juillet 2015, les dépenses d’investissement des collectivités ont évolué comme suit en 2014.
ÉVOLUTION DES DÉPENSES D’INVESTISSEMENT DES COLLECTIVITÉS EN 2014 | ||||
Collectivités |
Dépenses d’investissement |
Dépenses totales | ||
Montant |
Évolution annuelle (en %) |
Montant |
Évolution annuelle (en %) | |
Bloc communal |
41,2 |
− 9,6 |
130,6 |
− 1,9 |
Départements |
14,2 |
− 4,2 |
73,5 |
+ 1,4 |
Régions |
11,4 |
+ 2,8 |
29,3 |
+ 1,9 |
Ensemble |
66,8 |
− 6,5 |
233,4 |
− 0,4 |
Source : Observatoire des finances locales.
La baisse de l’investissement est particulièrement brutale pour les communes (– 11,4 %). Toutefois, l’objectif d’évolution de la dépense publique locale (ODEDEL) pour 2016 prévoit une hausse de l’investissement du bloc communal de 0,9 %, en raison à la fois du cycle électoral et des nouvelles mesures de soutien prévues par le Gouvernement. L’investissement des régions devrait rester stable, compte tenu là encore du cycle électoral et du contexte de fusion des régions.
B. LE PROBLÈME DU REMBOURSEMENT ANTICIPÉ DE TVA
1. Un débat récurrent
Compte tenu de la nécessité de soutenir l’investissement des collectivités territoriales, il pourrait être opportun de débattre à nouveau de la possibilité d’étendre la possibilité aux collectivités territoriales s’engageant à augmenter leurs investissements de bénéficier des attributions du FCTVA l’année de la réalisation de leurs dépenses. La commission avait adopté un amendement au projet de loi de finances pour 2015 ouvrant la faculté, aux collectivités territoriales s’engageant à augmenter leurs investissements en 2015 par rapport à la moyenne des années 2012–2014, de bénéficier des attributions du FCTVA l’année de la réalisation de leurs dépenses. Cet avantage devait être pérenne pour les collectivités s’engageant avant le 1er avril 2015 et respectant leur engagement. La Rapporteure générale chiffrait le coût d’une telle mesure à un milliard d’euros. Reprenant l’évaluation de la Cour des comptes, le Gouvernement évaluait son coût à 3,9 milliards d’euros. Le remboursement anticipé du FCTVA demeure une demande de l’Association des maires de France (AMF).
L’article 23 de loi du 30 décembre 2014 de finances pour 2015 a exclu le FCTVA de l’enveloppe normée des concours financiers de l’État aux collectivités territoriales, afin que le dynamisme de celui-ci ne pèse pas sur les variables d’ajustement. L’impact est de 166 millions d’euros en 2015.
2. Le préfinancement à taux zéro par la Caisse des dépôts
La Caisse des dépôts et consignations propose depuis le 16 juin 2015 le préfinancement du FCTVA à taux zéro à destination des collectivités territoriales. Toutes les collectivités éligibles au FCTVA peuvent bénéficier du dispositif sauf si elles perçoivent déjà le FCTVA l’année même de leurs investissements. Le montant du prêt est fixé forfaitairement à hauteur de 8 % des investissements inscrits au budget principal de la collectivité.
C. LA COUR DES COMPTES A FORMULÉ TRÈS RÉCEMMENT
DES PROPOSITIONS POUR AMÉLIORER LA GESTION DU FCTVA
La Cour des comptes a contrôlé, en application de l’article L. 111-3 du code des juridictions financières, l’exécution des prélèvements sur les recettes de l’État (PSR) au profit des collectivités territoriales. Elle appelle, dans le cadre du référé n° S 2015 0442 1 rendu public le 1er septembre 2015 (117), à une transparence accrue et à d’importantes simplifications. Parmi les PSR, elle indique que la gestion du FCTVA doit être, en elle-même, modernisée.
Recommandations de la Cour des comptes relatives à la gestion des PSR
au profit des collectivités territoriales
Recommandation n° 1 : clarifier et préciser les règles d’exécution budgétaire et comptable des dotations aux collectivités locales prélevées sur les recettes de l’État ;
Recommandation n° 2 : regrouper dans un processus de traitement de masse automatisé et centralisé l’ordonnancement, la notification et le paiement des dotations calculées par les administrations centrales (direction générale des collectivités locales et direction générale des finances publiques) ;
Recommandation n° 3 : compléter l’information du Parlement sur l’exécution des prélèvements sur recettes, dans les documents annexés à la loi de règlement, en justifiant les écarts entre les prélèvements votés et ceux versés et en étoffant les indicateurs de performances relatifs à la gestion de ces prélèvements ;
Recommandation n° 4 : maîtriser les risques liés à l’environnement informatique en organisant la transmission dématérialisée des pièces justificatives par les applications de gestion des dotations remettantes à CHORUS et en sécurisant, dans le système d’information financier de l’État, le montant maximal des prélèvements ;
Recommandation n° 5 : améliorer la qualité du service rendu aux collectivités locales en :
− diffusant un calendrier de notification des dotations actualisé en fonction de l’ampleur des modifications informatiques requises par les évolutions législatives,
− suivant leurs délais de notification et de versement,
− rendant accessible en ligne l’ensemble des données et des algorithmes de calcul utilisés par la direction générale des collectivités locales pour déterminer les dotations prélevées sur les recettes de l’État ;
Recommandation n° 6: rationaliser la gestion du FCTVA en :
− créant un système d’information national de pilotage de la gestion du FCTVA,
− levant au profit des préfets le secret professionnel sur la situation fiscale des activités des collectivités territoriales,
− en différenciant les contrôles selon une analyse des risques et en instituant des pôles spécialisés dans l’instruction des demandes complexes de FCTVA ;
Recommandation n° 7 : évaluer périodiquement le coût des extensions apportées au champ du FCTVA et en tenir le Parlement informé;
Recommandation n° 8 : améliorer la qualité du service rendu aux collectivités locales en raccourcissant les délais d’instruction de leurs demandes de FCTVA et en s’engageant sur ces délais.
III. LE DISPOSITIF PROPOSÉ : ÉLARGISSEMENT DU FCTVA AUX DÉPENSES D’ENTRETIEN DES BÂTIMENTS PUBLICS
Cet article met en œuvre les annonces faites par le Premier ministre à l’AMF le 28 mai 2015. Il étend le bénéfice du FCTVA aux dépenses d’entretien des bâtiments publics réalisées à compter du 1er janvier 2016.
Seules les dépenses imputées en investissement (opérations réelles ou d’ordre) et grevées de TVA sont éligibles sous condition au FCTVA.
La circulaire du 26 février 2002 relative aux règles d’imputation des dépenses du secteur public local (118) précise les critères de distinction entre les dépenses d’investissement et celles relevant du fonctionnement, qui résultent à la fois de l’application des principes du code civil en prenant en considération la consistance du bien et sa durabilité, et des principes du plan comptable général, dont s’inspirent les instructions budgétaires et comptables des collectivités locales. Ainsi, selon les règles communément admises, les dépenses qui ont pour résultat l’entrée d’un nouvel élément d’une certaine consistance destiné à rester durablement dans le patrimoine de la collectivité sont considérées comme des dépenses d’investissement. Tel n’est pas le cas en revanche des dépenses d’entretien ou de réparation qui ont pour objet de maintenir le patrimoine en l’état et non d’augmenter sa valeur.
Conformément à l’article L. 1615-5 du CGCT, non modifié par le présent article, « à compter du 1er janvier 1980, les sommes versées par le FCTVA sont inscrites à la section d’investissement du budget de la collectivité, de l’établissement ou de l’organisme bénéficiaire ». Les remboursements de dépenses de rénovation des bâtiments publics éligibles au FCTVA ne seront donc pas inscrits en section de fonctionnement.
Par ailleurs, alors que le l’article L. 1615-1 du même code prévoit que les ressources du FCTVA comprennent les dotations budgétaires ouvertes chaque année par la loi, le présent article supprime l’adjectif « budgétaires ».
IV. L’IMPACT BUDGÉTAIRE ET ÉCONOMIQUE
L’article 13 du présent projet de loi, qui évalue les prélèvements opérés sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales, retient une estimation du montant du FCTVA à 5,978 milliards d’euros en 2016, en hausse de 17 millions d’euros par rapport au montant adopté dans la loi de finances pour 2015. Cette hausse comprend l’impact de la mesure proposée par le présent article.
L’évaluation en a été réalisée à partir des montants observés dans les comptes de gestion 2013 (budgets principaux) des collectivités correspondant aux dépenses d’entretien des bâtiments publics. En prenant en compte l’hypothèse de l’éligibilité de l’ensemble de ces dépenses au FCTVA, et en appliquant le taux de compensation de 16,404 %, le FCTVA attribué au titre de ces dépenses sera de 143 millions d’euros par an en régime de croisière. Selon l’évaluation préalable, le coût de la mesure serait de 12 millions d’euros en 2016, puis de 109 millions d’euros en 2017et de 143 millions d’euros en 2018.
En régime de croisière et au titre des dépenses d’entretien des bâtiments publics, les collectivités bénéficiant du FCTVA en N percevront 12 millions d’euros, les collectivités relevant du régime anticipé (N-1) 97 millions d’euros et les collectivités relevant du régime de droit commun (N-2) 34 millions d’euros.
Le FCTVA est rétabli au sein de l’enveloppe normée par l’article 10 du présent projet de loi de finances : son évolution tendancielle en 2016 est gagée à hauteur de 12 millions d’euros par la baisse des variables d’ajustement, qui compensent certaines exonérations d’impôts locaux.
Certaines collectivités jugent plus pertinente une extension aux travaux d’entretien de voirie, pour lesquels les règles de distinction entre dépenses d’investissement et dépenses de fonctionnement, régulièrement rappelées par le Gouvernement, sont relativement complexes.
Les dépenses d’entretien de la voirie (et des réseaux, comprises dans le même compte) comptabilisées en 2014 sont égales au total à 1,876 milliard d’euros. En année pleine, étendre l’éligibilité au FCTVA au taux de 16,404 % aurait un coût de 307,7 millions d’euros.
*
* *
La commission est saisie de l’amendement I-CF 92 de Mme Christine Pires Beaune.
Mme Christine Pires Beaune. L’article 11 élargit l’assiette des dépenses éligibles au FCTVA aux dépenses d’entretien du bâtiment. L’amendement I-CF 92 vise à l’élargir également aux dépenses d’entretien de voirie – qui, dans certaines communes, sont bien supérieures aux dépenses d’entretien des bâtiments.
M. le président Gilles Carrez. A-t-on une idée du coût de cet amendement ?
Mme Christine Pires Beaune. Il s’établirait à environ 300 millions d’euros.
Mme la Rapporteure générale. J’avais soutenu cet amendement rédigé sur la base du constat que, contrairement au bâtiment pour lequel on a constaté une légère reprise, les travaux publics sont toujours dans une situation critique, la relance de l’investissement public n’étant pas suffisante. En élargissant aux dépenses d’entretien de la voirie le périmètre des dépenses éligibles au FCTVA, cet amendement pourrait contribuer à soutenir le secteur des travaux publics. Cela dit, je suis bien consciente du fait que son coût de 300 millions d’euros est loin d’être négligeable sur le plan budgétaire, et émets donc un avis de sagesse.
M. le président Gilles Carrez. Le FCTVA n’est plus dans l’enveloppe normée.
M. Charles de Courson. Il y a été réintégré.
M. le président Gilles Carrez. J’appelle votre attention sur le fait que, si cet amendement est adopté, ce sera la première fois qu’on élargira le FCTVA à la section de fonctionnement, dont font partie les dépenses d’entretien.
M. Charles de Courson. On peut aller jusqu’à s’interroger sur ce que sont les travaux d’entretien d’un point de vue comptable, et notamment ceux effectués en régie. De ce point de vue, je vous rappelle que le FCTVA n’est pas lié à la TVA : il se calcule sur une assiette avec des taux variables, voire à taux zéro.
En technique comptable, une fois les travaux d’entretien identifiés, le FCTVA calculé sur leur montant constituera-t-il une recette d’investissement ou une recette de fonctionnement ?
M. Joël Giraud. En 2008 ou 2009, une circulaire de la direction générale des finances publiques a déclassé tous les travaux d’investissement sur la voirie, qui étaient en fait des travaux d’entretien, en demandant qu’ils soient pris en compte en section de fonctionnement plutôt qu’en section d’investissement, sauf lorsqu’il s’agit d’une voirie nouvelle à créer. Très concrètement, les travaux qui étaient considérés comme des investissements sont devenus des dépenses de fonctionnement. Cet amendement est d’autant plus important que le système est appliqué selon des modalités différentes, en fonction des comptables publics concernés. On pourrait penser à une autre solution consistant à ce que ces travaux redeviennent des dépenses d’investissement, mais dans l’immédiat, cet amendement me paraît tout à fait nécessaire.
M. Jean Launay. J’ai été comptable public durant de nombreuses années, et j’ai souvent eu à connaître de travaux dits d’entretien, alors que les collectivités les considéraient comme des investissements lourds, puisqu’ils faisaient l’objet de programmes coordonnés, souvent réalisés par des syndicats à vocation multiple s’occupant essentiellement de voirie, et financés par des emprunts : quand on refait une couche de roulement, elle est censée tenir une bonne dizaine d’années. J’ai donc toujours payé ces travaux comme des investissements, et permis aux collectivités de récupérer la TVA sur leur montant. Ce n’est que récemment que la comptabilité publique est revenue sur cette pratique, ce que je conteste, car la réfection de la voirie constitue bien un investissement, et même l’un des plus gros postes de leur budget.
Mme Monique Rabin. Je suis cosignataire de cet amendement, qui doit nous faire réfléchir à l’objectif politique poursuivi. De ce point de vue, il me semble qu’il mériterait d’être retravaillé afin de mieux en définir le périmètre. Pour les collectivités locales, il existe, en effet, une distinction entre les gros investissements de voirie et le petit entretien – mais je suis d’accord avec Charles de Courson pour dire qu’il sera difficile de distinguer les deux dans la comptabilité des communes.
M. Romain Colas. Si l’on s’inscrit dans une logique d’entretien du patrimoine, je ne vois pas pourquoi on viserait uniquement les bâtiments, à l’exclusion de la voirie. Cet amendement est donc tout à fait justifié.
M. Éric Alauzet. Même si certaines précisions devront être apportées à cet amendement, il me paraît constituer une excellente mesure, car on fait bouger le curseur vers des travaux qui constituent bel et bien des investissements. Par ailleurs, cela peut nous aider à arbitrer un peu différemment entre la construction neuve et la réhabilitation, et à faire de meilleurs choix du point de vue de l’économie, du développement durable, de l’économie d’espace et de matière. Enfin, cet amendement va contribuer au dispositif améliorant les ressources des collectivités locales dans le contexte que nous connaissons.
M. Razzy Hammadi. Je ne défendrai pas mes deux prochains amendements, monsieur le président. Nous devons avoir une réflexion globale sur ce qui constitue un « bougé » de 300 millions d’euros : s’il y a une majorité pour voter une dépense de 300 millions d’euros, il doit y en avoir une pour discuter de la meilleure manière de cibler cette somme – pas forcément sur la voirie. La question de l’investissement et du fonctionnement date de 2009, et provient de l’Union européenne : avec l’arrivée des lois de 2006 et 2008 sur les contrats de partenariat, on a commencé à considérer les loyers versés par la collectivité à l’entreprise partenaire comme des dépenses d’investissement, notamment en ce qui concerne l’éclairage public ou la voirie. Je plaide donc pour que nous nous donnions le temps de réfléchir, d’ici à la séance publique, à un amendement efficace et ciblé.
M. Hervé Mariton. Le Gouvernement indique, dans l’exposé des motifs de l’article 11, que « les dépenses d’entretien des équipements des collectivités territoriales sont par nature inéligibles au FCTVA ». Il y a une certaine contradiction à dire qu’une chose est par nature inéligible, avant de la rendre éligible. Cela nous ramène à ce qu’a dit Charles de Courson au sujet de l’extrême difficulté qu’il y a à définir l’entretien d’un bâtiment ou d’une route. De bonne ou de mauvaise foi, des gouvernements successifs ont pu exciper de la fragilité du FCTVA au regard des règles communautaires. La question se pose de savoir si l’extension du FCTVA à des dépenses d’entretien n’est pas de nature à aggraver cette fragilité.
M. Dominique Lefebvre. Une mesure d’un coût d’un peu moins de 150 millions d’euros à l’horizon 2018 a été annoncée par le Premier ministre à la fin de l’été, dans le cadre d’une série d’annonces comprenant aussi 1 milliard d’euros pour l’investissement. Je suppose que, quand la Rapporteure générale nous dit que le coût de l’amendement est de 300 millions d’euros, c’est à comparer à ces 145 millions d’euros à l’horizon 2018 : en pratique, si nous adoptons l’amendement, il aura un coût d’une vingtaine de millions d’euros sur le budget 2016 et le solde, et il faudra trouver 100 millions d’euros en 2017 et 200 en 2018. Si l’amendement devait coûter 300 millions d’euros dès l’année prochaine, je m’y opposerais fermement, car nous devrions rechercher une somme équivalente sous la forme d’économies sur les dépenses de l’État.
M. le président Gilles Carrez. Il s’agit en fait de 2017, car la plupart des communes sont passées à une inscription en n +1 au titre du FCTVA.
La commission adopte l’amendement I-CF 92.
Les amendements I-CF 278 et I-CF 279 sont retirés.
La commission examine l’amendement I-CF 54 de M. Joël Giraud.
M. Joël Giraud. Cet amendement a trait au choix entre l’acquisition et la location de longue durée de véhicules par les collectivités territoriales. À l’heure actuelle, la location de longue durée étant exclue du FCTVA, les collectivités acquièrent des véhicules et les font durer le plus longtemps possible, ce qui pose d’énormes problèmes environnementaux et engendre des surcoûts considérables d’entretien – tout cela parce qu’elles souhaitent récupérer la TVA. Cet amendement a pour objet de procéder à une expérimentation sur la location de longue durée, à compter du 1er janvier 2016 et pour une durée n’excédant pas trois ans. Le bilan en serait fait neuf mois avant la fin de l’expérimentation, afin de déterminer s’il convient de maintenir ou non la mesure dans notre dispositif fiscal. Le dispositif proposé ne serait pas forcément coûteux si l’on se réfère à la somme considérable que représente le FCTVA sur les acquisitions de véhicules. Il serait, par ailleurs, plus écologique et permettrait de diminuer le fort taux d’accidentologie des collectivités territoriales, dû à l’obsolescence des véhicules.
Suivant l’avis défavorable de la Rapporteure générale, la commission rejette l’amendement I-CF 54.
Puis elle adopte l’article 11 modifié.
*
* *
Article 12
Compensation des transferts de compétences aux régions et aux départements par attribution d’une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) et de la taxe spéciale sur les conventions d’assurance (TSCA)
Essentiellement technique, le présent article procède à l’actualisation des modalités et des montants des compensations financières dues par l’État aux régions et départements au titre de différents transferts de ses compétences. Ces compensations financières sont assurées soit par l’attribution à chaque collectivité territoriale d’une fraction du produit de taxes, principalement la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE), soit par des dotations budgétaires (dotation générale de décentralisation notamment). S’agissant du financement de l’apprentissage, cet article modifie l’architecture de la compensation du transfert de compétences aux régions, pour substituer des fractions de TICPE à des dotations. Les fractions de TICPE des régions et départements font comme chaque année l’objet d’une actualisation. Ce dispositif doit être par ailleurs être adapté pour tenir compte de la nouvelle délimitation des régions à compter du 1er janvier 2016. Compte tenu d’évolutions minimes dans les transferts de compétences à compenser, l’impact budgétaire pour l’État du présent article s’élève à 16,5 millions d’euros.
I. L’ÉVOLUTION DE LA FISCALITÉ TRANSFÉRÉE POUR FINANCER LES TRANSFERTS DE COMPÉTENCES
A. LE DROIT À COMPENSATION DOIT ÊTRE GARANTI DANS LE TEMPS
Pour permettre leur libre administration, l’article 72-2 de la Constitution dispose que « les collectivités territoriales bénéficient de ressources dont elles peuvent disposer librement dans les conditions fixées par la loi. Elles peuvent recevoir tout ou partie du produit des impositions de toutes natures. La loi peut les autoriser à en fixer l’assiette et le taux dans les limites qu’elle détermine. Les recettes fiscales et les autres ressources propres des collectivités territoriales représentent, pour chaque catégorie de collectivités, une part déterminante de l’ensemble de leurs ressources ».
Dans sa décision n° 2004-500 DC du 29 juillet 2004 portant sur la loi organique relative à l’autonomie financière des collectivités territoriales organique, le Conseil constitutionnel a confirmé que les recettes fiscales qui entrent dans la catégorie des ressources propres s’entendent « du produit des impositions de toutes natures non seulement lorsque la loi autorise ces collectivités à en fixer l’assiette, le taux ou le tarif, mais encore lorsqu’elle en détermine, par collectivité, le taux ou une part locale d’assiette ».
Il en résulte que la notion constitutionnelle de « ressources propres » des collectivités recouvre l’ensemble des dispositifs de fiscalité transférée en dépit de leurs différences. Les ressources propres comprennent la fiscalité dont les collectivités sont légalement autorisées à fixer l’assiette, le taux ou le tarif (par exemple, droits de mutation à titre onéreux) et la fiscalité pour laquelle elles disposent d’une part d’assiette locale (TICPE affectée aux régions en compensation des transferts liés à la décentralisation) ou d’un taux identifié (TICPE et taxe spéciale sur les conventions d’assurances – TSCA versée aux départements en compensation des transferts liés à la décentralisation).
Aux termes de l’article 72-2 précité, les transferts de compétences vers les collectivités territoriales doivent s’accompagner des ressources consacrées par l’État à l’exercice des compétences transférées. « Tout transfert de compétences entre l’État et les collectivités territoriales s’accompagne de l’attribution de ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice. Toute création ou extension de compétences ayant pour conséquence d’augmenter les dépenses des collectivités territoriales est accompagnée de ressources déterminées par la loi. » Cette compensation doit être intégrale, concomitante et conforme à l’objectif d’autonomie financière.
Le droit à compensation doit également être garanti dans le temps, conformément à l’interprétation du Conseil constitutionnel (décision n° 2011-142/145 QPC du 30 juin 2011 relative au revenu de solidarité active). Les dispositions présentées visent donc à assurer le respect de cette obligation constitutionnelle dans le cadre de la nouvelle délimitation des régions.
B. LES MONTANTS DE FISCALITÉ TRANSFÉRÉE ONT DOUBLÉ EN DIX ANS
L’évolution des montants de fiscalité transférée depuis 2006 est retracée dans le tableau ci-contre.
ÉVOLUTION DE LA FISCALITÉ TRANSFÉRÉE EN EXÉCUTION
Évolution de la fiscalité transférée |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
LFI 2015 |
PLF 2016 | |
Fiscalité transférée au titre de l’acte I de la décentralisation |
Droit départemental d’enregistrement et taxe de publicité foncière (Départements - Hors DMTO-RTP) |
7 442 |
7 830 |
7 159 |
5 269 |
7 105 |
8 194 |
7 429 |
6 832 |
7 367 |
7 779 |
7 924 |
Cartes grises (régions - décentralisation acte I) |
1 812 |
1 857 |
1 967 |
1 917 |
1 917 |
2 080 |
2 117 |
2 042 |
2 077 |
2 062 |
2 140 | |
Fiscalité transférée au titre de l’acte II de la décentralisation |
TICPE- RMI/RSA (départements) |
4 940 |
4 944 |
4 942 |
5 264 |
5 586 |
5 915 |
5 924 |
5 853 |
5 908 |
5 861 |
5 881 |
TICPE- Acte II hors RSA (loi LRL de 2004 et compensation de la suppression de la « vignette ») |
1 318 |
3 631 |
5 252 |
6 009 |
6 205 |
6 249 |
6 341 |
6 347 |
6 385 |
6 536 |
6 727 | |
dont TICPE-régions |
1 035 |
2 368 |
2 854 |
3 259 |
3 304 |
3 213 |
3 212 |
3 202 |
3 233 |
3 213 |
3 437 | |
dont TICPE-départements |
265 |
538 |
630 |
647 |
653 |
654 |
659 |
655 |
671 | |||
dont TSCA-départements (article 52) |
282 |
1 264 |
2 135 |
2 211 |
2 270 |
2 390 |
2 476 |
2 492 |
2 493 |
2 668 |
2 619 | |
Fiscalité transférée au titre de la réforme de la fiscalité directe locale |
TSCA - article 77 (départements - réforme de la fiscalité directe locale) |
2 953 |
4 301 |
3 184 |
3 198 |
3 408 |
3 359 | |||||
TASCOM (communes • réforme de la fiscalité directe locale) |
603 |
647 |
708 |
718 |
803 |
753 | ||||||
Droit départemental d’enregistrement et taxe de publicité foncière (DMTO-RTP) |
515 |
485 |
429 |
463 |
489 |
498 | ||||||
Rebasage des taux de frais de gestion (TU, TFPB, TFFNB) |
2 010 |
2 115 |
2 196 |
2 260 |
2 372 |
2 476 | ||||||
Fiscalité transférée à des titres divers |
TSCA - article 53 (départements - SDIS) |
917 |
846 |
891 |
879 |
942 |
954 |
979 |
987 |
987 |
1 057 |
1 037 |
Fiscalité transférée au titre du pacte de confiance et de responsabilité pour les départements |
é |
874 |
906 | |||||||||
TSCA – article 11-II (Marseille-BMP) |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 | |
TICPE-Mayotte (départementalisation) |
3 |
9 |
20 |
10 |
17 | |||||||
TICPE-MAPTAM et NOTRe |
6 | |||||||||||
Fiscalité transférée au titre la réforme de l’apprentissage et de la formation professionnelle |
TICPE-prime d’apprentissage |
139 |
256 |
233 | ||||||||
TICPE- réforme du financement de l’apprentissage |
146 |
146 |
148 | |||||||||
Frais de gestion affectés aux régions - réforme de la formation professionnelle (pacte de confiance et de responsabilité) |
601 |
617 |
650 | |||||||||
TICPE- réforme de la formation professionnelle |
300 |
298 |
305 | |||||||||
Prime au recrutement d’un apprenti supplémentaire |
60 | |||||||||||
Total Fiscalité transférée |
16 438 |
19 119 |
20 222 |
19 437 |
21 764 |
27 472 |
28 235 |
26 401 |
28 318 |
32 569 |
33 129 | |
Source : annexe au projet de loi de finances pour 2016, Transferts financiers de l’État aux collectivités territoriale.
II. LES AJUSTEMENTS PROPOSÉS
A. COMPENSATION DES TRANSFERTS DE COMPÉTENCES ET DE SERVICES DE L’ÉTAT AU BÉNÉFICE DES RÉGIONS
Les alinéas 1er à 10 (I) du présent article organisent la compensation des transferts de compétences et de services de l’État au bénéfice des régions prévus par la loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles (MAPTAM) (119) et par la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) (120).
La loi MAPTAM du 27 janvier 2014 transfère aux régions la gestion des fonds européens et la loi NOTRe du 7 août 2015 leur transfère celle des centres de ressources, d’expertise et de performance sportives (CREPS).
La compensation financière du transfert des services chargés de la gestion des fonds européens transférés aux régions s’élève à 5,9 millions d’euros.
Les alinéas 1er à 3 attribuent à l’ensemble des régions d’une fraction unique de tarif de TICPE portant sur le gazole et le supercarburant sans plomb, calculée en rapportant le montant total du droit à compensation à l’assiette nationale de la taxe au 31 décembre de l’année précédant les transferts considérés.
Chaque région se voit ensuite attribuer une quote-part de cette fraction de tarif (alinéas 7 à 9).
La fraction est fixée en 2016 à 0,015 euro/hectolitre pour les supercarburants sans plomb et à 0,011 euro/hectolitre pour le gazole (alinéas 4 à 7).
Si le produit affecté globalement aux régions en vertu des fractions de tarif qui leur sont attribuées par la loi de finances représente un montant annuel inférieur au montant des dépenses exécutées par l’État au 31 décembre de l’année précédant le transfert, la différence fait l’objet d’une attribution d’une part correspondante du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l’État, et répartie entre les régions (alinéa 10).
B. L’ADAPTATION DE LA FISCALITÉ TRANSFÉRÉE À LA NOUVELLE DÉLIMITATION DES RÉGIONS
Les alinéas 11 et 12 (II) du présent article maintiennent le droit à compensation des nouvelles régions découlant des transferts de compétences prévus par la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales (LRL) (121) et de réformes ultérieures modifiant le coût d’exercice des compétences transférées.
Les nouvelles régions percevront la somme des droits à compensation auxquels les régions qui la composent pouvaient prétendre dans les conditions applicables avant regroupement.
Il s’agit d’assurer le respect de l’obligation constitutionnelle de garantie des droits à compensation dans le temps suite à la nouvelle délimitation des régions qui entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2016.
C. ACTUALISATION DU MONTANT DE LA COMPENSATION FINANCIÈRE AU TITRE DE L’ACTE II DE LA DÉCENTRALISATION
Les alinéas 13 et 14 (III) du présent article actualisent le montant de la compensation financière des transferts de compétences aux régions prévus par la loi LRL du 13 août 2004 précitée.
Ces transferts sont achevés. Toutefois la réforme du diplôme d’État de pédicure-podologue, prévue par l’arrêté du 5 juillet 2012 entraîne un ajustement à la baisse du montant des charges nouvelles résultant pour les régions de cette réforme. L’ajustement des fractions de la TICPE au bénéfice de l’État minore à hauteur de 10 532 euros la fiscalité transférée par l’État à trois régions.
D. ACTUALISATION DE LA COMPENSATION DU TRANSFERT DE COMPÉTENCES EN MATIÈRE DE REVENU DE SOLIDARITÉ ACTIVE (RSA)
Les alinéas 15 à 17 (IV) du présent article corrigent une erreur matérielle contenue dans l’article 44 de la loi de finances pour 2014 (122) et prévoient la poursuite du dispositif l’échelonnement des reprises de compensation restant dues à l’État à l’issue des clauses de revoyure mises en œuvre par la loi de finances pour 2013 (123) et la loi de finances pour 2014. Cet échelonnement résulte du plafonnement des ajustements négatifs non pérennes (dits « reprises ») de compensation au regard du montant total du droit à compensation de chaque collectivité au titre du transfert du revenu minimum d’insertion (RMI) et de la généralisation du revenu de solidarité active (RSA). Cela ne concerne plus que le département du Loiret (1,6 million d’euros) et la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon (11 888 euros).
Les taux des fractions de TICPE affectées aux départements (y compris les DOM) et à Saint-Pierre-et-Miquelon afin de compenser les charges résultant de la généralisation du RSA ne sont pas affectés par cet article, dans la mesure où la compensation pérenne allouée à chaque collectivité est définitive. Le droit à compensation des départements métropolitains, définitif depuis la loi de finances pour 2013 s’élève à 761 173 961 euros, tandis que le droit à compensation pérenne des départements d’outre-mer et de Saint-Pierre-et-Miquelon, définitivement fixé depuis la loi de finances pour 2014, s’élève à 158 079 755 euros.
Cet ajustement est qualifié de ponctuel dans la mesure où il prend la forme de reprises non pérennes, qui ne donnent pas lieu à transfert aux collectivités bénéficiaires de fractions de tarif de TICPE mais s’imputent sur le produit de TICPE transféré à ces collectivités.
COMPENSATION DES TRANSFERTS DE COMPÉTENCES AUX DÉPARTEMENTS
(en millions d’euros)
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 | |
Coût des compétences transférées |
n.c. |
n.c. |
n.c. |
n.c. |
n.c. |
Montant des compensations versées par l’État aux départements |
n.c. |
n.c. |
n.c. |
n.c. |
n.c. |
n.c. : le Gouvernement n’a pas été en mesure de transmettre ces informations demandées par la Rapporteure générale.
E. COMPENSATION DES CHARGES DE DÉPARTEMENTALISATION DE MAYOTTE
Les alinéas 18 à 26 (V) du présent article compensent au département de Mayotte, en 2016, les charges résultant du processus de départementalisation le concernant, et plus particulièrement les charges liées à la mise en place du RSA, à la gestion et au financement du fonds de solidarité pour le logement (FSL) et au financement des formations sociales initiales et des aides aux étudiants de ces formations, de la formation des assistants maternels ainsi que des allocations d’aide aux repas, de l’aide ménagère et de l’aide sociale à l’hébergement en établissement, à destination des personnes âgées et des personnes handicapées ; le montant total de cette compensation est de 16,5 millions d’euros pour 2016.
F. FINANCEMENT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DE L’APPRENTISSAGE
Les alinéas 27 à 53 (VI à X) du présent article actualisent les transferts effectués aux collectivités territoriales dans le cadre de la formation professionnelle et de l’apprentissage, conformément aux nouvelles délimitations des régions résultant de la loi du 16 janvier 2015 (124). Ils substituent un financement par affectation de recettes fiscales (TICPE) à un financement par dotations budgétaires, pour la compensation des primes pour l’apprentissage, de l’aide au recrutement d’apprentis et de l’aide au recrutement d’un apprenti d’autre part. Cette harmonisation des modalités de compensation des mesures liées à la formation professionnelle et à l’apprentissage, uniquement par voie fiscale, poursuit un objectif de plus grande transparence et lisibilité, retracé dans le tableau ci-après.
Les alinéas 26 et 27 (VI) du présent article adaptent la fraction régionale pour l’apprentissage de la taxe d’apprentissage à la nouvelle délimitation des régions.
Les alinéas 30 à 33 (VII) font de même pour la part du produit de la TICPE versée aux régions, à la collectivité territoriale de Corse et au département de Mayotte pour le financement du développement de l’apprentissage. Le montant total de cette fraction de TICPE augmente par ailleurs de 146,2 à 148,3 millions d’euros.
Les alinéas 34 à 36 adaptent en conséquence, à compter de 2016, la fraction de tarif permettant d’obtenir ce produit. Elle est fixée à 0,39 euro par hectolitre pour les supercarburants sans plomb, sans modification et passe de 0,27 euro à 0,28 euro par hectolitre pour le gazole.
Les alinéas 44 et 45 (VIII) actualisent les transferts effectués aux collectivités territoriales dans le cadre de la formation professionnelle et de l’apprentissage aux nouvelles définitions des régions et substituent un financement par affectation de recettes fiscales (TICPE) à un financement par dotations budgétaires (alinéas 38 et 39), de la compensation des primes pour l’apprentissage.
Les alinéas 40 à 43 adaptent en conséquence le montant des tarifs pour 2016, qui diminuent de 0,67 euro par hectolitre à 0,61 euro par hectolitre pour les supercarburants sans plomb et de 0,48 euro par hectolitre à 0,43 euro par hectolitre pour le gazole.
Les alinéas 46 à 47 (IX) adaptent le financement de la formation professionnelle continue à la nouvelle délimitation des régions en adaptant aux nouveaux périmètres la part de chaque région dans le produit total des fractions de contribution foncière des entreprises (CFE), cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), taxe d’habitation et TICPE transférées aux régions pour le financement de la formation professionnelle et de l’apprentissage.
Enfin, les alinéas 48 à 53 (X) déterminent les modalités de la compensation par l’État, à compter de 2016, du financement de l’aide de mille euros pour le recrutement des apprentis : le montant, fixé à titre provisionnel à 60 millions d’euros, est calculé définitivement dans la loi de finances rectificative de l’année sur la base du nombre d’aides versées par les régions. Il est financé par une fraction de TICPE, fixée, à titre provisionnel à 0,15 euro par hectolitre pour les supercarburants sans plomb et à 0,11 euro par hectolitre pour le gazole.
ÉVOLUTION DU FINANCEMENT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DE L’APPRENTISSAGE DE 2015 A 2016 | |||||
(en millions d’euros) | |||||
Mesure |
Montant 2015 |
Financement 2015 |
Montant 2016 |
Financement 2016 |
Évolution 2015/2016 |
Ressource régionale pour l’apprentissage |
146 1 544 + 92 |
Fraction de TICPE 51 % de la taxe d’apprentissage, sur le CAS FNDMA (part fixe et part dynamique) |
148 1 544+ 95 |
Fraction de TICPE 51 % de la taxe d’apprentissage |
+ 1,4 % Du fait de l’indexation de la fraction de TICPE sur l’évolution de la masse salariale du secteur privé en année N-2 |
Affectation de ressources fiscales aux régions en substitution de la dotation globale de décentralisation de la formation professionnelle continue et d’apprentissage |
Au moins 901 |
Fraction des produits de CVAE, CFE, TH, et TICPE |
Sans changement |
– | |
Prime à l’apprentissage d’au moins 1 000 euros par année de formation, pour les employeurs de moins de 11 salariés |
255 |
Dotations budgétaires Fraction de TICPE |
233 |
Fraction de TICPE L’évolution de la compensation par région est retracée dans le tableau ci-après. |
– 8,6 % Du fait de l’extinction de l’indemnité compensatrice forfaitaire (ICF) |
À titre transitoire, prime de 200 euros, 500 euros ou 1 000 euros pour les contrats d’apprentissage conclus avant le 1er janvier 2014 – en extinction | |||||
Aide au recrutement d’un apprenti supplémentaire, d’au moins 1 000 euros pour les contrats conclus à compter du 1er juillet 2014 dans une entreprise de moins de 250 salariés, sous conditions |
60 |
Compensation budgétaire |
60 |
TICPE |
– |
Compétences transférées aux régions par la loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et au dialogue social (programme « compétences clés », personnes détenues, Français résidant à l’étranger, etc.) |
207 |
Fraction de TICPE |
Sans changement |
– | |
Source : commission des finances, loi de finances pour 2015, projet de loi de finances pour 2016.
III. IMPACT BUDGÉTAIRE DU PRÉSENT ARTICLE
A. LES INCIDENCES DU DISPOSITIF PROPOSÉ
L’impact budgétaire est présenté dans le tableau ci-dessous, d’après les données de l’évaluation préalable, qui ne chiffre pas le transfert des CREPS aux régions.
INCIDENCES BUDGÉTAIRES DU DISPOSITIF PROPOSÉ | |
(en euros) | |
Transfert des fonds européens aux régions |
+ 5 250 911 |
Ajustement de la compensation pour la formation des pédicures-podologues |
– 10 532 |
Reprise de RSA pour Saint-Pierre et Miquelon |
1 669 056 |
Départementalisation de Mayotte |
+ 87 466 |
Hausse de la fraction régionale de l’apprentissage |
+ 2 048 000 |
Extinction de l’indemnité compensatrice forfaitaire versée en cas de conclusion d’un contrat d’apprentissage |
– 22 000 000 |
Coût total pour l’État |
+ 16 293 211 |
Source : évaluation préalable. | |
B. L’AFFECTATION DES FRACTIONS DE TICPE
La TICPE représente un tiers de la fiscalité transférée aux collectivités territoriales. On peut retracer comme suit l’affectation de son produit, dont le total est évalué à 15,6 milliards d’euros pour 2016 par le présent projet de loi de finances.
AFFECTATION DE TICPE SELON LES DIFFÉRENTS BÉNÉFICIAIRES (en millions d’euros) | ||||
Bénéficiaires |
2013 (exécution) |
2014 (exécution) |
2015 (prévision) |
2016 (prévision) |
État |
13 759 |
13 225 |
13 905 |
15 595 |
Régions |
3 850 |
4 276 |
4 768 |
4 823 |
Régions part Grenelle |
517 |
587 |
527 |
527 |
Départements |
6 522 |
6 536 |
6 546 |
6 548 |
AFITF |
– |
– |
1 139 |
715 |
Total |
24 648 |
24 624 |
26 885 |
28 208 |
AFITF : Agence de financement des infrastructures de transport de France. Source : Évaluation des voies et moyens, tome 1. | ||||
MONTANTS DE TICPE TRANSFÉRÉS AUX DÉPARTEMENTS ET AUX RÉGIONS | |||||
(en millions d’euros) | |||||
Collectivité |
Catégorie de compensation |
2013 (exécution) |
2014 (exécution) |
2015 (prévision) |
2016 (prévision) |
TICPE Régions |
Total |
3 202 |
3 651 |
3 913 |
4 189 |
Acte II décentralisation |
3 202 |
3 233 |
3 213 |
3 437 | |
Prime d’apprentissage |
– |
118 |
256 |
233 | |
Réforme du financement de l’apprentissage |
– |
– |
146 |
148 | |
Réforme de la formation professionnelle |
– |
300 |
298 |
305 | |
Prime au recrutement d’un apprenti supplémentaire |
– |
– |
– |
60 | |
TICPE Départements |
Total |
6 516 |
6 587 |
6 526 |
6 569 |
RMI RSA |
5 853 |
5 908 |
5 861 |
5 881 | |
Acte II décentralisation hors RSA |
654 |
659 |
655 |
671 | |
Mayotte départementalisation |
9 |
20 |
10 |
17 | |
Source : Transferts financiers de l’État aux collectivités territoriales. Annexe au projet de loi de finances pour 2016. | |||||
*
* *
La commission adopte l’article 12 sans modification.
*
* *
Article 13
Évaluation des prélèvements opérés sur les recettes de l’État
au profit des collectivités territoriales
Le présent article fixe le montant de l’ensemble des prélèvements sur recettes (PSR) opérés sur le budget de l’État au profit des collectivités territoriales, en application de l’article 6 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF).
Ces PSR devraient atteindre en 2016 la somme de 47,11 milliards d’euros, contre 50,73 milliards d’euros en 2015 et 54,17 milliards en 2014 et 55,69 milliards en 2013, soit une diminution de 15,8 % en trois ans. Cette baisse correspond à la réduction de l’enveloppe normée des concours de l’État aux collectivités à hauteur de 1,5 milliard d’euros en 2014, de 3,5 milliards d’euros en 2015 et de 3,67 milliards supplémentaires cette année.
L’effort d’économies est exclusivement porté par la dotation globale de fonctionnement (DGF) ; il fait l’objet d’un commentaire plus détaillé au titre des articles 10 et 58 du présent projet de loi de finances.
Contrairement à l’année dernière, le tableau figurant à l’alinéa 2 du présent article ne comporte plus vingt-trois mais vingt-cinq prélèvements différents.
● Un nouveau PSR au titre de la compensation des pertes de recettes de versement transport
L’article 4 du présent projet de loi, relatif à la limitation des seuils dans les très petites entreprises (TPE) et dans les petites et moyennes entreprises (PME) met en œuvre les engagements pris par le Gouvernement en faveur de l’emploi dans les TPE et les PME le 9 juin 2015. Il limite les effets de seuil d’effectifs de certains régimes fiscaux, afin de supprimer lever un frein à l’embauche de salariés supplémentaires. Dans ce cadre, il propose de relever les seuils de neuf et dix salariés à onze et lorsque la cette disposition ne s’applique pas, de permettre que les recrutements des entreprises de moins de cinquante salariés, effectués d’ici la fin d’année 2018 ne déclenchent pas de prélèvements fiscaux supplémentaires, pendant les trois années suivant le recrutement, du fait du passage d’un seuil, pour plusieurs prélèvements, dont le versement transport prévu par les articles L. 2333-64 et L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT).
L’article 4 précité institue un nouveau PSR afin de compenser intégralement les pertes de recettes que la réduction du champ des entreprises assujetties au versement transport générerait au détriment des autorités organisatrices de la mobilité (AOM) et de la métropole de Lyon. Les modalités de définition de la compensation intégrale sont notables du fait de leur caractère dynamique. En effet, la compensation est égale à la différence entre le produit de versement transport recouvré par les autorités organisatrices de la mobilité et celui qu’elles auraient perçu si les articles L. 2333-64 et L. 2531-2 du CGCT avaient été appliqués dans leur version en vigueur le 1er janvier 2015.
L’avant-dernière ligne du tableau de l’alinéa 2 évalue le montant de ce PSR à 78,75 millions d’euros en 2016.
● Le prélèvement sur les recettes de l’État spécifique au profit de la dotation globale de fonctionnement
Ce prélèvement n’était plus mentionné l’année dernière et n’a plus lieu d’être. Institué par la loi de finances pour 2011, il correspondait à une majoration exceptionnelle de DGF supprimée dès l’année suivante.
L’évolution positive ou négative de la plupart des PSR s’explique par leur mécanique propre dont le législateur assume les conséquences financières. Seul un petit nombre d’entre eux appelle des observations spécifiques de la Rapporteure générale.
ÉVALUATION DES PRÉLÈVEMENTS SUR LES RECETTES DE L’ÉTAT AU PROFIT DES COLLECTIVITÉS
(en milliers d’euros)
Intitulé du prélèvement |
Montant |
Montant |
Évolution |
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation globale de fonctionnement |
36 607 053 |
33 108 514 |
− 9,6 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs |
18 662 |
17 200 |
− 7,8 |
Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements |
25 000 |
75 696 |
+ 202,8 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) |
5 961 121 |
5 978 822 |
− 0,3 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale |
1 826 227 |
1 608 707 |
− 11,9 |
Dotation élu local |
65 006 |
65 006 |
− |
Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse |
40 976 |
40 976 |
− |
Fonds de mobilisation départementale pour l’insertion |
500 000 |
500 000 |
− |
Dotation départementale d’équipement des collèges |
326 317 |
326 317 |
− |
Dotation régionale d’équipement scolaire |
661 186 |
661 186 |
− |
Fonds de solidarité des collectivités territoriales touchées par des catastrophes naturelles |
5 000 |
0 |
− 100 |
Dotation globale de construction et d’équipement scolaire |
2 686 |
2 686 |
− |
Compensation relais de la réforme de la taxe professionnelle |
0 |
0 |
− |
Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle |
3 324 422 |
3 324 422 |
− |
Dotation pour transferts de compensations d’exonérations de fiscalité directe locale |
655 123 |
635 257 |
− 3 |
Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle |
423 292 |
423 292 |
− |
Prélèvement sur les recettes de l’État spécifique au profit de la dotation globale de fonctionnement |
− |
0 |
− |
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la Dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle |
192 733 |
170 738 |
− 11,4 |
Dotation de compensation des produits syndicaux fiscalisés |
0 |
0 |
− |
Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle (complément au titre de 2011) |
0 |
0 |
− |
Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d’habitation sur les logements vacants |
4 000 |
4 000 |
− |
Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte |
83 000 |
83 000 |
− |
Dotation exceptionnelle de correction des calculs de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle et du prélèvement ou du reversement des fonds nationaux de garantie individuelle des ressources |
0 |
0 |
− |
Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires |
6 822 |
6 822 |
− |
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d’assujettissement des entreprises au versement transport |
− |
78 750 |
− |
Total |
50 728 626 |
47 111 391 |
− 7,13 |
Source : loi de finances initiale pour 2015 et projet de loi de finances pour 2016.
Le PSR au titre de la DGF fait l’objet d’un commentaire spécifique à l’article 10 du présent projet de loi de finances.
La baisse du montant du PSR au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs s’explique par la diminution régulière des effectifs du corps des instituteurs, auquel se substitue celui des professeurs des écoles.
La hausse de 50,7 millions de la dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements tient aux fortes variations du produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises en fonction de la conjoncture économique.
Le PSR au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale diminue de 217,5 millions d’euros. Cette baisse est due, à hauteur de 192,1 millions d’euros, à la fin de la mesure d’exonération temporaire d’exonération de taxe d’habitation pour certains contribuables âgés de plus de soixante ans ainsi que des veuves et veufs sous condition de revenu. Elle s’explique, pour 25,4 millions d’euros, par la minoration des variables d’ajustement prévue par l’article 10 du présent projet de loi de finances.
La baisse de 5 millions d’euros du montant du fonds de solidarité des collectivités touchées par des catastrophes naturelles résulte de la fusion du fonds dit « CATNAT » au sein du fonds Calamités publiques du programme 122 de la mission Relations avec les collectivités territoriales (RCT).
La baisse de 19,8 millions d’euros de la dotation pour transferts de compensations d’exonérations de fiscalité directe locale résulte uniquement de la minoration des variables d’ajustement prévue par l’article 10 du présent projet de loi de finances. C’est également le cas de la diminution de 22 millions d’euros du montant du PSR au titre de la dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle.
Enfin, le présent article retient une progression de 17 millions d’euros pour le fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA), dont 12 millions résultent de l’élargissement des dépenses éligibles à un remboursement aux dépenses d’entretien des bâtiments publics réalisées à compter du 1er janvier 2016, mesure proposée par l’article 11 du présent projet de loi de finances. Toutefois, les évolutions tendancielles du FCTVA sont évaluées et gagées à hauteur de 12 millions d’euros selon l’exposé des motifs de l’article 10. Contrairement à l’année dernière, le FCTVA se trouverait ainsi placé à nouveau sous enveloppe normée.
L’article 11 précité étend le bénéfice du FCTVA aux dépenses d’entretien des bâtiments publics réalisées à compter du 1er janvier 2016. Le rythme de remboursement du FCTVA variant d’une collectivité à l’autre, les dépenses supplémentaires pour l’État résultant de cette mesure sont évaluées à 12 millions d’euros en 2016, 109 millions en 2017 et 143 millions d’euros en 2018.
Bien que cet article ait précisément pour objet de récapituler l’ensemble des mouvements affectant les concours de l’État aux collectivités qui prennent la forme de prélèvements sur recettes, la Rapporteure générale constate, comme l’an dernier, que le tableau est difficilement lisible et peu éclairant.
Compte tenu des sommes en jeu, le Parlement devrait pouvoir bénéficier d’une présentation adaptée à la discussion budgétaire. Les prélèvements sur recettes pourraient notamment être regroupés en fonction de l’objectif qu’ils poursuivent –fonctionnement, investissement, compensations d’exonérations – ou de leur rôle dans l’enveloppe normée, en précisant notamment les dotations jouant le rôle de variables d’ajustement. Si l’expression a moins de sens depuis 2014 du fait de la contribution au redressement des finances publiques, « l’enveloppe normée » désigne les PSR dont l’évolution est gagée par une minoration des variables d’ajustement.
Le tableau ci-dessous récapitule ces diverses informations.
LES PSR AU SEIN ET EN DEHORS DE L’ENVELOPPE NORMÉE DES CONCOURS DE L’ÉTAT
(en millions d’euros)
Concours financiers de l’État |
LFI 2013 |
LFI 2014 |
LFI 2015 |
PLF 2016 | ||
Enveloppe des concours de l’État stabilisée |
PSR (hors réforme TP) |
Dotation globale de fonctionnement |
41 505 |
40 121 |
36 607 |
33 108 |
Dotation spéciale pour le logement des instituteurs |
22 |
21 |
19 |
17 | ||
Dotation élu local |
65 |
65 |
65 |
65 | ||
PSR de l’État au profit de la collectivité de Corse et des départements de Corse |
41 |
41 |
41 |
41 | ||
FMDI |
500 |
500 |
500 |
500 | ||
Dotation départementale d’équipement des collèges |
326 |
326 |
326 |
326 | ||
Dotation régionale d’équipement scolaire |
661 |
661 |
661 |
661 | ||
Fonds CATNAT |
10 |
10 |
5 |
0 | ||
Dotation globale de construction et d’équipement scolaire |
3 |
3 |
3 |
3 | ||
Dotation de compensation des pertes de base de la TP et de redevance des mines |
52 |
25 |
25 |
76 | ||
PSR de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale |
1 831 |
1 751 |
1 826 |
1 609 | ||
DUCSTP |
370 |
292 |
193 |
171 | ||
Dotation pour transferts de compensations d’exonérations de FDL |
814 |
744 |
655 |
635 | ||
Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants |
4 |
4 |
4 |
4 | ||
Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) |
5 627 |
5 769 |
0 |
5 978 | ||
Dotation de compensation de la fiscalité à Mayotte |
0 |
83 |
83 |
83 | ||
Total PSR dans l’enveloppe |
46 204 |
44 647 |
41 013 |
43 277 | ||
Dotations budgétaires inscrites sur la mission RCT (hors crédits DGCL et TDIL) |
Dotation équipement des territoires ruraux (DETR) |
616 |
616 |
816 |
816 | |
Dotation de soutien à l’investissement des communes et de leurs groupements |
− |
− |
− |
800 | ||
Dotation globale d’équipement des départements |
219 |
219 |
219 |
219 | ||
Dotation générale de décentralisation |
1 527 |
1 539 |
1 614 |
1 614 | ||
Dotation de développement urbain (DDU) |
75 |
100 |
100 |
100 | ||
Dotation pour les titres sécurisés |
18 |
19 |
18,3 |
18,3 | ||
Fonds de soutien redéploiement territorial des armées |
10 |
0 |
0 |
0 | ||
Dotations Outre-mer |
153 |
150 |
150 |
138 | ||
Subventions diverses |
3 |
3 |
2,3 |
2,3 | ||
Total Mission RCT |
2 621 |
2 643 |
2 920 |
3 748 | ||
Dotation globale de décentralisation (DGD) Formation Professionnelle inscrite sur la mission Travail et emploi et sur le CAS « Fonds national de développement et de modernisation de l’apprentissage » |
1 703 |
0 |
0 |
0 | ||
Total des concours de l’État dans l’enveloppe normée |
50 528 |
47 290 |
43 536 |
47 025 | ||
Hors enveloppe normée |
PSR |
PSR hors enveloppe issus de la réforme de la fiscalité directe locale |
3 862 |
3 755 |
3 374 |
3 374 |
dont Dotation de compensation de la réforme de la Taxe professionnelle (DCRTP) |
3 429 |
3 324 |
3 324 |
3 324 | ||
dont Garantie des reversements des FDPTP |
430 |
430 |
423 |
423 | ||
dont Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires |
6,8 |
6,8 | ||||
dont Dotation de compensation des produits syndicaux fiscalisés |
3 |
1 |
0 |
0 | ||
Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) |
5 627 |
5 769 |
5 961 |
0 | ||
PSR de compensation du versement transport |
− |
− |
− |
78,8 | ||
Total PSR hors enveloppe |
9 489 |
9 524 |
9 335 |
3 453 | ||
Total des concours de l’État, hors fiscalité transférée |
60 017 |
56 814 |
52 871 |
50 478 | ||
Les dotations en italique servent de variables d’ajustement (totalement ou partiellement) de l’enveloppe normée. | ||||||
Source : direction du budget, commission des finances. | ||||||
*
* *
La commission est saisie de l’amendement I-CF 113 de M. Charles de Courson.
M. Charles de Courson. Cet amendement vise à inscrire en 2016 une baisse de 2 % de la dotation globale de fonctionnement par rapport à 2015, et à maintenir à leur niveau de 2015 les variables d’ajustement. J’ajoute que le FCTVA figure dans cette enveloppe pour 5,978 milliards d’euros.
Suivant l’avis défavorable de la Rapporteure générale, la commission rejette l’amendement I-CF 113.
Puis elle adopte l’article 13 sans modification.
*
* *
B.– Impositions et autres ressources affectées à des tiers
Article 14
Mesures relatives à l’ajustement des ressources affectées à des organismes chargés de mission de service public
Le présent article poursuit les efforts en économies demandés aux opérateurs de l’État et organismes chargés de missions de service public bénéficiant de taxes affectées.
Dans cette perspective, il prévoit de prélever au total 930 millions d’euros (125) :
– un nouvel ajustement à la hausse ou à la baisse des plafonds individuels de certaines taxes prévus au I de l’article 46 de la loi de finances pour 2012 (126) pour une économie nette de 316 millions d’euros à périmètre constant en 2016 (A du I de l’article). Cette économie s’accompagne d’une baisse des taux de certaines taxes visant à ajuster leur rendement aux nouveaux plafonds et à diminuer l’imposition des redevables concernés (E du II et V) ;
– l’élargissement du mécanisme de plafonnement des taxes affectées à 11 nouveaux organismes de manière à porter le montant global des taxes plafonnées comprises dans la norme de dépense de l’État de 5,8 milliards d’euros en 2015 à 8,4 milliards d’euros en 2016 (I, A à C du II et IV) ;
– une baisse de 424 millions d’euros de la fraction de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) affectée à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFIFT) (VII) ;
– un prélèvement au profit du budget de l’État de 100 millions d’euros sur le fonds de roulement de la Caisse de garantie du logement locatif social (CGLLS) (XI) ;
– un prélèvement au profit du budget de l’État de 90 millions d’euros sur le fonds de roulement de l’agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) (VI).
D’autres mesures sont également proposées :
– l’augmentation de la taxe affectée au Centre national pour le développement du sport (CNDS) de 16,5 millions d’euros à 27,6 millions pour financer la candidature de la ville de Paris aux jeux olympiques et paralympiques de 2024 (D du II) ;
– la « rebudgétisation » de la redevance pour archéologie préventive (RAP) de manière à sécuriser le financement de l’Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP) et du Fonds national pour l’archéologie préventive (FNAP) (VIII) ;
– l’affectation de 27,3 millions d’euros par an, prélevés sur les redevances des opérateurs privés des bandes de fréquences hertziennes à l’Agence nationale des fréquences au titre des années 2016 à 2018 pour assurer la continuité de la réception gratuite des services de télévision hertzienne dans le cadre du prochain changement des normes de diffusion (IX).
I. L’ÉTAT DU DROIT
A. L’ENCADREMENT PROGRESSIF DES TAXES AFFECTÉES
1. La fiscalité affectée à des tiers
Le principe budgétaire d’universalité, selon lequel les recettes perçues par l’État ont vocation à couvrir l’ensemble de ses dépenses, est a priori incompatible avec l’affectation d’une recette à une dépense ou à un organisme particulier.
Toutefois, l’article 2 de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) (127) encadre les exceptions faites à ce principe (128), dont le recours à des taxes affectées à des tiers. Il prévoit en ce sens que « les impositions de toute nature ne peuvent être directement affectées à un tiers qu’à raison des missions de service public confiées à lui ».
Par ailleurs, le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 25 juillet 2001 (129), a souhaité assurer au législateur des garanties minimales de suivi de ces affectations en les soumettant à « la triple condition que la perception de ces impositions soit autorisée par la loi de finances de l’année, que, lorsque l’imposition concernée a été établie au profit de l’État, ce soit une loi de finances qui procède à cette affectation et qu’enfin le projet de loi de finances de l’année soit accompagné d’une annexe explicative concernant la liste et l’évaluation de ces impositions ».
L’introduction d’une annexe explicative est d’autant plus importante qu’une fois l’affectation adoptée en loi de finances, le Parlement n’est plus appelé à se prononcer par un vote sur le montant des ressources affectées, le vote sur l’autorisation de prélever l’impôt couvrant également les taxes affectées. Par conséquent, le suivi par le Parlement de l’évolution de ces taxes est limité aux informations transmises chaque année par leurs bénéficiaires et le Gouvernement dans le cadre de l’examen des lois de finances.
2. L’accroissement du montant des taxes affectées
La dernière décennie, marquée par l’entrée en vigueur de la LOLF et l’expansion des règles contraignant l’augmentation de la dépense budgétaire, notamment au travers de l’application des normes « zéro volume » et « zéro valeur », a vu croître le recours à la fiscalité affectée.
Le produit des impositions affectées à des personnes morales autres que l’État représente ainsi près de 260 milliards d’euros en 2015, dont la majeure partie bénéficie aux régimes de la sécurité sociale (170 millions d’euros, soit 65 %) et aux collectivités territoriales (56 millions d’euros, soit 22 %).
RÉPARTITION DES TAXES AFFECTÉES PAR TYPES DE BÉNÉFICIAIRES
(en millions d’euros)
Description |
Exécution 2012 |
Exécution 2013 |
Exécution 2014 |
Prévision 2015 |
Prévision 2016 |
Organisme d’administration centrale |
12 593 |
15 616 |
18 089 |
16 973 |
16 308 |
Opérateurs État |
5 348 |
5 251 |
5 144 |
5 692 |
5 004 |
Autres |
7 245 |
10 365 |
12 945 |
11 281 |
11 304 |
Secteur social |
157 435 |
152 945 |
156 794 |
167 476 |
165 182 |
Secteur local |
56 139 |
59 504 |
55 649 |
55 317 |
56 438 |
Communes |
6 027 |
5 101 |
6 565 |
6 419 |
6 621 |
Groupements de collectivité à fiscalité propre |
5 488 |
6 041 |
6 079 |
6 263 |
6 521 |
Départements |
21 955 |
21 350 |
21 673 |
21 860 |
22 497 |
Régions |
6 982 |
6 412 |
7 132 |
7 604 |
7 686 |
Collectivités territoriales de Corse |
115 |
101 |
104 |
104 |
106 |
Collectivités territoriales de l’outre-mer |
1 754 |
1 797 |
1 928 |
1 948 |
1 976 |
Organismes consulaires |
1 936 |
1 910 |
1 810 |
1 591 |
1 440 |
Environnement |
2 178 |
2 152 |
2 175 |
2 054 |
2 106 |
Apprentissage |
750 |
763 |
782 |
0 |
0 |
Urbanisme |
425 |
305 |
– |
– |
– |
Équipement |
1 362 |
1 341 |
– |
– |
– |
Logement et construction |
316 |
204 |
– |
– |
– |
Transports |
6 851 |
7 027 |
7 401 |
7 474 |
7 485 |
Divers |
17 866 |
19 671 |
20 016 |
20 835 |
22 114 |
Secteur de l’emploi et de la formation professionnelle |
10 474 |
10 592 |
10 236 |
9 509 |
9 521 |
Secteur de l’industrie, de la recherche, du commerce et de l’artisanat |
595 |
574 |
6 248 |
7 735 |
8 881 |
Secteur de l’équipement, du logement, des transports et de l’urbanisme |
2 882 |
3 083 |
3 270 |
3 297 |
3 428 |
Secteur agricole |
17 |
17 |
20 |
8 |
3 |
Secteur de l’environnement |
3 840 |
5 354 |
197 |
204* |
209 |
Divers |
58 |
51 |
45 |
82 |
72 |
Total |
244 033 |
242 736 |
250 548 |
260 601 |
260 042 |
Lecture : L’organisation du classement par secteur est notamment opérée dans un souci d’offrir la meilleure cohérence et lisibilité. Par nature, un tel regroupement présente néanmoins ses limites propres, certaines taxes pouvant concerner plusieurs secteurs thématiques.
* Modification du périmètre non explicitée dans le Voies et moyens annexé au présent projet de loi.
Source : Voies et moyens, tome I, projet de loi de finances pour 2016.
Parmi ces impositions, les taxes affectées à des organismes ne relevant pas du secteur local ou du secteur social représentent un peu plus de 35 milliards d’euros (soit 13 % du total) et les taxes affectées spécifiquement à des organismes d’administration centrale 16 milliards d’euros (soit 6 %), celles-ci étant les seules à diminuer depuis 2013 à périmètre courant.
3. Les mesures visant à mieux prendre en compte le volume des taxes affectées
a. L’introduction d’un mécanisme de plafonnement de certaines taxes affectées, hors secteur local et secteur social
• Le fonctionnement du plafonnement des taxes affectées
La dynamique de certaines taxes affectées peut conduire à une augmentation sensible des ressources de leurs bénéficiaires décorrélée des besoins liés à leurs activités et à une augmentation de leurs dépenses ou de leurs fonds propres.
Pour limiter ces effets d’aubaine et faire participer les organismes concernés à l’effort d’économies engagé par l’ensemble de la sphère publique, le mécanisme de plafonnement, introduit à l’article 46 de la loi de finances pour 2012, poursuit un triple objectif, à savoir :
– renforcer le suivi et le contrôle par le Parlement des ressources fiscales affectées aux opérateurs, conformément aux principes budgétaires d’annualité (autorisation annuelle du Parlement) et d’universalité (interdiction d’affecter une ressource à un tiers), qui sont les garants du contrôle parlementaire sur l’emploi des ressources de l’État ;
– ajuster les ressources des opérateurs aux besoins qui leur sont nécessaires pour assurer leurs missions de service public ;
– maîtriser le niveau de la dépense de certains opérateurs de l’État par la régulation de leurs ressources affectées.
Le fonctionnement du plafonnement repose sur les dispositions suivantes :
– les affectations de ressources sont autorisées dans la limite d’un plafond soumis annuellement au Parlement. Au-delà de ce plafond, les ressources sont écrêtées au profit du budget général de l’État ;
– les plafonds sont mentionnés dans un tableau unique, à l’instar des états législatifs annexés aux lois de finances, présenté dans un article de loi de finances, en l’occurrence l’article 46 de la loi de finances pour 2012.
Par ailleurs, la liste des taxes affectées soumises à ce plafonnement a été définie par défaut, en retenant trois types d’exemptions :
– les exemptions fondées sur la nature du destinataire de la taxe : sont concernés l’ensemble des organismes gérant des services publics à l’exception des collectivités territoriales et de leurs établissements, des administrations sociales et des organismes paritaires ;
– les exemptions fondées sur la nature de la taxe : sont exclues les redevances pour services rendus et les taxes répondant à une logique de pollueur payeur ;
– les exemptions des taxes affectées s’accompagnant déjà d’un mécanisme indirect de plafonnement, via une subvention d’équilibre portée par le budget général (taxes affectées au Fonds de solidarité par exemple).
Le plafonnement s’applique donc à un champ limité de taxes, qui a toutefois été progressivement élargi par les dernières lois de finances.
• L’évolution du périmètre du plafonnement
Chaque année depuis sa mise en œuvre, le plafonnement est élargi à de nouvelles taxes.
ÉVOLUTION DU NOMBRE ET DU MONTANT DES TAXES AFFECTÉES ENTRE 2012 ET 2016
Années |
Nombre de taxes plafonnées |
Plafond des taxes |
Montant de l’écrêtement au profit du budget de l’État |
2012 |
45 |
3 000 |
136,2 |
2013 |
55 |
5 100 |
218 |
2014 |
60 |
5 600 |
296 |
2015 |
67 |
7 000 |
391 |
2016 |
80 |
8 700 |
452 |
Source : Voies et Moyens annexés aux PLF 2015 et PLF 2016, tome 1.
Ces élargissements successifs n’ont pas renforcé sensiblement la portée du plafonnement, qui demeure un outil limité en termes de périmètre (5,8 milliards sur 35 milliards de taxes affectées hors secteurs social et local) et d’objectif de baisse des recettes affectées aux opérateurs.
En effet, le plafonnement des taxes ne conduit pas nécessairement à diminuer les ressources affectées aux opérateurs, le rendement de certaines taxes étant inférieur au plafonnement fixé.
b. La prise en compte des taxes affectées plafonnées dans les normes de dépenses de l’État
Le fort dynamisme de la fiscalité affectée, qui s’explique pour partie par la possibilité de contourner les normes de dépenses par le recours à une taxe plutôt qu’à des dotations budgétaires, a conduit le législateur à inclure progressivement le montant des taxes plafonnées dans la norme de dépense « zéro valeur » de l’État (130).
Ces dispositions ont été complétées par des mesures ponctuelles de prélèvement sur les capacités financières des opérateurs.
c. Les mesures d’économies supplémentaires portant sur certains organismes bénéficiant d’une fiscalité affectée
Des mesures d’économie prenant la forme de prélèvement sur les recettes des bénéficiaires de taxes affectées ont également été adoptées au cours des dernières années de manière à mieux encadrer leurs dépenses ou financer d’autres entités, comme le rappelle le tableau suivant.
LES PRÉLÈVEMENTS SUR RECETTES DES BÉNÉFICIAIRES DE TAXES AFFECTÉES PLAFONNÉES ENTRE 2012 ET 2015
Organisme |
Fondement législatif |
Montant du prélèvement |
Entités bénéficiant du prélèvement |
Chambres de commerce et d’industrie (CCI) |
LFI 2015 |
500 millions d’euros |
Budget général de l’État (BG) |
LFI 2014 |
170 millions d’euros |
BG | |
Caisse de garantie du logement locatif social (CGLLS) |
PLF 2016* |
100 millions d’euros |
BG |
LFR 2014 |
15 millions d’euros |
Fonds de péréquation du logement social | |
LFR 2013 |
78 millions d’euros |
Fonds de péréquation du logement social | |
Agences de l’eau |
LFI 2015 pour 2016 |
175 millions d’euros |
BG |
LFI 2015 |
175 millions d’euros |
BG | |
LFI 2014 |
210 millions d’euros |
BG | |
Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC) |
2016 (mesure d’ajustement du budget 2015 du CNC) |
60 millions d’euros |
BG |
LFI 2014 |
90 millions d’euros |
BG | |
LFI 2013 |
150 millions d’euros |
BG | |
Institut national de la propriété industrielle (INPI) |
LFI 2014 |
11 millions d’euros |
BG |
Office national de l’eau et des milieux aquatiques (ONEMA) |
LFI 2012 |
55 millions d’euros |
BG |
Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) |
LFI 2012 |
42 millions d’euros |
BG |
Agence nationale de traitement automatisé des infractions |
LFI 2015 |
14 millions d’euros |
ANTS |
Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) |
PLF 2016* |
90 millions d’euros |
BG |
* Mesures présentées ci-après.
B. UNE RÉVISION GLOBALE DES TAXES AFFECTÉES PRÉVUES EN LOI DE PROGRAMMATION DES FINANCES PUBLIQUES POUR LES ANNÉES 2014 À 2019
Pour répondre aux limites de l’encadrement existant, la loi de programmation des finances publiques (LPFP) pour les années 2014 à 2019 (131) renforce le mécanisme de plafonnement des taxes affectées au travers de trois mesures.
1. Les objectifs en matière de baisse globale des taxes affectées
L’article 15 de la dernière LPFP prévoit que la réduction annuelle de la somme des plafonds des taxes affectées étant soumises au mécanisme de plafonnement doit être, à périmètre constant, au moins égale aux montants suivants :
(en millions d’euros)
2015 |
2016 |
2017 |
283 |
135 |
86 |
En 2015, la baisse du plafond des taxes affectées a ainsi été de 312 millions d’euros.
Pour 2016, le présent article propose de diminuer les taxes plafonnées, à périmètre constant, de plus du double de l’objectif fixé par la loi de programmation, soit de 316 millions d’euros au lieu des 135 millions prévus.
2. Les objectifs en matière de réduction du nombre de taxes affectées
L’article 16 de la loi de programmation prévoit pour l’ensemble des taxes ne relevant du secteur social ou du secteur local :
– un encadrement plus strict de la notion de taxe affectée, désormais reconnue aux seuls prélèvements d’intérêt sectoriel, aux contributions de nature assurantielle ou à la rémunération d’un service rendu par l’affectataire ;
– l’élargissement du plafonnement à toutes les taxes affectées répondant à cette notion à compter du 1er janvier 2016 ;
– la « rebudgétisation » des taxes affectées non plafonnées avant le 1er janvier 2017.
Ces objectifs s’inscrivent dans une démarche de rationalisation du nombre des taxes affectées existantes et d’encadrement des conditions de leur création. Si le présent article ne permet pas de répondre totalement aux objectifs fixés pour le 1er janvier 2016, il propose toutefois une nouvelle baisse du montant des taxes plafonnées et son élargissement à onze nouvelles taxes.
Cet effort devra être poursuivi dans le projet de loi de finances (PLF) pour 2017.
II. LES MESURES PROPOSÉES
A. UNE ÉCONOMIE DE 316 MILLIONS D’EUROS SUR LE PLAFONNEMENT DES TAXES AFFECTÉES À PÉRIMÈTRE CONSTANT
Le A du I prévoit des modulations à la hausse et à la baisse des plafonds en vigueur en 2015 pour une baisse globale nette de 316 millions d’euros à périmètre constant.
1. La diminution du plafond de 33 taxes
Le présent article propose d’abaisser le plafond de 33 taxes d’un montant total de 301 millions d’euros, dont la moitié porte sur les seules chambres de commerce et d’industrie.
BAISSE DU PLAFOND DE 33 TAXES AFFECTÉES
(en milliers d’euros)
Imposition ou ressource affectée |
Personne affectataire |
Plafond 2015 |
Plafond proposé 2016 |
Sommes des baisses |
Article 232 du code général des impôts (CGI) |
Agence nationale de l’habitat (ANAH) |
61 000 |
21 000 |
– 40 000 |
1° de l’article L. 342-21 du code de la construction et de l’habitation |
Agence nationale de contrôle du logement social |
7 000 |
6 790 |
– 210 |
2° de l’article L. 342-21 du code de la construction et de l’habitation |
Agence nationale de contrôle du logement social |
12 300 |
11 931 |
– 369 |
b du III de l’article 158 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 |
Agence nationale des fréquences |
6 000 |
3 000 |
– 3 000 |
V de l’article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) |
Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA) |
100 000 |
85 000 |
– 15 000 |
Article 1628 ter du CGI |
Agence nationale des titres sécurisés |
10 000 |
7 000 |
– 3 000 |
VI de l’article 135 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 |
ANTS |
38 700 |
36 200 |
– 2 500 |
Article L. 341-6 du code forestier |
Agence de services et de paiement |
18 000 |
10 000 |
-8 000 |
Article L. 612-20 du code monétaire et financier |
Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) |
195 000 |
190 000 |
-5 000 |
Article L. 2132-13 du code des transports |
Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières (ARAF) [ARAFER] |
11 000 |
10 457 |
– 543 |
F de l’article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) |
Centre d’étude et de recherche de l’industrie du béton (CERIB) ; Centre technique de matériaux naturels de construction (CTMNC) |
14 500 |
14 000 |
– 500 |
Article 1609 tricies du CGI |
Centre national pour le développement du sport (CNDS) |
34 600 |
32 300 |
– 2 300 |
Premier alinéa de l’article 1609 novovicies du CGI |
CNDS |
170 500 |
163 450 |
– 7 050 |
2 du III de l’article 1600 du CGI |
Chambres de commerce et d’industrie |
506 117 |
356 117 |
– 150 000 |
Article 1601 du CGI et article 3 de la loi n° 48-977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambre de métiers applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle |
Chambres de métiers et de l’artisanat |
244 009 |
243 018 |
– 991 |
D de l’article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) |
Comité de développement et de promotion de l’habillement (DEFI) |
9 500 |
9 310 |
– 190 |
A de l’article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) |
Comité professionnel de développement des industries françaises de l’ameublement et du bois (CODIFAB) ; Institut technologique filière cellulose, bois, ameublement (FCBA) ; Centre technique des industries mécaniques (CETIM) |
14 000 |
13 300 |
– 700 |
B de l’article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) |
Comité professionnel de développement cuir, chaussure, maroquinerie (CTC) |
12 500 |
12 250 |
– 250 |
E de l’article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) |
Centres techniques industriels de la mécanique (CETIM, Centre technique des industries mécaniques et du décolletage, Centre technique industriel de la construction métallique, Centre technique des industries aérauliques et thermiques, Institut de soudure) |
70 500 |
70 256 |
– 244 |
Articles 1607 ter du CGI et L. 321-1 du code de l’urbanisme |
Établissement public foncier de Lorraine |
25 300 |
25 275 |
– 25 |
Articles 1607 ter du CGI et L. 321-1 du code de l’urbanisme |
Établissement public foncier de Normandie |
22 100 |
14 286 |
– 7 814 |
Articles 1607 ter du CGI et L. 321-1 du code de l’urbanisme |
Établissement public foncier de Poitou-Charentes |
12 100 |
9 890 |
– 2 210 |
Articles 1607 ter du CGI et L. 321-1 du code de l’urbanisme |
Établissement public foncier de Languedoc-Roussillon |
31 800 |
19 754 |
– 12 046 |
Articles 1607 ter du CGI et L. 321-1 du code de l’urbanisme |
Établissement public foncier de Bretagne |
21 700 |
21 648 |
– 52 |
Article L. 2221-6 du code des transports |
Établissement public de sécurité ferroviaire (EPSF) |
10 500 |
10 200 |
– 300 |
Article 75 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) |
FranceAgriMer |
4 100 |
3 977 |
– 123 |
Article 1619 du CGI |
FranceAgriMer |
22 000 |
18 000 |
– 4 000 |
C de l’article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) |
Comité professionnel de développement de l’horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie, de l’orfèvrerie et des arts de la table (Francéclat) |
13 000 |
12 740 |
– 260 |
Article L. 121-16 du code de l’énergie |
Médiateur national de l’énergie |
6 860 |
6 723 |
– 137 |
Article L. 423-27 du code de l’environnement |
Office national de la chasse et de la faune sauvage |
67 620 |
66 200 |
– 1 420 |
C du I de l’article 31 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 |
Société du Grand Paris (SGP) |
375 000 |
350 000 |
– 25 000 |
Article L. 4316-3 du code des transports |
Voies navigables de France (VNF) |
139 748 |
132 844 |
– 6 904 |
Article L. 524-11 du code du patrimoine |
Organismes bénéficiaires de la redevance d’archéologie préventive |
118 000 |
0 |
– 118 000 |
III de l’article 134 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2008 |
Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) |
11 250 |
0 |
– 11 250 |
Taxe affectée au Centre technique interprofessionnel des fruits et légumes |
CTI Fruits et légumes |
4 500 |
0 |
– 4 500 |
Total |
33 |
2 468 804 |
2 033 916 |
– 433 888 |
Source : loi de finances pour 2015 et projet de loi de finances pour 2016.
2. Les taxes dont le plafond augmente
Le présent article propose d’augmenter le plafond de 5 taxes d’un montant total de 53,6 millions d’euros.
HAUSSE DU PLAFOND DE 6 TAXES AFFECTÉES
(en milliers d’euros)
Imposition ou ressource affectée |
Personne affectataire |
Plafond 2015 |
Plafond proposé 2016 |
Somme des écarts |
Article 302 bis ZB du CGI |
AFITF |
561 000 |
566 000 |
5 000 |
Articles L. 621-5-3 et suivants du code monétaire et financier |
Autorité des marchés financiers (AMF) |
74 000 |
94 000 |
20 000 |
Troisième alinéa de l’article 1609 novovicies du CGI |
CNDS |
24 000 |
27 600 |
3 600 |
I de l’article 22 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 |
Fonds de solidarité pour le développement (FSD) |
140 000 |
160 000 |
20 000 |
Article 1599 quater A bis du CGI |
SGP |
60 000 |
65 000 |
5 000 |
Total |
5 |
859 000 |
912 600 |
53 600 |
Source : loi de finances pour 2015 et projet de loi de finances pour 2016.
Le relèvement du plafonnement du prélèvement sur les jeux de loterie et les paris sportifs affecté au CNDS doit permettre la participation de l’État au financement de la candidature de la ville de Paris aux jeux olympiques et paralympiques de 2024 (132).
L’article 1609 novovicies du CGI prévoit que le plafond applicable à ce prélèvement est égal à 24 millions d’euros par an pour les années 2011 à 2015, à 16,5 millions d’euros en 2016 puis à 15,5 millions d’euros en 2017.
Le D du II prévoit donc de fixer le montant du plafond de 2016 à 27,6 millions d’euros pour permettre ce financement.
Par ailleurs, le X du présent article prévoit de minorer la baisse de la taxe pour frais de chambre (TFC) affectée aux chambres d’agriculture prévue par l’article 34 de la loi de finances pour 2015 : alors que le montant de la taxe en 2016 devait être égal à 96 % de celui notifié en 2014 et de 94 % en 2017, le présent article propose de limiter cette baisse à 98 % en 2016, 96 % en 2017 et 94 % en 2018. Les chambres ultramarines ne seraient pas concernées par la mesure.
3. Les taxes dont le plafond reste stable
Les plafonds des autres taxes affectées concernées par l’article 46 de la loi de finances pour 2012 restent stables.
STABILITÉ DU PLAFOND DE 41 TAXES AFFECTÉES
(en milliers d’euros)
Imposition ou ressource affectée |
Personne affectataire |
PLAFOND 2015 |
Article L. 131-5-1 du code de l’environnement |
ADEME |
448 700 |
Article 706-163 du code de procédure pénale |
Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC) |
1 806 |
a du III de l’article 158 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 |
Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail |
2 000 |
Article 46 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 (I de l’article 953 du CGI) |
ANTS |
118 750 |
Article 46 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 (IV et V de l’article 953 du CGI et article L. 311-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) |
ANTS |
14 490 |
Article 1605 nonies du CGI |
Agence de services et de paiement |
12 000 |
Article L. 253-8-2 du code rural et de la pêche maritime |
Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail |
4 200 |
Article 77 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) |
Association pour le soutien du théâtre privé |
8 000 |
Article 1609 nonies G du CGI |
Caisse de garantie du logement locatif social [Fonds national d’aide au logement] |
45 000 |
Article 224 du code des douanes |
Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres (CELRL) |
37 000 |
Article 59 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) |
CNDS |
40 900 |
a de l’article 1609 undecies du CGI |
Centre national du livre (CNL) |
5 300 |
b de l’article 1609 undecies du CGI |
CNL |
29 400 |
Article 76 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) |
Centre national de la chanson, des variétés et du jazz (CNV) |
30 000 |
Article 1604 du CGI |
Chambres d’agriculture |
292 000 |
II de l’article 1600 du CGI |
Chambres de commerce et d’industrie |
549 000 |
Article 72 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) |
Centre technique de la conservation des produits agricoles |
2 900 |
Articles 1607 ter du CGI et L. 321-1 du code de l’urbanisme |
Établissement public foncier de l’Ouest Rhône-Alpes |
30 600 |
Établissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d’Azur |
83 700 | |
Établissement public foncier des Hauts-de-Seine |
27 100 | |
Établissement public foncier des Yvelines |
23 700 | |
Établissement public foncier du Val-d’Oise |
19 600 | |
Établissement public foncier de Vendée |
7 700 | |
Établissement public foncier Nord-Pas-de-Calais |
80 200 | |
Article 1601 B du CGI |
Fonds d’assurance formation des chefs d’entreprise inscrits au répertoire des métiers mentionné au III de l’article 8 de l’ordonnance n° 2003-1213 du 18 décembre 2003 |
54 000 |
Article 1601 A du CGI |
Fonds national de promotion et de communication de l’artisanat (FNPCA) |
9 910 |
VI de l’article 302 bis K du CGI |
FSD |
210 000 |
Article L. 236-2 du code rural et de la pêche maritime |
FranceAgriMer |
2 000 |
Articles L. 236-2-2 et L. 251-17-2 du code rural et de la pêche maritime |
FranceAgriMer |
2 000 |
Article L. 642-13 du code rural et de la pêche maritime |
Institut national de l’origine et de la qualité (INAO) |
7 000 |
Article L. 137-24 du code de la sécurité sociale |
Institut national de prévention et d’éducation pour la santé (INPES) |
5 000 |
Article L. 311-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile |
Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) |
105 000 |
Article L. 311-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile |
OFII |
23 000 |
Article L. 211-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile |
OFII |
7 000 |
Article L. 8253-1 du code du travail |
OFII |
1 500 |
Article L. 626-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile |
OFII |
500 |
Article 958 du CGI |
OFII |
3 000 |
Article 1609 G du CGI |
SGP |
117 000 |
Total |
41 |
2 594 706 |
Source : projet de loi de finances pour 2016.
B. UN ÉLARGISSEMENT DU PLAFONNEMENT EXISTANT
Les I, A à C du II et IV du présent article élargissent le plafonnement à onze nouvelles entités bénéficiant de ressources affectées pour un montant global de 2,4 milliards d’euros (soit 2,3 milliards d’euros pour les agences de l’eau et 130,5 millions d’euros pour les 7 autres taxes concernées).
a. Le plafonnement des taxes affectées aux agences de l’eau
Le B du I introduit un nouveau III bis à l’article 46 de la LFI 2012 de manière à introduire un plafond spécifique sur les taxes et redevances perçues par pour les agences de l’eau.
Ce plafond est fixé à 2,3 milliards d’euros, après déduction de la fraction des taxes affectées aux agences de l’eau reversée à l’Office national de l’eau et des milieux aquatiques (ONEMA).
Ce plafond est un peu supérieur aux estimations de recettes affectées des agences de l’eau pour 2015.
RECETTES ISSUES DES « REDEVANCES » PERÇUES PAR LES SIX AGENCES DE L’EAU
(en millions d’euros)
Redevance |
2012 |
2013 |
2014 |
Prévisions 2015 |
Redevances pour prélèvement |
355,73 |
340,79 |
368,66 |
378,61 |
Redevances pour autres usages |
10,10 |
9,07 |
9,45 |
9,63 |
dont obstacle sur cours d’eau |
0,28 |
0,22 |
0,36 |
0,40 |
dont protection milieu aquatique |
8,56 |
8,42 |
8,66 |
8,89 |
dont stockage en période d’étiage |
1,26 |
0,43 |
0,43 |
0,34 |
dont contributions volontaires |
− |
− |
− |
− |
Redevances pour pollution et collecte |
1 884,85 |
1 842,61 |
1 815,21 |
1 818,36 |
Majoration pour paiement tardif redevances |
3,83 |
4,56 |
3,99 |
− |
Total |
2 254,51 |
2 197,02 |
2 197,32 |
2 206,60 |
Source : Gouvernement.
Pour rappel, si les redevances perçues par les agences de l’eau n’étaient pas soumises jusqu’à présent au plafonnement prévu par l’article 46 de la loi de finances pour 2012, elles ne pouvaient pour autant dépasser les montants inscrits dans l’enveloppe de financement des dixièmes programmes d’intervention (2013-2018) prévue à l’article 124 de la même loi de finances pour 2012.
Cet article prévoit notamment que les recettes des agences sont plafonnées à 13,8 milliards d’euros sur l’ensemble de la période couverte par le programme, hors part de « redevances » pour pollutions diffuses reversée à l’ONEMA dans le cadre du plan « Écophyto » et hors contribution au budget général de cet organisme. Ce plafond se décline en plafonds annuels cumulés sur la durée du programme : 2,3 milliards d’euros en 2013 ; 4,6 milliards d’euros en 2014 ; 6,9 milliards d’euros en 2015 ; 9,2 milliards d’euros en 2016 ; 11,5 milliards d’euros en 2017 et 13,8 milliards d’euros en 2018.
Le plafond annuel proposé par le présent article est cohérent avec cette trajectoire et permet d’intégrer les redevances perçues dans le champ de la norme en dépense de l’État.
Dans le cas où le rendement de ces taxes serait supérieur à ce plafond, l’écart constaté serait reversé à l’État qui le répartirait par la suite entre les différentes agences. Cet excédent serait établi sur la base d’un état mensuel des produits des taxes perçues transmis par chaque agence aux ministres chargés de l’écologie et du budget.
b. Les autres taxes entrant dans le mécanisme de plafonnement
4 nouvelles taxes verraient leur montant plafonné à compter de 2016 pour un montant global de 130,5 millions d’euros.
PLAFONNEMENT DE 7 AUTRES NOUVELLES TAXES
Imposition ou ressource affectée |
Personne affectataire |
Plafond 2015 |
Plafond proposé 2016 |
Article 1609 C du CGI |
Agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite « des cinquante pas géométriques » en Guadeloupe |
0 |
1 700 |
Article 169 C du CGI |
Agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite « des cinquante pas géométriques » en Martinique |
0 |
1 700 |
2° du B du I de l’article XX de la loi XX de finances pour 2016 |
Centre technique des industries de la fonderie |
0 |
1 159 |
3° du B du II de l’article XX de la loi XX de finances pour 2016 |
Centre technique industriel de la plasturgie et des composites |
0 |
3 000 |
Article 1635 bis A du CGI |
Fonds national de gestion des risques en agriculture |
0 |
60 000* |
1° du B du II de l’article XX de la loi XX de finances pour 2016 |
Institut des corps gras |
0 |
404 |
Article 96 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 |
Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire |
0 |
62 500 |
Total |
7 |
− |
130 463 |
* Ce montant correspond à la différence entre le rendement de la taxe attendue en 2016 et la baisse de taux prévue par le présent article et présenté ci-après. Par conséquent, pour obtenir le montant global de réduction des taxes affectées plafonnées de 316 millions d’euros, il faut ajouter au montant des taxes dont le plafond est relevé par l’article, les 60 millions d’euros de taxe affectée au FNGRA.
Source : Gouvernement.
L’élargissement du plafonnement aux taxes affectées au centre technique des industries (CTI) de la fonderie et à l’Institut des corps gras fait suite au remplacement des dotations budgétaires dont ils bénéficient par de nouvelles taxes affectées (prévu par l’article 53 du présent projet de loi de finances).
C. LES AJUSTEMENTS DE TAUX DES TAXES PLAFONNÉES
Comme précédemment rappelé, dans le cas où le rendement de la taxe est supérieur à celui du plafond fixé, l’écart constaté est écrêté au profit du budget de l’État, sauf disposition contraire.
Dans certains cas, le législateur a toutefois souhaité que la baisse des recettes versées aux organismes concernés se traduisent par une baisse d’imposition pour les redevables (à titre d’exemple, la baisse du plafond de la taxe pour frais de chambre affectée aux chambres de commerce et d’industrie de 213 millions d’euros en loi de finances pour 2015 s’est traduite par une baisse de taux permettant d’ajuster le rendement attendu de la taxe au titre de cette même année).
À cette même fin, le présent article prévoit au E du II et au V la baisse de :
– la taxe affectée à l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer) assise sur les quantités de céréales livrées par les exploitants agricoles aux collecteurs de céréales (elle passerait ainsi de 0,36 euro par tonne à 0,28 euro) ;
– la contribution additionnelle aux primes et cotisations afférentes aux conventions d’assurance affectée au Fonds national de gestion des risques en agriculture (FNGRA) dont le taux serait diminué de 11 % à 5,5 % (133).
D. LES AUTRES AJUSTEMENTS PROPOSÉS
1. la baisse de la part de TICPE affectée à l’AFIFT
L’AFITF est un établissement public administratif, créé par le décret du 26 novembre 2004 (134) et administré par un conseil d’administration composé pour moitié de représentants de l’État et pour moitié d’élus nationaux et locaux ainsi que d’une personnalité qualifiée.
Ses missions couvrent le financement de l’ensemble des infrastructures de transport d’intérêt national (création et modernisation) ainsi que de projets de communautés d’agglomérations relatifs aux transports collectifs de personnes. Elles sont exercées dans le respect des recommandations de la commission Mobilité 21 de juillet 2013.
Les ressources pérennes de l’agence se composeraient pour 2016 de :
– la redevance domaniale versée par les sociétés concessionnaires d’autoroutes (315 millions d’euros) ;
– la taxe d’aménagement du territoire (TAT) prélevée par les concessionnaires d’autoroutes (566 millions d’euros) ;
– une fraction du produit des amendes des radars automatiques du réseau routier national (230 millions d’euros en 2014) ;
– une fraction du produit de la TICPE fixée à 1 139 millions d’euros en 2015 pour compenser l’effet de la suspension sine die du péage de transit poids lourd qui devait initialement alimenter le budget de l’agence (135) que le VII du présent article propose de réduire à 715 millions d’euros.
Cette réduction de 424 millions d’euros en 2016 tient compte du paiement exceptionnel par l’État de l’indemnité due à la société Ecomouv’ à la suite de la résiliation du contrat de partenariat conclu avec cette société le 20 octobre 2011.
Selon les informations transmises à la Rapporteure générale, la fraction de TICPE versée permettrait ainsi d’équilibrer le budget de l’agence en ajustant le niveau de ses ressources à celui de ses dépenses prévisionnelles pour l’année 2016.
DÉPENSES ET RECETTES DE L’AFITF
(en millions d’euros)
Exécution 2012 |
Exécution 2013 |
Exécution 2014 |
Budget modifié 2015 |
Sous-jacents PLF 2016 | |
DÉPENSES |
|||||
Dépenses opérationnelles |
1 856 |
1 909 |
1 714 |
1 844 |
1 855 |
Indemnité Ecomouv |
|
529 |
47 | ||
Remboursement Agence France Trésor |
19 |
19 |
48 |
31 |
23 |
Dépenses de fonctionnement |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Total |
1 876 |
1 929 |
1 762 |
2 405 |
1 926 |
Fonds de roulement au 1er janvier de l’année N |
413 |
444 |
84 |
65 |
0 |
RECETTES |
|||||
Taxe d’aménagement du territoire |
535 |
538 |
571 |
561 |
566 |
Redevance domaniale |
198 |
300 |
314 |
310 |
315 |
Amendes radars |
272 |
170 |
203 |
230 |
230 |
Subvention État |
900 |
560 |
656 |
||
Contribution exceptionnelle du secteur autoroutier |
100 |
100 | |||
TICPE |
1 139 |
715 | |||
Total |
1 907 |
1 568 |
1 744 |
2 340 |
1 926 |
Fonds de roulement au 31 décembre de l’année N |
444 |
84 |
65 |
0 |
0 |
Source : Gouvernement.
2. Les prélèvements sur le fonds de roulement
a. Le prélèvement sur le fonds de roulement de l’ADEME
L’ADEME, créée par la loi du 19 décembre 1990 (136), est un établissement public à caractère industriel et commercial placé sous la tutelle conjointe du ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie et du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Elle a pour mission d’apporter une expertise technique sur les politiques environnementales et énergétiques et, depuis 2010, de gérer les investissements d’avenir dans ces domaines.
Elle est principalement financée par une fraction du produit de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) dont le montant est stabilisé à 448,7 millions d’euros depuis 2014.
Par ailleurs, elle dispose d’un fonds de roulement de 434 millions d’euros au 31 décembre 2014 sur lequel le présent article propose d’effectuer un prélèvement de 90 millions d’euros (VI). Ce dernier devrait être sans conséquence sur les activités de l’agence au titre de l’année 2016.
Les besoins de l’ADEME pourraient toutefois évoluer au cours des prochaines années, notamment sous l’effet du renforcement de certaines politiques environnementales et de la multiplication des directives européennes en matière de développement durable.
b. Le prélèvement sur le fonds de roulement de la CGLLS
La CGLLS est un établissement public administratif créé par la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains (SRU) (137) dont l’objet est d’apporter une garantie aux prêts réglementés accordés par la Caisse des dépôts et consignations aux organismes de logement locatif social qui ne bénéficient pas d’une garantie des collectivités territoriales et de prévenir leurs difficultés financières.
Elle est par ailleurs chargée de la gestion de trois fonds :
– le fonds de péréquation du logement locatif social alimenté par le prélèvement sur le potentiel financier des organismes HLM qui a vocation à financer le développement du parc de logements sociaux ;
– le fonds national d’accompagnement vers et dans le logement (FNAVDL) alimenté par les astreintes résultant des condamnations prononcées contre l’État dans le cadre du droit au logement opposable et qui finance des actions en faveur de publics prioritaires ;
– le fonds national de développement de l’offre de logement locatif très social (FNDOLLTS) financé par la majoration des prélèvements effectués au titre de la loi SRU et exclusivement destiné au financement de logements locatifs sociaux à destination des ménages éprouvant d’importantes difficultés à se loger.
Elle bénéficie pour l’exercice de ces missions de deux ressources constituées d’une cotisation de 1,4 % des loyers appelés par les organismes de logement social représentant 78 millions d’euros et une cotisation additionnelle assise sur le nombre de logements et l’autofinancement net des organismes de 94 millions d’euros.
Son budget prévisionnel pour 2015 est de 271 millions d’euros et son fonds de roulement atteint près de 500 millions d’euros (138).
Cette situation financière a conduit le Conseil des prélèvements obligatoires à souligner que « du fait de l’application de règles prudentielles et de la très faible sinistralité de son activité de garantie, la caisse dispose d’un niveau de fonds propres disproportionné au regard des risques, historiquement proches de zéro » (139).
Ce constat a conduit à effectuer plusieurs prélèvements sur le fonds de roulement de la CGLLS au cours des dernières années de l’ordre de :
– 78 millions d’euros en 2013 (article 80 de la loi de finances rectificative pour 2013 (140)) destinés au fonds de péréquation précité ;
– 15 millions d’euros en 2014 au profit de ce même fonds.
Le XI du présent article propose de prélever à nouveau 100 millions d’euros sur les ressources de la caisse avant le 31 janvier 2016.
Selon les informations transmises par la CGLLS ce prélèvement ne remettrait pas en question sa capacité à garantir les emprunts des bailleurs sociaux du fait de l’importance de ses ressources propres et de l’exemption du plafond prudentiel imposé dans le cas de grands risques dont elle bénéficie depuis la parution d’un arrêté du 27 juillet 2015.
3. La rebudgétisation de la redevance d’archéologie préventive
Le financement de l’archéologie préventive repose sur les aménageurs projetant de réaliser des travaux touchant le sous-sol et soumis à autorisation ou à déclaration préalable.
Le produit de la redevance d’archéologie préventive (RAP) est réparti entre les opérateurs archéologiques − 67 % pour l’INRAP et les collectivités territoriales et 30 % pour le FNAP −, les 3 % restants correspondant aux frais de gestion et de recouvrement du prélèvement.
Le produit de la redevance, plafonnée à 118 millions d’euros en 2015, est difficile à estimer a priori et les écarts entre les prévisions de rendement et les exécutions peuvent être importants.
RENDEMENT DE LA RAP ENTRE 2002 ET 2016
(en millions d’euros)
Année |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 (prévisions) |
Rendement de la RAP |
25,6 |
44,4 |
60,3 |
46,8 |
79,9 |
69,1 |
69 |
70,9 |
70,8 |
88 |
78,6 |
44,4 |
81,9 |
– |
Estimation |
− |
− |
− |
− |
− |
− |
− |
− |
− |
− |
100 |
100 |
100 |
98 |
Source : ministère de la culture et de la communication et projet de loi de finances pour 2016.
Par ailleurs, le rapport Pour une politique équilibrée de l’archéologie préventive de notre collègue, Mme Martine Faure, remis à la ministre de la culture et de la communication en mai dernier fait les constats suivants :
« – la liquidation et le recouvrement de la RAP ne posent pas de problème particulier ;
« – le reversement de la RAP, à savoir la ventilation des sommes recouvrées entre les différents bénéficiaires (pour la part opérateurs, entre les différents services de collectivités en particulier), s’avère bien plus difficile en raison de l’inadaptation actuelle des applications informatiques ;
« – des développements informatiques sont donc indispensables pour améliorer le dispositif, mais ils semblent conséquents et pourraient nécessiter du temps et des financements adéquats. »
Les importants délais entre la liquidation et le versement de la RAP entraînent « de graves crises de trésorerie » au sein de l’INRAP et ont contraint le ministère de la culture à procéder à des abondements de son budget en cours de gestion (de plus de 140 millions d’euros depuis 2009).
Le rapport en conclut que « cette accumulation de difficultés laisse planer un doute sérieux sur la viabilité du dispositif de financement de l’archéologie préventive » et recommande la rebudgétisation des ressources de l’INRAP.
Selon les informations transmises à la Rapporteure générale, cet institut est favorable à cette évolution, proposée au VIII du présent article. L’évaluation préalable de l’article indique par ailleurs que le montant des crédits d’archéologie préventive seraient fixé à 118 millions d’euros dans le cadre de la mission Culture, soit à un niveau équivalent à celui du plafond de la RAP prévu en 2015.
4. L’affectation d’une taxe à l’Agence nationale des fréquences
Le IX prévoit qu’une somme de 27,3 millions d’euros, prélevée sur le produit attendu des redevances acquittées par les opérateurs privés pour l’utilisation des fréquences comprises entre 694 MHz et 790 MHz, soit versée chaque année de 2016 à 2018 à l’Agence nationale des fréquences.
Cette somme doit permettre le financement du plan d’aide aux téléspectateurs et aux propriétaires d’équipements de transmission radio à usage professionnel qui sera mis en œuvre à la suite du changement de norme de diffusion numérique terrestre qui doit intervenir dans la nuit du 4 au 5 avril 2016 (141) et des réaménagements de fréquences qui interviendront entre 2016 et 2019.
Des aides à l’équipement d’un montant de 25 euros réservées aux foyers fiscaux dégrevés de contribution à l’audiovisuel public sont envisagées dans le cas de l’acquisition d’un nouveau décodeur ou d’un nouveau téléviseur ainsi que des aides à la réception de 120 euros à 250 euros.
*
* *
La commission examine les amendements identiques I-CF 324 de Mme Eva Sas et I-CF 403 de la commission des affaires économiques.
M. Éric Alauzet. L’amendement I-CF 324 vise à supprimer l’alinéa 4 de l’article 14, qui diminue de 61 à 21 millions d’euros le plafond de ressources affectées à l’Agence nationale de l’habitat (ANAH). Il importe, en effet, de préserver les ressources allant au logement, aux populations extrêmement défavorisées et à la transition énergétique.
M. le rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques. Alors qu’on en demande de plus en plus à l’ANAH, qui doit s’occuper à la fois de la rénovation énergétique et des logements des personnes les plus modestes, on baisse ses recettes d’une manière drastique. Dans ces conditions, je ne sais pas comment elle va pouvoir continuer à s’occuper de l’entretien et de la rénovation des logements des plus défavorisés.
Mme la Rapporteure générale. Avis défavorable. Une recette augmente de 60 millions d’euros tandis que l’autre baisse de 40 : l’ANAH bénéficiera donc de 20 millions d’euros supplémentaires.
La commission rejette les amendements I-CF 324 et I-CF 403.
Puis elle est saisie de l’amendement I-CF 80 du président Gilles Carrez.
M. le président Gilles Carrez. Cet amendement vise à intégrer, dans les ressources affectées plafonnées, celles dont bénéficie le Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC). Cette année, alors qu’on étend le nombre d’opérateurs faisant l’objet du plafonnement, comme par hasard, le CNC est oublié, alors qu’il s’agit de l’opérateur présentant la trésorerie la plus importante et les évolutions de recettes les plus favorables.
Mme la Rapporteure générale. Sagesse.
M. Pierre-Alain Muet. Je rappelle qu’il s’agit d’un autofinancement par le secteur de ses propres investissements. La taxe en question est donc une vraie taxe affectée, qu’il n’y a aucune raison de plafonner.
La commission rejette l’amendement I-CF 80.
Elle est ensuite saisie des amendements identiques I-CF 114 de M. Charles de Courson et I-CF 161 de M. Joël Giraud.
M. Charles de Courson. Depuis 2012, les ressources fiscales affectées aux chambres de commerce et d’industrie (CCI) n’ont cessé de diminuer d’année en année. Si l’on retient la nouvelle baisse de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (TACVAE) prévue à l’article 14 du projet de loi de finances, on constate une diminution de 37 % des ressources fiscales affectées aux chambres entre 2012 et 2016, ce à quoi aucun autre acteur public n’aura eu à faire face, en particulier les administrations de l’État.
Par ailleurs, en 2014 et en 2015, deux prélèvements dits exceptionnels, d’un montant de 170 millions d’euros en 2014 et 500 en 2015, se sont rajoutés à la baisse de la taxe.
La conjugaison de ces mesures a entraîné une asphyxie des capacités d’investissement des chambres dans les territoires – leur tête de réseau CCI France, évalue à 350 millions d’euros l’abandon des investissements sur la seule année 2015 –, mais elle a aussi sérieusement ébranlé les dispositifs d’accompagnement des entreprises et d’appareil de formation qu’elles proposent, qui ont pourtant fait preuve de leur efficacité.
Cet amendement propose donc de supprimer pour l’année 2016 la baisse de 150 millions d’euros de taxe additionnelle prévue à l’article 14.
M. Joël Giraud. J’ajoute simplement que la taxe affectée payée par les entreprises aux chambres – elle n’est donc pas budgétaire – permettait d’opérer une péréquation entre petites et grosses chambres : en cela, c’est un outil favorable aux petites.
Mme la Rapporteure générale. Avis défavorable. Nous examinerons plus loin un amendement de compromis, le I-CF 375.
M. Dominique Lefebvre. Nous allons examiner toute une série d’amendements relatifs au plafonnement de cette taxe affectée aux CCI. Le groupe socialiste, républicain et citoyen est favorable à l’amendement I-CF 375 que présentera ensuite Monique Rabin, qui maintient le plafonnement de la taxe dans l’enveloppe globale de 150 millions d’euros, tout en y imputant une autre disposition, à savoir la mise en place d’un fonds de mutualisation ayant vocation à aider à la modernisation des chambres – cet amendement a en quelque sorte pour effet de faire passer le plafonnement de 150 à 130 millions d’euros. Par conséquent, nous voterons contre les autres amendements ayant le même objet.
La commission rejette les amendements I-CF 114 et I-CF 161.
Elle en vient aux amendements identiques I-CF 67 de M. Joël Giraud, I-CF 87 de M. Laurent Grandguillaume, I-CF 115 de M. Charles de Courson, I-CF 235 de M. Éric Alauzet, I-CF 251 de Mme Marie-Christine Dalloz, I-CF 368 de M. Alain Fauré et I-CF 401 de la commission des affaires économiques.
M. Charles de Courson. Il y a eu une négociation entre le Gouvernement et les chambres de commerce et d’industrie, et un accord a été conclu sur le principe d’une baisse triennale. Alors qu’il était prévu une baisse de ressource de 117 millions d’euros pour 2016, le Gouvernement a inscrit dans le PLF une baisse de 150 millions d’euros. Nous proposons de revenir à ce qui avait été conclu : sinon, il n’y a plus de crédibilité du Gouvernement.
M. Éric Alauzet. Ces baisses de budget sont déjà difficiles à accepter, et il ne nous paraît pas opportun de les aggraver de 33 millions d’euros au mépris de la parole donnée. Nous proposons donc d’en revenir à la baisse initialement prévue de 117 millions d’euros, conformément aux recommandations de la mission d’évaluation et de contrôle.
Mme Marie-Christine Dalloz. Le Gouvernement s’est effectivement engagé à appliquer une baisse de la taxe additionnelle de 117 millions d’euros pour 2016, qu’il faut maintenir. Le procès qui est fait aux chambres consulaires est récurrent et, à agir de la sorte, on prend le risque qu’elles ne fassent plus rien sur nos territoires, ce qui serait très regrettable compte tenu des difficultés auxquelles sont actuellement confrontés le bâtiment et les travaux publics.
Suivant l’avis défavorable de la Rapporteure générale, la commission rejette les amendements.
Elle examine ensuite les amendements identiques I-CF 66 de M. Joël Giraud et I-CF 375 de Mme Monique Rabin.
M. Joël Giraud. L’amendement I-CF 66 propose de limiter l’effort demandé aux chambres de commerce et d’industrie à 20 millions d’euros pour 2016.
Mme Monique Rabin. Contrairement à ce qu’a dit Marie-Christine Dalloz, notre amendement propose de respecter la trajectoire triennale de la baisse des ressources affectées aux chambres de commerce et d’industrie. Alors que l’engagement du Gouvernement consistait en une baisse de 117 millions d’euros sur l’ensemble des taxes affectées, je propose une baisse de 130 millions d’euros, de manière à verser 20 millions d’euros supplémentaires au fonds de modernisation créé par l’article 52 du PLF. Ce dont il est ici question aurait valu mieux qu’un simple débat de chiffres, mais Catherine Vautrin et moi-même nous sommes déjà exprimées devant la commission des finances à ce sujet lors de la présentation de notre rapport pour la Mission d’évaluation et de contrôle.
Au-delà des chiffres, il importe de reconnaître le travail des chambres consulaires, mais aussi l’hétérogénéité des services qu’elles rendent. À cet égard, le fonds de modernisation que je propose est destiné à accompagner les chambres, qui constituent de véritables incubateurs du futur : il ne s’agit pas de larmoyer en évoquant le bon vieux temps, mais d’agir.
Par ailleurs, je ne suis pas d’accord quand j’entends dire qu’il y a eu une dérive des ressources : en réalité, les moyens des chambres n’ont augmenté que de 12 % au cours des cinq dernières années. Sur ce point, je vous renvoie à notre rapport, qui porte non seulement sur l’aspect financier, mais aussi sur la mission des chambres et la nécessité de les restructurer.
Dans un souci d’apaisement, je vous propose d’adopter cet amendement prévoyant une baisse de ressources de 130 millions d’euros. En seconde partie, je vous proposerai un amendement complémentaire à l’article 52.
Suivant l’avis favorable de la Rapporteure générale, la commission adopte les amendements I-CF 66 et I-CF 375.
En conséquence, l’amendement I-CF 82 tombe.
La commission examine les amendements I-CF 252, I-CF 253 et I-CF 254 de Mme Marie-Christine Dalloz qui font l’objet d’une présentation commune.
Mme Marie-Christine Dalloz. Ces amendements visent à préserver le budget du Comité de développement et de promotion de l’habillement (DEFI), du Comité professionnel de développement des industries françaises de l’ameublement et du bois (CODIFAB) et du Comité profession de développement de l’horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie, de l’orfèvrerie et des arts de la table (FRANCECLAT). L’ensemble de ces structures sera fortement affecté par les ponctions prévues à l’article 14. Il est donc proposé de supprimer les alinéas 25, 27 et 47.
Suivant l’avis défavorable de la Rapporteure générale, la commission rejette successivement les amendements I-CF 252, I-CF 253 et I-CF 254.
Elle en vient à l’amendement I-CF 225 de M. Jean-Marie Beffara.
M. Jean-Marie Beffara. Il s’agit d’un amendement de coordination avec l’amendement I-CF 224 que j’ai déposé à l’article 20. Ces deux amendements font suite aux travaux de la mission d’information relative au financement public de l’audiovisuel en France dont j’ai été le rapporteur et qu’a présidée Éric Woerth. Ils ont pour but d’attirer l’attention de la commission sur l’idée, consensuelle au sein de cette mission d’information, selon laquelle l’audiovisuel public français a aujourd’hui besoin de stabilité, de visibilité et d’indépendance dans son financement. L’audiovisuel ne comprend pas seulement France Télévisions mais aussi Radio France, Arte, France Médias Monde, TV5 Monde et l’Institut national de l’audiovisuel (INA). La totalité des financements publics alloués à cet ensemble s’élève à 3,7 milliards d’euros par an, issus pour l’essentiel du produit de la contribution à l’audiovisuel public mais aussi de celui de la publicité diffusée sur France Télévisions.
Or, la suppression de la publicité après 20 heures en 2009 sur les chaînes du groupe a fragilisé le financement de l’ensemble des opérateurs de l’audiovisuel public. Cette évolution a conduit à une perte de recettes de 400 millions d’euros pour France Télévisions, compensée, depuis 2009, par des dotations budgétaires directement issues du budget de l’État à hauteur de 450 millions d’euros la première année et ramenées à 160 en 2015. La baisse de cette dotation budgétaire est partiellement compensée par le produit d’une taxe sur les services fournis par les opérateurs de communications électroniques, qui rapporte environ 200 millions d’euros par an. Et depuis cette suppression, le solde pour l’État est négatif à hauteur de 450 millions d’euros.
Le président de la mission d’information et moi-même partageons l’idée qu’il conviendrait de stabiliser les ressources complémentaires de France Télévisions. C’est pourquoi nous proposons que la taxe précitée soit affectée à France Télévisions et plafonnée à hauteur de la dernière dotation de l’État. Il s’agit à la fois de préserver cette entreprise et l’ensemble des autres opérateurs de l’audiovisuel public, dans la mesure où la dotation précitée donne lieu chaque année à des régulations budgétaires infra-annuelles déstabilisantes. Il convient de permettre à l’audiovisuel public d’atteindre les objectifs de service public qui lui sont fixés dans un contexte de visibilité budgétaire à moyen et long terme. Sans doute m’objecterez-vous que l’amendement pose des problèmes juridiques. Quoi qu’il en soit, je vous renvoie à notre excellent rapport d’information pour de plus amples renseignements sur le sujet.
Mme la Rapporteure générale. L’affectation directe d’une taxe à une entreprise risque d’être qualifiée d’aide d’État.
M. le président Gilles Carrez. C’est pourquoi le produit de la taxe transite actuellement par un compte d’affectation spéciale.
Mme la Rapporteure générale. Je vous propose de retirer votre amendement afin que nous en améliorions la rédaction d’ici à la séance publique.
M. Jean-Marie Beffara. Ce problème ne m’avait pas échappé. Je me rallie donc à votre proposition.
L’amendement I-CF 225 est retiré.
Puis la commission aborde l’amendement I-CF 356 de M. Joël Giraud.
M. Joël Giraud. Cet amendement vise à supprimer une niche fiscale amoindrissant les recettes de Voies navigables de France (VNF). Cet établissement public met gratuitement à disposition son réseau pour l’utilisation du refroidissement par eau de rivière dans le cadre de la production frigorifique distribuée par réseau de froid urbain en délégation de service public. Il s’agit là de la seule exonération à affecter les recettes de VNF, qui se trouve au cœur des enjeux de développement durable en cette année de COP21. La suppression de cette niche fiscale permettrait à VNF de garder le même budget en 2016.
Mme la Rapporteure générale. Il semble qu’en supprimant l’alinéa 57, votre amendement n’atteigne pas l’objectif poursuivi. Je vous propose de le réécrire d’ici à la séance publique.
L’amendement I-CF 356 est retiré.
La commission est saisie des amendements identiques I-CF 325 de Mme Eva Sas et I-CF 389 de la commission du développement durable.
M. Éric Alauzet. Il est vrai que le prélèvement sur le fonds de roulement de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) est beaucoup moins important que les années précédentes et que la politique de transition énergétique ne tient pas qu’à cette agence et au ministère de l’écologie. Cela étant, cette diminution de crédits pose des difficultés.
Suivant l’avis défavorable de la Rapporteure générale, la commission rejette les amendements I-CF 325 et I-CF 389.
Elle examine, en discussion commune, les amendements I-CF 77 du président Gilles Carrez, I-CF 234 de M. Olivier Faure, I-CF 382 de la commission du développement durable, I-CF 79 du président Gilles Carrez et I-CF 326 de Mme Eva Sas.
M. le président Gilles Carrez. L’amendement I-CF 77 a pour objet de maintenir en 2016 l’affectation à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF) de la hausse de 2 centimes sur le diesel applicable en 2015. Seule une fraction de cette hausse devrait être affectée à l’agence en 2016, contrairement à 2015. Cette évolution correspond à un manque à gagner de quelque 400 millions d’euros.
M. Olivier Faure. Cet amendement vise à assurer que les 1 139 millions d’euros attribués à l’agence en 2015 le seront à nouveau en 2016 au lieu d’être alloués à d’autres besoins de financement. L’amendement porte le plafond d’attribution de la hausse de la taxe intérieure de consommation sur les productions énergétiques à 1,5 milliard d’euros, ce qui devrait nous permettre de débattre en séance publique avec le Gouvernement non seulement de la hausse de 2 centimes déjà prévue en loi de finances pour 2016 mais aussi de l’éventualité d’une augmentation supplémentaire.
M. le rapporteur pour avis de la commission du développement durable. L’amendement I-CF 382 a le même but, avec des chiffres quelque peu différents.
Mme la Rapporteure générale. Les dépenses opérationnelles courantes de l’AFITF s’élèvent effectivement à 1,9 milliard d’euros. L’an dernier, elles ont augmenté de 500 millions d’euros du fait du débouclage d’Écomouv’. Pour atteindre l’objectif poursuivi dans votre amendement, il conviendrait, monsieur le président, de dégager 700 millions d’euros.
M. le président Gilles Carrez. Monsieur Faure y était parvenu tout à l’heure.
Mme la Rapporteure générale. Presque ! D’ici à ce que l’on y parvienne, j’émets un avis défavorable à ces amendements, à moins que vous ne les retiriez pour les redéposer d’ici à la discussion en séance publique.
M. le président Gilles Carrez. Si l’on n’accorde pas 2,2 milliards d’euros à l’AFITF en 2016, celle-ci ne sera pas en mesure de financer les opérations qu’elle a déjà lancées. Cette somme ne correspond d’ailleurs qu’à l’hypothèse basse du rapport de Philippe Duron, l’hypothèse raisonnable étant fixée à 2,5 milliards d’euros.
M. Olivier Faure. C’est précisément la raison pour laquelle je propose de fixer le plafond des recettes issues de la hausse de taxation à 1,5 milliard d’euros. Pour les mêmes raisons que tout à l’heure, je suis plutôt d’avis de maintenir cet amendement d’appel afin que nous puissions débattre de la question en séance publique. Il n’est pas uniquement question ici de la convergence des taxations applicables aux différents carburants, mais aussi des recettes nécessaires au financement de l’agence. Après le débat en séance, je pourrai retirer l’amendement afin qu’il soit rediscuté lors de l’examen du projet de loi de finances rectificative.
M. Dominique Lefebvre. Lorsque j’ai pris connaissance des lettres plafonds et de leurs annexes, j’ai constaté une baisse significative des montants de taxe affectée à l’AFITF. Je me suis alors demandé si le Gouvernement entendait diviser par deux les moyens de l’agence de sorte qu’elle n’aurait plus les moyens d’exécuter ses opérations en 2016. En d’autres termes, s’agit-il d’un problème d’affectation d’une ressource ou de financement global de l’AFITF ?
M. le président Gilles Carrez. Il manque effectivement 700 millions d’euros à l’agence en 2016. Pour ma part, je retire mes amendements et les redéposerai en séance.
M. Éric Alauzet. La différence entre ce que l’écotaxe était censée rapporter et le produit de l’augmentation du prix du gazole pour les poids lourds pourrait expliquer en partie le manque à gagner pour l’AFITF.
Mme la Rapporteure générale. Avis défavorable à l’amendement I-CF 326.
Les amendements I-CF 77 et I-CF 79 sont retirés.
Puis la commission rejette successivement les amendements I-CF 234, I-CF 382 et I-CF 326.
Elle en vient à l’amendement I-CF 116 de M. Charles de Courson.
M. Charles de Courson. Le Gouvernement souhaitait réduire de 2 % par an entre 2015 et 2018 le montant de la taxe notifiée aux chambres d’agriculture. À la suite d’échanges au sommet avec le chef de l’État, cette baisse a été stabilisée à 98 % du montant total de la taxe en 2016, comme en 2015. Mon amendement vise à maintenir cette stabilisation à 98 % en 2017 et 2018. En effet, les chambres d’agriculture sont à quia. Leur restructuration ne permet pas de réaliser des économies immédiatement. De plus, la création des nouvelles régions les contraint également à se restructurer au niveau régional. Les chambres n’arrivent donc même plus à assumer les fonctions qui leur ont été confiées par la loi.
Mme Monique Rabin. Les arguments d’investissement et de maintien de l’emploi ayant prévalu pour les chambres de commerce et d’industrie ne sont pas applicables aux chambres d’agriculture, qui n’ont pas les mêmes difficultés d’investissement. C’est pourquoi je suis défavorable à cet amendement.
Mme la Rapporteure générale. J’émets le même avis, sur le fondement du rapport d’information de Monique Rabin.
La commission rejette l’amendement I-CF 116.
Elle est saisie des amendements identiques I-CF 117 de M. Charles de Courson, I-CF 327 de Mme Eva Sas et I-CF 399 de la commission des affaires économiques.
M. Charles de Courson. Cela faisait quelques années que le Gouvernement n’avait pas fait de hold-up sur la Caisse de garantie du logement locatif social (CGLLS).
M. le président Gilles Carrez. L’État a tellement procédé ainsi dans le passé que la caisse n’avait plus de fonds de roulement. Comme ce dernier s’est reconstitué depuis, le Gouvernement récidive. Il en va ainsi depuis vingt ans.
M. Charles de Courson. Financer une dépense durable à l’aide d’un prélèvement exceptionnel n’est pas de bonne politique. Comment fera-t-on l’an prochain ?
M. le rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques. Ces prélèvements sur la CGLLS font courir un risque au programme national de rénovation urbaine, les bailleurs n’ayant plus les moyens d’accompagner les projets de rénovation.
Mme la Rapporteure générale. Il est prévu que le prélèvement de 100 millions d’euros sur les ressources de la caisse soit réaffecté en deuxième partie au programme 135 de la mission Égalité des territoires et logement.
M. Jean-Louis Dumont. Il s’agit là exclusivement de l’argent des locataires. En outre, des négociations sont intervenues au cours de ces dernières semaines, qui se poursuivent actuellement. Les aides à la pierre dont nous discuterons en seconde partie méritent une attention particulière. L’avant-projet de loi de finances ayant été soumis au Conseil d’État il y a trois ou quatre semaines, le texte dont nous discutons ne tient pas compte des annonces formulées par le Gouvernement lors du congrès des HLM, des négociations en cours ni de la création du Fonds national d’aides à la pierre. Il conviendrait d’alerter l’administration de Bercy afin que ce prélèvement soit supprimé. Compte tenu des sommes considérables que représentent les restructurations actuelles et les dossiers d’aide aux sociétés d’économie mixte d’État en outre-mer, mieux vaudrait laisser ces crédits à la CGLLS, qui va néanmoins bénéficier d’une autorisation de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution concernant les grands risques.
La commission rejette les amendements I-CF 117, I-CF 327 et I-CF 399.
Puis elle adopte l’article 14 modifié.
*
* *
Article 15
Réforme de l’aide juridictionnelle
Dans le prolongement de l’article 35 de la loi de finances pour 2015 (142), le présent article vise à poursuivre la modernisation du dispositif d’aide juridictionnelle dont l’objet est de faciliter l’accès à la justice des personnes dont les revenus sont limités.
À cette fin, le présent article prévoit, en premier lieu, un ensemble de mesures disparates permettant d’affecter de nouveaux moyens à cette politique :
– il prévoit un prélèvement de 5 millions d’euros en 2016 et de 10 millions d’euros en 2017 sur les produits financiers des centres des règlements pécuniaires des avocats (CARPA) qui sera affecté au Conseil national des barreaux (CNB) ;
– il fait passer de 11,6 % en 2015, à 12,5 % en 2016 et à 13,4 % en 2017 le taux de la taxe sur les conventions d’assurances (TSCA) pesant sur les contrats d’assurance juridique. Le produit correspondant, évalué à 10 millions en 2016 et à 20 millions à compter de 2017, est affecté au CNB ;
– la taxe sur les actes des huissiers de justice doit passer de 11,16 euros en 2015 à 13,04 euros en 2016 et 14,89 euros en 2017. Toutefois, l’affectation du produit de cette taxe à hauteur de 11 millions d’euros au CNB, prévue dans la loi de finances pour 2015, est supprimée. Le produit de cette taxe ira donc intégralement au budget général de l’État ;
– l’affectation de 7 millions d’euros du droit pesant sur les décisions des juridictions répressives au CNB, décidée également l’année dernière, est supprimée : à l’inverse, une fraction du produit des amendes pénales est affectée au CNB à hauteur de 28 millions d’euros en 2016 et 38 millions d’euros en 2017.
Au total, ces mesures permettront d’affecter à cette politique un financement complémentaire de 25 millions d’euros en 2016et un montant identique en 2017 (soit 50 millions d’euros en deux ans). Le montant total des moyens en faveur de l’aide juridictionnelle passera donc de 331,6 millions d’euros en 2011 à 405 millions d’euros en 2017 (+ 22,1%). Par ailleurs, le nombre de personnes admises à l’aide juridictionnelle est passé de 915 625 en 2012 à 896 786 en 2014.
Parallèlement, le budget du ministère de la justice passera de 7 894 à 7 973 millions d’euros, soit une augmentation de 79 millions d’euros.
Comme l’année dernière, ces mesures budgétaires s’accompagnent d’une amélioration de la politique menée dans ce domaine :
– le présent article étend l’aide juridictionnelle à l’aide à la médiation, après avoir été étendue aux procédures non juridictionnelles l’année dernière. Ainsi, l’aide juridictionnelle prend de plus en plus en charge les modes souples de règlement des litiges ;
– il précise dans la loi les modalités de calcul de la rétribution des avocats au titre de l’aide juridictionnelle. Chaque acte reste rétribué par une « unité de valeur » pondérée par type d’acte, mais il est prévu qu’une rétribution complémentaire pourrait s’y ajouter, selon des modalités précisées par une convention cadre nationale et des déclinaisons locales ;
– le plafond de ressources pour bénéficier de l’aide juridictionnelle est relevé à 1 000 euros mensuels contre 941 euros actuellement, ce qui rend éligible environ 100 000 personnes supplémentaires à ce dispositif. En 2014, 896 786 personnes ont été admises à cette aide. Ce plafond sera désormais révisé en fonction de l’inflation et non de la première tranche de l’impôt sur le revenu ;
– le montant de l’unité de valeur est fixé à 24,20 euros, alors qu’elle était de 22,50 euros depuis 2007 avant d’être réévaluée à 22,84 euros en 2015.
Le placement du présent article en première partie du projet de loi de finances résulte de l’article 34 de la loi organique relative aux lois de finances (143) qui impose d’y faire figurer les dispositions relatives aux ressources de l’État affectant l’équilibre budgétaire et les dispositions relatives aux affectations de recettes au sein du budget de l’État.
Si l’ensemble des dispositions du présent article n’entre pas dans cette catégorie, la création de ressources nouvelles affectées au CNB suffit à justifier un tel placement.
CRÉDITS SUPPLÉMENTAIRES EN FAVEUR DE L’AIDE JURIDICTIONNELLE (2015-2017)
(en millions d’euros)
Mesures |
LFI 2015 |
LFI 2016 |
2017 |
Prélèvement sur le produit des placements des CARPA |
– |
+ 5 |
+ 5 |
Majoration TSCA sur les contrats d’assurance juridique |
+ 25 |
+ 10 |
+ 10 |
Augmentation de la taxe sur les actes des huissiers de justice au CNB puis suppression de son affectation |
+ 11 |
– 11 |
– |
Augmentation du droit sur les décisions des juridictions répressives au CNB puis suppression de son affectation |
+ 7 |
– 7 |
– |
Affectation d’une partie des amendes pénales au CNB |
– |
+ 28 |
+ 10 |
Total |
+43 |
+ 25 |
+ 25 |
Source : loi de finances pour 2015 et évaluation préalable de l’article.
Au total, les mesures budgétaires (hors crédits de la mission Justice) prévues en 2015 et 2016 devraient donc représenter 68 millions d’euros, ce qui constitue une augmentation de 18,7 % par rapport à la dépense effective totale de 364,47 millions d’euros enregistrée en 2014. Cette augmentation est de 25,5 % si l’on prend en compte l’année 2017.
L’article 1er de la loi n° 91–647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose qu’un accès effectif à la justice – principe fondamental dont le respect est garanti à la fois par le Conseil constitutionnel et par la Cour européenne des droits de l’homme – suppose, pour nos concitoyens aux revenus limités, une politique particulière prise en charge par l’État.
D’après cet article 1er, l’aide juridique comprend trois piliers :
– l’aide juridictionnelle, destinée à permettre aux personnes dont les revenus sont limités de faire valoir leurs droits en justice ;
– l’aide à l’accès au droit qui désigne un ensemble de dispositions destinées à permettre une information générale des personnes sur leurs droits et leurs obligations ;
– l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles, qui permet de déterminer les conditions dans lesquelles les crédits de l’aide juridictionnelle peuvent être mobilisés dans le cadre de procédures qui ne sont pas, ou pas encore, juridictionnelles.
S’agissant de la définition de l’aide juridictionnelle, l’article 2 de cette loi dispose que « les personnes physiques dont les ressources sont insuffisantes pour faire valoir leurs droits en justice peuvent bénéficier d’une aide juridictionnelle. Cette aide est totale ou partielle ». Il précise, par ailleurs, que son bénéfice n’est pas accordé lorsque les frais couverts par cette aide sont pris en charge au titre d’un contrat d’assurance de protection juridique ou d’un système de protection.
Le fonctionnement de l’aide juridictionnelle repose sur une prise en charge, totale ou partielle, par l’État des frais entraînés par une procédure, dès lors que le demandeur répond à certains critères de revenus.
Ces plafonds de revenus sont fixés par l’article 4 de la loi précitée, initialement à 5 175 francs pour l’aide juridictionnelle totale et à 7 764 francs pour l’aide juridictionnelle partielle. Ils sont revalorisés au 1er janvier de chaque année comme la tranche la plus basse de l’impôt sur le revenu et pondérés en fonction du nombre de personnes à charge.
La publication annuelle des revenus maximaux ouvrant le droit à l’admission à l’aide juridictionnelle, en fonction des montants fixés en 1991 et de leur actualisation par la loi de finances de l’année, fait l’objet d’une note annuelle du ministère de la justice. Celle du 29 décembre 2014 (144) retient pour l’année 2015 les montants suivants :
– pour l’aide juridictionnelle totale, le plafond de ressources est fixé à 941 euros au lieu de 936 euros en 2014 ;
– pour l’aide juridictionnelle partielle, ce plafond est fixé à 1 411 euros au lieu de 1 404 euros en 2014.
Les revenus compris entre 942 euros et 1 411 euros ouvrent le droit à une aide partielle dont les taux varient en fonction des tranches suivantes :
Ressources mensuelles |
Part prise en charge par l’État |
Moins de 941 euros |
100 % |
Entre 942 et 984 euros |
85 % |
Entre 985 et 1 037 euros |
70 % |
Entre 1 038 et 1 112 euros |
55 % |
Entre 1 113 et 1 197 euros |
40 % |
Entre 1 198 et 1 304 euros |
25 % |
Entre 1 305 et 1 411 euros |
15 % |
Ces montants sont ensuite modulés en fonction du nombre de personnes à charge ; au total, l’aide juridictionnelle permet d’apporter une aide dégressive de 100 % en deçà de 941 euros de revenus mensuels à 15 % pour les revenus ne dépassant pas 2 177 euros par mois avec six personnes à charge.
Le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi de 1991 précitée indique que le montant des revenus est calculé à partir d’une moyenne annuelle ; l’article 2 du décret précise en outre que ces ressources ne comprennent pas les prestations familiales, certaines prestations sociales, l’aide personnalisée au logement (APL), l’allocation de logement personnes âgées, des infirmes, des jeunes salariés et de certaines catégories de demandeurs d’emploi, ou le revenu de solidarité active (RSA).
Ces plafonds sont fixés à un niveau particulièrement bas et l’on peut s’étonner que le plafond supérieur de 1 411 euros ouvrant le droit au bénéfice de l’aide juridictionnelle soit encore inférieur au SMIC, fixé pour l’année 2015 à 1 457,52 euros mensuels. Même avec une ou deux personnes à charge, l’essentiel des personnes rémunérées au SMIC ne sont donc éligibles ni à une prise en charge totale ni à une prise en charge partielle au titre de l’aide juridictionnelle.
L’article 35 de la loi de finances pour 2015 précitée a déjà apporté de nombreuses modifications au dispositif de l’aide juridictionnelle.
Cet article prévoyait, en premier lieu, un ensemble de mesures permettant d’affecter de nouveaux moyens à cette politique :
– il ajoutait une fraction supplémentaire de 2,6 points au taux de la taxe sur les conventions d’assurance qui pèse actuellement sur les assurances de protection juridique au taux de 9 %. Le produit correspondant a été affecté dans la limite de 25 millions d’euros par an au CNB) ;
– il prévoyait une augmentation des droits forfaitaires de procédure perçus à l’occasion des décisions des juridictions répressives, permettant l’affectation au CNB de 7 millions d’euros ;
– il prévoyait une augmentation des actes des huissiers, permettant l’affectation à la même structure d’une enveloppe complémentaire de 11 millions d’euros.
Au total, environ 43 millions d’euros de recettes fiscales nouvelles ont ainsi été affectées aux missions d’aide juridictionnelle à compter de 2015.
Ces moyens nouveaux doivent permettre, en second lieu, une consolidation de l’aide juridictionnelle :
– le principe d’une rétribution des avocats dans le cadre des procédures non juridictionnelles a été consacré, en particulier lorsque la personne n’est encore que déférée devant le procureur de la République ;
– les modalités selon lesquelles le CNB ventile les crédits de l’aide juridictionnelle ont été clarifiées ;
– le mécanisme de démodulation adopté dans le cadre de l’article 128 de la loi de finances initiale pour 2014 (145) a été supprimé, ce qui s’est traduit par une dépense de 13,5 millions d’euros à compter de 2015.
Dans la mesure où le présent article vient modifier de nombreux dispositifs adoptés voici moins d’un an, dont certains revenaient eux-mêmes sur des dispositions adoptées en loi de finances pour 2014, la Rapporteure générale ne peut que s’interroger sur les origines d’une telle instabilité ; d’autre part, l’opportunité même d’élargir progressivement le périmètre de l’aide juridictionnelle – et non ses modalités de financement – dans le cadre de l’examen de la loi de finances peut prêter à discussion.
Les difficultés de financement de cette politique essentielle ont été analysées par de nombreux rapports publics ; récemment, un rapport d’information sénatorial (146) évoquait un dispositif « en faillite » tandis qu’un rapport réalisé par l’Inspection générale des services judiciaires décrivait de manière plus mesurée une « situation au milieu du gué » (147).
Le rapport le plus récent de notre collègue Jean-Yves Le Bouillonnec (148) met davantage l’accent sur la relation complexe entre « la situation contrainte du budget de la justice et la revendication de la profession d’avocat à une meilleure rétribution des prestations assurées par ses membres au titre de l’aide juridictionnelle ».
Malgré ces plafonds relativement bas, le nombre de bénéficiaires de l’aide juridictionnelle est en légère augmentation depuis plusieurs années.
ÉVOLUTION DU NOMBRE DE BÉNÉFICIAIRES DE L’AIDE JURIDICTIONNELLE (2007-2014)
Type d’aide |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
Toutes décisions |
1 038 929 |
1 057 777 |
1 068 927 |
1 032 577 |
1 065 721 |
1 080 203 |
1 056 497 |
Variation (en %) |
– 1,3 |
+ 1,8 |
– 1,1 |
– 3,4 |
+ 3,2 |
+ 1,4 |
– 2,2 |
Toutes admissions |
890 020 |
901 630 |
912 191 |
882 607 |
915 563 |
919 625 |
896 786 |
Variation (en %) |
0,0 |
+ 1,3 |
+ 1,2 |
– 3,2 |
+ 3,7 |
+ 0,4 |
– 2,5 |
Aide totale |
791 326 |
802 617 |
811 024 |
790 530 |
821 777 |
826 135 |
807 418 |
Variation (en %) |
+ 0,3 |
+ 1,4 |
+ 1,0 |
– 2,5 |
+ 4,0 |
+ 0,5 |
– 2,3 |
Aide partielle |
98 694 |
99 013 |
101 167 |
92 077 |
93 786 |
93 490 |
89 368 |
Variation (en %) |
– 2,8 |
+ 0,3 |
+ 2,2 |
– 9,0 |
+ 1,9 |
– 0,3 |
– 4,4 |
Autres décisions |
148 909 |
156 147 |
156 736 |
149 970 |
150 158 |
160 578 |
159 711 |
Dont rejets |
102 475 |
86 997 |
82 533 |
77 841 |
79 414 |
85 679 |
87 223 |
Taux de rejet définitif (en %) |
9,9 |
8,2 |
7,7 |
7,5 |
7,5 |
7,9 |
8,3 |
Source : ministère de la justice, bureau de l’aide juridictionnelle.
La répartition des bénéficiaires de l’aide juridictionnelle par type de contentieux fait ressortir une augmentation particulièrement marquée des admissions à l’aide juridictionnelle dans le domaine du droit administratif, ce qui peut paraître surprenant dans la mesure où le recours à un avocat y est facultatif s’agissant des recours pour excès de pouvoir.
RÉPARTITION DES BÉNÉFICIAIRES DE L’AIDE JURIDICTIONNELLE
SELON LE TYPE DE CONTENTIEUX (2007-2013)
Type de contentieux |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 | ||
Nombre |
Part du total |
Évolution 2014/2013 | |||||||
Civil |
423 022 |
433 258 |
445 467 |
438 984 |
469 384 |
464 290 |
459 751 |
51,3 % |
– 1,0 % |
Pénal |
400 773 |
398 636 |
394 120 |
373 166 |
374 737 |
376 627 |
355 558 |
39,6 % |
– 5,6 % |
Administratif |
21 489 |
29 955 |
34 586 |
39 234 |
43 141 |
47 603 |
55 941 |
6,2 % |
4,2 % |
Entrée et séjour des étrangers |
44 619 |
39 519 |
37 700 |
30 949 |
27 968 |
30 494 |
23 914 |
2,7 % |
– 2,1 % |
Total |
890 020 |
901 630 |
912 191 |
882 607 |
915 563 |
919 625 |
896 786 |
– |
– 2,5 % |
Source : ministère de la justice, bureau de l’aide juridictionnelle.
Au-delà des effets de la crise économique et de son impact social, cette augmentation du nombre de bénéficiaires de l’aide juridictionnelle résulte en grande partie d’une extension du champ couvert par cette aide au fur et à mesure des réformes successives, qui devraient produire leurs effets également dans les prochaines années.
En premier lieu, la loi du 14 avril 2011 (149) a renforcé les droits des personnes placées en garde à vue. Dans une décision du 30 juillet 2010 (150), le Conseil constitutionnel a en effet déclaré contraires à la Constitution les articles 62, 63 et 63-1, une partie de l’article 63-4 et l’article 77 du code de procédure pénale, au motif que ces articles n’apportent par les garanties appropriées au respect des droits du justiciable, notamment du fait de l’absence d’un avocat dans les premières heures de la garde à vue, alors même que le recours à cette procédure est de plus en plus courant aujourd’hui.
L’article 6 de la loi du 14 avril 2011 a, par conséquent, prévu l’insertion dans le code de procédure pénale d’un nouvel article 63-3-1 autorisant le justiciable à demander la présence d’un avocat « dès le début de la garde à vue ». Le décret n° 2011-810 du 6 juillet 2011 a précisé les modalités de prise en charge des frais liés à ces interventions au titre de l’aide juridictionnelle.
D’après le rapport d’information sénatorial précité, cette disposition devait entraîner un accroissement du nombre de gardes à vue de vingt-quatre heures d’environ 400 000, auxquelles il faudrait ajouter 100 000 prolongations au-delà de ce délai, et environ 90 000 confrontations entre les victimes et les personnes mises en garde à vue. Le recours à un avocat commis d’office au titre de l’aide juridictionnelle atteint dans ces cas 66 %.
Dans un autre domaine, la loi du 31 décembre 2012 (151) a prévu un dispositif permettant la retenue des personnes étrangères afin de vérifier leur droit de circulation et de séjour sur le territoire français. L’article 2 de cette loi dispose que l’officier de police judiciaire a le devoir d’informer le justiciable de son droit d’être assisté par un avocat. Le décret n° 2013-481 du 7 juin 2013 portant application de ce dispositif a fixé le montant de la rétribution à laquelle peuvent prétendre les avocats intervenant au titre de l’aide juridictionnelle.
Par ailleurs, la loi du 5 juillet 2011 (152) a renforcé les droits des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques. L’article 1er de cette loi prévoit la possibilité, pour le juge des libertés et de la détention, de lever la mesure de soins psychiatriques ordonnée par un expert. Le juge se prononce après une audience au cours de laquelle le justiciable peut être assisté de son avocat. Selon le rapport sénatorial précité, le nombre de ces admissions est passé de près de 5 000 en 2012 à plus de 20 000 en 2013.
En outre, la loi du 27 mai 2014 (153) renforce le droit à l’information des justiciables dans le cadre des procédures pénales. Elle instaure notamment le droit d’accès effectif à un avocat dans les cas où le justiciable est suspecté ou accusé, qu’il soit libre ou détenu, durant toute la phase d’enquête, d’instruction et de jugement des affaires pénales.
Enfin, la loi n° 2014-896 du 15 août 2014 relative à l’individualisation des peines et renforçant l’efficacité des sanctions pénales prévoit un renforcement du droit à la présence d’un avocat qui aura un impact sur l’aide juridictionnelle.
L’ensemble de ces nouveaux dispositifs légaux devrait entraîner une augmentation substantielle des recours à l’aide juridictionnelle dans les années à venir, rendant ainsi prégnante la question des moyens accordés pour mettre en œuvre cette politique.
Afin de faire face à ces nombreux enjeux, les moyens consacrés à cette politique restent insuffisants bien qu’ils enregistrent une augmentation assez substantielle depuis quelques années.
ÉVOLUTION DU FINANCEMENT DE L’AIDE JURIDICTIONNELLE (2010-2014)
Dépenses |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
PLF 2016 |
Crédits budgétaires |
309,65 |
344,40 |
292,91 |
317,31 |
328,46 |
332,4 |
336,7 |
Rétablissements de crédits |
11,55 |
6,70 |
4,42 |
0,75 |
0,00 |
n.c. |
n.c. |
Taxes affectées et prélèvements |
0 |
0 |
54,39 |
51,08 |
27,84 |
43 |
68 |
Évolution de la trésorerie des CARPA (1) |
10,80 |
19,50 |
–15,46 |
–1,43 |
– 8,15 |
n.c. |
n.c. |
Dépense effective |
310,40 |
331,6 |
367,18 |
370,57 |
364,47 |
375 |
405 |
(1) Les crédits de l’aide juridictionnelle sont versés par l’État aux caisses des règlements pécuniaires des avocats (CARPA), sous la forme d’une provision initiale en début d’année. Cette provision est réajustée en fonction des admissions effectives à l’aide juridictionnelle. À leur tour, les CARPA rétribuent les avocats qui ont accompli des missions au titre de l’aide juridictionnelle. Source : ministère de la justice, bureau de l’aide juridictionnelle. | |||||||
Comme l’indique le tableau précédent, l’essentiel du financement de l’aide juridictionnelle provient des crédits budgétaires du programme 101 Accès au droit et à la justice de la mission Justice.
Ces dépenses budgétaires ont connu des évolutions contrastées depuis 2002 ; en tendance toutefois, ils restent en augmentation puisqu’ils sont passés de près de 300 millions d’euros courants en 2009 à 336,7 millions d’euros prévus dans le présent projet de loi de finances.
La baisse importante des crédits budgétaires au cours de l’année 2012 s’explique pour partie par la substitution partielle de ressources extra-budgétaires. Afin de faire face aux nouveaux enjeux de la réforme de la garde à vue opérée par la loi du 14 avril 2011 précitée, l’article 54 de la loi de finances rectificative pour 2011 (154) a, en effet prévu, la création d’une nouvelle contribution pour l’aide juridique de 35 euros acquittée par tout justiciable introduisant une instance civile ou administrative.
Cette contribution concernait toutes les procédures introduites en matière civile, commerciale, prud’homale, sociale ou rurale devant une juridiction judiciaire ou par instance introduite devant une juridiction administrative.
L’État et les personnes bénéficiaires de l’aide juridictionnelle ont été exonérés du paiement de cette taxe, qui ne s’appliquait pas, d’autre part, dans le cadre des instances suivantes :
– les procédures de traitement des situations de surendettement des particuliers et les procédures de redressement et de liquidation judiciaire ;
– les procédures d’inscription sur les listes électorales ;
– les recours introduits devant le juge administratif dans le cadre d’un référé-liberté ou à l’encontre de toute décision individuelle relative à l’entrée, au séjour et à l’éloignement d’un étranger sur le territoire français ainsi qu’au droit d’asile ;
– certaines procédures spécifiques de protection des droits, comme la commission d’indemnisation des victimes d’infraction, le juge des enfants, le juge des libertés et de la détention, le juge des tutelles ou le juge aux affaires familiales.
La création de cette contribution a rapidement fait l’objet de nombreuses critiques après sa mise en place. Outre le problème du financement d’une politique importante par des ressources non budgétaires, elle constituait en elle-même un frein financier à l’accès à la justice des plus démunis, qu’elle était par ailleurs censée financer. La suppression de cette contribution a donc été adoptée dans le cadre de l’article 128 de la loi de finances pour 2014.
Actuellement, la rétribution des avocats à l’aide juridictionnelle résulte du produit du montant d’une unité de valeur (UV) fixé en loi de finances par un coefficient représentant la charge de travail correspondant à chaque type de mission, le coefficient étant pour sa part fixé par décret.
Régulièrement, les professionnels décrient l’insuffisante revalorisation de l’unité de valeur, qui est pourtant passée à 22,84 euros en 2014 (au lieu 22,50 euros depuis 2007).
L’article 90 du décret du 19 décembre 1991 précité prévoit, en outre, une grille permettant d’affecter à chaque catégorie d’actes un certain nombre d’UV. Sans pouvoir, dans le cadre du présent commentaire, reprendre l’ensemble des actes, on peut donner pour exemple :
– le divorce par consentement mutuel : 30 UV de base, auxquels on peut ajouter 9 UV pour une expertise avec déplacement ou 2 UV pour les médiations ordonnées par le juge ;
– le contentieux prud’homal : 30 UV de base, plus éventuellement 2 UV pour une enquête sociale et 4 UV pour une expertise sans déplacement ;
– une instruction criminelle : 50 UV ;
– un débat contradictoire relatif au placement en détention provisoire : 2 UV.
Le rapport de la mission sénatoriale précité démontre clairement que les rétributions résultant de ces grilles ne permettent pas de couvrir les charges d’un cabinet d’avocat, notamment dans les grandes villes. En même temps, il éloigne l’idée que l’aide juridictionnelle serait, pour l’ensemble des cabinets, une charge dont les avocats doivent s’acquitter par devoir. Selon le rapport, moins de 400 avocats sur 45 000 assurent la majorité des missions financées par l’aide juridictionnelle ; certains cabinets sont même spécialisés dans ce domaine et ne seraient pas économiquement viables sans cette rétribution publique.
Dans l’ensemble pourtant, la rétribution horaire de l’aide juridictionnelle se situe autour de 45 à 48 euros c’est-à-dire bien en dessous du point de rentabilité évalué par les représentants du barreau de Paris à 75 euros.
En outre, les représentants de la profession d’avocat regrettent que la grille établie par l’article 90 du décret précité soit déconnectée du degré de complexité réelle et de la durée de traitement des affaires.
Pour répondre à ces différents enjeux, le présent article tend donc à conforter la politique en faveur de l’aide juridictionnelle et à modifier ses modalités de financement.
L’aide juridictionnelle est financée à la fois à partir de crédits budgétaires et du produit de taxes ou de prélèvements affectés.
ÉVOLUTION DU FINANCEMENT DE L’AIDE JURIDICTIONNELLE (2010-2014)
Dépenses |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
PLF 2016 |
Crédits budgétaires |
309,65 |
344,40 |
292,91 |
317,31 |
328,46 |
332,4 |
336,7 |
Rétablissements de crédits |
11,55 |
6,70 |
4,42 |
0,75 |
0,00 |
n.c. |
n.c. |
Taxes affectées et prélèvements |
0 |
0 |
54,39 |
51,08 |
27,84 |
43 |
68 |
Évolution de la trésorerie des CARPA (1) |
10,80 |
19,50 |
– 15,46 |
– 1,43 |
– 8,15 |
n.c. |
n.c. |
Dépense effective |
310,40 |
331,6 |
367,18 |
370,57 |
364,47 |
375 |
405 |
(1) Les crédits de l’aide juridictionnelle sont versés par l’État aux caisses des règlements pécuniaires des avocats (CARPA), sous la forme d’une provision initiale en début d’année. Cette provision est réajustée en fonction des admissions effectives à l’aide juridictionnelle. À leur tour, les CARPA rétribuent les avocats qui ont accompli des missions au titre de l’aide juridictionnelle. Source : ministère de la justice, bureau de l’aide juridictionnelle. | |||||||
Le V du présent article prévoit en premier lieu un prélèvement de 5 millions d’euros en 2016 et de 10 millions d’euros en 2017 sur le produit des placements des fonds, effets et valeurs reçus par les avocats au nom de leurs clients.
L’article 53 de la loi du 31 décembre 1971 précitée prévoit en effet que les avocats sont dans l’obligation de déposer ces sommes, sauf lorsqu’ils agissent en qualité de fiduciaires, dans une caisse créée par chaque barreau ou entre plusieurs barreaux réunis.
En application de ces dispositions, des CARPA ont été créées pour sécuriser les opérations de maniements de fonds par les avocats, mais aussi pour assurer leur rémunération au titre de l’aide juridictionnelle.
Il y avait 130 caisses de ce type pour 164 barreaux au 1er janvier 2015.
La gestion de ces caisses a fait l’objet d’une communication de la Cour des comptes à la commission des finances du Sénat en 2008 (155) ; cette communication rappelle les modalités de financement de ces caisses :
– toutes les CARPA perçoivent des dotations annuelles versées par l’État ; les articles 27 et 29 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique prévoient en effet que l’État affecte annuellement à chaque barreau une dotation représentant sa part contributive aux missions d’aide juridique accomplies par les avocats du barreau en question, et que cette dotation, versée sur un compte spécial de la caisse des règlements pécuniaires prévu à l’article 53 (9°) de la loi du 31 décembre 1971 précitée, est intégralement affectée au paiement des avocats effectuant des missions d’aide juridique ;
– accessoirement, certaines CARPA peuvent obtenir une majoration de la contribution de l’État, dans une proportion maximale de 20 %, lorsque le barreau a conclu avec le tribunal de grande instance de rattachement un protocole visant à assurer une meilleure organisation de la défense pénale ;
– enfin, certaines CARPA bénéficient de l’occupation à titre gratuit de locaux judiciaires, ce qui constitue un concours financier en nature de la part de l’État.
D’après les informations de la direction du budget, les produits financiers des placements des CARPA sont estimés à environ 40 millions par an. Les produits du seul barreau de Paris se sont élevés à 26 millions d’euros en 2014.
En outre, d’après l’Union nationale des CARPA, le solde cumulé des 130 CARPA oscille, depuis plusieurs années, entre 2,7 et 3 milliards d’euros.
Le V du présent article prévoit que ce prélèvement est réparti au prorata de l’importance de ces produits l’année précédente ; il est recouvré par le CNB sous le contrôle du ministère de la justice.
Un arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre du budget, pris après avis du CNB et de l’Union nationale des CARPA doit fixer les modalités de répartition de cette contribution.
Cette disposition permettra donc de mettre en œuvre une péréquation entre les barreaux, appelée de ses vœux par plusieurs spécialistes. L’Union nationale des CARPA a toutefois adopté une délibération à l’unanimité le 25 septembre 2015 dénonçant « les conséquences désastreuses qu’aurait sur l’équilibre financier des CARPA l’adoption » du présent article « d’autant que les taux de rendement des placements financiers sont historiquement au plus bas et ce de manière durable ».
Selon cette délibération, ce prélèvement se traduira « par des cotisations supplémentaires appelées auprès des avocats eux-mêmes, ce qui revient à faire peser sur ceux-ci la participation au financement de l’aide juridictionnelle que le Gouvernement entend de manière inacceptable faire supporter par la profession d’avocat ». En conséquence, l’Union nationale des CARPA « demande le retrait immédiat de cet article ».
3. La création d’une fraction supplémentaire à la taxe sur les contrats d’assurance de protection juridique
Le IV du présent article prévoit l’instauration d’une fraction complémentaire au taux de la TSCA pesant sur les assurances de protection juridique. Taxés en 2014 au taux de 9 % en application du 6° de l’article 1001 du code général des impôts, ces contrats sont désormais taxés au taux de 11,6 %. À compter de 2016, le taux sera porté à 12,5 % puis à 13,4 % en 2017.
Le produit correspondant sera affecté à hauteur de 35 millions d’euros en 2016 et 45 millions d’euros en 2017 au CNB, contre 25 millions par an actuellement, conformément aux dispositions votées dans la loi de finances pour 2015.
D’après les informations publiées par la Fédération française des sociétés d’assurance, l’assurance de protection juridique permet de prendre en charge l’ensemble des frais de procédures et fournit des services juridiques en cas de différend ou de litige avec un tiers.
La protection juridique est généralement proposée dans le cadre d’un contrat support (assurance multirisques habitation par exemple) ou dans un contrat autonome. Elle peut aussi être délivrée à l’occasion d’autres prestations, comme la délivrance de cartes de crédit ou cartes d’adhésion à une association.
Ces polices permettent généralement de couvrir les frais engagés :
– au titre d’une information préliminaire et d’une assistance juridique ;
– au titre de la recherche d’une solution amiable ;
– au titre d’une procédure contentieuse, l’assurance permettant de prendre en charge les frais d’experts et d’huissiers divers, les frais d’avocat et les frais de procédure.
Ces assurances de protection juridique, dont les bénéficiaires sont insusceptibles de bénéficier de l’aide juridictionnelle, seront donc frappées à compter du 1er janvier 2016 d’une taxe au taux de 11,6 %. Le présent article précise que l’augmentation ne s’appliquera qu’aux primes ou cotisations échues à compter de cette date. Les contrats en cours ne seront donc pas affectés.
Le VI du présent article prévoit par ailleurs qu’une fraction du produit des amendes pénales sera affectée au CNB, à hauteur de 28 millions d’euros en 2016 et de 38 millions d’euros à compter de 2017. Ne sont pas comprises les amendes pénales résultant d’infractions aux règles de circulation routière, qui sont par ailleurs affectées au compte d’affectation spéciale Contrôle de la circulation et du stationnement routiers.
Le IV prévoit une augmentation de 11,16 à 13,04 euros de la taxe forfaitaire sur les actes mis en œuvre par la profession réglementée des huissiers de justice. Les bénéficiaires de l’aide juridictionnelle sont exonérés de cette taxe.
Cette taxe avait déjà été relevée de 9,15 à 11,16 euros l’année dernière, le produit correspondant étant affecté au CNB dans la limite de 11 millions d’euros.
Le présent article prévoit à l’inverse que cette affectation de 11 millions d’euros au CNB est supprimée ; l’ensemble du produit de la taxe ira par conséquent au budget général de l’État.
6. La suppression de l’affectation d’une fraction des droits fixes de procédure devant les juridictions répressives au CNB
La loi de finances pour 2015 précitée a prévu une augmentation des droits fixes de procédure dus par chaque condamné à l’occasion des décisions des juridictions répressives, à l’exclusion de celles qui ne statuent que sur les intérêts civils. En application de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1991 précitée, les bénéficiaires de l’aide juridictionnelle sont dispensés du paiement de ces droits, y compris lorsqu’ils sont condamnés.
Le tableau ci-dessous synthétise ces augmentations.
ÉVOLUTION DES DROITS FIXES DE PROCÉDURE
(en euros)
Type de procédure |
Montant actuel |
Montant prévu |
Variation |
Ordonnances pénales en matière contraventionnelle ou correctionnelle et autres décisions des tribunaux de police et des juridictions de proximité |
22 |
31 |
+ 40,9 |
Décisions des tribunaux correctionnels |
90 |
127 |
+ 41,1 |
Décisions des cours d’appel statuant en matière correctionnelle et de police |
120 |
169 |
+ 40,8 |
Décisions des cours d’assises |
375 |
527 |
+ 40,5 |
Décisions de la Cour de cassation statuant en matière criminelle, correctionnelle ou de police |
150 |
211 |
+ 40,7 |
La loi de finances pour 2015 a prévu que le produit résultant de ces augmentations serait affecté au CNB dans la limite de 7 millions d’euros par an. Le présent projet d’article prévoit la suppression de cette affectation, le produit correspondant retournant au budget général de l’État.
Outre la mobilisation de moyens nouveaux, le présent article apporte certaines clarifications nécessaires aux modalités actuelles de fonctionnement de l’aide juridictionnelle.
Le I du présent article apporte plusieurs précisions au mode de rétribution des avocats au titre de l’aide juridictionnelle, en insérant plusieurs articles dans la loi du 10 juillet 1991 précitée.
En premier lieu, il prévoit que les avocats pourront percevoir une rétribution complémentaire destinée à prendre en compte les charges et les contraintes spécifiques à certaines missions d’aide juridique, la longueur et la complexité des procédures ainsi que les conditions particulières d’exercice de ces missions dans le ressort de leur juridiction.
Les modalités d’application de cette rétribution supplémentaire seront fixées par décret en Conseil d’État.
Le présent article prévoit en outre de fixer l’unité de valeur servant à calculer cette rétribution à 24,20 euros par unité, ce qui constitue une augmentation très significative de 6 %.
Le I du présent article prévoit par ailleurs de fixer le plafond de ressources permettant d’accéder à l’aide juridictionnelle à 1 000 euros, alors que la rédaction actuelle fait encore référence à des sommes en francs revalorisées chaque année par voie réglementaire. Le présent article prévoit, en outre, que ce montant sera revalorisé annuellement en fonction de l’évolution des prix à la consommation hors tabac et non comme la tranche inférieure de l’impôt sur le revenu.
Selon l’évaluation préalable de cet article, environ 100 000 personnes supplémentaires deviendront ainsi éligibles à ce dispositif.
Enfin, le présent article prévoit une extension de l’aide juridique à la médiation, qui peut être ordonnée par le juge.
Introduite par la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, la médiation est une voie originale pour le traitement des litiges. Visant à faire émerger un accord entre des parties à un conflit, elle est encadrée, contrôlée et suivie par le juge.
D’après l’article 21 de cette loi, « la médiation régie par le présent chapitre s’entend de tout processus structuré, quelle qu’en soit la dénomination, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l’aide d’un tiers, le médiateur, choisi par elles ou désigné, avec leur accord, par le juge saisi du litige ».
Ce mode de règlement des litiges se distingue de l’arbitrage, dans lequel le rôle de l’arbitre s’apparente à celui d’un juge, mais aussi de la conciliation, spécificité juridique française qui désigne une pratique proche de la médiation dans laquelle le conciliateur cherche avant tout à régler le litige et non à rétablir le dialogue entre les parties.
Selon un rapport de l’Inspection générale des services judiciaires d’avril 2015 (156), la médiation judiciaire connaîtrait un « insuccès » depuis sa création en 1995, notamment en matière civile, sociale et commerciale.
Selon les statistiques du ministère de la justice relatées dans ce rapport, seules 200 affaires ont fait l’objet d’une médiation en 2011, 203 en 2012 et 277 en 2013.
L’extension de l’aide juridictionnelle à ce mode de règlement des litiges permettra donc probablement son développement.
Du point de vue strictement budgétaire, le présent article modifie plusieurs circuits de financement de l’aide juridictionnelle adoptés l’année dernière ; il en ressort une impression de confusion et d’un empilement de mesures disparates peu durables dont la seule unité consiste à débudgétiser une politique majeure de l’État.
Compte tenu de l’opposition de l’Union des CARPA au prélèvement opéré sur le produit de leur trésorerie, il y a lieu de craindre que le Parlement ne soit en premier lieu amené à examiner à nouveau des mesures d’ajustement.
En outre, il est particulièrement alarmant de constater que M. Pascal Eydoux, président du CNB, ait pris publiquement position – par le biais d’un éditorial mis en ligne sur le site de cette structure le 17 septembre 2015 – pour dénoncer le fait qu’aucune de leurs propositions n’ait été retenue, dénonçant « un nouvel échec du dossier de l’aide juridictionnelle ».
Les tableaux ci-dessous présentent une synthèse des modifications opérées par le présent article, en se plaçant du point de vue du financement de l’aide juridictionnelle et du point de vue du budget de l’État. Il intègre en outre des réformes menées par ailleurs, dont l’impact financier est synthétisé dans l’évaluation préalable du présent article.
COÜT GLOBAL DE LA RÉFORME DE L’AIDE JURIDICTIONNELLE
(en millions d’euros)
Mesures |
2016 |
À compter de 2017 |
Prise en charge de la médiation |
3 |
8 |
Revalorisation du plafond de l’aide juridique |
7 |
28 |
Rétribution complémentaire |
16 |
25 |
Augmentation de l’unité de valeur |
5 |
20 |
Consultation juridique préalable (1) |
2 |
2 |
Réforme du barème de l’aide juridique partielle (2) |
– 8 |
– 33 |
Total |
25 |
50 |
(1) Cet aspect de la réforme de l’aide juridique ne figure pas dans le présent article, mais sera intégré dans une réforme plus large de l’aide juridique.
(2) Cet aspect de la réforme de l’aide juridique ne figure pas dans le présent article, mais sera intégré dans une réforme plus large de l’aide juridique.
Source : évaluation préalable de l’article.
SYNTHÈSE DU POINT DE VUE DU BUDGET GÉNÉRAL DE L’ÉTAT
(en millions d’euros)
Mesures |
2016 |
2017 |
Suppression de l’affectation de la taxe sur les actes des huissiers de justice au CNB |
+ 11 |
|
Augmentation du taux de la taxe sur les actes des huissiers de justice (1) |
+ 11 |
+ 11 |
Suppression de l’affectation du droit sur les décisions des juridictions répressives au CNB |
+ 7 |
|
Affectation d’une partie des amendes pénales au CNB |
– 28 |
– 10 |
Total |
+ 1 |
+ 1 |
(1) Le produit de l’augmentation de 2 points de l’année dernière ayant évalué à 11 millions d’euros, les nouvelles augmentations similaires en 2016 et 2017 peuvent être évaluées de la même manière.
Source : évaluation préalable de l’article.
*
* *
La commission examine l’amendement I-CF 118 de M. Charles de Courson.
M. Charles de Courson. L’article 15 prévoit taxer les revenus de la profession d’avocat pour financer l’aide juridictionnelle. Et que penseriez-vous de taxer les enseignants pour financer l’éducation nationale ?
Suivant l’avis défavorable de la Rapporteure générale, la commission rejette l’amendement I-CF 118.
Puis elle adopte l’article 15 sans modification.
*
* *
La commission est saisie de l’amendement I-CF 329 de Mme Brigitte Allain.
M. Éric Alauzet. Cet amendement vise à doubler la redevance pour pollutions diffuses appliquée aux produits phytosanitaires répandus en agriculture dans les aires de captage d’eau potable.
Mme la Rapporteure générale. Avis défavorable.
M. Charles de Courson. S’il s’agit d’aires de captage d’eau potable ayant donné lieu à enquête publique, des normes y sont appliquées pour éviter la contamination. On ne va tout de même pas taxer les agriculteurs qui respectent les règles !
M. Éric Alauzet. L’existence de règles ne garantit pas que la situation soit optimale. Il existe toujours des marges de progrès.
La commission rejette l’amendement I-CF 329.
*
* *
C.– Dispositions relatives aux budgets annexes et aux comptes spéciaux
Article 16
Dispositions relatives aux affectations : reconduction des budgets annexes
et comptes spéciaux existants
L’article 16 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF) dispose que « certaines recettes peuvent être directement affectées à certaines dépenses. Ces affectations prennent la forme de budgets annexes, de comptes spéciaux ou de procédures comptables particulières au sein du budget général, d’un budget annexe ou d’un compte spécial ».
Par ailleurs, le 3° du I de l’article 34 de la même loi organique prévoit que « la loi de finances de l’année comporte toutes dispositions relatives aux affectations de recettes au sein du budget général de l’État ».
En conséquence, l’objet du présent article est de confirmer pour 2016 les affectations résultant de budgets annexes créés et de comptes spéciaux créés par les lois de finances antérieures.
Cette confirmation doit s’entendre sous réserve des dispositions particulières qui pourraient être prises dans le présent projet de loi de finances. Ainsi, par exception à cette confirmation, l’article 19 du présent projet de loi de finances prévoit la clôture du compte d’affectation spéciale (CAS) Gestion et valorisation des ressources tirées de l’utilisation du spectre hertzien, des systèmes et des infrastructures de télécommunications de l’État.
*
* *
La commission adopte l’article 16 sans modification.
*
* *
Article 17
Décentralisation et affectation des recettes du stationnement payant
Si la définition des zones et des tarifs de stationnement relève des communes, les amendes sanctionnant le non-paiement de ces tarifs sont de nature pénale. Leur montant, fixé à 17 euros, est uniforme sur tout le territoire et leur produit, affecté au compte d’affectation spéciale (CAS) Contrôle de la circulation du stationnement routier, est réparti entre l’État et les collectivités. L’article 63 la loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles (MAPTAM) (157) du 27 janvier 2014 organise la dépénalisation et la décentralisation des amendes de stationnement. À compter du 1er octobre 2016, les amendes doivent être transformées en redevances de post-stationnement, dont les communes pourront fixer librement le montant. Ce changement implique une perte de recettes pour l’État. Le présent article propose de compenser cette perte en apportant au CAS Contrôle de la circulation du stationnement routier des modifications qui sont de deux ordres.
La première vise à financer les dépenses du fonds interministériel pour la prévention de la délinquance (FIPD) sur un programme du budget général.
La deuxième vise à modifier l’architecture du CAS pour l’adapter à la dépénalisation et la décentralisation des amendes de stationnement. Cette nouvelle architecture ne s’appliquerait qu’à compter du 1er janvier 2018, compte tenu du report de l’entrée en vigueur de la réforme des amendes de stationnement, également proposée par le présent article.
Le montant des amendes est fixé à 17 euros depuis le 1er août 2011, alors qu’il était de 11 euros depuis 1986. Nombre de maires jugent ce tarif trop peu dissuasif par de maires pour inciter les automobilistes à régler leur stationnement. Une modulation à la hausse des redevances de stationnement et post-stationnement pourrait également apporter de nouvelles recettes aux communes et établissements publics de coopération intercommunale (EPCI).
Enfin, le présent article proposer de reporter l’entrée en vigueur de la réforme au 1er janvier 2018.
I. L’ARCHITECTURE ACTUELLE DU CAS CONTRÔLE DE LA CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT ROUTIER
Le CAS Contrôle de la circulation et du stationnement routiers comporte deux sections :
– section 1 : contrôle automatisé ;
– section 2 : circulation et stationnement routiers.
Le produit des amendes de la circulation et du stationnement routier est réparti entre le CAS, l’Agence de financement des infrastructures de transports de France (AFITF) et, avant sa suppression, l’Agence nationale pour la cohésion sociale (ACSé).
La part du produit de ces amendes affectée au CAS est répartie entre cinq programmes :
– programme 751 : déploiement et maintenance des dispositifs de contrôle automatisé ;
– programme 752 : ficher national du permis de conduire ;
– programme 753 : contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routier ;
– programme 754 : contribution à l’équipement des collectivités territoriales pour l’amélioration des transports en commun, de la sécurité et de la circulation ;
– programme 755 : désendettement de l’État.
ARCHITECTURE ACTUELLE DU
CAS CONTRÔLE DE LA CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT ROUTIERS
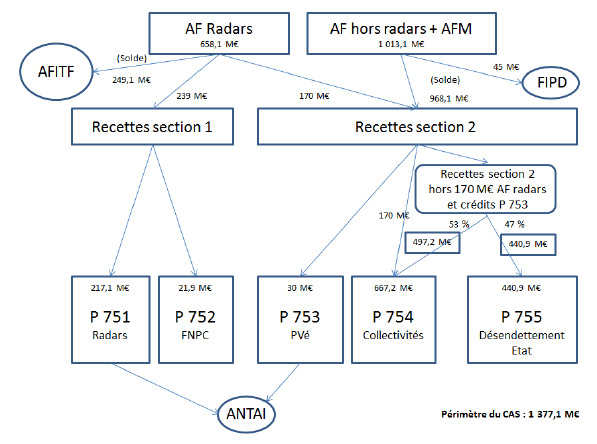
Source : projet de loi de finances pour 2015.
II. LE FINANCEMENT DES DÉPENSES DU FIPD SUR UN PROGRAMME DU BUDGET GÉNÉRAL
L’article 14 de la loi du 21 février 2014 de programmation pour la ville (158) dispose : « Les activités de l’Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances sont transférées à l’État suivant des modalités et un calendrier, prévus par décret, au plus tard le 1er janvier 2016.
« À cette date, l’établissement public Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances est dissous et ses biens, droits et obligations sont transférés à l’État. Ce transfert est réalisé à titre gratuit. »
La dissolution de l’ACSé et le transfert de ses activités à l’État nécessitent de revoir le circuit de la dépense du FIPD, qui a été créé au sein de l’ACSé par l’article 5 de la loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance (159). Ses ressources sont constituées par un prélèvement sur les recettes des amendes forfaitaires et amendes forfaitaires majorées (hors radars) pour un montant de 45 millions d’euros par an et par des subventions à hauteur de 7,9 millions d’euros, provenant notamment des ministères de la justice, de l’éducation nationale, des affaires sociales et de l’intérieur. En 2015, une subvention exceptionnelle supplémentaire de 20 millions d’euros au titre du plan de lutte anti-terrorisme doit être versée par le programme Police nationale au profit du FIPD.
Il est proposé de « rebudgétiser » ce fonds sur le programme 122 Concours spécifiques et administration de la mission Relations avec les collectivités territoriales (RCT), dont le responsable est le directeur général des collectivités locales.
À cette fin, les alinéas 2 et 9 (1° du I et II) du présent article mettent fin à l’affectation d’une fraction de 45 millions d’euros du produit des amendes forfaitaires et des amendes forfaitaires majorées de la police de la circulation à l’ACSé pour le financement du FIPD.
Les alinéas 10 à 12 (III) proposent une nouvelle rédaction pour l’article 5 de la loi du 5 mars 2007 précitée afin de maintenir le FIPD après l’abrogation de l’ACSé.
Ils modifient également le cadre d’action du FIPD. Celui-ci est actuellement destiné à financer la réalisation d’actions dans le cadre des plans de prévention de la délinquance définis à l’article L. 2215-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) et dans le cadre de la contractualisation mise en œuvre entre l’État et les collectivités territoriales en matière de politique de la ville définie au dernier alinéa de l’article L. 121-14 du code de l’action sociale et des familles. Les actions financées par le FIPD devront désormais être simplement élaborées en cohérence avec les plans de prévention de la délinquance définis à l’article L. 132-6 du code de la sécurité intérieure. Il est également proposé que le FIPD finance des actions de « prévention de la radicalisation ».
La nouvelle rédaction proposée pour l’article 5 de la loi du 5 mars 2007 supprime des dispositions relatives au rôle du comité interministériel de prévention de la délinquance, aux règles d’éligibilité au fonds et aux rapports d’activité, qui pourront le cas échéant être fixées par décret en Conseil d’État.
III. LE REPORT DE L’ENTRÉE EN VIGUEUR DE LA RÉFORME DE LA GESTION DES AMENDES DE STATIONNEMENT AU 1ER JANVIER 2018
A. LES AMENDES DE STATIONNEMENT DOIVENT ÊTRE DÉPÉNALISÉES ET LEUR GESTION DÉCENTRALISÉE
La réforme de la décentralisation du stationnement payant est prévue par l’article 63 la loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles (MAPTAM) (160) du 27 janvier 2014. L’article L. 2333-87 du CGCT, dans sa version applicable au 1er octobre 2016, requalifie les infractions au stationnement payant en forfaits de post-stationnement, dont le tarif serait fixé par le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’EPCI ou du syndicat mixte compétent pour l’organisation de la mobilité. Le montant de l’amende, identique sur tout le territoire, est aujourd’hui fixé à 17 euros.
Une période de préfiguration doit permettre aux collectivités de passer des conventions avec les services de l’État concernés et notamment avec l’Agence nationale de traitement automatisé des infractions (ANTAI), afin de valider les dispositifs techniques ainsi que les procédures destinés à garantir le paiement et la perception de cette redevance de stationnement.
B. LE REPORT DE L’ENTRÉE EN VIGUEUR DE LA RÉFORME AU 1ER JANVIER 2018
La loi MAPTAM du 27 janvier 2014 avait prévu l’entrée en vigueur de la réforme des amendes de stationnement au 1er janvier 2016. La loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) (161) a reporté cette échéance au 1er octobre 2016.
Les alinéas 13 à 15 (IV) du présent article proposent un nouveau report au 1er janvier 2018. Les raisons invoquées tiennent à des problèmes techniques et informatiques. Selon l’évaluation préalable associée au présent projet de loi de finances, la création de nouvelles applications informatiques de traitement des forfaits de post-stationnement et des recours contentieux qui sont susceptibles de lui succéder et le recours à des procédures de marché spécifiques pour répondre aux besoins et sécuriser les procédures ne permettent pas une entrée en vigueur de la réforme au 1er octobre 2016.
Parallèlement, il est proposé de reporter du 1er janvier 2016 au 1er avril 2017 la date à compter de laquelle les collectivités et leurs groupements peuvent passer des conventions avec les services de l’État et l’ANTAI pour valider les dispositifs techniques et les procédures de recouvrement de la redevance de stationnement.
L’alinéa 16 (V) rend ce report applicable aux communes de Polynésie française.
IV. LA NOUVELLE ARCHITECTURE PROPOSÉE POUR LE CAS CONTRÔLE DE LA CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT ROUTIER
A. SEUL LE PRINCIPE D’UNE COMPENSATION DES PERTES DE RECETTES A ÉTÉ POSÉ
Le VI de l’article 63 de la loi MAPTAM du 27 janvier 2014 précitée prévoit une compensation des pertes nettes de recettes pour l’État et les collectivités territoriales, issues de la mise en œuvre de cette réforme. Il n’en définit toutefois pas les modalités, renvoyées à la prochaine loi de finances. La question du financement de la réforme a été soulevée, sans être réglée, lors des débats sur le projet de loi MAPTAM.
L’absence de dispositif de compensation et de péréquation des recettes
Le dispositif ne prévoit aucune mesure de compensation du manque à gagner pour l’État et aucun dispositif de péréquation financière en faveur des petites communes. Actuellement, l’article L. 2334-24 du CGCT dispose que l’État rétrocède aux communes et à leurs groupements le produit des amendes de police relatives à la circulation routière dressées sur leur territoire qu’il a recouvré. Les articles R. 2334-10 et R. 2334-11 prévoient un dispositif permettant aux conseils généraux de répartir le produit entre les groupements de moins de 10 000 habitants exerçant la totalité des compétences en matière de voirie et les communes de moins de 10 000 habitants ne faisant pas partie de ces groupements afin de financer des travaux relatifs aux transports en commun ou à la sécurisation routière.
Au terme d’un circuit particulièrement complexe reposant sur le compte d’affectation spéciale Contrôle de la circulation et du stationnement routier, le produit des amendes liées au stationnement irrégulier sur voirie est affecté pour une fraction de 47 % à l’État et pour une fraction de 53 % aux communes, aux départements, aux régions et au syndicat des transports en Île-de-France (STIF). Faute de mesure prise en loi de finances, le budget général serait directement affecté par la dépénalisation des infractions au stationnement payant sur voirie, soit environ 90 millions d’euros de perte de recettes selon la commission des finances de l’Assemblée nationale, tandis que, parmi les collectivités, celles qui n’ont pas instauré de redevances de stationnement et de post-stationnement, notamment les plus petites, s’en trouveraient perdantes nettes.
Source : M. Olivier Dussopt, Rapport sur le projet de loi, adopté par le Sénat, de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, Assemblée nationale, XIVe législature : http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r1216.asp#P5098_1047472
B. LA COMPENSATION DES PERTES DE RECETTES POUR L’ÉTAT PAR UNE FRACTION DES RECETTES DES « AMENDES RADARS »
La modification de l’architecture du CAS Contrôle de la circulation et du stationnement routiers vise à déterminer les modalités de compensation des pertes de recettes pour l’État et les collectivités territoriales résultant de la réforme du stationnement payant introduite par la loi MAPTAM précitée. Conformément aux travaux qui ont été menés dans le cadre de la mission interministérielle de décentralisation du stationnement, il est prévu de compenser les pertes de recettes pour l’État par une fraction des recettes issues des amendes forfaitaires perçues par la voie de systèmes automatiques de contrôle et sanction, dites « amendes forfaitaires radars ».
Les alinéas 3 à 5 (2° du I) du présent article modifient la répartition des recettes de la section 2 jusqu’alors attribuées au programme 754. Ce programme bénéficie actuellement de 170 millions d’euros du produit des amendes forfaitaires radars et d’une part des amendes forfaitaires hors radars et des amendes forfaitaires majorées. La fraction de 170 millions d’euros se décompose en une part de 64 millions d’euros au plus affectée aux départements, à la métropole de Lyon, à la collectivité territoriale de Corse et aux régions d’outre-mer et une part de 106 millions d’euros au plus affectée aux communes et EPCI bénéficiaires de la répartition par le comité des finances locales des recettes mentionnées à l’article L. 2334-25 du CGCT en vue de financer des opérations destinées à améliorer les transports en commun et la circulation.
L’alinéa 4 maintient la fraction de ces recettes attribuée aux départements, à la métropole de Lyon, à la collectivité territoriale de Corse et aux régions d’outre-mer au même niveau qu’avant la réforme.
L’alinéa 5 fait du ministre de l’intérieur l’ordonnateur principal de ces dépenses.
Les alinéas 6 et 7 (3° du I) affectent à l’État, dans la limite de 106 millions d’euros, une fraction des amendes forfaitaires radars destinée à compenser les pertes de recettes résultant de la réforme. Cette perte est égale à la part du produit perçu par l’État, lors de la dernière année connue, au titre des amendes forfaitaires et forfaitaires majorées relatives au stationnement payant. Ces montants de compensation devront être définis seront définis dans le projet de loi de finances précédant l’entrée en vigueur de cette réforme. Il n’est pas prévu d’indexation de ce montant.
La compensation à destination des collectivités territoriales se fera au sein du programme 754.
L’évaluation préalable évalue à 202 millions d’euros en année pleine le gain pour le CAS résultant du report de l’entrée en vigueur de la réforme de dépénalisation et décentralisation du stationnement payant. Ces 202 millions d’euros de recettes de stationnement payant représentent un cinquième des recettes des amendes forfaitaires hors radars et amendes forfaitaires majorées.
À l’entrée en vigueur de la dépénalisation et décentralisation de la gestion des amendes, la perte de ces recettes serait répartie à hauteur de 95 millions d’euros et de 107 millions d’euros pour les collectivités territoriales, conformément à la répartition de 47 % et 53 % des recettes de section 2 entre le programme 755 (désendettement de l’État) et le programme 754 (collectivités). Les communes et EPCI percevront alors directement les recettes de stationnement, ce qui compensera cette perte de recettes, compensée par l’État comme indiqué ci-dessus.
L’alinéa 8 (4° du I) du présent article fixe l’entrée en vigueur de cette nouvelle architecture du CAS au 1er janvier 2018.
*
* *
La commission adopte l’article 17 sans modification.
*
* *
Article 18
Modification du compte de commerce Approvisionnement de l’État et des forces armées en produits pétroliers, biens et services complémentaires
Le présent article modifie le périmètre du compte de commerce Approvisionnement des armées en produits pétroliers, autres fluides et produits complémentaires de manière à regrouper l’ensemble des recettes et des dépenses liées à l’approvisionnement en essence des administrations dans un même compte de commerce intitulé Approvisionnement de l’État et des forces armées en produits pétroliers, biens et services complémentaires.
ÉVOLUTION DU COMPTE DE COMMERCE
(en millions d’euros)
2015 |
PLF 2016 | |
Dépenses des armées en produits pétroliers, |
678 |
731,5 |
Financement via le compte de commerce |
678 |
731,5 |
Financement via la mission Défense |
58,3 |
– |
Source : projet de loi de finances.
I. L’ETAT DU DROIT
A. LA NATURE DES RECETTES ET DES DÉPENSES RETRACÉES
Le compte de commerce Approvisionnement des armées en produits pétroliers, géré par le ministère chargé de la défense, a été créé par l’article 71 de la loi de finances pour 1985 (162).
Il retrace les opérations liées à l’exploitation de l’oléoduc de Donges-Metz et celles liées à la fourniture par le service des essences des armées (SEA) (163) de produits pétroliers au ministère de la défense, à d’autres ministères (notamment pour couvrir les besoins de la gendarmerie, de la sécurité civile, des douanes, etc.), ainsi qu’à certains autres acteurs, dont des armées étrangères et des personnes privées œuvrant dans un cadre de missions d’intérêt général.
Selon l’évaluation préalable, la fourniture de produits pétroliers à des services ou organismes ne relevant pas du ministère de la défense représentait 9 % des prestations du SEA en 2014 (164).
Le compte retrace en recettes :
– les cessions de produits pétroliers, autres fluides et produits complémentaires nécessaires à l’utilisation des matériels des armées et à l’exploitation de leurs infrastructures pétrolières (ces deux dernières catégories de cessions ayant été ajoutées par l’article 57 de la loi de finances initiale pour 2013 (165)) ;
– les revenus de l’exploitation de l’oléoduc Donges-Metz ;
– les recettes relatives aux produits financiers utilisés pour couvrir les variations du prix des approvisionnements en produits pétroliers.
Ses dépenses sont quant à elles composées :
– des opérations d’achats correspondant aux produits pétroliers et produits complémentaires, dont les dépenses d’approvisionnement, de transport et de stockage externalisé et le retraitement de ces produits ;
– du remboursement au ministère de la défense des frais engagés à l’occasion des cessions de produits pétroliers à des organismes ne relevant pas de ce ministère (166) ;
– des charges d’exploitation de l’oléoduc Donges-Metz ;
– des dépenses relatives aux produits financiers de couvertures des variations du prix des approvisionnements.
TABLEAU RÉCAPITULATIF DES RECETTES ET DES DÉPENSES DU COMPTE DE COMMERCE
Recettes |
LFI 2015 |
PLF 2016 |
Cessions de produits aux clients relevant du ministère de la défense |
608 424 000 |
654 556 122 |
Cessions de produits aux autres clients |
69 000 000 |
76 817 611 |
Recettes relatives aux instruments financiers utiles à la couverture des variations du prix des approvisionnements en produits pétroliers |
– |
– |
Recettes diverses |
100 000 |
100 000 |
Total |
677 524 000 |
731 473 733 |
Dépenses |
LFI 2015 |
PLF 2016 |
Approvisionnement en produits pétroliers |
672 424 000 |
691 256 528 |
Utilisation du système d’oléoduc Donges-Metz (dépenses de fonctionnement) |
– |
|
Utilisation du système d’oléoduc Donges-Metz (dépenses d’investissement) |
– |
|
Remboursement au budget de la défense de certaines dépenses liées à la livraison de |
5 000 000 |
3 000 000 |
produits pétroliers | ||
Dépenses relatives aux instruments financiers utiles à la couverture des variations du prix |
– |
|
des approvisionnements en produits pétroliers | ||
Autres dépenses de gestion courante |
100 000 |
100 000 |
Fonction pétrolière (dépenses de fonctionnement) |
24 917 2015 | |
Fonction pétrolière (dépenses d’investissement) |
12 200 000 | |
Total |
677 524 000 |
731 473 733 |
Source : projet de loi de finances pour 2016.
Certaines charges liées aux prestations assurées par le SEA ne sont toutefois pas inscrites au compte de commerce, mais au sein des crédits budgétaires de la mission Défense.
SUPPORTS BUDGÉTAIRES COMPRENANT DES DÉPENSES PÉTROLIÈRES
(en millions d’euros)
Support budgétaire |
Montants indicatifs pour 2016 |
Fonctionnement et investissements en matériels pétroliers : UO Service des essences des armées du BOP Soutien des forces |
RAP 2014 : AE: 35,8 ; CP : 32,8 PAP 2016 : AE : 25,5 ; CP : 25,5 |
Entretien des infrastructures pétrolières : UO Service d’infrastructure de la défense au sein du BOP Direction de la mémoire, du patrimoine et des archives du programme Soutien de la politique de la défense |
1,2 |
UO : unité opérationnelle
BOP : budget opérationnel de programme
Source : évaluation préalable.
B. L’AUTORISATION DE DÉCOUVERT RÉÉVALUÉE AU COURS DES DERNIÈRES ANNÉES
De manière à prendre en compte la volatilité des cours des produits pétroliers et d’assurer la capacité d’achat du compte, l’autorisation de découvert a été réévaluée à deux reprises au cours des dernières années :
– la loi de finances pour 2005 (167) a porté le montant de découvert autorisé à 75 millions d’euros ;
– la loi de finances pour 2008 (168) l’a à nouveau augmenté pour atteindre à 125 millions d’euros.
Pour l’année 2016, cette autorisation est stable.
II. LE DROIT PROPOSÉ
Les activités du SEA sont plus larges que l’intitulé du compte de commerce puisque ses clients peuvent relever d’autres administrations que celles rattachées à la défense ou d’autres entités (par exemple, des clients privés sous contrat avec l’État). Par ailleurs, les charges liées à ses prestations ne sont pas intégralement inscrites dans le compte.
Pour assurer davantage de lisibilité, le présent article propose de :
– retracer l’ensemble des dépenses (hors masse salariale) de la fonction pétrolière dans un seul compte (dépenses de fonctionnement et d’investissement, hors programmes d’infrastructures majeurs et hors dépenses de personnel) ;
– étendre la participation financière au fonctionnement du SEA à l’ensemble de ses clients étatiques ou tiers ;
– modifier l’intitulé du compte de manière à acter ces évolutions en mentionnant expressément l’État comme bénéficiaire de l’approvisionnement et en incluant aux prestations pétrolières les biens et services qui leur sont liés.
Les mesures de périmètre qui découlent de ces dispositions sont prévues par le présent projet de loi de finances (169).
Cette réforme doit permettre au SEA de disposer d’un financement cohérent et de moderniser son offre de prestations.
En matière de gouvernance, un conseil de gestion associerait l’état-major des armées, le secrétariat général du Gouvernement et la direction du budget.
*
* *
La commission adopte l’article 18 sans modification.
*
* *
Article 19
Clôture du compte d’affectation spéciale Gestion et valorisation
des ressources tirées de l’utilisation du spectre hertzien, des systèmes et des infrastructures de télécommunications de l’État
Le I du présent article procède à la clôture du compte d’affectation spéciale (CAS) Gestion et valorisation des ressources tirées de l’utilisation du spectre hertzien, des systèmes et des infrastructures de télécommunications de l’État, dit « CAS Fréquences ».
Le II abroge, en conséquence, l’article 54 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 qui avait institué ce CAS.
Le CAS Fréquences, créé par l’article 54 de la loi de finances pour 2009, est composé de trois programmes. Deux programmes ont été créés dès l’origine du CAS :
– le programme 761 Désendettement de l’État ;
– le programme 762 Optimisation de l’usage du spectre hertzien et interception et traitement des émissions électromagnétiques (ministère de la défense).
Un troisième programme a été créé par la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 : le programme 763 Optimisation du spectre hertzien et des infrastructures du réseau physique de télécommunications du ministère de l’intérieur.
Ce compte retrace :
« 1° En recettes :
« a) Le produit des redevances acquittées par les opérateurs privés pour l’utilisation des bandes de fréquences libérées par les ministères affectataires, à compter du 1er janvier 2009 ;
« a bis) Le produit des redevances acquittées par les opérateurs privés pour l’utilisation des bandes de fréquences comprises entre 694 MHz et 790 MHz ;
« b) Le produit de la cession de l’usufruit de tout ou partie des systèmes de communication militaires par satellites de l’État intervenant dans les conditions fixées au II de l’article 61 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 ;
« c) Le produit de la cession de l’usufruit de tout ou partie des systèmes de communication radioélectrique des services de l’État, dans les conditions fixées au II de l’article 48 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 ;
« d) Le produit des redevances d’occupation domaniale résultant d’autorisations d’utilisation de points hauts des réseaux de télécommunication et de transmission des services de l’État, dans les conditions fixées au même II ;
« e) Les versements du budget général ;
« f) Les fonds de concours ;
« 2° En dépenses :
« a) Les dépenses d’investissement et de fonctionnement liées aux services de télécommunications utilisant le spectre hertzien ou visant à en améliorer l’utilisation, y compris le transfert de services vers des supports non hertziens ;
« b) Les dépenses d’investissement et de fonctionnement liées à l’interception ou au traitement des émissions électromagnétiques, à des fins de surveillance ou de renseignement ;
« c) Les dépenses d’investissement et de fonctionnement destinées à l’acquisition et à la maintenance d’infrastructures, de réseaux, d’applications, de matériels et d’équipements d’information et de communication radioélectriques liées à l’exploitation du réseau ;
« d) Les versements au profit du budget général pour un montant qui ne peut être inférieur à 15 % du produit visé au a du 1°. Ces versements ne s’appliquent pas au produit des redevances acquittées par les opérateurs privés pour l’utilisation des bandes de fréquences libérées par le ministère de la défense jusqu’au 31 décembre 2019 et par le ministère de l’intérieur jusqu’au 31 décembre 2018. »
L’objectif poursuivi par le législateur était d’inciter les utilisateurs publics – le ministère de la défense et le ministère de l’intérieur – à libérer des bandes de fréquences. À titre incitatif, il était prévu que les deux ministères concernés bénéficient de la majeure partie des recettes du compte d’affectation spéciale pour leur permettre de financer leurs dépenses d’investissement et de fonctionnement en matière de télécommunications.
En pratique, seul le programme 762 relatif au ministère de la défense a enregistré des opérations.
Le programme 763 relatif au ministère de l’intérieur, créé en 2012, n’a jamais enregistré d’opérations. Selon les informations recueillies par la Rapporteure générale auprès de la direction du budget, ceci s’explique par le fait que les besoins des opérateurs de téléphonie mobile en réseau de quatrième génération (4G) sont limités et qu’ils pourraient n’exprimer de nouveaux besoins, qu’ au mieux en 2018 dans les agglomérations et, plus tardivement, dans les zones rurales.
Contrairement aux intentions initiales, le CAS Fréquences n’a pas contribué au désendettement de l’État. Le programme 761 n’a donc pas enregistré d’opérations.
Pourtant, il était prévu par l’article 54 de la loi de finances pour 2009 qu’au moins 15 % des produits de redevances pour l’utilisation des bandes de fréquences libérées devaient être reversés au budget général au titre du désendettement de l’État.
Mais le ministère de la défense a bénéficié, dès l’origine, d’une dérogation jusqu’au 31 décembre 2014, en vertu du régime dit « de retour intégral ». Cette dérogation a été prolongée jusqu’au 31 décembre 2019 par l’article 40 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 (170).
La même dérogation a été accordée au ministère de l’intérieur jusqu’au 31 décembre 2018, lors de la création du programme 763 par la loi de finances pour 2013.
DATE D’EXPIRATION DU RÉGIME DU « RETOUR INTÉGRAL » | ||
Base légale |
Ministère de la défense Programme 762 |
Ministère de l’intérieur Programme 763 |
Article 54 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 |
31 décembre 2014 |
– |
Article 48 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 |
– |
31 décembre 2018 |
Article 40 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 |
31 décembre 2019 |
– |
Source : commission des finances. | ||
Le régime du « retour intégral » a donc été permanent. La mission Défense a ainsi bénéficié de l’intégralité du produit des ventes des bandes de fréquences « Rubis » en 2011 et « Félin » en 2012 pour respectivement 936 millions et 1,32 milliard d’euros. Elle a également bénéficié d’environ 39 millions d’euros de redevances 4G.
BILAN DU FONCTIONNEMENT DU CAS FRÉQUENCES (en millions d’euros) | |||||||
Opérations |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2011-2015 | |
Recettes |
RUBIS |
936,1 |
– |
– |
– |
– |
936,1 |
Recettes |
FELIN |
– |
1 319,5 |
– |
– |
– |
1 319,5 |
Recettes |
Redevances 4G |
– |
– |
– |
15,8 |
23,0 |
38,8 |
Recettes |
Total |
936,1 |
1 319,5 |
0,0 |
15,8 |
23,0 |
2 294,4 |
Opérations |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2011-2015 | |
Dépenses |
Total |
89,3 |
1 100,0 |
1 066,2 |
15,9 |
23,0 |
2 294,4 |
Source : ministère des finances et des comptes publics, direction du budget. |
|||||||
II. UNE CLÔTURE DU COMPTE JUSTIFIÉE PRINCIPALEMENT PAR L’ACTUALISATION DE LA LOI DE PROGRAMMATION MILITAIRE POUR 2014-2019
A. LE CONTEXTE BUDGÉTAIRE DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE A NÉCESSITÉ UNE CONVERSION EN CRÉDITS BUDGÉTAIRES DES RECETTES EXCEPTIONNELLES À ATTENDRE DU CAS FRÉQUENCES
L’équilibre financier de la programmation militaire pour 2014-2019 (171) reposait en grande partie sur l’obtention de ressources exceptionnelles, et notamment sur le produit de la mise aux enchères de la bande de fréquences comprise entre 694 MHz et 790 Mhz, dite « bande des 700 MHz ».
Le financement par voie de ressources exceptionnelles était une source de fragilité de la programmation en raison des incertitudes affectant le calendrier de réalisation des cessions. Dans sa note d’analyse d’exécution budgétaire pour 2014, la Cour des comptes recommandait « de ne pas recourir aux ressources exceptionnelles pour le financement des crédits de la mission Défense ».
Les tensions sur le budget de la défense ont été soulignées par la Rapporteure générale dans le cadre de l’examen de la loi de règlement pour 2014 (172).
Il est rapidement apparu que les recettes de la cession de la bande des 700 Mhz ne seraient pas disponibles en 2015, ni même en 2016. En effet, cette vente dépend de la conclusion de négociations internationales et européennes qui visent à organiser la gestion du spectre hertzien. Ces négociations, connues sous le nom de « deuxième dividende numérique », ne seront pas achevées avant la fin de l’année 2015, pour des ventes effectives qui seront effectuées au plus tôt en 2016.
Or, la cession de la bande de fréquences des 700 MHz constituait un élément d’équilibre fondamental de la loi de programmation militaire. Le produit de sa cession par le ministère de la Défense devrait en effet participer à hauteur de près de 4 milliards d’euros aux recettes exceptionnelles. La règle d’antériorité des recettes sur les dépenses, propre au fonctionnement d’un compte d’affectation spéciale, faisait peser sur la mission Défense un aléa trop important sur le calendrier de financement des investissements.
C’est dans ce contexte que, lors du Conseil de défense du 29 avril dernier, le Président de la République a arbitré en faveur d’un changement important, l’essentiel des recettes exceptionnelles prévues pour la programmation 2014-2019 étant converties en crédits budgétaires.
L’actualisation de la loi de programmation militaire – mise en œuvre par la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 actualisant la programmation militaire pour les années 2015 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense – a ainsi permis la sécurisation financière et opérationnelle de notre politique de défense.
Dès 2015, des crédits budgétaires ont été substitués aux ressources exceptionnelles à hauteur de 2,14 milliards d’euros. Pour les années suivantes, les crédits budgétaires viennent prendre la place des ressources exceptionnelles décrites dans la précédente loi de programmation, à l’exception des ressources financières résultant des cessions immobilières, ou, dans une moindre mesure, de cessions à des tiers de matériels militaires.
Dans ce contexte nouveau, il n’est plus justifié de suivre dans un CAS le produit de la vente de la bande des 700 MHz, rendant de ce fait inutile le maintien du programme 762 relatif au ministère de la défense.
De même, le maintien du programme 763 n’est pas plus utile compte tenu de l’absence de vente de fréquences du ministère de l’intérieur.
Les ressources issues de la cession des fréquences du ministère de la défense ne seront donc pas inscrites dans le CAS Fréquences mais directement dans le budget général en recettes non fiscales. Elles viendront ainsi compenser les ouvertures de crédits budgétaires décidées au profit de la mission Défense.
Ainsi, la budgétisation à compter de 2015 de la ressource correspondant jusqu’alors au produit de la cession de fréquences de la bande des 700 MHz n’aura pas d’impact sur les comptes publics dans la mesure où cette cession reste d’actualité.
Le solde du CAS Fréquences sera reversé au budget général, ce qui sera sans conséquence sur celui-ci dans la mesure où le solde devrait être nul (équilibre des recettes et des dépenses).
*
* *
La commission adopte l’article 19 sans modification.
*
* *
Article 20
Garantie des ressources de l’audiovisuel public
Cet article vise à consolider le financement de l’audiovisuel public par deux augmentations de taxes :
– en premier lieu, il augmente de 0,9 % à 1,2 % le taux de la taxe sur les services fournis par les opérateurs de communications électroniques (TOCE). Concrètement, il en résultera un prélèvement supplémentaire de 75 millions d’euros sur environ trente-cinq entreprises de ce secteur.
Le produit correspondant doit abonder le compte de concours financiers à l’audiovisuel public après prélèvement de frais d’assiette et de recouvrement de 1 % de ce montant. Cette somme sera affectée, par le truchement de ce compte, à France Télévisions ;
– en second lieu, il prévoit l’ajustement des mécanismes de fonctionnement de ce compte rendus nécessaires par l’augmentation prévisible du produit de la contribution à l’audiovisuel public (CAP), l’ex-redevance audiovisuelle, pour un montant, selon le Gouvernement, de 64,7 millions d’euros en 2016, hausse résultant de la dynamique spontanée de son assiette et de sa revalorisation automatique d’un euro à compter du 1er janvier 2016. Ces ajustements correspondent à une augmentation d’un euro de l’ex-redevance, qui passera de 136 euros en 2015 à 137 euros en 2016. Cette augmentation découle directement de la prise en compte de l’inflation.
Le financement de l’audiovisuel public est assuré par :
– le produit de taxes affectées issues du compte de concours financiers ;
– les crédits budgétaires de la mission Médias, livre et industries culturelles ;
– leurs recettes publicitaires propres et des produits divers.
LES RESSOURCES DE L’AUDIOVISUEL PUBLIC
(en millions d’euros)
Ressources |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 (prévisions) |
2016 (prévisions |
Crédits budgétaires |
642,6 |
622 |
426 |
283,2 |
189,6 |
69,5 |
Taxes affectées nettes |
3 155,9 |
3 223,2 |
3 377,2 |
3 478,6 |
3 591,43 |
3722,7 |
Recettes publicitaires et produits divers (1) |
554,7 |
508,7 |
463,8 |
450,1 |
465,6 |
n.c. |
Total |
4 353 |
4 354 |
4 267 |
4 212 |
4 247 |
n.c. |
(1) Ces recettes ne comprennent pas la contribution publique des gouvernements partenaires reçue par TV5 Monde, d’un montant de 24 millions d’euros en 2015.
Source : réponses au questionnaire budgétaire, documents budgétaires.
1. La création de la taxe créée en réponse à la suppression de la publicité sur l’audiovisuel public en soirée
Cette taxe a été créée par l’article 33 de la loi n° 2009-258 du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision, dans le cadre d’une modification plus générale du financement de l’audiovisuel public impliquant, notamment, la suppression de la publicité après 20 heures sur France Télévisions et la restructuration de l’audiovisuel extérieur de la France.
Afin de compenser le surcoût budgétaire lié à cette suppression, cette loi a prévu la création de deux taxes, dont le produit vient abonder le budget général de l’État :
– la taxe sur la publicité diffusée par les chaînes de télévision, codifiée à l’article 302 bis KG du code général des impôts (CGI) ;
– la TOCE.
PRODUITS DES TAXES SUR LA PUBLICITÉ ET SUR LES SERVICES FOURNIS PAR LES OPÉRATEURS DE COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES
(en millions d’euros)
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 (prévisions) | |
Taxe sur la publicité |
27,7 |
17,8 |
13,2 |
13 |
14 |
15,3 |
15,3 |
TOCE |
185,9 |
255 |
251 |
179,7 |
253,9 |
212,7 |
212,7 |
Total |
213,6 |
272,8 |
264,2 |
192,7 |
267,9 |
228 |
228 |
Source : direction générale des médias et des industries culturelles.
Il ressort du tableau ci-dessus que le produit des deux taxes créées en 2009 est loin de compenser la perte, alors évaluée à environ 450 millions d’euros par an, liée à la suppression de la publicité après 20 heures sur France Télévisions, que l’État a dû compenser par une dotation budgétaire à compter de 2009.
Cette seconde taxe pèse sur les services de communications électroniques, c’est-à-dire sur toute prestation qui, au moins à titre principal, permet l’émission, la transmission ou la réception de signes, de signaux, d’écrits, d’images ou de sons, par voie électromagnétique. Cette définition exclut les services de télévision, de radios et de médias audiovisuels à la demande.
Elle est due par les opérateurs de communications électroniques tels que définis par l’article L. 32 du code des postes et communications électroniques, qui ont fait l’objet d’une déclaration préalable auprès de l’Autorité de régulation des communications électronique (ARCEP). La taxe est due à raison des services fournis en France, ce qui n’exclut pas les opérateurs dont le siège est installé à l’étranger.
Elle pèse sur le montant, hors TVA, des abonnements et autres sommes acquittés par les usagers auprès de ces opérateurs en rémunération des services de communications électroniques qu’ils fournissent. Sont notamment visés les abonnements au service téléphonique sur réseaux fixes, ceux sur réseaux mobiles, les abonnements pour accéder à internet, etc. Lorsqu’un abonnement donne également accès à d’autres catégories de services (accès à des services de télévision par exemple), la fraction du prix de l’abonnement ou les autres sommes acquittées par les usagers au titre de ces catégories de services n’entrent pas dans la base d’imposition.
Le montant des dotations aux amortissements comptabilisés dans le cadre de l’exercice clos au titre de l’année pour laquelle la taxe est due est déduit de l’assiette de la taxe lorsque les amortissements comptabilisés sont afférents aux matériels et équipements acquis à compter du 7 mars 2009 par les opérateurs pour les besoins des infrastructures et réseaux de communications électroniques établis sur le territoire national et que la durée d’amortissement de ces matériels et équipements est au moins égale à dix ans.
Par ailleurs, certains éléments sont exclus de la base d’imposition :
– les sommes acquittées par les opérateurs au titre des prestations d’interconnexion et d’accès ;
– les sommes acquittées au titre des prestations de diffusion ou de transport de services de communication audiovisuelle ;
– Les sommes acquittées au titre de l’utilisation de services universel de renseignement.
La taxe est perçue en appliquant à cette assiette un taux de 0,9 % à la fraction excédant 5 millions d’euros.
L’article 19 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF) prévoit la catégorie des comptes de concours financiers, en supprimant par ailleurs, à compter du 1er janvier 2006, celles des comptes d’avances et des comptes de prêts retraçant jusqu’alors les sommes mises à disposition d’organismes publics respectivement pour moins ou pour plus de deux années.
Ces comptes, dont la LOLF prévoit expressément qu’ils sont dotés de crédits limitatifs, ont pour avantage de permettre la réalisation d’avances, la plupart du temps au bénéfice de personnes publiques, avec un taux d’intérêt bonifié aligné sur celui des obligations ou bons du Trésor de même échéance.
Le compte de concours financiers pour l’audiovisuel public
En application de ces dispositions, l’article 46 de la loi de finances pour 2006 (1) a prévu la création d’un compte de concours financiers destiné à retracer les avances à l’audiovisuel public.
Ce compte retrace :
– en dépenses, le montant des avances accordées à certaines personnes publiques intervenant dans le domaine audiovisuel. Conformément à la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, dite « loi Léotard » (2), il s’agit de la société nationale de programme France Télévisions, de la société nationale de programme Radio France, de la société en charge de l’audiovisuel extérieur de la France, de la société dénommée ARTE-France et de l’Institut national de l’audiovisuel (INA) qui est un établissement public à caractère industriel et commercial (3) ; depuis 2015, TV5 Monde bénéficie également de ces avances ;
– en recettes, d’une part, les remboursements d’avances correspondant au produit de la CAP, déduction faite des frais d’assiette et de recouvrement et du montant des intérêts sur les avances, et, d’autre part, le montant des dégrèvements de CAP pris en charge par le budget général de l’État.
(1) Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006.
(2) Articles 44, 45 et 49 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.
(3) La Chaîne parlementaire est exclue du bénéfice du compte de concours financiers.
La clarté de la présentation du compte de concours financiers a toutefois été limitée dès l’origine par un double mécanisme de garantie faisant intervenir à titre subsidiaire des crédits budgétaires.
En effet, l’article 46 de la loi de finances initiale pour 2006 a d’abord prévu que la prise en charge des dégrèvements de redevance audiovisuelle par le budget général de l’État serait soumise à un plancher. Initialement fixé à 440 millions d’euros, ce montant a été révisé chaque année pour atteindre actuellement 517 millions d’euros.
En outre, ce même article 46 a prévu la fixation en loi de finances initiale d’un produit minimal de CAP ; s’il s’avère que le produit réel de cette taxe est en dessous de la prévision, la différence est alors comblée par le budget général de l’État. Initialement fixé à 2 280,5 millions d’euros, ce plancher de recettes a été révisé progressivement pour atteindre 3 023,8 millions d’euros en 2014.
Ce mécanisme de garantie fait peser, en théorie, une grande responsabilité sur les personnes chargées de prévoir l’équilibre du compte de concours financiers, dans la mesure où une sous-évaluation de recettes de CAP se traduit automatiquement par une dépense budgétaire imprévue en cours d’exercice.
L’analyse de ce compte de concours financiers par la Cour des comptes, dans ses différentes notes annuelles d’exécution budgétaire, laisse perplexe sur le respect des dispositions de la LOLF et de l’article 46 de la loi de finances initiale pour 2006 précitée.
La Cour décrit en effet un compte de concours financiers fonctionnant de façon relativement virtuelle, avec des jeux d’écritures en recettes comme en dépenses permettant d’arrêter des chiffres qui s’équilibrent entre eux mais ne sont pas suivis des versements correspondants.
S’agissant d’abord des recettes du compte, le rapport indique que les remboursements en principe opérés par les bénéficiaires des avances « ne sont en aucune manière des remboursements réels par les organismes audiovisuels publics, mais un simple jeu d’écritures conduisant à alimenter le compte par deux flux » que sont d’une part le produit de la CAP et le remboursement des dégrèvements.
S’agissant par ailleurs des dépenses ordonnées à partir du compte de concours financiers, la Cour note que les avances ne sont pas considérées comme telles par les organismes bénéficiaires, puisque « les organismes publics n’inscrivent pas dans leurs comptes une dette financière qui serait la contrepartie de l’avance consentie par l’État ». De ce fait, « l’opération ne se solde, en cours d’année, par aucun versement d’intérêt qui aurait vocation à alimenter le budget général en tant que recettes non fiscales ni, en fin d’année, par aucun remboursement du principal venant en recette du compte de concours financiers ».
En synthèse, « le recours à un compte de concours financiers ne répond pas à la définition donnée par l’article 24 de la LOLF. Il crée une distorsion de traitement avec la comptabilité générale, difficile à expliquer, et permet d’exonérer les avances à l’audiovisuel de toute discipline budgétaire puisque les dépenses faites sur ce compte (...) échappent à la norme de dépense ».
Le compte de concours financiers est actuellement alimenté à titre principal par le produit de la CAP et à titre accessoire par les dégrèvements de CAP décidés par l’État ainsi que les éventuels remboursements dus à une erreur de perception.
Le régime de la CAP due par les particuliers se distingue de celui applicable aux personnes physiques à titre professionnel et aux personnes morales, tandis que son tarif est différent entre la métropole (136 euros) et l’outre-mer (86 euros).
Sont concernées en premier lieu, pour l’imposition des particuliers, les personnes physiques imposables à la taxe d’habitation au titre d’un local meublé affecté à l’habitation et détenant, au 1er janvier de l’année, un téléviseur à usage privatif.
L’article 1605 bis du CGI prévoit, par un renvoi aux dispositifs applicables à la taxe d’habitation, les personnes dégrevées de cette contribution :
– les habitants reconnus indigents par la commission communale des impôts directs en accord avec l’agent de l’administration fiscale ;
– les ambassadeurs et agents diplomatiques étrangers pour leur résidence officielle dans le cas où cette exonération est réciproque ;
– les titulaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées, de l’allocation supplémentaire d’invalidité, de l’allocation aux adultes handicapés ;
– les contribuables de plus de soixante ans ainsi que les veuves et les veufs dont les ressources ne dépassent pas le plafond annuel prévu pour l’application de la taxe d’habitation ;
– les personnes autres que celles mentionnées ci-dessus dont les revenus ne dépassent pas le revenu fiscal de référence fixé à l’article 1417 du CGI ;
– les contribuables atteints d’une infirmité ou d’une invalidité les empêchant de subvenir aux nécessités de leur existence par leur travail ;
– les personnes qui conservent la jouissance exclusive de leur habitation avant d’être prises en charge par un centre pour personnes âgées dépendantes ;
– les redevables occupant à titre d’habitation principale dans les départements d’outre-mer un immeuble dont la valeur locative n’excède pas 40 % (ou 50 % sur délibération de la commune) de la valeur locative moyenne des locaux d’habitation de la commune.
La CAP est également due par toutes les personnes physiques autres que celles imposables à la taxe d’habitation et par les personnes morales.
Sont exonérées de ce volet de la CAP les personnes morales de droit public pour leurs activités non assujetties à la TVA, les associations caritatives hébergeant des personnes en situation d’exclusion, les établissements sociaux et médico-sociaux, les établissements de santé et les associations socioculturelles et sportives des établissements pénitentiaires.
Le tarif applicable est le même que celui en vigueur pour les particuliers. Il s’applique toutefois à chaque point de vision, avec un abattement de 30 % à partir du troisième et de 35 % à partir du trente et unième. Il est en outre multiplié par quatre pour les débits de boissons à consommer sur place.
LES REDEVABLES PROFESSIONNELS DE LA CAP
Année |
2012 |
2013 |
2014 |
Nombre de redevables (en milliers de personnes) |
100,5 |
100,1 |
100,8 |
Produit total (en millions d’euros) |
101 |
105 |
108 |
Source : direction du budget.
Le compte de concours financiers est par ailleurs alimenté par un montant correspondant aux dégrèvements et remboursements de CAP décidés par l’État ; ce montant, budgété à l’action 12 du programme 200 Remboursements et dégrèvements d’impôts d’État, rattaché à la mission Remboursements et dégrèvements.
Ces dégrèvements correspondent en premier lieu au dispositif dit « de maintien des droits acquis » appliqué à compter de 2005, prévu par le 3° de l’article 1605 bis du CGI à destination des personnes qui étaient exonérées de la redevance audiovisuelle au 31 décembre 2004.
Ce dispositif, prévu par l’article 41 de la loi n° 2004-1484 de finances pour 2005, était destiné à accompagner une réforme en profondeur de l’ancienne taxe parafiscale pour la transformer en imposition de toute nature, conformément au nouveau cadre posé par la LOLF.
Cette réforme s’est traduite par un rapprochement des conditions d’exonération de la CAP et de celles, plus restrictives, applicable pour la taxe d’habitation; en effet, l’exonération de redevance audiovisuelle était ouverte aux personnes de plus de soixante-cinq ans n’ayant pas été imposées sur le revenu au titre de l’avant-dernière année ou de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) au titre de la même année.
Le montant des dégrèvements versés au compte de concours financiers résulte par ailleurs du dispositif en vigueur, qui permet d’exonérer ou de dégrevé les personnes visées précédemment.
Pour une bonne compréhension du secteur de l’audiovisuel public et de ses modalités de financement, la Rapporteure générale ne peut que renvoyer au rapport d’information adopté par la commission des finances le 30 septembre 2015 (173). Seuls certains éléments importants seront mis en exergue dans le présent commentaire.
Le produit de la CAP a augmenté de manière tendancielle ces dernières années.
LE PRODUIT DE LA CAP EFFECTIVEMENT VERSÉ APRÈS IMPÔTS
(en millions d’euros)
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
3 058,9 |
3 155,9 |
3 223,2 |
3 377,2 |
3 478,6 |
3 591,43 |
Source : direction générale des médias et des industries culturelles.
Il convient de préciser que les chiffres présentés dans le tableau ci-dessus retracent les montants effectivement versés aux organismes publics, toutes taxes acquittées.
Ce montant résulte de l’addition des recettes brutes de CAP et du montant correspondant aux remboursements et dégrèvements de CAP opéré à partir des crédits de la mission Médias. Sont déduits les frais d’assiette et de recouvrement, des coûts de trésorerie, ainsi que la TVA au taux de 2,1 % pesant spécifiquement sur les subventions versées à partir de ce compte en application de l’article 257 du CGI.
ÉVOLUTION DU MONTANT DE LA CONTRIBUTION
À L’AUDIOVISUEL PUBLIC
(en millions d’euros)
Ressources |
2013 |
2014 |
2015 (prévisions) |
2016 (prévisions) |
Encaissements bruts de redevance |
2 986,2 |
3 072,2 |
3 173,4 |
3 243,7 |
Frais d’assiette et de recouvrement |
28,2 |
28,4 |
28,2 |
28,2 |
Coûts de trésorerie |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
1 |
Encaissements nets de redevance |
2 957,5 |
3 043,3 |
3 144,7 |
3 214,5 |
Compensation pour dégrèvement |
490,2 |
507,8 |
522,1 |
513,8 |
Dotations aux organismes publics (TTC) |
3 447,7 |
3551,1 |
3666,8 |
3 728,3 |
Dotations aux organismes publics (HT) |
3 377,2 |
3 478,6 |
3 591,4 |
3 652 |
Source : direction générale des médias et des industries culturelles.
Le rapport spécial Communication audiovisuelle du sénateur Claude Belot, réalisé dans le cadre de l’examen de la loi de finances pour 2005 (174), consacre un développement particulier à l’assujettissement à la TVA des versements ainsi opérés.
D’après ce rapport, cet assujettissement résulte d’une situation qui « arrange tout le monde » : d’après l’auteur du rapport, « si les sociétés du secteur audiovisuel public n’acquittaient plus de TVA sur la redevance, seules leurs ressources propres seraient soumises à la TVA, et leurs dépenses grevées de TVA en amont. Le mécanisme de la répercussion ne pourrait plus fonctionner, ce qui coûterait très cher à ces sociétés ».
Il ressort en outre du tableau ci-dessous que l’augmentation du produit ne résulte que pour une petite partie de l’augmentation du nombre de redevables, qui reste relativement modeste depuis 2013.
ÉVOLUTION DES REDEVABLES DE LA CONTRIBUTION À L’AUDIOVISUEL PUBLIC
(en millions de personnes)
Redevables |
2013 |
2014 |
2015 (prévisions) |
2016 (prévisions) |
Nombre total de redevables |
26,86 |
27,07 |
27,30 |
27,52 |
dont ceux résidant en métropole |
26,23 |
26,44 |
26,66 |
26,88 |
dont ceux résidant dans les départements d’outre-mer |
0,626 |
0,63 |
0,64 |
0,64 |
Source : direction générale des médias et des industries culturelles.
Cette augmentation résulte pour l’essentiel de l’augmentation régulière du tarif de cette contribution. Cette augmentation a concerné à la fois la métropole et l’outre-mer. Elle résulte à la fois de la revalorisation automatique en fonction de l’inflation et d’augmentations complémentaires décidées par le Gouvernement à échéances régulières.
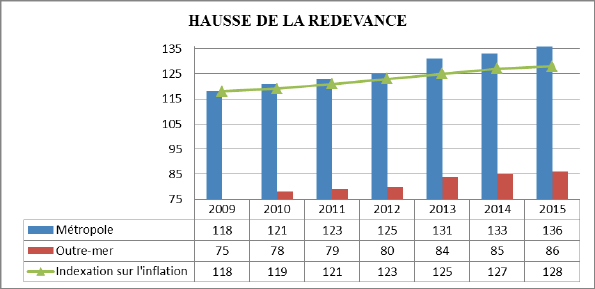
Source : direction générale des médias et des industries culturelles.
Depuis plusieurs années, l’augmentation des ressources de l’audiovisuel public provenant de la fiscalité affectée est concomitante à une baisse de son financement par des crédits budgétaires.
Récemment encore, l’article 44 de la loi de finances pour 2015 (175) a procédé à un élargissement du nombre d’entreprises bénéficiant de la CAP à la société TV5 Monde, tout en supprimant la dotation budgétaire de 76 millions d’euros qui lui était affectée.
Les ressources issues de la fiscalité affectée représentent par ailleurs une part variable des ressources publiques de ces entreprises.
LES RESSOURCES PUBLIQUES NETTES DE L’AUDIOVISUEL PUBLIC PAR BÉNÉFICIAIRE
(en millions d’euros)
Opérateurs |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 (prév.) |
PLF 2016 | |
France Télévisions |
CAP (+ TOCE) |
2 102,3 |
2 091,8 |
2 253,4 |
2 382,3 |
2 320,6 |
2 442,3 |
Subvention |
361,9 |
435,9 |
248,8 |
103,6 |
160,4 |
40,5 | |
ARTE France |
CAP |
246,7 |
262,7 |
262,6 |
260,5 |
261,8 |
264,1 |
Subvention |
|||||||
Radio France |
CAP |
594,2 |
610,2 |
605,5 |
600,4 |
601,8 |
606,5 |
Subvention |
|||||||
Soutien à l’expression radiophonique locale |
Subvention |
29,2 |
27,5 |
29 |
29 |
29,1 |
29 |
Audiovisuel extérieur (France Média Monde à compter 2014) |
CAP |
122,6 |
168 |
165,8 |
165,9 |
242 |
243,9 |
Subvention |
251,5 |
158,6 |
|
|
0 |
0 | |
Institut National de l’Audiovisuel |
CAP |
90,1 |
90,5 |
89,9 |
69,5 |
89 |
89 |
Subvention |
|||||||
TV5 Monde |
CAP |
|
76,9 | ||||
Subvention |
76,2 |
||||||
Total |
CAP (+TOCE) |
3 155,9 |
3 223,2 |
3 377,2 |
3 478,6 |
3 591,43 |
3 722,7 |
Subvention |
642,6 |
622 |
426 |
283,2 |
189,6 |
69,5 | |
Total général |
CAP HT+Sub |
3 798,5 |
3 845,2 |
3 803,2 |
3 761,8 |
3 781 |
3 792,2 |
Source : projets annuels de performances et rapports annuels de performance 2013 à 2015.
Outre une tendance forte à la débudgétisation du financement de l’audiovisuel public, le tableau ci-dessus met en évidence plusieurs évolutions récentes :
– en premier lieu, on pourra noter que le financement public total de l’audiovisuel est passé de 3 845 millions d’euros en 2012 à 3 781 millions d’euros en 2015. L’audiovisuel public n’a donc pas été épargné par les efforts de gestion demandés aux autres acteurs publics ;
– le tableau met en évidence les changements intervenus dans le financement de l’audiovisuel extérieur de la France. Alors ce dernier était encore financé à un peu plus de 46 % par des subventions en 2013, la séparation de TV5 Monde et de France Média Monde s’est accompagnée d’une suppression complète de ces subventions au profit d’une augmentation concomitante de la CAP.
L’audiovisuel public a été affecté, ces dernières années, par des restructurations importantes :
– la loi n° 2009-258 du 5 mars 2009 (176) a, en premier lieu, fragilisé le service public de la télévision et de la radio ainsi que les finances publiques permettant de le financer.
Cette loi prévoyait en effet, outre la nomination le président-directeur général de France Télévisions et de Radio France par le Président de la République, une suppression de la publicité commerciale après 20 heures sur France Télévisions. En l’absence de réévaluation de la CAP, ce choix s’est soldé par une mobilisation du budget général dans un contexte économique et budgétaire particulièrement incertain ;
– parallèlement, la précédente majorité a entrepris une réforme de l’audiovisuel public extérieur, s’expliquant alors par plusieurs constats : faiblesse de pilotage stratégique de l’État, empilement de structures disparates et multiplicité de tutelles et de sources de financement, insuffisante adéquation des modes de communication aux usages de chaque région du monde et absence de synergies entre les intervenants.
Afin d’améliorer ce pilotage stratégique, le Gouvernement a décidé de la création en 2008 d’une société holding dénommée Audiovisuel Extérieur de la France (AEF) (177). La société AEF a été dotée de 100 % du capital de Radio France Internationale (RFI) et de France 24 ainsi que 49 % du capital de TV5 Monde, celle-ci étant une entreprise partenaire et non filiale de la holding AEF. Par ailleurs les crédits alloués à TV5 Monde, RFI et France 24 ont été regroupés dans une enveloppe globale, la répartition des dotations incombant à la holding.
Si la création d’une entité juridique unique a probablement eu le mérite de créer des synergies et de dégager des économies d’échelle, la fusion des rédactions de RFI et France 24 a été menée sans concertation en menaçant l’identité particulière de RFI. Le Gouvernement a décidé d’arrêter le processus de fusion des rédactions tout en maintenant le principe d’une fusion juridique et d’un déménagement dans des locaux uniques à Issy-les-Moulineaux.
Quant à TV5 Monde, il a été décidé que la chaîne serait désormais adossée à France Télévisions. À cet effet, cette dernière a racheté, fin juillet 2013, 36,42 % du capital de cette société à l’AEF, cette dernière conservant 12,58 % de son capital et une place au conseil d’administration. Le reste du capital se partage entre les groupes audiovisuels publics belge RTBF et suisse SSR, Radio Canada, Télé Québec, ARTE-France, l’Institut national de l’audiovisuel (INA) et les mandataires sociaux.
COMPOSITION DU CAPITAL DES ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES
DU COMPTE DE CONCOURS FINANCIERS
France Télévisions |
100 % du capital est détenu par l’État |
Radio France |
100 % du capital est détenu par l’État |
ARTE France |
Le capital est partagé entre France Télévisions (45 %), État français (25 %), Radio France (15 %), INA (15 %) |
TV5 Monde |
Le capital est partagé entre France Télévisions (49 %), France Média Monde (12,64 %), RTBF (11,11 %), SSR (11,11 %), Radio-Canada (6,67 %), Télé-Québec (4,44 %), ARTE-France (3,29 %), INA (1,74 %) |
AEF (France Médias Monde) |
100 % de la holding est détenue par l’État |
Source : mentions légales publiées sur le site internet de ces sociétés.
Cette prise de position dans le capital de TV5 doit être regardée comme un retour à la normal dans la mesure où, avant la création de l’AEF, France Télévisions détenait déjà 48 % du capital de TV5 Monde. Compte tenu de cette modification, le président de France Télévisions assure également la présidence du conseil d’administration de TV5 Monde.
La suppression de la publicité commerciale après 20 heures sur les chaînes nationales de France Télévisions, conjuguée à la crise du marché publicitaire de la télévision, a pour effet indirect une perte d’attractivité et une marginalisation progressive de France Télévisions auprès des annonceurs et s’est traduite par une perte de chiffre d’affaires très nettement supérieure à celle du marché.
Cette tendance résulte de la conjugaison de deux phénomènes :
– avec des budgets d’investissement plus contraints du fait de la crise, les annonceurs en quête de visibilité et de retour sur investissement portent de plus en plus leurs choix vers les tranches de soirée définis comme des carrefours d’audience. Les écrans diffusés avant 20 heures ne représentent plus que 45 % des investissements (en retrait de 5 points en trois ans) toutes chaînes confondues ;
– concomitamment, l’optimisation des budgets conduit les annonceurs à concentrer leurs investissements sur un minimum de régies : le nombre de groupes annonceurs n’investissant que sur une unique régie est désormais de près de 44 %, contre 32 % en 2012. Ce processus se fait le plus souvent au détriment de France Télévisions qui est dans l’incapacité de commercialiser des écrans après 20 heures. Il y a donc un risque réel de déclassement de la régie de France Télévisions.
LES RESSOURCES PUBLICITAIRES DE FRANCE TÉLÉVISIONS
(en millions d’euros)
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 (prév.) |
591,3 |
404,9 |
441,3 |
423,7 |
372,2 |
333,1 |
317,8 |
340,1 |
Source : réponse au questionnaire budgétaire du rapporteur spécial de la mission Médias.
Entre 2010 et 2014, le groupe Radio France a représenté en moyenne 2 % de part du marché publicitaire radiophonique contre 3 % entre 2005 et 2010.
La société Radio France et la société RFI ne sont en effet autorisées qu’à programmer et à faire diffuser des messages de publicité collective et d’intérêt général dans un cadre réglementaire très contraint.
La publicité collective et d’intérêt général comprend la publicité effectuée en application de la loi du 24 mai 1951 pour certains produits ou services présentés sous leur appellation générique, la publicité en faveur de certaines causes d’intérêt général (lutte contre le tabagisme, action sanitaire, etc.) dont les campagnes peuvent être diffusées en dehors des écrans publicitaires, la publicité effectuée par des organismes publics ainsi que les campagnes d’information des administrations présentées sous forme de messages de type publicitaire, telles qu’elles sont définies par circulaires du Premier ministre.
LES RECETTES PUBLICITAIRES DE RADIO FRANCE
(en milliers d’euros)
Support |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 (prév.) |
Support radio |
40 601 |
39 904 |
39 088 |
38 893 |
40 379 |
38 636 |
Support numérique |
700 |
859 |
831 |
1 020 |
1 056 |
1 400 |
Message radio |
478 |
574 |
503 |
491 |
558 |
468 |
Total |
41 779 |
41 337 |
40 423 |
40 404 |
41 992 |
40 504 |
Source : réponse au questionnaire budgétaire du rapporteur spécial de la mission Médias.
ARTE France ne bénéficie d’aucune recette publicitaire.
Au sein de France Médias Monde, France 24 a vu ses recettes publicitaires évoluer de 2,1 millions d’euros en 2010 à 2,2 millions d’euros en 2014, après un montant particulièrement élevé de 3,7 millions d’euros en 2012. RFI a par ailleurs vu ses recettes s’établir à 1,6 million d’euros en 2014 (+ 7 % par rapport à 2013).
Enfin, la publicité sur TV5 Monde fait l’objet d’un contrat de régie avec France Télévisions publicité, dont l’échéance est prévue le 31 décembre 2015, prévoyant un montant minimum garanti de 4,2 millions d’euros entre 2010 et 2012 ; n’ayant pas prévu de montant garanti depuis 2013, les recettes de TV5 Monde ont été ramenées à 2,5 millions d’euros en 2013 et 2,87 millions d’euros en 2014.
Le présent article prévoit la consolidation du financement de l’audiovisuel public, et à titre principal de France Télévisions, par l’affectation d’une recette nouvelle de 75 millions d’euros (paragraphes I, III et IV du présent article) et en ajustant de compte de concours financiers en fonction d’une prévision d’augmentation de la CAP de 64,7 millions d’euros (paragraphe II du présent article).
A. L’AJUSTEMENT DU COMPTE DE CONCOURS FINANCIERS
Le 3° du II du présent article, tirant les conséquences de la revalorisation automatique d’un euro de la CAP, augmente de 3 149,8 à 3 214,5 millions d’euros le plancher de recettes garanties de cette taxe, soit une augmentation de 64,7 millions d’euros.
Selon les informations transmises par la direction du budget, cette augmentation résulte pour 43 millions d’euros de l’évolution de l’assiette et du nombre de contributeurs et pour 21,7 millions d’euros de l’augmentation de son tarif.
LE PLANCHER DE PRODUIT DE LA CAP EN LOI DE FINANCES INITIALE
(en millions d’euros)
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
PLF 2016 |
2 329 |
2 561 |
2 652 |
2 764 |
2 903,6 |
3 028,8 |
3 149,8 |
3 214,5 |
Source : réponses aux questionnaires budgétaires.
Le 1° du II présent article baisse en outre de 517 à 513,8 millions d’euros le plancher garanti de ressources à verser au compte de concours financiers au titre des remboursements et dégrèvements d’impôts.
Le plafond de remboursement des dégrèvements de cap fixé
en loi de finances initiale
(en millions d’euros)
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
PLF 2016 |
561,7 |
561,8 |
569,8 |
526,4 |
544,1 |
527,3 |
517 |
513,8 |
Source : réponses aux questionnaires budgétaires
Cette baisse globale de 3,2 millions d’euros masque des évolutions en sens opposé des deux dispositifs de dégrèvements de CAP décrits précédemment. Le coût du dispositif en vigueur augmente logiquement avec la réévaluation progressive de la CAP, tandis que le dispositif des droits acquis enregistre des baisses marquées qui compensent cette hausse depuis 2014.
DÉTAIL DES MONTANTS VERSÉS AU TITRE DES DÉGRÈVEMENTS DE CAP
(en millions d’euros)
Dégrèvement |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
PLF 2016 |
Dégrèvement en faveur des personnes de condition modeste |
446 |
471 |
482 |
490 |
497 |
Dégrèvement en faveur des personnes de condition modeste au titre des droits acquis |
53 |
50 |
46 |
27 |
16,8 |
Total |
499 |
521 |
528 |
517 |
513,8 |
Source : direction du budget.
Le I du présent article prévoit une augmentation d’un tiers de point du taux de la taxe sur les opérateurs de télécommunications.
Il prévoit par ailleurs, au titre des frais d’assiette et de recouvrement, un prélèvement de 1 % sur le montant correspondant à uniquement à cette augmentation, versé à France Télévisions en application du IV du présent article.
À titre de comparaison, les frais d’assiette et de recouvrement sont de 0,5 % pour la TVA, de 2,37 % pour les droits d’enregistrement, de 1 % pour la taxe sur les concessionnaires d’autoroute ou la CAP.
Le taux retenu pour la présente taxe est donc cohérent avec celui existant pour des impositions comparables ; en droit, il peut paraître singulier, toutefois, de n’asseoir ce prélèvement que sur la fraction créée par le présent article. La taxe ayant été créée en 2009, le recouvrement d’une fraction supplémentaire n’engendre pas à proprement parler de frais supplémentaires.
Le III du présent article prévoit que les acomptes de la taxe sur les opérateurs de télécommunications sont majorés d’un tiers à compter de l’année 2016. Conformément à l’article 1693 sexies du CGI, les redevables de cette taxe peuvent l’acquitter soit par acomptes mensuels soit par acomptes trimestriels au moins égaux au douzième ou au quart du montant de la taxe due au titre de l’année précédente.
Le V prévoit que cette augmentation de la taxe sur les opérateurs de télécommunications s’applique aux abonnements et aux autres sommes acquittées par les usagers à compter du 1er janvier 2016.
D’après le Bulletin officiel des finances publiques-impôts (BOFiP–Impôts), cette référence aux « autres sommes » désigne :
– les sommes relatives aux services fixes (téléphonie fixe et internet), y compris les services de télécommunications fournis sous forme de cartes prépayées ;
– les sommes relatives aux services mobiles (voix et messagerie, internet, SMS, MMS, e-mail), y compris les services de télécommunications fournis sous forme de cartes prépayées ;
– les sommes relatives aux services de capacité (liaisons louées et transport de données).
Ce même V prévoit par ailleurs que l’augmentation de la taxe prendra effet à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de regarder le dispositif comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.
Le présent article se traduira par une augmentation de la pression fiscale sur certains redevables et par un surcroît de ressources non budgétaires pour les entreprises de l’audiovisuel public bénéficiaires du compte de concours financiers.
D’après la direction du budget, cette augmentation devrait mécaniquement concerner les trente-cinq entreprises assujetties à cette taxe aujourd’hui. À titre principal, quatre ou cinq entreprises dominant ce marché devraient s’acquitter de l’essentiel de cette augmentation.
Les effets de ce prélèvement sur l’économie de ce secteur peuvent paraitre marginaux, puisqu’il représente 0,2 % de l’ensemble des revenus des opérateurs de communications électroniques de l’année 2014, même si le marché semble enregistrer une décrue depuis quelques années.
REVENUS DES OPÉRATEURS DE COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES
(en milliards d’euros)
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
43,8 |
44,3 |
43,4 |
41,2 |
38,2 |
36,8 |
Source : ARCEP, Rapport public d’activité en 2014, juin 2015.
La question de l’impact de cette augmentation sur les entreprises du secteur, et de son éventuelle répercussion sur le tarif des abonnements, est posée.
La Fédération française des télécoms a en effet publiquement pris position en mettant en évidence les problèmes de concurrence dans le secteur, ainsi que les investissements massifs que doivent opérer les entreprises pour couvrir les zones blanches ou acquérir les fréquences de la bande des 700 MHz.
Au cours d’une audition par la mission d’information sur le financement public de l’audiovisuel en France précité, le porte-parole de cette fédération a toutefois très clairement écarté la perspective d’une répercussion de cette hausse sur le tarif des abonnements.
Il a toutefois souligné la difficulté que pourrait entraîner cette augmentation sur la capacité des opérateurs à financer leurs investissements et notamment à déployer des antennes de quatrième génération (4G) dans les zones blanches, évoquant très précisément le chiffre de 700 antennes dont l’installation serait ainsi compromise.
Le rapport public de l’activité de l’ARCEP de juin 2015 met toutefois en évidence une grande stabilité des investissements de ces opérateurs entre 2004 et 2014 hors acquisition de fréquences (entre 5,5 et 7 milliards d’euros en 2004 et 2014) ; ce chiffre a enregistré une hausse conjoncturelle en 2011 et 2012 liée à l’acquisition des licences mobiles 4G, sans toutefois peser sur les autres investissements.
Compte tenu du fait que l’augmentation de la taxe représente environ 1 % des investissements hors acquisition de fréquences, la Rapporteure générale estime que la perspective d’une répercussion de la taxe sur les abonnés ou d’une érosion de la capacité d’investissement des opérateurs est hypothétique.
Lors de l’examen en commission des finances, dans le cadre du projet de loi de finances pour 2015, de l’article prévoyant une augmentation de la CAP de trois euros, plusieurs de ses membres ont souligné l’impact de cette mesure sur le pouvoir d’achat des ménages.
Il faut rappeler que, du fait des mécanismes de dégrèvement de CAP, environ 16 % du montant théorique recouvrable n’est pas acquitté par les redevables aux revenus limités (13,3 % hors dispositif des droits acquis). Le plancher de revenus en deçà duquel est opéré le dégrèvement est défini par renvoi au dispositif du revenu fiscal de référence, soit 10 686 euros pour la première part de quotient familial, majorée de 2 853 euros pour chaque demi-part supplémentaire.
Concrètement, une personne seule commencera à payer chaque mois, pour l’accès à l’ensemble des chaines de l’audiovisuel public, une contribution fixe de 11 euros alors que son revenu mensuel de référence avoisine les 900 euros. Dans le cas d’un couple, le revenu de référence sera de 1 130 euros environ.
Une analyse plus détaillée de la répartition du produit de la CAP en fonction du niveau de revenu des redevables et de la composition du foyer serait certainement très intéressante ; malgré ses demandes, la Rapporteure générale n’a toutefois pas pu recueillir de données permettant un tel travail.
Selon les informations fournies par le Gouvernement, l’augmentation du produit de la CAP permettra, pour l’essentiel, de poursuivre la politique de financement de France Télévisions à partir de ressources extra-budgétaires.
Sur le produit supplémentaire de 64,7 millions d’euros issu de l’augmentation de la CAP, 50 millions devraient être affectés à France Télévisions, le reste étant réparti entre les autres acteurs de l’audiovisuel public.
S’agissant de France Télévisions, cette ressource nouvelle de 50 millions d’euros, ajoutée au produit de 75 millions d’euros escompté de l’augmentation de la taxe sur les opérateurs de télécommunications, devrait s’accompagner d’une baisse de 120 millions d’euros de sa subvention budgétaire.
Au total, cet opérateur devrait voir ses ressources publiques augmenter de 5 millions d’euros.
*
* *
Les amendements I-CF 380 de la Rapporteure générale et I-CF 224 de M. Jean-Marie Beffara sont retirés.
La commission adopte l’article 20 sans modification.
*
* *
Article 21
Relations financières entre l’État et la sécurité sociale
Le présent article vise à compenser les pertes de recettes pour la sécurité sociale découlant de la poursuite en 2016 de la mise en œuvre du pacte de responsabilité et de solidarité, annoncé le 14 janvier 2014 par le Président de la République, pour 4,1 milliards d’euros ainsi que de certaines mesures adoptées dans le cadre de la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques pour 200 millions d’euros (178). Par ailleurs, une mesure de trésorerie prise en 2015 pour compenser les effets de la première année d’application du pacte voit son rendement diminuer d’un milliard d’euros en 2016. Il convient par conséquent de la remplacer par une autre mesure à due concurrence. Au total, les compensations proposées atteignent ainsi 5,3 milliards d’euros.
ÉVOLUTION DU MONTANT DES MESURES D’EXONÉRATION COMPENSÉES PAR L’ÉTAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 2012 À 2017
(en milliards d’euros) | ||||||
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 | |
Allégements généraux de cotisations sociales |
22,3 |
20,3 |
20,9 |
21,7 |
21,7 |
n.c |
Exonérations ciblées (sectorielles, géographiques…) |
2,6 |
3,8 |
3,7 |
3,6 |
3,5 |
n.c |
Pacte de responsabilité* |
- |
- |
- |
6,3 |
11,4 |
16 |
Loi croissance et activité (179)* |
- |
- |
- |
|
0,19 |
0,13 |
Total |
25 |
24,2 |
24,6 |
31,6 |
36,9 |
n.c |
* Ces mesures sont principalement compensées par des transferts de dépenses à l’État. Elles ne se traduisent pas par un versement de recettes supplémentaires à la sécurité sociale. Toutefois, leur prise en compte dans ce tableau permet d’apprécier l’évolution des compensations au sens large de l’État à la sécurité sociale sur la période 2015-2017.
Source : comptes de la sécurité sociale, septembre 2014 et septembre 2015
Les compensations proposées par le présent article sont constituées principalement du transfert de la sécurité sociale à l’État des dépenses liées à :
– l’allocation de logement familiale (ALF), actuellement financée par la branche famille pour un montant de 4,7 milliards d’euros, frais de gestion inclus (I et II de l’article) ;
– la part du financement du dispositif de protection juridique des personnes majeures (frais de tutelle et de curatelle) reposant sur les organismes de sécurité sociale pour 400 millions d’euros (III et IV) ;
– le financement par l’État des emplois de titulaires de la fonction publique hospitalière et des emplois en contrats à durée indéterminée mis à la disposition de la direction générale de l’organisation des soins (DGOS), actuellement financés par l’assurance maladie (5 millions d’euros).
La fraction de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) affectée à la sécurité sociale serait également ajustée de 7,10 % à 7,19 % pour compléter ces transferts (1° du I).
Par ailleurs, cet article propose de modifier les modalités de compensation de la déduction forfaitaire des cotisations versées par les particuliers employeurs en remplaçant la fraction de TVA affectée à ce titre à la sécurité sociale par une dotation budgétaire (V).
Le présent article entrerait en vigueur au 1er janvier 2016 (VI).
Comme l’illustre le tableau ci-dessous, les compensations annuelles de l’État à la sécurité sociale sont inférieures aux montants qu’il est censé compenser. Ceci contribue à créer une dette de l’État vis-à-vis de la sécurité sociale dont le montant a toutefois fortement diminué sur la dernière décennie pour atteindre 368 millions d’euros en 2015.
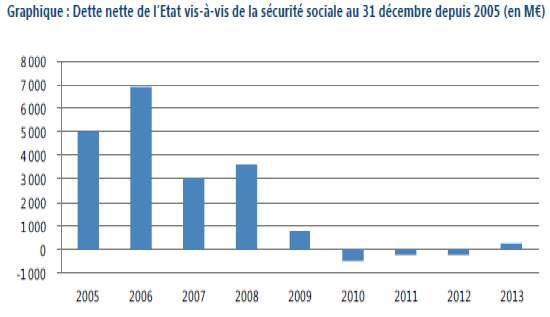
Source : annexe 6 du PLFSS 2015.
I. LES MESURES AFFECTANT LES RECETTES DE LA SÉCURITÉ SOCIALE EN 2016
1. Les principes encadrant les relations financières entre l’État et la sécurité sociale
Deux principes permettent d’assurer l’équilibre des relations financières entre l’État et la sécurité sociale :
– un principe de compensation par l’État des mesures affectant les recettes ou les charges de la sécurité sociale ;
– un principe de neutralité visant à garantir le versement des compensations dans des délais raisonnables.
a. Le principe de compensation
L’article L. 131-7 du code de la sécurité sociale (CSS) prévoit que donne lieu à compensation intégrale aux régimes concernés par le budget de l’État pendant la durée de leur application :
– toute mesure de réduction ou d’exonération de cotisations de sécurité sociale, instituée à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi n° 94-637 du 25 juillet 1994 relative à la sécurité sociale ;
– tout transfert de charges opéré entre l’État et les régimes concernés.
Des exceptions à ce principe sont toutefois possibles, à la condition d’être adoptées dans une loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) (180). Depuis 2005, 19 mesures non compensées ont ainsi fait l’objet d’une disposition expresse de non-compensation en LFSS.
Chaque année, la LFSS approuve le montant de la compensation proposée par l’État. Ce montant est fixé à 3,5 milliards d’euros par l’article 25 du projet de LFSS pour 2016.
La majeure partie des exonérations et des allégements de cotisations sont compensés par l’affectation de recettes fiscales ou de dotations budgétaires de l’État. Les allégements généraux sur les bas salaires font ainsi l’objet d’une compensation sous la forme de recettes affectées depuis 2011, tandis que les exonérations ciblées sont principalement compensées par des dotations budgétaires ou, plus rarement, par l’attribution d’une fraction de TVA nette. Une présentation détaillée de l’évolution des relations financières entre l’État et la sécurité sociale est proposée dans le tome I du présent rapport général.
ÉVOLUTION DE L’AGRÉGAT CONSTITUÉ DES COTISATIONS ET DES EXONÉRATIONS DE COTISATION ET ÉVOLUTION DE LA STRUCTURE DES EXEMPTIONS DE COTISATIONS SELON LE TYPE DE COMPENSATION
(en milliards d’euros)
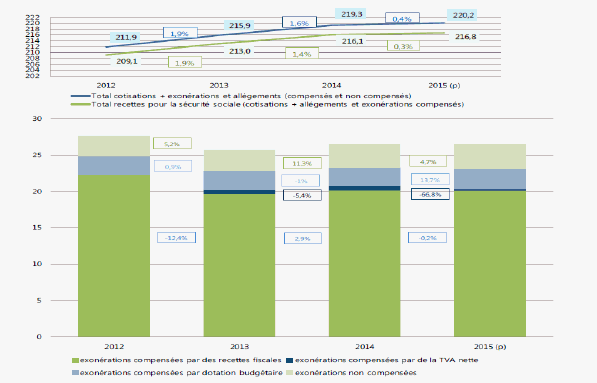
Lecture : les taux indiqués entre deux bâtons de l’histogramme précisent l’évolution du montant de chaque catégorie d’exonération selon les modalités de leur compensation..
Source : Comptes de la sécurité sociale, juin 2015.
b. Le principe de neutralité
Le versement d’une compensation doit également permettre d’assurer la neutralité en trésorerie des relations entre l’État et la sécurité sociale. L’article L. 139-2 du CSS prévoit à ce titre que les compensations dues par l’État doivent être versées dans les limites d’une périodicité de dix jours (181).
La différence entre le montant définitif de la dépense ou de la perte de recettes pour la sécurité sociale et le montant des versements de l’État au titre de la compensation est retracée dans l’état semestriel des sommes restant dues par l’État transmis par le Gouvernement au Parlement avant la fin du mois de janvier de l’exercice suivant (182).
Les montants de dette de l’État vis-à-vis de la sécurité sociale ont toutefois sensiblement diminué au cours des dernières années au regard des montants constatés entre 2005 et 2009.
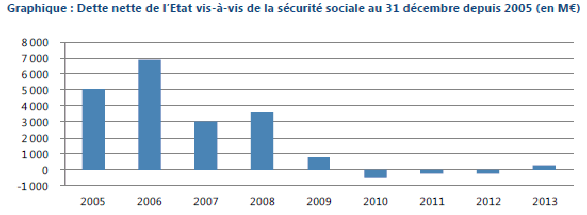
Source : annexe 6 du projet de loi de financement de la sécurité sociale.
Dans son rapport sur l’exécution budgétaire de 2014, la Cour des comptes constate toutefois une augmentation de la dette de l’État envers la sécurité sociale de 249 millions d’euros fin 2013 à 368 millions d’euros fin 2014. Elle souligne que cette augmentation fait « peser un risque significatif sur l’exercice 2015, puisque l’apurement définitif de cette taxe supposerait à la fois de verser 368 millions d’euros à la sécurité sociale et d’augmenter les dotations (sous forme de crédits budgétaires ou de taxes affectées) d’environ 120 millions d’euros (insuffisance constatée). C’est donc au total un coût d’environ 500 millions d’euros qui devrait être supporté par l’État en 2015 afin de rétablir une situation équilibrée vis-à-vis de la sécurité sociale ».
2. Les mesures du pacte de responsabilité et de solidarité diminuant
les recettes de la sécurité sociale
Le pacte de responsabilité et de solidarité prévoit la mise en œuvre progressive de mesures en faveur des entreprises et des ménages sur les années 2015 à 2017.
En 2015, les entreprises ont ainsi bénéficié de près de 24 milliards d’euros d’allégements fiscaux et sociaux dont 17,3 milliards au titre du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE), 4,5 milliards au titre d’allégements de cotisations patronales entre 1 et 1,6 SMIC, 1 milliard au titre d’allégements de cotisations en faveur des travailleurs indépendants et 1 milliard au titre de la réduction de contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S).
Selon le rapport des comptes de la sécurité sociale de septembre 2015 sur les résultats de 2014 et les prévisions pour 2015 et 2016, les dispositions du pacte ont été compensées par des mesures d’un rendement « sensiblement supérieur au montant nécessaire à la stricte compensation du pacte (8,5 milliards d’euros). De ce fait, la fraction de TVA nette affectée à la sécurité sociale a été ajustée à la baisse pour 1,6 milliard d’euros ».
MESURES DU PACTE DE RESPONSABILITÉ COMPENSÉES EN 2015
(en milliards d’euros)
Mesures |
Impact négatif |
Impact positif |
Bilan |
Baisse de 1,8 point du taux de cotisation famille pour les salaires inférieurs à 1,6 SMIC |
– 3,58 |
– |
– |
Renforcement des allégements généraux et modification de leur répartition (hors Fonds national d’aide au logement – FNAL) |
– 0,76 |
– |
– |
Allégements de cotisations famille des travailleurs indépendants |
– 1,00 |
– |
– |
Suppression progressive de la C3S |
– 1,00 |
– |
– |
Total à compenser pour l’ensemble du pacte |
– 6,34 |
– 6,34 | |
Prélèvement à la source des cotisations des caisses de congés payés |
– |
1,49 |
– |
Affectation au régime général du prélèvement de solidarité sur les revenus du capital |
– |
2,26 |
– |
Transfert au budget de l’État de la fraction d’aides personnelles au logement (APL) auparavant financée par la Caisse nationale des allocations familiales (CNAF) |
– |
4,78 |
– |
Total des mesures destinées à compenser le pacte |
– |
8,54 |
8,54 |
Source : Comptes de la sécurité sociale, septembre 2015.
En 2016, le Gouvernement poursuit ces mesures allégements au travers notamment de :
– l’élargissement de la baisse des cotisations d’allocations familiales aux salaires compris entre 1,6 et 3,5 fois le SMIC, qui représente un coût en année pleine de 4,5 milliards d’euros. Cet élargissement qui devait s’appliquer au 1er janvier 2016 est toutefois repoussé au 1er avril, ce qui permet de limiter son coût à 3,1 milliards d’euros ;
– un nouvel abattement sur l’assiette de la C3S en direction des petites et moyennes entreprises (PME) (183), à hauteur d’un milliard d’euros supplémentaire, réduisant le nombre de redevables de 98 000 en 2015 à 20 000 en 2016 (au lieu de 296 000 en 2014).
Ces deux dispositions sont prévues par les articles 7 et 8 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 (PLFSS pour 2016).
Pour rappel, le tableau suivant présente la déclinaison des mesures concernant la sphère sociale prévues par le pacte pour les années 2015 à 2017. Il permet de constater qu’il sera encore nécessaire de compenser la sécurité sociale à hauteur de 4,6 milliards d’euros en 2017.
LES MESURES SOCIALES DU PACTE DE RESPONSABILITÉ EN FAVEUR DES ENTREPRISES
(en milliards d’euros)
Mesures |
2015 |
2016 |
2017 |
Allégements de cotisations patronales entre 1 et 1,6 SMIC |
4,3 |
– |
– |
Allégements de cotisations patronales entre 1,6 et 3,5 SMIC |
– |
3,1 |
1* |
Allégements de cotisations en faveur des indépendants |
1 |
– |
– |
Abattement de contribution sociale sur l’IS |
1 |
1 |
3,6 |
Total annuel des mesures |
6,3 |
4,1 |
4,6 |
Total cumulé des mesures |
6,3 |
10,4 |
15 |
* En année pleine, l’application de la mesure coutera 1 milliard d’euros de plus qu’en 2016, année au titre de laquelle l’entrée en vigueur de la mesure est reportée au 1er avril.
Source : commission des finances.
3. Le moindre rendement de la mesure de prélèvement à la source des cotisations des caisses des congés payés (1 milliard d’euros)
L’article 23 de la LFSS pour 2015 (184) a introduit un dispositif de retenue à la source des cotisations et contributions de sécurité sociale sur les indemnités versées par les caisses de congés payés.
Cette mesure, qui constituait une avance sur trésorerie, devait permettre au régime général de la sécurité sociale de bénéficier de 1,52 milliard d’euros supplémentaires en 2015 et de compenser à due concurrence les premières mesures d’exonération adoptées dans le cadre du pacte de responsabilité.
La Rapporteure générale avait toutefois précisé, lors de la présentation de cette mesure, que la recette afférente ne pourrait, conformément à sa nature, être constatée qu’en 2015. L’estimation de son rendement est ainsi de 500 millions d’euros en 2016 pour devenir nulle en 2017. Par conséquent, une nouvelle compensation de 1 milliard d’euros doit être trouvée pour 2016 et de 500 millions d’euros en 2017 pour atteindre un total pérenne de 1,5 milliard d’euros.
4. Les mesures de la loi pour la croissance
La loi du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques a introduit plusieurs allégements de recettes à destination de la sphère sociale que le présent article se propose de compenser pour un montant total de 193 millions d’euros.
a. Les allégements sociaux en faveur des attributions d’actions gratuites
L’article 135 assouplit les conditions d’attribution des actions gratuites (AGA) et met en place un régime fiscal et social plus favorable. Les gains d’attribution, auparavant imposés selon les modalités applicables aux traitements et salaires, sont désormais imposés selon celles des plus-values mobilières et soumis aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine.
En contrepartie, la contribution salariale spécifique portant sur le gain d’acquisition de 10 % est supprimée (pour un coût annuel de 25 millions d’euros), tandis que le taux de la contribution patronale sur la valeur des actions au jour de leur attribution est abaissé de 30 % à 20 % (pour un coût annuel de 100 millions d’euros).
b. La réduction du taux du forfait social
L’article 149, adopté à l’initiative de l’Assemblée nationale, prévoit l’application d’un taux de forfait social de 16 % (au lieu de 20 %) pour les versements des sommes issues de la participation ou de l’intéressement ainsi que pour les contributions des entreprises versées sur un Perco, dont au moins 7 % des titres sont destinés au financement des PME et des entreprises de taille intermédiaire (ETI).
L’article 171 étend, quant à lui, le bénéfice du taux réduit du forfait social de 8 % : ce taux, qui s’appliquait aux contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de prévoyance ou aux sommes affectées à la réserve spéciale de participation dans les sociétés coopératives de production, s’appliquera également, à compter du 1er janvier 2016, aux sommes versées au titre de la participation et de l’intéressement par une PME qui conclut pour la première fois un accord de participation ou d’intéressement.
Le coût moyen de ces deux mesures est estimé à 80 millions d’euros.
Au total, les mesures à compenser atteignent un montant total de 5,3 milliards d’euros, comme l’indique le tableau suivant.
TABLEAU RÉCAPITULATIF DES MESURES À COMPENSER
(en milliards d’euros)
Mesures |
Sphère sociale |
Extension du champ du taux réduit de cotisations d’allocations familiales – PLFSS pour 2016 |
– 3,075 |
Suppression progressive de la C3S – PLFSS pour 2016 |
– 1,020 |
Perte de recettes liées à la baisse du rendement de la mesure de prélèvement à la source des cotisations des caisses de congés payé – LFI pour 2015 |
1 |
Impact de la réforme des prélèvements sur les attributions gratuites d’actions et le forfait social – articles 135 et 149 de la loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques |
0,193 |
Total des mesures à compenser |
5,288 |
Source : évaluation préalable.
II. LES MESURES DE COMPENSATION PROPOSÉES PAR LE PRÉSENT ARTICLE
1. Le transfert à l’État du financement de l’allocation de logement familiale (4,7 milliards d’euros)
a. Le financement des aides personnelles au logement
Il existe trois aides personnelles au logement :
– l’allocation logement à caractère social (ALS) et l’aide personnalisée au logement (APL), entièrement rebudgétisées en loi de finances pour 2015 de manière à compenser les premières mesures du pacte de responsabilité affectant les recettes de la sécurité sociale (pour un montant de 4,75 milliards d’euros) (185) ;
– l’allocation de logement familiale (ALF) prise en charge par la Caisse nationale des allocations familiales (CNAF).
Ces aides, accordées sous condition de ressources, permettent de diminuer les coûts de logement à la charge de leurs bénéficiaires.
Elles bénéficient à 6,5 millions de ménages pour un coût total estimé à 18,3 milliards d’euros en 2015 (+ 3,1 % par rapport à 2014), répartis comme suit.
MONTANT DES AIDES AU LOGEMENT DE 2012 À 2015
(en milliards d’euros)
Aides |
2012 |
2013 |
Évolution % |
2014 |
Évolution % |
2015 (p)* |
Évolution % |
2016 (p)* |
Évolution % |
ALF |
4,2 |
4,4 |
2,9 % |
4,4 |
1,6 % |
4,5 |
1,4 % |
4,6 |
1,7 % |
ALS |
5,1 |
5,3 |
3,5 % |
5,3 |
0,2 % |
5,3 |
1,1 % |
5,4 |
0,7 % |
APL |
7,4 |
7,8 |
4,8 % |
8,0 |
2,9 % |
8,3 |
3,8 % |
8,6 |
3,2 % |
Total |
16,8 |
17,4 |
3,9 % |
17,7 |
1,7 % |
18,2 |
2,4 % |
18,5 |
2,1 % |
Total CNAF |
8,5 |
8,8 |
3,9 % |
9,0 |
2,8 % |
4,5 |
1,4 % |
4,6 |
1,7 % |
Total État |
8,3 |
8,6 |
3,9 % |
8,7 |
0,7 % |
13,6 |
2,7 % |
13,9 |
2,2 % |
(*) L’évolution pour 2015 est présentée à champ 2015, soit la progression de la dépense d’ALF pour la part CNAF et le reste pour le financement État.
Source : Comptes de la sécurité sociale, juin 2015.
Le rapport sur les comptes de la sécurité sociale de juin 2015 précise à ce titre le transfert à l’État de la totalité du financement des APL, « neutre pour les bénéficiaires, modifie la structure de financement des aides au logement : la progression – à périmètre constant – de la dépense de logement financée par la branche (famille) (3,9 % en 2013 et 2,8 % en 2014, contre une évolution globale de la dépense de 3,9 % et 1,7 %), devrait s’atténuer mécaniquement en 2015, reflétant l’évolution des seules dépenses d’ALF (+ 2,2 %) ».
b. La rebudgétisation de l’ensemble des aides personnelles au logement
Le présent article propose de rebudgétiser les dépenses liées à l’ALF de manière à uniformiser le mode de financement des aides personnelles au logement. Cette nouvelle dépense transférée à l’État est estimée à 4,7 milliards d’euros, soit 4,6 milliards d’euros pour l’allocation elle-même et 92 millions d’euros au titre des frais de gestion (fixés à 2 % des prestations).
Le Fonds national d’aide au logement (FNAL) serait désormais en charge de cette allocation ainsi que de la prime déménagement et des frais qui s’y rapportent. Toutefois, la CNAF en resterait gestionnaire.
À cette fin, le I de l’article exclut l’ALF des prestations prises en charge par la CNAF à l’article L. 214-6 du code de la sécurité sociale.
Les 3° du I et le II complètent au sein, réciproquement, du code de la sécurité sociale et du code de la construction et de l’habitation, les dépenses mises à la charge du FNAL.
Celles-ci couvrent actuellement les APL, la prime de déménagement prévue à l’article L. 351-5 du code de la construction, l’ALS et les dépenses du conseil national de l’habitat. Elles seraient étendues à l’ALF et à la prime de déménagement accordée à la suite d’une déclaration de grossesse prévue à l’article L. 542-8 du code de la sécurité sociale.
2. Le transfert à l’État de la part du financement du dispositif
de protection juridique des majeurs
Le financement des mesures de protection des personnes majeures repose totalement ou en partie sur les personnes protégées selon leur niveau de ressources. Les revenus pris en compte sont ceux perçus l’avant-dernière année précédant la mise en œuvre de la mesure de tutelle ou de curatelle.
Lorsque ce financement n’est pas intégralement supporté par la personne concernée, sa charge revient à différentes entités publiques selon la nature de la mesure de protection appliquée et les revenus perçus.
RÉPARTITION DU FINANCEMENT ENTRE FINANCEURS PUBLICS
Financeurs au niveau local |
Nature de la mesure et revenus perçus par la personne |
État |
Personnes sous tutelle, curatelle, mandat spécial percevant aucune prestation sociale ou une prestation sociale non listée Personnes sous tutelle, curatelle, mandat spécial percevant une prestation sociale relevant du conseil général : allocation personnalisée d’autonomie (APA), prestation de compensation du handicap (PCH) et revenu de solidarité active (RSA) |
Département |
Personnes sous mesure d’accompagnement judiciaire percevant l’APA (perçue directement par la personne), la PCH ou le RSA |
Caisse d’allocations familiales (CAF) |
Quelle que soit la mesure, personnes percevant directement l’allocation pour adulte handicapé (AAH), l’allocation de logement social (ALS) ou l’aide personnalisée au logement (APL) |
Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) |
Quelle que soit la mesure, personnes percevant l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) ou le minimum vieillesse (MV) et personnes ayant plus de 60 ans et percevant l’allocation supplémentaire d’invalidité (ASI) |
Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) |
Quelle que soit la mesure, personnes ayant moins de soixante ans et percevant l’ASI |
Mutualité sociale agricole (MSA) |
Quelle que soit la mesure, personnes affiliées au régime agricole et percevant une des prestations sociales listées |
Service de l’ASPA |
Quelle que soit la mesure, personnes percevant l’ASPA-MV |
Régimes spéciaux |
Quelle que soit la mesure personne percevant l’ASPA ou l’ASI et relevant de régimes spéciaux |
Source : évaluation préalable.
Au-delà de l’objectif de compensation de nouvelles pertes de recettes pour la sécurité sociale, la rebudgétisation de ces dépenses doit permettre d’en simplifier les modalités de financement.
En ce sens, le III modifie le code de l’action sociale et des familles de manière à préciser que :
– le financement des frais de tutelle reposera désormais pour 0,3 % du montant de la dotation globale sur le conseil départemental du lieu d’implantation du siège de l’organisme gestionnaire du service de protection et pour le reste, sur l’État (article L. 361-1) ;
– les agents des organismes de sécurité sociale seront habilités à transmettre aux préfets les informations dont ils disposent sur les ressources de leurs allocataires et les prestations qu’ils leur servent afin de permettre aux services de l’État dans le département de vérifier le montant de la participation de la personne protégée au financement du coût de sa mesure (article L. 471-5).
Pour rappel, le montant des frais de tutelle pour les organismes de sécurité sociale a faiblement progressé depuis 2012. Le transfert de charge à l’État est estimé à 400 millions d’euros.
DÉPENSES DE FRAIS DE TUTELLE
(en millions d’euros)
Année |
2012 |
2013 |
% |
2014 |
% |
2015 (p) |
% |
Structure 2015 |
2016 (p) |
% |
Frais de tutelle |
348 |
353 |
1,6 |
366 |
3,6 |
374 |
2,3 |
1 % |
383 |
2,3 |
(p) Prévisions
Source : Comptes de la sécurité sociale, septembre 2015.
3. Deux mesures réglementaires mises à la charge de l’État
Deux mesures de nature réglementaire et de montant modeste sont également prises en compte pour le calcul du montant des compensations à la sécurité sociale :
– le projet de décret relatif à l’aide à la réinsertion familiale et sociale des anciens travailleurs migrants (ARFS), pris en application de l’article L. 117-3 du code de l’action sociale et des familles (60 millions d’euros) ;
– le transfert à l’État du financement des emplois de titulaires de la fonction publique hospitalière et des CDI mis à la disposition de la DGOS du ministère de la santé, actuellement financés par l’assurance maladie (5 millions d’euros).
4. La majoration de la fraction de TVA affectée à la sécurité sociale
Le 1° du I prévoit d’ajuster à la hausse la fraction de TVA nette affectée à la sécurité sociale de 7,10 % à 7,19 % (soit + 140 millions d’euros) de manière à compléter les mesures de compensation précédemment décrites.
Au total, les mesures de compensation couvriraient ainsi la totalité du montant des exonérations prévues dans le cadre de la poursuite du pacte de responsabilité et de solidarité.
RÉCAPITULATIF DES COMPENSATIONS PROPOSÉES
(en milliards d’euros)
Mesures à compenser |
Sphère sociale |
État |
Extension du champ du taux réduit de cotisations d’allocations familiales – PLFSS 2016 |
3,075 |
0 |
Suppression progressive de la C3S – PLFSS 2016 |
1,020 |
0 |
Perte de recettes liée à la baisse du rendement de la mesure de prélèvement à la source des cotisations des caisses de congés payés – LFI pour 2015 |
1 |
0 |
Impact de la réforme des prélèvements sur les attributions gratuites d’actions et forfait social – loi pour la croissance et l’activité |
0,193 |
0 |
Total mesures à compenser |
5,288 |
0,0 |
Budgétisations |
Sphère sociale |
État |
ALF – PLF 2016 |
– 4,691 |
4,691 |
Prise en charge de la protection juridique des majeurs – PLF 2015 |
– 0,390 |
0,390 |
ARFS – projet de décret relatif à l’aide à la réinsertion familiale et sociale des anciens travailleurs migrants |
– 0,060 |
0,060 |
Emplois mis à la disposition de la DGOS |
– 0,005 |
0,005 |
Total budgétisations |
– 5,146 |
5,141 |
Majoration de la fraction de TVA affectée pour compléter la compensation des pertes de recettes en 2015 |
– 0,142 |
0,142 |
Total en PLF 2016 |
0 |
5,288 |
Source : évaluation préalable.
III. LA MODIFICATION DES MODALITÉS DE COMPENSATION DE LA DÉDUCTION FORFAITAIRE POUR LES PARTICULIERS EMPLOYEURS
Le coût de la déduction forfaitaire des charges patronales en faveur de l’emploi à domicile, introduit par la LFSS pour 2013, a fortement augmenté à la suite de l’extension du dispositif aux départements d’outre-mer, avec un barème plus favorable pour les particuliers employeurs (déduction forfaitaire de 3,50 euros par heure travaillée, contre 0,75 euro pour le barème appliqué en métropole). Ce coût est à nouveau majoré par l’introduction, à partir de 2015, de la déduction forfaitaire de cotisations accordée aux particuliers employeurs pour la garde d’enfants de six à treize ans (1,50 euro par heure travaillée). Au total, ce dispositif devrait donc représenter 200 millions d’euros.
DÉDUCTION FORFAITAIRE SERVICE À LA PERSONNE
(en millions d’euros)
Déduction |
2013 (*) |
2014 |
2015 (p) |
2016 (p) |
Déduction forfaitaire service à la personne (0,75 euro par heure) |
133 |
169 |
151 |
151 |
Déduction forfaitaire service à la personne (1,50 euro par heure) |
0 |
0 |
27 |
27 |
Déduction forfaitaire service à la personne en outre-mer (3,50 euros par heure) |
0 |
15 |
20 |
20 |
Total |
133 |
184 |
198 |
198 |
(p) Prévisions
Source : Comptes de la sécurité sociale, septembre 2015.
Le V du présent article prévoit que cette déduction, actuellement compensée par le versement d’une fraction de TVA à la sécurité sociale, sera désormais compensée par des crédits budgétaires qui constituent le mode de compensation de droit commun pour les exonérations ciblées (géographiques ou sectorielles). Cette mesure est neutre pour la sécurité sociale comme pour l’État.
IV. L’INSCRIPTION DES BUDGÉTISATIONS PROPOSÉES DANS LE BUDGET GÉNÉRAL DE L’ÉTAT
Les dispositions du présent article se traduiront par l’inscription, en seconde partie du présent projet de loi de finances, de crédits budgétaires supplémentaires :
– à la mission Égalité des territoires, logement et ville ;
– à la mission Solidarité, insertion et égalité des chances ;
– à la mission Travail et emploi.
SCHÉMA RÉCAPITULATIF DES TRANSFERTS PRÉVUS PAR LE PRÉSENT ARTICLE
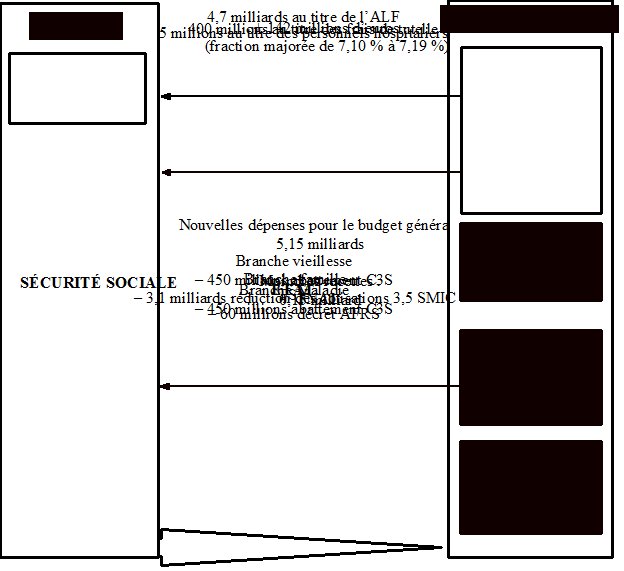
*
* *
La commission adopte l’article 21 sans modification.
*
* *
Article additionnel avant l’article 22
Réduction des frais de recouvrement et de dégrèvement de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises
La commission examine, en discussion commune, l’amendement I-CF 47 de M. Marc Le Fur et les amendements identiques I-CF 137 de M. Charles de Courson et I-CF 328 de M. Éric Alauzet.
Mme Marie-Christine Dalloz. L’amendement I-CF 47 vise à rétablir un pourcentage raisonnable et réaliste pour les frais de recouvrement et de dégrèvement de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises (TACFE). Cette taxe concerne seulement vingt-six attributaires alors que la cotisation foncière des entreprises (CFE) concerne des milliers d’attributaires du bloc communal.
M. Charles de Courson. Lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2015 en première lecture à l’Assemblée nationale, le secrétaire d’État chargé du budget avait indiqué en séance publique ne pas être opposé à ce que soit menée une étude « pour entrer dans le détail des frais de dégrèvement et de non-paiement [de la TACFE], qui permettent de garantir les ressources des collectivités bénéficiaires ». Il a jugé logique que la part d’impayé ou de dégrèvement ne soit pas « pour la poche de l’État ».
M. Éric Alauzet. Vous admettrez, chers collègues, que l’écart entre le taux de 9 % pour la TACFE et celui de 3 % qui s’applique à la CFE mérite au moins des explications, sans quoi nous ne saurions l’admettre.
Mme la Rapporteure générale. En effet, il convient sinon de toiletter ces taux, du moins de les relier au rendement des taxes en question, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui. Ce sujet a d’ailleurs été abordé l’an dernier en séance publique. J’émets donc un avis de sagesse.
Mme Marie-Christine Dalloz. Je retire mon amendement et me rallie aux deux amendements identiques.
L’amendement I-CF 47 est retiré.
La commission adopte les amendements I-CF 137 et I-CF 328.
*
* *
La commission examine l’amendement I-CF 249 de Mme Marie-Christine Dalloz.
Mme Marie-Christine Dalloz. Ce matin, le reproche nous a été fait de vouloir créer des dépenses supplémentaires ; c’est pourquoi nous vous proposons par cet amendement de créer des recettes supplémentaires, madame la Rapporteure générale, en rétablissant deux dispositifs que vous avez supprimés dès 2012 en loi de finances rectificative : le droit annuel forfaitaire au profit de l’aide médicale de l’État, et la procédure d’agrément préalable pour les soins hospitaliers les plus coûteux. En effet, le déficit structurel des hôpitaux est très problématique, et il est temps d’envisager comment le combler.
Suivant l’avis défavorable de la Rapporteure générale, la commission rejette l’amendement I-CF 249.
Article additionnel avant l’article 22
Suppression du plafonnement de la décote pour l’aliénation des terrains du ministère de la défense en faveur du logement social
La commission examine ensuite l’amendement I-CF 394 de la commission des affaires économiques.
M. le rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques. Il a été décidé, dans la loi relative à la mobilisation du foncier public, une décote importante visant précisément à mobiliser ce foncier pour construire des logements. Or, la loi de programmation militaire prévoit la diminution de cette décote pour le foncier du ministère de la défense. Dès lors, de nombreux terrains militaires, qui pourraient être mobilisés pour la construction de logements si la décote était plus élevée, ne pourront être vendus, ce qui diminuera d’autant le nombre de logements construits. Par conséquent, l’amendement vise à revenir au dispositif prévu par la « loi Duflot » relative à la mobilisation du foncier public.
M. le président Gilles Carrez. Il y a là un conflit entre la « loi Duflot » et la loi de programmation militaire. Pour boucler son budget, le ministère de la défense semble avoir besoin de l’intégralité de ses ressources immobilières.
M. le rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques. Sans doute, mais sans décote, il n’en percevra pas les recettes attendues et, de surcroît, les logements ne seront pas construits. Personne n’y gagnera !
Mme la Rapporteure générale. Sagesse.
M. Dominique Lefebvre. En l’espèce, la contradiction est manifeste. Nous pourrions adopter cet amendement mais, faute de visibilité, il faut confirmer le dispositif avec le Gouvernement.
M. Jean-Louis Dumont. En matière de foncier public, le ministère de la défense est le dernier à faire de la résistance. À titre personnel, j’estime que la défense de la France mérite autre chose que d’être soumise aux aléas d’une vente immobilière. Non loin d’ici, un immeuble a récemment été vendu à des conditions exceptionnelles qui ont dépassé toutes les estimations, mais les affaires ne seront peut-être pas toujours aussi intéressantes. Faudra-t-il décider d’acheter un Rafale ou de lancer une opération en Syrie ou ailleurs en fonction des ventes immobilières ? Une telle politique de défense me paraîtrait peu sérieuse.
Par ailleurs, le ministère de la défense n’a pas les moyens financiers lui permettant d’effectuer les dépollutions nécessaires à la vente de son foncier, qui s’en trouve freinée. Dans plusieurs cas, des opérateurs capables d’effectuer la dépollution sont intéressés par des terrains mais ne trouvent aucun interlocuteur. Ne faudrait-il donc pas rappeler à l’ordre le ministère de la défense quant à la gestion de son patrimoine immobilier ? La mission de réalisation des actifs immobiliers, la MRAI, pourtant dynamique et performante à ses débuts, est trop souvent aux abonnés absents. L’adoption de cet amendement permettrait de lui envoyer un avertissement ; il est temps de secouer ce ministère !
Enfin, le site de Balard doit être occupé intégralement, et le premier exemple à donner serait d’y installer le ministre et son cabinet – ce qui n’empêche pas de sanctuariser l’hôtel de Brienne.
La commission adopte l’amendement I-CF 394.
*
* *
Article additionnel avant l’article 22
Extension de la possibilité d’aliéner un terrain de l’État en faveur du logement social avec une décote aux cas de réhabilitation
La commission examine ensuite l’amendement I-CF 396 de la commission des affaires économiques.
M. le rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques. S’agissant encore de la mobilisation du foncier public, une décote s’applique à l’acquisition de terrains nus et de terrains bâtis sur lesquels il est prévu de détruire pour reconstruire. Cet amendement vise à l’étendre aux simples travaux de réhabilitation, ce qui permettrait d’englober les immeubles pouvant être simplement transformés en logements plutôt que détruits et, ainsi, de favoriser la construction de logements à partir du foncier public. En l’état, la décote incite en effet à détruire, même lorsqu’il est plus simple de se contenter d’une réhabilitation. J’ajoute que le Président de la République lui-même semble avoir donné son accord à cette mesure.
Suivant l’avis favorable de la Rapporteure générale, la commission adopte l’amendement I-CF 396.
Puis elle examine les amendements identiques I-CF 51 de M. Marc Le Fur et I-CF 136 de M. Charles de Courson.
Mme Marie-Christine Dalloz. L’amendement I-CF 51 vise à supprimer le prélèvement de 28,9 millions d’euros qui est effectué sur les ressources de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises (TACFE), normalement affectée aux chambres de commerce et d’industrie. En effet, ce prélèvement, qui a été maintenu sans fondement, s’ajoute à d’autres ponctions réalisées sur les ressources fiscales de celles-ci.
M. Charles de Courson. Je présente le même amendement, car ce prélèvement me semble aujourd’hui sans fondement.
Mme la Rapporteure générale. Je précise qu’il s’agit du prélèvement d’une somme dont les chambres n’ont jamais disposé.
M. Charles de Courson. En effet : les ressources de la TACFE sont normalement affectées aux chambres, mais l’État prélève ce montant de 29 millions environ et leur verse le reliquat.
Suivant l’avis défavorable de la Rapporteure générale, la commission rejette les amendements I-CF 51 et I-CF 136.
*
* *
Article 22
Évaluation du prélèvement opéré sur les recettes de l’État au titre
de la participation de la France au budget de l’Union européenne
Le présent article évalue à 21,509 milliards d’euros le montant prévisionnel, pour 2016, du prélèvement sur les recettes en faveur de l’Union européenne. Pour 2015, l’évaluation révisée est de 20 milliards d’euros au lieu de 20,7 milliards en loi de finances initiale. La hausse prévue du prélèvement sur recettes en 2016 s’explique essentiellement par le fait que la France devra s’acquitter, en 2016, de façon rétroactive, d’un montant de 0,9 milliard d’euros correspondant à des corrections et rabais forfaitaires accordés à certains États membres au titre des années 2014 et 2015.
Le système actuel de financement de l’Union européenne repose sur quatre types de ressources :
– les ressources propres traditionnelles (RPT), droits de douane et cotisation sucre, pour les lesquelles les administrations nationales agissent en simples intermédiaires pour la perception des ressources au profit de l’Union européenne,
– la ressource dite TVA, calculée par l’application d’un taux d’appel uniforme (0,3 %) à une assiette harmonisée,
– la ressource sur le revenu national brut (RNB), versée par les États membres au prorata de leur RNB dans le RNB total de l’Union européenne pour équilibrer le montant global des dépenses inscrites au budget,
– les recettes diverses.
Le budget européen pour 2016 est le troisième du cadre financier pluriannuel portant sur 2014-2020. Ce cadre pluriannuel prévoit un plafond global de dépenses de 1 024 milliards d’euros sur sept ans.
Par application combinée de l’article 6 et du 4° du I de l’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF), la première partie de la loi de finances doit comporter une évaluation du prélèvement sur recettes rétrocédé à l’Union européenne.
Le prélèvement sur recettes porte uniquement sur les ressources propres TVA et RNB. Le prélèvement sur recettes est donc la somme de deux contributions.
Le reversement des RPT n’est pas traité en prélèvement sur recettes, car la France collecte ces ressources en simple intermédiaire au profit de l’Union européenne.
Depuis 2008, les prélèvements sur recettes, dont celui au profit de l’Union européenne, sont intégrés dans la norme de dépense. Depuis 2011, ils sont intégrés dans la norme dite « zéro valeur », calculée hors charge de la dette et pensions. Les prélèvements sur recettes sont d’ailleurs traités en dépenses dans la comptabilité nationale.
Le tableau qui suit présente l’évolution depuis 2007 du prélèvement sur recettes au profit de l’Union européenne. Pour permettre la comparaison, l’actuel périmètre du prélèvement sur recettes a été retenu dans le tableau ; autrement dit, les RPT, qui ne font plus partie du périmètre du prélèvement sur recettes depuis 2010, sont exclues.
PRÉLÈVEMENT SUR RECETTES AU PROFIT DE L’UNION EUROPÉENNE DEPUIS 2007 (en milliards d’euros) | |||||
Année |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
Montant |
15,4 |
16,6 |
18,3 |
17,5 |
18,2 |
Année |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 (prévision actualisée) |
2016 (prévision) |
Montant |
19,1 |
22,5 |
20,3 |
20,0 |
21,5 |
Prélèvement sur recettes au profit de l’UE « nouveau périmètre » : depuis 2010, les RPT ne sont plus intégrées dans le prélèvement sur recettes. Source : annexe au projet de loi de finances pour 2015 sur les relations financières avec l’Union européenne ; exposé des motifs du projet de loi de règlement pour 2014 ; projet de loi de finances pour 2016. | |||||
Au total, en 2013, la France a versé 21,9 milliards d’euros à l’Union européenne au titre des ressources propres TVA et RNB (en ce compris la correction britannique), dont :
– une contribution au titre de la ressource TVA qui a représenté pour la France 2,8 milliards d’euros en 2013, outre la « correction britannique » de 1,2 milliard d’euros ;
– une contribution au titre de la ressource RNB qui a représenté pour la France 17,8 milliards d’euros en 2013.
En 2014, le prélèvement sur recettes au profit de l’Union européenne a été de 20,3 milliards d’euros.
Pour 2015, l’évaluation révisée est de 20 milliards d’euros au lieu de 20,7 milliards en loi de finances initiale. Néanmoins, le montant final du prélèvement sur recettes demeure difficile à prévoir. Plusieurs budgets rectificatifs ont été, en effet, présentés par la Commission européenne. Il subsiste, par ailleurs, un aléa sur la prévision liée aux corrections d’assiette de TVA et de RNB sur les exercices antérieurs à 2015.
Le prélèvement sur recettes au profit de l’Union européenne est évalué en fonction des prévisions de recettes et de dépenses du budget de l’Union européenne pour 2016, ainsi que d’une hypothèse de solde 2015 reporté sur 2016.
En 2016, l’estimation de la contribution française prend également en compte l’impact de l’entrée en vigueur prévisionnelle de la décision relative au système de ressources propres de l’Union européenne. La France devra notamment s’acquitter, en 2016, de façon rétroactive, des corrections et rabais forfaitaires accordés à certains États membres au titre des années 2014 et 2015. Cet impact, limité à 2016, est estimé par le Gouvernement à 0,9 milliard d’euros sur le prélèvement sur recettes.
Le budget de l’Union européenne pour 2016 n’ayant pas encore été adopté, la prévision de prélèvement sur recettes repose sur une anticipation de l’issue de la procédure budgétaire européenne.
L’évaluation pour 2016 du prélèvement sur recettes au profit de l’Union européenne a, ainsi, été fixée à 21,509 milliards d’euros.
VENTILATION DU PRÉLÈVEMENT SUR RECETTES AU PROFIT DE L’UNION EUROPÉENNE POUR 2016 (en millions d’euros) | |
Ressource TVA |
4 450 |
dont correction britannique |
1 497 |
Ressource RNB |
17 059 |
Total |
21 509 |
Source : évaluations des voies et moyens, tome 1. | |
*
* *
La commission adopte l’article 22 sans modification.
*
* *
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES
À L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES
Article 23
Équilibre général du budget, trésorerie et plafond d’autorisation des emplois
Le présent article est l’article d’équilibre du projet de loi de finances pour 2016, dont il clôt la première partie. Il ne porte que sur le budget de l’État.
Il tend à garantir qu’il ne sera pas porté atteinte, lors de l’examen des dépenses en seconde partie, aux grandes lignes de l’équilibre préalablement défini. Ainsi, la seconde partie du projet de loi de finances ne peut pas être mise en discussion tant que n’a pas été votée et adoptée « la disposition qui arrête en recettes et en dépenses les données générales de l’équilibre » (186).
Le I fixe les prévisions de ressources, détaillées à l’état A annexé au projet de loi de finances, les plafonds de charges et l’équilibre général du budget de l’État présenté dans un tableau.
Le II prévoit le tableau de financement de l’État ainsi que diverses autorisations en matière de recours à l’endettement.
Le III fixe le plafond des autorisations d’emplois rémunérés par l’État, dont le détail est prévu par l’article 28 du présent projet de loi de finances.
Le IV prévoit les modalités d’affectation d’éventuels surplus de recettes. Conformément à l’article 17 de la loi n° 2014-1653 du 29 décembre 2014 de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019, ces surplus seraient affectés en totalité à la réduction du déficit.
Les chiffres clés de l’article d’équilibre du projet de loi de finances pour 2016
Recettes totales nettes : 301,7 milliards d’euros
dont recettes fiscales nettes : 286 milliards d’euros
dont recettes non fiscales : 15,7 milliards d’euros
Prélèvements sur recettes : 68,6 milliards d’euros
Dépenses nettes : 306,2 milliards d’euros
Solde général : – 72 milliards d’euros
dont solde du budget général : – 73,1 milliards d’euros
dont solde des budgets annexes et comptes spéciaux : + 1,1 milliard
Besoin de financement : 200,2 milliards d’euros
dont amortissement de la dette : 127 milliards d’euros
dont déficit à financer : 72 milliards d’euros
dont autres besoins de trésorerie : 1,2 milliard d’euros
Plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État : 1 916 279 équivalents temps plein travaillé
Le 5° de l’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF) dispose que la première partie de la loi de finances comporte une évaluation de chacune des recettes budgétaires.
Tel est l’objet de l’état A, annexé au projet de loi de finances, qui évalue le montant des recettes brutes du budget général, des budgets annexes, des comptes d’affectation spéciale et des comptes de concours financiers.
En application du 4° de l’article 34 de la LOLF précitée, l’état A comporte également une évaluation des prélèvements sur recettes.
Ces éléments sont récapitulés dans le tableau d’équilibre général, mentionné par le 7° de l’article 34 de la LOLF, qui fait apparaître séparément les ressources du budget général, des budgets annexes, et des comptes spéciaux.
Le tableau d’équilibre général comporte également, dans la colonne des ressources, une évaluation des remboursements et dégrèvements afin de faire ressortir le montant net des recettes.
Contrairement aux dépenses, les éléments relatifs aux ressources constituent de simples évaluations et non pas des plafonds à ne pas dépasser. L’autorisation de percevoir les recettes est délivrée par l’article 1er du projet de loi de finances.
Il ressort du tableau d’équilibre que les recettes totales nettes du budget général s’établiraient à 301,7 milliards d’euros et se composeraient de :
– 286 milliards d’euros de recettes fiscales nettes (recettes fiscales brutes de 386,1 milliards d’euros sous déduction des remboursements et dégrèvements estimés à 100,1 milliards d’euros) ;
– et 15,7 milliards de recettes non fiscales.
Le montant net des ressources pour le budget général s’établirait à 233,1 milliards d’euros après les prélèvements sur recettes de 68,6 milliards d’euros, dont 47,1 milliards au profit des collectivités territoriales et 21,5 milliards au profit de l’Union européenne.
Après prise en compte des fonds de concours (3,6 milliards d’euros), le montant net des ressources pour le budget général s’élèverait à 236,6 milliards d’euros.
Les ressources du budget gÉnÉral de l’État (en millions d’euros) | |
Recettes fiscales brutes |
+ 386 130 |
À déduire : remboursements et dégrèvements |
– 100 164 |
Recettes non fiscales |
+ 15 711 |
Prélèvements sur recettes |
– 68 620 |
Fonds de concours |
+ 3 571 |
Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours |
236 628 |
Source : extraits du tableau d’équilibre de l’article 23 du projet de loi de finances pour 2016. | |
Les recettes fiscales sont évaluées à législation constante en fonction de la croissance du produit intérieur (PIB). Ceci permet de déterminer leur « évolution spontanée ». Puis, cette évaluation est corrigée des mesures nouvelles et de périmètre devant entrer en vigueur durant l’année faisant l’objet du projet de loi de finances.
En 2016, les recettes fiscales nettes s’établiraient à 286 milliards d’euros, en hausse de 7,8 milliards d’euros par rapport à la prévision actualisée pour 2015, et de 11,7 milliards d’euros par rapport l’exécution constatée en 2014.
RECETTES FISCALES NETTES (en milliards d’euros) | |||||
Recettes |
2014 Exécution |
2015 Prévision actualisée |
2016 Prévision |
Variation 2015/2016 | |
Impôt sur le revenu |
69,2 |
69,6 |
72,3 |
+ 2,7 | |
Impôt sur les sociétés |
35,3 |
33,5 |
32,9 |
– 0,6 | |
Taxe intérieure sur la consommation des produits énergétiques |
13,2 |
13,9 |
15,6 |
+ 1,7 | |
Taxe sur la valeur ajoutée |
138,4 |
141,5 |
144,7 |
+ 3,2 | |
Autres recettes fiscales |
18,2 |
19,7 |
20,5 |
+ 0,8 | |
Total |
274,3 |
278,2 |
286 |
+ 7,8 | |
Source : annexes du projet de loi de finances pour 2016. | |||||
La hausse des recettes fiscales serait le résultat de deux mouvements contraires :
– une évolution spontanée à la hausse de 9,4 milliards d’euros, d’une part ;
– des mesures nouvelles et de transfert qui pèsent à la baisse pour 1,6 milliard d’euros, d’autre part.
L’estimation de l’évolution spontanée des recettes supposerait que l’élasticité des recettes fiscales à la croissance du PIB soit de 1,3.
Une élasticité des recettes fiscales à la croissance de 1,3
Les prévisions fiscales ne sont pas réalisées par l’application ex ante d’une hypothèse d’élasticité des recettes au taux de croissance prévu. Elles sont déterminées pour chaque impôt, sur la base d’un scénario macroéconomique établi par la direction générale du Trésor. Néanmoins, sur la base de ces prévisions, il en est déduit une élasticité attendue pour l’année suivante. L’élasticité est, en effet, égale au taux de croissance des recettes sur le taux de croissance du PIB en valeur.
En 2016, l’évolution spontanée des recettes fiscales est estimée à 9,4 milliards d’euros, soit une hausse de 3,4 % par rapport à 2015. Or, le PIB devrait croître en valeur de 2,5 % (1 % d’inflation et 1,5 % de croissance en volume).
Cela signifie que l’élasticité des recettes fiscales à la croissance est attendue à 1,36 pour 2016 (arrondi à 1,3 dans les annexes du projet de loi de finances).
Le rendement net de l’impôt sur le revenu devrait être de 72,3 milliards d’euros en 2016 au lieu de 69,6 milliards d’euros en 2015, soit une hausse de 2,7 milliards d’euros.
La hausse de l’impôt sur le revenu résulterait exclusivement de son évolution spontanée estimée à 4 %. Cette hausse serait proportionnellement plus dynamique que la hausse du PIB, ce qui est normal en période de reprise d’activité compte tenu de la progressivité du barème de l’impôt sur le revenu. L’élasticité des recettes de l’impôt sur le revenu s’établirait ainsi à 1,6 pour 2016.
Les mesures nouvelles devraient, en revanche, se compenser puisque la baisse prévue par l’article 2 du présent projet loi de finances est sensiblement égale au montant de la prime pour l’emploi supprimée à compter de 2016, soit environ 2 milliards d’euros. Les autres mesures nouvelles devraient peser marginalement à la baisse, pour environ 0,1 milliard d’euros.
Le rendement net de l’impôt sur les sociétés (IS) devrait encore baisser en 2016 pour s’établir à 32,9 milliards d’euros au lieu de 33,5 milliards d’euros en 2015, soit une baisse de 0,6 milliard d’euros.
Les mesures nouvelles devraient entraîner une baisse de 3,4 milliards d’euros, résultant essentiellement de la suppression de la contribution exceptionnelle sur l’IS (2,6 milliards d’euros).
À l’inverse, l’évolution spontanée de l’IS serait assez forte (+ 8,5 %) sous l’effet conjugué de la reprise de l’activité et de la hausse mécanique de l’assiette liée aux mesures de baisse des charges. La baisse des cotisations patronales décidées dans le cadre du pacte de responsabilité et de solidarité augmente, en effet, le résultat fiscal des entreprises. L’élasticité des recettes d’IS à la croissance serait, ainsi, de 3,4 en 2016.
En 2016, les recettes de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) devraient progresser pour s’établir à 15,6 milliards d’euros au lieu de 13,9 milliards d’euros en 2015, soit une hausse de 12,2 %.
Cette hausse résulterait principalement de la montée en charge de la fiscalité écologique avec l’augmentation pour 1,2 milliard d’euros de la composante carbone de la TICPE (de 14,5 euros la tonne en 2015 à 22 euros en 2016).
L’évolution spontanée de la TICPE serait, en revanche, assez faible (0,4 %).
Le rendement net de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) serait de 144,7 milliards d’euros en 2016, au lieu de 141,5 milliards d’euros en 2015, soit une hausse de 3,2 milliards résultant principalement de l’évolution spontanée, les mesures nouvelles pesant marginalement à la hausse (pour 0,2 milliard d’euros). L’élasticité des recettes de TVA demeurerait cependant inférieure à l’unité (0,8).
Les autres recettes fiscales sont estimées pour 2016 à 20,5 milliards d’euros au lieu de 19,7 milliards en 2015. Cette hausse de 0,8 milliard d’euros résulterait exclusivement de leur évolution spontanée.
En 2016, le produit des recettes non fiscales augmenterait de 1,6 milliard d’euros par rapport à 2015 pour s’établir à 15,7 milliards, notamment en raison de la vente des fréquences hertziennes de 700 MHz. Le produit de cette vente sera, en effet, comptabilisé en recettes non fiscales du fait de la clôture du compte d’affectation spéciale Fréquences prévue par l’article 19 du présent projet de loi de finances.
Selon l’état A annexé au projet de loi de finances, ces recettes non fiscales se décomposeraient en :
– 5,7 milliards d’euros de dividendes ;
– 2,5 milliards d’euros de produits du domaine de l’État ;
– 0,9 milliard d’euros de produits de la vente de biens et services ;
– 1 milliard d’euros de remboursements et d’intérêts des prêts, d’avances et d’autres immobilisations financières ;
– 1,7 milliard d’euros d’amendes, de sanctions, de pénalités, et de frais de poursuite,
– et 4 milliards d’euros de produits divers.
Aux termes du 6° du I de l’article 34 de la LOLF, la loi de finances fixe les plafonds des dépenses du budget général et de chaque budget annexe ainsi que les plafonds des charges de chaque catégorie de comptes spéciaux.
Contrairement aux recettes, les montants ainsi fixés ne sont pas des évaluations mais des plafonds.
Le détail des plafonds de charges est prévu aux états B (répartition des crédits par mission), C (répartition des crédits par budget annexe) et D (répartition des crédits par compte d’affectation spéciale et compte de concours financiers) visés respectivement par les articles 24, 25 et 26 du présent projet de loi de finances.
Le tableau d’équilibre général du présent article mentionne le plafond des charges du budget général, des budgets annexes et des comptes spéciaux.
Les dépenses nettes du budget général en crédits de paiement sont, ainsi, plafonnées à 306,1 milliards d’euros hors fonds de concours (soit 406,3 milliards d’euros de dépenses brutes sous déduction des remboursements et dégrèvements).
Dépenses nettes de l’État
À noter que, dans le tableau d’équilibre général, les prélèvements sur recettes au profit de l’Union européenne et des collectivités territoriales ne sont pas traités pas comme des charges mais comme des moindres ressources. Si l’on retraite le prélèvement sur recettes comme une dépense, le total des dépenses de l’État prévu pour 2016 s’élève à 374,8 milliards d’euros.
Avec les fonds de concours, le montant des charges de l’État ressort à 309,7 milliards pour 2016.
Le solde du budget général ressortirait en 2016 à – 73,1 milliards compte tenu :
– d’un montant de charges de 309,7 milliards d’euros (306,1 milliards hors fonds de concours) ;
– et d’un montant de ressources de 236,6 milliards d’euros (301,1 milliards de recettes totales nettes, desquelles il convient de déduire les prélèvements sur recettes et les fonds de concours à hauteur, respectivement, de 68,6 milliards d’euros et de 3,6 milliards d’euros).
Après prise en compte du solde des budgets annexes (15 millions d’euros), et des comptes spéciaux (1,1 milliard d’euros), le déficit budgétaire de l’État est estimé à 72 milliards d’euros pour 2016.
Passage du solde budgétaire au solde en comptabilité nationale
Le tableau d’équilibre général de l’article d’équilibre est établi selon les principes de la comptabilité budgétaire, c’est-à-dire selon une comptabilité de caisse (encaissements et décaissements). La comptabilité nationale repose, au contraire, sur les droits constatés (créances acquises et dettes certaines).
Pour 2016, aux termes de l’article d’équilibre, le solde budgétaire s’établirait à
– 72 milliards d’euros. Le solde en comptabilité nationale serait, en revanche, de
– 73,5 milliards d’euros compte tenu des retraitements suivants exposés dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances :
– 5,7 milliards d’euros au titre des crédits d’impôts restituables et reportables (dont l’essentiel au titre du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi) ;
+ 5,4 milliards d’euros au titre de l’enregistrement en droits constatés des intérêts d’emprunts (primes et décotes à l’émission et intérêts courus non échus) ;
– 1 milliard d’euros au titre de provisions de contentieux définitifs sur le précompte mobilier : les montants perçus correspondent à des affaires gagnées en appel pour lesquelles l’État avait déjà procédé à des remboursements ;
+ 0,6 milliard d’euros pour la participation de la France dans les organismes internationaux ;
– 0,6 milliard d’euros au titre du rattachement à 2015 en comptabilité nationale des recettes perçues par l’État dans le cadre de la cession des fréquences hertziennes 700 MHz (il est fait l’hypothèse d’un flux budgétaire étalé sur quatre années du produit total de la vente) ;
– 0,4 milliard d’euros au titre des dépenses des fonds de la Caisse des dépôts et consignations au titre des investissements d’avenir ;
+ 0,4 milliard d’euros au titre du rattachement à 2015 des montants déboursés dans le cadre de l’apurement communautaire lié au contentieux sur les aides agricoles et déjà enregistré en intégralité en 2015 en comptabilité nationale ;
– l’étalement en comptabilité nationale du versement des soultes par France Télécom et La Poste au titre de la prise en charge par l’État de leur régime de retraite employeur (+ 0,2 milliard d’euros) ;
– le décalage en droits constatés des reversements de l’État aux collectivités locales du produit des impôts locaux et au retraitement de la cotisation sur la valeur ajoutée en comptabilité nationale (– 0,4 milliard d’euros).
Source : Rapport économique, social et financier.
En vertu du 8° du I de l’article 34 de la LOLF précitée, l’article d’équilibre « comporte les autorisations relatives aux emprunts et à la trésorerie de l’État » et « évalue les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à l’équilibre financier, présentées dans un tableau de financement ».
Le 1° du II du présent article comporte un tableau de financement avec les ressources et les charges de trésorerie de l’État qui concourent à la réalisation de son équilibre financier.
Le besoin de financement pour 2016 est prévu à 200,2 milliards d’euros au lieu de 192,3 milliards d’euros en 2015. Il se décompose ainsi :
– 127 milliards au titre de l’amortissement de la dette (remboursement du capital) ;
– 72 milliards au titre du déficit budgétaire ;
– et 1,2 milliard au titre d’autres besoins de trésorerie.
Il est ainsi prévu de nouvelles émissions de dette à hauteur de 187 milliards d’euros pour couvrir la majeure partie de ce besoin de financement, soit le même montant que prévu par la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015.
Le solde du besoin de financement est couvert par des variations de disponibilité du Trésor et des placements de trésorerie (10,7 milliards d’euros) ainsi que par d’autres ressources (2,5 milliards d’euros).
Le 2° du II du présent article a pour objet d’accorder au ministre des finances et des comptes publics une autorisation globale pour conclure toutes les opérations nécessaires au financement de l’État et à la gestion de sa trésorerie pour l’année 2016.
Par ailleurs, suite à la ratification du traité instituant le Mécanisme européen de stabilité (MES), et à l’instar de ce qui est autorisé pour le Fonds européen de stabilité financière (FESF), le ministre des finances et des comptes publics est également autorisé à effectuer des opérations de trésorerie avec le MES.
Le ministre dispose également d’une autorisation de recourir aux instruments à terme pour la réalisation des opérations de couverture financière des variations de change ou de coûts de matières premières.
Le 3° du II du présent article reprend les dispositions traditionnelles qui ont pour objet d’autoriser le ministre des finances et des comptes publics à prévoir la stabilisation des charges d’emprunts en devises des établissements spécialisés dans le financement à moyen et long terme des investissements.
Enfin, en application du 9° du I de l’article 34 précité de la LOLF, l’article d’équilibre doit également fixer un plafond de la variation de la dette, qui s’établit, au 4° du II du présent article, à 60,5 milliards d’euros en 2016 (au lieu de 70,9 milliards d’euros en 2015).
Ce plafonnement indique la variation nette autorisée, appréciée en fin d’année, de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an, soit de la dette émise sous forme d’obligations assimilables du Trésor (OAT) et de bons du Trésor à taux fixe et à intérêt annuel (BTAN).
En application du 6° du I de l’article 34 précité de la LOLF, la première partie de la loi de finances fixe un plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État. Les emplois sont exprimés en « équivalents temps plein travaillé » (ETPT), notion qui permet de comptabiliser les agents au prorata de leur période de présence et de leur quotité de travail par rapport à un temps plein.
À la différence des plafonds de dépenses qui sont ventilés entre le budget général, chaque budget annexe et chaque catégorie de comptes spéciaux, ce plafond recouvre l’ensemble des emplois rémunérés par l’État.
Le III du présent article fixe ce plafond à 1 916 279 ETPT au lieu de 1 901 099 ETPT en loi de finances pour 2015.
La forte hausse du plafond d’emplois doit être relativisée dans la mesure où le schéma d’emplois de l’État ne prévoit que 8 304 créations nettes de postes, essentiellement au profit des ministères de l’éducation nationale et de la défense.
Il est, en effet, important de rappeler que ce plafond d’emplois n’a pas vocation à être intégralement consommé, comme cela fut le cas en 2013 et 2014. Ce plafond constitue simplement un stock maximal d’emplois à ne pas dépasser en exécution.
|
AUTORISATION, EXÉCUTION ET SOUS-EXÉCUTION DES EMPLOIS POUR L’ÉTAT EN ETPT | ||
Année |
2013 |
2014 |
Plafond d’emplois autorisé |
1 914 921 |
1 906 424 |
Exécution |
1 883 713 |
1 877 359 |
Sous-exécution |
31 208 |
29 065 |
Source : commission des finances. | ||
En seconde partie du présent projet de loi de finances (article 28), les plafonds d’autorisation d’emplois de l’État font l’objet d’une répartition par ministère et par budget annexe, dans la limite du plafond voté en première partie.
Ces plafonds ministériels complètent le dispositif de plafonnement de la masse salariale (crédits du titre 2), conformément au III de l’article 7 de la LOLF aux termes duquel « les crédits ouverts sur le titre des dépenses de personnel sont assortis de plafonds d’autorisation des emplois rémunérés par l’État. Ces plafonds sont spécialisés par ministère ».
*
* *
La commission examine l’amendement I-CF 119 de M. Charles de Courson.
M. Charles de Courson. Cet amendement incite à réaliser une économie supplémentaire de 4 milliards d’euros.
Mme la Rapporteure générale. Malgré toutes les dépenses supplémentaires que vous nous avez proposées ?
M. Éric Alauzet. Environ 10 milliards d’euros…
M. Charles de Courson. Oui : le déficit ne diminuant que de 1 milliard d’euros entre 2015 et 2016, il est temps de se réveiller ! L’article 23 est peu utilisé, mais nous pouvons par ce moyen forcer le Gouvernement à réaliser une telle économie dans la seconde partie du projet de loi de finances.
Suivant l’avis défavorable de la Rapporteure générale, la commission rejette l’amendement I-CF 119.
Puis elle adopte l’article 23 sans modification.
Enfin, elle adopte l’ensemble de la première partie du projet de loi de finances pour 2016, modifiée.