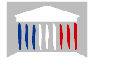______
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 18 février 2016.
RAPPORT
FAIT
AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE, SUR LE PROJET DE LOI (n° 3473)
renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme
et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale,
PAR Mme Colette CAPDEVIELLE et M. Pascal POPELIN,
Députés
——
Voir les numéros : 3510, 3515.
SOMMAIRE
___
Pages
INTRODUCTION 11
I. LA PRÉVENTION ET LA RÉPRESSION DES ATTEINTES À L’ORDRE PUBLIC SONT SOUMISES À DES EXIGENCES NOMBREUSES ET PARFOIS CONTRADICTOIRES 15
A. L’EXIGENCE D’EFFICACITÉ FACE AUX DÉFIS POSÉS PAR LE TERRORISME 15
1. Une menace d’ampleur inédite à la frontière du crime organisé et du terrorisme 15
a. Une menace croissante et protéiforme… 15
b. … qui exige une adaptation des moyens de surveillance et d’investigation des activités liées au crime organisé 17
2. Les moyens financiers à la disposition des organisations terroristes 18
B. L’EXIGENCE DE RESPECT DE LA GARANTIE DES DROITS 20
1. La Cour européenne des droits de l’homme et le ministère public 20
2. L’influence croissante du droit européen sur la procédure pénale 23
3. Une procédure pénale complexe dont les acteurs attendent la réforme 24
II. LES DISPOSITIONS DU PROJET DE LOI 26
A. COMBATTRE LE TERRORISME EN LUTTANT CONTRE LA CRIMINALITÉ ORGANISÉE, LE TRAFIC D’ARMES ET LA CYBERCRIMINALITÉ 26
1. L’élargissement des mesures spéciales d’investigation (articles 1er à 3) 26
2. L’adaptation de la compétence centralisée de la juridiction parisienne en matière d’exécution des peines à l’augmentation du contentieux terroriste (article 4) 29
3. La protection de l’identité et de la sécurité des témoins s’exposant à des risques de représailles dans des affaires sensibles (articles 5 et 6) 30
4. Le renforcement de la lutte contre le trafic d’armes (articles 7 à 10) 31
5. L’adaptation de notre législation à la « cybercriminalité » (article 11) 33
B. MIEUX DÉTECTER ET RÉPRIMER LES ACTIVITÉS FINANÇANT LE TERRORISME 35
C. ADAPTER LES MOYENS ADMINISTRATIFS D’ENQUÊTE ET DE CONTRÔLE À LA MENACE TERRORISTE 36
1. L’extension des pouvoirs des forces de l’ordre à l’occasion des contrôles et vérifications d’identité (article 17) 36
2. La retenue en cas de suspicions sérieuses que le comportement d’une personne est lié à des activités à caractère terroriste (article 18) 37
3. La précision du cadre légal de l’état de nécessité en cas de périple meurtrier (article 19) 38
4. Le contrôle administratif des retours sur le territoire national (article 20) 39
5. L’instauration d’un contrôle des accès aux établissements ou installations accueillant des évènements de grande ampleur (article 21) 41
D. MODERNISER LA PROCÉDURE PÉNALE 41
1. La clarification du rôle du procureur de la République et la modernisation de l’enquête préliminaire (articles 22 et 24) 42
2. Le renforcement de l’autorité fonctionnelle des magistrats sur la police judiciaire (article 23) 44
3. L’encadrement des interceptions pendant l’information judiciaire (article 25) 44
4. L’amélioration de dispositifs ponctuels (articles 26 à 31 et 33) 45
E. DONNER UN CADRE JURIDIQUE AUX CAMÉRAS INDIVIDUELLES PORTÉES PAR LES FORCES DE L’ORDRE 47
III. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR VOTRE COMMISSION DES LOIS 48
A. UN MEILLEUR ENCADREMENT DES MOYENS JUDICIAIRES DE LUTTE CONTRE LE TERRORISME ET LA CRIMINALITÉ ORGANISÉE 48
B. UN RENFORCEMENT DES GARANTIES ASSOCIÉES AUX ENQUÊTES ET CONTRÔLES ADMINISTRATIFS 50
C. UNE PROCÉDURE PÉNALE PLUS EFFICACE ET PLUS RESPECTUEUSE DES DROITS DES PERSONNES 51
D. UNE RÉDUCTION IMPORTANTE DU CHAMP DES ORDONNANCES AU PROFIT DE DISPOSITIONS DISCUTÉES PAR LE PARLEMENT 53
CONTRIBUTION DE M. PATRICK DEVEDJIAN, CO-RAPPORTEUR SUR LA MISE EN APPLICATION DE LA LOI (article 86, alinéa 7, du Règlement) 55
AUDITION DE M. JEAN-JACQUES URVOAS, GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, ET DISCUSSION GÉNÉRALE 57
EXAMEN DES ARTICLES 81
TITRE IER – DISPOSITIONS RENFORÇANT LA LUTTE CONTRE LE CRIME ORGANISÉ, LE TERRORISME ET LEUR FINANCEMENT 81
Chapitre Ier – Dispositions renforçant l’efficacité des investigations judiciaires 81
Article 1er (art. 706-90 à 706-92 du code de procédure pénale) : Perquisitions de nuit dans les locaux d’habitation en matière de terrorisme 81
Après l’article 1er 93
Article 2 (art. 706-95-1 [nouveau] du code de procédure pénale) : Mise en œuvre de dispositifs techniques de proximité de recueil de données techniques de connexion (IMSI catcher) en matière de criminalité et de délinquance organisées 94
Après l’article 2 108
Article 3 (art. 706-96, 706-98 à 706-101 et 706-102-1 à 706-102-8 du code de procédure pénale) : Extension à l’enquête de techniques spéciales d’investigation jusque-là réservées à l’instruction en criminalité et délinquance organisées 111
Article 4 (art. 706-22-1 du code de procédure pénale) : Limitation de la compétence du juge de l’application des peines de Paris aux personnes condamnées pour actes de terrorisme par la juridiction parisienne 120
Article 4 bis (nouveau) (art. 132-45 du code pénal) : Nature des obligations du sursis avec mise à l’épreuve en cas de condamnation pour une infraction terroriste 123
Après l’article 4 bis 126
Article 4 ter (nouveau) (art. L. 811-4 du code de la sécurité intérieure) : Intégration du bureau du renseignement pénitentiaire dans le « deuxième cercle » de la communauté du renseignement 129
Après l’article 4 ter 133
Chapitre II – Dispositions renforçant la protection des témoins 136
Article 5 (art. 306-1 et 400-1 [nouveaux] du code de procédure pénale) : Audition de témoins à huis clos en cas de risques graves de représailles en matière de crimes contre l’humanité ou d’infractions graves 136
Après l’article 5 140
Article 6 (art. 706-62-1 et 706-62-2 [nouveaux] du code de procédure pénale) : Protection de l’identité et de la sécurité des témoins s’exposant à des risques graves de représailles dans certaines affaires (identification par un numéro, attribution d’une identité d’emprunt) 141
Chapitre III – Dispositions améliorant la lutte contre les infractions en matière d’armes et contre la cybercriminalité 154
Article 7 (art. L. 312-3, L. 312-3-1 [nouveau], L. 312-4, L. 312-4-1 et L. 312-16 du code de la sécurité intérieure) : Renforcement du contrôle administratif de l’acquisition et de la détention d’armes 154
Article 8 (art. 706-55, 706-73 et 706-106-1 [nouveau] du code de procédure pénale) : Renforcement des moyens d’investigation judiciaire en matière de lutte contre le trafic d’armes 162
Article 9 (art. L. 317-4, L. 317-5, L. 317-7 et L. 317-8 du code de la sécurité intérieure et art. L. 2339-10 du code de la défense) : Renforcement de la répression pénale de certains faits de trafic d’armes 174
Article 10 (art. 67 bis et 67 bis-1 : du code des douanes) : Extension de certaines techniques spéciales d’enquête des douanes au trafic d’arme (infiltration et « coup d’achat ») 180
Article 11 (art. 113-2-1 [nouveau] du code pénal et art. 43, 52, 382 et 706-73-1 du code de procédure pénale) : Modification des règles de compétence des juridictions en matière de « cybercriminalité » 184
Chapitre IV – Dispositions améliorant la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme 194
Article 12 (art. 421–2–7 [nouveau] du code pénal et art. 706–24–1 et 706–25–1 du code de procédure pénale) : Création d’une infraction réprimant le trafic de biens culturels émanant de théâtres d’opérations de groupements terroristes 194
Après l’article 12 201
Article 13 (art. L. 315–9 [nouveau] et L. 561–12 du code monétaire et financier) : Plafonnement des cartes prépayées et modalités de recueil d’informations relatives à l’utilisation de ces cartes 205
Article 14 (art. L. 561–29–1 [nouveau] et L. 574–1 du code monétaire et financier) : Signalement par TRACFIN aux personnes soumises au dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme de situations générales et individuelles présentant des risques élevés 208
Article 15 (art. L. 561–26 du code monétaire et financier) : Extension du droit de communication de TRACFIN 213
Article 15 bis (nouveau) (art. L. 561–27 du code monétaire et financier) :Extension de l’accès des agents habilités de TRACFIN au fichier des antécédents judiciaires 214
Article 16 (art. 415–1 [nouveau] du code des douanes) : Extension en matière douanière du mécanisme de renversement de la preuve de l’origine illicite des fonds 217
Chapitre V – Dispositions renforçant l’enquête et les contrôles administratifs 220
Article 17 (art. 78–2–2 du code de procédure pénale) : Dispositions relatives à la fouille des bagages lors d’un contrôle d’identité 220
Après l’article 17 226
Article 18 (art. 78–3–1[nouveau] et 78–4 du code de procédure pénale) : Retenue en cas de suspicions sérieuses que le comportement d’une personne est lié à des activités à caractère terroriste 227
Article 19 (art. L. 434–2 [nouveau] du code de la sécurité intérieure, art. L. 4123–12 du code de la défense et art. 56 du code des douanes) : Cadre légal de l’usage des armes par les forces de l’ordre dans le cas d’un périple meurtrier 247
Avant l’article 20 258
Article 20 (art. L. 225–1 à 225–6 [nouveaux] du code des douanes) : Contrôle administratif des retours sur le territoire national 259
Article 21 (art. L. 211–11–1 [nouveau] du code de la sécurité intérieure) : Renforcement des contrôles d’accès aux établissements ou installations accueillant des événements de grande ampleur 277
Après l’article 21 281
TITRE II – DISPOSITIONS RENFORÇANT LES GARANTIES DE LA PROCÉDURE PÉNALE ET SIMPLIFIANT SON DÉROULEMENT 282
Chapitre Ier – Dispositions renforçant les garanties de la procédure pénale 282
Article 22 (art. 39-3 [nouveau] du code de procédure pénale) : Missions du procureur de la République 282
Article 23 (art. 229-1 [nouveau] du code de procédure pénale) : Procédure disciplinaire d’urgence à l’encontre des officiers et agents de police judiciaire 285
Article 24 (art. 77-2, 77-3 et 393 du code de procédure pénale) : Renforcement de la dimension contradictoire de l’enquête préliminaire 287
Article 25 (art. 100-1, 100-2 et 100-7 du code de procédure pénale) : Modalités d’interception de communications au cours de l’instruction 297
Article 25 bis (nouveau) (art. 56, 56-5 [nouveau], 57, 57-1, 60-1, 77-1-1 et 96 du code de procédure pénale) : Protection des documents couverts par le secret du délibéré 301
Après l’article 25 bis 307
Article 26 (art. 179, 186-4 [nouveau], 186-5 [nouveau], 194-1 [nouveau] et 199 du code de procédure pénale) : Améliorations de la procédure en matière de détention provisoire et de renvoi 307
Article 27 (art. L. 1521-18 du code de la défense) : Modalités de garde à vue après une arrestation en mer 310
Article 27 bis (nouveau) (art. 132-57 du code de procédure pénale) : Conversion des peines d’emprisonnement en sursis avec mise à l’épreuve ou en contrainte pénale 312
Article 27 ter (nouveau) (art. 41-7 [nouveau], 99, 99-2-1 et 802-1 [nouveaux] du code de procédure pénale) : Renforcement des garanties applicables en matière de restitution des objets placés sous main de justice à leur propriétaire 313
Article 27 quater (nouveau) (art. 61-3 [nouveau], 63-1, 63-2, 63-4-2, 76-1 [nouveau], 117, 133-1, 135-2, 145-4, 154, 695-17-1[nouveau], 695-27 et 706-88 du code de procédure pénale, art. 323-5 du code des douanes, art. 4 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante, art. 64 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et art. 23-1-1 de l’ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 relative à l’aide juridictionnelle en matière pénale en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna) : Transposition de la directive « C » sur l’accès à l’avocat et la communication avec un tiers 316
Après l’article 27 quater 321
Article 27 quinquies (nouveau) (art. 213 et 215 du code de procédure pénale) : Motivation des arrêts de règlement de la chambre de l’instruction 321
Article 27 sexies (nouveau) (art. 721-1 du code de procédure pénale) : Prise en compte de la surpopulation carcérale dans l’octroi des réductions supplémentaires de peines 322
Article 27 septies (nouveau) (art. 723-15-2 du code de procédure pénale) : Délai offert au juge de l’application des peines pour l’examen d’un aménagement de peine 322
Article 27 octies (nouveau) (art. 762 du code de procédure pénale) : Emprisonnement encouru pour défaut de paiement d’un jour-amende 323
Chapitre II – Dispositions simplifiant le déroulement de la procédure pénale 324
Article 28 (art. 18 du code de procédure pénale) : Habilitation des officiers de police judiciaire 324
Article 29 (art. 148 et 803-7 [nouveau] du code de procédure pénale) : Mise en liberté des personnes placées en détention provisoire 326
Article 30 (art. 390-1, 396 et 527 du code de procédure pénale) : Dispositions simplifiant le jugement 329
Article 31 (art. 74-2, 78-2, 78-2-2 et 78-2-4 du code de procédure pénale) : Recherche des personnes en fuite 333
Article 31 bis (nouveau) (art. L. 218-30, L. 218-55 et L. 218-68 du code de l’environnement) : Procédure d’immobilisation d’un navire polluant 334
Article 31 ter (nouveau) (art. 132-20 du code pénal, art. 705-6 [nouveau] du code de procédure pénale, art. 409-1 du code des douanes, art. L. 612-42 et L. 621-15 du code monétaire et financier, art. L. 464-5-1 du code de commerce, et art. 44 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne) : Sur-amendes 336
Article 31 quater (nouveau) (art. 28 du code de procédure pénale, art. L. 8271-6-1 du code du travail, art. L. 172-8 du code de l’environnement, art. L. 450-4 du code de commerce, art. L. 215-8 du code de la consommation, art. L. 331-21-1 du code de la propriété intellectuelle, art. L. 3341-2 du code de la santé publique et art. L. 234-18 et L. 235-5 du code de la route) : Audition libre par des agents publics détenteurs de pouvoir de police spéciale 337
Article 31 quinquies (nouveau) (art. 41-4, 41-5, 99, 99-2, 373, 481, 493-1 [nouveau], 706-1, 706-143, 706-148, 706-157, 706-160, 706-161, 706-163, 706-164 et 707-1 du code de procédure pénale) : Confiscation des produits du crime et prérogatives de l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués 338
Article 31 sexies (nouveau) (art. 48-1 du code de procédure pénale) : Accès des magistrats chargés du contrôle des fichiers de police judiciaire au fichier des procédures judiciaires 341
Article 31 septies (nouveau) (art. 84-1 [nouveau], 135-2, 141-2, 161-1, 175 et 706-71 du code de procédure pénale) : Dispositions relatives à l’instruction 341
Article 31 octies (nouveau) (art. 230-2, 230-3 et 230-45 [nouveau] du code de procédure pénale) : Plate-forme nationale des interceptions judiciaires 343
Article 31 nonies (nouveau) (art. 308 du code de procédure pénale) : Enregistrement des débats en cour d’assises 344
Article 31 decies (nouveau) (art. 354 et 355 du code de procédure pénale) : Délibéré hors du palais de justice 345
Article 31 undecies (nouveau) (art. 379-2, 379-7 et 380-1 du code de procédure pénale) : Jugement aux assises réputé contradictoire 346
Article 31 duodecies (nouveau) (art. 380-14, 380-15, 500-1, 502 et 505-1 du code de procédure pénale) : Dispositions relatives à l’appel 347
Article 31 terdecies (nouveau) (art. 394 du code de procédure pénale) : Délai de comparution devant le tribunal correctionnel 348
Article 31 quaterdecies (nouveau) (art. 590-1 et 509-2 [nouveaux] du code de procédure pénale) : Déchéance des pourvois en cassation 349
Article 31 quindecies (nouveau) (art. 628–1 du code de procédure pénale) : Spécialisation de la cour d’assises de Paris en matière de jugement des crimes contre l’humanité et les crimes de guerre 350
Article 31 sexdecies (nouveau) (art. 665 du code de procédure pénale) : Modification du délai d’examen des requêtes en dessaisissement 351
Article 31 septdecies (nouveau) (art. 712–17 du code de procédure pénale) : Recours à la visio-conférence pour l’exécution des mandats délivrés par les juges d’application des peines 352
Article 31 octodecies (nouveau) (art. 713–49 [nouveau] du code de procédure pénale) : Caractère exécutoire par provision des décisions mettant à exécution l’emprisonnement contre un condamné qui ne respecte pas sa peine de contrainte pénale 353
TITRE III – DISPOSITIONS DIVERSES 354
Chapitre Ier A (nouveau) – Dispositions relatives aux peines 355
Avant l’article 32 355
Article 32 A (nouveau) (art. 131–5–1 du code pénal) : Ouverture de la possibilité d’une prescription d’un stage de citoyenneté en l’absence du prévenu 357
Article 32 B (nouveau) (art. 131–8 du code pénal) : Ouverture de la possibilité d’une prescription d’un travail d’intérêt général en l’absence du prévenu 358
Article 32 C (nouveau) (art. 131–35–2 [nouveau] du code pénal) : Limitation du coût du stage à la charge du condamné au montant de l’amende de troisième classe 359
Article 32 D (nouveau) (art. 132–54 du code pénal) : Ouverture de la possibilité de prononcer un sursis assorti de l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général en l’absence du prévenu 359
Chapitre Ier – Caméras mobiles 360
Article 32 (art. L. 241-1 [nouveau] du code de la sécurité intérieure) : Caméras mobiles 360
Après l’article 32 367
Chapitre II – Habilitation à légiférer par ordonnances 368
Article 33 : Habilitation à légiférer par ordonnances 368
Chapitre III – Dispositions relatives aux outre-mer 389
Article 34 (art. L. 285-1, L. 286-1, L. 287-1, L. 288-1, L. 344-1, L. 345-1, L. 346-1, L. 347-1, L. 445-1, L. 446-1, L. 447-1 et L. 448-1 du code de la sécurité intérieure ; art. L. 1641-1, L. 1651-1, L. 1661-1, L. 1671-1, L. 2441-1, L. 2451-1, L. 2461-1, L. 2471-1, L. 4341-1, L. 4351-1, L. 4361-1 et L. 4371-1 du code de la défense ; art. L. 743-7-2, L. 753-7-2 et L. 763-7-2 du code monétaire et financier) : Application Outre-mer 389
Article 35 (nouveau) (art. 926–1 du code de procédure pénale) : Création d’un service pénitentiaire d’insertion et de probation à Saint-Pierre-et-Miquelon 390
TABLEAU COMPARATIF 393
PRÉSENTATION DES OBSERVATIONS SUR LES DOCUMENTS RENDANT COMPTE DE L’ÉTUDE D’IMPACT (article 86, alinéa 9, du Règlement) 595
LISTE DES PERSONNES ENTENDUES PAR LES RAPPORTEURS 597
Mesdames, Messieurs,
Trait d’union « entre deux intérêts également puissants, également sacrés, qui veulent à la fois être protégés, l’intérêt général de la société qui veut la juste et prompte répression des délits, l’intérêt des accusés qui est lui aussi un intérêt social et qui exige une complète garantie des droits de la collectivité et de la défense » (1), la procédure pénale est l’objet, en France, depuis une quinzaine d’années, de réformes nombreuses.
Le présent projet de loi, dont l’Assemblée nationale est saisie en première lecture, s’attache à concilier ces deux exigences de sécurité et de liberté, comme l’indique son intitulé qui fait référence à « la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement » ainsi qu’à « l’efficacité » et aux « garanties de la procédure pénale ».
Ce projet a trois objets principaux : renforcer les garanties apportées au justiciable, en particulier au stade de l’enquête initiale, simplifier la procédure pénale dans le sens souhaité par de nombreux professionnels et améliorer l’efficacité de la procédure dérogatoire applicable à la criminalité et à la délinquance organisées.
Résultat de longs mois de consultations conduites sur le sujet par la Chancellerie, il s’articule avec diverses mesures de simplification administrative et réglementaire décidées par le Gouvernement sur proposition de plusieurs groupes de travail, ainsi que l’a précisé M. Robert Gelli, directeur des affaires criminelles et des grâces, devant la mission d’information relative à la réforme de la procédure pénale, confiée à nos collègues Dominique Raimbourg et Patrick Devedjian (2).
Le présent texte est fortement attendu par le monde judiciaire, qui appelle, depuis plusieurs années, à une modernisation et à une adaptation des moyens mis à sa disposition pour remplir ses missions.
Il s’agit, en premier lieu, de mettre notre procédure pénale en conformité avec les exigences progressivement dégagées par la jurisprudence du Conseil constitutionnel – au travers de diverses questions prioritaires de constitutionnalité – et de la Cour européenne des droits de l’homme, et de parachever son adaptation aux règles posées par plusieurs directives communautaires dans le cadre du « programme de Stockholm » (3).
Il convient, en deuxième lieu, de répondre aux besoins de clarté et de lisibilité exprimés par les professionnels, au travers notamment de trois rapports remis à la garde des Sceaux, ministre de la justice, le premier, en novembre 2013, sur la refondation du ministère public sous la présidence de M. Jean-Louis Nadal (4), le deuxième, en février 2014, sur la protection des internautes face à la cybercriminalité, sous l’égide de M. Marc Robert (5), et le dernier, en juillet de la même année, sur la réforme de la procédure pénale par un comité de réflexion dirigé par M. Jacques Beaume (6).
Il importe, en troisième et dernier lieu, de donner aux services enquêteurs et aux magistrats de nouveaux moyens d’investigation et de poursuite des infractions délictuelles et criminelles, lesquelles tendent à devenir de plus en plus sophistiquées et astucieuses, notamment en matière de criminalité et de délinquance organisées.
Alors que le projet de loi était en cours de préparation par le Gouvernement, notre pays a été douloureusement frappé, au mois de novembre 2015, par de nouveaux attentats terroristes, quelques mois après les attaques perpétrées contre le journal Charlie Hebdo à Paris et le magasin Hyper Cacher de Vincennes.
Une fois les premiers enseignements tirés de ces évènements et compte tenu des besoins exprimés par l’ensemble des services impliqués dans la lutte contre la grande criminalité et le terrorisme, il est apparu nécessaire d’ajouter au contenu du texte plusieurs dispositions instituant des mesures préventives de détection et de surveillance de la menace, notamment en matière de contrôles administratifs et de financement du terrorisme. Ces dispositions, justifiées par la nécessité de faire preuve d’une fermeté inébranlable face au terrorisme, sont proportionnées et encadrées, et respectent les valeurs de la République, l’État de droit et nos traditions démocratiques.
Dans ces conditions, vos deux rapporteurs, M. Pascal Popelin sur l’ensemble des dispositions renforçant la lutte contre le crime organisé et le terrorisme à l’exception de celles relatives à leur financement – articles 1er à 11 et 17 à 21 – et Mme Colette Capdevielle sur les dispositions améliorant la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme – articles 12 à 16 – ainsi que celles renforçant les garanties au cours de la procédure pénale et simplifiant son déroulement – articles 22 à 34 –, se sont attachés à en enrichir le contenu afin de doter notre pays de règles de procédure pénale efficaces, équitables et accessibles.
I. LA PRÉVENTION ET LA RÉPRESSION DES ATTEINTES À L’ORDRE PUBLIC SONT SOUMISES À DES EXIGENCES NOMBREUSES ET PARFOIS CONTRADICTOIRES
Les règles régissant la prévention et la répression des atteintes susceptibles d’être portées à l’ordre public doivent concilier une triple exigence au cœur des dispositions du présent projet de loi : l’exigence d’efficacité, pour donner aux services d’enquête et aux magistrats les outils adaptés au nouveau visage du crime organisé et du terrorisme (A) ; l’exigence de respect de la garantie des droits, conformément aux règles posées en la matière par le droit conventionnel et communautaire (B) ; l’exigence de simplification face à une procédure pénale devenue, au fil des ans, de plus en plus lourde (C).
La première de ces exigences, attendue par de nombreux enquêteurs et magistrats, vise à doter notre pays d’outils d’investigation plus efficaces face à la menace actuelle de la grande criminalité organisée (1) et aux moyens financiers dont disposent les organisations terroristes (2).
Le terrorisme et ses adjuvants, le crime organisé et le trafic d’armes, représentent une menace d’ampleur inédite dans notre pays et en Europe. Phénomène multiforme, alimenté par des évènements nationaux et internationaux, il s’est douloureusement exprimé sur notre territoire à plusieurs reprises, notamment avec les tueries de Toulouse et Montauban en mars 2012, l’attaque contre Charlie Hebdo et l’Hyper Cacher de Vincennes en janvier 2015 et les attentats coordonnés, en novembre dernier, en plusieurs lieux de l’Île-de-France.
À la différence des précédents mouvements, le terrorisme actuel se nourrit de filières djihadistes issues de l’afflux de combattants étrangers sur les territoires syrien et irakien en décomposition et dont la France constitue l’un des principaux pourvoyeurs. Plus largement, ainsi que l’a démontré la commission d’enquête du Sénat sur l’organisation et les moyens de la lutte contre les réseaux djihadistes en France et en Europe (7), on assiste à une augmentation préoccupante du nombre de personnes radicalisées, développant une vision dévoyée de l’islam, et nihilistes, en raison d’un « individualisme forcené » (8) s’articulant autour d’un imaginaire du héros, de la violence et de la mort.
Le terrorisme djihadiste se présente sous des formes renouvelées, allant au-delà des actions des organisations terroristes comme Al-Qaïda et ses groupes affiliés – Al-Qaïda dans la péninsule arabique ou Al-Qaïda au Maghreb islamique – ou Daech. À ces menaces s’ajoutent celles des djihadistes revenant de la zone irako-syrienne dont la dangerosité, qu’ils soient endurcis, repentants ou traumatisés, est difficile à évaluer, ou encore celles des individus « velléitaires » qui n’ont pas réussi à rejoindre un théâtre d’opérations étranger.
La commission d’enquête de l’Assemblée nationale sur la surveillance des filières et des individus djihadistes a relevé que les terroristes « n’ont plus recours à l’explosif mais aux armes à feu, voire aux armes blanches, d’autant plus faciles d’accès que de nombreux djihadistes ont un passé de délinquant, ce qui conduit de nombreux observateurs à souligner la perméabilité entre le monde de la délinquance et celui du terrorisme (…) et entre les réseaux de criminalité organisée et le terrorisme ». Devant elle, M. Bernard Cazeneuve, ministre de l’Intérieur, a souligné que la « lutte contre le trafic d’armes et l’utilisation des fonds provenant de la traite des êtres humains » était un « domaine d’action absolument stratégique » car ces activités « peuvent contribuer à alimenter des activités terroristes » (9). Ainsi que l’a indiqué M. Jean-Jacques Urvoas, garde des Sceaux, ministre de la justice, lors de son audition par votre commission des Lois le mercredi 10 février, « depuis 2014, 6 000 armes sont saisies chaque année et la mise en œuvre de l’état d’urgence a permis d’accroître notablement ce nombre, 212 infractions à la législation sur les armes [faisant] actuellement l’objet de poursuites ». Il a également fait observer « que les auteurs des récents attentats étaient lourdement armés » (10).
Enfin, les terroristes s’organisent bien souvent non pas en filières organisées mais en microcellules soutenues par des complicités et des soutiens logistiques (fourniture d’armes, de véhicules…). Maîtrisant parfaitement l’usage des nouvelles technologies, ils communiquent en se jouant des techniques traditionnelles de surveillance, notamment les interceptions de correspondances.
En décembre 2015, près de 680 personnes étaient mises en cause dans des procédures judiciaires d’enquêtes et d’informations pour des faits de terrorisme, contre moins de 500 avant les attentats de novembre. Si, à la même date, le nombre d’individus impliqués dans le djihad irako-syrien et suivis par les services de renseignement semblait se stabiliser entre 1 750 et 1 780 personnes (11), il aurait dépassé, au mois de février 2016, les 2 000 personnes, dont 1 012 se seraient rendues sur place et 597 s’y trouveraient toujours, soit une augmentation de plus de 57 % par rapport au mois de janvier 2015 (12).
b. … qui exige une adaptation des moyens de surveillance et d’investigation des activités liées au crime organisé
La grande diversité des profils des djihadistes et des individus radicalisés, le perfectionnement des modes opératoires utilisés pour passer à l’acte et la porosité croissante entre la grande criminalité, le trafic d’armes et le terrorisme exigent de faire évoluer les moyens d’investigation à la disposition des services de police judiciaire et administrative.
Notre pays a déjà donné, ces trente dernières années, aux services d’enquête et aux magistrats de nouveaux moyens juridiques destinés à leur permettre de mieux anticiper et détecter les menaces terroristes pesant sur notre pays, démanteler les réseaux qui les portent et, le cas échéant, réprimer sévèrement les atteintes portées à l’ordre public : création d’une compétence concurrente nationale des juridictions pénales parisiennes en matière de terrorisme et application à ce domaine de règles procédurales dérogatoires (13), répression de l’association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste (14), extension des règles procédurales dérogatoires (garde à vue prolongée à 6 jours (15), intervention de l’avocat différée à la 72e heure (16), allongement des délais de prescription de l’action publique (17)…), élargissement de la poursuite aux délits terroristes commis à l’étranger par des Français (18).
Cette législation a été récemment enrichie de nouvelles dispositions par la loi n° 2014-1353 du 13 novembre 2014 renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme. Il s’agit notamment, sur le plan administratif, de la création d’un dispositif d’interdiction de sortie du territoire et du renforcement des mesures d’assignation à résidence et, sur le plan judiciaire, de la création d’un délit d’entreprise terroriste individuelle, de la facilitation des perquisitions de données stockées à distance ou sur des terminaux mobiles, de la généralisation de l’enquête sous pseudonyme à l’ensemble de la criminalité et de la délinquance organisées ou de l’extension de la captation de données informatiques à celles reçues ou émises par des périphériques audiovisuels de type Skype.
Enfin, avec la loi n° 2015-912 du 24 juillet 2015 relative au renseignement, le législateur a doté notre pays d’un cadre juridique complet et cohérent de surveillance administrative des activités susceptibles de porter atteinte à certains intérêts protégés, par la mise en place d’un régime d’autorisation des techniques de recueil de renseignement sous un double contrôle administratif et juridictionnel.
Il est nécessaire de parachever cet édifice en donnant aux enquêteurs et aux magistrats les moyens dont ils ont besoin pour faire face aux nouvelles formes de terrorisme et à ses corollaires, le crime organisé et le trafic d’armes, près de dix années après l’adoption de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité. La loi dite « Perben II » avait elle-même adapté notre droit aux évolutions de la grande criminalité en améliorant et en renforçant l’efficacité des enquêtes pénales.
Cela est d’autant plus nécessaire que, si les outils judiciaires autorisés par la procédure dérogatoire commune à la délinquance et à la criminalité organisées s’appliquent à la lutte antiterroriste, ces outils ne recouvrent pas la totalité de ceux récemment mis à la disposition des services de renseignement. De surcroît, certains d’entre eux, en l’état du droit, ne peuvent être utilisés que lorsqu’une information judiciaire est ouverte, et pas en enquête de flagrance ou préliminaire, alors même que la part de l’instruction, obligatoire pour les affaires criminelles, dans les affaires pénales donnant lieu à des poursuites est tombée à moins de 3 % et que le rôle du procureur de la République dans les réponses pénales apportées à la délinquance et à la criminalité n’a cessé de croître.
L’une des clés de la prévention et de la répression du terrorisme est de parvenir à entraver les moyens financiers dont disposent les organisations pour attirer et maintenir en leur sein des combattants et organiser leurs actions criminelles.
Ce financement prend deux formes principales :
– un financement « macroéconomique » des organisations terroristes, qui s’appuie sur des moyens importants ;
– des circuits de micro-financements, mobilisant des sommes modestes, utilisés par les combattants étrangers pour rejoindre des groupes structurés.
Plusieurs initiatives récentes prises au niveau international ont pour objectif de tarir le financement international de Daech, sur le modèle de ce qui avait été entrepris contre Al Quaida après les attentats du 11 septembre 2001.
Initiatives internationales concernant la lutte contre le financement de Daech
– résolution 7804 de la Ligue des États arabes du 7 septembre 2014 ;
– déclaration de Paris du 15 septembre 2014 (Irak - Conférence internationale pour la paix et la sécurité) ;
– déclaration du groupe d’action financière (GAFI) du 24 octobre 2014 sur la lutte contre le financement de Daech qui contient des préconisations très précises portant notamment sur la coopération internationale, le contrôle des fonds transitant par les ONG ou l’accès de Daech au système financier international ;
– déclaration de Manama du 9 novembre 2014 (émanant de 29 pays et de plusieurs organisations régionales et internationales dans le cadre de la coalition internationale contre Daech).
En revanche, le repérage des micro-flux est particulièrement délicat, nombre de ces transactions s’effectuant en liquide. Ainsi, et malgré le fait que les professionnels du secteur financier, notamment les banques, ont été alertés et formés, peu de signalements sont effectués auprès de la justice pour des motifs liés au financement du terrorisme, et ceux qui le sont ne sont pas aisément exploitables. Comme l’a noté le rapport du sénateur Jean-Pierre Sueur, « l’essentiel de ces signalements concernent des associations cultuelles ou caritatives, parfois des commerces, mais n’aboutissent pas nécessairement en raison de la difficulté de prouver la destination réelle des fonds et sont donc traités sous la qualification d’abus de confiance et non de financement du terrorisme. » (19)
Les dispositifs juridiques européens et français s’organisent pour s’adapter aux nouvelles formes de financement du terrorisme. Ainsi, la Commission européenne a présenté le 2 février 2016 un plan d’action destiné à lutter contre le financement du terrorisme, qui s’inspire en grande partie du programme présenté par les autorités françaises en décembre 2015. Il s’articule autour de deux axes :
– prévenir les mouvements de fonds et repérer le financement du terrorisme, ce qui supposera une modification substantielle du « quatrième paquet anti–blanchiment » afin de rajouter des contrôles obligatoires aux flux financiers provenant de pays tiers dont le cadre de lutte contre le financement du terrorisme comporte des carences, de mettre en place des registres nationaux centralisés des comptes bancaires et d’inclure les plateformes de change de monnaies virtuelles dans le champ d’application des directives européennes. La Commission devrait également proposer la définition commune de l’infraction de blanchiment et permettre aux autorités d’agir en cas de soupçons d’activité illicite sur des faibles montants ;
– déstabiliser les sources de revenus utilisées par les organisations terroristes, en s’attaquant à leur capacité à lever des fonds et en apportant une assistance technique aux pays dans lesquels elles se financent.
Dès mars 2015, le Gouvernement français a mis en place un plan d’action national contre le financement du terrorisme, dont un premier bilan a été établi en novembre 2015 :
– l’abaissement du plafond de paiement en espèces de 3 000 à 1 000 euros est effectif depuis le 1er septembre ;
– le signalement à TRACFIN de tout dépôt ou retrait d’espèces supérieur à 10 000 euros est en place depuis le 1er janvier 2016 ;
– une prise d’identité pour toute opération de change d’un montant supérieur à 1 000 euros est effective depuis le 1er janvier 2016 ;
– l’obligation déclarative de transferts de capitaux par fret devrait entrer en vigueur au 1er trimestre 2016 ;
– le recul de l’anonymat dans l’usage des cartes prépayées est prévu pour l’année 2016.
En outre, les capacités de gel des avoirs terroristes seront renforcées par la loi sur la transparence de la vie économique qui devrait être bientôt présentée en Conseil des ministres. Enfin, la lutte contre le commerce illicite des biens culturels sera facilitée par la loi relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine qui a été adoptée, en première lecture, par l’Assemblée nationale le 6 octobre 2015 et par le Sénat le 16 février 2016.
L’exigence de respect de la garantie des droits des justiciables, qui est aussi une expression du principe de séparation des pouvoirs et d’indépendance de la magistrature, a été fortement affirmée par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme en ce qui concerne la procédure pénale française et, plus particulièrement, le rôle dévolu en son sein au ministère public (1). Les directives communautaires en matière pénale insistent sur le principe de l’accès à un avocat (2). Il résulte de ce double mouvement, auquel s’ajoute la nécessité de simplifier une matière marquée par l’inflation normative depuis deux décennies, une attente générale en faveur d’une réforme de la procédure pénale (3).
La tradition juridique française de séparation de l’enquête de police – par nature inquisitoriale, par conséquent secrète et sourde aux demandes des personnes qui ne sont pas encore les « parties » – de la phase judiciaire –contradictoire et au cours de laquelle s’expriment pleinement les droits de la défense – conduit à exclure de la procédure pénale stricto sensu les opérations de vérification des faits, de collecte des preuves et de qualification de l’infraction. Le droit de la défense, par essence processuel, ne se rapporte bien qu’au droit du procès, c’est-à-dire en réalité de l’audience. La chambre criminelle de la Cour de cassation l’a affirmé sans détour dans un arrêt du 6 mars 2013 (n° 12-90.078) :
« [Les] dispositions légales critiquées, qui permettent au procureur de la République, lorsqu’il estime que les faits portés à sa connaissance constituent un délit, de décider que la poursuite se fera, après enquête préliminaire, par la voie de la citation directe devant le tribunal, sans ouverture d’information, ne modifient pas le déroulement du procès pénal, et ne privent pas la personne d’un procès juste et équitable, celle-ci, quant au respect des droits de la défense, ayant, devant la juridiction, des garanties équivalentes à celles dont elle aurait bénéficié si l’affaire avait fait l’objet d’une information. »
Les magistrats du parquet, au même titre que ceux du siège, représentent l’autorité judiciaire, « gardienne de la liberté individuelle » au sens de l’article 66 de la Constitution. La tradition française considère que « le procureur de la République bénéficie dans l’exercice de ses attributions d’une délégation de la loi qui lui confère sa légitimité. Il agit non pas au nom de l’État ou du Gouvernement mais au nom de la République à qui l’ensemble des citoyens a délégué sa souveraineté » (20).L’article 31 du code de procédure pénale indique que « le ministère public exerce l’action publique et requiert l’application de la loi, dans le respect du principe d’impartialité auquel il est tenu ». Ni le garde des Sceaux, ni le procureur général ne peuvent déclencher à sa place l’action publique.
Pour autant, le procureur de la République reste organiquement dépendant du pouvoir exécutif à travers son mode de nomination et le déroulement de sa carrière. Jusqu’à récemment, il l’était aussi du fait de l’exercice du pouvoir hiérarchique du garde des Sceaux.
En modifiant l’article 65 de la Constitution, la révision du 27 juillet 1993 a octroyé au Conseil supérieur de la magistrature (CSM) une compétence d’avis sur les propositions établies par le garde des Sceaux pour les nominations des magistrats du parquet, à l’exception des « emplois auxquels il est pourvu en conseil des ministres », c’est-à-dire les emplois de procureur général près la Cour de cassation et de procureur général près une cour d’appel. La loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 a supprimé cette réserve en étendant les compétences du CSM à tous les magistrats du parquet. En outre, le CSM exerce, depuis 1993, une compétence disciplinaire consultative à l’égard des magistrats du parquet, mais le Gouvernement reste seul à même de prononcer une sanction.
Par ailleurs, le garde des Sceaux a longtemps pu adresser aux parquets des instructions individuelles écrites et versées au dossier (21). Le procureur de la République était tenu de les exécuter, mais pouvait développer « librement les observations orales qu’il [croyait] convenables au bien de la justice » (22). La loi n° 2013-669 du 25 juillet 2013, relative aux attributions du garde des sceaux et des magistrats du ministère public en matière de politique pénale et de mise en œuvre de l’action publique, a mis fin à cette prérogative de direction de l’action publique dont jouissait le ministre de la Justice, consacrant l’impartialité du ministère public au regard des parties.
Cette construction juridique entre en contradiction avec la notion de « procès équitable » protégée par divers instruments conventionnels et, notamment, l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La cour de Strasbourg considère que ce principe a vocation à couvrir l’intégralité de la procédure, y compris les phases de l’enquête et de l’instruction judiciaire « si, et dans la mesure où, son inobservation initiale risque de compromettre gravement l’équité du procès et où les preuves obtenues durant cette phase déterminent le cadre dans lequel l’infraction imputée sera examinée au procès » (23). C’est pourquoi la jurisprudence de la Cour européenne estime que « certes, l’article 6 a pour finalité principale, au pénal, d’assurer un procès équitable devant un tribunal compétent pour décider du bien-fondé de l’accusation, mais il n’en résulte pas que [la Cour] se désintéresse des phases qui se déroulent avant la procédure de jugement » (24).
La tradition française est surtout critiquée par les juges de Strasbourg à travers le prisme de l’article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, relatif au droit à la liberté et à la sûreté.
Dans un arrêt du 10 juillet 2008, Medvedyev et autres c. France, la France a été condamnée pour l’arraisonnement d’un navire cambodgien, le Winner, dont l’équipage se livrait au trafic de stupéfiants. La retenue imposée sous le contrôle du procureur de la République a été sanctionnée au motif que ce magistrat ne pouvait être regardé comme une autorité judiciaire. Par une jurisprudence constante depuis l’arrêt Schiesser c. Suisse du 4 décembre 1979, la Cour exige du juge « des garanties d’indépendance à l’égard de l’exécutif et des parties, ce qui exclut notamment qu’il puisse agir par la suite contre le requérant dans la procédure pénale, à l’instar du ministère public ». La grande chambre de la Cour a été appelée à se prononcer sur la même affaire le 29 mars 2010 : sans explicitement retirer au parquet français la qualité d’autorité judiciaire, elle a rappelé que le contrôle juridictionnel des arrestations et détentions implique nécessairement une double indépendance à l’égard du pouvoir exécutif ainsi qu’à l’égard des parties et qu’il est donc, à ce dernier titre, incompatible avec l’exercice des poursuites. Cette position a été confirmée par l’arrêt Moulin c. France du 23 novembre 2011.
Le programme de La Haye (2004-2009), portant application des orientations du Conseil européen de Tampere (15-16 octobre 1999), s’était déjà traduit, dans la matière pénale, par l’adoption de près de quinze textes de coopération judiciaire et autant de textes de rapprochement du droit pénal matériel, principalement des décisions et des décisions-cadre, parmi lesquelles celles relatives au mandat d’arrêt européen et à la mise en place d’Eurojust.
L’intervention de l’Union européenne dans la matière pénale s’est accrue avec l’adoption du traité de Lisbonne. Mettant fin à l’existence des « piliers » de compétence de l’Union européenne qui structuraient le cadre communautaire depuis 1992, il a soumis les textes relatifs à la matière pénale, auparavant adoptés à l’unanimité du Conseil avec avis simple du Parlement européen, à la procédure législative ordinaire : intervention du Parlement européen, vote du Conseil à la majorité qualifiée, édiction de règlements ou de directives, contrôle de la Cour de justice de l’Union européenne.
Outre cet aspect procédural, l’élaboration de directives en matière pénale résulte de l’ambition toujours réaffirmée d’une reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires entre les États membres de l’Union européenne. Cette reconnaissance suppose une confiance mutuelle dans le système de chacun, qui ne peut elle-même résulter que de normes de fond et de procédure communes.
Selon cette logique, le Conseil européen a adopté, le 11 décembre 2009, le « programme de Stockholm », qui a fixé le cadre de travail de l’Union européenne dans le domaine de la justice, de la liberté et de la sécurité pour la période allant de 2010 à 2014. Il préconise notamment l’adoption d’une approche fondée sur la reconnaissance des droits (aux victimes de la criminalité, aux personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales, etc.), sur une mise en cohérence des sanctions pénales et sur la poursuite de la reconnaissance mutuelle et de la confiance mutuelle dans le domaine de la justice.
La « feuille de route »
Une « feuille de route » adoptée par résolution du Conseil le 30 novembre 2009 a été annexée au programme de Stockholm. Elle a invité la Commission européenne à procéder par étapes sur les points suivants :
– le droit à la traduction et à l’interprétation, qui a donné lieu à la directive 2010/64/UE du 20 octobre 2010 relative aux droits à l’interprétation et à la traduction dans le cadre des procédures pénales (dite « directive A ») ;
– le droit d’être informé de ses droits et des accusations portées contre soi, qui a donné lieu à la directive 2012/13/UE du 22 mai 2012 relative au droit à l’information dans le cadre des procédures pénales (dite « directive B ») ;
– le droit à l’assistance juridique et à l’aide judiciaire, ainsi que le droit de communiquer avec ses proches, ses employeurs et les autorités consulaires, points réunis dans la directive 2013/48/UE du 22 octobre 2013 relative au droit d’accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales et des procédures relatives au mandat d’arrêt européen, au droit d’informer un tiers dès la privation de liberté et au droit des personnes privées de liberté de communiquer avec des tiers et avec les autorités consulaires (dite « directive C ») ;
– la question des garanties particulières pour les personnes soupçonnées ou poursuivies qui sont vulnérables a donné lieu à la publication par la Commission européenne d’une proposition de directive relative à la mise en place de garanties procédurales en faveur des enfants soupçonnés ou poursuivis, dont l’adoption semble proche ;
– un livre vert sur la détention provisoire, publié le 14 juin 2011.
Le Parlement a adopté la loi n° 2013-711 du 5 août 2013 portant diverses dispositions d’adaptation dans le domaine de la justice en application du droit de l’Union européenne et des engagements internationaux de la France, qui a assuré la transposition de plusieurs textes européens relatifs à la matière pénale, dont la « directive A ».
La « directive B » a fait l’objet de la loi n° 2014-535 du 27 mai 2014 portant transposition de la directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, relative au droit à l’information dans le cadre des procédures pénales.
Enfin, la « directive C » a d’ores et déjà partiellement été transposée à l’occasion de la loi du 27 mai 2014, mais certaines de ses stipulations – notamment au regard de l’accès à un avocat et du droit de communiquer avec un tiers – restent à incorporer en droit interne.
Le 23 décembre 2015, la garde des Sceaux, ministre de la Justice, le ministre des Finances et le ministre de l’Intérieur ont présenté une communication au Conseil des ministres à propos du présent projet de loi. Le 6 janvier 2016, celui-ci a été transmis au Conseil d’État qui a émis un avis favorable par délibération du 28 janvier, pour une adoption en Conseil des ministres et un dépôt sur le Bureau de l’Assemblée nationale le 3 février. Si cette procédure paraît excessivement rapide, il convient de rappeler que les interrogations à propos de la procédure pénale n’ont pas été brutalement révélées au grand jour : les dispositions du titre II du projet de loi soumis à l’Assemblée nationale ont fait l’objet de travaux préparatoires particulièrement approfondis.
Compliquée par dix-sept lois de réforme depuis 1999 et révisée par touche successive, la procédure pénale a profondément évolué en deux décennies. L’apparition d’un nouvel acteur en la personne du juge des libertés et de la détention, la critique sourde à laquelle a été confronté le juge d’instruction dans la deuxième moitié de la décennie 2010, la montée en puissance de l’enquête préliminaire et du ministère public avant la remise en cause par les jugements de la Cour européenne des droits de l’homme, les manifestations régulières en faveur d’une anticipation de l’accès au dossier d’enquête, dessinent un paysage juridique complexe que ne simplifie pas le dénuement financier dans lequel se trouvent les juridictions.
Confronté à cet environnement instable, le système pénal français a engagé une réflexion de long terme :
– en novembre 2013, une commission présidée par l’ancien procureur général près la Cour de cassation, M. Jean-Louis Nadal, a remis à la garde des Sceaux un rapport destiné à « Repenser le ministère public » pour tenir compte des différents enjeux touchant au statut et aux missions du procureur de la République ;
– en juillet 2014, M. Jacques Beaume, procureur général, a produit un « Rapport sur la procédure pénale » de portée plus large et abordant les questions de l’enquête, du droit des victimes, de la garde à vue ou encore de la fonction de l’avocat ;
– tout au long de l’année 2015, des consultations ont été menées au sein de la Chancellerie, avec les services de police et de gendarmerie et avec les syndicats et organisations professionnelles pour évaluer l’opportunité de transcrire dans la loi les recommandations des deux rapports susmentionnés.
La qualité de la concertation menée par la Chancellerie a pour conséquence l’approbation générale que suscitent les dispositions du titre II du projet de loi chez l’ensemble des acteurs de la procédure pénale, dont vos rapporteurs ne peuvent que se réjouir, même si des compléments pourront être utilement apportés par voie d’amendement au cours de la discussion parlementaire.
Organisé autour de trois titres, le projet de loi poursuit principalement cinq objectifs. Au titre Ier, consacré au crime organisé, au terrorisme et à leur financement, les chapitres Ier à III tendent à renforcer la lutte contre le crime organisé, le trafic d’armes et la « cybercriminalité » (A), le chapitre IV vise à améliorer la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (B) et le chapitre V renforce de manière permanente les pouvoirs de police administrative principalement dans le cadre de la prévention des menaces terroristes (C). Les titres II et III sont, pour l’essentiel, consacrés à la modernisation de la procédure pénale (D) tandis que l’article 32 autorise les forces de l’ordre à s’équiper de caméras individuelles en intervention (E).
A. COMBATTRE LE TERRORISME EN LUTTANT CONTRE LA CRIMINALITÉ ORGANISÉE, LE TRAFIC D’ARMES ET LA CYBERCRIMINALITÉ
Les trois premiers chapitres du projet de loi, consacrés respectivement aux moyens d’investigation de l’enquête et de l’information judiciaires, à la protection des témoins et au contrôle des armes ainsi qu’à la lutte contre leur trafic et contre la cybercriminalité, tendent à renforcer l’efficacité de la lutte contre la criminalité organisée et notamment le terrorisme.
Certaines règles de compétences particulières et certaines techniques spéciales d’investigation peuvent déjà s’appliquer en matière de criminalité et de délinquance organisées, conformément au titre XXV du livre IV du code de procédure pénale. Il s’agit, notamment, des opérations d’infiltration (articles 706-81 à 706-87), de l’enquête sous pseudonyme (article 706-87-1), du prolongement de la garde à vue jusqu’à 4 jours en matière de criminalité organisée et 6 jours en matière terroriste (contre 2 jours en droit commun), avec l’intervention différée de l’avocat jusqu’à la 72e heure (articles 706-88 et 706-88-1), des perquisitions de nuit (articles 706-89 à 706-94), des écoutes téléphoniques dans le cadre d’une enquête préliminaire ou de flagrance (25) (article 706-95), des sonorisations et fixations d’images de certains lieux ou véhicules (articles 706-96 à 706-102), de la captation de données informatiques (706-102-1 à 706-102-9) ou des mesures conservatoires (article 706-103).
L’ensemble de ces règles dérogatoires sont applicables à l’enquête, la poursuite, l’instruction et le jugement des crimes et des délits mentionnés par l’article 706-73 (terrorisme, meurtre, tortures et actes de barbarie commis en bande organisée, trafic de stupéfiants…). Certaines infractions, qui ne portent pas une atteinte grave à la sécurité, à la dignité ou à la vie des personnes, mentionnées par l’article 706-73-1, se voient appliquer l’ensemble de ces dispositions à l’exclusion de celles relatives au prolongement de la garde à vue et à l’intervention différée de l’avocat, susceptibles d’être les plus attentatoires aux droits et libertés (escroquerie en bande organisée, travail dissimulé…). D’autres infractions économiques et financières ne se voient appliquer qu’une partie de ces dispositions dans les conditions prévues par les articles 706-1-1 et 706-1-2 (certaines atteintes à la probité, délits de fraude fiscale commis en bande organisée ou aggravés, certains délits douaniers, grande délinquance économique et financière…).
Les conditions d’application de ce régime procédural dérogatoire présentent cependant plusieurs lacunes que les articles 1er à 3 du projet de loi tendent à réparer.
En premier lieu, l’article 1er autorise, aux articles 706-90 à 706-92, la perquisition de nuit dans les locaux d’habitation, en cas d’urgence, lorsqu’est en cause une infraction de terrorisme et « afin de prévenir un risque d’atteinte à la vie ou à l’intégrité physique », dans le cadre d’une enquête préliminaire, sur autorisation préalable du juge des libertés et de la détention (JLD) et, dans le cadre d’une information judiciaire, sur décision du juge d’instruction. De telles perquisitions ne sont possibles, dans le droit actuel, que dans le cas où un crime ou un délit relevant de la criminalité organisée vient de se commettre ou, lors d’une instruction, dans les hypothèses d’urgence limitativement énumérées par les 1° à 3° de l’article 706-91 (flagrance, risque de disparition de preuves, soupçon de commission d’un crime ou délit relevant de la criminalité organisée).
Cette évolution respecte les exigences posées par le Conseil constitutionnel depuis la loi « Perben II » en continuant de subordonner ces perquisitions à l’autorisation d’un magistrat du siège, en les cantonnant à certaines situations particulièrement graves et en les entourant des mêmes garanties procédurales que celles existantes.
En deuxième lieu, l’article 2 insère un nouvel article 706-95-1 au sein du code de procédure pénale afin d’autoriser, en enquête comme en instruction, pour une durée maximale d’un mois renouvelable une seule fois, le recours à des dispositifs techniques de proximité de recueil de certaines données de connexion, dits « IMSI catcher », afin de recueillir les seules données « permettant l’identification d’un équipement terminal ou du numéro d’abonnement de son utilisateur ».
Cette disposition, qui constitue la sécurisation juridique de pratiques aujourd’hui mises en œuvre sous l’empire des dispositions générales de l’article 81 du code de procédure pénale, permet de confier aux services de police judiciaire des outils d’investigation identiques à ceux récemment donnés aux services de renseignement par la loi n° 2015-912 du 24 juillet 2015 relative au renseignement. Là encore, le recours à cette technique est strictement encadré et soumis à l’autorisation du JLD ou du juge d’instruction, en tout état de cause d’un magistrat du siège, sauf en cas d’urgence où l’autorisation pourra être délivrée, pour une durée limitée à 24 heures, par le procureur de la République.
En dernier lieu, l’article 3 étend à l’enquête plusieurs techniques spéciales d’investigation applicables à la criminalité et à la délinquance organisées – les sonorisations et fixations d’images de certains lieux et véhicules et la captation de données informatiques – jusque-là réservées à l’instruction par les sections VI et VI bis du chapitre II du titre XXV du livre IV du code de procédure pénale.
L’autorisation délivrée par le juge d’instruction lors d’une information judiciaire le serait, pour les enquêtes, par le JLD sur requête du procureur de la République. La durée de mise en œuvre de ces techniques serait limitée à un mois renouvelable une fois en enquête de flagrance ou préliminaire et, pour l’instruction, à quatre mois renouvelable dans la limite de deux ans, conformément aux durées prévues par le code de procédure pénale en matière d’interception de communications et de géolocalisation. Pour le reste, l’ensemble des garanties de fond et de forme aujourd’hui applicables à ces techniques à l’instruction continuera de s’appliquer aux enquêtes.
Les auditions conduites par votre rapporteur sur ces articles ont révélé certaines inquiétudes quant à la place croissante accordée aux enquêtes préliminaires par rapport aux informations judiciaires et la prétendue insuffisance des garanties entourant la mise en œuvre de ces techniques spéciales d’investigation. Tel a été le constat notamment formulé par M. Bertrand Louvel, premier président de la Cour de cassation, par le Syndicat de la magistrature, la Conférence nationale des premiers présidents de cours d’appel, la Conférence nationale des présidents de tribunaux de grande instance, l’Association des avocats pénalistes, le Syndicat des avocats de France, le Conseil national des barreaux, la Conférence des bâtonniers et le Conseil de l’ordre des avocats de Paris.
Votre rapporteur tient à souligner que ces moyens d’enquête spéciaux doivent être mis en œuvre, en toutes circonstances, avec l’autorisation et sous le contrôle d’un magistrat du siège – selon le cas, le juge d’instruction ou le JLD, ce dernier devant prochainement voir son statut et son indépendance consolidés (26) – pour les besoins de la poursuite de certaines infractions limitativement énumérées et portant une atteinte grave à l’ordre public et, « à peine de nullité », dans le respect d’un régime procédural strict. Il fait observer que les articles 1er et 3 constituent un rééquilibrage des pouvoirs entre, d’une part, ceux dévolus aux services de renseignement et ceux donnés aux services d’enquête judiciaires et, d’autre part, ceux respectivement confiés au procureur de la République et au juge d’instruction. Ces articles donnent ainsi à nos magistrats les moyens de procéder à certaines investigations dans l’urgence sans recourir, dans un premier temps, à l’ouverture d’une information judiciaire. Ils préservent le statut et l’utilité de l’instruction, dont il convient de rappeler qu’elle est « obligatoire en matière de crime » (27), ainsi qu’en témoigne, par exemple, la différenciation opérée dans les durées pendant lesquelles le juge d’instruction et le procureur de la République pourront recourir à la sonorisation ou à la fixation d’images et à la captation de données informatiques.
Ces articles ont d’ailleurs été accueillis très favorablement par de nombreux magistrats, policiers et gendarmes, notamment M. Jean-Claude Marin, Procureur général près la Cour de cassation, l’Union syndicale des magistrats, la Conférence nationale des procureurs généraux, la Conférence nationale des procureurs de la République ainsi que plusieurs représentants de la section antiterroriste du tribunal de grande instance de Paris en première ligne dans la lutte contre le crime organisé à caractère terroriste.
2. L’adaptation de la compétence centralisée de la juridiction parisienne en matière d’exécution des peines à l’augmentation du contentieux terroriste (article 4)
En complément de la compétence nationale concurrente reconnue aux magistrats parisiens pour la poursuite, l’instruction et le jugement des actes terroristes, le juge de l’application des peines de Paris, le tribunal de l’application des peines et, en appel, la chambre de l’application des peines de la cour d’appel de Paris sont, depuis 2006, seuls compétents pour prendre les décisions concernant les personnes condamnées pour une infraction terroriste, conformément à l’article 706-22-1 du code de procédure pénale.
L’accroissement du contentieux terroriste, en raison, en particulier, de l’élargissement du champ des infractions ayant cette qualification opéré par le législateur avec le transfert, dans le code pénal, des faits de provocation à la commission d’actes terroristes et d’apologie de ces actes, ont conduit à alourdir significativement la charge de travail de la juridiction chargée du suivi de l’application des peines de Paris.
En conséquence, l’article 4 restreint la compétence exclusive reconnue au JAP de Paris, au tribunal de l’application des peines et, en appel, à la chambre de l’application des peines de la cour d’appel de Paris aux décisions concernant les personnes condamnées par la juridiction parisienne. Cette dernière n’étant, en principe, pas saisie des faits de provocation au terrorisme ou d’apologie de celui-ci, à l’exception de ceux qui s’inscrivent « dans une démarche organisée et structurée de propagande » (28), cette disposition conduira à recentrer la mission de la juridiction parisienne d’application des peines sur les seules décisions de condamnation pour les actes de terrorisme les plus graves.
3. La protection de l’identité et de la sécurité des témoins s’exposant à des risques de représailles dans des affaires sensibles (articles 5 et 6)
Les procédures relatives à certaines infractions particulièrement graves peuvent exposer les témoins et leurs proches à des risques importants de représailles.
Le code de procédure pénale comporte déjà certaines dispositions admettant, sous certaines conditions, le témoignage sous X, afin de protéger l’adresse ou l’identité du témoin (articles 706-57 à 706-63), et, en matière de criminalité et de délinquance organisées, le témoignage d’agents « spéciaux » infiltrés ayant recours à une identité d’emprunt (articles 706-86 et 706-87). Par ailleurs, au stade du jugement, il peut être dérogé au principe de la publicité des débats devant la cour d’assises si cette publicité s’avère « dangereuse pour l’ordre ou les mœurs » et si la victime partie civile le demande en cas de poursuites exercées du chef de viol ou de tortures et d’actes de barbarie accompagnés d’agressions sexuelles (article 306) ou, devant le tribunal correctionnel, si la « publicité est dangereuse pour l’ordre, la sérénité des débats, la dignité de la personne ou les intérêts d’un tiers » (article 400).
Ces dispositions sont toutefois insuffisantes. La possibilité d’ordonner le huis clos, au stade du jugement, est relativement étrangère à la sécurité des témoins appelés à déposer. De surcroît, le droit existant ne permet pas de moduler l’intensité du degré de protection accordé au témoin en fonction des circonstances : le recours à la procédure du témoignage sous X est relativement contraignant et sa force probante peut être facilement remise en cause. Enfin, l’article 706-63-1, qui garantit aux « repentis », sous le contrôle d’une commission nationale, « une protection destinée à assurer leur sécurité » et, si nécessaire, dès « leur réinsertion », le cas échéant par la délivrance d’une identité d’emprunt, n’est applicable qu’à la « personne qui a tenté de commettre un crime ou un délit (…) ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire » afin de permettre « d’éviter la réalisation de l’infraction et, le cas échéant, d’identifier les autres auteurs ou complices ».
Les articles 5 et 6 du projet de loi, qui s’inspirent de dispositifs mis en œuvre devant la Cour pénale internationale, visent à renforcer la protection des témoins dont les auditions sont déterminantes pour la résolution des enquêtes pénales mais susceptibles d’entraîner des représailles à leur encontre, en particulier dans les procédures relatives aux crimes contre l’humanité, aux crimes et délits de guerre et à la criminalité et délinquance organisées qui incluent le terrorisme.
L’article 5 insère deux nouveaux articles 306-1 et 400-1 au sein du code de procédure pénale prévoyant la possibilité de recourir au huis clos partiel pour auditionner un témoin lors du jugement des crimes et délits en matière de criminalité et de délinquance organisées les plus graves et des crimes contre l’humanité, de disparition forcée, de torture ou d’actes de barbarie et de guerre, « si la déposition publique de celui-ci est de nature à mettre gravement en danger sa vie ou son intégrité physique ou psychique, ou celles des membres de sa famille ou de ses proches ».
L’article 6 crée, au sein de ce code, deux nouveaux articles qui permettent, pour le témoin s’exposant aux mêmes risques de représailles :
– d’une part, pour les seuls crimes et délits punis d’au moins trois ans d’emprisonnement, que son identité « ne soit pas mentionnée au cours des audiences publiques et ne figure pas dans les ordonnances, jugements ou arrêts de la juridiction d’instruction ou de jugement qui sont susceptibles d’être rendus publics » grâce à l’attribution à cette personne d’un numéro (article 706-62-1) ;
– d’autre part, en cas de procédure portant sur un crime contre l’humanité, un crime ou délit de guerre ou un crime ou délit relevant de la criminalité organisée, de disposer d’« une protection destinée à assurer sa sécurité » en étant autorisé, « [e]n cas de nécessité, (…) à faire usage d’une identité d’emprunt » dans les mêmes conditions que celles qui s’appliquent aujourd’hui aux « repentis » (article 706-62-2).
Ces nouvelles dispositions ne remettent en cause ni les droits de la défense, ni les règles du procès équitable prévues par l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elles permettent à la France de rattraper son retard dans le domaine de la protection des témoins et des victimes en comparaison avec les dispositifs qui existent en cette matière dans les pays anglo-saxons et devant certaines juridictions internationales.
Le quatrième volet de la partie de ce projet de loi consacrée au crime organisé et au terrorisme concerne l’amélioration de la lutte contre les infractions en matière d’armes, corollaires fréquents de la grande criminalité.
Héritée de dispositions anciennes, ayant fait l’objet d’une modernisation par le législateur en 2004 (29) et 2012 (30), la législation sur les armes figure à la fois dans le code de la sécurité intérieure et dans le code de la défense. D’une part, les articles L. 312-1 à L. 312-7 du code de la sécurité intérieure déterminent les conditions d’acquisition et de détention des armes et confient au préfet un pouvoir de police spéciale permettant, notamment, d’en exiger la remise ou le dessaisissement. D’autre part, les articles L. 2339-2 à L. 2339-11-4 et L. 2353-4 à L. 2353-14 du code de la défense (fabrication et commerce, importations, exportations et transferts de matériels de guerre, d’armes, de munitions et d’explosifs) et les articles L. 317-1 à L. 317-12 du code de la sécurité intérieure (acquisition, détention, commerce de détail, conservation, perte, transfert de propriété, port et transport d’armes et de munitions) répriment pénalement les manquements aux obligations édictées par la loi et, plus généralement, le trafic d’armes. Par ailleurs, l’enquête, la poursuite, l’instruction et le jugement de certaines infractions relatives aux armes font l’objet de règles procédurales dérogatoires du droit commun.
Les articles 7 à 10 complètent cette législation par diverses mesures renforçant le contrôle des armes et munitions, aggravant les peines encourues pour certains faits délictueux et adaptant les techniques spéciales d’enquêtes à la lutte contre le trafic d’armes.
En premier lieu, l’article 7 vise à renforcer le contrôle administratif des armes et munitions. Le 1° élargit le champ de l’interdiction légale d’acquisition et de détention d’armes des catégories B, C et D. Le 2° autorise les préfets à interdire l’acquisition et la détention de ces armes en raison du comportement dangereux d’une personne sans attendre que celle-ci soit en possession d’une arme comme c’est le cas aujourd’hui. Le 5° renforce l’effectivité de l’inscription au fichier national automatisé nominatif des personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA) de l’ensemble des personnes interdites d’acquisition. Les 3° et 4° procèdent, en outre, à plusieurs clarifications des modalités d’acquisition et de détention des armes de catégories B et C.
En second lieu, l’article 8 tend à adapter les moyens d’enquête contre le trafic d’armes. Le 1° élargit le champ des infractions relatives aux armes susceptibles de justifier le recueil et la centralisation de traces et d’empreintes génétiques dans le fichier national des empreintes génétiques (FNAEG). Le 2° étend le champ de la procédure dérogatoire prévue en matière de criminalité et de délinquance organisées à l’ensemble des infractions de trafic d’armes de catégories A et B même lorsqu’elles ne sont pas commises en bande organisée, dans le respect de la jurisprudence constitutionnelle qui subordonne une telle extension à la gravité ou à la complexité particulière des infractions en cause et aux atteintes qu’elles portent, par elles-mêmes, « à la sécurité, à la dignité ou à la vie des personnes » (31).
Le 3° de l’article 8 complète le chapitre II du titre XXV du livre IV du code de procédure pénale, qui définit la procédure applicable à la criminalité et à la délinquance organisées, par une section 9 et un nouvel article 706-106-1 afin d’autoriser les services de police judiciaire à recourir à la technique dite du « coup d’achat » pour les besoins de la lutte contre le trafic d’armes. Aujourd’hui réservée à la lutte contre le trafic de stupéfiants, cette technique permet aux enquêteurs, avec l’autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction, de réaliser des actes illégaux sans engager leur responsabilité pénale pour remonter les filières criminelles et caractériser pénalement les trafics.
Corrélativement, afin de confier des moyens d’investigation homogènes et comparables à l’ensemble des services de l’État chargés de la lutte contre le crime organisé et des infractions liées au terrorisme, l’article 10 permet aux douanes de mettre en œuvre, en matière de trafic d’armes, des opérations d’infiltration et la technique du « coup d’achat », deux techniques spéciales d’enquête qu’elles peuvent déjà utiliser dans certaines affaires relevant de leurs missions en application des articles 67 bis et 67 bis-1 du code des douanes (trafic de stupéfiants, contrebande de tabac ou d’alcool, contrefaçon…).
En dernier lieu, l’article 9 renforce la répression pénale de certaines infractions relatives aux armes. Le I aggrave les peines encourues pour l’acquisition, la cession ou la détention sans autorisation d’armes de catégories A et B (1°), la détention d’un dépôt d’armes ou de munitions de catégories A, B et D (3°) et le port ou transport, sans motif légitime, d’armes de catégories A et B (4°) ; par ailleurs, il étend le champ de l’infraction relative à l’acquisition ou à la détention d’armes en méconnaissance d’une interdiction (2°). Le II augmente les peines encourues pour des faits d’importation, sans autorisation, de matériels de catégories A, B, C et D (1°) et sanctionne pénalement le transfert, sans autorisation, de certaines armes ou munitions (2°).
Les nouvelles technologies constituent le vecteur de nouvelles formes d’intimidations et le support d’infractions de plus en plus nombreuses, dont certaines sont en lien direct avec la grande criminalité et le terrorisme. Plus qu’une liste précise d’infractions, cette « cybercriminalité » se rapporte davantage à un mode opératoire qui, en utilisant ou ciblant un système d’information, permet de faciliter la commission de l’infraction et d’en démultiplier les effets.
L’article 11 du projet de loi a pour principal objet d’adapter notre législation aux nouvelles caractéristiques et aux nouveaux dangers de cette criminalité qui soulève au moins deux séries de problèmes.
D’une part, les auteurs de ces infractions bénéficient d’une certaine impunité, facilitée par l’anonymat des réseaux numériques, la difficulté de déterminer précisément le lieu de commission de l’infraction et la localisation de son auteur, fréquemment situé à l’étranger, et l’absence de plainte systématique de la victime, pourtant nécessaire pour poursuivre, en France, les infractions commises hors du territoire de la République (32).
Suivant les préconisations formulées par le rapport Protéger les internautes remis par le groupe de travail interministériel sur la lutte contre la cybercriminalité présidé par le procureur général Marc Robert (33), le I pose, dans un nouvel article 113-2-1 du code pénal, le principe de la compétence des juridictions françaises lorsque la victime d’une infraction commise sur un réseau de communications électroniques réside en France. De plus, les II à IV prévoient, respectivement aux articles 43, 52 et 382 du code de procédure pénale, la compétence du parquet, du juge d’instruction et de la juridiction de jugement en raison du domicile de la victime ou du siège social de la personne morale victime.
D’autre part, une partie de cette criminalité constitue une forme de « cyberterrorisme » en portant atteinte à la disponibilité des réseaux ou des services informatiques des administrations ou d’opérateurs importants ainsi qu’à la confidentialité ou à l’intégrité des données qui y sont stockées, a fortiori lorsqu’il s’agit de données personnelles, ou des matériels utilisés pour leur fonctionnement.
Afin de renforcer l’efficacité de la poursuite et de la répression des cyberattaques les plus graves, les V et VI soumettent les atteintes aux systèmes de traitements automatisés de données personnelles mis en œuvre par l’État, commises en bande organisées, au régime procédural dérogatoire applicable à la criminalité et à la délinquance organisées en vertu de l’article 706-73-1 du code de procédure pénale. Cette modification aura pour conséquence d’appliquer à l’enquête, la poursuite, l’instruction et le jugement de ces atteintes, déjà soumises, depuis 2014 (34), à une partie de ce régime dérogatoire (infiltrations, enquêtes sous pseudonyme, écoutes téléphoniques dans le cadre d’une enquête préliminaire ou de flagrance, sonorisations et fixations d’images, captations de données informatiques, mesures conservatoires…), deux nouvelles règles particulières : la compétence des juridictions interrégionales spécialisées (35) et les perquisitions de nuit (36). En revanche, conformément à la jurisprudence constitutionnelle en la matière, il demeurera impossible de leur appliquer la prolongation de la garde à vue à quatre jours et l’intervention différée de l’avocat à la 72e heure, ces règles étant réservées à l’enquête, la poursuite, l’instruction et le jugement des infractions susceptibles de porter atteinte « à la sécurité, à la dignité ou à la vie des personnes » (37), mentionnées à l’article 706-73 du même code.
1. La lutte contre le trafic de biens culturels (article 12)
La Commission européenne, dans le cadre de ses annonces du 2 février 2016 sur le plan d’action destiné à lutter contre le financement du terrorisme, s’est engagée à proposer en 2017 une proposition législative visant à mieux contrôler le commerce illicite des biens culturels.
L’article 12 du projet de loi s’inscrit dans ce cadre en créant une nouvelle infraction réprimant le trafic de biens culturels émanant de théâtres d’opérations de groupements terroristes. Le rapport commandé à M. Jean–Luc Martinez, président–directeur du musée du Louvre, sur « la protection du patrimoine en situation de conflit armé », a en effet établi un constat sévère de la réalité du trafic des biens culturels, qualifiés d’« antiquités du sang », qui montre l’urgence d’une action répressive en la matière. Cet article constituera le pendant du dispositif adopté dans le cadre du projet de loi relatif à la liberté de création, à l’architecture et au patrimoine, voté en première lecture par l’Assemblée nationale le 6 octobre 2015 et par le Sénat le 16 février 2016 tendant à renforcer la législation en matière de lutte contre la circulation illicite des biens culturels.
2. Le plafonnement des cartes prépayées et l’organisation du recueil d’information sur l’utilisation de ces cartes (article 13)
Les cartes prépayées permettent la circulation discrète, en marge du système bancaire, d’importantes sommes d’argent, y compris par-delà les frontières. L’article 13 du projet de loi introduit au sein du chapitre V relatif à l’émission et à la gestion de la monnaie électronique du titre Ier du livre III du code monétaire et financier une section 4 intitulée « Plafonnement » qui comprend un article unique L. 315–9 plafonnant la valeur monétaire maximale stockée sous forme électronique et utilisable au moyen d’un support physique.
Cette mesure vient utilement compléter le plan d’action lancé par le Gouvernement français en mars 2015 visant à restreindre l’usage de l’anonymat des cartes prépayées.
3. L’extension des pouvoirs de TRACFIN (articles 14 et 15)
Le service de traitement du renseignement et d’action contre les circuits financiers clandestins, dit TRACFIN, a pour missions de lutter contre les circuits financiers clandestins, le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Il travaille à partir de deux sources d’information complémentaires que sont les déclarations de soupçons, transmises par certaines catégories de professions, au premier rang desquels les banques, lorsqu’elles constatent des opérations financières atypiques et les documents conservés par ces professions à l’égard desquels TRACFIN dispose d’un droit d’obtention.
Outre ces sources « traditionnelles », TRACFIN a réalisé deux appels à vigilance à destination des professionnels assujettis à l’occasion des évènements du printemps arabe en 2011 et au regard de la situation politique et sécuritaire en Ukraine en 2014. Ces messages ont montré leur efficacité puisqu’une hausse des déclarations de soupçons en lien avec ces problématiques a été constatée. L’article 14 du projet de loi vise à donner à cette pratique une base légale en permettant à TRACFIN de désigner, pour une durée maximum de six mois renouvelable, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État, aux personnes soumises au dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme des opérations qui présentent, eu égard à leur nature particulière ou aux zones géographiques déterminées qu’elles concernent, des personnes qui présentent un risque élevé de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme.
L’article 15 autorise TRACFIN à demander aux gestionnaires d’un système de cartes de paiement ou de retrait toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission. Il s’agira, par exemple, du groupement d’intérêt économique CB ou des sociétés Visa et Mastercard.
4. L’extension en matière douanière du mécanisme de renversement de la preuve de l’origine illicite des fonds (article 16)
Le blanchiment est défini à l’article 324-1 du code pénal comme « le fait de faciliter, par tout moyen, la justification mensongère de l’origine des biens ou des revenus de l’auteur d’un crime ou d’un délit ayant procuré à celui-ci un profit direct ou indirect », ainsi que comme « le fait d’apporter un concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d’un crime ou d’un délit ».
L’article 16 du projet de loi étend en matière douanière le mécanisme de renversement de la preuve de l’origine illicite des fonds instauré par la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière pour le délit général de blanchiment afin de renforcer les moyens juridiques de lutte contre le financement du terrorisme. Afin de répondre aux exigences constitutionnelles, cette présomption d’illicéité n’est pas irréfragable et nécessite, pour être mise en œuvre, la réunion de conditions de fait ou de droit faisant supposer la dissimulation de l’origine ou du bénéficiaire effectif de ces biens ou revenus.
1. L’extension des pouvoirs des forces de l’ordre à l’occasion des contrôles et vérifications d’identité (article 17)
Aux termes de l’article 78-1 du code de procédure pénale, « toute personne se trouvant sur le territoire national doit accepter de se prêter à un contrôle d’identité effectué dans les conditions et par les autorités de police visées » aux articles 78–2 et suivants du même code. L’article 78–2–2 du code de procédure pénale encadre les contrôles d’identité et les visites de véhicules menés par les officiers de police judiciaires sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite des actes de terrorisme des infractions en matière de prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs, d’armes et d’explosifs, des infractions de vol, de recel ou des faits de trafic de stupéfiants.
L’article 17 du projet de loi introduit à cet article 78-2-2 la possibilité pour les officiers de police judiciaire de procéder également à l’inspection visuelle et à la fouille de bagages en plus des contrôles d’identité et de la visite des véhicules.
2. La retenue en cas de suspicions sérieuses que le comportement d’une personne est lié à des activités à caractère terroriste (article 18)
L’étude d’impact indique qu’il est recommandé aux services de police et de gendarmerie lorsqu’ils contrôlent des personnes faisant l’objet de certaines catégories de fiches dites « S » (Sûreté de l’État) au fichier des personnes recherchées (FPR)de les retenir et d’aviser sans délai le service ayant procédé à l’inscription de ces personnes pour recueillir ses instructions. Aujourd’hui, cette retenue s’opère, le cas échéant, sur le fondement de l’article 78–3 du code de procédure pénale, qui permet de retenir jusqu’à 4 heures une personne refusant ou se trouvant dans l’impossibilité de justifier de son identité lors d’un contrôle prévu par l’article 78-2 du même code. Pourtant, une personne ayant décliné son identité ne devrait pas pouvoir faire l’objet d’une retenue administrative dans le cadre du droit existant.
L’article 17 du projet de loi crée donc un nouveau cas de retenue pour examen de la situation administrative d’une personne à l’encontre de laquelle il existe des « raisons sérieuses de penser que son comportement est lié à des activités à caractère terroriste ou qu’elle est en relation directe et non fortuite avec une personne ayant un tel comportement ». Cette retenue doit permettre une vérification d’identité approfondie, par un officier de police judiciaire. À l’exception du fait que le Procureur doit être obligatoirement prévenu dès le début de la rétention, la procédure relative à cette nouvelle forme de retenue est identique à celle prévue à l’article 78–3 :
– la personne ne peut être retenue que pendant le temps strictement nécessaire à l’accomplissement des vérifications ;
– elle est aussitôt informée de son droit de prévenir à tout moment sa famille. Si des circonstances particulières l’exigent, l’officier de police judiciaire prévient lui–même la famille ou la personne choisie ;
– la retenue ne peut excéder quatre heures ;
– le procureur de la République peut y mettre fin à tout moment ;
– le mineur de dix–huit ans doit être assisté de son représentant légal, sauf impossibilité ;
– l’officier de police judiciaire mentionne dans un procès–verbal, transmis au procureur de la République, les motifs qui justifient la vérification de situation administrative et les conditions dans lesquelles la personne a été présentée devant lui, informée de ses droits et mise en mesure de les exercer ;
– dans le cas où une procédure d’enquête ou d’exécution est adressée à l’autorité judiciaire et assortie du placement en garde à vue, la personne retenue doit être aussitôt informée de son droit de faire aviser le procureur de la République de cette mesure ;
– les prescriptions sont imposées à peine de nullité ;
– la durée de la rétention s’impute, s’il y a lieu, sur celle de la garde à vue.
Cicéron, dans son Discours pour Milon, écrivait que « Tout moyen est honnête pour sauver nos jours lorsqu’ils sont exposés aux attaques et aux poignards d’un brigand et d’un ennemi. Car les lois se taisent au milieu des armes, elles n’ordonnent pas qu’on les attende lorsque celui qui les attendrait serait victime d’une violence injuste avant qu’elles pussent lui prêter une juste assistance. » Ce principe est aujourd’hui consacré à la fois par le droit conventionnel – article 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales – et le droit interne.
Toutefois, même dans le cadre légal de l’usage des armes, les juridictions nationale et conventionnelle vérifient que les critères d’existence d’un danger actuel, de l’absolue nécessité et de la proportionnalité de la riposte sont réunis.
Comme le souligne l’étude d’impact, l’appréciation stricte de la concomitance de l’agression et de la riposte, condition nécessaire pour appliquer le principe de légitime défense, soulève certaines difficultés d’appréciation notamment en cas de fuite de l’agresseur et d’évolution de l’agression dans un espace de temps, même très bref, qui caractérise pourtant les nouveaux modes opératoires des terroristes, comme lors du périple meurtrier de la nuit du 13 novembre 2015.
L’article 19 du projet de loi insère un article L. 434–2 dans le code de la sécurité intérieure instituant un nouveau régime d’irresponsabilité pénale en raison de l’état de nécessité. Ce régime bénéficie au fonctionnaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale, au militaire des formes armées déployées sur le territoire national dans le cadre des réquisitions légales pour les besoins de la défense et de la sécurité civiles et à l’agent des douanes qui fait un usage de son arme rendu absolument nécessaire pour empêcher l’auteur d’un ou plusieurs homicides volontaires ou tentatives d’homicides volontaires dont il existe des raisons réelles et objectives de penser qu’il est susceptible de réitérer d’autres crimes dans un temps rapproché.
Le rapport de la commission d’enquête menée par l’Assemblée nationale sur la surveillance des filières et des individus djihadistes établit un constat inquiétant : « les retours de djihadistes de la zone irako-syrienne sont l’un des facteurs importants de l’aggravation de la menace, la majorité d’entre eux ayant combattu dans les rangs de Daech, qui a officiellement appelé le 21 septembre 2014 à la commission d’attentats terroristes en France et dans les pays participant à la coalition. » (38)
Les procédures judiciaires concernant les personnes de retour d’une zone de combat se fondent sur deux qualifications juridiques :
– l’association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste (AMT), définie à l’article 421–2–1 du code pénal, qui nécessite l’existence d’un groupement ou d’une entente constitués par des faits matériels en vue de la préparation d’actes terroristes ;
– l’entreprise terroriste individuelle, définie à l’article 421–2–6 du même code, qui suppose le fait de préparer, en relation avec une entreprise individuelle et dans un but terroriste, la commission de certaines infractions terroristes (atteintes aux personnes, atteintes aux biens les plus graves et actes graves de terrorisme écologique).
Ces qualifications nécessitent néanmoins d’apporter la preuve que les personnes s’étant rendues en Syrie et en Irak l’ont fait pour rejoindre un groupe terroriste, principalement Jabhat al-Nosra ou Daech, ce qui peut être complexe à démontrer, du fait de la situation en Syrie, où combattent plusieurs groupes, dont l’armée syrienne libre (ASL) qui n’a pas de caractère terroriste.
L’article 20 du projet de loi crée en conséquence un contrôle administratif des retours sur le territoire national de ces personnes.
● Le nouvel article L. 225–1 définit les situations de nature à justifier la mise en œuvre d’un contrôle administratif d’une personne de retour sur le territoire national. Ce nouveau dispositif concernera toute personne qui a quitté le territoire national pour accomplir, dans des conditions susceptibles de la conduire à porter atteinte à la sécurité publique lors de son retour sur le territoire national, des :
– déplacements à l’étranger ayant pour objet la participation à des activités terroristes (1°) ;
– déplacements (2°) ou tentatives de déplacement (3°) à l’étranger sur un théâtre d’opérations de groupements terroristes.
● Le nouvel article L. 225–2 définit les obligations pouvant être imposées, pour une durée maximale d’un mois non renouvelable, aux personnes s’étant effectivement rendues dans une zone théâtre d’opérations de groupement terroriste. Le ministère de l’Intérieur, dans un délai maximal d’un mois à compter de la date certaine du retour sur le territoire national, peut leur faire obligation de :
– résider dans un périmètre géographique déterminé, permettant à l’intéressé de poursuivre une vie familiale et professionnelle normale et, le cas échéant, l’astreindre à demeurer à son domicile, ou à défaut, dans un autre lieu à l’intérieur du périmètre précité, pendant la plage horaire qu’il fixe, dans la limite de huit heures par vingt–quatre heures (1°) ;
– se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, dans la limite de trois présentations par semaine, en précisant si cette obligation s’applique également les dimanches et jours fériés ou chômés (2°).
● Le nouvel article L. 225–3 définit les obligations pouvant être imposées aux personnes mentionnées à l’article L. 225–1, de manière alternative ou cumulative avec celles mentionnées à l’article L. 225–2, par le ministère de l’Intérieur. Ce dernier peut, dans un délai maximal d’un an à compter de la date certaine du retour sur le territoire national, leur faire obligation de :
– déclarer leur domicile (1°) ;
– déclarer leurs identifiants de tout moyen de communication électronique dont ils disposent ou qu’ils utilisent (2°) ;
– signaler leurs déplacements à l’extérieur d’un périmètre défini par l’autorité administrative et ne pouvant être plus restreint que le territoire d’une commune (3°) ;
– ne pas se trouver en relation, directement ou indirectement, avec certaines personnes, nommément désignées, dont il existe des raisons sérieuses de penser que leur comportement constitue une menace pour la sécurité et l’ordre publics (4°).
Ces obligations sont prononcées pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une fois.
● Le nouvel article L. 225–4 apporte les garanties procédurales devant entourer le contrôle administratif des retours sur le territoire national. Les décisions de contrôle administratif doivent être écrites et motivées. La personne concernée est mise en mesure de présenter ses observations dans un délai maximal de huit jours après la notification de la décision. Elle peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix.
● Le nouvel article L. 225–5 prévoit que les obligations prononcées dans le cadre du contrôle administratif sont suspendues, intégralement ou partiellement, si la personne se soumet à une action destinée à permettre sa réinsertion à l’acquisition des valeurs de citoyenneté. Cette participation ne peut se faire que sur la base du volontariat.
● Le nouvel article L. 225–6 propose de créer une infraction pénale nouvelle, sur le modèle de celle créée à L. 224-1 du code pénal pour la violation de l’interdiction de quitter le territoire. Le fait de se soustraire aux obligations du présent article serait puni de trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende.
5. L’instauration d’un contrôle des accès aux établissements ou installations accueillant des évènements de grande ampleur (article 21)
L’article 21 du projet de loi renforce les contrôles d’accès aux établissements ou installations accueillant des évènements de grande ampleur, comme prochainement l’Euro 2016 de football. Il permet aux organisateurs, lorsque ces évènements sont exposés à un risque exceptionnel de menace terroriste, de solliciter l’avis de l’autorité administrative avant d’autoriser l’accès des personnes autres que les spectateurs ou participants.
S’inspirant fortement des préconisations formulées par la commission présidée par l’ancien procureur général près la Cour de cassation, M. Jean-Louis Nadal, et du rapport du mois de juillet 2014 rédigé sous la présidence du procureur général Jacques Beaume, le titre II du projet de loi modifie les règles de la procédure pénale afin de porter les garanties offertes par la législation française au niveau qu’attendent les Français d’un État de droit au XXIe siècle. Il poursuit également l’objectif de remédier aux scories identifiées par les forces de police et les juridictions dans toutes les phases de la procédure pénale, à savoir l’enquête et l’instruction, le jugement et le prononcé, l’exécution et l’application des peines.
La qualité de la préparation de ces dispositions et le soin qu’a pu apporter le Gouvernement à leur élaboration, expliquent qu’elles aient recueilli, au cours des auditions menées par vos deux rapporteurs, un satisfecit quasi-unanime.
1. La clarification du rôle du procureur de la République et la modernisation de l’enquête préliminaire (articles 22 et 24)
L’évolution qu’ont connue depuis une vingtaine d’années les pratiques judiciaires et les textes législatifs a conduit à réduire progressivement la part d’informations confiées au juge d’instruction par rapport aux enquêtes – en flagrance et surtout préliminaires – dirigées par un procureur de la République dont les pouvoirs d’investigations ont été très sensiblement accrus.
Cette évolution a pu conduire, un temps, à envisager la suppression pure et simple du juge d’instruction auquel n’échoient plus désormais que 3 % des affaires pénales. Une telle suppression ne paraît cependant pas souhaitable : l’intervention d’un magistrat du siège indépendant, instruisant dans un cadre contradictoire les affaires les plus délicates, constitue une application fondamentale du principe de séparation des pouvoirs dans la tradition juridique française. Pour des raisons évidentes, il importe que les dossiers criminels ainsi que les affaires correctionnelles les plus complexes, au premier rang desquelles celles qui mettent en jeu la sûreté des personnes ou le bon fonctionnement de la démocratie, puissent continuer à bénéficier de la procédure d’information judiciaire.
Conservant intactes les modalités de l’instruction, le projet de loi s’attache à rapprocher d’elles le fonctionnement de l’enquête menée par le procureur de la République. Une dimension contradictoire s’y trouve introduite dans des circonstances déterminées, afin de concilier nécessités de l’enquête et droits des parties – personne suspectée comme plaignante. Ainsi, le recours à ces mesures n’aura pas pour conséquence d’empiéter sur les instructions, mais plus sûrement d’éviter l’ouverture d’informations inutiles et le déclenchement de poursuites mal fondées.
L’article 22 du projet de loi détaille les missions fondamentales du procureur de la République au cours de l’enquête, dans ses fonctions de direction de la police judiciaire. Il indique que ce magistrat contrôle la légalité des moyens déployés par les enquêteurs, la proportionnalité des actes d’investigation au regard de la nature et de la gravité des faits, les choix retenus pour l’orientation de l’enquête ainsi que la qualité de son contenu. De façon solennelle, l’article 22 proclame l’attachement à ce que les investigations tendent à la manifestation de la vérité et qu’elles soient accomplies, dans le respect des droits de la victime et de ceux de la personne suspectée, à charge et à décharge.
Vos rapporteurs approuvent cette rédaction qui, si elle ne constitue « pas à proprement parler une innovation » ainsi que l’a souligné le Conseil d’État dans son avis sur le projet de loi, définissent utilement la place du directeur d’enquête qu’est le procureur de la République dans la procédure pénale contemporaine. L’affirmation par la loi de son impartialité, qui complète la suppression des instructions individuelles adressées par la Chancellerie par la loi n° 2013-669 du 25 juillet 2013 relative aux attributions du garde des sceaux et des magistrats du ministère public en matière de politique pénale et de mise en œuvre de l’action publique, sera de nature à renforcer son statut et à répondre aux critiques adressées par la Cour européenne des droits de l’homme.
L’article 24 institue le respect du contradictoire dans les enquêtes préliminaires de longue durée – supérieures à un an – à la demande des personnes qui ont fait l’objet d’une mesure d’audition libre, de garde à vue, ou de saisie de leurs biens. À moins qu’il ne décide de l’ouverture d’une information judiciaire ou d’un défèrement contradictoire, lorsqu’il estimera que la procédure est en état d’être communiquée, le procureur de la République sera tenu de communiquer à ces personnes, ainsi qu’à la victime, l’intégralité du dossier de la procédure, pour recevoir leurs observations et leurs éventuelles demandes d’actes.
L’article 24 octroie également au procureur de la République la faculté de communiquer tout ou partie de l’enquête lorsqu’il l’estime utile aux investigations, légalisant une pratique des parquets jusque-là fondée sur l’ambiguïté de l’article 11 du code de procédure pénale (39).
Si vos rapporteurs soutiennent la volonté d’instiller dans l’enquête une part de contradictoire afin de préserver au mieux les droits de la défense et d’éviter que ne s’étalent sur plusieurs années des procédures dans lesquelles il n’est pratiquement pas possible de se disculper du fait de l’interdiction d’accéder au dossier, ils s’interrogent sur l’opportunité de la procédure retenue par le Gouvernement. Outre qu’elle confère au procureur de la République un pouvoir discrétionnaire d’appréciation du caractère communicable de l’enquête – donc en réalité une faculté de vider la disposition de sa portée –, elle soulève également des questions à la fois pratiques et théoriques.
D’une part, comment organiser l’accès au dossier avant l’achèvement de l’enquête, alors que les pièces et les actes se trouvent éparpillées entre la juridiction et le commissariat de police ou la caserne de gendarmerie chargé des investigations ?
D’autre part, comment justifier que soit conféré le droit de présenter des observations et de solliciter des actes de procédure à des personnes qui, si elles ont fait l’objet d’une mesure d’investigation, n’ont aucunement vocation à être poursuivies devant un tribunal correctionnel ? Les longues enquêtes en matière financière, qu’évoque l’étude d’impact à l’appui du dispositif proposé, se composent le plus souvent d’investigations très larges jusqu’à ce que les poursuites se concentrent sur quelques personnes jugées expressément responsables. Pourquoi impliquer les autres, qui ne seront pas inquiétées et qui se limiteront probablement à la fonction de témoin, dans les orientations retenues par le magistrat ?
L’article 23 du projet de loi renforce l’autorité fonctionnelle des magistrats sur la police judiciaire. Constatant la faible efficacité de la procédure actuelle – cinq décisions seulement en 2015 des chambres de l’instruction visant des agents et officiers de police judiciaire contre soixante-treize sanctions décidées par le procureur général qui n’a pourtant autorité que sur les seuls officiers –, il crée une procédure disciplinaire d’urgence qui permettra, en cas de manquement professionnel grave, au président de la chambre de l’instruction de suspendre immédiatement, et pour un mois, l’exercice des fonctions de police judiciaire dans l’attente de la décision de la chambre.
Ce renforcement du contrôle de la police judiciaire par l’autorité judiciaire, conforme à la jurisprudence du Conseil constitutionnel selon laquelle la police judiciaire doit être placée sous le contrôle des magistrats, a satisfait les représentants du monde judiciaire auditionnés par vos rapporteurs.
Les interceptions de communication décidées au cours d’une information judiciaire sont, en l’état du droit, essentiellement laissées à l’appréciation du magistrat instructeur, sous réserve des recours exercés par la suite devant la chambre de l’instruction. L’article 25 du projet de loi modernise le cadre législatif en exigeant la motivation de la décision d’interception, en limitant la durée maximale de l’opération à un an – deux ans pour la délinquance et la criminalité organisées – et en soumettant la mesure au contrôle a priori du juge des libertés et de la détention lorsqu’elle concerne un avocat, un parlementaire ou un magistrat soupçonné d’avoir participé, en qualité d’auteur ou de complice, à la commission de l’infraction. Dans ce dernier cas, une copie de l’ordonnance motivée du juge des libertés et de la détention sera communiquée au bâtonnier, au président de l’Assemblée nationale ou du Sénat, ou au premier président ou procureur général de la Cour d’appel ou de la Cour de cassation.
Cette évolution bienvenue permettra de mettre le droit français en conformité avec les prescriptions de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de renforcer le caractère démocratique de la procédure d’instruction par un plus grand respect de la séparation des pouvoirs et des droits de la défense.
Rédigés sur le fondement des rapports produits par différentes instances, et au premier rang le rapport annuel de la Cour de cassation, les articles 26 à 31 du projet de loi et une partie des ordonnances prévues à l’article 33 visent à corriger des imperfections révélées au cours des dernières années. D’ordre essentiellement technique, ils n’ont guère suscité de commentaires – sinon une approbation de principe – lors des auditions menées par vos rapporteurs.
L’article 26 améliore sur plusieurs points les garanties du justiciable dans le cas particulier de décisions successives à propos d’un renvoi devant la juridiction de jugement alors que le prévenu se trouve en détention provisoire dans l’attente de son procès. S’agissant d’une situation dans laquelle une personne est privée de liberté, le code de procédure pénale exige du juge d’instruction, et de la chambre de l’instruction devant laquelle est jugé l’appel de ses décisions, une célérité particulière, faute de quoi le prévenu doit être élargi. Mais le droit ne prévoyait aucune disposition dans l’hypothèse, il est vrai rare, d’une cassation d’un arrêt de renvoi rendu par une chambre de l’instruction suivi d’un renvoi de l’affaire à une autre chambre de l’instruction. L’article 26 comble cette lacune en prévoyant les délais auxquels sont astreintes les chambres de l’instruction de renvoi.
L’article 27 modifie le code de la défense afin de prendre en compte la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme dans le cas, très spécifique, d’une arrestation et d’une privation de liberté effectuées en haute mer suivies d’une mesure de garde à vue à l’arrivée sur le sol français. Prenant acte du caractère non conventionnel de cette situation en l’absence de présentation immédiate à un juge autre que le procureur de la République, le dispositif proposé prévoit une comparution dans les plus brefs délais devant le juge des libertés et de la détention ou, en, cas d’information judiciaire, devant le juge d’instruction.
L’article 28 simplifie les dispositions de l’article 18 du code de procédure pénale relatif à l’extension de compétence territoriale des enquêteurs. Il supprime les habilitations successives que doivent actuellement solliciter les officiers de police judiciaire auprès du procureur général du ressort dans lequel se trouve le lieu d’exercice de leurs fonctions, y compris dans la perspective d’une mise à disposition temporaire d’un service situé hors de ce ressort. Le contrôle fonctionnel des officiers de police judiciaire sera donc réalisé une seule fois a priori, le code de procédure pénale modifié par l’article 23 du projet de loi prévoyant par ailleurs un contrôle a posteriori efficace.
L’article 29 procède à deux modernisations en matière de détention provisoire. En premier lieu, alors que le non-respect des délais de jugement des demandes de mise en liberté est sanctionné par une libération automatique, et que certains détenus exploitent cette disposition en formulant jusqu’à plusieurs demandes dans la même journée pour pousser le magistrat chargé de les étudier à la faute, le Gouvernement propose que soient déclarées irrecevables les demandes déposées alors qu’une précédente demande est encore en cours d’examen. En second lieu, l’article 29 permet le placement sous contrôle judiciaire d’une personne dont la libération est ordonnée à la suite de la constatation de l’irrégularité formelle de sa détention provisoire, mais dont la situation au fond justifie toujours l’édiction de mesures restrictives de liberté.
L’article 30 améliore la procédure de jugement des délits en permettant une convocation en justice par le délégué du procureur, en évitant aux prévenus attendant une comparution immédiate mais libérés par le juge des libertés et de la détention de devoir comparaître à nouveau devant le procureur de la République pour connaître la date de leur procès, et en permettant la notification des ordonnances pénales par les délégués du procureur en matière contraventionnelle comme en matière délictuelle.
L’article 31 prévoit la possibilité de procéder à des contrôles d’identité en cas de soupçons de violation des obligations résultant d’une peine ou d’une mesure pré ou post-sentencielle, c’est-à-dire lorsqu’une personne ne fait pas l’objet d’une mesure de recherche directement liée à une infraction spécifique. Il modifie par ailleurs le code de procédure pénale afin d’étendre les procédures de recherche des personnes en fuite à toutes les personnes condamnées qui ne respectent pas leur peine, quelle qu’elle soit.
Enfin, l’article 33 habilite le Gouvernement à prendre une série de mesures d’adaptation de la procédure pénale à la suite de directives de l’Union européenne, de décisions du Conseil constitutionnel et d’un arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme. Sont ainsi prévues :
– la finalisation de la transposition en droit interne de la directive 2013/48/UE du 22 octobre 2013 relative au droit d’accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales et des procédures relatives au mandat d’arrêt européen, au droit d’informer un tiers dès la privation de liberté et au droit des personnes privées de liberté de communiquer avec des tiers et avec les autorités consulaires ;
– la transposition de la directive 2014/41/UE du 3 avril 2014 relative à la décision d’enquête européenne en matière pénale ;
– la modification des dispositions en vigueur en matière de saisies, mises sous scellés et confiscations afin de transposer la directive 2014/42/UE du 3 avril 2014 concernant le gel et la confiscation des instruments et des produits du crime dans l’Union européenne, de tirer les conséquences de plusieurs décisions du Conseil constitutionnel concernant des questions prioritaires de constitutionnalité, de simplifier et de renforcer l’efficacité des dispositions en la matière, notamment en étendant les missions de l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués ;
– la mise en conformité du droit avec la décision du Conseil constitutionnel n° 2015-494 QPC du 16 octobre 2015, Consorts R., qui a déclaré contraire à la Constitution la procédure pénale en matière de restitution des objets placés sous main de justice ;
– la prise en compte de la décision du Conseil constitutionnel n° 2014-375 QPC du 21 mars 2014, M. Bertand L. et autres, qui a déclaré contraire à la Constitution la procédure pénale en matière d’immobilisation des navires et de cautionnement ;
– la correction du code de procédure pénale rendue nécessaire par la décision du Conseil constitutionnel n° 2015-499 QPC du 20 novembre 2015, M. Hassan B., dans laquelle est déclaré contraire à la Constitution la validité d’un procès d’assises en dépit du défaut d’enregistrement sonore des débats devant la cour d’assises ;
– la modification de la procédure de perquisition en matière pénale afin de respecter la décision du Conseil constitutionnel n° 2015-506 QPC du 4 décembre 2015, M. Gilbert A., qui confère une valeur constitutionnelle au secret du délibéré et interdit la saisie des documents par lui couverts ;
– la prise en compte de la condamnation de la France par la Cour européenne des droits de l’homme dans un arrêt du 18 septembre 2014, Brunet c. France, à propos des modalités de fonctionnement du traitement d’antécédents judiciaires (TAJ), fichier commun à la police et à la gendarmerie nationales, notamment en ce qui concerne la durée de conservation des données collectées ;
– l’obligation pour les enquêteurs de recourir à la plate-forme nationale des interceptions judiciaires (PNIJ), dans un souci d’efficacité, de limitation des frais de justice et d’une plus grande confidentialité des opérations ;
– l’extension de l’application des dispositions de l’article 61-1 du code de procédure pénale sur l’audition libre aux enquêtes effectuées par des fonctionnaires et agents mettant en œuvre des prérogatives de police spéciale.
L’article 32 du projet de loi clarifie le cadre légal applicable à l’usage de « caméras piétons » par les forces de l’ordre, afin de prévenir les incidents susceptibles de se produire à l’occasion de leurs interventions, de constater les infractions et d’aider à leur répression par la collecte de preuves. Il prévoit que les agents de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale pourront procéder au moyen de caméras individuelles à un enregistrement audiovisuel des interventions auxquelles ils procèdent dans l’exercice de leurs missions de prévention des atteintes à l’ordre public et de protection de la sécurité des personnes et des biens, comme de leurs missions de police judiciaire, lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident.
Dans la mesure où la captation de tels images et sons est susceptible d’intervenir en tous lieux publics et privés et est de nature à porter atteinte au droit au respect de la vie privée, la mise en œuvre de ces dispositifs fait l’objet de plusieurs garanties. Ainsi, les caméras doivent être portées de façon apparente, comporter un signal visible informant de l’enregistrement et faire l’objet, sauf si les circonstances l’interdisent, d’une information des personnes filmées. Par ailleurs, les personnels auxquels les caméras individuelles sont fournies ne peuvent avoir accès aux enregistrements auxquels ils procèdent. Hormis les cas où ils seront utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, les enregistrements seront effacés au bout de six mois. Enfin, la Commission nationale de l’informatique et des libertés sera consultée sur les modalités d’application de ce dispositif, qui fera l’objet d’un décret en Conseil d’État.
Vos rapporteurs approuvent ce dispositif qui prend appui sur une expérimentation conduite depuis 2013 et dont le succès a permis de gagner à la mesure l’ensemble des représentants des forces de l’ordre. Ils y voient une garantie nouvelle pour l’ensemble de la société, tant pour les policiers et gendarmes trop souvent menacés ou outragés dans l’exercice de leurs fonctions que pour les personnes mises en cause qui pourront ainsi plus facilement agir en responsabilité en cas de comportement fautif. Par ailleurs, ils soulignent que le dispositif de l’article 32 a été adopté, en termes très voisins et au bénéfice des services de sécurité des opérateurs de transport public, par la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi relative à la prévention et à la lutte contre les incivilités, contre les atteintes à la sécurité publique et contre les actes terroristes dans les transports collectifs de voyageurs, qui devrait prochainement être définitivement adoptée par le Parlement.
A. UN MEILLEUR ENCADREMENT DES MOYENS JUDICIAIRES DE LUTTE CONTRE LE TERRORISME ET LA CRIMINALITÉ ORGANISÉE
La commission des Lois a sensiblement renforcé les garanties applicables à la mise en œuvre de certaines techniques spéciales d’enquête dont l’utilisation est facilitée par le présent projet de loi aux fins de répression et de prévention de la grande criminalité et du terrorisme.
En premier lieu, elle a, sur proposition de votre rapporteur, mieux encadré le recours aux perquisitions domiciliaires de nuit que, sous certaines conditions, l’article 1er autorise en enquête préliminaire et facilite lors d’une information judiciaire. Elle a précisé, d’une part, que le régime juridique prévu par l’article 706-92 du code de procédure pénale s’appliquerait de plein droit à ces opérations lorsqu’elles sont réalisées au stade de l’enquête préliminaire et, d’autre part, que le magistrat ayant autorisé ces perquisitions en enquête préliminaire ou à l’instruction devrait être informé « dans les meilleurs délais ». Ces deux nouvelles garanties répondent aux préoccupations formulées par M. Jacques Toubon, Défenseur des droits, lors de son audition par votre rapporteur et dans son avis sur le présent projet de loi (40).
En deuxième lieu, à l’article 2, la Commission a adopté un amendement de votre rapporteur exigeant que l’autorisation de recourir à l’IMSI catcher, qui relève, selon le cas, du JLD ou du juge d’instruction, soit délivrée par « ordonnance motivée », ainsi que l’a également suggéré le Défenseur des droits. En outre, mais contre l’avis de votre rapporteur, soucieux d’apporter, en séance publique, des garanties procédurales plus complètes, elle a adopté un amendement de M. Lionel Tardy prévoyant – selon des modalités qui mériteront d’être retravaillées en séance publique – la « destruction des données recueillies » lorsque le JLD n’a pas confirmé l’autorisation donnée, en urgence, par le procureur de la République de recourir à ce dispositif.
En troisième lieu, à l’initiative de votre rapporteur, la Commission a complété la liste des obligations susceptibles d’être prononcées dans le cadre d’un sursis avec mise à l’épreuve en ajoutant, à l’article 132-45 du code pénal, la possibilité de prononcer, à l’égard d’une personne condamnée pour une infraction terroriste, l’obligation particulière de « faire l’objet d’une prise en charge sanitaire, sociale, éducative ou psychologique », sous la forme, par exemple, d’un stage de « déradicalisation » (article 4 bis).
En quatrième lieu, la Commission a adopté trois amendements identiques déposés par MM. Éric Ciotti, Sébastien Pietrasanta et Philippe Goujon autorisant le Gouvernement à inscrire le bureau du renseignement pénitentiaire dans le « deuxième cercle » de la communauté du renseignement, c’est-à-dire parmi les administrations, autres que les services spécialisés, pouvant recourir à des techniques de recueil du renseignement (article 4 ter).
En dernier lieu, la Commission a mieux circonscrit les mécanismes de protection de l’identité et de sécurisation des témoins s’exposant à des risques de représailles institués par les articles 5 et 6.
Par cohérence avec le dispositif actuel de l’article 706-58, qui autorise, sous certaines conditions, le témoignage anonyme lorsque l’audition du témoin « est susceptible de mettre gravement en danger la vie ou l’intégrité de cette personne » :
– sur proposition de votre rapporteur, la Commission a limité la possibilité de décider le huis clos partiel lors d’une audience aux seuls cas de risques graves de représailles sur la vie ou l’intégrité physique du témoin, à l’exclusion de tout risque d’atteinte à son intégrité psychique (article 5) ;
– à l’initiative de M. Sergio Coronado et de votre rapporteur, elle a subordonné l’anonymisation du témoin et son identification, par un numéro, dans les audiences publiques et les jugements rendus publics, à l’existence de graves risques de représailles d’une part, de risques d’atteinte à la vie ou à l’intégrité physique de la personne d’autre part (article 6).
À l’initiative de votre rapporteur, la commission des Lois a renforcé les garanties applicables aux enquêtes et contrôles administratifs.
Ainsi, à l’article 18, la Commission a adopté un amendement visant à préciser l’objet de la nouvelle retenue administrative qui paraissait trop floue dans la rédaction initiale du projet de loi. Aux termes de la nouvelle rédaction, cette procédure de vérification doit uniquement permettre :
– de consulter les traitements relevant de l’article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés selon les règles propres à chacun de ces fichiers ;
– d’interroger les services à l’origine du signalement de l’intéressé ;
– d’interroger des organismes de coopération internationale en matière de police judiciaire ou des services de police étrangers.
Au même article, la Commission a adopté – à titre conservatoire – un amendement permettant d’encadrer la retenue des mineurs en précisant que celui-ci doit être assisté de son représentant légal ou, en cas d’impossibilité dûment justifiée, d’un tuteur désigné par le juge des enfants sur saisine du procureur de la République. Cette formulation devra encore être améliorée en séance publique.
À l’article 19, la Commission a adopté un amendement apportant des précisions destinées à éclairer les raisons réelles et objectives pouvant conduire à justifier l’usage des armes dans le cadre du nouvel état de nécessité. L’appréciation, faite par le fonctionnaire de police ou le militaire de gendarmerie au moment du tir, doit résulter :
– des circonstances de la première agression ;
– du caractère déterminé de leur auteur et de ses motivations ;
– de la certitude d’une réitération des homicides ou tentatives d’homicides, dans un temps rapproché ;
– de la nécessité de faire obstacle à la réitération.
À l’article 20, la Commission a adopté deux amendements visant à mieux coordonner les procédures administratives et judiciaires applicables aux personnes qui reviennent sur le territoire national après s’être rendues sur un théâtre d’opérations terroriste ou qui ont tenté de le faire :
– le premier impose l’information préalable du parquet avant toute mesure de contrôle administratif ;
– le second fait primer l’ouverture d’une procédure judiciaire sur la mesure de police administrative : cette dernière doit cesser dès l’ouverture d’une procédure judiciaire concernant une personne visée par le contrôle administratif des retours sur le territoire national.
À l’initiative de votre rapporteure, la commission des Lois s’est attachée à approfondir la réforme de la procédure pénale proposée par le projet de loi dans un double objectif d’efficacité et de meilleur respect des droits des personnes.
Cette orientation s’est traduite par la modification de certains dispositifs du projet de loi, notamment de l’article 24 donnant à l’enquête préliminaire un caractère contradictoire. Limité aux procédures longues et soumis à l’appréciation des magistrats du parquet, le mécanisme proposé par le Gouvernement a été écarté au profit d’une consultation systématique, en fin d’enquête, des futures parties à l’instance.
Ont également été complétés par la Commission l’article 22 afin de distinguer au cours de l’enquête les notions de victime et de plaignant, l’article 29 pour garantir l’élargissement d’une personne dès lors qu’un fait nouveau remet en cause la nécessité de la détention provisoire, et l’article 30 pour éviter que les mesures de simplification des modalités de comparution ne se traduisent par une restriction des droits du justiciable en matière de mandat de dépôt.
L’apport de la commission des Lois s’est principalement manifesté dans l’adoption d’amendements portant articles additionnels. La Commission a ainsi suivi plusieurs axes.
Sur proposition de la rapporteure et du président Dominique Raimbourg, les commissaires aux Lois se sont attachés à introduire dans le projet de loi plusieurs dispositions précédemment adoptées au cours de la discussion de la loi n° 2015-993 du 17 août 2015 portant adaptation de la procédure pénale au droit de l’Union européenne et censurées par le Conseil constitutionnel pour des raisons de forme par la décision n° 2015-719 DC du 13 août 2015. Il en va ainsi de :
– la conversion des peines d’emprisonnement en sursis avec mise à l’épreuve ou en contrainte pénale (article 27 bis) ;
– l’obligation de motivation des arrêts de règlement de la chambre de l’instruction (article 27 quinquies) ;
– la prise en compte de la surpopulation carcérale dans l’octroi des réductions supplémentaires de peines (article 27 sexies) ;
– l’accroissement du délai dont dispose le juge de l’application des peines pour l’examen d’un aménagement de peine (article 27 septies) ;
– l’acquittement d’une peine de jours-amende pour éviter l’incarcération (article 27 octies) ;
– la création d’un dispositif de « sur-amendes » destiné à l’aide aux victimes d’infractions (article 31 ter) ;
– l’allongement à un mois du délai d’examen des requêtes en dessaisissement d’un parquet (article 31 sexdecies) ;
– la possibilité de condamner un prévenu à un stage de citoyenneté, à un travail d’intérêt général ou à un sursis en dépit de son absence à l’audience (articles 32 A, 32 B et 32 D) ;
– la limitation du stage que doit suivre un condamné à une durée d’un mois et à un coût correspondant à l’amende pour une contravention de troisième classe (article 32 C).
La Commission a également entrepris de simplifier le droit en corrigeant des lourdeurs et scories du code de procédure pénale dont les juridictions avaient signalé le caractère dérangeant. Ainsi :
– il sera désormais possible aux magistrats chargés du contrôle des fichiers de police judiciaire d’accéder au fichier des procédures judiciaires (article 31 sexies) ;
– l’instruction permettra aux parties de renoncer de conserve à certains délais, au juge de recourir à la visioconférence et au procureur de la République d’exercer un contrôle judiciaire plus strict après l’ordonnance de renvoi (article 31 septies) ;
– l’accusé pourra sortir du palais de justice pendant les délibérations, et le jury se réunir à l’extérieur de la chambre des délibérations (article 31 decies) ;
– l’arrêt de la cour d’assises sera réputé rendu contradictoirement lorsque l’accusé aura pris la fuite après l’interrogatoire sur les faits et sa personnalité ou au cours de l’instance d’appel, son avocat continuant à assurer sa défense (article 31 undecies) ;
– les modalités de l’appel seront simplifiées, permettant notamment d’interjeter appel sur une partie de la décision de première instance seulement, et de déclarer plus facilement irrecevables les déclarations déposées en violation des règles formelles (article 31 duodecies) ;
– les modalités de déchéance des pourvois en cassation seront encadrées (article 31 quaterdecies) ;
– la compétence spéciale de la cour d’assises de Paris en matière de crime de guerre et de crime contre l’humanité sera étendue aux instances d’appel (article 31 quindecies) ;
– le juge d’application des peines pourra recourir à la visioconférence (article 31 septdecies) ;
– enfin, la décision d’emprisonnement d’un condamné qui ne respecte pas sa peine de contrainte pénale aura un caractère exécutoire par provision (article 31 octodecies).
D. UNE RÉDUCTION IMPORTANTE DU CHAMP DES ORDONNANCES AU PROFIT DE DISPOSITIONS DISCUTÉES PAR LE PARLEMENT
Le projet de loi déposé sur le Bureau de l’Assemblée nationale comportait, à l’article 33, un article portant habilitation du Gouvernement à légiférer par ordonnance sur vingt-et-un sujets, dont dix relatifs aux modalités de transposition et d’application du « paquet anti-blanchiment et financement du terrorisme » composé de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 – dite « 4ème directive anti-blanchiment et financement du terrorisme » – et du règlement (UE) 2015/847 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 sur les informations accompagnant les transferts de fonds.
Considérant ce volume d’habilitations excessif, votre rapporteure a souhaité que soient introduits dans le projet de loi un certain nombre des dispositifs destinés à donner lieu à des ordonnances. Les amendements portant articles additionnels qu’elle a présentés et les amendements dont elle a obtenu le dépôt par le Gouvernement ont permis de réduire considérablement l’ampleur de l’article 33, qui ne prévoit désormais plus que onze habilitations, la transposition du « paquet anti-blanchiment et financement du terrorisme » et la détermination de ses modalités d’application sur les territoires d’Europe et d’outre-mer apparaissant une œuvre trop considérable pour être réalisée au cours des deux semaines séparant le dépôt du projet de loi de son examen par la commission des Lois.
Sont donc désormais incluses dans le projet de loi :
– les dispositions tirant les conséquences de décisions de justice – du Conseil constitutionnel et de la Cour européenne des droits de l’homme – ;
– la transposition de trois textes européens : la directive 2013/48/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013 relative au droit d’accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales et des procédures relatives au mandat d’arrêt européen, au droit d’informer un tiers dès la privation de liberté et au droit des personnes privées de liberté de communiquer avec des tiers et avec les autorités consulaires ; la directive 2014/42/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant le gel et la confiscation des instruments et des produits du crime dans l’Union européenne ; la directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 relative au droit à l’information dans le cadre des procédures pénales ;
– les modifications du code de procédure pénale relatives aux prérogatives de l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC) et au caractère obligatoire du recours à la plate-forme nationale des interceptions judiciaires (PNIJ).
CONTRIBUTION DE M. PATRICK DEVEDJIAN, CO-RAPPORTEUR SUR LA MISE EN APPLICATION DE LA LOI
(article 86, alinéa 7, du Règlement)
Un projet qui a déraillé :
Le projet de loi qui nous est soumis a été annoncé et préparé depuis longtemps. Il a été précédé du rapport de Jean Louis Nadal « Refonder le ministère public » (2013), du rapport Beaume « Rénovation de l’enquête pénale » et du rapport Robert consacré à la cybercriminalité (2014).
En 2015, la Chancellerie a procédé à de nombreuses auditions et la commission des Lois a institué une mission de préfiguration de ce projet, avec Dominique Raimbourg et moi-même pour rapporteurs.
Nous avons procédé à de nombreuses auditions, dont celle du Directeur des affaires criminelles et des grâces.
Partant du constat partagé que la Justice judiciaire était engluée par la complexité des procédures et submergée par les contentieux de masse qui expliquent la lenteur avec laquelle elle est rendue, il s’agissait de proposer au Parlement des mesures de simplification propres à accélérer son déroulement.
Des propositions très nombreuses et très intéressantes ont été faites par les acteurs de terrain : pratiquement aucune n’a été retenue dans le projet qui nous est soumis alors que le Garde des Sceaux lui-même se prévaut des travaux préalables que je viens de rappeler.
Le terrorisme et son obsession nous ont rattrapés et dépassés et la simplification recherchée a laissé place à la normalisation de l’exception, comme la loi sur le renseignement avait commencé à le faire. Plusieurs mesures de l’état d’urgence font leur entrée dans le droit commun avec un risque important pour les libertés individuelles.
Un projet qui réduit la place du judiciaire :
Nous vivons un paradoxe : dans le même temps où le Gouvernement ne cesse de proclamer la nécessaire indépendance de la justice judiciaire, il s’évertue à en réduire le champ de compétence. Il lui en dispute les moyens, évite les réformes qui lui rendraient son efficacité et la distrait de ses tâches fondamentales. Ses personnels mêmes sont moins bien rémunérés que d’autres dans la fonction publique d’État.
Le projet de loi vient retirer au juge judiciaire des compétences qui lui appartenaient pour les confier au juge administratif, à l’égard duquel nul souci d’indépendance ne s’exprime, quand bien même il passe de l’exécutif au juridictionnel et réciproquement.
Comme l’observait le premier président de la Cour de cassation le 1er février 2016, l’indépendance du juge est indispensable pour pouvoir assurer le respect des libertés individuelles. C’est ainsi que l’entend la loi constitutionnelle du 3 juin 1958, fondatrice de notre Constitution, et cette exigence est reprise dans l’article 66 de la Constitution.
Depuis 1998, le Conseil constitutionnel a imposé l’idée que si la police judiciaire ressortait du juge judiciaire, la police administrative était du domaine du juge administratif. Il distingue l’atteinte à la liberté individuelle, qui est la privation de liberté au-delà de la douzième heure, de la restriction de liberté qui est tout le reste et n’est donc pas une atteinte à la liberté individuelle !
Le concept de liberté une et indivisible a disparu même si l’article 4 de la Déclaration des Droits de l’Homme dit le contraire : « la liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui ».
Le projet de loi qui nous est proposé consacre donc dans la vie quotidienne cette théorie définitivement restrictive de la liberté individuelle. Sauf à prévoir un jour la fusion des justices administrative et judiciaire comportant toutes les deux les mêmes exigences et les mêmes garanties.
Un certain nombre de mesures restrictives de liberté qui devaient être autorisées préalablement par le juge judiciaire deviennent de la compétence du juge administratif. La différence est qu’il ne les examinera que sous forme de recours après qu’elles auront été exécutées.
Certaines sont graves. Ainsi de l’assignation à résidence décidée par le Préfet et de l’obligation faite de déclarer les identifiants de tous ses moyens de communication électroniques à peine de trois ans d’emprisonnement.
AUDITION DE M. JEAN-JACQUES URVOAS, GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, ET DISCUSSION GÉNÉRALE
Lors de sa réunion du mercredi 10 février 2016, la commission des Lois procède à l’audition de M. Jean-Jacques Urvoas, garde des Sceaux, ministre de la Justice, et à la discussion générale du projet de loi renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale (n° 3473).
M. le président Dominique Raimbourg. Nous allons procéder à l’audition de M. Jean-Jacques Urvoas, garde des Sceaux, ministre de la justice, que je félicite à nouveau pour sa récente nomination à ces fonctions. Il vient présenter le projet de loi renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale. Notre Assemblée examinera ce texte en séance publique au cours de la première semaine du mois de mars. Au terme des propos liminaires du garde des Sceaux, je donnerai la parole aux rapporteurs et à un orateur par groupe. Si l’horaire ne nous permet pas d’entendre d’autres orateurs, la discussion générale se poursuivra lors de notre réunion du 17 février, qui sera consacrée à la suite de l’examen du texte.
M. Jean-Jacques Urvoas, garde des Sceaux, ministre de la justice. Ce n’est pas sans émotion que je reviens dans cette salle, à une place à laquelle je n’étais pas assis précédemment. Émotion en souvenir du travail que nous avons accompli ensemble, émotion aussi parce qu’en regardant vos débats, mercredi dernier, j’ai pris connaissance des mots fort aimables prononcés à mon endroit. Je me sens redevable : il me faut être à la hauteur de la confiance qui m’a ainsi été manifestée, et de la responsabilité qui est dorénavant la mienne d’être à la disposition du Parlement. Je viendrai devant vous, aussi souvent que j’y serai invité, répondre à vos questions et poursuivre nos échanges. Je salue l’élection de M. Dominique Raimbourg à la présidence de la commission des Lois et je me félicite que continue cette aventure législative en votre compagnie et, je l’espère, avec votre aide. Ma fonction a changé, mais évidemment pas ma disposition d’esprit : je redis ma volonté de travailler avec tous les membres de votre commission, quel que soit leur groupe politique, et ma totale disponibilité, qui sera aussi celle de mes collaborateurs directs ; ils répondront à vos questions avec toute la précision requise.
L’intitulé du projet de loi que je suis invité à vous présenter a été rappelé par le président Raimbourg. Il est vaste et explicite. Avant d’entrer dans le détail du texte, je pense utiles quelques remarques sur sa construction et son élaboration.
Ce projet polyphonique est porté par trois ministres. Les articles 7 à 10 inclus, 18 à 21 inclus et 32 relèvent de la compétence du ministre de l’Intérieur ; les articles 13 à 16 et 33-I de celle du ministre de l’économie et des finances ; le reste relève de ma responsabilité.
Je vous dirai quelques mots seulement des articles qui sont du ressort du ministère de l’Intérieur. Ils prévoient des mesures administratives visant à renforcer la prévention du terrorisme par un dispositif de contrôle administratif des personnes qui se sont rendues sur un théâtre d’opérations terroristes et qui, de retour sur le territoire national, sont susceptibles de constituer une menace pour la sécurité publique. Sont également prévus l’instauration d’un nouveau cas de retenue administrative de courte durée pour contrôler les individus susceptibles d’être liés à des activités à caractère terroriste ainsi que l’encadrement juridique des enquêtes administratives sur le personnel participant à l’organisation de grands événements tels que la COP 21 ou l’Euro 2016. Dans l’hypothèse particulière où un tueur de masse se manifesterait, d’autres dispositions prévoient un nouveau cas d’usage des armes par les agents des forces de sécurité, dans le respect de l’impératif de stricte nécessité.
Les articles concernant le ministère de l’économie et des finances portent sur la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Ils regroupent des dispositions afférentes à la répression du trafic de biens culturels en provenance de zones contrôlées par des organisations ou groupements terroristes, à la réglementation des cartes prépayées, au renforcement des pouvoirs de la cellule TRACFIN et au blanchiment douanier.
L’objectif commun des auteurs de ce texte est de renforcer la protection accordée à nos concitoyens dans le cadre intangible de l’État de droit, où l’autorité judiciaire tient une place éminente. Je vous proposerai, par de nombreuses mesures contenues dans ce projet, de la renforcer plus encore.
Ce n’est ni un texte de circonstances, ni une loi uniquement antiterroriste. Il faut en effet distinguer le moment de la présentation de ce projet au conseil des ministres – ce que j’ai fait la semaine dernière – de son élaboration, largement antérieure puisqu’il a été pensé à la Chancellerie depuis le début de l’année 2015. Les directions se sont appuyées sur la réflexion menée par deux hauts magistrats parmi les plus expérimentés, que Mme Christiane Taubira avait sollicités à cette fin : le procureur général honoraire près la Cour de cassation Jean-Louis Nadal, qui a remis en novembre 2013 un rapport portant sur le ministère public, et le procureur général Jacques Beaume, qui a rendu en juillet 2014 un rapport centré sur l’enquête pénale. La direction des affaires criminelles et des grâces a aussi travaillé sur la base du rapport, antérieur, demandé au procureur général près la cour d’appel de Riom, M. Marc Robert, et consacré à la cybercriminalité. Ces trois rapports ont conduit à définir nombre des mesures contenues dans le texte qui vous est soumis. Enfin, dès septembre 2015, la Chancellerie a procédé à de multiples concertations.
Si j’ai tenu à exposer les étapes de cette maturation, c’est pour mieux souligner que ce texte harmonieux a été mûrement réfléchi, dans le respect scrupuleux des libertés fondamentales. Il articule la recherche de performance dans la lutte contre la criminalité et le terrorisme et une réflexion plus large sur l’efficacité de la procédure pénale. Il le fallait, parce que les enquêteurs et les magistrats, notamment ceux du parquet et de l’instruction, sont accaparés par des contraintes procédurales qui, sans rien apporter au justiciable ni à la sauvegarde des libertés, contribuent à rendre la procédure incohérente. Ces contraintes sont des obstacles formels, générateurs d’une insécurité juridique que, je l’espère, nous parviendrons ensemble à éliminer. Le temps libéré par la plus grande rationalité des enquêtes, des poursuites et du jugement permettra aux enquêteurs et aux magistrats de se consacrer davantage au fond des dossiers.
Ces mesures de simplification législatives seront complétées, comme l’a annoncé le Premier ministre au mois d’octobre dernier, par des mesures réglementaires et pratiques de nature à alléger davantage encore la tâche des enquêteurs. Je ne m’interdirai d’ailleurs pas de vous soumettre, dès la semaine prochaine, quelques amendements complémentaires – dans le respect scrupuleux des prérogatives de votre commission, cela va sans dire. J’ajoute que le Gouvernement montrera la plus grande ouverture aux amendements d’origine parlementaire sur ces sujets. Je l’ai dit la semaine dernière, au Sénat, lors de l’examen de la proposition de loi de M. Philippe Bas tendant à renforcer l’efficacité de la lutte antiterroriste dont M. Michel Mercier est le rapporteur : en ces matières, nos chemins sont parallèles et nous pourrions sans grand effort les faire converger. En bref, le Gouvernement étudiera avec bienveillance les amendements des députés et des sénateurs visant à rendre la procédure plus efficace. Une justice moderne, efficace et sereine est une justice qui évite la bureaucratie inutile et pesante, et lui préfère des procédures pondérées et aussi durablement stables.
Parce que la procédure pénale constitue un élément fondamental de l’État de droit, le Gouvernement a souhaité faire figurer dans ce texte des dispositions permettant l’emploi de techniques spéciales d’enquête – sonorisation et captation de données informatiques, IMSI catcher – pour combattre une menace dont les auteurs usent des moyens technologiques les plus modernes, ainsi que des dispositions renforçant les garanties offertes à nos concitoyens, en limitant la durée de mise en œuvre de ces techniques et en renforçant la procédure du contradictoire par la communication des dossiers.
La modernisation des techniques spéciales d’enquête en police judiciaire est rendue nécessaire par nos engagements internationaux, notamment par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, mais aussi par l’impérieuse nécessité que des enquêtes relatives à des faits graves demandant des investigations approfondies ne soient pas annulées ou ne donnent lieu à la condamnation de la France devant la Cour européenne des droits de l’homme. Nous partageons tous la conviction que la garantie des libertés individuelles et publiques ne doit en aucun cas s’effacer devant la menace du terrorisme, quelle que soit son intensité. Non seulement les droits et libertés qui structurent l’État de droit doivent perdurer mais ils doivent être renforcés ; c’est l’objet de ce texte. La résistance au terrorisme passe aussi par l’illustration de la supériorité de la démocratie, et donc par la confiance en la justice.
Dans le détail, ce projet sera un facteur de cohérence pour notre système judiciaire en renforçant la complémentarité entre police judiciaire et police administrative. Ce sujet a été longuement abordé lors des audiences solennelles de rentrée. La magistrature a ainsi manifesté une inquiétude que nous devons dissiper, car il n’y a aucune raison de nourrir ces interrogations : le Gouvernement entend bien faire respecter l’article 66 de la Constitution, renforcer les moyens mis à la disposition de la police judiciaire et, tout autant, contribuer à l’articulation féconde entre celle-ci et la police administrative. Le texte tend aussi à renforcer la cohérence entre magistrats du siège et magistrats du parquet – en particulier entre le procureur de la République, le juge d’instruction et le juge des libertés et de la détention – ainsi qu’entre le parquet et la police judiciaire.
Je veux revenir sur ce que je pense être un malentendu. J’ai entendu s’exprimer des réserves sur la « transposition à la police judiciaire de méthodes de la police administrative » qu’effectuerait ce texte. Une telle présentation fait fi de la chronologie. En réalité, la loi relative au renseignement a transposé des techniques spéciales d’enquête de la police judiciaire à la police administrative, non l’inverse. Mais cette modernisation a eu pour conséquence de mettre l’accent sur la nécessaire adaptation des techniques de l’enquête judiciaire. Aussi le texte tire-t-il avantage des réflexions législatives les plus récentes et les plus en phase avec les besoins des enquêteurs, et cherche à rétablir un équilibre que seuls le temps et les technologies avaient quelque peu rogné.
Par ailleurs, le projet de loi remédie à une incohérence en permettant le recours aux techniques spéciales d’enquête soit au cours de l’enquête soit lors de l’instruction en les encadrant de façon adaptée, notamment dans leur durée, afin de respecter l’équilibre entre le parquet et le juge d’instruction.
S’agissant des relations entre magistrats du parquet et magistrats du siège, je rappelle que l’évolution des pratiques et des textes depuis vingt ans a eu pour conséquence que la proportion d’informations confiées au juge d’instruction par rapport aux enquêtes dirigées par le procureur de la République s’est progressivement réduite. Les pouvoirs d’investigation de ce dernier ont été accrus, avec l’autorisation préalable du juge des libertés et de la détention. Cette évolution a conduit à des projets de suppression de la fonction de juge d’instruction ; c’est une suggestion que je n’ai jamais faite mienne. Dans une société démocratique, l’intervention d’un juge du siège indépendant, agissant dans le cadre d’une procédure pleinement contradictoire, est à mes yeux indispensable, tant dans les affaires criminelles que dans les dossiers correctionnels graves et complexes, notamment ceux qui exigent des mesures de sûreté contre les personnes. L’hypothèse de la suppression de la fonction de juge d’instruction est donc écartée par le Gouvernement.
En revanche, il convient de renforcer le caractère contradictoire de certaines enquêtes, de simplifier le déroulement des instructions, et aussi d’étendre – pour une durée très limitée et uniquement en matière de délinquance et de criminalité organisées – les pouvoirs d’investigations au cours de l’enquête. Ces évolutions complètent d’ailleurs la suppression des instructions individuelles, prohibées par la loi du 25 juillet 2013.
Le projet de loi porte donc une attention particulière d’une part à la place dévolue au procureur de la République, au magistrat instructeur et au juge des libertés et de la détention, d’autre part à l’articulation des prérogatives de chacun d’entre eux.
Le deuxième équilibre est maintenu par la différence opérée dans la mise en œuvre des pouvoirs d’enquête – le juge d’instruction agissant seul, le procureur de la République sollicitant l’autorisation du juge des libertés et de la détention. La distinction ainsi opérée entre les enquêtes faisant l’objet d’une ouverture d’information judiciaire et celles diligentées par le parquet se traduit par une faculté de recours à des techniques spéciales d’enquête plus large dans le cadre des premières, les champs d’application et les durées différant.
En matière de criminalité et de délinquance organisées, les prérogatives d’enquête du juge d’instruction et du parquet – ces dernières étant, je le redis, autorisées par le juge des libertés et de la détention – sont étoffées. D’une part, les hypothèses permettant de recourir aux perquisitions domiciliaires nocturnes et aux techniques de sonorisation, fixation d’images et captations de données sont étendues ; d’autre part, un cadre juridique spécifique est créé pour permettre le recours à de nouvelles techniques d’investigation telles que l’accès au contenu des données stockées dans un système informatique et l’identification de données techniques de connexion par le biais d’un IMSI-catcher.
En outre, la liste des infractions relevant du régime dérogatoire de la criminalité organisée est élargie par l’ajout à l’article 706-73-1 du code de procédure pénale des délits d’atteinte aux systèmes informatiques et d’évasion commis en bande organisée. Une fois encore, je veux rassurer : ces techniques d’enquêtes sont encadrées par le juge judiciaire et utilisées à l’encontre du terrorisme et de la criminalité organisée. Aucune extension n’est donc à redouter, et les libertés individuelles sont préservées.
Une place particulière est réservée aux témoins qui, par leurs dépositions, sont susceptibles de concourir à la manifestation de la vérité. Demain, lors d’une procédure, un témoin pourra demander à n’être identifié que par un numéro ou encore à être entendu à huis clos, s’agissant du jugement des crimes contre l’humanité ou d’autres infractions graves. Cette protection est également garantie par la possibilité de demander une identité d’emprunt pour éviter les risques de représailles.
Comme je l’ai brièvement mentionné, le texte reprend en outre certaines préconisations contenues dans le rapport du procureur général Marc Robert relatif à la cybercriminalité. Ainsi adapte-t-il les règles de compétence territoriale aux infractions commises par le biais d’un réseau de communication électronique en créant un nouveau critère de compétence lié au domicile de la victime. Cela facilitera la détermination de la juridiction compétente pour traiter une affaire en l’absence de localisation de l’auteur de l’infraction. La prise en charge des dossiers relatifs à des infractions commises par internet, dont le nombre va croissant, en sera simplifiée.
D’autre part, la compétence des juridictions parisiennes de l’application des peines spécialisées en matière antiterroriste sera limitée aux personnes condamnées pour les infractions terroristes les plus importantes.
Vous l’aurez compris : ces mesures préservent la place institutionnelle de chacun des magistrats acteurs de la procédure pénale.
Enfin, le projet tend à clarifier le rôle du procureur de la République dans la direction d’enquête. Il convient en effet d’assurer la juste distance entre ce magistrat et les enquêteurs, tout en renforçant les pouvoirs de contrôle de l’autorité judiciaire – en l’espèce, le procureur général – sur la discipline des officiers et des agents de police judiciaire et des autres fonctionnaires exerçant des missions de police judiciaire.
Dans cette perspective, le texte améliore sur plusieurs points les garanties de la procédure pénale. Il clarifie le rôle du procureur de la République dans la direction de la police judiciaire. Il crée une procédure disciplinaire d’urgence en cas de faute grave d’une personne exerçant des missions de police judiciaire. Il institue une procédure simplifiée de règlement contradictoire des enquêtes de plus d’un an. Il limite la durée des interceptions téléphoniques tout en prévoyant une double décision du juge d’instruction et du juge des libertés et de la détention pour les interceptions concernant des avocats, des parlementaires ou des magistrats. Il encadre les délais de détention provisoire en cas de renvoi par le juge d’instruction ou de poursuite de la procédure après cassation.
Enfin, le texte simplifie la procédure pour permettre aux magistrats de se concentrer au fond des enquêtes et garantir une bonne administration de la justice. Ces simplifications concernent l’habilitation des officiers de police judiciaire, l’encadrement des demandes de mise en liberté, la possibilité de placer sous contrôle judiciaire une personne dont la détention provisoire est apparue formellement irrégulière, la convocation en justice par les délégués du procureur de la République, la procédure de comparution immédiate ou l’extension des procédures de contrôle d’identité et de recherche des personnes en fuite aux personnes condamnées qui ne respectent pas leurs obligations.
Je rappellerai pour conclure les principaux apports de ce texte. C’est, en premier lieu, le renforcement des pouvoirs de l’autorité judiciaire dans le cadre des enquêtes et des informations judiciaires. C’est aussi la confirmation du procureur de la République dans son rôle de direction de la police judiciaire : dans le prolongement de la loi du 25 juillet 2013, il est conforté dans sa qualité d’autorité judiciaire agissant dans le respect du principe d’impartialité, à charge et à décharge, avec le seul souci de la recherche de la manifestation de la vérité. C’est encore le progrès des garanties offertes aux justiciables et des droits de la défense, notamment par l’introduction du contradictoire dans le cadre de l’enquête préliminaire. C’est d’autre part l’amélioration de l’efficacité de la lutte contre le terrorisme. C’est enfin la simplification de la procédure.
Sans doute avez-vous été surpris par le volume de l’article 33, qui vise à permettre au Gouvernement de légiférer par ordonnances. Je sais l’extrême prudence, à juste titre, du Parlement ainsi sollicité. Aussi ai-je demandé que mes services tiennent à la disposition de vos rapporteurs ceux des textes prévus qui relèvent de ma compétence ; ils le sont déjà. Je précise que je viens de rendre compte au Conseil des ministres de l’ordonnance sur le droit des contrats, pour laquelle vous aviez permis l’habilitation du Gouvernement. Elle ne compte pas moins de 380 articles ; c’est dire que la procédure choisie était la bonne, d’autant que 95 % de ces articles sont consensuels. Je remercie le Parlement d’avoir permis au Gouvernement d’agir dans l’intérêt général pour simplifier le droit des contrats. Nous allons maintenant nous lancer dans un autre chantier, d’une ampleur comparable et aussi indispensable, celui de la responsabilité.
M. Pascal Popelin, rapporteur. Je suis chargé de rapporter sur les dispositions renforçant la lutte contre le crime organisé et le terrorisme et sur celles qui visent à renforcer l’efficacité des investigations judiciaires – articles 1er à 4 du texte ; celles qui tendent à renforcer la protection des témoins, et qui figurent aux articles 5 et 6 ; celles qui visent à améliorer la lutte contre les infractions en matière d’armes et la cybercriminalité, contenues dans les articles 7 à 11 ; enfin, celles qui tendent à renforcer l’enquête et les contrôles administratifs, qui font l’objet des articles 17 à 21.
Même si j’ai compris quel est le périmètre du projet couvert par la Chancellerie, c’est sur l’ensemble de ces articles que porteront mes questions au représentant du Gouvernement. Les auditions que nous menons, Mme Colette Capdevielle et moi-même, ayant commencé hier, je m’en tiendrai, monsieur le ministre, à vous interroger sur quelques points appelant des éclaircissements.
S’agissant de l’efficacité des investigations judiciaires, les articles 1er, 2 et 3 font intervenir des décisions d’autorisation du juge des libertés et de la détention. Ce magistrat a vu son rôle évoluer considérablement au cours des dernières années, sans qu’il soit formellement consacré dans notre droit. L’organisation des services et les effectifs permettront-ils aux juges des libertés et de la détention de remplir cette nouvelle mission ?
L’article 4 recentre les missions de la juridiction parisienne d’application des peines sur le seul suivi des peines prononcées pour actes de terrorisme, à l’exclusion des faits de provocation à ces actes ou d’apologie de ceux-ci. Cette disposition suffira-t-elle à désengorger la juridiction ? Une augmentation de ses moyens est-elle envisagée ?
Les articles 5 et 6 visent à renforcer la protection des témoins qui s’exposent à des risques importants de représailles. Mais cette protection, légitime, n’emporte-t-elle pas le risque que des condamnations soient prononcées sur la foi d’un seul ou de plusieurs témoignages uniquement anonymes ?
Les articles 7 et 9 renforcent le contrôle administratif des armes et la violation des règles en cette matière. Même si ces questions relèvent davantage du ministère de l’Intérieur que de la Chancellerie, pouvez-vous nous dire ce que représente le trafic d’armes en France, et quel lien établir entre ce trafic et le terrorisme ?
Les articles 8 et 11 donnent aux services enquêteurs, qu’ils soient judiciaires ou douaniers, des moyens d’investigation supplémentaires, élargissant notamment au trafic d’armes la possibilité de recourir à des infiltrations et à la technique du « coup d’achat ». Quel est l’état de la coopération des douanes et des services de police d’une part, de la coopération européenne d’autre part, en matière de lutte contre le trafic d’armes ?
L’article 11 adapte nos règles procédurales aux enjeux de la cybercriminalité. Il prévoit de nouveaux critères de compétence territoriale dès lors que la victime est française, de nouveaux critères de compétence du parquet, du juge d’instruction et du tribunal correctionnel en raison du domicile de cette victime et l’extension des règles procédurales de la criminalité organisée aux atteintes aux systèmes informatiques de l’État comportant des données personnelles. Pourquoi ne pas reconnaître une compétence spécifique à la juridiction parisienne en matière de cybercriminalité ? Comment l’État et les opérateurs d’importance vitale protègent-ils leurs systèmes informatiques contre le cyberterrorisme ?
J’en viens maintenant à l’enquête et aux contrôles administratifs.
L’article 17 étend les pouvoirs des forces de l’ordre à l’occasion des contrôles et vérifications d’identité. Il introduit la possibilité, pour les officiers de police judiciaire agissant sur réquisition du procureur de la République en application de l’article 78-2-2 du code de procédure pénale, de procéder, dans les lieux et pour la période prévus par ce magistrat, à l’inspection visuelle et à la fouille de bagages en plus des contrôles d’identité et de la visite des véhicules. Quelles garanties encadrent-elles cette extension, du point de vue des libertés individuelles ?
L’article 18 permet aux forces de l’ordre, à l’occasion d’un contrôle d’identité, de retenir une personne lorsqu’il y a des raisons sérieuses de penser que son comportement est lié à des activités à caractère terroriste, le temps de l’examen de sa situation, qui pourrait comprendre la consultation plus extensive de fichiers de police, la vérification de sa situation administrative et la consultation des services à l’origine du signalement. Ce temps d’examen ne pourra excéder quatre heures à compter du début du contrôle. Comment s’articulera cette nouvelle retenue avec la garde à vue, si cette dernière s’avère nécessaire ? Comment la sécurité juridique de la procédure sera-t-elle garantie ?
L’article 19 précise le cadre légal de l’usage des armes par les policiers, les gendarmes, les douaniers et les militaires déployés sur le territoire national en renfort des forces de sécurité intérieure, en dehors des cas de légitime défense, dans le cas d’un périple meurtrier durant lequel la légitime défense ne pourrait être invoquée, mais qui relève de l’état de nécessité. Comment cette mesure s’articulera-t-elle avec la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme relative au droit à la vie ? La notion de « temps rapproché » désigne-t-elle une durée de quelques minutes ou de plusieurs jours ?
Enfin, si le départ vers des pays en guerre de ressortissants français souhaitant participer aux combats n’est pas nouveau, il a pris une ampleur inédite au cours des dernières années : des centaines de jeunes, hommes et femmes, se rendent notamment en Syrie pour rallier des groupes de combattants terroristes. Le rapport de la commission d’enquête menée par l’Assemblée nationale à ce sujet établit un constat inquiétant : « Les retours de djihadistes de la zone irako-syrienne sont l’un des facteurs importants de l’aggravation de la menace, la majorité d’entre eux ayant combattu dans les rangs de Daech, qui a officiellement appelé à la commission d’attentats terroristes en France et dans les pays participant à la coalition ». L’article 20 renforce le contrôle à l’égard des personnes qui se sont déplacées à l’étranger afin de participer à des activités terroristes, et qui, de retour sur le territoire national, sont susceptibles de constituer une menace pour la sécurité publique. À combien estimez-vous le nombre de personnes qui pourraient être concernées par ces mesures ?
Mme Colette Capdevielle, rapporteure. Monsieur Urvoas, c’est avec beaucoup d’émotion et de plaisir que nous vous retrouvons ici en qualité de garde des Sceaux, de surcroît, pour nous présenter un texte majeur. Je pense que ces sentiments sont partagés par tous.
Pascal Popelin et moi-même avons été désignés rapporteurs sur le projet de loi renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale. Ce texte regroupe les dispositions relatives aux formes les plus graves de criminalité. Je m’occuperai, pour ma part, des modifications apportées à la procédure de droit commun ainsi qu’à la lutte contre le blanchiment – Yann Galut sera sur ce point rapporteur pour avis de la commission des Finances.
Le projet de loi comporte des avancées intéressantes en matière de contradictoire dans les enquêtes préliminaires, de pénalisation du trafic de biens culturels et d’organisation de la cellule Tracfin qui détecte les mouvements financiers suspects. Certains points obscurs de notre droit sont clarifiés, comme les conséquences des arrestations en haute mer ou encore l’encadrement des délais de jugement dans le contentieux de la détention provisoire. Ce sont des articles qui, je pense, emporteront facilement l’adhésion de la commission des Lois et de l’Assemblée nationale dans son ensemble.
Je concentrerai mes questions sur la philosophie générale du texte et j’évoquerai les doutes entendus lors des auditions que nous venons de commencer. Chacun admet la nécessité de renforcer les prérogatives policières en période d’urgence et de doter les forces de l’ordre de moyens efficaces d’investigation. Mais le projet de loi va plus loin en prévoyant un double mouvement : l’un au profit de l’administration et au détriment du juge judiciaire ; l’autre au sein même de ce monde judiciaire, du juge d’instruction vers le parquet, sous le regard du juge des libertés et de la détention.
Concernant le premier point, pourquoi le Gouvernement a-t-il fait le choix de confier le contrôle administratif des retours sur le territoire national au ministre de l’Intérieur plutôt qu’à la magistrature ? N’est-ce pas le rôle du juge judiciaire que de superviser les restrictions de liberté, hors période d’état d’urgence ? Nous faisons toute confiance à l’administration et aux forces de l’ordre mais la confiance n’exclut pas le contrôle ; or il revient par nature aux magistrats judiciaires de fixer des bornes aux actions de l’exécutif.
Le second point, à savoir l’influence grandissante du procureur dans la procédure judiciaire, est l’aspect le plus présent dans le texte et dans les articles que la Commission m’a demandé de rapporter. L’enquête préliminaire est rapprochée, sur bien des points, de l’instruction. N’est-ce pas une remise en cause progressive du rôle du juge d’instruction, qui agit selon une procédure plus stricte mais plus encadrée, au bénéfice du procureur – que la justice européenne ne tient pas pour un magistrat indépendant ? Certes, le projet de loi prévoit qu’il enquête « à charge et à décharge », mais cette proclamation n’est pas vraiment assortie d’applications concrètes. Seriez-vous ouvert à un renforcement du contradictoire dans l’enquête préliminaire et à l’institution de voies de recours là où elles font défaut ? Nous savons qu’un statut du juge des libertés et de la détention est prévu dans le projet de loi organique accompagnant la réforme de la justice du XXIe siècle. Pouvez-vous nous confirmer que ce texte sera prochainement inscrit à l’ordre du jour de notre Commission ?
Au-delà de la rédaction proposée par le Gouvernement, certaines dispositions additionnelles pourraient apporter des compléments intéressants. Je pense aux mesures adoptées par notre Commission lors de l’examen du projet de loi portant adaptation de la procédure pénale au droit de l’Union européenne, qui ont été censurées par le Conseil constitutionnel pour des raisons de forme. Je pense aussi aux protections renforcées que réclament certains professionnels détenteurs de secrets protégés par la loi – avocats, journalistes, médecins – face au risque d’interceptions policières mettant en jeu les droits de leurs clients, de leurs sources et de leurs patients. Pouvons-nous compter sur la bienveillance du Gouvernement si nous proposons de telles mesures ?
Je constate aussi que l’article 33 prévoit une liste particulièrement longue d’habilitations du Gouvernement à légiférer par ordonnances. Certaines des mesures concernées étant particulièrement arides et techniques, je ne suis pas opposée à ce qu’elles soient prises par ordonnance plutôt que par la loi. D’autres évolutions, cependant, me paraissent relativement simples et susceptibles de faire l’objet d’un débat parlementaire classique. Comme vous le savez, notre Commission apprécie peu la multiplication des ordonnances. Êtes-vous ouvert à la conversion de certaines habilitations en dispositions « en dur », au sein du présent texte ? En outre, on lit curieusement à l’article 33 que le Gouvernement sollicite six mois pour prendre des ordonnances quand il laisse au Parlement un délai bien plus réduit pour voter la loi. Je vous demanderai donc des mesures d’harmonisation.
Nous sommes conscients que les menaces qui pèsent sur la France justifient un renforcement des moyens dévolus aux services de la justice. Nous savons, monsieur le garde des Sceaux, que vous mettrez tout en œuvre pour obtenir les crédits budgétaires nécessaires. Nous vous remercions d’ailleurs de l’avoir indiqué dès votre prise de fonctions. En ce qui concerne les moyens humains, vous savez pouvoir compter sur le dévouement sans faille des hommes et des femmes qui prennent part à l’institution judiciaire – magistrats, fonctionnaires et personnels de greffe. S’agissant enfin des moyens légaux, la commission des Lois saura prendre les responsabilités qui sont les siennes pour garantir aux citoyens une France plus sûre dans un monde incertain. Nous exercerons notre droit d’amendement en préservant l’économie générale du projet de loi ainsi que ses ambitions.
M. Patrick Devedjian, rapporteur. Vous avez affirmé, monsieur le garde des Sceaux, que le projet de loi qui nous est présenté ce matin avait été longuement pensé : c’est exact. Il me semble néanmoins avoir déraillé.
Afin de préparer l’examen de ce texte, notre Commission avait institué une mission d’information relative à la réforme de la procédure pénale, dont les rapporteurs furent l’actuel président de notre commission et moi-même, et qui a notamment auditionné le directeur des affaires criminelles et des grâces. En outre, et comme vous l’avez indiqué, la Chancellerie s’est appuyée sur les trois rapports que vous avez cités. L’essentiel des réflexions contenues dans ces rapports n’est cependant que très partiellement repris dans le texte du Gouvernement. En effet, le problème de la justice judiciaire réside principalement dans son encombrement et son enlisement dans les contentieux de masse. Il est donc indispensable de simplifier les procédures pour rendre à la justice judiciaire sa capacité de réaction. Pierre Drai, alors Premier président de la Cour de cassation, disait : « La justice apporte des solutions mortes à des questions mortes. » Voilà qui appelle des remèdes importants. Pourtant, le problème des contentieux de masse, auquel une grande partie de la réflexion est consacrée, est aujourd’hui écarté. Les auditions auxquelles nous avions procédé montrent que pareille omission entraînera une grande déception.
Nous nous trouvons dans une situation paradoxale. En effet, au moment où le Gouvernement proclame de plus en plus, et à juste raison, la nécessaire indépendance de l’ordre judiciaire – avec en perspective la réforme du Conseil supérieur de la magistrature –, nous assistons à deux phénomènes préoccupants : d’une part, à l’enlisement de la justice judiciaire dans les contentieux de masse, qui la prive de toute autonomie réelle ; d’autre part, et plus grave encore, au transfert d’une grande partie des compétences du juge judiciaire vers le juge administratif, sans d’ailleurs que personne ne se pose la question de l’indépendance de ce dernier. Sans doute est-ce la dévitalisation – peut-être consentie – de la justice judiciaire qui conduit à de tels transferts de compétences. Il ne sert à rien de dénoncer l’insuffisante indépendance de l’ordre judiciaire lorsqu’on transfert vers la justice administrative l’essentiel de ses compétences. Le discours sur l’indépendance est malvenu : il est inadéquat et quelque peu hypocrite.
C’est avec inquiétude que j’ai entendu le ministre de l’Intérieur dire que si l’article 66 de la Constitution, qui donne compétence aux magistrats judiciaires en matière de protection des libertés individuelles, demeurait, son sens est en réalité de plus en plus réduit. Désormais, en effet, le juge judiciaire serait compétent en matière de privation de liberté mais pas de restriction de liberté, domaine qui échoirait au juge administratif. Or, j’avais appris au cours de mes leçons de droit – très anciennes – que la liberté était indivisible. Il semble là qu’on veuille pratiquer une césure dans le traitement des libertés. Seule la privation de liberté de longue durée serait contrôlée par le juge judiciaire puisque jusqu’à douze heures de privation, le juge administratif serait compétent. Et dans le cadre de l’état d’urgence, on va très au-delà.
Le Premier président de la Cour de cassation a ainsi publié une note dans laquelle il se demande si, compte tenu de cette évolution et de ces transferts – sanctionnés de longues date par la jurisprudence du Conseil d’État et du Conseil constitutionnel –, le temps n’est pas venu, afin de garantir l’indépendance, de fusionner la justice administrative et la justice judiciaire.
M. le garde des Sceaux. Je commencerai par aborder la question des moyens de la justice qui n’est pas directement liée à ce projet de loi mais qui est en réalité le défi principal auquel je serai confronté dans les quinze mois qui viennent et que Mme Capdevielle vient d’évoquer. Comme je l’ai souligné lors de ma première intervention publique, à l’occasion de la passation de pouvoirs entre Christiane Taubira et moi-même, c’est à la loi de finances que je dois consacrer toute mon énergie. On peut adopter de nombreuses lois et ouvrir tous les postes que l’on veut, si l’on ne donne pas à la justice les moyens de fonctionner, on ne créera pas de vrais droits. Nous devons faire en sorte que les droits votés soient des droits appliqués. Ce ne sont pas les dix jours que je viens de passer à la Chancellerie qui m’ont fait changer d’avis sur ce point : chaque dossier que j’ouvre me renvoie à ce manque de moyens. En l’espèce, les responsabilités supplémentaires que nous donnons au juge des libertés et de la détention engageront nécessairement des moyens. Nous devrons consacrer l’énergie nécessaire à cette question et je compte sur le soutien de la commission des Lois de l’Assemblée nationale lors du vote de la loi de finances. Je suis naturellement à la disposition des parlementaires pour me rendre dans les juridictions car il n’est de meilleur moyen de nourrir une argumentation que de voir ce qui se fait en leur sein.
M. Patrick Devedjian vient de souligner un point important. On pense toujours à la justice pénale. Mais en dépit des multiples maux auxquels elle est confrontée, celle-ci bénéficie d’un atout : l’encadrement de ses procédures dans des délais. En revanche, dans la justice civile, la justice du quotidien – celle du surendettement, des prud’hommes et du divorce – , l’attente est la règle. Chaque jour que je passe à la Chancellerie, je commence par lire ce que les présidents et procureurs disent à l’occasion des audiences. La situation n’est d’ailleurs pas identique sur tout le territoire. Il est des juridictions dans lesquelles la situation n’est certes pas confortable mais, du moins, acceptable tandis que certains tribunaux sont à l’agonie. Sans doute faut-il donc hiérarchiser les urgences. Il n’est pas acceptable que des justiciables abdiquent dans l’exercice de leurs droits parce que nous ne sommes pas capables de faire fonctionner la justice. La question des moyens sera donc pour moi une bataille centrale pour garantir l’exercice des droits votés.
Mme Capdevielle m’a interrogé concernant l’article 33 du projet de loi qui habilite le Gouvernement à légiférer par ordonnances. Quelques-unes de celles-ci visent à la transposition de directives européennes, d’autres tirent les conséquences de questions prioritaires de constitutionnalité. Si l’Assemblée nationale souhaite transformer ces habilitations en articles au sein du présent projet de loi, je n’y serai pas opposé dans la mesure où leur objet est très précis.
En ce qui concerne le renforcement à venir du statut du juge des libertés et de la détention, au-delà de la question des moyens que j’ai déjà évoquée, un aspect du texte mérite d’être rappelé et clarifié, à en croire les commentaires que j’ai pu lire ou entendre de la part des représentants de professions juridiques que j’ai rencontrés. Je songe notamment aux représentants d’organisations d’avocats – le Conseil national des barreaux, le Barreau de Paris, la Conférence des bâtonniers – que j’ai croisés hier lorsque vous les auditionniez. Les garanties que nous apportons pour préserver la sérénité du juge des libertés et de la détention dans l’exercice de ses fonctions sont, j’en suis convaincu, utiles et attendues par la profession. Dans l’état actuel du droit, le juge ne bénéficie pas de garanties suffisantes : il est désigné par une décision du président de sa juridiction, une décision sur laquelle celui-ci peut à tout moment revenir. L’intention du Gouvernement est de faire du juge des libertés et de la détention un magistrat spécialisé, nommé à ses fonctions par décret après avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature.
À ce propos, j’insiste sur le souhait du Gouvernement de faire aboutir la réforme du CSM. Je crois savoir que M. Georges Fenech n’y est pas hostile. L’Assemblée nationale a voté un texte, le Sénat aussi ; ils sont assez éloignés l’un de l’autre, mais celui du Sénat serait déjà un premier pas appréciable. Le Gouvernement entend donc demander à l’Assemblée nationale de se prononcer sur le texte sénatorial et s’il peut y avoir un vote conforme – je répète ici ce que le Président de la République a dit vendredi à Bordeaux devant 366 auditeurs de justice qui prêtaient serment, soit la promotion la plus nombreuse que la Ve République ait connue –, le Gouvernement se saisira du texte en l’état et la Constitution sera modifiée en ce sens. Ce n’était pas l’intention première du Gouvernement, qui défendait un projet plus vaste et, à mon sens, plus ambitieux. Mais l’avis conforme du CSM est une avancée bonne à prendre.
Je reviens au juge des libertés et de la détention, qui serait nommé, à l’instar des autres magistrats spécialisés, pour une durée maximale de dix ans dans une même juridiction et aux mêmes fonctions. Cette réforme figure dans le projet de loi organique, bien connu de vous, relatif aux garanties statutaires, aux obligations déontologiques et au recrutement des magistrats.
En ce qui concerne le durcissement des modalités d’aménagement de peine pour les condamnés terroristes, je n’y suis pas hostile ; je pense que cette question, qui n’a jamais été débattue quant au fond, mérite de l’être. Si l’on veut conserver le principe d’individualisation des peines – que personne, j’imagine, n’entend remettre en cause –, on peut discuter de cette possibilité pour les détenus les plus signalés ou dangereux. Au sein de la magistrature, le président du tribunal de grande instance de Paris a déjà évoqué quelques éléments qui seraient utiles pour éclairer l’Assemblée nationale.
J’en viens à la protection des témoins, un sujet évidemment sensible. Le régime de protection des témoins a été créé en 2004 par la loi dite « Perben II », mais n’est applicable que depuis deux ans. Il coûte 450 000 euros par an, financés par l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués – quand les Italiens consacrent depuis des années plusieurs millions par an au dispositif équivalent. Il existe aujourd’hui une commission nationale de protection et de réinsertion, placée auprès du ministre de l’Intérieur et composée de sept personnes dont, à sa tête, Mme Anne Kostomaroff, avocat générale près la cour d’appel de Paris. C’est cette commission qui délivre le statut de collaborateur de justice et qui décide du niveau de protection accordé. Les dossiers lui sont soumis par des magistrats et la gestion est confiée au bureau de protection des repentis au sein du service interministériel d’assistance technique (SIAT), qui relève de la direction centrale de la police judiciaire. Une modification est aujourd’hui proposée afin d’apporter des éléments utiles concernant la base légale de ce dispositif, qui paraît en effet perfectible.
J’en viens au trafic d’armes et à son lien avec le terrorisme. Même si le Gouvernement est un, ce sujet concerne prioritairement le ministre de l’Intérieur, qui a présenté un plan de lutte contre le trafic d’armes, ainsi que le ministre de l’économie et des finances, qui a la tutelle des douanes. Voici ce que je puis vous en dire de mon côté : depuis 2014, 6 000 armes sont saisies chaque année et la mise en œuvre de l’état d’urgence a permis d’accroître notablement ce nombre ; 212 infractions à la législation sur les armes font actuellement l’objet de poursuites. Le lien avec le terrorisme est évident : on a observé que les auteurs des récents attentats étaient lourdement armés. En la matière, la coopération européenne est absolument nécessaire, afin d’harmoniser les législations. Les Anglais, en particulier, ont réussi à juguler le trafic d’armes ; il est vrai que l’insularité est un avantage que nous n’avons pas, mais nous pourrions utilement nous inspirer des techniques qu’ils ont utilisées.
En ce qui concerne les coopérations à propos desquelles vous m’avez interrogé, vous comprendrez que, par strict respect des responsabilités de chacun, je laisse à mes collègues le privilège de vous répondre dans l’hémicycle.
S’agissant de la compétence spécifique de la juridiction parisienne en matière de cybercriminalité, l’idée vient du Sénat : le président de la commission des Lois M. Philippe Bas l’a fait figurer dans la proposition de loi qu’il a défendue la semaine dernière. J’y suis défavorable. Le « rapport Robert », que j’ai souvent eu l’occasion d’évoquer et que M. Patrick Devedjian a également mentionné, invite à reconnaître une compétence concurrente au tribunal de grande instance de Paris pour les seules atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données (STAD) visant les services de l’État et les opérateurs d’importance vitale, et une compétence résiduelle aux juridictions interrégionales spécialisées (JIRS) pour l’ensemble des autres cyberaffaires commises en bande organisée.
En ce qui concerne la protection de l’État et des opérateurs d’importance vitale face au cyberterrorisme, rappelons qu’en France, on a fait le choix de séparer les activités de cyberoffensive, confiées à l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI), de celles de cyberdéfense, qui relèvent des services. Le Secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale (SGDSN) organise leur coopération. Les effectifs de l’ANSSI ont très fortement augmenté depuis la création de l’agence en 2009, passant de 120 agents à l’origine à 250 en 2012, puis à 360 en 2013, enfin à 500 aujourd’hui. Le Gouvernement a ainsi indiqué clairement que la mission de l’agence est pour lui une priorité. De fait, l’ANSSI joue un rôle déterminant dans la protection de l’État et des opérateurs d’importance vitale et je ne doute pas que M. Guillaume Poupard, son directeur général, serait ravi de venir vous en parler.
Quant à la retenue administrative, prévue à l’article 18 du texte, sa durée – quatre heures – ne vient pas de nulle part : elle a été validée par le Conseil constitutionnel en matière de vérification d’identité. Cette durée sera naturellement imputée sur celle de la garde à vue si cette mesure est ensuite ordonnée.
La modification des règles d’usage des armes par les policiers a fait l’objet d’un engagement du Président de la République lors de la réunion organisée le 22 octobre dernier à l’Élysée, puis d’un groupe de travail auquel plusieurs parlementaires de votre commission ont participé, dont Mme Élisabeth Pochon et M. Éric Ciotti. Le Conseil d’État a signalé à ce sujet qu’une réflexion plus globale méritait d’être conduite. Néanmoins, ces questions relèvent elles aussi du ministre de l’Intérieur, chargé du pilotage ; je me réserve donc de lui demander s’il est ouvert ou non à des amendements.
Les individus qui pourraient être concernés par l’article 20 en raison de leur retour de Syrie sont aujourd’hui 250, d’après les chiffres fournis par le ministère de l’Intérieur. Je veux souligner le caractère novateur de l’alternative proposée, qui inclut des possibilités de déradicalisation ou de réinsertion. En la matière, l’offre mérite d’être structurée. Mais le ministre de la justice, tant au sein de l’administration pénitentiaire que de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ), a conduit des réflexions que je découvre et qui méritent à mon avis d’être valorisées. Naturellement, le Parlement a déjà élaboré sa doctrine, comme en témoigne le rapport de M. Sébastien Pietrasanta. Le rôle du secteur associatif, trop méconnu, mérite une attention particulière.
J’en viens à l’équilibre entre procureur et juge d’instruction, évoqué par Mme Capdevielle et dont j’ai constaté qu’il suscitait beaucoup d’interrogations. Le rôle du juge d’instruction n’est pas remis en cause ; je crois même avoir dit en commençant que je souhaitais que le projet de loi le renforce. Mais il est nécessaire de renforcer également les prérogatives du procureur, pour deux raisons. Premièrement, plus de 97 % des enquêtes sont aujourd’hui conduites sous son contrôle, sans qu’un juge d’instruction ne soit saisi. Il importe donc de lui donner les moyens nécessaires à l’élucidation de ces affaires. Deuxièmement, dans les 3 % d’affaires qui nécessitent la saisine d’un juge d’instruction, il faut permettre au procureur de diligenter les premières investigations afin d’être en mesure de saisir le juge lorsque cela est justifié, sans l’engorger inutilement – un drame auquel toutes les juridictions sont confrontées. Cette idée d’équilibre, quelque peu galvaudée, a vraiment servi de boussole dans la préparation de ce texte. Le procureur ne décide pas seul, mais uniquement sur autorisation du juge des libertés et de la détention ; et la durée de validité de sa décision est inférieure à celle des décisions du juge d’instruction.
S’agissant enfin de la place de la police administrative, M. Devedjian est libre d’adopter une interprétation plus limitative, mais il existe de nombreuses décisions du Conseil constitutionnel – entre 50 et 100 depuis 1999, ce qui témoigne d’une certaine stabilité – qui confient à la police administrative la restriction de liberté et à l’autorité judiciaire la privation de liberté, en référence aux articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.
M. le président Dominique Raimbourg. Avant de laisser la parole aux représentants des groupes, je précise, afin d’éviter par avance toute frustration, que la discussion générale pourra se poursuivre à l’occasion de la prochaine réunion et de l’examen des amendements.
M. Georges Fenech. Avec le ministre ?
M. le garde des Sceaux. Le ministre est convoqué tous les mercredis matin, de dix heures à midi, à une réunion où il n’est pas prévu que l’on puisse être excusé – fût-ce au nom de la souveraineté du Parlement à laquelle je suis très attaché ! (Sourires)
M. Éric Ciotti. Je m’exprimerai au nom du groupe Les Républicains.
Ce projet de loi est le cinquième texte de lutte contre le terrorisme depuis 2012. En 2012, nous avions réclamé un projet de loi d’orientation et de programmation financière destiné à lutter contre le terrorisme. Je regrette que nous n’ayons pas été écoutés.
Dans un contexte de menace extrêmement élevée – le Premier ministre l’a encore rappelé –, le présent texte introduit des dispositions dont une partie nous semble positive. Toutefois, à bien des égards, il nous paraît très largement inachevé. Nous espérons que, grâce au débat parlementaire, et grâce à votre accession à la Chancellerie, monsieur le garde des Sceaux – je vous en félicite à nouveau, mais je forme aussi pour vous des vœux de courage, car vous avez à remédier à une situation passablement dégradée –, ce projet de loi ne restera pas une occasion manquée.
Le dispositif proposé souffre de graves lacunes. C’est un dispositif beaucoup plus large, plus complet, plus élaboré que nous défendrons par voie d’amendement. Car ce texte doit être l’occasion d’une rupture profonde avec la politique pénale portée par Mme Taubira. Ainsi, nous proposerons de rétablir les « peines plancher », qui étaient très efficaces contre la délinquance, et de revenir sur la contrainte pénale. Le texte doit aussi permettre d’instaurer un véritable dispositif de renseignement pénitentiaire – que vous avez défendu dans d’autres fonctions, monsieur le ministre.
Il convient en outre de se prémunir contre le retour des djihadistes. À ce sujet, permettez-moi d’évoquer le témoignage diffusé dans les médias de la personne qui a permis d’arrêter Abaaoud et, ainsi, d’empêcher de terribles attentats. Outre qu’il soulève des questions pertinentes sur la protection des témoins – le sort réservé à cette personne était manifestement inadapté compte tenu du service qu’elle a rendu à la nation –, il nous apprend que, d’après ce qu’Abaaoud a déclaré à Hasna Aït Boulahcen, 90 djihadistes sont rentrés en même temps que lui et se cachent actuellement en Île-de-France. C’est terrifiant ! Cela nous ramène au problème de leur détection et, plus généralement, du traitement des retours – un point essentiel ; nous ne cessons de le répéter depuis la loi présentée par M. Manuel Valls en 2012 et nous y insistons plus encore aujourd’hui. Vous prévoyez un dispositif d’assignation à résidence de quelques heures. Je n’ignore pas les contraintes qu’impose la jurisprudence du Conseil constitutionnel, mais la réforme que vous avez engagée aurait pu être l’occasion d’une disposition fort utile à cet égard. Le problème des retours doit être au cœur de nos débats. Comment protéger notre pays de leurs conséquences ?
En ce qui concerne la protection des forces de l’ordre, le dispositif limité au cas des tueurs de masse n’est absolument pas suffisant. Vous l’avez dit vous-même à mots choisis, monsieur le garde des Sceaux : l’avis du Conseil d’État, particulièrement éclairant sur ce point, signale que le dispositif risque de contraindre davantage les forces de l’ordre lorsqu’elles mobilisent la force armée dont elles ont le monopole. Nous défendrons donc, dans le sillage de la proposition de loi que j’avais déposée avec MM. Guillaume Larrivé, Philippe Goujon et Olivier Marleix, un dispositif beaucoup plus large prenant notamment en considération les notions de danger imminent et de violence grave.
Mme Cécile Untermaier. Monsieur le ministre, au nom du groupe Socialiste, républicain et citoyen, je vous félicite à nouveau de votre nomination. Vous avez brillamment présidé la commission des Lois ; vous êtes un universitaire tout aussi brillant, et l’exigence qui caractérise cette profession ne pourra qu’influencer très favorablement l’exercice de la très haute responsabilité qui vous revient.
Notre groupe a désigné trois représentants sur ce projet de loi : M. Yves Goasdoué, Mme Élisabeth Pochon et moi-même. Nous avons apprécié que vous rappeliez le travail mené en amont à la Chancellerie : on ne peut pas parler de précipitation à propos du texte qui arrive devant nous, même si l’accélération du rythme pose des problèmes aux députés et particulièrement aux rapporteurs – mais nous ferons tout pour que la qualité et le niveau d’exigence du projet n’en pâtissent pas.
Nous sommes naturellement très favorables à ce texte qui tend à adapter le dispositif législatif au besoin de sécurité et à l’assortir d’une exigence nouvelle de prévention des risques menaçant la vie de la nation comme des individus.
La simplification sur laquelle vous avez insisté est essentielle. Elle suppose de libérer le juge du contentieux de masse et de le réinstaller dans son rôle, le cas échéant en réorganisant ses missions pour le soulager de travaux en commission qui l’accaparent trop. Ce sont des questions qu’il faudra poser. En outre, la simplification organisationnelle et des mesures de modernisation du dispositif sont indispensables.
Vous l’avez rappelé, les moyens budgétaires doivent être accrus. Nous serons à vos côtés pour rappeler que la justice mérite cet effort. Nous pouvons tous en témoigner, les juridictions sont en souffrance, pas seulement en Île-de-France mais dans tout le pays. Les parquets craquent !
La loi soulève aussi le problème de la place des magistrats du ministère public. De fait, le moment nous paraît opportun pour nous interroger sur le renforcement du statut du procureur, au regard des exigences constitutionnelles et conventionnelles. Vous l’avez également indiqué.
Le statut du juge des libertés et de la détention, élément important du dispositif, est prévu par le projet de loi organique relatif aux garanties statutaires, aux obligations déontologiques et au recrutement des magistrats. Nous apprécions bien sûr tout particulièrement l’idée que sa nomination sera soumise à l’avis conforme du CSM.
Les dispositions du texte consacrées à Tracfin sont en parfaite cohérence avec la loi de 2015 sur le renseignement, qu’elles complètent très utilement. Je songe en particulier aux mesures concernant les cartes prépayées et à la nouvelle infraction de trafic de biens culturels. C’est tout à fait essentiel.
À mes yeux, avec ce texte, nous travaillons bien et de manière cohérente. La cohérence finale viendra du texte sur la justice du xxie siècle qui traitera du public, du justiciable, de son attente et de la réorganisation qu’elle exige, de l’accueil et de l’accès au droit des citoyens.
Je vous transmets également, à sa demande, une observation de Mme Mazetier, qui conteste la sévérité de l’avis du Conseil d’État sur le projet de loi.
Enfin, s’agissant tout particulièrement de Tracfin, nous nous interrogeons sur l’absence de frontières. Un dispositif européen et international accompagne-t-il les mesures prises pour leur donner toute l’efficacité requise ?
M. Noël Mamère. Monsieur le ministre, je vous félicite à mon tour de votre nomination. Je n’ai pas siégé à la commission des Lois lorsque vous en étiez président, mais j’ai pu y apprécier vos qualités de juriste au cours de la précédente législature.
J’ai écouté avec intérêt votre exposé introductif, qui était une sorte de défense et illustration de l’État de droit. Mais on a le sentiment, à la lecture du projet de loi, qu’il ne s’agit que d’une vitrine. En réalité, le texte contribue à installer dans le droit commun des dispositions qui relèvent aujourd’hui de l’état d’urgence. Il a surtout le grave défaut de faire passer le juge judiciaire après le policier, le procureur et le préfet – qui entre pour la première fois dans le code de procédure pénale.
Je me contenterai de citer ici de hauts magistrats, les premiers présidents des cours d’appel, dans leur délibération commune du 14 janvier dernier : le texte « contient des dispositions dangereuses pour les libertés et gravement contraires aux droits de l’homme » – et d’en citer quatre exemples : « l’assignation à résidence par l’autorité préfectorale pour des motifs imprécis et sans autorisation ni contrôle du juge judiciaire, l’extension juridiquement inutile, au regard des critères actuels de la légitime défense, de l’usage des armes par les forces armées et de sécurité intérieure, des perquisitions de nuit dans les domiciles par les forces de police, en enquête préliminaire, hors flagrant délit, des retenues, à l’initiative de l’autorité préfectorale, créant une garde à vue administrative ».
Je formulerai pour ma part les observations suivantes.
D’abord, le projet de loi, qui a pour vocation d’alourdir l’arsenal pénal et administratif antiterroriste, introduit – c’est son vice originel – trop de pouvoirs dérogatoires, au sein du code de procédure pénale comme du code de la sécurité intérieure. Il était pourtant censé renforcer les garanties du procès équitable, notamment du contradictoire par l’accès au dossier ; ce n’est pas le cas.
Ensuite – je ne suis pas seul ici à le dire –, le juge d’instruction est marginalisé au profit du juge des libertés et de la détention dont le statut, fragile, reste à préciser par une loi organique et qui, déjà « surbooké », aura bien du mal, dans l’urgence, à juger de la proportionnalité des mesures dont il devra décider. C’est une régression de la place du juge d’instruction, normalement chargé des enquêtes les plus lourdes.
L’article 17 illustre parfaitement le recul du juge judiciaire au profit des forces de police et de l’autorité administrative. Je songe en particulier à la fouille des véhicules, à l’inspection visuelle et à la fouille des bagages.
En outre, ce texte vient après toute une série de dispositions législatives relatives au terrorisme qui ont été votées sans faire l’objet de la moindre évaluation. Le décompte de notre collègue Éric Ciotti est erroné. Depuis 1986 ont été votées : la loi du 9 septembre 1986, qui introduit un régime dérogatoire au droit commun ; celle de 1996, qui crée l’association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un acte de terrorisme ; celle de 2001 relative à la sécurité quotidienne, qui autorisait à titre temporaire, jusqu’au 31 décembre 2003, la fouille des véhicules – mais comme par hasard, le 18 mars 2003, une loi a pérennisé les outils de procédure pénale. Voilà qui rappelle les prélèvements ADN qui devaient être limités aux délinquants sexuels et sont maintenant pratiqués sur des syndicalistes ou sur des faucheurs volontaires : c’est un bon exemple de la manière dont une loi temporaire peut devenir permanente. Ensuite, la loi du 9 mars 2004 a institué une procédure pénale bis, avec ses infractions dites de délinquance ou de criminalité organisée. La loi de 2006 impose à tout opérateur de télécommunications et à tout fournisseur d’accès de conserver les données de connexion pendant un an et porte la durée de la garde à vue de quatre à six jours. La loi du 14 mars 2011, dite « LOPPSI II », accroît le recours aux traitements automatisés de données à caractère personnel. Celle du 13 novembre 2014 renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme prévoit des interdictions administratives d’entrée sur le territoire ou de sortie du territoire. Vient enfin la loi de juillet 2015 relative au renseignement.
Le texte prévoit trop d’ordonnances – plus d’une vingtaine : ce n’est rien d’autre qu’une forme de mépris envers le Parlement, qui devrait pouvoir connaître des dispositions concernées. Il est toujours dangereux de légiférer par ordonnance.
J’ai entendu dire que nous connaissions parfaitement les IMSI-catchers ; en effet : nous savons qu’il s’agit d’espionnage de masse, du premier pas vers une société de type orwellien. Dans la mesure où le juge judiciaire, entièrement effacé, ne peut protéger nos libertés individuelles, nous avons toutes les raisons de nous inquiéter.
Il a enfin été question d’un débat intéressant, qui n’a jamais été ouvert dans cette maison. Il concerne le Conseil d’État, créé par Napoléon – vous savez, cet organe qui juge qu’il ne faut pas construire le pont sur l’île de Ré une fois que celui-ci est terminé, ou qui rend un arrêt considérant comme illégal un barrage, d’ailleurs tout proche de Sivens, qui n’en est pas moins resté en place… Je vous conseille vivement la lecture d’une tribune publiée aujourd’hui dans Libération par un chercheur, sous le titre « Le Conseil d’État, verrou de l’Élysée ». Comment le juge administratif peut-il à la fois dire le droit et conseiller le prince ? Ce sujet mérite tout notre intérêt lorsque nous réfléchissons aux réformes à venir : sans doute devrions-nous envisager la suppression du Conseil d’État.
Mme Marietta Karamanli. Membre de la commission des affaires européennes, j’aimerais vous demander une précision, monsieur le ministre. Vous avez évoqué la nécessaire coopération européenne. Or la directive relative au contrôle de l’acquisition et de la détention d’armes est en cours de révision. Cette question doit faire l’objet d’une communication à la commission des affaires européennes dans quinze jours. Vous avez signalé nos difficultés à imposer la vision française, laquelle rejoint dans une certaine mesure celle du Royaume Uni. Comment le présent texte s’articule-t-il avec les discussions au niveau européen sur cette directive, qui a été amendée parce qu’elle a révélé des failles dans la législation européenne ? Comment s’appuyer sur ce texte pour aller un peu plus loin ?
Par ailleurs, l’article 1er introduit une référence nouvelle à la prévention d’un risque d’atteinte à la vie ou à l’intégrité physique. Qu’apporte-t-elle de plus ?
M. Guillaume Larrivé. J’aimerais formuler une remarque de méthode et de principe sur le processus d’élaboration de la loi.
J’entends bien que plusieurs hauts magistrats s’expriment à ce sujet, mais je ne voudrais pas que certains se croient autorisés à ressusciter les remontrances des Parlements d’Ancien Régime. Je suis trop attaché à la conception classique de la séparation des pouvoirs pour ne pas demander que chacun fasse son office. Nous sommes le législateur, nous sommes même parfois le constituant ; nous le sommes pleinement ; et, si le dialogue avec telle ou telle personnalité du monde judiciaire est tout à fait souhaitable, il me semble que chacun doit rester dans son champ. Il n’appartient pas à l’autorité judiciaire de formuler des recommandations ni de suggérer des orientations au pouvoir législatif.
M. le président Dominique Raimbourg. Voulez-vous répondre aux orateurs, monsieur le ministre ?
M. le garde des Sceaux. Monsieur le président, vous êtes très aimable de me redonner la parole ; mais, à cette heure avancée, je crois préférable de garder nos arguments pour l’examen des articles. J’avais prévu de répondre à des parlementaires qui n’ont pas eu la courtoisie d’attendre ma réponse avant de partir ; je ne le ferai donc pas.
M. le président Dominique Raimbourg. Il nous reste à vous remercier, monsieur le ministre.
*
* *
Lors de sa réunion du mercredi 17 février 2016, la commission des Lois poursuit l’examen, sur le rapport de Mme Colette Capdevielle et de M. Pascal Popelin, du projet de loi renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale (n° 3473).
M. le président Dominique Raimbourg. Nous avons entendu la semaine dernière le garde des Sceaux sur le projet de loi renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale. Nous poursuivons aujourd’hui nos travaux à un rythme soutenu, et je remercie nos rapporteurs, Mme Colette Capdevielle et M. Pascal Popelin, le rapporteur pour avis de la commission des Finances, M. Yann Galut, et les administrateurs, qui ont travaillé dans des conditions difficiles.
Je suis intervenu auprès de la présidence pour que le délai de dépôt des amendements en séance soit repoussé du vendredi 26 au lundi 29 février, à 17 heures. La Conférence des Présidents en a accepté le principe. De plus, l’examen des articles ne commencera que le mercredi 2 mars, les séances de la veille étant consacrées à la seule discussion générale. J’attire également votre attention sur le fait que les séances du vendredi 4 mars ont été ouvertes.
Je propose à présent de donner la parole au rapporteur pour avis, qui ne s’est pas exprimé la semaine dernière, puis d’en venir à l’examen des articles du projet de loi.
M. Yann Galut, rapporteur pour avis de la commission des finances. J’ai été saisi pour avis du chapitre IV du titre Ier du projet de loi, relatif à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, ainsi que de l’article 33, au chapitre II du titre II, autorisant le Gouvernement à procéder par voie d’ordonnance afin de transposer en droit interne la directive européenne du 20 mai 2015, dite « quatrième directive anti-blanchiment », ainsi que le règlement européen portant sur les informations accompagnant les transferts de fonds.
Les mesures sur lesquelles j’ai eu à me prononcer constituent des avancées majeures. Elles permettent tout d’abord de renforcer les moyens d’action des deux acteurs essentiels que sont Tracfin et les services douaniers, dans la lutte contre le financement du crime organisé et du terrorisme. Ensuite, en encadrant l’utilisation des cartes prépayées, le projet de loi tire les conséquences nécessaires de l’apparition, au sein des organisations criminelles, de nouvelles pratiques de financement. Ces mesures semblent satisfaire les acteurs concernés, ce qui tend à prouver qu’elles sont opérationnelles.
Ce projet de loi a fait l’objet d’une procédure accélérée, ce qui était souhaitable au vu du contexte actuel mais ce qui nous a laissé peu de répit pour creuser d’éventuelles pistes d’amélioration. J’ai néanmoins profité du peu de temps qui m’était imparti pour travailler sur certaines propositions qui viendront utilement renforcer et sécuriser notre corpus juridique de lutte contre le financement du terrorisme et le blanchiment des capitaux. J’ai déposé à cet effet devant la commission des finances onze amendements, dont huit ont été adoptés ; j’ai fait le choix de retirer les trois autres, qui portaient sur des sujets plus polémiques et demandaient donc un temps de réflexion supplémentaire. Je me suis par ailleurs engagé à redéposer l’ensemble de ces amendements en séance, afin qu’ils puissent donner lieu à un débat constructif.
Les principales avancées adoptées en commission des finances sont les suivantes : plafonnement du rechargement en liquide des cartes prépayées ; exonération de responsabilité et sécurisation de l’environnement juridique des banques lorsqu’elles agissent dans le cadre d’un nouvel appel à vigilance de Tracfin ; possibilité pour les douanes de mener des enquêtes sous pseudonyme et possibilité pour ces mêmes services de recourir au prélèvement d’échantillons.
Je souhaite maintenant avancer sur les points suivants dans la perspective de la discussion en séance : donner compétence en matière de lutte contre le financement du terrorisme aux services des douanes ou, a minima, aux services de la douane judiciaire ; renforcer l’obligation déclarative en abaissant le seuil à 5 000 euros pour les transferts intracommunataires ; pour les montants les plus importants, imposer des documents permettant de justifier de la provenance des fonds et rendre parallèlement plus dissuasif le manquement à cette obligation déclarative en renforçant les sanctions pécuniaires, voire en érigeant ce manquement en délit.
La Commission en vient à l’examen des articles.
TITRE IER
DISPOSITIONS RENFORÇANT LA LUTTE CONTRE LE CRIME ORGANISÉ,
LE TERRORISME ET LEUR FINANCEMENT
Chapitre Ier
Dispositions renforçant l’efficacité des investigations judiciaires
Article 1er
(art. 706-90 à 706-92 du code de procédure pénale)
Perquisitions de nuit dans les locaux d’habitation en matière de terrorisme
Le présent article porte sur les perquisitions de nuit dans les locaux d’habitation en matière de terrorisme. Il les autorise, sur décision préalable et motivée du juge des libertés et de la détention (JLD), en enquête préliminaire, et les facilite au cours d’une information judiciaire lorsqu’elles sont nécessaires à la prévention d’un risque d’atteinte à la vie ou à l’intégrité physique.
1. La perquisition de nuit dans un local d’habitation, une mesure réservée à l’enquête de flagrance et, sous certaines conditions, à l’information judiciaire conduites en matière de criminalité et de délinquance organisées
En vertu de l’article 59 du code de procédure pénale, les perquisitions et les visites domiciliaires ne peuvent être commencées, sauf exception, qu’entre 6 heures et 21 heures. Le code de procédure pénale prévoit deux exceptions à cette règle, pour lutter contre le proxénétisme ou le recours à la prostitution de mineurs d’une part (article 706-35), et en matière de criminalité et de délinquance organisées, dont relève le terrorisme (voir l’encadré ci-après), d’autre part (articles 709-89 à 706-94).
S’agissant de la criminalité et de la délinquance organisées, les perquisitions de nuit sont possibles dans les conditions suivantes :
– en enquête de flagrance, le JLD peut, à la demande du procureur de la République, autoriser les perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction la nuit, y compris dans un local d’habitation (article 706-89) ;
– en enquête préliminaire, le JLD peut, dans les mêmes conditions, autoriser ces opérations de nuit qui ne peuvent cependant pas concerner des locaux d’habitation (article 706-90) ;
– au cours d’une information judiciaire, le juge d’instruction peut autoriser les officiers de police judiciaire (OPJ) agissant sur commission rogatoire à procéder aux mêmes opérations à condition qu’elles ne concernent pas des locaux d’habitation sauf, en cas d’urgence, dans trois hypothèses : « [l]orsqu’il s’agit d’un crime ou d’un délit flagrant » (1°), « [l]orsqu’il existe un risque immédiat de disparition des preuves ou des indices matériels » (2°) ou « [l]orsqu’il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’une ou plusieurs personnes se trouvant dans les locaux (…) sont en train de commettre des crimes ou des délits » (3°) relevant du champ de la criminalité et de la délinquance organisées (article 706-91).
Liste des infractions concernées par la procédure applicable
à la criminalité et à la délinquance organisées
L’article 706-73 définit les infractions relevant de l’intégralité du régime procédural spécial de la criminalité et de la délinquance organisées :
1° Crime de meurtre commis en bande organisée ;
2° Crime de tortures et d’actes de barbarie commis en bande organisée ;
3° Crimes et délits de trafic de stupéfiants ;
4° Crimes et délits d’enlèvement et de séquestration commis en bande organisée ;
5° Crimes et délits aggravés de traite des êtres humains ;
6° Crimes et délits aggravés de proxénétisme ;
7° Crime de vol commis en bande organisée ;
8° Crimes aggravés d’extorsion ;
9° Crime de destruction, dégradation et détérioration d’un bien commis en bande organisée ;
10° Crimes en matière de fausse monnaie ;
11° Crimes et délits constituant des actes de terrorisme ;
12° Délits en matière d’armes et de produits explosifs commis en bande organisée ;
13° Délits d’aide à l’entrée, à la circulation et au séjour irréguliers d’un étranger en France commis en bande organisée ;
14° Délits de blanchiment ou de recel du produit, des revenus et des choses provenant des infractions mentionnées aux 1° à 13° ;
15° Délits d’association de malfaiteurs, lorsqu’ils ont pour objet la préparation de l’une des infractions mentionnées aux 1° à 14° et 17° ;
16° Délit de non-justification de ressources correspondant au train de vie, lorsqu’il est en relation avec l’une des infractions mentionnées aux 1° à 15° et 17° ;
17° Crime de détournement d’aéronef, de navire ou de tout autre moyen de transport commis en bande organisée ;
18° Crimes et délits punis de dix ans d’emprisonnement, contribuant à la prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs entrant dans le champ d’application de l’article 706-167 du code de procédure pénale ;
19° Délit d’exploitation d’une mine ou de disposition d’une substance concessible sans titre d’exploitation ou autorisation, accompagné d’atteintes à l’environnement, commis en bande organisée, lorsqu’il est connexe avec l’une des infractions mentionnées aux 1° à 17° du présent article.
L’article 706-73-1, récemment introduit dans le code de procédure pénale par la loi n° 2015-993 du 17 août 2015 portant adaptation de la procédure pénale au droit de l’Union européenne, applique également le régime procédural spécial relatif à la criminalité et à la délinquance organisées aux infractions suivantes, à l’exception notable de l’article 706-88 permettant de prolonger la durée de la garde à vue jusqu’à quatre jours et de différer l’intervention de l’avocat jusqu’à la 72e heure :
1° Délit d’escroquerie en bande organisée ;
2° Délits de dissimulation d’activités ou de salariés, de recours aux services d’une personne exerçant un travail dissimulé, de marchandage de main-d’œuvre, de prêt illicite de main-d’œuvre ou d’emploi d’étranger sans titre de travail, commis en bande organisée ;
3° Délits de blanchiment ou de recel du produit, des revenus ou des choses provenant des infractions mentionnées aux 1° et 2° ;
4° Délits d’association de malfaiteurs, lorsqu’ils ont pour objet la préparation de l’une des infractions mentionnées aux 1° à 3° ;
5° Délit de non-justification de ressources correspondant au train de vie, lorsqu’il est en relation avec l’une des infractions mentionnées aux 1° à 4°.
L’article 706-74 du même code dispose que, « [l]orsque la loi le prévoit », la procédure spéciale relative à la criminalité et à la délinquance organisées s’applique également aux crimes et délits suivants :
1° Crimes et délits commis en bande organisée autres que ceux précédemment mentionnés ;
2° Délits d’association de malfaiteurs.
Il est donc possible de pénétrer dans un lieu clos la nuit dans les conditions suivantes :
– en tous lieux clos, y compris un local d’habitation, en enquête de flagrance ;
– dans les lieux clos autres que les locaux d’habitation lors d’une enquête préliminaire ;
– en tous lieux clos, y compris un local d’habitation, lors d’une information judiciaire, sous réserve de satisfaire à l’une des trois conditions mentionnées aux 1° à 3° de l’article 706-91 : flagrance, risque immédiat de dépérissement des preuves, soupçon de commission d’une infraction relevant de la criminalité ou de la délinquance organisées.
Ces perquisitions, visites domiciliaires et saisies ne peuvent, « à peine de nullité », avoir d’autre objet « que la recherche et la constatation des infractions visées dans la décision du juge des libertés et de la détention ou du juge d’instruction » (article 706-93). Les autorisations de procéder à ces opérations doivent, « à peine de nullité », respecter un certain formalisme (article 706-92) :
– « elles font l’objet d’une ordonnance écrite, précisant la qualification de l’infraction dont la preuve est recherchée ainsi que l’adresse des lieux dans lesquels les visites, perquisitions et saisies peuvent être faites » et « motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que ces opérations sont nécessaires » ;
– dans le cas où le juge d’instruction autorise l’une de ces opérations dans un local d’habitation, « l’ordonnance comporte également l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de cette décision par référence aux seules conditions prévues par » les 1° à 3° de l’article 706-91 précité ;
– en toute hypothèse, ces opérations doivent être réalisées sous le contrôle du magistrat qui les a autorisées.
Enfin, l’article 706-94 prévoit des exceptions à la présence nécessaire de la personne concernée. Si la personne au domicile de laquelle la perquisition est faite ne peut y assister et que son transport sur place doit être évité en raison de risques graves de troubles à l’ordre public, d’évasion ou de disparition des preuves, « la perquisition peut être faite (…) en présence de deux témoins requis (…) ou du représentant désigné » par ladite personne, après autorisation préalable du procureur de la République ou du juge d’instruction pour les enquêtes de flagrance ou d’instruction et du JLD en enquête préliminaire « lorsque la perquisition est faite sans l’assentiment de la personne ».
2. Le cadre constitutionnel applicable aux perquisitions de nuit
La faculté pour le législateur d’étendre le recours aux perquisitions de nuit met en cause plusieurs exigences de nature constitutionnelle : d’un côté, la prévention des atteintes à l’ordre public et la recherche des auteurs d’infractions et, de l’autre, l’exercice des libertés constitutionnellement garanties au nombre desquelles figurent la liberté d’aller et venir, l’inviolabilité du domicile privé, le secret des correspondances et le respect de la vie privée, protégés par les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, ainsi que la liberté individuelle, que l’article 66 de la Constitution place sous la surveillance de l’autorité judiciaire. Statuant sur la loi « Perben II » qui étendait notamment le régime des perquisitions de nuit, jusque-là applicable seulement en matière de lutte contre le terrorisme, à la lutte contre la criminalité et la délinquance organisées, le Conseil constitutionnel a jugé :
– en matière de flagrance, qu’« eu égard aux exigences de l’ordre public et de la poursuite des auteurs d’infractions, le législateur [pouvait] prévoir la possibilité d’opérer des perquisitions, visites domiciliaires et saisies de nuit dans le cas où un crime ou un délit relevant de la criminalité et de la délinquance organisées vient de se commettre, à condition que l’autorisation de procéder à ces opérations émane de l’autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, et que le déroulement des mesures autorisées soit assorti de garanties procédurales appropriées » (41) (autorisation du JLD par décision écrite et motivée, contrôle permanent de ce magistrat, nécessité, à peine de nullité, d’avoir pour objet la recherche et la constatation des infractions visées) ;
– dans le cadre de l’instruction, que des perquisitions de nuit « dans certains cas d’urgence limitativement énumérés, [dans] des locaux d’habitation, (…) également subordonnée à une autorisation du juge d’instruction », étaient « justifiées par la recherche des auteurs d’infractions particulièrement graves ou la nécessité d’intervenir dans des locaux où sont en train de se commettre de telles infractions » (42) et ne portaient pas une atteinte excessive au principe de l’inviolabilité du domicile.
En tout état de cause, la perquisition de nuit n’est conforme à la Constitution « que si celle-ci ne peut être réalisée dans d’autres circonstances de temps » (43).
3. La facilitation des perquisitions de nuit dans les locaux d’habitation pour les infractions de terrorisme en cas de risque d’atteinte à la vie ou à l’intégrité physique
Pour tenir compte des exigences particulières posées par la lutte antiterroriste, le présent article assouplit, sous certaines réserves de fond et de forme, les conditions de réalisation des perquisitions de nuit pour les nécessités des seules enquêtes préliminaires et des informations judiciaires relatives aux infractions de terrorisme.
a. En enquête préliminaire
Par dérogation au premier alinéa de l’article 706-90, le 1° prévoit que, pour les besoins de l’enquête concernant des crimes et délits constituant des actes de terrorisme au sens des articles 421-1 à 421-6 du code pénal, des perquisitions de nuit pourraient être réalisées dans des locaux d’habitation « en cas d’urgence », « lorsque la réalisation de cette opération en dehors des heures prévues à l’article 59 est nécessaire afin de prévenir un risque d’atteinte à la vie ou à l’intégrité physique ». Sur requête du procureur de la République, le JLD serait seul compétent pour les autoriser dans les conditions précédemment mentionnées.
b. Au cours d’une information judiciaire
Le 2° procède au même élargissement des possibilités de perquisition de nuit dans des locaux d’habitation dans le cas d’une information judiciaire relative aux crimes et délits constituant des actes de terrorisme au sens des articles 421-1 à 421-6 précités.
Pour ce faire, il complète la liste des circonstances mentionnées aux 1° à 3° de l’article 706-91 du code de procédure pénale, permettant au juge d’instruction, en cas d’urgence, d’autoriser les OPJ à procéder à de telles perquisitions, au cas dans lesquelles ces opérations seraient nécessaires « afin de prévenir un risque d’atteinte à la vie ou à l’intégrité physique ».
Le juge d’instruction serait seul habilité à les autoriser, dans les mêmes conditions que celles précédemment mentionnées. Conformément aux exigences constitutionnelles posées en la matière, le présent article subordonne la possibilité de réaliser de telles perquisitions aux hypothèses limitativement énumérées d’actes de terrorisme risquant de porter atteinte, au sens du code pénal, à la vie – meurtre, assassinat, empoisonnement ou homicide involontaire (44) – ou à l’intégrité physique – tortures ou actes de barbarie, violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner, violences ayant entraîné une mutilation ou infirmité permanente, violences, administration de substances nuisibles, embuscade, atteintes involontaires à l’intégrité de la personne, agressions sexuelles (45).
L’élargissement des conditions de réalisation des perquisitions de nuit dans des locaux d’habitation prolonge l’évolution législative observée au cours de ces dernières années en matière de terrorisme, tendant notamment au renforcement de l’efficacité des enquêtes préliminaires (46), tout en veillant au respect des exigences constitutionnelles. L’autorisation de recourir à ces perquisitions demeure ainsi subordonnée au respect de trois exigences au moins : l’intervention d’un juge du siège, l’existence d’infractions d’une particulière gravité et l’application des garanties procédurales prévues par les articles 706-92 et 706-93 du code de procédure pénale.
Aussi le 3° du présent article prévoit-il que l’ordonnance par laquelle le JLD ou le juge d’instruction autoriserait la perquisition de nuit d’un local d’habitation devrait comporter spécifiquement, outre les éléments mentionnés au premier alinéa de l’article 706-92 précité, « l’énoncé des considérations de droit et de fait qui [en] constituent le fondement ».
Auditionnés par votre rapporteur, plusieurs représentants de la section antiterroriste du tribunal de grande instance (TGI) de Paris – M. François Molins, procureur de la République, Mme Camille Hennetier, vice-procureur et chef de la section antiterroriste, ainsi que Mme Laurence Le Vert, première vice-présidente chargée de l’instruction – ont unanimement salué les avancées proposées par le présent article. Le dispositif répond à une nécessité pour la section antiterroriste dans la mesure où la majeure partie des enquêtes ouvertes du chef d’association de malfaiteurs en vue de commettre des actes de terrorisme le sont sous la forme préliminaire : M. François Molins a ainsi fait observer que, « compte tenu des profils des mis en cause, et du fait que certaines investigations sont susceptibles de révéler des perspectives imminentes de passage à l’acte sur le territoire national, il paraît impératif de pouvoir ménager un effet de surprise lors des interpellations, et de pouvoir pénétrer dans un local d’habitation en urgence à n’importe quelle heure lorsque l’on suppose que des individus y préparent un attentat ». Mme Laurence Le Vert a également souligné que le 2° de l’article 1er permettra de faciliter le recours aux perquisitions de nuit, devenues quasiment impossibles compte tenu des conditions posées par l’actuel article 706-91 précité.
4. Les modifications opérées par votre commission des Lois
À l’initiative de votre rapporteur et suivant les recommandations formulées sur cet article par M. Jacques Toubon, Défenseur des droits, au cours de son audition (47), la commission des Lois a renforcé les garanties procédurales entourant ces perquisitions.
D’une part, elle a précisé que le régime juridique encadrant le recours aux perquisitions nocturnes tel qu’il est aujourd’hui prévu par l’article 706-92 serait applicable de plein droit aux perquisitions domiciliaires nocturnes décidées dans le cadre d’une enquête préliminaire sur le fondement du troisième alinéa du présent article, comme le prévoit déjà l’article 706-91 en matière d’information judiciaire.
D’autre part, elle a renforcé, pour toutes les perquisitions domiciliaires de nuit décidées en enquête préliminaire ou lors d’une information judiciaire, l’information, « dans les meilleurs délais », du JLD ou du juge d’instruction qui les a autorisées, afin de lui permettre d’exercer un réel contrôle sur les opérations auxquelles il est ainsi procédé, à l’instar de ce qui existe en matière d’interception de correspondances.
*
* *
La Commission examine l’amendement CL163 de M. Sergio Coronado.
M. Sergio Coronado. La première partie de l’article 1er prévoit d’autoriser les perquisitions de nuit en enquête préliminaire. Or le renforcement constant des pouvoirs autorisés en enquête préliminaire pose différents problèmes : d’une part, faute de révision constitutionnelle, le parquet ne bénéficie toujours pas de garanties équivalentes à celles des magistrats du siège ; d’autre part, l’ouverture de l’instruction, qui offre à la justice des moyens supplémentaires et ouvre des droits pour le justiciable, se retrouve de plus en plus retardée.
Le juge d’instruction se retrouve ainsi pris entre le parquet et le juge des libertés et de la détention (JLD), à qui on demande de valider les enquêtes demandées. La situation statuaire et matérielle des JLD ne leur permet pourtant pas d’exercer pleinement ce rôle de juge de l’enquête. Il y a également un paradoxe à faire du JLD un juge de l’enquête, alors que ce juge a été créé pour séparer conduite de l’enquête et décision sur la détention provisoire. Les pouvoirs importants supplémentaires offerts au parquet en enquête préliminaire par ce projet de loi vont aggraver cette tendance, sans pour autant qu’une véritable réflexion accompagne cette évolution lourde. C’est la raison pour laquelle nous proposons de supprimer les alinéas 1 à 3.
M. Pascal Popelin, rapporteur. La possibilité offerte par les alinéas 1 à 3 du présent article de procéder, sous des conditions strictes, à des perquisitions domiciliaires de nuit en enquête préliminaire répond à un réel besoin des services judiciaires de l’antiterrorisme, sans porter aux droits et libertés une atteinte disproportionnée. Le champ de la mesure est en effet strictement limité, puisqu’elle ne s’applique que dans le cadre de la répression des infractions à caractère terroriste, en cas d’urgence et « afin de prévenir un risque d’atteinte à la vie ou à l’intégrité physique ».
Par ailleurs, elle nécessite une autorisation impérative du JLD, magistrat du siège indépendant, dont les conditions statutaires devraient être prochainement renforcées par le projet de loi organique relative aux garanties statutaires, aux obligations déontologiques et au recrutement des magistrats ainsi qu’au Conseil supérieur de la magistrature.
Enfin, les garanties procédurales prévues par les articles 706-92 à 706-94 du code de procédure pénale sont applicables de plein droit, « à peine de nullité ». En d’autres termes, une perquisition nocturne requiert une ordonnance écrite et motivée comportant les considérations de droit et de fait fondant l’autorisation ; elle ne peut pas avoir d’autre objet que la recherche et la constatation des infractions visées dans l’autorisation ; le JLD enfin a la possibilité de se déplacer sur les lieux pour tout contrôler.
Ces dispositions correspondent à un réel besoin. En effet, non seulement la majorité des enquêtes ouvertes du chef d’association de malfaiteurs en vue de commettre des actes de terrorisme le sont sous la forme préliminaire mais, face à des perspectives imminentes de passage à l’acte, il est de surcroît impératif de ménager un effet de surprise et de pouvoir pénétrer dans un local d’habitation en urgence.
Il n’y a donc pas de marginalisation de l’instruction puisque les mêmes pouvoirs sont reconnus au juge d’instruction lors d’une information judiciaire. Au contraire, il s’agit d’un rééquilibrage entre enquête et information judiciaire.
Telles sont les raisons pour lesquelles je suis défavorable à cet amendement.
M. Yves Goasdoué. Je m’étonne de cet amendement visant à supprimer une mesure qui s’inscrit pleinement dans le cadre classique de notre droit commun et n’est en rien assimilable aux dispositions susceptibles d’être prises durant l’état d’urgence.
Les perquisitions de nuit sur des lieux d’habitation dont il est question ici sont subordonnées à l’autorisation d’un magistrat du siège, qui doit motiver sa décision, laquelle étant obligatoirement prise dans le cadre de la répression d’infractions à caractère terroriste. J’ajoute par ailleurs que, compte tenu de la jurisprudence du Conseil constitutionnel, ces perquisitions nocturnes doivent, pour ne pas être réputées disproportionnées, aboutir à des résultats qu’une perquisition classique, effectuée de jour, n’aurait pas permis d’obtenir.
La Commission rejette l’amendement.
Puis elle adopte successivement les amendements de précision CL242 et CL243 du rapporteur.
Elle en vient ensuite aux amendements identiques CL70 de M. Georges Fenech et CL147 de M. Michel Zumkeller.
M. Georges Fenech. Je voudrais insister sur le déséquilibre entre les garanties qui entourent, d’une part, l’enquête préliminaire et, d’autre part, l’instruction, laquelle demeure au cœur de notre système judiciaire.
Nous devons nous prononcer ici sur une procédure dans laquelle le procureur qui décide d’une perquisition doit en demander l’autorisation au JLD. Le juge d’instruction en revanche, lorsqu’il ordonne une perquisition, n’a à en référer à personne. Il en décide souverainement et est le seul à en apprécier la légalité et la proportionnalité, le seul contrôle de légalité possible étant le contrôle a posteriori devant la chambre d’instruction.
C’est ce qui a fait dire à M. Robert Badinter que notre juge d’instruction était à la fois Salomon et Maigret, juge et enquêteur, alors que, dans les pays anglo-saxons soumis à l’Habeas corpus, le prosecutor qui souhaite procéder à une perquisition ou à des écoutes téléphoniques doit se conformer à la règle de la probable cause, et préciser la nature des indices graves et concordants qui motivent une telle atteinte à la liberté individuelle. Dans un document très étoffé, appelé affidavit, il a l’obligation d’indiquer ce qu’il recherche, pourquoi il le recherche et à quel endroit il pense trouver l’objet utile à la manifestation de la vérité, à partir de quoi le juge effectue un contrôle strict avant de donner son autorisation.
En France au contraire, le cumul et la confusion des fonctions assumées par le juge d’instruction augmentent les risques d’arbitraire et d’atteinte aux libertés fondamentales. C’est pourquoi mon amendement propose une mini-révolution, en obligeant le juge d’instruction à demander au JLD l’autorisation de procéder à une perquisition, mesure par nature attentatoire aux libertés individuelles.
M. Michel Zumkeller. Si on s’en tient à la rédaction actuelle de l’article 706-90 du code de procédure pénale, le contrôle du JLD est induit, mais nous souhaiterions que cela soit inscrit de manière explicite dans la loi.
M. le rapporteur. Ces amendements précisent le cadre des perquisitions nocturnes ordonnées non dans le cadre de l’instruction – alinéa 5 – mais en enquête préliminaire – alinéa 3. Or, s’agissant des enquêtes préliminaires, ils sont doublement satisfaits, d’une part par la rédaction de l’alinéa 3 du présent article, qui vise les perquisitions nocturnes en enquête préliminaire « mentionnées à l’alinéa précédent » lorsqu’elles ont lieu dans un local d’habitation, c’est-à-dire les perquisitions telles qu’elles sont autorisées par le JLD sur requête du procureur et selon les modalités prévues à l’article 706-92 du code de procédure pénale ; d’autre part, par la rédaction actuelle de ce même article 706-92, qui prévoit que, « à peine de nullité, les autorisations prévues par les articles 706-89 à 706-91 sont données pour des perquisitions déterminées et font l’objet d’une ordonnance écrite ».
S’agissant des informations judiciaires, les perquisitions sont déjà soumises à l’autorisation préalable et motivée du juge d’instruction, magistrat du siège présentant toutes les garanties d’impartialité et d’indépendance au sens de la jurisprudence conventionnelle et constitutionnelle. La personne concernée pourra toujours, en temps utile, soulever des nullités si elle souhaite contester ces perquisitions et faire annuler les moyens de preuve collectés. Mon avis est défavorable.
M. Patrick Devedjian. Monsieur le rapporteur, vous ne répondez pas à l’objection soulevée avec pertinence par M. Georges Fenech, qui souligne que le juge d’instruction – dont Balzac, avant M. Robert Badinter, dénonçait déjà la toute-puissance – est à la fois juge et partie. D’où sa proposition d’étendre le contrôle du JLD à tous les cas de perquisition.
M. Guy Geoffroy. Le JLD a précisément été créé pour mettre fin à cette dualité des fonctions du juge d’instruction. Pour respecter le parallélisme des formes comme la volonté du législateur, le JLD doit donc se prononcer sur les initiatives du parquet comme sur celles du juge d’instruction.
Mme Marie-Françoise Bechtel. Ce qui nous est proposé ici, c’est de soumettre les perquisitions effectuées dans le cadre d’une enquête préliminaire à l’autorisation d’un JLD mais, si l’on veut appliquer les mêmes règles à l’instruction, c’est toute notre procédure judiciaire – procédure inquisitoire et non accusatoire comme celle des anglo-saxons – qu’il faut revoir, et M. Georges Fenech a raison de parler de révolution juridique. Cela étant, je ne pense pas que cela soit l’objet de ce projet de loi.
La Commission rejette les amendements.
Puis elle adopte l’amendement rédactionnel CL244 du rapporteur.
Elle en vient ensuite à l’amendement CL12 de M. Éric Ciotti.
M. Éric Ciotti. Cet amendement vise à revenir sur les conditions des perquisitions ordonnées dans le cadre de l’enquête préliminaire en ne les limitant pas nécessairement aux cas où elles sont nécessaires afin de prévenir un risque d’atteinte à la vie ou à l’intégrité physique.
M. le rapporteur. Cela me paraît une extension excessive. La jurisprudence du Conseil constitutionnel relative aux perquisitions de nuit dans un local d’habitation, telle qu’elle résulte de sa décision du 2 mars 2004 sur la loi dite « Perben II » est très stricte, puisqu’elle exige que ces perquisitions soient cantonnées à la constatation de crimes et délits d’une gravité et d’une complexité particulières, dans le respect des prérogatives de l’autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle ; que les restrictions apportées aux droits constitutionnellement garantis soient nécessaires à la manifestation de la vérité, proportionnées à la gravité et à la complexité des infractions commises ; que ces perquisitions enfin ne puissent pas être réalisées à un autre moment.
Pour ces raisons, il appartient au législateur de définir précisément les conditions dans lesquelles de telles perquisitions sont possibles en enquête préliminaire, ce qui est le cas à l’alinéa 3 qui pose trois conditions : en matière terroriste, en cas d’urgence et lorsque c’est nécessaire à la prévention d’un risque d’atteinte à la vie ou à l’intégrité physique. La suppression de l’une de ces trois conditions n’est donc pas souhaitable. Avis défavorable.
La Commission rejette l’amendement.
Puis elle adopte l’amendement rédactionnel CL367 du rapporteur.
Elle en vient ensuite à l’amendement CL164 de M. Sergio Coronado.
M. Sergio Coronado. Cet amendement vise à préciser les cas dans lesquels une perquisition nocturne est possible. Le risque doit être sérieux et imminent pour justifier la nécessité d’une telle perquisition.
M. le rapporteur. M. Coronado souhaite aller dans le sens inverse de M. Ciotti et restreindre les cas dans lesquels une perquisition nocturne est possible. Il me semble néanmoins que le dispositif est équilibré en l’état. Avis dévavorable.
La Commission rejette l’amendement.
Puis elle examine l’amendement CL165 de M. Sergio Coronado.
M. Sergio Coronado. Cet amendement vise à préciser les cas dans lesquels une perquisition nocturne est possible. Les atteintes à l’intégrité physique pouvant recouvrir un nombre de situations très larges, il me semble opportun de limiter les perquisitions aux situations comportant des risques d’atteinte à la vie.
Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement.
Elle examine ensuite l’amendement CL245 du rapporteur.
M. le rapporteur. Le présent amendement tend à préciser expressément que le régime juridique encadrant le recours aux perquisitions nocturnes tel qu’il est prévu par l’article 706-92 est applicable aux perquisitions domiciliaires nocturnes décidées dans le cadre d’une enquête préliminaire instituées par l’alinéa 3 du présent article, comme le précise déjà l’article 706-91 en matière d’information judiciaire.
La Commission adopte l’amendement.
Puis elle adopte successivement les amendements rédactionnels CL246 et CL247 du rapporteur.
Suivant l’avis défavorable du rapporteur, elle rejette ensuite successivement les amendements CL166 et CL167 de M. Sergio Coronado.
Puis elle examine l’amendement CL369 du rapporteur.
M. le rapporteur. Cet amendement précise que le magistrat ayant autorisé les perquisitions doit être informé dans les meilleurs délais des actes accomplis.
La Commission adopte l’amendement.
Puis elle en vient à l’amendement CL157 de Mme Élisabeth Pochon.
Mme Élisabeth Pochon. Il importe de préciser que l’autorisation de procéder à des perquisitions doit être spécialement motivée.
M. le rapporteur. Juridiquement, la différence entre une décision « motivée » et « spécialement motivée » est assez difficile à établir. Je vous demanderai donc de retirer cet amendement.
L’amendement est retiré.
La Commission adopte l’article 1ermodifié.
La Commission est saisie de l’amendement CL93 de M. Patrick Devedjian.
M. Patrick Devedjian. Nous souhaitons que l’avocat de la personne perquisitionnée soit obligatoirement informé, dès le début de la perquisition.
M. le rapporteur. Votre amendement n’a pas pour objet de prévoir l’information obligatoire de l’avocat lors des perquisitions domiciliaires de nuit comme le précise l’exposé sommaire, mais pour toutes les perquisitions décidées par le juge d’instruction en vertu de l’article 92 du code de procédure pénale.
Or les perquisitions domiciliaires de droit commun demandées par le juge d’instruction, juge du siège indépendant, sont déjà encadrées par les articles 92 à 99-4 du code de procédure pénale : si la perquisition a lieu au domicile d’une personne mise en examen ou gardée à vue, elle doit se dérouler en sa présence ou celle d’un représentant de son choix ou, à défaut, de deux témoins ; dans les autres hypothèses, la personne dont le domicile est perquisitionné est invitée à y assister, la perquisition ayant lieu en présence de parents ou de témoins en cas d’absence de la personne perquisitionnée.
La chambre criminelle de la Cour de cassation juge avec constance que l’absence de convocation de l’avocat lors d’une perquisition n’est pas irrégulière dès lors que la personne mise en examen n’est pas soumise à un interrogatoire, une confrontation ou une reconstitution. Elle considère que l’absence de l’avocat lors de la perquisition ne porte pas atteinte au droit à un procès équitable du demandeur.
S’agissant des perquisitions domiciliaires de nuit en matière de criminalité et de délinquance organisées, elles sont justifiées par un motif d’urgence. Il paraît donc pour le moins compliqué de prévenir l’avocat de la personne concernée, sauf à faire perdre de son utilité à la mesure qui est prise à son insu. Avis défavorable.
M. Alain Marsaud. Monsieur le président, je vous remercie de m’accueillir dans votre Commission dont je ne suis pas membre. Les personnes faisant l’objet d’une perquisition sous ce régime juridique ne sont pas mises en examen et n'ont pas d’avocat. Si la police procédait à une perquisition au domicile de M. Salah Abdeslam, comment pourrait-elle prévenir son avocat ? Ces gens ne désignent pas d’avocat ! Il faut dire que, bien souvent, on n'est pas sûr de l’identité des personnes ciblées. Mon cher collègue Patrick Devedjian ne se rend pas compte des contextes dans lesquels se déroulent de telles opérations.
La Commission rejette l’amendement.
Article 2
(art. 706-95-1 [nouveau] du code de procédure pénale)
Mise en œuvre de dispositifs techniques de proximité
de recueil de données techniques de connexion (IMSI catcher)
en matière de criminalité et de délinquance organisées
Le présent article complète la liste des techniques de surveillance applicables à la poursuite judiciaire de la criminalité et de la délinquance organisées (principalement les interceptions de correspondances émises par la voie des télécommunications) par de nouvelles possibilités de recueil, en temps réel, de données techniques de connexion. À cet effet, dans le prolongement des possibilités déjà reconnues par le législateur aux services de renseignement en 2015, il autorise, pour les besoins de la répression de ce type d’infractions, le recours aux « IMSI catcher » dans les enquêtes ou informations judiciaires.
1. Le droit en vigueur
a. Un régime dérogatoire d’interception des correspondances
i. Les interceptions de correspondances, des opérations en principe réservées à l’instruction en matière criminelle et délictuelle…
Dans le droit commun fixé par les articles 100 à 100-7 du code de procédure pénale, l’interception, l’enregistrement et la transcription des correspondances électroniques ne sont pas possibles lors de la phase d’enquête, que celle-ci soit préliminaire ou de flagrance. En revanche, de telles opérations sont possibles, en matière criminelle et correctionnelle, si une information judiciaire a été ouverte relativement à une infraction réprimée par le code pénal d’une peine égale ou supérieure à deux ans d’emprisonnement. De telles opérations ne peuvent être réalisées que sous certaines conditions :
– sur décision du juge d’instruction (article 100), « prise pour une durée maximum de quatre mois », renouvelable (article 100-2), qui « doit comporter tous les éléments d’identification de la liaison à intercepter, l’infraction qui motive le recours à l’interception ainsi que la durée de celle-ci » (article 100-1) ;
– le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire (OPJ) commis par lui qui fait procéder à l’installation du dispositif d’interception doit dresser un procès-verbal des opérations d’interception et d’enregistrement (article 100-4) et de transcription de la seule correspondance utile à la manifestation de la vérité (deux premiers alinéas de l’article 100-5) ;
– les enregistrements doivent être détruits à l’expiration du délai de prescription de l’action publique (article 100-6).
Par ailleurs, certaines personnes bénéficient d’une protection contre ces interceptions judiciaires à raison de leur profession, comme les parlementaires, les avocats, les magistrats et les journalistes (deux derniers alinéas de l’article 100-5 et article 100-7).
ii. …mais possibles, en matière de criminalité et de délinquance organisées, lors de la phase d’enquête
Depuis la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, dite loi « Perben II », compte tenu de la nécessité de procéder parfois à des interceptions de correspondances sans que les faits sur lesquels porte l’enquête justifient l’ouverture d’une information judiciaire, l’article 706-95 autorise de telles opérations dans le cadre d’une enquête de flagrance ou préliminaire relative à l’une des infractions de délinquance et de criminalité organisées mentionnées aux articles 706-73 et 706-73-1 dudit code (48).
L’article 706-95 soumet ces interceptions à la décision préalable du juge des libertés et de la détention (JLD), saisi en ce sens par le procureur de la République, « pour une durée maximum d’un mois, renouvelable une fois dans les mêmes conditions de forme et de durée ». Ce délai, initialement fixé à quinze jours, avait été jugé insuffisant par le législateur en 2011, qui l’avait porté à un mois par la loi n° 2011-267 d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure afin de permettre d’identifier le plus efficacement possible des réseaux qui s’organisent souvent selon des relations complexes. Le JLD contrôle leur exécution et est informé sans délai par le procureur de la République des actes accomplis en application des articles 100-3 à 100-5 précités.
b. L’application du droit commun de l’accès aux données techniques de connexion
Le recueil judiciaire des données techniques de connexion (ou métadonnées) obéit à un régime distinct en raison de la différence de nature qui existe entre ces données, lesquelles correspondent aux données d’identification ou de trafic, et les correspondances, qui, elles, renseignent sur le contenu des échanges des personnes surveillées.
Le droit commun s’applique pour l’accès à ces données, quelle que soit la nature de l’infraction en cause. Les OPJ peuvent requérir des opérateurs de téléphonie et d’internet qui, en application de l’article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques, « [p]our les besoins de la recherche, de la constatation et de la poursuite des infractions pénales, (…) sont tenus de conserver pendant une durée maximale d’un an les données techniques se rapportant à la connexion de leurs abonnés » (III), les données « [portant] exclusivement sur l’identification des personnes utilisatrices des services fournis par les opérateurs, sur les caractéristiques techniques des communications assurées par ces derniers et sur la localisation des équipements terminaux » (premier alinéa du VI).
En enquête de flagrance, le deuxième alinéa de l’article 60-2 du code de procédure pénale dispose que « [l]’officier de police judiciaire, intervenant sur réquisition du procureur de la République préalablement autorisé par ordonnance du juge des libertés et de la détention, peut requérir des opérateurs de télécommunications (…) de prendre, sans délai, toutes mesures propres à assurer la préservation, pour une durée ne pouvant excéder un an, du contenu des informations consultées par les personnes utilisatrices des services fournis par les opérateurs ».
Dans le cadre d’une enquête préliminaire, le deuxième alinéa de l’article 77-1-2 du même code prévoit une procédure semblable : « [s]ur autorisation du juge des libertés et de la détention saisi à cette fin par le procureur de la République, l’officier de police peut procéder aux réquisitions prévues par le deuxième alinéa de l’article 60-2 ».
Au cours d’une information judiciaire, en vertu du deuxième alinéa de l’article 99-4 du même code, l’OPJ peut également procéder à ces mêmes réquisitions « [a]vec l’autorisation expresse du juge d’instruction ».
2. L’instauration de nouvelles capacités de recueil de données techniques de connexion
Le présent article vise à offrir de nouvelles capacités de collecte de données de connexion dans le domaine de la criminalité et de la délinquance organisées en autorisant le recours à des dispositifs techniques de proximité afin de recueillir certaines données techniques de connexion permettant l’identification d’un équipement terminal – un téléphone portable par exemple – ou du numéro d’abonnement de son utilisateur.
a. Une faculté déjà reconnue aux services de renseignement en 2015…
Sont ici visés les dispositifs techniques de proximité, dits « IMSI catcher » (49), sortes d’antennes relais mobiles imposant aux terminaux mobiles situés dans leur périmètre de se connecter à elles et se substituant à celles des opérateurs afin de collecter certaines données techniques associées à leur utilisation, voire de capter les correspondances qui transitent par eux.
L’utilisation de ces dispositifs a déjà été autorisée par le législateur dans le domaine du renseignement lors de l’adoption de la loi n° 2015-912 du 24 juillet 2015 relative au renseignement. Ainsi, en vertu du nouvel article L. 851-6 du code de la sécurité intérieure, « peuvent être directement recueillies, au moyen d’un appareil ou d’un dispositif technique mentionné au 1° de l’article 226-3 du code pénal, les données techniques de connexion permettant l’identification d’un équipement terminal ou du numéro d’abonnement de son utilisateur ainsi que les données relatives à la localisation des équipements terminaux utilisés ».
Statuant sur les recours formés à l’encontre de cette loi, le Conseil constitutionnel a considéré que le recueil administratif de données de connexion au moyen d’un tel appareil ou dispositif était conforme à la Constitution eu égard aux conditions, finalités et garanties posées par le législateur pour la mise en œuvre des techniques de recueil du renseignement : autorisation préalable, limitation de la durée des opérations, nature des informations recueillies, modalités de destruction des éléments recueillis sans rapport avec l’autorisation… (50).
b. … élargie, par le présent article, aux enquêtes et informations judiciaires en matière de criminalité et de délinquance organisées
Le 2° du présent article complète la section V du chapitre II du titre XXV du livre IV du code de procédure pénale par un nouvel article 706-95-1 habilitant l’OPJ à recourir à cette technique pour les besoins de l’enquête ou de l’information concernant l’un des crimes ou délits mentionnés aux articles 706-73 et 706-73-1 précités.
Le premier alinéa de ce nouvel article subordonne la mise en œuvre de cette technique au respect de plusieurs exigences :
– l’autorité compétente serait, lors d’une enquête, le JLD « sur requête du procureur de la République » et, lors d’une information judiciaire, le juge d’instruction « après avis du procureur de la République » : il s’agirait donc, en toute hypothèse, d’un magistrat du siège, membre de « l’autorité judiciaire », conformément aux prescriptions de la jurisprudence constitutionnelle et de l’article 5 § 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CESDH) ;
– seules « les données techniques de connexion permettant l’identification d’un équipement terminal ou du numéro d’abonnement de son utilisateur » pourraient être recueillies : en effet, si certains dispositifs sont équipés de fonctionnalités leur permettant de procéder à la géolocalisation des terminaux et à l’interception de communications, ces fonctionnalités sont déjà couvertes, pour les enquêtes judiciaires, par les dispositions du code de procédure pénale relatives aux mesures de géolocalisation (51) et à l’interception des correspondances (52) ;
– la durée de mise en place du dispositif ne pourrait excéder « une durée maximale d’un mois renouvelable une fois dans les mêmes conditions de forme et de durée », comme pour les interceptions de correspondances ;
– le magistrat qui aurait délivré l’autorisation de recourir à cette technique serait chargé d’en contrôler l’exécution.
Le deuxième alinéa aménage une procédure d’urgence autorisant le procureur de la République à délivrer directement l’autorisation de recourir à cette technique. Toutefois, cette autorisation, pour être conforme aux prescriptions de la jurisprudence constitutionnelle et conventionnelle, devrait « alors être confirmée par le juge des libertés et de la détention dans le délai de 24 heures, à défaut de quoi il [serait] mis fin à l’opération ».
Le dernier alinéa permet au procureur de la République, au juge d’instruction ou à l’OPJ de « requérir tout agent qualifié d’un service, d’une unité ou d’un organisme placé sous l’autorité du ministre de l’intérieur et dont la liste est fixée par décret, en vue de procéder à l’utilisation du dispositif technique ».
Par cohérence, le 1° complète l’intitulé de la section V précitée, aujourd’hui consacrée aux « interceptions de correspondances émises par la voie des télécommunications », afin d’y inclure le « recueil de données techniques de connexion ».
En tout état de cause, compte tenu de la nécessité d’en contrôler l’usage et des atteintes portées à la vie privée par leur intermédiaire, les matériels utilisés pour procéder à ce recueil de données demeurent soumis, sous peine de sanctions définies par l’article 226-6 du code pénal, à une autorisation du Premier ministre, délivrée après l’avis de l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI) (53).
Le présent article concrétise une demande forte de la part des services chargés de la lutte contre la criminalité et la délinquance organisées, en particulier le terrorisme, ainsi que l’ont relayée devant votre rapporteur M. François Molins, procureur de la République de Paris, et Mme Camille Hennetier, vice-procureur, chef de la section antiterroriste au tribunal de grande instance de Paris, en considérant que rien ne justifiait que les services enquêteurs, sous le contrôle du parquet, ne puissent avoir l’usage de cette technique alors que le législateur avait reconnu cette faculté aux services de renseignement. Ce dispositif sera particulièrement utile dans l’hypothèse de surveillances ou dans celle d’individus reclus.
L’utilisation de cette technique aujourd’hui mise en œuvre, dans certaines procédures particulières, sous l’empire des dispositions générales de l’article 81 du code de procédure pénale, permettra d’identifier les moyens de communication utilisés par une personne et ses identifiants téléphoniques, sans passer, dans un premier temps, par la procédure lourde, coûteuse et seulement rétrospective de réquisition des opérateurs. Toutefois, une fois cette identification opérée et passé le stade de l’urgence, il pourra être procédé aux réquisitions nécessaires afin d’obtenir l’historique des données de connexion, les données de géolocalisation en temps réel et l’interception des communications, dans le respect du code de procédure pénale.
3. Les modifications opérées par votre commission des Lois
Sur proposition de votre rapporteur, reprenant l’une des recommandations formulées par M. Jacques Toubon, Défenseur des droits, au cours de son audition (54), la commission des Lois a précisé que l’autorisation du JLD ou du juge d’instruction de recourir à un IMSI catcher pour les nécessités de l’enquête ou de l’information concernant l’une des infractions mentionnées aux articles 706-73 et 706-73-1 précités devrait être délivrée par « ordonnance motivée ».
Par ailleurs, la commission des Lois, contre l’avis de votre rapporteur qui souhaitait, en séance publique, proposer un dispositif procédural plus complet et cohérent, a adopté un amendement de M. Lionel Tardy tendant à préciser les conditions de mise en œuvre de ce procédé technique en situation d’urgence telles qu’elles sont prévues par le deuxième alinéa du nouvel article 706-95-1 précité. Le texte adopté par la Commission prévoit que, si le JLD ne confirme pas dans les 24 heures l’autorisation délivrée en urgence par le procureur de la République, non seulement il devra être « mis fin à l’opération », ainsi que le précisait la rédaction initiale de cet article, mais il devra également être « procédé à la destruction des données recueillies ».
*
* *
La Commission étudie l’amendement CL168 de M. Sergio Coronado.
M. Sergio Coronado. Cet amendement vise à limiter le recours à l’International mobile subscriber identity (IMSI)-catcher. Nous avons déjà débattu de l’emploi de cet instrument très intrusif au moment de l’examen de la loi du 24 juillet 2015 relative au renseignement. Comme il procède à une captation massive de données, nous proposons que son emploi ne soit possible que lors de l’instruction et que l’on ne puisse l’utiliser lors de l’enquête préliminaire.
M. le rapporteur. Votre amendement, monsieur Coronado, est motivé par une prévention contre cet outil. Le texte du projet de loi prévoit l’encadrement de son recours, y compris lors des enquêtes de flagrance ou préliminaires. Son utilisation est ainsi limitée à la recherche et à la constatation d’une infraction relevant du champ de la criminalité et de la délinquance organisées. Seul le juge des libertés et de la détention (JLD) peut autoriser le recours à cet instrument. La durée d’installation du dispositif ne peut excéder un mois, même si elle peut être renouvelée une fois. Certes, une procédure d’urgence est aménagée au stade de l’enquête, mais le JLD doit confirmer dans les vingt-quatre heures l’autorisation alors délivrée par le procureur de la République, sous peine de l’arrêt immédiat des opérations.
Je m’étonne toujours que l’on fasse une fixation sur l’IMSI-catcher, car d’autres instruments, comme les interceptions judiciaires, s’avèrent bien plus intrusifs que celui-ci, et, pourtant, on ne propose pas de les supprimer.
Au surplus, la rédaction de votre amendement conduirait à permettre l’installation de l’IMSI-catcher pour l’enquête, mais il confierait l’autorisation et le contrôle de l’emploi de l’outil au juge d’instruction, ce qui constituerait un mélange des compétences ni conforme ni souhaitable à l’organisation du système judiciaire. J’émets donc un avis défavorable à son adoption.
La Commission rejette l’amendement.
Puis elle examine les amendements identiques CL169 de M. Sergio Coronado et CL248 du rapporteur.
M. Sergio Coronado. Il s’agit d’un amendement rédactionnel, identique à celui proposé par M. le rapporteur.
M. le rapporteur. En effet. J’y suis donc favorable.
La Commission adopte les amendements.
Puis elle est saisie de l’amendement CL249 du rapporteur.
M. le rapporteur. Cet amendement vise à renforcer les garanties applicables à la délivrance de l’autorisation de recourir à un dispositif de recueil de proximité des données de connexion, en précisant qu’elle devra faire l’objet d’une ordonnance motivée du JLD ou du juge d’instruction, comme pour la mise en œuvre d’autres mesures spéciales d’investigation.
M. Georges Fenech. Monsieur le rapporteur, vous souhaitez contraindre le JLD et le juge d’instruction à motiver l’autorisation de recourir à un tel dispositif, ce qui constituerait une innovation. Je m’en réjouis, mais un tel mouvement épouse les remarques que je formulais tout à l’heure sur les perquisitions.
La Commission adopte l’amendement.
Puis elle adopte l’amendement de précision CL250 du rapporteur.
La Commission en vient à l’amendement CL251 du rapporteur.
M. le rapporteur. Cet amendement précise que la possibilité pour le procureur de la République d’autoriser, en cas d'urgence, le recours à un dispositif de proximité de recueil des données techniques de connexion ne vaut que dans le cadre d'une enquête de flagrance ou préliminaire, et non dans celui d'une information judiciaire, pour laquelle seul le juge d'instruction restera compétent pour délivrer cette autorisation.
La Commission adopte l’amendement.
Puis elle adopte successivement les amendements rédactionnels CL252 et CL253 du rapporteur.
La Commission aborde l’amendement CL170 de M. Sergio Coronado.
M. Sergio Coronado. Cet amendement vise à réduire de vingt-quatre à douze heures le délai dans lequel le JLD doit valider l’utilisation d’un IMSI-catcher.
M. le rapporteur. On a retenu la durée de vingt-quatre heures car elle s’applique à d’autres dispositifs et semble raisonnable. J’émets un avis défavorable à l’adoption de cet amendement.
La Commission rejette l’amendement.
Puis elle étudie l’amendement CL113 de M. Lionel Tardy.
M. Lionel Tardy. L’article 2 du projet de loi complète la loi sur le renseignement en prévoyant l’utilisation d’un IMSI-catcher pour recueillir des données de connexion ; le texte prévoit l’encadrement de cette procédure par le juge, à l’exception des cas d’urgence où l’autorisation est délivrée par le procureur de la République sans validation préalable du juge. Le JLD peut néanmoins suspendre l’opération de recueil des données s’il n’en confirme pas l’autorisation dans les vingt-quatre heures. En revanche, le texte ne précise pas le sort des données collectées dans cet intervalle d’une journée. Mon amendement vise à ce que celles-ci soient détruites.
M. le rapporteur. Vous soulevez un sujet important, monsieur Tardy. L’alinéa 5 de l’article 2 prévoit que l’opération cesse si l’autorisation délivrée par le procureur de la République n’a pas été confirmée dans les vingt-quatre heures par le JLD ; dans ce cas, les données recueillies dans l'intervalle seront réputées nulles et non avenues.
Je travaille avec le Gouvernement à l’ajout de dispositions – qui seront, je l’espère, prêtes pour l’examen du texte en séance publique – renforçant les garanties entourant le recours à l’IMSI-catcher. Il conviendrait notamment de centraliser davantage le recueillement des données, afin de faciliter les contrôles. Nous pourrions nous inspirer des dispositions élaborées en matière de renseignement, même si le système, en cours de construction, diffère pour les interceptions judiciaires.
Les droits de la défense interdisent de détruire des données tant que la procédure relative à l’infraction concernée demeure ouverte, car les avocats des parties doivent connaître la nature des données collectées pour soulever d’éventuels arguments de nullité. J’émets un avis défavorable à l’adoption de cet amendement.
M. Jean-Christophe Lagarde. Je regrette que vous ne souteniez pas cet amendement, monsieur le rapporteur, car M. Tardy met en lumière un point essentiel. Un pouvoir peu précautionneux pourrait procéder à des écoutes qui ne pourront certes pas être utilisées dans une procédure judiciaire, mais dont les résultats seront connus des services de renseignement et de police, voire des autorités politiques. Il s’avère donc essentiel de s’assurer de la destruction des éléments collectés.
Mme Cécile Untermaier. Le groupe Socialiste, républicain et citoyen (SRC) estime indispensable d’encadrer la collecte des données dans les cas d’urgence. Il convient de se pencher sur les conditions dans lesquelles il sera procédé à la destruction de ces données.
Mme Marie-Anne Chapdelaine. Il faudra prévoir la destruction physique des données, et non leur simple suppression informatique qui ne ferait que les placer dans des répertoires où l’on pourrait facilement les récupérer.
M. Lionel Tardy. Toutes les interventions vont dans le même sens. La rédaction de l’alinéa 5 de l’article 2, indiquant qu’à défaut de validation de l’autorisation par le JLD, il est « mis fin à l’opération », ne s’avère pas assez protectrice. Le texte doit prévoir la destruction des données, la question du contrôle de cette destruction restant ouverte.
M. Sergio Coronado. Nous partageons la volonté d’encadrer l’utilisation de ces données, et la formulation actuelle du projet de loi n’offre pas suffisamment de garanties, comme vient de le souligner mon collègue Lionel Tardy. Le temps a manqué car le Gouvernement a choisi d’examiner ce texte selon la procédure accélérée, mais vous devez nous donner votre opinion, monsieur le rapporteur : soit vous soutenez cet amendement et obtenez du Gouvernement la suppression des données, soit vous garantissez que les données recueillies ne puissent être utilisées dans d’autres procédures judiciaires – j’ai déposé un amendement allant dans ce sens.
M. le rapporteur. J’ai clairement indiqué mon intention de rédiger d’ici à la séance publique un amendement traitant de la centralisation des données recueillies dans un contexte d’urgence et des modalités de leur destruction.
Monsieur Lagarde, vous avez évoqué les autorités politiques, mais ce dispositif s’inscrit dans le cadre d’une procédure judiciaire et non dans celui des activités de renseignement.
L’adoption de cet amendement créerait un système inopérant. Monsieur Tardy, je ne doute pas de votre confiance dans ma sincérité à vouloir avancer sur ce sujet. Si mon amendement en séance ne vous satisfaisait pas, vous pourriez nous soumettre à nouveau votre proposition. Si vous mainteniez votre amendement en Commission, j’émettrais un avis défavorable à son adoption.
M. Jean-Christophe Lagarde. Nous discuterons en séance du texte adopté en Commission, si bien qu’il importe d’adopter cet amendement aujourd’hui. L’IMSI-catcher est tellement large, le dispositif tellement intrusif, qu’il convient de l’encadrer. Certes, il est utilisé dans le cadre d’une procédure judiciaire, mais vous savez, monsieur le rapporteur, que les services de police judiciaire rendent parfois compte de leurs activités à leur hiérarchie, voire à l’autorité politique. Cela s’est vu sous tous les gouvernements, mais il s’agissait d’écoutes ciblées alors que ce système s’avère bien plus large. Le texte doit donc fixer les conditions de la destruction des données recueillies.
M. Jean-Yves Le Bouillonnec. M. Tardy refuse que l’on conserve les données recueillies et souhaite l’annulation de la procédure ou le lancement d’une enquête administrative si tel n’était pas le cas. La destruction des données vise à atteindre ces deux objectifs.
M. le rapporteur. La destruction des données oblige tout d’abord à prévoir leur centralisation.
Nous avons trouvé une solution satisfaisante à ce problème lors de l’examen de la loi sur le renseignement. Le texte que nous examinons aujourd’hui concerne uniquement des données de connexion et non des contenus d’échanges, contrairement à la loi sur le renseignement qui ouvre les deux possibilités, l’utilisation des contenus d’échanges étant soumise à un fort encadrement.
M. Lionel Tardy. Je maintiens mon amendement, car il faut détruire ces données. Monsieur le rapporteur, il est libre à vous de trouver une rédaction encadrant cette destruction.
Mme Élisabeth Pochon. Nous souhaiterions déposer un amendement en vue de la séance publique prévoyant l’élaboration d’un décret fixant les conditions dans lesquelles il est procédé à la destruction matérielle des données à l’issue de l’opération.
La Commission adopte l’amendement.
Puis elle adopte l’amendement de précision CL254 du rapporteur.
La Commission est saisie de l’amendement CL171 de M. Sergio Coronado.
M. Sergio Coronado. Nous proposons que les données recueillies ne puissent pas être utilisées pour d’autres procédures que celle ayant justifié l’autorisation du recours à l’IMSI-catcher.
M. le rapporteur. La rédaction de votre amendement soulève des interrogations sur son objet précis. S'agit-il de prévoir que les opérations de recueil des données ne sauraient, à peine de nullité, avoir un autre objet que la recherche et la constatation des infractions visées dans la décision du magistrat qui les a autorisées ? Si tel était le cas, il nous faudra aboutir, avec le Gouvernement, au renforcement des garanties entourant le recours à cette technique. S’agit-il au contraire de frapper de nullité des procédures incidentes lorsque les données collectées révèlent d'autres infractions que celles visées dans la décision du magistrat qui les a autorisées ? Cela ne me paraît pas souhaitable car, pour d’autres techniques d’enquête, les articles 706-96 et 706-102-4 du code de procédure pénale disposent que la nullité des procédures incidentes n’est pas constituée en l’espèce.
J’émets donc un avis défavorable à l’adoption de cet amendement.
M. Jean-Christophe Lagarde. Il est difficile d’écarter les délits incidents lorsque l’on mène une enquête, mais les contenus de conversation n’entrant pas dans le champ du texte, la probabilité que l’on en découvre semble faible. Par contre, lorsque l’on enquête sur des faits de grande criminalité, on peut avoir connaissance d’un délit terroriste, et il ne faudrait pas s’empêcher de réaliser la connexion entre les deux infractions.
M. Guy Geoffroy. Monsieur Coronado, excusez mon purisme grammatical, mais il conviendrait de rédiger ainsi votre amendement : « Les données recueillies ne peuvent être utilisées pour d’autre enquête ou information que celle ayant justifié l’autorisation ».
La Commission rejette l’amendement.
Puis elle en vient à l’amendement CL172 de M. Sergio Coronado.
M. Sergio Coronado. Cet amendement a pour objet de supprimer les données recueillies par l’IMSI-catcher au bout d’un délai de 90 jours. Il reprend les dispositions prévues en matière de renseignement administratif.
M. le rapporteur. Je me suis déjà exprimé sur ce sujet et j’émets un avis défavorable à l’adoption de cet amendement.
La Commission rejette l’amendement.
Puis elle examine, en discussion commune, les amendements CL71 de M. Georges Fenech, CL148 de M. Michel Zumkeller et CL94 de M. Patrick Devedjian.
M. Georges Fenech. Cet amendement vise à assurer la protection du secret professionnel des avocats, des magistrats, des journalistes, des députés et des sénateurs. Ces dispositifs intrusifs s’avèrent utiles pour lutter contre le crime organisé et le terrorisme, mais ils ne doivent pas porter atteinte à des secrets protégés par la loi.
M. Michel Zumkeller. Mon amendement s’inscrit dans la même logique que celui de M. Zumkeller, et il oblige le juge d’instruction à informer le président de l’Assemblée nationale, celui du Sénat, le bâtonnier ou le procureur général près la juridiction si l’IMSI-catcher est utilisé à l’encontre d’un député, d’un sénateur, d’un avocat ou d’un magistrat. Il importe d’encadrer davantage le système lorsqu’il doit s’appliquer à ces professions ou à ces fonctions pour lesquelles le secret professionnel revêt une dimension particulière.
M. Patrick Devedjian. Mon amendement va dans le même sens que celui de M. Georges Fenech. Des procès-verbaux paraissent dans la presse trois jours après leur signature, ce qui me rend prudent sur la possibilité de protéger le secret professionnel.
M. Patrice Verchère. Je suis favorable à l’adoption de ces amendements ; mais que se passerait-il si un juge souhaitait utiliser l’IMSI-catcher pour écouter le président de l’Assemblée nationale, le bâtonnier ou le procureur général de la juridiction ? Qui devrait-il informer ?
M. Jean-Christophe Lagarde. La rédaction que M. Michel Zumkeller et moi-même proposons utilise le terme de « parlementaires », incluant ainsi les membres du Parlement européen, alors que les autres amendements n’évoquent que les députés et les sénateurs nationaux.
M. le rapporteur. L’IMSI-catcher n'a pas vocation à être installé au domicile ou au bureau des personnes, et il s’avère techniquement impossible de ne pas recueillir telle ou telle nature de données. Agissant comme une sorte d'antenne relais factice, il est installé à un endroit sans qu’il soit nécessaire de pénétrer dans un lieu privé. Si l’on entre dans un lieu privé, on change de technique d'investigation et de régime juridique.
Le cadre juridique entourant l’utilisation de l’IMSI-catcher est adapté à la nature des données collectées, celles-ci ne portant pas sur le contenu des échanges mais sur des données techniques ; il diffère donc de celui des interceptions de correspondances.
Des dispositions particulières sont prévues pour le recours aux IMSI-catchers à l'encontre des professions protégées en matière de renseignement administratif, car le juge judiciaire n’intervient ni pour autoriser, ni pour contrôler la mise en œuvre de cette technique. La loi sur le renseignement fixe une composition différente de la formation de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement (CNCTR) suivant le régime juridique qui s’applique. La Commission se réunit en formation plénière – c’est-à-dire avec la présence de quatre parlementaires – pour les professions d’avocat et de journaliste et pour la fonction de parlementaire. Le législateur a donc prévu des garanties particulières pour l’utilisation de ces outils à l’encontre de ces professions dans le cadre d’une procédure administrative. Dans une procédure judiciaire, c’est un magistrat du siège indépendant – JLD avant l’ouverture d’une information judiciaire, et juge d’instruction une fois la procédure enclenchée – qui autorise le recours à l’IMSI-catcher.
Monsieur Fenech, l’adoption de votre amendement conduirait à exclure purement et simplement l’application de cette technique d'enquête pour les avocats, les magistrats et les parlementaires, ce qui n'est pas acceptable.
J’émets un avis défavorable à l’adoption de ces amendements.
M. Georges Fenech. L’IMSI-catcher ne peut en effet pas trier les données qu’il recueille, mais vous pourriez prévoir un système les détruisant rapidement lorsque leur conservation porte atteinte au secret professionnel. En l’état actuel, le texte ne garantit pas la protection des avocats, des magistrats et des journalistes puisque ces données pourront être utilisées dans une procédure judiciaire.
M. le rapporteur. On utilise l’IMSI-catcher pour lutter contre le terrorisme et le crime organisé. Monsieur Fenech, je n’imagine pas que vous souhaitiez interdire l’emploi de cette technique à l’encontre des avocats, des journalistes et des parlementaires. Il nous faut cependant établir des garanties pour encadrer le recours à cet outil contre des membres de ces professions en raison de la nature des secrets professionnels dont ils sont détenteurs. La réunion en plénière de la CNCTR apporte des garanties dans le cadre d’une procédure administrative, et la fonction des personnes autorisant son recours dans une procédure judiciaire fournit également les assurances nécessaires.
En outre, on ne peut pas utiliser les données étrangères au motif ayant justifié l’emploi de l’IMSI-catcher. Vous proposez l’interdiction de l’utilisation de cet outil pour les professions d’avocat, de magistrat et de journaliste et pour la fonction de parlementaire. Je ne partage pas ce souhait, car je ne vois pas au nom de quoi certaines professions seraient soustraites du droit commun. Par ailleurs, qui considère-t-on comme journaliste ? Quelqu’un se qualifiant de directeur de la publication d’un blog peut revendiquer la qualité de journaliste. Un contrôle accru doit s’opérer lors de l’utilisation de l’IMSI-catcher à l’encontre d’un membre d’une profession protégée, mais on ne doit pas prévoir l’impossibilité du recours à cette technique contre ces personnes.
M. Jean-Christophe Lagarde. Il ne s’agit pas, à mes yeux, d’interdire cette technique, mais d’encadrer et de contrôler son usage. L’utilisation d’un IMSI-catcher ne vise pas nécessairement un avocat, un magistrat, un parlementaire ou un journaliste : le dispositif est installé, et, au milieu du flux de connexions et d’informations obtenu, on entend l’une de ces professions. Il faut donc prévoir, sinon l’interdiction de l’usage, la destruction des données ou l’interdiction d’en prendre connaissance. J’entends bien qu’en cas de besoin, une de ces professions peut faire l’objet d’une enquête, avec un contrôle. Imaginons cependant qu’un IMSI-catcher soit installé pour surveillance à proximité du Palais Bourbon, c’est toute l’Assemblée nationale qui se trouvera concernée.
D’ici à l’examen du texte en séance publique, il faut trouver la bonne rédaction établissant que, si à l’occasion de l’utilisation du dispositif, en entend une personne qui doit être protégée, il faut prévoir la destruction des données. La question de M. Coronado, relative à l’interdiction d’utiliser les données au sujet de délits connexes, se pose alors dans toute son acuité. Nous avons parmi nous un ancien ministre de l’intérieur qui ne se livrait pas à ce type d’exercice, mais un service de police peut enquêter à côté pour avoir une information qu’il cherche en fait sur quelqu’un d’autre ; cela peut être dangereux. Il faut donc prévoir que, pour ces professions, il ne peut être question de délit connexe : soit un délit est soupçonné et l’on mène une enquête sur l’intéressé, soit l’enquête concerne quelqu’un d’autre et l’on ne tombe pas par hasard sur ce type de profession.
M. le président Dominique Raimbourg. Ce qui est proscrit aujourd’hui, c’est l’utilisation, dans une procédure judiciaire, d’informations obtenues par cette technique : elles ne peuvent pas servir de preuve. C’est cette nullité qui protège les professions en question, le recours à un IMSI-catcher rendant impossible la discrimination entre les connexions établies.
M. le rapporteur. Je rappelle que l’information sur le nombre des appareils utilisés est classifiée et qu’ils ont des capacités de captation différentes. Or c’est toujours le plus faible faisceau qui est recherché, faute de quoi les résultats sont inexploitables.
Il reste deux questions importantes. D’une part, ces professions protégées bénéficient-elles de garanties supplémentaires ? De mon point de vue, celles-ci existent de par la qualité de la personne susceptible de demander une captation.
S’agissant, d’autre part, des données recueillies de façon incidente, le Gouvernement est au fait de ce débat, et je m’engage à m’en entretenir avec lui afin de dégager des solutions applicables, particulièrement pour la destruction des données concernées. Je demande donc le retrait de ces amendements. Au demeurant, si la rédaction que je proposerai en séance ne vous convenait pas, vous pourriez faire vos propres propositions.
M. Georges Fenech. Sur la foi de l’engagement pris par le rapporteur, je retire mon amendement.
M. Patrick Devedjian. Je tiens à faire quelques observations.
Dans sa décision du 23 juillet 2015, le Conseil constitutionnel a rappelé ses exigences fortes en matière de protection du secret professionnel. Ensuite, nous ne pouvons pas oublier que, même en matière de terrorisme, la fin ne justifie pas les moyens. Par ailleurs, la carte de presse n’est délivrée à un journaliste qu’à la condition que l’essentiel de ses revenus soit le fruit de cette activité : si donc n’importe qui peut se prétendre journaliste tout le monde ne peut pas avoir ce document. Enfin, le fait que la machine soit privée de discernement et le contexte de la lutte contre le terrorisme ne justifient pas que, finalement, on écoute tout le monde !
Concernant les parlementaires, nous sommes au cœur du débat démocratique, il ne s’agit pas de les protéger pour ce qu’ils sont : il s’agit de la protection de l’opposition, quelle qu’elle soit. Il faut éviter qu’une majorité – peut-être une autre que celle d’hier ou d’aujourd’hui – puisse utiliser ces moyens techniques pour écouter l’opposition. Vous introduisez dans nos institutions une technique dangereuse et totalement incontrôlée.
M. Michel Zumkeller. L’amendement est maintenu. Il ne vise pas à empêcher cette pratique, mais à l’encadrer.
L’amendement CL71 est retiré.
La Commission rejette successivement les amendements CL148 et CL94.
Puis elle adopte l’article 2 modifié.
La Commission examine, en discussion commune, les amendements CL14 et CL59 de M. Éric Ciotti.
M. Éric Ciotti. Ces amendements visent à revenir sur les principales dispositions de la « loi Taubira » du 15 août 2014 relative à l’individualisation des peines et à la prévention de la récidive. Le nouveau garde des Sceaux nous propose de modifier en profondeur la procédure pénale : nous lui donnons acte de sa volonté et de son pragmatisme, face au terrorisme, et, de façon plus générale, à la délinquance.
Cependant, l’efficacité de cette nouvelle politique pénale, que nous jugerons sur pièce, passe par l’abrogation de la contrainte pénale. Mesure d’autant plus dangereuse, qu’à partir de 2017, elle concernera tous les délits, y compris l’association de malfaiteurs en matière de terrorisme. Concrètement, cela signifie que les personnes condamnées pour des agressions sexuelles aggravées, des violences volontaires graves contre les forces de l’ordre, de proxénétisme ou encore de trafic de stupéfiants pourront éviter la prison. Cette mesure a gommé par idéologie toute référence à la prison et envoie un message d’impunité aux délinquants : nous proposons sa suppression.
M. le rapporteur. Ce sujet sortant du champ du texte que nous examinons ce matin, nous n’allons pas rouvrir ici un débat qui nous a déjà occupés très longuement. Avis défavorable. Monsieur Ciotti, vous pourrez toujours revenir sur la question en séance publique.
M. Georges Fenech. Je rappellerai que le projet de loi que nous examinons s’intitule « Lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement ». Cela implique que la question des moyens donnés aux enquêteurs doit également nous préoccuper. Or la contrainte pénale implique la surveillance d’individus susceptibles de récidiver alors que les forces de police sont fortement mobilisées pour prévenir les actes de terrorisme.
En outre, d’après les évaluations du ministère de la justice, la contrainte pénale va monter en puissance : 20 000 détenus pourraient ainsi sortir de prison, notamment avec l’extension du dispositif – dans moins d’un an – aux peines de cinq à dix ans d’emprisonnement. Nous sommes actuellement placés sous le régime de l’état d’urgence : vous adressez donc aux Français un message de protection maximale. Mais, dans le même temps, vous laissez perdurer une politique pénale décidée avant la menace terroriste qui aura pour conséquence d’alourdir considérablement la charge de travail de la police qui est exsangue aujourd’hui.
M. Philippe Goujon. La contrainte pénale, telle qu’elle pourra être appliquée à l’avenir, entre en contradiction avec bien des mesures positives relatives au régime des sanctions contenues dans ce projet de loi. En outre, son champ d’application devrait être élargi alors qu’aucune évaluation n’a été pratiquée.
M. Éric Ciotti. Dans le même esprit, mon amendement CL59 tend à exclure du champ d’application de la contrainte pénale les délits terroristes. Ne pas le faire serait extrêmement dangereux dans le contexte qui est le nôtre actuellement.
M. le rapporteur. Avis défavorable.
La Commission rejette ces amendements.
Puis elle étudie l’amendement CL15 de M. Éric Ciotti.
M. Éric Ciotti. Cet amendement vise à rétablir au sein de notre arsenal juridique les peines minimales de privation de liberté en cas de récidive légale, communément dénommées « peines plancher ». Leur suppression a constitué une erreur majeure qui a privé la justice d’un outil important contre la récidive. Cette mesure était pourtant compatible avec le principe constitutionnel d’individualisation des peines puisque 40 % des cas éligibles bénéficiaient de peines plancher, laissées à l’appréciation du juge. Rappelons-le, la durée moyenne des peines des récidivistes était ainsi passée de neuf à seize mois d’emprisonnement.
M. Alain Tourret. Pour moi, la peine plancher constitue une monstruosité juridique totalement opposée au principe général du droit qu’est l’individualisation de la peine. Pourquoi ne pas proposer des peines collectives ?
M. Georges Fenech. Nous touchons là à l’ambiguïté qui sous-tend ce texte : vous proposez des moyens d’intrusion, d’investigation et d’enquête auxquels nous sommes favorables mais vous n’abordez pas la question de la sanction et de la répression. Vous n’insistez pas sur l’effet dissuasif inhérent à toute politique pénale en matière de récidive. Vous restez à mi-parcours, tant en termes de procédure que de sanctions parce que, pour des raisons politiques qui peuvent se comprendre, vous ne souhaitez pas remettre en cause la politique pénale de Mme Taubira.
Vous aurez beau mettre tous les moyens à la disposition des services de renseignement et des enquêteurs pour arrêter et identifier des candidats au terrorisme, si ceux-ci bénéficient de la contrainte pénale ou d’une libération conditionnelle prématurée ou de réductions de peine automatiques alignées sur le régime des primo délinquants, nous n’aurons pas une procédure pénale adaptée à la lutte contre le terrorisme.
Enfin, et contrairement à ce qu’a dit M. Alain Tourret, les peines a minima n’ont rien de scandaleux, d’autres pays y ont recours. Elles ont existé chez nous jusqu’à l’adoption du nouveau code pénal de 1994. Tous les textes prévoyaient des peines minima et maxima. Il faudra y revenir un jour.
M. le rapporteur. Les évaluations pratiquées ont montré que le taux de récidive n’a pas cessé de croître en dépit des peines plancher. Par ailleurs, la contrainte pénale est l’un des outils – pas une obligation – mis à la disposition du juge. Mais imaginerait-on un juge prononçant une mesure de contrainte pénale à l’encontre d’un terroriste dangereux – a fortiori sans aucun appel du ministère public ?
Il est légitime de défendre ses positions, mais prétendre que ne pas supprimer la contrainte pénale et ne pas rétablir les peines plancher à l’occasion de ce texte revient à faire la moitié du chemin n’est pas intellectuellement objectif. Outre que ce débat est hors-sujet, dire que la contrainte pénale est un outil d’affaiblissement de la politique de lutte contre le terrorisme et les peines plancher une amélioration de la lutte contre la récidive est contraire à la vérité.
La Commission rejette l’amendement.
Article 3
(art. 706-96, 706-98 à 706-101 et 706-102-1 à 706-102-8 du code de procédure pénale)
Extension à l’enquête de techniques spéciales d’investigation jusque-là réservées à l’instruction en criminalité et délinquance organisées
Le présent article a pour principal objet, en matière de criminalité et de délinquance organisées, d’élargir à l’enquête de flagrance ou préliminaire la mise en œuvre des techniques de sonorisation, de fixation d’images et de captation de données informatiques, aujourd’hui réservées à l’information judiciaire.
1. Des techniques principalement réservées aux informations judiciaires ouvertes en matière de criminalité et de délinquance organisées
Le code de procédure pénale réserve certaines techniques spéciales d’investigation, eu égard à leur caractère intrusif dans la vie privée des individus, aux enquêtes relatives à des infractions particulièrement graves ou complexes. Il en va ainsi de la sonorisation, de la fixation d’images et de la captation de données informatiques, principalement réservées aux informations judiciaires relatives à la criminalité et à la délinquance organisées, conformément aux articles 706-96 à 706-102-9 du code de procédure pénale.
Toutefois, en vertu des articles 706-1-1 et 706-1-2 du code de procédure pénale, le législateur a récemment décidé (55) d’en étendre partiellement le champ d’application à certaines atteintes à la probité (56), aux délits de fraude fiscale commis en bande organisée ou aggravés par l’une des cinq circonstances mentionnées à l’article L. 228 du livre des procédures fiscales, à certains délits douaniers de première classe et à l’ensemble des délits douaniers de seconde classe punis d’une peine d’emprisonnement de plus de cinq ans, ainsi qu’en matière de grande délinquance économique et financière.
La sonorisation de lieux et de véhicules et la captation d’images consistent à saisir à leur insu l’image et la parole de personnes par le recours à des enregistreurs, des microphones ou des caméras.
Ces techniques, introduites dans notre droit par la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, dite loi « Perben II », alors que « la plupart des pays développés [s’étaient] dotés de ce type de moyens et que la France [était] régulièrement sollicitée par les services de pays voisins qui, par exemple, [avaient] sonorisé des véhicules de trafiquants de drogue et se [voyaient] dans l’impossibilité de poursuivre l’enquête – ou alors de manière illégale – lorsque ces véhicules [passaient] nos frontières » (57).
En application de l’article 706-96 du code de procédure pénale, de telles techniques ne peuvent être mises en œuvre qu’à l’instruction de l’un des crimes ou délits mentionnés aux articles 706-73 et 706-73-1 (58). Seul « le juge d’instruction peut, après avis du procureur de la République, autoriser par ordonnance motivée les officiers et agents de police judiciaire commis sur commission rogatoire à mettre en place un dispositif technique ayant pour objet, sans le consentement des intéressés, la captation, la fixation, la transmission et l’enregistrement de paroles prononcées par une ou plusieurs personnes à titre privé ou confidentiel, dans des lieux ou véhicules privés ou publics, ou de l’image d’une ou plusieurs personnes se trouvant dans un lieu privé ».
Afin de permettre l’installation du dispositif technique ou sa désinstallation, le juge d’instruction peut autoriser l’introduction dans un véhicule ou un lieu privé à l’insu ou sans le consentement de la personne concernée, y compris en dehors des heures légales de perquisition. Lorsque cette opération se fait dans un lieu d’habitation en dehors des heures légales de perquisition, l’autorisation doit être délivrée par le juge des libertés et de la détention (JLD) saisi par le juge d’instruction.
La mise en œuvre de ces opérations est subordonnée au respect de plusieurs exigences, similaires à celles fixées par les articles 100 à 100-7 du code de procédure pénale pour l’interception de correspondances :
– les décisions du juge d’instruction ou du JLD, « prises pour une durée maximale de quatre mois », renouvelable (article 706-98), « doivent comporter tous les éléments permettant d’identifier les véhicules ou les lieux privés ou publics visés, l’infraction qui motive le recours à ces mesures ainsi que la durée de celles-ci » (article 706-97) ;
– le juge d’instruction et l’officier de police judiciaire (OPJ) qui font procéder à l’installation du dispositif de sonorisation ou de captation doivent dresser un procès-verbal des opérations de mise en place dudit dispositif et des opérations de captation, de fixation et d’enregistrement sonore ou audiovisuel (article 706-100) ainsi que de celles de description ou transcription des seules images ou conversations enregistrées utiles à la manifestation de la vérité (article 706-101) ;
– les enregistrements doivent être détruits à l’expiration du délai de prescription de l’action publique (article 706-102) ;
– certains lieux occupés par des personnes protégées en raison de leur mandat ou de leur profession sont exclus : cabinet, domicile et véhicule d’un avocat, locaux et véhicules professionnels d’une entreprise de presse, de communication audiovisuelle ou de communication au public en ligne ou d’une agence de presse, domicile d’un journaliste, cabinet d’un médecin, d’un notaire ou d’un huissier, véhicule, bureau et domicile d’un parlementaire ou d’un magistrat (troisième alinéa de l’article 706-96).
La captation de données informatiques recouvre, elle, l’utilisation de logiciels espions, de type « keylogger », permettant aux enquêteurs d’accéder, en temps réel, aux données informatiques telles qu’elles s’affichent au même moment pour l’utilisateur sur son écran ou telles qu’il les introduit sur le terminal et de les enregistrer, conserver et transmettre.
Cette technique se distingue de l’accès aux données stockées au sein d’un système informatique, prévu par les articles 57-1, 76-3 et 97-1 du code de procédure pénale dans le cadre d’une perquisition. Elle a été introduite aux articles 706-102-1 à 706-102-9 du même code par la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure, qui l’a cantonnée au domaine de la criminalité et de la délinquance organisées.
Par la suite, la loi n° 2014-1353 du 13 novembre 2014 renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme a étendu son champ d’application aux données informatiques reçues et émises par des périphériques audiovisuels ou des logiciels de communication électronique, comme Skype. En effet, « ces moyens de communication électronique, (…) de plus en plus utilisés par les auteurs d’infractions (…), échappent au champ des interceptions judiciaires de correspondances émises par la voie des télécommunications, dans la mesure où les sociétés proposant ces services audiovisuels en ligne ne sont pas des opérateurs téléphoniques au sens de l’article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques. Elles ne sont donc pas contraintes de se déclarer au préalable auprès de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) et ne sont pas davantage soumises à l’obligation de mise en œuvre d’interceptions sur le territoire national justifiées par les nécessités de la sécurité publique. De surcroît (…), s’il est techniquement possible d’intercepter les données brutes transmises via la connexion Internet de la personne mise en cause, ces sociétés [aujourd’hui implantées pour la plupart à l’étranger] cryptent les données ainsi transmises et refusent de répondre aux demandes de déchiffrement qui leur sont adressées par les autorités françaises » (59).
Comme dans le cas des sonorisations ou prises d’images, l’article 706-102-1 prévoit que la captation de données informatiques n’est possible que dans le cadre d’une information judiciaire relative à un crime ou délit relevant de la criminalité et de la délinquance organisées et entrant dans le champ des articles 706-73 et 706-73-1 (60). L’application de cette technique est pareillement subordonnée au respect des mêmes exigences que celles qui s’appliquent à la sonorisation et à la prise d’images, rappelées aux articles 706-102-2 à 706-102-9 : autorisation du juge d’instruction par ordonnance spécialement motivée, limitation de leur durée à quatre mois, possibilité de s’introduire dans un lieu privé en dehors des heures légales de perquisition avec l’autorisation du JLD, établissement des procès-verbaux de chacune des opérations de mise en place du dispositif et de description ou transcription des données utiles à la manifestation de la vérité, destruction des enregistrements à l’expiration du délai de prescription de l’action publique… Au surplus, « [a]ucune séquence relative à la vie privée étrangère aux infractions visées dans les décisions autorisant la mesure ne peut être conservée dans le dossier de la procédure ».
La captation ne peut pas concerner les données informatiques contenues dans un système de traitement automatisé de données se trouvant dans les lieux occupés par des personnes traditionnellement protégées en raison de leur mandat ou de leur profession (dernier alinéa de l’article 706-102-5).
2. Le cadre constitutionnel et conventionnel
La conformité à la Constitution de dispositions législatives élargissant le recours à des mesures spéciales d’investigation et de contrainte au cours de la procédure pénale, potentiellement très intrusives et attentatoires aux libertés publiques, fait l’objet d’une jurisprudence bien établie du Conseil constitutionnel. Ce dernier s’attache à concilier, d’une part, le respect du principe de « rigueur nécessaire », tel qu’il résulte de l’article 9 de la Déclaration de 1789 et qui impose une proportionnalité entre la gravité des mesures et les objectifs qui motivent ces atteintes, de la liberté individuelle ainsi que des droits de la défense et, d’autre part, l’objectif constitutionnel de sauvegarde de l’ordre public ainsi que la prévention des atteintes à l’ordre public et la recherche des auteurs d’infractions, qui constituent également un objectif nécessaire à la sauvegarde de droits et principes de valeur constitutionnelle.
Statuant, en 2004, sur la loi « Perben II », le Conseil constitutionnel avait considéré que, « si le législateur peut prévoir des mesures d’investigation spéciales en vue de constater des crimes et délits d’une gravité et d’une complexité particulières, d’en rassembler les preuves et d’en rechercher les auteurs, c’est sous réserve que ces mesures soient conduites dans le respect des prérogatives de l’autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, et que les restrictions qu’elles apportent aux droits constitutionnellement garantis soient nécessaires à la manifestation de la vérité, proportionnées à la gravité et à la complexité des infractions commises et n’introduisent pas de discriminations injustifiées » (61). Il avait ainsi jugé que les infractions retenues par l’article 706-73 précité, « susceptibles de porter une atteinte grave à la sécurité, à la dignité ou à la vie des personnes » (62), étaient « suffisamment graves et complexes pour que le législateur ait pu fixer, en ce qui les concerne, des règles spéciales de procédure pénale » (63) sous réserve, pour certaines de ces infractions, qu’elle présente des éléments de gravité suffisants pour justifier des mesures dérogatoires, l’autorité judiciaire étant seule compétente pour apprécier l’existence de tels éléments.
Il a également été saisi, en 2013, de la conformité à la Constitution des dispositions de la loi relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière, qui permettait de recourir à certaines techniques spéciales d’enquête (64) pour les infractions de fraude fiscale en bande organisée ou commises dans des circonstances particulières. À cette occasion, il a considéré, s’agissant spécifiquement des pouvoirs spéciaux d’investigation à l’exclusion des mesures de garde à vue exceptionnelles, que la difficulté d’appréhender les auteurs de ces infractions tenant « à des éléments d’extranéité ou à l’existence d’un groupement ou d’un réseau dont l’identification, la connaissance et le démantèlement posent des problèmes complexes » et « eu égard à la gravité des infractions qu’il a retenues, le législateur a pu, à cette fin, fixer des règles spéciales de surveillance et d’investigation », lesquelles, « ne revêtent pas un caractère disproportionné au regard du but poursuivi » (65).
Il a, enfin, en 2015, admis la conformité à la Constitution de la sonorisation et de la fixation d’images dans le cadre préventif des activités de renseignement (66).
b. Le cadre conventionnel
Aux termes de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CESDH), « [t]oute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance » (§ 1) et « [i]l ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Pour la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH), les conditions comprises dans les mots « prévues par la loi » au sens de l’article 8 § 2 précité exigent l’accès à la loi de la personne concernée qui doit pouvoir en prévoir les conséquences précises pour elle (67). En matière de sonorisation, la loi doit notamment permettre de déterminer les catégories de personnes susceptibles de faire l’objet de mesures de surveillance et la nature des infractions pouvant y donner lieu, fixer une limite à la durée de l’exécution de la mesure, et prévoir les conditions d’établissement des procès-verbaux de synthèse consignant les opérations réalisées ainsi que les modalités de contrôle par le juge de celles-ci (68).
3. L’extension de ces techniques aux enquêtes ouvertes en matière de criminalité et de délinquance organisées
Tirant les conséquences de ce que certains faits de criminalité et de délinquance organisées, sur lesquels porte une enquête mais qui ne justifient pas l’ouverture d’une instruction, peuvent nécessiter la mise en place de telles techniques d’investigation, le présent article permet, avec l’autorisation du JLD, leur mise en œuvre en enquête de flagrance ou préliminaire.
a. La sonorisation et la fixation d’images de certains lieux et véhicules
Le 1° modifie l’article 706-96 précité, relatif à la sonorisation et à la fixation d’images, afin d’étendre l’application de ses dispositions aux cas dans lesquels « les nécessités de l’enquête ou de l’information concernant un crime ou un délit entrant dans le champ d’application des articles 706-73 et 706-73-1 l’exigent », le champ des infractions concernées demeurant donc identique à celui défini par le droit actuel.
Pour l’enquête, le JLD serait seul habilité à exercer les compétences aujourd’hui attribuées au juge d’instruction lors d’une information judiciaire :
– pour, sur requête du procureur de la République, « autoriser par ordonnance motivée les officiers et agents de police judiciaire à mettre en place un dispositif technique ayant pour objet, sans le consentement des intéressés, la captation, la fixation, la transmission et l’enregistrement de paroles prononcées par une ou plusieurs personnes à titre privé ou confidentiel, dans des lieux ou véhicules privés ou publics, ou de l’image d’une ou plusieurs personnes se trouvant dans un lieu privé » (a) ;
– pour autoriser l’introduction dans un véhicule ou un lieu privé à l’insu ou sans le consentement de la personne concernée, y compris en dehors des heures légales de perquisition, l’autorisation de s’introduire dans un lieu d’habitation en dehors de ces heures devant être également délivrée par ce juge saisi par le procureur de la République (b) ;
– pour contrôler les opérations de mise en place du dispositif technique ainsi que celles de captation, de fixation, de transmission et d’enregistrement des paroles ou des images (a et b).
b. La captation des données informatiques
De manière symétrique, le 5° modifie l’article 706-102-1 précité afin d’élargir la possibilité de captation de données informatiques au stade de l’enquête de flagrance ou préliminaire.
Comme pour la sonorisation et la fixation d’images de certains lieux et véhicules, le JLD serait seul habilité, sur requête du procureur de la République, à autoriser, « par ordonnance motivée », les OPJ et agents de police judiciaire à procéder à la captation des données, à mettre en place le dispositif nécessaire et à contrôler l’exécution de ces opérations (a, b et d).
Afin d’autoriser la captation de données déjà entreposées dans un système informatique, comme les courriers électroniques archivés, le c précise que les données informatiques susceptibles d’être enregistrées, conservées et transmises sont non seulement celles « telles qu’elles s’affichent sur un écran pour l’utilisateur d’un système de traitement automatisé de données ou telles qu’il les y introduit par saisie de caractères » mais aussi celles « telles qu’elles sont stockées dans un système informatique ».
En effet, si, auparavant, la notion d’interception avait pu être interprétée comme couvrant l’ensemble des messages envoyés à la personne, y compris ceux archivés, tel n’est plus le cas depuis un arrêt rendu par la Cour de cassation le 8 juillet 2015. La Cour a soumis la saisie des correspondances antérieures à une décision d’interception au régime de la perquisition et donc à l’assentiment et à la présence de la personne concernée, à la différence de la captation des flux de courriers émis postérieurement, soumis au régime des interceptions de correspondances (69).
c. Des garanties communes destinées à assurer une mise en œuvre de ces techniques proportionnée aux objectifs poursuivis
Le 2° et le a du 7°, qui modifient les articles 706-98 et 706-102-3, fixent une durée maximale de mise en œuvre des techniques de sonorisation, fixation d’images et captation de données informatiques :
– dans le cas d’une enquête, ces opérations ne pourraient durer plus d’un mois, renouvelable une seule fois dans les mêmes conditions de forme et de durée : cette durée maximale de deux mois est cohérente avec la durée déjà retenue en matière d’interception de télécommunications en criminalité et délinquance organisées (70) et en matière de géolocalisation (71) ;
– dans le cas d’une instruction, ces opérations ne pourraient excéder une durée de quatre mois, renouvelable dans les mêmes conditions de forme et de durée – comme le prévoit déjà le droit existant – mais la durée totale des opérations ne pourrait désormais excéder deux ans : cette durée, quoique notablement supérieure à celle aujourd’hui prévue pour la captation de données informatiques (quatre mois renouvelables à titre exceptionnel une seule fois), est cohérente avec celle introduite par l’article 25 du projet de loi en matière d’interceptions de télécommunications en délinquance et criminalité organisées et est apparue « proportionnée à la gravité des infractions en cause » aux yeux du Conseil d’État (72) .
En vertu des 3° et 6°, du b du 7° ainsi que des 8° et 9°, l’ensemble des garanties de fond et de forme respectivement posées par les articles 706-97 à 706-102 et 706-102-2 à 706-102-9 demeureraient applicables aux sonorisations et fixations d’images d’une part, et à la captation de données informatiques d’autre part (motivation de l’ordonnance d’autorisation, réquisition de toute personne qualifiée, procès-verbaux de chacune des opérations, destruction des enregistrements…). Toutefois, les compétences dévolues par ces articles au juge d’instruction seraient alors exercées, selon le cas, par le JLD ou le procureur de la République.
De même, comme lors d’une information judiciaire, ces techniques ne pourraient être mises en œuvre dans les lieux – véhicules, bureaux, domiciles, locaux – occupés par des personnes protégées en raison de leur mandat ou de leur profession et mentionnés aux articles 56-1 à 56-3 et 100-7.
Enfin, le 4° du présent article complète l’article 706-101 afin de transposer à la procédure applicable aux techniques de sonorisation et de fixation d’images de certains lieux et véhicules la garantie déjà prévue au premier alinéa de l’article 706-102-8 en matière de captation de données informatiques, selon laquelle « [a]ucune séquence relative à la vie privée ne peut être conservée dans le dossier de la procédure ».
En définitive, le présent article ne modifie ni le périmètre des infractions qui relèvent du régime procédural autorisant le recours à ces deux pouvoirs spéciaux d’investigation, ni les garanties attachées à leur mise en œuvre. Cohérente avec la faculté récemment offerte aux services de renseignement d’y recourir, l’extension de ces techniques aux enquêtes du parquet permettra ainsi d’éviter que des instructions soient ouvertes uniquement dans le but de permettre leur mise en œuvre en matière judiciaire, comme c’est parfois le cas aujourd’hui.
Plusieurs magistrats et avocats se sont inquiétées de la place croissante accordée aux enquêtes préliminaires par rapport aux informations judiciaires au travers de ces dispositions, à l’instar de M. Bertrand Louvel, premier président de la Cour de cassation, du Syndicat de la magistrature, de la Conférence nationale des premiers présidents de cours d’appel, de la Conférence nationale des présidents de tribunaux de grande instance, de l’Association des avocats pénalistes, du Syndicat des avocats de France, du Conseil national des barreaux, de la Conférence des bâtonniers et du Conseil de l’ordre des avocats de Paris.
D’autres ont, au contraire, salué le rééquilibrage opéré entre, d’une part, les pouvoirs dévolus aux services de renseignement et ceux donnés aux services d’enquête judiciaires et, d’autre part, les moyens d’investigation respectivement confiés au procureur de la République et au juge d’instruction, notamment M. Jean-Claude Marin, Procureur général près la Cour de cassation, l’Union syndicale des magistrats, la Conférence nationale des procureurs généraux, la Conférence nationale des procureurs de la République ainsi que plusieurs représentants de la section antiterroriste du tribunal de grande instance de Paris.
Votre rapporteur s’est, pour sa part, attaché à examiner les effets positifs susceptibles d’être générés par l’adoption de ces dispositions en matière de lutte contre la grande criminalité et le terrorisme. Il a constaté que, contrairement à ce qui était parfois affirmé, d’importantes garanties étaient apportées au justiciable, au regard des conditions posées à la mise en œuvre de ces techniques d’enquête et au rôle confié au JLD au stade de l’enquête, lequel est un magistrat du siège, indépendant, qui devrait se voir doter prochainement d’un statut plus protecteur avec l’adoption de dispositions organiques en ce sens et auquel il conviendra de donner les moyens de remplir ces nouvelles missions. Enfin, à l’instar de Mme Laurence Le Vert, première vice-présidente chargée de l’instruction à la section antiterroriste du tribunal de grande instance de Paris, il salue la différenciation opérée dans les durées pendant lesquelles le juge d’instruction et le procureur de la République pourront recourir à la sonorisation ou fixation d’images et à la captation de données informatiques. Loin de préfigurer la disparition des instructions au profit des enquêtes préliminaires, le présent article s’attache, au contraire, à préserver l’existence de chacune de ces procédures en définissant de manière proportionnée et cohérente les conditions dans lesquelles ces différents actes d’enquête peuvent être accomplis.
*
* *
La Commission adopte successivement les amendements rédactionnels CL255, CL256, CL257, CL258 et CL259 du rapporteur.
Puis elle adopte l’article 3 modifié.
Article 4
(art. 706-22-1 du code de procédure pénale)
Limitation de la compétence du juge de l’application des peines de Paris aux personnes condamnées pour actes de terrorisme par la juridiction parisienne
Le présent article limite la compétence du juge de l’application des peines (JAP) du tribunal de grande instance (TGI) de Paris, qui s’étend aujourd’hui à l’application de toutes les peines prononcées en matière terroriste, aux seules décisions concernant des personnes condamnées pour des faits de terrorisme par une formation de jugement du tribunal de Paris. L’objectif est, en pratique, de décharger ce juge du suivi des décisions de condamnation pour provocation à des actes de terrorisme ou apologie de ces actes lorsqu’ils ne relèvent pas d’une démarche organisée et structurée.
1. L’application des peines en matière terroriste, une compétence aujourd’hui centralisée à Paris
Depuis 2006 (73), le suivi de l’ensemble des personnes condamnées pour des actes de terrorisme relève de la compétence exclusive et centralisée du JAP, du tribunal de l’application des peines et, en appel, de la chambre de l’application des peines de la cour d’appel de Paris. Complétant l’organisation judiciaire française en matière de lutte contre le terrorisme, fondée sur la compétence nationale concurrente des magistrats parisiens en matière de poursuite, d’instruction et de jugement des actes terroristes, le législateur a en effet inscrit cette règle au premier alinéa de l’article 706-22-1 du code de procédure pénale.
Cohérente avec la centralisation à Paris du traitement des affaires de terrorisme destinée à permettre le recoupement et l’exploitation des informations, la centralisation du contentieux de l’application des peines en matière de terrorisme visait à « s’assurer de l’homogénéité, sur l’ensemble du territoire, des décisions prises à l’endroit des condamnés pour acte de terrorisme, que ceux-ci soient incarcérés ou qu’ils bénéficient d’une mesure d’aménagement de leur peine » et à garantir un suivi de ces condamnés « dont les demandes d’aménagement de la peine mériteraient d’être examinées et décidées par un juge spécialisé ayant une connaissance particulièrement précise des dossiers et de leur dangerosité » (74).
Le deuxième alinéa de l’article 706-22-1 précité prévoit cependant que, dans l’exercice de leur compétence exclusive, les juridictions parisiennes de l’application des peines doivent, préalablement à toute décision, recueillir l’avis du JAP territorialement compétent en application de l’article 712-10 du même code, c’est-à-dire le JAP « de la juridiction dans le ressort de laquelle est situé soit l’établissement pénitentiaire dans lequel le condamné est écroué, soit, si le condamné est libre, la résidence habituelle de celui-ci ou, s’il n’a pas en France de résidence habituelle, le juge de l’application des peines du tribunal dans le ressort duquel a son siège la juridiction qui a statué en première instance ».
En conséquence de la compétence nationale qui leur est ainsi conférée, les magistrats des juridictions parisiennes de l’application des peines « peuvent se déplacer sur l’ensemble du territoire national » mais, afin de limiter leurs déplacements et d’éviter le transfèrement délicat ou dangereux de certains détenus, ils peuvent également recourir à la visio-conférence (dernier alinéa du même article 706-22-1).
2. Face à l’accroissement du contentieux terroriste, la nécessaire limitation de la compétence parisienne aux seules peines de terrorisme prononcées à Paris
Près de dix années après son instauration, la compétence exclusive de la juridiction parisienne en matière de suivi des peines paraît de moins en moins adaptée à l’accroissement quantitatif et à la dissémination géographique de ce contentieux. Le champ des infractions terroristes s’est élargi de manière notable depuis 2006, en particulier avec l’introduction dans le code pénal, au sein des articles relatifs aux actes de terrorisme, des délits de provocation à la commission d’actes de terrorisme et d’apologie de ces actes, qui relevaient auparavant du régime de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse (75).
Selon le Gouvernement, depuis leur transfert dans le code pénal, 185 affaires de provocation à la commission d’actes de terrorisme et d’apologie de ces actes, concernant 201 personnes, auraient été recensées, ayant donné lieu au prononcé de peines d’emprisonnement ferme à l’encontre de 23 auteurs (76). Au total, au 31 décembre 2015, le cabinet du JAP de Paris compétent en matière terroriste assurait seul le suivi de 240 condamnés pour des faits de terrorisme – un chiffre en hausse de 27 % par rapport à 2014 – et faisait face à un nombre croissant de demandes d’aménagement des peines – en augmentation de près de 24 % entre 2013 et 2014 et de 47 % entre 2014 et 2015.
La commission d’enquête créée par notre Assemblée sur la surveillance des filières et des individus djihadistes a ainsi constaté qu’« [e]n raison de sa compétence exclusive en matière de terrorisme, le juge de l’application des peines de Paris suit un très grand nombre de dossiers » alors que « ses moyens sont insuffisants face à la masse de dossiers que ce juge doit suivre, puisqu’il est seul avec un greffier ». Elle suggérait donc d’« [a]dapter la compétence centralisée de la juridiction parisienne au changement d’échelle du contentieux terroriste ». Elle proposait de « prévoir une exception à la compétence exclusive de la juridiction parisienne (…) pour les dossiers concernant des personnes condamnées pour apologie et provocation au terrorisme » au motif que leur traitement centralisé se justifie moins que pour les autres délits terroristes, « les personnes condamnées ayant un profil différent, les tribunaux correctionnels locaux étant compétents et les peines comme les suivis étant de courte durée » (77).
En effet, si, en principe, toutes les infractions terroristes entrant dans le champ d’application de l’article 706-16 du code de procédure pénale relèvent de la compétence concurrente de la juridiction parisienne, la section antiterroriste du parquet de Paris ne se saisit que des faits « s’inscrivant non dans une glorification isolée et ponctuelle du terrorisme, mais dans une démarche organisée et structurée de propagande », conformément à une circulaire de la garde des Sceaux du 5 décembre 2014 (78), soit le plus souvent le cas de ressortissants français participant à des films de propagande terroriste.
En conséquence, le présent article, qui modifie l’article 706-22-1 précité, réserve la compétence du JAP de Paris, du tribunal de l’application des peines de Paris et, en appel, de la chambre de l’application des peines de la cour d’appel de Paris aux seules « décisions concernant les personnes condamnées par le tribunal correctionnel, la cour d’assises, le juge des enfants, le tribunal pour enfants ou la cour d’assises des mineurs de Paris » statuant sur des faits de terrorisme.
Cette disposition devrait donc conduire, en pratique, à décharger le JAP de Paris du suivi des décisions concernant les personnes condamnées pour provocation au terrorisme ou apologie de celui-ci en application de l’article 421-2-5 du code pénal dès lors que ces faits ne relèvent pas d’une démarche organisée de propagande terroriste.
*
* *
La Commission adopte l’article 4 sans modification.
Article 4 bis (nouveau)
(art. 132-45 du code pénal)
Nature des obligations du sursis avec mise à l’épreuve
en cas de condamnation pour une infraction terroriste
Le présent article, adopté par la commission des Lois à l’initiative de votre rapporteur, vise à compléter la liste des obligations susceptibles d’être prononcées dans le cadre d’un sursis avec mise à l’épreuve en cas de condamnation pour une infraction terroriste.
1. Les obligations du sursis avec mise à l’épreuve
En vertu des articles 132-40 à 132-42 du code pénal, la juridiction qui prononce une peine d’emprisonnement peut décider de l’assortir du sursis et de placer la personne concernée sous le régime de la mise à l’épreuve. Cette peine n’est toutefois applicable qu’« aux condamnations à l’emprisonnement prononcées pour une durée de cinq ans au plus, en raison d’un crime ou d’un délit de droit commun », et, lorsque la personne est récidiviste, « aux condamnations à l’emprisonnement prononcées pour une durée de dix ans au plus ». Par ailleurs, le sursis avec mise à l’épreuve (SME) ne peut pas être prononcé à l’encontre d’une personne déjà condamnée par deux fois à une telle peine pour des délits identiques ou assimilés et se trouvant en état de récidive légale. Il en va de même à l’égard d’une personne en état de récidive légale déjà condamnée une fois au SME pour des infractions identiques ou assimilées lorsqu’il s’agit d’un crime ou d’un délit de violences volontaires, d’agressions ou d’atteintes sexuelles ou commis avec la circonstance aggravante de violences.
Plusieurs obligations s’imposent à la personne condamnée dans les conditions fixées par les articles 132-43 à 132-46 du même code. Certaines mesures de contrôle sont mises en œuvre indépendamment d’obligations particulières, comme l’obligation de répondre aux convocations du juge de l’application des peines ou du travailleur social, ou celle d’informer préalablement le premier de tout déplacement à l’étranger et le second de tout changement d’emploi ou de résidence (article 132-44). D’autres obligations, facultatives, peuvent être ajoutées à ces mesures de contrôle. Définies par l’article 132-45, ces obligations particulières recouvrent un vaste spectre de mesures, allant de l’exercice d’une activité professionnelle à la réparation des dommages causés par l’infraction en passant par le suivi d’un stage de citoyenneté (voir l’encadré ci--après).
Liste des obligations spéciales susceptibles d’être imposées à un condamné
dans le cadre d’un SME (article 132-45 du code pénal)
1° Exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation ;
2° Établir sa résidence en un lieu déterminé ;
3° Se soumettre à des mesures d’examen médical, de traitement ou de soins ;
4° Justifier qu’il contribue aux charges familiales ou acquitte les pensions alimentaires ;
5° Réparer en tout ou partie, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par l’infraction ;
6° Justifier qu’il s’acquitte en fonction de ses facultés contributives les sommes dues au Trésor public à la suite de la condamnation ;
7° S’abstenir de conduire certains véhicules ;
7°bis Sous réserve de son accord, s’inscrire et se présenter aux épreuves du permis de conduire, le cas échéant après avoir suivi des leçons de conduite ;
8° Ne pas se livrer à l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise ou ne pas exercer une activité impliquant un contact habituel avec des mineurs ;
9° S’abstenir de paraître en certains lieux ou certaines zones ;
10° Ne pas engager de paris et ne pas prendre part à des jeux d’argent et de hasard ;
11° Ne pas fréquenter les débits de boissons ;
12° Ne pas fréquenter certains condamnés ;
13° S’abstenir d’entrer en relation avec certaines personnes, dont la victime, ou certaines catégories de personnes, et notamment des mineurs, à l’exception de ceux désignés par la juridiction ;
14° Ne pas détenir ou porter une arme ;
15° En cas d’infraction commise à l’occasion de la conduite d’un véhicule terrestre à moteur, accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;
16° En cas de condamnation pour crimes ou délits d’atteintes volontaires à la vie, d’agressions ou d’atteintes sexuelles, s’abstenir de diffuser tout ouvrage ou œuvre audiovisuelle dont il serait l’auteur ou le coauteur et qui porterait sur l’infraction commise et s’abstenir de toute intervention publique relative à cette infraction ;
17° Remettre ses enfants entre les mains de ceux auxquels la garde a été confiée ;
18° Accomplir un stage de citoyenneté ;
19° En cas d’infraction commise soit contre son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, soit contre ses enfants ou ceux de son conjoint, concubin ou partenaire, résider hors du domicile ou de la résidence du couple et, le cas échéant, s’abstenir de paraître dans ce domicile ou cette résidence ou aux abords immédiats de celui-ci, ainsi que, si nécessaire, faire l’objet d’une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique ;
20° Accomplir à ses frais un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes ;
21° Obtenir l’autorisation préalable du juge de l’application des peines pour tout déplacement à l’étranger.
2. La nécessité de les compléter pour favoriser les actions de « déradicalisation »
Les obligations particulières susceptibles d’être imposées à une personne condamnée à un SME telles qu’elles sont mentionnées dans la liste figurant à l’article 132-45 précité ne comportent aucune disposition spécifique aux personnes condamnées pour des faits de terrorisme.
C’est la raison pour laquelle le présent article complète cette liste pour les seules personnes condamnées pour terrorisme afin de prévoir l’obligation particulière d’être prises en charge sur le plan sanitaire, social, éducatif ou psychologique. Cette formulation permettra de prescrire aux personnes reconnues coupables des infractions terroristes les moins graves, si leur personnalité permet une alternative à l’incarcération, de suivre, par exemple, des stages de « déradicalisation ».
Entendus par votre rapporteur, M. François Molins, procureur de la République de Paris, et Mme Camille Hennetier, vice-procureur, chef de la section antiterroriste au tribunal de grande instance de Paris, ont souligné l’utilité d’une telle mesure. Une disposition similaire figure également dans la proposition de loi tendant à renforcer l’efficacité de la lutte antiterroriste récemment adoptée par le Sénat à l’initiative du président de la commission des Lois, M. Philippe Bas (79).
*
* *
La Commission est saisie de l’amendement CL260 du rapporteur.
M. le rapporteur. Le présent amendement vise à compléter la liste des obligations susceptibles d’être prononcées dans le cadre d’un sursis avec mise à l’épreuve telle qu’elle est prévue par l’article 132-45 du code pénal pour les condamnations à l’emprisonnement de cinq ans au plus en cas de condamnation pour infraction terroriste.
En effet, les auditions que j’ai conduites ont fait apparaître la nécessité de mentionner la possibilité pour des personnes condamnées pour les infractions terroristes les moins graves, et si leur personnalité s’y prête, d’accomplir un stage de « déradicalisation » ou, plus généralement, de faire l’objet d’une prise en charge particulière en la matière.
La Commission adopte l’amendement. L’article 4 bis est ainsi rédigé.
La Commission examine l’amendement CL58 de M. Éric Ciotti.
M. Georges Fenech. Nous revenons à la question – non objective selon le rapporteur – de la sanction. Cet amendement issu de la proposition de loi tendant à renforcer l’efficacité de la lutte antiterroriste, déposée par M. Philippe Bas et adoptée par le Sénat, propose que l’association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste, actuellement délictuelle, puisse être davantage réprimée.
Il s’agit d’une part de créer une circonstance aggravante permettant de criminaliser les associations de malfaiteurs en vue d’une entreprise terroriste, lorsqu’elles sont commises à l’étranger, ou après un séjour à l’étranger, sur un théâtre d’opérations de groupements terroristes.
D’autre part, cet amendement entend renforcer le quantum des peines relatives aux crimes terroristes, dès lors que l’association de malfaiteurs prépare un crime d’atteinte à la vie ou des actes susceptibles d’entraîner la mort. Actuellement punis de 20 ans de réclusion criminelle et de 350 000 euros d’amende, ces crimes seraient désormais punis de 30 ans d’emprisonnement et de 450 000 euros d’amende. La peine de réclusion criminelle pour les dirigeants d’un groupe terroriste, prévue à l’article 421-5 du code pénal, serait également portée à trente ans.
Enfin, il modifie l’article 421-3 du même code afin de permettre à la cour d’assises, en cas de condamnation pour meurtre commis en bande organisée en relation avec une entreprise individuelle ou collective terroriste, de prononcer soit une période de sûreté de trente ans si elle prononce une peine à temps, soit une période de sûreté dite « incompressible » si elle prononce une réclusion criminelle à perpétuité.
M. Alain Tourret. Nous n’en finissons pas d’augmenter les peines, bientôt nous appliquerons la réclusion criminelle à perpétuité pour tous les crimes et délits. À l’occasion de nos travaux sur la prescription en matière pénale, M. Georges Fenech et moi-même avons constaté à quel point les peines s’alourdissaient avec le temps : certains délits sont punis d’une peine d’emprisonnement de trente ans ! Il faut mettre un terme à cette dérive ou s’astreindre à reconsidérer l’ensemble de l’échelle des peines.
M. Philippe Gosselin. Le Sénat a fourni un travail de fond dont les constats sont partagés par beaucoup, au-delà du président de la commission des Lois, M. Philippe Bas. Il est important d’envoyer un signal fort.
M. le rapporteur. Vous empiétez peut-être sur les intentions du Sénat – nos collègues auront l’occasion de débattre de ces sujets.
À ce stade, je rappelle qu’une période de sûreté générale, à la moitié de la peine, ou aux deux tiers de la peine et pouvant atteindre 22 ans est déjà possible. L’amendement propose donc une modification substantielle du droit existant ne correspondant pas à une demande qui aurait été exprimée par les magistrats antiterroristes. Cette modification de l’échelle des peines ne manquerait pas de perturber l’équilibre établi par le législateur jusqu’à ce jour. Une telle criminalisation aurait pour effet de faire juger ces infractions par la cour d’assises spéciale de Paris, avec un risque d’engorgement de la justice antiterroriste et une perte de souplesse pour les magistrats. Pour ces raisons, mon avis est défavorable.
La Commission rejette l’amendement.
Puis elle est saisie de l’amendement CL61 de M. Éric Ciotti.
M. Philippe Goujon. Le présent texte vise à renforcer l’efficacité des mesures antiterroristes : notre amendement tend à rendre obligatoire la peine complémentaire d’interdiction du territoire français pour les condamnés terroristes étrangers, sauf décision spéciale et motivée de la juridiction de jugement.
Cette peine complémentaire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement ou de réclusion.
Au regard du faible nombre de peines complémentaires aujourd’hui prononcées, il est proposé que celle-ci soit automatique, sauf décision spécialement motivée en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur.
M. le rapporteur. Il est déjà possible de prononcer de telles peines, mais cela n’est pas obligatoire – et pas toujours réalisable. Faut-il rendre la peine automatique ? À mes yeux, cela n’apporterait rien au droit, et, sur le plan des principes, je suis favorable à l’individualisation de chacune des décisions de justice. Mon avis est donc défavorable.
La Commission rejette l’amendement.
Puis elle étudie l’amendement CL60 de M. Éric Ciotti.
M. Philippe Goujon. Cet amendement a pour objet d’augmenter les durées maximales de détention provisoire pour les personnes mineures de plus de 16 ans mises en examen dans des procédures terroristes.
M. le rapporteur. Il s’agit là aussi de l’un des articles de la proposition de loi de M. Philippe Bas au Sénat. Cet amendement paraît fort peu compatible avec les dispositions de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990. Avis défavorable.
La Commission rejette l’amendement.
Elle examine ensuite l’amendement CL6 de M. Éric Ciotti.
M. Philippe Goujon. Il s’agit de permettre la prolongation de la garde à vue de personnes soupçonnées d’avoir commis des crimes ou des délits constituant des actes de terrorisme. Le droit en vigueur autorise une durée maximale de six jours de garde à vue ; cet amendement, en autorisant le juge des libertés et de la détention à renouveler deux fois supplémentaires le maintien en garde à vue, porterait sa durée totale à huit jours.
M. Alain Tourret. Je suis favorable à cet amendement.
M. le rapporteur. C’est là l’un de ces amendements qui m’évoquent le « monsieur Plus » des publicités Bahlsen : c’est plus d’affichage. Six jours constituent d’ores et déjà une durée de garde à vue extrêmement longue, et aucun des magistrats que j’ai pu rencontrer ne demandait à disposer de plus de temps. Maurice Thorez disait qu’il faut savoir arrêter une grève : il faut aussi savoir limiter l’inflation des durées dont nous décidons. Mon avis est défavorable.
M. Philippe Goujon. Je peux comprendre la position du rapporteur, mais de nombreux exemples étrangers la démentent : dans un certain nombre de pays, même si leur système judiciaire est différent – je pense au Royaume-Uni –, les gardes à vue durent beaucoup plus longtemps qu’en France.
La Commission rejette l’amendement.
Puis elle examine, en discussion commune, les amendements CL4 de M. Éric Ciotti et CL37 de M. Philippe Goujon.
M. Pierre Morel-A-L’Huissier. Par l’amendement CL4, nous proposons l’isolement systématique de tout individu condamné pour acte de terrorisme.
M. Alain Tourret. L’amendement ne prévoit pas de limitation dans le temps, et c’est tout le problème : une telle peine d’isolement perpétuel est inconcevable.
M. Philippe Goujon. L’amendement CL 37 vise à sécuriser juridiquement le regroupement des détenus prosélytes tel qu’il est actuellement expérimenté à Fresnes dans une unité de prévention du prosélytisme, en établissant un cadre légal proche de celui de la mise en isolement et assorti des mêmes garanties procédurales. De fait, les modalités et les critères de ces regroupements sont particulièrement flous. Ainsi, aucune procédure ne permet à un détenu de contester son placement dans cette unité. Par ailleurs, nous proposons d’appliquer ce dispositif non seulement aux individus mis en cause ou condamnés pour des faits en lien avec une entreprise terroriste, mais aussi aux détenus condamnés pour d’autres motifs mais qui se sont radicalisés et exercent des pressions graves sur leurs codétenus.
M. le rapporteur. Avis défavorable. Les expérimentations en cours sont intéressantes et doivent, selon moi, être développées. Faut-il pour autant aller jusqu’à leur donner un fondement législatif ? Cela me semble prématuré.
La Commission rejette successivement ces amendements.
Article 4 ter (nouveau)
(art. L. 811-4 du code de la sécurité intérieure)
Intégration du bureau du renseignement pénitentiaire dans
le « deuxième cercle » de la communauté du renseignement
Le présent article, issu de l’adoption par la commission des Lois de trois amendements identiques déposés par des parlementaires de la majorité et de l’opposition, MM. Éric Ciotti, Sébastien Pietrasanta et Philippe Goujon, avec l’avis favorable de votre rapporteur, permet au Gouvernement d’inscrire le bureau du renseignement pénitentiaire dans le décret pris en Conseil d’État précisant quelles administrations, autres que les services spécialisés de renseignement, peuvent recourir à des techniques de recueil du renseignement.
1. Le renseignement pénitentiaire
La direction de l’administration pénitentiaire a instauré, depuis de nombreuses années, un service rattaché à la sous-direction de l’état-major de sécurité, dénommé « bureau du renseignement pénitentiaire » (BRP). Aux termes de l’arrêté du 9 juillet 2008 (80), ce bureau, aujourd’hui composé de 16 personnes, a pour missions de recueillir et d’analyser l’ensemble des informations utiles à la sécurité des établissements et des services pénitentiaires. Il organise la collecte de ces renseignements auprès des services déconcentrés, procède à leur exploitation à des fins opérationnelles et assure la liaison avec les services centraux de la police et de la gendarmerie.
De manière plus générale, le renseignement pénitentiaire s’appuie sur un réseau d’officiers de renseignement au sein des neuf directions interrégionales pénitentiaires (DIRP) et de la mission des services pénitentiaires de l’outre-mer – à raison de 68 personnes actuellement et 80 d’ici la fin de l’année, contre 10 en 2012 – et des établissements pénitentiaires – 75 personnes aujourd’hui et 89 d’ici la fin de l’année, contre 45 en 2012. Si au sein des DIRP, ces fonctionnaires exercent leurs missions de renseignement à plein temps, tel n’est pas le cas au sein des établissements pénitentiaires où le fonctionnaire qui en est chargé peut parfois exercer d’autres fonctions.
Par ailleurs, le monde carcéral est couvert par l’action de certains services spécialisés de renseignement, en particulier la direction générale de la sécurité intérieure, qui peut y mettre en œuvre certaines techniques dans les conditions de droit commun.
2. La participation du bureau du renseignement pénitentiaire au « deuxième cercle » de la communauté du renseignement
L’article L. 811-4 du code de la sécurité intérieure dispose qu’un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, désigne les services autres que les services spécialisés de renseignement (81) qui peuvent être également autorisés à recourir par eux-mêmes, et dans les conditions de forme et de fond prévues par le code de la sécurité intérieure, à certaines techniques de renseignement, pour une ou plusieurs finalités. Ces services, qui, sans appartenir à la communauté du renseignement, exercent des missions de renseignement, relèvent du « deuxième cercle ».
Par la loi n° 2015-912 du 24 juillet 2015 relative au renseignement, le Parlement a fixé la liste des services que le pouvoir réglementaire peut intégrer à ce « deuxième cercle » en visant les services relevant des ministres de la défense et de l’intérieur ainsi que des ministres chargés de l’économie, du budget ou des douanes. La liste complète des services concernés figure à l’article R. 811-2 du même code.
L’opportunité d’ajouter à cette liste les services du ministère de la justice exerçant des missions de renseignement avait soulevé d’importants débats lors de l’adoption de la loi relative au renseignement. L’Assemblée nationale s’était prononcée en faveur d’une telle mesure, contre l’avis du Gouvernement mais avec le soutien de M. Jean-Jacques Urvoas, alors président de la commission des Lois, et de votre rapporteur. Toutefois, le Sénat avait finalement décidé de sortir le BRP du « deuxième cercle » de la communauté du renseignement, solution retenue par la commission mixte paritaire (82).
Compte tenu des besoins fortement exprimés par l’administration pénitentiaire en ce domaine et de la nécessité de renforcer les conditions de surveillance de certains détenus dangereux, le présent article ajoute à la liste des services déjà mentionnés par l’article L. 811-4 les services relevant du ministre de la justice. Cet ajout n’aura pas pour effet de faire du personnel pénitentiaire des agents de renseignement mais d’ouvrir une possibilité pour l’administration pénitentiaire, et notamment pour son BRP, de solliciter la mise en œuvre de techniques de renseignement pour l’accomplissement de certaines de ses missions.
*
* *
La Commission examine en discussion commune les amendements CL35 de M. Philippe Goujon, CL16 de M. Éric Ciotti, CL219 de M. Sébastien Pietrasanta et CL221 de M. Philippe Goujon, les trois derniers amendements étant identiques.
M. Philippe Goujon. Par l’amendement CL35, nous proposons de permettre au renseignement pénitentiaire d’être plus efficace. Il s’agit, tout d’abord, de l’autoriser à utiliser les IMSI-catcher, comme l’avait du reste proposé le Gouvernement lors de l’examen du projet de loi sur le renseignement. Il s’agit, ensuite, de lui permettre d’écouter les appels passés par les détenus avec un téléphone portable clandestin – je rappelle qu’environ 30 000 de ces téléphones sont saisis chaque année –, comme c’est déjà le cas pour les appels passés sur des téléphones fixes. L’administration pénitentiaire aurait ainsi la possibilité de saisir la nouvelle Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement (CNCTR). Je précise que ces écoutes seraient, bien entendu, réalisées par des personnes habilitées extérieures à la détention. Enfin, l’amendement vise à intégrer le renseignement pénitentiaire à la communauté du renseignement, comme l’avait d’ailleurs proposé l’ancien président de notre Commission, aujourd’hui garde des Sceaux, lors de l’examen du projet de loi sur le renseignement. Il s’agit d’une demande ancienne de l’administration pénitentiaire. Il serait d’autant plus logique que le bureau du renseignement pénitentiaire figure dans cette instance que les douanes et TRACFIN font partie du premier cercle. En quoi, en effet, la lutte contre les évasions et la surveillance des détenus serait moins légitime que la lutte contre la fraude fiscale et douanière ?
M. Sébastien Pietrasanta. L’amendement CL219 vise à offrir au Gouvernement la possibilité de modifier le décret du 11 décembre 2015 afin d’intégrer le bureau du renseignement pénitentiaire – qui n’est plus surnommé l’EMS3 – dans le deuxième cercle de la communauté du renseignement. Je rappelle que, lors de l’examen du projet de loi sur le renseignement, notre Commission avait émis un avis favorable à cette intégration, qui n’a cependant été retenue ni par le Sénat ni par la CMP. Les deux plans de lutte contre le terrorisme des mois de janvier et novembre 2015 ont doté le bureau du renseignement pénitentiaire de moyens budgétaires et de personnels supplémentaires, le recrutement de 66 agents permettant de porter ses effectifs à 150.
M. Alain Tourret. Je dois avouer que je suis très favorable à l’amendement CL35. Il ne s’agit pas d’obliger le Gouvernement à modifier le décret du 11 décembre 2005, mais de lui en donner la possibilité. Les prisons ne sauraient être des passoires. Loin de porter atteinte aux libertés, une telle mesure offrirait un moyen de contrôle indispensable.
Mme Sandrine Mazetier. Ce débat a déjà eu lieu, à l’Assemblée et au Sénat, lors de l’examen d’un précédent projet de loi. Le ministère de tutelle de l’administration pénitentiaire n'est absolument pas demandeur de ce type de dispositions et, à titre personnel, je n’y suis pas favorable.
M. Yves Goasdoué. Je ne pense pas que, aujourd’hui, le ministère de la justice ne soit pas demandeur : une réflexion a été menée sur ce point et des évolutions sont intervenues. Il ne nous semble pas opportun de maintenir le service du renseignement pénitentiaire en dehors de la communauté du renseignement. C’est pourquoi le groupe Socialiste, républicain et citoyen est favorable à l’amendement CL219 de M. Pietrasanta.
M. le rapporteur. Il s’agit, non pas d’intégrer le renseignement pénitentiaire dans la communauté du renseignement, qui comprend les six services du premier cercle, mais de donner la possibilité à l’administration pénitentiaire d’avoir recours directement à certaines techniques de renseignement. Par ailleurs, non seulement l’administration du ministère de la justice était, je crois, demandeuse de cette mesure, mais le garde des Sceaux actuel avait déposé un amendement en ce sens lors de l’examen du projet de loi sur le renseignement.
Mme Sandrine Mazetier. La garde des Sceaux de l’époque n’y était pas favorable !
M. le rapporteur. Je n’ai parlé que de l’administration du ministère et de l’actuel garde des Sceaux.
En outre, un amendement similaire avait été adopté par notre Commission, puis en séance publique – je l’avais moi-même voté. Je ne vois donc pas pourquoi je serais défavorable à ces amendements sur le principe. Je suggère cependant à M. Goujon de retirer l’amendement CL35, sachant que je donnerai un avis favorable aux trois amendements identiques, dont deux portent sa signature.
M. Philippe Goujon. Je retire l’amendement CL35.
Mme Sandrine Mazetier. Je rappelle à toutes fins utiles que, lors des débats sur le projet de loi relatif au renseignement, un amendement similaire a en effet été adopté en séance publique, mais qu’il l’a été contre l’avis du Gouvernement, représenté alors par le ministre de l’intérieur.
Mme Marie-Françoise Bechtel. Pour ma part, je ne voterai pas ces amendements. Je me rappelle très bien le débat que nous avons eu sur ce point : la garde des Sceaux de l’époque avait expliqué de manière précise et argumentée la nécessité de ne pas faire un camaïeu des différents services de renseignement en y incluant, comme si c’était naturel, les services de la justice. Elle avait notamment insisté sur le fait qu’il ne fallait pas transformer le métier de gardien de prison et que le bureau du renseignement pénitentiaire était une unité spécialement constituée qui pouvait, en relation avec les services, effectuer un renseignement efficace au sein des établissements pénitentiaires. Tout le monde est d’accord pour qu’un tel renseignement existe dans ces établissements, mais transformer le métier de la pénitentiaire en y incluant le renseignement n’est ni utile ni conforme à une saine pratique des institutions de la République.
M. Yves Goasdoué. Mme Bechtel a raison ; j’étais présent lors du débat qu’elle a évoqué. Mais, une fois n’est pas coutume, je ne suis pas entièrement d’accord avec elle. En effet, il ne s’agit pas de mélanger les fonctions, mais de permettre à un service dédié, rattaché à l’administration pénitentiaire, d’avoir, dans le cadre du « deuxième cercle », des rapports plus simples et juridiquement encadrés avec les autres services de renseignement. Nous nous plaignons tous du manque de fluidité de l’information dans ces services ; le moment est venu de remédier à cette situation.
M. Éric Ciotti. Si j’ai déposé l’amendement CL16, c’est parce que la prison, qui est un lieu de radicalisation, peut être aussi, pour les services, un lieu de détection et de prévention de la commission de crimes et de délits terroristes. Il est donc essentiel de rattacher les services de l’administration pénitentiaire à la communauté du renseignement et de faire en sorte que cette administration puisse recourir aux techniques de renseignement. Du reste, l’ancien président de notre Commission et actuel garde des Sceaux s’est beaucoup battu, hélas sans succès, en faveur de cette intégration, qui ne peut qu’améliorer nos dispositifs de sécurité.
M. Sébastien Pietrasanta. Je veux tout d’abord rappeler que, depuis l’adoption de la loi sur le renseignement, le bureau du renseignement pénitentiaire a été doté de moyens humains et financiers supplémentaires, de sorte qu’il est devenu un véritable service de renseignement. Par ailleurs, il est nécessaire de faciliter la fluidité et la transversalité des relations entre les différents services de renseignement. Enfin, il s’agit d’intégrer le renseignement pénitentiaire, non pas dans la communauté du renseignement, mais dans le deuxième cercle. Il est évident que la détection de la radicalisation dans les prisons est un enjeu primordial en matière de lutte contre le terrorisme. Or les amendements dont nous discutons visent à la faciliter. J’espère donc qu’ils seront adoptés.
L’amendement CL35 a été retiré.
La Commission adopte les amendements identiques CL16, CL219 et CL221. L’article 4 ter est ainsi rédigé.
La Commission est saisie de l’amendement CL36 de M. Philippe Goujon.
M. Philippe Goujon. Cet amendement en reprend un autre qui avait été déposé sur le projet de loi relatif au renseignement par l’actuel président de notre Commission et qui, hélas, n’a pas été préservé au cours de la navette parlementaire. Un détenu pouvant tenter de radicaliser ses codétenus par le vecteur de la correspondance, il est proposé de permettre la retenue de celle-ci en cas de « pressions graves ou réitérées sur autrui en faveur d’une religion, d’une idéologie ou d’une organisation violente ou terroriste ». Cet amendement a également pour objet d’introduire, à l’article 35 de la loi pénitentiaire, un nouveau cas de refus de permis de visite en permettant au chef d’établissement, sur décision motivée, de refuser d’accorder un permis de visite ou de retirer celui-ci à des personnes extérieures en cas de prosélytisme avéré en faveur de mouvements ou d’actions tendant à favoriser la violence ou le terrorisme.
M. le rapporteur. Avis défavorable. L’article 35 de la loi pénitentiaire de 2009 prévoit déjà des motifs suffisamment larges et généraux susceptibles de justifier le refus de délivrer un permis de visite. Quant au contrôle des correspondances écrites, il est autorisé à l’article 40 de la même loi.
La Commission rejette l’amendement.
Puis elle examine, en discussion commune, les amendements CL3 de M. Éric Ciotti et CL38 de M. Philippe Goujon.
M. Éric Ciotti. L’amendement CL3 vise à autoriser la fouille des visiteurs et des détenus dans les établissements pénitentiaires. Lorsque nous l’avons auditionnée dans le cadre de la commission l’enquête sur les filières djihadistes, la directrice de l’administration pénitentiaire a indiqué qu’en 2014, environ 27 000 téléphones portables avaient été saisis dans les établissements pour peines et les maisons d’arrêt. Ce chiffre révèle la porosité de ces établissements. Il faut donc revenir sur la restriction des possibilités de fouiller les détenus, qui fait peser des menaces importantes sur le personnel pénitentiaire, auquel je veux rendre hommage pour le travail remarquable qu’il accomplit. Cette mesure de sécurité correspond, du reste, à l’une de ses revendications fortes et légitimes. On sait en effet que l’introduction d’objets, notamment de téléphones portables, dans les établissements pénitentiaires permet de maintenir la continuité de certains réseaux de délinquance, qui s’organisent depuis la prison ; ce fut notamment le cas, hélas ! dans certaines affaires de terrorisme. Nous devons donc, en particulier en cette période de menaces extrêmes et afin de lutter contre le terrorisme et la délinquance générale, revenir sur les dispositions inopportunes de l’article 57 de la loi pénitentiaire de 2009. Je précise, à ce propos, que je n’ai pas voté cette loi et que je m’étais fortement opposé à son article 57, qui me paraît contraire au pragmatisme dont il faut faire preuve pour assurer la sécurité en prison.
M. le rapporteur. La prolifération du nombre de téléphones portables en milieu carcéral est un véritable sujet de préoccupation, mais il n’est pas nécessaire de modifier la loi sur ce point. En effet, le droit en vigueur, notamment la loi de 2009, permet les fouilles en cas de présomption d’une infraction ou en raison des risques que le comportement des personnes détenues fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l'établissement. Je rappelle, en outre, qu’en 2007, notre pays a été condamné par la Cour européenne des droits de l’homme, dans l'affaire « Frérot contre France », au motif que si les fouilles peuvent être justifiées par des considérations de sécurité, elles doivent cependant demeurer nécessaires et proportionnées au regard de leurs finalités.
Si des téléphones portables sont introduits dans les prisons, c’est davantage par manque de moyens humains pour faire appliquer la loi actuelle que par manque de moyens juridiques. La volonté politique et des moyens humains supplémentaires devraient donc permettre de régler le problème, sans qu’il soit besoin de nous mettre en difficulté par rapport aux conventions que nous avons signées.
M. Alain Tourret. Un tel amendement soulève deux problèmes. Tout d’abord, le terme de « visiteur » est extrêmement vague. Un enseignant, un avocat ou un député qui se rend en prison doit-il être considéré comme un visiteur et faire l’objet, à ce titre, d’une fouille systématique ? Pourquoi ne pas revenir, dans ce cas, sur la suppression des fouilles corporelles intégrales que nous avions votée dans la loi sur la présomption d’innocence ?
Ensuite, il conviendrait, si nous devions rétablir ces fouilles, de faire la différence entre ceux qui sont présumés innocents et ceux qui sont reconnus coupables, car ce n’est tout de même pas la même chose ! En tout état de cause, une telle mesure serait, selon moi, extraordinairement humiliante.
M. Georges Fenech. Monsieur le rapporteur, vous avez fait référence aux fouilles aléatoires, qui sont en effet toujours possibles. Mais cet amendement vise à rétablir les fouilles systématiques à chaque parloir. Je ne comprends pas que l’on puisse hésiter à adopter un tel amendement, car on sait très bien que la radicalisation se fait surtout en prison et par internet. Or, le téléphone portable offre un accès à internet et, par voie de conséquence, à la propagande de l’État islamique. Dans la période actuelle, le rétablissement des fouilles systématiques serait donc une mesure protectrice et préventive tout à fait indispensable : on ne peut pas continuer à laisser entrer dans les établissements pénitentiaires quelque 24 000 téléphones portables par an, surtout lorsque l’on sait que certains des attentats dont la France a été victime en 2015 auraient été cordonnés – je n’ai pas d’informations plus précises sur ce point – depuis des prisons à l’aide de téléphones portables. Encore une fois, et peu importent les recommandations européennes, il est absolument nécessaire de rétablir des fouilles systématiques avant les parloirs.
M. Philippe Goujon. Il convient de distinguer les fouilles aléatoires des fouilles systématiques. Le rapporteur a raison : les premières sont possibles. Mais l’amendement CL38 vise à rétablir les fouilles systématiques. En effet, plusieurs directeurs d’établissements nous l’ont dit : s’ils pratiquent de telles fouilles sur des détenus condamnés pour terrorisme, ces derniers porteront plainte et l’administration pénitentiaire leur recommandera de ne plus pratiquer ces fouilles. Par ailleurs, depuis l’application de la loi pénitentiaire, le nombre de téléphones portables interceptés a presque triplé. Une augmentation aussi considérable montre combien il est nécessaire de rétablir les fouilles systématiques.
La Commission rejette successivement ces amendements.
Puis elle examine l’amendement CL39 de M. Philippe Goujon.
M. Philippe Goujon. Il s’agit de donner une base légale à l’installation de la vidéo-protection dans les parloirs ordinaires, qui sont non seulement le point d’entrée privilégié des substances ou objets interdits en détention, mais aussi le lieu où les détenus – ce fut le cas notamment de Mohammed Merah – peuvent être approchés par des visiteurs extérieurs.
M. le rapporteur. Avis défavorable. Il est inutile d’en dire davantage…
La Commission rejette l’amendement.
Chapitre II
Dispositions renforçant la protection des témoins
Article 5
(art. 306-1 et 400-1 [nouveaux] du code de procédure pénale)
Audition de témoins à huis clos en cas de risques graves de représailles en matière de crimes contre l’humanité ou d’infractions graves
Le présent article offre la faculté à la cour d’assises et au tribunal correctionnel appelés à juger des crimes et délits particulièrement graves d’auditionner à huis clos certains témoins en cas de risques graves de représailles à leur encontre.
1. Les modalités d’audition des témoins devant les juridictions de jugement
Devant les juridictions de jugement, toutes les personnes susceptibles de concourir à la manifestation de la vérité peuvent être invitées à déposer. Le ministère public et les avocats des parties peuvent poser directement des questions aux témoins appelés à déposer, en matière délictuelle (83) et criminelle (84).
En matière délictuelle, les conditions d’audition des témoins par les tribunaux correctionnels sont fixées par les articles 435 à 457 du code de procédure pénale. Toute personne citée pour être entendue comme témoin est tenue de comparaître, de prêter serment de dire toute la vérité, rien que la vérité et de déposer. En application de l’article 400 du code de procédure pénale, les audiences sont publiques, sauf lorsque « la publicité est dangereuse pour l’ordre, la sérénité des débats, la dignité ou les intérêts d’un tiers ».
L’audition des témoins devant la cour d’assises est régie par les articles 329 à 344 du même code. En application de l’article 331, « [l]es témoins doivent, sur la demande du président, faire connaître leurs nom, prénoms, âge, profession, leur domicile ou résidence ». Le même article dispose que, « [a]vant de commencer leur déposition, les témoins prêtent le serment " de parler sans haine et sans crainte, de dire toute la vérité, rien que la vérité " ». En vertu de l’article 306 du même code, les débats de la cour d’assises sont publics. Ils peuvent toutefois se tenir à huis clos si cette publicité s’avère dangereuse pour l’ordre ou les mœurs. Le huis clos est de droit, si la victime partie civile ou l’une des victimes parties civiles le demande, « [l]orsque les poursuites sont exercées du chef de viol ou de tortures et actes de barbarie accompagnés d’agressions sexuelles ». Dans les autres cas, le huis clos ne peut être ordonné que si la victime partie civile ou l’une des victimes parties civiles ne s’y oppose pas.
En définitive, la possibilité de recourir au huis clos ne couvre, en l’état actuel du droit, que des hypothèses relativement étrangères à la sécurité des témoins appelés à déposer.
La publicité devant les juridictions de jugement, forme essentielle de la procédure qui participe à l’impartialité des débats se déroulant devant elles et au prononcé de jugements réguliers et équitables, est une règle affirmée avec constance par le législateur français depuis la Révolution française. Ainsi que l’a relevé la Cour de cassation très tôt, « [l]e principe de la publicité des débats en matière criminelle, étant l’essence même de la justice, a été consacré par tous les actes constitutionnels et constitutifs qui ont régi la France depuis 1790 » (85).
Ce principe est aujourd’hui protégé par l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CESDH) qui stipule que « [t]oute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi ». Il est toutefois prévu que si « [l]e jugement doit être rendu publiquement », « l’accès de la salle d’audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l’intérêt de la moralité, de l’ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l’exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice ».
2. La possibilité offerte par le présent article de procéder à l’audition, à huis clos, de certains témoins en cas de risques graves de représailles
Le présent article élargit les possibilités de recours au huis clos partiel devant la cour d’assises et le tribunal correctionnel afin de tenir compte des risques importants de représailles qui pèsent sur certains témoins devant déposer relativement à des infractions particulièrement graves.
Il complète la section I du chapitre VI du titre Ier du livre II et la section III du chapitre Ier du titre II du même livre du code de procédure pénale, relatives respectivement aux débats devant la cour d’assises et devant le tribunal correctionnel, par deux nouveaux articles 306-1 et 400-1 qui autorisent le recours au huis clos partiel le temps de l’audition de témoins appelés à déposer dans le cadre du jugement de certains crimes et délits limitativement énumérés et sur lesquels pèseraient de graves menaces de représailles.
En application du nouvel article 306-1 précité (1°), la cour, statuant sans l’assistance des jurés, pourrait ainsi « ordonner le huis clos, par un arrêt rendu en audience publique, pour le temps de l’audition d’un témoin, si la déposition publique de celui-ci est de nature à mettre gravement en danger sa vie ou son intégrité physique ou psychique, ou celles des membres de sa famille ou de ses proches ».
Une telle faculté serait strictement limitée au jugement des crimes suivants, pour lesquels une protection adéquate des témoins qui ont participé à en révéler l’existence et permis d’en identifier les auteurs serait nécessaire :
– les crimes contre l’humanité mentionnés au sous-titre Ier du titre Ier du livre II du code pénal ;
– le crime de disparition forcée mentionné à l’article 221-12 du même code ;
– les crimes de tortures ou d’actes de barbarie mentionnés aux articles 222-1 à 222-6 du même code ;
– les crimes de guerre mentionnés au chapitre Ier du livre IV bis du même code ;
– et les infractions relevant de la criminalité organisée mentionnées aux 1° à 19° de l’article 706-73 du code de procédure pénale (86).
De manière similaire, en application du nouvel article 400-1 précité (2°), le tribunal correctionnel pourrait, « par jugement rendu en audience publique, ordonner le huis clos le temps de l’audition d’un témoin, si la déposition publique de celui-ci est de nature à mettre gravement en danger sa vie ou son intégrité physique ou psychique, ou celles des membres de sa famille ou de ses proches ».
Cette disposition ne serait applicable que pour le jugement des délits de guerre mentionnés au chapitre Ier du livre IV bis du code pénal d’une part, et des délits les plus graves relevant de la délinquance organisée mentionnés à l’article 706-73 précité du code de procédure pénale d’autre part.
À titre illustratif, le témoignage à huis clos est une possibilité déjà reconnue pour le jugement des infractions relevant de la compétence de la Cour pénale internationale, devant laquelle le texte constitutif, le Statut de Rome, prévoit que « [l]e procès est public » mais que, « [t]outefois, la Chambre de première instance peut, en raison de circonstances particulières, prononcer le huis clos pour certaines audiences aux fins énoncées à l’article 68 ou en vue de protéger des renseignements confidentiels ou sensibles donnés dans les dépositions » (87).
M. François Molins, procureur de la République de Paris et Mme Camille Hennetier, vice-procureur et chef de la section antiterroriste au tribunal de grande instance de Paris, ont rappelé à votre rapporteur toute l’utilité d’un tel élargissement des possibilités de huis clos. Ils ont relevé que, par exemple, à l’occasion du premier procès d’un génocidaire rwandais devant la cour d’assises de Paris au printemps 2014, de nombreux témoins étaient venus spécialement du Rwanda déposer devant la cour, non sans une certaine appréhension, sans que le président de la juridiction ait pu restreindre la publicité des débats faute de cadre juridique approprié. Les présentes dispositions, d’application immédiate comme toute loi de procédure, pourraient ainsi être appliquées lors de procès de même type qui devraient se tenir au printemps et à l’automne 2016.
3. Les modifications opérées par votre commission des Lois
La commission des Lois a restreint les conditions de recours au huis clos partiel pour les besoins de la protection d’un témoin afin de les aligner sur celles aujourd’hui prévues par l’article 706-58 du code de procédure pénale pour le témoignage anonyme, lequel n’est possible que si son audition « est susceptible de mettre gravement en danger la vie ou l’intégrité physique de cette personne ».
Par cohérence avec cette rédaction, à l’initiative de votre rapporteur, elle a limité la mise en œuvre du présent article aux seules situations « de nature à mettre gravement en danger sa vie ou son intégrité physique », à l’exclusion de celles dans lesquelles l’intégrité psychique de ce témoin serait gravement mise en danger. La suppression des risques de représailles « psychiques » permettra de circonscrire le dispositif à des hypothèses suffisamment graves et clairement délimitées pour que le huis clos soit ordonné le temps de la déposition.
*
* *
La Commission adopte l’amendement rédactionnel CL261 du rapporteur.
Puis elle examine, en discussion commune, les amendements CL355 du rapporteur, CL72 de M. Georges Fenech et CL158 de Mme Élisabeth Pochon.
M. le rapporteur. L’amendement CL355 vise à supprimer les menaces psychiques des critères devant être réunis pour la protection des témoins.
M. Georges Fenech. L’amendement CL72 a le même objet ; il est défendu.
L’amendement CL158 est retiré.
La Commission adopte l’amendement CL355.
En conséquence, l’amendement CL72 tombe.
La Commission adopte l’article 5 modifié.
La Commission est saisie de l’amendement CL40 de M. Philippe Goujon, portant article additionnel après l’article 5.
M. Philippe Goujon. Il s’agit de supprimer la condition des cinq années d’existence prévue par le code de procédure pénale pour permettre à une fédération d’associations de victimes d’attentats de se porter partie civile lorsque l’action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée. Nous entendons ainsi répondre à une demande exprimée par les victimes des attentats du 13 novembre, qui souhaitent être réunies dans une association constituée spécialement pour leur défense en raison de la spécificité du traumatisme subi.
M. Alain Tourret. Je suis très réticent. L’action publique appartient essentiellement au procureur de la République. Nous risquons de voir des dizaines, voire des centaines d’associations se constituer partie civile, si bien qu’un ou deux avocats défendent le prévenu, contre 100 ou 150 pour les parties civiles. Cela déséquilibre totalement les procès, comme on a pu le constater dans l’affaire Papon.
M. Georges Fenech. Entendons-nous bien. Nous parlons de plusieurs associations représentant un grand nombre de victimes des derniers attentats qui se heurtent à des difficultés considérables pour faire valoir leurs droits, que ce soit au niveau administratif ou judiciaire. Il est évident que l’association joue, en l’espèce, un rôle extrêmement utile. Au demeurant, je rappelle que les associations qui défendent les victimes de catastrophes naturelles n’ont pas besoin de justifier de cinq ans d’existence pour ester en justice. Nous devons donc permettre aux associations – je pense notamment à l’association « 13 novembre : fraternité et vérité » – de jouer un rôle utile auprès des milliers de victimes qui souhaitent être ainsi représentées. C’est pourquoi je soutiens cet amendement avec conviction.
M. Sébastien Pietrasanta. Cet amendement va dans le bon sens, dans la mesure où il répond aux attentes des victimes d’attentats, en particulier celles des attentats de l’année 2015 – que nous avons auditionnées dans le cadre de la commission d’enquête relative aux moyens mis en œuvre par l’État pour lutter contre le terrrorisme –, dont les associations n’avaient, par définition, pas d’existence légale il y a quelques mois. Je suis donc favorable, à titre personnel, à cet amendement, mais je pense que la rédaction devra en être améliorée – éventuellement en lien avec les services du garde des Sceaux, qui est sensible à cette question – d’ici à l’examen du texte en séance publique, afin de caler la mesure sur le dispositif prévu en matière de catastrophe naturelle. En tout état de cause, il me paraît important d’adresser ce signal à ces associations et à ce collectif.
M. le rapporteur. Je partage l’état d’esprit des auteurs de l’amendement. Je crois que les choses ne doivent pas rester en l’état, mais qu’il ne faut pas non plus ouvrir les vannes. Or, la rédaction de l’amendement présente ce travers. Je m’engage donc à élaborer avec ses auteurs un dispositif similaire à celui qui existe pour les victimes de catastrophes naturelles, afin de satisfaire les attentes des associations représentatives de victimes d’attentats tout en évitant que le premier venu qui ne représenterait que lui-même puisse agir en justice en créant une association représentative des victimes. Je suggère donc à M. Goujon de retirer son amendement, et je lui propose, s’il le souhaite, que nous rédigions ensemble, avec M. Pietrasanta, un amendement commun. Je sais que, si nous parvenons à bien définir son champ d’application, le Gouvernement ne s’y opposera pas.
M. Philippe Goujon. Je fais confiance au rapporteur pour que la collaboration qu’il nous propose permette de remédier aux problèmes considérables que rencontrent ces associations pour ester en justice.
L’amendement CL40 est retiré.
Article 6
(art. 706-62-1 et 706-62-2 [nouveaux] du code de procédure pénale)
Protection de l’identité et de la sécurité des témoins s’exposant à des risques graves de représailles dans certaines affaires
(identification par un numéro, attribution d’une identité d’emprunt)
Le présent article constitue le prolongement des dispositions introduites par l’article 5 du projet de loi au sein du code de procédure pénale en matière de protection de certains témoins appelés à déposer devant les juridictions de jugement. Il renforce la protection de l’identité des témoins dans les audiences publiques et les décisions de justice et institue un mécanisme de protection de leur sécurité similaire à celui qui s’applique aux repentis.
1. La protection actuelle du témoin anonyme
De manière générale, le témoin dispose de certains droits attachés à sa qualité, notamment le droit à une indemnité de comparution (88), de frais de voyage et de séjour (89), le droit à une protection pénale contre les injures et diffamations à raison de sa déposition (90) ou le droit à une protection physique au titre des obligations de contrôle judiciaire (91) ou du placement en détention provisoire (92) de la personne mise en cause afin d’éviter toute pression sur le témoin avant le jugement définitif.
a. Les conditions actuelles de recours au témoignage anonyme
La loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne a instauré, au titre XXI du livre IV du code de procédure pénale, une protection spécifique du témoin anonyme. En application des articles 706-57 à 706-63, il est ainsi possible de recourir, à certaines conditions, au témoignage anonyme, sous réserve de respecter les droits de la défense et de ne pas faire bénéficier de ces dispositions le témoin qui a participé à l’activité délictuelle ou criminelle.
C’est à ces conditions que la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) admet ce type de témoignages au regard de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CESDH), relatif au droit au procès équitable, en particulier son § 3 aux termes duquel tout accusé a le droit à « interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ». Si elle n’interdit pas le recours à un témoin anonyme, elle apprécie sa conventionalité au regard de son impact sur le déroulement de la procédure, en particulier le respect du contradictoire et des exigences du procès équitable (93). Elle a ainsi jugé qu’une condamnation fondée sur le seul témoignage anonyme violait l’article 6 de la CESDH dans la mesure où ce témoignage constituait la preuve principale et déterminante fondant la culpabilité sans que la défense eut pu le contester (94). Elle a également établi une gradation dans l’appréciation qu’elle porte sur les conditions d’admission d’un témoignage anonyme, lesquelles sont plus restrictives lorsqu’il s’agit notamment d’un policier infiltré (95).
En France, l’article 706-57 permet au procureur de la République ou au juge d’instruction d’autoriser l’occultation du domicile des témoins à l’encontre desquels « il n’existe aucune raison plausible de soupçonner qu’[ils] ont commis ou tenté de commettre une infraction et qui sont susceptibles d’apporter des éléments de preuve intéressant la procédure », l’adresse déclarée étant alors celle du commissariat ou de la brigade de gendarmerie. L’article 706-58 prévoit, « [e]n cas de procédure portant sur un crime ou sur un délit puni d’au moins trois ans d’emprisonnement », que lorsque l’audition du témoin « est susceptible de mettre gravement en danger la vie ou l’intégrité physique de cette personne, des membres de sa famille ou de ses proches, le juge des libertés et de la détention, saisi par requête motivée du procureur de la République ou du juge d’instruction, peut, par décision motivée, autoriser que les déclarations de cette personne soient recueillies sans que son identité apparaisse dans le dossier de la procédure ».
En pratique, la décision du juge des libertés et de la détention (JLD), insusceptible de recours, est jointe au procès-verbal d’audition du témoin, sur lequel ne figure ni la signature de l’intéressé, ni son identité, lesquelles sont versées à un dossier distinct. L’identité ou l’adresse du témoin ayant bénéficié de ces dispositions sont, en principe, protégées en toute circonstance (article 706-59). Plusieurs limites sont apportées au recours à cette procédure.
En premier lieu, l’exercice des droits de la défense peut s’opposer à la protection de l’anonymat du témoignage et permettre la révélation de son identité (article 706-60) :
– l’article 706-58 ne s’applique pas « si, au regard des circonstances dans lesquelles l’infraction a été commise ou de la personnalité du témoin, la connaissance de l’identité de la personne est indispensable à l’exercice des droits de la défense » (premier alinéa) ;
– le mis en examen peut, dans les dix jours suivant la date à laquelle il a été informé de l’audition d’un témoin anonyme, contester le recours à cette procédure devant le président de la chambre de l’instruction qui statue par décision motivée, insusceptible de recours : le cas échéant, l’audition du témoin peut être annulée ou la levée de son anonymat ordonnée, « à la condition que ce dernier fasse expressément connaître qu’il accepte la levée de son anonymat » (second alinéa).
En deuxième lieu, la décision de recourir à l’anonymat d’un témoin ne fait pas obstacle à ce qu’une confrontation soit organisée entre le témoin et la personne mise en examen au cours de la procédure d’instruction et lors de la phrase du jugement « par l’intermédiaire d’un dispositif technique permettant l’audition du témoin à distance » ou par l’interrogatoire de ce témoin par l’avocat du mis en cause par ce même moyen. Il est expressément précisé que « [l]a voix du témoin est alors rendue non identifiable par des procédés techniques appropriés » (article 706-61).
En dernier lieu, l’article 706-62 dispose qu’« [a]ucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement de déclarations recueillies dans les conditions prévues par les articles 706-58 et 706-61 ».
b. Le recours à l’anonymat des témoins « spéciaux » en matière de criminalité et de délinquance organisées
Depuis la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, dite loi « Perben II », des opérations d’infiltration, auparavant réservées aux seuls trafics de stupéfiants, peuvent être mises en œuvre pour toutes les affaires relatives à la criminalité et à la délinquance organisées, conformément aux articles 706-81 à 706-87 du code de procédure pénale.
En application de l’article 706-81, ces opérations, qui doivent être autorisées par le procureur de la République ou, après avis de ce magistrat, par le juge d’instruction consistent, « pour un officier ou un agent de police judiciaire spécialement habilité dans des conditions fixées par décret et agissant sous la responsabilité d’un officier de police judiciaire chargé de coordonner l’opération, à surveiller des personnes suspectées de commettre un crime ou un délit en se faisant passer, auprès de ces personnes, comme un de leurs coauteurs, complices ou receleurs ». Compte tenu de la nature particulière de ces opérations, l’officier ou l’agent de police judiciaire peut recourir à une identité d’emprunt et commettre, si nécessaire, les infractions mentionnées à l’article 706-82 (96) sans engager sa responsabilité pénale, sous réserve, à peine de nullité, de ne pas inciter à commettre des infractions. L’identité réelle des agents concernés est particulièrement protégée par l’article 706-84.
Dans le prolongement des règles conventionnelles précédemment mentionnées, en particulier celles destinées à préserver l’équité de la procédure en cas d’infiltration policière (97), ces opérations sont strictement encadrées :
– l’autorisation d’y recourir doit être, à peine de nullité, « délivrée par écrit et (…) spécialement motivée », mentionner « la ou les infractions qui justifient le recours à cette procédure et l’identité de l’officier de police judiciaire sous la responsabilité duquel se déroule l’opération », fixer « la durée de l’opération d’infiltration, qui ne peut pas excéder quatre mois » renouvelables (article 706-83) ;
– en cas de décision d’interruption de l’opération ou à la fin de cette dernière et en l’absence de prolongation, l’agent infiltré peut poursuivre ses activités sans en être pénalement responsable, « le temps strictement nécessaire pour lui permettre de cesser sa surveillance dans des conditions assurant sa sécurité sans que cette durée puisse excéder quatre mois » : le magistrat ayant délivré l’autorisation en est alors informé dans les meilleurs délais et, « [s]i, à l’issue du délai de quatre mois, l’agent infiltré ne peut cesser son opération dans des conditions assurant sa sécurité, ce magistrat en autorise la prolongation pour une durée de quatre mois au plus » (article 706-85) ;
– si, en principe, l’officier de police judiciaire sous la responsabilité duquel s’est déroulée l’opération peut seul être entendu en qualité de témoin sur l’opération, « la personne mise en examen ou comparaissant devant la juridiction de jugement (…) directement mise en cause par des constatations effectuées par un agent ayant personnellement réalisé les opérations d’infiltration (…) peut demander à être confrontée avec cet agent dans les conditions prévues par l’article 706-61 ». Toutefois, les questions posées à l’agent infiltré lors de cette confrontation ne peuvent conduire à révéler, directement ou indirectement, sa véritable identité (article 706-86) ;
– enfin, « [a]ucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement des déclarations faites par les officiers ou agents de police judiciaire ayant procédé à une opération d’infiltration », sauf si celui-ci a déposé sous sa véritable identité (article 706-87).
2. Le renforcement de la protection de l’identité des témoins exposés à des risques importants de représailles dans les audiences et jugements relatifs à des infractions punies d’au moins trois ans d’emprisonnement (identification par un numéro)
Le présent article vise à renforcer la protection dont font déjà l’objet les témoins appelés à déposer dans certaines affaires particulièrement sensibles. Il permet de moduler l’intensité du degré de protection selon les circonstances de l’espèce, au stade de l’information judiciaire comme à celui du jugement, sans recourir au témoignage anonyme qui nécessite une procédure lourde et dont la force probante peut être aisément remise en cause.
En premier lieu, il insère, au sein du titre XXI du livre IV du code de procédure pénale précité, consacré à la protection des témoins, un nouvel article 706-62-1 instaurant, dans les procédures concernant certains crimes et délits, la protection, sous un numéro non-identifiant, des témoins qui s’exposent à des risques de représailles.
Le premier alinéa permet au juge d’instruction ou au président de la juridiction de jugement, à la demande du procureur de la République ou des parties, d’ordonner, en chambre du conseil, que l’identité d’un témoin « ne soit pas mentionnée au cours des audiences publiques et ne figure pas dans les décisions de la juridiction d’instruction ou de jugement pouvant faire l’objet d’une diffusion publique ». Le procureur de la République et les parties en sont avisés (deuxième alinéa).
L’application de ce nouveau dispositif est toutefois subordonnée au respect de deux exigences :
– d’une part, que la procédure porte sur un crime ou un délit puni d’au moins trois ans d’emprisonnement ;
– d’autre part, que la révélation de l’identité du témoin puisse « mettre en danger sa vie ou son intégrité physique ou psychique, ou celles des membres de sa famille ou de ses proches ».
Le troisième alinéa permet de substituer à l’identité du témoin, en principe déclinée et précisée au cours des audiences ou dans les ordonnances, jugements ou arrêts, « un numéro que lui attribue le juge d’instruction ou le président de la juridiction de jugement ».
Cette nouvelle disposition présente l’avantage de garantir le plein exercice des droits de la défense, en permettant que l’identité du témoin apparaisse dans la procédure et soit connue des parties mais ne soit pas rendue publique. Dans le même esprit, l’article 706-24 du code de procédure pénale autorise déjà les officiers et agents de police judiciaire affectés dans les services de police judiciaire spécialement chargés de la lutte contre le terrorisme à déposer ou à comparaître comme témoins sous leur numéro d’immatriculation.
Comme c’est déjà le cas pour la décision du JLD autorisant le recueil des déclarations d’un témoin dont le nom est occulté dans le dossier de la procédure (premier alinéa de l’article 706-58), l’avant-dernier alinéa précise que la décision ordonnant la confidentialité de l’identité du témoin, qui n’affecte aucun droit fondamental, « n’est pas susceptible de recours ».
Le dernier alinéa punit de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende « [l]e fait de révéler sciemment l’identité d’un témoin ayant bénéficié des dispositions du présent article ou de diffuser des informations permettant son identification ou sa localisation », soit les mêmes peines que celles encourues pour la révélation de l’identité ou de l’adresse d’un témoin protégé par les articles 706-57 et 706-58 (second alinéa de l’article 706-59).
Votre rapporteur souligne que ces nouvelles dispositions viennent utilement compléter celles aujourd’hui prévues par les articles 706-57 à 706-63 en garantissant au témoin, selon un formalisme plus souple, une protection vis-à-vis du seul public et dans le respect des droits de la défense, puisque le mis en examen ou l’accusé aura connaissance de son identité sans toutefois pouvoir en faire état. M. François Molins, procureur de la République de Paris, et Mme Camille Hennetier, vice-procureur et chef de la section antiterroriste au tribunal de grande instance de Paris, ont estimé que ce dispositif trouverait son principal intérêt à l’audience où il pourrait se conjuguer avec le nouveau dispositif de huis clos partiel prévu par l’article 5 du projet de loi, la procédure de témoignage sous X ne permettant pas, au surplus, de rendre anonymes a posteriori des témoignages déjà recueillis.
3. L’instauration d’un dispositif spécifique de protection de la sécurité des témoins exposés à des risques importants de représailles dans certaines affaires (identité d’emprunt)
a. Le dispositif proposé par le présent article
Le présent article complète le même titre XXI par un nouvel article 706-62-2 instituant un mécanisme spécifique de protection de certains témoins exposés à des risques graves de représailles en raison de leur collaboration avec la justice.
Le premier alinéa prévoit ainsi que « lorsque l’audition d’une personne mentionnée à l’article 706-57 est susceptible de mettre gravement en danger la vie ou l’intégrité physique de cette personne, des membres de sa famille ou de ses proches, celle-ci fait l’objet, en tant que de besoin, d’une protection destinée à assurer sa sécurité ».
À la différence du mécanisme de protection des témoins institué au nouvel article 706-62-1, le présent dispositif ne s’appliquerait qu’« en cas de procédure portant sur un crime ou un délit mentionné aux articles 628, 706-73 et 706-73-1 » du code de procédure pénale, c’est-à-dire :
– les crimes contre l’humanité mentionnés au sous-titre Ier du titre Ier du livre II du code pénal (98) ;
– les crimes et délits de guerre mentionnés au chapitre Ier du livre IV bis du même code (99) ;
– les crimes et délits relevant de la criminalité et de la délinquance organisées mentionnés aux articles 706-73 et 706-73-1 du code de procédure pénale (100).
Les deuxième et troisième alinéas prévoient que la protection destinée à assurer la sécurité du témoin peut comporter, « [e]n cas de nécessité », l’autorisation, « par ordonnance motivée rendue par le président du tribunal de grande instance, [de] faire usage d’une identité d’emprunt », sauf « pour une audition ».
L’avant-dernier alinéa réprime pénalement toute violation de la protection instituée par cet article. La répression pénale prévue par cet alinéa s’inscrit dans le prolongement de l’incrimination actuelle de toute révélation de l’identité ou de l’adresse d’un témoin (second alinéa de l’article 706-59) et de celle créée par le présent article en cas de révélation de l’identité du témoin au cours des audiences publiques ou dans les ordonnances, jugements ou arrêts d’une juridiction (dernier alinéa du nouvel article 706-62-1). Toutefois, elle s’en écarte en prévoyant des circonstances aggravantes à raison de l’impact que pourrait avoir la violation de la protection sur la vie du témoin ou de ses proches :
– la « simple » révélation de ce que certaines personnes font l’objet d’une identité d’emprunt ou de tout élément permettant leur identification ou leur localisation serait punie d’une peine de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende ;
– ces peines seraient portées à sept ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende « [l]orsque cette révélation a causé, directement ou indirectement, des violences à l’encontre de ces personnes ou de leurs conjoints, enfants et ascendants directs » ;
– elles seraient encore aggravées à dix ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende « lorsque cette révélation a causé, directement ou indirectement, la mort de ces personnes ou de leurs conjoints, enfants et ascendants directs ».
Enfin, les deux derniers alinéas prévoient que le bénéfice de la protection pourra s’étendre aux proches du témoin, un décret en Conseil d’État étant compétent pour fixer les conditions d’application de cet article.
b. Un dispositif inspiré du mécanisme de protection des « repentis »
Le dispositif institué au nouvel article 706-62-2 s’inspire en grande partie des dispositions du code de procédure pénale protégeant les « repentis », autrement désignés « collaborateurs de justice », qui, bien qu’ayant participé à des activités illégales, obtiennent des avantages en échange de leur collaboration avec les autorités judiciaires ou policières. Outre l’abandon des poursuites de la part du ministère public ou une réduction de peine, les « repentis » bénéficient en effet d’une protection particulière depuis la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, dite loi « Perben II ». Cette loi s’est inspirée de législations comparables adoptées par d’autres pays, comme l’Italie ou les États-Unis (voir l’encadré ci-après).
La protection des témoins et « repentis » en Italie et aux États-Unis
En Italie
Les premières mesures en faveur des « repentis » datent de 1978 mais les mesures de protection ont été définies par un décret-loi du 15 janvier 1991, modifié par une loi de 2001 qui a opéré une distinction entre « repentis » et témoins.
Parmi les mesures de protection pouvant être accordées aux « collaborateurs de justice » figurent notamment le transfèrement de la personne dans un autre lieu de résidence, la délivrance à l’intéressé et à ses proches de documents d’identité de couverture, des mesures de réinsertion (attribution d’un logement, remboursement des frais de déménagement…), voire la possibilité de changer définitivement d’identité. Pour les témoins, un mécanisme de compensation existe afin de permettre à toute personne contrainte de modifier son mode de vie pour délivrer des informations de conserver le même niveau de vie.
Sur le plan administratif, les mesures de protection sont accordées sur proposition du procureur de la République, par une commission placée auprès du ministre de l’Intérieur et dont la gestion est confiée à un service central de protection. Le coût de ce système variait entre 50 et 60 millions d’euros par an dans les années 2000.
Aux États-Unis
Les règles relatives à la protection des témoins ont été fixées par une loi de 1970, amendée par le Comprehensive Crime Control Act de 1984. Elles s’appliquent aussi bien à des témoins menacés qu’à des personnes impliquées dans la commission d’infractions. Afin de favoriser la coopération de témoins importants, le procureur fédéral peut proposer aux personnes appelées à témoigner devant des juridictions fédérales ou des États fédérés une immunité ou un plaider coupable avec coopération et certains moyens de protection : fourniture d’une nouvelle identité, mise à disposition d’un nouveau logement, versement de fonds pour faire face aux besoins de la vie courante, aide pour trouver un emploi.
L’Office of Enforcement Operation est chargé d’instruire les demandes et la mise en œuvre de la protection relève du US Marshals Service. Le budget consacré à ce programme était d’environ 30 millions de dollars par an en 2003.
Source : Étude de législation comparée du Sénat n° 124 du 1er juin 2003, Les repentis face à la justice pénale.
En France, prévu au titre XXI bis du livre IV (101) et à l’article 706-63-1 du code de procédure pénale, le dispositif consiste en une « protection » destinée à assurer la sécurité de la personne concernée, en cas de nécessité, par l’usage d’une identité d’emprunt, et des « mesures destinées à assurer leur réinsertion ». Les mesures de protection et de réinsertion sont « définies, sur réquisitions du procureur de la République, par une commission nationale dont la composition et les modalités de fonctionnement sont définies par décret en Conseil d’État ». Il est prévu que cette commission fixe les obligations que doit respecter la personne et assure le suivi des mesures de protection et de réinsertion mais que, en cas d’urgence, les services compétents prennent les mesures nécessaires et en informent sans délai la commission nationale.
Longtemps retardée faute de moyens financiers suffisants, cette protection n’est entrée en vigueur qu’en 2014 (102), soit dix ans après l’adoption de l’article 706-63-1 qui l’a institué. Depuis la loi n° 2014-1353 du 13 novembre 2014 renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme, l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC) peut, sur ses recettes propres, verser des contributions à l’État ayant pour objet de « contribuer au financement de la lutte contre la délinquance et la criminalité » (103) et, notamment, financer le dispositif relatif à la protection des collaborateurs de justice. Pour les années 2015 à 2017, une dotation de 450 000 euros a été prévue à titre expérimental.
La commission nationale est aujourd’hui composée de trois magistrats (104) et de trois représentants des services d’enquête (105) ainsi que, à titre consultatif, d’un représentant du service interministériel d’assistance technique (SAIT) auprès duquel elle est placée et qui est chargé de mener des opérations d’infiltration de réseaux criminels en appui des enquêtes de police. Elle instruit les demandes de protection qui lui parviennent et « peut décider de toutes mesures proportionnées qu’elle définit, notamment de protection physique et de domiciliation, destinées à assurer la protection des personnes mentionnées à l’article 706-63-1 du code de procédure pénale » ; elle est également chargée de définir, « s’il y a lieu, les mesures de réinsertion, eu égard notamment à la situation matérielle et sociale de la personne concernée et, le cas échéant, de sa famille et de ses proches » (106). Le président du tribunal de grande instance est compétent pour statuer sur les demandes de recours à une identité d’emprunt qui lui sont adressées par l’intermédiaire du président de la commission. S’il est fait droit à ces demandes, seul le SIAT est « habilité à créer les identités d’emprunt, à conserver l’ensemble des identités d’emprunt attribuées et à faire le rapprochement entre les identités d’emprunt et les identités réelles » (107).
Par cohérence, ce sont ces dispositions que le sixième alinéa du nouvel article 706-62-2 rend donc applicables au nouveau cas de protection destiné à assurer la sécurité de certains témoins.
Lors de leur audition par votre rapporteur, M. François Molins, procureur de la République de Paris, et Mme Camille Hennetier, vice-procureur et chef de la section antiterroriste au tribunal de grande instance de Paris, ont souligné que la création de ce nouvel article 706-62-2 constituait une « avancée très importante, la France ayant pris un retard dans le domaine de la protection des témoins et victimes, en comparaison avec les dispositifs existants en cette matière dans les pays anglo-saxons et devant les juridictions internationales ». Ils ont fait valoir que « l’insuffisance de notre dispositif de protection, jusqu’alors limité au seul témoignage sous X, apparaissait de plus en plus problématique, un nombre croissant d’États, de juridictions internationales ou de témoins potentiels conditionnant leur coopération avec la justice française à l’apport de garanties en termes de protection, que nous n’étions jusqu’alors guère en capacité de leur accorder faute de cadre normatif adapté ».
4. Les modifications opérées par votre commission des Lois
À l’initiative de votre rapporteur et de M. Sergio Coronado, la commission des Lois a précisé le dispositif de protection des témoins institué par le présent article. Au premier alinéa du nouvel article 706-62-1 précité, elle a subordonné l’anonymisation du témoin et son identification par un numéro au cours des audiences publiques et dans les jugements rendus publics :
– d’une part, à l’existence de graves risques de représailles, condition de gravité qui ne figurait pas dans le texte initial du Gouvernement ;
– d’autre part, aux cas dans lesquels « la révélation de l’identité d’un témoin est susceptible de mettre gravement en danger sa vie ou son intégrité physique », à l’exclusion de tout risque de représailles psychiques.
Ces modifications permettent, au surplus, d’aligner les dispositions relatives à la protection des témoins créées par le présent article sur celles qui sont aujourd’hui prévues par l’article 706-58 du code de procédure pénale en matière de témoignage anonyme, lequel n’est possible que si l’audition du témoin « est susceptible de mettre gravement en danger la vie ou l’intégrité physique de cette personne ».
*
* *
La Commission examine l’amendement CL180 de M. Sergio Coronado.
M. Sergio Coronado. Cet amendement vise à permettre l’articulation du nouveau dispositif prévu par le présent article avec l’article 706-58 du code de procédure pénale, qui prévoit déjà une protection des témoins.
M. le rapporteur. Avis défavorable. Il n’est pas nécessaire d’articuler les dispositions relatives à l'identification du témoin par un numéro avec celles qui sont relatives au témoignage anonyme, car ces deux dispositifs n'interviennent pas au même stade de la procédure et n'ont pas la même portée. En effet, la protection instaurée au nouvel article 706-62-1 du code de procédure pénale ne concerne que l'anonymisation, par l'attribution d'un numéro, de l'identité des témoins protégés, et ce uniquement dans les documents susceptibles d'être rendus publics ou au cours des audiences publiques, où les parties connaissent l'identité réelle du témoin. En revanche, les dispositions de l'actuel article 706-58 du même code relatives au témoignage anonyme prévoient la possibilité de recourir à la déposition sous X d'une personne s'exposant à de graves risques de représailles tout au long de la procédure – les parties ignorant dans ce cas qui est le témoin, sauf décision de levée de l'anonymat.
L’amendement CL180 est retiré.
La Commission passe à l’amendement CL159 de Mme Élisabeth Pochon.
Mme Élisabeth Pochon. Cet amendement vise à porter de trois à cinq ans d’emprisonnement le quantum minimum de la peine visée par une procédure ouvrant droit à l’anonymisation des témoins protégés.
M. le rapporteur. Je suis attaché à ce que les délais prévus soient peu ou prou les mêmes dans toutes les circonstances. Or, le critère d’un crime ou d’un délit puni d’au moins trois ans d’emprisonnement figure déjà à l’article 706-58 du code de procédure pénale prévoyant le témoignage sous X. De plus, le nouveau dispositif de témoignage sous numéro n’est pas attentatoire aux droits de la défense dans la mesure où, à la différence du témoignage anonyme, l’avocat de la défense connaîtra l’identité du témoin en question. En conséquence, il apparaît à la fois cohérent et nécessaire de retenir un seuil équivalent à celui qui existe pour le témoignage sous X, lequel est le plus susceptible de porter atteinte aux droits de la défense. Je vous propose donc de retirer cet amendement.
L’amendement CL159 est retiré.
La Commission examine les amendements identiques CL177 de M. Sergio Coronado et CL262 de M. le rapporteur.
M. Sergio Coronado. Nul ne conteste l’utilité du témoignage sous X, qui peut contribuer à protéger des témoins pouvant être soumis à des menaces. Il pose toutefois plusieurs problèmes pour l’exercice des droits de la défense car il ne permet pas aux accusés de repousser des témoignages litigieux. Dès lors, la possibilité de témoigner sous X en cas de risque d’atteinte à l’intégrité psychique est problématique, cette notion étant très large. Cet amendement vise à restreindre le témoignage sous X aux cas de mise en danger grave. Cette précision figure d’ailleurs à l’alinéa 3 de l’article 5 et à l’alinéa 7 du présent article.
M. le rapporteur. Avis favorable : je présente un amendement CL262 identique.
La Commission adopte les amendements identiques.
Puis elle examine, en discussion commune, les amendements identiques CL178 de M. Sergio Coronado et CL263 de M. le rapporteur, ainsi que l’amendement CL160 de Mme Élisabeth Pochon.
M. Sergio Coronado. L’amendement CL178 vise à supprimer la notion de risque d’atteinte à l’intégrité psychique.
M. le rapporteur. L’amendement CL262 est identique.
Mme Élisabeth Pochon. L’amendement CL160 est défendu.
La Commission adopte les amendements CL178 et CL163.
En conséquence, l’amendement CL160 tombe.
Puis la Commission adopte l’amendement rédactionnel CL264 du rapporteur.
Elle examine ensuite l’amendement CL179 de M. Sergio Coronado.
M. Sergio Coronado. Cet amendement vise à préciser que le magistrat ne peut décider le témoignage sous X qu’après avoir recueilli les observations des parties.
M. le rapporteur. Avis défavorable. Comme je l’ai déjà indiqué, le nouveau dispositif de témoignage sous numéro n’est pas attentatoire aux droits de la défense dans la mesure où, à la différence du témoignage anonyme, l’avocat de la défense connaîtra l’identité du témoin sous numéro. Dans ces conditions, il n’est pas nécessaire de demander le recueil préalable des observations des parties.
L’amendement CL179 est retiré.
La Commission adopte les amendements rédactionnels CL265 et CL266 du rapporteur.
Puis elle examine l’amendement CL107 de M. Philippe Houillon.
M. Philippe Houillon. Cet amendement vise à ce que les infractions pénales prévues à cet article ne s’appliquent pas aux avocats dans l’exercice des droits de la défense, ce qui me semble légitime.
M. le rapporteur. Je partage votre préoccupation visant à concilier l’exercice des droits de la défense avec la nécessaire protection des témoins qui s’exposent à de graves risques de représailles et dont l’identité est pour cette raison remplacée par un numéro d’identification au cours des audiences publiques ou dans les jugements rendus publics. Toutefois, votre proposition conduirait de facto à amoindrir la portée de la mesure de protection, à priver ainsi le témoin protégé d’une garantie importante et, in fine, à vider de sa substance le mécanisme de protection.
La divulgation de l’identité du témoin ou des informations permettant son identification n’est pas nécessaire à l’exercice des droits de la défense dans la mesure où les parties – défense comprise – en ont déjà connaissance ; seul le public ignore l’identité réelle du témoin. Dès lors, la protection instituée par le nouvel article 706-62-1 du code de procédure pénale constitue une mesure par essence bien plus favorable aux droits de la défense que le témoignage anonyme, lequel empêche, sauf exception, de connaître l’identité du témoin. Il ne faut pas selon moi aller au-delà.
M. Philippe Houillon. Autrement dit, la défense n’est plus libre !
M. le rapporteur. Elle n’est pas libre d’amoindrir un dispositif que nous souhaitons protecteur pour les témoins, en effet.
La Commission rejette l’amendement CL107.
Puis elle adopte l’amendement de coordination rédactionnelle CL368, l’amendement de précision CL268 et les amendements rédactionnels CL269, CL267 et CL270 à CL277 du rapporteur.
Elle adopte ensuite l’article 6 modifié.
Chapitre III
Dispositions améliorant la lutte contre les infractions
en matière d’armes et contre la cybercriminalité
La Commission adopte l’amendement rédactionnel CL278 rectifié du rapporteur modifiant l’intitulé du chapitre III.
Article 7
(art. L. 312-3, L. 312-3-1 [nouveau], L. 312-4, L. 312-4-1
et L. 312-16 du code de la sécurité intérieure)
Renforcement du contrôle administratif
de l’acquisition et de la détention d’armes
Le présent article vise à renforcer le contrôle de l’accès aux armes et munitions afin de tarir les sources d’approvisionnement en matériels dangereux du crime organisé et du terrorisme. Il prolonge le dispositif dont s’est doté notre pays en matière d’acquisition et de détention des armes depuis la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l’établissement d’un contrôle des armes moderne, simple et préventif.
1. Le régime actuel d’acquisition et de détention des armes
Les conditions d’acquisition et de détention d’une arme sont fixées par le chapitre II du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure. Ce chapitre II comprend les articles L. 312-1 à L. 312-17 qui confient aux préfets un pouvoir de police administrative spéciale des armes et munitions.
Définie de manière particulièrement large par le droit pénal comme « tout objet conçu pour tuer ou blesser » et par assimilation, « tout autre objet susceptible de présenter un danger pour les personnes (…) dès lors qu’il est utilisé pour tuer, blesser ou menacer ou qu’il est destiné, par celui qui en est porteur, à tuer, blesser ou menacer » (108), l’arme est classée en quatre catégories
– A, B, C et D – par l’article L. 311-2 du même code (voir le tableau ci-après), en fonction de la dangerosité des matériels et des armes et, notamment, des modalités de répétition du tir ainsi que du nombre de coups tirés sans qu’il soit nécessaire de procéder à un réapprovisionnement.
En pratique, les matériels, armes, munitions, éléments essentiels, accessoires et opérations industrielles compris dans chacune de ces catégories ainsi que les modalités de leur acquisition et détention sont fixés par l’article R. 311-2 du même code.
LA CLASSIFICATION DES ARMES EN CATÉGORIES
Catégorie A |
Matériels de guerre et armes interdits à l’acquisition et à la détention, sous réserve des dispositions des articles L. 312-1 à L. 312-4-3 du code de la sécurité intérieure : armes et éléments d’armes interdits à l’acquisition et à la détention (A1) et armes relevant des matériels de guerre, matériels destinés à porter ou à utiliser au combat les armes à feu, matériels de protection contre les gaz de combat (A2) |
Catégorie B |
Armes soumises à autorisation pour l’acquisition et la détention |
Catégorie C |
Armes soumises à déclaration pour l’acquisition et la détention |
Catégorie D |
Armes soumises à enregistrement et armes et matériels dont l’acquisition et la détention sont libres, notamment les armes et matériels historiques et de collection visés à l’article L. 311-3 du même code |
a. Les conditions d’acquisition et de détention des armes
Les articles L. 312-1 à L. 312-6 du code de la sécurité intérieure déterminent les conditions générales d’acquisition et de détention des armes et munitions selon les distinctions suivantes.
De prime abord, l’acquisition et la détention des armes et munitions de toute catégorie sont interdites pour les mineurs, sous réserve de certaines exceptions définies par décret en Conseil d’État pour la chasse et la pratique du tir sportif (article L. 312-2). Pour le reste, l’appartenance de telle ou telle arme à l’une ou l’autre des catégories précitées, indifférente, en droit pénal, pour qu’un objet soit considéré comme une arme ayant servi à la commission d’une infraction, commande le régime juridique auquel elle est soumise par le code de la sécurité intérieure.
En premier lieu, l’acquisition et la détention des armes de catégorie A sont par principe interdites mais, par dérogation :
– sont autorisées l’acquisition et la détention de telles armes « pour les besoins de la défense nationale et de la sécurité publique » et, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, par « l’État, pour les besoins autres que ceux de la défense nationale et de la sécurité publique, les collectivités territoriales et les organismes d’intérêt général ou à vocation culturelle, historique ou scientifique » ;
– peuvent également être autorisées, par décret en Conseil d’État, l’acquisition et la détention de matériels de guerre « à fin de collection, professionnelle ou sportive par des personnes, sous réserve des engagements internationaux en vigueur et des exigences de l’ordre et de la sécurité publics » (article L. 312-2).
En deuxième lieu, l’acquisition par une personne de matériels et d’armes de catégories B et C est subordonnée à deux conditions :
– « [d]isposer d’un bulletin n° 2 de son casier judiciaire ne comportant pas de mention de condamnation » pour certaines infractions graves d’atteintes à la vie (109), à l’intégrité physique ou psychique (110), aux libertés (111) ou à la dignité de la personne (112), certains crimes et délits contre les biens (113), certaines infractions d’atteintes à l’autorité de l’État (114) et certaines infractions à la législation relative aux matériels de guerre, armes et munitions (115) ;
– « [n]e pas se signaler par un comportement laissant objectivement craindre une utilisation de l’arme ou du matériel dangereuse pour soi-même ou pour autrui » (article L. 312-3).
En troisième lieu, l’acquisition et la détention d’armes de catégorie B sont soumises à autorisation, et notamment à la présentation d’une licence de tir en cours de validité et délivrée par une fédération sportive agréée. De surcroît, la personne qui souhaite acquérir ou détenir l’une de ces armes doit « produire un certificat datant de moins d’un mois, attestant de manière circonstanciée d’un état de santé physique compatible avec l’acquisition ou la détention d’une arme ». Toute personne qui hérite d’une telle arme sans être autorisée à la détenir « doit s’en défaire dans un délai de trois mois à compter de la mise en possession » (article L. 312-4).
En quatrième lieu, l’acquisition des armes de catégorie C « nécessite l’établissement d’une déclaration par l’armurier ou par leur détenteur » et, pour les personnes physiques, « la production d’un certificat médical datant de moins d’un mois, attestant de manière circonstanciée d’un état de santé physique et psychique compatible avec l’acquisition et la détention d’une arme » ou la présentation d’une copie d’un permis de chasser valide ou de l’année précédente, d’une licence de tir valide délivrée par une fédération sportive agréée ou d’une carte de collectionneur d’armes (article L. 312-4-1).
En cinquième et dernier lieu, l’acquisition et la détention des armes de catégorie D sont libres, sous réserve des obligations particulières entourant l’acquisition de certaines d’entre elles afin de garantir leur traçabilité (article L. 312-4-2).
En application de l’article L. 312-6, l’état de santé physique et psychique de la personne qui sollicite la délivrance ou le renouvellement d’une autorisation d’acquisition ou de détention – pour les armes de catégories A et B – ou faisant une déclaration de détention – pour les armes de catégorie C – doit être compatible avec la détention de tels objets.
L’article L. 312-4-3 restreint le nombre d’armes de catégorie B susceptibles d’être possédées par un seul individu ou le nombre de cartouches par arme détenue. En application de l’article L. 312-5, seules les personnes autorisées à acquérir et détenir des matériels et armes des catégories A, B et D peuvent, dans les ventes publiques, se porter acquéreur de telles armes.
Des dispositions particulières à l’acquisition et à la détention d’armes et de munitions par les collectionneurs sont prévues par les articles L. 312-6-1 à L. 312-6-5.
b. Les modalités de remise et de dessaisissement des armes
L’autorité préfectorale dispose d’un pouvoir de police administrative lui permettant d’enjoindre à une personne de remettre son arme ou de s’en dessaisir, dans des conditions fixées par les articles L. 312-7 à L. 312-10 pour la saisie et L. 312-11 à L. 312-15 pour le dessaisissement.
i. La remise d’une arme
Le préfet peut ordonner, « sans formalité préalable ni procédure contradictoire », à toute personne dont « le comportement ou l’état de santé (…) présente un danger grave pour elle-même ou pour autrui » de remettre les armes et munitions en sa possession aux services de police ou de gendarmerie. Cette remise peut être effectuée par saisie de l’objet au domicile du détenteur par le commissaire de police ou le commandant de la brigade de gendarmerie aux heures légales de perquisition et sur autorisation préalable du juge des libertés et de la détention (JLD) (articles L. 312-7 et L. 312-8).
Les objets remis ou saisis sont conservés durant une période maximale d’un an, période durant laquelle le préfet peut décider, « après que la personne intéressée a été mise à même de présenter ses observations », de les restituer ou de les saisir définitivement (article L. 312-9). La remise ou saisie des armes et munitions a pour effet d’interdire aux personnes concernées d’acquérir ou de détenir tout autre type d’armes aussi longtemps que dure la saisie, sauf si le préfet décide de limiter cette interdiction à certaines catégories ou certains types d’armes. Lorsque les objets ont fait l’objet d’une saisie définitive, l’interdiction d’en acquérir ou détenir de nouveaux « peut être levée (…) en considération du comportement du demandeur ou de son état de santé depuis la décision de saisie » (article L. 312-10).
ii. Le dessaisissement
Par ailleurs, le dessaisissement de certaines armes et munitions peut être décidé. Le préfet peut, après une procédure contradictoire, « pour des raisons d’ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d’une arme des catégories B, C et D de s’en dessaisir » dans un délai qu’il détermine, soit par la vente de l’arme, soit par sa neutralisation, soit enfin par sa remise à l’État (article L. 312-11).
À défaut de s’être conformé à l’ordre du préfet, l’intéressé doit remettre l’arme et ses munitions aux services de police ou de gendarmerie. Le cas échéant, il peut être procédé à la saisie de ces objets par le commissaire de police ou le commandant de la brigade de gendarmerie directement au domicile du détenteur aux heures légales de perquisition. La saisie, qui constitue une opération administrative potentiellement intrusive pour la vie privée de l’intéressé, doit alors respecter certaines conditions de fond et de forme proches de celles prévues par le code de procédure pénale en matière de perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces judiciaires. Le commissaire ou commandant doit saisir le JLD d’une demande, qui comporte toutes les informations justifiant de recourir à une telle procédure. Le JLD, seul habilité à l’autoriser, contrôle son exécution. En toute hypothèse, comme en matière de perquisition, la saisie s’effectue en présence de l’occupant des lieux ou de son représentant ou, à défaut, de deux témoins. Il est dressé un procès-verbal des opérations qui est transmis dans les meilleurs délais au JLD (article L. 312-12).
Comme en matière de remise, le dessaisissement d’une arme ou munition a, en principe, pour effet d’interdire aux personnes concernées d’acquérir ou de détenir d’autres armes similaires. L’interdiction peut être levée si le risque d’atteinte à l’ordre public ou à la sécurité des personnes disparaît (article L. 312-13).
c. Les fichiers destinés à faciliter le respect des règles relatives à l’acquisition et à la détention d’armes
Afin de renforcer l’efficacité de ces règles, le législateur a institué, initialement à l’article L. 2336-6 du code de la défense puis à l’article L. 312-16 du code de la sécurité intérieure, le fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA). Ce fichier a vocation à recenser « [l]es personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes en application des articles L. 312-10 et L. 312-13 » précités ainsi que « [l]es personnes condamnées à une peine d’interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation ou condamnées à la confiscation d’une ou de plusieurs armes dont elles sont propriétaires ou dont elles ont la libre disposition en application des articles du code pénal » et du code de la sécurité intérieure.
Ce fichier permet la recension des personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes sur décision préfectorale ou en vertu d’une condamnation pénale et contribue à faciliter l’application des décisions de saisies en permettant d’empêcher les intéressés d’acquérir de nouvelles armes.
Par ailleurs, les policiers et gendarmes habilités « peuvent, dans la stricte mesure exigée par la protection de la sécurité des personnes ou la défense des intérêts fondamentaux de la Nation », consulter le traitement d’antécédents judiciaires (TAJ). Cette consultation s’exerce « pour les besoins de l’instruction des demandes d’autorisation ou de renouvellement d’autorisation d’acquisition ou de détention d’armes faites en application de l’article L. 312-1 » et, « dans la stricte mesure exigée par la protection de l’ordre public ou la sécurité des personnes, pour l’exécution des ordres de remise d’armes et de munitions à l’autorité administrative » (article L. 312-17).
2. Le durcissement des règles d’acquisition et de détention d’armes
Afin de renforcer l’efficacité de la lutte contre le crime organisé et le terrorisme, le présent article parachève ce dispositif de contrôle administratif des armes en durcissant les conditions nécessaires à leur acquisition et à leur détention.
a. L’instauration d’une interdiction générale d’acquisition et de détention d’armes pour les personnes condamnées par la justice
En l’état actuel de la réglementation, une condamnation judiciaire n’emporte pas de conséquence directe et automatique sur la capacité des personnes définitivement condamnées à acquérir et détenir une arme. Ainsi, en l’absence d’automaticité entre le prononcé d’une condamnation judiciaire comportant une peine complémentaire relative aux armes et les mesures d’interdiction administrative d’acquisition et de détention des armes, le préfet peut seulement demander la remise de l’arme si l’état de santé ou le comportement de la personne « présente un danger grave pour elle-même ou pour autrui » (article L. 312-7) ou le dessaisissement « pour des raisons d’ordre public ou de sécurité des personnes » (article L. 312-11).
Pour pallier cette lacune, le 1° énonce, à l’article L. 312-3, une interdiction générale d’acquisition et de détention d’armes des catégories B, C et D – cette dernière catégorie est un ajout par rapport au champ actuel de cet article – pour les personnes qui ont fait l’objet d’une condamnation judiciaire. Seraient concernées :
– d’une part, « [l]es personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire comporte une mention de condamnation » pour les mêmes infractions que celles qui sont aujourd’hui mentionnées par cet article (a) ;
– d’autre part, « [l]es personnes condamnées à une peine d’interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation ou condamnées à la confiscation d’une ou de plusieurs armes dont elles sont propriétaires ou dont elles ont la libre disposition en application des articles du code pénal et du présent code qui les prévoient » : sont principalement visées les peines complémentaires relatives aux armes prévues par le code pénal pour certaines infractions (116) (b).
b. L’instauration d’une mesure d’interdiction administrative d’acquisition et de détention d’une arme applicable à toute personne se signalant par un comportement dangereux
En l’état du droit, l’interdiction préfectorale d’acquisition et de détention d’armes ne peut être prononcée que dans le cadre des mesures prévues aux articles L. 312-7 (remise) et L. 312-11 (dessaisissement), c’est-à-dire lorsque la personne est déjà en possession d’une arme.
Le 2°, qui insère au sein du même code un nouvel article L. 312-3-1, permet à l’autorité administrative de prononcer une mesure d’interdiction administrative d’acquisition et de détention des mêmes armes de catégories B, C et D à l’encontre de personnes qui auraient fait l’objet d’un signalement « laissant craindre une utilisation de l’arme ou du matériel dangereuse pour elles-mêmes ou pour autrui ». Ce nouvel article permettra donc le prononcé d’une mesure préventive d’interdiction sans attendre que la personne ait acquis une arme.
La rédaction retenue, qui se réfère à la crainte d’une utilisation de l’objet dangereuse pour la personne ou pour autrui, est quasi-identique à l’une des conditions posée à l’actuel 2° de l’article L. 312-3 pour être autorisé à acquérir une arme de catégorie B ou C (117) et très proche de la rédaction de l’actuel article L. 312-7, lequel vise le comportement ou l’état de santé susceptible de présenter « un danger grave pour elle-même ou pour autrui ».
c. La clarification des conditions d’acquisition et de détention des armes de catégories B et C
Le 3° procède à une clarification des modalités d’autorisation de l’acquisition et de la détention des armes de catégorie B telles qu’elles sont prévues par le premier alinéa de l’article L. 312-4.
Alors qu’en l’état du droit, l’autorisation est notamment conditionnée à la présentation de la copie d’une licence de tir valide délivrée par une fédération sportive agréée, cette formalité ne serait plus requise que « [l]orsque l’autorisation est délivrée pour la pratique du tir sportif ». Cette nouvelle rédaction n’obligerait donc plus la présentation d’une copie de licence de tir lorsque la demande d’autorisation ne serait pas réalisée pour un motif sportif, notamment pour le besoin de certains agents de sécurité exposés ou des experts judiciaires.
Le 4° constitue également une mesure de clarification des conditions d’acquisition d’une arme de catégorie C afin de lever une contradiction entre la lettre de l’article L. 312-4-1 et les dispositions réglementaires prises pour son application.
En effet, en l’état actuel de la rédaction de l’article L. 312-4-1 précité, l’acquisition de ce type d’arme nécessite, outre l’établissement d’une déclaration par l’armurier ou leur détenteur, pour les personnes physiques « la production d’un certificat médical datant de moins d’un mois ou (…) la présentation d’une copie » d’un permis de chasse, d’une licence de tir ou d’une carte de collectionneur. Alors que cette rédaction pourrait laisser penser qu’il est possible d’acheter une arme de catégorie C sur simple présentation d’un certificat médical, l’article R. 312-53 subordonne cette acquisition « à la présentation d’un permis de chasser délivré en France ou à l’étranger ou de toute autre pièce tenant lieu de permis de chasser étranger, accompagné d’un titre de validation de l’année en cours ou de l’année précédente ou, dans les conditions prévues au 4° de l’article R. 312-5 du présent code, d’une licence en cours de validité d’une fédération sportive ayant reçu (…) délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir ou du ball-trap ».
En conséquence, sans préjudice de la déclaration de l’armurier ou du détenteur au moment de l’achat, le 4° prévoit que l’acquisition de ce type d’arme serait désormais soumise à la production d’un certificat médical et à la présentation d’une copie d’un permis de chasser, d’une licence de tir ou d’une carte de collectionneur (a). Par dérogation à cette règle, il habilite le pouvoir réglementaire à dispenser une personne de la présentation de l’un de ces trois documents et donc à autoriser sur simple présentation d’un certificat médical l’acquisition de certaines armes de catégorie C « en raison de leurs caractéristiques techniques ou de leur destination », comme les pistolets à balle de caoutchouc (softgom) ou pour permettre la régularisation d’armes héritées (b).
d. L’élargissement du champ des personnes inscrites au FINIADA
Le 5° complète l’article L. 312-16 précité afin d’étendre la liste des personnes recensées par le FINIADA à deux catégories de personnes visées par la nouvelle rédaction de l’article L. 312-3 et du nouvel article L. 312-3-1.
La première catégorie est constituée des personnes « interdites d’acquisition et de détention de matériels ou d’armes des catégories B, C et D » en application de la nouvelle rédaction de l’article L. 312-3. Sont concernées « [l]es personnes condamnées à une peine d’interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation ou condamnées à la confiscation d’une ou de plusieurs armes dont elles sont propriétaires ou dont elles ont la libre disposition en application des articles du code pénal et du présent code qui les prévoient » (déjà visées par l’actuel 2° de l’article L. 312-16). Sont également concernées les personnes « dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire comporte une mention de condamnation » pour certaines infractions graves d’atteintes à la vie, à l’intégrité physique ou psychique, aux libertés ou à la dignité de la personne, certains crimes et délits contre les biens, certaines infractions d’atteintes à l’autorité de l’État et certaines infractions à la législation relative aux matériels de guerre, armes et munitions (a).
La seconde catégorie est constituée des personnes « interdites d’acquisition et de détention en application de l’article L. 312-3-1 » tel qu’il résulte du présent article, autrement dit celles qui ont fait l’objet d’un signalement « laissant objectivement craindre une utilisation de l’arme ou du matériel dangereuse pour elles-mêmes ou pour autrui » (b).
*
* *
La Commission adopte les amendements rédactionnels CL279 à CL282 du rapporteur.
Puis elle adopte l’article 7 modifié.
Article 8
(art. 706-55, 706-73 et 706-106-1 [nouveau] du code de procédure pénale)
Renforcement des moyens d’investigation judiciaire
en matière de lutte contre le trafic d’armes
Le présent article tend à renforcer les moyens d’enquête contre le trafic d’armes, lequel constitue bien souvent le corollaire d’activités criminelles portant gravement atteinte à l’ordre public. À cette fin, il élargit le recueil d’empreintes génétiques, le champ de la procédure applicable à la criminalité et à la délinquance organisées et le recours à la technique du « coup d’achat » aux infractions relatives aux armes.
1. L’élargissement du champ des infractions justifiant le recueil et la centralisation des empreintes génétiques de leurs auteurs
Le 1° vise à étendre la liste des infractions relatives aux armes permettant le recueil et la centralisation d’empreintes génétiques dans le fichier national des empreintes génétiques (FNAEG).
a. Certaines infractions relatives aux armes figurent déjà parmi celles permettant l’inscription de traces et d’empreintes au fichier des empreintes génétiques
Créé par la loi n° 98-468 du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu’à la protection des mineurs, le FNAEG, fichier d’identification judiciaire, centralise les traces et empreintes génétiques des personnes déclarées coupables, poursuivies mais déclarées pénalement irresponsables ou à l’encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu’elles aient commis certaines infractions limitativement énumérées par l’article 706-55 du code de procédure pénale. À l’origine cantonné à la recherche et à l’identification des seuls auteurs d’infractions sexuelles, le législateur a, par la suite, progressivement élargi le champ de ce fichier en étendant le nombre – notamment en 2001 (118), 2003 (119), 2004 (120) et 2013 (121) – des infractions concernées et en ajoutant au fichage des personnes condamnées celui des personnes soupçonnées.
Appelé à se prononcer sur la conformité à la Constitution de l’article 706-55, le Conseil constitutionnel a considéré, en 2010, à propos de la liste des infractions justifiant de porter des traces et empreintes génétiques au FNAEG, « qu’outre les atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation, toutes ces infractions [portaient] atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, [incriminaient] des faits en permettant la commission ou ceux qui en tirent bénéfice » et « que pour l’ensemble de ces infractions, les rapprochements opérés avec des empreintes génétiques provenant des traces et prélèvements enregistrés au fichier [étaient] aptes à contribuer à l’identification et à la recherche de leurs auteurs ». Il en a conclu « que la liste prévue par l’article 706-55 [était] en adéquation avec l’objectif poursuivi par le législateur et que cet article ne [soumettait] pas les intéressés à une rigueur qui ne serait pas nécessaire et ne [portait] atteinte à aucun des droits et libertés » constitutionnellement protégés (122).
En l’état du droit, les infractions permettant l’inscription d’empreintes génétiques au FNAEG sont :
« 1° Les infractions de nature sexuelle visées à l’article 706-47 du présent code ainsi que le délit prévu par l’article 222-32 du code pénal ;
« 2° Les crimes contre l’humanité et les crimes et délits d’atteintes volontaires à la vie de la personne, de torture et actes de barbarie, de violences volontaires, de menaces d’atteintes aux personnes, de trafic de stupéfiants, d’atteintes aux libertés de la personne, de traite des êtres humains, de proxénétisme, d’exploitation de la mendicité et de mise en péril des mineurs (…) ;
« 3° Les crimes et délits de vols, d’extorsions, d’escroqueries, de destructions, de dégradations, de détériorations et de menaces d’atteintes aux biens (…) ;
« 4° Les atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation, les actes de terrorisme, la fausse monnaie, l’association de malfaiteurs et les crimes et délits de guerre (…) ;
« 5° Les délits prévus par les articles L. 2353-4 et L. 2339-1 à L. 2339-11 du code de la défense ;
« 6° Les infractions de recel ou de blanchiment du produit de l’une des infractions mentionnées aux 1° à 5° (…) ».
C’est en 2003 que le législateur a, notamment, élargi cette liste à certaines infractions en matière de détention d’armes ou de munitions de guerre en y incluant les crimes et délits prévus par l’article 2 de la loi du 24 mai 1834 sur les détenteurs d’armes ou de munitions de guerre (fabrication ou détention de poudre de guerre ou de toute autre poudre), l’article 3 de la loi du 19 juin 1871 abrogeant le décret du 4 septembre 1870 sur la fabrication des armes de guerre (fabrication ou détention de machines ou d’engins meurtriers ou incendiaires) et les articles 24 à 35 du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions (fabrication et détention d’armes sans autorisation, importation sans autorisation de matériels prohibés, acquisition ou détention d’armes en dépit d’une interdiction, transport sans motif légitime de certaines catégories d’armes…) (123).
En application du 5° de l’article 706-55 précité, le FNAEG centralise donc les traces et empreintes génétiques des personnes déclarées coupables des délits « prévus par les articles L. 2353-4 et L. 2339-1 à L. 2339-11 du code de la défense », de celles poursuivies pour avoir commis de telles infractions mais déclarées pénalement irresponsables et de celles à l’encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu’elles les aient commises. Les infractions du code de la défense mentionnées recouvrent :
– certaines infractions à la législation sur les matériels de guerre, armes et munitions : les délits de fabrication et de commerce (articles L. 2339-2 à L. 2339-4-1), les infractions en matière d’acquisition et de détention (article L. 2339-5) ou de port, de transport et d’expédition (article L. 2339-9), ainsi que les délits d’importation sans autorisation, d’usage illégal du poinçon d’épreuve des canons d’armes de guerre fabriqués en France et de contrefaçon ou d’usage frauduleux de ce poinçon (articles L. 2339-10 et L. 2339-11) ;
– certaines infractions à la législation relative aux explosifs : les délits de fabrication, sans autorisation, d’un engin explosif ou incendiaire ou d’un produit explosif, ou de tout autre élément ou substance destinés à entrer dans la composition d’un produit explosif (article L. 2353-4).
b. L’extension de la liste des infractions relatives aux armes justifiant l’inscription de traces et empreintes au fichier des empreintes génétiques
Le 1° du présent article actualise et étend la liste des infractions relatives aux armes permettant l’insertion de traces et d’empreintes au FNAEG.
En premier lieu, il remplace les références aux articles L. 2339-3-1, L. 2339-5 et L. 2339-9 du code de la défense, qui renvoient aux sanctions pénales encourues pour certaines activités illicites réprimées par le code de la sécurité intérieure, par les articles L. 317-1-1 à L. 317-3-2, L. 317-4 à L. 317-9 et L. 317-9-2 du code de la sécurité intérieure qui fixent les sanctions pénales en matière d’acquisition, de détention, de commerce de détail, de conservation, de perte, de transfert de propriété, de port et de transport d’armes.
En second lieu, il ajoute aux infractions concernées en matière d’importation, d’exportation et de transfert d’armes les deux nouveaux délits créés en 2011 (124) par le législateur aux articles L. 2339-11-1 et L. 2339-11-2 du code de la défense, portant respectivement sur les violations d’utilisation des licences et de tenue des registres et les violations concernant les obligations de réexportation. Il complète également cette liste par les infractions réprimées par l’article L. 2353-13 du même code, relatif à l’acquisition, la détention, le transport ou le port illégal de produits ou d’engins explosifs.
2. L’extension du champ de la procédure applicable à la criminalité et à la délinquance organisées à de nouvelles infractions relatives aux armes
Le 2° du présent article élargit la liste des infractions relatives aux armes susceptibles de se voir appliquer la procédure dérogatoire de la criminalité et de la délinquance organisées à l’ensemble des faits de trafic d’armes de catégories A et B, même s’ils n’ont pas été commis en bande organisée.
a. Une procédure d’ores et déjà applicable à certaines infractions relatives aux armes commises en bande organisée
Certains crimes et délits sont soumis, en raison de leur caractère astucieux, de leur gravité et de l’atteinte particulière qu’ils portent à l’ordre public, à une procédure de poursuite, d’instruction et de jugement dérogatoire du droit commun.
Les articles 706-73 à 706-74 fixent la liste des infractions relevant de cette catégorie (125) auxquelles s’appliquent des mesures spéciales d’investigations (surveillance, infiltration, perquisition de nuit, interception, au stade de l’enquête, de correspondances émises par télécommunications, sonorisation et fixation d’image de certains lieux et véhicules, captation de données informatiques et mesures conservatoires) et un régime particulier de garde à vue fixé par l’article 706-88, laquelle peut, au-delà du délai de quarante-huit heures de droit commun, être prolongée de quarante-huit heures en une ou deux fois par décision du juge des libertés et de la détention (JLD) :
– l’article 706-73 énumère les crimes et délits relevant en totalité du régime spécial de la criminalité et de la délinquance organisées ;
– l’article 706-73-1, récemment introduit dans le code de procédure pénale par la loi n° 2015-993 du 17 août 2015 portant adaptation de la procédure pénale au droit de l’Union européenne, applique le régime procédural spécial relatif à la criminalité et à la délinquance organisées à certaines infractions, à l’exception notable de l’article 706-88 permettant de prolonger la durée de la garde à vue jusqu’à quatre jours et de différer l’intervention de l’avocat jusqu’à la 72e heure ;
– l’article 706-74 dispose que, « [l]orsque la loi le prévoit », la procédure spéciale relative à la criminalité et à la délinquance organisées s’applique également aux autres crimes et délits commis en bande organisée et aux délits d’association de malfaiteurs.
Dès 2004, le législateur a inscrit dans la liste des infractions mentionnées à l’article 706-73 les délits en matière de fabrication ou de détention d’armes lorsqu’ils étaient commis en bande organisée. En l’état du droit, le 12° de cet article permet en effet d’appliquer les mesures spéciales d’investigation et les règles particulières de compétences aux « délits en matière d’armes et de produits explosifs commis en bande organisée, prévus par les articles L. 2339-2, L. 2339-3, L. 2339-10, L. 2341-4, L. 2353-4 et L. 2353-5 du code de la défense ainsi que par les articles L. 317-2, L. 317-4 et L. 317-7 du code de la sécurité intérieure ». Sont principalement visées les infractions de détention, de cession et d’acquisition d’armes de catégories A et B à condition qu’elles aient été commises en bande organisée.
Cette situation n’apparaît toutefois pas satisfaisante dans la mesure où l’organisation des trafics d’armes, impliquant un faible nombre de protagonistes, empêche souvent de caractériser, dès le début de l’enquête, la bande organisée – qui implique, au sens de l’article 132-71 du code pénal, l’existence d’un groupement formé ou d’une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’une ou de plusieurs infractions.
b. Les conditions constitutionnelles d’extension de cette procédure
Initialement cantonnée à quinze infractions (126) punies de peines d’emprisonnement importantes lorsque l’article 706-73 précité a été introduit dans notre droit par la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, dite loi « Perben II », la liste des crimes et délits soumis à cette procédure dérogatoire s’est progressivement allongée.
Le Conseil constitutionnel avait déclaré conforme à la Constitution l’économie initiale de l’article 706-73 précité, en considérant que « si le législateur peut prévoir des mesures d’investigation spéciales en vue de constater des crimes et délits d’une gravité et d’une complexité particulières, d’en rassembler les preuves et d’en rechercher les auteurs, c’est sous réserve que ces mesures soient conduites dans le respect des prérogatives de l’autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, et que les restrictions qu’elles apportent aux droits constitutionnellement garantis soient nécessaires à la manifestation de la vérité, proportionnées à la gravité et à la complexité des infractions commises et n’introduisent pas de discriminations injustifiées » (127).
Il s’est également prononcé, par la suite, sur l’extension du champ de cette procédure à de nouvelles infractions en procédant à un distinguo entre les mesures de garde à vue et les autres pouvoirs spéciaux d’enquête.
En 2013, à propos de l’application aux infractions de fraude fiscale en bande organisée ou commises dans des circonstances particulières de la procédure relative à la criminalité et à la délinquance organisées, le Conseil a ainsi jugé :
– que le législateur pouvait décider d’appliquer des mesures spéciales d’enquête et d’instruction à certaines infractions graves en raison de la difficulté d’appréhender leurs auteurs compte tenu des « éléments d’extranéité » ou de « l’existence d’un groupement ou d’un réseau dont l’identification, la connaissance et le démantèlement posent des problèmes complexes », « les atteintes au respect de la vie privée et au droit de propriété résultant de leur mise en œuvre ne [revêtant] pas un caractère disproportionné au regard du but poursuivi » (128) ;
– en revanche, que le législateur ne pouvait pas appliquer le régime dérogatoire de la garde à vue applicable à la criminalité et à la délinquance organisées aux infractions « qui ne sont pas susceptibles de porter atteinte en eux-mêmes à la sécurité, à la dignité ou à la vie des personnes », sauf à « [porter] à la liberté individuelle et aux droits de la défense une atteinte qui ne peut être regardée comme proportionnée au but poursuivi » (129).
Statuant, en 2014, sur la conformité à la Constitution de l’inscription, au 8° bis de l’article 706-73 précité, du délit d’escroquerie en bande organisée par la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit, le Conseil a ainsi considéré que « le délit d’escroquerie [n’était] pas susceptible de porter atteinte en lui-même à la sécurité, à la dignité ou à la vie des personnes » et « qu’en permettant de recourir à la garde à vue selon les modalités fixées par l’article 706-88 du code de procédure pénale au cours des enquêtes ou des instructions portant sur ce délit, le législateur [avait] permis qu’il soit porté à la liberté individuelle et aux droits de la défense une atteinte qui ne [pouvait] être regardée comme proportionnée au but poursuivi » (130). Il a, en 2015, suivi le même raisonnement à propos des faits de blanchiment, de recel et d’association de malfaiteurs en lien avec l’infraction d’escroquerie en bande organisée (131).
c. L’application de cette procédure à l’ensemble des trafics d’armes de catégories A et B, même non commis en bande organisée
Le 2° du présent article procède à un double élargissement de la liste des infractions relatives aux armes mentionnées au 12° de l’article 706-73 pour lesquelles il serait possible d’appliquer la procédure dérogatoire applicable en matière de criminalité et de délinquance organisées.
D’une part, il ajoute à la liste des infractions déjà mentionnées l’infraction prévue par le 1° de l’article L. 317-8 du code de la sécurité intérieure, qui réprime le port ou le transport sans motif légitime de matériels de guerre, d’armes ou de munitions de catégories A ou B. Avec cet ajout, c’est l’ensemble des infractions de trafic d’armes des catégories A et B – les plus dangereuses – qui pourront être poursuivies sous le régime de la criminalité organisée.
D’autre part, il prévoit que l’ensemble des infractions relatives aux armes visées par le 12° précité pourront se voir appliquer ce régime dérogatoire qu’elles aient été commises en bande organisée ou non, afin de tenir compte de la dimension souvent limitée – en ampleur et en nombre de protagonistes – des trafics d’armes. Ces infractions rejoignent ainsi les autres crimes et délits figurant dans le champ de l’article 706-73 du code de procédure pénale sans qu’il soit nécessaire qu’ils aient été commis en bande organisée (trafics de stupéfiants, traite des êtres humains, proxénétisme, extorsion…).
3. L’application au trafic d’armes de la technique du « coup d’achat »
Le 3° du présent article permet aux enquêteurs de recourir, en matière d’infractions relatives aux armes, à la technique dite du « coup d’achat », laquelle les autorise à acquérir ou à mettre à disposition des armes afin de constater une infraction et d’en identifier les auteurs ou complices.
a. Une technique aujourd’hui applicable au trafic de stupéfiants…
Les services de police sont déjà autorisés à procéder, dans le cadre de la lutte contre les trafics de stupéfiants et de manière ponctuelle, à des opérations d’achat pour remonter la filière jusqu’au vendeur ou pour caractériser pénalement le trafic. Cette technique, dite du « coup d’achat », permet de renforcer l’efficacité des poursuites sans engager la responsabilité pénale des enquêteurs qui l’utilisent.
Depuis son inscription à l’article 706-32 du même code par la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance, les enquêteurs peuvent recourir au « coup d’achat » dans les conditions suivantes :
– pour les seules infractions prévues aux articles 227-37 et 227-39 du code pénal : transport, détention, offre, cession, acquisition ou emploi illicite de stupéfiants, facilitation de l’usage de stupéfiants, cession ou offre illicite de stupéfiants à une personne en vue de sa consommation personnelle ;
– la mise en œuvre de la procédure est confiée à un officier de police judiciaire (OPJ) ou à un agent de police judiciaire (APJ) sous l’autorité de celui-ci, et subordonnée à une autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction saisi des faits ;
– l’irresponsabilité pénale attachée aux actes commis dans ce cadre est limitée à l’acquisition de produits stupéfiants (1°) et, en vue de l’acquisition de tels produits, à la mise à disposition de certaines personnes de « moyens de caractère juridique ou financier ainsi que [de] moyens de transport, de dépôt, d’hébergement, de conservation et de télécommunication » (2°) ;
– enfin, « à peine de nullité », l’autorisation, qui peut être donnée par tout moyen, doit être mentionnée ou versée au dossier de la procédure, et les actes autorisés ne doivent pas constituer une incitation à commettre une infraction.
b. …transposée par le présent article au trafic d’armes
Afin de faciliter la détection des trafics d’armes, le 3° du présent article applique cette technique aux enquêtes judiciaires relatives au trafic d’armes, l’article 10 du projet de loi ayant pour objet d’en étendre l’usage aux douanes.
À cet effet, il complète le chapitre II du titre XXV du livre IV du code de procédure pénale, relatif à la procédure applicable à la criminalité et à la délinquance organisée, par une nouvelle section IX. Cette nouvelle section comporterait un article 706-106-1 encadrant le recours à la technique du « coup d’achat » dans le domaine du trafic d’armes dans des conditions identiques à celles qui existent pour le trafic de stupéfiants :
– son usage serait strictement limité « aux seules fins de constater les infractions mentionnées au 12° de l’article 706-73 [tel qu’il résulte du présent projet de loi], d’en identifier les auteurs et complices et d’effectuer les saisies prévues au présent code » : les infractions visées sont les délits en matière d’armes et de produits explosifs prévus par les articles L. 2339-2, L. 2339-3, L. 2339-10, L. 2341-4, L. 2353-4 et L. 2353-5 du code de la défense ainsi que par les articles L. 317-2, L. 317-4 et L. 317-7 et le 1° de l’article L. 317-8 du code de la sécurité intérieure (premier alinéa) ;
– seuls les OPJ et, sous leur autorité, les APJ pourraient y recourir « avec l’autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction saisi des faits qui en avise préalablement le parquet » (même alinéa) ;
– l’irresponsabilité pénale attachée aux actes commis dans ce cadre demeurerait cantonnée à l’acquisition des armes (1°) et, en vue de l’acquisition d’armes, à la mise à disposition des personnes se livrant à ces infractions « des moyens de caractère juridique ou financier ainsi que des moyens de transport, de dépôt, d’hébergement, de conservation et de télécommunication » (2°) ;
– les mêmes nullités s’appliqueraient lorsque l’autorisation ne serait pas mentionnée ou versée au dossier de la procédure et lorsque les actes autorisés constitueraient une incitation à commettre une infraction (dernier alinéa).
*
* *
La Commission examine l’amendement CL181 de M. Sergio Coronado.
M. Sergio Coronado. Cet amendement vise à réserver l’inscription au fichier national automatisé des empreintes génétiques, le FNAEG, aux délits pour lesquels une peine de prison est encourue. Cette année, le nombre d’inscriptions aux différents fichiers a explosé. En l’espèce, est notamment concerné le délit prévu au deuxième alinéa de l’article 322-1 du code pénal. En effet, il semble disproportionné de permettre cette inscription dans les cas d’infractions qui ne sont punies d’aucune peine de prison.
M. le rapporteur. Avis défavorable. Vous souhaitez limiter l’inscription au FNAEG aux seules traces génétiques de personnes définitivement condamnées pour une infraction punie d’une peine de prison et, en particulier, exclure du champ de cette mesure certaines dégradations de biens comme le fait de tracer des inscriptions, des signes et des dessins sans autorisation sur des façades, des véhicules, des voies publiques ou du mobilier urbain, lorsqu’il en est résulté un dommage léger.
Les infractions justifiant l’inscription de traces ou d’empreintes génétiques au FNAEG ne sont pas déterminées en fonction de la peine encourue mais de leur nature et des nécessités liées à l’identification et à la recherche de leurs auteurs. De ce seul point de vue, l’infraction mentionnée au second alinéa de l'article 322-1 est indivisible de l'incrimination pénale de destruction, dégradation, ou détérioration d'un bien appartenant à autrui.
La liste des infractions figurant à l'article 706-55 du code de procédure pénale a récemment été jugée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel à la suite d’une question prioritaire de constitutionnalité. Le Conseil a considéré d’une part « qu'outre les atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation, toutes ces infractions [portaient] atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, [incriminaient] des faits en permettant la commission ou ceux qui en tirent bénéfice » et « que pour l'ensemble de ces infractions, les rapprochements opérés avec des empreintes génétiques provenant des traces et prélèvements enregistrés au fichier [étaient] aptes à contribuer à l'identification et à la recherche de leurs auteurs », et, d’autre part, « que la liste prévue par l'article 706-55 [était] en adéquation avec l'objectif poursuivi par le législateur et que cet article ne [soumettait] pas les intéressés à une rigueur qui ne serait pas nécessaire et ne [portait] atteinte à aucun des droits et libertés » constitutionnellement protégés.
J’émets donc un avis défavorable à cet amendement, même si je n’exclus pas d’envisager l’évolution de la liste des délits inscriptibles au FNAEG ; nous verrons d’ici au débat en séance si cette réflexion a pu progresser.
M. Sergio Coronado. Je vous invite à y réfléchir, en effet, car ce débat est déjà ancien. Presque toutes les actions syndicales ou revendicatives entrent dans le champ de la mesure.
M. le rapporteur. C’est précisément sur cette question que je souhaite travailler, monsieur Coronado, mais cela ne peut se faire au moyen de votre amendement, car il efface tout, en quelque sorte.
M. Sergio Coronado. Soit, mais j’ai déjà eu l’occasion de faire cette proposition en défendant un amendement à une proposition de loi déposée par M. Marc Dolez, qui avait initialement reçu l’aval du groupe majoritaire et du Gouvernement avant que le ministre compétent se rétracte le matin même sur une station de radio. Je ne fais qu’utiliser les « véhicules » dont je dispose. La proposition de loi en question était consacrée à ce que d’aucuns ont appelé une « amnistie » syndicale et politique ; elle visait à progresser en la matière. Le Gouvernement ne l’a pas souhaité in extremis ; qu’il change d’avis d’ici à la séance serait une excellente nouvelle.
M. le rapporteur. Évitons toute confusion entre la recherche que j’envisage, dont je ne saurais garantir à ce stade qu’elle aboutira et qui porte sur l’avenir, et le texte auquel vous faites référence qui concernait le passé. Cela étant, la préoccupation qui inspire votre amendement – auquel je demeure toutefois défavorable – concernant certains délits susceptibles d’être inscrits au FNAEG ne m’est pas étrangère, et je chercherai un moyen d’y remédier à l’avenir, notamment en matière de liberté syndicale.
M. Jean-Luc Warsmann. Le développement du FNAEG n’est pas un recul, bien au contraire : c’est un immense progrès. Rien ne doit être fait pour y porter atteinte, car ce fichier est un outil de recherche des auteurs d’infractions. Tant qu’il demeurera aussi prudent sur ce point, je soutiendrai le rapporteur ; l’amendement qui nous est proposé, en effet, est tout à fait inacceptable.
La Commission rejette l’amendement.
Elle adopte l’amendement de simplification CL283 de M. le rapporteur.
Puis elle examine l’amendement CL182 de M. Sergio Coronado.
M. Sergio Coronado. Cet amendement, dont vous constaterez la cohérence avec les précédents, vise à empêcher que soient conservées les empreintes génétiques des personnes suspectées, poursuivies ou condamnées pour des délits d’atteinte aux biens – destructions, dégradations, détériorations ou menaces –, de violation de domicile ou d'atteinte à un système de traitement automatisé des données, quand ces délits ont été commis à l’occasion de conflits du travail, d’activités syndicales et revendicatives ou de mouvements collectifs revendicatifs relatifs aux problèmes liés au logement, à l’environnement, aux droits humains, à la santé, à l’éducation, à la culture, à la lutte contre les discriminations, aux langues régionales, au maintien des services publics et aux droits des migrants.
S’il est en effet légitime d’inclure dans le FNAEG les personnes suspectées de crimes ou de délits graves, notamment d’infractions sexuelles – qui ont justifié la création du fichier en premier lieu – afin d’en faciliter l’élucidation, il semble peu opportun, voire dangereux, de procéder au fichage génétique systématique de militants politiques et syndicaux. Si le prélèvement peut être utile à l’enquête, sa conservation n’est pas souhaitable, car elle s’apparenterait à un fichage génétique des militants politiques et syndicaux. Ces militants agissent en plein jour et à visage découvert. Ils assument et revendiquent leurs actes ; leur identification ne présente donc aucune difficulté.
M. le rapporteur. Nous venons d’avoir ce débat et mon avis demeure défavorable. Cependant, cet amendement cible plus particulièrement un sujet qui m’intéresse et que nous allons étudier de plus près.
La Commission rejette l’amendement.
Elle passe à l’amendement CL183 de M. Sergio Coronado.
M. Sergio Coronado. Cet amendement vise à abroger une disposition qui semble contraire à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, la CEDH. En effet, le III de l’article 706-56 prévoit le retrait de plein droit de toutes les réductions de peine et interdit l’octroi de toute nouvelle réduction pour les personnes condamnées ayant refusé le fichage de leur ADN, en contradiction avec le principe d’individualisation des peines.
M. le rapporteur. Avis défavorable. Votre raccourci me semble rapide : c’est la cour d’appel de Pau – pour laquelle j’ai le plus grand respect par ailleurs – qui estime que cette disposition est contraire à la jurisprudence de la CEDH ; ce n’est pas l’avis du Conseil constitutionnel qui l’a considérée conforme à notre Constitution.
La Commission rejette l’amendement.
Puis elle adopte l’amendement de simplification CL284 et les amendements rédactionnels CL285 à CL288 du rapporteur.
Elle examine l’amendement CL217 de Mme Pascale Crozon.
Mme Pascale Crozon. M. le rapporteur peut-il nous préciser si l’autorisation d’acquérir des armes prévue au présent article est ponctuelle et délivrée pour telle ou telle transaction délictuelle ou, au contraire, de portée générale et destinée à couvrir l’ensemble de la mission de l’agent ? Si c’est le cas, cet amendement vise à préciser que les armes acquises font l’objet d’une déclaration auprès de l’autorité en ayant autorisé l’acquisition. Il ne pourrait donc être question d’accorder une immunité pour des faits délictuels qui seraient délibérément cachés à l’autorité judiciaire.
M. le rapporteur. La technique du « coup d’achat » en matière de trafic d’armes – comme en matière de trafic de stupéfiants – est mise en œuvre dans le cadre d’une enquête ou d’une information judiciaire, sous l’autorité, la direction et le contrôle du procureur de la République dans le premier cas et du juge d’instruction dans le second. Il n’est donc pas nécessaire de prévoir un dispositif de déclaration des armes acquises, qui serait concrètement très lourd pour les services concernés. La technique du « coup d’achat » est strictement encadrée par l’article 8 du projet de loi, puisqu’il y est expressément mentionné que « les actes autorisés ne peuvent constituer une incitation à commettre une infraction ». Je vous propose donc de retirer cet amendement ; à défaut, j’y serai défavorable.
L’amendement CL217 est retiré.
La Commission adopte l’article 8 modifié.
Article 9
(art. L. 317-4, L. 317-5, L. 317-7 et L. 317-8 du code de la sécurité intérieure
et art. L. 2339-10 du code de la défense)
Renforcement de la répression pénale de certains faits de trafic d’armes
Le présent article renforce la répression de certaines infractions relatives aux armes, corollaires fréquents du crime organisé et du terrorisme, dans le prolongement de l’article 8 du projet de loi qui modernise les moyens d’investigation mis à la disposition des enquêteurs afin de les poursuivre.
1. Les peines encourues pour les faits de trafic d’armes
Les sanctions pénales encourues en cas d’infraction à la législation sur les matériels de guerre, armes et munitions sont principalement fixées, d’une part, par les articles L. 2339-2 à L. 2339-11-4 et L. 2353-4 à L. 2353-14 du code de la défense s’agissant de la fabrication et du commerce, des importations, exportations et transferts de ces objets ainsi que des explosifs, et, d’autre part, par les articles L. 317-1 à L. 317-12 du code de la sécurité intérieure pour ce qui concerne l’acquisition, la détention, le commerce de détail, la conservation, la perte, le transfert de propriété, le port et le transport d’armes et de munitions.
L’essentiel des peines prévues par ces articles et encourues à titre principal est recensé dans le tableau ci-après.
LES PRINCIPALES PEINES ENCOURUES POUR LES FAITS DE TRAFIC
DE MATÉRIELS DE GUERRE, D’ARMES, DE MUNITIONS ET D’EXPLOSIFS
Disposition |
Infraction |
Peine encourue |
Code de la défense | ||
Art. L. 2339-2 |
Fabrication ou commerce illicites de matériels, armes ou munitions ou exercice d’une activité d’intermédiaire ou d’agent de publicité |
7 ans d’emprisonnement et 100 000 € d’amende |
Même infraction commise en bande organisée |
10 ans d’emprisonnement et 500 000 € d’amende | |
Art. L. 2339-3 |
Manquement à l’article L. 2332-2 et au premier alinéa des articles L. 2332-10 et L. 2339-1 |
5 ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende |
Même infraction commise en bande organisée |
10 ans d’emprisonnement et 500 000 € d’amende | |
Art. L. 2339-4 |
Cession par un fabricant ou commerçant d’une ou de plusieurs armes ou munitions de catégories A, B, C et D en violation des articles L. 312-1 à L. 312-4-3 ou L. 314-3 |
3 ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende |
Art. L. 2339-4-1 |
Manquement aux obligations de formalités préalables, notamment de tenue de registres spéciaux, par une personne titulaire d’une autorisation de fabrication ou de commerce d’armes et de munitions |
6 mois d’emprisonnement et 7 500 € d’amende |
Art. L. 2339-10 |
Importation, sans autorisation, de certains matériels des catégories A, B, C et D |
5 ans d’emprisonnement et 9 000 € d’amende |
Même infraction commise en bande organisée |
10 ans d’emprisonnement et 500 000 € d’amende | |
Art. L. 2339-11 |
Usage, par une personne non qualifiée, du poinçon d’épreuve des canons d’arme de guerre fabriqués en France |
2 ans d’emprisonnement et 30 000 € d’amende |
Contrefaçons d’un poinçon d’épreuve et usage frauduleux des poinçons contrefaits |
5 ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende | |
Art. L. 2339-11-1 |
Manquement aux obligations en matière d’autorisation des importations, exportations et transferts d’armes au sein de l’Union européenne et de formalités préalables, notamment de tenue de registres spéciaux |
5 ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende |
Art. L. 2339-11-2 |
Manquement aux obligations relatives aux licences d’exportation ou de transfert d’armes ; obtention d’une telle licence à la suite d’une déclaration mensongère ou frauduleuse ; omission ou refus de répondre aux demandes des autorités en matière d’importation, d’exportation ou de transfert |
3 ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende |
Art. L. 2339-11-3 |
Absence d’information du ministère de la défense de l’intention d’un fournisseur ou exportateur d’utiliser une licence d’exportation ou de transfert ; absence de transmission de la déclaration des matériels exportés ou transférés |
15 000 € d’amende |
Art. L. 2353-4 |
Fabrication, sans autorisation, d’un engin explosif |
5 ans d’emprisonnement et 3 750 € d’amende |
Même infraction commise en bande organisée |
10 ans d’emprisonnement et 500 000 € d’amende | |
Art. L. 2353-5 |
Violation de l’article L. 2352-1 ; refus de se soumettre à des contrôles ou entrave à ceux-ci |
5 ans d’emprisonnement et 4 500 € d’amende |
Même infraction commise en bande organisée |
10 ans d’emprisonnement et 500 000 € d’amende | |
Art. L. 2353-6 |
Vente illégale de produits explosifs non susceptibles d’un usage militaire |
2 ans d’emprisonnement et 3 750 € d’amende |
Art. L. 2353-7 |
Exportation illégale de produits explosifs non susceptibles d’un usage militaire |
3 750 € d’amende |
Art. L. 2353-10 |
Port ou transport, sans motif légitime, d’artifices non détonants |
6 mois d’emprisonnement et 7 500 € d’amende |
Art. L. 2353-11 |
Absence de déclaration de la disparition de produits explosifs par une personne autorisée à les fabriquer, acquérir, transporter ou conserver |
1 an d’emprisonnement et 6 000 € d’amende |
Art. L. 2353-12 |
Absence de déclaration de la disparition de produits explosifs par un préposé qui en avait la garde |
6 mois d’emprisonnement et 3 750 € d’amende |
Code de la sécurité intérieure | ||
Art. L. 317-1-1 |
Fabrication ou commerce illicites de matériels, armes ou munitions ; exercice illicite d’une activité d’intermédiaire ou d’agent de publicité |
7 ans d’emprisonnement et 100 000 € d’amende |
Même infraction commise en bande organisée |
10 ans d’emprisonnement et 500 000 € d’amende | |
Art. L. 317-2 |
Violation des articles L. 312-5 et L. 317-1 ; vente ou achat irréguliers des matériels de guerre, armes et munitions ; cession ou vente des matériels de guerre, armes et munitions à un mineur |
5 ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende |
Art. L. 317-2-1 |
Même infraction commise en bande organisée |
10 ans d’emprisonnement et 500 000 € d’amende |
Art. L. 317-3-1 |
Cession irrégulière par un fabricant ou commerçant détenteurs d’une autorisation d’une ou de plusieurs armes des catégories A, B, C et D |
3 ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende |
Art. L. 317-3-2 |
Manquement aux obligations de formalités préalables, notamment de tenue de registres spéciaux, par une personne titulaire d’une autorisation de fabrication ou de commerce d’armes |
6 mois d’emprisonnement et 7 500 € d’amende |
Art. L. 317-4 |
Acquisition, cession ou détention sans autorisation d’une ou de plusieurs armes des catégories A et B |
3 ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende |
Même infraction commise par une personne antérieurement condamnée à l’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit |
5 ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende | |
Même infraction commise en bande organisée |
10 ans d’emprisonnement et 500 000 € d’amende | |
Art. L. 317-5 |
Acquisition ou détention d’armes ou de munitions en violation d’une interdiction administrative |
3 ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende |
Art. L. 317-6 |
Obstacle à une décision administrative de saisie ou de dessaisissement |
3 ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende |
Art. L. 317-7 |
Détention d’un dépôt d’armes ou de munitions des catégories A, B et D |
5 ans d’emprisonnement et 3 750 € d’amende |
Même infraction commise en bande organisée |
10 ans d’emprisonnement et 500 000 € d’amende | |
Même infraction commise par une personne antérieurement condamnée à l’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit |
10 ans d’emprisonnement et 500 000 € d’amende | |
Art. L. 317-7-1 |
Suppression, masquage, altération ou modification frauduleuses des marquages, poinçons, numéros de série, emblèmes ou signes apposés ou intégrés sur des matériels ou armes ; détention, en connaissance de cause, d’une arme ainsi modifiée |
5 ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende |
Art. L. 317-7-2 |
Acquisition, vente, livraison ou transport de matériels ou d’armes dépourvus des marquages, poinçons, numéros de série, emblèmes ou signes nécessaires à leur identification de manière certaine ou dont ces mêmes éléments auraient été supprimés, masqués, altérés ou modifiés |
5 ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende |
Art. L. 317-7-3 |
Même infraction commise en bande organisée |
10 ans d’emprisonnement et 500 000 € d’amende |
Art. L. 317-8 |
Port ou transport sans motif légitime de matériels de guerre ou d’armes ou de munitions des catégories A et B |
5 ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende |
Port ou transport sans motif légitime d’armes ou de munitions de catégorie C |
2 ans d’emprisonnement et 30 000 € d’amende | |
Port ou transport sans motif légitime d’armes ou de munitions de catégorie D, sauf celles qui présentent une faible dangerosité |
1 an d’emprisonnement et 15 000 € d’amende | |
Art. L. 317-9 |
Transport sans motif légitime de matériels de guerre ou d’armes ou de munitions des catégories A et B par au moins deux personnes |
10 ans d’emprisonnement et 500 000 € d’amende |
Transport sans motif légitime d’armes ou de munitions de catégorie C par au moins deux personnes |
5 ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende | |
Transport sans motif légitime d’armes ou de munitions de catégorie D par au moins deux personnes, sauf celles qui présentent une faible dangerosité |
2 ans d’emprisonnement et 30 000 € d’amende | |
Art. L. 317-9-2 |
Contrefaçons d’un poinçon d’épreuve et usage frauduleux des poinçons contrefaits |
5 ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende |
Nota bene : les dispositions et les peines soulignées sont celles modifiées par l’article 9 du projet de loi.
Selon les données relatives aux condamnations prononcées entre 2010 et 2014 communiqués par le Gouvernement, les peines les plus nombreuses sont prononcées :
– d’une part, pour les délits d’acquisition, de détention ou de cession d’armes de catégorie A ou B, soit environ 1 000 par an, dont moins de dix sont liées à une activité terroriste. Il s’agit généralement de faits de détention illicite (autour de 90 %). Lorsqu’ils ont été commis avec une circonstance aggravante, c’est principalement en raison des antécédents judiciaires de l’auteur qui avait déjà été condamné à une peine privative de liberté ;
– et, d’autre part, pour les délits de port et de transport d’armes de même catégorie et d’explosifs, qui oscillent entre 320 et 350 par an, dont moins de dix liés au terrorisme : la très grande majorité des condamnations portent sur des faits de port d’armes de catégorie B (132).
2. Le renforcement de la répression pénale de certains de ces faits
Le présent article renforce sensiblement les sanctions pénales applicables à certaines violations de la législation sur les armes à feu.
a. L’aggravation des peines encourues en application des articles L. 317-4, L. 317-7 et L. 317-8 du code de la sécurité intérieure
Le I aggrave les peines encourues pour les faits pénalement sanctionnés par les articles L. 317-4, L. 317-7 et L. 317-8 du code de la sécurité intérieure.
i. L’aggravation des peines encourues pour l’acquisition, la cession ou la détention sans autorisation d’armes de catégories A et B (article L. 317-4)
Pour les faits d’acquisition, de cession ou de détention sans autorisation d’une ou de plusieurs armes de catégorie A ou B réprimés par l’article L. 317-4, le 1° porte la peine d’emprisonnement encourue de trois à cinq ans (a).
Une telle aggravation poursuit deux objectifs. D’une part, elle tient mieux compte de la gravité particulière du trouble causé à l’ordre public par ces infractions. D’autre part, elle permet, sur le plan procédural, d’appliquer à la poursuite de ces infractions deux moyens d’enquête susceptibles de renforcer l’efficacité de leur répression :
– le régime dérogatoire de la perquisition sans l’assentiment de la personne concernée au cours d’une enquête préliminaire prévu par l’avant-dernier alinéa de l’article 76 du code de procédure pénale, qui réserve cette possibilité aux « nécessités de l’enquête relative à un crime ou à un délit puni d’une peine d’emprisonnement d’une durée égale ou supérieure à cinq ans » ;
– la mise en œuvre d’une mesure de géolocalisation en application du 2° de l’article 230-32 du même code, aux termes duquel « [i]l peut être recouru à tout moyen technique destiné à la localisation en temps réel, sur l’ensemble du territoire national, d’une personne, à l’insu de celle-ci, d’un véhicule ou de tout autre objet, sans le consentement de son propriétaire ou de son possesseur, si cette opération est exigée par les nécessités (…) [d]’une enquête ou d’une instruction relative à un crime ou à un délit (…) puni d’un emprisonnement d’au moins cinq ans ».
Par cohérence avec cette aggravation de la peine d’emprisonnement, la peine d’amende encourue est augmentée de 45 000 à 75 000 euros afin de respecter l’échelle des peines applicables à des délits similaires.
Par ailleurs, pour la même infraction, la peine d’emprisonnement encourue est portée de cinq à sept ans lorsque la personne qui s’est rendue coupable de ces faits a été antérieurement condamnée à l’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit (b).
ii. L’extension de l’infraction relative à l’acquisition ou à la détention d’armes en violation d’une interdiction (article L. 317-5)
Le 2° étend le champ de l’infraction pénale relative à l’acquisition ou la détention d’armes et de munitions en violation d’une interdiction prévue par l’article L. 317-5 du code de la sécurité intérieure aux personnes ayant fait l’objet d’une condamnation judiciaire en application de la nouvelle rédaction de l’article L. 312-1 du même code.
iii. L’aggravation des peines encourues pour la détention d’un dépôt d’armes ou de munitions (article L. 317-7)
Pour les faits de détention d’un dépôt d’armes ou de munitions de catégorie A, B ou D punis d’une peine d’emprisonnement de cinq ans par le premier alinéa de l’article L. 317-7, le 3° augmente la peine d’amende encourue de 3 750 à 75 000 euros.
Cette augmentation permet d’aligner le montant de l’amende encourue pour des faits de gravité comparable punis d’une peine d’emprisonnement de cinq ans. À titre d’exemple, sont punis de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende la vente ou l’achat irréguliers des matériels de guerre, armes et munitions et la cession ou vente de matériels de guerre, armes et munitions à un mineur (article L. 317-2), la modification des marquages, poinçons, numéros de série, emblèmes ou signes apposés ou intégrés sur des matériels ou armes nécessaires à leur identification de manière certaine ainsi que la détention, l’acquisition, la vente ou le transport, en connaissance de cause, d’une arme ainsi modifiée (articles L. 317-7-1 et L. 317-7-2) ou encore le port ou transport, sans motif légitime, de matériels de guerre ou d’armes ou de munitions de catégorie A ou B (article L. 317-8).
iv. L’aggravation des peines encourues pour le port ou transport d’armes sans motif légitime (article L. 317-8)
Le 4° complète l’article L. 317-8, qui réprime notamment le port ou le transport, sans motif légitime, de matériels de guerre, d’armes ou de munitions, par un nouvel alinéa instituant une circonstance aggravante pour les faits de port ou de transport, sans motif légitime, de matériels de guerre ou d’armes ou de munitions de catégorie A ou B. Afin de réprimer plus sévèrement une personne qui a déjà fait la preuve de sa dangerosité, il prévoit ainsi que lorsque ces faits auront été commis par une personne antérieurement condamnée « pour un ou plusieurs crimes ou délits mentionnés à l’article 706-73 et 706-73-1 du code de procédure pénale à une peine égale ou supérieure à un an d’emprisonnement ferme ou à une peine plus grave », la peine d’emprisonnement de cinq ans sera portée à dix ans.
Est ainsi rétablie la circonstance aggravante qui existait avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2013-518 du 20 juin 2013 modifiant certaines dispositions du code de la sécurité intérieure et du code de la défense (parties législatives) relatives aux armes et munitions, afin de réprimer plus sévèrement le port d’armes par une personne notoirement dangereuse. Ainsi, selon le Gouvernement, avant l’entrée en vigueur de cette ordonnance, les infractions de port d’armes aggravées par les antécédents judiciaires de leur auteur avaient donné lieu à une trentaine de condamnations par an entre 2010 et 2013. Il s’agissait fréquemment de personnes en possession d’armes appartenant au grand banditisme.
b. L’aggravation de la répression des faits d’importation ou de transfert, sans autorisation, de matériels de catégorie A, B, C ou D
Le II du présent article complète l’article L. 2339-10 du code de la défense qui punit de cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de 9 000 euros le délit – ou sa tentative – d’« importation, sans autorisation, des matériels des catégories A, B, C et D figurant sur une liste fixée par un décret en Conseil d’État » et de dix ans d’emprisonnement et d’une amende de 500 000 euros le même délit – ou sa tentative – commis en bande organisée.
Afin de mettre à niveau le montant de l’amende en fonction de la peine d’emprisonnement encourue, le 1° porte de 9 000 à 75 000 euros la peine d’amende susceptible d’être prononcée pour de tels faits lorsqu’ils n’ont pas été commis en bande organisée. Comme précédemment, cette augmentation permet d’aligner le montant de l’amende encourue pour des faits de gravité comparable punis d’une peine d’emprisonnement de cinq ans en application des articles L. 317-2, L. 317-7-1, L. 317-7-2 et L. 317-8 du code de la sécurité intérieure et L. 2339-3, L. 2339-11 et L. 2339-11-1 du code de la défense.
Par ailleurs, le 2° complète le même article L. 2339-10 qui ne réprime que l’importation sans autorisation, afin de sanctionner pénalement des mêmes peines le transfert de certaines armes, munitions et de leurs éléments ne relevant pas de la catégorie A2 sans l’autorisation préalable spécifique prévue par le I de l’article L. 2335-17 du code de la défense.
*
* *
La Commission adopte l’amendement rédactionnel CL289, l’amendement de simplification CL290 et l’amendement de coordination CL291 du rapporteur.
Puis elle adopte l’article 9 modifié.
Article 10
(art. 67 bis et 67 bis-1 du code des douanes)
Extension de certaines techniques spéciales d’enquête
des douanes au trafic d’arme (infiltration et « coup d’achat »)
Dans le souci de confier des moyens d’investigation homogènes et comparables à l’ensemble des services de l’État appelés à connaître de la délinquance organisée et d’infractions liées au terrorisme, le présent article a pour objet d’étendre au trafic d’armes les opérations d’infiltration et de « coup d’achat » déjà conduites dans certains domaines par les douanes, très activement impliquées dans le démantèlement des filières de fraude aux armes.
1. L’utilisation par les douanes des opérations d’infiltration et de la technique du « coup d’achat »
a. Les opérations d’infiltration
L’article 67 bis du code des douanes fixe le régime dit des « livraisons surveillées », c’est-à-dire les procédures de surveillance et d’infiltration que peuvent mettre en œuvre les douaniers dans l’exercice de leurs missions. Ce régime, instauré par la loi n° 91-1264 du 19 décembre 1991 relative au renforcement de la lutte contre le trafic de stupéfiants, a été complété par la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, dite loi « Perben II », afin de l’aligner sur celui prévu en matière de criminalité et de délinquance organisées pour la police judiciaire.
En vertu du II de cet article, les agents des douanes spécialement habilités peuvent réaliser, sur autorisation du procureur de la République et sous son contrôle, des opérations d’infiltration afin de « surveiller des personnes suspectées de commettre un délit douanier en se faisant passer, auprès de ces personnes, comme un de leurs coauteurs, complices ou intéressés à la fraude ». À cette fin, ils peuvent être autorisés « à faire usage d’une identité d’emprunt et à commettre si nécessaire » des actes qui constituent des infractions sans être pénalement responsables de ces infractions, ces actes ne pouvant constituer une incitation à commettre des infractions, « à peine de nullité ».
En l’état du droit, ces opérations ne sont autorisées que pour constater les infractions énumérées ci-après, identifier les auteurs et complices de ces infractions ainsi que ceux qui y ont participé comme intéressés et effectuer les saisies afférentes :
– les infractions douanières d’importation, d’exportation ou de détention de substances ou plantes classées comme stupéfiants, de contrebande de tabac manufacturé, d’alcool et de spiritueux (1°) ;
– les infractions douanières réprimées par l’article 414 du même code, caractérisées par des faits de contrebande ainsi que par tout fait d’importation ou d’exportation sans déclaration lorsque ces infractions se rapportent à des marchandises contrefaisantes, en particulier les contrefaçons de marque, de dessins et modèles et de tous les droits de propriété intellectuelle (133) (droit d’auteur, droits voisins, brevet, certificats d’obtention végétale, indications géographiques…) (2°) ;
– les infractions douanières en matière d’opérations financières entre la France et l’étranger portant sur des fonds provenant d’un délit douanier ou d’une infraction à la législation sur les stupéfiants, en application de l’article 415 du même code (3°).
Les opérations d’infiltration autorisées sont celles mentionnées au III de l’article 67 bis précité, c’est-à-dire l’acquisition, la détention, le transport ou la livraison de substances, biens, produits, documents ou informations tirés de la commission des infractions (a) ainsi que l’utilisation ou la mise à disposition des personnes se livrant à ces infractions « des moyens de caractère juridique ainsi que des moyens de transport, de dépôt, d’hébergement, de conservation et de télécommunication » (b).
Le régime juridique auquel sont soumises ces opérations, précisément défini aux IV à IX du même article, est très proche de celui qui s’applique aux opérations d’infiltration menées dans le cadre de la lutte contre la criminalité et la délinquance organisées (modalités de délivrance de l’autorisation, durée des opérations, conditions de témoignage des agents infiltrés…) (134).
b. La pratique du « coup d’achat »
La pratique dite du « coup d’achat » permet à certains agents des douanes d’acquérir des produits illicites ou d’aider des personnes se livrant au trafic de tels produits, comme la sollicitation d’un vendeur de produits contrefaits afin de constituer le délit de commercialisation de produits contrefaisants, tout en bénéficiant d’une exonération de responsabilité pénale. Une telle technique est déjà utilisée par la police judiciaire en matière de trafic de stupéfiants (135) et pourra l’être, en vertu de l’article 8 du projet de loi, en matière de trafic d’armes (136).
En matière douanière, cette technique a été autorisée par la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure et a vu son domaine d’application étendu successivement en 2012 (137) et 2014 (138). En l’état actuel de l’article 67 bis-1 du code des douanes qui en conditionne le recours, elle s’applique :
– « aux seules fins de constater l’infraction d’importation, d’exportation ou de détention de produits stupéfiants, d’en identifier les auteurs et complices ainsi que ceux qui y ont participé comme intéressés au sens de l’article 399 [ceux qui ont un intérêt direct à la fraude, qui y ont coopéré d’une manière quelconque ou qui ont couvert les agissements des fraudeurs] et d’effectuer les saisies prévues par le présent code » (premier alinéa) ;
– ainsi qu’« aux fins de constatation de l’infraction d’importation, d’exportation ou de détention illicite de tabac manufacturé et de marchandises présentées sous une marque contrefaisante ou incorporant un dessin ou modèle (…) sur des marchandises contrefaisant un droit d’auteur, des droits voisins ou un brevet tels que mentionnés aux articles L. 335-2 à L. 335-4, L. 613-3 et L. 613-5 du code de la propriété intellectuelle » (dernier alinéa).
Trois types de techniques sont autorisés par cet article :
– en premier lieu l’acquisition de produits stupéfiants (1°) ;
– en deuxième lieu, en vue de l’acquisition de produits stupéfiants, la mise à disposition des personnes se livrant à ces infractions « des moyens de caractère juridique ou financier ainsi que des moyens de transport, de dépôt, d’hébergement, de conservation et de télécommunication » (2°) ;
– en troisième lieu, « [l]orsque l’infraction est commise en ayant recours à un moyen de communication électronique », l’usage d’une identité d’emprunt en vue de l’acquisition des produits stupéfiants ainsi que le recours à plusieurs techniques de « cyberpatrouille » : la participation sous un pseudonyme à des échanges électroniques, la mise en contact sous ce pseudonyme avec les personnes susceptibles d’être les auteurs de l’infraction, l’extraction, l’acquisition sous ce pseudonyme ou la conservation des données relatives aux personnes susceptibles d’être les auteurs de l’infraction ainsi qu’aux comptes bancaires utilisés (3°).
Comme en matière d’infiltration, cette technique ne peut être mise en œuvre que par des agents des douanes habilités à cet effet après autorisation du procureur de la République, donnée par tout moyen. « À peine de nullité », l’autorisation doit être mentionnée ou versée au dossier de la procédure et « les actes autorisés ne peuvent constituer une incitation à commettre une infraction ».
2. L’extension de ces techniques à la lutte douanière contre le trafic d’armes
Le présent article étend ces deux moyens spéciaux d’investigation à la lutte contre le trafic d’armes à laquelle participent activement les douanes au titre de leurs missions, en particulier par l’intermédiaire de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières.
À titre indicatif, la douane avait ainsi saisi, en 2014, près de 830 armes à feu et 67 850 munitions, soit une quantité équivalente à celle qui avait été saisie en 2013 (139). Selon le Gouvernement, les saisies d’armes et de munitions réalisées par les douanes durant l’année 2015 pourraient être sensiblement supérieures.
Le présent article ne modifie pas le régime juridique auquel les services douaniers sont soumis, lequel continuera donc de présenter les mêmes garanties que celles aujourd’hui applicables, en particulier quant à l’autorisation des opérations par le procureur de la République et le champ des actions susceptibles d’être réalisées par les agents sans que leur responsabilité pénale puisse être engagée, qui excluent toute incitation à la commission d’infraction.
Le 1° complète le 1° du II de l’article 67 bis précité, relatif aux opérations d’infiltration douanières, afin d’ajouter à la liste des infractions dont le constat justifie la mise en œuvre de telles opérations les infractions douanières réprimées par l’article 414 du code des douanes, caractérisées par des faits de contrebande ainsi que par tout fait d’importation ou d’exportation sans déclaration lorsque ces infractions se rapportent à des armes à feu, leurs éléments, des munitions ou des explosifs, et pas seulement lorsqu’elles portent sur des marchandises contrefaisantes.
Le 2° étend, au dernier alinéa de l’article 67 bis-1 précité, la technique du « coup d’achat » à la constatation de l’infraction d’importation, d’exportation ou de détention illicite « d’armes à feu, de leurs éléments, des munitions ou d’explosifs », et pas seulement à l’importation, l’exportation ou la détention illicite de tabac manufacturé et de marchandises contrefaisantes.
Grâce au présent article, qui constitue le pendant douanier des compétences reconnues à la police judiciaire en matière d’infiltration – déjà autorisée pour la criminalité et la délinquance organisées, dont relèvent les infractions relatives au trafic d’armes (140) – et de celles qui lui sont confiées par l’article 8 du projet de loi en matière de technique de « coup d’achat », la France dote ses services enquêteurs, judiciaires comme douaniers, de moyens d’investigation complets et adaptés aux enjeux soulevés par la lutte contre le trafic d’armes.
*
* *
La Commission adopte les amendements rédactionnels CL292 et CL293 du rapporteur.
Puis elle adopte l’article 10 modifié.
Article 11
(art. 113-2-1 [nouveau] du code pénal et art. 43, 52, 382 et 706-73-1 du code de procédure pénale)
Modification des règles de compétence des juridictions
en matière de « cybercriminalité »
Le présent article vise à apporter une réponse pénale plus effective et adaptée aux infractions commises sur un réseau de communications électroniques, autrement appelées « cybercriminalité ». D’une part, il précise les règles de compétences territoriale et juridictionnelle qui s’appliquent à la poursuite et au jugement de ces infractions. D’autre part, il étend les règles de compétence et de procédure particulières applicables en matière de criminalité et de délinquance organisées aux délits d’atteintes aux systèmes informatiques commis en bande organisée.
1. L’instauration de nouvelles règles de compétences territoriale et juridictionnelle, mieux adaptées à la « cybercriminalité »
Les infractions réalisées par l’intermédiaire des réseaux de communications électroniques, par définition commises à distance et, le plus souvent, depuis l’étranger, soulèvent des problèmes spécifiques de compétence des juridictions françaises – et des juridictions françaises entre elles – pour les poursuivre et les juger, notamment parce que le domicile ou la résidence de la victime ne sont jamais un critère de compétence dans notre droit.
a. La compétence territoriale des juridictions françaises à l’égard des cyber-infractions
i. Le droit en vigueur
En l’état du droit, les conditions de l’application de la loi pénale dans l’espace sont fixées par les articles 113-1 à 113-13 du code pénal, complétés par les articles 689 à 689-13 du code de procédure pénale. En principe applicable aux « infractions commises sur le territoire de la République », c’est-à-dire « dès lors qu’un de [leurs] faits constitutifs [ont] eu lieu sur ce territoire » (article 113-2 du code pénal), la loi pénale est également « applicable à tout crime commis par un Français hors du territoire de la République » et à tous les délits « si les faits sont punis par la législation du pays où ils ont été commis » (article 113-6 du même code). Par ailleurs, l’article 113-7 du même code donne compétence aux juridictions françaises en cas de crime, ou de délit puni d’emprisonnement, « commis par un Français ou par un étranger hors du territoire de la République lorsque la victime est de nationalité française au moment de l’infraction ».
Toutefois, les délits commis à l’étranger à l’encontre d’une victime française ne peuvent être poursuivis en France qu’à la requête du ministère public, « précédée d’une plainte de la victime ou de ses ayants droit ou d’une dénonciation officielle par l’autorité du pays où le fait a été commis », conformément à l’article 113-8 du même code.
Dans son rapport remis en février 2014 intitulé Protéger les internautes, le groupe de travail interministériel sur la lutte contre la cybercriminalité, présidé par le procureur général Marc Robert, considérait que ces règles posaient problème au regard de l’effectivité de la réponse pénale apportée aux cyber-infractions, en raison notamment de la nécessité d’une plainte préalable, des difficultés de détermination du lieu de commission de l’infraction et des difficultés d’interprétation soulevées par ces articles (voir l’encadré ci-après).
Les problèmes de compétence territoriale soulevés par la « cybercriminalité »
(extraits du rapport Protéger les internautes)
« [S]i l’on se place au plan de la victime, dès lors qu’il y a plainte d’une personne de nationalité française pour un crime ou un délit puni d’emprisonnement et cela même si le lieu de commission de l’infraction est extérieur au territoire français - ce qui n’est pas une hypothèse d’école en matière de cybercriminalité -, la loi française est applicable.
« Toutefois, la plainte préalable est rare dans certains types d’affaires.
« Or, et sauf exception tenant à la nature de la cyber-infraction, il est le plus souvent peu aisé de déterminer son lieu de commission, compte tenu des difficultés tenant à l’identification de la personne ou de la société en cause, notamment lorsque l’auteur utilise des ordinateurs “rebonds” (VPN ou proxy) donnant dans un premier temps une fausse indication quant à l’adresse IP de l’ordinateur responsable de l’attaque ; quant à la localisation du serveur informatique utilisé par l’auteur, il est difficile dans les premiers temps d’une enquête de déterminer, avec exactitude, sa localisation, d’autant plus qu’elle s’avère souvent évolutive.
« En outre, il n’est pas toujours possible de trouver un élément constitutif commis en France pour fonder la compétence de la loi nationale.
« Dès lors, les praticiens se heurtent à des difficultés d’interprétation et leurs interrogations sont nombreuses (…).
« Même si la jurisprudence adopte, généralement, une conception extensive, en retenant ordinairement la compétence des juridictions françaises dès lors que les contenus illicites diffusés via Internet sont accessibles en France, des doutes subsistent encore pour d’autres infractions, notamment la contrefaçon.
« Telle est la raison pour laquelle il est estimé opportun, eu égard à la spécificité de cette criminalité, de lever toute équivoque en préconisant un nouveau critère de compétence. »
Source : Groupe de travail interministériel sur la lutte contre la cybercriminalité, Protéger les internautes. Rapport sur la cybercriminalité, La Documentation française, février 2014, pp. 210-211.
ii. La création d’un nouveau critère de compétence territoriale lorsque la victime de la cyber-infraction est domiciliée en France
Le rapport sur la « cybercriminalité » précité recommandait donc de « [c]réer (…) un nouveau cas de compétence des juridictions pénales françaises, en énonçant que toute infraction commise par le biais d’un réseau de communication électronique, de nature criminelle ou de nature correctionnelle mais punissable d’un emprisonnement, lorsqu’elle est tentée ou commise au préjudice d’une personne, physique ou morale, de nationalité française au moment de sa commission, est réputée avoir été commise en France » (141).
Traduction législative de cette recommandation, le I du présent article prévoit la compétence des juridictions françaises lorsque la victime d’une infraction commise sur un réseau de communications électroniques, personne morale ou physique, est domiciliée en France.
À cette fin, il insère, au chapitre III du titre Ier du livre Ier du code pénal, un nouvel article 113-2-1 aux termes duquel « [t]out crime ou tout délit réalisé par le biais d’un réseau de communication électronique, lorsqu’il est tenté ou commis au préjudice d’une personne physique résidant en France ou d’une personne morale dont le siège se trouve en France, est réputé commis en France ».
Dans ces conditions, les juridictions françaises pourraient se déclarer compétentes pour toutes les infractions commises sur internet, même en dehors du territoire de la République française, dès lors qu’elles concerneraient une victime résidant en France, sans qu’il soit nécessaire qu’elles aient reçu la plainte préalable de cette dernière.
b. La compétence des juridictions françaises entre elles à l’égard de la « cybercriminalité »
i. Le droit en vigueur
Les articles 43, 52 et 382 du code de procédure pénale déterminent la compétence juridictionnelle respective du procureur de la République, du juge d’instruction et du tribunal correctionnel. Il peut s’agir :
– du lieu de l’infraction ;
– du lieu de la résidence de l’une des personnes soupçonnées d’avoir participé à l’infraction ;
– du lieu d’arrestation d’une de ces personnes, même lorsque cette arrestation a été opérée pour une autre cause ;
– et du lieu de détention d’une de ces personnes, même lorsque cette détention est effectuée pour une autre cause.
Ces règles ne soulèvent pas de difficulté lorsque la cyber-infraction est constatée en flagrance ou après l’identification de son auteur et de son domicile par le parquet, comme dans le cas de détention d’images pédopornographiques : si l’auteur est domicilié en France, le parquet compétent sera celui du lieu où il réside. En revanche, ces critères peuvent ne pas suffire à déterminer la compétence précise des juridictions pour certaines infractions réalisées par internet lorsqu’il n’est pas possible de déterminer le lieu de leur commission et lorsque le lieu de résidence de leur auteur est difficile à déterminer.
Comme le soulignait, en 2014, le rapport précité de M. Marc Robert consacré à la « cybercriminalité », « dans la grande majorité des cas, le parquet est saisi d’une cyber-infraction soit par plainte, soit par dénonciation (par exemple d’un professionnel), sans que l’on connaisse ordinairement l’identité de l’auteur supposé et, a fortiori, son lieu de résidence ». Dans cette hypothèse, seul le critère du lieu de commission de l’infraction peut fonder la compétence d’une juridiction. « Or, si les infractions dites de presse peuvent être souvent considérées comme étant commises sur l’ensemble du territoire (lieu de diffusion d’internet), si, selon la nature de certaines infractions, partie des éléments constitutifs sont commis dans un lieu donné (par exemple au siège de l’entreprise victime, ou le lieu de livraison en matière de vente à distance), si la compétence spéciale reconnue, pour certaines infractions, à la juridiction parisienne ou aux juridictions inter-régionales spécialisées est aussi attributive de compétence, le critère de compétence de droit commun lié au lieu de commission peut s’avérer impuissant à saisir la cyber-infraction » (142).
ii. La création d’un nouveau critère de compétence du parquet, du juge d’instruction et du tribunal correctionnel en raison du domicile ou du siège social de la victime
Le groupe de travail présidé par M. Marc Robert préconisait donc de créer un nouveau critère de compétence territoriale relatif à la localisation de la victime de la cyber-infraction, afin de renforcer la sécurité des procédures ouvertes et faciliter le travail des services d’enquête et des parquets.
Tel est l’objet des II à IV du présent article qui traduisent dans notre droit cette préconisation en complétant les articles 43, 52 et 382 précités afin de rendre également compétents le procureur de la République, le juge d’instruction et le tribunal correctionnel « du domicile de la victime personne physique ou du siège social de la personne morale victime, lorsque l’infraction a été réalisée par le biais d’un réseau de communication électronique ».
En définitive, la clarification des règles de compétence territoriale et juridictionnelle à laquelle procède le présent article en matière de « cybercriminalité », qui constitue un contentieux de masse, contribuera à en faciliter matériellement et à en sécuriser juridiquement le traitement, en évitant notamment les dessaisissements successifs des parquets liés à l’absence de critère clair de compétence.
Auditionnés par votre rapporteur, M. François Molins, procureur de la République de Paris, et Mme Camille Hennetier, vice-procureur et chef de la section antiterroriste au tribunal de grande instance de Paris, ont ainsi salué la consécration législative du critère de compétence jusqu’alors jurisprudentiel du domicile de la victime de l’infraction, retenu en particulier par un arrêt de la chambre de l’instruction de Paris du 3 mai 2008 et auquel la section cybercriminalité du tribunal de grande instance de Paris a fréquemment recours en raison des sièges à Paris de grandes sociétés et d’administrations centrales.
2. L’extension des règles de compétence et de procédure de la criminalité organisée applicables aux atteintes les plus graves contre les systèmes informatiques
a. Certaines atteintes aux systèmes informatiques sont déjà soumises à une partie du régime procédural dérogatoire applicable à la criminalité et à la délinquance organisées
Depuis la loi n° 2014-1353 du 13 novembre 2014 renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme, le « cyberterrorisme », qui consiste en des atteintes à la disponibilité des réseaux ou des services informatiques des administrations ou d’opérateurs importants ainsi qu’à la confidentialité ou à l’intégrité des données qui y sont stockées ou des matériels utilisés pour leur fonctionnement, fait l’objet de mesures de poursuites et de jugement renforcées.
Ainsi, en vertu du titre XXIV du livre IV et de l’article 706-72 du code de procédure pénale, la poursuite, l’instruction et le jugement des atteintes portées à un système de traitement automatisé de données (STAD) à caractère personnel mis en œuvre par l’État sont soumis à certaines des dispositions du régime procédural applicable à la criminalité et à la délinquance organisées, ainsi que le blanchiment de ces délits et l’association de malfaiteurs ayant pour objet leur préparation.
Les règles dérogatoires ayant vocation à s’appliquer sont les suivantes :
– sauf opposition du procureur de la République préalablement informé, la compétence des officiers de police judiciaire (OPJ) et des agents de police judiciaire (APJ) peut être étendue à l’ensemble du territoire national pour la surveillance des personnes suspectées d’avoir commis certaines infractions (article 706-80) ;
– le procureur de la République ou le juge d’instruction, lorsque les nécessités de l’enquête ou de l’instruction le justifient, peut autoriser l’organisation d’une opération d’infiltration d’un OPJ ou d’un APJ afin de « surveiller des personnes suspectées de commettre un crime ou un délit en se faisant passer, auprès de ces personnes, comme un de leurs coauteurs, complices ou receleurs » (articles 706-81 à 706-87) ;
– une enquête sous pseudonyme peut être conduite sous réserve que l’infraction ait été préparée, facilitée ou commise par un moyen de communication électronique (article 706-87-1) ;
– des écoutes téléphoniques dans le cadre d’une enquête préliminaire ou de flagrance peuvent être réalisées, sur autorisation du juge des libertés et de la détention, alors que pour les crimes et délits de droit commun cela n’est possible que dans le cadre d’une instruction (article 706-95) ;
– des sonorisations et des fixations d’images de certains lieux ou véhicules sont possibles, c’est-à-dire la mise en place d’« un dispositif technique ayant pour objet, sans le consentement des intéressés, la captation, la fixation, la transmission et l’enregistrement de paroles prononcées par une ou plusieurs personnes à titre privé ou confidentiel, dans des lieux ou véhicules privés ou publics, ou de l’image d’une ou plusieurs personnes se trouvant dans un lieu privé » (articles 706-96 à 706-102) ;
– le juge d’instruction peut autoriser la captation de données informatiques, c’est-à-dire la mise en place d’« un dispositif technique ayant pour objet, sans le consentement des intéressés, d’accéder, en tous lieux, à des données informatiques, de les enregistrer, les conserver et les transmettre, telles qu’elles s’affichent sur un écran pour l’utilisateur d’un système de traitement automatisé de données ou telles qu’il les y introduit par saisie de caractères » (articles 706-102-1 à 706-102-9) ;
– le juge des libertés et de la détention peut ordonner des mesures conservatoires sur les biens de la personne mise en examen afin de garantir le paiement des amendes encourues ainsi que l’indemnisation éventuelle des victimes (article 706-103) ;
– la personne mise en cause peut interroger le parquet sur les suites données à l’enquête six mois après son placement en garde à vue et peut, en cas de nouvelle audition ou interrogatoire, être assisté d’un avocat qui dispose d’un accès préalable à la procédure (article 706-105).
En revanche, l’application de deux règles procédurales dérogatoires est expressément exclue :
– la prolongation de la garde à vue à quatre jours en matière de criminalité organisée et six jours en matière terroriste, contre deux jours en droit commun, et la possibilité de différer l’intervention de l’avocat jusqu’à la 72e heure de la mesure (articles 706-88 et 706-88-1) ;
– les perquisitions de nuit, possibles, en droit commun, seulement entre 6 heures et 21 heures (articles 706-89 à 706-94).
b. Le cadre constitutionnel
Depuis sa décision n° 2004-492 DC du 2 mars 2004 sur la loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, le Conseil constitutionnel considère que « si le législateur peut prévoir des mesures d’investigation spéciales en vue de constater des crimes et délits d’une gravité et d’une complexité particulières, d’en rassembler les preuves et d’en rechercher les auteurs, c’est sous réserve que ces mesures soient conduites dans le respect des prérogatives de l’autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, et que les restrictions qu’elles apportent aux droits constitutionnellement garantis soient nécessaires à la manifestation de la vérité, proportionnées à la gravité et à la complexité des infractions commises et n’introduisent pas de discriminations injustifiées » (143).
En 2013, au sein de ces mesures d’investigation spéciales, il a établi un distinguo entre les mesures dérogatoires de garde à vue d’une part, applicables aux seules infractions susceptibles de porter atteinte « à la sécurité, à la dignité ou à la vie des personnes », et les autres pouvoirs spéciaux d’enquête d’autre part, qui peuvent, eux, dans la mesure où ils portent une atteinte de moindre ampleur aux libertés individuelles, être appliqués à certaines infractions graves en raison de la difficulté d’appréhender leurs auteurs. Il a ainsi jugé que la possibilité donnée par la loi relative à la lutte contre la fraude fiscale de prolonger la garde à vue jusqu’à quatre jours et de différer l’intervention de l’avocat jusqu’à la 72e heure pour les délits de corruption, de trafic d’influence et de fraude fiscale aggravée, « qui ne sont pas susceptibles de porter atteinte en eux-mêmes à la sécurité, à la dignité ou à la vie des personnes », constituait une atteinte à la liberté individuelle et aux droits de la défense « qui ne [pourrait] être regardée comme proportionnée au but poursuivi » (144).
C’est la raison pour laquelle le législateur a décidé, en 2014, de ne viser que les infractions présentant une gravité particulière – les seuls délits d’atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données (STAD) à la double condition qu’ils soient commis en bande organisée et qu’ils visent des traitements de données personnelles mis en œuvre par l’État – et de ne leur appliquer que certains pouvoirs spéciaux d’enquête, à l’exclusion notamment de la prolongation de la garde à vue et de l’intervention différée de l’avocat.
c. L’extension des règles procédurales dérogatoires applicables aux délits, commis en bande organisée, d’atteintes aux systèmes informatiques de l’État comportant des données personnelles
Le VI du présent article a pour objet d’étendre le périmètre des dispositions procédurales de la criminalité et de la délinquance organisées applicables aux atteintes, commises en bande organisée, aux STAD mis en œuvre par l’État et comportant des données personnelles, à l’exception de l’article 706-88 du code de procédure pénale relatif à la prolongation de la garde à vue à quatre jours et à la possibilité de différer l’intervention de l’avocat jusqu’à la 72e heure.
À cette fin, il complète le 1° de l’article 706-73-1 du code de procédure pénale, qui prévoit que toutes les dispositions spécifiques à la criminalité et à la délinquance organisées sont rendues applicables au délit d’escroquerie en bande organisée, à l’exception de l’article 706-88 du même code. Cet article a été introduit par le législateur en 2015 afin de créer un régime procédural spécifique, excluant expressément la prolongation de la garde à vue à quatre jours, à l’enquête, à la poursuite, à l’instruction et au jugement des délits d’escroquerie en bande organisée (145) ainsi que d’autres infractions qui ne sont pas susceptibles de porter atteinte en elles-mêmes à la sécurité, à la dignité ou à la vie des personnes.
En l’état du droit, seules les infractions suivantes sont soumises à ce régime dérogatoire :
– le délit d’escroquerie en bande organisée (1°) ;
– les délits de dissimulation d’activités ou de salariés, de recours aux services d’une personne exerçant un travail dissimulé, de marchandage de main-d’œuvre, de prêt illicite de main-d’œuvre ou d’emploi étranger sans titre de travail, commis en bande organisée (2°) ;
– les délits de blanchiment ou de recel du produit, des revenus ou des choses provenant des infractions mentionnées aux 1° et 2° (3°) ;
– les délits d’association de malfaiteurs lorsqu’ils ont pour objet la préparation de l’une des infractions mentionnées aux 1° à 3° (4°) ;
– le délit de non-justification de ressources correspondant au train de vie lorsqu’il est en relation avec l’une des infractions mentionnées aux 1° à 4° (5°).
En pratique, l’inscription de cette infraction à l’article 706-73-1 précité a pour conséquence, par rapport au droit actuel :
– d’une part, d’étendre la compétence des juridictions interrégionales spécialisées à la poursuite, à l’instruction et au jugement de ces atteintes en vertu des articles 706-75 à 706-79-1 du même code ;
– d’autre part, d’autoriser la mise en œuvre de perquisitions de nuit, entre 21 heures et 6 heures le lendemain, dans les conditions prévues par les articles 706-89 à 706-94 du même code.
Le blanchiment du délit, commis en bande organisée, d’atteinte aux STAD mis en œuvre par l’État et comportant des données personnelles ainsi que l’association de malfaiteurs ayant pour objet sa préparation seraient également soumis à cette procédure dérogatoire, en application des 3° et 4° de l’article 706-73-1.
En conséquence, le V du présent article abroge le titre XXIV du livre IV et les dispositions de l’article 706-72 du code de procédure pénale qui fixent, en l’état du droit, le régime procédural applicable à l’enquête, à la poursuite et au jugement du délit prévu par l’article 323-4-1 du code pénal et qui, par souci de rationalisation, ont davantage leur place au sein de l’article 706-73-1 précité.
3. L’extension du régime procédural de la criminalité et de la délinquance organisées au délit d’évasion commis en bande organisée
Sans que cette disposition présente un lien avec l’objet du présent article, consacré à la lutte contre la « cybercriminalité », le VI complète également le 1° de l’article 706-73-1 précité afin d’inclure le délit d’évasion commis en bande organisée prévu par l’article 434-30 du code pénal dans le périmètre des infractions soumises à l’ensemble des dispositions procédurales de la criminalité et de la délinquance organisées, à l’exception de l’article 706-88 relatif à la garde à vue prolongée.
*
* *
La Commission adopte l’amendement rédactionnel CL294, l’amendement de précision CL295 et l’amendement de clarification rédactionnelle CL296 du rapporteur.
Puis elle examine l’amendement CL184 de M. Sergio Coronado.
M. Sergio Coronado. Le délit d’atteinte aux systèmes de traitement automatisé des données commis en bande organisée, prévu à l’article 323-4-1 du code pénal, a été créé par une loi de novembre 2014, et les amendes ont été alourdies par la loi sur le renseignement. Or, l’article 706-72 du code de procédure pénale prévoit déjà que de nombreuses dispositions du titre XXV du livre IV dudit code sont applicables à ce délit, à l’exception de la garde à vue spéciale et des perquisitions de nuit.
Rien ne me semble donc justifier une troisième modification du cadre législatif en deux ans, d’autant plus que le présent projet de loi ne revient pas sur l’article 706-72 précité.
M. le rapporteur. Avis défavorable. En l’état du droit, la poursuite, le traitement et le jugement des atteintes portées aux systèmes de traitement automatisé des données à caractère personnel mis en œuvre par l’État sont déjà soumis à la plupart des règles dérogatoires applicables à la criminalité organisée, à l’exception de la compétence des juridictions interrégionales spécialisées et des perquisitions de nuit. Ce sont ces deux nouvelles règles que le présent article applique à ces infractions.
Il aligne le régime procédural dérogatoire applicable à ces atteintes informatiques sur celui qui est prévu pour toutes les infractions de gravité comparable qui figurent à l'article 706-73-1 du code de procédure pénale. Rien ne justifiait en effet de leur appliquer des règles distinctes. Je rappelle que les infractions visées sont particulièrement graves: elles relèvent du cyberterrorisme, puisqu'elles portent sur des données informatiques détenues par l'État mais relatives à la vie privée des individus.
En revanche, il demeurera impossible d'appliquer à ces infractions les règles dérogatoires de la garde à vue prolongée, qui sont réservées aux seules infractions susceptibles de porter atteinte « à la sécurité, à la dignité ou à la vie des personnes », dans le respect de la jurisprudence du Conseil constitutionnel.
Enfin, contrairement à ce que vous affirmez dans votre exposé sommaire, l’article 706-72 du code de procédure pénale, qui fixe actuellement les règles applicables à la poursuite de ces infractions, est bien abrogé par cohérence au V du présent article.
La Commission rejette l’amendement.
Elle adopte les amendements de précision CL297 et CL298 et l’amendement de coordination CL299 du rapporteur.
Puis elle adopte l’article 11 modifié.
Chapitre IV
Dispositions améliorant la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme
Article 12
(art. 421–2–7 [nouveau] du code pénal et art. 706–24–1 et 706–25–1 du code de procédure pénale)
Création d’une infraction réprimant le trafic de biens culturels émanant de théâtres d’opérations de groupements terroristes
Le présent article crée une nouvelle infraction réprimant le trafic de biens culturels émanant de théâtres d’opérations de groupements terroristes.
1. Le trafic de biens culturels
Les conflits qui ravagent aujourd’hui la zone irako–syrienne ont des conséquences dramatiques sur des patrimoines d’une valeur historique, artistique et culturelle inestimable. Le rapport de M. Jean–Luc Martinez, président–directeur du musée du Louvre, sur « la protection du patrimoine en situation de conflit armé », a établi un constat sévère de la réalité du trafic des biens culturels, qualifiés d’« antiquités du sang » :
« À l’échelle mondiale, on estime communément que le trafic illicite des biens culturels arrive au troisième ou au quatrième rang des commerces illicites dans le monde, après les armes et la drogue. Même si, comme le rappelle INTERPOL, les instruments de mesure et les chiffres sur les mouvements de circulation illicites ne sont pas disponibles, certains estiment que le seul trafic d’antiquités pourrait brasser des sommes de 6 à 15 milliards d’euros par an. » (146)
La situation est particulièrement dramatique dans les zones qui sont le théâtre d’opérations de groupements terroristes. À propos de l’Irak et la Syrie, certains chiffres estiment que le trafic des antiquités pourrait représenter entre 1 % et jusqu’à 15 à 20 % des ressources de Daech, ce qui en ferait le deuxième mode de financement de cette organisation terroriste, après les ressources pétrolières. Comme le souligne le rapport précité, Daech a créé un département des antiquités « Diwan al Rikaz » chargé de délivrer des permis de fouilles contre le versement de « dîmes » imposées aux fouilleurs. Surtout, il est certain que les principaux sites de Syrie et d’Irak font l’objet d’un nombre incalculable de fouilles sauvages. Ainsi, « les photos satellites révèlent des sites constellés de trous (on les estime à plus de 10 000 sur le site d’Apamée en Syrie), semblables aux trous d’obus de la Première Guerre mondiale. Daech a probablement récupéré les plus belles pièces du musée de Raqah (en plus de celles volées dans les musées en Irak) pour les revendre à des trafiquants qui bénéficient de réseaux parfaitement organisés et qui existaient bien avant l’apparition de Daech. » (147)
Principaux cas récents de destruction et de pillage du patrimoine culturel
dans les pays en situation de conflit armé
Mali
Au printemps 2012, sept des douze mausolées de saints soufis de Tombouctou ont été détruits par le groupe Ansar Dine aux motifs qu’ils étaient la matérialisation de formes perverties de l’Islam véritable. Des bibliothèques furent également détruites et pillées. Un des chefs de ce groupe a comparu pour crime de guerre pour destruction de ces mausolées devant la Cour pénale internationale le 30 septembre 2015.
Irak
Le patrimoine muséal, archéologique et monumental en Irak a subi des destructions majeures au cours de la dernière décennie. En 2003, le musée national de Bagdad a été pillé par des réseaux criminels organisés, qui ont également vandalisé l’inventaire informatisé. Le musée a depuis récupéré une partie de ses œuvres.
Depuis la prise de Mossoul en 2014, les destructions et pillages se sont succédés à un rythme effréné : destructions d’objets archéologiques au musée de Mossoul, vandalisations de sites archéologiques à Hatra, Uruk et Nimroud…
Syrie
Depuis le début du conflit armé, de nombreux biens syriens font l’objet de bombardements ciblés, d’explosions délibérées et de fouilles illicites de grande ampleur. L’UNESCO (148) a indiqué que le conflit avait affecté six biens du patrimoine mondial en Syrie : l’ancienne ville de Damas (en particulier la mosquée des Omeyyades), l’ancienne ville de Bosra, le site archéologique de Palmyre (anéantissement à l’explosif du petit temple de Baalshamin et de l’arc de triomphe situé à l’entrée de la colonnade…), la Vallée des tombes, le Camp de Dioclétien et la ville d’Alep.
Si l’on n’observe pas encore de recrudescence du trafic d’objets en provenance de pays en guerre, en particulier de pièces importantes, il est cependant probable que ce phénomène interviendra dans les années à venir. Ce décalage s’explique par le fait que les œuvres provenant de pillages ou de fouilles clandestines transitent « par des réseaux de trafiquants expérimentés qui savent brouiller les pistes en produisant de faux documents d’authentification et en stockant les œuvres quelques années notamment dans des ports « francs » (149), le temps de leur « inventer une histoire » avant de tenter de les écouler sur le marché.» (150). Il existe donc un temps de latence relativement important entre une fouille clandestine et l’écoulement des objets sur le marché. Les États-Unis ont par exemple restitué en 2015 aux autorités irakiennes 700 objets et fragments issus de trafics illégaux, pillés lors de la guerre d’Irak en 2003.
2. Les limites des dispositifs internationaux
Plusieurs instruments internationaux ont été élaborés dans le but de prévenir et d’interdire les actes de pillage et de trafic de biens culturels :
– les conventions UNESCO de 1970 concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l’importation, l’exportation et le transfert de propriété des biens culturels, de 1972 pour la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel, de 2000 contre la criminalité transnationale organisée, de 2003 pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel ;
– la convention UNIDROIT de 1995 sur les biens culturels volés ou illicitement exportés ;
– la convention de l’Organisation des Nations Unies (ONU) de 2000 contre la criminalité transnationale organisée.
La protection du patrimoine et la lutte contre les trafics ont par ailleurs fait l’objet de plusieurs résolutions de l’ONU et de l’UNESCO. Ainsi, le Conseil de sécurité de l’ONU a intégré la protection du patrimoine culturel au mandat de la mission de la paix au Mali (MINUSMA) (151). Le Conseil de sécurité a également adopté une résolution condamnant en particulier les destructions du patrimoine culturel irakien et syrien et dénonçant le pillage et la contrebande d’objets (152).
Pourtant, le rapport précité de M. Jean–Luc Martinez a identifié quatre freins à ces dispositifs :
– le principe de souveraineté des États, ces traités ne s’appliquant qu’aux États les ayant ratifiés ;
– la dispersion des initiatives ;
– la difficulté de dépasser le stade de la condamnation et de mettre en place des mesures concrètes ;
– un contexte international de plus en plus complexe avec des États qui ne contrôlent plus l’intégrité de leur territoire, une vaste zone étant sous l’emprise d’une organisation terroriste.
3. Un arsenal juridique national en évolution : les apports du projet de loi relatif à la liberté de création, à l’architecture et au patrimoine
Le projet de loi relatif à la liberté de création, à l’architecture et au patrimoine, voté en première lecture par l’Assemblée nationale le 6 octobre 2015 et par le Sénat le 16 février 2016, comporte un article 18 B tendant à renforcer la législation en matière de lutte contre la circulation illicite des biens culturels.
Il crée une faculté de contrôle douanier à l’importation spécifique pour les biens culturels, alors qu’en l’état du droit, les contrôles exercés en France sur les mouvements internationaux de biens culturels sont orientés vers l’exportation, principalement par souci de protection du patrimoine national. L’introduction d’un contrôle à l’importation doit permettre à la France de se conformer pleinement à ses engagements internationaux, en particulier à la convention de l’UNESCO du 17 novembre 1970 concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l’importation, l’exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels.
Il vise par ailleurs à interdire la circulation de biens culturels ayant quitté illicitement un État lorsqu’une résolution du Conseil de sécurité de l’ONU a été prise en ce sens. Seront ainsi concernés les biens culturels irakiens et syriens enlevés illégalement d’Irak depuis le 6 août 1990 et de Syrie depuis le 15 mars 2011, conformément à l’article 17 de la résolution 2199 du Conseil de sécurité des Nations unies.
Il crée en France des refuges pour les biens culturels menacés, en prévoyant la possibilité de mise à disposition de locaux sécurisés pour recevoir en dépôt les biens culturels se trouvant dans une situation d’urgence et de grave danger en raison d’un conflit armé ou d’une catastrophe sur le territoire d’un État étranger qui les possède ou les détient.
Enfin, il institue un dispositif permettant aux propriétaires publics de biens acquis de bonne foi, mais dont il s’avérerait qu’ils ont en réalité été volés ou exportés illicitement dans un autre État partie à la convention de l’Unesco de novembre 1970 précitée, de demander au juge judiciaire l’annulation du contrat ou du legs par lequel ils en ont fait l’acquisition.
4. La création d’une infraction réprimant le trafic de biens culturels émanant de théâtres d’opérations de groupements terroristes
Le I du présent article crée au sein du chapitre 1er relatif aux actes de terrorisme du titre II du livre IV du code pénal une nouvelle infraction réprimant le trafic de biens culturels émanant de « théâtres d’opérations de groupements terroristes » (153).
Aux termes du nouvel article 421–2–7 du code pénal, est puni de cinq d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende le fait d’importer, d’exporter, de faire transiter, de détenir, de vendre, d’acquérir ou d’échanger un bien culturel présentant un intérêt archéologique, artistique, historique ou scientifique en sachant qu’il provient d’un théâtre d’opérations de groupements terroristes.
Afin de respecter les principes fondamentaux du droit pénal et les règles européennes en matière de circulation des biens et marchandises, cette incrimination est précisément définie, ne visant que les biens soustraits d’un territoire qui constituait, au moment de la soustraction, un théâtre d’opérations de groupements terroristes et pour lesquels la licéité de l’origine du bien ne peut être justifiée.
Le II a pour objet d’exclure, pour l’application de cette infraction, trois des règles procédurales dérogatoires prévues en matière terroriste.
Les deux premières exclusions sont mises en œuvre par l’introduction d’une référence au délit de trafic de biens culturels provenant d’un théâtre d’opérations de groupements terroristes à l’article 706-24-1 du code de procédure pénale, qui écarte déjà l’application, pour les délits de provocation au terrorisme et d’apologie du terrorisme prévus à l’article 421-2-5 du code pénal :
– de l’article 706-88 du code de procédure pénale, qui permet de prolonger la garde à vue jusqu’à quatre jours et de différer l’intervention de l’avocat jusqu’à la soixante-douzième heure en matière de criminalité organisée et, par conséquent, en matière de terrorisme ;
– des articles 706-89 à 706-94 du même code, qui autorisent les perquisitions de nuit.
La troisième règle dont l’application est écartée est celle qui est prévue à l’article 706-25-1 du code de procédure pénale, qui allonge les délais de prescription de l’action publique et des peines à vingt ans pour les délits terroristes.
Les règles procédurales dérogatoires prévues en matière terroriste
Le titre XV du livre IV du code de procédure pénale, intitulé « De la poursuite, de l’instruction et du jugement des actes de terrorisme », et le titre XXV de ce même livre, intitulé « De la procédure applicable à la criminalité et à la délinquance organisée », soumettent les infractions terroristes prévues aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal à un certain nombre de règles dérogatoires par rapport aux règles générales de la procédure pénale.
Les principales règles dérogatoires sont les suivantes :
– les articles 706-17 à 706-22-1, qui confient au parquet près le tribunal de grande instance de Paris, à ce tribunal et à la cour d’assises de Paris une compétence concurrente à celle qui résulte de l’application des règles ordinaires de détermination du parquet et de la juridiction compétents ; cette compétence concurrente permet la centralisation à Paris des affaires complexes et la spécialisation des magistrats sur ce contentieux sensible ;
– l’article 706-25, qui prévoit que la cour d’assises de Paris est composée exclusivement de magistrats professionnels ;
– l’article 706-25-1, qui prévoit des règles particulières en matière de prescription : en matière terroriste, l’action publique des crimes et des délits se prescrit, respectivement, par trente et vingt ans, au lieu de dix et trois ans en droit commun ; les peines prononcées pour ces crimes et délits se prescrivent, respectivement, par trente et vingt ans, au lieu de vingt et cinq ans en droit commun ;
– l’article 706-25-2, qui autorise les enquêtes sous pseudonyme sur internet ;
– l’article 706-80, qui permet aux enquêteurs chargés des enquêtes en matière terroriste d’étendre à l’ensemble du territoire national la surveillance des personnes soupçonnées d’actes de terrorisme ;
– les articles 706-81 à 706-87, qui autorisent le recours à l’infiltration, technique spéciale d’enquête consistant, pour un enquêteur, à « surveiller des personnes suspectées de commettre un crime ou un délit en se faisant passer, auprès de ces personnes, comme un de leurs coauteurs, complices ou receleurs » ;
– les articles 706-88 et 706-88-1, qui permettent de prolonger la durée de la garde à vue jusqu’à six jours, contre deux en droit commun et quatre en matière de criminalité organisée, et de différer l’intervention de l’avocat jusqu’à la soixante-douzième heure ;
– les articles 706-89 à 706-94, qui autorisent les perquisitions de nuit, alors qu’en droit commun les perquisitions ne sont possibles qu’entre 6 heures et 21 heures ;
– l’article 706-95, qui permet de procéder à des écoutes téléphoniques dans le cadre d’une enquête préliminaire ou de flagrance, sur autorisation du juge des libertés et de la détention, alors que pour les crimes et délits de droit commun le recours aux écoutes n’est possible que dans le cadre d’une instruction ;
– les articles 706-96 à 706-102, qui autorisent le recours aux sonorisations et aux fixations d’images de certains lieux ou véhicules, technique d’enquête consistant à « mettre en place un dispositif technique ayant pour objet, sans le consentement des intéressés, la captation, la fixation, la transmission et l’enregistrement de paroles prononcées par une ou plusieurs personnes à titre privé ou confidentiel, dans des lieux ou véhicules privés ou publics, ou de l’image d’une ou plusieurs personnes se trouvant dans un lieu privé » ;
– les articles 706-102-1 à 706-102-9, qui permettent la captation de données informatiques par la mise en place d’« un dispositif technique ayant pour objet, sans le consentement des intéressés, d’accéder, en tous lieux, à des données informatiques, de les enregistrer, les conserver et les transmettre, telles qu’elles s’affichent sur un écran pour l’utilisateur d’un système de traitement automatisé de données ou telles qu’il les y introduit par saisie de caractères » ;
– enfin, l’article 706-103, qui rend possible le prononcé de mesures conservatoires sur les biens des personnes soupçonnées d’actes de terrorisme, afin de « garantir le paiement des amendes encourues ainsi que, le cas échéant, l’indemnisation des victimes ».
Cette triple exclusion est justifiée par le fait que l’application des règles précitées à des délits qui, bien qu’ils deviennent des délits de nature terroriste, sont fondés sur un élément matériel constitué par un trafic qui n’est pas susceptible de porter atteinte en lui–même à la sécurité, à la dignité ou à la vie des personnes, soulèverait vraisemblablement des difficultés constitutionnelles au regard de la nécessaire proportionnalité que doit respecter le législateur entre la gravité et la complexité des infractions commises et les mesures d’enquêtes mises en œuvre pour rechercher et condamner leurs auteurs.
Dans sa décision n° 2004–492 DC du 2 mars 2004 sur la loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, le Conseil constitutionnel a énoncé que « le législateur tient de l’article 34 de la Constitution, ainsi que du principe de légalité des délits et des peines, l’obligation de fixer lui-même le champ d’application de la loi pénale et de définir les crimes et délits en termes suffisamment clairs et précis ; que cette exigence s’impose non seulement pour exclure l’arbitraire dans le prononcé des peines, mais encore pour éviter une rigueur non nécessaire lors de la recherche des auteurs d’infractions » (154). En conséquence, il a considéré que « si le législateur peut prévoir des mesures d’investigation spéciales en vue de constater des crimes et délits d’une gravité et d’une complexité particulières, d’en rassembler les preuves et d’en rechercher les auteurs, c’est sous réserve que (…) les restrictions qu’elles apportent aux droits constitutionnellement garantis soient nécessaires à la manifestation de la vérité, proportionnées à la gravité et à la complexité des infractions commises et n’introduisent pas de discriminations injustifiées ».
Appliquant ces principes, le Conseil constitutionnel a, dans sa décision n° 2013–679 DC du 4 décembre 2013 sur la loi relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière, considéré qu’en prévoyant la possibilité de prolonger la garde à vue jusqu’à quatre jours et de différer l’intervention de l’avocat jusqu’à la soixante–douzième heure pour des délits qui n’étaient « pas susceptibles de porter atteinte en eux-mêmes à la sécurité, à la dignité ou à la vie des personnes » – en l’espèce, des délits de corruption, de trafic d’influence et de fraude fiscale aggravée – le législateur avait « permis qu’il soit porté à la liberté individuelle et aux droits de la défense une atteinte qui ne peut être regardée comme proportionnée au but poursuivi » (155).
Si le législateur appliquait aux délits de trafic de biens culturels provenant d’un théâtre d’opérations de groupements terroristes les trois règles dérogatoires prévues pour les infractions terroristes en matière de garde à vue, de perquisitions de nuit et de délai de prescription, il est probable que le Conseil constitutionnel y verrait une rigueur non nécessaire à leur répression. Il n’en va pas de même des autres règles dérogatoires précédemment décrites, qui portent aux libertés individuelles une atteinte de moindre ampleur.
5. Les modifications opérées par votre commission des Lois
À l’initiative de votre rapporteure, la Commission a adopté une précision visant à permettre l’incrimination du « transport » de biens culturels soustraits des zones d’opérations de groupements terroristes.
*
* *
La Commission est saisie de l’amendement CL241 de Mme Colette Capdevielle, rapporteure.
Mme Colette Capdevielle, rapporteure. Cet amendement vise à ajouter à l’alinéa 2 les mots « de transporter » au mot « transiter ».
La Commission adopte l’amendement.
Puis elle examine l’amendement CL185 de M. Sergio Coronado.
M. Sergio Coronado. Cet amendement vise à préciser les théâtres d’opérations concernés par le nouveau délit d’importation illégale de biens culturels afin que la liste en soit fixée par arrêté, et non par la jurisprudence.
Mme la rapporteure. Je comprends l’objectif de cet amendement, mais la définition de ces territoires a été adoptée en miroir de celle qui motive l’interdiction de sortie de territoire prévue à l’article L. 24-1 du code de la sécurité intérieure. Certes, on pourrait a priori croire nécessaire de fixer la liste des zones en question pour garantir la sécurité juridique du dispositif, mais les débats au Conseil d’État ont montré qu’il convient de conserver une certaine souplesse dans la définition de ces « théâtres d’opérations de groupements terroristes », et que ce n’est pas incompatible avec des garanties sérieuses : d’une part, la charge de la preuve repose naturellement sur l’accusation et, d’autre part, la personne poursuivie a la possibilité de prouver la licéité de l’origine du bien. Si l’amendement est maintenu, j’émettrai donc un avis défavorable.
M. Sergio Coronado. Je le maintiens : je suis d’accord pour que cette définition soit souple, mais pas aléatoire, ce qui serait le cas si elle se fondait sur la jurisprudence.
La Commission rejette l’amendement.
Puis elle adopte l’article 12 modifié.
La Commission examine les amendements identiques CL29 de M. Philippe Gosselin et CL49 de M. Pierre Morel-A-L’Huissier.
M. Philippe Gosselin. L’amendement CL29 est le premier d’une série qui porte sur le commerce illicite et le lien très souvent avéré qu’il entretient avec le terrorisme. Il faut en effet prévenir davantage la vente d’objets provenant d’actes de vol, de contrefaçon, de contrebande ou de fraude réalisée en violation de la réglementation propre à ces objets.
C’est pourquoi cet amendement vise à modifier l’article 131-21 du code pénal afin de faciliter la répression et de mieux cibler le dispositif en abaissant de cinq à trois ans d’emprisonnement le quantum de la peine au-delà de laquelle la charge de la preuve de la propriété est renversée.
M. Pierre Morel-A-L’Huissier. Le projet qui nous est soumis traite notamment des sources internationales de financement et des instruments assurant la circulation des fonds auxquels ont recours les mouvements terroristes. La lutte contre le commerce illicite passe nécessairement par des dispositifs efficaces de confiscation des biens issus du trafic. Dans plusieurs cas, la loi présume le lien entre l’infraction et le bien sur lequel porte la confiscation, de sorte que la preuve de l’origine licite de l’acquisition du bien repose sur la personne condamnée. Toutefois, dans sa rédaction actuelle, l’article 131-21 du code pénal applique ce mécanisme aux seules infractions punies d’au moins cinq ans d’emprisonnement lorsqu’elles ont procuré à leur auteur un profit direct ou indirect. L’amendement CL49 vise à assurer une plus grande efficacité répressive en l’élargissant à toutes les infractions dont la peine encourue est d’au moins trois ans d’emprisonnement.
Mme la rapporteure. Vous proposez d’élargir la peine complémentaire de confiscation à tous les délits punis d’au moins trois ans d’emprisonnement, au motif que cela permettrait d’inclure les délits de recel. Je vous rappelle néanmoins qu’en vertu de l’article 321-1 du code pénal, le recel est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende. Autrement dit, votre intention est satisfaite puisque le recel est inclus dans les infractions visées. Je vous propose donc de retirer ces amendements, faute de quoi j’y serai défavorable.
La Commission rejette les amendements.
Elle examine les amendements identiques CL45 de M. Pierre Morel-A-L’Huissier et CL111 de M. Philippe Gosselin.
M. Pierre Morel-A-L’Huissier. En droit, le commerce illicite ne fait pas l’objet d’une incrimination spécifique, ce qui semble préjudiciable à l’action des services d’enquête et à l’exercice de poursuites. L’amendement CL45 vise à y remédier.
M. Philippe Gosselin. L’amendement CL111 a le même objet : il est important de prévoir une incrimination spécifique pour le commerce illicite.
Mme la rapporteure. Avis défavorable. Vous souhaitez créer une infraction autonome de commerce illicite. Je rappelle néanmoins les termes de l’article 321-1 du code pénal : « Le recel est le fait de dissimuler, de détenir ou de transmettre une chose, ou de faire office d’intermédiaire afin de la transmettre, en sachant que cette chose provient d’un crime ou d’un délit ». La notion de recel permet déjà, selon moi, d’appréhender cette source de financement en incriminant tout à la fois la détention et la transmission des biens concernés. La vente illicite d’un objet relève bien de cette catégorie ; il n’est donc pas nécessaire de créer une nouvelle incrimination.
De surcroît, la question du commerce illicite dépasse les enjeux de lutte contre le financement du terrorisme même si, j’en conviens, il peut constituer l’une de ses sources de financement.
La Commission rejette les amendements.
Elle passe aux amendements identiques CL46 de M. Pierre Morel-À-L’Huissier et CL112 de M. Philippe Gosselin.
M. Pierre Morel-À-L’Huissier. L’amendement CL46 vise à créer une nouvelle circonstance aggravante au délit de recel prévu à l’article 321-1 du code pénal en visant expressément la vente comme une activité délictuelle. Le receleur qui revend ou qui fait commerce de produits obtenus frauduleusement encourrait ainsi une peine de dix ans d’emprisonnement et de 750 000 euros d’amende.
M. Philippe Gosselin. L’amendement CL112 a le même objet. Cette mesure présente l’avantage d’adapter la répression du délit de recel à la réalité et à la gravité des réseaux structurés qui existent, et permettrait de mieux s’attaquer à l’économie criminelle.
Mme la rapporteure. La définition que donne le code pénal du recel est suffisamment large et permet d’inclure le commerce illicite. Il paraît donc inutile de prévoir que la vente constitue un délit aggravant, puisqu’elle est l’un des éléments constitutifs du délit de recel.
La Commission rejette les amendements.
Puis elle examine les amendements identiques CL28 de M. Philippe Gosselin et CL48 de M. Pierre Morel-A-L’Huissier.
M. Philippe Gosselin. L’amendement CL28 vise à abaisser de cinq à trois ans la peine maximale encourue pour que le délit de non-justification de ressources s’applique, de sorte que de nombreuses situations délictuelles qui échappaient jusqu’à présent à la répression pourront désormais être appréhendées par la justice.
M. Pierre Morel-A-L’Huissier. L’amendement CL48 est défendu.
Mme la rapporteure. Ces amendements me semblent n’avoir qu’un rapport assez lointain avec le projet de loi, car ils ne visent pas spécifiquement des infractions qui financent le crime organisé ou le terrorisme. L’article 321-6 du code pénal punit déjà d’une peine de trois ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende le fait de ne pas pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie ou de ne pas pouvoir justifier de l’origine d’un bien détenu. Est puni des mêmes peines le fait de faciliter la justification de ressources fictives. Dès lors, il me paraît tout à fait prématuré d’aggraver comme vous le proposez les sanctions sans justification particulière, alors même que les juges ne prononcent que rarement les peines maximales.
La Commission rejette les amendements.
Elle est saisie des amendements identiques CL26 de M. Philippe Gosselin et CL52 de M. Pierre Morel-A-L’Huissier.
M. Philippe Gosselin. Pour démontrer une fois de plus le lien qui existe entre la contrefaçon et le terrorisme, l’amendement CL26 vise à ajouter le délit de contrefaçon en bande organisée à la liste des actes de terrorisme au sens de l’article 421-1 du code pénal.
M. Pierre Morel-A-L’Huissier. L’amendement CL52 est défendu.
Mme la rapporteure. Avis défavorable. L’article 421-1 du code pénal permet d’incriminer les actes terroristes, notamment les atteintes volontaires à la vie, mais aussi les infractions en matière d’armes, de produits explosifs ou de matières nucléaires. La qualification d’« acte terroriste » entraîne l’application d’un certain nombre de règles dérogatoires tenant à la spécificité des juridictions, concernant la prescription et les enquêtes sous pseudonyme, par exemple.
L’application de ces règles aux délits de contrefaçon en bande organisée qui, bien qu’ils puissent contribuer au financement du terrorisme, sont fondés sur un élément matériel et relèvent d’un trafic qui n’est pas susceptible de porter atteinte en lui-même à la sécurité, à la dignité ou à la vie des personnes peut soulever de graves difficultés constitutionnelles au regard de la proportionnalité qu’il convient de respecter entre la gravité et la complexité des infractions et les mesures d’enquête. Je rappelle en outre que la législation actuelle permet déjà d’incriminer de manière substantielle le délit de contrefaçon.
M. Philippe Gosselin. Certes, mais nous visons là le délit de contrefaçon en bande organisée.
La Commission rejette les amendements.
Puis elle examine les amendements identiques CL30 de M. Philippe Gosselin et CL50 de M. Pierre Morel-A-L’Huissier.
M. Philippe Gosselin. L’amendement CL30 est défendu.
M. Pierre Morel-A-L’Huissier. L’amendement CL50 l’est également.
Mme la rapporteure. Avis défavorable : l’extension de la peine complémentaire de confiscation aux délits punis d’une peine de cinq ans d’emprisonnement est disproportionnée.
Mme Cécile Untermaier. Nous suivrons naturellement l’avis de la rapporteure sur ces amendements, mais nous estimons que la contrefaçon est un élément majeur du financement du terrorisme, comme la vente illicite de biens culturels. Sans doute serait-il opportun d’envisager d’ici la séance comment cibler cette source de financement.
M. Philippe Gosselin. Je remercie Mme Untermaier de souligner ce point, car la lutte contre la contrefaçon est un objectif partagé sur tous les bancs. Je rappelle que la loi relative à la contrefaçon de 2007 a été adoptée à l’unanimité, de même que la loi de 2014. Il s’agit d’un véritable fléau dont le lien avec le financement du terrorisme et des réseaux mafieux – qui ne sont pas tous terroristes – est de plus en plus avéré. C’est un vrai pillage qui dépasse les seules atteintes à la propriété intellectuelle et industrielle.
J’apprécie donc beaucoup que la majorité et l’opposition s’associent sur ce sujet, et je participerai volontiers aux travaux qui permettront de formuler en séance une proposition sérieuse et susceptible d’envoyer un véritable signal opérationnel.
Mme la rapporteure. Vous avez raison, monsieur Gosselin, mais il existe déjà des sanctions à la disposition des juges.
M. Philippe Gosselin. J’en conviens, mais il faut aller au-delà et envoyer un message ciblé.
Mme Untermaier. En effet, le recel n’est pas la contrefaçon.
Mme la rapporteure. La contrefaçon est déjà incriminée ; or, les juges ne prononcent pas toujours les peines maximales en la matière.
La Commission rejette les amendements.
Article 13
(art. L. 315–9 [nouveau] et L. 561–12 du code monétaire et financier)
Plafonnement des cartes prépayées et modalités de recueil d’informations relatives à l’utilisation de ces cartes
Le présent article prévoit le plafonnement des cartes prépayées, de manière à éviter qu’elles ne fassent l’objet d’utilisations abusives permettant la réalisation de transactions financières indétectables dans le cadre de la criminalité organisée ou du terrorisme. Il permet par ailleurs de soumettre les établissements de crédit et les établissements de monnaie électronique à l’obligation de recueillir et de conserver les informations et les données techniques relatives à l’activation, au chargement et à l’utilisation de la monnaie électronique au moyen d’une carte prépayée.
1. L’instauration d’un plafonnement des cartes prépayées
La monnaie électronique est une valeur monétaire stockée sous une forme électronique, y compris magnétique, représentant une créance sur l’émetteur, émise contre la remise de fonds aux fins d’opérations de paiement et acceptée par une personne physique ou morale autre que l’émetteur de monnaie électronique.
Comme le souligne l’étude d’impact associée au projet de loi, les « cartes prépayées permettent la circulation discrète d’importantes sommes d’argent, avec la possibilité de faire passer le support (similaire à celui d’une carte bancaire) de main en main, y compris par-delà les frontières ». En permettant la circulation de fonds en marge du système bancaire, ces cartes sont donc susceptibles d’être utilisées par des groupes criminels.
Le I du présent article introduit au sein du chapitre V relatif à l’émission et à la gestion de la monnaie électronique du titre Ier du livre III du code monétaire et financier une section 4 intitulée « Plafonnement » qui comprend un article unique L. 315–9 plafonnant la valeur monétaire maximale stockée sous forme électronique et utilisable au moyen d’un support physique.
La valeur monétaire maximale sera fixée par décret, en tenant compte des caractéristiques du produit et des risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme que celui–ci présente. Cette disposition est conforme à la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention et à l’utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, qui a retenu une approche « fondée sur le risque » (156).
Dans son avis sur le présent projet de loi, le Conseil d’État a relevé que « la pleine efficacité de ces mesures, en raison notamment du risque d’importation de cartes prépayées non plafonnées acquises à l’étranger ou d’achat à distance de ces cartes, dépendant de leur combinaison avec l’application des règles, de niveau réglementaire, relatives à la limitation du montant des paiements réalisés au moyen de la monnaie électronique et avec celles, que le Gouvernement envisage d’introduire par voie réglementaire, tendant à imposer une obligation d’identification du client quel que soit le montant chargé sur la carte prépayée. »
2. Les modalités de recueil d’information relatives à l’utilisation de ces cartes prépayées
En application du code monétaire et financier, certaines personnes sont soumises à des obligations en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.
Aux termes de l’article L. 561–12, et sous réserve de dispositions plus contraignantes, les personnes mentionnées à l’article L. 561–2 conservent pendant cinq ans à compter de la clôture de leurs comptes ou de la cessation de leurs relations avec eux les documents relatifs à l’identité de leurs clients habituels ou occasionnels. Elles conservent également, dans la limite de leurs attributions, pendant cinq ans à compter de leur exécution, les documents relatifs aux opérations faites par ceux-ci, ainsi que les documents consignant les caractéristiques des opérations présentant un risque de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme.
Les personnes soumises à des obligations en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme en application de l’article L. 561–2 du code monétaire et financier
– Banques et établissements de crédit ;
– Compagnies d’assurances et intermédiaire d’assurance ;
– Établissements de paiement ;
– Établissements de monnaie électronique ;
– Mutuelles et institutions de prévoyance ;
– Entreprises d’investissement, conseillers en investissements financiers, sociétés de gestion de portefeuille ;
– Banque de France et Institut d’émission ;
– Changeurs manuels ;
– Agents immobiliers ;
– Responsables de casinos, cercles et sociétés de jeux (Pari Mutuel Urbain, Française des Jeux) et opérateurs de jeux en ligne ;
– Experts comptables et commissaires aux comptes ;
– Notaires, huissiers de justice, avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, avocats, administrateurs et mandataires judiciaires, commissaires-priseurs judiciaires ;
– Opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ;
– Marchands de pierres précieuses, de matériaux précieux, d’antiquités et d’œuvres d’art ;
– Sociétés de domiciliation ;
– Agents sportifs.
Le II complète l’article L. 561–12 du même code consacré aux obligations de vigilance à l’égard de la clientèle des établissements financiers :
– le 1° apporte au a) et au b) deux précisions rédactionnelles – les éléments à conserver ne doivent pas seulement être des « documents », comme le prévoit actuellement le droit, mais également les « informations », et ce, « quel qu’en soit le support » ;
– le 2° ajoute un nouvel alinéa imposant aux prestataires de services bancaires et aux établissements de monnaie électronique de recueillir et conserver les informations et les données techniques relatives à l’activation, au chargement et à l’utilisation de la monnaie électronique au moyen d’un support physique. Un arrêté du ministre de l’économie précise les informations et les données techniques qui sont recueillies et conservées ;
– le 3° procède à une coordination rendue nécessaire du fait de l’ajout d’un nouvel alinéa (par le 2°).
*
* *
La Commission adopte l’amendement rédactionnel CL229 de la rapporteure.
Puis elle adopte l’article 13 modifié.
Article 14
(art. L. 561–29–1 [nouveau] et L. 574–1 du code monétaire et financier)
Signalement par TRACFIN aux personnes soumises au dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme de situations générales et individuelles présentant des risques élevés
Le présent article a pour principal objet de permettre à TRACFIN de signaler aux personnes soumises au dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme des situations générales et individuelles présentant des risques élevés de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme.
1. Les déclarations de soupçon reçues par TRACFIN
Le service de traitement du renseignement et d’action contre les circuits financiers clandestins, connu sous le nom de TRACFIN, a été créé par la loi n° 90–614 du 12 juillet 1990 (157). Initialement institué pour combattre le blanchiment de l’argent de la drogue, ce service du ministère de l’Économie et des finances, a désormais une mission plus large, consistant à lutter contre les circuits financiers clandestins, le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Pour exercer cette mission, TRACFIN reçoit de la part d’un certain nombre de professions, dont la liste est fixée à l’article L. 561-2 du code monétaire et financier (158), des informations signalant des opérations financières atypiques, appelées déclarations de soupçon. Ces déclarations sont analysées par le service et peuvent, le cas échéant après la réalisation d’investigations complémentaires, conduire TRACFIN à transmettre une note d’information à l’administration fiscale si l’opération permet de suspecter une fraude fiscale ou au procureur de la République territorialement compétent en cas de suspicion d’une autre infraction.
Le nombre de déclarations de soupçon reçues et analysées par TRACFIN n’a cessé de croître avec les années, passant de 11 553 en 2005 à 36 715 en 2014 (159). Parmi les professions soumises à l’obligation de déclaration, les banques et établissements de crédit sont celles qui en transmettent le plus grand nombre (29 508 en 2014). En revanche, si les notaires commencent à transmettre un nombre croissant de déclarations (1 040), le volume de celles qui proviennent des compagnies d’assurance (1 423), des commissaires-priseurs (26) et des avocats (une seule déclaration) paraît réduit par rapport au volume des transactions douteuses dont ils peuvent avoir connaissance.
Comme l’a souligné notre collègue Yann Galut dans son rapport sur le projet de loi relatif à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière, « s’agissant des avocats, le Conseil national des barreaux et les avocats fiscalistes ont fait valoir, lors de leurs auditions, que les avocats mettaient en œuvre l’obligation de vigilance que la loi met à leur charge par un refus ou une interruption de collaboration lorsqu’ils ont un doute sérieux sur l’origine licite de fonds. Ils font valoir que le secret professionnel qui protège les relations avec leurs clients ne les autoriserait pas à transmettre des déclarations de soupçon à TRACFIN. Cependant, votre rapporteur estime qu’une meilleure participation des avocats au dispositif de déclaration de soupçon à TRACFIN serait sans doute possible, notamment dans les cas où la relation avec le client est uniquement une activité de conseil, à l’exclusion de toute activité de défense, comme cela est fréquemment le cas dans le domaine du conseil fiscal » (160).
2. Les obligations de vigilance mises à la charge de certains professionnels
a. Les obligations standards (articles L. 561–5 et L. 561–6 du code monétaire et financier)
La loi articule deux phases de vigilance pour les professionnels : la première au moment de l’entrée en relation avec la clientèle, la seconde lors du suivi des clients et de leurs opérations.
Les professionnels sont tenus, avant l’entrée en relation d’affaires ou avant d’assister leur client dans la préparation ou la réalisation d’une opération, de procéder :
– à l’identification du client de la relation d’affaires ou de l’opération sollicitée, étant précisé que cet impératif s’étend au bénéficiaire effectif, c’est à dire « la personne physique qui contrôle, directement ou indirectement, le client ou de celle pour laquelle une transaction est exécutée ou une activité réalisée » (articles L. 561-2-2) ;
− à la vérification de son identité sur la base de tout document écrit probant ;
− au recueil d’informations concernant l’objet et la nature de la relation d’affaires envisagée.
À défaut d’obtention de ces données, le professionnel ne peut nouer la relation d’affaires, ni la poursuivre ou exécuter des opérations.
Il doit ensuite assurer une vigilance constante tout au long de la relation d’affaires permettant ainsi d’avoir une « connaissance actualisée » du client et d’assurer « un examen attentif des opérations » afin d’être en mesure d’évaluer la cohérence de ces dernières et de détecter celles devant faire l’objet d’une déclaration auprès du service TRACFIN.
b. La vigilance renforcée (articles L. 561-10, L. 561-10-1 et L. 561-10-2 du code monétaire et financier)
Aux termes du I de l’article L. 561–10–2, la mise en œuvre de mesures de vigilance complémentaires par rapport aux obligations standards s’impose en toutes circonstances dans les situations suivantes :
– le client ou son représentant légal n’est pas physiquement présent au moment de l’identification ;
– le produit ou l’opération favorise l’anonymat, sans préjudice de la prohibition absolue des produits anonymes ;
– l’opération pour compte propre ou pour compte de tiers est effectuée avec des personnes physiques ou morales, y compris leurs filiales ou établissements domiciliés, enregistrés ou établis dans un État ou un territoire dont la liste est arrêtée par décret ;
– le client répond à la qualification de « personne politiquement exposée », à savoir « une personne résidant dans un autre État membre de l’Union européenne ou un pays tiers et qui est exposée à des risques particuliers en raison des fonctions politiques, juridictionnelles ou administratives qu’elle exerce ou a exercées pour le compte d’un autre État ou de celles qu’exercent ou ont exercées des membres directs de sa famille ou des personnes connues pour leur être étroitement associées ». L’article R. 561-18 du code monétaire et financier précise les catégories de personnes ainsi concernées non seulement à principal, telles que « les chefs d’État et de gouvernement, les ministres, les parlementaires, les membres des cours suprêmes, constitutionnelles et des comptes, les ambassadeurs » mais aussi celles qui, de par la nature de leurs liens, y sont assimilées.
Le II du même article prévoit que ces personnes effectuent un examen renforcé de toute opération particulièrement complexe ou d’un montant inhabituellement élevé ou ne paraissant pas avoir de justification économique ou d’objet licite. Dans ce cas, elles se renseignent auprès du client sur l’origine des fonds et la destination de ces sommes ainsi que sur l’objet de l’opération et l’identité de la personne qui en bénéficie.
À l’issue de cet examen, le professionnel apprécie, en fonction de la pertinence des données recueillies, ou du défaut d’obtention de celles-ci, la nécessité de procéder à une déclaration auprès de TRACFIN (article L. 561–15 du code monétaire et financier).
3. Signalement par TRACFIN des situations générales et individuelles présentant des risques élevés de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme
Afin de renforcer l’efficacité des obligations de vigilance, le I du présent article crée un article L. 561–29–1 permettant à TRACFIN de désigner, pour une durée maximum de six mois renouvelable, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État, aux personnes soumises au dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, les opérations (eu égard à leur nature particulière ou aux zones géographiques qu’elles concernent) (1°) et les personnes (2°) qui présentent un risque élevé de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme.
Les personnes soumises au dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, de même que le président de l’ordre des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation et le bâtonnier de l’ordre auprès duquel l’avocat est inscrit ne peuvent porter à la connaissance de leurs clients ou à des tiers autres que les autorités de contrôle, ordres professionnels et instances représentatives nationales les informations transmises par TRACFIN dans ce cadre.
Il ne s’agit donc pas de nouvelles mesures de vigilance mises à la charge des personnes soumises au dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme mais de permettre à TRACFIN d’appeler leur attention sur des risques précisément identifiés.
Comme l’indique l’étude d’impact, « TRACFIN a déjà réalisé deux appels à vigilance à destination des professionnels assujettis à l’occasion des événements du printemps arabe en 2011 et au regard de la situation politique et sécuritaire en Ukraine en 2014. Ces messages avaient conduit les professionnels déclarants à renforcer l’intensité des mesures de vigilance à l’égard de toutes les opérations financières susceptibles de se rapporter à ces événements et avaient montré leur efficacité (hausse des déclarations de soupçons en lien avec ces problématiques). »
Le II complète l’article L. 574–1 du même code par une disposition aux termes de laquelle la méconnaissance de l’interdiction de divulgation est punie d’une amende de 22 500 euros.
*
* *
La Commission est saisie de l’amendement CL230 de Mme Colette Capdevielle, rapporteure.
Mme Colette Capdevielle, rapporteure. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.
La Commission adopte l’amendement.
Elle examine ensuite l’amendement CL232 de Mme la rapporteure,
Mme la rapporteure. Amendement rédactionnel également.
La Commission adopte l’amendement.
Elle en vient à l’amendement CL186 de M. Sergio Coronado.
M. Sergio Coronado. Cet amendement vise à préciser que les territoires mentionnés au nouvel article L. 561-29-1 du code monétaire et financier et la liste des opérations qui seraient considérées comme risquées sont fixés par arrêté, afin de sécuriser les opérateurs concernés.
Mme la rapporteure. Cet amendement est satisfait : aux alinéas 2 à 4, il est précisé que c’est bien TRACFIN qui signale aux personnes soumises aux obligations de vigilance les opérations et les personnes qui présentent un risque élevé de blanchiment de capitaux. Par ailleurs, l’alinéa 6 indique qu’un décret fixe les modalités d’application de ce nouvel article L. 561-29-1 du code monétaire et financier.
Je vous demanderai de bien vouloir retirer votre amendement, monsieur Coronado.
L’amendement CL 186 est retiré.
La Commission adopte l’article 14 modifié.
Article 15
(art. L. 561–26 du code monétaire et financier)
Extension du droit de communication de TRACFIN
Le présent article étend le droit de communication de TRACFIN, qui existe déjà à l’égard des établissements financiers, aux entités (associations, groupements, etc.) chargées de gérer les systèmes de paiement. L’interdiction de divulguer les informations communiquées à TRACFIN s’appliquera également à ces groupements et réseaux.
1. Le droit en vigueur
TRACFIN travaille à partir de deux sources d’information complémentaires :
– les « déclarations de soupçons », transmises par des catégories de professions définies à l’article L. 561-2 du code monétaire et financier (institutions bancaires, experts comptables, etc.) lorsqu’elles constatent des opérations financières atypiques (161) ;
– les documents conservés par ces professions (article L. 561-26) et par les administrations publiques (article L. 561-27), à l’égard desquels TRACFIN dispose d’un droit d’obtention.
L’article 16 de la loi n° 2015-912 du 24 juillet 2015 relative au renseignement a élargi ce droit d’obtention aux entreprises de transport et aux opérateurs de voyage ou de séjour. TRACFIN peut leur demander des informations concernant leurs clients et leur parcours, les éléments d’identification des personnes ayant payé ou bénéficié d’une prestation ainsi que les dates, les heures et les lieux de départ et d’arrivée de ces personnes et, s’il y a lieu, les éléments d’information relatifs aux bagages et aux marchandises transportés. Toutes les catégories de transport sont concernées (transport routier, ferroviaire, maritime et aérien). Ce dispositif s’inspire du droit de communication reconnu à l’administration des douanes.
2. L’extension du droit de communication de TRACFIN
Le présent article modifie l’article L. 561–26 du code monétaire et financier sur le droit de communication de TRACFIN.
Au 1° et au 2°, il apporte une précision rédactionnelle en substituant à l’expression « pièces conservées », les mots « documents, informations ou données conservés ».
Au 3°, il ajoute un II ter autorisant TRACFIN à demander aux gestionnaires d’un système de cartes de paiement ou de retrait toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission. Il s’agira par exemple du groupement d’intérêt économique CB ou des sociétés Visa et Mastercard.
Cette disposition a été jugée par le Conseil d’État compatible avec le cadre réglementaire de l’Union européenne en matière de lutte contre le blanchiment (162), qui fait obligation aux États membres de veiller à l’accès en temps utile de leur cellule de renseignement financier aux informations financières nécessaires à l’accomplissement de leurs missions.
En conséquence, le 4° étend aux gestionnaires d’un système de cartes de paiement ou de retrait l’interdiction de divulgation prévue par le III de l’article L. 561–26 du code monétaire et financier.
*
* *
La Commission est saisie de l’amendement CL233 de Mme la rapporteure.
Mme la rapporteure. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.
La Commission adopte l’amendement.
Elle adopte l’article 15 modifié.
Article 15 bis (nouveau)
(art. L. 561–27 du code monétaire et financier)
Extension de l’accès des agents habilités de TRACFIN au fichier des antécédents judiciaires
À l’initiative de votre rapporteure, la commission des Lois a adopté un amendement permettant d’élargir l’accès des agents habilités de TRACFIN au fichier des antécédents judiciaires (TAJ).
1. Le droit en vigueur
Aux termes de l’article 230-10 du code de procédure pénale, « les personnels spécialement habilités des services de la police et de la gendarmerie nationales désignés à cet effet ainsi que les personnels spécialement habilités de l’État investis par la loi d’attributions de police judiciaire, notamment les agents des douanes, peuvent accéder aux informations, y compris nominatives, figurant dans les traitements de données personnelles d’antécédents judiciaires ».
En l’état du droit, l’accès direct au TAJ par les agents habilités de TRACFIN est possible dans deux hypothèses :
– dans un objectif de recrutement (article L. 234–2 du code de la sécurité intérieure tel que modifié par la loi du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire (163)) ;
– pour les besoins relatifs à l’indépendance nationale, l’intégrité du territoire et la défense nationale ainsi que pour les besoins relatifs à la prévention du terrorisme (article L. 234–4 du code de la sécurité intérieure issu de la loi n° 2015-912 sur le renseignement du 24 juillet 2015).
2. Un élargissement de l’accès des agents habilités de TRACFIN au TAJ
L’objet même des lois de 2013 et 2015 précitées a, de fait, limité les possibilités d’accès du service aux missions relatives à la prévention du terrorisme et à l’indépendance nationale, l’intégrité du territoire et la défense nationale. Or, il serait logique de prévoir un accès direct au TAJ pour l’exercice de l’ensemble des missions de TRACFIN, y compris sa mission de lutte contre le blanchiment de capitaux.
TRACFIN est destinataire d’environ 38 000 informations annuelles émanant principalement des professionnels assujettis, lesquels portent à sa connaissance des flux financiers atypiques. L’action de TRACFIN consiste à contextualiser et analyser l’information reçue avant, le cas échéant, de l’enrichir et de l’externaliser, notamment à l’autorité judiciaire dès lors qu’il existe une présomption d’infraction pénale. En effet, l’article L. 561-23 du code monétaire et financier prévoit que « lorsque ses investigations mettent en évidence des faits susceptibles de relever du blanchiment du produit d’une infraction punie d’une peine privative de liberté supérieure à un an ou du financement du terrorisme (…) le service (…) saisit le procureur de la République par note d’information ». Il est important de souligner qu’alors que la transmission d’information à d’autres services de l’État relève du pouvoir d’appréciation de TRACFIN (article L. 561-29 du code monétaire et financier), celle–ci est obligatoire vis-à-vis de l’autorité judiciaire dès lors que les conditions mentionnées à l’article L. 561-23 sont réunies. 592 transmissions ont ainsi été adressées par TRACFIN à l’autorité judiciaire et aux services de police judiciaire en 2014.
Or, l’activité de contextualisation et d’analyse des flux dès leur réception, ainsi que la nécessaire articulation de l’action de TRACFIN avec celle de l’autorité judiciaire et des services délégués par celle-ci, implique très fréquemment la consultation du TAJ (environ 9 000 consultations annuelles).
Ces consultations s’effectuent actuellement de manière indirecte, à la fois par l’intermédiaire de l’office central pour la répression de la grande délinquance financière (OCRGDF) et par le biais des trois officiers de liaison police–gendarmerie présents à TRACFIN. Néanmoins, compte tenu de l’augmentation massive et continue du flux d’informations reçus, le système de consultation indirecte trouve ses limites et l’accès direct de TRACFIN au TAJ prévu en matière de prévention du terrorisme ne répond que très partiellement aux besoins de ce service.
Surtout, au stade initial, lorsque TRACFIN reçoit une information financière, il lui est difficile de savoir si les flux portés à sa connaissance sont susceptibles d’être mis en lien avec du financement du terrorisme ou du blanchiment d’une infraction pénale. Seule une consultation du TAJ peut le permettre.
Votre rapporteure a donc déposé un amendement, adopté par la Commission, visant à élargir l’accès des agents habilités de TRACFIN au TAJ pour l’ensemble de ses missions. L’élargissement de cet accès ne contrevient à aucune norme d’ordre constitutionnel ou conventionnel dans la mesure où il est pleinement justifié par les missions du service et où il exclut les données relatives aux personnes enregistrées en qualité de victimes.
Enfin, il est important de rappeler :
– d’une part, que TRACFIN est un service de renseignement spécialisé qui ne peut agir d’initiative (il faut que le service ait été destinataire d’une déclaration ou d’une information de soupçon préalable pour mettre en œuvre des investigations, notamment la consultation du TAJ) ;
– d’autre part, que l’accès au TAJ sera réservé à des agents spécialement habilités et que la traçabilité des consultations sera assurée à la fois par le TAJ et par le système d’information de TRACFIN, appelé STRATRAC.
*
* *
La Commission examine l’amendement CL234 de la rapporteure.
Mme la rapporteure. Cet amendement vise à permettre aux agents habilités de TRACFIN d’avoir accès au fichier de traitement d’antécédents judiciaires (TAJ).
Le principe d’un accès direct au TAJ est d’ores et déjà juridiquement possible dans deux hypothèses : dans un objectif de recrutement ; pour les besoins relatifs à l’indépendance nationale, l’intégrité du territoire et la défense nationale ainsi que pour les besoins relatifs à la prévention du terrorisme.
Cet élargissement d’accès demandé par TRACFIN nous paraît pleinement justifié par les missions du service.
Plusieurs garanties sont réunies : TRACFIN est un service de renseignement spécialisé qui ne peut agir d’initiative ; l’accès au TAJ sera strictement réservé à des agents spécialement habilités ; enfin, la traçabilité des consultations sera assurée à la fois par le TAJ et par le système d’information de TRACFIN et les données relatives aux personnes enregistrées en qualité de victimes seront exclues.
M. Jean-Luc Warsmann. J’apporte mon soutien à cette très bonne initiative, madame la rapporteure.
La Commission adopte cet amendement. L’article 15 bis est ainsi rédigé.
Article 16
(art. 415–1 [nouveau] du code des douanes)
Extension en matière douanière du mécanisme de renversement de la preuve de l’origine illicite des fonds
Le présent article étend en matière douanière le mécanisme de renversement de la preuve de l’origine illicite des fonds instauré en 2013 pour le délit général de blanchiment afin de renforcer les moyens juridiques de lutte contre le financement du terrorisme.
1. L’introduction en 2013 d’un mécanisme de renversement de la preuve de l’origine illicite des fonds pour le délit général de blanchiment
L’article 8 de la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière a créé un article L. 324–1–1 du code pénal permettant d’assouplir la preuve du délit de blanchiment. Aux termes de cet article : « Pour l’application des dispositions de l’article 324-1, les biens ou les revenus sont présumés être le produit direct ou indirect d’un crime ou d’un délit dès lors que les conditions matérielles, juridiques ou financières de l’opération de placement, dissimulation ou de conversion, ne peuvent avoir d’autre justification que de dissimuler l’origine ou le bénéficiaire effectif de ces biens ou revenus. »
Comme l’a souligné le rapport de M. Yann Galut sur ledit projet de loi : « Un tel renversement de la charge de la preuve n’est en rien une innovation dans notre droit pénal, qui connaît déjà d’autres cas d’incriminations dont l’un des éléments constitutifs est l’incapacité, pour certaines personnes se trouvant dans des situations précises définies par la loi, à prouver l’origine licite de biens ou de revenus. Tel est le cas, notamment, de l’article 321-6 du code pénal, qui assimile au recel le fait « de ne pas pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie ou de ne pas pouvoir justifier de l’origine d’un bien détenu, tout en étant en relations habituelles avec une ou plusieurs personnes qui soit se livrent à la commission de crimes ou de délits punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement et procurant à celles-ci un profit direct ou indirect, soit sont les victimes d’une de ces infractions », ainsi que le fait « de faciliter la justification de ressources fictives pour des personnes se livrant à la commission de crimes ou de délits punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement et procurant à celles-ci un profit direct ou indirect ». Tel est également le cas du 3° de l’article 225-6 du code pénal, qui assimile au proxénétisme le fait « de ne pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie tout en vivant avec une personne qui se livre habituellement à la prostitution ou tout en étant en relations habituelles avec une ou plusieurs personnes se livrant à la prostitution ». » (164)
La chambre criminelle de la Cour de cassation n’a pas jugé sérieuse la question de la conformité à la Constitution de cet article, dès lors que la présomption d’illicéité n’est pas irréfragable et qu’elle nécessite, pour être mise en œuvre, la réunion de conditions de fait ou de droit faisant supposer la dissimulation de l’origine ou du bénéficiaire effectif de ces biens ou revenus. (165)
2. L’extension du mécanisme de renversement de la preuve de l’origine illicite des fonds en matière douanière
La direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI) est chargée de s’assurer du respect de l’obligation de déclaration prévue à l’article 464 du code des douanes, qui s’impose à tout individu franchissant la frontière française avec une somme égale ou supérieure à 10 000 euros (166) conformément à l’article 3 du règlement (CE) n° 1889/2005 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant ou sortant de la Communauté. Le manquement à l’obligation déclarative constitue un levier important pour les enquêtes administratives et judiciaires en matière de blanchiment et de lutte contre le terrorisme. Sur le fondement de l’article 415 du code des douanes, la DGDDI est également habilitée à constater le délit douanier de blanchiment, constitué dès lors qu’une personne réalise ou tente de réaliser une opération financière entre la France et l’étranger par la voie de l’importation, de l’exportation, du transfert ou de la compensation de fonds provenant directement ou indirectement d’un délit douanier ou d’une infraction à la législation sur les stupéfiants dès lors que cette personne a la connaissance coupable de l’origine des fonds.
Le nombre de dossiers de blanchiment douanier notifiés par la douane en 2015 a progressé de 300 % en un an (167).
Le présent article introduit un nouvel article 415–1 dans le code des douanes aux termes duquel, pour l’application de l’article 415 du même code, les fonds sont présumés être le produit direct ou indirect d’un délit douanier ou d’une infraction à la législation sur les stupéfiants, dès lors que les conditions matérielles, juridiques ou financières de l’opération d’exportation, d’importation, de transfert ou de compensation ne paraissent obéir à d’autres motifs que de dissimuler les fonds ou une telle origine.
Votre rapporteur estime que ce nouvel article ne contrevient ni aux exigences constitutionnelles ni aux exigences conventionnelles en matière de respect de la présomption d’innocence et de droit à un procès équitable.
Il résulte en effet de la jurisprudence du Conseil constitutionnel que le législateur peut, à titre exceptionnel, instituer une présomption de culpabilité en matière correctionnelle « dès lors qu’elle ne revêt pas de caractère irréfragable, qu’est assuré le respect des droits de la défense et que les faits induisent raisonnablement la vraisemblance de l’imputabilité » (168). De même, la Cour européenne des droits de l’homme admet l’existence de présomptions en matière répressive dès lors qu’elles ne dépassent pas un certain seuil et que les États les enserrent « dans des limites raisonnables prenant en compte la gravité de l’enjeu et préservant les droits de la défense » (169). Elle veille par ailleurs à ce que les juridictions répressives se gardent de « tout recours automatique aux présomptions » (170).
*
* *
Après le retrait de l’amendement CL 220 de M. Sergio Coronado, la Commission adopte l’article 16 sans modification.
Chapitre V
Dispositions renforçant l’enquête et les contrôles administratifs
Article 17
(art. 78–2–2 du code de procédure pénale)
Dispositions relatives à la fouille des bagages lors d’un contrôle d’identité
Le présent article étend les pouvoirs des forces de l’ordre à l’occasion des contrôles et vérifications d’identité réalisés en application des articles 78-2 et suivants du code de procédure pénale. Il introduit la possibilité, pour les officiers de police judiciaire (OPJ) agissant sur réquisition du procureur de la République en application de l’article 78-2-2 du code pénal, de procéder, dans les lieux et pour la période prévus par ce magistrat, à l’inspection visuelle et à la fouille de bagages en plus des contrôles d’identité et de la visite des véhicules.
1. Les règles régissant les contrôles d’identité et les fouilles de véhicules
Aux termes de l’article 78-1 du code de procédure pénale, « toute personne se trouvant sur le territoire national doit accepter de se prêter à un contrôle d’identité effectué dans les conditions et par les autorités de police visées » aux articles 78-2 et suivants du même code.
La compétence pour effectuer ces contrôles appartient aux OPJ et, « sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci », aux agents de police judiciaire et aux agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1 du code de procédure pénale, ce qui inclut la quasi-totalité des militaires de la gendarmerie nationale et des fonctionnaires de la police nationale (171).
a. Les contrôles d’identité
L’article 78–2 du code de procédure pénale pose le cadre général applicable aux contrôles d’identité.
Les contrôles d’identité de police judiciaire, régis par les six premiers alinéas de l’article 78-2, interviennent soit à l’initiative des forces de l’ordre, soit sur réquisition du parquet. Dans le premier cas, ils peuvent concerner toute personne « à l’égard de laquelle existent une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner » :
– qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction ;
– ou qu’elle se prépare à commettre un crime ou un délit ;
– ou qu’elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l’enquête en cas de crime ou de délit ;
– ou qu’elle fait l’objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire.
Dans le second cas, l’identité de toute personne peut être contrôlée « sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite d’infractions qu’il précise (…), dans les lieux et pour une période de temps déterminés par ce magistrat ».
Les contrôles d’identité de police administrative sont prévus à l’alinéa 7 : « l’identité de toute personne, quel que soit son comportement, peut (…) être contrôlée (…) pour prévenir une atteinte à l’ordre public, notamment à la sécurité des personnes ou des biens ».
L’alinéa 8 vise les contrôles d’identité mettant en œuvre la Convention de Schengen de 1990 et ayant pour objet la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontalière. Ces contrôles peuvent intervenir dans les zones frontalières – dans une bande territoriale de vingt kilomètres – et dans les zones accessibles au public des ports, aéroports et gares ferroviaires ou routières ouverts au trafic international. Ils tendent à « vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévues par la loi ». (172)
Tous ces contrôles d’identité peuvent donner lieu à une procédure coercitive de vérification d’identité prévue à l’article 78–3 du code de procédure pénale, en cas de refus ou d’impossibilité de la personne concernée de justifier de son identité (173).
Le régime douanier des contrôles d’identité est moins étendu que celui qui s’applique aux gendarmes et policiers :
– ratione loci, alors que les douaniers ne peuvent procéder qu’au contrôle d’identité des personnes « qui entrent dans le territoire douanier ou qui en sortent, ou qui circulent dans le rayon des douanes », gendarmes et policiers peuvent y procéder sur l’ensemble du territoire ;
– ratione materiae, les gendarmes et policiers peuvent non seulement contrôler l’identité des personnes en lien avec une infraction déterminée (police judiciaire) mais aussi de toutes les personnes afin de prévenir une atteinte à l’ordre public (police administrative).
Le régime des contrôles d’identité est constitutionnellement encadré. Saisi en 1993 d’une loi qui visait à étendre les conditions de mise en œuvre des contrôles et vérifications d’identité, le Conseil constitutionnel a estimé que si « la prévention d’atteintes à l’ordre public, notamment d’atteintes à la sécurité des personnes ou des biens, est nécessaire à la sauvegarde de principes et de droits ayant valeur constitutionnelle, (…) la pratique de contrôles d’identité généralisés et discrétionnaires serait incompatible avec le respect de la liberté individuelle ». Il ajoutait « que s’il est loisible au législateur de prévoir que le contrôle d’identité d’une personne peut ne pas être lié à son comportement, il demeure que l’autorité concernée doit justifier, dans tous les cas, des circonstances particulières établissant le risque d’atteinte à l’ordre public qui a motivé le contrôle (…) » (174).
Trois séries de dispositions du code de procédure pénale encadrent aujourd’hui les visites des véhicules effectuées par les officiers de police judiciaire, éventuellement assistés par des agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints (175) :
– l’article 78-2-2, sur réquisitions écrites du procureur de la République, aux fins de recherche et de poursuite d’une série d’infractions (176), dont le Conseil constitutionnel a jugé que la liste « n’est pas manifestement excessive au regard de l’intérêt public qui s’attache à la recherche des auteurs de ces infractions » (177). Cette procédure peut s’accompagner d’un contrôle d’identité de police judiciaire, dans les conditions prévues à l’alinéa 6 de l’article 78-2. Elle doit intervenir pendant une période fixée par le procureur de la République, de vingt-quatre heures au maximum, susceptible d’être prolongée sur décision expresse et motivée ;
– l’article 78-2-3, lorsqu’il existe, à l’égard du conducteur ou d’un passager, « une ou plusieurs raisons de soupçonner » qu’il a commis ou tenté de commettre « un crime ou un délit flagrant » ;
– l’article 78-2-4 « pour prévenir une atteinte grave à la sécurité des personnes et des biens ». Cette procédure nécessite « l’accord du conducteur » ou, à défaut, des instructions du procureur de la République. Dans l’attente de ces dernières, le véhicule peut être immobilisé pour trente minutes au maximum. La fouille peut s’accompagner d’un contrôle d’identité de police administrative.
Les agents des douanes disposent d’importants pouvoirs de visite et de contrôle des véhicules dans l’exercice de leurs missions : ainsi peuvent-ils, sur l’ensemble du territoire douanier (aéroport, gare, port, voie publique, etc.), « procéder à la visite des marchandises et des moyens de transport et à celle des personnes » pour l’application des dispositions du code des douanes et aux fins de recherche d’une fraude (article 60 du code des douanes).
Étendu, le pouvoir de visite des moyens de transport par les agents des douanes n’en demeure pas moins conditionné à une finalité principale, la recherche de la fraude douanière. Saisie à plusieurs reprises de questions prioritaires de constitutionnalité portant sur la conformité de l’article 60 précité aux droits et libertés garantis par la Constitution, la Cour de cassation, refusant de transmettre au Conseil constitutionnel les questions qui lui étaient soumises, a constamment considéré que « le droit de visite exercé par les agents des douanes, qui, sous le contrôle d’un juge, n’autorise aucune mesure coercitive et ne permet le maintien à disposition des personnes que le temps strictement nécessaire aux vérifications effectuées et à leur consignation, répond, sans disproportion, aux objectifs de valeur constitutionnelle de lutte contre les fraudes transfrontalières et les atteintes aux intérêts financiers de l’Union européenne » (178).
En présence d’un véhicule situé dans un lieu clos à usage privé ou spécialement aménagé en lieu d’habitation, elle soumet sa fouille au régime de droit commun de la perquisition (179).
À la différence de la perquisition qui s’opère dans un lieu clos à usage privé, généralement le domicile, la visite consiste dans la recherche d’indices dans tous autres endroits qu’un lieu immobilier clos, un véhicule par exemple. Comme pour les contrôles d’identité, policiers et gendarmes peuvent pratiquer des visites de véhicules dans le cadre de leurs missions de police judiciaire ou de manière préventive. En revanche, dans le relatif silence du code de procédure pénale, c’est la jurisprudence qui a précisé le cadre juridique applicable à la fouille de bagages en décidant de l’aligner totalement ou partiellement sur le cadre applicable à la perquisition domiciliaire. (180)
Si les fouilles de bagages pratiquées par les douaniers, qui relèvent des dispositions de l’article 60 du code des douanes (« procéder à la visite des marchandises et des moyens de transport et à celle des personnes ») sont pratiquées dans les mêmes conditions que celles précédemment exposées pour les véhicules, les fouilles de bagages réalisées par les policiers et les gendarmes ne sont pas explicitement prévues par le code de procédure pénale.
En matière judiciaire et comme pour les véhicules, le régime de la perquisition domiciliaire régit de plein droit la fouille d’un bagage situé dans un lieu clos à usage privé ou dans l’une ses annexes. Dans les autres cas, la doctrine considère que ce régime s’applique principalement pour la détermination de l’agent compétent pour y procéder et l’exigence du consentement : exécution par un officier de police judiciaire ou un agent de police judiciaire après l’accord de l’intéressé en enquête préliminaire (article 76 du code de procédure pénale), sans le consentement de l’intéressé mais seulement par un officier de police judiciaire ou un juge d’instruction en flagrance (article 56 du code de procédure pénale) ou au cours d’une information judiciaire (article 92 du code de procédure pénale) (181) .
En matière administrative, le code de procédure pénale demeure silencieux sur la possibilité de procéder à la fouille préventive de bagages. Lorsque des textes abordent cette question, ils visent généralement d’autres hypothèses comme les palpations de sécurité, la fouille des bagages par des agents de sécurité privée ou les fouilles aéroportuaires.
Si la jurisprudence (182) et certains textes admettent la palpation de sécurité pratiquée par un policier ou un gendarme afin d’écarter tout objet dangereux ou délictueux dont peuvent être porteurs des individus qui font l’objet de contrôles (183), ils n’évoquent pas expressément le cas de la fouille des bagages.
L’article L. 613-2 du code de la sécurité intérieure, qui autorise à « procéder à l’inspection visuelle des bagages à main et, avec le consentement de leur propriétaire, à leur fouille », ne régit que les agents de surveillance privée, habilités à procéder à ces fouilles seulement à l’intérieur des bâtiments ou dans la limite des lieux dont ils ont la garde (magasins, musées, aéroports, etc.). Ils peuvent également procéder, sous certaines conditions et avec le consentement de la personne, à des palpations de sécurité « en cas de circonstances particulières liées à l’existence de menaces graves pour la sécurité publique ». Des dispositions similaires réglementent les palpations de sécurité, l’inspection visuelle des bagages et leur fouille « pour l’accès aux enceintes dans lesquelles est organisée une manifestation sportive, récréative ou culturelle rassemblant plus de 300 spectateurs » (article L. 613-3 du même code).
Enfin, des dispositions règlent le cas des fouilles exécutées dans certains lieux sensibles accueillant du public, comme les aéroports : l’article L. 6342-2 du code des transports autorise ainsi les policiers, gendarmes et douaniers d’une part, et certains agents de sécurité privée spécialement agréés d’autre part, à « procéder à la fouille et à la visite, par tous moyens appropriés, des personnes, des bagages, du fret, des colis postaux, des aéronefs et des véhicules pénétrant ou se trouvant dans les zones non librement accessibles au public des aérodromes et de leurs dépendances ou sortant de celles-ci ».
2. L’extension des pouvoirs des forces de l’ordre à l’occasion des contrôles et vérifications d’identité
Le présent article modifie l’article 78–2–2 du code de procédure pénale.
Au 1°, il introduit la possibilité pour les officiers de police judiciaire, assistés le cas échéant des agents de police judiciaire adjoints, agissant sur réquisition du procureur de la République, de procéder également à l’inspection visuelle et à la fouille de bagages en plus des contrôles d’identité et de la visite des véhicules.
Au 2°, il prévoit une mesure de coordination rendue nécessaire par le 1° et qui apporte les garanties prévues par l’article 78–2–2, à savoir l’établissement d’un procès-verbal en cas de découverte d’une infraction à l’occasion de la fouille ou si la personne le demande, ce procès–verbal devant être transmis sans délai au procureur de la République.
*
* *
La Commission est saisie de l’amendement CL187 de M. Sergio Coronado.
M. Sergio Coronado. L’article 17 étend les pouvoirs des forces de l’ordre à l’occasion des contrôles d’identité. Il introduit la possibilité pour les officiers de police judiciaire, assistés des agents de police judiciaire adjoints, de procéder, avec l’autorisation du parquet, à l’inspection visuelle et à la fouille de bagages en plus des contrôles d’identité et de la visite des véhicules. La liste des infractions permettant de recourir à ce cadre de contrôle et de fouille est très large et aucun élément objectivable n’est nécessaire pour demander d’y procéder.
Rappelons pour finir que l’important recours aux contrôles qui est fait en France est source régulière de critiques, qui portent notamment sur leur caractère discriminatoire.
C’est pourquoi il est proposé de supprimer cet article.
M. Pascal Popelin, rapporteur. Le champ de cet article est très large, dites-vous ; permettez-moi de rappeler que sont notamment visés les actes de terrorisme, les infractions en matière de prolifération d’armes de destruction massive et de leurs vecteurs ainsi qu’en matière d’armes et explosifs. Le Conseil constitutionnel a jugé que cette liste n’était pas excessive au regard de l’intérêt public qui s’attache à la recherche des auteurs de ces infractions.
Compte tenu de la nature des infractions visées, de la courte période pendant laquelle la réquisition du procureur peut être donnée et des garanties qui entourent la fouille – un procès-verbal est établi en cas de découverte d’une infraction ou à la demande de la personne concernée, puis transmis sans délai au procureur de la République –, nous y voyons pour notre part un outil extrêmement utile : cet article permettrait de donner une base légale, très encadrée, aux fouilles de bagages, à l’instar de ce qui existe pour les contrôles d’identité et les visites de véhicule.
Je vous suggère donc de retirer votre amendement, monsieur Coronado.
M. Sergio Coronado. Je le maintiens.
La Commission rejette l’amendement CL187.
Puis elle adopte l’article 17 sans modification.
La Commission est saisie de l’amendement CL188 de M. Sergio Coronado.
M. Sergio Coronado. Cet amendement porte sur la délivrance d’un récépissé à la suite d’un contrôle d’identité, qui était un des engagements de campagne de l’actuel Président de la République,…
M. le rapporteur. Non !
M. Sergio Coronado.… et que réclament de nombreuses associations, notamment des associations de quartier.
Le projet de loi élargit les possibilités d’opérer des fouilles, lesquelles sont susceptibles de poser les mêmes problèmes que les contrôles d’identité avec toujours la même impossibilité de contester une éventuelle discrimination du fait de l’absence de dispositif de traçabilité.
L’amendement CL188 propose de tester ce récépissé de contrôle ou de fouille dans le cadre d’une expérimentation qui serait conduite dans deux métropoles, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État. Je vous épargne les références au rapport de la Commission nationale consultative des droits de l’homme et aux différentes décisions de justice qui ont conduit à une condamnation de l’État.
M. le rapporteur. Une lecture attentive des soixante propositions formulées par François Hollande en 2012 ne m’a pas permis de trouver une quelconque trace d’un engagement portant sur le récépissé en tant que tel… En revanche, il est fait mention de la lutte contre les discriminations dans le cadre de toute procédure qui amène les forces de l’ordre à contrôler telle ou telle personne.
J’aimerais rappeler le travail mené à cet effet depuis le début de ce quinquennat : obligation pour les policiers et les gendarmes de porter de manière visible sur leur uniforme leur numéro de matricule, mise en place d’un nouveau code de déontologie de la police nationale depuis le 1er janvier 2014, dispositions prises dans le cadre de la réforme de l’inspection générale de la police nationale, possibilité de déposer des pré-plaintes en ligne.
Enfin, je précise qu’un article de ce projet de loi, que nous examinerons en fin de discussion, vise à généraliser l’utilisation des « caméras-piétons », qui font désormais l’objet d’un consensus dans la police qui n’avait accepté qu’à contrecœur de les utiliser au début de l’expérimentation. C’est par ce genre de disposition, plutôt que par un récépissé, que nous pourrons mieux encadrer contrôles et fouilles.
Je vous demande de bien vouloir retirer votre amendement ; à défaut, j’émettrai un avis défavorable.
M. Sergio Coronado. Je le maintiens.
La Commission rejette l’amendement CL188.
Article 18
(art. 78–3–1[nouveau] et 78–4 du code de procédure pénale)
Retenue en cas de suspicions sérieuses que le comportement d’une personne est lié à des activités à caractère terroriste
Le présent article permet aux forces de l’ordre, à l’occasion d’un contrôle ou d’une vérification d’identité, de retenir une personne lorsqu’il y a des raisons sérieuses de penser que son comportement est lié à des activités à caractère terroriste, le temps nécessaire – mais qui ne peut excéder quatre heures à compter du début du contrôle – à l’examen de sa situation. Ce délai peut permettre une consultation plus extensive de fichiers de police, la vérification de la situation administrative de la personne concernée et la consultation des services à l’origine de son signalement.
1. Le droit en vigueur
Aux termes de l’article 78–3 du code de procédure pénale, si une personne refuse ou se trouve dans l’impossibilité de justifier de son identité lors d’un contrôle prévu par l’article 78–2 du même code, elle peut, en cas de nécessité, être retenue sur place ou dans le local de police où elle est conduite aux fins de vérification de son identité.
La personne est alors présentée immédiatement à un officier de police judiciaire qui la met en mesure de fournir par tout moyen les éléments permettant d’établir son identité et qui procède, s’il y a lieu, aux opérations de vérification nécessaires. Elle est aussitôt informée de son droit de faire aviser le procureur de la République de la vérification dont elle fait l’objet et de prévenir à tout moment sa famille ou toute personne de son choix. Lorsqu’il s’agit d’un mineur de dix-huit ans, le procureur de la République doit être informé dès le début de la rétention. Sauf impossibilité, le mineur doit être assisté de son représentant légal.
La personne qui fait l’objet d’une vérification ne peut être retenue que pendant le temps strictement exigé par l’établissement de son identité. La rétention ne peut excéder quatre heures, ou huit heures à Mayotte, à compter du contrôle effectué et le procureur de la République peut y mettre fin à tout moment.
Si la personne interpellée maintient son refus de justifier de son identité ou fournit des éléments d’identité manifestement inexacts, les opérations de vérification peuvent donner lieu, après autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction, à la prise d’empreintes digitales ou de photographies lorsque celle-ci constitue l’unique moyen de l’établir.
L’officier de police judiciaire mentionne, dans un procès-verbal, les motifs qui justifient le contrôle, et les conditions dans lesquelles la personne a été présentée devant lui, informée de ses droits et mise en mesure de les exercer. Ce procès-verbal est transmis au procureur de la République.
Si elle n’est suivie à l’égard de la personne qui a été retenue d’aucune procédure d’enquête ou d’exécution adressée à l’autorité judiciaire, la vérification d’identité ne peut donner lieu à une mise en mémoire sur fichiers et le procès-verbal ainsi que toutes les pièces s’y rapportant sont détruits dans un délai de six mois sous le contrôle du procureur de la République.
Dans le cas où il y a lieu à procédure d’enquête ou d’exécution adressée à l’autorité judiciaire et assortie du maintien en garde à vue, la personne retenue doit être aussitôt informée de son droit de faire aviser le procureur de la République de la mesure dont elle fait l’objet.
La durée de la rétention s’impute, s’il y a lieu, sur celle de la garde à vue.
La procédure de retenue aux fins de vérification du droit au séjour et de circulation
Avant la loi n° 2012-1560 du 31 décembre 2012 relative à la retenue pour vérification du droit au séjour et modifiant le délit d’aide au séjour irrégulier pour en exclure les actions humanitaires et désintéressées, les services de police et de gendarmerie ne disposaient que de la procédure de la vérification d’identité prévue à l’article 78-3 du code pénal, dont la durée maximale est de quatre heures, pour mener à bien l’ensemble des opérations nécessaires au placement en rétention, lorsque l’étranger se trouve dans une situation qui justifie une telle mesure. Cette durée paraissait souvent insuffisante pour faire le point sur la situation administrative exacte de l’intéressé et pour que le préfet puisse éventuellement prendre une décision d’éloignement ainsi que les décisions complémentaires qui peuvent lui être associées.
Cette loi a donc inséré un article L. 611-1-1 dans le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) prévoyant une nouvelle procédure de retenue aux fins de vérification du droit au séjour et de circulation. Cette retenue, d’une durée maximale de seize heures, peut être déclenchée à la suite de divers contrôles d’identité (ceux prévus par les articles 78-1, 78-2, 78-2-1 et 78-2-2 du code de procédure pénale) ou de titres de séjour (ceux des articles L. 611-1 du CESEDA et 67 quater du code des douanes).
La retenue est entourée de garanties importantes visant à préserver les droits des personnes concernées. En premier lieu, elle est placée sous le contrôle d’un officier de police judiciaire et du procureur de la République, ce dernier étant informé dès son début et pouvant y mettre fin à tout moment. En deuxième lieu, la personne retenue bénéficie de plusieurs droits substantiels :
– le droit à l’assistance d’un interprète ;
– le droit à l’assistance d’un avocat, avec lequel elle pourra s’entretenir 30 minutes dans des conditions garantissant la confidentialité de l’entretien. Elle pourra bénéficier d’une aide juridictionnelle à ce titre ;
– le droit d’être examinée par un médecin, la retenue ne pouvant se prolonger si l’état de santé de l’intéressé s’y oppose ;
– le droit de prévenir à tout moment sa famille ou toute personne de son choix ;
– le droit d’avertir ou de faire avertir les autorités consulaires de son pays.
2. La retenue en cas de suspicions sérieuses que le comportement d’une personne est lié à des activités à caractère terroriste
a. La pratique de la retenue des personnes faisant l’objet d’une fiche « S »
L’étude d’impact indique qu’il est recommandé aux services de police et de gendarmerie lorsqu’ils contrôlent certaines personnes faisant l’objet d’une fiche dite « S » (Sûreté de l’État) – et notamment d’une fiche S14 (djihadistes revenant d’Irak ou de Syrie) ou S15 (personne suspectée de radicalisation islamiste) – au fichier des personnes recherchées (FPR) (184) de les retenir et d’aviser sans délai le service ayant procédé à leur inscription pour recueillir ses instructions.
Mais cette retenue ne repose stricto sensu sur aucun fondement juridique. En effet, elle n’est pas une retenue ayant pour fin une vérification d’identité au sens de l’article 78–3 du code de procédure pénale.
b. La création d’un cadre légal ad hoc
Le 1° du présent article – en insérant un article 78–3–1 dans le code de procédure pénale – crée un nouveau cas de retenue pour examen de la situation administrative d’une personne à l’encontre de laquelle il existe des « raisons sérieuses de penser que son comportement est lié à des activités à caractère terroriste ou qu’elle est en relation directe et non fortuite avec une personne ayant un tel comportement ».
Cette retenue doit permettre une vérification d’identité approfondie, par un officier de police judiciaire, qui peut comprendre la consultation de traitements relevant de l’article 26 de la loi n° 78–17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés (185), selon les règles propres à chacun de ses fichiers.
À l’exception du fait que le Procureur doit être obligatoirement prévenu dès le début de la rétention, la procédure relative à cette nouvelle forme de retenue est identique à celle prévue à l’article 78–3 :
– la personne ne peut être retenue que pendant le temps strictement nécessaire à l’accomplissement des vérifications ;
– elle est aussitôt informée de son droit de prévenir à tout moment sa famille. Si des circonstances particulières l’exigent, l’officier de police judiciaire prévient lui–même la famille ou la personne choisie ;
– la retenue ne peut excéder quatre heures ;
– le procureur de la République peut y mettre fin à tout moment ;
– le mineur de dix–huit ans doit être assisté de son représentant légal, sauf impossibilité ;
– l’officier de police judiciaire mentionne dans un procès–verbal, transmis au procureur de la République, les motifs qui justifient la vérification de situation administrative et les conditions dans lesquelles la personne a été présentée devant lui, informée de ses droits et mise en mesure de les exercer ;
– dans le cas où une procédure d’enquête ou d’exécution est adressée à l’autorité judiciaire et assortie du placement en garde à vue, la personne retenue doit être aussitôt informée de son droit de faire aviser le procureur de la République de cette mesure ;
– les prescriptions sont imposées à peine de nullité.
Le 2° prévoit que la durée de la rétention s’impute, s’il y a lieu, sur celle de la garde à vue.
Le Conseil constitutionnel a considéré que certaines mesures privatives de liberté organisées à des fins de police administrative ne méconnaissaient pas l’article 66 de la Constitution et ce, même si elles échappaient au contrôle de l’autorité judiciaire dès lors qu’elles étaient :
– nécessaires, adaptées et proportionnées aux objectifs de préservation de l’ordre public ;
– brèves ;
– consignées par les agents de la police et de la gendarmerie nationale ;
– prises en compte, le cas échéant, dans la durée de la garde à vue (186).
3. Les modifications opérées par votre commission des Lois
À l’initiative de votre rapporteur et de Mme Élisabeth Pochon, votre Commission a adopté plusieurs amendements visant à préciser la rédaction de l’article 18.
De plus, sur proposition de votre rapporteur, la Commission a estimé utile d’adopter un amendement visant à préciser l’objet de la nouvelle retenue administrative introduite par le présent article.
En effet, la rédaction actuelle de l’alinéa 2 de l’article 18 indiquait seulement que la vérification approfondie pouvait comprendre une consultation de traitements relevant de l’article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés selon les règles propres à chacun de ces fichiers. Cette formulation pouvait laisser penser que la retenue pouvait également comprendre d’autres actions de « vérification approfondie » de la part de l’officier de police judiciaire. L’amendement de votre rapporteur visait donc à mieux encadrer cette nouvelle procédure de vérification, au demeurant fort utile, en précisant qu’elle permet :
– de consulter les traitements relevant de l’article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés selon les règles propres à chacun de ces fichiers ;
– d’interroger les services à l’origine du signalement ;
– d’interroger des organismes de coopération internationale en matière de police judiciaire ou des services de police étrangers.
En outre, la Commission a adopté un amendement de votre rapporteur permettant d’encadrer la retenue des mineurs en précisant que celui–ci doit être assisté de son représentant légal ou, en cas d’impossibilité dûment justifiée, d’un tuteur désigné par le juge des enfants sur saisine du procureur de la République.
Enfin, sur proposition de M. Sergio Coronado, la Commission a adopté un amendement supprimant l’alinéa 9 qui prévoyait que dans le cas où il y a lieu à procédure d’enquête ou d’exécution adressée à l’autorité judiciaire et assortie du placement en garde à vue, la personne retenue est aussitôt informée de son droit de faire aviser le procureur de la République de la mesure dont elle fait l’objet. En effet, aux termes de l’article 62–3 du code de procédure pénale, « la garde à vue s’exécute sous le contrôle du procureur de la République ». Dès lors, la précision apportée à l’alinéa 9 paraissait superfétatoire.
*
* *
La Commission examine deux amendements identiques, l’amendement CL96 de M. Patrick Devedjian et l’amendement CL189 de M. Sergio Coronado.
M. Patrick Devedjian. Mon amendement CL96 est défendu.
M. Sergio Coronado. Mon amendement est identique à celui de mon collègue Devedjian, dont je trouve l’exposé sommaire parfait… L’article 18 permet aux forces de l’ordre, à l’occasion d’un contrôle d’identité, de retenir une personne jusqu’à quatre heures lorsqu’il y a des raisons sérieuses de penser que son comportement est lié à des activités à caractère terroriste.
Actuellement, rien n’empêche les policiers et les gendarmes de contrôler la situation d’une personne au regard de son inscription dans divers fichiers de sécurité ainsi que du fichier des personnes recherchées (FPR) ; la majorité des personnes recherchées sont d’ailleurs retrouvées à l’occasion d’une consultation de ce fichier.
La procédure hybride proposée par l’article 18 s’appliquerait dès lors qu’il existe des raisons sérieuses de penser que le comportement de la personne est lié à des activités à caractère terroriste ou qu’elle est en relation directe et non fortuite avec une personne ayant un tel comportement. Qui plus est, elle ne s’accompagnerait d’aucune garantie pour la personne retenue alors même que la garde à vue pourrait s’appliquer dans ce cas.
Pour toutes ces raisons, nous proposons de supprimer l’article 18.
M. le rapporteur. J’aimerais repréciser les raisons qui ont motivé l’insertion de cet article dans le projet de loi.
Toutes les dispositions proposées dans ce texte ont pour but de couvrir et d’encadrer par le droit des « angles morts », constatés depuis des années et plus particulièrement au cours de l’année écoulée, autrement dit des situations face auxquelles nos services de police et de la justice perdent toute efficacité car il leur est impossible d’y répondre en l’état actuel du droit.
Les modalités du contrôle d’identité sont encadrées par la loi et il existe un contrôle a posteriori visant à s’assurer qu’il a été effectué de manière conforme à la loi.
Si, à l’issue de ce contrôle d’identité, la découverte d’une infraction permet le placement immédiat en garde à vue, il n’y a pas de difficulté. Mais ce contrôle peut être également l’occasion de s’apercevoir que l’individu fait l’objet d’une de ces fameuses fiches S. Or la fiche S n’est qu’un simple élément de renseignement ; contrairement aux inepties que l’on a pu entendre sur certains bancs de l’Assemblée ou durant certaines campagnes électorales récentes, elle ne saurait constituer en aucun cas un motif suffisant pour placer systématiquement une personne en garde à vue. D’autant qu’une fiche S est constituée d’informations recueillies sur une longue durée ; certains renseignements devenus obsolètes nécessitent des compléments d’information.
M. Patrick Devedjian. Il y a de grandes variations.
M. le rapporteur. De ce fait, elle appelle dans la plupart des cas des vérifications. Cela implique d’interroger d’autres fichiers et des services de police, français ou étrangers. Pendant le temps de ces recherches, il convient de s’assurer que la personne concernée ne s’évanouit pas dans la nature. Elle n’est pas placée en garde à vue…
M. Patrick Devedjian. Elle doit avoir des droits !
M. le rapporteur. Certes, mais pour bénéficier des droits attachés à la garde à vue, il faudrait qu’elle se soumette à un interrogatoire et diverses autres procédures. Dans le cas qui nous occupe, elle est simplement retenue sur place pendant quatre heures au maximum.
M. Patrick Devedjian. Cela n’en est pas moins une atteinte à la liberté d’aller et venir !
M. le rapporteur. Monsieur Devedjian, certains collègues de votre groupe ont proposé une durée bien supérieure.
M. Patrick Devedjian. Peu m’importe : je n’ai pas de mandat impératif !
M. le rapporteur. Au lieu de vous gausser, laissez-moi aller au bout de mon explication. Ceux qui jugent cette mesure inutile ou excessivement attentatoire aux libertés publiques voteront la suppression de cet article ; je me borne à expliquer les raisons pour lesquelles il a été proposé.
Cette durée de retenue sur place de quatre heures maximum doit permettre aux policiers et aux gendarmes de consulter un certain nombre de fichiers. À l’issue de ces recherches, ou bien la personne repart librement, ou bien une garde à vue est prononcée, qui lui donnera tous les droits inhérents à cette procédure, et la durée de cette immobilisation préalable sera intégrée dans le calcul de la durée maximale de la garde à vue.
Si l’on admet le bien-fondé de cette procédure de retenue, il convient de l’entourer de toutes les garanties nécessaires. C’est la raison pour laquelle j’ai déposé deux amendements à cet article. Le premier vise à préciser expressément l’objet de la retenue : à partir du moment où ce que l’on a le droit de faire pendant ce temps maximal de quatre heures est inscrit dans la loi, on ne peut faire autre chose. Le second vise à trancher la question des mineurs.
J’entends parfaitement que l’on soit opposé au principe même de la mesure, ce qui conduirait à supprimer l’article 18 ; pour ma part, je n’y suis pas défavorable car j’y vois une nécessité, et c’est pourquoi j’ai déposé des amendements qui garantiront les droits des personnes faisant l’objet d’une retenue et éviteront que cette procédure ne fasse l’objet de reproches au regard tant de sa constitutionnalité que de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme.
Vous l’aurez compris, mon avis sur les amendements de suppression est défavorable.
M. Patrick Devedjian. Les fiches S sont établies de manière incontrôlée, incontrôlable, voire aléatoire. Une haute autorité – je ne préciserai pas laquelle pour ne pas lui nuire – m’a indiqué que les deux tiers des inscriptions étaient extrêmement discutables.
Ce qui est choquant dans cette procédure, c’est que le seul fait pour ces gens d’être inscrit sur une fiche S vaut réduction de leurs droits : ils pourront être « retenus » pendant quatre heures, autrement dit subir une atteinte à leur liberté d’aller et venir. Il me paraît utile ici, n’en déplaise au Conseil d’État et au Conseil constitutionnel, de rappeler la définition de la liberté telle qu’elle figure à l’article 4 de la Déclaration universelle des droits de l’homme et du citoyen : « La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui ». Point final !
Je suis scandalisé par la distinction totalement arbitraire opérée par le Conseil constitutionnel entre privation de liberté et restriction de liberté, qui voudrait qu’en dessous de douze heures d’assignation à résidence, il n’y aurait pas d’atteinte aux droits garantis par l’article 66 de la Constitution. Je conteste cette jurisprudence : elle est en contradiction totale avec l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme.
Cette distinction était déjà très discutable quand elle restait du domaine de la théorie. La voilà maintenant intégrée dans la pratique quotidienne des forces de l’ordre, elle est inacceptable : ce sont les libertés individuelles mêmes qui sont mises en cause, sans qu’aucun contrôle ne s’exerce. La personne concernée ne peut même pas savoir pourquoi elle a fait l’objet d’une inscription au fichier S !
Des contentieux devant la juridiction administrative sont en cours et j’ai la conviction que certains recours aboutiront. Je citerai le cas d’une personne qui a été retenue pendant quatre heures et a fait l’objet d’une perquisition simplement parce qu’elle avait montré du doigt un policier, lequel a interprété ce geste comme une menace au motif qu’il simulait un pistolet !
Des conduites aussi banales que celle-ci peuvent aboutir à des mesures attentatoires à la liberté particulièrement graves. La lutte contre le terrorisme est une chose, mais la fin ne justifie par les moyens.
M. le rapporteur. J’aimerais simplement rappeler qu’aux termes de l’article 18, une personne peut faire l’objet d’une retenue « lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement est lié à des activités à caractère terroriste ou qu’elle est en relation directe et non fortuite avec une personne ayant un tel comportement ». Autrement dit, les personnes potentiellement concernées ne sont pas tous les gens faisant l’objet d’une fiche S mais avant tout ceux relevant d’une fiche S14 – djihadiste revenu d’Irak ou de Syrie – ou S15 – personne soupçonnée de radicalisation islamiste.
M. Patrick Devedjian. Et comment contrôle-t-on cela ? Comment une personne fichée peut-elle vérifier le bien-fondé de son inscription ?
M. le rapporteur. N’oubliez pas que l’article prévoit que le procureur de la République doit être informé sans délai.
M. Sergio Coronado. Ce qui me paraît étonnant, c’est l’assurance de M. le rapporteur quant à la manière dont ces fiches sont établies…
C’est un monde que je découvre et j’ai moins d’expérience que vous. Mais j’ai été particulièrement surpris par un cas dont j’ai été saisi, celui d’un fonctionnaire en poste à l’étranger. Il est parti rejoindre son affectation muni du passeport de service qui lui a été délivré après vérification du ministère de l’intérieur. Le lundi 16 novembre, trois jours après les attentats, il a été convoqué par l’officier de sécurité du poste diplomatique auquel il était rattaché puis renvoyé en France, sans explications, au motif qu’il faisait l’objet d’une fiche S. À l’aéroport, les policiers à qui il a eu affaire lui ont couru après pour l’interroger, tout en reconnaissant qu’ils n’avaient pas grand-chose à lui reprocher. Et depuis qu’il est revenu, il se débat dans les méandres de l’administration. Il ne parvient pas à savoir ce qu’on lui reproche et ignore comme faire supprimer sa fiche S.
Je crois que certains n’ont pas encore mesuré l’étendue des dégâts que la situation que nous vivons provoque – et je ne parle pas seulement des opérations de police administrative mais de l’ambiance générale que tout cela suscite. Il faut bien avoir à l’esprit le fait que ces fiches S sont établies de manière tout à fait subjective et aléatoire.
Mme Marie-Anne Chapdelaine. Cet article pose de multiples questions en termes de respect du droit et plus encore s’agissant des mineurs. Quelle que soit la façon de formuler l’accompagnement dont ils feront l’objet – par un parent, par un tuteur, par une personne mandatée –, leur retenue n’en restera pas moins une mesure d’exception. Même à dix-sept ans trois quarts, une personne reste mineure. Une barrière a été fixée. Selon moi, les mineurs ne doivent absolument pas être concernés par cet article. C’est la raison pour laquelle je voterai ces amendements de suppression.
M. Alain Tourret. Parmi tous les criminels impliqués dans des attentats en 2015, combien faisaient l’objet d’une fiche S ?
M. le rapporteur. Certains terroristes n’étaient pas de nationalité française. Quant à ceux qui l’étaient – sans pouvoir être totalement affirmatif, car il s’agit d’informations relevant du ministère de l’intérieur –, j’ai cru comprendre que la plupart faisaient l’objet d’une fiche S, parfois ancienne dans la mesure où ils avaient quitté le territoire national depuis un moment. Lorsque Salah Abdeslam, franco-belge, a été contrôlé par des douaniers non loin de la frontière belge, après les attentats, l’information selon laquelle il faisait partie des individus dangereux recherchés n’était pas encore parvenue ; on l’a laissé repartir, puisqu’il était en règle… Et pourtant, d’après ce que j’ai compris, il faisait l’objet d’une fiche S.
M. Patrick Devedjian. Autrement dit, ce n’est pas efficace.
M. le rapporteur. Monsieur Devedjian, vous êtes d’une malhonnêteté insigne ! Je suis précisément en train d’essayer de vous expliquer qu’avec ce dispositif, il aurait pu faire l’objet d’une retenue. Et j’avais l’honnêteté intellectuelle d’indiquer que ce n’était pas certain !
M. Patrick Devedjian. Ce n’est pas parce qu’on n’est pas d’accord avec vous qu’on est nécessairement malhonnête !
M. Alain Tourret. J’ai une autre question : parmi toutes les personnes qui ont fait l’objet de perquisitions ou d’assignations à résidence, sait-on combien faisaient l’objet d’une fiche S ?
M. le président. Je pense que non. Mais cette question a son intérêt dans le cadre du contrôle parlementaire et elle peut donner lieu à des vérifications.
Mme Sandrine Mazetier. Je comprends l’agacement du rapporteur quand il est empêché d’aller au bout de son argumentation, mais il faut qu’il prenne en compte le passé de cette commission et le passé tout court.
Je renverrai l’ensemble de mes collègues à ce qui s’est passé lors de l’avant-dernière campagne pour les élections régionales. Un candidat socialiste a été accusé d’être un délinquant multirécidiviste par des candidats d’une autre liste dont certains avaient accès aux fichiers de police. En réalité, il portait le même nom qu’une personne ayant eu maille à partir avec la maréchaussée. Des homonymes, il y en a beaucoup dans ce pays… N’y a-t-il pas lieu de craindre que certaines personnes ayant le malheur de porter le même nom qu’un individu fiché S ne se trouvent retenues pendant quatre heures ?
M. le président. Madame Mazetier, je comprends vos craintes mais le nom seul ne suffit pas à établir l’identité d’un individu lors de contrôles de police. Des recoupements sont opérés à partir de la date de naissance, qui figure sur les fiches. La seule homonymie ne suffit pas.
M. le rapporteur. Je me souviens parfaitement du cas auquel Mme Mazetier fait référence puisqu’il s’agit d’un élu de mon département. Pour l’exactitude des faits, je dois préciser que c’était la consultation non de fiches S, mais du casier judiciaire qui avait conduit à cette approximation douteuse.
Par ailleurs, l’argument de l’homonymie ne vaut pas spécifiquement pour la retenue : une confusion de personnes peut amener à se retrouver temporairement privé de liberté au moment d’un contrôle, et parfois plus de quatre heures, parce qu’un homonyme fait l’objet d’un avis de recherche, parfois même d’un mandat d’arrêt.
M. Patrick Devedjian. Oui, mais il y a une grande différence : la personne indûment gardée à vue peut exiger des réparations alors que ce n’est pas possible dans le cadre de la retenue !
M. Jean-Yves Le Bouillonnec. Nous sommes face à un problème de fond : il n’est pas possible de priver un individu de liberté sans garanties extrêmement strictes. C’est ce qui explique l’évolution historique de ce processus qui amène à priver quelqu’un de sa liberté : nous n’avons cessé d’année en année de faire en sorte que la garde à vue soit assortie de toutes sortes de garanties, jusqu’au principe du contradictoire. Or le dispositif législatif que nous examinons va encore ouvrir des champs nouveaux.
Nous sommes dans une volonté permanente de ne jamais priver quelqu’un de sa liberté en prenant le risque d’une décision arbitraire. Le risque d’arbitraire est couvert par le processus judiciaire : la rétention administrative d’un étranger sans titre de séjour, par exemple, est accompagnée juridiquement de manière extrêmement forte.
La loi de 2006 a instauré la rétention dans les locaux de police aux fins de vérification d’identité. J’avais déjà contesté ce dispositif au motif qu’il ne saurait y avoir de rétention administrative « sèche ». Je suis troublé de voir à nouveau recourir à cette procédure qui, en la circonstance, n’est plus justifiée par aucun élément concret, mais seulement motivée par la nécessité de vérifier une hypothèse… Qui plus est, ceux qui vérifient sont les mêmes que ceux qui prennent la décision de placer l’individu en rétention. L’intervention du judiciaire, à l’inverse, a le mérite de détacher le fait générateur de la rétention de la décision du placement en rétention.
Ajoutons que la rédaction de l’article 18 est extrêmement complexe. Elle renvoie à des « activités à caractère terroriste » ou à une « relation directe et non fortuite avec une personne ayant un tel comportement ». Les motifs de la rétention sont donc considérablement élargis : il peut s’agir de liens familiaux, voire de simples liens de voisinage. J’estime qu’ils ne sont pas assez précis pour échapper au soupçon d’arbitraire.
Je suis extrêmement gêné par cet article 18. La garde à vue est un dispositif suffisamment « bétonné » pour servir de matière de droit commun pour toute privation de la liberté.
M. le rapporteur. Avant que le président ne mette aux voix ces amendements, j’appelle l’attention de mes collègues sur le fait que s’ils sont adoptés, l’article 18 sera purement et simplement supprimé. Nous n’examinerons pas alors les amendements qui ont fait l’objet de très longues discussions et même, à ce que j’avais cru comprendre, d’un accord.
M. Patrick Devedjian. C’est faire preuve d’honnêteté intellectuelle que de le dire !
M. le président. Chers collègues, je comprends les difficultés que suscite cet article 18 et je n’ai pas de solution. J’appelle simplement votre attention sur le fait que la garde à vue, qui est bel et bien un dispositif protecteur, monsieur Le Bouillonnec, aboutira dans les faits à une retenue d’au moins trois heures, le temps de faire venir un avocat, un médecin, etc.
M. Patrick Devedjian. Robespierre disait : « périssent les colonies plutôt qu’un principe ».
M. le président. Certes, mais il n’a pas bien fini et il n’a toujours pas respecté ce principe à la lettre…
M. Alain Tourret. En tant que président de président du Club des amis de l’Incorruptible, je me permets de rappeler que Robespierre est l’auteur des plus beaux discours en faveur de l’abolition de la peine de mort.
Mme Marie-Françoise Bechtel. En tant que députée de la circonscription de Saint-Just, je ne peux qu’approuver mon collègue.
La séance, suspendue à dix-sept heures cinq, est reprise à dix-sept heures vingt.
Mme Élisabeth Pochon. Ce débat montre que nous cherchons tous un équilibre : nous voulons protéger nos concitoyens, nous voulons aussi conserver notre âme en préservant les libertés publiques. Notre groupe ne votera pas les amendements de suppression, car nous souhaitons pouvoir débattre d’amendements qui proposent de meilleures rédactions de l’article, voire exiger d’autres changements en vue de la séance publique.
M. Alain Tourret. À mon sens, il fallait envoyer un signal en faveur des libertés. J’ai le sentiment que, jour après jour, depuis le mois de novembre, on va plus loin dans l’autre sens. J’ai voté jusqu’ici les lois proposées sur ce sujet ; mais je me sens aujourd’hui très mal à l’aise. De plus, il aurait été bon de conforter la situation de M. Devedjian, qui doit être bien minoritaire au sein de son propre groupe…
M. le président Dominique Raimbourg. Il n’en demandait pas tant !
M. Patrick Devedjian. C’est un argument que je n’ai pas employé, vous l’aurez remarqué !
M. Alain Tourret. Je sais que mon vote n’aura que peu d’influence, au vu du nombre de commissaires socialistes présents ; je voterai l’amendement de suppression.
La Commission rejette les amendements CL96 et CL189.
Elle se saisit alors de l’amendement CL363 du rapporteur.
M. le rapporteur. Chacun est animé ici, je crois, du même souci : faire en sorte que les services chargés de nous protéger et de rendre la justice disposent de moyens efficaces pour remplir leur mission, sans que ces dispositifs ne remettent en cause les libertés publiques auxquelles tout républicain – au sens commun du terme, s’entend – est attaché.
Je me suis efforcé, dans cet amendement, de renforcer l’encadrement de cette nouvelle procédure de vérification, dont j’ai rappelé tout à l’heure – au cours de nos passionnants échanges – les raisons pour laquelle elle est proposée. Il est précisé qu’il s’agit d’un contrôle réalisé par un officier de police judiciaire permettant de consulter les traitements automatisés de données à caractère personnel relevant de l’article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, selon les règles propres à chacun de ces traitements, et le cas échéant d’interroger les services à l’origine du signalement de l’intéressé ainsi que des organismes de coopération internationale en matière de police judiciaire ou des services de police étrangers. Autrement dit, nous définissons ce qu’il est possible de faire pendant la période de quatre heures : tout ce qui n’est pas explicitement décrit comme possible est interdit.
J’ai bien conscience que cet amendement, s’il améliore le projet de loi, n’est pas encore pleinement satisfaisant ; je comprends ceux qui ont, pour cette raison, pensé voter les amendements de suppression, et je remercie celles et ceux qui – notamment au sein du groupe socialiste – ne l’ont pas fait, nous permettant ainsi de continuer à débattre. Nous devons continuer de rechercher une rédaction aussi équilibrée que possible : il est à mon sens essentiel de ne pas laisser quelqu’un s’évanouir dans la nature quand il faudrait deux ou trois heures pour rassembler les éléments qui permettraient de le mettre en garde à vue, ou au contraire de lever des soupçons ; mais il ne faut pas aboutir à une procédure qui constituerait une retenue arbitraire. Je ne crois pas, au vu de la jurisprudence, que cela soit le cas avec cette rédaction, mais nous allons nous efforcer de l’améliorer encore.
Mais j’ai la conviction que nous pouvons encore améliorer la rédaction de l’article, et nous allons nous y attacher.
La Commission adopte l’amendement.
Puis elle examine l’amendement CL190 de M. Sergio Coronado.
M. Sergio Coronado. J’ai bien noté que le rapporteur était soucieux de mieux encadrer cette mesure de privation de liberté ; cet amendement vise justement à préciser la notification des droits à la personne retenue. Le dispositif prévu est absolument lacunaire ; il ne prévoit qu’une information de la famille, et pas forcément d’un proche. Il ne prévoit pas une notification précise des droits de la personne retenue : le droit de faire prévenir un proche et son employeur ainsi que, si elle est de nationalité étrangère, les autorités consulaires de l’État dont elle est ressortissante, le droit d’être examinée par un médecin, le droit d’être assistée par un avocat.
Il n’est pas non plus prévu de notifier le droit au silence, ni d’informer sur la durée maximale de la mesure.
Il semblerait incohérent de ne pas notifier ces droits, alors que le Parlement vient d’adopter une loi pour transposer la directive 2012/13/UE du 22 mai 2012 relative au droit à l’information dans le cadre des procédures pénales.
La rédaction de cet amendement est calquée sur celle de l’article 141-4 du code de procédure pénale.
M. le rapporteur. Avis défavorable. Je comprends très bien, intellectuellement, que vous refusiez pour des raisons de principe l’instauration d’un dispositif intermédiaire entre le contrôle d’identité et la garde à vue – vous avez été quelques-uns à exprimer ce point de vue avec force. Mais, justement, cette procédure intermédiaire n’est pas une garde à vue ! En calquant les droits des personnes retenues dans le cadre de cette nouvelle procédure sur ceux d’une garde à vue, ce que justement elle n’est pas, ce que vous proposez, finalement, serait une sous-garde à vue.
M. Patrick Devedjian. Karl Marx avait raison : l’histoire ne se répète pas, elle bégaie…
Souvenons-nous de l’histoire de la garde à vue pour comprendre ce qui est en train de se passer : la garde à vue a été introduite lorsqu’en 1897, l’avocat a été autorisé à assister son client chez le juge d’instruction. Autrement dit, elle n’a été inventée que pour faire échec à la présence de l’avocat aux côtés de l’accusé.
Comme l’a très justement rappelé M. Jean-Yves Le Bouillonnec, le mouvement de l’histoire a fait progressivement refluer cette malice répressive, et les garanties ont été peu à peu renforcées, jusqu’en 2006. L’État de droit et les libertés individuelles ont progressé.
Ce soir, vous refaites le coup de la fin du XIXe siècle, en inventant la rétention sans garantie ! Puisque vous inventez un nouveau truc pour vous débarrasser de la garde à vue, pour ne plus subir ses contraintes, nous reprenons le flambeau de nos ancêtres en proposant de doter la retenue des garanties de libertés individuelles. C’est le mouvement historique. Karl Marx avait raison…
M. Alain Tourret. Toute ma vie d’avocat m’invite à réagir aux propos de M. Devedjian. Il a entièrement raison, et je ne vous suis plus. Ce que vous proposez, c’est une mise au secret. Parmi les droits proposés, nous pourrions en retenir au moins un, deux ou trois – au moins la présence du médecin ! J’ai moi-même défendu des gens interrogés par ceux-là même qui les avaient cabossés… C’est cela aussi, la vérité des choses.
M. le président Dominique Raimbourg. Dans la mesure où cette retenue n’est pas une garde à vue, il n’y aura pas d’audition : en aucun cas on ne peut dresser de procès-verbal relatant les dires de l’intéressé et susceptible de servir de preuve. Il ne peut y avoir qu’un procès-verbal dans lequel l’officier de police judiciaire récapitulera les diligences qu’il a faites.
Je suis assez favorable à ce que dit M. Tourret sur la présence au moins du médecin. Mais tout ceci doit être retravaillé avant la séance publique.
M. Patrick Devedjian. Tant qu’on n’aura pas de mort en cellule, on n’aura pas de médecin !
M. le rapporteur. Votre rapporteur, mes chers collègues, admire le talent de plaidoirie qui vient de se déployer. Mais il est également surpris que l’on occulte, en convoquant l’histoire, des éléments de notre droit actuel qui n’ont jamais suscité de telles déclarations enflammées.
L’article 78-3 du code de procédure pénale prévoit le cas d’une personne qui « refuse ou se trouve dans l’impossibilité de justifier de son identité ». Les dispositions prévues ici sont exactement calquées sur cet article : ce n’est donc nullement un objet non identifié. Ce que nous proposons de faire, pour des personnes qui sont soupçonnées de tout autre chose que d’un vol de poule…
M. Sergio Coronado. Pas du tout, il n’y a besoin que de leur reprocher un « comportement » !
M. le rapporteur. Non, ce n’est pas seulement un comportement : au moment du contrôle d’identité, la consultation de différents fichiers crée un doute, et donc la nécessité d’une vérification des informations.
Ce qui est proposé reprend en tout cas rigoureusement ce qui existe, sans avocat, sans médecin, sans procès-verbal d’audition, quand une personne ne peut pas justifier de son identité, ou refuse de le faire !
M. Patrick Devedjian. Ce sont des cas très différents !
M. le rapporteur. S’il est attentatoire aux droits individuels des personnes de permettre une retenue pour suspicion de terrorisme, il est a fortiori attentatoire à ces mêmes droits de prévoir une retenue pour le seul motif que l’on n’a pas ses papiers ou que l’on refuse de les donner.
M. Jean-Yves Le Bouillonnec. J’ai, tout à l’heure, évoqué ce dispositif, monsieur le rapporteur – en le critiquant : en 2006, notre groupe avait déjà querellé cette mesure qui nous semblait ouvrir un champ de possibles ultérieurs en inscrivant dans la loi le principe d’une rétention de nature administrative susceptible d’entamer les garanties des droits – droits qui ont plutôt progressé depuis 2006, puisque nous avons effectivement intégré l’an dernier à notre droit les dispositions de la directive européenne sur la garde à vue.
On notera que la justification d’identité est un élément matériel précis : je justifie, ou je ne justifie pas. De plus, personne n’a l’obligation de porter sur soi un document prouvant son identité. On peut donc – même si cela me paraît totalement critiquable – comprendre le principe d’une retenue qui, à tout le moins, s’appuie sur un élément factuel précis, bien défini.
Ici, c’est tout à fait autre chose : on parle d’une personne dont « il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement est lié à des activités à caractère terroriste ou qu’elle est en relation directe et non fortuite avec une personne ayant un tel comportement ». Dans le premier cas, il n’est pas explicitement question de fiche S. Dans le second cas, il ne s’agit plus que d’une relation ! Il s’agit alors de construire des éléments susceptibles de mieux faire connaître la réalité des actes de celui qui est suspecté de terrorisme. On n’est plus dans la simple vérification d’identité.
M. Alain Tourret. Si le parti socialiste était tout entier dans l’opposition, ou tout entier dans la majorité, les choses seraient plus claires…
Mme la rapporteure. Monsieur le rapporteur, votre amendement et vos propos nous ont permis, et je vous en remercie, de mieux comprendre les raisons qui doivent mener à la création de cette nouvelle procédure de privation de liberté – car, ne nous racontons pas d’histoire, il s’agit bel et bien de priver quelqu’un de liberté pendant quatre heures. Notre droit connaît d’ailleurs déjà de tels mécanismes : je pense par exemple à la retenue douanière. Mais, si nous savons pourquoi cette nouvelle procédure serait utile, nous devons maintenant savoir qui elle concerne précisément. M. Coronado a raison sur ce point : la rédaction fait bien référence à un simple « comportement ». Le Gouvernement doit donc retravailler son texte, car il pose sur ce point une réelle difficulté.
Quant à votre comparaison avec le contrôle d’identité, elle ne me paraît pas appropriée : en effet, celui-ci ne fait pas grief – une fois le contrôle terminé, on est libre – à l’inverse de cette nouvelle procédure, qui peut précéder une garde à vue.
Pourquoi ne pas prévoir que l’on doit non pas simplement informer le procureur, mais, au-delà d’une heure ou deux peut-être, lui demander l’autorisation de continuer de retenir la personne ?
M. Patrick Devedjian. Les arguments qui viennent d’être avancés par M. Jean-Yves Le Bouillonnec et Mme Colette Capdevielle sont excellents. En revanche, monsieur le rapporteur, votre comparaison avec l’article 78-3 du code de procédure pénale ne me paraît pas recevable, si on se donne la peine de le lire jusqu’au bout. Que dit exactement cet article – créé, je le note au passage, par une loi du 10 juin 1983 ? « Si l’intéressé refuse ou se trouve dans l’impossibilité de justifier de son identité, il peut, en cas de nécessité, être retenu sur place ou dans le local de police où il est conduit aux fins de vérification de son identité. Dans tous les cas, il est présenté immédiatement à un officier de police judiciaire qui le met en mesure de fournir par tout moyen les éléments permettant d’établir son identité et qui procède, s’il y a lieu, aux opérations de vérification nécessaires. Il est aussitôt informé par celui-ci de son droit de faire aviser le procureur de la République de la vérification dont il fait l’objet et de prévenir à tout moment sa famille ou toute personne de son choix. Si des circonstances particulières l’exigent, l’officier de police judiciaire prévient lui-même la famille ou la personne choisie. » Ce n’est pas tout à fait le dispositif que vous nous proposez !
M. le rapporteur. J’ai pour ma part lu jusqu’au bout l’article 78-3 du code de procédure pénale, monsieur Devedjian, mais également l’article 18 du projet de loi… C’est effectivement différent, je vous le concède : dans l’article 78-3, le procureur est prévenu à la demande de la personne retenue ; dans l’article 18, il l’est systématiquement, ce qui protège davantage la personne retenue !
On peut déjà ici prévenir la famille, et un amendement prévoit que l’on peut faire prévenir la personne de son choix.
Quant au médecin, il ne figure ni dans l’un ni dans l’autre article.
M. Patrick Devedjian. Vous ne voulez donc pas du médecin !
Mme Cécile Untermaier. Un travail avec le Gouvernement est nécessaire : je m’interroge, et nous avons besoin de savoir quel public est visé. Nous recherchons tous l’efficacité. Mais pourquoi prévoir un dispositif dérogatoire, alors que nous disposons déjà de tout un arsenal de mesures, notamment la garde à vue mais aussi l’audition libre ? Nous avons transposé, en 2015, une directive européenne qui permet d’entendre un suspect libre ; s’il décide de se taire ou de partir, alors la seule solution est de le placer en garde à vue. Il me semble que nous pourrions travailler sur cette possibilité, qui comporte toutes les garanties nécessaires – quitte à l’améliorer.
Par ailleurs, il est peut-être plus efficace que le procureur de la République soit informé lorsque l’intéressé le réclame, plutôt que de façon automatique et administrative : le regard du procureur sera alors différent. Il sera dans l’obligation de se pencher sur le dossier : quand une personne retenue réclame que le procureur de la République soit avisé, on peut penser qu’elle s’interroge également sur le bien-fondé de la retenue dont elle fait l’objet.
M. le président Dominique Raimbourg. De l’avis général, l’article 18 ne donne pas satisfaction. Il est indispensable qu’un travail de réécriture soit mené d’ici à la séance publique afin que ce dispositif soit mieux encadré, et assure mieux la protection des libertés publiques.
M. le rapporteur. L’amendement CL363 a réglé, me semble-t-il, une partie des problèmes en dressant la liste de ce qu’il est possible de faire pendant cette période de retenue – dès lors que l’on admet la légitimité de cette retenue de quatre heures, autrement dit le principe d’une procédure intermédiaire entre le contrôle d’identité et la garde à vue. L’écriture de l’article demeure perfectible, et je fais là miennes les remarques de Mme la rapporteure. D’ici à la séance, il faut donc travailler, avec le Gouvernement. Je serai moi-même force de proposition pour essayer de trouver un équilibre satisfaisant.
Le Gouvernement suit attentivement nos débats, et il aura compris la nécessité de retravailler ce texte pour le rendre acceptable – par ceux, en tout cas, qui ne sont pas opposés au principe même de cette retenue. Nous ne convaincrons pas les autres.
Mme Françoise Descamps-Crosnier. J’entends bien tout ce qui est dit ; l’article 18 doit être réécrit, sur la base de l’amendement du rapporteur. Certains pourraient avoir envie de voter l’amendement CL190, mais le texte deviendrait un méli-mélo auquel on ne comprendrait plus rien. Attendons la séance pour réécrire correctement l’ensemble.
La Commission rejette l’amendement CL190.
Elle examine ensuite l’amendement CL161 de Mme Élisabeth Pochon.
Mme Élisabeth Pochon. Il s’agit d’un amendement de cohérence. Il permet également à la personne retenue de faire prévenir une personne de son choix, et non pas seulement une personne de sa famille.
M. le rapporteur. Avis favorable. L’amendement améliore et clarifie la rédaction.
La Commission adopte l’amendement.
Puis, suivant l’avis défavorable du rapporteur, elle rejette l’amendement CL97 de M. Patrick Devedjian.
Elle adopte ensuite successivement l’amendement de précision CL236 et l’amendement rédactionnel CL237, tous deux du rapporteur.
Puis elle se saisit de l’amendement CL11 de M. Éric Ciotti.
M. Pierre Morel-A-L’Huissier. Le délai de quatre heures apparaît insuffisant pour effectuer toutes les vérifications nécessaires. Cet amendement vise donc à le porter à huit heures.
M. le président Dominique Raimbourg. Compte tenu des débats que nous venons d’avoir, je doute que cet amendement connaisse une issue favorable…
M. Patrick Devedjian. Peut-être devrais-je demander une suspension de séance pour réunir mon groupe. (Rires.)
M. le rapporteur. Merci, monsieur Morel-A-L’Huissier : vous montrez par votre amendement que la diversité des points de vue n’est pas l’apanage d’un seul groupe. Entre la suppression pure et simple et le doublement, restons-en à quatre heures… Avis défavorable.
Aucun des acteurs que nous avons rencontrés pour préparer notre rapport n’a jugé qu’il était nécessaire d’aller au-delà de quatre heures ; ils ont même considéré – je le dis à la fois à ceux qui voudraient une retenue de huit heures et à ceux qu’une retenue quelle qu’elle soit inquiète – que la durée de quatre heures était un maximum qui ne devrait pas être souvent atteint : cela ne pourrait correspondre qu’à des cas très complexes, où il faudrait interroger des fichiers à l’étranger, par exemple.
La Commission rejette l’amendement.
Puis elle examine, en discussion commune, les amendements CL364 du rapporteur et CL191 de M. Sergio Coronado.
M. le rapporteur. Cet amendement ne vise qu’à mettre le pied dans la porte : je vous le dis d’emblée, il n’est pas encore satisfaisant.
Il concerne les mineurs. Dans mon esprit, comme dans celui d’un grand nombre de mes collègues, s’il y a parfois peu de différence entre la dangerosité potentielle d’un individu qui n’a pas tout à fait dix-huit ans et celui qui vient tout juste de passer cette barre, il n’empêche que l’on ne peut accepter le principe de laisser un mineur seul dans un commissariat, sans l’assistance nécessaire.
Lorsque le représentant légal prévu par le texte est là, les principes généraux du droit sont à mon sens respectés. S’il ne peut pas être là, ou s’il n’existe pas, la solution que je vous propose – mauvaise, j’en ai conscience – consiste à permettre que le mineur soit assisté d’un tuteur désigné par le juge des enfants sur saisine du procureur de la République. Cet amendement, je le redis, propose une solution d’attente : il nous faudra mieux d’ici à la séance publique.
M. Sergio Coronado. Mon amendement porte sur le même sujet, mais il entend en rester aux principes : il ne doit y avoir aucune exception au fait qu’un mineur soit assisté lors de la retenue. De plus, il me semble que l’impossibilité est ici mal définie, ce qui revient à laisser une forte marge d’appréciation aux forces de police et de gendarmerie.
M. Erwann Binet. Le terme de « tuteur » est-il conforme à votre intention ? Ne serait-il pas préférable d’utiliser celui d’« administrateur ad hoc », que l’on connaît dans d’autres situations, dans les zones d’attentes par exemple ? Il est d’ailleurs déjà très difficile de bénéficier d’un administrateur ad hoc en zone d’attente : pour un simple contrôle d’identité, je ne me fais aucune illusion…
M. Alain Tourret. Je suis gêné par la notion de « mineur de dix-huit ans ». Incontestablement, il y a une évolution sur la notion de majorité. Mais si l’on peut admettre certaines dispositions spécifiques aux mineurs de plus de seize ans, aucune ne devrait être acceptée pour des mineurs de seize ans.
M. le rapporteur. Monsieur Binet, j’ai déjà concédé que mon amendement n’était pas appelé à demeurer tel quel dans le texte : il s’agit en quelque sorte de placer un signet, d’appeler notre attention sur un point particulier.
J’ai pleinement conscience du caractère extrêmement aléatoire, pour ne pas dire plus, du dispositif que je propose. Mais ce serait au bout du compte protecteur pour le mineur : si les conditions ne sont pas réunies, il ne peut pas être gardé !
En revanche, monsieur Coronado, si mon amendement est très faible, le vôtre marque un degré de faiblesse supplémentaire, dans la mesure où il consacre une situation impossible. On ne peut donc inscrire dans la loi que le représentant légal doit impérativement être là quand il n’existe pas ou quand c’est matériellement impossible.
Je vous propose donc de continuer de chercher une solution plus satisfaisante au cours des deux semaines qui nous restent.
La Commission adopte l’amendement CL364.
En conséquence, l’amendement CL191 tombe.
La Commission examine ensuite l’amendement CL192 de M. Sergio Coronado.
M. Sergio Coronado. Le fait que la personne mise en cause doive aviser elle-même le procureur est contradictoire avec l’information systématique du même procureur prévue par l’alinéa 3.
M. le rapporteur. C’est finement observé… Avis favorable.
La Commission adopte l’amendement.
En conséquence, les amendements CL84 de M. Philippe Houillon, CL129 de M. Pascal Cherki et CL150 de M. Michel Zumkeller tombent.
La Commission adopte alors l’article 18 modifié.
Article 19
(art. L. 434–2 [nouveau] du code de la sécurité intérieure, art. L. 4123–12 du code de la défense et art. 56 du code des douanes)
Cadre légal de l’usage des armes par les forces de l’ordre dans le cas d’un périple meurtrier
Le présent article précise le cadre légal de l’usage des armes par les policiers, les gendarmes, les douaniers et les militaires déployés sur le territoire national en renfort des forces de sécurité intérieure, en dehors des cas de légitime défense, dans le cas d’un périple meurtrier durant lequel la légitime défense, y compris pour autrui, ne pourrait être invoquée, mais qui relève d’un état de nécessité.
1. Le cadre légal en matière de légitime défense et d’état de nécessité
Le principe de la légitime défense est aussi vieux que les sociétés humaines. Platon, au livre IX de son traité des lois, affirmait ainsi que : « Si quelqu’un surprend la nuit un voleur qui pénètre dans sa maison pour lui voler son argent et s’il le tue, il sera tenu pour justifié. Il le sera aussi si, pour se défendre contre un détrousseur, il le tue ». Ce principe, certes exprimé dans des termes datés, est aujourd’hui consacré à la fois par le droit conventionnel – article 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (187) – et le droit interne.
L’article 122–5 du code pénal (188) organise la légitime défense, sous les causes d’irresponsabilité pénale, au même titre que l’abolition du discernement, la contrainte, l’erreur de droit, l’autorisation de la loi et l’état de nécessité. Aux termes de cet article, la légitime défense suppose la réunion de plusieurs conditions :
– une agression injuste de soi–même ou d’autrui ;
– une réaction immédiate, nécessaire et proportionnée.
Par ailleurs, l’article 122–6 du même code prévoit deux hypothèses dans lesquelles la légitime défense est présumée (189) :
– lorsque l’auteur de l’acte a repoussé, de nuit, l’entrée par effraction, violence, ou ruse dans un lieu habité ;
– lorsqu’il s’est défendu contre les auteurs de vols ou de pillage exécutés avec violence.
Enfin, aux termes de l’article 122–7, est également considérée irresponsable la personne qui, face à un danger actuel ou imminent qui menace elle-même, autrui ou un bien, accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du bien, sauf s’il y a disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace. Même si cet article n’exclut pas la justification de l’emploi de la force armée, l’esprit du législateur de 1994, confirmé par l’interprétation prétorienne est que le danger ne vient pas a priori d’une agression humaine. Il concerne davantage des cas tels que la commission d’un excès de vitesse pour conduire une personne en danger à l’hôpital.
2. Les règles d’engagement des armes à feu
Les règles d’engagement des armes à feu sont rassemblées dans le code pénal et le code de la sécurité intérieure, un volet particulier se rajoutant pour les gendarmes dans le code de la défense et pour les agents des douanes dans le code des douanes.
Outre le droit commun prévu aux articles 122–5 et 122–7 du code pénal, les représentants de la force publique peuvent faire usage de la force armée afin de disperser un attroupement (articles L. 211-9 du code de la sécurité intérieure et 431–3 du code pénal) soit « après deux sommations de se disperser demeurées sans effet », soit directement « si des violences ou voies de fait sont exercées contre eux et s’ils ne peuvent défendre autrement le terrain qu’ils occupent ».
Les gendarmes peuvent également invoquer le régime d’irresponsabilité pénale reposant sur l’ordre de la loi de façon plus extensive que ne le peuvent les agents de la police nationale. En effet, au-delà des interventions visant à disperser un attroupement précédemment évoquées et celles visant à empêcher une intrusion dans une zone militaire hautement sensible (190), les gendarmes peuvent avoir recours à la force armée, en l’absence de l’autorité judiciaire ou administrative et sans que leur responsabilité pénale ne soit engagée, dans quatre circonstances prévues par l’article L. 2338-3 du code de la défense :
– lorsque des violences ou des voies de fait sont exercées contre eux ou lorsqu’ils sont menacés par des individus armés ;
– lorsqu’ils ne peuvent défendre autrement le terrain qu’ils occupent, les postes ou les personnes qui leur sont confiés, ou si la résistance est telle qu’elle ne puisse être vaincue que par la force des armes ;
– lorsque les personnes invitées à s’arrêter par des appels répétés de « Halte gendarmerie » faits à haute voix cherchent à échapper à leur garde ou à leurs investigations et ne peuvent être contraintes de s’arrêter que par l’usage des armes ;
– lorsqu’ils ne peuvent immobiliser autrement les véhicules, embarcations ou autres moyens de transport dont les conducteurs n’obtempèrent pas à l’ordre d’arrêt.
L’article 56 du code des douanes régit, outre le cas de légitime défense, les cas dans lesquels les agents des douanes peuvent faire usage de leurs armes :
– lorsque des violences ou voies de fait sont exercées contre eux ou lorsqu’ils sont menacés par des individus armés ;
– lorsqu’ils ne peuvent immobiliser autrement les véhicules, embarcations et autres moyens de transport dont les conducteurs n’obtempèrent pas à l’ordre d’arrêt ;
– lorsqu’ils ne peuvent autrement s’opposer au passage d’une réunion de personnes qui ne s’arrêtent pas aux sommations qui leur sont adressées ;
– lorsqu’ils ne peuvent capturer vivants les chiens, les chevaux et autres animaux employés pour la fraude ou que l’on tente d’importer ou d’exporter frauduleusement ou qui circulent irrégulièrement.
3. Le cadre jurisprudentiel
De nombreuses voix s’élèvent pour demander un alignement sur l’un ou l’autre de ces régimes. Pourtant, il faut noter qu’au-delà des textes, ce domaine a été profondément modelé par la jurisprudence, dans un sens restrictif.
À cet égard, la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a joué un rôle très important, en interprétant strictement la condition d’« absolue nécessité » en cas d’atteinte à la vie posée par l’article 2 de la Cconvention.
L’utilisation de la force meurtrière a été examinée pour la première fois dans l’arrêt du 27 septembre 1995 Mc Cann et autres c. Royaume–Uni. La Cour a jugé que l’article 2 n’admet des exceptions au droit à la vie que si le recours à la force est rendu « absolument nécessaire », ces termes indiquant qu’il fallait appliquer un critère de nécessité plus strict et impérieux que celui normalement employé pour déterminer si l’intervention de l’État est « nécessaire dans une société démocratique » au sens du paragraphe 2 des articles 8 à 11 de la Convention (191).
Elle estime que le but légitime d’empêcher l’évasion d’une personne régulièrement détenue et d’effectuer une arrestation régulière ne peut justifier de mettre en danger les vies humaines qu’en cas de nécessité absolue (192). La Cour juge, qu’en principe, il ne peut y avoir pareille nécessité lorsque la personne qui doit être arrêtée ne représente aucune menace pour la vie ou l’intégrité physique de quiconque et qu’elle n’est pas soupçonnée d’avoir commis une infraction à caractère violent, même s’il peut en résulter une impossibilité d’arrêter le fugitif (193).
De manière générale, elle estime que s’il peut s’avérer justifié, dans certaines conditions, tout usage de la force meurtrière doit être strictement proportionné aux circonstances, qui font l’objet d’un examen particulièrement attentif, comme en témoigne l’abondante jurisprudence en la matière (194).
Elle a par ailleurs réitéré le devoir primordial pour l’État d’assurer le droit à la vie en mettant en place un cadre juridique et administratif approprié définissant les circonstances limitées dans lesquelles les représentants de l’application des lois peuvent recourir à la force et faire usage d’armes à feu, compte tenu des lignes directrices internationales en la matière. Conformément au principe de proportionnalité, le cadre juridique national régissant les opérations d’arrestation doit subordonner le recours aux armes à feu à une appréciation minutieuse de la situation et, surtout, à une évaluation de la nature de l’infraction commise par le fugitif et de la menace qu’il représente.
Enfin, la Cour estime que les policiers comme les gendarmes doivent être formés pour être en mesure d’apprécier la nécessité d’utiliser les armes à feu, non seulement en suivant la lettre de la législation mais aussi en tenant compte de la prééminence du respect de la vie humaine en tant que valeur fondamentale (195).
Les juridictions nationales exigent également que le recours aux armes à feu soit absolument nécessaire au regard des circonstances de l’espèce (196). Même dans le cadre légal de l’usage des armes, la juridiction vérifie que les critères d’existence d’un danger actuel, de l’absolue nécessité et de la proportionnalité de la riposte sont réunis.
En outre, il faut noter que la Cour de cassation refuse le bénéfice du régime de l’article L. 2338–3 du code de la défense aux gendarmes exerçant en tenue civile lorsqu’ils sont en service et utilisent leur arme de dotation (197).
De fait, comme il a été pu être noté lors des auditions menées par votre rapporteur, l’utilité d’un cadre juridique énumérant les différents cas d’ouverture du feu est largement atténuée par la prévalence du régime de légitime défense dans le prétoire du juge judiciaire.
Néanmoins, la notion de la légitime défense telle qu’interprétée par le juge judiciaire et le juge européen montre une grande plasticité. Ainsi, dans sa qualification de légitime défense, le juge tient compte des circonstances entourant l’acte et de la manière dont elles peuvent être interprétées par leur auteur, ce qui permet de prendre en compte les cas de légitime défense putative (198). Cela permet d’admettre la légitime défense d’une personne qui peut raisonnablement se croire en présence d’une menace actuelle, alors que cette dernière se révélait a posteriori infirmée (199). Ainsi, s’agissant du siège, en octobre 2002, du théâtre moscovite « Dubrovka » par des séparatistes tchétchènes et la décision de mettre les terroristes hors d’état de nuire et de libérer les otages en diffusant un gaz, la Cour a jugé que compte tenu du profil des terroristes, de leur caractère déterminé, des conséquences potentielles de l’opération terroriste, que l’utilisation d’un gaz était conforme à l’article 2 de la Convention alors même que les autorités ne pouvaient savoir avec certitude si les terroristes auraient effectivement mis leur menace à exécution. Elle a estimé qu’il existait « une menace réelle et sérieuse pour la vie des otages et que l’emploi de la force meurtrière était tôt ou tard inévitable » (§221).
Les mêmes conditions sont appliquées au cas de recours à la force en situation de flagrance. Si la Cour de cassation a admis l’usage de la force pour l’interpellation de l’auteur présumé d’une infraction flagrante, elle a exigé que l’usage de la force soit proportionné aux conditions de l’arrestation (200).
4. La création d’un cadre légal de l’usage des armes par les forces de l’ordre dans le cas d’un périple meurtrier
a. L’appréciation de l’actualité de l’agression pose des difficultés en cas de « périple meurtrier »
Comme le souligne l’étude d’impact, l’appréciation stricte de la concomitance de l’agression et de la riposte, condition nécessaire pour appliquer le principe de légitime défense, soulève certaines difficultés d’appréciation notamment en cas de fuite de l’agresseur et d’évolution de l’agression dans un espace de temps, même très bref : « la législation et l’application jurisprudentielle qui en est faite apparaît insuffisamment prévisible et explicite, et par conséquent sécurisante, pour permettre aux policiers de mesurer l’étendue de leur action lorsqu’ils sont appelés à agir dans un temps distinct de la menace immédiate à la vie d’autrui ou à leur vie et alors que la valeur sacrifiée peut être équivalente ». Elle note que seule une décision de la Cour de cassation a fait application de l’état de nécessité dans le cadre de l’usage d’une arme par un policier (201).
L’analyse des menaces et modes opératoires terroristes actuels, comme l’indique l’étude d’impact, « démontre que les terroristes radicalisés commettent des actions débutant, la plupart du temps, par des assassinats de masse et des prises d’otages meurtrières s’achevant quais–systématiquement par un retranchement afin de mener une confrontation armée volontaire avec les unités d’intervention ». Il faut en outre noter qu’entre une tuerie ou une prise d’otages les terroristes peuvent massacrer des civils sans défense au gré de leurs pérégrinations ou qu’ils peuvent déambuler sans menacer quiconque par un canon d’arme pointé stricto sensu – pas de victime particulièrement visée, pas d’arme apparente.
L’idée d’une présomption de légitime défense au bénéfice des forces de l’ordre a pu constituer pour certains une hypothèse séduisante. En effet, les forces de l’ordre sont de facto plus fréquemment exposées que le reste de la population à des agressions, contre elles ou contre autrui, et de ce fait, à faire un usage de la force.
L’hypothèse de l’introduction d’un nouveau cas de présomption de légitime défense a été écartée par le rapport de M. Mattias Guyomar sur la protection fonctionnelle renforcée des policiers et des gendarmes (202) et par le présent projet de loi. Elle comporte en effet de nombreux inconvénients sans véritablement apporter de solutions à l’hypothèse d’un périple meurtrier. Il faut noter qu’elle serait d’un maniement pour le moins délicat dans les cas de plus en plus fréquents de ports d’armes factices. Surtout, cela bouleverserait le régime de la légitime défense fondé non pas sur la qualité de l’auteur de l’acte, mais sur la nature particulière de la situation à laquelle il est confronté. Enfin, elle ne modifierait rien au droit au recours aux armes à feu tel qu’il est interprété par les juridictions françaises et européennes.
b. La création d’un cadre légal ad hoc
Le I du présent article crée un nouvel article L. 434–2 du code de la sécurité intérieure instituant un nouveau régime d’irresponsabilité pénale en raison de l’état de nécessité. Cette insertion dans le code de la sécurité intérieure plutôt que dans le code pénal se justifie par le fait que le dispositif proposé est une doctrine d’emploi de la force armée, propre aux forces de l’ordre.
Ce régime bénéficie au fonctionnaire de la police nationale ou militaire de la gendarmerie nationale qui fait un usage de son arme rendu absolument nécessaire pour empêcher l’auteur d’un ou plusieurs homicides volontaires ou tentatives d’homicides volontaires dont il existe des raisons réelles et objectives de penser qu’il est susceptible de réitérer d’autres crimes dans un temps rapproché.
Ces dispositions paraissent répondre aux exigences conventionnelles et constitutionnelles :
– la CEDH juge qu’en principe il ne peut y avoir nécessité absolue de mettre en danger les vies humaines que lorsque la personne qui doit être arrêtée représente une menace pour la vie ou l’intégrité physique de quiconque et qu’elle est soupçonnée d’avoir commis une infraction à caractère violent ;
– de même, la Cour a été amenée a jugé compatible avec l’article 2 de la Convention l’usage de la force meurtrière s’il existait « une menace réelle et sérieuse pour la vie » (203).
Le II complète l’article L. 4123–12 du code de la défense pour prévoir l’application du I aux militaires des formes armées déployés sur le territoire national dans le cadre des réquisitions légales pour les besoins de la défense et de la sécurité civiles.
Le III complète l’article 56 du code des douanes pour appliquer aux agents des douanes les dispositions du I.
5. Les modifications opérées par votre commission des Lois
À l’initiative de votre rapporteur, la Commission a adopté un amendement comportant des précisions destinées à éclairer les raisons réelles et objectives pouvant conduire à justifier l’usage des armes dans le cadre de ce nouvel état de nécessité.
En application de l’article 2 § 2 b) de la Convention européenne des droits de l’homme, le but légitime d’effectuer une arrestation régulière ne peut justifier de mettre en danger des vies humaines qu’en cas de nécessité absolue. La Cour estime qu’en principe il ne peut y avoir pareille nécessité lorsque l’on sait que la personne qui doit être arrêtée ne représente aucune menace pour la vie ou l’intégrité physique de quiconque et n’est pas soupçonnée d’avoir commis une infraction à caractère violent, même s’il peut en résulter une impossibilité d’arrêter le fugitif (204).
À l’inverse, le recours à la force meurtrière par des agents de l’État pour atteindre l’un des objectifs de l’article 2 peut se justifier lorsqu’il se fonde sur une conviction honnête considérée, pour de bonnes raisons, comme valable à l’époque des évènements, selon laquelle l’individu est dangereux et susceptible de réitérer ses actes.
Ainsi, l’état de nécessité résulte à la fois de la nature des homicides commis (un ou plusieurs homicides), de la quasi-certitude, au moment où l’agent fait usage de son arme, que leur auteur présumé est déterminé à en commettre d’autres dans un temps voisin, dans le cadre d’un périple meurtrier. L’usage de l’indicatif présent dans cet amendement est destiné à caractériser la certitude de la réitération.
Aux termes de la nouvelle rédaction adoptée par votre Commission, cette appréciation, faite par le fonctionnaire de police ou le militaire de gendarmerie au moment du tir, résulte :
– des circonstances de la première agression (violence extrême, tuerie de masse, attentat…) ;
– du caractère déterminé de leur auteur et de ses motivations (mots d’ordre, revendications…) ;
– de la certitude d’une réitération des homicides ou tentatives d’homicides, dans un temps rapproché ;
– de la nécessité de faire obstacle à la réitération.
*
* *
La Commission examine d’abord l’amendement de suppression CL152 de Mme Sandrine Mazetier.
Mme Élisabeth Pochon. Il s’agit d’un amendement d’appel – que je vais retirer. Nous souhaitions une nouvelle rédaction de l’article 19, qui modifie le cadre légal de l’usage des armes par les forces de l’ordre.
L’amendement est retiré.
La Commission se saisit alors de l’amendement CL120 de Mme Élisabeth Pochon.
Mme Élisabeth Pochon. J’ai participé à un groupe de travail qui s’est réuni à la suite du rejet par le Parlement de la proposition de loi de notre collègue M. Éric Ciotti, au printemps dernier. Les forces de l’ordre ont en effet exprimé un sentiment d’insécurité juridique, dans la mesure où la légitime défense n’est pas toujours applicable aux situations de tueries de masse : ils peuvent devoir sauver des personnes menacées, sans être eux-mêmes mis en joue. Mon amendement CL120 vise à répondre à ce problème précis de l’emploi de la force armée en cas de crime terroriste. Il prévoit notamment un principe d’absolue nécessité et des sommations. Ces dispositions me semblent respecter les notions clés reconnues par la Cour européenne des droits de l’homme que sont le droit à la vie, la proportionnalité dans l’emploi de la force et son absolue nécessité.
M. le rapporteur. Mme Pochon a parfaitement décrit le cheminement de chacun à la lecture de l’article 19.
Lorsque l’on considère qu’un article n’est pas idéalement rédigé, une des logiques est de demander sa suppression. C’était l’objet d’un amendement qu’elle a déposé avec plusieurs collègues et qu’elle a à l’instant souhaité retirer.
Une autre logique consiste à essayer d’améliorer la rédaction. Mme Pochon fait une telle proposition dans cet amendement, s’appuyant sur les critiques formulées contre la rédaction initiale de l’article 19 dans l’avis du Conseil d’État.
Pour ma part, je propose également une autre rédaction dans l’amendement CL356. Je suis donc dans le même état d’esprit que Mme Pochon, et je lui propose de retirer son amendement au profit de celui que je présente, en précisant qu’elle a participé à sa rédaction.
Mme Élisabeth Pochon. Je conviens que la situation de flagrance ne va pas sans poser de problèmes, et qu’il est difficile de ne cibler que des situations liées au terrorisme. Lorsque nous parlons de tueurs de masse, nous pensons immédiatement au terrorisme, mais d’autres situations de tueries de masse, comme nous en avons vu à Colombine aux États-Unis, pourraient un jour survenir en France.
L’amendement que je présente n’est donc pas suffisamment bien rédigé pour que je tienne absolument à le conserver. Je garde encore quelques doutes sur la sommation, qui me semble permettre de donner une dernière chance aux terroristes de faire preuve d’humanité et de poser leurs armes.
L’amendement est retiré.
La Commission examine l’amendement CL356 du rapporteur.
M. le rapporteur. Cet amendement est le résultat d’un travail mené en commun avec Mme Pochon. Nous cherchons la formulation idéale, si tant est que cela soit possible en droit. Je ne suis pas certain que la rédaction que nous vous présentons soit totalement aboutie, nous allons encore y réfléchir d’ici la séance.
En tout cas, notre souci de préciser les circonstances de la première agression, le caractère déterminé de son auteur, la certitude d’une réitération et la nécessité de mettre la personne hors d’état de nuire nous amène à vous proposer de rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 : « au regard des circonstances de la première agression et des informations dont dispose l’agent au moment où il fait usage de son arme, que plusieurs autres de ces actes, participant à une action criminelle visant à causer une pluralité de victimes, soient à nouveau commis par le ou les mêmes auteurs dans un temps rapproché, le fait pour un fonctionnaire de la police nationale ou un militaire de la gendarmerie nationale, de faire un usage de son arme rendu absolument nécessaire pour faire obstacle à cette situation… »
Je ne considère pas que cette rédaction purge totalement le débat, mais je remercie tous ceux qui ont permis d’y aboutir à cette rédaction, car elle marque un net progrès. Nous avons encore un peu de temps pour y travailler d’ici à la séance.
La Commission adopte l’amendement CL356
Elle en vient à l’amendement CL118 de M. Pierre Morel-A-L’Huissier.
M. Pierre Morel-A-L’Huissier. Cet amendement propose d’étendre le dispositif de l’article 19 aux policiers municipaux.
M. le rapporteur. Nous légiférons la main tremblante sur un sujet aussi sensible que celui du cadre légal de l’usage des armes. Nous cherchons les meilleures formules pour les membres de nos forces de l’ordre qui disposent d’une formation spécifique. Cela ne veut pas dire que les policiers municipaux n’ont pas de formation, mais celles que reçoivent les policiers nationaux et les gendarmes sont différentes. Je pense que cette proposition est prématurée.
Mme Cécile Untermaier. Le groupe Socialiste, républicain et citoyen est très réservé sur cette question. La police municipale et la police nationale sont deux choses bien distinctes ; chacune doit rester dans son rôle respectif.
M. Pierre Morel-A-L’Huissier. Cet amendement traduit une demande récurrente des syndicats de policiers municipaux. Ils sont tout de même confrontés à des problèmes de sécurité, et ils considèrent qu’ils sont en danger dans certaines situations.
Le rejet de cet amendement ne serait pas la preuve d’une grande considération à leur endroit.
M. Patrick Devejian. C’est une policière municipale qui a été tuée à Montrouge…
M. le rapporteur. Un policier municipal qui dispose d’une arme bénéficie toujours des règles relatives à la légitime défense et à l’état de nécessité.
Par ailleurs, il n’est pas sûr que les sujets dont nous traitons correspondent aux objectifs assignés aux polices municipales par l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales.
Laissons l’éventuelle nouvelle doctrine d’emploi des armes proposée à cet article 19 faire ses preuves parmi nos forces nationales avant de l’étendre.
M. le président. L’adoption de l’amendement précédent a eu pour effet de faire tomber cet amendement, il n’y a donc pas lieu de le mettre aux voix. Je tenais toutefois à ce que le débat ait lieu.
L’amendement CL118 est tombé.
M. le président. Je tenais à rappeler que cet article 19 a été proposé parce que la police s’est demandé si la légitime défense était constituée au moment où des tireurs d’élite avaient dans leur viseur un terroriste armé qui ne les menaçait pas directement. Il n’est donc pas question d’ouvrir largement la possibilité de faire feu ; je tenais à dissiper les éventuelles inquiétudes qui pourraient exister sur les intentions des forces de police.
La Commission adopte l’article 19 modifié.
La Commission en vient à l’amendement CL1 de M. Éric Ciotti.
M. Pierre Morel-A-L’Huissier. Cet amendement a trait au retour en France d’individus ayant effectué des déplacements à l’étranger afin de participer à des activités terroristes. Il vous est proposé de retirer le passeport et la pièce d’identité française des personnes concernées, lorsque celles-ci ont la double nationalité.
M. le rapporteur. En son article 3 intitulé : « Interdiction de l’expulsion des nationaux », le protocole n° 4 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales prévoit : « Nul ne peut être privé du droit d’entrer sur le territoire de l’État dont il est le ressortissant. »
La mesure que vous proposez n’est donc pas applicable.
La Commission rejette l’amendement.
Article 20
(art. L. 225–1 à 225–6 [nouveaux] du code des douanes)
Contrôle administratif des retours sur le territoire national
Le présent article renforce le contrôle des personnes qui se sont déplacées à l’étranger afin de participer à des activités terroristes, et qui, de retour sur le territoire national, sont susceptibles de constituer une menace pour la sécurité publique.
1. Les ressortissants ou résidents français partis sur les théâtres d’opérations de groupes terroristes
Si le phénomène des ressortissants français se rendant dans des pays en guerre pour participer aux combats n’est pas nouveau, il a pris une ampleur tout à fait inédite au cours des dernières années avec le départ de centaines de jeunes, hommes et femmes, en Syrie, pour rallier des groupes de combattants terroristes. À titre de comparaison, une quarantaine de djihadistes Français seulement avaient combattu en Afghanistan au cours de la dernière décennie.
D’après les chiffres communiqués par le ministre de l’Intérieur le 19 mai 2015 à la commission d’enquête de l’Assemblée nationale sur « la surveillance des filières et des individus djihadistes » (205), 1 683 individus candidats au départ ou effectivement partis ont été recensés. Ce nombre a triplé depuis janvier 2014. On distingue parmi ces personnes :
– 457 individus présents en Syrie ou en Irak, dont 137 femmes et 80 mineurs (dont 45 jeunes filles) ;
– 320 individus considérés comme en transit entre la France et la Syrie ;
– 278 individus détectés comme étant repartis de la zone, dont 213 sont revenus en France ; les autres sont principalement localisés en Turquie et dans les pays du Maghreb ; depuis les premières frappes de la coalition en septembre 2014, le nombre de volontaires ayant regagné la France est passé de 121 à 212, soit une progression de 57 % ;
– 105 présumés morts dont 8 dans des opérations suicides ;
– 2 détenus en Syrie ;
– 521 ayant des projets de départ.
Ces chiffres ne reflètent probablement pas, comme l’a montré le rapport précité, toute l’ampleur du phénomène des départs vers la zone irako-syrienne, ainsi qu’en témoigne le fait que des personnes soient remises par la Turquie aux autorités françaises sans que ces dernières aient eu connaissance de leur départ préalable.
Le phénomène des départs pour le djihad vers la zone irako-syrienne n’est pas propre à la France, le recours aux « combattants étrangers » faisant partie intégrante de la stratégie de Daech : comme l’a indiqué devant la commission d’enquête précitée M. Laurent Fabius, ministre des Affaires étrangères et du développement international, environ 20 000 de ces combattants, originaires de plus d’une centaine de pays, sont recensés dans les rangs de Daech, sur un nombre total de combattants estimé entre 40 000 et 50 000. Plus de 3 000 combattants étrangers proviendraient d’un pays européen.
2. Les retours sur le territoire national
Comme l’a montré le récent rapport de M. Jean–Pierre Sueur, « certaines de ces personnes reviennent en France ou dans d’autres pays européens avec l’intention de commettre des actes terroristes. Ainsi Mehdi Nemmouche, qui a combattu dans les rangs de l’ « État islamique », a commis l’attentat de Bruxelles du 24 mai 2014, tandis que d’autres combattants revenus de Syrie et interceptés par les services français entendaient préparer un attentat sur notre sol.
Le caractère dangereux de ces personnes de retour sur notre territoire est également lié à l’entraînement militaire de niveau professionnel qu’ils reçoivent en Syrie, notamment au sein de l’organisation de l’ « État islamique ». Il est également à craindre que ces jeunes, dont beaucoup de spécialistes s’accordent à reconnaître la fréquente fragilité psychologique, reviennent sur notre territoire avec des pathologies mentales lourdes liées aux événements traumatiques vécus sur les théâtres d’opérations en Syrie. » (206)
Le rapport de la commission d’enquête menée par l’Assemblée nationale établit un constat similaire : « les retours de djihadistes de la zone irako-syrienne sont l’un des facteurs importants de l’aggravation de la menace, la majorité d’entre eux ayant combattu dans les rangs de Daech, qui a officiellement appelé le 21 septembre 2014 à la commission d’attentats terroristes en France et dans les pays participant à la coalition.
Les intentions des djihadistes de retour sur notre territoire peuvent être diverses. M. Farhad Khosrokavar a ainsi distingué lors de son audition les « djihadistes endurcis », durablement endoctrinés et acquis à la violence, les « djihadistes repentants », qui ont pris conscience de l’écart entre leur imaginaire djihadiste et la réalité de Daech, et enfin les « djihadistes traumatisés ».
De l’avis de nombreuses personnes entendues par la commission, il est particulièrement difficile d’évaluer la dangerosité des djihadistes de retour sur notre territoire, notamment parce que certains peuvent avoir des stratégies de dissimulation.
M. Marc Trévidic, alors vice-président chargé de l’instruction au pôle anti-terroriste du tribunal de grande instance de Paris, a néanmoins estimé qu’il existait « des critères objectifs » de dangerosité : « [l]es éléments que je demande à connaître dans le dossier judiciaire d’un individu arrêté pour activités terroristes en Syrie sont les suivants : l’ancienneté et le degré de radicalisation ; la volonté ou la tentative de départ pour le djihad précédemment ; l’expérience du djihad précédemment ; le groupe rejoint ; la durée du séjour ; enfin, ce qu’il a fait là-bas – entraînement, combat, participation à des atrocités ».
Il est désormais acquis que Daech souhaite utiliser des djihadistes occidentaux pour commettre des attentats dans leur pays d’origine et leur retour peut donc avoir été planifié pour mettre en œuvre des projets terroristes élaborés par cette organisation. D’autres djihadistes sont susceptibles de commettre des attentats de leur propre initiative pour obéir à l’appel général de Daech. Enfin, même parmi les djihadistes ayant fui les zones de combat parce qu’ils ont été horrifiés par les atrocités auxquelles ils ont assisté, voire participé, certains peuvent présenter un risque de passage à l’acte, en raison de leur état de fragilité psychologique, s’apparentant à un syndrome post-traumatique. D’autres éléments psychologiques peuvent également avoir un effet, en particulier un sentiment d’humiliation engendré par le retour, vécu comme un échec, susceptible de déclencher un projet terroriste.
La dangerosité des djihadistes de retour est d’autant plus élevée qu’ils ont subi un très fort endoctrinement, suivi un entraînement aux techniques militaires et au maniement des armes et qu’ils ont été confrontés à des niveaux de violence et de barbarie extrêmes. Parmi les récents attentats qui ont frappé la France ou d’autres pays européens, plusieurs ont été commis par des terroristes qui s’étaient rendus dans une zone d’entraînement ou de combat : Mohammed Merah au Waziristan, Mehdi Nemmouche en Syrie ou Saïd Kouachi au Yémen. »
Il est d’ailleurs révélateur de constater que certains djihadistes ayant rejoint la Syrie ne sont pas partis pour combattre sur la ligne de front, mais pour ouvrir des commerces ou des restaurants à Racca ou occuper des fonctions administratives ou judiciaires – un juge islamique de Daech serait ainsi de nationalité française.
Interrogés sur ce point, les services du ministère de l’intérieur reconnaissent qu’« il conviendrait en effet de distinguer les individus partant dans la zone syro-irakienne pour combattre ou apporter leur soutien aux combattants - les "djihadistes" - de ceux et celles souhaitant simplement faire leur hijra, c’est à dire vivre dans un milieu purement islamique. Cependant cette distinction n’est pas aisée à opérer, cette distinction n’étant pas forcément connue, perceptible ni toujours claire dans l’esprit des "partants". »
3. Les réponses judiciaires et administratives actuelles
Au plan administratif, 489 des individus ayant quitté ou tenté de quitter la France pour combattre dans la zone irako–syrienne ont été inscrits au fichier des personnes recherchées (FPR) pour un refus de délivrance ou de renouvellement de passeport. 10 demandes de retrait de passeport ont été transmises à la direction des libertés publiques et des affaires juridiques du ministère de l’intérieur, qui en a validé 3. Enfin, la DGSI et la direction du renseignement territorial ont mené 291 entretiens administratifs préventifs, dont très peu ont permis de dissuader une personne de partir, ce qui montre la force de l’endoctrinement idéologique, réalisé en grande partie via internet.
Le dispositif d’interdiction de sortie du territoire
La loi n° 2014–1353 du 13 novembre 2014 renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme a introduit un mécanisme permettant à l’État d’interdire le départ de France d’un ressortissant français lorsqu’il existe des raisons sérieuses de croire qu’il projette des déplacements à l’étranger ayant pour objet la participation à des activités terroristes, des crimes de guerre ou des crimes contre l’humanité, ou sur un théâtre d’opérations de groupements terroristes et dans des conditions susceptibles de le conduire à porter atteinte à la sécurité publique lors de son retour sur le territoire français.
Aux termes du nouvel article L. 224-1 du code de la sécurité intérieure, la décision est prononcée par le ministre de l’Intérieur pour une durée maximale de six mois à compter de sa notification. Cette décision est renouvelable, par période de six mois, uniquement sur décision expresse, dans la limite de deux ans. Puisqu’il s’agit d’une mesure administrative, dès lors que les conditions prévues ne sont plus réunies, elle doit être levée immédiatement.
La réponse judiciaire s’organise, ainsi que l’a indiqué Mme Christiane Taubira, alors ministre de la Justice, garde des Sceaux, lors de son audition par la commission d’enquête précitée sur la surveillance des filières et des individus djihadistes, « 122 procédures sont en cours au pôle antiterroriste, dont 69 informations judiciaires et 53 enquêtes préliminaires. 170 personnes sont mises en examen, dont 105 ont été placées en détention provisoire et 65 sous contrôle judiciaire. Les premières affaires relatives aux filières djihadistes vers la zone irako-syrienne ont été jugées en 2014. À ce jour, le tribunal correctionnel de Paris a prononcé quatre jugements de condamnations à l’encontre de 11 personnes :
– le 7 mars 2014, trois candidats au djihad armé en Syrie ont été condamnés à des peines de quatre ans d’emprisonnement dont deux ans avec sursis et mise à l’épreuve, quatre ans d’emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l’épreuve et cinq ans d’emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l’épreuve ;
– le 13 novembre 2014, un ressortissant français ayant combattu en Syrie a été condamné à une peine de sept ans d’emprisonnement et son complice, candidat au djihad en Syrie, à la peine de quatre ans d’emprisonnement dont 18 mois avec sursis et mise à l’épreuve ;
– le 10 mars 2015, un homme qui a apporté son aide à une mineure de 14 ans ayant sans succès tenté de gagner la Syrie pour y épouser un combattant djihadiste a été condamné à une peine de trois ans d’emprisonnement dont un an avec sursis ;
– le 16 avril 2015, cinq ressortissants tchétchènes impliqués dans une filière d’acheminement de combattants djihadistes vers la Syrie implantée en région lyonnaise, ainsi que dans son financement, ont été condamnés à des peines allant de deux à six ans d’emprisonnement. » (207)
Les procédures judiciaires concernant les personnes de retour d’une zone de combat se fondent sur deux qualifications juridiques :
– l’association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste (AMT), définie à l’article 421–2–1 du code pénal, qui nécessite l’existence d’un groupement ou d’une entente constitués par des faits matériels en vue de la préparation d’actes terroristes ;
– l’entreprise terroriste individuelle, définie à l’article 421–2–6 du même code, qui suppose le fait de préparer, en relation avec une entreprise individuelle et dans un but terroriste, la commission de certaines infractions terroristes (atteintes aux personnes, atteintes aux biens les plus graves et actes graves de terrorisme écologique). Les éléments matériels de l’infraction sont caractérisés par le fait « de détenir, de rechercher, de se procurer ou de fabriquer des objets ou des substances de nature à créer un danger pour autrui » et par un second élément matériel (repérages, entraînement au maniement des armes ou explosifs, consultation habituelle de site internet provoquant au terrorisme, séjour à l’étranger sur un théâtre d’opérations de groupements terroristes).
Ces qualifications nécessitent donc d’apporter la preuve que les personnes s’étant rendues en Syrie et en Irak l’ont fait pour rejoindre un groupe terroriste, principalement Jabhat al-Nosra ou Daech, ce qui peut être complexe, du fait de la situation en Syrie, où combattent plusieurs groupes, dont l’armée syrienne libre (ASL) qui n’a pas de caractère terroriste. Les djihadistes cherchent par ailleurs souvent à dissimuler les raisons de leur voyage derrière des motifs humanitaires ou religieux (l’émigration en terre d’islam, la hijra).
Le rapport de la commission d’enquête sur la surveillance des filières et des individus djihadistes a montré les difficultés posées par le cadre juridique actuel :
« (…) le recueil des preuves ne pose pas pour le moment de difficulté majeure, les djihadistes se mettant fréquemment en scène sur les réseaux sociaux, tandis que d’autres sont reconnus par des personnes arrêtées à leur retour. Dans l’hypothèse d’une évolution de leur comportement vers la clandestinité, une plus grande complexité dans la conduite des enquêtes serait à redouter pour l’avenir.
Par ailleurs, des difficultés spécifiques se posent s’agissant des femmes ayant quitté la France pour une zone de djihad. En effet, celles-ci ne semblent pas avoir de rôle actif dans les combats mais plutôt être accompagnatrices d’un mari combattant ou future épouse d’un djihadiste rencontré sur les réseaux sociaux. Elles semblent le plus souvent cantonnées près de la frontière turco-syrienne où elles vivent en communauté avec leurs enfants et assurent un soutien d’ordre familial. Cette situation explique le nombre peu élevé de dossiers judiciaires concernant des femmes : les 14 femmes actuellement mises en examen l’ont été en raison de preuves concernant une aide logistique ou financière à une filière de combattants djihadistes.
Les dossiers concernant les mineurs sont également complexes, ceux-ci pouvant faire l’objet d’une réponse pénale ou de mesures d’assistance éducative. Actuellement, 11 mineurs sont mis en examen. Il s’agit le plus souvent d’adolescents immatures, en rupture scolaire et familiale, inconscients de la situation dans la zone, qui ont fréquemment été victimes d’endoctrinement par le biais d’internet et des réseaux sociaux. À cet égard, un mineur parti dans une zone de djihad à la suite de contacts avec des filières d’acheminement peut être appréhendé sous l’angle de la participation à une AMT mais aussi être considéré comme une victime dans le cadre d’une procédure pour soustraction de mineurs. » (208)
4. La création d’un contrôle administratif des retours sur le territoire national
Le présent article insère un chapitre V intitulé « Contrôle administratif des retours sur le territoire national » au titre II du livre II du code de la sécurité intérieure.
● Le nouvel article L. 225–1 définit les situations de nature à justifier la mise en œuvre d’un contrôle administratif d’une personne de retour sur le territoire national. Ainsi, ce nouveau dispositif concernera toute personne qui a quitté le territoire national pour accomplir, dans des conditions susceptibles de la conduire à porter atteinte à la sécurité publique lors de son retour sur le territoire national, des :
– déplacements à l’étranger ayant pour objet la participation à des activités terroristes (1°) ;
– déplacements (2°) ou tentatives de déplacement (3°) à l’étranger sur un théâtre d’opérations de groupements terroristes.
Il paraît important d’intégrer à cette liste les individus qualifiés de « velléitaires » (3°), c’est-à-dire ceux qui souhaitent rejoindre un théâtre d’opérations mais n’ont pas encore réussi à le faire. Comme l’a montré le rapport de la commission d’enquête de l’Assemblée nationale sur la surveillance des filières et des individus djihadistes, « ils peuvent passer à l’acte par représailles si leur départ a été empêché ou par frustration. Cela a été évoqué dans le cas de Michael Zehaf-Bibeau, auteur de l’attentat commis à Ottawa le 22 octobre 2014, ou s’agissant de la France, de Moussa Coulibaly, qui a attaqué le 3 février 2015 trois militaires à Nice » (209).
● Le nouvel article L. 225–2 définit les obligations pouvant être imposées, pour une durée maximale d’un mois non renouvelable, aux personnes mentionnées aux 1° et 2° du I. Le ministère de l’Intérieur, dans un délai maximal d’un mois à compter de la date certaine du retour sur le territoire national, peut leur faire obligation de :
– résider dans un périmètre géographique déterminé, permettant à l’intéressé de poursuivre une vie familiale et professionnelle normale et, le cas échéant, l’astreindre à demeurer à son domicile, ou à défaut, dans un autre lieu à l’intérieur du périmètre précité, pendant la plage horaire qu’il fixe, dans la limite de huit heures par vingt–quatre heures (1°) ;
– se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, dans la limite de trois présentations par semaine, en précisant si cette obligation s’applique également les dimanches et jours fériés ou chômés (2°).
● Le nouvel article L. 225–3 définit les obligations pouvant être imposées aux personnes mentionnées à l’article L. 225–1, de manière alternative ou cumulative avec celles mentionnées à l’article L. 225–2, par le ministère de l’Intérieur. Ce dernier peut, dans un délai maximal d’un an à compter de la date certaine du retour sur le territoire national, leur faire obligation de :
– déclarer leur domicile (1°) ;
– déclarer leurs identifiants de tout moyen de communication électronique dont ils disposent ou qu’ils utilisent (2°) ;
– signaler leurs déplacements à l’extérieur d’un périmètre défini par l’autorité administrative et ne pouvant être plus restreint que le territoire d’une commune (3°) ;
– ne pas se trouver en relation directement ou indirectement, avec certaines personnes, nommément désignées, dont il existe des raisons sérieuses de penser que leur comportement constitue une menace pour la sécurité et l’ordre publics (4°).
Ces obligations sont prononcées pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une fois.
● Le nouvel article L. 225–4 apporte les garanties procédurales devant entourer le contrôle administratif des retours sur le territoire national.
Les décisions de contrôle administratif doivent être écrites et motivées. La personne concernée est mise en mesure de présenter ses observations dans un délai maximal de huit jours après la notification de la décision. Elle peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix.
● Le nouvel article L. 225–5 prévoit que les obligations prononcées dans le cadre du contrôle administratif sont suspendues, intégralement ou partiellement, si la personne se soumet à une action destinée à permettre sa réinsertion à l’acquisition des valeurs de citoyenneté. Cette participation ne peut se faire que sur la base du volontariat.
● Le nouvel article L. 225–6 propose de créer une infraction pénale nouvelle, sur le modèle de celle créée à L. 224-1 du code pénal pour la violation de l’interdiction de quitter le territoire. Le fait de se soustraire aux obligations du présent article serait puni de trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende.
Les modalités d’application de ce chapitre sont renvoyées à un décret en Conseil d’État.
5. Un dispositif compatible avec les exigences constitutionnelles
Le législateur doit assurer la conciliation entre, d’une part, la prévention des atteintes à l’ordre public et, d’autre part, l’exercice des libertés constitutionnellement garanties.
a. Une liberté de mouvement conciliable avec une vie familiale et professionnelle normale
Dans sa décision n° 2004-492 DC du 2 mars 2004, le Conseil constitutionnel constate qu’« au nombre des libertés constitutionnellement garanties, figurent la liberté d’aller et venir, l’inviolabilité du domicile privé, le secret des correspondances et le respect de la vie privée, protégés par les articles 2 et 4 de la Déclaration de 1789, ainsi que la liberté individuelle, que l’article 66 de la Constitution place sous la surveillance de l’autorité judiciaire ». Les termes de cette décision montrent que seule cette dernière liberté relève de l’article 66 de la Constitution.
Par ailleurs, la sauvegarde de l’ordre public constitue, selon le Conseil constitutionnel (210), un objectif de valeur constitutionnelle qui autorise que des limitations puissent être apportées à l’exercice de libertés fondamentales. Plus précisément, les mesures de police administrative susceptibles d’affecter l’exercice des libertés constitutionnellement garanties doivent être nécessaires à la sauvegarde de l’ordre public (211) et proportionnées à cet objectif (212).
Une mesure d’assignation à résidence ne constitue pas, a priori, une mesure privative de liberté entrant dans le champ de l’article 66 de la Constitution et justifiant par suite, un contrôle au titre de la protection de la liberté individuelle (213). Ce type de mécanisme existe par exemple s’agissant des étrangers placés en rétention administrative en application de l’article L. 551–1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), qui peuvent être assignés à résidence.
Ce n’est que lorsque les contraintes imposées à l’intéressé excèdent par leur rigueur une simple restriction de la liberté de circulation, au point de le confiner en pratique à un lieu déterminé, que l’assignation à résidence est assimilable à une privation de liberté.
La CEDH retient une approche très similaire à celle du juge constitutionnel français puisqu’elle assimile à une privation de liberté le confinement à domicile sous surveillance avec interdiction de sortir (214) de même que l’assignation d’une personne dans un endroit reculé, difficile d’accès, avec un contrôle policier permanent (215). Toutefois, elle estime qu’une personne placée sous une surveillance de la police n’impliquant aucun confinement dans un local délimité subit une restriction de liberté et non une privation de liberté (216).
Dans son avis n° 390867 du 17 décembre 2015, le Conseil d’État a indiqué que « seule une assignation à résidence qui se bornerait, pour les personnes radicalisées et présentant des indices de dangerosité, à restreindre leur liberté de circulation avec des modalités d’exécution laissant à l’intéressé une liberté de mouvement conciliable avec une vie familiale et professionnelle normale, pourrait, le cas échéant, être envisagée dans un cadre administratif. Elle devrait être prévue par la loi et comporter un degré de contraintes inférieur aux mesures prévues par l’article 6 de la loi n° 55–385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence. En tout état de cause, une telle mesure devrait être justifiée par la nécessité de sauvegarder l’ordre public et être proportionnée à cet objectif, notamment quant à sa durée et aux contraintes qu’elle impose. »
L’assignation à résidence lors de l’état d’urgence
Article 6 de la loi n° 55–385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence
Le ministre de l’intérieur peut prononcer l’assignation à résidence, dans le lieu qu’il fixe, de toute personne résidant dans la zone fixée par le décret mentionné à l’article 2 et à l’égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace pour la sécurité et l’ordre publics dans les circonscriptions territoriales mentionnées au même article 2. Le ministre de l’intérieur peut la faire conduire sur le lieu de l’assignation à résidence par les services de police ou les unités de gendarmerie.
La personne mentionnée au premier alinéa du présent article peut également être astreinte à demeurer dans le lieu d’habitation déterminé par le ministre de l’intérieur, pendant la plage horaire qu’il fixe, dans la limite de douze heures par vingt-quatre heures.
L’assignation à résidence doit permettre à ceux qui en sont l’objet de résider dans une agglomération ou à proximité immédiate d’une agglomération.
En aucun cas, l’assignation à résidence ne pourra avoir pour effet la création de camps où seraient détenues les personnes mentionnées au premier alinéa.
L’autorité administrative devra prendre toutes dispositions pour assurer la subsistance des personnes astreintes à résidence ainsi que celle de leur famille.
Le ministre de l’intérieur peut prescrire à la personne assignée à résidence :
1° L’obligation de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, selon une fréquence qu’il détermine dans la limite de trois présentations par jour, en précisant si cette obligation s’applique y compris les dimanches et jours fériés ou chômés ;
2° La remise à ces services de son passeport ou de tout document justificatif de son identité. Il lui est délivré en échange un récépissé, valant justification de son identité en application de l’article 1er de la loi n° 2012-410 du 27 mars 2012 relative à la protection de l’identité, sur lequel sont mentionnées la date de retenue et les modalités de restitution du document retenu.
La personne astreinte à résider dans le lieu qui lui est fixé en application du premier alinéa du présent article peut se voir interdire par le ministre de l’intérieur de se trouver en relation, directement ou indirectement, avec certaines personnes, nommément désignées, dont il existe des raisons sérieuses de penser que leur comportement constitue une menace pour la sécurité et l’ordre publics. Cette interdiction est levée dès qu’elle n’est plus nécessaire.
Lorsque la personne assignée à résidence a été condamnée à une peine privative de liberté pour un crime qualifié d’acte de terrorisme ou pour un délit recevant la même qualification puni de dix ans d’emprisonnement et a fini l’exécution de sa peine depuis moins de huit ans, le ministre de l’intérieur peut également ordonner qu’elle soit placée sous surveillance électronique mobile. Ce placement est prononcé après accord de la personne concernée, recueilli par écrit. La personne concernée est astreinte, pendant toute la durée du placement, au port d’un dispositif technique permettant à tout moment de déterminer à distance sa localisation sur l’ensemble du territoire national. Elle ne peut être astreinte ni à l’obligation de se présenter périodiquement aux services de police et de gendarmerie, ni à l’obligation de demeurer dans le lieu d’habitation mentionné au deuxième alinéa. Le ministre de l’intérieur peut à tout moment mettre fin au placement sous surveillance électronique mobile, notamment en cas de manquement de la personne placée aux prescriptions liées à son assignation à résidence ou à son placement ou en cas de dysfonctionnement technique du dispositif de localisation à distance.
Les dispositions proposées semblent bien conformes aux exigences rappelées par l’avis précité du Conseil d’État puisque les mesures les plus contraignantes qui sont celles prévues à l’article L. 225–2 du code de la sécurité intérieure :
– permettent d’atteindre un objectif de protection de l’ordre public ;
– sont moins rigoureuses que celles prévues à l’article 6 de la loi sur l’état d’urgence précitée (assignation à résidence dans la limite de huit heures et non pas de douze heures…) ;
– ne peuvent être prises que dans le délai très court d’un mois à compter du retour sur le territoire national et que leur durée est limitée à un mois non renouvelable.
b. Un droit au recours effectif
Une assignation à résidence emporte une restriction à la liberté d’aller et de venir, mais cette dernière sera soumise au contrôle entier du juge administratif, pour vérifier que cette restriction est adaptée, nécessaire et proportionnée à la finalité poursuivie, en application de la récente jurisprudence du Conseil constitutionnel (217).
La personne dispose d’un recours juridictionnel effectif puisqu’elle peut contester la mesure devant le juge administratif, y compris par la voie du référé-liberté. En effet, le droit d’aller et de venir constitue une liberté fondamentale au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Le juge des référés se prononce alors dans un délai de quarante-huit heures. Il convient de souligner que la possibilité de saisir le juge des référés ne fait pas obstacle à ce que le juge administratif puisse être saisi par la voie d’un recours pour excès de pouvoirs dans les conditions classiques du contentieux administratif.
Ce recours juridictionnel pourra être intenté à tout moment par la personne concernée, notamment si des éléments nouveaux permettent de démontrer que les conditions ayant conduit à la décision du ministre ne sont plus remplies.
De même, la mesure ne pourra être prolongée que par décision expresse, reposant sur un dossier étayé, ouvrant les mêmes possibilités de recours aux personnes concernées.
6. Les modifications opérées par votre commission des Lois
À l’initiative de votre rapporteur, la Commission a adopté deux amendements précisant que la mesure de police administrative visant à contrôler les retours sur le territoire national des personnes qui se sont rendues sur un théâtre d’opérations terroriste ou qui ont tenté de le faire a vocation à être subsidiaire à la judiciarisation de ces personnes :
– le premier impose l’information préalable du parquet avant que le ministre de l’intérieur puisse décider un contrôle administratif des retours sur le territoire national, afin que le parquet envisage les suites judiciaires à donner ;
– le second fait primer l’ouverture d’une procédure judiciaire sur la mesure de police administrative, la mesure devant cesser dès l’instant où une procédure est ouverte.
*
* *
La Commission examine l’amendement CL193, présenté par M. Sergio Coronado.
M. Sergio Coronado. Alors que la loi de 2014 a créé une interdiction de sortie du territoire, cet article instaure un contrôle judiciaire aux mains de l’autorité administrative. Les critères permettant d’y recourir resteront vagues et la mesure ne sera pas décidée dans un cadre contradictoire.
Actuellement, les personnes de retour de Syrie ou d’Irak peuvent faire l’objet d’un contrôle judiciaire ou d’une détention provisoire pour association de malfaiteurs à caractère terroriste ou pour entreprise terroriste individuelle, sur la base de l’article 421-2-1 du code pénal. Un juge d’instruction peut donc d’ores et déjà ordonner ces mesures de contrôle judiciaire ou de détention.
Cet article 20 est une nouvelle illustration du transfert progressif du contrôle judiciaire vers la mesure administrative, qui constitue l’un des défauts de ce texte. Pour ces raisons, il est proposé de supprimer cet article.
M. le rapporteur. Les procédures judiciaires concernant les personnes de retour d’une zone de combat se fondent sur deux qualifications juridiques.
La première est l’association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste, définie à l’article 421-2-1 du code pénal, qui nécessite l’existence d’un groupement ou d’une entente constitués par des faits matériels en vue de la préparation d’actes terroristes.
L’autre qualification est l’entreprise terroriste individuelle, définie à l’article 421-2-6 du même code, qui suppose le fait de préparer, en relation avec une entreprise individuelle et dans un but terroriste, la commission d’infractions terroristes.
Ces qualifications requièrent néanmoins d’apporter la preuve que les personnes s’étant rendues en Syrie et en Irak l’ont fait pour rejoindre un groupe terroriste, principalement Jabhat al-Nosra ou Daech, ce qui peut être complexe du fait de la situation en Syrie, où combattent plusieurs groupes, dont l’armée syrienne libre (ASL), qui n’a pas de caractère terroriste. Mais il est parfois difficile d’identifier qui combat avec qui…
L’article 20 crée en conséquence un contrôle administratif des retours sur le territoire national de ces personnes, et je ne suis pas favorable à ce qu’on le supprime.
Je me suis demandé s’il n’était pas possible de systématiquement judiciariser tout retour, ce qui permettrait ensuite d’engager les procédures que les magistrats jugeront nécessaires. Les opinions sur ce point divergent, mais les praticiens que j’ai interrogés m’ont dit que dans un certain nombre de cas, un laps de temps est nécessaire pour vérifier et étayer un dossier. C’est précisément pendant ce délai d’un mois non renouvelable que l’administration instaure les mesures de contrôle, puisque le juge n’est pas en situation de les fonder.
Afin de garantir l’articulation entre ces mesures administratives et une éventuelle suite judiciaire, et de s’assurer que l’appréciation de l’autorité préfectorale est bien fondée, je vous proposerai un amendement CL238 qui prévoit l’information immédiate du procureur de la République : si le procureur de la République estime qu’il y a assez d’éléments pour judiciariser, il le fera.
Je vous présenterai également l’amendement CL240, prévoyant que lorsqu’une procédure judiciaire concernant une personne faisant l’objet d’obligations fixées en application de ces articles est ouverte, le ministre de l’intérieur abroge les décisions mentionnées à ces articles.
Aux termes de ces deux amendements, on ne pourra donc pas engager la procédure sans avoir informé le procureur, qui s’assurera qu’elle n’est pas judiciarisable à ce stade. Et dès que la procédure sera judiciarisée, la mesure cessera immédiatement de plein droit.
Néanmoins, j’ai demandé que nous puissions disposer d’éléments supplémentaires nous permettant de nous assurer que cet article 20 est bien nécessaire. Je veux des exemples concrets de situations dans lesquelles une personne rentrant de ces théâtres ne peut pas être immédiatement judiciarisée. Dans la plupart des cas, il y a incarcération immédiate au retour : garde à vue et placement en détention provisoire. Mais il faut des faits, et parfois un peu de temps pour réunir les faits.
Il s’agit de personnes qui reviennent des théâtres d’opération en Syrie et en Irak. Nous en avons débattu lorsqu’il s’est agi d’empêcher nos ressortissants de s’y rendre, en prévoyant la retenue du passeport et l’interdiction de sortie du territoire. J’ai encore en mémoire que certains nous reprochaient à l’époque d’avoir traité le cas des sorties, mais de ne pas avoir trouvé des moyens suffisants pour gérer le cas des retours…
Voilà pourquoi je ne suis pas favorable, à ce stade de la discussion, à ce que nous supprimions purement et simplement l’article 20 comme il est proposé par cet amendement. Je vous ai également expliqué comment je proposai de faire évoluer cet article en prévoyant l’intervention du procureur de la République dès le début du processus et en rappelant que dès qu’il y avait judiciarisation, ce processus cessait de plein droit.
M. Alain Tourret. Vos propositions sur cet article 20 me semblent bien articulées. Nous nous adressons à des personnes qui reviennent du théâtre des opérations : il y a donc à l’évidence une présomption, qui devra être étayée. Le procureur de la République doit donc être saisi, et dans le cadre de sa saisine, il demandera vraisemblablement une détention provisoire. Mais dans le cas où il n’y aura pas suffisamment d’éléments, la solution intermédiaire me semble également satisfaisante.
M. Sergio Coronado. Le dispositif actuellement en vigueur offre la garantie, extrêmement importante à mes yeux, du contradictoire, car les choses ne sont pas toujours aussi simples. Ainsi, l’an dernier, le Président de la République a reçu deux combattantes : une responsable du PYD (Parti de l’union démocratique) et une dirigeante des milices kurdes qui ont libéré Kobané. Un certain nombre d’étrangers ont rejoint ces forces. Dans le Kurdistan syrien, ces forces qui ont fait reculer Daech sont liées au PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan), et si elles sont nos alliés, elles ont aussi joué un jeu trouble en Syrie où elles ont longtemps été liées au pouvoir d’État. Et lorsque vous discutez avec l’opposition syrienne, vous réalisez qu’elles ne font pas forcément cause commune.
Avoir participé avec ces forces à la libération de Kobané vous associe aujourd’hui avec une entreprise terroriste, car ces forces sont liées au PKK qui est qualifié d’organisation terroriste par l’Europe et les États-Unis.
La situation n’est donc pas simple, c’est pour cela qu’il faut rester très attaché à l’intervention du juge judiciaire, qui permet une procédure contradictoire lorsque l’on traite de ces questions de retour.
M. Patrick Devedjian. L’article 20 prévoit trois cas dans lesquels les mesures de contrôle administratif peuvent être ordonnées. Le premier cas envisagé est celui dans lequel une personne effectue : « Des déplacements à l’étranger ayant pour objet la participation à des activités terroristes ». Mais ces cas, sauf erreur de ma part, seront automatiquement du ressort du procureur de la République, donc judiciarisés, la seule question étant de savoir si l’on détient des preuves de ces activités. Je ne comprends donc pas l’utilité de cette disposition : de tels agissements tomberont automatiquement dans le domaine de compétence du procureur de la République.
Le deuxième cas envisagé est celui de « déplacements à l’étranger sur un théâtre d’opérations de groupements terroristes ». Cette formulation est extrêmement vague. Cela peut inclure la situation de personnes qui se rendent dans ces zones pour des opérations humanitaires de soutien, je connais de tels cas.
Enfin, le troisième cas concerne « une tentative de se rendre sur un tel théâtre ». Cela pose un problème de preuve, qui n’est pas du tout évident. Et l’appréciation de cette preuve serait du domaine administratif, et non du domaine judiciaire ? C’est préoccupant.
Mme Marie-Françoise Bechtel. Je crois au contraire que cet article, peut-être au bénéfice d’une amélioration rédactionnelle, est tout à fait adapté. Je me souviens que nous avions eu le même débat lorsque j’ai rapporté la première loi sur le terrorisme, par laquelle nous avons délictualisé le fait de revenir sur le territoire français en provenance de théâtres d’opération de groupes terroristes.
Nous pourrions peut-être reprendre la rédaction de cette loi et y inclure les cas prévus au 1° et 3°. Je me rappelle que le débat était le même à l’époque : on nous reprochait de délictualiser le retour au lieu de garder le contrôle sur les personnes concernées. C’est ce à quoi s’attache ce texte ; nous devrions peut-être essayer de caler les deux rédactions.
À propos de l’objection kurde soulevée par notre collègue Coronado, à laquelle j’ai été très sensible, il faut retenir la condition posée en facteur commun : dans tous les cas, cet article ne s’applique que si les personnes visées ont fait ces déplacements « dans des conditions susceptibles de la conduire à porter atteinte à la sécurité publique lors de son retour sur le territoire français ». Dans ces conditions, cette objection, qui me semble sérieuse, tombe.
M. Sergio Coronado. Il existe toutefois des cas de condamnations par des tribunaux français pour relations avec des organisations terroristes qui concernent des militants kurdes.
M. le rapporteur. Je fais mienne l’analyse de Mme Bechtel : la condition que ces déplacements soient faits par la personne « dans des conditions susceptibles de la conduire à porter atteinte à la sécurité publique lors de son retour sur le territoire français » s’applique à tout l’article, et pas au seul cas de tentative de départ prévu par le 3°.
Monsieur Devedjian, j’ai entendu vos arguments sur le 1°, et je ne suis pas loin d’être convaincu. Mais ce n’est pas si simple… Nous allons donc étudier s’il est utile de maintenir cet alinéa. Nous apporterons donc des modifications rédactionnelles à cet article en séance.
Monsieur Coronado, l’alinéa 20 de l’article, qui créé l’article L. 225-4, prévoit : « Les décisions prononçant les obligations prévues aux articles L. 225-2 et L. 225-3 sont écrites et motivées. Le ministre de l’intérieur ou son représentant met la personne concernée en mesure de lui présenter ses observations dans un délai maximal de huit jours à compter de la notification de la décision. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. »
Il est donc faux de dire qu’aucune disposition n’assure le principe du contradictoire.
La Commission rejette l’amendement.
Elle en vient à l’amendement CL194 de M. Sergio Coronado.
M. Sergio Coronado. Cet amendement tend à exclure spécifiquement des mesures préfectorales les personnes suivies par la justice par ailleurs, et qui auraient été laissées libres ou sous contrôle judiciaire. La mesure administrative ne doit pas être l’expédient d’un contrôle ou d’une incarcération que le juge aurait refusé.
M. le rapporteur. Nous sommes d’accord, monsieur Coronado. Je vous demande simplement le retrait de cet amendement au profit du suivant, pour une question de rédaction.
L’amendement est retiré.
La Commission en vient à l’amendement CL238 du rapporteur.
M. le rapporteur. M. Coronado vient de brillamment défendre cet amendement.
La Commission adopte l’amendement.
Puis elle adopte l’amendement rédactionnel CL239 du rapporteur.
Elle examine ensuite l’amendement CL13 de M. Éric Ciotti.
M. Pierre Morel-A-L’Huissier. Cet amendement tend à porter la durée pendant laquelle une personne peut être assignée à son domicile à douze heures par tranche de vingt-quatre, au lieu de huit actuellement.
M. le rapporteur. Nous avons déjà débattu de ce sujet lorsque nous avons modifié la loi de 1955 sur l’état d’urgence. Et depuis, le Conseil d’État a refait état du droit sur cette question. Avis défavorable.
La Commission rejette l’amendement.
L’amendement CL76, de M. Jean-Luc Warsmann, est retiré.
La Commission en vient à l’amendement CL195 de M. Sergio Coronado.
M. Sergio Coronado. Cet amendement a pour objet de faciliter la vie des forces de l’ordre et des citoyens concernés par ces mesures administratives : dès lors que l’article n’autorise que trois pointages par semaine, il n’est pas indispensable qu’ils s’effectuent le dimanche et les jours fériés, jours les plus problématiques pour les personnes assignées, comme pour les forces de l’ordre.
M. le rapporteur. On nous dit parfois que les assignations à résidence et les obligations de pointage gênent les personnes pour aller travailler, voilà qu’elles les gênent le week-end.
Cet amendement me rappelle la ligne Maginot : on prévoit tous les dispositifs de défense, mais on s’arrête à un moment donné. Dans Astérix chez les Bretons, les Romains le comprennent et décident d’attaquer pendant l’heure du thé… Avis défavorable.
La Commission rejette l’amendement.
Elle en arrive à l’amendement CL77 de M. Jean-Luc Warsmann.
M. Pierre Morel-A-L’Huissier. Cet amendement vous propose que l’assignation à résidence, actuellement non renouvelable, soit renouvelable deux fois.
M. le rapporteur. Au vu de l’objet de ces mesures de contrôle administratif, il me semble que le délai prévu dans le texte est suffisant. Si l’on trouve des éléments de preuve, il y aura judiciarisation ; si l’on n’a rien trouvé au bout d’un mois, on entre alors dans un autre champ, prévu par le futur article L. 225-3 du code de la sécurité intérieure qui figure à l’alinéa 14 : « Le ministre de l’intérieur peut faire obligation à toute personne mentionnée à l’article L. 225-1, dans un délai maximal d’un an à compter de la date certaine de son retour sur le territoire national, de : 1° déclarer son domicile, et tout changement de domicile ; 2° déclarer ses identifiants de tout moyen de communication électronique dont il dispose ou qu’il utilise, ainsi que tout changement d’identifiant […] »
M. Pierre Morel-A-L’Huissier. Le rapporteur m’a convaincu, je retire cet amendement.
L’amendement est retiré.
La Commission en vient à l’amendement CL196 de M. Sergio Coronado.
M. Sergio Coronado. Cet amendement tend à supprimer l’alinéa qui impose à la personne retenue de : « déclarer ses identifiants de tout moyen de communication électronique dont il dispose ou qu’il utilise, ainsi que tout changement d’identifiant ».
Cette innovation juridique va largement au-delà de la simple surveillance, elle serait une intrusion lourde dans la vie privée des individus, sans aucun contrôle. Par ailleurs, aucune précision n’est apportée quant à la destination et à l’utilisation des identifiants récoltés.
M. le rapporteur. Avis défavorable. Si l’on souhaite être efficace, il faut avoir les moyens de savoir où sont les gens.
La Commission rejette l’amendement.
Elle examine ensuite l’amendement CL240 du rapporteur.
M. le rapporteur. J’ai expliqué cet amendement précédemment : dès qu’une procédure judiciaire est ouverte, les mesures administratives doivent immédiatement cesser.
La Commission adopte l’amendement.
Elle en vient à l’amendement CL197 de M. Sergio Coronado.
M. Sergio Coronado. La précision que les formations doivent s’effectuer exclusivement dans un établissement habilité relève du décret prévu à l’alinéa 23. Je vous propose donc de supprimer cette mention du projet de loi.
Suite à l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement.
Elle examine ensuite l’amendement CL198 de M. Sergio Coronado.
M. Sergio Coronado. Les recours contre les assignations à résidence prononcées dans le cadre de l’état d’urgence ont montré la forte hostilité de l’autorité administrative vis-à-vis des décisions en référé. Ainsi, le ministère de l’intérieur a continué jusqu’en janvier à soutenir dans ses mémoires en défense que la condition d’urgence nécessaire à l’examen d’un recours en référé n’était pas remplie, malgré la décision du Conseil d’État.
Cet amendement vous propose de préciser que la condition d’urgence est présumée remplie.
M. le rapporteur. Je ne suis pas hostile à l’idée de mieux préciser les modalités de recours contre ces décisions administratives, même s’il s’agit d’un principe général du droit : nous ne sommes pas obligés de l’écrire, les voies de recours existeront tout de même.
Toutefois, compte tenu de la sensibilité du sujet et de son caractère novateur, je suis prêt à y réfléchir. Mais je serais plus favorable à une rédaction proche de celle de l’article 1er de la loi n° 2014-1353 du 13 novembre 2014, qui renforçait déjà les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme. Ce serait juridiquement plus net…
Mme Élisabeth Pochon. Il me semble en effet me souvenir qu’au début de l’état d’urgence, il y a eu quelques soucis, mais dès le mois de décembre des décisions ont jugé que l’urgence était automatique et que la charge de la preuve était inversée.
L’amendement est retiré.
La Commission adopte l’article 20, modifié.
Article 21
(art. L. 211–11–1 [nouveau] du code de la sécurité intérieure)
Renforcement des contrôles d’accès aux établissements ou installations accueillant des événements de grande ampleur
Le présent article renforce les contrôles d’accès aux établissements ou installations accueillant des événements de grande ampleur, comme prochainement l’Euro 2016 de football. Il permet aux organisateurs, lorsque ces évènements sont exposés à un risque exceptionnel de menace terroriste, de solliciter l’avis de l’autorité administrative avant d’autoriser l’accès des personnes autres que les spectateurs ou participants.
1. Le droit en vigueur
Aux termes de l’article L. 114–1 du code de la sécurité intérieure, « les décisions administratives de recrutement, d’affectation, d’autorisation, d’agrément ou d’habilitation, prévues par des dispositions législatives ou réglementaires, concernant soit les emplois publics participant à l’exercice des missions de souveraineté de l’État, soit les emplois publics ou privés relevant du domaine de la sécurité ou de la défense, soit les emplois privés ou activités privées réglementées relevant des domaines des jeux, paris et courses, soit l’accès à des zones protégées en raison de l’activité qui s’y exerce, soit l’utilisation de matériels ou produits présentant un caractère dangereux, peuvent être précédées d’enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement des personnes physiques ou morales intéressées n’est pas incompatible avec l’exercice des fonctions ou des missions envisagées. » Ces enquêtes administratives peuvent donner lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l’article 230–6 du code de procédure pénale, y compris pour les données portant sur des procédures judiciaires en cours, dans la stricte mesure exigée par la protection de la sécurité des personnes et la défense des intérêts fondamentaux de la Nation.
La liste des décisions pouvant donner lieu à ces enquêtes administratives est fixée aux articles R. 114–2 à R. 114–5 du code de la sécurité intérieure.
Exemples de décisions pouvant donner lieu à ces enquêtes administratives sur le fondement des articles R. 114–2 à R. 114–5 du code de la sécurité intérieure
R. 114–2 du code de la sécurité intérieure : décisions relatives aux emplois publics participant à l’exercice des missions de souveraineté de l’État ainsi qu’aux emplois publics ou privés relevant du domaine de la sécurité ou de la défense :
1° Autorisation ou habilitation :
a) Des personnes physiques ayant accès aux informations et supports protégés au titre du secret de la défense nationale (…) ;
d) Des agents des services internes de sécurité de la Société nationale des chemins de fer français et de la Régie autonome des transports parisiens, préalablement à leur affectation (…) ;
i) Des personnes mettant en œuvre le dispositif technique permettant le contrôle à distance des personnes placées sous surveillance électronique (…) ;
2° Recrutement des membres des juridictions administratives, des magistrats de l’ordre judiciaire et des juges de proximité ;
3° Recrutement ou nomination et affectation :
a) Des préfets et sous-préfets (…) ;
b) Des ambassadeurs et consuls (…) ;
j) Des militaires ;
4° Agrément :
a) Des agents de police municipale (…) ;
i) Des agents de surveillance et gardiennage et des agents du service d’ordre des manifestations sportives, récréatives ou culturelles, habilités à procéder à des palpations de sécurité en application des articles L. 613-2 et L. 613-3 du présent code (…) ;
k) Des agents employés pour exercer une activité privée de transport de fonds, de bijoux ou de métaux précieux (…) ;
l) Des agents des exploitants de transports publics de personnes habilités à relever l’identité et l’adresse des contrevenants, dans les conditions prévues à l’article 529-4 du code de procédure pénale.
R. 114–3 : décisions relatives aux emplois privés ainsi qu’aux activités privées réglementées relevant des domaines des jeux, paris et courses :
1° Autorisation :
a) De pratiquer les jeux de hasard dans les casinos des stations balnéaires, thermales ou climatiques (…) ;
c) De faire courir, d’entraîner, de monter et driver des chevaux de course (…) ;
2° Agrément :
a) Des directeurs et des membres des comités de direction des casinos autorisés ainsi que des personnes employées dans les salles de jeux des casinos et des cercles de jeux (…) ;
e) Des arbitres et assesseurs des parties de pelote basque.
R. 114–4 : autorisations d’accès aux lieux suivants protégés en raison de l’activité qui s’y exerce :
1° Zones militaires ou placées sous le contrôle de l’autorité militaire (…) ;
3° Établissements, installations ou ouvrages d’importance vitale, mentionnés aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2 du code de la défense (…).
R. 114–5 : autorisations ou agréments suivants relatifs à des matériels, produits ou activités présentant un danger pour la sécurité publique :
1° Fabrication, commerce, acquisition, détention, importation et exportation de matériels de guerre, armes et munitions ;
2° Port d’armes (…) ;
4° Élaboration, détention, transfert, utilisation, importation, exportation et transport de matières nucléaires (…).
2. Le renforcement des contrôles d’accès aux établissements ou installations accueillant des événements de grande ampleur
Les dispositions du code de la sécurité intérieure précitées ne permettent pas aux organisateurs de grands événements de solliciter l’autorité administrative pour avis afin qu’elle procède à une enquête administrative à l’encontre d’une personne susceptible d’accéder à tout ou partie d’un établissement accueillant des évènements exposés, par leur ampleur ou leurs circonstances particulières, à un risque exceptionnel de menace terroriste. Ce serait notamment le cas d’un événement tel que l’Euro 2016 de football.
Une habilitation législative étant indispensable pour limiter la liberté du commerce et de l’industrie (218) et le droit pour chacun d’obtenir un emploi (219), le présent article introduit donc au chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la sécurité intérieure une section 4 bis intitulée « Grands événements », composée d’un article unique L. 211–11–1 (nouveau) créant un régime d’autorisation dans le cadre duquel une enquête administrative est sollicitée.
Aux termes de l’article L. 211–11–1, l’accès de toute personne, à un autre titre que celui de spectateur ou de participant, à une partie des installations et établissements d’un grand événement exposé à un risque exceptionnel de menace terroriste est soumis à autorisation de l’organisateur pendant la préparation et la durée de cet événement.
Cette autorisation est délivrée après avis de l’autorité administrative, rendu à la suite d’une enquête administrative qui peut donner lieu à la consultation, selon les règles propres à chacun d’eux, de certains traitements automatisés de données à caractère personnel relevant de l’article 26 de la loi n° 78–17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés(220), à l’exception des fichiers d’identification.
Un avis défavorable ne peut être émis que s’il ressort de l’enquête administrative que le comportement ou les agissements de la personne sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’État.
Les grands événements exposés, par leur ampleur ou leurs circonstances particulières, à un risque exceptionnel de menace terroriste sont désignés par décret.
Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), fixe les modalités d’application de cet article, en particulier s’agissant de la liste des fichiers pouvant faire l’objet d’une consultation, les catégories de personnes concernées et les garanties d’information ouvertes à ces personnes.
*
* *
La Commission examine l’amendement CL199 de M. Sergio Coronado.
M. Sergio Coronado. Cet amendement vise à éviter l’application des mesures de criblage aux journalistes.
M. le rapporteur. J’étais tenté de donner un avis favorable à cet amendement, parce qu’il me semblait normal de traiter de la même manière un journaliste et un spectateur. Mais en échangeant avec le cabinet du ministre de l’intérieur…
M. Sergio Coronado. Il est toujours très convaincant !
M. le rapporteur. Pas toujours : nous ne vous avons pas proposé de voter conformes tous les articles…
Il nous est apparu que certains journalistes ont la possibilité d’accéder à des zones qui ne sont pas ouvertes au public : salles de presse à l’intérieur des enceintes, vestiaires, etc. Il peut donc être nécessaire, dans certains cas, de regarder précisément à qui on a affaire, d’autant que la notion de journaliste est extrêmement large.
Si le journaliste vient simplement faire un reportage dans les tribunes, il sera considéré comme un spectateur ; mais s’il demande des accréditations particulières, il ne faut pas s’interdire de mener le même type d’investigations que celles prévues par l’article 21 pour les personnes qui vont encadrer l’organisation de la manifestation. Avis défavorable.
La Commission rejette l’amendement.
Elle en vient à l’amendement CL114 de M. Lionel Tardy.
M. Lionel Tardy. Je souhaite appeler votre attention sur la procédure prévue par l’article 21 pour l’organisation de grands événements, notamment l’Euro 2016 de football.
Pour les bénévoles, l’organisateur devra demander l’avis de l’autorité administrative avant d’autoriser l’accès au stade, et ainsi vérifier qu’ils ne représentent aucun danger. Cependant, sauf erreur de ma part, l’organisateur est libre de ne pas suivre cet avis. On ne peut pas lui imposer, mais il faudrait savoir ce qui se passera si cet avis n’est pas suivi : devra-t-il en informer l’autorité administrative ? C’est le sens de mon amendement, qui invite à apporter des précisions sur le suivi des avis dans le décret d’application.
M. le rapporteur. Je comprends mieux votre intention, mais votre explication ne correspond pas tout à fait au dispositif de votre amendement. Je vous propose de le retirer et de retravailler sa rédaction.
L’amendement est retiré.
La Commission adopte l’article 21 sans modification.
La Commission examine l’amendement CL42 de M. Philippe Goujon.
M. Pierre Morel-A-L’Huissier. Cet amendement reprend une proposition formulée par Philippe Goujon lors de la séance publique du jeudi 4 février 2016 à l’occasion de l’examen de la proposition de loi de Guillaume Larrivé renforçant la lutte contre le hooliganisme, qui avait recueilli l’avis favorable de la Commission. Il vise à permettre à l’autorité administrative ou au ministre de l’intérieur d’interdire les déplacements de supporters dangereux dans les fan zones. À cet effet, il étend à ces zones la portée de l’arrêté ministériel ou préfectoral pouvant être pris sur le fondement des articles L.332-16-1 et L.332.16-2 du code du sport. Tenant compte des remarques formulées par le Gouvernement en séance, nous avons reformulé cet amendement afin de préciser qu’il concernera les lieux publics où sont retransmises au public les manifestations sportives, ce qui permet de cibler ces zones et d’exclure les bars.
M. le rapporteur. La réécriture de cette proposition ne règle pas les problèmes qu’elle posait précédemment. Un long débat sur le sujet ayant déjà eu lieu lors de la discussion sur la proposition de loi sur le hooliganisme, déposée, rappelons-le, à l’initiative du groupe Les Républicains et adoptée en première lecture, je suis défavorable à cet amendement.
L’amendement est retiré.
TITRE II
DISPOSITIONS RENFORÇANT LES GARANTIES DE LA PROCÉDURE PÉNALE ET SIMPLIFIANT SON DÉROULEMENT
Le présent titre se compose de deux chapitres. Le chapitre Ier, qui compte six articles, a pour objectif le renforcement des garanties offertes par la procédure pénale. Quant aux quatre articles qui composent le chapitre II, ils procèdent à des simplifications et à des coordinations au sein de cette même procédure pénale.
Chapitre Ier
Dispositions renforçant les garanties de la procédure pénale
Article 22
(art. 39-3 [nouveau] du code de procédure pénale)
Missions du procureur de la République
1. L’état du droit
Le code de procédure pénale fait du procureur de la République le directeur de l’enquête judiciaire. Selon l’article 12, « la police judiciaire est exercée sous la direction du procureur de la République ». L’article 41 précise qu’il « procède ou fait procéder à tous les actes nécessaires à la recherche et à la poursuite des infractions à la loi pénale » et que, à cette fin, il « dirige l’activité des officiers et agents de la police judiciaire dans le ressort de son tribunal ». « Il contrôle les mesures de garde à vue », ce qui fait de lui un protecteur des libertés individuelles (221).
L’étude d’impact jointe au projet de loi pointe toutefois l’écart entre ces dispositions relativement laconiques et l’article 81 du code de procédure pénale relatif au juge d’instruction. Celui-ci dispose notamment que le juge d’instruction procède, conformément à la loi, à tous les actes d’information qu’il juge utiles à la manifestation de la vérité et, depuis la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la présomption d’innocence et les droits des victimes, « instruit à charge et à décharge ».
Le relatif silence du code de procédure pénale pourrait laisser supposer que l’action du procureur n’est pas – elle aussi – encadrée par la loi, et que sa mission ne consiste pas à rechercher la vérité, mais uniquement à poursuivre devant les juridictions. Or, si le procureur a également un rôle d’avocat général et d’accusateur public, il n’en demeure pas moins que, dans sa mission de direction d’enquête, il est tenu aux mêmes obligations de légalité, d’équité et d’objectivité que le juge d’instruction.
La loi n° 2013-669 du 25 juillet 2013, relative aux attributions du garde des Sceaux et des magistrats du ministère public en matière de politique pénale et de mise en œuvre de l’action publique, a renforcé l’indépendance et l’objectivité des magistrats du parquet, en supprimant les instructions individuelles du ministre de la justice et en rappelant, à l’article 31 du code de procédure pénale, que le ministère public exerce l’action publique et requiert l’application de la loi « dans le respect du principe d’impartialité auquel il est tenu ».
Néanmoins, la fonction de procureur de la République pâtit de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme. Dans la mesure où le parquet est à la fois accusateur – donc partial dans sa mission de poursuite – et hiérarchisé – donc dépourvu des garanties d’indépendance dont bénéficient les magistrats du siège –, les juges européens ont refusé de le considérer apte à contrôler les mesures de privation de liberté (222).
L’article 22 du projet de loi tend à clarifier et, partant, à renforcer les dispositions précitées en établissant les principes auxquels doit se conformer le procureur de la République dans sa fonction de directeur d’enquête. Il insère, à cet effet, un nouvel article 39-3 dans le code de procédure pénale.
Dans ses attributions de direction de la police judiciaire, il contrôle la légalité des moyens mis en œuvre par les enquêteurs, la proportionnalité des actes d’investigation au regard des faits ainsi que la qualité et la direction de l’enquête. Attaché à la manifestation de la vérité, dans le respect des droits de la victime et de ceux de la personne suspectée, il investigue à charge et à décharge.
Ainsi le procureur est-il rapproché, non des magistrats du siège, mais du juge d’instruction dans la mesure où il conduit ses investigations dans une logique et une déontologie similaires.
La rédaction proposée est conforme à la jurisprudence du Conseil constitutionnel, dont la décision n° 2011-625 DC du 10 mars 2011, Loi d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure, avait affirmé que la police judiciaire est placée sous la direction et le contrôle de l’autorité judiciaire (223).
3. Les modifications opérées par votre commission des Lois
La commission des Lois a adopté quatre amendements de la rapporteure. Si trois d’entre eux sont de portée rédactionnelle, un quatrième précise le rôle du procureur en mentionnant son attachement non seulement aux droits de la victime et de la personne suspectée, comme le prévoit la rédaction initiale, mais aussi à ceux du plaignant.
En effet, au stade de l’enquête, il n’est pas certain que le plaignant ait bien la qualité de victime. Seul le jugement peut établir une vérité judiciaire, affirmer que le suspect est bien coupable et que le plaignant est bien victime.
De même, il peut ne pas y avoir confusion entre les deux. Certains plaignants, personnes morales, ne sont pas à proprement parler les victimes d’une infraction donnée (224). Au contraire, certaines victimes se refusent à porter plainte et il revient alors au parquet d’agir d’initiative, par exemple dans les affaires de violence faites aux femmes (225).
Le rôle du ministère public, dans ces situations toujours délicates, consistera à la fois à garantir les droits des futures parties et à préserver la victime qui refuse de prendre part à l’action judiciaire.
*
* *
L’amendement CL98 est retiré.
La Commission adopte successivement les amendements rédactionnels CL300, CL301, CL302 et CL303 de la rapporteure.
Puis elle adopte l’article 22 modifié.
Article 23
(art. 229-1 [nouveau] du code de procédure pénale)
Procédure disciplinaire d’urgence à l’encontre des
officiers et agents de police judiciaire
1. L’état du droit
L’article 13 du code de procédure pénale prévoit que « la police judiciaire est placée, dans chaque ressort de cour d’appel, sous la surveillance du procureur général et sous le contrôle de la chambre de l’instruction ». Cette disposition est confirmée par l’article 224 aux termes duquel « la chambre de l’instruction exerce un contrôle sur l’activité des fonctionnaires civils et des militaires, officiers et agents de police judiciaire, pris en cette qualité ».
Lorsque l’activité d’un officier ou d’un agent de police judiciaire est mise en cause, la chambre de l’instruction est saisie pour procéder à une enquête. Elle entend le procureur général et l’intéressé, assisté d’un avocat et dans le respect des règles du contradictoire. Sans préjudice des sanctions disciplinaires qui peuvent être infligées par la suite, elle peut prononcer une interdiction d’exercice des fonctions d’officier ou d’agent de police judiciaire, à titre temporaire ou définitif, dans le ressort de la cour d’appel ou sur l’ensemble du territoire national. Cette décision prend effet immédiatement (226).
Ce dispositif se distingue des pouvoirs disciplinaires dévolus au procureur général sur le fondement de l’article 38 du code de procédure pénale (227). En effet, ceux-ci ne s’exercent qu’à l’encontre des officiers de police judiciaire sur le fondement de l’habilitation que leur accorde le procureur général.
En application du huitième alinéa de l’article 16 du même code, les fonctionnaires de police et les militaires de la gendarmerie « ne peuvent exercer effectivement les attributions attachées à leur qualité d’officier de police judiciaire ni se prévaloir de cette qualité que s’ils sont affectés à un emploi comportant cet exercice et en vertu d’une décision du procureur général près la cour d’appel les y habilitant personnellement ». Cette habilitation est soumise aux règles de l’article R. 14 pour la gendarmerie nationale et de l’article R. 15-3 pour la police nationale : un officier de police judiciaire doit être habilité par le procureur général du ressort dans lequel il exerce habituellement ses fonctions pour pouvoir exercer effectivement les attributions attachées à la qualité d’officier de police judiciaire.
Le procureur général peut, après entretien contradictoire avec l’officier de police judiciaire en présence d’un conseil, suspendre ou retirer son habilitation en cas de manquement professionnel ou d’atteinte à l’honneur ou à la probité ayant une incidence sur sa capacité à exercer des missions de police judiciaire de manière satisfaisante. La décision de suspension ou de retrait d’une habilitation prend la forme d’un arrêté individuel motivé. Deux voies de recours sont ouvertes à l’officier de police judiciaire ainsi sanctionné :
– l’article 16-1 du code de procédure pénale lui permet, dans le mois qui suit la notification de la décision, de saisir le procureur général pour ce qui s’apparente à un recours gracieux ;
– l’article 16-2 du code de procédure pénale prévoit, dans un nouveau délai d’un mois, un recours devant une commission de recours composée de trois magistrats du siège de la Cour de cassation. Le contrôle exercé par la commission porte sur la légalité de la décision, sur l’appréciation des faits reprochés et sur l’opportunité de la décision du procureur général. Ainsi peut-elle annuler la décision, la confirmer ou la réformer.
Contrairement aux décisions de la chambre de l’instruction, la sanction prononcée par le procureur général présente un caractère temporaire dans la mesure où l’officier de police judiciaire dont l’habilitation est suspendue ou retirée peut, selon les cas, la recouvrer à l’issue de la mesure de suspension ou solliciter une nouvelle habilitation.
L’étude d’impact jointe au projet de loi indique que la procédure disciplinaire relevant de la chambre de l’instruction est peu mise en œuvre. Un officier de police judiciaire au comportement fautif fait plus facilement l’objet de poursuites pénales et de sanctions administratives que d’un retrait d’habilitation. De plus, il est plus rapide et plus efficace pour le procureur général de convoquer l’intéressé que pour la chambre de l’instruction de se réunir : en 2015, l’activité disciplinaire de l’ensemble des procureurs généraux a représenté 39 suspensions et 34 retraits d’habilitation d’officier de police judiciaire, contre 5 saisines seulement des chambres de l’instruction – toutes à l’encontre d’agents de police judiciaire.
Cette situation n’est pas satisfaisante : elle montre l’inadaptation de la procédure devant la chambre de l’instruction, qui a pour conséquence une concentration du pouvoir de sanction entre les mains des procureurs généraux pour les officiers de police judiciaire, et une quasi-disparition du pouvoir de contrôle des agents de police judiciaire par l’autorité judiciaire.
2. Les dispositions du projet de loi
L’article 23 du projet de loi insère un nouvel article 229-1 au sein du code de procédure pénale afin d’instituer une procédure disciplinaire d’urgence à l’encontre des agents et officiers de police judiciaire en cas de manquement professionnel grave ou d’atteinte grave à l’honneur ou à la probité ayant une incidence sur la capacité d’exercice des missions de police judiciaire.
Le président de la chambre de l’instruction, saisi par le procureur général territorialement compétent, peut décider immédiatement que l’agent ou l’officier ne pourra exercer ses fonctions de police judiciaire pour une durée maximale d’un mois. La sanction correspond donc à une mesure conservatoire de mise à pied.
Il est précisé que la saisine du président de la chambre de l’instruction dans la nouvelle procédure vaut saisine au titre de la procédure disciplinaire de droit commun, de sorte qu’une interdiction temporaire ou définitive puisse succéder sans délai à la mesure conservatoire.
*
* *
La Commission examine l’amendement CL17 de M. Éric Ciotti.
M. Pierre Morel-A-L’Huissier. Je le retire.
L’amendement CL17 est retiré.
La Commission adopte l’amendement rédactionnel CL304 de la rapporteure.
Puis elle adopte l’article 23 modifié.
Article 24
(art. 77-2, 77-3 et 393 du code de procédure pénale)
Renforcement de la dimension contradictoire de l’enquête préliminaire
1. L’état du droit
Dirigée par le procureur de la République, l’enquête consiste en la recherche d’éléments visant à la constatation et à la caractérisation d’une infraction, à la recherche de l’auteur des faits et au recueil de preuves permettant d’établir la vérité. Le code de procédure pénale en distingue principalement deux :
– l’enquête de flagrance, prévue aux articles 53 à 73, qui n’est possible qu’en cas de constatation d’un crime ou d’un délit flagrant puni d’une peine d’emprisonnement. Sa durée est limitée à huit jours au cours desquels les enquêteurs disposent de pouvoirs étendus ;
– l’enquête préliminaire, qui regroupe tout ce qui n’entre pas dans le cadre de la flagrance et qui est longtemps demeurée informelle. Elle est aujourd’hui régie par les articles 75 à 78.
Outre sa direction par le parquet, l’enquête s’oppose à l’instruction – confiée à un magistrat spécialisé – du fait de son caractère non contradictoire (228). Les personnes faisant l’objet d’une enquête ne sont pas autorisées à accéder à l’ensemble du dossier de la procédure, à formuler des demandes d’actes ou de nullité, à contester les décisions prises au cours de l’enquête. Du reste, rien n’oblige à seulement informer une personne qu’elle fait l’objet d’une enquête.
Cette absence traditionnelle de contradictoire s’est cependant progressivement estompée :
– l’article 60 du code de procédure pénale permet au procureur de la République de communiquer aux suspects ou aux victimes le résultat des examens techniques, c’est-à-dire des expertises réalisées au cours de l’enquête (229) ;
– les articles 77-1 et 77-2, introduits par la loi n° 2000-1354 du 30 décembre 2000 tendant à faciliter l’indemnisation des condamnés reconnus innocents et portant diverses dispositions de coordination en matière de procédure pénale, autorisent une personne gardée à vue d’interroger six mois après sa libération le procureur de la République sur l’état de l’enquête ;
– l’article 706-105 prévoit que, dans les enquêtes en matière de délinquance ou de criminalité organisée qui se prolongent plus de six mois après une garde à vue, la personne gardée à vue puisse demander que son avocat ait accès au dossier avant de nouvelles auditions ;
– en cas de garde à vue ou d’audition libre, il est possible depuis 2014 d’être assisté par un avocat qui dispose de certaines des pièces de la procédure ;
– une phase contradictoire est également prévue par l’article 393 du code de procédure pénale au moment du défèrement (230), avant que le procureur prenne sa décision sur l’action publique (231).
Des situations inconfortables, dans lesquelles une personne apprend par déduction ou par indiscrétion qu’elle fait l’objet d’une enquête sans pouvoir aucunement mettre fin aux investigations ou à la rumeur, soulèvent d’importantes critiques au regard de l’exigence de procès équitable.
Pour autant, le caractère peu contradictoire de l’enquête n’a jamais donné lieu à condamnation par les juridictions nationales ou européennes. La Cour de cassation considère que l’absence d’accès au dossier au cours de l’enquête est sans incidence sur le caractère équitable du procès puisque cet accès est pleinement garanti devant les juridictions d’instruction ou de jugement (232). Pareillement, la Cour européenne des droits de l’homme, dissipant les interrogations qui avaient pu résulter de certains arrêts, n’impose pas la mise à disposition du dossier lors de l’interrogatoire de police (233).
La question demeure cependant ouverte. En novembre 2013, la commission de modernisation de l’action publique a ainsi pris position en faveur d’un supplément de contradictoire dans les enquêtes dirigées par le parquet :
« La Commission juge en effet nécessaire de prévoir que, dans les enquêtes préliminaires d’une certaine durée, le procureur de la République ne puisse décider du renvoi en jugement de l’auteur présumé qu’après l’avoir mis en mesure de formuler des observations sur une éventuelle poursuite ou de solliciter la réalisation d’actes d’enquête complémentaires.
[Le] renforcement des pouvoirs du parquet dans le cadre de l’enquête préliminaire, le recours plus fréquent à ce type d’enquêtes et la tendance corrélative à un moindre recours à l’instruction ainsi que la longueur particulière de certaines de ces enquêtes militent clairement en faveur de l’ouverture du contradictoire aux mis en cause et aux victimes, sous certaines conditions.
Au-delà de certaines expériences ponctuelles en ce sens, qui ne peuvent être jugées suffisantes, ni satisfaisantes, tant qu’elles dépendent du choix discrétionnaire du parquet, il semble donc utile de prévoir, dans le cadre de l’enquête préliminaire, une possibilité de donner accès aux pièces du dossier, sur la base de critères objectifs, avant que la décision d’engager des poursuites intervienne.
Soucieuse d’écarter le risque d’une fragilisation des enquêtes en cours, la Commission a d’abord jugé opportun de prévoir que l’accès aux pièces de la procédure ne puisse avoir lieu qu’une fois l’enquête clôturée par le service d’enquête et transmise au parquet.
Elle a également estimé que seules les enquêtes longues, d’une durée au moins égale à un an à compter du premier procès-verbal, devaient ouvrir droit à l’accès au dossier. » (234)
L’article 24 du projet de loi s’inspire fortement de la proposition de la commission présidée par M. Nadal mentionnée ci-dessus. En réécrivant les articles 77-2 et 77-3 du code de procédure pénale, il vise à instaurer une phase contradictoire à l’issue des enquêtes longues, dans des conditions restrictives afin de ne pas amoindrir l’efficacité des investigations.
Les alinéas 3 à 6 prévoient que, lorsqu’une enquête est en cours depuis au moins un an, toute personne soupçonnée d’avoir commis ou tenté de commettre un crime ou un délit et qui a fait l’objet d’un acte restreignant sa liberté (235), peut, six mois après l’accomplissement du premier de ces actes, demander au procureur de la République de consulter le dossier de la procédure. Cet accès lui est accordé à condition que l’enquête soit estimée en état d’être communiquée et que n’intervienne aucune décision de classement sans suite, de défèrement contradictoire ou d’ouverture d’une information judiciaire confiée à un juge d’instruction. Il est alors possible de formuler des observations dans un délai d’un mois au cours duquel le procureur ne peut prendre aucune décision sur l’action publique autre que la poursuite ou l’information judiciaire. La victime, qui dispose des mêmes droits, est avisée dans les mêmes conditions. Dès lors, toute nouvelle audition donne lieu à une information préalable de la personne, dix jours auparavant, l’informant qu’elle peut demander la consultation de son dossier.
L’alinéa 7 offre au procureur de la République la faculté de communiquer à tout moment tout ou partie de la procédure à la victime et au suspect afin de recueillir leurs observations. Le contradictoire est ici considéré positivement, comme un moyen pour le parquet de faire progresser l’enquête.
Avant de prendre sa décision sur l’action publique, ce magistrat sera tenu de communiquer à ces personnes, ainsi qu’à la victime, l’intégralité du dossier de la procédure, pour recevoir leurs observations et leurs éventuelles demandes d’actes. Cette communication du dossier et ce recueil d’observations pourra également intervenir à tout moment en cours de procédure, même en l’absence de demande, à l’initiative du procureur.
Les alinéas 8 et 9 ordonnent que les observations formulées dans le cadre des alinéas précédents soient versées au dossier. Elles portent sur la régularité de la procédure, sur la qualification retenue, sur la qualité de l’enquête et sur les suites envisagées – par exemple en proposant une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (236). Elles peuvent également comporter des demandes d’actes que la personne estime souhaitables. Le procureur de la République apprécie les suites à donner à ces observations, dans le respect du nouvel article 39-3 du code de procédure pénale qui lui fait obligation d’enquêter à charge et à décharge. Ses décisions ne pourront faire l’objet d’un recours, de la même façon qu’aucun recours n’est possible contre celle prise à l’issue d’un défèrement (237).
L’alinéa 10 précise que la demande d’accès au dossier est adressée au procureur de la République sous la direction duquel l’enquête est menée ou, au choix du demandeur, au procureur de la République du tribunal de grande instance dans le ressort duquel l’un des actes mentionnés à cet article a été réalisé.
Enfin, l’alinéa 11 modifie l’article 393 du code de procédure pénale relatif au défèrement contradictoire de façon à harmoniser le contenu des observations qui peuvent être présentées alors avec celles prévues au présent article.
3. Les modifications opérées par votre commission des Lois
L’introduction au cours de l’enquête préliminaire d’une « fenêtre de contradictoire » est une nécessité afin d’introduire des garanties supplémentaires dans la procédure pénale. Toutefois, la disposition proposée dans le projet de loi soulevait plusieurs interrogations.
– Comment une personne apprend-elle qu’elle fait l’objet d’une enquête préliminaire ? Comment, une fois informée, peut-elle savoir que l’enquête en question a commencé depuis plus d’un an et qu’elle est autorisée à solliciter la communication du dossier ?
– Le droit d’accès au dossier peut-il réellement prospérer dès lors que le procureur de la République est seul juge du caractère communicable de l’enquête, que sa décision est discrétionnaire et qu’elle ne peut faire l’objet d’aucun recours ? Ne sera-t-il pas tentant, pour des magistrats par ailleurs confrontés à des tâches extrêmement nombreuses et prenantes, de garder le silence et de ne jamais considérer l’enquête en état d’être communiquée ?
– Surtout, dans les enquêtes complexes sur des sujets tels que le terrorisme ou les délits financiers, il est fréquent que de nombreuses personnes fassent l’objet d’investigations sans pour autant être renvoyées devant la juridiction de jugement. Est-il cohérent de donner accès au dossier, voire d’offrir la possibilité de solliciter des actes et de formuler un avis sur l’enquête, à des personnes qui ne seront même pas parties au procès et qui, contrairement à l’instruction, ne bénéficient d’aucun statut comparable à celui de témoin assisté (238) ou de mis en examen ?
La commission des Lois a considéré ces incertitudes trop grandes pour approuver la rédaction proposée par le Gouvernement. À l’initiative de votre rapporteure et à l’unanimité, elle a profondément modifié l’article 24 pour instituer un mécanisme qui, présenté à l’occasion des auditions préparatoires, a recueilli un soutien quasi-général.
S’inspirant de la rédaction de l’article 175 du code de procédure pénale relatif à la mise en état de l’instruction avant règlement, le dispositif proposé n’intervient qu’une fois que le procureur estime l’enquête terminée. Cette condition relève certes de son appréciation discrétionnaire, mais elle est objectivement observable en ce qu’elle précède la clôture de la phase d’enquête pour donner une suite aux investigations accomplies : elle présente donc l’avantage d’obliger, à terme, à procéder à une communication (239). L’accès en fin d’enquête offre également des avantages pratiques, les pièces se trouvant alors en un même endroit et non réparties entre les différents enquêteurs.
En supprimant tout délai, la nouvelle rédaction de l’article 24 simplifie les démarches et crée les conditions d’une égalité entre les enquêtes longues et les dossiers traités plus brièvement – ces derniers échappant à tout contradictoire dans la version proposée par le Gouvernement. La consultation n’est pas non plus conditionnée à une quelconque mesure d’enquête privative ou restrictive de liberté, la Commission ayant estimé fortement improbable que des poursuites puissent être engagées à l’encontre d’une personne n’ayant jamais fait l’objet de la moindre audition par les enquêteurs.
Enfin, elle limite la communication à la victime, au plaignant et à la seule personne que le procureur de la République envisage de poursuivre, donc aux seules parties au procès – sauf à ce qu’il recoure à la procédure du défèrement contradictoire. Les hypothèses d’une information judiciaire ou d’un classement sans suite, qui ne sont pas des poursuites, n’ont donc plus à être expressément mentionnées (240). Des observations et des demandes d’actes pourraient toujours être présentées dans le délai d’un mois et versées au dossier. Le ministère public déciderait discrétionnairement de satisfaire, ou non, les sollicitations reçues, mais son refus pourrait servir de base à une mise en cause de la qualité de l’enquête devant la juridiction de jugement.
Outre cette communication obligatoire, la rédaction adoptée par la commission des Lois laisse perdurer la liberté pour le procureur de la République de communiquer, à tout moment, tout ou partie de la procédure s’il voit là un moyen de faire progresser l’enquête.
*
* *
La Commission est saisie de l’amendement CL305 de la rapporteure.
Mme Colette Capdevielle, rapporteure. L’article 24 du projet de loi prévoit d’ouvrir aux personnes ayant fait l’objet d’une mesure d’investigation – audition, garde à vue, saisie, perquisition – depuis plus de six mois, au cours d’une enquête préliminaire ouverte depuis plus d’un an, la faculté de demander au procureur de la République un accès au dossier afin de formuler des observations. Le parquet reste libre de faire échec à cette requête s’il estime que l’enquête n’est pas en état d’être communiquée.
La rédaction initiale de cet article soulève de nombreuses interrogations. Premièrement, comment une personne suspectée peut-elle savoir qu’elle fait l’objet d’une enquête préliminaire – et a fortiori, que celle-ci a commencé depuis plus d’un an ?
Deuxièmement, le droit d’accès au dossier peut-il réellement prospérer dès lors que le procureur de la République est seul juge du caractère communicable de l’enquête, que sa décision est discrétionnaire et qu’elle ne peut faire l’objet d’aucun recours ?
Troisièmement, enfin, dans les enquêtes complexes sur des sujets tels que le terrorisme ou les délits financiers, il est très fréquent que des personnes fassent l’objet d’investigations sans pour autant être renvoyées devant une juridiction de jugement. Est-il dès lors cohérent de donner accès au dossier, voire de donner la possibilité de solliciter des actes et de formuler un avis sur l’enquête, à des personnes qui ne seront même pas parties au procès ?
L’amendement CL305 propose de remédier à ces interrogations en suggérant un mécanisme qui a recueilli l’aval quasi unanime des magistrats entendus par les rapporteurs. S’inspirant de la rédaction de l’article 175 du code de procédure pénale relatif à la mise en état de l’instruction, le dispositif proposé n’intervient qu’une fois que le procureur estime l’enquête terminée, mais ne lui permet pas de refuser un accès au dossier à ce moment-là : il doit obligatoirement communiquer la copie de la procédure à toutes les parties, quelles qu’elles soient, avant de rendre sa décision. C’est le point de départ d’un délai d’un mois, pendant lequel les parties peuvent formuler des demandes d’actes.
M. Patrick Devedjian. Ou des observations ?
Mme la rapporteure. Ou des observations, effectivement : le dispositif proposé est très similaire à celui de l’article 175 du code de procédure pénale.
M. Alain Tourret. Avec des délais impératifs ?
Mme la rapporteure. J’y viens.
Le dispositif limite l’avis, outre à la victime et au plaignant, à la seule personne que le procureur de la République envisage de poursuivre – donc aux seules parties au procès.
M. Patrick Devedjian. Mais il peut aussi envisager de classer l’affaire ?
Mme la rapporteure. Bien sûr ; auquel cas il est toujours possible de demander la copie de la procédure – c’est d’ailleurs ce qui se fait habituellement aujourd’hui.
Il n’est plus fait mention de délais d’aucune sorte, ce qui permet une égalité entre toutes les procédures ; en effet, en sa rédaction actuelle, le texte défavorise les procédures courtes – de moins d’un an –, qui ne peuvent donner lieu à communication.
L’amendement propose qu’il ne soit plus fait référence aux actes d’investigation subis par la personne que le procureur envisage de poursuivre, dans la mesure où il serait extraordinaire que soit renvoyé devant le tribunal correctionnel un prévenu qui n’aurait jamais été entendu préalablement à l’audience.
Par ailleurs, la possibilité laissée au procureur de communiquer à tout moment tout ou partie de la procédure demeure inchangée et à sa discrétion, s’il voit là un moyen de faire progresser l’enquête. Cela correspond à la tendance actuelle, consistant à faire évoluer la procédure en ouvrant une porte vers davantage de contradictoire.
M. Patrick Devedjian. Une fenêtre !
Mme la rapporteure. Une lucarne, si vous voulez… Mais c’est une évolution importante que celle consistant à permettre à toutes les parties à une enquête de faire des observations et de demander des actes, qu’il s’agisse d’expertises complémentaires, d’une confrontation ou d’un classement sans suite, à l’instar de ce qui se fait en fin d’information judiciaire.
M. Alain Tourret. C’est une excellente initiative, madame la rapporteure, mais pouvez-vous nous préciser les sanctions qui s’appliquent en cas de non-respect des délais ?
Mme la rapporteure. Si le procureur ne répond pas, les parties pourront s’en prévaloir dans le cadre du débat sur le fond.
M. Patrick Devedjian. S’il y a un débat sur le fond !
Mme la rapporteure. S’il vient devant la juridiction, évidemment.
Mon amendement est ainsi rédigé : « Aussitôt que l’enquête préliminaire lui paraît terminée et sauf s’il fait application des dispositions de l’article 393, le procureur de la République avise la personne qu’il envisage de poursuivre, ou son avocat, de la mise à disposition d’une copie de la procédure et de la possibilité de formuler des observations dans un délai d’un mois par lettre recommandée avec accusé de réception ou déclaration au greffe contre récépissé. La victime et le plaignant disposent des mêmes droits et sont avisés dans les mêmes conditions.
« Pendant ce délai d’un mois, le procureur de la République ne prend aucune décision sur l’action publique, hors l’ouverture d’une information ou l’application des dispositions de l’article 393. » Je précise que le défèrement contradictoire est d’ores et déjà une possibilité offerte par la loi.
M. Patrick Devedjian. Que signifie l’expression « le procureur de la République ne prend aucune décision » ? Qu’il ne procède à aucune autre investigation ?
Mme la rapporteure. Cela peut vouloir dire cela. Les parties peuvent également estimer que l’enquête menée est suffisante. Ce qui est important, c’est d’introduire du contradictoire lors de cette phase de l’enquête, c’est-à-dire donner à toutes les parties la possibilité de faire valoir qu’ils estiment l’enquête mal conduite ou insuffisante. Cela permet de ne pas attendre l’audience pour enregistrer dans le dossier les commentaires et les demandes des parties, qui y figureront au même titre que les éléments de fond que sont les auditions ou les confrontations. Ce n’est pas rien.
M. Patrick Devedjian. Le procureur de la République doit-il communiquer même quand il a l’intention de classer sans suite – puisqu’il prévient toutes les parties, y compris la victime ?
Mme la rapporteure. Comme vous le savez, lorsque le procureur classe une affaire, les parties ont déjà la possibilité de demander la communication de la procédure.
M. Patrick Devedjian. Le parquet le fait, mais on ne sait pas vraiment en vertu de quel texte.
M. Alain Tourret. Que pensent les magistrats de ce délai d’un mois ? Estiment-ils qu’il convient ?
Mme la rapporteure. Lorsque nous les avons interrogés sur ce point, ils ont estimé qu’il convenait. N’oublions pas que le délai commence quand ils estiment l’enquête terminée et qu’ils envisagent de renvoyer.
M. Patrick Devedjian. En fait, ce sont eux qui font démarrer le délai.
Mme la rapporteure. Il faut bien qu’ils communiquent la procédure à un moment donné, même dans les greffes surchargés. Pour le moment, cela se fait au stade de l’audience ; je propose que cela se fasse préalablement.
M. Alain Tourret. Si le procureur de la République ne répond pas à une demande d’instruction, la personne qui a formulé cette demande dispose-t-elle d’un droit acquis à la faire valider par les juridictions du fond ?
M. Patrick Devedjian. En tout état de cause, le fait qu’une partie demande des investigations complémentaires ne va-t-il pas conduire presque systématiquement le procureur à renvoyer chez le juge d’instruction ?
Mme la rapporteure. Il ne le fera que s’il l’estime utile, à l’instar du juge d’instruction qui ne fait droit à une demande que si elle lui paraît motivée et non formulée à des fins dilatoires – le plus souvent, il y fait droit, afin de sécuriser sa procédure. Le procureur n’aura aucune raison de repousser une demande visant à concourir à la manifestation de la vérité.
M. Alain Tourret. Si le procureur de la République refuse de faire droit à une demande, en motivant la décision qu’il notifie, sa décision est-elle susceptible d’être attaquée ?
Mme la rapporteure. Il n’a pas besoin de la motiver.
M. Patrick Devedjian. De toute façon, on ne fait pas appel des décisions du procureur, qui ne juge pas.
Mme la rapporteure. Effectivement, les décisions prises ont simplement vocation à être versées au dossier afin de faire ultérieurement l’objet d’un débat contradictoire lors de l’audience devant la juridiction de fond.
Il faut voir cette proposition comme un moyen d’introduire du contradictoire lors de la phase d’enquête, et de donner aux parties la possibilité de porter un regard sur ce qui s’y fait.
M. Patrick Devedjian. C’était l’une des conclusions du rapport Beaume.
Mme la rapporteure. Tout à fait. Nous aurons l’occasion d’en discuter avec le Gouvernement en séance publique. Et si nous sommes tous favorables à pratiquer une ouverture vers davantage de contradictoire au stade de l’enquête, nous savons bien que nous n’allons pas passer du jour au lendemain d’un système inquisitoire à un système accusatoire à l’anglo-saxonne : culturellement, nous ne sommes pas prêts à cette évolution.
Quoi qu’il en soit, je vous remercie pour la qualité de cet échange.
La Commission adopte l’amendement à l’unanimité.
En conséquence, les amendements CL200 de M. Sergio Coronado et CL101 de M. Philippe Houillon tombent.
La Commission adopte les amendements CL306, de conséquence, et CL307, rédactionnel, de la rapporteure.
Puis elle adopte l’article 24 modifié.
Article 25
(art. 100-1, 100-2 et 100-7 du code de procédure pénale)
Modalités d’interception de communications au cours de l’instruction
1. L’état du droit
Issus de la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des communications électroniques, les articles 100 à 100-7 du code de procédure pénale autorisent l’interception, l’enregistrement et la transcription des correspondances électroniques, en matière criminelle et correctionnelle, si une information judiciaire a été ouverte relativement à une infraction réprimée par le code pénal d’une peine égale ou supérieure à deux ans d’emprisonnement.
De telles opérations sont strictement encadrées :
– elles sont engagées sur décision du juge d’instruction, « prise pour une durée maximum de quatre mois » indéfiniment renouvelable, qui « doit comporter tous les éléments d’identification de la liaison à intercepter, l’infraction qui motive le recours à l’interception ainsi que la durée de celle-ci » ;
– le juge d’instruction – ou l’officier de police judiciaire commis par lui –qui fait procéder à l’installation du dispositif d’interception dresse un procès-verbal des opérations d’interception et d’enregistrement ainsi que de la transcription des seules correspondances utiles à la manifestation de la vérité ;
– les enregistrements sont détruits à l’expiration du délai de prescription de l’action publique ;
– certaines personnes bénéficient d’une protection renforcée contre ces interceptions judiciaires à raison de leur profession et du bénéfice de dispositions constitutionnelles spécifiques (241). À peine de nullité, ne peuvent être retranscrits les échanges entre une personne et son avocat relevant de l’exercice des droits de la défense – sauf à ce qu’ils révèlent la participation du conseil à la commission d’une infraction – ni ceux permettant d’identifier la source d’un journaliste. Aucune interception ne peut avoir lieu sur la ligne d’un parlementaire sans que le président de l’assemblée à laquelle il appartient en soit informé ; sur une ligne dépendant du cabinet d’un avocat ou de son domicile sans que le bâtonnier en soit informé ; sur une ligne dépendant du cabinet d’un magistrat ou de son domicile sans que le premier président ou le procureur général de la juridiction en soit informé.
Bien qu’il n’ait jamais eu à se prononcer sur la constitutionnalité des interceptions ordonnées au cours de l’instruction, le Conseil constitutionnel a livré une analyse des principes constitutionnels applicables en la matière dans sa décision n° 2004-492 DC du 2 mars 2004, Loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, à propos de dispositions relatives aux interceptions dans des enquêtes ouvertes en matière de délinquance organisée. Rappelant qu’il appartient au législateur « d’assurer la conciliation entre, d’une part, la sauvegarde de l’ordre public et la recherche des auteurs d’infractions, toutes deux nécessaires à la protection de principes et de droits de valeur constitutionnelle et, d’autre part, le respect de la vie privée et des autres droits et libertés constitutionnellement protégés », il considère que les écoutes « doivent être exigées par les besoins de l’enquête et autorisées par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance, à la requête du procureur de la République ; que cette autorisation est délivrée pour une durée maximale de quinze jours, qui n’est renouvelable qu’une fois, sous le contrôle du juge des libertés et de la détention ».
Les exigences de la Cour européenne des droits de l’homme en matière d’interception ont été explicitées dans un arrêt Uzun c. Allemagne du 2 septembre 2010. Le considérant n° 65 note : « La loi doit définir la nature des infractions susceptibles de donner lieu à un mandat d’interception, les catégories de personnes susceptibles d’être mises sur écoute, la durée maximale de l’exécution de la mesure, la procédure à suivre pour l’examen, l’utilisation et la conservation des données recueillies, les précautions à prendre pour la communication des données à d’autres parties et les circonstances dans lesquelles peut ou doit s’opérer l’effacement ou la destruction des enregistrements. » En application du principe de proportionnalité des atteintes à la vie privée qui se déduit de l’article 8 de la Convention, l’interception des communications d’un individu trop longtemps prolongée serait donc très probablement considérée irrégulière.
Tant le juge constitutionnel que le droit européen prêtent donc de l’importance à la limitation de la durée totale des interceptions de communication, ce que ne prévoit pas la procédure pénale française dans le cadre de l’instruction.
La Cour européenne des droits de l’homme exige également des garanties procédurales renforcées au bénéfice des professionnels et des élus dont l’activité doit être particulièrement protégée. L’arrêt Kopp c. Suisse du 25 mars 1998 admet les interceptions téléphoniques d’un avocat à condition que les droits de la défense soient préservés : le tri entre ce qui relève des relations avec les clients, couvertes par le secret professionnel, et les conversations exploitables semble devoir être opéré par un magistrat indépendant.
2. Les dispositions du projet de loi
Afin de sécuriser juridiquement le dispositif d’interception au cours de l’instruction, l’article 25 du projet de loi procède à trois modifications au sein du code de procédure pénale.
Le I modifie l’article 100-1 en ordonnant la motivation de l’ordonnance par laquelle le juge d’instruction prescrit une interception.
Le II précise que le renouvellement de la décision d’interception ne peut conduire à ce que l’écoute excède une durée d’un an. Ce maximum est porté à deux ans dans les affaires de criminalité et de délinquance organisées.
Le III renforce la protection spécifique dont bénéficient certains professionnels et élus. Les interceptions sur la ligne d’un parlementaire, d’un avocat ou d’un magistrat que décide le juge d’instruction sont soumises à l’appréciation du juge des libertés et de la détention qui les autorise par ordonnance motivée, à condition qu’il existe des raisons plausibles de penser que la personne a participé, comme auteur ou complice, à la commission de l’infraction. Ce double examen par le juge d’instruction et par le juge des libertés et de la détention est comparable à celui prévu à l’article 230-34 du code de procédure pénale en matière de géolocalisation. Copie de l’ordonnance est communiquée, pour information, soit au président de l’assemblée parlementaire concernée, soit au bâtonnier, soit au premier président ou au procureur général.
*
* *
La Commission est saisie de l’amendement CL104 de M. Patrick Devedjian.
M. Patrick Devedjian. Cet amendement vise à instaurer un contrôle de proportionnalité en matière d’écoutes téléphoniques.
Mme la rapporteure. Comme vous le savez, ce n’est pas par plaisir que le juge d’instruction décide de procéder à des interceptions. Lorsqu’il y recourt, c’est parce qu’il en a besoin dans le cadre de l’instruction pour la manifestation de la vérité. Le fait d’imposer la motivation des décisions du juge d’instruction et de limiter les écoutes dans le temps suffit, à mon sens, à assurer la proportionnalité. Je rappelle qu’en vertu de la jurisprudence, une écoute irrégulière, qui outrepasse les nécessités de l’enquête, est frappée de nullité, ce qui constitue une mesure de protection efficace. Par ailleurs, le contrôle de proportionnalité que vous proposez me paraît flou dans sa rédaction, puisque les critères n’en sont pas précisés.
M. Patrick Devedjian. C’est en fonction de l’importance des faits poursuivis : il existe une jurisprudence en matière de proportionnalité.
Mme la rapporteure. Nous sommes, me semble-t-il, sur un terrain un peu glissant, la notion de proportionnalité étant très subjective. Je suis donc défavorable à cet amendement.
La Commission rejette l’amendement.
Puis elle adopte l’amendement rédactionnel CL308 de la rapporteure.
Elle examine ensuite l’amendement CL100 de M. Patrick Devedjian.
M. Patrick Devedjian. La rédaction actuelle du deuxième alinéa de l’article 100-7 du code de procédure pénale autorise les écoutes téléphoniques sur les lignes tant professionnelles que privées d’un avocat, pour peu que le bâtonnier ait été informé de l’écoute par le juge d’instruction. Il est proposé avec cet amendement de soumettre la décision du placement sur écoute d’un avocat à un débat contradictoire préalable entre le juge des libertés et de la détention (JLD) et le bâtonnier. En effet, mettre un avocat sur écoute est un acte très grave, une atteinte aux droits de la défense qu’il convient d’entourer de précautions particulières.
Mme la rapporteure. C’est à l’évidence une atteinte significative. Cela dit, le bâtonnier représente un ordre professionnel et n’est pas partie à un procès : il est simplement présent lors des perquisitions effectuées soit au cabinet, soit au domicile d’un avocat.
Le dispositif que vous proposez est extrêmement lourd. Il existe déjà un double contrôle, que contestent d’ailleurs certains magistrats, avec contrôle du JLD sur décision du juge d’instruction.
M. Patrick Devedjian. C’est l’évolution naturelle du JLD.
Mme la rapporteure. Sans doute, mais votre amendement aurait pour conséquence de voir trois juges se prononcer sur la même mesure d’instruction, ce qui fait beaucoup. Si un avocat n’est effectivement pas un justiciable comme les autres…
M. Patrick Devedjian. Si, mais pas dans l’exercice de sa profession.
Mme la rapporteure. … dans la mesure où il est dépositaire des droits de la défense, le texte prévoit déjà sa protection en renforçant le système dérogatoire dont il bénéficie. Quand un magistrat instructeur décide de procéder à la mise sur écoute d’un avocat, cette mesure est soumise au double contrôle du juge d’instruction et du juge des libertés et de la détention, ce qui me paraît déjà constituer une sérieuse garantie du fait que la mesure demandée est justifiée. Enfin, quand il commet une infraction, un avocat doit être considéré comme un justiciable comme les autres. Je suis donc défavorable à cet amendement.
M. Alain Tourret. Je rappelle qu’il est ici question du placement sur écoute des lignes professionnelles et privées, ce qui m’a toujours choqué, car on confond ainsi le professionnel et la personne privée, en contradiction avec une distinction qui n’est plus aussi évidente de nos jours mais qu’il a toujours été d’usage de respecter. Certes, on fait intervenir le JLD, lui-même saisi par le juge d’instruction, mais est-ce suffisant pour contrôler un acte aussi grave que la mise sur écoute d’un avocat, détenteur de tant de secrets ? Comme vous le savez, c’est souvent au moyen des discussions ayant eu lieu entre un avocat et son bâtonnier que l’on peut remonter une procédure.
M. Patrick Devedjian. C’est arrivé !
M. Alain Tourret. Effectivement, c’est même arrivé dans une affaire que chacun connaît. En tout état de cause, il ne me paraît pas superflu de prévoir une garantie supplémentaire, comme le propose M. Devedjian.
Mme la rapporteure. J’entends bien vos arguments, qui justifient que nous reprenions ce débat en séance publique.
La Commission rejette l’amendement.
Elle examine ensuite l’amendement CL99 de M. Patrick Devedjian.
M. Patrick Devedjian. Il s’agit d’un amendement de repli.
Mme la rapporteure. Même avis que précédemment.
La Commission rejette l’amendement.
Elle est ensuite saisie de l’amendement CL105 de M. Patrick Devedjian.
M. Patrick Devedjian. Il s’agit de protéger plus efficacement le secret professionnel de l’avocat et de son client par l’interdiction des écoutes incidentes, et ainsi de se conformer aux règles et à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme.
Mme la rapporteure. Avis défavorable, pour les raisons exposées précédemment.
La Commission rejette l’amendement.
Elle adopte ensuite l’article 25 modifié.
Article 25 bis (nouveau)
(art. 56, 56-5 [nouveau], 57, 57-1, 60-1, 77-1-1 et 96 du code de procédure pénale)
Protection des documents couverts par le secret du délibéré
Le présent article, adopté par la commission des Lois à l’initiative de votre rapporteure, vise à tirer les conséquences dans notre droit de la décision n° 2015-506 QPC du 4 décembre 2015 par laquelle le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution certaines dispositions relatives aux modalités de perquisition et de saisie en matière pénale.
1. Les perquisitions et les saisies dans le cadre d’une enquête pénale
La plupart des dispositions encadrant le recours aux perquisitions et aux saisies au cours de l’enquête pénale sont anciennes, puisqu’elles sont issues de la loi n° 57-1426 du 31 décembre 1957 portant institution d’un code de procédure pénale.
a. Les modalités générales de perquisitions et de saisies en enquête de flagrance, en enquête préliminaire et dans le cadre de l’instruction
i. En enquête de flagrance
En vertu des articles 56 et 57 du code de procédure pénale, les perquisitions dans un domicile doivent être réalisées par un officier de police judiciaire (OPJ). L’autorisation du procureur de la République n’est pas requise, sauf « si la perquisition est effectuée aux seules fins de rechercher et de saisir des biens dont la confiscation est prévue par les cinquième et sixième alinéas » de l’article 131-21 du code pénal. Le consentement de l’occupant n’est pas requis mais la perquisition doit être réalisée « en présence de la personne au domicile de laquelle la perquisition a lieu » ou, à défaut, d’un représentant de son choix ou de deux témoins requis par l’OPJ. Un procès-verbal de ces opérations est dressé. La perquisition ne peut se dérouler que durant les heures légales mentionnées par l’article 59 du même code, soit entre 6 heures et 21 heures.
Seuls l’OPJ, les témoins requis par celui-ci ou les personnes requises en vue de procéder à des constatations ou à des examens techniques ou scientifiques peuvent prendre connaissance des documents dont la saisie est envisagée. Les biens saisis doivent être inventoriés et placés sous scellés. Certaines dispositions particulières sont prévues pour la saisie de données informatiques et de fonds ou valeurs.
ii. En enquête préliminaire
L’article 76 du code de procédure pénale fixe les conditions des perquisitions et saisies dans le cadre d’une enquête préliminaire, les règles procédurales étant identiques à celles applicables en matière de flagrance. Toutefois, à la différence de cette dernière, le consentement de la personne chez qui les opérations ont lieu est requis, sauf dérogation autorisée par le juge des libertés et de la détention (JLD).
iii. Dans le cadre d’une instruction
Si, de manière générale, le juge d’instruction peut réaliser des perquisitions et saisies sur le fondement de l’article 81 du code de procédure pénale, lequel l’autorise à procéder, « conformément à la loi, à tous les actes d’information qu’il juge utiles à la manifestation de la vérité », plusieurs dispositions de ce code précisent les conditions de réalisation de telles opérations.
L’article 92 du même code dispose que le juge d’instruction peut « se transporter sur les lieux pour y effectuer les constatations utiles ou procéder à des perquisitions ». L’article 94 prévoit que « les perquisitions sont effectuées dans tous les lieux où peuvent se trouver des objets ou des données informatiques dont la découverte serait utile à la manifestation de la vérité ou des biens dont la confiscation est prévue par l’article 131-21 du code pénal ». L’article 95 rend applicables à ces perquisitions les articles 57 et 59 précités. Enfin, les deux premiers alinéas de l’article 96 exigent, dans le cas d’une perquisition au domicile d’une personne autre que celle mise en examen, que la personne chez qui elle est réalisée soit invitée à y assister ou, à défaut, que l’opération ait lieu en présence de deux de ses parents ou alliés ou de deux témoins. Le dernier alinéa de l’article 96 précité rend applicables aux perquisitions effectuées par le juge d’instruction les dispositions de l’article 56 précité.
L’article 97 applique aux saisies au stade de l’instruction des règles très voisines de celles prévues en flagrance.
b. Les conditions de protection du secret professionnel
De manière générale, le troisième alinéa des articles 56 et 96 précités disposent que l’OPJ ou le juge d’instruction qui procède à une perquisition ou à une saisie « a l’obligation de provoquer préalablement toutes mesures utiles pour que soit assuré le respect du secret professionnel et des droits de la défense ». La Cour de cassation a ainsi jugé que la saisie d’objets utiles à la manifestation de la vérité devait respecter la confidentialité des correspondances échangées entre un avocat et son client et celles liées à l’exercice des droits de la défense (242).
Plus spécifiquement, les articles 56-1 à 56-4 du même code assurent la protection de certains secrets professionnels et des droits de la défense :
– les perquisitions réalisées au cabinet d’un avocat ou à son domicile ne peuvent être réalisées que par un magistrat, en présence du bâtonnier, à la suite d’une décision écrite du magistrat ; en outre, le bâtonnier peut s’opposer à la saisie d’un document s’il l’estime irrégulière, le JLD étant alors compétent pour statuer sur la régularité de la procédure (article 56-1) ;
– les perquisitions dans les locaux ou véhicules d’une entreprise de presse, de communication audiovisuelle ou au public en ligne, d’une agence de presse ou au domicile d’un journaliste, lorsque les investigations sont liées à son activité professionnelle, doivent être également menées par un magistrat et faire l’objet d’une décision écrite et motivée : la personne présente lors de l’opération peut s’opposer à une saisie si elle l’estime irrégulière, dans les mêmes conditions que celles prévues par l’article 56-1 (article 56-2) ;
– les perquisitions réalisées dans le cabinet d’un médecin, d’un notaire ou d’un huissier doivent aussi être effectuées par un magistrat et en présence de la personne responsable de l’ordre à laquelle la personne appartient (article 56-3) ;
– les perquisitions « dans un lieu précisément identifié, abritant des éléments couverts par le secret de la défense nationale », ne peuvent être réalisées que par un magistrat en présence du président de la Commission consultative du secret de la défense nationale, dans des conditions strictement définies (article 56-4).
2. La décision n° 2015-506 QPC du 4 décembre 2015
Constatant l’absence de dispositions spécifiques à la protection du secret des délibérés, le Conseil constitutionnel a, dans sa décision n° 2015-506 QPC, déclaré contraires à la Constitution le troisième alinéa de l’article 56 et certaines dispositions de l’article 57 du code de procédure pénale, précités, relatifs à la saisie et à la perquisition dans le cadre d’une enquête de flagrance.
En effet, le Conseil a considéré que « s’il [était] loisible au législateur de permettre la saisie d’éléments couverts par le secret du délibéré, il lui [appartenait] de prévoir les conditions et modalités selon lesquelles une telle atteinte au principe d’indépendance [pouvait] être mise en œuvre afin que celle-ci demeure proportionnée ». Or, il a constaté que « les dispositions contestées se [bornaient] à imposer à l’officier de police judiciaire de provoquer préalablement à une saisie « toutes mesures utiles pour que soit assuré le respect du secret professionnel et des droits de la défense » » et que « ni ces dispositions ni aucune autre disposition [n’indiquaient] à quelles conditions un élément couvert par le secret du délibéré [pouvait] être saisi » (243).
En conséquence, le Conseil a considéré que le législateur avait méconnu l’étendue de ses compétences dans des conditions affectant le principe d’indépendance des juridictions, garanti par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, lequel « est indissociable de l’exercice de fonctions juridictionnelles et dont découle le principe du secret des délibérés » (244).
Quoique similaires, les règles applicables à l’instruction figurant à l’article 96 précité ont échappé à la censure car, issues de la loi du 31 décembre 1957, elles ne pouvaient méconnaître le domaine de la loi délimité par la Constitution du 4 octobre 1958.
3. Les dispositions du présent article
Les effets de cette déclaration d’inconstitutionnalité ayant été reportés au 1er octobre 2016, il appartient au législateur de fixer un nouveau cadre aux perquisitions et saisies décidées au cours de l’enquête pénale. Tel est l’objet du présent article, qui se substitue à l’autorisation de légiférer par ordonnance que le Gouvernement entendait initialement solliciter du Parlement au 5° du II de l’article 33 (245).
Le 2° du I du présent article insère un nouvel article 56-5 au sein du code de procédure pénale relatif aux « perquisitions dans les locaux d’une juridiction ou au domicile d’une personne exerçant des fonctions juridictionnelles et qui tendent à la saisie de documents susceptibles d’être couverts par le secret du délibéré ». Cet article s’inscrit à la suite des articles 56-1 à 56-4 protégeant certains secrets professionnels et le secret de la défense nationale contre les perquisitions et les saisies.
Les garanties prévues pour ces perquisitions et les saisies susceptibles d’être réalisées lors de ces opérations sont très proches de celles qui s’appliquent pour les perquisitions dans les cabinets d’avocats, les entreprises de presse ou le domicile des journalistes en application des articles 56-1 et 56-2 précités :
– à peine de nullité, elles devront être effectuées par un magistrat, « sur décision écrite et motivée de celui-ci, et en présence du premier président de la cour d’appel ou du premier président de la Cour de cassation ou de son délégué ». La décision autorisant l’opération devra comporter « la nature de l’infraction ou des infractions sur lesquelles portent les investigations, les raisons justifiant la perquisition et l’objet de celle-ci ». Seuls le magistrat, le premier président ou son délégué auront le droit de consulter ou de prendre connaissance des documents ou des objets se trouvant sur les lieux préalablement à leur éventuelle saisie et « [a]ucune saisie ne [pourra] concerner des documents ou des objets relatifs à d’autres infractions que celles mentionnées dans la décision » d’autorisation (premier alinéa) ;
– il est expressément prévu que le magistrat « veille à ce que les investigations conduites ne portent pas atteinte à l’indépendance de la justice » (deuxième alinéa) ;
– le premier président ou son délégué pourront s’opposer à la saisie d’un document ou d’un objet s’ils l’estiment irrégulière : le document ou l’objet sera alors placé sous scellé fermé, transmis sans délai, avec le procès-verbal mentionnant leurs objections, au JLD, qui statuera sur la contestation par ordonnance motivée non susceptible de recours après avoir entendu le magistrat qui a autorisé l’opération, le cas échéant, le procureur de la République, ainsi que le premier président ou son délégué (troisième et quatrième alinéas) ;
– si le JLD « estime qu’il n’y a pas lieu à saisir le document ou l’objet, [il ordonnera] sa restitution immédiate, ainsi que la destruction du procès-verbal des opérations » (avant-dernier alinéa) ; dans le cas contraire, il ordonnera le versement du scellé et du procès-verbal au dossier de la procédure ;
– enfin, la décision de verser le scellé au dossier de la procédure « n’exclut pas la possibilité ultérieure pour les parties de demander la nullité de la saisie devant, selon les cas, la juridiction de jugement ou la chambre de l’instruction » (dernier alinéa).
En conséquence, le 1° du même I précise que l’actuel troisième alinéa de l’article 56 précité, qui fait obligation à l’OPJ ou au juge d’instruction « de provoquer préalablement toutes mesures utiles pour que soit assuré le respect du secret professionnel et des droits de la défense », s’appliquera sans préjudice des dispositions des articles 56-1 à 56-5 inclus.
Les 3° à 5° du I procèdent à diverses coordinations aux articles 57, 57-1, 60-1, 77-1-1 et 96 afin de tenir compte des nouvelles dispositions relatives au respect de certains secrets mentionnés par les articles 56-1 à 56-5 précités.
Enfin, le II reporte l’entrée en vigueur du présent article au 1er octobre 2016, compte tenu de l’effet différé de la censure opérée par le Conseil constitutionnel dans sa décision précitée.
* *
La Commission examine l’amendement CL309 de la rapporteure.
Mme la rapporteure. L’article additionnel qu’il vous est proposé d’insérer vise à protéger les documents couverts par le secret du délibéré. Des régimes de protection sont prévus par le code de procédure pénale pour encadrer de manière drastique les perquisitions effectuées chez les avocats, les médecins, les journalistes, les notaires, les huissiers et les détenteurs d’un secret de la défense nationale. Mais rien n’était prévu, en cas de perquisition chez un magistrat ou un juré, pour empêcher la saisie de documents couverts par le secret du délibéré. Saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel a sanctionné ce défaut de la législation par une décision du 4 décembre 2015.
Le projet de loi prévoit une habilitation à légiférer par ordonnance pour combler cette lacune, mais j’ai préféré rédiger un amendement afin que la disposition proposée soit soumise à l’examen des parlementaires. En conséquence, je vous proposerai tout à l’heure, à l’article 33, de supprimer l’habilitation correspondante.
La Commission adopte l’amendement. L’article 25 bis est ainsi rédigé.
La Commission est saisie de l’amendement CL108 de M. Patrick Devedjian.
M. Patrick Devedjian. Cet amendement vise à créer un article additionnel ayant pour objet de renforcer la protection du secret des communications privées et professionnelles et de l’étendre aux communications et correspondances électroniques, conformément à la jurisprudence.
Mme la rapporteure. Nous avons déjà échangé sur ce point. La perquisition au cabinet ou au domicile de l’avocat ne peut être effectuée que par un magistrat – à la suite d’une décision écrite et motivée de ce magistrat – et en présence du bâtonnier, qui peut d’ailleurs s’opposer à une saisie de document : en ce cas, il est prévu de soumettre le dossier au juge des libertés et de la détention. Ces différentes étapes sont autant de garanties de la régularité de la procédure. Pour autant, il ne saurait être question de mettre en œuvre des conditions aboutissant à créer une quasi-immunité de ce professionnel protégé. Je suis donc défavorable à cet amendement.
La Commission rejette l’amendement.
Elle examine ensuite l’amendement CL106 de M. Patrick Devedjian.
M. Patrick Devedjian. Défendu.
Mme la rapporteure. Avis défavorable.
La Commission rejette l’amendement.
Article 26
(art. 179, 186-4 [nouveau], 186-5 [nouveau], 194-1 [nouveau] et 199 du code de procédure pénale)
Améliorations de la procédure en matière de détention provisoire et de renvoi
1. La détention provisoire après renvoi devant la juridiction de jugement
a. L’état du droit
L’article 179 du code de procédure pénale régit les modalités de renvoi d’un prévenu devant le tribunal correctionnel par ordonnance prise par le juge d’instruction. Cette ordonnance met fin à la détention provisoire, à l’assignation à résidence ou au contrôle judiciaire dont le prévenu faisait précédemment l’objet, sauf ordonnance distincte spécialement motivée décidant le maintien des mesures privatives ou restrictives de liberté pour deux mois dans l’attente de l’audience. Le tribunal peut, à titre exceptionnel, par une décision mentionnant les raisons de fait ou de droit faisant obstacle au jugement de l’affaire, ordonner la prolongation de la détention pour une nouvelle durée de deux mois, renouvelable une fois. Si le prévenu n’a toujours pas été jugé à l’issue de cette nouvelle prolongation, il est remis immédiatement en liberté.
Les rapports annuels de la Cour de cassation demandent, sans interruption depuis 2010, une clarification législative des délais dont la violation est sanctionnée par la mise en liberté en raison de « l’incidence de voies de recours irrecevables sur la computation des délais qui continuent de courir » (246). Deux arrêts de la chambre criminelle du 5 février 2014 (247) ont fait évoluer l’état du droit pour réduire les difficultés de calcul rencontrées :
– d’une part, la chambre de l’instruction qui statue en appel sur une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel n’est plus soumise aux règles régissant la durée de la détention provisoire pendant l’instruction. En effet, l’ordonnance a dessaisi le juge d’instruction. Quant au délai de deux mois applicable à la comparution devant la juridiction de jugement, il ne commence à courir qu’une fois l’appel jugé et l’ordonnance devenue définitive ;
– d’autre part, le tribunal correctionnel est incompétent pour prolonger la détention provisoire de deux mois tant que l’ordonnance n’est pas devenue définitive.
Compte tenu de cette jurisprudence, le seul délai applicable reste le délai raisonnable prévu à l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme. De surcroît, si l’article 574-1 impose à la Cour de cassation de statuer dans les trois mois sur un pourvoi frappant un arrêt portant mise en accusation devant la cour d’assises, il demeure muet en ce qui concerne le pourvoi sur un arrêt de renvoi devant le tribunal correctionnel (248).
b. Les dispositions du projet de loi
Le I du présent article modifie l’article 179 du code de procédure pénale de sorte que, si la règle perdure selon laquelle le prévenu en détention est remis en liberté lorsque le tribunal correctionnel n’a pas commencé à examiner l’affaire au fond à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la date de l’ordonnance de renvoi, le cas d’un appel est désormais prévu. Le délai de deux mois s’entend alors à compter de la décision de la chambre de l’instruction ou, en cas de pourvoi en cassation, de la décision de la Cour de cassation. En cas de remise en liberté suivie d’un nouveau placement en détention provisoire, le délai de deux mois court à compter de la date du placement.
Le II prévoit, dans un nouvel article 186-4 du même code, que la chambre de l’instruction statue dans les deux mois de l’ordonnance, même en cas d’appel irrecevable, faute de quoi la remise en liberté est de droit.
Le II insère également dans le même code un nouvel article 186-5 aux termes duquel l’ordonnance de renvoi rendue par le juge d’instruction clôt l’instruction et, par conséquent, les délais maximaux qui sont attachés à la détention provisoire pendant son déroulement.
Le V modifie l’article 574-1 du même code en fixant à trois mois le délai dans lequel la chambre criminelle doit statuer en cas de pourvoi sur l’arrêt de renvoi devant le tribunal correctionnel.
2. La détention provisoire après cassation et renvoi de la demande de mise en liberté
a. L’état du droit
La question du maintien en détention se pose, dans le cas d’une demande de mise en liberté rejetée par un arrêt de la chambre de l’instruction, lorsque l’arrêt en question est cassé par la Cour de cassation et renvoyé devant une juridiction de renvoi. Aucun délai de jugement n’est alors prévu par le code de procédure pénale.
Cette hypothèse a fait l’objet d’une question prioritaire de constitutionnalité examinée par le Conseil constitutionnel le 29 janvier 2015 à l’occasion de la décision n° 2014-446 QPC, M. Maxime T., qui avait conclu à la conformité de la procédure : en « matière de privation de liberté, le droit à un recours juridictionnel effectif impose que le juge judiciaire soit tenu de statuer dans les plus brefs délais ; qu’il appartient aux autorités judiciaires, sous le contrôle de la Cour de cassation, de veiller au respect de cette exigence y compris lorsque la chambre de l’instruction statue sur renvoi de la Cour de cassation ; que, sous cette réserve, l’absence de disposition législative fixant un délai maximum dans lequel la chambre de l’instruction doit statuer lorsqu’elle est saisie en matière de détention provisoire sur renvoi de la Cour de cassation ne porte pas atteinte aux exigences constitutionnelles ».
b. Les dispositions du projet de loi
La validation de la législation actuelle par le Conseil constitutionnel ne remet pas en cause l’opportunité d’une modification législative. La réserve d’interprétation posée, qui se borne à exiger les « délais les plus brefs », ne saurait sécuriser efficacement les procédures ni protéger comme il convient les droits des justiciables.
Le III du présent article procède à l’insertion au sein du code de procédure pénale d’un nouvel article 194-1. Celui-ci rend applicable à la chambre de l’instruction saisie pour renvoi les délais de jugement impartis à la première chambre saisie (249). Le point de départ de ces délais est fixé à la date de réception par la juridiction de renvoi de l’arrêt et du dossier transmis par la Cour de cassation, établissant un parallélisme avec le point de départ du délai imposé à la chambre criminelle par l’article 567-2 pour statuer sur un pourvoi contre un arrêt de la chambre de l’instruction rendu en matière de détention provisoire.
Le 2° du IV modifie l’article 199 du même code en prolongeant les délais de jugement de la chambre de l’instruction saisie sur renvoi de dix jours, contre cinq jours pour la première chambre saisie, en cas de comparution personnelle de l’intéressé.
3. La comparution personnelle devant la chambre de l’instruction
a. L’état du droit
Lorsque la chambre de l’instruction statue sur l’appel du ministère public à la suite de la mise en liberté sous contrôle judiciaire d’une personne mise en examen, la comparution personnelle de cette dernière à l’audience n’est pas de droit. La personne n’est donc autorisée à assister à l’audience et à présenter ses observations que sur décision du président de la juridiction.
Cette disposition, prévue à l’article 199 du code de procédure pénale, attente ouvertement aux droits de la défense même si elle n’a pas fait l’objet d’une question prioritaire de constitutionnalité.
b. Les dispositions du projet de loi
Le 1° du IV du présent article modifie l’article 199 du code de procédure pénale. Il précise que la comparution personnelle de la personne concernée est de droit en cas d’appel du ministère public contre une décision de remise en liberté ou de refus de placement en détention provisoire, sur demande de l’intéressé ou de l’avocat qui l’assiste.
*
* *
La Commission adopte successivement les amendements CL310, de précision, CL311 et CL312, rédactionnels, de la rapporteure.
Puis elle adopte l’article 26 modifié.
Article 27
(art. L. 1521-18 du code de la défense)
Modalités de garde à vue après une arrestation en mer
1. L’état du droit
Différentes conventions internationales attribuent aux États des pouvoirs de police en haute mer – donc hors de leur juridiction – pour lutter contre les activités préjudiciables à l’ensemble des nations. La convention de Vienne réprime le trafic de stupéfiants (250) ; les stipulations de la convention de Palerme sont relatives à différentes formes de criminalité organisée (251) ; la convention de Montego Bay sur le droit de la mer comprend des dispositifs destinés à combattre la piraterie maritime (252). Il revient aux droits nationaux de prévoir des mesures d’application de la règle internationale.
Lorsque l’État français exerce ses pouvoirs de police en mer, les personnes à bord d’un navire suspect peuvent être placées sous des régimes de contrainte prévus par les articles L. 1521-11 à L. 1521-15 du code de la défense et faire l’objet de mesures de coercition, de restriction ou de privation de liberté. La mise en œuvre de ces mesures est décidée par le commandant du navire, qui en avise le préfet maritime – ou, outre-mer, le délégué du Gouvernement pour l’action de l’État en mer – afin que celui-ci en informe dans les plus brefs délais le procureur de la République territorialement compétent.
Le maintien des mesures de restriction ou de privation de liberté au-delà de quarante-huit heures suppose toutefois une autorisation du juge des libertés et de la détention. Aux termes de l’article L. 1521-4 du code de la défense, le juge autorise leur prolongation pour une durée de cinq jours renouvelable.
L’article L. 1521-18 du même code de la défense précise que « dès leur arrivée sur le sol français, les personnes faisant l’objet de mesures de coercition sont mises à la disposition de l’autorité judiciaire ». Les règles ordinaires de la procédure pénale s’appliquent aux fins de constatation des infractions et d’identification de leurs auteurs, notamment la garde à vue à l’encontre de ces personnes lorsqu’il existe des raisons plausibles de soupçonner une infraction punie d’une peine d’emprisonnement.
Cet enchaînement d’une coercition en mer le temps de rallier le territoire français, et d’une garde à vue à terre dans le cadre de la procédure judiciaire, a été condamné par la Cour européenne des droits de l’homme au titre de l’obligation de traduire devant un juge un suspect arrêté ou détenu dans les meilleurs délais (253). En matière d’arrestation en mer, la jurisprudence constante de la Cour admet l’existence de circonstances exceptionnelles – distance à parcourir notamment – qui justifient un délai de privation de liberté de plusieurs jours, le temps de convoyer les requérants vers le territoire de l’État concerné (254). En revanche, elle estime que cette mesure de coercition doit aboutir au plus tôt à une présentation à un magistrat, ce qui exclut qu’une garde à vue puisse succéder au débarquement (255).
2. Les dispositions du projet de loi
L’article 27 du projet de loi complète l’article L. 1521-18 du code de la défense en précisant que les personnes débarquées sur le territoire national après une arrestation en mer et qui sont placées en garde à vue sont présentées à un magistrat « dans les plus brefs délais ». Il peut s’agir d’un juge d’instruction si une information judiciaire est ouverte ou, à défaut, du juge des libertés et de la détention à la requête du procureur de la République.
L’assistance d’un avocat est de droit au cours de la comparution à l’issue de laquelle le magistrat peut prononcer la mise en liberté. À défaut, la garde à vue se poursuit.
*
* *
La Commission adopte successivement les amendements de précision CL313 et CL314 de la rapporteure.
Puis elle adopte l’article 27 modifié.
Article 27 bis (nouveau)
(art. 132-57 du code de procédure pénale)
Conversion des peines d’emprisonnement en sursis
avec mise à l’épreuve ou en contrainte pénale
Le présent article, issu de l’adoption par la commission des Lois d’un amendement de votre rapporteure, vise à permettre la conversion des peines d’emprisonnement de six mois au plus en sursis avec mise à l’épreuve ou en contrainte pénale, y compris lorsque plusieurs peines d’emprisonnement ferme inférieures ou égales à six mois ont été prononcées et que leur durée cumulée excèderait six mois.
Il s’agit de la reprise de l’article 21 du projet de loi portant adaptation de la procédure pénale au droit de l’Union européenne adopté par notre Assemblée, en lecture définitive, le 23 juillet 2015, que le Conseil constitutionnel avait déclaré contraire à la Constitution en raison de l’absence de lien avec le contenu du projet de loi initial (256).
*
* *
La Commission est saisie de l’amendement CL327 de la rapporteure.
Mme la rapporteure. Cet amendement reprend une disposition censurée l’été dernier dans le texte portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne (DDADUE), pour des raisons de procédure.
Il permet la conversion des peines d’emprisonnement de six mois au plus en sursis avec mise à l’épreuve ou en contrainte pénale. Je vous demande de réserver à cette disposition un avis favorable comme vous l’avez déjà fait précédemment, chers collègues.
M. Alain Tourret. N’est-ce pas un cavalier législatif ?
Mme la rapporteure. En aucun cas, puisque cet amendement a bien trait à la procédure pénale.
La Commission adopte l’amendement. L’article 27 bis est ainsi rédigé.
Article 27 ter (nouveau)
(art. 41-7 [nouveau], 99, 99-2-1 et 802-1 [nouveaux] du code de procédure pénale)
Renforcement des garanties applicables en matière de restitution
des objets placés sous main de justice à leur propriétaire
Le présent article, adopté par la commission des Lois à l’initiative de votre rapporteure, vise à tirer les conséquences dans notre droit de la décision n° 2015-494 QPC du 16 octobre 2015 par laquelle le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution certaines dispositions relatives à la procédure de restitution, au cours de l’information judiciaire, des objets placés sous main de justice.
1. La restitution des objets placés sous main de justice
La restitution de biens placés sous main de justice – afin d’éviter la disparition ou le dépérissement d’un élément de preuve, de garantir les droits des victimes et l’exécution d’une condamnation à une peine d’amende ou à une confiscation, de retirer un objet dangereux de la circulation ou de préserver l’intégrité d’un bien – obéit à des règles procédurales distinctes selon la période au cours de laquelle elle intervient :
– la juridiction de jugement est compétente pour statuer sur le sort des biens saisis lorsque l’affaire est renvoyée devant elle, dans les conditions prévues par les articles 478 et suivants du code de procédure pénale ;
– le ministère public est, en principe, compétent pour décider du sort des objets saisis au cours de l’enquête, en l’absence de saisie de toute juridiction ou lorsque la dernière juridiction saisie a épuisé sa compétence, conformément à l’article 41-4 du même code ;
– le juge d’instruction est généralement compétent pour statuer sur le sort des biens saisis au cours de l’information judiciaire, en application des articles 99 et 177 du même code.
2. La décision n° 2015-494 QPC du 16 octobre 2015
L’article 99 précité prévoit que le juge d’instruction « statue, par ordonnance motivée, soit sur réquisitions du procureur de la République, soit, après avis de ce dernier, d’office ou sur requête de la personne mise en examen, de la partie civile ou de toute autre personne qui prétend avoir droit sur l’objet ».
Le Conseil constitutionnel a jugé cette disposition contraire à la Constitution au motif que « ni les dispositions contestées ni aucune autre disposition [n’imposaient] au juge d’instruction de statuer dans un délai déterminé sur la demande de restitution d’un bien saisi formée en vertu du deuxième alinéa de l’article 99 du code de procédure pénale » et « que, s’agissant d’une demande de restitution d’un bien placé sous main de justice, l’impossibilité d’exercer une voie de recours devant la chambre de l’instruction ou toute autre juridiction en l’absence de tout délai déterminé imparti au juge d’instruction pour statuer [conduisait] à ce que la procédure applicable méconnaisse les exigences découlant de l’article 16 de la Déclaration de 1789 et prive de garanties légales la protection constitutionnelle du droit de propriété » (257).
Les effets de cette déclaration d’inconstitutionnalité ayant été reportés au 1er janvier 2017, il appartient au législateur de fixer, dans l’intervalle, un nouveau cadre à la procédure de restitution des objets saisis. Tel est l’objet du présent article, qui se substitue à l’autorisation de légiférer par ordonnance que le Gouvernement entendait initialement solliciter du Parlement au c) du 3° du II de l’article 33 (258).
3. Les dispositions du présent article
Le présent article a un objet plus large que simplement tirer les conséquences de la décision d’inconstitutionnalité précitée : il instaure un cadre juridique global applicable à la contestation des décisions en matière de restitution d’objets saisis.
Le 1° du I du présent article, qui insère un nouvel article 47-1 au sein du code de procédure pénale, renforce les garanties applicables à la restitution de biens placés sous main de justice dans le cadre de l’enquête, par la création d’une procédure générale de référé-restitution :
– il autorise la personne qui souhaite la restitution d’un objet saisi au cours de l’enquête en application de l’article 41-4 précité à « solliciter que cette demande soit examinée par le procureur de la République dans un délai de cinq jours si elle justifie que le maintien de la saisie lui causerait un préjudice irrémédiable dans l’exercice de son activité professionnelle » (premier alinéa) ;
– cette demande doit respecter un certain formalisme, en particulier être présentée « dans un écrit spécialement motivé, faisant apparaître les termes « référé-restitution » » (deuxième alinéa) ;
– le refus par le procureur de la République de faire droit à la demande « peut être déféré par le demandeur, dans les vingt-quatre heures de sa notification, devant le président de la chambre de l’instruction, qui statue par ordonnance motivée non susceptible de recours dans les huit jours suivant la réception du recours, au vu des observations écrites de la personne ou de son avocat et de celles du procureur général » ; il est toutefois précisé que, à défaut de réponse du procureur de la République dans un délai de cinq jours, la personne peut saisir directement le président de la chambre de l’instruction (dernier alinéa).
Le 2° du I modifie l’article 99 précité, relatif aux modalités de restitution des biens placés sous main de justice au cours de l’information judiciaire, afin de prévoir que « faute pour le juge d’instruction d’avoir statué dans un délai d’un mois », la personne pourra saisir directement le président de la chambre de l’instruction qui statuera conformément aux troisième à dernier alinéas de l’article 186-1 du même code (259).
Le 3° du I, qui crée un nouvel article 99-2-1 au sein du code de procédure pénale, rend applicable à l’information judiciaire la procédure de référé-restitution instaurée par l’article 41-7 précité dans le cadre de l’enquête.
Le 4° du I insère, au sein du même code, un nouvel article 802-1, qui, de manière transversale, permet à toute personne de contester l’absence de réponse à une demande de restitution d’objets saisis. Aux termes de ce nouvel article, lorsque « le ministère public ou une juridiction [sera] saisi d’une demande à laquelle il doit être répondu par une décision motivée susceptible de recours, en l’absence de réponse dans le délai de deux mois à compter de la demande effectuée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou déclaration au greffe contre récépissé, ce recours [pourra] être exercé devant l’autorité compétente contre la décision implicite de rejet de la demande ». Cette disposition ne s’appliquera pas lorsque la loi prévoit déjà une voie de recours spécifique en l’absence de réponse du magistrat.
Enfin, par cohérence avec l’effet différé de la censure opérée par le Conseil constitutionnel dans sa décision précitée, le II reporte au 1er janvier 2017 l’entrée en vigueur du seul 2° du I, qui ouvre une voie de recours en l’absence de décision du juge d’instruction sur la restitution d’objets saisis.
*
* *
La Commission examine ensuite l’amendement CL330 de la rapporteure.
Mme la rapporteure. Le présent amendement procède aux modifications rendues nécessaires par la jurisprudence constitutionnelle en matière de restitution à leur propriétaire des objets sous main de justice – en l’occurrence la décision rendue par le Conseil constitutionnel le 16 octobre 2015 en matière de saisies à la suite d’une question prioritaire de constitutionnalité.
Il s’agit, pour l’essentiel, de prévoir une voie de recours contre la décision prononcée par la justice. En combinaison avec la procédure de référé restitution créée par ailleurs, le droit de propriété fera désormais l’objet d’une protection optimale par l’autorité judiciaire.
La Commission adopte l’amendement. L’article 27 ter est ainsi rédigé.
Article 27 quater (nouveau)
(art. 61-3 [nouveau], 63-1, 63-2, 63-4-2, 76-1 [nouveau], 117, 133-1, 135-2, 145-4, 154, 695-17-1[nouveau], 695-27 et 706-88 du code de procédure pénale, art. 323-5 du code des douanes, art. 4 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante, art. 64 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et art. 23-1-1 de l’ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 relative à l’aide juridictionnelle en matière pénale en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna)
Transposition de la directive « C » sur l’accès à l’avocat
et la communication avec un tiers
Le présent article, issu de l’adoption par la commission des Lois d’un amendement de votre rapporteure, vise à transposer dans notre droit certaines dispositions de la directive 2013/48/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013 relative au droit d’accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales et des procédures relatives au mandat d’arrêt européen, au droit d’informer un tiers dès la privation de liberté et au droit des personnes privées de liberté de communiquer avec des tiers et avec les autorités consulaires, dite « directive C ». Il s’agit principalement de dispositions relatives au droit à l’assistance d’un avocat et au droit à la communication avec un tiers lors de la garde à vue, y compris dans le cadre de l’exécution d’un mandat d’arrêt européen.
Il se substitue donc à l’autorisation de légiférer par ordonnance que le Gouvernement entendait initialement solliciter du Parlement au 1° du II de l’article 33, au commentaire duquel votre rapporteure renvoie pour plus de précisions sur les nouvelles obligations posées par cette directive (260).
Le I du présent article comporte plusieurs dispositions mettant le code de procédure pénale en conformité avec les règles posées par cette directive.
Le 1°, qui insère un nouvel article 61-3, permet, en enquête de flagrance, à la personne mise en cause de bénéficier de l’assistance d’un avocat lors des opérations de reconstitution d’une infraction à laquelle elle participe (1°) ou lors des séances d’identification des suspects dont elle fait partie (2°). Cette possibilité sera ouverte à la « personne à l’égard de laquelle existent une ou plusieurs raisons plausibles permettant de soupçonner qu’elle a participé en tant qu’auteur ou complice à la commission d’un crime ou d’un délit puni d’emprisonnement » (premier alinéa). La personne devra être informée de ce droit avant la réalisation de l’une des opérations mentionnées aux 1° et 2° (quatrième alinéa).
À l’instar des règles applicables en matière de garde à vue, l’avocat pourra « présenter des observations écrites » à l’issue de ces opérations (avant-dernier alinéa). De même, par parallélisme avec ce qui existe dans les confrontations, la victime, si elle participe à ces opérations, pourra être assistée par un avocat (dernier alinéa).
Le 5° prévoit que ces nouvelles possibilités d’assistance par un avocat s’appliqueront également à l’enquête préliminaire (nouvel article 76-1).
Le 2° complète l’article 63-1, relatif à l’information dont fait l’objet la personne placée en garde à vue, afin de prévoir que, lorsqu’elle est de nationalité étrangère, elle bénéficie non seulement du « droit de faire prévenir (…) les autorités consulaires de l’État dont elle est ressortissante », comme c’est le cas aujourd’hui, mais aussi « de communiquer avec ces personnes ».
Le 3° précise les conditions dans lesquelles une personne placée en garde à vue peut demander à faire prévenir une personne avec laquelle elle vit habituellement ou l’un ses proches ainsi que son employeur, telles qu’elles sont aujourd’hui fixées par l’article 63-2. Il supprime le deuxième alinéa de cet article qui permet à l’officier de police judiciaire (OPJ), « en raison des nécessités de l’enquête », de demander au procureur de la République de ne pas faire droit à cette demande (a). Il institue, en lieu et place de cette disposition, une nouvelle procédure plus protectrice des droits de la personne gardée à vue (a et c).
En premier lieu, il autorise le procureur de la République, saisi par l’OPJ, à différer la possibilité pour la personne de faire prévenir un tiers et son employeur dans des conditions plus strictes que ne le permet le droit actuel. L’avis pourra être « différé ou ne sera pas délivré si cette décision est, au regard des circonstances de l’espèce, indispensable afin de permettre le recueil ou la conservation des preuves ou de prévenir une atteinte grave à la vie, à la liberté ou à l’intégrité physique d’une personne ». En cas de report de la garde à vue au-delà de 48 heures, seul le juge des libertés et de la détention (JLD) pourra maintenir le report de cet avis, pour les mêmes motifs, « sauf lorsque l’avis concerne les autorités consulaires ».
En second lieu, il prévoit que l’OPJ pourra « autoriser la personne en garde à vue qui en fait la demande à communiquer, par écrit, par téléphone ou lors d’un entretien, avec un des tiers » précédemment mentionnés, « s’il lui apparaît que cette communication n’est pas incompatible avec les objectifs [de la garde à vue] mentionnés à l’article 62-2 et qu’elle ne risque pas de permettre une infraction pénale ». Toutefois, « [a]fin d’assurer le bon ordre, la sûreté et la sécurité des locaux dans lesquels s’effectue la mesure, l’officier ou l’agent de police judiciaire détermine le moment, les modalités et la durée de cette communication, qui ne peut excéder trente minutes et intervient sous son contrôle, le cas échéant en sa présence ou en la présence d’une personne qu’il désigne ». En tout état de cause, lorsque la demande de communication concerne les autorités consulaires, l’OPJ ne peut s’y opposer au-delà de la 48e heure de la mesure. Par cohérence avec les dispositions permettant de différer ou de ne pas délivrer l’avis au tiers pour certains motifs, cette possibilité de communication ne s’applique pas à l’égard de ce tiers.
Le 4° restreint les possibilités de reporter la présence de l’avocat lors de la garde à vue, eu égard à l’impact d’une telle décision sur l’exercice des droits de la défense. Dans le droit commun, cette possibilité est aujourd’hui possible, en vertu du quatrième alinéa de l’article 63-4-2, « [à] titre exceptionnel, (…) si cette mesure apparaît indispensable pour des raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l’enquête, soit pour permettre le bon déroulement d’investigations urgentes tenant au recueil ou à la conservation des preuves, soit pour prévenir une atteinte imminente aux personnes ». La nouvelle rédaction proposée exige, s’agissant de la prévention de l’atteinte aux personnes, une « atteinte grave et imminente à la vie, à la liberté ou à l’intégrité physique d’une personne ».
La même restriction est prévue par le 13° pour la garde à vue en matière de criminalité et de délinquance organisées : conformément à l’article 706-88, il ne sera possible de différer l’intervention de l’avocat qu’« en considération de raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l’enquête ou de l’instruction, soit pour permettre le recueil ou la conservation des preuves, soit pour prévenir une atteinte grave à la vie, à la liberté ou à l’intégrité physique d’une personne ».
À l’article 117, le 6° encadre davantage, au cours de l’information judiciaire, la faculté laissée au juge d’instruction de procéder à des interrogatoires immédiats et à des confrontations en cas d’urgence, en supprimant la possibilité d’y recourir lorsque cette urgence résulte seulement de crimes ou délits flagrants. Il ne pourra désormais procéder à ces interrogatoires et confrontations que si l’urgence résulte « soit de l’état d’un témoin en danger de mort, soit de l’existence d’indices sur le point de disparaître ».
Le 7° complète l’article 133-1, relatif aux conditions de retenue d’une personne par les services de police ou de gendarmerie avant sa présentation devant un magistrat au cours de l’instruction, afin de prévoir que cette personne a non seulement le droit de faire prévenir un proche et d’être examinée par un médecin mais également « d’être assistée d’un avocat » dans les mêmes conditions que celles qui s’appliquent en matière de garde à vue. Les mêmes droits sont reconnus à la personne qui, faisant l’objet d’un mandat d’arrêt et découverte après le règlement de l’information judiciaire, est arrêtée et retenue par les services de police ou de gendarmerie avant d’être présentée à un magistrat, conformément à la nouvelle rédaction de l’article 135-2 (8°).
Le 9° complète, à l’article 145-4, les modalités de communication avec un tiers de la personne mise en examen par le juge d’instruction et placée en détention provisoire. Sauf interdiction de communiquer décidée par ce dernier, la personne pourra, comme c’est déjà le cas aujourd’hui, avec l’autorisation de ce magistrat, « recevoir des visites sur son lieu de détention » ou, fait nouveau, « téléphoner à un tiers » (a). Passé un délai d’un mois de détention provisoire, le juge d’instruction ne pourra lui refuser l’usage du téléphone que par décision écrite et spécialement motivée au regard des nécessités de l’instruction, comme c’est déjà le cas aujourd’hui en matière de refus de délivrance d’un permis de visite (b). Enfin, il est précisé que les attributions du juge d’instruction en matière de communication au tiers durant la détention provisoire sont exercées par le procureur de la République après la clôture de l’instruction (c).
Le 10° rend applicable lors de l’exécution des commissions rogatoires le droit à l’assistance d’un avocat reconnu à toute personne, par le nouvel article 61-3, d’être assistée d’un avocat lors d’opérations de reconstitution à laquelle elle participe ou de séances d’identification des suspects dont elle fait partie (article 154).
Les 11° et 12° complètent le chapitre IV du titre X du livre quatrième du code de procédure pénale relatif à l’exécution d’un mandat d’arrêt européen :
– il est créé, à la section II relative à l’émission d’un mandat d’arrêt européen par les juridictions françaises, un nouvel article 695-17-1 aux termes duquel « [s]i le ministère public est informé par l’autorité judiciaire de l’État d’exécution d’une demande de la personne arrêtée tendant à la désignation d’un avocat sur le territoire national, il transmet à cette personne les informations utiles lui permettant de faire le choix d’un avocat, ou, à la demande de la personne, fait procéder à la désignation d’office d’un avocat par le bâtonnier » (11°) ;
– à l’article 695-27 relatif à la procédure d’exécution d’un mandat d’arrêt européen décerné par une juridiction étrangère, les droits de la personne appréhendée sont complétés : le procureur général compétent devra l’informer non seulement de l’existence et du contenu du mandat d’arrêt et de son droit à être assistée par un avocat en France, comme c’est le cas actuellement, mais également de « demander à être assistée dans l’État d’émission par un avocat de son choix ou par un avocat commis d’office » (12°).
Le II étend à la procédure de retenue douanière prévue par l’article 323-5 du code des douanes la possibilité reconnue par le 2° du I à la personne étrangère placée en garde à vue de « faire contacter les autorités consulaires de son pays » et « de communiquer le cas échéant avec ces personnes ».
Le III modifie l’article 4 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante afin de préciser les conditions dans lesquelles il peut être dérogé au droit du mineur placé en garde à vue d’informer un tiers de cette mesure. Aujourd’hui possible sur simple « décision du procureur de la République ou du juge chargé de l’information », le report de ce droit ne le sera désormais que « pour permettre le recueil ou la conservation des preuves ou pour prévenir une atteinte grave à la vie, à la liberté ou à l’intégrité physique d’une personne, sur décision du procureur de la République ou du juge chargé de l’information prise au regard des circonstances de l’espèce ». Ces motifs sont les mêmes que ceux justifiant le report de ce droit durant la garde à vue d’un majeur, conformément à la nouvelle rédaction de l’article 63-2 précité. La durée durant laquelle le report de ce droit pourra être décidée demeure, en revanche, inchangée : elle sera déterminée par le magistrat et ne pourra excéder 24 heures ou, lorsque la garde à vue ne pourra faire l’objet d’une prolongation, 12 heures.
Le IV procède à diverses coordinations rendues nécessaires par l’élargissement du droit à l’assistance de l’avocat lors des opérations de reconstitution et des séances d’identification :
– à l’article 64 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, il permet la rétribution de l’avocat qui intervient, dans ces conditions, auprès de la personne soupçonnée ou de la victime lorsqu’elle bénéficie de l’aide juridictionnelle ;
– à l’article 23-1-1 de l’ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 relative à l’aide juridictionnelle en matière pénale en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna, il rend également possible une telle rétribution dans ces deux territoires ultra-marins.
*
* *
La Commission est saisie de l’amendement CL332 de la rapporteure.
Mme la rapporteure. Le présent amendement procède à la transposition de la directive 2013/48/UE du 22 octobre 2013 relative au droit d’accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales. Je constate que M. Devedjian a déposé un amendement pratiquement identique poursuivant le même objectif ; je l’invite à le retirer pour se rallier au mien.
La Commission adopte l’amendement. L’article 27 quater est ainsi rédigé.
L’amendement CL109 est retiré.
Article 27 quinquies (nouveau)
(art. 213 et 215 du code de procédure pénale)
Motivation des arrêts de règlement
de la chambre de l’instruction
Le présent article, issu de l’adoption par la commission des Lois d’un amendement du Gouvernement, avec l’avis favorable de votre rapporteure, vise à faire obligation à la chambre de l’instruction de mentionner les éléments à charge et à décharge lorsqu’elle met en accusation une personne et ordonne son renvoi devant la cour d’assises, le tribunal correctionnel, le tribunal de police ou la juridiction de proximité.
Il s’agit de la reprise de l’article 24 du projet de loi portant adaptation de la procédure pénale au droit de l’Union européenne adopté par notre Assemblée, en lecture définitive, le 23 juillet 2015, que le Conseil constitutionnel avait déclaré contraire à la Constitution en raison de l’absence de lien avec le contenu du projet de loi initial (261).
*
* *
La Commission est saisie de l’amendement CL224 du Gouvernement.
Mme la rapporteure. Je suis favorable à cet amendement visant à motiver les arrêts de règlement rendus par la chambre de l’instruction. L’exigence de motivation des arrêts qui renvoient le prévenu devant la juridiction de jugement est une avancée en matière de garantie des droits de la défense. Ces décisions feront désormais mention des éléments retenus à charge et à décharge.
La Commission adopte l’amendement. L’article 27 quinquies est ainsi rédigé.
Article 27 sexies (nouveau)
(art. 721-1 du code de procédure pénale)
Prise en compte de la surpopulation carcérale
dans l’octroi des réductions supplémentaires de peines
Le présent article, issu de l’adoption par la commission des Lois d’un amendement de votre rapporteure, reconnaît un nouveau critère d’appréciation au juge de l’application des peines chargé d’apprécier les efforts de réinsertion pour l’octroi des réductions supplémentaires de peine au condamné. Il permet de prendre en compte l’impact sur ce dernier des conditions matérielles de détention et du taux d’occupation de l’établissement pénitentiaire.
Il s’agit de la reprise de l’article 27 du projet de loi portant adaptation de la procédure pénale au droit de l’Union européenne adopté par notre Assemblée, en lecture définitive, le 23 juillet 2015, que le Conseil constitutionnel avait déclaré contraire à la Constitution en raison de l’absence de lien avec le contenu du projet de loi initial (262).
*
* *
La Commission est saisie de l’amendement CL339 de la rapporteure.
Mme la rapporteure. Précédemment adopté dans la loi DDADUE et malheureusement censuré cet été par le Conseil constitutionnel, cet amendement invite à la prise en compte des conditions matérielles de détention dans l’appréciation des efforts de réinsertion des détenus. Dans le même esprit que l’amendement précédent, il laisse pleine latitude au juge pour en tirer les conséquences en termes d’octroi de réductions de peine.
La Commission adopte l’amendement. L’article 27 sexies est ainsi rédigé.
Article 27 septies (nouveau)
(art. 723-15-2 du code de procédure pénale)
Délai offert au juge de l’application des peines
pour l’examen d’un aménagement de peine
Le présent article, issu de l’adoption par la commission des Lois d’un amendement de votre rapporteure, vise à porter de quatre à six mois le délai au terme duquel, à défaut de décision du juge de l’application des peines, le ministère public peut ramener la peine à exécution, dans le but de permettre le développement des aménagements de peines.
Il s’agit de la reprise de l’article 28 du projet de loi portant adaptation de la procédure pénale au droit de l’Union européenne adopté par notre Assemblée, en lecture définitive, le 23 juillet 2015, que le Conseil constitutionnel avait déclaré contraire à la Constitution en raison de l’absence de lien avec le contenu du projet de loi initial (263).
*
* *
La Commission examine l’amendement CL338 de la rapporteure.
Mme la rapporteure. Toujours issu de la loi DDADUE, le présent amendement porte de quatre à six mois le délai laissé au juge d’application des peines pour prononcer un aménagement de peine avant que le ministère public ne mette celle-ci à exécution. Il s’agit de donner davantage de temps à la justice, afin de faciliter la tâche de ses services, qui travaillent bien et beaucoup, dans un contexte de restriction des moyens.
La Commission adopte l’amendement. L’article 27 septies est ainsi rédigé.
Article 27 octies (nouveau)
(art. 762 du code de procédure pénale)
Emprisonnement encouru pour défaut de paiement d’un jour-amende
Le présent article, issu de l’adoption par la commission des Lois d’un amendement de votre rapporteure, tend à permettre aux personnes condamnées pour défaut de paiement d’éviter une incarcération ou d’obtenir leur élargissement en s’acquittant des jours-amende restés impayés. Aujourd’hui, lorsqu’un condamné ne paie pas ses jours-amende et que sa peine est transformée en peine d’emprisonnement, celle-ci est définitive.
Il s’agit de la reprise de l’article 29 du projet de loi portant adaptation de la procédure pénale au droit de l’Union européenne adopté par notre Assemblée, en lecture définitive, le 23 juillet 2015, que le Conseil constitutionnel avait déclaré contraire à la Constitution en raison de l’absence de lien avec le contenu du projet de loi initial (264).
*
* *
La Commission est saisie de l’amendement CL337 de la rapporteure.
Mme la rapporteure. Toujours dans le même esprit et le même contexte, le présent amendement permet aux personnes incarcérées pour défaut de paiement de jours-amendes d’obtenir leur libération en s’acquittant en une seule fois des impayés.
La Commission adopte l’amendement. L’article 27 octies est ainsi rédigé.
Chapitre II
Dispositions simplifiant le déroulement de la procédure pénale
Article 28
(art. 18 du code de procédure pénale)
Habilitation des officiers de police judiciaire
1. Le droit en vigueur
Le code de procédure pénale attribue au ministère public une compétence de surveillance et de contrôle des officiers de police judiciaire. Son article 13 prévoit que « la police judiciaire est placée, dans chaque ressort de cour d’appel, sous la surveillance du procureur général et sous le contrôle de la chambre de l’instruction », tandis que, aux termes de l’article 38, « les officiers et agents de police judiciaire sont placés sous la surveillance du procureur général ». Cette surveillance se traduit par l’habilitation, la notation et le pouvoir disciplinaire du procureur général vis-à-vis des officiers de police judiciaire.
En application du huitième alinéa de l’article 16 du même code, les fonctionnaires de police et les militaires de la gendarmerie « ne peuvent exercer effectivement les attributions attachées à leur qualité d’officier de police judiciaire ni se prévaloir de cette qualité que s’ils sont affectés à un emploi comportant cet exercice et en vertu d’une décision du procureur général près la cour d’appel les y habilitant personnellement ». Cette habilitation est soumise aux règles de l’article R. 14 pour la gendarmerie nationale et de l’article R. 15-3 pour la police nationale : un officier de police judiciaire doit être habilité par le procureur général du ressort dans lequel il occupe habituellement ses fonctions pour pouvoir exercer effectivement les attributions attachées à cette qualité. Cette habilitation est renouvelée à chaque changement de service ou d’affectation.
Les officiers de police judiciaire ont compétence dans « les limites territoriales où ils exercent leurs fonctions habituelles » selon l’article 18 du code de procédure pénale. Toutefois, le même article prévoit une compétence territoriale automatiquement étendue en cas de mise à disposition dans un autre service ou une autre unité (alinéa 2), mais il exige une habilitation spéciale en cas de suppléance (265) d’un officier de police judiciaire d’un autre service ou d’une autre unité (alinéa 6).
La mission d’habilitation constitue une charge importante pour les parquets généraux : chaque année, 5 000 demandes d’habilitation d’officiers de police judiciaire doivent être satisfaites. La masse des dossiers et les échanges de correspondance avec les autorités policière et militaire sont responsables de délais de traitement excessifs – parfois de plusieurs mois, pendant lesquels l’officier ne peut valablement effectuer les tâches qu’il a pourtant qualité à accomplir – quand les ressources humaines dont disposent les juridictions pourraient être mieux employées. Ces contraintes ont pour conséquence un caractère formel de la supervision, alors même que les compétences et les aptitudes professionnelles des demandeurs devraient faire l’objet d’un examen approfondi.
2. Les dispositions du projet de loi
Le présent article simplifie la législation en unifiant le dispositif d’habilitation. La suppression du sixième alinéa de l’article 18 du code de procédure pénale, aux termes duquel les officiers de police judiciaire « peuvent, sur proposition des autorités administratives dont ils dépendent et par habilitation du procureur général, recevoir compétence dans les mêmes limites de compétence territoriale que celles des officiers de police judiciaire qu’ils sont appelés à suppléer en cas de besoin », a une double conséquence :
– le régime de la suppléance se trouve aligné sur celui de la mise à disposition, qui étend automatiquement la compétence territoriale ;
– la procédure d’habilitation n’a plus à être renouvelée en cas de changement – temporaire ou définitif – de service ou d’unité d’affectation de l’officier de police judiciaire. Une habilitation unique est délivrée par le procureur général du premier lieu d’exercice des fonctions de l’officier de police judiciaire, à condition que ce dernier ait la qualité d’officier de police judiciaire et exerce des missions de police judiciaire au sein d’un service ou d’une unité de police judiciaire (266).
Le contrôle des habilitations des officiers de police judiciaire est donc mis en œuvre par le procureur général territorialement compétent, qui en prononce la suspension ou le retrait (267). En cas d’affectation dans un service ou une unité n’ayant pas de compétence judiciaire, la suspension est d’ores et déjà automatique (268).
*
* *
La Commission adopte l’article 28 sans modification.
Article 29
(art. 148 et 803-7 [nouveau] du code de procédure pénale)
Mise en liberté des personnes placées en détention provisoire
1. Le droit en vigueur
a. La demande de mise en liberté
L’article 148 du code de procédure pénale prévoit qu’une personne placée en détention provisoire dans l’attente de son jugement peut, à tout moment, solliciter sa remise en liberté. La requête suit la procédure suivante :
– à compter de la communication du dossier au procureur de la République aux fins de réquisition, le juge d’instruction dispose d’un délai de cinq jours pour saisir le juge des libertés et de la détention de la demande et de son avis motivé (269) ;
– le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de trois jours ;
– si les délais ne sont pas respectés, le détenu peut saisir directement la chambre de l’instruction, qui se prononce dans les vingt jours ;
– à défaut de réponse de la chambre de l’instruction dans le délai imparti, la remise en liberté est de droit.
Dans l’hypothèse où une demande de mise en liberté est formulée alors même qu’il n’a pas encore été statué sur une demande précédente ou sur l’appel d’une ordonnance de refus de mise en liberté, une décision unique peut être rendue ; dans le cas contraire, les délais qui s’appliquent à la seconde demande ne courent qu’à partir de la décision rendue sur la première.
Ces règles apparaissent insuffisantes face aux stratégies d’engorgement mises en œuvre par certains détenus. Comme l’indique l’étude d’impact jointe au projet de loi, certains multiplient « des demandes successives de mise en liberté, y compris en en déposant une chaque jour et [en faisant] systématiquement appel des refus ou [en saisissant] directement la chambre en cas d’omission du juge, dans le seul but d’obtenir leur libération parce que la chambre de l’instruction aura omis de statuer dans le délai de vingt jours ».
Le droit de la mise en liberté a fait l’objet d’une réserve d’interprétation du Conseil constitutionnel à l’occasion de la décision n° 86-215 DC du 3 septembre 1986, Loi relative à la lutte contre la criminalité et la délinquance. Saisi des dispositions précédemment présentées reportant le point de départ du délai imparti pour se prononcer sur une nouvelle demande à la date à laquelle la précédente demande reçoit une réponse, il a estimé, au considérant n° 20, que « ces dispositions, ainsi qu’il ressort des travaux préparatoires, ne font pas obstacle à ce que le juge d’instruction, saisi d’un fait nouveau à l’appui de toute demande, statue immédiatement ; que, dès lors, ces articles ne méconnaissent pas le principe du respect des droits de la défense. »
La violation des délais dans lesquels doit statuer le juge en matière de détention provisoire entraîne l’irrégularité de la privation de liberté et la remise en liberté du détenu. Cet élargissement n’interdit pas, si les conditions de la détention provisoire sont toujours réunies, de décider à nouveau d’une mise en détention (270).
La question d’un nouveau placement en détention après une détention irrégulière a fait l’objet d’une évolution de la jurisprudence de la Cour de cassation. En 2002, un arrêt de la chambre criminelle (271) a conditionné une nouvelle mise en détention à la survenance de circonstances nouvelles. Des décisions contradictoires ont cependant suivi, qui affirmaient qu’aucune « disposition légale ou conventionnelle n’interdit, lorsqu’un mandat de dépôt a été annulé pour vice de forme, de placer à nouveau la personne mise en examen en détention provisoire, dans la même information et à raison des mêmes faits » (272) : le juge des libertés et de la détention peut délivrer un nouveau mandat sans qu’il soit besoin d’établir l’existence de circonstances nouvelles, dès lors que les conditions posées à l’article 145 du code de procédure pénale demeurent respectées (273).
Cette jurisprudence suppose qu’un nouveau placement en détention provisoire ne peut être ordonné sans délai, et risque de se heurter à la fuite de l’individu concerné le temps du déroulement de la procédure. Or, la chambre criminelle de la cour de cassation a jugé irrégulière l’édiction d’un contrôle judiciaire immédiatement consécutif à une détention elle-même irrégulière en raison d’une violation des délais impartis pour statuer sur une demande de mise en liberté (274).
2. Les dispositions du projet de loi
Le I du présent article complète l’article 148 du code de procédure pénale afin de prévenir les demandes dilatoires et multiples de mise en liberté. Il déclare irrecevable la demande de mise en liberté tant que la décision de rejet d’une précédente requête n’a pas été rendue par le juge des libertés et de la détention dans les délais fixés par la loi. Une telle évolution serait de nature à sécuriser les procédures et à préserver les moyens de l’institution judiciaire pour les requêtes sérieuses, sans amoindrir pour autant les garanties dont bénéficie le justiciable. En pratique, la décision de rejet du juge des libertés et de la détention ouvrira une alternative entre déposer une nouvelle demande ou interjeter appel sur la première ; comme le prévoit le droit actuel, le délai pour statuer sur la nouvelle demande ne commencera à courir qu’à compter de la décision de la cour d’appel.
Le II permet que succède à une détention irrégulière une mesure de placement sous contrôle judiciaire. Cette dernière est prononcée par la juridiction qui décide la mise en liberté, ou par le juge des libertés et de la détention à la demande du procureur de la République dans les autres.
3. Les modifications opérées par votre commission des Lois
La commission des Lois a modifié le dispositif proposé par le Gouvernement en adoptant quatre amendements de la rapporteure. Si trois d’entre eux se limitent à des améliorations rédactionnelles, le quatrième prend en compte une réserve d’interprétation formulée par le Conseil constitutionnel dans la décision n° 86‑215 DC du 3 septembre 1986, Loi relative à la lutte contre la criminalité et la délinquance. Examinant des dispositions relatives au droit de la détention provisoire et déjà destinées à faciliter l’examen de demandes successives de mise en liberté, le Conseil avait estimé, au considérant n° 20, que « ces dispositions, ainsi qu’il ressort des travaux préparatoires, ne font pas obstacle à ce que le juge d’instruction, saisi d’un fait nouveau à l’appui de toute demande, statue immédiatement ; que, dès lors, ces articles ne méconnaissent pas le principe du respect des droits de la défense ».
On ne saurait tirer des conclusions définitives de cette décision dans la mesure où le dispositif proposé par le projet de loi diverge assez fortement du texte de 1986 : les nouvelles demandes ne sont irrecevables que pendant un temps très bref, jusqu’à la décision du juge des libertés et de la détention, alors que la loi soumise au Conseil constitutionnel permettait au juge de ne pas statuer jusqu’à la décision en appel de la chambre de l’instruction. En outre, le Parlement a depuis adopté la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d’innocence et les droits des victimes, qui a créé l’article 144-1 du code de procédure pénale imposant la mise en liberté d’office quand les conditions de la détention ne sont plus remplies.
La Commission a cependant estimé utile de formuler explicitement dans la loi la réserve du Conseil constitutionnel de façon à sécuriser le nouveau dispositif. Il est ainsi prévu que, malgré l’irrecevabilité des demandes nouvelles, le juge d’instruction reste tenu d’ordonner la mise en liberté dès lors qu’un fait nouveau remet en cause le raisonnement qui l’avait préalablement conduit à prononcer un placement en détention provisoire.
*
* *
La Commission examine l’amendement CL378 de la rapporteure.
Mme la rapporteure. Cet amendement relatif à l’irrecevabilité des demandes de mise en liberté vise à décourager les procédures entreprises de mauvaise foi, à des fins dilatoires ou pour obtenir un élargissement de manière injustifiée.
En matière de droit de la mise en liberté, le Conseil constitutionnel a estimé dans une décision de 1986 que les dispositions législatives ne doivent jamais faire obstacle à l’obligation qui pèse sur le magistrat de prononcer la mise en liberté dès lors qu’apparaît un fait nouveau qui ne permet plus de réunir les conditions d’une détention provisoire.
Depuis est intervenue la loi du 15 juin 2000, qui a créé l’article 144-1 du code de procédure pénale, imposant la mise en liberté d’office quand les conditions de la détention ne sont plus remplies.
Il importe cependant de reprendre, en l’adaptant, la réserve du Conseil constitutionnel de façon à sécuriser le dispositif de l’article 29. Il est ainsi prévu que, malgré l’irrecevabilité des demandes nouvelles tant qu’une demande précédente se trouve en phase de jugement, le juge d’instruction doit ordonner la remise en liberté en cas d’élément nouveau faisant apparaître que la détention n’est plus justifiée.
La Commission adopte l’amendement.
Elle adopte ensuite, successivement, les amendements de précision CL316 et CL317, puis l’amendement rédactionnel CL318, tous trois de la rapporteure.
Puis elle adopte l’article 29 modifié.
Article 30
(art. 390-1, 396 et 527 du code de procédure pénale)
Dispositions simplifiant le jugement
L’article 30 du projet de loi procède à trois modernisations du code de procédure pénale afin de simplifier les modalités de jugement.
1. La convocation en justice
La convocation en justice prévue à l’article 309-1 du code de procédure pénale, délivrée sur instructions du procureur de la République, vaut citation devant le tribunal correctionnel. Elle est notifiée par un greffier, par un officier ou agent de police judiciaire, ou par le chef de l’établissement pénitentiaire lorsque le prévenu se trouve en détention.
En pratique, la convocation en justice exige l’intervention des services de police ou de gendarmerie. Les agents et officiers de police judiciaire perçoivent cette mission comme une tâche ingrate dans laquelle leur qualification n’est d’aucune utilité, particulièrement lorsque la notification exige de convoquer la personne (275).
Afin de faciliter la notification de la convocation en justice à l’intéressé, le I du présent article élargit la liste des personnes autorisées à y procéder aux délégués et médiateurs du procureur de la République, dont les compétences sont définies à l’article R. 15-33-30 du code de procédure pénale :
« Les personnes physiques ainsi que les associations régulièrement déclarées qui ont été habilitées comme délégués du procureur de la République dans les conditions prévues par la présente section peuvent être désignées par ce dernier pour être chargées d’une des missions prévues par les 1° à 4° de l’article 41-1 (276) ou pour intervenir lors de la procédure de composition pénale prévue par les articles 41-2 et 41-3 (277).
Les personnes physiques ainsi que les associations régulièrement déclarées qui ont été habilitées comme médiateurs du procureur de la République dans les conditions prévues par la présente section peuvent être désignées par ce dernier pour effectuer une mission de médiation conformément aux dispositions du 5° de l’article 41-1 (278). Elles peuvent également se voir confier les missions [du délégué du procureur de la République]. »
La rédaction proposée permet aussi de tirer immédiatement les conséquences de l’échec d’une mesure alternative aux poursuites. Il s’agit d’une demande ancienne des délégués et médiateurs, jusqu’à présent cantonnés à la rédaction d’un rapport au procureur pour que celui-ci engage des poursuites et les fasse notifier par les forces de l’ordre. Permettre au délégué et au médiateur de délivrer en personne la convocation en justice – sur instructions préalables du procureur de la République – simplifiera la tâche des parquets et libérera du temps pour les services d’enquête. C’est aussi un moyen de dissiper le sentiment d’impuissance face à l’échec d’une mesure alternative aux poursuites.
2. La comparution immédiate
Prévue aux articles 395 et suivants du code de procédure pénale, la comparution du prévenu devant le tribunal correctionnel dans un délai inférieur à trois jours nécessite la réunion de trois conditions : que les charges réunies paraissent suffisantes au parquet ; que la peine d’emprisonnement encourue soit au moins égale à deux ans et, en cas de délit flagrant, à six mois ; que l’affaire ne concerne ni un mineur, ni un délit de presse, ni un délit politique, ni une infraction dont la poursuite est prévue par une loi spéciale.
Une difficulté se pose lorsque, alors que le tribunal ne peut se réunir le jour même, le juge des libertés et de la détention laisse le prévenu en liberté. Le procureur est tenu d’attendre la décision du juge pour notifier à la personne une date d’audience dans un délai compris entre dix jours et deux mois. Si d’autres personnes sont provisoirement détenues dans la même affaire, plusieurs audiences de jugement doivent alors être organisées, ce qui nuit à la bonne administration de la justice.
Le II du présent article modifie l’article 396 du code de procédure pénale afin que, dans le cas précédemment évoqué, la disjonction (279) soit évitée. Le prévenu laissé libre par le juge des libertés et de la détention pourra être convoqué en même temps que les autres personnes demeurées en détention, c’est-à-dire dans le cadre d’une comparution immédiate. La date d’audience est communiquée par le juge des libertés et de la détention ou par son greffier, de façon à éviter une nouvelle comparution devant le procureur de la République.
3. La notification des ordonnances pénales contraventionnelles
Le régime des ordonnances pénales en matière contraventionnelle est prévu aux articles 524 et suivants du code de procédure pénale. Il permet le jugement rapide, selon des modalités simplifiées, des contraventions de police autres que celles commises par un mineur ou en matière de droit du travail.
La notification des ordonnances pénales contraventionnelles exige une lettre recommandée avec demande d’avis de réception suivant l’article 527 du code de procédure pénale. Au contraire, les ordonnances délictuelles peuvent être portées « à la connaissance du prévenu par le procureur de la République, directement ou par l’intermédiaire d’une personne habilitée » (280).
Le III du présent article modifie cette disposition pour permettre que les ordonnances pénales soient notifiées par les délégués du procureur, qu’elles soient de rang contraventionnel ou délictuel.
4. Les modifications opérées par votre commission des Lois
Sur proposition de la rapporteure, la commission des Lois a apporté à l’article 30 des améliorations rédactionnelles ainsi qu’une précision de fond.
Une juridiction statuant en comparution immédiate peut assortir d’un mandat de dépôt (281) toute peine d’emprisonnement alors que, dans la procédure normale, le mandat de dépôt ne peut être ordonné que si la peine prononcée est supérieure ou égale à un an (282). Toutefois, il n’était pas admissible que le prévenu convoqué à l’audience de comparution immédiate aux seules fins d’éviter la disjonction et de permettre une meilleure administration de la justice ait à pâtir de règles procédurales plus strictes que celles qui auraient dû lui être appliquées.
La Commission a donc explicitement indiqué que les dispositions de l’article 397-4 du code de procédure pénale n’étaient pas applicables dès lors que le juge des libertés et de la détention avait choisi de ne pas maintenir le prévenu en détention, que son audience soit ensuite prévue immédiatement ou dans un délai plus important.
* *
La Commission examine l’amendement CL319 de la rapporteure.
Mme la rapporteure. Cet amendement prévoit que le prévenu jugé à l’audience de comparution immédiate avec d’autres prévenus, dans le cadre du même dossier, ce qui est assez fréquent, alors même que le juge des libertés et de la détention a choisi de ne pas le maintenir en détention, n’est pas soumis aux règles de la comparution immédiate pour ce qui concerne le mandat de dépôt. En effet, une juridiction statuant en comparution immédiate peut assortir toute peine d’emprisonnement d’un mandat de dépôt alors que, dans la procédure normale, le mandat de dépôt ne peut être ordonné que si la peine prononcée est supérieure ou égale à un an.
Il s’agit par conséquent d’une mesure de bonne administration de la justice visant à ne pas disjoindre les dossiers relevant d’une même affaire et, surtout, à ne pas restreindre les droits des prévenus.
La Commission adopte l’amendement.
Elle adopte ensuite l’amendement de coordination CL320 de la rapporteure.
Puis elle adopte l’article 30 modifié.
Article 31
(art. 74-2, 78-2, 78-2-2 et 78-2-4 du code de procédure pénale)
Recherche des personnes en fuite
1. Le droit en vigueur
Les alinéas 1er à 5 de l’article 78-2 du code de procédure pénale autorisent les officiers de police judiciaire à inviter à justifier de son identité, par tout moyen, toute personne à l’égard de laquelle existent une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction, qu’elle se prépare à commettre un crime ou un délit, qu’elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l’enquête en cas de crime ou de délit, ou qu’elle fait l’objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire. Ce contrôle d’identité de police judiciaire constitue souvent un préalable à diverses vérifications, notamment l’interrogation du fichier des personnes recherchées (283).
Quant à l’article 74-2 du code de procédure pénale, il prévoit que les officiers de police judiciaire, sur instructions du procureur de la République, sont chargés de rechercher et de découvrir une personne en fuite lorsque celle-ci fait l’objet d’un mandat d’arrêt ou si elle a été condamnée à une peine privative de liberté sans sursis supérieure ou égale à un an – condamnation exécutoire ou passée en force de chose jugée.
Ces deux dispositifs s’avèrent lacunaires quand il s’agit pour les forces de l’ordre de retrouver une personne qui se soustrait aux obligations qui lui sont imposées à la suite d’une peine ou d’un placement sous contrôle judiciaire, mais qui n’est pas encore expressément recherchée pour ce motif. En effet, en l’absence d’élément permettant de caractériser la suspicion d’une infraction ou l’existence de recherches ordonnées par une autorité judiciaire, de telles interventions seraient frappées d’illégalité.
2. Les dispositions du projet de loi
Le I du présent article étend le dispositif de recherche prévu à l’article 74-2 du code de procédure pénale aux personnes ayant fait l’objet d’une décision de retrait ou de révocation d’un aménagement de peine ou d’une libération sous contrainte, ou d’une décision de mise à exécution de l’emprisonnement prévu par la juridiction de jugement en cas de violation des obligations et interdictions résultant d’une peine, dès lors que cette décision a pour conséquence la mise à exécution d’une peine supérieure à un an d’emprisonnement.
Le II modifie l’article 78-2 du code de procédure pénale afin que la police judiciaire puisse inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l’égard de laquelle existent une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a violé les obligations ou interdictions prononcées à son encontre dans le cadre d’un contrôle judiciaire, d’une mesure d’assignation à résidence avec surveillance électronique, d’une peine ou d’une mesure suivie par le juge de l’application des peines.
3. Les modifications opérées par votre commission des Lois
Sur proposition de la rapporteure, la Commission a adopté deux amendements, l’un rédactionnel, l’autre procédant à des coordinations nécessaires aux articles 78-2-2 et 78-2-4 du code de procédure pénale par l’insertion d’un III et d’un IV nouveaux.
*
* *
La Commission adopte successivement les amendements CL321, rédactionnel, et CL322, de coordination, de la rapporteure.
Puis elle adopte l’article 31 modifié.
Article 31 bis (nouveau)
(art. L. 218-30, L. 218-55 et L. 218-68 du code de l’environnement)
Procédure d’immobilisation d’un navire polluant
Le présent article, adopté par la commission des Lois à l’initiative de votre rapporteure, vise à tirer les conséquences dans notre droit de la décision du Conseil constitutionnel n° 2014-375 QPC du 21 mars 2014, M. Bertrand L. et autres. Par cette décision, le Conseil a déclaré contraire à la Constitution « la combinaison du caractère non-contradictoire de la procédure et de l’absence de voie de droit permettant la remise en cause de la décision du juge autorisant la saisie et fixant le cautionnement (284) » en matière maritime.
Dans la rédaction initiale du projet de loi, ces dispositions faisaient l’objet du d) du 3° du II de l’article 33 prévoyant une habilitation du Gouvernement à légiférer par ordonnance. En conséquence de l’adoption de l’article 31 bis, l’habilitation en question a fait l’objet d’un amendement de suppression.
L’article L. 218-30 du code de l’environnement selon lequel le navire qui a servi à commettre un rejet polluant au sens des articles L. 218-11 à L. 218-19 du même code peut être immobilisé, aux frais de l’armateur, sur décision du procureur de la République ou du juge d’instruction saisi. L’autorité judiciaire peut lever l’immobilisation dès lors qu’est fourni un cautionnement dont elle fixe le montant et les modalités de versement. La décision d’immobilisation prise par l’autorité judiciaire peut être contestée dans le délai de cinq jours à compter de sa notification, par requête de l’intéressé devant le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance saisi de l’enquête.
Le 1° complète ce dispositif en prévoyant que le juge des libertés et de la détention peut confirmer la saisie ou ordonner la mainlevée. Il est désormais celui qui détermine les conditions du cautionnement. Son ordonnance motivée, rendue dans les trois jours de la saisine, est notifiée au procureur de la République, au juge d’instruction lorsqu’il est saisi, à la personne mise en cause – soit l’armateur – et, s’ils sont connus, au propriétaire et aux tiers ayant des droits sur le navire.
Une voie de recours est ouverte contre la décision du juge des libertés et de la détention devant la chambre de l’instruction, saisie sous cinq jours et qui se prononce dans les cinq jours de la saisine suivant une procédure contradictoire. Cet appel n’est pas suspensif, sauf demande expresse du procureur de la République formulée dans les six heures suivant la notification de l’ordonnance de mainlevée lorsqu’il estime que persiste un risque sérieux de réitération ou qu’il est nécessaire de garantir le paiement des amendes futures, et acceptation de cette demande par le premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Le 2° étend l’application de cette procédure aux navires causant une pollution par immersion (article L. 218-55 du code de l’environnement) et par incinération (article L. 218-68 du même code).
*
* *
La Commission examine l’amendement CL340 de la rapporteure.
Mme la rapporteure. Le présent amendement tire les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel à la suite d’une question prioritaire de constitutionnalité sur les immobilisations de navires polluants, en créant une voie de recours à l’encontre des décisions prises en ce sens.
La Commission adopte l’amendement. L’article 31 bis est ainsi rédigé.
Article 31 ter (nouveau)
(art. 132-20 du code pénal, art. 705-6 [nouveau] du code de procédure pénale, art. 409-1 du code des douanes, art. L. 612-42 et L. 621-15 du code monétaire et financier, art. L. 464-5-1 du code de commerce, et art. 44 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne)
Sur-amendes
Le présent article, issu de l’adoption d’un amendement du président Dominique Raimbourg, vise à permettre une majoration des amendes pénales et douanières ainsi que des sanctions pécuniaires prononcées par certaines autorités administratives indépendantes afin de consolider le financement de l’aide aux victimes d’infraction.
Il s’agit de la reprise de l’article 9 du projet de loi portant adaptation de la procédure pénale au droit de l’Union européenne adopté par l’Assemblée nationale, en lecture définitive, le 23 juillet 2015, que le Conseil constitutionnel avait déclaré contraire à la Constitution en raison de l’absence de lien avec le contenu du projet de loi initial (285).
*
* *
La Commission examine les amendements identiques CL154 de M. Dominique Raimbourg et CL325 de la rapporteure.
M. le président Dominique Raimbourg. L’amendement CL154 vise à rétablir un dispositif qualifié de « sur-amende » permettant au juge qui prononce une amende de la majorer dans la limite de 10 % de son montant, de façon à abonder les budgets des associations de défense des victimes.
Mme la rapporteure. J’espère que cet amendement, après un parcours particulièrement tortueux émaillé de deux censures par le Conseil constitutionnel, finira par être voté. Il est temps en effet que cette disposition, particulièrement attendue par les associations de défense des victimes, soit inscrite dans notre droit.
L’amendement CL325 est retiré.
La Commission adopte l’amendement CL154. L’article 31 ter est ainsi rédigé.
Article 31 quater (nouveau)
(art. 28 du code de procédure pénale, art. L. 8271-6-1 du code du travail, art. L. 172-8 du code de l’environnement, art. L. 450-4 du code de commerce, art. L. 215-8 du code de la consommation, art. L. 331-21-1 du code de la propriété intellectuelle, art. L. 3341-2 du code de la santé publique et art. L. 234-18 et L. 235-5 du code de la route)
Audition libre par des agents publics détenteurs de pouvoir de police spéciale
Le présent article, adopté par la commission des Lois à l’initiative de votre rapporteure, vise à compléter la transposition en droit interne des prescriptions de la directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, relative au droit à l’information dans le cadre des procédures pénales, afin d’étendre les règles relatives au déroulement de l’audition libre aux enquêtes effectuées par des fonctionnaires et agents chargés de certaines mission de police judiciaire au titre d’une compétence de police spéciale.
Dans la rédaction initiale du projet de loi, ces dispositions faisaient l’objet du 7° du II de l’article 33 prévoyant une habilitation du Gouvernement à légiférer par ordonnance. En conséquence de l’adoption de l’article 31 quater, l’habilitation en question a fait l’objet d’un amendement de suppression.
Le I complète l’article 28 du code de procédure pénale, aux termes duquel « les fonctionnaires et agents des administrations et services publics auxquels des lois spéciales attribuent certains pouvoirs de police judiciaire exercent ces pouvoirs dans les conditions et dans les limites fixées par ces lois », par la mention du caractère applicable des règles de l’article 61-1 du même code (286) aux auditions donnant lieu à procès-verbal lorsqu’il existe des raisons plausibles de soupçonner que la personne entendue a commis ou tenté de commettre une infraction.
Les II, III, IV, V et VI consistent en une disposition miroir de la précédente inscrite respectivement au sein du code du travail, du code de l’environnement, du code de commerce, du code de la consommation et du code de la propriété intellectuelle.
Le VII précise que les auditions menées dans le cadre du code de la santé publique et du code de la route sont également soumises aux règles de l’audition libre prévues par l’article 61-1 du code de procédure pénale.
*
* *
La Commission en vient à l’amendement CL328 de la rapporteure.
Mme la rapporteure. Le présent amendement, qui porte sur la compétence des agents publics chargés de la mise en œuvre d’une police spéciale, vise à procéder aux modifications législatives nécessaires à la transposition de la directive 2012/13/UE du 22 mai 2012 afin d’étendre l’application des dispositions du code de procédure pénale sur l’audition libre aux enquêtes effectuées par des fonctionnaires chargés de certaines missions de police judiciaire, comme les agents du ministère de l’environnement ou les inspecteurs du travail.
La Commission adopte l’amendement. L’article 31 quater est ainsi rédigé.
Article 31 quinquies (nouveau)
(art. 41-4, 41-5, 99, 99-2, 373, 481, 493-1 [nouveau], 706-1, 706-143, 706-148, 706-157, 706-160, 706-161, 706-163, 706-164 et 707-1 du code de procédure pénale)
Confiscation des produits du crime et prérogatives de l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués
Le présent article, adopté par la commission des Lois sur amendement gouvernemental, procède à la transposition des dispositions de la directive 2014/42/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant le gel et la confiscation des instruments et des produits du crime dans l’Union européenne, ainsi qu’à des modifications destinées à renforcer l’efficacité de l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC), dans la gestion des biens saisis et confisqués.
Dans la rédaction initiale du projet de loi, ces dispositions faisaient l’objet des paragraphes a) et b) du 3° du II de l’article 33 prévoyant une habilitation du Gouvernement à légiférer par ordonnance. En conséquence de l’adoption de l’article 31 quater, les habilitations en question ont fait l’objet d’un amendement de suppression.
Le 1° modifie l’article 41-4 du code de procédure pénale afin de permettre au procureur de la République, une fois une affaire terminée, de ne pas restituer les biens placés sous main de justice qui sont l’instrument ou le produit direct ou indirect de l’infraction. Il réduit à un mois, contre deux actuellement, le délai dans lequel le propriétaire ou la personne à laquelle la restitution a été accordée doit réclamer l’objet avant que celui-ci soit détruit ou remis à l’AGRASC ; ce délai court à compter d’une mise en demeure adressée à son domicile. Il procède enfin à une coordination.
Le 2° et le 10° sont de nature rédactionnelle.
Le 3° modifie l’article 99 du code de procédure pénale pour autoriser le juge d’instruction, une fois une affaire terminée, de ne pas restituer les biens placés sous main de justice qui sont l’instrument ou le produit direct ou indirect de l’infraction.
Le 4° modifie l’article 99-2 du même code pour réduire de deux à un mois le délai pour obtenir restitution des objets placés sous main de justice, dans le cadre de l’information judiciaire, sur le modèle de ce qui est prévu au 1° dans le cadre de l’enquête. Par ailleurs, il précise qu’une décision de destruction de produits stupéfiants saisis à l’occasion de l’exécution d’une commission rogatoire, peut être contestée dans les vingt-quatre heures devant la chambre de l’instruction par déclaration au greffe ou à l’autorité qui a procédé à cette notification lorsque celle-ci a pris une forme orale.
Le 5° complète l’article 373 du même code en indiquant que, si une cour d’assises peut ordonner d’office la restitution des objets placés sous main de justice, il est possible aux parties de la solliciter en ce sens. Il précise également que la juridiction peut refuser de restituer les biens qui sont l’instrument ou le produit direct ou indirect de l’infraction. Enfin, afin de réserver la compétence de la juridiction, il prescrit que seuls les procès-verbaux relatifs à la saisie puissent être communiqués à une autre personne que les parties.
Le 6° prévoit, à l’article 481 du même code, que le tribunal correctionnel refuse la restitution des biens qui sont l’instrument ou le produit direct ou indirect de l’infraction.
Le 7° crée dans le même code un nouvel article 493-1 prévoyant des modalités d’exécution lorsque la confiscation a été prononcée par défaut afin de garantir que le condamné ne pourra pas revendiquer la restitution des biens confisqués à l’expiration du délai de prescription de la peine.
Le 8° interdit au fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions, qui est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l’infraction le remboursement de l’indemnité ou de la provision qu’il a versé, d’exercer son recours à l’encontre de l’AGRASC (article 706-11 du même code).
Le 9° modifie l’article 706-143 du même code pour permettre au juge d’instruction ou, sur requête du parquet, au juge des libertés et de la détention, de décider l’aliénation (par cession ou destruction) d’un bien saisi dont les frais de conservation apparaissent sans proportion avec sa valeur avant qu’intervienne le jugement au fond. La décision, motivée, peut faire l’objet d’un recours devant la chambre de l’instruction. Le propriétaire dispose sur le produit de la vente des droits qui étaient les siens sur l’objet aliéné.
Le 11° instaure à l’article 706-157 du même code un monopole de l’AGRASC pour la publication des saisies de fonds de commerce, afin de décharger les juridictions de ces formalités et de satisfaire aux objectifs généraux de centralisation des mesures de saisies et d’établissement d’un bilan statistique.
Le 12° crée à l’article 706-160 du même code un mécanisme de rapatriement au budget général de l’État de la partie du solde de l’AGRASC pour laquelle l’identification du statut de ces sommes, saisies ou confisquées, reste non établie à l’issue d’un délai de quatre ans après réception des fonds. En cas de décision de restitution postérieure, il revient à l’État de rembourser à l’agence les sommes dues.
Le 13° permet à l’AGRASC d’intervenir d’initiative auprès du parquet compétent ou de la juridiction pénale. Il donne également aux magistrats et greffiers de l’AGRASC un accès au fichier des procédures judiciaires « Cassiopée ». Utile pour l’accomplissement des missions de l’agence, cette procédure répond également à une inquiétude des organisations de magistrats qui s’alarmaient de premiers projets autorisant la consultation du fichier par tout agent de l’AGRASC. Cette limitation aux seuls magistrats et greffiers qui y sont affectés permet de préserver la confidentialité des données (article 706-61 du même code).
Le 14° permet à l’AGRASC de disposer pour son fonctionnement des ressources générées par le produit des placements qu’elle effectue avec les sommes dont elle a la garde (article 706-63 du même code).
Le 15° modifie l’article 706-164 du même code pour améliorer le dispositif d’indemnisation des victimes reconnues par les tribunaux grâce aux biens des coupables confisqués par l’AGRASC. La demande de paiement est formulée dans un délai de deux mois après la décision de justice à peine de forclusion. En cas de pluralité de créanciers, les premières demandes seront les premières servies, et celles parvenues à l’agence le même jour seront satisfaites en proportion des sommes à disposition. L’AGRASC est également chargée d’instruire l’action récursoire pour le compte de l’État à l’encontre du condamné.
Enfin, le 16° précise à l’article 707-1 du même code que l’AGRASC est chargée d’administrer pour leur conservation et leur valorisation les biens saisis en vertu d’une sentence pénale.
*
* *
La Commission examine ensuite l’amendement CL227 du Gouvernement.
Mme la rapporteure. À ma demande, le Gouvernement a accepté de présenter à l’Assemblée nationale un dispositif relatif au gel et à la confiscation des instruments et des produits du crime qu’il envisageait initialement de transposer par voie d’ordonnance. Je vous engage à voter cet amendement qui nous permettra de débattre de la rédaction du dispositif au cours des phases ultérieures de la discussion parlementaire.
La Commission adopte l’amendement. L’article 31 quinquies est ainsi rédigé.
Article 31 sexies (nouveau)
(art. 48-1 du code de procédure pénale)
Accès des magistrats chargés du contrôle des fichiers de police judiciaire
au fichier des procédures judiciaires
Issu d’un amendement de votre rapporteure, l’article 31 sexies modifie l’article 48-1 du code de procédure pénale relatif au bureau d’ordre national automatisé des procédures judiciaires. Cette application automatisée, placée sous le contrôle d’un magistrat, conserve les informations nominatives relatives aux plaintes et dénonciations reçues par les procureurs de la République ou les juges d’instruction et aux suites qui leur ont été réservées. Elle est destinée à faciliter la gestion et le suivi des procédures judiciaires par les juridictions compétentes, l’information des victimes et la connaissance réciproque entre les juridictions des procédures concernant les mêmes faits ou mettant en cause les mêmes personnes, afin notamment d’éviter les doubles poursuites.
Les données enregistrées dans le bureau d’ordre national automatisé portent notamment sur les date, lieu et qualification juridique des faits ainsi que sur les nom, prénoms, date et lieu de naissance ou la raison sociale des personnes mises en cause et des victimes. Les informations relatives aux décisions sur l’action publique, au déroulement de l’instruction, à la procédure de jugement et aux modalités d’exécution des peines y apparaissent également, de même que les renseignements relatifs à la situation judiciaire, au cours de la procédure, de la personne mise en cause, poursuivie ou condamnée.
L’article 31 sexies permet l’accès à ces informations des magistrats chargés du contrôle des fichiers de la police judiciaire, du fichier national automatisé des empreintes génétiques et du fichier automatisé des empreintes digitales. Cette nouvelle prérogative leur permettra un meilleur exercice de leurs missions.
*
* *
Puis elle en vient à l’amendement CL331 de la rapporteure.
Mme la rapporteure. Le présent amendement prévoit l’accès des magistrats chargés du contrôle des fichiers de police judiciaire au fichier des procédures judiciaires.
La Commission adopte l’amendement. L’article 31 sexies est ainsi rédigé.
Article 31 septies (nouveau)
(art. 84-1 [nouveau], 135-2, 141-2, 161-1, 175 et 706-71 du code de procédure pénale)
Dispositions relatives à l’instruction
Issu d’un amendement du Gouvernement adopté avec l’avis favorable de la rapporteure, l’article 31 septies procède à diverses simplifications dans la procédure d’instruction afin d’éliminer les formalités qui entravent les magistrats dans l’exercice de leurs missions.
Le 1° et le 4° simplifient les modalités selon lesquelles les parties peuvent, lorsqu’elles le souhaitent et en présence de leur avocat (ou ce dernier à tout le moins régulièrement convoqué), renoncer aux délais prévus en leur faveur pour formuler des observations ou des demandes complémentaires en matière d’expertise et de règlement de l’instruction, en permettant de subordonner cette renonciation à une renonciation similaire de l’ensemble des parties. Cette disposition permettra de gagner du temps lorsque les parties considèrent l’affaire en état d’être jugée et tout acte complémentaire superflu.
Le 2° et le 5° étendent le recours à la visio-conférence aux présentations sur mandats d’arrêt et mandat d’amener. Ils précisent les modalités selon lesquelles une personne détenue peut, d’une façon générale, le refuser et solliciter une présentation dans les formes normales.
Le 3° permet un meilleur suivi des contrôles judiciaires par le procureur de la République après la décision de renvoi devant la juridiction, en prévoyant la possibilité d’une perquisition au domicile lorsque la détention interdite d’armes est suspectée.
*
* *
La Commission examine l’amendement CL223 du Gouvernement.
Mme la rapporteure. Cet amendement du Gouvernement tend à simplifier la procédure d’instruction afin de permettre aux magistrats de mener leurs investigations sans être contraints par des formalités.
Il est proposé que les parties, lorsqu’elles le souhaitent et en présence de leur avocat, puissent renoncer aux délais prévus pour formuler des observations ou des demandes complémentaires en matière d’expertise et de règlement de l’instruction, en subordonnant cette renonciation à une renonciation similaire de l’ensemble des parties.
Est également autorisé le recours à la visioconférence pour les présentations sur mandats d’arrêt ou d’amener. Comme à l’accoutumée, une personne détenue peut toujours refuser et solliciter une présentation selon des modalités classiques.
Enfin, il s’agit d’améliorer le suivi des contrôles judiciaires par le procureur de la République après le renvoi devant la juridiction de jugement.
Il est donc bien question ici de simplifier le droit et non pas de le modifier ou, encore moins, de restreindre les droits des personnes. Je suis favorable à cet amendement.
La Commission adopte l’amendement. L’article 31 septies est ainsi rédigé.
Article 31 octies (nouveau)
(art. 230-2, 230-3 et 230-45 [nouveau] du code de procédure pénale)
Plate-forme nationale des interceptions judiciaires
Issu d’un amendement du Gouvernement adopté avec l’avis favorable de la rapporteure, le présent article procède aux modifications rendant obligatoire le recours à la plate-forme nationale des interceptions judiciaires (PNIJ).
Instaurée par le décret n° 2014-1162 du 9 octobre 2014, la plate-forme a pour objet de fournir aux services d’investigation un outil adapté et réactif répondant aux besoins opérationnels des enquêteurs, juridiquement sécurisé et garantissant la confidentialité des conversations interceptées. La centralisation opérée permet de renforcer le contrôle de l’autorité judiciaire et de simplifier le travail des greffes pour la gestion des scellés et l’établissement des mémoires de frais. Elle réduit, par conséquent, le montant des frais de justice.
Dans la rédaction initiale du projet de loi, ces dispositions faisaient l’objet du 8° du II de l’article 33 prévoyant une habilitation du Gouvernement à légiférer par ordonnance. En conséquence de l’adoption de l’article 31 octies, l’habilitation en question a fait l’objet d’un amendement de suppression.
Le 1° crée un nouveau chapitre VI dédié à la PNIJ au sein du titre IV du livre Ier du code de procédure pénale relatif aux dispositions communes à l’enquête et à l’instruction. Il se compose d’un unique article 230-45 qui rend obligatoire le recours à la PNIJ pour les magistrats, les services d’enquête et les douanes. En raison du degré de sécurité de cet instrument, les enregistrements n’ont pas à être placés sous scellés fermés.
Le 2° prévoit que les données électroniques chiffrées obtenues grâce à la PNIJ font l’objet d’une mise au clair par réquisition directe de l’autorité judiciaire.
Le 3° opère une coordination.
*
* *
La Commission en vient à l’amendement CL228 du Gouvernement.
Mme la rapporteure. Le présent amendement procède aux modifications rendant obligatoire le recours à la plate-forme nationale des interceptions judiciaires (PNIJ) pour lesquelles le projet de loi prévoit une habilitation du Gouvernement à légiférer par ordonnance. Il s’agit là de dispositions techniques qui incitent les enquêteurs à solliciter un service dédié aux interceptions, ce qui devrait permettre à la fois une baisse des coûts et une hausse de la qualité de service, garante d’une meilleure protection des droits des justiciables. Avis favorable.
La Commission adopte l’amendement. L’article 31 octies est ainsi rédigé.
Article 31 nonies (nouveau)
(art. 308 du code de procédure pénale)
Enregistrement des débats en cour d’assises
Le présent article, adopté par la commission des Lois à l’initiative de votre rapporteure, vise à tirer les conséquences dans notre droit de la décision du Conseil constitutionnel n° 2015-499 QPC du 20 novembre 2015, M. Hassan B., par laquelle est déclaré contraire aux droits et libertés garantis par la Constitution le dernier alinéa de l’article 308 du code de procédure pénale, selon lequel le défaut d’enregistrement sonore des débats devant la cour d’assises ne vaut pas nullité.
Dans la rédaction initiale du projet de loi, ces dispositions faisaient l’objet du 4° du II de l’article 33 prévoyant une habilitation du Gouvernement à légiférer par ordonnance. En conséquence de l’adoption de l’article 31 nonies, l’habilitation en question a fait l’objet d’un amendement de suppression.
L’article 308 du code de procédure pénale est modifié afin que le défaut d’enregistrement sonore constitue une cause de cassation de l’arrêt de condamnation – et non de l’acquittement – s’il est établi qu’il a eu effet de porter atteinte aux intérêts du demandeur. Cet enregistrement est rendu obligatoire en appel mais optionnel à la demande de la présidence ou des parties en première instance, étant entendu que les accusés qui renoncent à leur appel acceptent la décision de justice et ne forment généralement pas de demande de révision par la suite.
L’article entre en vigueur au 1er septembre 2016, date à laquelle le Conseil constitutionnel a reporté la prise d’effet de sa décision de non-conformité.
*
* *
La Commission examine l’amendement CL333 de la rapporteure.
Mme la rapporteure. Cet amendement procède aux modifications nécessitées par la décision rendue le 20 novembre 2015 par le Conseil constitutionnel à la suite d’une question prioritaire de constitutionnalité portant sur l’enregistrement sonore des débats devant la cour d’assises.
Le Conseil a estimé que l’enregistrement sonore des débats de la cour d’assises est un droit de l’accusé dans la perspective d’une possible révision. Il convient soit de le garantir, soit de le supprimer, mais la législation actuelle, qui l’impose sans faire de son absence une cause de nullité, n’est pas conforme aux droits de la défense.
Le présent amendement prévoit que le défaut d’enregistrement sonore constitue une cause de cassation de l’arrêt de condamnation s’il est établi qu’il a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts du demandeur. L’enregistrement sonore serait obligatoire en appel et optionnel en première instance, étant entendu que les accusés qui renoncent à leur droit d’appel acceptent la décision de justice et ne forment pas ensuite de demande de révision
M. Alain Tourret. Cette disposition me semble très intéressante en ce qu’elle paraît appliquer la loi relative à la réforme des procédures de révision et de réexamen d’une condamnation pénale définitive. Les questions liées à la révision des décisions pénales sont extraordinairement compliquées puisque l’enregistrement de l’ensemble des procédures pénales n’est pas obligatoire. Je ne puis donc qu’approuver cet amendement.
La Commission adopte l’amendement. L’article 31 nonies est ainsi rédigé.
Article 31 decies (nouveau)
(art. 354 et 355 du code de procédure pénale)
Délibéré hors du palais de justice
Le présent article, adopté par la commission des Lois sur proposition du Gouvernement avec avis favorable de la rapporteure, procède à une modification des articles 354 et 355 du code de procédure pénale selon lesquels l’accusé ne peut quitter le palais de justice, ni le jury la chambre des délibérations, pendant que le délibéré a lieu.
L’expérience montre que des affaires délicates nécessitent des délibérés d’une longueur supérieure à douze heures, dans des conditions matérielles particulièrement inconfortables pour tous.
L’article 31 decies permet au président de désigner un lieu hors du palais de justice pour que l’accusé et le jury bénéficient d’un supplément de confort.
*
* *
La Commission en vient à l’amendement CL225 du Gouvernement.
Mme la rapporteure. L’amendement, purement matériel, permet au jury et à l’accusé de rejoindre un lieu plus adapté que le palais de justice dans le cas de délibérés qui se prolongent toute la nuit afin d’assurer le confort de chacun. J’y suis favorable.
M. Alain Tourret. Est-il nécessaire qu’une telle disposition figure dans la loi ?
Mme la rapporteure. Tout à fait : les textes en vigueur disposent que l’accusé ne doit pas quitter le palais de justice pendant la durée du délibéré.
La Commission adopte l’amendement. L’article 31 decies est ainsi rédigé.
Article 31 undecies (nouveau)
(art. 379-2, 379-7 et 380-1 du code de procédure pénale)
Jugement aux assises réputé contradictoire
Le présent article, adopté par la commission des Lois sur proposition du Gouvernement avec avis favorable de la rapporteure, écarte le bénéfice des règles avantageuses du jugement par défaut (287) et répute contradictoire l’arrêt d’assises rendu à l’encontre d’un accusé qui prend la fuite alors que les interrogatoires sur les faits et la personnalité ont déjà été réalisés et que son avocat continue à assurer la défense de ses intérêts. L’arrêt de condamnation vaut mandat d’arrêt et ouvre les délais d’appel ou de cassation (1°).
Le 2° prévoit également de réputer contradictoire un jugement rendu lorsque l’accusé a pris la fuite à l’occasion de son procès devant la cour d’assises d’appel, la décision de première instance ayant été rendue normalement et son avocat continuant à assurer la défense de ses intérêts.
Le 3° procède à une coordination.
*
* *
La Commission examine l’amendement CL358 du Gouvernement.
Mme la rapporteure. Cet amendement du Gouvernement a pour fin de réputer contradictoires les jugements rendus alors que l’accusé a pris la fuite une fois les interrogatoires terminés ou à l’occasion du procès en appel, étant entendu qu’il demeure représenté par son avocat.
Il évite le régime avantageux d’un jugement rendu par défaut en conséquence d’une fuite délibérée de l’accusé alors que les droits de la défense restent correctement garantis. J’y suis favorable.
La Commission adopte l’amendement. L’article 31 undecies est ainsi rédigé.
Article 31 duodecies (nouveau)
(art. 380-14, 380-15, 500-1, 502 et 505-1 du code de procédure pénale)
Dispositions relatives à l’appel
Le présent article, adopté par la commission des Lois sur proposition du Gouvernement avec avis favorable de la rapporteure, simplifie la procédure d’appel des arrêts d’assises.
Conformément à l’article 380-1 du code de procédure pénale, la cour d’assises chargée de connaître de l’appel doit être une juridiction différente de celle de première instance. Elle est aujourd’hui désignée par la chambre criminelle de la Cour de cassation. En modifiant l’article 380-14 du code de procédure pénale, le 1° confie au premier président de la cour d’appel le soin de la choisir parmi les cours d’assises de son ressort. Si le ministère public ou l’une des parties demande à voir désignée une cour d’assises hors de ce ressort, la chambre criminelle de la Cour de cassation en décide. Cette mesure de déconcentration permettra des désignations plus proches du terrain et évitera la lourdeur d’une décision centralisée.
Le 2° prévoit l’irrecevabilité des appels formés hors délais sur décision du président de la chambre criminelle de la Cour de cassation. Il ne sera donc plus nécessaire de réunir la chambre criminelle, comme le prévoit aujourd’hui l’article 380-15 du code de procédure pénale, pour dire « n’y avoir pas lieu à désignation d’une cour d’assises chargée de statuer en appel ».
Le 3° modifie l’article 500-1 du même code pour que le désistement d’appel principal fasse tomber les appels incidents jusqu’à deux mois de l’audience, et non dans le seul mois suivant la déclaration d’appel comme aujourd’hui. Le désistement signifiant l’acceptation de la décision de première instance par toutes les parties, il n’est aucunement utile de maintenir la tenue d’une audience d’appel en dépit de ce consensus.
Le 4° permet à l’appelant d’interjeter appel partiellement, c’est-à-dire de ne contester qu’une partie de la décision de première instance – par exemple d’admettre la culpabilité mais de demander un réexamen de la peine. Cette nouvelle option devrait faciliter la tâche des juridictions en leur épargnant de tenir de nouveaux débats sur des points admis par toutes les parties.
Le 5° charge le président de la chambre des appels correctionnels de rendre d’office une ordonnance de non-admission de l’appel lorsqu’une déclaration lui est présentée en violation des obligations de forme de l’article 502 du code de procédure pénale (pour les jugements du tribunal correctionnel) ou de l’article 546 du même code (pour les jugements du tribunal de police).
*
* *
La Commission en vient à l’amendement CL360 du Gouvernement.
Mme la rapporteure. Le présent amendement vise à moderniser les procédures d’appel en faisant en sorte que le choix de la cour d’assises d’appel revienne au premier président de la cour d’appel au lieu de relever de la Cour de cassation, sauf cas exceptionnel ou demande expresse des parties. C’est une mesure de déconcentration bienvenue et de confiance à l’égard de nos juridictions.
Les appels formés hors délai pourraient être déclarés irrecevables par le premier président de la cour d’appel.
Le désistement d’appel principal permettrait plus facilement d’éviter une audience inopportune, la décision de première instance étant finalement acceptée par toutes les parties, en faisant tomber les appels incidents jusqu’à deux mois de l’instance.
Enfin, il serait désormais possible d’interjeter appel partiellement, c’est-à-dire de ne contester qu’une partie de la décision rendue en première instance – par exemple d’admettre la culpabilité mais de demander un réexamen de la peine – afin de faciliter la tâche des juridictions. J’y suis favorable.
M. Alain Tourret. C’est possible ?
Mme la rapporteure. Cela va le devenir.
La Commission adopte l’amendement. L’article 31 duodecies est ainsi rédigé.
Article 31 terdecies (nouveau)
(art. 394 du code de procédure pénale)
Délai de comparution devant le tribunal correctionnel
Le présent article, adopté par la commission des Lois sur proposition du président Dominique Raimbourg avec avis favorable de la rapporteure, modifie l’article 394 du code de procédure pénale. Celui-ci prévoit que le procureur de la République peut inviter la personne déférée à comparaître devant le tribunal dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours, sauf renonciation expresse de l’intéressé en présence de son avocat, ni supérieur à deux mois.
L’article 31 terdecies porte le délai maximum à six mois afin de prendre en compte l’encombrement des juridictions.
*
* *
La Commission examine les amendements identiques CL156 de M. Dominique Raimbourg et CL334 de la rapporteure.
M. le président Dominique Raimbourg. L’amendement CL156 vise à donner au procureur de la République, dans le cadre d’une convocation par procès-verbal, la possibilité de faire comparaître un prévenu non plus dans un délai de deux mois mais de six mois. Il s’agit notamment de lui permettre de placer l’intéressé sous contrôle judiciaire dans l’attente de l’audience et d’ainsi faire face à l’engorgement des juridictions.
Mme la rapporteure. C’est une très bonne mesure.
La Commission adopte les amendements identiques. L’article 31 terdecies est ainsi rédigé.
Article 31 quaterdecies (nouveau)
(art. 590-1 et 509-2 [nouveaux] du code de procédure pénale)
Déchéance des pourvois en cassation
Le présent article, adopté par la commission des Lois sur proposition du Gouvernement avec avis favorable de la rapporteure, encadre la procédure de déchéance des pourvois en cassation.
Le nouvel article 590-1 du code de procédure pénale prévoit que les pourvois déposés en violation des obligations de délai de l’article 584 du code de procédure pénale – soit dans les dix jours suivant la date de la décision attaquée – ou sans constitution d’avocat ne sont pas recevables devant la Cour de cassation, qui prononce leur déchéance. Il en va de même lorsque les mémoires à l’appui des pourvois ne sont pas déposés dans le mois suivant. Toutefois, il est exclu que soit déchu de son pourvoi le demandeur condamné à une peine illégale.
Le nouvel article 590-2 du même code précise que la déchéance est prononcée par ordonnance du président de la chambre criminelle ou du conseiller qu’il a désigné pour ce faire.
*
* *
La Commission en vient à l’amendement CL361 du Gouvernement.
Mme la rapporteure. Le présent amendement simplifie les règles en matière de pourvoi en cassation, en permettant que la déchéance du pourvoi, lorsque le requérant n’a pas déposé de mémoire dans les délais requis, soit constatée par le président de la chambre criminelle ou son délégué, et non par la chambre elle-même. Le but est de gagner du temps. Une garantie est toutefois adjointe pour la défense dans la mesure où le pourvoi fondé sur une condamnation à une peine illégale ne pourra jamais être écarté. Avis favorable.
La Commission adopte l’amendement. L’article 31 quaterdecies est ainsi rédigé.
Article 31 quindecies (nouveau)
(art. 628–1 du code de procédure pénale)
Spécialisation de la cour d’assises de Paris en matière de jugement des crimes contre l’humanité et les crimes de guerre
Le présent article, adopté à l’initiative du Gouvernement par votre Commission, est relatif à la procédure dérogatoire prévue en matière de crimes contre l’humanité et de crimes de guerre, pour lesquels la cour d’assise de Paris dispose d’une spécialisation depuis la loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 relative à la répartition des contentieux et à l’allègement de certaines procédures juridictionnelles.
Aux termes de l’article 380-1 du code de procédure pénale la procédure de droit commun impose que l’appel en matière criminelle soit confié à une cour d’assises autre que celle qui a jugé en première instance.
Le présent article complète l’article 628-1 du code de procédure pénale relatif aux juridictions compétentes pour la poursuite, l’instruction et le jugement des crimes contre l’humanité et des crimes et délits de guerre, en instituant une dérogation permettant que la cour d’assises de Paris puisse être à nouveau désignée pour connaître de l’affaire à la condition qu’elle soit autrement composée.
Cette exception se justifie par le fait que les crimes de guerre susceptibles d’être jugés en France sont généralement fondés sur des faits commis hors du territoire national, dans des circonstances de droit et de fait particulièrement dérogatoires au droit commun.
*
* *
La Commission examine l’amendement CL362 du Gouvernement.
Mme la rapporteure. Le présent amendement concerne la procédure dérogatoire prévue en matière de crimes contre l’humanité et de crimes de guerre, pour laquelle la cour d’assise de Paris dispose d’une spécialisation depuis la loi du 13 décembre 2011 relative à la répartition des contentieux et à l’allégement de certaines procédures juridictionnelles.
Bien que la procédure de droit commun exige que l’appel en matière criminelle soit confié à une cour d’assises autre que celle qui a jugé en première instance, il est proposé d’instituer une dérogation en permettant que la cour d’assises de Paris puisse être à nouveau désignée pour connaître de l’affaire, à la condition expresse qu’elle soit autrement composée.
Cette exception se justifie par le fait que les crimes de guerre susceptibles d’être jugés en France sont généralement fondés sur des faits commis hors du territoire national, dans des circonstances de droit et de fait particulièrement dérogatoires au droit commun. Il convient que les débats relatifs à de tels dossiers puissent être menés par des magistrats disposant d’une bonne connaissance de ces affaires. J’émets un avis favorable sur cet amendement.
M. Alain Tourret. Je suis très sceptique, madame la rapporteure : nous mettons là le doigt dans un engrenage des plus dangereux. On va commencer par les crimes de guerre, puis viendront les crimes les plus atroces, et ainsi de suite… L’un des principaux apports de la disposition prévoyant le droit d’appel des décisions d’assises, que j’ai eu à voter en 1999, était précisément le changement de lieu de ce jugement en appel. Il est en effet pratiquement impossible d’obtenir un acquittement dans un lieu identique, quand bien même le tribunal serait composé différemment. Ce n’est pas une bonne chose, je vous le dis !
Mme la rapporteure. J’entends votre observation, monsieur Tourret, mais vous aurez bien noté que la cour d’assise amenée à connaître de l’appel sera autrement composée. De plus, je rappelle que les crimes concernés – les crimes de guerre – sont caractérisés par leur rareté.
M. Alain Tourret. Reste que ces magistrats travaillent au même étage et que leurs bureaux sont voisins.
Mme la rapporteure. C’est exact, et je comprends votre attachement à la double juridiction. Je vous propose d’évoquer la question en séance car j’estime qu’elle doit faire l’objet d’un débat.
M. Alain Tourret. Ce fut l’un des grands progrès apportés par la « loi Guigou » renforçant la protection de la présomption d’innocence et les droits des victimes. Je me souviens que c’est notre collègue Houillon qui avait proposé cette disposition. Je voterai contre cet amendement.
La Commission adopte l’amendement. L’article 31 quindecies est ainsi rédigé.
Article 31 sexdecies (nouveau)
(art. 665 du code de procédure pénale)
Modification du délai d’examen des requêtes en dessaisissement
Le présent article, adopté par votre Commission à l’initiative de votre rapporteure, allonge à un mois le délai d’examen des requêtes en dessaisissement d’un parquet dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
La loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 relative à la répartition des contentieux et à l’allégement de certaines procédures juridictionnelles a modifié l’article 665 du code de procédure pénale en précisant que la requête devait être signifiée « à toutes les parties intéressées qui ont un délai de huit jours pour déposer un mémoire au greffe de la Cour de cassation ».
Or, le délai de huit jours s’avère trop court pour permettre l’instruction du dossier par le cabinet du procureur général, puis par le rapporteur et l’avocat général, de sorte que, dans la pratique, la chambre criminelle est conduite, pour respecter ce délai, à n’enregistrer la requête que lorsque la date d’audience est fixée.
En conséquence, cet article allonge à un mois le délai d’examen des requêtes en dessaisissement d’un parquet dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
Il s’agit de la reprise de l’article 26 du projet de loi portant adaptation de la procédure pénale au droit de l’Union européenne adopté par notre Assemblée, en lecture définitive, le 23 juillet 2015, que le Conseil constitutionnel avait déclaré contraire à la Constitution en raison de l’absence de lien avec le contenu du projet de loi initial (288).
*
* *
La Commission en vient à l’amendement CL335 de la rapporteure.
Mme la rapporteure. Le présent amendement, issu de la loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne (DDADUE), vise à allonger à un mois le délai d’examen des requêtes en dessaisissement d’un parquet.
La Commission adopte l’amendement. L’article 31 sexdecies est ainsi rédigé.
Article 31 septdecies (nouveau)
(art. 712–17 du code de procédure pénale)
Recours à la visio-conférence pour l’exécution des mandats délivrés par les juges d’application des peines
Le présent article est issu d’un amendement du Gouvernement adopté par votre Commission. Il complète l’article 712-17 du code de procédure pénale relatif au juge de l’application des peines en permettant le recours à la visioconférence pour l’exécution des mandats, sous la condition sine qua non d’un accord préalable de l’intéressé. Le cas échéant, l’opposition de ce dernier lui permet de bénéficier de plein droit de la procédure classique.
*
* *
La Commission examine l’amendement CL357 du Gouvernement.
Mme la rapporteure. Cet amendement du Gouvernement prévoit le recours à la visioconférence pour l’exécution des mandats délivrés par les juges d’application des peines, toujours sous la condition sine qua non d’un accord préalable de l’intéressé. Son opposition lui permet de bénéficier de plein droit de la procédure classique. Avis favorable.
La Commission adopte l’amendement. L’article 31 sepdecies est ainsi rédigé.
Article 31 octodecies (nouveau)
(art. 713–49 [nouveau] du code de procédure pénale)
Caractère exécutoire par provision des décisions mettant à exécution l’emprisonnement contre un condamné qui ne respecte pas sa peine de contrainte pénale
Le présent article, adopté par la Commission à l’initiative de votre rapporteure, prévoit le caractère exécutoire par provision des décisions mettant à exécution l’emprisonnement contre un condamné qui ne respecte pas sa peine de contrainte pénale.
Aux termes de l’article 713-47 du code de procédure pénale, en cas d’inobservation par la personne condamnée des mesures de contrôle et d’assistance, des obligations ou des interdictions qui lui sont imposées, le juge de l’application des peines peut, d’office ou sur réquisitions du procureur de la République, modifier ou compléter les obligations ou interdictions auxquelles le condamné est astreint. Le juge de l’application des peines peut également procéder à un rappel des mesures, obligations et interdictions auxquelles est astreinte la personne condamnée. Si cette solution est insuffisante pour assurer l’effectivité de la peine, le juge saisit le président du tribunal de grande instance afin que soit mis à exécution tout ou partie de l’emprisonnement encouru par le condamné en cas d’inobservation des obligations et interdictions auxquelles il est astreint.
De même, il est prévu, aux termes de l’article 713-48 du code de procédure pénale, que si le condamné commet, pendant la durée d’exécution de la contrainte pénale, un crime ou un délit de droit commun suivi d’une condamnation à une peine privative de liberté sans sursis, la juridiction de jugement peut, après avis du juge de l’application des peines, ordonner la mise à exécution de tout ou partie de l’emprisonnement encouru par le condamné en cas d’inobservation des obligations et interdictions auxquelles il est astreint.
Le présent article introduit un nouvel article 713-49 au sein du code de procédure pénale disposant que les décisions prises en application des articles 713-47 et 713-48 mettant à exécution tout ou partie de l’emprisonnement sont exécutoires par provision. Ainsi, lorsque le condamné interjettera appel contre ces décisions, son recours sera examiné dans un délai de deux mois, à défaut de quoi il sera remis en liberté s’il n’est pas détenu pour une autre cause.
*
* *
La Commission en vient à l’amendement CL336 de la rapporteure.
Mme la rapporteure. Le présent amendement prévoit le caractère exécutoire par provision des décisions d’emprisonnement contre un condamné qui ne respecte pas sa peine de contrainte pénale. Cette mesure de simplification tire les conséquences du mauvais comportement de la personne intéressée.
La Commission adopte l’amendement. L’article 31 octodecies est ainsi rédigé.
TITRE III
DISPOSITIONS DIVERSES
Le présent titre se compose de trois chapitres. Chacun d’entre eux comprend un unique article :
– au chapitre Ier, l’article 32 encadre l’usage par les forces de l’ordre de caméras individuelles portées sur les uniformes, ou « caméras piéton », destinées à enregistrer les interventions et à fournir des preuves utilisables dans le cadre de la procédure pénale. Le Gouvernement avait initialement envisagé d’inscrire ce dispositif au sein du titre Ier du projet de loi mais, le Conseil d’État ayant constaté l’absence de lien spécifique avec la lutte contre le crime organisé et le terrorisme, et recommandant en conséquence son déplacement, il figure finalement dans le titre III ;
– au chapitre II, l’article 33 habilite le Gouvernement à prendre des ordonnances à fin de transposition en droit interne des directives européennes et de mise en conformité de la législation avec la jurisprudence du Conseil constitutionnel ;
– au chapitre III, l’article 34 prescrit l’application des dispositions du projet de loi sur les territoires ultramarins.
Considérant les modifications profondes apportées au projet de loi par la commission des Lois, votre rapporteure a présenté des amendements pour donner au titre III une nouvelle architecture :
– avant le chapitre Ier, un nouveau chapitre Ier A rassemble les « Dispositions relatives aux peines » consécutives à l’adoption de quatre amendements portant article additionnel avant l’article 32 concernant le titre III du livre Ier du code pénal ;
– l’intitulé du chapitre Ier a été modifié de façon à substituer à l’expression « caméras piétons », qui n’est pas comprise en dehors des milieux professionnels du maintien de l’ordre public, et qui s’avère de surcroît fausse puisque les policiers équipés ne sont pas forcément piétons mais peuvent fort bien se trouver à bord d’un véhicule quelconque, par l’expression plus explicite et plus juste de « caméras mobiles » ;
– le chapitre II est demeuré inchangé ;
– le chapitre III, enrichi d’une disposition proposée par le Gouvernement pour la création d’un service pénitentiaire d’insertion et de probation à Saint-Pierre-et-Miquelon, est intitulé « Dispositions relatives aux outre-mer ».
Chapitre Ier A (nouveau)
Dispositions relatives aux peines
La Commission adopte l’amendement CL365, de cohérence, présenté par la rapporteure. Le chapitre Ier A, « Dispositions relatives aux peines », est ainsi créé.
La Commission examine l’amendement CL213 de M. Jean-Pierre Blazy.
M. Jean-Pierre Blazy. N’étant plus membre de la commission des Lois, je tiens au préalable à préciser que j’aurais voté sans hésitation de nombreux amendements défendus par la rapporteure ou par vous-même, monsieur le président : en effet, ils améliorent le texte.
Les cinq amendements que je présente sont inspirés du rapport que j’ai remis en 2014 à la Commission en conclusion des travaux de la mission d’information sur la lutte contre l’insécurité sur tout le territoire. Ses préconisations sur la nécessité de contraventionnaliser bien davantage que nous ne le faisons afin d’être plus efficaces dans la prise de sanctions et de désengorger les tribunaux avaient fait consensus aussi bien à l’Assemblée nationale que parmi les policiers, les gendarmes et les magistrats.
L’amendement CL213 concerne l’occupation illicite des parties communes des immeubles contre laquelle nous sommes très peu efficaces depuis l’entrée en vigueur de la loi de 2003 pour la sécurité intérieure. La contraventionnalisation de l’infraction, en responsabilisant policiers et gendarmes, permettrait de mieux répondre aux attentes de nos concitoyens désireux qu’une sanction proportionnée soit prononcée. C’est pourquoi je propose de remplacer la réponse pénale en vigueur par une contravention de 750 euros.
Mme la rapporteure. Monsieur Blazy, votre proposition tenant à contraventionnaliser l’occupation des parties communes d’immeubles mériterait d’être discutée avec le ministère de l’Intérieur autant qu’avec le ministère de la Justice. En effet, même si le texte prévoit quelques nouvelles infractions, il vise avant tout, ainsi que le précise son intitulé, à renforcer la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et à améliorer l’efficacité et les garanties de la procédure pénale. Aussi, en l’état, et si l’on s’en réfère à la jurisprudence du Conseil constitutionnel, je crains que cet amendement ne s’apparente à un cavalier législatif. Je donnerai donc un avis défavorable si vous ne le retirez pas. Reste, j’y insiste, que je comprends vos préoccupations.
M. Jean-Pierre Blazy. Je suis évidemment d’accord pour que nous en discutions avec le Gouvernement, mais je rappelle qu’au cours des auditions préliminaires à la préparation du texte, les gendarmes entendus se sont montrés tout à fait favorables au principe de la contraventionnalisation, confirmant par-là, d’ailleurs, la teneur des auditions réalisées par la mission d’information que j’ai présidée.
Nous partageons le souci de désencombrer les tribunaux, souci auquel j’ajoute la nécessité de réellement sanctionner et de façon proportionnée les infractions en question, afin, je le répète, de vraiment répondre aux attentes des habitants.
Je ne pense pas que les amendements que je présente, qui visent avant tout à simplifier le droit en vigueur, soient des cavaliers législatifs.
M. le président Dominique Raimbourg. Je suis favorable à votre démarche de contraventionnalisation, monsieur Blazy : elle garantit une plus grande efficacité de la réponse pénale. Cette rapidité nous est demandée par les policiers et les gendarmes qui se heurtent à une incompréhension de l’opinion publique, qui craint qu’ainsi nous n’affaiblissions la réponse, alors que c’est précisément l’inverse.
Cependant, je comprends les objections de la rapporteure et je me range à son avis. Je souhaite que nous menions ce débat en séance publique en l’élargissant à la question de la circulation routière. Nous devons ruiner les fantasmes à cause desquels l’opinion publique croit que la contraventionnalisation est une réponse plus faible alors que dans les faits, j’y insiste, elle la rend au contraire plus efficace.
M. Jean-Pierre Blazy. Si nous sommes un certain nombre à défendre ce principe, je suis prêt à retirer mes amendements pour les redéposer en séance.
Mme Élisabeth Pochon. Nous vous soutiendrons !
Mme Françoise Descamps-Crosnier. Ayant participé à la mission d’information présidée par M. Blazy sur la lutte contre l’insécurité sur tout le territoire, je suis tout à fait favorable à la contraventionnalisation qui n’est pas, vous l’avez bien dit, monsieur le président, une moindre peine.
Mme la rapporteure. Nous sommes très nombreux à partager les préoccupations de M. Blazy. Reste que certaines dispositions proposées touchent au code de la route ; or vous savez combien la sécurité routière est un sujet sensible.
Je vous invite donc, à ce stade, à retirer vos amendements afin que nous les examinions avec le Gouvernement. Le but est d’améliorer la réponse pénale tout en désengorgeant nos juridictions.
M. Jean-Pierre Blazy. Je retire mes amendements, monsieur le président, fort de votre engagement qu’ils seront défendus en séance.
M. le président Dominique Raimbourg. Je suppose que la rapporteure donnera à certains d’entre eux un avis favorable dans le cadre de l’article 88 du Règlement.
L’amendement est retiré.
Article 32 A (nouveau)
(art. 131–5–1 du code pénal)
Ouverture de la possibilité d’une prescription d’un stage de citoyenneté en l’absence du prévenu
L’article 131-5-1 du code pénal prévoit que, lorsqu’un délit est puni d’une peine d’emprisonnement, la juridiction peut prescrire, à la place de l’emprisonnement, que le condamné devra accomplir un stage de citoyenneté.
Le présent article, introduit par la Commission à l’initiative de votre rapporteure, vise à offrir cette possibilité même en l’absence du prévenu dès lors que celui-ci a donné un accord écrit et qu’il est représenté à l’audience par un avocat.
Il s’agit de la reprise de l’article 15 du projet de loi portant adaptation de la procédure pénale au droit de l’Union européenne adopté par notre Assemblée, en lecture définitive, le 23 juillet 2015, que le Conseil constitutionnel avait déclaré contraire à la Constitution en raison de l’absence de lien avec le contenu du projet de loi initial (289).
*
* *
La Commission examine l’amendement CL324 de la rapporteure.
Mme la rapporteure. Le présent amendement vise à permettre aux juridictions de prescrire un stage de citoyenneté alternatif à l’emprisonnement même si le prévenu ne comparaît pas, dès lors qu’il est représenté à l’audience par son avocat et qu’il a préalablement donné son accord écrit.
La Commission adopte l’amendement. L’article 32 A est ainsi rédigé.
Article 32 B (nouveau)
(art. 131–8 du code pénal)
Ouverture de la possibilité d’une prescription d’un travail d’intérêt général en l’absence du prévenu
L’article 131-8 du code pénal prévoit que, lorsqu’un délit est puni d’une peine d’emprisonnement, la juridiction peut prescrire, à la place de l’emprisonnement, que le condamné accomplira un travail d’intérêt général.
Le présent article, introduit par la Commission à l’initiative de votre rapporteure, vise à offrir cette possibilité même en l’absence du prévenu dès lors que celui-ci a donné un accord écrit et qu’il est représenté à l’audience par un avocat.
Il s’agit de la reprise de l’article 16 du projet de loi portant adaptation de la procédure pénale au droit de l’Union européenne adopté par notre Assemblée, en lecture définitive, le 23 juillet 2015, que le Conseil constitutionnel avait déclaré contraire à la Constitution en raison de l’absence de lien avec le contenu du projet de loi initial (290).
*
* *
La Commission en vient à l’amendement CL323 de la rapporteure.
Mme la rapporteure. Cet amendement est similaire au précédent, mais envisage pour sa part que le substitut à l’emprisonnement soit la peine de travaux d’intérêt général.
La Commission adopte l’amendement. L’article 32 B est ainsi rédigé.
Article 32 C (nouveau)
(art. 131–35–2 [nouveau] du code pénal)
Limitation du coût du stage à la charge du condamné au montant de l’amende de troisième classe
Le présent article crée un nouvel article 131–35–2 du code pénal plafonnant le coût du stage auquel peut être condamné un prévenu au montant de l’amende encourue pour les contraventions de la troisième classe, soit 68 euros dans sa forme simple et 180 euros dans sa forme majorée.
Il s’agit de la reprise de l’article 20 du projet de loi portant adaptation de la procédure pénale au droit de l’Union européenne adopté par notre Assemblée, en lecture définitive, le 23 juillet 2015, que le Conseil constitutionnel avait déclaré contraire à la Constitution en raison de l’absence de lien avec le contenu du projet de loi initial (291).
*
* *
La Commission examine l’amendement CL226 du Gouvernement.
Mme la rapporteure. Cet amendement vise à plafonner le coût du stage auquel peut être condamné un prévenu au montant de l’amende encourue pour les contraventions de la troisième classe, soit 68 euros dans sa forme simple et 180 euros dans sa forme majorée. J’y suis favorable.
La Commission adopte l’amendement. L’article 32 C est ainsi rédigé.
Article 32 D (nouveau)
(art. 132–54 du code pénal)
Ouverture de la possibilité de prononcer un sursis assorti de l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général en l’absence du prévenu
L’article 132-54 du code pénal permet à la juridiction de prononcer un sursis assorti de l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général. Le présent article vise à offrir cette possibilité même en l’absence du prévenu dès lors que celui-ci a donné un accord écrit et qu’il est représenté à l’audience par un avocat.
Il s’agit de la reprise de l’article 17 du projet de loi portant adaptation de la procédure pénale au droit de l’Union européenne adopté par notre Assemblée, en lecture définitive, le 23 juillet 2015, que le Conseil constitutionnel avait déclaré contraire à la Constitution en raison de l’absence de lien avec le contenu du projet de loi initial (292).
*
* *
La Commission en vient à l’amendement CL326 de la rapporteure.
Mme la rapporteure. Cet amendement vise à permettre à la juridiction d’assortir la peine de travaux d’intérêt général d’un sursis lorsque le prévenu, bien qu’absent, a formulé son accord écrit et se trouve représenté par son avocat.
M. Alain Tourret. Très bien !
La Commission adopte l’amendement. L’article 32 D est ainsi rédigé.
La Commission examine l’amendement CL366 de la rapporteure.
Mme la rapporteure. Il s’agit de substituer l’expression de « caméra mobile », bien plus évocatrice – elle fait penser aux téléphones mobiles –, à l’expression « caméra piéton », beaucoup moins parlante pour nos concitoyens, d’autant que leurs utilisateurs ne seront pas forcément piétons…
La Commission adopte l’amendement. L’intitulé du chapitre Ier est ainsi modifié.
Article 32
(art. L. 241-1 [nouveau] du code de la sécurité intérieure)
Caméras mobiles
1. L’état du droit
Le cadre juridique de la vidéoprotection, codifié aux articles L. 251-1 et suivants du code de la sécurité intérieure, est issu de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité. Il prévoit que la transmission et l’enregistrement d’images prises sur la voie publique par le moyen de la vidéoprotection peuvent être mis en œuvre par les autorités publiques compétentes aux fins d’assurer :
– la protection des bâtiments et installations publics et de leurs abords ;
– la sauvegarde des installations utiles à la défense nationale ;
– la régulation des flux de transport ;
– la constatation des infractions aux règles de la circulation ;
– la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens ainsi que des fraudes douanières ;
– la prévention d’actes de terrorisme ;
– la prévention des risques naturels ou technologiques ;
– le secours aux personnes et la défense contre l’incendie ;
– la sécurité des installations accueillant du public dans les parcs d’attractions.
Les commerçants peuvent également être autorisés à employer un système de vidéoprotection sur la voie publique afin d’assurer la protection des abords immédiats de leurs bâtiments.
La vidéoprotection est autorisée par le représentant de l’État dans le département, après avis consultatif de la commission départementale de la vidéoprotection (293). L’autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans renouvelable.
Les enregistrements utilisés dans des traitements automatisés, ou contenus dans des fichiers structurés selon des critères permettant d’identifier directement ou indirectement des personnes physiques, sont soumis à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Leur conservation ne peut excéder un mois.
En revanche, la loi n’autorise pas l’enregistrement d’images prises dans des lieux privés. L’article L. 251-3 du code de la sécurité intérieure interdit que les opérations de vidéoprotection de la voie publique conduisent à la visualisation des images de l’intérieur des immeubles d’habitation, ni de façon spécifique, leurs entrées. La captation d’images dans un lieu privé sans le consentement des personnes est réprimée d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende (294).
b. L’expérimentation et la décision de généralisation des caméras piétons
L’utilisation de caméras individuelles portées sur les uniformes, dites « caméras piétons », a fait l’objet d’une expérimentation par les agents de la police nationale et par les militaires de la gendarmerie nationale à compter de 2013. Le bilan dressé de l’opération est positif : la sécurisation des interventions des agents et des militaires s’est doublée d’une amélioration inattendue des conditions d’intervention auprès de la population. Les forces de l’ordre ont constaté l’effet modérateur du dispositif, dont le déclenchement ostensible incite au calme et à la maîtrise de soi. La population s’est rapidement habituée à la présence de la caméra, ne cherchant pas à se dissimuler ou à se positionner hors-champ.
En conséquence, le Premier ministre a annoncé, le 26 octobre 2015, la généralisation du dispositif à toutes les patrouilles et unités de police et de gendarmerie en intervention opérationnelle (295).
Le cadre juridique applicable à la vidéoprotection ne saurait cependant convenir aux caméras piétons. Celles-ci ont vocation à servir dans tous les lieux accessibles aux forces de l’ordre, y compris des lieux privés, et non à se limiter à la voie publique et aux établissements recevant du public. Elles filment des unités en intervention, donc probablement mobiles, et non un site déterminé depuis une position fixe. Par ailleurs, elles procèdent à la captation des sons et non des seules images comme les équipements installés sur la voie publique. Enfin, dans l’expérimentation qui a précédé la décision de généralisation, elles fonctionnent de manière ponctuelle, lorsque l’agent de police ou le militaire de gendarmerie le décide, et non de façon continue. Les enjeux relatifs à la protection de la vie privée que présente la réglementation de la vidéoprotection sont donc extrêmement minorés dans l’utilisation des caméras piétons. Le dispositif est conçu pour offrir une garantie, tant aux agents de la police nationale et aux militaires de la gendarmerie nationale qu’aux personnes contrôlées ou appréhendées, quant aux conditions de déroulement des opérations. Enfin, les caméras piétons représentent un outil utile pour l’identification des personnes mises en cause et permettent d’accréditer les propos des policiers lors des interpellations, notamment pour les faits d’outrage et rébellion.
Le régime de l’autorisation administrative préalable délivrée installation par installation par l’autorité préfectorale est donc inadapté aux caméras individuelles.
Une définition du régime des caméras piétons a été adoptée par le Sénat à l’occasion de l’examen de la proposition de loi relative à la prévention et à la lutte contre les incivilités, contre les atteintes à la sécurité publique et contre les actes terroristes dans les transports collectifs de voyageurs, déposée par M. Gilles Savary et plusieurs de ses collègues devant l’Assemblée nationale le 7 octobre 2015 (n° 3109). L’article 1er ter de ce texte, adopté par la commission mixte paritaire, régit l’usage des enregistreurs individuels par les personnels de sûreté des entreprises de transport public selon des modalités comparables à celles prévues par le présent projet de loi.
Un cadre juridique spécifique doit être défini, qui ne peut relever que de la loi pour une conciliation efficace des objectifs poursuivis et des droits et libertés des personnes enregistrées.
L’enregistrement des images et des paroles des personnes filmées ainsi que la conservation de données à caractère personnel, qui se rapportent à des individus identifiés ou identifiables, est de nature à constituer une ingérence dans la vie privée. L’article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958 réserve au législateur la compétence pour fixer les règles relatives aux « garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques ». Le Conseil constitutionnel juge que, parmi les libertés proclamées à l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, figure le droit au respect de la vie privée et que « la collecte, l’enregistrement, la conservation, la consultation et la communication de données à caractère personnel doivent être justifiés par un motif d’intérêt général et mis en œuvre de manière adéquate et proportionnée à cet objectif » (296).
L’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 n’admet l’ingérence d’une « autorité publique » dans l’exercice du droit au respect de la vie privée et familiale, du domicile et de la correspondance qu’à la double condition que celle-ci soit prévue par la loi et constitue une mesure « nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». La Cour européenne des droits de l’homme juge ainsi que le simple fait de mémoriser des données relatives à la vie privée d’un individu constitue une ingérence au sens de l’article 8 (297). Le droit à l’image participe de la notion de vie privée (298).
Par ailleurs, comme il peut être utilisé comme un moyen d’aider à la répression des incidents et de constater des infractions par la collecte de preuves, l’enregistrement issu des caméras piétons s’inscrit dans la procédure pénale, que l’article 34 de la Constitution place également dans le domaine de la loi.
Enfin, le Conseil constitutionnel juge de manière constante que « la prévention d’atteintes à l’ordre public, notamment d’atteintes à la sécurité des personnes et des biens, et la recherche des auteurs d’infractions, sont nécessaires à la sauvegarde de principes et droits à valeur constitutionnelle » et qu’il « appartient au législateur d’assurer la conciliation entre ces objectifs de valeur constitutionnelle et l’exercice des libertés publiques constitutionnellement garanties » au nombre desquelles figurent la liberté individuelle, le droit au respect de la vie privée ainsi que l’inviolabilité du domicile (299).
L’article 32 insère au sein du code de la sécurité intérieure un titre dédié au régime des caméras piétons. Il se compose d’un unique article L. 241-1 qui réserve l’usage des caméras piétons aux seules forces de police nationale et de gendarmerie nationale dans l’exercice de leurs missions de prévention des atteintes à l’ordre public, de protection de la sécurité des personnes et des biens et de police judiciaire. Les agents peuvent y procéder en tous lieux, y compris privés, en fonction des circonstances de l’intervention et du comportement des personnes concernées (alinéa 5).
Quatre finalités sont expressément définies à l’alinéa 7 : prévenir les incidents au cours des interventions, constater les infractions et aider à leur répression par la collecte de preuves, assurer le respect de leurs obligations déontologiques et statutaires par les agents et militaires, et enfin servir de matériel pédagogique dans les écoles de police et de gendarmerie.
Les alinéas 6 et 8 encadrent l’usage des caméras piétons afin de concilier les droits des personnes avec l’efficacité de l’action des forces de l’ordre. Ainsi l’enregistrement n’est-il ni permanent ni même automatique en cas d’intervention, laissé à la discrétion de l’agent équipé. Les caméras individuelles sont portées de manière apparente et comportent un témoin visuel d’enregistrement afin que soient averties les personnes enregistrées. En outre, une information générale sur ces équipements est délivrée par le ministère de l’Intérieur tandis que la personne enregistrée est préalablement prévenue du déclenchement de l’enregistrement, sauf si les circonstances y font obstacle. Enfin, pour éviter tout risque de falsification, les personnels auxquels les caméras sont fournies ne peuvent accéder directement aux enregistrements.
Quant aux alinéas 9 et 10, ils établissent des règles de protection de la vie privée traditionnelles en matière de captation d’images. La durée de conservation des enregistrements est limitée à six mois, sous réserve de leur utilisation dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, comme dans le régime susmentionné de la vidéoprotection. Les modalités d’application du dispositif et d’utilisation des données collectées sont précisées par décret en Conseil d’État, pris après consultation de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, conformément aux règles générales édictées par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés (300).
3. Les modifications opérées par votre commission des Lois
Outre des modifications rédactionnelles, la commission des Lois a adopté deux amendements :
– l’un, présenté par la rapporteure, qui désigne l’équipement « caméra mobile » en cohérence avec la modification effectuée dans l’intitulé du chapitre Ier ;
– l’autre, présenté par Mme Élisabeth Pochon et les membres du groupe Socialiste, républicain et citoyen, qui prévoit un déclenchement des enregistrements à la demande des personnes concernées par les interventions des forces de l’ordre.
Le fait que l’agent de police ou le militaire de gendarmerie ait seul la capacité de décider ce qu’il convient de filmer et ce qui ne doit pas l’être a été jugé problématique, dans la mesure où tout incident se produisant la caméra éteinte ferait immanquablement planer un soupçon sur le comportement des équipes de sécurité. À l’inverse, l’option d’un enregistrement permanent a été résolument écartée : les policiers et les gendarmes n’ont pas à être les seuls professionnels dont tous les faits et gestes seraient sous le regard de la caméra dans la perspective d’une sanction disciplinaire. En conséquence, la Commission a adopté une rédaction équilibrée, permettant l’enregistrement à l’initiative de l’agent comme à l’initiative de la personne faisant l’objet du contrôle. Il reviendra au Gouvernement, en séance publique, d’apporter des précisions quant au fonctionnement exact du dispositif et aux leçons tirées de la phase d’expérimentation.
* *
La Commission adopte l’amendement rédactionnel CL341 de la rapporteure.
Puis elle en vient à l’amendement CL153 de Mme Élisabeth Pochon.
Mme Élisabeth Pochon. Le présent amendement porte sur les caméras piétons qui donc, désormais, devraient s’appeler les caméras mobiles. Il semble nécessaire que l’enregistrement audiovisuel des interventions des policiers et des gendarmes puisse être déclenché également à la demande des individus concernés. Un premier bilan de l’utilisation de ces caméras a montré qu’elle avait favorisé une pacification des rapports entre les forces de l’ordre et la population.
Mme la rapporteure. Vous avez tout à fait raison, madame Pochon : il n’est pas bon pour le dispositif que l’agent de police ou le militaire de gendarmerie ait totalement la main sur son déclenchement. Si un incident se produit alors que la caméra est éteinte, on en retirera immanquablement un soupçon à l’encontre du fonctionnaire et un doute sur sa version des faits. Quant à la solution d’un enregistrement permanent, elle n’est même pas envisageable.
Nous allons travailler de nouveau sur le sujet en séance car certaines questions de procédure peuvent se poser. En l’état, je donne un avis favorable à l’amendement et vous invite, chers collègues, à le voter afin que le Gouvernement nous indique de quelle manière il entend sécuriser ce procédé – tout de même destiné, il faut le rappeler, à améliorer les conditions d’exercice de leur activité des policiers et à constituer une preuve en cas de difficulté.
Mme Élisabeth Pochon. Nous sommes attachés à la sécurisation des contrôles d’identité et je me demande si le déclenchement de l’enregistrement audiovisuel ne devrait pas, dans cette circonstance, être obligatoire. Je déposerai sans doute, au nom de mon groupe, un amendement en ce sens.
Mme la rapporteure. Je souhaite un débat en séance afin que le Gouvernement nous fasse part de sa position.
La Commission adopte l’amendement.
Elle adopte ensuite successivement les amendements rédactionnels CL342 et CL343 de la rapporteure.
Puis elle en vient à l’amendement CL115 de M. Lionel Tardy.
M. Lionel Tardy. La proposition de loi relative à la prévention et à la lutte contre les incivilités, contre les atteintes à la sécurité publique et contre les actes terroristes dans les transports collectifs de voyageurs, a fait l’objet d’un accord en commission mixte paritaire et devrait être adoptée définitivement dans trois semaines. Elle prévoit déjà une expérimentation des caméras piétons par les agents de la SNCF et de la RATP, le ministère de l’Écologie organisant une campagne d’information générale sur l’utilisation de ce matériel.
Or l’article que nous sommes en train d’examiner ne prévoit pas d’expérimentation mais bien l’organisation par le ministère de l’Intérieur, cette fois, d’une campagne d’information générale des citoyens. Les modalités d’utilisation de la caméra piéton étant sensiblement les mêmes dans les deux textes, il serait judicieux de prévoir une campagne commune au Gouvernement pour des raisons budgétaires évidentes mais aussi d’efficacité.
J’en profite pour souligner que, sans préjuger de l’efficacité de ces fameuses caméras, elles ont un coût non négligeable – de l’ordre de 1 200 euros l’unité – ; or nos policiers manquent déjà d’équipements basiques comme ils le font valoir depuis plusieurs mois maintenant.
Mme la rapporteure. L’organisation d’une campagne d’information commune ne me paraît pas relever de la loi, mais plutôt du domaine réglementaire. À ce titre, j’émets un avis défavorable.
La Commission rejette l’amendement.
Puis elle adopte l’article 32 modifié.
La Commission examine l’amendement CL79 de Mme Françoise Descamps-Crosnier.
Mme Françoise Descamps-Crosnier. Le présent amendement envisage l’extension de l’utilisation de la caméra piéton – devenue caméra mobile – à la police municipale à titre expérimental dans les zones de sécurité prioritaire. L’autorisation serait évidemment subordonnée à la demande préalable du maire et à l’existence d’une convention de coordination. Ce dispositif, facultatif, conduirait les agents des polices municipales à respecter les mêmes obligations que celles prévues par le projet de loi pour les agents de la police nationale et les gendarmes.
Vous avez souligné, madame la rapporteure, que cet équipement améliorait les conditions d’exercice de leur activité par les agents de la police nationale. Il serait, de la même manière, protecteur pour le policier municipal autant que pour le citoyen.
Mme la rapporteure. Vous demandez que l’utilisation de la « camob’», qui va équiper nos policiers nationaux et nos gendarmes, soit étendue aux policiers municipaux. Je comprends le sens de votre amendement mais j’émets à son encontre un avis défavorable.
Pour commencer, le coût qu’un tel équipement des policiers municipaux ferait peser sur les finances des communes représenterait une charge importante. Ensuite, ce dispositif ne paraît pas correspondre à la philosophie de la police municipale dont je ne pense pas qu’elle souhaite vraiment être pourvue de caméras mobiles. Je rappelle que la police municipale n’a pas vocation à remplacer la police nationale dont elle n’est pas, par ailleurs, un équivalent : elle n’est pas du tout chargée des mêmes missions, qu’il s’agisse de l’ordre public ou des investigations ; elle n’a pas vocation non plus à intervenir sur les points chauds, à procéder à des interpellations ni à effectuer des contrôles d’identité, hormis dans le contexte d’une infraction routière dont elle est directement témoin.
Le moment ne me paraît pas venu d’équiper les polices municipales de caméras mobiles. Du reste, pour en avoir parlé avec des policiers municipaux dans ma circonscription, je ne crois pas qu’elles le demandent. Elles veulent avant tout une formation continue, une claire définition de leurs missions.
Mieux vaut voir comment se passe cette généralisation à l’ensemble des fonctionnaires de la police nationale et des gendarmes avant de vouloir décalquer le dispositif à l’échelon de la police municipale.
Vous pourriez me faire valoir – je devance l’argument – que nous prévoyons d’équiper les agents de sûreté dans les transports publics : vous conviendrez avec moi qu’il s’agit d’espaces où les incivilités sont fréquentes et où le contrôleur est susceptible de se trouver isolé.
La police municipale n’a pas toujours un travail facile, je le reconnais, mais ses missions relèvent avant tout de la prévention et son rôle, ne l’oublions pas, est de faire respecter les arrêtés municipaux.
La Commission rejette l’amendement CL79.
Chapitre II
Habilitation à légiférer par ordonnances
Article 33
Habilitation à légiférer par ordonnances
Conformément à l’article 38 de la Constitution, l’article 33 du projet de loi sollicite du Parlement une habilitation du Gouvernement à procéder par ordonnances pour, d’une part, transposer en droit interne des dispositions contenues dans des directives communautaires, et, d’autre part, modifier la législation afin d’assurer le respect de décisions récentes du Conseil constitutionnel (I et II).
Le III fixe à six mois à compter de la promulgation de la loi le délai dont dispose le Gouvernement pour prendre les ordonnances. Le IV précise qu’un projet de loi de ratification devra être déposé devant le Parlement dans un délai de quatre mois à compter de leur publication.
1. La mise en conformité du droit français avec le droit européen
a. Le « paquet anti-blanchiment et financement du terrorisme »
Précédemment régies par la directive n° 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, dite « 3ème directive anti-blanchiment et financement du terrorisme » (301), et par le règlement n° 1781/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 novembre 2006 relatif aux informations concernant le donneur d’ordres accompagnant les virements de fonds, les orientations européennes en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme ont été redéfinies en 2015. Les modifications opérées comblent les failles identifiées dans l’architecture précédente et s’inspirent notamment des recommandations présentées en février 2012 par le Groupe d’action financière (GAFI) (302).
Au terme d’une procédure d’élaboration au cours de laquelle la France a plaidé avec constance pour une réforme ambitieuse et des exigences renforcées (303), un « paquet » a été adopté le 20 mai 2015 et publié le 5 juin suivant. Il se compose de deux textes : la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 – dite « 4ème directive anti-blanchiment et financement du terrorisme » – et le règlement (UE) 2015/847 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 sur les informations accompagnant les transferts de fonds.
L’article 67 de la directive prescrit aux États d’adopter les mesures de transposition nécessaires au plus tard le 26 juin 2017. Les 1° et 3° du I habilitent le Gouvernement à prendre une ordonnance à fin de mise en conformité du droit français avec ces nouvelles dispositions.
i. Les dispositions de la « 4ème directive anti-blanchiment »
La « 4ème directive » procède à un approfondissement des dispositifs et du périmètre prévus par la précédente. Le seuil au-delà duquel les paiements en espèces sont surveillés est abaissé de quinze mille à dix mille euros. L’ensemble du secteur des jeux d’argent et de hasard fait l’objet d’une vigilance au-delà de 2000 euros de gain ou de mise, et non plus les seuls casinos. Les personnes politiquement exposées à l’égard desquelles sont appliquées des mesures de vigilance renforcée sont définies quel que soit leur lieu de résidence (304).
Aux termes de l’article 7, une évaluation des risques permet d’identifier les fragilités organisationnelles et d’apporter les réponses adaptées. Les entités assujetties à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (305) adaptent en conséquence leurs mesures de vigilance à l’égard de leurs clients. Elle est diligentée par chaque État membre mais aussi, dans le cadre d’une « analyse supranationale des risques », par la Commission européenne pour cartographier les faiblesses à l’échelle de l’Union européenne.
Les mesures de vigilance auxquelles sont astreintes les entités assujetties comprennent des mesures d’identification du client, l’obtention d’informations sur l’objet et la nature de la relation d’affaires, et l’exercice d’un contrôle continu de celle-ci. Elles sont modulées en fonction des risques identifiés. Une vigilance renforcée est notamment ordonnée pour les opérations en lien avec des « États et territoires non coopératifs (306) » ainsi que dans le cadre d’opérations de correspondance bancaire en lien avec les établissements clients d’État tiers et pour les opérations avec des personnes politiquement exposées. Par ailleurs, l’indépendance opérationnelle et l’autonomie des cellules de renseignement financier (307) sont renforcées conformément aux standards du GAFI.
En l’état du droit, l’identification des bénéficiaires effectifs des personnes morales et des trusts repose sur les organismes assujettis. La « 4ème directive » prévoit un accès à l’information centralisé et ouvert aux tiers sous réserve d’un intérêt légitime – autorités et cellules de renseignement financier, mais aussi journalistes et organisations non-gouvernementales. Un accès entièrement public est possible si les États-membres le souhaitent.
La « 4ème directive » prévoit un encadrement plus strict de la monnaie électronique anonyme, c’est-à-dire des cartes de crédit prépayées. Les mesures de vigilance – dont la vérification d’identité – peuvent être levées si plusieurs conditions sont remplies : cartes non rechargeables ou plafonnées à 250 euros de transactions par mois dans un seul État Membre, montant maximum stocké limité à 250 euros (ou 500 euros si la carte est utilisable dans un seul État Membre), rechargement par des procédures nominatives. De plus, le remboursement en espèces d’une carte prépayée est soumis à vérification d’identité à partir de 100 euros.
En matière de supervision et de contrôle, la directive privilégie une « approche par les risques ». L’intensité et la fréquence de la surveillance sont définies au regard du profil de risque. Pour ce qui concerne les groupes, une supervision consolidée confère des pouvoirs spécifiques dans le contrôle de l’entité-mère si la législation d’un pays tiers ne permet pas une surveillance efficace des activités des filiales qui y sont implantées ; elle peut aller jusqu’à l’injonction de mettre fin à des relations d’affaires ou de renoncer à une implantation dans ledit pays.
Afin de mettre fin à des pratiques divergentes au sein de l’Union, les sanctions sont harmonisées en répression d’une violation « sérieuse, répétées ou systématique » par les entités assujetties des obligations de vigilance à l’égard de la clientèle, de déclaration de soupçon, de conservation des données et des dispositions relatives au contrôle interne. L’amende administrative ou pénale encourue par un établissement de crédit ou un établissement financier ne saurait être inférieure à cinq millions d’euros ou, pour les personnes morales, à 10 % du chiffre d’affaires annuel. Le plancher est fixé à un million d’euros pour les autres entités assujetties.
ii. Le règlement sur les informations accompagnant les transferts de fonds
Le règlement du 20 mai 2015 met le droit européen en conformité avec les standards du GAFI. Il comporte deux évolutions majeures imposées aux prestataires de services de paiements :
– une obligation d’information sur le bénéficiaire en supplément de celle sur le donneur d’ordres prévue par les dispositions précédentes ;
– une vérification de l’identité des clients, donneur d’ordres et bénéficiaire, pour toute transmission de fonds alors que le règlement actuel prévoit un seuil de minimis de mille euros.
iii. Les modifications de la loi nécessaires à la transposition
La transposition de la directive implique une modernisation des dispositions nationales relatives à la vigilance dans le domaine de l’assurance, sur les personnes politiquement exposées et la monnaie électronique anonyme – ce dernier point figurant à l’article 13 du projet de loi. Le renforcement de la réglementation des paiements en espèces et des jeux ainsi que la création des registres centralisés des bénéficiaires effectifs des personnes morales et des trusts nécessiteront des modifications substantielles du code monétaire et financier.
Les prescriptions relatives à l’analyse des risques sont globalement satisfaites par la législation française. S’agissant du volet national, cette analyse est confiée au Conseil d’orientation de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (308), enceinte réunissant services de l’État et autorités de contrôle. Il conviendra uniquement de prévoir une coordination de ses travaux avec ceux de la Commission européenne à l’échelle continentale.
En ce qui concerne TRACFIN, la cellule française de renseignement financier est largement conforme aux dispositions de la « 4ème directive ». Il conviendra toutefois de consacrer son indépendance opérationnelle et d’encadrer les échanges d’information avec les cellules des autres États membres.
En ce qui concerne les dispositions relatives à la supervision, la législation nationale pourrait être opportunément revue en profondeur, notamment en ce qui concerne les pouvoirs de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) et les sanctions qu’elle est en mesure de prononcer (309).
Enfin, aucune évolution n’est nécessaire pour l’application des dispositions concernant les vérifications d’identité, déjà requises dès le premier euro pour les transmissions de fonds effectuées par des établissements financiers vis-à-vis d’un client occasionnel (310).
b. Le gel et la confiscation des instruments et des produits du crime
La directive 2014/42/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant le gel et la confiscation des instruments et des produits du crime dans l’Union européenne devait être transposée avant le 4 octobre 2015 (311). La France accuse donc déjà un retard de plusieurs mois dans l’adaptation de sa législation. Le a) du 3° du II habilite le Gouvernement à mettre par ordonnance le droit français en conformité avec ces nouvelles dispositions.
La directive vise à harmoniser les procédures de saisie et de confiscation des produits du crime au sein de l’Union européenne. Elle précise le champ d’application et l’étendue des pouvoirs de gel et de confiscation des avoirs tout en instaurant des garanties procédurales à l’égard des personnes concernées.
Il s’agit d’un domaine dans lequel la législation française a été significativement renforcée au cours des dernières années, notamment avec l’adoption de la loi n° 2010-768 du 9 juillet 2010 visant à faciliter la saisie et la confiscation en matière pénale (312), texte à l’origine de la création de l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC). Ainsi le droit français est-il déjà largement conforme aux prescriptions européennes.
L’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués
Établissement public administratif placé sous la double tutelle des ministères de la Justice et du Budget, l’Agence est dirigée par un magistrat de l’ordre judiciaire. Elle est composée de vingt-cinq agents provenant des ministères de la Justice, de l’Intérieur et du Budget. Les articles 706-159 à 706-164 du code de procédure pénale, précisés par les articles R. 54-1 et suivants du même code, prévoient ses modalités de fonctionnement.
Ayant pour rôle d’améliorer le traitement judiciaire des saisies et des confiscations en matière pénale, l’Agence a pour mission, outre son rôle général d’aide, de conseil et d’orientation donnés aux magistrats en matière de saisies et de confiscations :
– d’assurer la gestion centralisée, sur un compte qu’elle a ouvert à la Caisse des dépôts et consignations, de toutes les sommes saisies (c’est-à-dire appréhendées dans l’attente d’un jugement définitif, en vue d’une éventuelle confiscation) lors de procédures pénales en France ;
– de procéder à l’ensemble des ventes avant jugement de biens meubles saisis, décidées par les magistrats lorsque ces biens ne sont plus utiles à la manifestation de la vérité et qu’ils sont susceptibles de dépréciation. La somme issue de la vente est consignée sur le compte tenu par la Caisse des dépôts et consignations. Elle est restituée au propriétaire si celui-ci bénéficie d’un acquittement, d’un non-lieu ou d’une relaxe ou si le bien ne lui est pas confisqué. Depuis la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure (dite LOPPSI 2), l’Agence est également chargée de l’aliénation ou de la destruction des véhicules confisqués en application du code de la route ;
– de procéder à l’ensemble des publications, auprès des Bureaux de conservation des hypothèques, des saisies pénales immobilières et des confiscations immobilières prononcées par les juridictions ;
– de gérer, sur mandat de justice, tous les biens qui nécessitent, pour leur conservation ou leur valorisation, des actes d’administration ;
– d’assurer la gestion de biens saisis, de procéder à leur vente et à la répartition de son produit en exécution de toute demande d’entraide internationale ou de coopération émanant d’une autorité judiciaire étrangère, notamment en tant que bureau de recouvrement des avoirs au sens de la décision 2007/845/JAI du Conseil du 6 décembre 2007 relative à la coopération entre les bureaux de recouvrement des avoirs des États membres en matière de dépistage et d’identification des produits du crime ou des autres biens en rapport avec le crime ;
– de veiller, enfin, le cas échéant, à l’information préalable des créanciers avant exécution de toute décision judiciaire de restitution et à l’indemnisation prioritaire des parties civiles sur les biens confisqués à la personne condamnée.
Le quatrième rapport annuel de l’Agence a été publié le 11 mai 2015. Il témoigne d’une activité significative : 45 280 affaires enregistrées correspondant à 87 278 biens. Sur la seule année 2014, l’AGRASC a récupéré plus de 126 millions d’euros, dont 107 millions d’euros reversés au budget de l’État.
Les adaptations à apporter seront donc d’envergure limitée :
– des rectifications seront nécessaires pour garantir une procédure équitable dans le cadre particulier des procès d’assises, notamment en ce qui concerne la motivation des décisions (313) ;
– l’article 4§2 de la directive impose aux États membres de prendre les mesures nécessaires pour permettre une confiscation lorsque la procédure, qui aurait été susceptible de déboucher sur une condamnation pénale, est mise en échec par la fuite ou la maladie de la personne poursuivie. Il convient donc de garantir, en droit interne, que le condamné ne pourra pas revendiquer la restitution des biens à l’expiration du délai de prescription de la peine ;
– en cas d’extinction de l’action publique pour cause de décès de la personne suspectée ou poursuivie, il doit être permis de refuser la restitution à ses héritiers de biens qui sont le produit de l’infraction.
c. L’accès à un avocat, le droit à communication et le mandat européen
Le 1° du II autorise le Gouvernement à procéder par ordonnance à la transposition de la directive 2013/48/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013 relative au droit d’accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales et des procédures relatives au mandat d’arrêt européen, au droit d’informer un tiers dès la privation de liberté et au droit des personnes privées de liberté de communiquer avec des tiers et avec les autorités consulaires. La directive vise à instituer des garanties tant en matière d’assistance d’un avocat au cours de l’enquête ou des poursuites que de droit à la communication avec un tiers pour les personnes privées de liberté. Elle présente également des dispositions spécifiques à l’exécution des mandats d’arrêts européens. La date limite de sa transposition est fixée au 27 novembre 2016 (314).
i. Les dispositions de la directive au regard des règles actuellement en vigueur en France
L’article 3 de la directive impose que les suspects ou les personnes poursuivies aient accès à un avocat « sans retard indu » afin que ceux « qui sont privés de liberté soient en mesure d’exercer effectivement leur droit ». Les infractions qui ne sont pas sanctionnées d’une peine privative de liberté peuvent déroger à cette obligation. En revanche, elle est impérative avant tout interrogatoire policier ou judiciaire, dans le cadre d’une confrontation, en cas de détention provisoire ou de privation de liberté, ou encore dans la perspective d’une comparution devant une juridiction pénale.
Le droit à l’assistance d’un avocat est aujourd’hui garanti par le droit national au bénéfice des personnes poursuivies devant un juge d’instruction (315) ou prévenues devant le tribunal correctionnel (316) ou le tribunal de police (317). Il est également protégé au cours du procès pénal, que l’audition ou la confrontation soit conduite par le juge d’instruction (318) ou par le Procureur de la République (319), et lors des interrogatoires ou des confrontations réalisés par les services de police s’agissant des personnes placées en garde à vue (320). La loi n° 2014-535 du 27 mai 2014 portant transposition de la directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, relative au droit à l’information dans le cadre des procédures pénales, a étendu ce droit, à compter du 1er janvier 2015 aux personnes suspectées d’un crime ou d’un délit puni d’emprisonnement et entendues dans le cadre de l’audition libre (321).
En revanche, le droit français ne prévoit pas l’assistance d’un avocat pour la personne retenue en exécution d’un mandat d’arrêt (322) ou d’un mandat d’amener (323), ni pour une reconstitution de scène de crime ordonnée en dehors d’une instruction préparatoire, ni à l’occasion d’une séance d’identification de suspects.
La directive comporte également des stipulations relatives au droit à la communication avec un tiers des personnes privées de liberté – c’est-à-dire placées sous le régime de la garde à vue, de la rétention pour exécution d’un mandat ou de la détention provisoire. Celui-ci se compose de trois volets :
– le droit à l’information d’un tiers au choix de la personne privée de liberté ou, s’il s’agit d’un mineur, de son représentant légal. Il ne peut être dérogé à ce droit, sur décision de l’autorité judiciaire ou contrôlée par elle, que pour « prévenir une atteinte grave à la vie, à la liberté ou à l’intégrité physique d’une personne ou lorsqu’il existe une nécessité urgente d’éviter une situation susceptible de compromettre sérieusement une procédure pénale ». Le droit national répond à ces préoccupations en prévoyant que toute personne suspectée ou poursuivie soumise à une mesure privative de liberté reçoit, lors de la notification de cette mesure, un document énonçant ses droits et notamment la possibilité d’informer au moins un tiers (324).Unepersonne placée en garde à vue peut informer un membre de sa famille et son employeur, sauf décision contraire du Procureur de la République retardant cet avis pour une durée maximale de vingt-quatre heures (325). Enfin, l’article 4 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante dispose que, lorsqu’un mineur est placé en garde à vue, l’officier de police judiciaire doit immédiatement en informer les parents, le tuteur, la personne ou le service auquel est confié le mineur ;
– le droit à la communication avec un tiers est proclamé à l’article 6 de la directive, qui permet toutefois aux États de le limiter ou de reporter son exercice « eu égard à des exigences impératives ou à des besoins opérationnels proportionnés ». Un droit de visite est aujourd’hui reconnu au bénéfice des personnes en détention provisoire (326). Le juge d’instruction peut toutefois s’opposer à l’exercice de ces différents droits. Par ailleurs, aucun droit de communiquer avec les tiers n’est reconnu aux personnes gardées à vue ;
– le droit des personnes suspectées ou poursuivies de communiquer avec les autorités consulaires de leur pays est particulièrement protégé par la directive européenne puisque l’article 7 ne tolère aucune dérogation à son exercice. Le droit français prévoit la délivrance aux autorités consulaires d’un permis de visite des personnes placées en détention provisoire (327). Toutefois, le juge d’instruction peut toujours refuser de le délivrer. Rien n’est cependant prévu pendant la garde à vue.
Enfin, l’article 10 de la directive impose aux États le respect de garanties précises s’agissant de l’assistance d’un avocat auprès des personnes arrêtées en exécution d’un mandat d’arrêt européen. Ce droit doit être assuré sans retard indu après la privation de liberté et inclure notamment la possibilité d’un entretien et la présence du conseil au cours des auditions. L’assistance d’un avocat vaut tant dans l’État d’exécution que dans celui d’émission du mandat.
Le droit français satisfait ces obligations à l’exception de la dernière mentionnée : aucune disposition ne permet la désignation, par la personne arrêtée en France, d’un avocat dans le pays d’émission du mandat d’arrêt européen (328).
ii. Les modifications nécessaires à la transposition
Le droit français est globalement conforme aux exigences de la directive précitée du 22 octobre 2013. L’habilitation à prendre une ordonnance sollicitée par le Gouvernement ne devrait comporter, selon l’étude d’impact jointe au projet de loi, qu’un nombre limité de dispositions.
Le droit à l’assistance d’un avocat serait étendu au bénéfice de la personne interpellée en exécution d’un mandat d’amener ou d’arrêt, au cas des personnes participant à une opération de reconstitution et soupçonnées d’avoir participé en tant qu’auteur ou complice à la commission d’un crime ou d’un délit puni d’emprisonnement, et aux séances d’identification de suspects (329). L’accès au dispositif d’aide juridictionnelle serait facilité en conséquence. Enfin, les possibilités de dérogation prononcées par le procureur de la République seraient conditionnées à la prévention d’une atteinte « grave et imminente à la vie, à la liberté ou à l’intégrité physique d’une personne ».
Le droit à la communication avec un tiers serait encadré : uniquement possible sur décision du procureur de la République « au regard des circonstances de l’espèce afin de permettre le recueil ou la conservation des preuves ou de prévenir une atteinte grave à la vie, à la liberté ou à l’intégrité physique d’une personne » – la même condition serait exigée en matière de garde à vue d’un mineur – et après confirmation par le juge des libertés et de la détention si la garde à vue est prolongée au-delà de la quarante-huitième heure. Une ordonnance motivée serait nécessaire à chaque refus d’un permis de visite ou d’une autorisation de téléphoner par le juge d’instruction.
L’article 695-27 du code de procédure pénale serait enfin modifié pour prévoir que, lorsqu’une personne est interpellée en France en exécution d’un mandat d’arrêt européen, elle peut demander à être assistée dans l’État d’émission par un avocat de son choix ou par un avocat commis d’office. Une procédure similaire est prévue à la suite d’une arrestation à l’étranger sur le fondement d’un mandat d’arrêt émis en France.
d. L’enquête européenne en matière pénale
Le 2° du II autorise le Gouvernement à procéder par ordonnance à la transposition de la directive 2014/41/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant la décision d’enquête européenne en matière pénale.
Au cours des cinq dernières années, la France a traité entre 800 et 1 000 mandats d’arrêt européens. Ces procédures ont abouti à une remise effective à l’État membre demandeur après un délai moyen de deux semaines pour les individus consentants et une attente d’un peu plus d’un mois pour les réfractaires. En sens inverse, la France émet chaque année un peu plus de mille mandats d’arrêt européens.
La directive précitée du 3 avril 2014, qui doit être transposée avant le 22 mai 2017 (330), institue un dispositif de reconnaissance mutuelle des demandes d’enquête émises par les autorités d’un État membre à destination d’un autre. Elle a vocation à remplacer les dispositions correspondantes de la convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale du Conseil de l’Europe du 20 avril 1959 ainsi que les deux protocoles additionnels à celle-ci et les accords bilatéraux conclus sur son fondement, la convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985, et la convention relative à l’entraide judiciaire en matière pénale entre les États membres de l’Union européenne du 29 mai 2000 ainsi que son protocole.
Le passage à une logique de reconnaissance mutuelle, qui pose le principe de l’exécution des demandes d’enquête sauf exceptions limitativement énumérées, impose de modifier la législation afin d’établir les conditions de fond et de forme dans lesquelles un refus pourra être opposé.
L’habilitation que sollicite le Gouvernement pour modifier le code de procédure pénale entend limiter par voie d’ordonnance les motifs de refus aux cas énumérés à l’article 11 de la directive – immunité, atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation, mesure ne pouvant être ordonnée en droit national, faits n’ayant pas été commis sur le territoire de l’Union européenne ou ne constituant pas une infraction. La procédure et la forme des décisions devront également être précisées.
e. L’effacement des données des fichiers de police judiciaire
Le 6° du II autorise le Gouvernement à tirer par ordonnance les conséquences d’un arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme du 18 septembre 2014, Brunet c. France (requête n° 21010/10).
Le droit des fichiers de police judiciaire a été profondément remanié par la loi n° 2011-267 d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure (LOPPSI) du 14 mars 2011. Ce texte a notamment introduit au sein du titre IV du livre Ier du code de procédure pénale un chapitre II relatif aux fichiers de police judiciaire, complété par la suite par le décret n° 2012-652 du 4 mai 2012, codifié aux articles R. 40-23 et suivants du code de procédure pénale, relatif au traitement d’antécédents judiciaires (TAJ), fichier commun à la police et à la gendarmerie nationales.
L’article 230-8 du code de procédure pénale distingue les suites judiciaires provoquant l’effacement des données de celles donnant lieu à l’ajout d’une mention interdisant d’y accéder dans le cadre des enquêtes administratives :
– les décisions de relaxe ou d’acquittement ayant acquis un caractère définitif entraînent l’effacement des données sauf si le procureur de la République en prescrit le maintien pour des raisons liées à la finalité du fichier. Dans ce cas, elles font l’objet d’une mention ;
– les décisions de non-lieu et de classement sans suite motivées par une insuffisance de charges font l’objet d’une mention, sauf si le procureur de la République prescrit l’effacement des données ;
– les autres décisions de classement sans suite font l’objet d’une mention.
Les critères d’appréciation que prend en compte le procureur de la République pour décider de l’effacement ou du maintien des données dans le fichier ne sont aucunement précisés. À l’inverse, en cas de relaxe ou d’acquittement, il est indiqué que la décision de maintien des données est prise au regard de la finalité du fichier.
Selon l’étude d’impact jointe au projet de loi, l’autorité judiciaire n’est pas en mesure d’effectuer un contrôle efficace sur les requêtes en effacement qui lui sont soumises. Au surplus, les pratiques varient d’un ressort à un autre. Enfin, seules les décisions de non-lieu et de classement sans suite motivées par une insuffisance de charges peuvent donner lieu à un effacement à l’initiative du procureur de la République ; il ne peut intervenir dans les autres cas de classement sans suite – mise en œuvre d’une alternative aux poursuites, poursuites inopportunes, classement pour des motifs juridiques.
Cette situation a été jugée contraire à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 par la Cour européenne des droits de l’homme dans son arrêt Brunet précité. Au visa de l’article 8 de la Convention relatif au droit au respect à la vie privée, la Cour a rappelé, s’agissant d’une personne mise en cause, que l’appréciation du caractère proportionné de la durée de conservation au regard du but poursuivi dépend de l’existence d’un contrôle indépendant de la justification de leur maintien dans le fichier, fondé sur des critères précis tels que la gravité de l’infraction, les arrestations antérieures, la force des soupçons sur la personne ou toute autre circonstance particulière. La Cour a également relevé que les règles françaises ne tirent aucune conséquence de l’absence de déclaration de culpabilité sur la durée de conservation des données. Enfin, en dehors des hypothèses de relaxe, d’acquittement, de non-lieu et de classement sans suite pour insuffisance de charges, l’autorité chargée d’examiner les requêtes en effacement de données ne peut ordonner l’effacement des données du fichier : la durée de conservation apparaît dès lors comme une norme et non un maximum. Ces considérations ont conduit la Cour à entrer en voie de condamnation.
Afin de mettre le droit français en conformité avec la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, le Gouvernement sollicite une habilitation à procéder par ordonnance au détail des critères pris en compte par l’autorité judiciaire pour décider de l’effacement ou du maintien des données dans le fichier. Comme pour le fichier automatisé des empreintes digitales, dont le régime a été modernisé par le décret n° 2015-1580 du 2 décembre 2015, ces décisions seront prises en fonction des finalités du fichier appréciées au regard de la nature et des circonstances de l’infraction et de la personnalité de l’intéressé.
f. Le droit à l’information dans le cadre des procédures pénales
Le 7° du II autorise le Gouvernement à compléter par ordonnance la transposition de la directive 2012/13/UE du 22 mai 2012 relative au droit à l’information dans le cadre des procédures pénales, dont le délai de transposition a expiré le 2 juin 2014 (331). Ce texte impose aux États membres de garantir à tout suspect une information sur les droits procéduraux dont il dispose avant son premier interrogatoire officiel. Sa transposition en droit interne (332) a rendu nécessaire l’introduction dans le code de procédure pénale d’un article 61-1 qui impose, avant toute audition au cours d’une enquête ou sur commission rogatoire, la notification par procès-verbal des droits mentionnés dans la directive.
Les dispositions de l’article 61-1 du code de procédure pénale ne sont pas, néanmoins, applicables aux enquêtes diligentées par les fonctionnaires et agents des administrations et services publics auxquels des lois spéciales attribuent certains pouvoirs de police judiciaire. L’article 28 du même code prévoit que « les fonctionnaires et agents des administrations et services publics auxquels des lois spéciales attribuent certains pouvoirs de police judiciaire exercent ces pouvoirs dans les conditions et dans les limites fixées par ces lois ». Les articles 28-1 et 28-2 établissent des procédures particulières respectivement destinées aux agents des douanes et des services fiscaux.
Or ces polices spéciales entrent dans le champ d’application de la directive qui concerne tout suspect, c’est-à-dire toute personne soupçonnée d’avoir commis une infraction. Il s’agit d’une lacune que le Gouvernement envisage de combler par voie d’ordonnance en modifiant l’article 28 du code de procédure pénale, commun à l’ensemble des polices spéciales, et en introduisant des dispositions miroir dans les codes applicables à chacune de ces polices, dans un souci de lisibilité de la loi.
La réforme projetée est de nature à renforcer les garanties des justiciables pour un coût limité, les enquêtes spéciales ne concernant que très peu la population éligible à l’aide juridictionnelle – lutte contre le travail illégal, infractions en matière de droit de la concurrence, de la propriété intellectuelle ou de droit de l’environnement.
2. Des mesures de coordination dans la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme
a. Des mesures connexes aux dispositions de transposition des directives européennes
Les 2°, 4°, 5°, 6° et 7° du I prévoient une habilitation du Gouvernement à prendre par ordonnance des mesures de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme destinées à accompagner la transposition du « paquet » européen.
Le 2° porte sur la définition des modalités d’assujettissement, de contrôle et de sanction de personnes demeurées en dehors du périmètre d’application de la « 4ème directive ». Le Gouvernement souhaite étendre les dispositions européennes à des professions non assujetties par la directive, ce que celle-ci autorise expressément en son article 4§2 sous réserve d’une information de la Commission européenne. D’ores et déjà, l’article L. 561-2 du code monétaire et financier impose l’application des règles de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme aux vendeurs de métaux précieux et aux agents sportifs, qui ne sont pas cités par les textes européens.
Le 4° prévoit des dispositions de renforcement des règles d’organisation et de fonctionnement de la commission nationale des sanctions habilitée à prononcer des mesures disciplinaires à l’encontre des professions non financières (333). Lors de son évaluation du dispositif français de lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement des activités terroristes et les loteries, jeux et paris prohibés, le 25 février 2011, le GAFI a souligné qu’un respect accru des règles de contrôle était impératif de la part de ces professions. La meilleure prise en compte de leurs obligations par les acteurs économiques suppose des sanctions plus importantes et plus efficaces en répression de leurs manquements. Un renforcement des garanties de la personne mise en cause irait de pair, en permettant sa représentation à l’audience notamment.
Le 5° concerne les mesures de gel d’avoirs prises à titre national (334) ou en application d’une résolution du Conseil de sécurité des Nations-Unies ou d’une décision de l’Union européenne (335). Les fonds, instruments financiers et ressources économiques susceptibles de faire l’objet d’une mesure de gel sont définis à l’article L. 562-4 du code monétaire et financier comme « les avoirs de toute nature, corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers (336) ». Toutefois, aux termes des articles L. 562-1 et L. 562-2, seuls les avoirs détenus auprès des personnes assujetties au respect de la législation anti-blanchiment et financement du terrorisme – avoirs détenus sous forme de compte – peuvent être gelés. Or, même si une mesure de gel s’accompagne toujours d’une interdiction de mise à disposition des fonds (337), une vente immobilière peut permettre de contourner le dispositif. Le Gouvernement envisage, en conséquence, la modification du code monétaire et financier afin d’étendre le gel des avoirs à l’ensemble des biens meubles et immeubles, directement détenus mais aussi indirectement contrôlés par la personne visée (338). Diverses clarifications rédactionnelles sont également mentionnées par l’étude d’impact jointe au projet de loi.
Le 6° a pour ambition de protéger le contenu et l’origine des informations détenues par TRACFIN. Il élargit la possibilité, pour ce service, de recevoir et de communiquer des informations. Ces finalités sont conformes aux orientations du GAFI : l’efficacité de l’action des cellules de renseignement financier suppose un accès le plus large possible à l’information, notamment financière et administrative, et une communication des données collectées à toute autorité compétente impliquée dans la lutte contre le blanchiment de capitaux, les infractions sous-jacentes et le financement du terrorisme.
Le 7° autorise le Gouvernement à apporter les corrections formelles et adaptations nécessaires à la simplification, la cohérence et l’intelligibilité des dispositions du code monétaire et financier en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.
Les 8°, 9° et 10° du I permettent l’extension aux territoires ultramarins de certaines des dispositions pour lesquelles une habilitation à légiférer par ordonnances est prévue au I de l’article 33.
Le 8° permet de procéder aux adaptations rendues nécessaires par les dispositions prises en application des alinéas précédents dans l’ensemble des territoires d’outre-mer, quel que soit leur degré d’autonomie (339).
Le 9° vise à donner force de loi aux dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme ainsi qu’au gel des avoirs qui ne s’appliquent pas encore aux îles Wallis et Futuna.
Le 10° autorise l’extension, dans les collectivités d’outre-mer qui ne font pas partie de l’Union européenne (340), du règlement UE n° 2015/847 du 20 mai 2015 relatif aux informations accompagnant les transferts de fonds. Texte d’effet direct en droit interne, son contenu ne fait l’objet que de modifications limitées au sein des codes législatifs pour son application en métropole. À l’inverse, son respect outre-mer nécessite une modernisation importante du code monétaire et financier, qui comprend un certain nombre de dispositions d’adaptation outre-mer du règlement (CE) n° 1781/2006 désormais abrogé.
3. La mise en conformité de la législation avec la jurisprudence du Conseil constitutionnel
Le c) du 3° du II autorise le Gouvernement à tirer par ordonnance les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel n° 2015-494 QPC du 16 octobre 2015, Consorts R., qui a déclaré contraire à la Constitution le deuxième alinéa de l’article 99 du code de procédure pénale. Celui-ci traite de la restitution des objets placés sous main de justice : il prévoit que le juge d’instruction « statue, par ordonnance motivée, soit sur réquisitions du procureur de la République, soit, après avis de ce dernier, d’office ou sur requête de la personne mise en examen, de la partie civile ou de toute autre personne qui prétend avoir droit sur l’objet ». Dans la mesure toutefois où aucun délai n’est imparti au juge d’instruction pour statuer et où aucun appel n’est prévu devant la chambre de l’instruction, cette rédaction porte atteinte au droit de propriété et au droit à un recours juridictionnel effectif.
La déclaration d’inconstitutionnalité prononcée par le Conseil constitutionnel prend effet à compter du 1er janvier 2017.
Dans l’étude d’impact jointe au projet de loi, le Gouvernement indique souhaiter modifier l’article 99 du code de procédure pénale pour prévoir que, en l’absence de réponse du juge d’instruction à une demande de restitution d’un objet placé sous scellé, la personne peut saisir directement le président de la chambre de l’instruction à l’issue d’un délai d’un mois à compter du dépôt de sa requête.
b. La procédure d’immobilisation des navires et la fixation du cautionnement
Le d) du 3° du II autorise le Gouvernement à tirer par ordonnance les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel n° 2014-375 QPC du 21 mars 2014, M. Bertand L. et autres, par laquelle est déclarée contraire à la Constitution « la combinaison du caractère non-contradictoire de la procédure et de l’absence de voie de droit permettant la remise en cause de la décision du juge autorisant la saisie et fixant le cautionnement (341) » en matière maritime.
La sollicitation est cependant étonnante dans la mesure où les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel ont d’ores et déjà été tirées à l’article 96 de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt. Cette disposition est issue d’un amendement du Gouvernement adopté en première lecture par le Sénat (342).
c. L’enregistrement sonore des débats d’assises
Le 4° du II autorise le Gouvernement à tirer par ordonnance les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel n° 2015-499 QPC du 20 novembre 2015, M. Hassan B., par laquelle est déclaré contraire aux droits et libertés garantis par la Constitution le dernier alinéa de l’article 308 du code de procédure pénale, selon lequel le défaut d’enregistrement sonore des débats devant la cour d’assises ne vaut pas nullité. Le considérant n° 4 précise ainsi que « le législateur a conféré aux parties un droit à l’enregistrement sonore des débats de la cour d’assises ; qu’en interdisant toute forme de recours en annulation en cas d’inobservation de cette formalité, les dispositions contestées méconnaissent les exigences de l’article 16 de la Déclaration de 1789 ».
L’enregistrement sonore des débats d’assises peut être utilisé jusqu’au prononcé de l’arrêt, devant la cour d’assises statuant en appel, devant la cour de révision et de réexamen saisie d’une demande en révision, et, après cassation ou annulation sur révision, devant la juridiction de renvoi. Cette utilisation peut être ordonnée d’office, sur réquisition du ministère public, à la demande de l’accusé ou sur requête de la partie civile. Il ne s’agit donc pas d’une mesure d’administration judiciaire puisqu’elle est appréciée par le président de la juridiction et peut être contestée devant lui.
Le Conseil constitutionnel a différé l’effet de sa décision de contrariété au 1er septembre 2016, en précisant que les arrêts d’assises rendus jusqu’à cette date ne pourront être contestés sur le fondement de sa décision. Il convient, par conséquent, de modifier avant cette date l’article 308 du code de procédure pénale pour préciser que le défaut d’enregistrement sonore peut valablement fonder une requête en nullité. Les autres prescriptions qu’il contient – l’interdiction de filmer et les règles relatives à l’ouverture des enregistrements sous scellés – demeureront, au contraire, dans le régime actuel puisqu’elles ne constituent pas une garantie du procès équitable.
L’étude d’impact jointe au projet de loi précise que la mise en conformité du droit avec la décision du Conseil constitutionnel pourrait aussi passer par la suppression de l’obligation d’enregistrer les débats d’assises. Si cette option semble écartée par le Gouvernement, celui-ci ne s’interdit pas de limiter ce dispositif aux procès tenus en appel au motif que, institué par le législateur pour faciliter une éventuelle révision, il ne trouverait probablement pas à s’appliquer dans les affaires dans lesquelles la condamnation prononcée en première instance n’est pas contestée. La dimension économique n’est sans doute pas étrangère à cette perspective puisque, si toutes les salles d’audiences d’assises devront être équipées d’un enregistreur fonctionnel au 1er septembre 2016, la moitié d’entre elles ne l’étaient pas en septembre 2015. Le coût d’équipement et d’installation requis pour la mise en conformité est évalué à un million d’euros.
d. Le secret du délibéré
Le 5° du II autorise le Gouvernement à tirer par ordonnance les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel n° 2015-506 QPC du 4 décembre 2015, M. Gilbert A., qui confère une valeur constitutionnelle au secret du délibéré en le liant directement au principe d’indépendance de l’autorité judiciaire (343).
Dès lors, la saisie en flagrance d’éléments couverts par le secret du délibéré, dans les conditions des articles 56 et 57 du code de procédure pénale, est contraire à la Constitution. Elle ne peut intervenir qu’en vertu de conditions et de modalités qui permettent une mise en œuvre proportionnée et une conciliation avec d’autres impératifs de rang constitutionnel. Or, l’article 56 précité se borne à imposer à l’officier de police judiciaire de prendre, préalablement à une saisie, « toutes mesures utiles pour que soit assuré le respect du secret professionnel et des droits de la défense ». Cette rédaction, imprécise et insuffisamment protectrice du principe d’indépendance des juridictions, a été censurée pour incompétence négative du législateur. L’interdiction de saisie des éléments couverts par le secret du délibéré est d’ores et déjà effective ; les autres effets de l’inconstitutionnalité ont été reportés au 1er octobre 2016.
Seules les dispositions du code de procédure pénale relatives à l’enquête ont été déclarées contraires à la Constitution. Quoique similaires, les règles applicables à l’instruction figurant à l’article 96 du même code ont échappé à la censure car, issues de la loi du 31 décembre 1957, elles ne sauraient méconnaître le domaine de la loi délimité par la Constitution du 4 octobre 1958 (344).
L’habilitation sollicitée par le Gouvernement lui permet de corriger le régime de perquisition et de saisie en flagrance en prévoyant, en matière d’atteinte au secret du délibéré, des garanties similaires à celles prévues aux articles 56-1 et 56-2 pour les perquisitions d’un cabinet d’avocat, d’une entreprise de presse ou du domicile d’un journaliste.
4. L’obligation de recours à la plate-forme nationale des interceptions judiciaires
Le 8° du II autorise le Gouvernement à modifier le code de procédure pénale et le code des douanes afin de rendre obligatoire le recours à la plate-forme nationale des interceptions judiciaires.
Le décret n° 2014-1162 du 9 octobre 2014 portant création d’un traitement automatisé de données à caractère personnel a mis en place la plate-forme nationale des interceptions judiciaires (PNIJ) dont l’objectif consiste à fournir aux services d’investigation un outil adapté aux évolutions des technologies de communications électroniques. Les dispositions correspondantes ont été codifiées aux articles R. 40-42 à R. 40-56 du code de procédure pénale.
Placée sous la responsabilité du secrétaire général du ministère de la Justice et sous le contrôle d’une personnalité qualifiée (345), la PNIJ procède à un traitement automatisé de données à caractère personnel qui permet aux magistrats, aux officiers de police judiciaire ainsi qu’aux agents des douanes et des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires, de requérir les opérateurs de communications électroniques et de recevoir les données relatives au trafic – prestations annexes, géolocalisation – et au contenu des échanges par téléphone comme par internet. Elle a vocation à se substituer progressivement aux centrales d’écoutes mises en place dans les services de police et unités de gendarmerie ainsi qu’au système de transmission des interceptions judiciaires (STIJ) du ministère de la Justice : après une phase de test et d’étalonnage, le déploiement national de la PNIJ a débuté le 12 octobre 2015 et s’achèvera le 11 avril 2016 avec la couverture des départements et collectivités d’outre-mer.
Le cadre juridique de la PNIJ n’est cependant pas exempt d’imperfections.
En premier lieu, le code de procédure pénale proclame le principe d’une liberté des réquisitions : il est possible de ne pas recourir à la PNIJ pour l’obtention des interceptions judiciaires, des prestations annexes ou des données de géolocalisation. Les articles 60-1 et 60-2 (enquête de flagrance), 77-1-1 et 77-1-2 (enquête préliminaire), et 99-3 et 99-4 (instruction) permettent au magistrat de solliciter toute personne compétente ou susceptible de détenir une information utile.
Par ailleurs, l’article R. 40-49 du code de procédure pénale prescrit le placement sous scellés au sein de la PNIJ des données relatives aux interceptions judiciaires et aux mesures de géolocalisation en temps réel. La PNIJ joue ainsi un rôle de « coffre-fort numérique » pour la conservation des données interceptées. Elles ne sont alors plus accessibles, dans la plate-forme, que par le magistrat ayant ordonné l’interception et par le greffier. Le traitement garantit l’intégrité des scellés qui y sont conservés et la traçabilité des consultations. Or, l’article 97 du code de procédure pénale prévoit que, dans le cadre d’une information judiciaire, les scellés renfermant des enregistrements ne peuvent être ouverts qu’en présence du mis en examen assisté de son avocat.
De plus, dans le cadre de la PNIJ, la destruction des enregistrements est « automatique » à l’expiration du délai de prescription de l’action publique (346). Or, de façon contradictoire, les articles 100-6 et 230-43 du même code de procédure pénale prévoient que les enregistrements relatifs aux interceptions et aux géolocalisations sont détruits « à la diligence » du procureur de la République et du procureur général.
Enfin, l’article 230-2 du code de procédure pénale exige la saisine d’un organisme technique soumis au secret de la défense nationale pour procéder à la mise au clair des données chiffrées ou cryptées. Cette disposition apparaît en inadéquation avec les fonctionnalités de la PNIJ et impose le recours à une procédure d’une lourdeur injustifiée.
En conséquence, au regard des garanties offertes par le fonctionnement et l’organisation de la PNIJ, le Gouvernement souhaite être habilité à modifier par ordonnance les dispositions du code de procédure pénale qui empêchent cet outil de donner sa pleine mesure. L’objectif poursuivi est de réduire les frais de justice et alléger la charge de travail des juridictions par une simplification des formalités. Il est ainsi prévu de rendre la PNIJ obligatoire et d’adapter les textes relatifs aux scellés, d’une part, et au déchiffrement des données, d’autre part.
Ces évolutions devraient générer une économie de frais de justice grâce à la suppression du recours aux sociétés privées de location de matériel d’interception. La dépense en la matière s’est élevée à 36 millions d’euros en 2013 et 43 millions d’euros en 2014 pour les interceptions de contenu, chiffres auxquels il convient d’ajouter 8,9 millions d’euros en 2013 et 10,5 millions d’euros en 2014 pour les géolocalisations.
5. Les modifications opérées par votre commission des Lois
La commission des Lois ayant adopté au cours de l’examen du titre II du projet de loi des articles additionnels prévoyant des dispositions que le Gouvernement envisageait de prendre par voie d’ordonnances, les habilitations correspondantes avaient perdu leur raison d’être. Elles ont donc fait l’objet d’un amendement de suppression présenté par la rapporteure.
Les dispositions correspondantes se trouvent désormais :
– pour la transposition de la directive 2013/48/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013 relative au droit d’accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales et des procédures relatives au mandat d’arrêt européen, au droit d’informer un tiers dès la privation de liberté et au droit des personnes privées de liberté de communiquer avec des tiers et avec les autorités consulaires, prévue au 1° du II, au nouvel article 27 quater ;
– pour la transposition de la directive 2014/42/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant le gel et la confiscation des instruments et des produits du crime dans l’Union européenne et pour les modifications du code de procédure pénale relatives aux prérogatives de l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC), respectivement prévues aux a) et b) du 3° du II, au nouvel article 31 quinquies ;
– pour les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel n° 2015-494 QPC du 16 octobre 2015, Consorts R., prévues au c) du 3° du II, au nouvel article 27 ter ;
– pour les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel n° 2014-375 QPC du 21 mars 2014, M. Bertrand L. et autres, prévues au d) du 3° du II, au nouvel article 31 bis ;
– pour les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel n° 2015-499 QPC du 20 novembre 2015, M. Hassan B., prévues au 4° du II, au nouvel article 31 nonies ;
– pour les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel n° 2015-506 QPC du 4 décembre 2015, M. Gilbert A., prévues au 5° du II, au nouvel article 25 bis ;
– pour la transposition de la directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, relative au droit à l’information dans le cadre des procédures pénales, prévue au 7° du II, au nouvel article 31 quater ;
– pour le caractère obligatoire du recours à la plate-forme nationale des interceptions judiciaires (PNIJ), prévu au 8° du II, au nouvel article 31 octies.
Quant aux conséquences de la décision de la Cour européenne des droits de l’homme du 18 septembre 2014, Brunet c. France, prévues au 6° du II, elles feront l’objet d’un amendement à l’occasion de la discussion du projet de loi en séance publique.
*
* *
La Commission adopte successivement les amendements rédactionnels CL344, CL345, CL346, CL347, CL348 et CL349 de la rapporteure.
Elle examine ensuite son amendement CL350.
Mme la rapporteure. L’adoption par la Commission d’amendements portant sur le titre II a rendu sans objet une bonne part des habilitations sollicitées. Je vous invite donc à les supprimer.
La Commission adopte cet amendement.
En conséquence, les amendements CL116, CL210 et CL117 tombent.
La Commission adopte l’amendement de précision CL351 de la rapporteure.
Elle adopte l’article 33 modifié.
Chapitre III
Dispositions relatives aux outre-mer
La Commission est saisie de l’amendement CL352 de la rapporteure.
Mme la rapporteure. Cet amendement vise à modifier l’intitulé du chapitre III. Nous préférons : « Dispositions relatives à l’outre-mer ».
La Commission adopte l’amendement. L’intitulé du chapitre III est ainsi modifié.
Article 34
(art. L. 285-1, L. 286-1, L. 287-1, L. 288-1, L. 344-1, L. 345-1, L. 346-1, L. 347-1, L. 445-1, L. 446-1, L. 447-1 et L. 448-1 du code de la sécurité intérieure ; art. L. 1641-1, L. 1651-1, L. 1661-1, L. 1671-1, L. 2441-1, L. 2451-1, L. 2461-1, L. 2471-1, L. 4341-1, L. 4351-1, L. 4361-1 et L. 4371-1 du code de la défense ; art. L. 743-7-2, L. 753-7-2 et L. 763-7-2 du code monétaire et financier)
Application Outre-mer
Le présent article prévoit l’application des dispositions précédentes sur l’ensemble du territoire de la République. Il procède également à des modifications de coordination.
1. Les normes de référence
L’article 74 de la Constitution prévoit que le statut des collectivités qu’il régit détermine « les conditions dans lesquelles les lois et règlements y sont applicables ». Ces collectivités sont en principe soumises au principe dit de « spécialité législative », en vertu duquel les lois et règlements n’y sont applicables que sur mention expresse. Il en va ainsi de la Polynésie française (347), de Saint-Barthélemy et Saint-Martin (348), de Saint-Pierre-et-Miquelon (349) et des îles Wallis et Futuna (350). La Nouvelle-Calédonie est également soumise au principe de spécialité législative, mais sur le fondement de l’article 77 de la Constitution précisé par la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie.
Les statuts de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon prévoient toutefois que la plupart des lois et règlements y sont applicables de plein droit en dérogation au principe de spécialité. On parle de « régime de l’Atlantique » ou de régime du « tout est applicable sauf... » (351). Il n’y a alors pas lieu, pour les textes concernés, de prévoir une mention particulière d’applicabilité.
Les autres territoires requièrent une mention spéciale. Les îles Wallis et Futuna sont ainsi régies « par les lois, décrets et arrêtés ministériels déclarés expressément applicables (352) ». Il en va de même en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie où, par ailleurs, les statuts établissent un partage des compétences entre les autorités locales et l’État. Le droit pénal et la procédure pénale sont cependant toujours du domaine de la loi nationale (353).
2. Les dispositions du projet de loi
Conformément à la recommandation du Conseil d’État, le I prévoit que la loi est « applicable sur l’ensemble du territoire de la République ». Cette formulation générale vaut extension aux collectivités régies par le principe de spécialité. Elle évite d’en dresser la liste exhaustive.
Les II, III et IV procèdent respectivement aux coordinations nécessaires au sein du code de la sécurité intérieure, du code de la défense et du code monétaire et financier.
*
* *
La Commission adopte successivement l’amendement de cohérence CL353 et l’amendement de coordination CL354 de la rapporteure.
Elle adopte l’article 34 modifié.
Article 35 (nouveau)
(art. 926–1 du code de procédure pénale)
Création d’un service pénitentiaire d’insertion et de probation
à Saint-Pierre-et-Miquelon
Le présent article, adopté par votre Commission à l’initiative du Gouvernement, autorise la création d’un service pénitentiaire d’insertion et de probation à Saint-Pierre-et-Miquelon.
L’article 474 du code de procédure pénale dispose qu’en cas de condamnation d’une personne non incarcérée à une peine d’emprisonnement inférieure ou égale à deux ans ou pour laquelle la durée de détention restant à subir est inférieure ou égale à deux ans, il est remis au condamné qui est présent à l’issue de l’audience un avis de convocation à comparaître, dans un délai qui ne saurait excéder trente jours, devant le juge de l’application des peines en vue de déterminer les modalités d’exécution de la peine. Le condamné est également avisé qu’il est convoqué aux mêmes fins devant le service pénitentiaire d’insertion et de probation dans un délai qui ne saurait être supérieur à quarante-cinq jours. Les durées de deux ans prévues par le présent alinéa sont réduites à un an si le condamné est en état de récidive légale. Le présent alinéa est applicable au condamné exécutant une peine sous le régime de la semi-liberté, du placement à l’extérieur ou du placement sous surveillance électronique.
Ces dispositions sont également applicables lorsque la personne est condamnée à une contrainte pénale, à une peine d’emprisonnement assortie du sursis avec mise à l’épreuve, à une peine d’emprisonnement avec sursis assortie de l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général ou bien à une peine de travail d’intérêt général. Toutefois, dans ces hypothèses, le condamné n’est convoqué que devant le service pénitentiaire d’insertion et de probation qui se trouve ainsi saisi de la mesure.
Aux termes de l’article 926–1 du code de procédure pénale, « pour l’application de l’article 474 à Saint-Pierre-et-Miquelon, le président du tribunal de première instance exerce les fonctions dévolues au service pénitentiaire d’insertion et de probation. »
Le présent article abroge cet article 926–1 du code de procédure pénale, ouvrant ainsi la voie à la création d’un service pénitentiaire d’insertion et de probation à Saint-Pierre-et-Miquelon.
*
* *
La Commission est saisie de l’amendement CL359 du Gouvernement.
Mme la rapporteure. Nous sommes favorables à cet amendement qui autorise enfin la création d’un service pénitentiaire d’insertion de probation à Saint-Pierre-et-Miquelon.
M. Jean-Pierre Blazy. Il était temps !
La Commission adopte cet amendement. L’article 35 est ainsi rédigé.
Puis elle adopte l’ensemble du projet de loi modifié.
M. le Président Dominique Raimbourg. Nous aurons au total consacré à l’examen de ce texte pratiquement sept heures de réunion et étudié quelque 360 amendements… La discussion en séance publique commencera le mardi 1er mars, après les questions au Gouvernement et la lecture définitive du projet de loi relatif à la protection de l’enfant.
*
* *
En conséquence, la commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République vous demande d’adopter le projet de loi renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale, après engagement de la procédure accélérée, dans le texte figurant dans le document annexé au présent rapport.
___
Dispositions en vigueur ___ |
Texte du projet de loi ___ |
Texte adopté par la Commission ___ |
Projet de loi renforçant la lutte |
Projet de loi renforçant la lutte | |
TITRE IER |
TITRE IER | |
DISPOSITIONS RENFORÇANT |
DISPOSITIONS RENFORÇANT | |
Chapitre Ier |
Chapitre Ier | |
Dispositions renforçant l’efficacité des investigations judiciaires |
Dispositions renforçant l’efficacité des investigations judiciaires | |
Article 1er |
Article 1er | |
Code de procédure pénale |
Le code de procédure pénale est ainsi modifié : |
(Alinéa sans modification) |
Art. 706-90. – Si les nécessités de l’enquête préliminaire relative à l’une des infractions entrant dans le champ d’application des articles 706-73 et 706-73-1 l’exigent, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance peut, à la requête du procureur de la République, décider, selon les modalités prévues par l’article 706-92, que les perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction pourront être effectuées en dehors des heures prévues à l’article 59, lorsque ces opérations ne concernent pas des locaux d’habitation. |
||
1° Après le premier alinéa de l’article 706-90, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
1° (Alinéa sans modification) | |
« Pour les enquêtes concernant les infractions mentionnées au 11° de l’article 706-73, les perquisitions mentionnées |
« Pour les enquêtes préliminaires concernant les infractions mentionnées au 11° de l’article 706-73, par dérogation au premier alinéa du présent article, les perquisitions mentionnées au même premier alinéa peuvent, en cas d’urgence, être également effectuées dans des locaux d’habitation, selon les modalités prévues à l’article 706-92, lorsque la réalisation de ces opérations en dehors des heures prévues à l’article 59 est nécessaire afin de prévenir un risque d’atteinte à la vie ou à l’intégrité physique. » ; amendements CL242, CL243, CL244, CL245 et CL367 | |
Art. 706-91. – Si les nécessités de l’instruction relative à l’une des infractions entrant dans le champ d’application des articles 706-73 et 706-73-1 l’exigent, le juge d’instruction peut, selon les modalités prévues par l’article 706-92, autoriser les officiers de police judiciaire agissant sur commission rogatoire à procéder à des perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction en dehors des heures prévues à l’article 59, lorsque ces opérations ne concernent pas des locaux d’habitation. |
||
En cas d’urgence, le juge d’instruction peut également autoriser les officiers de police judiciaire à procéder à ces opérations dans les locaux d’habitation : |
||
1° Lorsqu’il s’agit d’un crime ou d’un délit flagrant ; |
||
2° Lorsqu’il existe un risque immédiat de disparition des preuves ou des indices matériels ; |
||
3° Lorsqu’il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’une ou plusieurs personnes se trouvant dans les locaux où la perquisition doit avoir lieu sont en train de commettre des crimes ou des délits entrant dans le champ d’application des articles 706-73 et 706-73-1. |
||
2° L’article 706-91 est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
2° (Alinéa sans modification) | |
« 4° Lorsque la réalisation de |
« 4° Lorsque la réalisation de ces opérations, dans le cadre d’une instruction relative aux crimes et délits mentionnés au 11° de l’article 706-73, est nécessaire afin de prévenir un risque d’atteinte à la vie ou à l’intégrité physique. » ; amendements CL367, CL246 | |
2° L’article 706-92 est ainsi modifié : | ||
a) (nouveau) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : | ||
Art. 706-92. – À peine de nullité, les autorisations prévues par les articles 706-89 à 706-91 sont données pour des perquisitions déterminées et font l’objet d’une ordonnance écrite, précisant la qualification de l’infraction dont la preuve est recherchée ainsi que l’adresse des lieux dans lesquels les visites, perquisitions et saisies peuvent être faites ; cette ordonnance, qui n’est pas susceptible d’appel, est motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que ces opérations sont nécessaires. Les opérations sont faites sous le contrôle du magistrat qui les a autorisées, et qui peut se déplacer sur les lieux pour veiller au respect des dispositions légales. |
« Le magistrat qui les a autorisées est informé dans les meilleurs délais par le procureur de la République ou l’officier de police judiciaire des actes accomplis en application des articles 706-89 à 706-91. » ; amendement CL369 | |
|
Dans les cas prévus par les 1°, 2° et 3° de l’article 706-91, l’ordonnance comporte également l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de cette décision par référence aux seules conditions prévues par ces alinéas. |
|
b) (Sans modification) |
Pour l’application des dispositions des articles 706-89 et 706-90, est compétent le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dont le procureur de la République dirige l’enquête, quelle que soit la juridiction dans le ressort de laquelle la perquisition doit avoir lieu. Le juge des libertés et de la détention peut alors se déplacer sur les lieux quelle que soit leur localisation sur l’ensemble du territoire national. Le procureur de la République peut également saisir le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la perquisition doit avoir lieu, par l’intermédiaire du procureur de la République de cette juridiction. |
||
Article 2 |
Article 2 | |
Section 5 |
La section 5 du chapitre II du titre XXV du livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifiée : |
(Alinéa sans modification) |
Des interceptions de correspondances émises par la voie des télécommunications |
1° L’intitulé est complété par les mots : « et du recueil de données techniques de connexion » ; |
1° (Sans modification) |
2° Après l’article 706-95, il est inséré un article 706-95-1 ainsi rédigé : |
2° (Alinéa sans modification) | |
« Art. 706-95-1. – Lorsque les nécessités de l’enquête ou de l’information concernant un crime ou un délit entrant dans le champ d’application des articles 706-73 et 706-73-1 l’exigent, le juge des libertés |
« Art. 706-95-1. – Lorsque les nécessités de l’enquête ou de l’information concernant un crime ou un délit entrant dans le champ d’application des articles 706-73 et 706-73-1 l’exigent, le juge des libertés et de la détention, sur requête du procureur de la République, ou le juge d’instruction, après avis du procureur de la République, peut, par ordonnance motivée, autoriser les officiers de police judiciaire à mettre en place un dispositif technique mentionné au 1° de l’article 226-3 du code pénal afin de recueillir les données techniques de connexion permettant l’identification d’un équipement terminal ou du numéro d’abonnement de son utilisateur, pour une durée maximale d’un mois, renouvelable une fois dans les mêmes conditions de forme et de durée. Ces opérations sont effectuées sous l’autorité et le contrôle du magistrat qui les a autorisées. amendements CL169, CL248, CL249 et CL250 | |
« |
« Dans le cadre d’une enquête relative à un crime ou un délit mentionné au premier alinéa du présent article, en cas d’urgence, l’autorisation peut être accordée par le procureur de la République. Elle doit alors être confirmée par le juge des libertés et de la détention dans un délai de vingt-quatre heures, à défaut de quoi il est mis fin à l’opération et procédé à la destruction des données recueillies. amendements CL251, CL252, CL253 et CL113 | |
« Le procureur de la République, le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire, peut requérir tout agent qualifié d’un service, d’une unité ou d’un organisme placé sous l’autorité du ministre de l’intérieur et dont la liste est fixé par décret, en vue de procéder à l’utilisation du dispositif technique mentionné au premier alinéa. » |
« Le procureur de la République, le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire peut requérir tout agent qualifié d’un service, d’une unité ou d’un organisme placé sous l’autorité du ministre de l’intérieur et dont la liste est fixée par décret, en vue de procéder à l’utilisation du dispositif technique mentionné au premier alinéa du présent article. » amendement CL254 | |
Article 3 |
Article 3 | |
Le code de procédure pénale est ainsi modifié : |
(Alinéa sans modification) | |
1° L’article 706-96 du code de procédure pénale est ainsi modifié : |
1° (Alinéa sans modification) | |
|
Art. 706-96. – Lorsque les nécessités de l’information concernant un crime ou un délit entrant dans le champ d’application des articles 706-73 et 706-73-1 l’exigent, le juge d’instruction peut, après avis du procureur de la République, autoriser par ordonnance motivée les officiers et agents de police judiciaire commis sur commission rogatoire à mettre en place un dispositif technique ayant pour objet, sans le consentement des intéressés, la captation, la fixation, la transmission et l’enregistrement de paroles prononcées par une ou plusieurs personnes à titre privé ou confidentiel, dans des lieux ou véhicules privés ou publics, ou de l’image d’une ou plusieurs personnes se trouvant dans un lieu privé. Ces opérations sont effectuées sous l’autorité et le contrôle du juge d’instruction. |
a) Au premier alinéa, après les mots : « les nécessités », il est inséré les mots : « de l’enquête ou », les mots : « le juge d’instruction peut, après avis du procureur de la République » sont remplacés par les mots : « le juge des libertés et de la détention, sur requête du procureur de la République, ou le juge d’instruction, après avis du procureur de la République, peut », les mots : « commis sur commission rogatoire » sont supprimés, et après les mots : « le contrôle », il est inséré les mots : « du juge des libertés et de la détention ou » ; |
a) (Sans modification) |
En vue de mettre en place le dispositif technique mentionné au premier alinéa, le juge d’instruction peut autoriser l’introduction dans un véhicule ou un lieu privé, y compris hors des heures prévues à l’article 59, à l’insu ou sans le consentement du propriétaire ou du possesseur du véhicule ou de l’occupant des lieux ou de toute personne titulaire d’un droit sur ceux-ci. S’il s’agit d’un lieu d’habitation et que l’opération doit intervenir hors des heures prévues à l’article 59, cette autorisation est délivrée par le juge des libertés et de la détention saisi à cette fin par le juge d’instruction. Ces opérations, qui ne peuvent avoir d’autre fin que la mise en place du dispositif technique, sont effectuées sous l’autorité et le contrôle du juge d’instruction. Les dispositions du présent alinéa sont également applicables aux opérations ayant pour objet la désinstallation du dispositif technique ayant été mis en place. |
b) |
b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié : |
– à la première phrase, après le mot : « alinéa, », sont insérés les mots : « le juge des libertés et de la détention ou » ; | ||
– à la deuxième phrase, après les mots : « fin par », sont insérés les mots : « le procureur de la République ou » ; | ||
– à la fin de l’avant-dernière phrase, les mots : « juge d’instruction » sont remplacés par les mots : « magistrat qui les a autorisées » ; amendement CL255 | ||
La mise en place du dispositif technique mentionné au premier alinéa ne peut concerner les lieux visés aux articles 56-1,56-2 et 56-3 ni être mise en oeuvre dans le véhicule, le bureau ou le domicile des personnes visées à l’article 100-7. |
||
Le fait que les opérations prévues au présent article révèlent des infractions autres que celles visées dans la décision du juge d’instruction ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. |
||
2° L’article 706-98 est ainsi rédigé : |
2° (Alinéa sans modification) | |
Art. 706-98. – Ces décisions sont prises pour une durée maximale de quatre mois. Elles ne peuvent être renouvelées que dans les mêmes conditions de forme et de durée. |
« Art. 706-98. - Lorsqu’elles interviennent au cours de l’enquête, |
« Art. 706-98. – Lorsqu’elles interviennent au cours de l’enquête, les décisions mentionnées à l’article 706-97 sont prises pour une durée maximale d’un mois, renouvelable une fois dans les mêmes conditions de forme et de durée. amendement CL256 |
« Lorsqu’elles interviennent au cours de l’instruction, ces décisions sont prises pour une durée maximale de quatre mois, renouvelable dans les mêmes conditions de forme et de durée, sans que la durée totale des opérations ne puisse excéder deux ans. » ; |
(Alinéa sans modification) | |
Art. 706-99. – Le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire commis par lui peut requérir tout agent qualifié d’un service, d’une unité ou d’un organisme placé sous l’autorité ou la tutelle du ministre de l’intérieur et dont la liste est fixée par décret, en vue de procéder à l’installation des dispositifs techniques mentionnés à l’article 706-96. |
3° Aux premiers alinéas des articles 706-99, 706-100 et 706-101, après les mots : « commis par lui » sont insérés les mots : « ou requis par le procureur de la République » ; |
3° (Sans modification) |
Les officiers ou agents de police judiciaire ou les agents qualifiés mentionnés au premier alinéa du présent article chargés de procéder aux opérations prévues par l’article 706-96 sont autorisés à détenir à cette fin des appareils relevant des dispositions de l’article 226-3 du code pénal. |
||
Art. 706-100. – Le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire commis par lui dresse procès-verbal de chacune des opérations de mise en place du dispositif technique et des opérations de captation, de fixation et d’enregistrement sonore ou audiovisuel. Ce procès-verbal mentionne la date et l’heure auxquelles l’opération a commencé et celles auxquelles elle s’est terminée. |
||
Les enregistrements sont placés sous scellés fermés. |
||
Art. 706-101. – Le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire commis par lui décrit ou transcrit, dans un procès-verbal qui est versé au dossier, les images ou les conversations enregistrées qui sont utiles à la manifestation de la vérité. |
4° Le premier alinéa de l’article 706-101 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Aucune séquence relative à la vie privée |
4° Le premier alinéa de l’article 706-101 est complété par une phrase ainsi rédigée : |
« Aucune séquence relative à la vie privée des personnes filmées ou enregistrées et n’ayant pas de lien avec les infractions mentionnées au premier alinéa de l’article 706-96 ne peut être conservée dans le dossier de la procédure. » ; amendement CL257 | ||
Les conversations en langue étrangère sont transcrites en français avec l’assistance d’un interprète requis à cette fin. |
||
5° L’article 706-102-1 est ainsi modifié : |
5° (Sans modification) | |
Art. 706-102-1. – Lorsque les nécessités de l’information concernant un crime ou un délit entrant dans le champ d’application des articles 706-73 et 706-73-1 l’exigent, le juge d’instruction peut, après avis du procureur de la République, autoriser par ordonnance motivée les officiers et agents de police judiciaire commis sur commission rogatoire à mettre en place un dispositif technique ayant pour objet, sans le consentement des intéressés, d’accéder, en tous lieux, à des données informatiques, de les enregistrer, les conserver et les transmettre, telles qu’elles s’affichent sur un écran pour l’utilisateur d’un système de traitement automatisé de données, telles qu’il les y introduit par saisie de caractères ou telles qu’elles sont reçues et émises par des périphériques audiovisuels. Ces opérations sont effectuées sous l’autorité et le contrôle du juge d’instruction. |
a) Après les mots : « les nécessités », il est inséré les mots : « de l’enquête ou » ; |
|
b) Les mots : « le juge d’instruction peut, après avis du procureur de la République » sont remplacés par les mots : « le juge des libertés et de la détention, sur requête du procureur de la République, ou le juge d’instruction, après avis du procureur de la République, peut » ; |
||
c) Après les mots : « et les transmettre », il est inséré les mots : « , telles qu’elles sont stockées dans un système informatique, » ; |
||
d) Après les mots : « le contrôle », il est inséré les mots : « du juge des libertés et de la détention ou » ; |
||
|
Art. 706-102-2. – À peine de nullité, les décisions du juge d’instruction prises en application de l’article 706-102-1 précisent l’infraction qui motive le recours à ces opérations, la localisation exacte ou la description détaillée des systèmes de traitement automatisé de données ainsi que la durée des opérations. |
6° À l’article 706-102-2 et au premier alinéa de l’article 706-102-4, après les mots : « les décisions », il est inséré les mots : « du juge des libertés et de la détention ou » ; |
6° (Sans modification) |
Art. 706-102-4. – Les opérations prévues à la présente section ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre objet que la recherche et la constatation des infractions visées dans les décisions du juge d’instruction. |
||
Le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles visées dans ces décisions ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. |
||
7° L’article 706-102-3 est ainsi modifié : |
7° (Alinéa sans modification) | |
a) Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : |
a) (Alinéa sans modification) | |
Art. 706-102-3. – Les décisions mentionnées à l’article 706-102-2 sont prises pour une durée maximale de quatre mois. Si les nécessités de l’instruction l’exigent, l’opération de captation des données informatiques peut, à titre exceptionnel et dans les mêmes conditions de forme, faire l’objet d’une prolongation supplémentaire de quatre mois. |
« Lorsqu’elles interviennent au cours de l’enquête, |
« Lorsqu’elles interviennent au cours de l’enquête, les décisions mentionnées à l’article 706-102-2 sont prises pour une durée maximale d’un mois, renouvelable une fois dans les mêmes conditions de forme et de durée. amendement CL258 |
« Lorsqu’elles interviennent au cours de l’instruction, ces décisions sont prises pour une durée maximale de quatre mois, renouvelable dans les mêmes conditions de forme et de durée, sans que la durée totale des opérations ne puisse excéder deux ans. » ; |
(Alinéa sans modification) | |
|
Le juge d’instruction peut, à tout moment, ordonner l’interruption de l’opération. |
b) Au début du deuxième alinéa sont insérés les mots : « Le juge des libertés et de la détention ou » ; |
b) (Sans modification) |
8° L’article 706-102-5 est ainsi modifié : |
8° (Alinéa sans modification) | |
Art. 706-102-5. – En vue de mettre en place le dispositif technique mentionné à l’article 706-102-1, le juge d’instruction peut autoriser l’introduction dans un véhicule ou dans un lieu privé, y compris hors des heures prévues à l’article 59, à l’insu ou sans le consentement du propriétaire ou du possesseur du véhicule ou de l’occupant des lieux ou de toute personne titulaire d’un droit sur celui-ci.S’il s’agit d’un lieu d’habitation et que l’opération doit intervenir hors des heures prévues à l’article 59, cette autorisation est délivrée par le juge des libertés et de la détention saisi à cette fin par le juge d’instruction. Ces opérations, qui ne peuvent avoir d’autre fin que la mise en place du dispositif technique, sont effectuées sous l’autorité et le contrôle du juge d’instruction. Le présent alinéa est également applicable aux opérations ayant pour objet la désinstallation du dispositif technique ayant été mis en place. |
a) |
a) Le premier alinéa est ainsi modifié : |
– à la première phrase, après la référence : « 706-102-1, », sont insérés les mots : « le juge des libertés et de la détention, sur requête du procureur de la République, ou » ; amendement CL259 | ||
– à la deuxième phrase, après les mots : « à cette fin », sont insérés les mots : « par le procureur de la République ou » ; | ||
– à l’avant-dernière phrase, après le mot : « contrôle », sont insérés les mots : « du juge des libertés et de la détention ou » ; | ||
En vue de mettre en place le dispositif technique mentionné à l’article 706-102-1, le juge d’instruction peut également autoriser la transmission par un réseau de communications électroniques de ce dispositif. Ces opérations sont effectuées sous l’autorité et le contrôle du juge d’instruction. Le présent alinéa est également applicable aux opérations ayant pour objet la désinstallation du dispositif technique ayant été mis en place. |
b) |
b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié : |
– à la première phrase, après la référence : « 706-102-1, », sont insérés les mots : « le juge des libertés et de la détention, sur requête du procureur de la République, ou » ; amendement CL259 | ||
– à la deuxième phrase, après le mot : « contrôle », sont insérés les mots : « du juge des libertés et de la détention ou » ; | ||
La mise en place du dispositif technique mentionné à l’article 706-102-1 ne peut concerner les systèmes automatisés de traitement des données se trouvant dans les lieux visés aux articles 56-1, 56-2 et 56-3 ni être réalisée dans le véhicule, le bureau ou le domicile des personnes visées à l’article 100-7. |
||
Art. 706-102-6. – Le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire commis par lui peut requérir tout agent qualifié d’un service, d’une unité ou d’un organisme placé sous l’autorité ou la tutelle du ministre de l’intérieur ou du ministre de la défense et dont la liste est fixée par décret en vue de procéder à l’installation des dispositifs techniques mentionnés à l’article 706-102-1. |
9° À l’article 706-102-6 et aux premiers alinéas des articles 706-102-7 et 706-102-8, après les mots : « commis par lui » sont insérés les mots : « ou requis par le procureur de la République ». |
9° (Sans modification) |
Art. 706-102-7. – Le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire commis par lui dresse procès-verbal de chacune des opérations de mise en place du dispositif technique mentionné à l’article 706-102-1 et des opérations de captation des données informatiques. Ce procès-verbal mentionne la date et l’heure auxquelles l’opération a commencé et celles auxquelles elle s’est terminée. |
||
Les enregistrements des données informatiques sont placés sous scellés fermés. |
||
Art. 706-102-8. – Le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire commis par lui décrit ou transcrit, dans un procès-verbal qui est versé au dossier, les données qui sont utiles à la manifestation de la vérité. Aucune séquence relative à la vie privée étrangère aux infractions visées dans les décisions autorisant la mesure ne peut être conservée dans le dossier de la procédure. |
||
Les données en langue étrangère sont transcrites en français avec l’assistance d’un interprète requis à cette fin. |
||
Article 4 |
Article 4 | |
Art. 706-22-1. – Par dérogation aux dispositions de l’article 712-10, sont seuls compétents le juge de l’application des peines du tribunal de grande instance de Paris, le tribunal de l’application des peines de Paris et la chambre de l’application des peines de la cour d’appel de Paris pour prendre les décisions concernant les personnes condamnées pour une infraction entrant dans le champ d’application de l’article 706-16, quel que soit le lieu de détention ou de résidence du condamné. |
À l’article 706-22-1 du code de procédure pénale, les mots : « pour une infraction entrant dans le champ d’application de l’article 706-16 » sont remplacés par les mots : « par le tribunal correctionnel, la cour d’assises, le juge des enfants, le tribunal pour enfants ou la cour d’assises des mineurs de Paris statuant en application de l’article 706-17 ». |
(Sans modification) |
Ces décisions sont prises après avis du juge de l’application des peines compétent en application de l’article 712-10. |
||
Pour l’exercice de leurs attributions, les magistrats des juridictions mentionnées au premier alinéa peuvent se déplacer sur l’ensemble du territoire national, sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 706-71 sur l’utilisation de moyens de télécommunication. |
||
Code pénal |
||
Art. 132-45. – La juridiction de condamnation ou le juge de l’application des peines peut imposer spécialement au condamné l’observation de l’une ou de plusieurs des obligations suivantes : |
||
1° Exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle ; |
||
2° Etablir sa résidence en un lieu déterminé ; |
||
3° Se soumettre à des mesures d’examen médical, de traitement ou de soins, même sous le régime de l’hospitalisation. Ces mesures peuvent consister en l’injonction thérapeutique prévue par les articles L. 3413-1 à L. 3413-4 du code de la santé publique, lorsqu’il apparaît que le condamné fait usage de stupéfiants ou fait une consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques. Une copie de la décision ordonnant ces mesures est adressée par le juge de l’application des peines au médecin ou au psychologue qui doit suivre la personne condamnée. Les rapports des expertises réalisées pendant la procédure sont adressés au médecin ou au psychologue, à leur demande ou à l’initiative du juge de l’application des peines. Celui-ci peut également leur adresser toute autre pièce utile du dossier ; |
||
4° Justifier qu’il contribue aux charges familiales ou acquitte régulièrement les pensions alimentaires dont il est débiteur ; |
||
5° Réparer en tout ou partie, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par l’infraction, même en l’absence de décision sur l’action civile ; |
||
6° Justifier qu’il acquitte en fonction de ses facultés contributives les sommes dues au Trésor public à la suite de la condamnation ; |
||
7° S’abstenir de conduire certains véhicules déterminés par les catégories de permis prévues par le code de la route ; |
||
7° bis Sous réserve de son accord, s’inscrire et se présenter aux épreuves du permis de conduire, le cas échéant après avoir suivi des leçons de conduite ; |
||
8° Ne pas se livrer à l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise ou ne pas exercer une activité impliquant un contact habituel avec des mineurs ; |
||
9° S’abstenir de paraître en tout lieu, toute catégorie de lieux ou toute zone spécialement désignés ; |
||
10° Ne pas engager de paris, notamment dans les organismes de paris mutuels, et ne pas prendre part à des jeux d’argent et de hasard ; |
||
11° Ne pas fréquenter les débits de boissons ; |
||
12° Ne pas fréquenter certains condamnés, notamment les auteurs ou complices de l’infraction ; |
||
13° S’abstenir d’entrer en relation avec certaines personnes, dont la victime, ou certaines catégories de personnes, et notamment des mineurs, à l’exception, le cas échéant, de ceux désignés par la juridiction ; |
||
14° Ne pas détenir ou porter une arme ; |
||
15° En cas d’infraction commise à l’occasion de la conduite d’un véhicule terrestre à moteur, accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ; |
||
16° S’abstenir de diffuser tout ouvrage ou oeuvre audiovisuelle dont il serait l’auteur ou le coauteur et qui porterait, en tout ou partie, sur l’infraction commise et s’abstenir de toute intervention publique relative à cette infraction ; les dispositions du présent alinéa ne sont applicables qu’en cas de condamnation pour crimes ou délits d’atteintes volontaires à la vie, d’agressions sexuelles ou d’atteintes sexuelles ; |
||
17° Remettre ses enfants entre les mains de ceux auxquels la garde a été confiée par décision de justice ; |
||
18° Accomplir un stage de citoyenneté ; |
||
19° En cas d’infraction commise soit contre son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, soit contre ses enfants ou ceux de son conjoint, concubin ou partenaire, résider hors du domicile ou de la résidence du couple et, le cas échéant, s’abstenir de paraître dans ce domicile ou cette résidence ou aux abords immédiats de celui-ci, ainsi que, si nécessaire, faire l’objet d’une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique ; les dispositions du présent 19° sont également applicables lorsque l’infraction est commise par l’ancien conjoint ou concubin de la victime, ou par la personne ayant été liée à elle par un pacte civil de solidarité, le domicile concerné étant alors celui de la victime. Pour l’application du présent 19°, l’avis de la victime est recueilli, dans les meilleurs délais et par tous moyens, sur l’opportunité d’imposer au condamné de résider hors du logement du couple. Sauf circonstances particulières, cette mesure est prise lorsque sont en cause des faits de violences susceptibles d’être renouvelés et que la victime la sollicite. La juridiction peut préciser les modalités de prise en charge des frais afférents à ce logement ; |
||
20° Accomplir à ses frais un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes ; |
||
21° Obtenir l’autorisation préalable du juge de l’application des peines pour tout déplacement à l’étranger. |
Article 4 bis (nouveau) | |
L’article 132-45 du code pénal est complété par un 22° ainsi rédigé : | ||
« 22° En cas d’infraction aux articles 421-1 à 421-6, faire l’objet d’une prise en charge sanitaire, sociale, éducative ou psychologique. » amendement CL260 | ||
Code de la sécurité intérieure |
Article 4 ter (nouveau) | |
Art. L. 811-4. – Un décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, désigne les services, autres que les services spécialisés de renseignement, relevant des ministres de la défense et de l’intérieur ainsi que des ministres chargés de l’économie, du budget ou des douanes, qui peuvent être autorisés à recourir aux techniques mentionnées au titre V du présent livre dans les conditions prévues au même livre. Il précise, pour chaque service, les finalités mentionnées à l’article L. 811-3 et les techniques qui peuvent donner lieu à autorisation. |
À la première phrase de l’article L. 811-4 du code de la sécurité intérieure, les mots : « et de l’intérieur » sont remplacés par les mots : « , de l’intérieur et de la justice ». amendements CL16, | |
Chapitre II |
Chapitre II | |
Dispositions renforçant la protection des témoins |
Dispositions renforçant la protection des témoins | |
Article 5 |
Article 5 | |
Le code de procédure pénale est ainsi modifié : |
(Alinéa sans modification) | |
1° Après l’article 306, il est inséré un article 306-1 ainsi rédigé : |
1° (Alinéa sans modification) | |
« Art. 306-1. - Pour le jugement des crimes contre l’humanité mentionnés au sous-titre Ier du titre Ier du livre II du code pénal, du crime de disparition forcée mentionné à l’article 221-12 du même code, des crimes de tortures ou d’actes de barbarie mentionnés aux articles 222-1 à 222-6 dudit code , des crimes de guerre mentionnés au chapitre Ier du livre IV bis du même code, et des crimes mentionnés à l’article 706-73 du présent code, la cour, sans l’assistance du jury, peut |
« Art. 306-1. – Pour le jugement des crimes contre l’humanité mentionnés au sous-titre Ier du titre Ier du livre II du code pénal, du crime de disparition forcée mentionné à l’article 221-12 du même code, des crimes de tortures ou d’actes de barbarie mentionnés aux articles 222-1 à 222-6 dudit code, des crimes de guerre mentionnés au chapitre Ier du livre IV bis du même code et des crimes mentionnés à l’article 706-73 du présent code, la cour, sans l’assistance du jury, peut, par un arrêt rendu en audience publique, ordonner le huis clos pour le temps de l’audition d’un témoin si la déposition publique de celui-ci est de nature à mettre gravement en danger sa vie ou son intégrité physique, ou celles des membres de sa famille ou de ses proches. » ; amendements CL261 et CL355 | |
2° Après l’article 400, il est inséré un article 400-1 ainsi rédigé : |
2° (Alinéa sans modification) | |
« Art. 400-1. - Pour le jugement des délits de guerre mentionnés au chapitre Ier du livre IV bis du code pénal et des délits mentionnés à l’article 706-73 du présent code, le tribunal peut, par jugement rendu en audience publique, ordonner le huis clos pour le temps de l’audition d’un témoin, si la déposition publique de celui-ci est de nature à mettre gravement en danger sa vie ou son intégrité physique |
« Art. 400-1. – Pour le jugement des délits de guerre mentionnés au chapitre Ier du livre IV bis du code pénal et des délits mentionnés à l’article 706-73 du présent code, le tribunal peut, par jugement rendu en audience publique, ordonner le huis clos pour le temps de l’audition d’un témoin si la déposition publique de celui-ci est de nature à mettre gravement en danger sa vie ou son intégrité physique, ou celles des membres de sa famille ou de ses proches. » amendement CL355 | |
Article 6 |
Article 6 | |
Après l’article 706-62 du même code, il est inséré deux articles ainsi rédigés : |
(Alinéa sans modification) | |
« Art. 706-62-1. - En cas de procédure portant sur un crime ou sur un délit puni d’au moins trois ans d’emprisonnement, lorsque la révélation de l’identité d’un témoin est susceptible de mettre en danger sa vie ou son intégrité physique |
« Art. 706-62-1. – En cas de procédure portant sur un crime ou sur un délit puni d’au moins trois ans d’emprisonnement, lorsque la révélation de l’identité d’un témoin est susceptible de mettre gravement en danger sa vie ou son intégrité physique, ou celles des membres de sa famille ou de ses proches, le juge d’instruction ou le président de la juridiction de jugement statuant en chambre du conseil peut ordonner, soit d’office, soit à la demande du procureur de la République ou des parties, que cette identité ne soit pas mentionnée au cours des audiences publiques et ne figure pas dans les ordonnances, jugements ou arrêts de la juridiction d’instruction ou de jugement qui sont susceptibles d’être rendus publics. amendements CL262, CL177, CL263, CL178 et CL264 | |
« Le juge d’instruction adresse sans délai copie de la décision |
« Le juge d’instruction adresse sans délai copie de la décision prise en application du premier alinéa au procureur de la République et aux parties. amendement CL265 | |
« La décision ordonnant la confidentialité de l’identité du témoin n’est pas susceptible de recours. amendement CL266 | ||
« Le témoin est alors désigné au cours des audiences ou dans les ordonnances, jugements ou arrêts par un numéro que lui attribue le juge d’instruction ou le président de la juridiction de jugement. |
(Alinéa sans modification) | |
|
Alinéa supprimé amendement CL266 | |
« Le fait de révéler |
« Le fait de révéler l’identité d’un témoin ayant bénéficié des dispositions du présent article ou de diffuser des informations permettant son identification ou sa localisation est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende. amendement CL368 | |
« Art. 706-62-2. – Sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 706-58, en cas de procédure portant sur un crime ou un délit mentionné aux articles 628, 706-73 et 706-73-1, lorsque l’audition d’une personne mentionnée à l’article 706-57 est susceptible de mettre gravement en danger la vie ou l’intégrité physique de cette personne, des membres de sa famille ou de ses proches, |
« Art. 706-62-2. – Sans préjudice de l’application de l’article 706-58, en cas de procédure portant sur un crime ou un délit mentionné aux articles 628, 706-73 et 706-73-1, lorsque l’audition d’une personne mentionnée à l’article 706-57 est susceptible de mettre gravement en danger la vie ou l’intégrité physique de cette personne, des membres de sa famille ou de ses proches, cette personne fait l’objet, en tant que de besoin, ‘de mesures de protection destinées à assurer sa sécurité. amendements CL268 et CL269 | |
« En cas de nécessité, |
« En cas de nécessité, elle peut être autorisée, par ordonnance motivée rendue par le président du tribunal de grande instance, à faire usage d’une identité d’emprunt. amendement CL267 | |
« Toutefois, il ne peut pas être fait usage de cette identité d’emprunt pour une audition au cours de la procédure mentionnée au premier alinéa. |
(Alinéa sans modification) | |
« Le fait de révéler |
« Le fait de révéler qu’une personne fait usage d’une identité d’emprunt en application du présent article ou de révéler tout élément permettant son identification ou sa localisation est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende. Lorsque cette révélation a eu pour conséquence, directe ou indirecte, des violences à l’encontre de cette personne ou de son conjoint, de ses enfants ou de ses ascendants directs, les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 € d’amende. amendements CL270, CL271, CL272, CL273 et CL274 | |
« Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 € d’amende lorsque cette révélation a |
« Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 € d’amende lorsque cette révélation a eu pour conséquence, directe ou indirecte, la mort de cette personne ou de son conjoint, de ses enfants ou de ses ascendants directs. amendements CL273 et CL274 | |
« Les mesures de protection sont définies, sur réquisition du procureur de la République par la commission nationale prévue à l’article 706-63-1. Cette commission assure le suivi des mesures de protection, qu’elle peut modifier ou auxquelles elle peut mettre fin à tout moment. En cas d’urgence les services compétents prennent les mesures nécessaires et en informent sans délai la commission nationale. |
« Les mesures de protection mentionnées au premier alinéa du présent article sont définies, sur réquisitions du procureur de la République, par la commission nationale prévue à l’article 706-63-1. Cette commission assure le suivi des mesures de protection, qu’elle peut modifier ou auxquelles elle peut mettre fin à tout moment. En cas d’urgence, les services compétents prennent les mesures nécessaires et en informent sans délai la commission nationale. amendements CL275 et CL276 | |
|
« Les membres de la famille et les proches de la personne mentionnée au premier alinéa du présent article peuvent également faire l’objet de mesures de protection et être autorisés à faire usage d’une identité d’emprunt, dans les conditions prévues au présent article. amendement CL277 | |
« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. » |
(Alinéa sans modification) | |
Chapitre III |
Chapitre III | |
Dispositions améliorant la lutte contre les infractions |
Dispositions améliorant la lutte contre les infractions amendement CL278 rect. | |
Article 7 |
Article 7 | |
Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié : |
(Alinéa sans modification) | |
1° L’article L. 312-3 est ainsi modifié : |
1° (Sans modification) | |
a) Les deux premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes : |
||
Art. L. 312-3. – Nul ne peut acquérir et détenir légalement des matériels ou des armes des catégories B et C s’il ne remplit pas les conditions suivantes : |
« Sont interdites d’acquisition et de détention d’armes de catégories B, C et D : |
|
1° Disposer d’un bulletin n° 2 de son casier judiciaire ne comportant pas de mention de condamnation pour l’une des infractions suivantes : |
« 1° Les personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire comporte une mention de condamnation pour l’une des infractions suivantes : » ; |
|
– meurtre, assassinat ou empoisonnement prévus aux articles 221-1 et suivants du code pénal ; |
||
– tortures et actes de barbarie prévus aux articles 222-1 et suivants du code pénal ; |
||
– violences volontaires prévues aux articles 222-7 et suivants du code pénal ; |
||
– menaces d’atteinte aux personnes prévues aux articles 222-17 et suivants du code pénal ; |
||
– viol et agressions sexuelles prévus aux articles 222-22 et suivants du code pénal ; |
||
– exhibition sexuelle prévue à l’article 222-32 du code pénal ; |
||
– harcèlement sexuel prévu à l’article 222-33 du code pénal ; |
||
– harcèlement moral prévu aux articles 222-33-2 et 222-33-2-1 du code pénal ; |
||
– enregistrement et diffusion d’images de violence prévus à l’article 222-33-3 du code pénal ; |
||
– trafic de stupéfiants prévu aux articles 222-34 et suivants du code pénal ; |
||
– enlèvement et séquestration prévus aux articles 224-1 et suivants du code pénal ; |
||
– détournement d’aéronef, de navire ou de tout autre moyen de transport prévu aux articles 224-6 et suivants du code pénal ; |
||
– traite des êtres humains prévue aux articles 225-4-1 et suivants du code pénal ; |
||
– proxénétisme et infractions qui en résultent prévus aux articles 225-5 et suivants du code pénal ; |
||
– recours à la prostitution des mineurs ou de personnes particulièrement vulnérables prévu aux articles 225-12-1 et suivants du code pénal ; |
||
– exploitation de la mendicité prévue aux articles 225-12-5 et suivants du code pénal ; |
||
– vols prévus aux articles 311-1 et suivants du code pénal ; |
||
– extorsions prévues aux articles 312-1 et suivants du code pénal ; |
||
– recel de vol ou d’extorsion prévu aux articles 321-1 et suivants du code pénal ; |
||
– destructions, dégradations et détériorations dangereuses pour les personnes prévues aux articles 322-5 et suivants du code pénal ; |
||
– menaces de destruction, de dégradation ou de détérioration et fausses alertes prévues aux articles 322-12 et 322-14 du code pénal ; |
||
– blanchiment prévu aux articles 324-1 et suivants du code pénal ; |
||
– participation à un attroupement en étant porteur d’une arme ou provocation directe à un attroupement armé prévues aux articles 431-5 et 431-6 du code pénal ; |
||
– participation à une manifestation ou à une réunion publique en étant porteur d’une arme prévue à l’article 431-10 du code pénal ; |
||
– intrusion dans un établissement d’enseignement scolaire par une personne porteuse d’une arme prévue aux articles 431-24 et 431-25 du code pénal ; |
||
– introduction d’armes dans un établissement scolaire prévue à l’article 431-28 du code pénal ; |
||
– rébellion armée et rébellion armée en réunion prévues à l’article 433-8 du code pénal ; |
||
– destructions, dégradations et détériorations ne présentant pas de danger pour les personnes prévues aux articles 322-1 et suivants du code pénal commises en état de récidive légale ; |
||
– fabrication ou commerce des matériels de guerre ou d’armes ou de munitions de défense sans autorisation prévus et réprimés par les articles L. 2339-2, L. 2339-3 et L. 2339-4 du code de la défense ainsi que par les articles L. 317-1-1, L. 317-2 et L. 317-3-1 du présent code ; |
||
– acquisition, cession ou détention, sans autorisation, d’une ou plusieurs armes ou matériels des catégories A, B, C ou d’armes de catégorie D mentionnées à l’article L. 312-4-2 ou de leurs munitions prévues et réprimées par les articles L. 317-4 ; |
||
– port, transport et expéditions d’armes des catégories A, B, C ou d’armes de la catégorie D soumises à enregistrement sans motif légitime prévus et réprimés par les articles L. 317-8 et L. 317-9 ; |
||
– importation sans autorisation des matériels des catégories A, B, C ou d’armes de la catégorie D énumérées par un décret en Conseil d’État prévue et réprimée par les articles L. 2339-10 et L. 2339-11 du code de la défense ; |
||
– fabrication, vente, exportation, sans autorisation, d’un engin ou produit explosif ou incendiaire, port ou transport d’artifices non détonants prévus et réprimés par les articles L. 2353-4 à L. 2353-13 du code de la défense ; |
||
b) Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes : |
||
2° Ne pas se signaler par un comportement laissant objectivement craindre une utilisation de l’arme ou du matériel dangereuse pour soi-même ou pour autrui. |
« 2° Les personnes condamnées à une peine d’interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation ou condamnées à la confiscation d’une ou de plusieurs armes dont elles sont propriétaires ou dont elles ont la libre disposition en application des articles du code pénal et du présent code qui les prévoient. » ; |
|
2° Après l’article L. 312-3, il est inséré un article L. 312-3-1 ainsi rédigé : |
2° (Alinéa sans modification) | |
« Art. L. 312-3-1. – |
« Art. L. 312-3-1. – L’autorité administrative peut interdire l’acquisition et la détention des armes des catégories B, C et D aux personnes se signalant par un comportement laissant craindre une utilisation de ces armes dangereuse pour elles-mêmes ou pour autrui. » ; amendement CL279 | |
3° Le premier alinéa de l’article L. 312-4 est remplacé par les dispositions suivantes : |
3° (Sans modification) | |
Art. L. 312-4. – L’acquisition et la détention des armes, éléments d’armes et de munitions de catégorie B sont soumises à autorisation dans des conditions définies par un décret en Conseil d’État qui prévoit notamment la présentation de la copie d’une licence de tir en cours de validité délivrée par une fédération sportive ayant reçu délégation du ministre chargé des sports au titre de l’article L. 131-14 du code du sport. |
« L’acquisition et la détention des armes, éléments d’armes et de munitions de catégorie B sont soumises à autorisation dans des conditions définies par un décret en Conseil d’État. Lorsque l’autorisation est délivrée pour la pratique du tir sportif, ce décret prévoit notamment la présentation de la copie d’une licence de tir en cours de validité délivrée par une fédération sportive ayant reçu délégation du ministre chargé des sports au titre de l’article L. 131-14 du code du sport. » ; |
|
Nul ne peut acquérir et détenir légalement des matériels ou des armes, éléments d’armes et munitions classés en catégorie B s’il ne peut produire un certificat médical datant de moins d’un mois, attestant de manière circonstanciée d’un état de santé physique et psychique compatible avec l’acquisition et la détention d’une arme et établi dans les conditions fixées à l’article L. 312-6 du présent code. |
||
Quiconque devient propriétaire par voie successorale ou testamentaire d’une arme de catégorie B, sans être autorisé à la détenir, doit s’en défaire dans un délai de trois mois à compter de la mise en possession, dans les conditions prévues à l’article L. 314-2. |
||
4° L’article L. 312-4-1 est ainsi modifié : |
4° (Alinéa sans modification) | |
Art. L. 312-4-1. – L’acquisition des armes de catégorie C nécessite l’établissement d’une déclaration par l’armurier ou par leur détenteur dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. Pour les personnes physiques, leur acquisition est subordonnée à la production d’un certificat médical datant de moins d’un mois, attestant de manière circonstanciée d’un état de santé physique et psychique compatible avec l’acquisition et la détention d’une arme et établi dans les conditions fixées à l’article L. 312-6 ou, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, à la présentation d’une copie : |
a) Au premier alinéa, les mots : « à l’article L. 312-6 ou, » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 312-6 et, » ; |
a) (Sans modification) |
1° D’un permis de chasser revêtu de la validation de l’année en cours ou de l’année précédente ; |
||
2° D’une licence de tir en cours de validité délivrée par une fédération sportive ayant reçu délégation du ministre chargé des sports au titre de l’article L. 131-14 du code du sport ; |
||
3° Ou d’une carte de collectionneur d’armes délivrée en application de la section 2 du présent chapitre. |
||
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : |
b) (Alinéa sans modification) | |
« Ce décret peut prévoir qu’en raison de leurs caractéristiques techniques ou de leur destination, l’acquisition de certaines armes de catégorie C est dispensée de la présentation des documents mentionnés |
« Ce décret peut prévoir qu’en raison de leurs caractéristiques techniques ou de leur destination, l’acquisition de certaines armes de catégorie C est dispensée de la présentation des documents mentionnés aux 1° à 3° du présent article ou est soumise à la présentation d’autres documents. » ; amendement CL280 | |
Art. l. 312-16. – Un fichier national automatisé nominatif recense : |
5° L’article L. 312-16 est ainsi modifié : |
5° (Alinéa sans modification) |
1° Les personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes en application des articles L. 312-10 et L. 312-13 ; |
||
a) Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes : |
a) (Alinéa sans modification) | |
2° Les personnes condamnées à une peine d’interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation ou condamnées à la confiscation d’une ou de plusieurs armes dont elles sont propriétaires ou dont elles ont la libre disposition en application des articles du code pénal et du présent code qui les prévoient. |
« 2° Les personnes interdites d’acquisition et de détention |
« 2° Les personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes des catégories B, C et D en application de l’article L. 312-3 ; » amendement CL281 |
b) Après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé : |
b) (Alinéa sans modification) | |
« 3° Les personnes interdites d’acquisition et de détention en application de l’article L. 312-3-1. » |
« 3° Les personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes des catégories B, C et D en application de l’article L. 312-3-1. » amendement CL282 | |
Les modalités d’application du présent article, y compris la nature des informations enregistrées, la durée de leur conservation ainsi que les autorités et les personnes qui y ont accès, sont déterminées par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. |
||
Article 8 |
Article 8 | |
Code de procédure pénale |
Le code de procédure pénale est ainsi modifié : |
(Alinéa sans modification) |
Art. 706-55. – Le fichier national automatisé des empreintes génétiques centralise les traces et empreintes génétiques concernant les infractions suivantes : |
||
1° Les infractions de nature sexuelle visées à l’article 706-47 du présent code ainsi que le délit prévu par l’article 222-32 du code pénal ; |
||
2° Les crimes contre l’humanité et les crimes et délits d’atteintes volontaires à la vie de la personne, de torture et actes de barbarie, de violences volontaires, de menaces d’atteintes aux personnes, de trafic de stupéfiants, d’atteintes aux libertés de la personne, de traite des êtres humains, de proxénétisme, d’exploitation de la mendicité et de mise en péril des mineurs, prévus par les articles 221-1 à 221-5, 222-1 à 222-18, 222-34 à 222-40,224-1 à 224-8,225-4-1 à 225-4-4, 225-5 à 225-10, 225-12-1 à 225-12-3, 225-12-5 à 225-12-7 et 227-18 à 227-21 du code pénal ; |
||
3° Les crimes et délits de vols, d’extorsions, d’escroqueries, de destructions, de dégradations, de détériorations et de menaces d’atteintes aux biens prévus par les articles 311-1 à 311-13,312-1 à 312-9,313-2 et 322-1 à 322-14 du code pénal ; |
||
4° Les atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation, les actes de terrorisme, la fausse monnaie, l’association de malfaiteurs et les crimes et délits de guerre prévus par les articles 410-1 à 413-12,421-1 à 421-4,442-1 à 442-5,450-1 et 461-1 à 461-31 du code pénal ; |
||
1° Le 5° de l’article 706-55 est remplacé par les dispositions suivantes : |
1° (Alinéa sans modification) | |
5° Les délits prévus par les articles L. 2353-4 et L. 2339-1 à L. 2339-11 du code de la défense ; |
« 5° Les délits prévus |
« 5° Les délits prévus aux articles L. 2339-2, L. 2339-3, L. 2339-4, L. 2339-4-1, L. 2339-10 à L. 2339-11-2, L. 2353-4 et L. 2353-13 du code de la défense et aux articles L. 317-1-1 à L. 317-9 et L. 317-9-2 du code de la sécurité intérieure ; » amendement CL283 |
6° Les infractions de recel ou de blanchiment du produit de l’une des infractions mentionnées aux 1° à 5°, prévues par les articles 321-1 à 321-7 et 324-1 à 324-6 du code pénal. |
||
Art. 706-73. – La procédure applicable à l’enquête, la poursuite, l’instruction et le jugement des crimes et des délits suivants est celle prévue par le présent code, sous réserve des dispositions du présent titre : |
||
1° Crime de meurtre commis en bande organisée prévu par le 8° de l’article 221-4 du code pénal ; |
||
2° Crime de tortures et d’actes de barbarie commis en bande organisée prévu par l’article 222-4 du code pénal ; |
||
3° Crimes et délits de trafic de stupéfiants prévus par les articles 222-34 à 222-40 du code pénal ; |
||
4° Crimes et délits d’enlèvement et de séquestration commis en bande organisée prévus par l’article 224-5-2 du code pénal ; |
||
5° Crimes et délits aggravés de traite des êtres humains prévus par les articles 225-4-2 à 225-4-7 du code pénal ; |
||
6° Crimes et délits aggravés de proxénétisme prévus par les articles 225-7 à 225-12 du code pénal ; |
||
7° Crime de vol commis en bande organisée prévu par l’article 311-9 du code pénal ; |
||
8° Crimes aggravés d’extorsion prévus par les articles 312-6 et 312-7 du code pénal ; |
||
8° bis (Abrogé) ; |
||
9° Crime de destruction, dégradation et détérioration d’un bien commis en bande organisée prévu par l’article 322-8 du code pénal ; |
||
10° Crimes en matière de fausse monnaie prévus par les articles 442-1 et 442-2 du code pénal ; |
||
11° Crimes et délits constituant des actes de terrorisme prévus par les articles 421-1 à 421-6 du code pénal ; |
||
2° Le 12° de l’article 706-73 est remplacé par les dispositions suivantes : |
2° (Alinéa sans modification) | |
12° Délits en matière d’armes et de produits explosifs commis en bande organisée, prévus par les articles L. 2339-2, L. 2339-3, L. 2339-10, L. 2341-4, L. 2353-4 et L. 2353-5 du code de la défense ainsi que par les articles L. 317-2, L. 317-4 et L. 317-7 du code de la sécurité intérieure ; |
« 12° Délits en matière d’armes et de produits explosifs prévus |
« 12° Délits en matière d’armes et de produits explosifs prévus aux articles L. 2339-2, L. 2339-3, L. 2339-10, L. 2341-4, L. 2353-4 et L. 2353-5 du code de la défense ainsi qu’aux articles L. 317-2, L. 317-4, L. 317-7 et au 1° de l’article L. 317-8 du code de la sécurité intérieure ; » amendement CL284 |
13° Délits d’aide à l’entrée, à la circulation et au séjour irréguliers d’un étranger en France commis en bande organisée prévus par l’article L. 622-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; |
||
14° Délits de blanchiment prévus par les articles 324-1 et 324-2 du code pénal, ou de recel prévus par les articles 321-1 et 321-2 du même code, du produit, des revenus, des choses provenant des infractions mentionnées aux 1° à 13° ; |
||
15° Délits d’association de malfaiteurs prévus par l’article 450-1 du code pénal, lorsqu’ils ont pour objet la préparation de l’une des infractions mentionnées aux 1° à 14° et 17° ; |
||
16° Délit de non-justification de ressources correspondant au train de vie, prévu par l’article 321-6-1 du code pénal, lorsqu’il est en relation avec l’une des infractions mentionnées aux 1° à 15° et 17° ; |
||
17° Crime de détournement d’aéronef, de navire ou de tout autre moyen de transport commis en bande organisée prévu par l’article 224-6-1 du code pénal ; |
||
18° Crimes et délits punis de dix ans d’emprisonnement, contribuant à la prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs entrant dans le champ d’application de l’article 706-167 ; |
||
19° Délit d’exploitation d’une mine ou de disposition d’une substance concessible sans titre d’exploitation ou autorisation, accompagné d’atteintes à l’environnement, commis en bande organisée, prévu à l’article L. 512-2 du code minier, lorsqu’il est connexe avec l’une des infractions mentionnées aux 1° à 17° du présent article ; |
||
20° (Abrogé). |
||
Pour les infractions visées aux 3°, 6° et 11°, sont applicables, sauf précision contraire, les dispositions du présent titre ainsi que celles des titres XV, XVI et XVII. |
||
3° Au chapitre II du titre XXV du livre IV, il est ajouté une section 9 ainsi rédigée : |
3° (Alinéa sans modification) | |
« Section 9 |
(Alinéa sans modification) | |
« Dispositions spécifiques à certaines infractions |
(Alinéa sans modification) | |
« Art. 706-106-1. – Sans préjudice |
« Art. 706-106-1. – Sans préjudice des articles 706-81 à 706-87 et aux seules fins de constater les infractions mentionnées au 12° de l’article 706-73, d’en identifier les auteurs et les complices et d’effectuer les saisies prévues au présent code, les officiers de police judiciaire et les agents de police judiciaire placés sous leur autorité peuvent, avec l’autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction saisi des faits qui en avise préalablement le parquet, sans être pénalement responsables de ces actes : amendements CL285, CL286, CL287 et CL288 | |
« 1° Acquérir des armes ; |
« 1° (Sans modification) | |
« 2° En vue de l’acquisition d’armes, mettre à la disposition des personnes se livrant à ces infractions des moyens de caractère juridique ou financier ainsi que des moyens de transport, de dépôt, d’hébergement, de conservation et de télécommunication. |
« 2° (Sans modification) | |
« À peine de nullité, l’autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction, qui peut être donnée par tout moyen, est mentionnée ou versée au dossier de la procédure et les actes autorisés ne peuvent constituer une incitation à commettre une infraction. » |
||
Article 9 |
Article 9 | |
I. – Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié : |
I. – (Alinéa sans modification) | |
Code de la sécurité intérieure |
1° L’article L. 317-4 est ainsi modifié : |
1° (Sans modification) |
Art. L. 317-4. – Sont punies de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende l’acquisition, la cession ou la détention, sans l’autorisation prévue à l’article L. 313-3, d’une ou de plusieurs armes des catégories A ou B, de munitions ou de leurs éléments essentiels en violation des articles L. 312-1 à L. 312-4-3, L. 314-2 ou L. 314-3. |
a) Au premier alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq », la somme de « 45 000 » par la somme de « 75 000 », les mots : « sans l’autorisation prévue à l’article L. 313-3 » sont remplacés par les mots : « sans l’autorisation prévue au I de l’article L. 2332-1 du code de la défense » et après les mots : « ou L. 314-3 » sont insérés les mots : « du présent code » ; |
|
La peine d’emprisonnement est portée à cinq ans et l’interdiction de séjour peut être prononcée suivant les modalités prévues par l’article 131-31 du code pénal, si le coupable a été antérieurement condamné à l’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit. |
b) Au deuxième alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « sept » ; |
|
Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 500 000 € d’amende lorsque l’infraction est commise en bande organisée. |
||
Le tribunal ordonne, en outre, la confiscation des armes ou des munitions. |
||
Art. L. 317-5. – Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende le fait d’acquérir ou de détenir des armes et des munitions en violation d’une interdiction prévue à l’article L. 312-10 ou à l’article L. 312-13. |
2° À l’article L. 317-5, les mots : « à l’article L. 312-10 ou à l’article L. 312-13 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 312-3, L. 312-3-1, L. 312-10 et L. 312-13 » ; |
2° (Sans modification) |
Art. L. 317-7. – La détention d’un dépôt d’armes ou de munitions des catégories A, B, ainsi que des armes de la catégorie D figurant sur une liste fixée par un décret en Conseil d’État, est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende. |
3° Au premier alinéa de l’article L. 317-7, la somme : « 3 750 € » est remplacée par la somme : « 75 000 € » ; |
3° (Sans modification) |
Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 500 000 € d’amende lorsque l’infraction est commise en bande organisée. |
||
La peine est portée à dix ans d’emprisonnement et la peine complémentaire d’interdiction de séjour peut être prononcée suivant les modalités prévues par l’article 131-31 du code pénal lorsque le coupable a antérieurement été condamné à l’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit. |
||
Le tribunal ordonne, en outre, la confiscation des armes ou des munitions. |
||
Ces dispositions ne sont pas applicables, dans la mesure où ils exercent leur industrie ou leur commerce, aux fabricants et aux vendeurs régulièrement autorisés. |
||
Art. L. 317-8. – Quiconque, hors de son domicile et sauf les exceptions résultant des articles L. 315-1 et L. 315-2, est trouvé porteur ou effectue sans motif légitime le transport de matériels de guerre, d’une ou plusieurs armes, de leurs éléments essentiels ou de munitions, même s’il en est régulièrement détenteur, est puni : |
||
1° S’il s’agit de matériels de guerre mentionnés à l’article L. 311-2, d’armes, de leurs éléments essentiels ou de munitions des catégories A ou B, de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende ; |
||
4° Après le deuxième alinéa l’article L. 317-8, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
4° (Alinéa sans modification) | |
« |
« La peine d’emprisonnement peut être portée à dix ans si l’auteur des faits a été antérieurement condamné pour un ou plusieurs crimes ou délits mentionnés aux articles 706-73 et 706-73-1 du code de procédure pénale à une peine égale ou supérieure à un an d’emprisonnement ferme ; ». amendements CL289 et CL290 | |
2° S’il s’agit d’armes, de leurs éléments essentiels ou de munitions de la catégorie C, de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende ; |
||
3° S’il s’agit d’armes, de munitions ou de leurs éléments de la catégorie D, à l’exception de ceux qui présentent une faible dangerosité et figurent sur une liste fixée par arrêté, d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende. |
||
Code de la défense |
||
II. – L’article L. 2339-10 du code de la défense est ainsi modifié : |
II. – (Sans modification) | |
Art. L. 2339-10. – Est punie de cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de 9 000 euros l’importation, sans autorisation, des matériels des catégories A, B, C et D figurant sur une liste fixée par un décret en Conseil d’État. |
1° Au premier alinéa, la somme : « 9 000 € » est remplacée par la somme : « 75 000 € » ; |
|
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
||
« Le fait de contrevenir aux dispositions du I de l’article L. 2335-17 est puni des mêmes peines. » |
||
Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 500 000 euros d’amende lorsque l’infraction est commise en bande organisée. |
||
La tentative des délits prévus aux alinéas précédents est punie des mêmes peines. |
||
Art. L. 2339-14. – Les infractions définies au premier alinéa du I de l’article L. 2339-2, à l’article L. 2339-4 et au premier alinéa de l’article L. 2339-10 du présent code, ainsi qu’au premier alinéa des articles L. 317-4 et L. 317-7 et au 1° de l’article L. 317-8 du code de la sécurité intérieure, sont punies de quinze ans de réclusion criminelle et un million et demi d’euros d’amende lorsqu’elles concernent des missiles, fusées ou autres systèmes sans pilote capables de conduire à leur cible des armes nucléaires telles que définies au III de l’article L. 1333-13-4, chimiques ou biologiques et spécialement conçus à cet usage. |
III (nouveau). – Au premier alinéa de l’article L. 2339-14 du même code, la référence : « au premier alinéa de l’article L. 2339-10 » est remplacée par la référence : « aux deux premiers alinéas de l’article L. 2339-10 ». amendement CL291 | |
Ces faits sont punis de vingt ans de réclusion criminelle et de trois millions d’euros d’amende lorsqu’ils sont commis en bande organisée. |
||
Article 10 |
Article 10 | |
Code des douanes |
Le code des douanes est ainsi modifié : |
(Alinéa sans modification) |
Art. 67 bis. – (…) II. – Lorsque les investigations le justifient, le procureur de la République peut autoriser qu’il soit procédé, sous son contrôle, à une opération d’infiltration dans les conditions prévues par le présent article afin : |
||
1° De constater les infractions suivantes : |
||
– les infractions douanières d’importation, d’exportation ou de détention de substances ou plantes classées comme stupéfiants, de contrebande de tabac manufacturé, d’alcool et spiritueux ; |
||
– les infractions mentionnées à l’article 414 lorsqu’elles portent sur des marchandises contrefaisantes ; |
1° |
1° L’avant-dernier alinéa du 1° du II de l’article 67 bis est complété par les mots : « , des armes à feu ou leurs éléments, des munitions ou des explosifs » ; amendement CL292 |
– les infractions prévues à l’article 415 ; |
||
2° D’identifier les auteurs et complices de ces infractions ainsi que ceux qui y ont participé comme intéressés au sens de l’article 399 ; |
||
3° D’effectuer les saisies prévues par le présent code. |
||
L’infiltration consiste, pour un agent des douanes spécialement habilité dans des conditions fixées par décret, agissant sous la responsabilité d’un agent de catégorie A chargé de coordonner l’opération, à surveiller des personnes suspectées de commettre un délit douanier en se faisant passer, auprès de ces personnes, comme un de leurs coauteurs, complices ou intéressés à la fraude. L’agent des douanes est à cette fin autorisé à faire usage d’une identité d’emprunt et à commettre si nécessaire les actes mentionnés ci-après. A peine de nullité, ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre des infractions. |
||
L’infiltration fait l’objet d’un rapport rédigé par l’agent de catégorie A ayant coordonné l’opération qui comprend les éléments strictement nécessaires à la constatation des infractions et ne mettant pas en danger la sécurité de l’agent infiltré et des personnes requises au sens du III. (…) |
||
Art. 67 bis-1. – Sans préjudice des dispositions de l’article 67 bis, et aux seules fins de constater l’infraction d’importation, d’exportation ou de détention de produits stupéfiants, d’en identifier les auteurs et complices ainsi que ceux qui y ont participé comme intéressés au sens de l’article 399 et d’effectuer les saisies prévues par le présent code, les agents des douanes habilités par le ministre chargé des douanes dans les conditions fixées par décret peuvent, sur l’ensemble du territoire national, avec l’autorisation du procureur de la République et sans être pénalement responsables de ces actes : |
||
1° Acquérir des produits stupéfiants ; |
||
2° En vue de l’acquisition des produits stupéfiants, mettre à la disposition des personnes se livrant à ces infractions des moyens de caractère juridique ou financier ainsi que des moyens de transport, de dépôt, d’hébergement, de conservation et de télécommunication ; |
||
3° Lorsque l’infraction est commise en ayant recours à un moyen de communication électronique, faire usage d’une identité d’emprunt en vue de l’acquisition des produits stupéfiants. Dans ce cadre, les agents des douanes habilités peuvent également : |
||
a) Participer sous un pseudonyme à des échanges électroniques ; |
||
b) Être en contact sous ce pseudonyme avec les personnes susceptibles d’être les auteurs de l’infraction ; |
||
c) Extraire, acquérir sous ce pseudonyme ou conserver des données sur les personnes susceptibles d’être les auteurs de l’infraction ainsi que sur les comptes bancaires utilisés. |
||
L’exonération de responsabilité prévue au premier alinéa du présent article est également applicable, pour les actes commis à seule fin de procéder à l’opération d’acquisition des produits stupéfiants, aux personnes requises par les agents des douanes pour permettre la réalisation de cette opération. |
||
À peine de nullité, l’autorisation du procureur de la République, qui peut être donnée par tout moyen, est mentionnée ou versée au dossier de la procédure et les actes autorisés ne peuvent constituer une incitation à commettre une infraction. |
||
La révélation de l’identité d’emprunt des agents des douanes ayant effectué l’acquisition est passible des peines prévues au V de l’article 67 bis du présent code. |
||
Le présent article est applicable aux fins de constatation de l’infraction d’importation, d’exportation ou de détention illicite de tabac manufacturé et de marchandises contrefaisantes. |
2° Au dernier alinéa de l’article 67 bis-1, après les mots : « tabac manufacturé », il est inséré les mots : « , d’armes à feu |
2° Au dernier alinéa de l’article 67 bis-1, après le mot : « manufacturé », sont insérés les mots : « , d’armes à feu ou de leurs éléments, de munitions ou d’explosifs ». amendement CL292 et CL293 |
Article 11 |
Article 11 | |
I. – Après l’article 113-2 du code pénal, il est inséré un article 113-2-1 ainsi rédigé : |
I. – (Alinéa sans modification) | |
« Art. 113-2-1. – Tout crime ou tout délit réalisé |
« Art. 113-2-1. – Tout crime ou tout délit réalisé au moyen d’un réseau de communication électronique, lorsqu’il est tenté ou commis au préjudice d’une personne physique résidant sur le territoire de la République ou d’une personne morale dont le siège se situe sur le territoire de la République, est réputé commis sur le territoire de la République. » amendements CL294 et CL295 | |
Code de procédure pénale |
II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié : | |
Art. 43. – Sont compétents le procureur de la République du lieu de l’infraction, celui de la résidence de l’une des personnes soupçonnées d’avoir participé à l’infraction, celui du lieu d’arrestation d’une de ces personnes, même lorsque cette arrestation a été opérée pour une autre cause et celui du lieu de détention d’une de ces personnes, même lorsque cette détention est effectuée pour une autre cause. |
|
1° Le premier alinéa de l’article 43 est complété par une phrase ainsi rédigée : |
« Pour les infractions mentionnées à l’article 113-2-1 du code pénal, est également compétent le procureur de la République du lieu respectif de résidence ou du siège des personnes physiques ou morales mentionnées au même article 113-2-1. » ; amendement CL296 | ||
Lorsque le procureur de la République est saisi de faits mettant en cause, comme auteur ou comme victime, un magistrat, un avocat, un officier public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes ou de l’administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public qui est habituellement, de par ses fonctions ou sa mission, en relation avec les magistrats ou fonctionnaires de la juridiction, le procureur général peut, d’office, sur proposition du procureur de la République et à la demande de l’intéressé, transmettre la procédure au procureur de la République auprès du tribunal de grande instance le plus proche du ressort de la cour d’appel. Cette juridiction est alors territorialement compétente pour connaître l’affaire, par dérogation aux dispositions des articles 52, 382 et 522. La décision du procureur général constitue une mesure d’administration judiciaire qui n’est susceptible d’aucun recours. |
||
Art. 52. – Sont compétents le pôle de l’instruction du lieu de l’infraction, celui de la résidence de l’une des personnes soupçonnées d’avoir participé à l’infraction, celui du lieu d’arrestation d’une de ces personnes, même lorsque cette arrestation a été opérée pour une autre cause et celui du lieu de détention d’une de ces personnes, même lorsque cette détention est effectuée pour une autre cause. |
|
2° L’article 52 est complété par une phrase ainsi rédigée : |
« Pour les infractions mentionnées à l’article 113-2-1 du code pénal, est également compétent le juge d’instruction du lieu respectif de résidence ou du siège des personnes physiques ou morales mentionnées au même article 113-2-1. » ; amendement CL296 | ||
Art. 382. – Est compétent le tribunal correctionnel du lieu de l’infraction, celui de la résidence du prévenu ou celui du lieu d’arrestation ou de détention de ce dernier, même lorsque cette arrestation ou cette détention a été opérée ou est effectuée pour une autre cause. |
||
Pour le jugement du délit d’abandon de famille prévu par l’article 227-3 du code pénal, est également compétent le tribunal du domicile ou de la résidence de la personne qui doit recevoir la pension, la contribution, les subsides ou l’une des autres prestations visées par cet article. |
|
3° Le deuxième alinéa de l’article 382 est complété par une phrase ainsi rédigée : |
« Pour les infractions mentionnées à l’article 113-2-1 du code pénal, est également compétent le tribunal correctionnel du lieu respectif de résidence ou du siège des personnes physiques ou morales mentionnées au même article 113-2-1. » ; amendement CL296 | ||
La compétence du tribunal correctionnel s’étend aux délits et contraventions qui forment avec l’infraction déférée au tribunal un ensemble indivisible ; elle peut aussi s’étendre aux délits et contraventions connexes, au sens de l’article 203. |
||
Titre XXIV |
|
4° (Sans modification) |
De la procédure applicable aux atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données |
||
Art. 706-72. – Les articles 706-80 à 706-87-1,706-95 à 706-103 et 706-105 du présent code sont applicables à l’enquête, à la poursuite, à l’instruction et au jugement des délits prévus à l’article 323-4-1 du code pénal. |
||
Les articles mentionnés au premier alinéa du présent article sont également applicables à l’enquête, à la poursuite, à l’instruction et au jugement du blanchiment des mêmes délits ainsi qu’à l’association de malfaiteurs lorsqu’elle a pour objet la préparation de l’un desdits délits. |
||
Art. 706-73-1. – Le présent titre, à l’exception de l’article 706-88, est également applicable à l’enquête, à la poursuite, à l’instruction et au jugement des délits suivants : |
||
1° Délit d’escroquerie en bande organisée, prévu au dernier alinéa de l’article 313-2 du code pénal ; |
|
5° Le 1° de l’article 706-73-1 est complété par les mots : « , délit d’atteinte aux systèmes de traitement automatisé de données à caractère personnel mis en œuvre par l’État commis en bande organisée, prévu à l’article 323-4-1 du même code et délit d’évasion commis en bande organisée prévu au second alinéa de l’article 434-30 dudit code » ; amendements CL297 et CL298 |
2° Délits de dissimulation d’activités ou de salariés, de recours aux services d’une personne exerçant un travail dissimulé, de marchandage de main-d’œuvre, de prêt illicite de main-d’œuvre ou d’emploi d’étranger sans titre de travail, commis en bande organisée, prévus aux 1° et 3° de l’article L. 8221-1 et aux articles L. 8221-3, L. 8221-5, L. 8224-1, L. 8224-2, L. 8231-1, L. 8234-1, L. 8234-2, L. 8241-1, L. 8243-1, L. 8243-2, L. 8251-1 et L. 8256-2 du code du travail ; |
||
3° Délits de blanchiment, prévus aux articles 324-1 et 324-2 du code pénal, ou de recel, prévus aux articles 321-1 et 321-2 du même code, du produit, des revenus ou des choses provenant des infractions mentionnées aux 1° et 2° du présent article ; |
||
4° Délits d’association de malfaiteurs, prévus à l’article 450-1 du code pénal, lorsqu’ils ont pour objet la préparation de l’une des infractions mentionnées aux 1° à 3° du présent article ; |
||
5° Délit de non-justification de ressources correspondant au train de vie, prévu à l’article 321-6-1 du code pénal, lorsqu’il est en relation avec l’une des infractions mentionnées aux 1° à 4° du présent article. |
||
Art. 706-87-1. – Dans le but de constater les infractions mentionnées aux articles 706-72, 706-73 et 706-73-1 et, lorsque celles-ci sont commises par un moyen de communication électronique, d’en rassembler les preuves et d’en rechercher les auteurs, les officiers ou agents de police judiciaire agissant au cours de l’enquête ou sur commission rogatoire peuvent, s’ils sont affectés dans un service spécialisé désigné par arrêté du ministre de l’intérieur et spécialement habilités à cette fin, procéder aux actes suivants sans en être pénalement responsables : |
6° (nouveau) Au premier alinéa de l’article 706-87-1, la référence : « 706-72, » est supprimée. | |
1° Participer sous un pseudonyme aux échanges électroniques ; |
||
2° Etre en contact par le moyen mentionné au 1° avec les personnes susceptibles d’être les auteurs de ces infractions ; |
||
3° Extraire, acquérir ou conserver par ce moyen les éléments de preuve et les données sur les personnes susceptibles d’être les auteurs de ces infractions ; |
||
4° Extraire, transmettre en réponse à une demande expresse, acquérir ou conserver des contenus illicites, dans des conditions fixées par décret. |
||
À peine de nullité, ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre ces infractions. |
||
Code de l’organisation judiciaire |
||
Art. L. 532-22. – En matière pénale, les règles concernant la compétence et le fonctionnement de la juridiction de proximité ainsi que celles relatives au ministère public près cette juridiction sont fixées par l’article 706-72 du code de procédure pénale et, en ce qui concerne les mineurs, par l’article 21 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2005-47 du 26 janvier 2005 relative aux compétences du tribunal d’instance, de la juridiction de proximité et du tribunal de grande instance. |
III (nouveau). – Aux articles L. 532-22, L. 552-16 et L. 562-32 du code de l’organisation judiciaire, les mots : « par l’article 706-72 du code de procédure pénale et » sont supprimés et le mot : « leur » est remplacé par le mot : « sa ». amendements CL299 | |
Art. L. 552-16. – En matière pénale, les règles concernant la compétence et le fonctionnement de la juridiction de proximité ainsi que celles relatives au ministère public près cette juridiction sont fixées par l’article 706-72 du code de procédure pénale et, en ce qui concerne les mineurs, par l’article 21 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2005-47 du 26 janvier 2005 relative aux compétences du tribunal d’instance, de la juridiction de proximité et du tribunal de grande instance. |
||
Art. L. 562-32. – En matière pénale, les règles concernant la compétence et le fonctionnement de la juridiction de proximité ainsi que celles relatives au ministère public près cette juridiction sont fixées par l’article 706-72 du code de procédure pénale et, en ce qui concerne les mineurs, par l’article 21 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2005-47 du 26 janvier 2005 relative aux compétences du tribunal d’instance, de la juridiction de proximité et du tribunal de grande instance. |
||
Chapitre IV |
Chapitre IV | |
Dispositions améliorant la lutte |
Dispositions améliorant la lutte | |
Article 12 |
Article 12 | |
I. – Après l’article 421-2-6 du code pénal, il est inséré un article ainsi rédigé : |
I. – (Alinéa sans modification) | |
« Art. 421-2-7. – Est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende, le fait d’importer, d’exporter, de faire transiter, de détenir, de vendre, d’acquérir ou d’échanger un bien culturel présentant un intérêt archéologique, artistique, historique ou scientifique en sachant que ce bien a été soustrait d’un territoire qui constituait, au moment de la soustraction, un théâtre d’opérations de groupements terroristes et sans pouvoir justifier la licéité de l’origine de ce bien. » |
« Art. 421-2-7. – Est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende le fait d’importer, d’exporter, de faire transiter, de transporter, de détenir, de vendre, d’acquérir ou d’échanger un bien culturel présentant un intérêt archéologique, artistique, historique ou scientifique en sachant que ce bien a été soustrait d’un territoire qui constituait, au moment de la soustraction, un théâtre d’opérations de groupements terroristes et sans pouvoir justifier la licéité de l’origine de ce bien. » amendement CL241 | |
Art. 706-24-1. – Les articles 706-88 à 706-94 du présent code ne sont pas applicables aux délits prévus à l’article 421-2-5 du code pénal. |
II. – Aux articles 706-24-1 et 706-25-1 du code de procédure pénale, les mots : « à l’article 421-2-5 » sont remplacés par les mots : « aux articles 421-2-5 et 421-2-7 ». |
II. – (Sans modification) |
Art. 706-25-1. – L’action publique des crimes mentionnés à l’article 706-16 se prescrit par trente ans. La peine prononcée en cas de condamnation pour l’un de ces crimes se prescrit par trente ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive. |
||
L’action publique relative aux délits mentionnés à l’article 706-16 se prescrit par vingt ans. La peine prononcée en cas de condamnation pour ces délits se prescrit par vingt ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive. |
||
Le présent article n’est pas applicable aux délits prévus à l’article 421-2-5 du code pénal. |
||
Article 13 |
Article 13 | |
I. – Le chapitre V du titre Ier du livre III du code monétaire et financier est complété par une section ainsi rédigée : |
I. – (Alinéa sans modification) | |
« Section 4 |
(Alinéa sans modification) | |
« Plafonnement |
(Alinéa sans modification) | |
« Art. L. 315-9. – La valeur monétaire maximale stockée sous |
« Art. L. 315-9. – La valeur monétaire maximale stockée sous forme électronique et utilisable au moyen d’un support physique est fixée par décret, en tenant compte des caractéristiques du produit et des risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme que celui-ci présente. » amendement CL229 | |
II. – L’article L. 561-12 du même code est ainsi modifié : |
II. – (Sans modification) | |
Code monétaire et financier |
1° Au premier alinéa : |
|
Art. L. 561-12. – Sous réserve de dispositions plus contraignantes, les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 conservent pendant cinq ans à compter de la clôture de leurs comptes ou de la cessation de leurs relations avec eux les documents relatifs à l’identité de leurs clients habituels ou occasionnels. Elles conservent également, dans la limite de leurs attributions, pendant cinq ans à compter de leur exécution, les documents relatifs aux opérations faites par ceux-ci, ainsi que les documents consignant les caractéristiques des opérations mentionnées au II de l’article L. 561-10-2. |
a) À la première phrase, après le mot : « documents » sont insérés les mots : « et informations, quel qu’en soit le support, » ; |
|
b) À la seconde phrase, la première occurrence du mot : « documents » est remplacée par les mots : « quel qu’en soit le support, les documents et informations » ; |
||
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
||
« Sans préjudice des obligations mentionnées au premier alinéa, les personnes mentionnées aux 1° et 1° ter de l’article L. 561-2 recueillent les informations et les données techniques relatives à l’activation, au chargement et à l’utilisation de la monnaie électronique au moyen d’un support physique, et les conservent pendant une durée de cinq ans à compter de l’exécution de ces opérations. Un arrêté du ministre chargé de l’économie précise les informations et les données techniques qui sont recueillies et conservées. » ; |
||
Les personnes mentionnées au 9° de l’article L. 561-2 satisfont à cette obligation en appliquant les mesures prévues à l’article L. 561-13. |
3° Au second alinéa, qui devient le troisième, les mots : « à cette obligation » sont remplacés par les mots : « aux obligations prévues au premier alinéa ». |
|
Article 14 |
Article 14 | |
I. – Après l’article L. 561-29 du même code est inséré un article L. 561-29-1 ainsi rédigé : |
I. – (Alinéa sans modification) | |
« Art. L. 561-29-1. – Le service mentionné à l’article L. 561-23 peut, pour une durée maximum de six mois renouvelable, désigner aux personnes mentionnées à l’article L. 561-2, pour la mise en œuvre de leurs obligations de vigilance à l’égard de la clientèle énoncées au présent chapitre : |
« Art. L. 561-29-1. – (Alinéa sans modification) | |
« 1° Les opérations qui présentent, eu égard à leur nature particulière ou aux zones géographiques déterminées à partir desquelles, à destination desquelles ou en relation avec lesquelles elles sont effectuées, un risque élevé de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ; |
« 1° (Sans modification) | |
« 2° Des personnes qui présentent un risque élevé de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme. |
« 2° (Sans modification) | |
« Il est interdit, sous peine des sanctions prévues à l’article L. 574-1, aux personnes mentionnées à l’article L. 561-2, au président de l’ordre des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation ou au bâtonnier de l’ordre auprès duquel l’avocat est inscrit de porter à la connaissance de leurs clients ou à |
« Il est interdit, sous peine des sanctions prévues à l’article L. 574-1, aux personnes mentionnées à l’article L. 561-2, au président de l’ordre des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation ou au bâtonnier de l’ordre auprès duquel l’avocat est inscrit de porter à la connaissance de leurs clients ou à la connaissance de tiers autres que les autorités de contrôle, ordres professionnels et instances représentatives nationales mentionnés à l’article L. 561-36, les informations transmises par le service mentionné à l’article L. 561-23 lorsqu’il procède à une désignation en application du 2° du présent article. amendements CL230 et CL232 | |
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. » |
(Alinéa sans modification) | |
Art. L. 574-1. – Est puni d’une amende de 22 500 euros le fait de méconnaître l’interdiction de divulgation prévue à l’article L. 561-19 et au III de l’article L. 561-26 ; |
II. - À l’article L. 574-1 du même code, les mots : « et au III de l’article L. 561-26 » sont remplacés par les mots : « au III de l’article L. 561-26 et au quatrième alinéa de l’article L. 561-29-1 ». |
II. - (Sans modification) |
Article 15 |
Article 15 | |
L’article L. 561-26 du même code est ainsi modifié : |
(Alinéa sans modification) | |
Art. L. 561-26. – I. – Pour l’application du présent chapitre, le service mentionné à l’article L. 561-23 peut demander que les pièces conservées en application du II de l’article L. 561-10-2 et des articles L. 561-12 et L. 561-13 lui soient communiquées quel que soit le support utilisé pour leur conservation et dans les délais qu’il fixe. Ce droit s’exerce, sur pièces ou sur place pour les personnes mentionnées aux 1° à 7° de l’article L. 561-2 et sur pièces pour les autres personnes mentionnées à cet article, dans le but de reconstituer l’ensemble des transactions faites par une personne physique ou morale liées à une opération ayant fait l’objet d’une déclaration mentionnée à l’article L. 561-15 ou à une information reçue au titre des articles L. 561-27, L. 561-30 ou L. 561-31, ainsi que dans le but de renseigner, dans les conditions prévues à l’article L. 561-31, des cellules de renseignement financier homologues étrangères. |
1° Au I, les mots : « pièces conservées » sont remplacés par les mots : « documents, informations ou données conservés » ; |
1° (Sans modification) |
II. – Par dérogation au I, les demandes de communication de pièces effectuées auprès des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation et des avocats sont présentées par le service, selon le cas, au président de l’ordre des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation ou au bâtonnier de l’ordre auprès duquel l’avocat est inscrit. |
2° |
2° Le II est ainsi modifié : |
a) Au premier alinéa et à la première phrase du deuxième alinéa, le mot : « pièces » est remplacé par les mots : « documents, informations ou données » ; amendement CL233 | ||
L’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation ou l’avocat, communique à l’autorité dont il relève les pièces qu’elle lui demande.L’autorité les transmet au service selon les modalités prévues à l’article L. 561-17. |
||
À défaut du respect de cette procédure, l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation ou l’avocat est en droit de s’opposer à la communication des pièces demandées par le service mentionné à l’article L. 561-23. |
b) Au troisième alinéa, les mots : « pièces demandées » sont remplacés par les mots : « documents, informations ou données demandés » ; amendement CL233 | |
Cette dérogation ne s’applique pas à l’avocat agissant en qualité de fiduciaire. |
||
II bis. – Le service mentionné à l’article L. 561-23 peut demander à toute entreprise de transport routier, ferroviaire, maritime ou aérien ou à tout opérateur de voyage ou de séjour les éléments d’identification des personnes ayant payé ou bénéficié d’une prestation ainsi que les dates, les heures et les lieux de départ et d’arrivée de ces personnes et, s’il y a lieu, les éléments d’information en sa possession relatifs aux bagages et aux marchandises transportés. |
||
3° Après le II bis, il est inséré un II ter ainsi rédigé : |
3° (Sans modification) | |
« II ter. – Le service mentionné à l’article L. 561-23 peut demander aux gestionnaires d’un système de cartes de paiement ou de retrait toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission. » ; |
||
III. – Il est interdit, sous peine des sanctions prévues à l’article L. 574-1, aux dirigeants et aux personnes mentionnées au II bis du présent article et à l’article L. 561-2, au président de l’ordre des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation ou au bâtonnier de l’ordre auprès duquel l’avocat est inscrit de porter à la connaissance du propriétaire des sommes ou de l’auteur de l’une des opérations mentionnées à l’article L. 561-15 ou à des tiers, autres que les autorités de contrôle, ordres professionnels et instances représentatives nationales visées à l’article L. 561-36, les informations provenant de l’exercice par le service mentionné à l’article L. 561-23 du droit de communication prévu à l’article L. 561-26. |
4° Au III, après les mots : « au II bis », sont insérés les mots : « et au II ter ». |
4° (Sans modification) |
Le fait pour les personnes mentionnées au 13° de l’article L. 561-2 de s’efforcer de dissuader leur client de prendre part à une activité illégale ne constitue pas une divulgation au sens de l’alinéa qui précède. |
||
Article 15 bis (nouveau) | ||
Art. L. 561-27. – Le service mentionné à l’article L. 561-23 reçoit, à l’initiative des administrations de l’Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics, des organismes mentionnés à l’article L. 134-1 du code des juridictions financières et de toute autre personne chargée d’une mission de service public, toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission ou les obtient de ceux-ci à sa demande. |
Le deuxième alinéa de l’article L. 561-27 du code monétaire et financier est complété par une phrase ainsi rédigée : | |
Il dispose, pour les besoins de l’accomplissement de sa mission, d’un droit d’accès direct aux fichiers utilisés par les services en charge de l’établissement de l’assiette, du contrôle et du recouvrement des impôts. |
« Il dispose également d’un accès direct aux traitements de données à caractère personnel mentionnés à l’article 230-6 du code de procédure pénale, y compris pour les données portant sur des procédures judiciaires en cours et à l’exclusion de celles relatives aux personnes enregistrées en qualité de victimes. » amendement CL234 | |
L’autorité judiciaire, les juridictions financières et les officiers de police judiciaire peuvent le rendre destinataire de toute information aux mêmes fins. |
||
Article 16 |
Article 16 | |
Après l’article 415 du code des douanes, il est inséré un article 415-1 ainsi rédigé : |
(Sans modification) | |
« Art. 415-1. – Pour l’application de l’article 415, les fonds sont présumés être le produit direct ou indirect d’un délit prévu au présent code ou d’une infraction à la législation sur les substances ou plantes vénéneuses classées comme stupéfiants lorsque les conditions matérielles, juridiques ou financières de l’opération d’exportation, d’importation, de transfert ou de compensation ne paraissent obéir à d’autre motif que de dissimuler que les fonds ont une telle origine. » |
||
Chapitre V |
Chapitre V | |
Dispositions renforçant l’enquête et les contrôles administratifs |
Dispositions renforçant l’enquête et les contrôles administratifs | |
Article 17 |
Article 17 | |
Code de procédure pénale |
L’article 78-2-2 du code de procédure pénale est ainsi modifié : |
(Sans modification) |
Art. 78-2-2. – Sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite des actes de terrorisme visés par les articles 421-1 à 421-6 du code pénal, des infractions en matière de prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs visées aux 1° et 2° du I de l’article L. 1333-9, à l’article L. 1333-11, au II des articles L. 1333-13-3 et L. 1333-13-4 et aux articles L. 1333-13-5, L. 2339-14, L. 2339-15, L. 2341-1, L. 2341-2, L. 2341-4, L. 2342-59 et L. 2342-60 du code de la défense, d’armes et d’explosifs visées par les articles L. 2339-8 et L. 2353-4 du code de la défense et L. 317-8 du code de la sécurité intérieure, des infractions de vol visées par les articles 311-3 à 311-11 du code pénal, de recel visées par les articles 321-1 et 321-2 du même code ou des faits de trafic de stupéfiants visés par les articles 222-34 à 222-38 dudit code, les officiers de police judiciaire, assistés, le cas échéant, des agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l’article 21 peuvent, dans les lieux et pour la période de temps que ce magistrat détermine et qui ne peut excéder vingt-quatre heures, renouvelables sur décision expresse et motivée selon la même procédure, procéder non seulement aux contrôles d’identité prévus au sixième alinéa de l’article 78-2 mais aussi à la visite des véhicules circulant, arrêtés ou stationnant sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public. |
1° À la fin du premier alinéa, avant les mots : « la visite des véhicules » sont insérés les mots : « l’inspection visuelle et la fouille de bagages ainsi qu’à » ; |
|
Pour l’application des dispositions du présent article, les véhicules en circulation ne peuvent être immobilisés que le temps strictement nécessaire au déroulement de la visite qui doit avoir lieu en présence du conducteur. Lorsqu’elle porte sur un véhicule à l’arrêt ou en stationnement, la visite se déroule en présence du conducteur ou du propriétaire du véhicule ou, à défaut, d’une personne requise à cet effet par l’officier ou l’agent de police judiciaire et qui ne relève pas de son autorité administrative. La présence d’une personne extérieure n’est toutefois pas requise si la visite comporte des risques graves pour la sécurité des personnes et des biens. |
||
En cas de découverte d’une infraction ou si le conducteur ou le propriétaire du véhicule le demande ainsi que dans le cas où la visite se déroule en leur absence, il est établi un procès-verbal mentionnant le lieu et les dates et heures du début et de la fin de ces opérations. Un exemplaire en est remis à l’intéressé et un autre est transmis sans délai au procureur de la République. |
2° Au troisième alinéa, les mots : « le conducteur ou le propriétaire du véhicule » sont remplacés par les mots : « la personne concernée » et après les mots : « la visite » sont ajoutés les mots : « ou la fouille » ; |
|
Toutefois, la visite des véhicules spécialement aménagés à usage d’habitation et effectivement utilisés comme résidence ne peut être faite que conformément aux dispositions relatives aux perquisitions et visites domiciliaires. |
||
Le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. |
||
Article 18 |
Article 18 | |
1° Après l’article 78-3 du code de procédure pénale, il est inséré un article 78-3-1 ainsi rédigé : |
1° (Alinéa sans modification) | |
« Art. 78-3-1. – Toute personne faisant l’objet d’un contrôle ou d’une vérification d’identité prévus au présent chapitre peut, lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement est lié à des activités à caractère terroriste ou qu’elle est en relation directe et non fortuite avec une personne ayant un tel comportement, faire l’objet d’une retenue sur place ou dans le local de police où elle est conduite, pour une vérification approfondie |
« Art. 78-3-1. – Toute personne faisant l’objet d’un contrôle ou d’une vérification d’identité prévus au présent chapitre peut, lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement est lié à des activités à caractère terroriste ou qu’elle est en relation directe et non fortuite avec une personne ayant un tel comportement, faire l’objet d’une retenue sur place ou dans le local de police où elle est conduite pour une vérification approfondie de sa situation par un officier de police judiciaire permettant de consulter les traitements automatisés de données à caractère personnel relevant de l’article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, selon les règles propres à chacun de ces traitements, et, le cas échéant, d’interroger les services à l’origine du signalement de l’intéressé ainsi que des organismes de coopération internationale en matière de police judiciaire ou des services de police étrangers. amendement CL363 | |
« Le procureur de la République en est informé sans délai. |
(Alinéa sans modification) | |
« La personne faisant l’objet de cette retenue est aussitôt informée de son droit de prévenir à tout moment |
« La personne faisant l’objet de cette retenue est aussitôt informée de son droit de prévenir à tout moment une personne de son choix. Si des circonstances particulières l’exigent, l’officier de police judiciaire prévient lui-même la personne choisie par la personne faisant l’objet de la retenue. amendement CL161 | |
« Cette personne ne peut être retenue que pendant le temps strictement nécessaire à l’accomplissement |
« Cette personne ne peut être retenue que pendant le temps strictement nécessaire à l’accomplissement des vérifications mentionnées au premier alinéa, pour une durée qui ne peut excéder quatre heures à compter du début du contrôle effectué, et le procureur de la République peut y mettre fin à tout moment. amendements CL236 et CL237 | |
« Lorsqu’il s’agit d’un mineur de dix-huit ans, |
« Lorsqu’il s’agit d’un mineur de dix-huit ans, celui-ci doit être assisté de son représentant légal ou, en cas d’impossibilité dûment justifiée, d’un tuteur désigné par le juge des enfants sur saisine du procureur de la République. amendement CL364 | |
« L’officier de police judiciaire mentionne, dans un procès-verbal, les motifs qui justifient la vérification de situation administrative et les conditions dans lesquelles la personne a été présentée devant lui, informée de ses droits et mise en mesure de les exercer. Il précise le jour et l’heure à partir desquels la vérification a été effectuée, le jour et l’heure de la fin de la retenue et la durée de celle-ci. |
(Alinéa sans modification) | |
« Ce procès-verbal est présenté à la signature de l’intéressé. Si ce dernier refuse de le signer, mention est faite du refus et des motifs de celui-ci. Le procès-verbal est transmis au procureur de la République, copie en ayant été remise à l’intéressé. |
(Alinéa sans modification) | |
|
Alinéa supprimé amendement CL192 | |
« Les prescriptions énumérées au présent article sont imposées à peine de nullité. » ; |
(Alinéa sans modification) | |
Art. 78-4. – La durée de la rétention prévue par l’article précédent s’impute, s’il y a lieu, sur celle de la garde à vue. |
2° À l’article 78-4, les mots : « l’article précédent » sont remplacés par les mots : « les articles 78-3 et 78-3-1 ». |
2° (Sans modification) |
Article 19 |
Article 19 | |
I. – Après l’article L. 434-1 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 434-2 ainsi rédigé : |
I. – (Alinéa sans modification) | |
« Art. L. 434-2. – Constitue un acte nécessaire à la sauvegarde des personnes au sens de l’article 122-7 du code pénal, lorsqu’un ou plusieurs homicides volontaires ou tentatives d’homicide volontaire viennent d’être commis et qu’il existe des raisons réelles et objectives de craindre |
« Art. L. 434-2. – Constitue un acte nécessaire à la sauvegarde des personnes, au sens de l’article 122-7 du code pénal, lorsqu’un ou plusieurs homicides volontaires ou tentatives d’homicide volontaire viennent d’être commis et qu’il existe des raisons réelles et objectives de craindre, au regard des circonstances de la première agression et des informations dont dispose l’agent au moment où il fait usage de son arme, que plusieurs autres de ces actes, participant à une action criminelle visant à causer une pluralité de victimes, soient à nouveau commis par le ou les mêmes auteurs dans un temps rapproché, le fait pour un fonctionnaire de la police nationale ou un militaire de la gendarmerie nationale de faire un usage de son arme rendu absolument nécessaire pour faire obstacle à cette situation. » amendement CL356 | |
Code de la défense |
||
Art. L. 4123-12. – I. – Outre les cas de légitime défense, n’est pas pénalement responsable le militaire qui déploie, après sommations, la force armée absolument nécessaire pour empêcher ou interrompre toute intrusion dans une zone de défense hautement sensible et procéder à l’arrestation de l’auteur de cette intrusion. |
||
Constitue une zone de défense hautement sensible la zone définie par voie réglementaire à l’intérieur de laquelle sont implantés ou stationnés des biens militaires dont la perte ou la destruction serait susceptible de causer de très graves dommages à la population, ou mettrait en cause les intérêts vitaux de la défense nationale. |
||
Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application des alinéas précédents. Il détermine les conditions dans lesquelles sont définies les zones de défense hautement sensibles, les conditions de délivrance des autorisations d’y pénétrer et les modalités de leur protection. Il précise les modalités des sommations auxquelles procède le militaire. |
||
II. – N’est pas pénalement responsable le militaire qui, dans le respect des règles du droit international et dans le cadre d’une opération mobilisant des capacités militaires, se déroulant à l’extérieur du territoire français ou des eaux territoriales françaises, quels que soient son objet, sa durée ou son ampleur, y compris la libération d’otages, l’évacuation de ressortissants ou la police en haute mer, exerce des mesures de coercition ou fait usage de la force armée, ou en donne l’ordre, lorsque cela est nécessaire à l’exercice de sa mission. |
||
II. – L’article L. 4123-12 du code de la défense est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
II. – (Sans modification) | |
« III. – Les dispositions de l’article L. 434-2 du code de la sécurité intérieure sont applicables aux militaires des forces armées déployés sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues par l’article L. 1321-1 du présent code. » |
||
Code des douanes |
||
Art. 56. – 1° Les agents des douanes ont, pour l’exercice de leurs fonctions, le droit au port d’armes. |
||
a) lorsque des violences ou voies de fait sont exercées contre eux ou lorsqu’ils sont menacés par des individus armés ; |
||
b) lorsqu’ils ne peuvent immobiliser autrement les véhicules, embarcations et autres moyens de transport dont les conducteurs n’obtempèrent pas à l’ordre d’arrêt ; |
||
c) lorsqu’ils ne peuvent autrement s’opposer au passage d’une réunion de personnes qui ne s’arrêtent pas aux sommations qui leur sont adressées ; |
||
d) lorsqu’ils ne peuvent capturer vivants les chiens, les chevaux et autres animaux employés pour la fraude ou que l’on tente d’importer ou d’exporter frauduleusement ou qui circulent irrégulièrement. |
||
III. – L’article 56 du code des douanes est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
III. – (Sans modification) | |
« 3. Les dispositions de l’article L. 434-2 du code de la sécurité intérieure sont applicables aux agents des douanes. » |
||
Article 20 |
Article 20 | |
Au titre II du livre II du code de la sécurité intérieure, il est ajouté un chapitre V ainsi rédigé : |
(Alinéa sans modification) | |
« Chapitre V |
(Alinéa sans modification) | |
« Contrôle administratif des retours sur le territoire national |
(Alinéa sans modification) | |
« Art. L. 225-1. – Toute personne qui a quitté le territoire national pour accomplir : |
« Art. L. 225-1. – (Sans modification) | |
« 1° Des déplacements à l’étranger ayant pour objet la participation à des activités terroristes ; |
||
« 2° Ou des déplacements à l’étranger sur un théâtre d’opérations de groupements terroristes ; |
||
« 3° Ou une tentative de se rendre sur un tel théâtre : |
||
« dans des conditions susceptibles de la conduire à porter atteinte à la sécurité publique lors de son retour sur le territoire français peut faire l’objet d’un contrôle administratif, dès son retour sur le territoire national. |
||
« Art. L. 225-2. – Le ministre de l’intérieur peut faire obligation à la personne ayant accompli un déplacement mentionné au 1° et au 2° de l’article L. 225-1, dans un délai maximal d’un mois à compter de la date certaine de son retour sur le territoire national, de : |
« Art. L. 225-2. – Le ministre de l’intérieur peut, après en avoir informé le procureur de la République territorialement compétent, faire obligation à la personne ayant accompli un déplacement mentionné aux 1° et 2° de l’article L. 225-1, dans un délai maximal d’un mois à compter de la date certaine de son retour sur le territoire national, de : amendement CL238 | |
« 1° Résider dans un périmètre géographique déterminé, permettant à l’intéressé de poursuivre une vie familiale et professionnelle normale et, le cas échéant, l’astreindre à demeurer à son domicile ou, à défaut, dans un autre lieu à l’intérieur de ce périmètre , pendant |
« 1° Résider dans un périmètre géographique déterminé permettant à l’intéressé de poursuivre une vie familiale et professionnelle normale et, le cas échéant, l’astreindre à demeurer à son domicile ou, à défaut, dans un autre lieu à l’intérieur de ce périmètre, pendant une plage horaire fixée par le ministre, dans la limite de huit heures par vingt-quatre heures ; amendement CL239 | |
« 2° Se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, dans la limite de trois présentations par semaine, en précisant si cette obligation s’applique les dimanches et jours fériés ou chômés. |
« 2° (Sans modification) | |
« Les obligations prévues aux 1° et au 2° du présent article sont prononcées pour une durée maximale d’un mois, non renouvelable. |
(Alinéa sans modification) | |
« Art. L. 225-3. – Le ministre de l’intérieur peut faire obligation à toute personne mentionnée à l’article L. 225-1, dans un délai maximal d’un an à compter de la date certaine de son retour sur le territoire national, de : |
« Art. L. 225-3. – Le ministre de l’intérieur peut, après en avoir informé le procureur de la République territorialement compétent, faire obligation à toute personne mentionnée à l’article L. 225-1, dans un délai maximal d’un an à compter de la date certaine de son retour sur le territoire national, de : amendement CL238 | |
« 1° Déclarer son domicile et tout changement de domicile ; |
« 1° (Sans modification) | |
« 2° Déclarer ses identifiants de tout moyen de communication électronique dont il dispose ou qu’il utilise, ainsi que tout changement d’identifiant ; |
« 2° (Sans modification) | |
« 3° Signaler ses déplacements à l’extérieur d’un périmètre déterminé ne pouvant être plus restreint que le territoire d’une commune ; |
« 3° (Sans modification) | |
« 4° Ne pas se trouver en relation directement ou indirectement, avec certaines personnes, nommément désignées, dont il existe des raisons sérieuses de penser que leur comportement constitue une menace pour la sécurité et l’ordre publics. |
« 4° (Sans modification) | |
« Ces obligations sont prononcées pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une fois. |
(Alinéa sans modification) | |
« Art. L. 225-4. – Les décisions prononçant les obligations prévues aux articles L. 225-2 et L. 225-3 sont écrites et motivées. Le ministre de l’intérieur ou son représentant met la personne concernée en mesure de lui présenter ses observations dans un délai maximal de huit jours à compter de la notification de la décision. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. |
« Art. L. 225-4. – (Sans modification) | |
« Art. L. 225-4-1 (nouveau). – Lorsqu’une procédure judiciaire concernant une personne faisant l’objet d’obligations fixées en application des articles L. 225-2 et L. 225-3 est ouverte, le ministre de l’intérieur abroge les décisions mentionnées à ces articles. amendement CL240 | ||
« Art. L. 225-5. – Les obligations prononcées en application des articles L. 225-2 et L. 225-3 peuvent être en tout ou partie suspendues lorsque la personne accepte de participer, dans un établissement habilité à cet effet, à une action destinée à permettre sa réinsertion et l’acquisition des valeurs de citoyenneté. |
« Art. L. 225-5. – (Sans modification) | |
« Art. L. 225-6. – Le fait de se soustraire aux obligations fixées par l’autorité administrative en application des articles L. 225-2 et L. 225-3 est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende. |
« Art. L. 225-6. – (Sans modification) | |
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre du présent article, notamment les conditions dans lesquelles l’action mentionnée à l’article L. 225-5 est conduite. » |
||
Article 21 |
Article 21 | |
Au chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la sécurité intérieure, il est inséré, après la section 4, une section 4 bis ainsi rédigée : |
(Sans modification) | |
« Section 4 bis |
||
« Grands événements |
||
« Art. L. 211-11-1. – Les grands événements exposés, par leur ampleur ou leurs circonstances particulières, à un risque exceptionnel de menace terroriste sont désignés par décret. Ce décret désigne également les établissements et les installations qui accueillent ces grands événements ainsi que les organisateurs concernés. |
||
« L’accès de toute personne, à un autre titre que celui de spectateur ou celui de participant, à tout ou partie des établissements et installations désignés par le décret mentionné au premier alinéa est soumis à autorisation de l’organisateur pendant la durée de cet événement et de sa préparation. L’organisateur recueille au préalable l’avis de l’autorité administrative rendu à la suite d’une enquête administrative qui peut donner lieu à la consultation, selon les règles propres à chacun d’eux, de certains traitements automatisés de données à caractère personnel relevant de l’article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification. Un avis défavorable ne peut être émis que s’il ressort de l’enquête administrative que le comportement ou les agissements de la personne sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’État. |
||
« Un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés fixe les modalités d’application du présent article, notamment la liste des fichiers, mentionnés au deuxième alinéa, pouvant faire l’objet d’une consultation, les catégories de personnes concernées et les garanties d’information ouvertes à ces personnes. » |
||
TITRE II |
TITRE II | |
DISPOSITIONS RENFORÇANT LES GARANTIES |
DISPOSITIONS RENFORÇANT LES GARANTIES | |
Chapitre Ier |
Chapitre Ier | |
Dispositions renforçant les garanties de la procédure pénale |
Dispositions renforçant les garanties de la procédure pénale | |
Article 22 |
Article 22 | |
Après l’article 39-2 du code de procédure pénale, il est inséré un article 39-3 ainsi rédigé : |
(Alinéa sans modification) | |
« Art. 39-3. – Dans ses attributions de direction de la police judiciaire, le procureur de la République, sans préjudice des instructions générales ou particulières qu’il |
« Art. 39-3. – Dans le cadre de ses attributions de direction de la police judiciaire, le procureur de la République, sans préjudice des instructions générales ou particulières qu’il adresse aux enquêteurs, contrôle la légalité des moyens mis en œuvre par ces derniers, la proportionnalité des actes d’investigation au regard de la nature et de la gravité des faits, l’orientation donnée à l’enquête ainsi que la qualité de celle-ci. amendements CL300, | |
« Il veille à ce que les investigations tendent à la manifestation de la vérité et qu’elles soient accomplies, dans le respect des droits de la victime et de ceux de la personne suspectée, à charge et à décharge. » |
« Il veille à ce que les investigations tendent à la manifestation de la vérité et qu’elles soient accomplies, dans le respect des droits de la victime, du plaignant et de ceux de la personne suspectée, à charge et à décharge. » amendement CL303 | |
Article 23 |
Article 23 | |
Après l’article 229 du même code, il est inséré un article 229-1 ainsi rédigé : |
(Alinéa sans modification) | |
« Art. 229-1. – En cas de manquement professionnel grave ou d’atteinte grave à l’honneur ou à la probité |
« Art. 229-1. – En cas de manquement professionnel grave ou d’atteinte grave à l’honneur ou à la probité par une des personnes mentionnées à l’article 224 ayant une incidence sur la capacité d’exercice des missions de police judiciaire, le président de la chambre de l’instruction, saisi par le procureur général près la cour d’appel dans le ressort de laquelle la personne exerce habituellement ses fonctions, peut, sans préjudice des sanctions disciplinaires administratives qui pourraient être infligées, décider immédiatement qu’elle ne pourra exercer ses fonctions de police judiciaire pour une durée maximale d’un mois. amendement CL304 | |
« Cette décision prend effet immédiatement. Elle est notifiée, à la diligence du procureur général, aux autorités dont dépend la personne. |
(Alinéa sans modification) | |
« La saisine du président de la chambre de l’instruction par le procureur général en application du premier alinéa vaut saisine de la chambre de l’instruction au titre du premier alinéa de l’article 225. » |
(Alinéa sans modification) | |
Article 24 |
Article 24 | |
Code de procédure pénale |
Le même code est ainsi modifié : |
(Alinéa sans modification) |
Art. 63-8. – À l’issue de la garde à vue, la personne est, sur instruction du procureur de la République sous la direction duquel l’enquête est menée, soit remise en liberté, soit déférée devant ce magistrat. |
||
Si la personne est remise en liberté à l’issue de la garde à vue sans qu’aucune décision n’ait été prise par le procureur de la République sur l’action publique, les dispositions de l’article 77-2 sont portées à sa connaissance. |
1° A (nouveau) Le second alinéa de l’article 63-8 est supprimé. amendement CL305 | |
1° Les articles 77-2 |
1° L’article 77-2 est ainsi rédigé : | |
Art. 77-2. - Toute personne placée en garde à vue au cours d’une enquête préliminaire ou de flagrance qui, à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la fin de la garde à vue, n’a pas fait l’objet de poursuites, peut interroger le procureur de la République dans le ressort duquel la garde à vue s’est déroulée sur la suite donnée ou susceptible d’être donnée à la procédure. Cette demande est adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Ces dispositions ne sont pas applicables aux enquêtes portant sur l’un des crimes ou délits entrant dans le champ d’application des articles 706-73 et 706-73-1. |
« Art. 77-2. – I. - |
« Art. 77-2. – I. – Aussitôt que l’enquête préliminaire lui paraît terminée et sauf s’il fait application de l’article 393, le procureur de la République avise la personne qu’il envisage de poursuivre, ou son avocat, de la mise à disposition d’une copie de la procédure et de la possibilité de formuler des observations dans un délai d’un mois, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par déclaration au greffe contre récépissé. La victime et le plaignant disposent des mêmes droits et sont avisés dans les mêmes conditions. amendement CL305 |
|
Alinéa supprimé amendement CL305 | |
|
« Pendant ce délai d’un mois, le procureur de la République ne prend aucune décision sur l’action publique, hors l’ouverture d’une information ou l’application de l’article 393. | |
|
« Si le procureur de la République décide de poursuivre l’enquête préliminaire et envisage de procéder à une nouvelle audition ou à un nouvel interrogatoire de la personne, celle-ci est informée, au moins dix jours avant cette audition ou cet interrogatoire, qu’elle peut demander la consultation du dossier de la procédure par elle-même ou par un avocat désigné par elle ou commis d’office à sa demande par le bâtonnier. Le dossier est alors mis à disposition au plus tard cinq jours avant l’audition ou l’interrogatoire. | |
|
« II. – À tout moment de la procédure, le procureur de la République peut communiquer tout ou partie de la procédure à la victime, au plaignant et à la personne qu’il envisage de poursuivre pour recueillir leurs éventuelles observations ou celles de leur avocat. amendement CL305 | |
« III. - Dans les cas mentionnés aux I et II, les observations de la personne ou de son avocat, qui sont versées au dossier de la procédure, peuvent notamment porter sur la régularité de la procédure, sur la qualification retenue, sur le caractère éventuellement insuffisant de l’enquête et sur les modalités d’engagement éventuel des poursuites ou le recours éventuel à la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. Elles peuvent comporter, le cas échéant, des demandes d’actes que la personne estime nécessaires à la manifestation de la vérité. |
« III. - (Sans modification) | |
« Le procureur de la République apprécie les suites devant être apportées à ces observations. Il en informe les personnes concernées. |
(Alinéa sans modification) | |
Art. 77-3. – Lorsque l’enquête n’a pas été menée sous la direction du procureur de la République du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la garde à vue a été réalisée, celui-ci adresse sans délai la demande mentionnée à l’article 77-2 au procureur de la République qui dirige l’enquête. |
« Art. 77-3. – |
1° bis L’article 77-3 est abrogé ; amendement CL306 |
Art. 393. – En matière correctionnelle, lorsqu’il envisage de poursuivre une personne en application des articles 394 et 395, le procureur de la République ordonne qu’elle soit déférée devant lui. |
||
Après avoir, s’il y a lieu, informé la personne de son droit d’être assistée par un interprète, constaté son identité et lui avoir fait connaître les faits qui lui sont reprochés ainsi que leur qualification juridique, le procureur de la République l’informe qu’elle a le droit à l’assistance d’un avocat de son choix ou commis d’office. L’avocat choisi ou, dans le cas d’une demande de commission d’office, le bâtonnier de l’ordre des avocats en est avisé sans délai. |
||
L’avocat ou la personne déférée lorsqu’elle n’est pas assistée par un avocat peut consulter sur-le-champ le dossier. L’avocat peut communiquer librement avec le prévenu. |
||
Le procureur de la République avertit alors la personne de son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. Après avoir, le cas échéant, recueilli les observations de la personne ou procédé à son interrogatoire, le procureur de la République entend, s’il y a lieu, les observations de l’avocat, portant notamment sur la régularité de la procédure, sur la qualification retenue, sur le caractère éventuellement insuffisant de l’enquête et sur la nécessité de procéder à de nouveaux actes. Au vu de ces observations, le procureur de la République soit procède comme il est dit aux articles 394 à 396, soit requiert l’ouverture d’une information, soit ordonne la poursuite de l’enquête, soit prend toute autre décision sur l’action publique en application de l’article 40-1. S’il ordonne la poursuite de l’enquête et que la personne est à nouveau entendue, elle a le droit d’être assistée, lors de son audition, par son avocat, en application de l’article 63-4-3. |
2° À la deuxième phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article 393, les mots : « et sur la nécessité de procéder à de nouveaux actes » sont remplacés par les mots : « , sur la nécessité de procéder à de nouveaux actes qu’il estime |
2° À la fin de la deuxième phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article 393, les mots : « et sur la nécessité de procéder à de nouveaux actes » sont remplacés par les mots : « , sur la nécessité de procéder à de nouveaux actes qu’il estime utiles à la manifestation de la vérité et sur les modalités d’engagement éventuel des poursuites ou le recours éventuel à la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ». amendement CL307 |
Mention de ces formalités est faite au procès-verbal à peine de nullité de la procédure. |
||
Article 25 |
Article 25 | |
Le même code est ainsi modifié : |
(Alinéa sans modification) | |
Art. 100-1. – La décision prise en application de l’article 100 doit comporter tous les éléments d’identification de la liaison à intercepter, l’infraction qui motive le recours à l’interception ainsi que la durée de celle-ci. |
1° À l’article 100-1, |
1° À l’article 100-1, substituer au mot : « doit comporter » les mots : « est motivée. Elle comporte » ; amendement CL308 |
2° La deuxième phrase de l’article 100-2 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : |
2° (Sans modification) | |
Art. 100-2. – Cette décision est prise pour une durée maximum de quatre mois. Elle ne peut être renouvelée que dans les mêmes conditions de forme et de durée. |
« Elle ne peut être renouvelée que dans les mêmes conditions de forme et de durée, sans que la durée totale de l’interception ne puisse excéder un an ou, s’il s’agit d’une infraction prévue aux articles 706-73 et 706-73-1, deux ans. » ; |
|
Art. 100-7. – Aucune interception ne peut avoir lieu sur la ligne d’un député ou d’un sénateur sans que le président de l’assemblée à laquelle il appartient en soit informé par le juge d’instruction. |
3° Le quatrième alinéa de l’article 100-7 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : |
3° (Sans modification) |
Aucune interception ne peut avoir lieu sur une ligne dépendant du cabinet d’un avocat ou de son domicile sans que le bâtonnier en soit informé par le juge d’instruction. |
||
Aucune interception ne peut avoir lieu sur une ligne dépendant du cabinet d’un magistrat ou de son domicile sans que le premier président ou le procureur général de la juridiction où il réside en soit informé. |
||
Les formalités prévues par le présent article sont prescrites à peine de nullité. |
« Les interceptions prévues par le présent article ne peuvent être ordonnées que par décision motivée du juge des libertés et de la détention, saisi par ordonnance motivée du juge d’instruction, lorsqu’il existe des raisons plausibles de soupçonner que la personne a participé, comme auteur ou complice, à la commission de l’infraction. Le juge d’instruction communique aux personnes devant être informées en application des trois premiers alinéas une copie de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention. |
|
« Les dispositions du présent article sont prévues à peine de nullité. » |
||
Article 25 bis (nouveau) | ||
I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié : | ||
Art. 56. – Si la nature du crime est telle que la preuve en puisse être acquise par la saisie des papiers, documents, données informatiques ou autres objets en la possession des personnes qui paraissent avoir participé au crime ou détenir des pièces, informations ou objets relatifs aux faits incriminés, l’officier de police judiciaire se transporte sans désemparer au domicile de ces derniers pour y procéder à une perquisition dont il dresse procès-verbal. L’officier de police judiciaire peut également se transporter en tous lieux dans lesquels sont susceptibles de se trouver des biens dont la confiscation est prévue à l’article 131-21 du code pénal, pour y procéder à une perquisition aux fins de saisie de ces biens ; si la perquisition est effectuée aux seules fins de rechercher et de saisir des biens dont la confiscation est prévue par les cinquième et sixième alinéas de ce même article, elle doit être préalablement autorisée par le procureur de la République. |
||
Il a seul, avec les personnes désignées à l’article 57 du présent code et celles auxquelles il a éventuellement recours en application de l’article 60, le droit de prendre connaissance des papiers, documents ou données informatiques avant de procéder à leur saisie. |
||
|
Toutefois, il a l’obligation de provoquer préalablement toutes mesures utiles pour que soit assuré le respect du secret professionnel et des droits de la défense. |
1° Au troisième alinéa de l’article 56, après le mot : « toutefois, », sont insérés les mots :« sans préjudice de l’application des articles 56-1 à 56-5, » ; | |
Tous objets et documents saisis sont immédiatement inventoriés et placés sous scellés. Cependant, si leur inventaire sur place présente des difficultés, ils font l’objet de scellés fermés provisoires jusqu’au moment de leur inventaire et de leur mise sous scellés définitifs et ce, en présence des personnes qui ont assisté à la perquisition suivant les modalités prévues à l’article 57. |
||
Il est procédé à la saisie des données informatiques nécessaires à la manifestation de la vérité en plaçant sous main de justice soit le support physique de ces données, soit une copie réalisée en présence des personnes qui assistent à la perquisition. |
||
Si une copie est réalisée, il peut être procédé, sur instruction du procureur de la République, à l’effacement définitif, sur le support physique qui n’a pas été placé sous main de justice, des données informatiques dont la détention ou l’usage est illégal ou dangereux pour la sécurité des personnes ou des biens. |
||
Avec l’accord du procureur de la République, l’officier de police judiciaire ne maintient que la saisie des objets, documents et données informatiques utiles à la manifestation de la vérité, ainsi que des biens dont la confiscation est prévue à l’article 131-21 du code pénal. |
||
Le procureur de la République peut également, lorsque la saisie porte sur des espèces, lingots, effets ou valeurs dont la conservation en nature n’est pas nécessaire à la manifestation de la vérité ou à la sauvegarde des droits des personnes intéressées, autoriser leur dépôt à la Caisse des dépôts et consignations ou à la Banque de France ou sur un compte ouvert auprès d’un établissement bancaire par l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués. |
||
Lorsque la saisie porte sur des billets de banque ou pièces de monnaie libellés en euros contrefaisants, l’officier de police judiciaire doit transmettre, pour analyse et identification, au moins un exemplaire de chaque type de billets ou pièces suspectés faux au centre d’analyse national habilité à cette fin. Le centre d’analyse national peut procéder à l’ouverture des scellés. Il en dresse inventaire dans un rapport qui doit mentionner toute ouverture ou réouverture des scellés. Lorsque les opérations sont terminées, le rapport et les scellés sont déposés entre les mains du greffier de la juridiction compétente. Ce dépôt est constaté par procès-verbal. |
||
Les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables lorsqu’il n’existe qu’un seul exemplaire d’un type de billets ou de pièces suspectés faux, tant que celui-ci est nécessaire à la manifestation de la vérité. |
||
Si elles sont susceptibles de fournir des renseignements sur les objets, documents et données informatiques saisis, les personnes présentes lors de la perquisition peuvent être retenues sur place par l’officier de police judiciaire le temps strictement nécessaire à l’accomplissement de ces opérations. |
||
2° Après l’article 56-4, il est inséré un article 56-5 ainsi rédigé : | ||
« Art. 56-5. – Les perquisitions dans les locaux d’une juridiction ou au domicile d’une personne exerçant des fonctions juridictionnelles et qui tendent à la saisie de documents susceptibles d’être couverts par le secret du délibéré ne peuvent être effectuées que par un magistrat, sur décision écrite et motivée de celui-ci, et en présence du premier président de la cour d’appel ou du premier président de la Cour de cassation ou de son délégué. Cette décision indique la nature de l’infraction sur laquelle portent les investigations, les raisons justifiant la perquisition et l’objet de celle-ci. Le contenu de la décision est porté dès le début de la perquisition à la connaissance du premier président ou de son délégué par le magistrat. Celui-ci, le premier président ou son délégué ont seuls le droit de consulter ou de prendre connaissance des documents ou des objets se trouvant sur les lieux préalablement à leur éventuelle saisie. Aucune saisie ne peut concerner des documents ou des objets relatifs à d’autres infractions que celles mentionnées dans la décision précitée. Les dispositions du présent alinéa sont édictées à peine de nullité. | ||
« Le magistrat qui effectue la perquisition veille à ce que les investigations conduites ne portent pas atteinte à l’indépendance de la justice. | ||
« Le premier président ou son délégué peut s’opposer à la saisie d’un document ou d’un objet s’il estime cette saisie irrégulière. Le document ou l’objet est alors placé sous scellé fermé. Ces opérations font l’objet d’un procès-verbal mentionnant les objections du premier président ou de son délégué, qui n’est pas joint au dossier de la procédure. Si d’autres documents ou objets ont été saisis au cours de la perquisition sans soulever d’opposition, ce procès-verbal est distinct de celui prévu à l’article 57. Ce procès-verbal ainsi que le document ou l’objet placé sous scellé fermé sont transmis sans délai au juge des libertés et de la détention, avec l’original ou une copie du dossier de la procédure. | ||
« Dans un délai de cinq jours à compter de la réception de ces pièces, le juge des libertés et de la détention statue sur l’opposition par ordonnance motivée non susceptible de recours. | ||
« À cette fin, il entend le magistrat qui a procédé à la perquisition et, le cas échéant, le procureur de la République, ainsi que le premier président ou son délégué. Il ouvre le scellé en présence de ces personnes. | ||
« S’il estime qu’il n’y a pas lieu à saisir le document ou l’objet, le juge des libertés et de la détention ordonne sa restitution immédiate, ainsi que la destruction du procès-verbal mentionné au troisième alinéa et, le cas échéant, la cancellation de toute référence à ce document ou à son contenu ou à cet objet qui figurerait dans le dossier de la procédure. | ||
« Dans le cas contraire, il ordonne le versement du scellé et du procès-verbal au dossier de la procédure. Cette décision n’exclut pas la possibilité ultérieure pour les parties de demander la nullité de la saisie devant, selon les cas, la juridiction de jugement ou la chambre de l’instruction. » ; | ||
|
Art. 57. – Sous réserve de ce qui est dit à l’article 56 concernant le respect du secret professionnel et des droits de la défense, les opérations prescrites par ledit article sont faites en présence de la personne au domicile de laquelle la perquisition a lieu. |
3° Au premier alinéa de l’article 57, les mots : « de ce qui est dit à l’article 56 concernant le respect du secret professionnel et des droits de la défense, » sont remplacés par les mots : « des articles 56-1 à 56-5 et du respect du secret professionnel et des droits de la défense mentionné à l’article 56, » ; | |
En cas d’impossibilité, l’officier de police judiciaire aura l’obligation de l’inviter à désigner un représentant de son choix ; à défaut, l’officier de police judiciaire choisira deux témoins requis à cet effet par lui, en dehors des personnes relevant de son autorité administrative. |
||
Le procès-verbal de ces opérations, dressé ainsi qu’il est dit à l’article 66, est signé par les personnes visées au présent article ; au cas de refus, il en est fait mention au procès-verbal. |
||
Art. 57-1. – Les officiers de police judiciaire ou, sous leur responsabilité, les agents de police judiciaire peuvent, au cours d’une perquisition effectuée dans les conditions prévues par le présent code, accéder par un système informatique implanté sur les lieux où se déroule la perquisition à des données intéressant l’enquête en cours et stockées dans ledit système ou dans un autre système informatique, dès lors que ces données sont accessibles à partir du système initial ou disponibles pour le système initial. |
||
Ils peuvent également, dans les conditions de perquisition prévues au présent code, accéder par un système informatique implanté dans les locaux d’un service ou d’une unité de police ou de gendarmerie à des données intéressant l’enquête en cours et stockées dans un autre système informatique, si ces données sont accessibles à partir du système initial. |
||
S’il est préalablement avéré que ces données, accessibles à partir du système initial ou disponibles pour le système initial, sont stockées dans un autre système informatique situé en dehors du territoire national, elles sont recueillies par l’officier de police judiciaire, sous réserve des conditions d’accès prévues par les engagements internationaux en vigueur. |
||
Les données auxquelles il aura été permis d’accéder dans les conditions prévues par le présent article peuvent être copiées sur tout support. Les supports de stockage informatique peuvent être saisis et placés sous scellés dans les conditions prévues par le présent code. |
||
Les officiers de police judiciaire peuvent, par tout moyen, requérir toute personne susceptible : |
||
1° D’avoir connaissance des mesures appliquées pour protéger les données auxquelles il est permis d’accéder dans le cadre de la perquisition ; |
||
2° De leur remettre les informations permettant d’accéder aux données mentionnées au 1°. |
||
|
À l’exception des personnes mentionnées aux articles 56-1 à 56-3, le fait de s’abstenir de répondre dans les meilleurs délais à cette réquisition est puni d’une amende de 3 750 €. |
4° Au dernier alinéa de l’article 57-1, à la seconde phrase du premier alinéa et au deuxième alinéa de l’article 60-1 et à la seconde phrase du premier alinéa de l’article 77-1-1, la référence : « 56-3 » est remplacée par la référence : « 56-5 » ; | |
Art. 60-1. – Le procureur de la République ou l’officier de police judiciaire peut, par tout moyen, requérir de toute personne, de tout établissement ou organisme privé ou public ou de toute administration publique qui sont susceptibles de détenir des informations intéressant l’enquête, y compris celles issues d’un système informatique ou d’un traitement de données nominatives, de lui remettre ces informations, notamment sous forme numérique, sans que puisse lui être opposée, sans motif légitime, l’obligation au secret professionnel. Lorsque les réquisitions concernent des personnes mentionnées aux articles 56-1 à 56-3, la remise des informations ne peut intervenir qu’avec leur accord. |
||
À l’exception des personnes mentionnées aux articles 56-1 à 56-3, le fait de s’abstenir de répondre dans les meilleurs délais à cette réquisition est puni d’une amende de 3 750 euros. |
||
À peine de nullité, ne peuvent être versés au dossier les éléments obtenus par une réquisition prise en violation de l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. |
||
Art. 77-1-1. – Le procureur de la République ou, sur autorisation de celui-ci, l’officier de police judiciaire, peut, par tout moyen, requérir de toute personne, de tout établissement ou organisme privé ou public ou de toute administration publique qui sont susceptibles de détenir des informations intéressant l’enquête, y compris celles issues d’un système informatique ou d’un traitement de données nominatives, de lui remettre ces informations, notamment sous forme numérique, sans que puisse lui être opposée, sans motif légitime, l’obligation au secret professionnel. Lorsque les réquisitions concernent des personnes mentionnées aux articles 56-1 à 56-3, la remise des informations ne peut intervenir qu’avec leur accord. |
||
En cas d’absence de réponse de la personne aux réquisitions, les dispositions du second alinéa de l’article 60-1 sont applicables. |
||
Le dernier alinéa de l’article 60-1 est également applicable. |
||
Art. 96. – Si la perquisition a lieu dans un domicile autre que celui de la personne mise en examen, la personne chez laquelle elle doit s’effectuer est invitée à y assister. Si cette personne est absente ou refuse d’y assister, la perquisition a lieu en présence de deux de ses parents ou alliés présents sur les lieux, ou à défaut, en présence de deux témoins. |
||
Le juge d’instruction doit se conformer aux dispositions des articles 57 (alinéa 2) et 59. |
||
Les dispositions des articles 56 et 56-1 à 56-4 sont applicables aux perquisitions effectuées par le juge d’instruction. |
5° Au dernier alinéa de l’article 96, la référence : « 56-4 » est remplacée par la référence : « 56-5 ». | |
II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er octobre 2016. amendement CL309 | ||
Article 26 |
Article 26 | |
Art. 179. – Si le juge estime que les faits constituent un délit, il prononce, par ordonnance, le renvoi de l’affaire devant le tribunal correctionnel. Cette ordonnance précise, s’il y a lieu, que le prévenu bénéficie des dispositions de l’article 132-78 du code pénal. |
||
L’ordonnance de règlement met fin à la détention provisoire, à l’assignation à résidence avec surveillance électronique ou au contrôle judiciaire. S’il a été décerné, le mandat d’arrêt conserve sa force exécutoire ; s’ils ont été décernés, les mandats d’amener ou de recherche cessent de pouvoir recevoir exécution, sans préjudice de la possibilité pour le juge d’instruction de délivrer un mandat d’arrêt contre le prévenu. |
||
Toutefois, le juge d’instruction peut, par ordonnance distincte spécialement motivée, maintenir le prévenu en détention, sous assignation à résidence avec surveillance électronique ou sous contrôle judiciaire jusqu’à sa comparution devant le tribunal. L’ordonnance de maintien en détention provisoire est motivée par référence aux 2°, 4°, 5° et 6° de l’article 144. |
||
Le prévenu en détention est immédiatement remis en liberté si le tribunal correctionnel n’a pas commencé à examiner au fond à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la date de l’ordonnance de renvoi. |
I. – À la fin du quatrième alinéa de l’article 179 du même code, les mots : « de l’ordonnance de renvoi » sont remplacés par les mots : « soit de l’ordonnance de renvoi ou, en cas d’appel, de l’arrêt de renvoi non frappé de pourvoi, de l’arrêt déclarant l’appel irrecevable, de l’ordonnance de non-admission rendue en application du dernier alinéa de l’article 186 ou de l’arrêt de la chambre criminelle rejetant le pourvoi, soit de la date à laquelle il a été ultérieurement placé en détention provisoire ». |
|
Toutefois, si l’audience sur le fond ne peut se tenir avant l’expiration de ce délai, le tribunal peut, à titre exceptionnel, par une décision mentionnant les raisons de fait ou de droit faisant obstacle au jugement de l’affaire, ordonner la prolongation de la détention pour une nouvelle durée de deux mois. La comparution personnelle du prévenu est de droit si lui-même ou son avocat en font la demande. Cette décision peut être renouvelée une fois dans les mêmes formes. Si le prévenu n’a toujours pas été jugé à l’issue de cette nouvelle prolongation, il est remis immédiatement en liberté. |
||
Lorsqu’elle est devenue définitive, l’ordonnance mentionnée au premier alinéa couvre, s’il en existe, les vices de la procédure. |
||
II. – Après l’article 186-3 du même code, il est inséré deux articles ainsi rédigés : |
II. – (Alinéa sans modification) | |
« Art. 186-4. – En cas d’appel formé contre une ordonnance prévue à l’article 179 |
« Art. 186-4. – En cas d’appel formé contre une ordonnance prévue à l’article 179, la chambre de l’instruction statue dans les deux mois de l’ordonnance, faute de quoi la personne détenue est remise d’office en liberté. amendements CL310 et CL311 | |
« Art. 186-5. – Les délais relatifs à la durée de la détention provisoire prévus aux articles 145-1 à 145-3 ne sont plus applicables lorsque le juge d’instruction a rendu son ordonnance de renvoi devant la juridiction de jugement, même en cas d’appel formé contre cette ordonnance. » |
« Art. 186-5. – (Sans modification) | |
III. – Après l’article 194 du même code, il est inséré un article 194-1 ainsi rédigé : |
III. – (Alinéa sans modification) | |
« Art. 194-1. – Lorsque la chambre de l’instruction est saisie sur renvoi après cassation, les dispositions des articles 148-2, 186-2, 186-4 et 194 fixant les délais dans lesquels elle doit statuer sont applicables. Ces délais courent à compter de la réception par le procureur général près la cour d’appel de l’arrêt et du dossier transmis par le procureur général près la Cour de cassation. » |
« Art. 194-1. – Lorsque la chambre de l’instruction est saisie sur renvoi après cassation, elle statue dans les délais prévus aux articles 148-2, 186-2, 186-4 et 194. Ces délais courent à compter de la réception par le procureur général près la cour d’appel de l’arrêt et du dossier transmis par le procureur général près la Cour de cassation. » amendement CL312 | |
Art. 199. – Les débats se déroulent et l’arrêt est rendu en chambre du conseil. Toutefois, si la personne majeure mise en examen ou son avocat le demande dès l’ouverture des débats, ceux-ci se déroulent et l’arrêt est rendu en séance publique, sauf si la publicité est de nature à entraver les investigations spécifiques nécessitées par l’instruction ou à nuire à la dignité de la personne ou aux intérêts d’un tiers. La chambre de l’instruction statue sur cette demande, après avoir recueilli les observations du procureur général et, le cas échéant, des avocats des autres parties, par un arrêt rendu en chambre du conseil qui n’est susceptible de pourvoi en cassation qu’en même temps que l’arrêt portant sur la demande principale. |
IV. – L’article 199 du même code est ainsi modifié : |
IV. – (Sans modification) |
En matière de détention provisoire, et par dérogation aux dispositions du premier alinéa, si la personne mise en examen est majeure, les débats se déroulent et l’arrêt est rendu en audience publique. Toutefois, le ministère public, la personne mise en examen ou la partie civile ou leurs avocats peuvent, avant l’ouverture des débats, s’opposer à cette publicité si celle-ci est de nature à entraver les investigations spécifiques nécessitées par l’instruction, à porter atteinte à la présomption d’innocence ou à la sérénité des débats ou à nuire à la dignité de la personne ou aux intérêts d’un tiers, ou si l’enquête porte sur des faits mentionnés aux articles 706-73 et 706-73-1. La chambre statue sur cette opposition après avoir recueilli les observations du ministère public et des parties, par un arrêt rendu en chambre du conseil qui n’est susceptible de pourvoi en cassation qu’en même temps que l’arrêt portant sur la demande principale. Si la chambre fait droit à cette opposition ou si la personne mise en examen est mineure, les débats ont lieu et l’arrêt est rendu en chambre du conseil. Il en est de même si la partie civile s’oppose à la publicité, dans les seuls cas où celle-ci est en droit de demander le huis-clos lors de l’audience de jugement. |
||
Après le rapport du conseiller, le procureur général et les avocats des parties sont entendus. |
||
La chambre de l’instruction peut ordonner la comparution personnelle des parties ainsi que l’apport des pièces à conviction. |
||
Il est donné lecture de l’arrêt par le président ou par l’un des conseillers ; cette lecture peut être faite même en l’absence des autres conseillers. |
||
En matière de détention provisoire, la comparution personnelle de la personne concernée est de droit si celle-ci ou son avocat en fait la demande ; cette requête doit, à peine d’irrecevabilité, être présentée en même temps que la déclaration d’appel ou que la demande de mise en liberté adressée à la chambre de l’instruction. Si la personne a déjà comparu devant la chambre de l’instruction moins de quatre mois auparavant, le président de cette juridiction peut, en cas d’appel d’une ordonnance rejetant une demande de mise en liberté, refuser la comparution personnelle de l’intéressé par une décision motivée qui n’est susceptible d’aucun recours. |
1° L’avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas d’appel du ministère public contre une décision de refus de placement en détention provisoire ou de remise en liberté, la personne concernée est également avisée que sa comparution personnelle à l’audience est de droit. » ; |
|
En cas de comparution personnelle de la personne concernée, le délai maximum prévu au dernier alinéa de l’article 194 est prolongé de cinq jours. |
2° Le dernier alinéa est complété par les mots : « , ou de dix jours si la chambre de l’instruction statue sur renvoi après cassation ». |
|
Art. 574-1. – La chambre criminelle saisie d’un pourvoi contre l’arrêt portant mise en accusation doit statuer dans les trois mois de la réception du dossier à la Cour de cassation. |
V. – Au premier alinéa de l’article 574-1 du même code, après le mot : « accusation » sont insérés les mots : « ou ordonnant le renvoi devant le tribunal correctionnel ». |
V. – (Sans modification) |
Le demandeur en cassation ou son avocat doit, à peine de déchéance, déposer son mémoire exposant les moyens de cassation dans le délai d’un mois à compter de la réception du dossier à la Cour de cassation, sauf décision du président de la chambre criminelle prorogeant, à titre exceptionnel, le délai pour une durée de huit jours. Après l’expiration de ce délai, aucun moyen nouveau ne peut être soulevé par lui et il ne peut plus être déposé de mémoire. |
||
S’il n’est pas statué dans le délai prévu au premier alinéa, le prévenu est mis d’office en liberté. |
||
Code de la défense |
Article 27 |
Article 27 |
Art. L. 1521-18. – Dès leur arrivée sur le sol français, les personnes faisant l’objet de mesures de coercition sont mises à la disposition de l’autorité judiciaire. |
L’article L. 1521-18 du code de la défense est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
(Alinéa sans modification) |
« Si ces personnes font l’objet d’une mesure de garde à vue à leur arrivée sur le sol français, elles sont présentées dans les plus brefs délais |
« Si ces personnes font l’objet d’une mesure de garde à vue à leur arrivée sur le sol français, elles sont présentées dans les plus brefs délais soit, à la requête du procureur de la République, au juge des libertés et de la détention, soit au juge d’instruction, qui peuvent ordonner leur remise en liberté. À défaut d’une telle décision, la garde à vue se poursuit. amendements CL313 et CL314 | |
« La personne peut demander, dans les conditions prévues à l’article 63-3-1 du code de procédure pénale, à être assistée par un avocat lors de cette présentation. » |
(Alinéa sans modification) | |
Article 27 bis (nouveau) | ||
La section 2 du chapitre II du titre III du livre Ier du code pénal est ainsi modifiée : | ||
1° Est insérée une sous-section 5 bis intitulée : « De la conversion d’une peine d’emprisonnement ferme en sursis avec mise à l’épreuve, travail d’intérêt général, jours-amende ou contrainte pénale » et comprenant l’article 132-57 ; | ||
2° L’article 132-57 est ainsi modifié : | ||
Code pénal |
a) Le premier alinéa est ainsi modifié : | |
Art. 132-57. – Lorsqu’une condamnation pour un délit de droit commun comportant une peine d’emprisonnement ferme de six mois au plus a été prononcée, le juge de l’application des peines peut, lorsque cette condamnation n’est plus susceptible de faire l’objet d’une voie de recours par le condamné, ordonner qu’il sera sursis à l’exécution de cette peine et que le condamné accomplira, pour une durée de vingt à deux cent quatre-vingts heures, un travail d’intérêt général non rémunéré au profit soit d’une personne morale de droit public, soit d’une personne morale de droit privé chargée d’une mission de service public ou d’une association habilitées à mettre en œuvre des travaux d’intérêt général. L’exécution de l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général est soumise aux prescriptions du troisième alinéa de l’article 132-54 et des articles 132-55 et 132-56. Le juge de l’application des peines peut également décider que le condamné effectuera une peine de jours-amende, conformément aux dispositions des articles 131-5 et 131-25. |
– à la première phrase, la première occurrence du mot : « et » est remplacée par les mots : « selon les modalités prévues aux articles 132-43 et 132-44 ; en ce cas, le juge de l’application des peines fixe le délai d’épreuve prévu à l’article 132-42 et détermine les obligations mentionnées à l’article 132-45. Le juge de l’application des peines peut également ordonner » ; | |
– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : | ||
« Le juge de l’application des peines peut également ordonner que le condamné effectuera une contrainte pénale selon les modalités prévues aux articles 713-42 à 713-48 du code de procédure pénale ; en ce cas, la durée maximale de l’emprisonnement encouru par le condamné en cas d’inobservation des obligations et des interdictions auxquelles il est astreint correspond à la durée de la peine d’emprisonnement initialement prononcée, et le juge d’application des peines détermine les obligations mentionnées à l’article 713-43 du même code. » ; | ||
Le présent article est applicable aux peines d’emprisonnement ayant fait l’objet d’un sursis partiel, assorti ou non d’une mise à l’épreuve, lorsque la partie ferme de la peine est inférieure ou égale à six mois. Dans ce cas, la partie de la peine avec sursis demeure applicable. |
||
Le présent article est également applicable aux peines d’emprisonnement inférieures ou égales à six mois résultant de la révocation d’un sursis, assorti ou non d’une mise à l’épreuve. |
||
b) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : | ||
« Si le condamné doit exécuter plusieurs peines d’emprisonnement, le présent article peut s’appliquer à chacune des peines prononcées, même si la durée totale de l’emprisonnement à exécuter excède six mois. » amendement CL327 | ||
En cas d’exécution partielle d’un travail d’intérêt général, le juge de l’application des peines peut ordonner la conversion de la partie non exécutée en jours-amende. |
||
Article 27 ter (nouveau) | ||
I. – Le code de procédure pénale est modifié : | ||
1° Après l’article 41-6, il est inséré un article 41-7 ainsi rédigé : | ||
« Art. 41-7. – La personne qui demande la restitution d’un objet saisi au cours de l’enquête en application de l’article 41-4 peut solliciter que cette demande soit examinée par le procureur de la République dans un délai de cinq jours si elle justifie que le maintien de la saisie lui causerait un préjudice irrémédiable dans l’exercice de son activité professionnelle. | ||
« À peine d’irrecevabilité, cette demande est présentée dans un écrit spécialement motivé, faisant apparaître les termes “référé-restitution”, et adressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par déclaration au greffe contre récépissé. | ||
|
Code de procédure pénale |
« Si le procureur de la République refuse la restitution, sa décision peut-être déférée par le demandeur, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification, devant le président de la chambre de l’instruction, qui statue par ordonnance motivée non susceptible de recours dans les huit jours suivant la réception du recours, au vu des observations écrites de la personne ou de son avocat et de celles du procureur général. À défaut de réponse du procureur de la République dans un délai de cinq jours, la personne peut saisir directement le président de la chambre de l’instruction. » ; | |
Art. 99. – Au cours de l’information, le juge d’instruction est compétent pour décider de la restitution des objets placés sous main de justice. |
||
Il statue, par ordonnance motivée, soit sur réquisitions du procureur de la République, soit, après avis de ce dernier, d’office ou sur requête de la personne mise en examen, de la partie civile ou de toute autre personne qui prétend avoir droit sur l’objet. |
2° Le deuxième alinéa de l’article 99 est complété par les mots : « lorsque la requête est formée conformément à l’avant-dernier alinéa de l’article 81, faute pour le juge d’instruction d’avoir statué dans un délai d’un mois, la personne peut saisir directement le président de la chambre de l’instruction, qui statue conformément aux troisième à cinquième alinéas de l’article 186-1. » ; | |
Il peut également, avec l’accord du procureur de la République, décider d’office de restituer ou de faire restituer à la victime de l’infraction les objets placés sous main de justice dont la propriété n’est pas contestée. |
||
Il n’y a pas lieu à restitution lorsque celle-ci est de nature à faire obstacle à la manifestation de la vérité ou à la sauvegarde des droits des parties ou lorsqu’elle présente un danger pour les personnes ou les biens. Elle peut être refusée lorsque la confiscation de l’objet est prévue par la loi. |
||
L’ordonnance du juge d’instruction mentionnée au deuxième alinéa du présent article est notifiée soit au requérant en cas de rejet de la demande, soit au ministère public et à toute autre partie intéressée en cas de décision de restitution. Elle peut être déférée à la chambre de l’instruction, sur simple requête déposée au greffe du tribunal, dans le délai et selon les modalités prévus par le quatrième alinéa de l’article 186. Ce délai est suspensif. |
||
Le tiers peut, au même titre que les parties, être entendu par la chambre de l’instruction en ses observations, mais il ne peut prétendre à la mise à sa disposition de la procédure. |
||
3° Après l’article 99-2, il est inséré un article 99-2-1 ainsi rédigé : | ||
« Art. 99-2-1. – La procédure de référé-restitution prévue à l’article 41-7 est applicable aux demandes de restitution formées en application de l’article 99. Les attributions du procureur de la République sont alors exercées par le juge d’instruction. » ; | ||
4° Après l’article 802, il est inséré un article 802-1 ainsi rédigé : | ||
« Art. 802-1. – Lorsque, en application du présent code, le ministère public ou une juridiction est saisi d’une demande à laquelle il doit être répondu par une décision motivée susceptible de recours, en l’absence de réponse dans le délai de deux mois à compter de la demande effectuée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par déclaration au greffe contre récépissé, ce recours peut être exercé devant l’autorité compétente contre la décision implicite de rejet de la demande. | ||
« Le présent article n’est pas applicable lorsque la loi prévoit un recours spécifique en l’absence de réponse, le cas échéant dans un délai inférieur à deux mois. » | ||
II. – Le 2° du I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2017. amendement CL330 | ||
Article 27 quater (nouveau) | ||
I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié : | ||
1° Après l’article 61-2, il est inséré un article 61-3 ainsi rédigé : | ||
« Art. 61-3. – Toute personne à l’égard de laquelle existent une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a participé, en tant qu’auteur ou complice, à la commission d’un crime ou d’un délit puni d’emprisonnement peut demander qu’un avocat de son choix ou, si elle n’est pas en mesure d’en désigner un, qu’un avocat commis d’office par le bâtonnier : | ||
« 1° L’assiste lorsqu’elle participe à une opération de reconstitution de l’infraction ; | ||
« 2° Soit présent lors d’une séance d’identification des suspects dont elle fait partie. « La personne est informée de ce droit avant qu’il soit procédé à ces opérations. | ||
« L’avocat désigné peut, à l’issue des opérations, présenter des observations écrites qui sont jointes à la procédure ; il peut directement adresser ces observations ou copie de celles-ci au procureur de la République. | ||
« Lorsque la victime participe à ces opérations, elle peut également être assistée par un avocat dans les conditions prévues à l’article 61-2. » ; | ||
Art. 63-1. – La personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu’elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa : |
||
1° De son placement en garde à vue ainsi que de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont celle-ci peut faire l’objet ; |
||
2° De la qualification, de la date et du lieu présumés de l’infraction qu’elle est soupçonnée d’avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs mentionnés aux 1° à 6° de l’article 62-2 justifiant son placement en garde à vue ; |
||
3° Du fait qu’elle bénéficie : |
||
– du droit de faire prévenir un proche et son employeur ainsi que, si elle est de nationalité étrangère, les autorités consulaires de l’Etat dont elle est ressortissante, conformément à l’article 63-2 ; |
2° Au deuxième alinéa du 3° de l’article 63-1, après le mot : « ressortissante, », sont insérés les mots : « et, le cas échéant, de communiquer avec ces personnes, » ; | |
– du droit d’être examinée par un médecin, conformément à l’article 63-3 ; |
||
- du droit d’être assistée par un avocat, conformément aux articles 63-3-1 à 63-4-3 ; |
||
– s’il y a lieu, du droit d’être assistée par un interprète ; |
||
– du droit de consulter, dans les meilleurs délais et au plus tard avant l’éventuelle prolongation de la garde à vue, les documents mentionnés à l’article 63-4-1 ; |
||
– du droit de présenter des observations au procureur de la République ou, le cas échéant, au juge des libertés et de la détention, lorsque ce magistrat se prononce sur l’éventuelle prolongation de la garde à vue, tendant à ce qu’il soit mis fin à cette mesure. Si la personne n’est pas présentée devant le magistrat, elle peut faire connaître oralement ses observations dans un procès-verbal d’audition, qui est communiqué à celui-ci avant qu’il ne statue sur la prolongation de la mesure ; |
||
– du droit, lors des auditions, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. |
||
Si la personne est atteinte de surdité et qu’elle ne sait ni lire, ni écrire, elle doit être assistée par un interprète en langue des signes ou par toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant de communiquer avec elle. Il peut également être recouru à tout dispositif technique permettant de communiquer avec une personne atteinte de surdité. |
||
Si la personne ne comprend pas le français, ses droits doivent lui être notifiés par un interprète, le cas échéant après qu’un formulaire lui a été remis pour son information immédiate. |
||
Mention de l’information donnée en application du présent article est portée au procès-verbal de déroulement de la garde à vue et émargée par la personne gardée à vue. En cas de refus d’émargement, il en est fait mention. |
||
En application de l’article 803-6, un document énonçant ces droits est remis à la personne lors de la notification de sa garde à vue. |
||
3° L’article 63-2 est ainsi modifié : | ||
Art. 63-2. –Toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, faire prévenir, par téléphone, une personne avec laquelle elle vit habituellement ou l’un de ses parents en ligne directe, l’un de ses frères et soeurs ou son curateur ou son tuteur de la mesure dont elle est l’objet. Elle peut en outre faire prévenir son employeur. Lorsque la personne gardée à vue est de nationalité étrangère, elle peut faire contacter les autorités consulaires de son pays. |
a) Au début du premier alinéa, est ajouté la mention : « I. – » ; | |
Si l’officier de police judiciaire estime, en raison des nécessités de l’enquête, ne pas devoir faire droit à cette demande, il en réfère sans délai au procureur de la République qui décide, s’il y a lieu, d’y faire droit. |
b) Le deuxième alinéa est supprimé ; | |
Sauf en cas de circonstance insurmontable, qui doit être mentionnée au procès-verbal, les diligences incombant aux enquêteurs en application du premier alinéa doivent intervenir au plus tard dans un délai de trois heures à compter du moment où la personne a formulé la demande. |
||
c) Sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés : | ||
« Le procureur de la République peut, à la demande de l’officier de police judiciaire, décider que l’avis prévu au premier alinéa sera différé ou ne sera pas délivré si cette décision est, au regard des circonstances, indispensable afin de permettre le recueil ou la conservation des preuves ou de prévenir une atteinte grave à la vie, à la liberté ou à l’intégrité physique d’une personne. | ||
« Si la garde à vue est prolongée au delà de quarante-huit heures, le report de l’avis peut être maintenu, pour les mêmes raisons, par le juge des libertés et de la détention ou le juge d’instruction, sauf lorsque l’avis concerne les autorités consulaires. | ||
« II. – L’officier de police judiciaire peut autoriser la personne en garde à vue qui en fait la demande à communiquer, par écrit, par téléphone ou lors d’un entretien, avec un des tiers mentionnés au I du présent article, s’il lui apparaît que cette communication n’est pas incompatible avec les objectifs mentionnés à l’article 62-2 et qu’elle ne risque pas de permettre une infraction. | ||
« Afin d’assurer le bon ordre, la sûreté et la sécurité des locaux dans lesquels s’effectue la garde à vue, l’officier ou l’agent de police judiciaire détermine le moment, les modalités et la durée de cette communication, qui ne peut excéder trente minutes et intervient sous son contrôle, le cas échéant en sa présence ou en la présence d’une personne qu’il désigne. Si la demande de communication concerne les autorités consulaires, l’officier de police judiciaire ne peut s’y opposer au delà de la quarante-huitième heure de la garde à vue. | ||
« Le présent II n’est pas applicable en cas de demande de communication avec un tiers dont il a été décidé en application des deux derniers alinéas du I du présent article qu’il ne pouvait être avisé de la garde à vue. » ; | ||
Art. 63-4-2. – La personne gardée à vue peut demander que l’avocat assiste à ses auditions et confrontations. Dans ce cas, la première audition, sauf si elle porte uniquement sur les éléments d’identité, ne peut débuter sans la présence de l’avocat choisi ou commis d’office avant l’expiration d’un délai de deux heures suivant l’avis adressé dans les conditions prévues à l’article 63-3-1 de la demande formulée par la personne gardée à vue d’être assistée par un avocat. Au cours des auditions ou confrontations, l’avocat peut prendre des notes. |
||
Si l’avocat se présente après l’expiration du délai prévu au premier alinéa alors qu’une audition ou une confrontation est en cours, celle-ci est interrompue à la demande de la personne gardée à vue afin de lui permettre de s’entretenir avec son avocat dans les conditions prévues à l’article 63-4 et que celui-ci prenne connaissance des documents prévus à l’article 63-4-1. Si la personne gardée à vue ne demande pas à s’entretenir avec son avocat, celui-ci peut assister à l’audition en cours dès son arrivée dans les locaux du service de police judiciaire ou à la confrontation. |
||
Lorsque les nécessités de l’enquête exigent une audition immédiate de la personne, le procureur de la République peut autoriser, par décision écrite et motivée, sur demande de l’officier de police judiciaire, que l’audition débute sans attendre l’expiration du délai prévu au premier alinéa. |
||
À titre exceptionnel, sur demande de l’officier de police judiciaire, le procureur de la République ou le juge des libertés et de la détention, selon les distinctions prévues par l’alinéa suivant, peut autoriser, par décision écrite et motivée, le report de présence de l’avocat lors des auditions ou confrontations, si cette mesure apparaît indispensable pour des raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l’enquête, soit pour permettre le bon déroulement d’investigations urgentes tendant au recueil ou à la conservation des preuves, soit pour prévenir une atteinte imminente aux personnes. |
4° Après le mot : « atteinte », la fin du quatrième alinéa de l’article 63-4-2 est ainsi rédigée : « grave et imminente à la vie, à la liberté ou à l’intégrité physique d’une personne. » ; | |
Le procureur de la République ne peut différer la présence de l’avocat que pendant une durée maximale de douze heures. Lorsque la personne est gardée à vue pour un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement supérieure ou égale à cinq ans, le juge des libertés et de la détention peut, sur requête du procureur de la République, autoriser à différer la présence de l’avocat, au-delà de la douzième heure, jusqu’à la vingt-quatrième heure. Les autorisations du procureur de la République et du juge des libertés et de la détention sont écrites et motivées par référence aux conditions prévues à l’alinéa précédent au regard des éléments précis et circonstanciés résultant des faits de l’espèce. |
||
Lorsque, conformément aux dispositions des deux alinéas qui précèdent, le procureur de la République ou le juge des libertés et de la détention a autorisé à différer la présence de l’avocat lors des auditions ou confrontations, il peut également, dans les conditions et selon les modalités prévues par ces mêmes alinéas, décider que l’avocat ne peut, pour une durée identique, consulter les procès-verbaux d’audition de la personne gardée à vue. |
||
5° L’article 76-1 est ainsi rétabli : | ||
« Art. 76-1. – L’article 61-3 est applicable à l’enquête préliminaire. » ; | ||
Art. 117. – Nonobstant les dispositions prévues à l’article 116, le juge d’instruction peut procéder à un interrogatoire immédiat et à des confrontations si l’urgence résulte soit de l’état d’un témoin en danger de mort, soit de l’existence d’indices sur le point de disparaître, ou encore dans le cas prévu à l’article 72. |
6° À la fin du premier alinéa de l’article 117, les mots : « , ou encore dans le cas prévu à l’article 72 » sont supprimés ; | |
Le procès-verbal fait mention des causes d’urgence. |
||
Art. 133-1. – Dans les cas prévus par les articles 125, 127 et 133, lorsque la personne est retenue par les services de police ou de gendarmerie avant sa présentation devant un magistrat, le procureur de la République du lieu de l’arrestation est informé dès le début de cette rétention et la personne a le droit de faire prévenir un proche dans les conditions prévues par l’article 63-2 et d’être examinée par un médecin dans les conditions prévues par l’article 63-3. |
7° Après la référence : « 63-2 », la fin de l’article 133-1 est ainsi rédigée : « , d’être examinée par un médecin dans les conditions prévues à l’article 63-3 et d’être assistée d’un avocat dans les conditions prévues aux articles 63-3-1 à 63-4-4. » ; | |
Art. 135-2. – Si la personne faisant l’objet d’un mandat d’arrêt est découverte après le règlement de l’information, il est procédé selon les dispositions du présent article. |
||
Le procureur de la République du lieu de l’arrestation est avisé dès le début de la rétention de la personne par les services de police ou de gendarmerie. Pendant cette rétention, il est fait application des dispositions des articles 63-2 et 63-3. La rétention ne peut durer plus de vingt-quatre heures. |
8° À la fin de la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article 135-2, les références : « des dispositions des articles 63-2 et 63-3 » sont remplacées par la référence : « de l’article 133-1 » ; | |
La personne est conduite dans les meilleurs délais et au plus tard dans les vingt-quatre heures de son arrestation devant le procureur de la République du tribunal de grande instance dans le ressort duquel siège la juridiction de jugement saisie des faits. Après avoir vérifié son identité et lui avoir notifié le mandat, ce magistrat la présente devant le juge des libertés et de la détention. |
||
Le juge des libertés et de la détention peut, sur les réquisitions du procureur de la République, soit placer la personne sous contrôle judiciaire, soit ordonner son placement en détention provisoire jusqu’à sa comparution devant la juridiction de jugement, par ordonnance motivée conformément aux dispositions de l’article 144, rendue à l’issue d’un débat contradictoire organisé conformément aux dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l’article 145. Si la personne est placée en détention, les délais prévus par les quatrième et cinquième alinéas de l’article 179 et par les huitième et neuvième alinéas de l’article 181 sont alors applicables et courent à compter de l’ordonnance de placement en détention. La décision du juge des libertés et de la détention peut faire, dans les dix jours de sa notification, l’objet d’un appel devant la chambre des appels correctionnels si la personne est renvoyée devant le tribunal correctionnel et devant la chambre de l’instruction si elle est renvoyée devant la cour d’assises. |
||
Si la personne a été arrêtée à plus de deux cents kilomètres du siège de la juridiction de jugement et qu’il n’est pas possible de la conduire dans le délai de vingt-quatre heures devant le procureur de la République mentionné au troisième alinéa, elle est conduite devant le juge des libertés et de la détention du lieu de son arrestation, qui vérifie son identité, lui notifie le mandat et reçoit ses éventuelles déclarations après l’avoir avertie qu’elle est libre de ne pas en faire. Ce magistrat met alors le mandat à exécution en faisant conduire la personne à la maison d’arrêt et il en avise le procureur de la République du tribunal de grande instance dans le ressort duquel siège la juridiction de jugement. Celui-ci ordonne le transfèrement de la personne, qui doit comparaître devant lui dans les quatre jours de la notification du mandat ; ce délai est porté à six jours en cas de transfèrement entre un département d’outre-mer et la France métropolitaine ou un autre département d’outre-mer. Il est alors procédé conformément aux dispositions des troisième et quatrième alinéas. |
||
La présentation devant le juge des libertés et de la détention prévue par le quatrième alinéa n’est pas nécessaire si, dans les délais prévus pour cette présentation, la personne peut comparaître devant la juridiction de jugement saisie des faits. |
||
Les dispositions du présent article sont également applicables aux mandats d’arrêt délivrés après l’ordonnance de règlement. Elles ne sont toutefois pas applicables lorsque, postérieurement à la délivrance du mandat d’arrêt décerné au cours de l’instruction ou après son règlement, la personne a été condamnée à une peine privative de liberté, soit en matière correctionnelle par un jugement contradictoire ou réputé contradictoire, soit en matière criminelle par un arrêt rendu par défaut ; elles ne sont de même pas applicables lorsque le mandat a été délivré à la suite d’une telle condamnation. Dans ces cas, sans qu’il soit nécessaire de la présenter devant le juge des libertés et de la détention, la personne arrêtée est placée en détention provisoire jusqu’à l’expiration des délais de recours et, en cas de recours, jusqu’à sa comparution devant la juridiction de jugement, sans préjudice de son droit de former des demandes de mise en liberté. |
||
Art. 145-4. – Lorsque la personne mise en examen est placée en détention provisoire, le juge d’instruction peut prescrire à son encontre l’interdiction de communiquer pour une période de dix jours. Cette mesure peut être renouvelée, mais pour une nouvelle période de dix jours seulement. En aucun cas, l’interdiction de communiquer ne s’applique à l’avocat de la personne mise en examen. |
9° L’article 145-4 est ainsi modifié : | |
Sous réserve des dispositions qui précèdent, toute personne placée en détention provisoire peut, avec l’autorisation du juge d’instruction, recevoir des visites sur son lieu de détention. |
a) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « ou téléphoner à un tiers » ; | |
À l’expiration d’un délai d’un mois à compter du placement en détention provisoire, le juge d’instruction ne peut refuser de délivrer un permis de visite à un membre de la famille de la personne détenue que par une décision écrite et spécialement motivée au regard des nécessités de l’instruction. |
b) Au troisième alinéa, les mots : « à un membre de la famille de la personne détenue » sont remplacés par les mots : « ou d’autoriser l’usage du téléphone » ; | |
Cette décision est notifiée par tout moyen et sans délai au demandeur. Ce dernier peut la déférer au président de la chambre de l’instruction qui statue dans un délai de cinq jours par une décision écrite et motivée non susceptible de recours. Lorsqu’il infirme la décision du juge d’instruction, le président de la chambre de l’instruction délivre le permis de visite. |
||
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : | ||
« Après la clôture de l’instruction, les attributions du juge d’instruction sont exercées par le procureur de la République selon les formes et conditions prévues au présent article. » ; | ||
Art. 154. – Les dispositions des articles 61-1 et 61-2 relatives à l’audition d’une personne soupçonnée ou d’une victime ainsi que celles des articles 62-2 à 64-1 relatives à la garde à vue sont applicables lors de l’exécution des commissions rogatoires. |
10° Au premier alinéa de l’article 154, les mots : « celles des articles 62-2 à 64-1 relatives à la garde à vue » sont remplacés par les références : « les artcles 61-3 et 62-2 à 64-1 » ; | |
Les attributions conférées au procureur de la République par ces articles sont alors exercées par le juge d’instruction. Lors de la délivrance de l’information prévue aux articles 61-1 et 63-1, il est précisé que l’audition ou la garde à vue intervient dans le cadre d’une commission rogatoire. |
||
11° Le paragraphe 1er de la section 2 du chapitre IV du titre X du livre IV est complété par un article 695-17-1 ainsi rédigé : | ||
« Art. 695-17-1. – Si le ministère public est informé par l’autorité judiciaire de l’État membre d’exécution d’une demande de la personne arrêtée tendant à la désignation d’un avocat sur le territoire national, il transmet à cette personne les informations utiles lui permettant de faire le choix d’un avocat ou, à la demande de la personne, fait procéder à la désignation d’office d’un avocat par le bâtonnier. » ; | ||
Art. 695-27. – Toute personne appréhendée en exécution d’un mandat d’arrêt européen doit être conduite dans les quarante-huit heures devant le procureur général territorialement compétent. Pendant ce délai, les dispositions des articles 63-1 à 63-7 sont applicables. |
12° L’article 695-27 est ainsi modifié : | |
Après avoir vérifié l’identité de cette personne, le procureur général l’informe, dans une langue qu’elle comprend, de l’existence et du contenu du mandat d’arrêt européen dont elle fait l’objet. Il l’avise également qu’elle peut être assistée par un avocat de son choix ou, à défaut, par un avocat commis d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats, informé sans délai et par tout moyen. Il l’avise de même qu’elle peut s’entretenir immédiatement avec l’avocat désigné. |
||
a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : | ||
« Le procureur général informe également la personne qu’elle peut également demander à être assistée dans l’État d’émission du mandat par un avocat de son choix ou par un avocat commis d’office ; si la personne en fait la demande, celle-ci est aussitôt transmise à l’autorité judiciaire compétente de l’État d’émission. » ; | ||
Mention de ces informations est faite, à peine de nullité de la procédure, au procès-verbal. |
||
|
L’avocat peut consulter sur-le-champ le dossier et communiquer librement avec la personne recherchée. |
b) Au quatrième alinéa, après le mot : « avocat », sont insérés les mots : « désigné en application du deuxième alinéa » ; | |
Le procureur général informe ensuite la personne recherchée de sa faculté de consentir ou de s’opposer à sa remise à l’autorité judiciaire de l’Etat membre d’émission et des conséquences juridiques résultant de ce consentement. Il l’informe également qu’elle peut renoncer à la règle de la spécialité et des conséquences juridiques de cette renonciation. |
||
Lorsque le mandat d’arrêt européen a été émis aux fins d’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privative de liberté et que la personne se trouve dans le cas prévu au 4° de l’article 695-22-1 et n’a pas été informée dans les formes légales de l’existence des poursuites pénales ayant abouti à la décision de condamnation, elle peut demander à recevoir copie de celle-ci avant la remise. Le procureur général informe de cette demande l’autorité compétente de l’Etat membre d’émission. Dès que cette autorité lui a adressé copie de la décision, le procureur général la communique à l’intéressé. Cette communication est faite pour information. Elle ne vaut pas signification de la décision et ne fait courir aucun délai de recours. |
||
Art. 706-88. – Pour l’application des articles 63,77 et 154, si les nécessités de l’enquête ou de l’instruction relatives à l’une des infractions entrant dans le champ d’application de l’article 706-73 l’exigent, la garde à vue d’une personne peut, à titre exceptionnel, faire l’objet de deux prolongations supplémentaires de vingt-quatre heures chacune. |
||
Ces prolongations sont autorisées, par décision écrite et motivée, soit, à la requête du procureur de la République, par le juge des libertés et de la détention, soit par le juge d’instruction. |
||
La personne gardée à vue doit être présentée au magistrat qui statue sur la prolongation préalablement à cette décision. La seconde prolongation peut toutefois, à titre exceptionnel, être autorisée sans présentation préalable de la personne en raison des nécessités des investigations en cours ou à effectuer. |
||
Lorsque la première prolongation est décidée, la personne gardée à vue est examinée par un médecin désigné par le procureur de la République, le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire. Le médecin délivre un certificat médical par lequel il doit notamment se prononcer sur l’aptitude au maintien en garde à vue, qui est versé au dossier. La personne est avisée par l’officier de police judiciaire du droit de demander un nouvel examen médical. Ces examens médicaux sont de droit. Mention de cet avis est portée au procès-verbal et émargée par la personne intéressée ; en cas de refus d’émargement, il en est fait mention. |
||
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, si la durée prévisible des investigations restant à réaliser à l’issue des premières quarante-huit heures de garde à vue le justifie, le juge des libertés et de la détention ou le juge d’instruction peuvent décider, selon les modalités prévues au deuxième alinéa, que la garde à vue fera l’objet d’une seule prolongation supplémentaire de quarante-huit heures. |
||
Par dérogation aux dispositions des articles 63-4 à 63-4-2, lorsque la personne est gardée à vue pour une infraction entrant dans le champ d’application de l’article 706-73, l’intervention de l’avocat peut être différée, en considération de raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l’enquête ou de l’instruction, soit pour permettre le recueil ou la conservation des preuves, soit pour prévenir une atteinte aux personnes, pendant une durée maximale de quarante-huit heures ou, s’il s’agit d’une infraction mentionnée aux 3° ou 11° du même article 706-73, pendant une durée maximale de soixante-douze heures. |
13° Au sixième alinéa de l’article 706-88, les mots : « aux personnes » sont remplacés par les mots : « grave à la vie, à la liberté ou à l’intégrité physique d’une personne ». | |
Code des douanes |
II. – Le premier alinéa de l’article 323-5 du code des douanes est ainsi modifié : | |
Art. 323-5. – La personne placée en retenue douanière bénéficie du droit de faire prévenir un proche ou son curateur ou son tuteur, de faire prévenir son employeur, d’être examinée par un médecin et de l’assistance d’un avocat dans les conditions et sous les réserves définies aux articles 63-2 à 63-4-4 du code de procédure pénale. Lorsque la personne placée en retenue douanière est de nationalité étrangère, elle peut faire contacter les autorités consulaires de son pays. Les attributions conférées à l’officier de police judiciaire par les articles 63-2 à 63-3-1,63-4-2 et 63-4-3 du même code sont exercées par un agent des douanes. |
1° À la première phrase, après le mot : « employeur », sont insérés les mots : « , de faire contacter les autorités consulaires de son pays si elle est de nationalité étrangère, de communiquer le cas échéant avec l’une de ces personnes » ; | |
2° La deuxième phrase est supprimée. | ||
Lorsque la personne est retenue pour un délit douanier mentionné au dernier alinéa de l’article 414 ou à l’article 415 du présent code ou pour un délit connexe à une infraction mentionnée à l’article 706-73 du code de procédure pénale, l’intervention de l’avocat peut être différée dans les conditions prévues aux sixième à huitième alinéas de l’article 706-88 du même code. |
||
Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante |
||
Art. 4. – I – Le mineur de treize ans ne peut être placé en garde à vue. Toutefois, à titre exceptionnel, le mineur de dix à treize ans contre lequel il existe des indices graves ou concordants laissant présumer qu’il a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’au moins cinq ans d’emprisonnement peut, pour l’un des motifs prévus par l’article 62-2 du code de procédure pénale, être retenu à la disposition d’un officier de police judiciaire avec l’accord préalable et sous le contrôle d’un magistrat du ministère public ou d’un juge d’instruction spécialisés dans la protection de l’enfance ou d’un juge des enfants, pour une durée que ce magistrat détermine et qui ne saurait excéder douze heures. Cette retenue peut toutefois être prolongée à titre exceptionnel par décision motivée de ce magistrat pour une durée qui ne saurait non plus excéder douze heures, après présentation devant lui du mineur, sauf si les circonstances rendent cette présentation impossible. Elle doit être strictement limitée au temps nécessaire à la déposition du mineur et à sa présentation devant le magistrat compétent ou à sa remise à l’une des personnes visées au II du présent article. |
||
Les dispositions des II, III et IV du présent article et de l’article 803-6 du code de procédure pénale sont applicables. Lorsque le mineur ou ses représentants légaux n’ont pas désigné d’avocat, le procureur de la République, le juge chargé de l’instruction ou l’officier de police judiciaire doit, dès le début de la retenue, informer par tout moyen et sans délai le bâtonnier afin qu’il commette un avocat d’office. |
||
II – Lorsqu’un mineur est placé en garde à vue, l’officier de police judiciaire doit, dès que le procureur de la République ou le juge chargé de l’information a été avisé de cette mesure, en informer les parents, le tuteur, la personne ou le service auquel est confié le mineur. |
||
|
Il ne peut être dérogé aux dispositions de l’alinéa précédent que sur décision du procureur de la République ou du juge chargé de l’information et pour la durée que le magistrat détermine et qui ne peut excéder vingt-quatre heures ou, lorsque la garde à vue ne peut faire l’objet d’une prolongation, douze heures. |
III. – Au second alinéa du II de l’article 4 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante, les mots : « sur décision du procureur de la République ou du juge chargé de l’information » sont remplacés par les mots : « pour permettre le recueil ou la conservation des preuves ou pour prévenir une atteinte grave à la vie, à la liberté ou à l’intégrité physique d’une personne, sur décision du procureur de la République ou du juge chargé de l’information prise au regard des circonstances de l’espèce, ». | |
III – Dès le début de la garde à vue d’un mineur de seize ans, le procureur de la République ou le juge chargé de l’information doit désigner un médecin qui examine le mineur dans les conditions prévues par l’article 63-3 du code de procédure pénale. |
||
Lorsqu’un mineur de plus de seize ans est placé en garde à vue, ses représentants légaux sont avisés de leur droit de demander un examen médical lorsqu’ils sont informés de la garde à vue en application du II du présent article. |
||
IV – Dès le début de la garde à vue, le mineur peut demander à être assisté par un avocat, conformément aux articles 63-3-1 à 63-4-3 du code de procédure pénale. Il doit être immédiatement informé de ce droit. Lorsque le mineur n’a pas sollicité l’assistance d’un avocat, cette demande peut également être faite par ses représentants légaux qui sont alors avisés de ce droit lorsqu’ils sont informés de la garde à vue en application du II du présent article. |
||
V – En cas de délit puni d’une peine inférieure à cinq ans d’emprisonnement, la garde à vue d’un mineur âgé de treize à seize ans ne peut être prolongée. |
||
Aucune mesure de garde à vue ne peut être prolongée sans présentation préalable du mineur au procureur de la République ou au juge d’instruction du lieu d’exécution de la mesure. |
||
VI – Les interrogatoires des mineurs placés en garde à vue visés à l’article 64 du code de procédure pénale font l’objet d’un enregistrement audiovisuel. |
||
L’enregistrement ne peut être consulté, au cours de l’instruction ou devant la juridiction de jugement, qu’en cas de contestation du contenu du procès-verbal d’interrogatoire, sur décision du juge d’instruction, du juge des enfants ou de la juridiction de jugement, à la demande du ministère public ou d’une des parties. Les huit derniers alinéas de l’article 114 ne sont pas applicables. Lorsqu’une partie demande la consultation de l’enregistrement, cette demande est formée et le juge d’instruction statue conformément aux deux premiers alinéas de l’article 82-1 du code de procédure pénale. |
||
Le fait, pour toute personne, de diffuser un enregistrement original ou une copie réalisée en application du présent article est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. |
||
Lorsque l’enregistrement ne peut être effectué en raison d’une impossibilité technique, il en est fait mention dans le procès-verbal d’interrogatoire qui précise la nature de cette impossibilité. Le procureur de la République ou le juge d’instruction en est immédiatement avisé. |
||
A l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la date de l’extinction de l’action publique, l’enregistrement original et sa copie sont détruits dans le délai d’un mois. |
||
Un décret précise en tant que de besoin les modalités d’application du présent VI. |
||
VII. – L’article 706-88 du code de procédure pénale, à l’exception de ses sixième à huitième alinéas, est applicable au mineur de plus de seize ans lorsqu’il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’une ou plusieurs personnes majeures ont participé, comme auteurs ou complices, à la commission de l’infraction. |
||
|
Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique |
IV. – Le premier alinéa des articles 64 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et 23-1-1 de l’ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 relative à l’aide juridictionnelle en matière pénale en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna est ainsi modifié : | |
Art. 64. – L’avocat assistant, au cours de l’audition ou de la confrontation mentionnée aux articles 61-1 et 61-2 du code de procédure pénale, à l’article L. 39 du livre des procédures fiscales ou à l’article 67 F du code des douanes, la personne soupçonnée qui remplit les conditions pour bénéficier de l’aide juridictionnelle a droit à une rétribution. Il en est de même de l’avocat qui intervient pour assister une victime lors d’une confrontation en application de l’article 61-2 du code de procédure pénale, lorsque la victime remplit les conditions pour bénéficier de l’aide juridictionnelle. |
a) À la première phrase, les mots : « ou de la confrontation mentionnée aux articles 61-1 et 61-2 » sont remplacés par les mots : « , de la confrontation ou des mesures d’enquête mentionnées aux articles 61-1 à 61-3 » ; | |
b) À la seconde phrase, les mots : « en application de l’article 61-2 », sont remplacés par les mots : « ou d’une reconstitution en application des articles 61-2 et 61-3 ». | ||
Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités d’application du présent article. |
||
Ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 relative à l’aide juridictionnelle en matière pénale en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna |
||
Art. 23-1-1. – L’avocat ou, dans les îles Wallis et Futuna, la personne agréée qui assiste, au cours de l’audition ou de la confrontation prévue aux articles 61-1 et 61-2 du code de procédure pénale, à l’article L. 39 du livre des procédures fiscales ou à l’article 67 F du code des douanes, la personne soupçonnée qui remplit les conditions pour bénéficier de l’aide juridictionnelle a droit à une rétribution. Il en est de même de l’avocat qui intervient pour assister une victime lors d’une confrontation en application de l’article 61-2 du code de procédure pénale, lorsque la victime remplit les conditions pour bénéficier de l’aide juridictionnelle. |
||
Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités d’application du présent article. |
||
V. – Le présent article entre en vigueur le 15 novembre 2016. amendement CL332 | ||
Article 27 quinquies (nouveau) | ||
La section 1 du chapitre II du titre III du livre Ier du code de procédure pénale est ainsi modifiée : | ||
Code de procédure pénale |
1° Le premier alinéa de l’article 213 est complété par une phrase ainsi rédigée : | |
Art. 213. – Si la chambre de l’instruction estime que les faits constituent un délit ou une contravention, elle prononce le renvoi de l’affaire, dans le premier cas devant le tribunal correctionnel, dans le second cas devant le tribunal de police ou devant la juridiction de proximité. |
« L’article 184 est applicable. » ; | |
Le prévenu détenu est immédiatement remis en liberté et le contrôle judiciaire prend fin. Toutefois, la chambre de l’instruction peut faire application, par un arrêt spécialement motivé, des dispositions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article 179. |
||
En cas de renvoi devant le tribunal de police ou devant la juridiction de proximité, le prévenu détenu est immédiatement remis en liberté ; le contrôle judiciaire prend fin. |
||
Art. 215. – L’arrêt de mise en accusation contient, à peine de nullité, l’exposé et la qualification légale des faits, objet de l’accusation, et précise l’identité de l’accusé. Il précise également, s’il y a lieu, que l’accusé bénéficie des dispositions de l’article 132-78 du code pénal. |
||
|
Les dispositions de l’article 181 sont applicables. |
2° Au deuxième alinéa de l’article 215, les mots : « dispositions de l’article 181 » sont remplacés par les références : « articles 181 et 184 ». amendement CL224 | |
L’arrêt de mise en accusation est notifié à l’accusé conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 183. |
||
Art. 721-1. – Une réduction supplémentaire de la peine peut être accordée aux condamnés qui manifestent des efforts sérieux de réadaptation sociale, notamment en passant avec succès un examen scolaire, universitaire ou professionnel traduisant l’acquisition de connaissances nouvelles, en justifiant de progrès réels dans le cadre d’un enseignement ou d’une formation, en s’investissant dans l’apprentissage de la lecture, de l’écriture et du calcul, ou en participant à des activités culturelles, et notamment de lecture, en suivant une thérapie destinée à limiter les risques de récidive ou en s’efforçant d’indemniser leurs victimes. Sauf décision contraire du juge de l’application des peines, aucune réduction supplémentaire de la peine ne peut être accordée à une personne condamnée pour un crime ou un délit pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru, qui refuse pendant son incarcération de suivre le traitement qui lui est proposé par le juge de l’application des peines en application des articles 717-1 et 763-7. Il en est de même lorsque le juge de l’application des peines est informé, en application de l’article 717-1, que le condamné ne suit pas de façon régulière le traitement qu’il lui a proposé. De même, après avis médical et sauf décision contraire du juge de l’application des peines, aucune réduction supplémentaire de peine ne peut être accordée à une personne condamnée dans les circonstances mentionnées à la première phrase du second alinéa de l’article 122-1 du code pénal qui refuse les soins qui lui sont proposés. |
||
Cette réduction, accordée par le juge de l’application des peines après avis de la commission de l’application des peines, ne peut excéder trois mois par année d’incarcération ou sept jours par mois lorsque la durée d’incarcération restant à subir est inférieure à une année. Lorsque la personne a été condamnée pour les crimes ou délits, commis sur un mineur, de meurtre ou assassinat, torture ou actes de barbarie, viol, agression sexuelle ou atteinte sexuelle, la réduction ne peut excéder deux mois par an ou quatre jours par mois, dès lors qu’elle refuse les soins qui lui ont été proposés. |
||
Elle est prononcée en une seule fois si l’incarcération est inférieure à une année et par fraction annuelle dans le cas contraire. |
||
Sauf décision du juge de l’application des peines, prise après avis de la commission de l’application des peines, les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes condamnées pour l’une des infractions mentionnées à l’article 706-47 si, lorsque leur condamnation est devenue définitive, le casier judiciaire faisait mention d’une telle condamnation. |
Article 27 sexies (nouveau) | |
En cas d’exécution sur le territoire de la République d’une peine prononcée à l’étranger, les réductions de peines accordées antérieurement à la mise à exécution de la peine en France restent acquises à la personne condamnée en tant qu’elles ont été accordées à raison de la durée de détention subie à l’étranger. La personne condamnée bénéficie d’un crédit de réduction de peine en application du présent article, calculé sur la durée de détention restant à subir en France à compter de son arrivée sur le territoire national, déduction faite des réductions de peine déjà accordées à l’étranger pour la période qui restait à exécuter. |
L’article 721-1 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé : | |
« L’appréciation des efforts de réinsertion en vue de l’octroi des réductions supplémentaires de peine tient compte de l’impact sur le condamné des conditions matérielles de détention et du taux d’occupation de l’établissement pénitentiaire. » amendement CL339 | ||
Article 27 septies (nouveau) | ||
Art. 723-15-2. – Si le condamné ne souhaite pas bénéficier d’un aménagement ou d’une conversion de sa peine ou si, au vu du rapport motivé du service pénitentiaire d’insertion et de probation, un tel aménagement ou une telle conversion ne lui paraît pas possible, le juge de l’application des peines peut fixer la date d’incarcération. |
||
|
À défaut de décision du juge de l’application des peines dans les quatre mois suivant la communication de la copie de la décision, ainsi que dans les cas prévus par l’article 723-16, le ministère public peut ramener la peine à exécution. |
Au deuxième alinéa de l’article 723-15-2 du code de procédure pénale, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « six ». amendement CL338 | |
Si, sauf motif légitime ou exercice des voies de recours, la personne ne se présente pas aux convocations, le juge de l’application des peines en informe le ministère public qui ramène la peine à exécution. |
||
Article 27 octies (nouveau) | ||
Art. 762. – Lorsque le juge de l’application des peines statue en application des dispositions de l’article 754 pour mettre à exécution l’emprisonnement encouru pour défaut de paiement d’un jour-amende, les dispositions de l’article 750 ne sont pas applicables. |
||
Les dispositions des articles 752 et 753 sont applicables. Pour l’application de l’article 754, une mise en demeure de payer, adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, a les mêmes effets qu’un commandement de payer. |
L’article 762 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé : | |
« La personne condamnée à la peine de jours-amende et contre qui la mise à exécution de l’emprisonnement a été prononcée peut prévenir cette mise à exécution ou en faire cesser les effets en payant l’intégralité de l’amende. » amendement CL337 | ||
Chapitre II |
Chapitre II | |
Dispositions simplifiant le déroulement de la procédure pénale |
Dispositions simplifiant le déroulement de la procédure pénale | |
Article 28 |
Article 28 | |
Art. 18. – Les officiers de police judiciaire ont compétence dans les limites territoriales où ils exercent leurs fonctions habituelles. |
(Sans modification) | |
Les officiers de police judiciaire, mis temporairement à disposition d’un service autre que celui dans lequel ils sont affectés, ont la même compétence territoriale que celle des officiers de police judiciaire du service d’accueil. |
||
Les officiers de police judiciaire peuvent se transporter dans le ressort des tribunaux de grande instance limitrophes du tribunal ou des tribunaux auxquels ils sont rattachés, à l’effet d’y poursuivre leurs investigations et de procéder à des auditions, perquisitions et saisies. Pour l’application du présent alinéa, les ressorts des tribunaux de grande instance situés dans un même département sont considérés comme un seul et même ressort. Les ressorts des tribunaux de grande instance de Paris, Nanterre, Bobigny et Créteil sont considérés comme un seul et même ressort. |
||
Les officiers de police judiciaire peuvent, sur commission rogatoire expresse du juge d’instruction ou sur réquisitions du procureur de la République, prises au cours d’une enquête préliminaire ou d’une enquête de flagrance, procéder aux opérations prescrites par ces magistrats sur toute l’étendue du territoire national. Ils sont tenus d’être assistés d’un officier de police judiciaire territorialement compétent si le magistrat dont ils tiennent la commission ou la réquisition le décide. Le procureur de la République territorialement compétent en est informé par le magistrat ayant prescrit l’opération. |
||
Avec l’accord des autorités compétentes de l’État concerné, les officiers de police judiciaire peuvent, sur commission rogatoire expresse du juge d’instruction ou sur réquisitions du procureur de la République, procéder à des auditions sur le territoire d’un État étranger. |
||
Ils peuvent, sur proposition des autorités administratives dont ils dépendent et par habilitation du procureur général, recevoir compétence dans les mêmes limites de compétence territoriale que celles des officiers de police judiciaire qu’ils sont appelés à suppléer en cas de besoin. |
L’avant dernier alinéa de l’article 18 du code de procédure pénale est supprimé. |
|
Les officiers ou agents de police judiciaire exerçant habituellement leur mission dans les véhicules affectés au transport collectif de voyageurs ou dans les lieux destinés à l’accès à ces moyens de transport sont compétents pour opérer sur l’étendue de la zone de défense de leur service d’affectation, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État. |
||
Article 29 |
Article 29 | |
I. – L’article 148 du même code est ainsi modifié : |
(Alinéa sans modification) | |
Art. 148. – En toute matière, la personne placée en détention provisoire ou son avocat peut, à tout moment, demander sa mise en liberté, sous les obligations prévues à l’article précédent. |
1° Le premier alinéa est complété par |
1° Le premier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigée : |
« Toutefois, à peine d’irrecevabilité, aucune demande de mise en liberté ne peut être formée tant qu’il n’a pas été statué par le juge des libertés et de la détention, dans les délais prévus au troisième alinéa, sur une précédente demande. Cette irrecevabilité est prévue sans préjudice de l’obligation pour le juge d’instruction, en cas de fait nouveau apparu dans la procédure suite à la première demande, d’ordonner la mise en liberté d’office en application du second alinéa de l’article 144-1, dès lors qu’il apparaît à la suite de ce fait nouveau que les conditions permettant la détention ne sont plus remplies. » amendement CL378 | ||
La demande de mise en liberté est adressée au juge d’instruction, qui communique immédiatement le dossier au procureur de la République aux fins de réquisitions. |
||
Sauf s’il donne une suite favorable à la demande, le juge d’instruction doit, dans les cinq jours suivant la communication au procureur de la République, la transmettre avec son avis motivé au juge des libertés et de la détention. Ce magistrat statue dans un délai de trois jours ouvrables, par une ordonnance comportant l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de cette décision par référence aux dispositions de l’article 144. Toutefois, lorsqu’il n’a pas encore été statué sur une précédente demande de mise en liberté ou sur l’appel d’une précédente ordonnance de refus de mise en liberté, les délais précités ne commencent à courir qu’à compter de la décision rendue par la juridiction compétente. Lorsqu’il a été adressé plusieurs demandes de mise en liberté, il peut être répondu à ces différentes demandes dans les délais précités par une décision unique. |
2° Dans la troisième phrase du troisième alinéa, les mots : « sur une précédente demande de mise en liberté ou » sont supprimés. |
2° (Sans modification) |
La mise en liberté, lorsqu’elle est accordée, peut être assortie de mesures de contrôle judiciaire. |
||
Faute par le juge des libertés et de la détention d’avoir statué dans le délai fixé au troisième alinéa, la personne peut saisir directement de sa demande la chambre de l’instruction qui, sur les réquisitions écrites et motivées du procureur général, se prononce dans les vingt jours de sa saisine faute de quoi la personne est mise d’office en liberté sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées. Le droit de saisir dans les mêmes conditions la chambre de l’instruction appartient également au procureur de la République. |
||
II. – Après l’article 803-6 du même code, il est inséré un article 803-7 ainsi rédigé : |
II. – (Alinéa sans modification) | |
« Art. 803-7. – Lorsqu’une juridiction ordonne la mise en liberté immédiate d’une personne dont la détention provisoire |
« Art. 803-7. – Lorsqu’une juridiction ordonne la mise en liberté immédiate d’une personne dont la détention provisoire est irrégulière en raison du non-respect des délais ou formalités prévus par le présent code, elle peut, dans cette même décision, placer la personne sous contrôle judiciaire si cette mesure est indispensable pour assurer l’un des objectifs énumérés à l’article 144. amendement CL316 | |
« Lorsque, hors les cas prévus au premier alinéa, le procureur de la République ordonne la libération d’une personne dont la détention provisoire |
« Lorsque, hors les cas prévus au premier alinéa du présent article, le procureur de la République ordonne la libération d’une personne dont la détention provisoire est irrégulière en raison du non-respect des délais ou formalités prévus par le présent code, il peut saisir sans délai le juge des libertés et de la détention de réquisitions tendant au placement immédiat de la personne concernée sous contrôle judiciaire si cette mesure est indispensable pour assurer l’un des objectifs énumérés à l’article 144. » amendements CL317 et CL318 | |
Article 30 |
Article 30 | |
Art. 390-1. – Vaut citation à personne la convocation en justice notifiée au prévenu, sur instructions du procureur de la République et dans les délais prévus par l’article 552, soit par un greffier ou un officier ou agent de police judiciaire, soit, si le prévenu est détenu, par le chef de l’établissement pénitentiaire. |
I. – Au premier alinéa de l’article 390-1 du même code, après le mot : « greffier », les mots : « ou un officier ou agent de police judiciaire » sont remplacés par les mots : « un officier ou agent de police judiciaire ou un délégué ou un médiateur du procureur de la République ». |
I. – (Sans modification) |
La convocation énonce le fait poursuivi, vise le texte de loi qui le réprime et indique le tribunal saisi, le lieu, la date et l’heure de l’audience. Elle précise, en outre, que le prévenu peut se faire assister d’un avocat de son choix ou, s’il en fait la demande, d’un avocat commis d’office, dont les frais seront à sa charge sauf s’il remplit les conditions d’accès à l’aide juridictionnelle, et qu’il a également la possibilité de bénéficier, le cas échéant gratuitement, de conseils juridiques dans une structure d’accès au droit. Elle l’informe qu’il doit comparaître à l’audience en possession des justificatifs de ses revenus ainsi que de ses avis d’imposition ou de non-imposition. Elle l’informe également que le droit fixe de procédure dû en application du 3° de l’article 1018 A du code général des impôts peut être majoré s’il ne comparaît pas personnellement à l’audience ou s’il n’est pas jugé dans les conditions prévues par les premier et deuxième alinéas de l’article 411 du présent code. |
||
Elle est constatée par un procès-verbal signé par le prévenu qui en reçoit copie. |
||
Art. 396. – Dans le cas prévu par l’article précédent, si la réunion du tribunal est impossible le jour même et si les éléments de l’espèce lui paraissent exiger une mesure de détention provisoire, le procureur de la République peut traduire le prévenu devant le juge des libertés et de la détention, statuant en chambre du conseil avec l’assistance d’un greffier. |
||
Le juge, après avoir fait procéder, sauf si elles ont déjà été effectuées, aux vérifications prévues par le septième alinéa de l’article 41, statue sur les réquisitions du ministère public aux fins de détention provisoire, après avoir recueilli les observations éventuelles du prévenu ou de son avocat ; l’ordonnance rendue n’est pas susceptible d’appel. |
||
Il peut placer le prévenu en détention provisoire jusqu’à sa comparution devant le tribunal. L’ordonnance prescrivant la détention est rendue suivant les modalités prévues par l’article 137-3, premier alinéa, et doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision par référence aux dispositions des 1° à 6° de l’article 144. Cette décision énonce les faits retenus et saisit le tribunal ; elle est notifiée verbalement au prévenu et mentionnée au procès-verbal dont copie lui est remise sur-le-champ. Le prévenu doit comparaître devant le tribunal au plus tard le troisième jour ouvrable suivant. A défaut, il est mis d’office en liberté. |
||
Si le juge estime que la détention provisoire n’est pas nécessaire, il peut soumettre le prévenu, jusqu’à sa comparution devant le tribunal, à une ou plusieurs obligations du contrôle judiciaire ou le placer sous assignation à résidence avec surveillance électronique. Le procureur de la République notifie alors à l’intéressé la date et l’heure de l’audience selon les modalités prévues au premier alinéa de l’article 394. Si le prévenu placé sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique se soustrait aux obligations qui lui sont imposées, les dispositions du deuxième alinéa de l’article 141-2 sont applicables. |
II. – La deuxième phrase du dernier alinéa de l’article 396 du même code est remplacée par |
II. – La deuxième phrase du dernier alinéa de l’article 396 du même code est remplacée par trois phrases ainsi rédigées : |
« La date et l’heure de l’audience, établies dans les délais prévus à l’article 394, sont alors notifiées à l’intéressé soit par le juge ou par son greffier, si ces informations leur ont été préalablement données par le procureur de la République, soit, dans le cas contraire, par le procureur ou son greffier. Toutefois, si les poursuites concernent plusieurs personnes dont certaines sont placées en détention, la personne reste convoquée à l’audience où comparaissent les autres prévenus détenus. L’article 397-4 ne lui est pas applicable. » amendement CL319 | ||
Art. 527. – Le ministère public peut, dans les dix jours de l’ordonnance, former opposition à son exécution par déclaration au greffe du tribunal. |
||
Si, à l’expiration du délai prévu à l’alinéa précédent, le ministère public n’a pas fait opposition, l’ordonnance pénale est notifiée au prévenu par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et exécutée suivant les règles prévues par le présent code pour l’exécution des jugements de police. |
III. – |
III. – L’article 527 du même code est ainsi modifié : |
1° Au deuxième alinéa, les mots : « par lettre recommandée avec demande d’avis de réception » sont remplacés par les mots : « selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l’article 495-3 » ; | ||
2° (nouveau) Le troisième alinéa est ainsi modifié : | ||
Le prévenu peut, dans un délai de trente jours à compter de la date d’envoi de la lettre, former opposition à l’exécution de l’ordonnance. |
a) Après le mot : « lettre », sont insérés les mots : « ou de la date à laquelle le procureur de la République a porté l’ordonnance à sa connaissance » ; | |
b) Le mot : « l’ordonnance » est remplacé par le mot : « celle-ci ». amendement CL320 | ||
À défaut de paiement ou d’opposition dans le délai ci-dessus, l’amende et le droit fixe de procédure sont exigibles. |
||
Toutefois, s’il ne résulte pas de l’avis de réception que le prévenu a reçu la lettre de notification, l’opposition reste recevable jusqu’à l’expiration d’un délai de trente jours qui courent de la date à laquelle l’intéressé a eu connaissance, d’une part, de la condamnation, soit par un acte d’exécution, soit par tout autre moyen, d’autre part, du délai et des formes de l’opposition qui lui est ouverte. |
||
Le comptable public compétent arrête le recouvrement dès réception de l’avis d’opposition à l’ordonnance pénale établi par le greffe. |
||
Article 31 |
Article 31 | |
Art. 74-2. – Les officiers de police judiciaire, assistés le cas échéant des agents de police judiciaire, peuvent, sur instructions du procureur de la République, procéder aux actes prévus par les articles 56 à 62 aux fins de rechercher et de découvrir une personne en fuite dans les cas suivants : |
|
1° (Sans modification) |
1° Personne faisant l’objet d’un mandat d’arrêt délivré par le juge d’instruction, le juge des libertés et de la détention, la chambre de l’instruction ou son président ou le président de la cour d’assises, alors qu’elle est renvoyée devant une juridiction de jugement ; |
||
2° Personne faisant l’objet d’un mandat d’arrêt délivré par une juridiction de jugement ou par le juge de l’application des peines ; |
||
3° Personne condamnée à une peine privative de liberté sans sursis supérieure ou égale à un an, lorsque cette condamnation est exécutoire ou passée en force de chose jugée ; |
1° Au 3°, après les mots : « une peine privative de liberté sans sursis supérieure ou égale à un an, » sont insérés les mots : « ou à une peine privative de liberté supérieure ou égale à un an résultant de la révocation d’un sursis assorti ou non d’une mise à l’épreuve, » ; |
|
4° Personne inscrite au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes ayant manqué aux obligations prévues à l’article 706-25-7 ; |
||
5° Personne inscrite au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes ayant manqué aux obligations prévues à l’article 706-53-5. |
||
2° Après le 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé : |
||
« 6° Personne ayant fait l’objet d’une décision de retrait ou de révocation d’un aménagement de peine ou d’une libération sous contrainte, ou d’une décision de mise à exécution de l’emprisonnement prévu par la juridiction de jugement en cas de violation des obligations et interdictions résultant d’une peine, dès lors que cette décision a pour conséquence la mise à exécution d’un quantum ou d’un reliquat de peine d’emprisonnement supérieur à un an. » |
||
Si les nécessités de l’enquête pour rechercher la personne en fuite l’exigent, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance peut, à la requête du procureur de la République, autoriser l’interception, l’enregistrement et la transcription de correspondances émises par la voie des télécommunications selon les modalités prévues par les articles 100, 100-1 et 100-3 à 100-7, pour une durée maximale de deux mois renouvelable dans les mêmes conditions de forme et de durée, dans la limite de six mois en matière correctionnelle. Ces opérations sont faites sous l’autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention. |
||
Pour l’application des dispositions des articles 100-3 à 100-5, les attributions confiées au juge d’instruction ou à l’officier de police judiciaire commis par lui sont exercées par le procureur de la République ou l’officier de police judiciaire requis par ce magistrat. |
||
Le juge des libertés et de la détention est informé sans délai des actes accomplis en application de l’alinéa précédent. |
||
Art. 78-2. – Les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l’égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner : |
||
– qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction ; |
||
– ou qu’elle se prépare à commettre un crime ou un délit ; |
||
– ou qu’elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l’enquête en cas de crime ou de délit ; |
||
|
2° (Alinéa sans modification) | |
« - ou qu’elle a violé les obligations ou interdictions |
« – ou qu’elle a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d’un contrôle judiciaire, d’une mesure d’assignation à résidence avec surveillance électronique, d’une peine ou d’une mesure suivie par le juge de l’application des peines ; ». amendement CL321 | |
– ou qu’elle fait l’objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire. |
||
Sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite d’infractions qu’il précise, l’identité de toute personne peut être également contrôlée, selon les mêmes modalités, dans les lieux et pour une période de temps déterminés par ce magistrat. Le fait que le contrôle d’identité révèle des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. |
||
L’identité de toute personne, quel que soit son comportement, peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, pour prévenir une atteinte à l’ordre public, notamment à la sécurité des personnes ou des biens. |
||
Dans une zone comprise entre la frontière terrestre de la France avec les États parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et une ligne tracée à 20 kilomètres en deçà, ainsi que dans les zones accessibles au public des ports, aéroports et gares ferroviaires ou routières ouverts au trafic international et désignés par arrêté, pour la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontalière, l’identité de toute personne peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévues par la loi. Lorsqu’il existe une section autoroutière démarrant dans la zone mentionnée ci-dessus et que le premier péage autoroutier se situe au-delà de la ligne des 20 kilomètres, le contrôle peut en outre avoir lieu jusqu’à ce premier péage sur les aires de stationnement ainsi que sur le lieu de ce péage et les aires de stationnement attenantes. Les péages concernés par cette disposition sont désignés par arrêté. Le fait que le contrôle d’identité révèle une infraction autre que celle de non-respect des obligations susvisées ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. Pour l’application du présent alinéa, le contrôle des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi ne peut être pratiqué que pour une durée n’excédant pas six heures consécutives dans un même lieu et ne peut consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans les zones ou lieux mentionnés au même alinéa. |
||
Dans une zone comprise entre les frontières terrestres ou le littoral du département de la Guyane et une ligne tracée à vingt kilomètres en-deçà, et sur une ligne tracée à cinq kilomètres de part et d’autre, ainsi que sur la route nationale 2 sur le territoire de la commune de Régina, l’identité de toute personne peut être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi. |
||
L’identité de toute personne peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa du présent article, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi : |
||
1° En Guadeloupe, dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à un kilomètre en deçà, ainsi que dans une zone d’un kilomètre de part et d’autre, d’une part, de la route nationale 1 sur le territoire des communes de Basse-Terre, Gourbeyre et Trois-Rivières et, d’autre part, de la route nationale 4 sur le territoire des communes du Gosier et de Sainte-Anne et Saint-François ; |
||
2° A Mayotte, dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à un kilomètre en deçà ; |
||
3° A Saint-Martin, dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à un kilomètre en deçà ; |
||
4° A Saint-Barthélemy, dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à un kilomètre en deçà. |
||
Art. 78-2-2. – Sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite des actes de terrorisme visés par les articles 421-1 à 421-6 du code pénal, des infractions en matière de prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs visées aux 1° et 2° du I de l’article L. 1333-9, à l’article L. 1333-11, au II des articles L. 1333-13-3 et L. 1333-13-4 et aux articles L. 1333-13-5, L. 2339-14, L. 2339-15, L. 2341-1, L. 2341-2, L. 2341-4, L. 2342-59 et L. 2342-60 du code de la défense, d’armes et d’explosifs visées par les articles L. 2339-8 et L. 2353-4 du code de la défense et L. 317-8 du code de la sécurité intérieure, des infractions de vol visées par les articles 311-3 à 311-11 du code pénal, de recel visées par les articles 321-1 et 321-2 du même code ou des faits de trafic de stupéfiants visés par les articles 222-34 à 222-38 dudit code, les officiers de police judiciaire, assistés, le cas échéant, des agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l’article 21 peuvent, dans les lieux et pour la période de temps que ce magistrat détermine et qui ne peut excéder vingt-quatre heures, renouvelables sur décision expresse et motivée selon la même procédure, procéder non seulement aux contrôles d’identité prévus au sixième alinéa de l’article 78-2 mais aussi à la visite des véhicules circulant, arrêtés ou stationnant sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public. |
3° (nouveau) Au premier alinéa de l’article 78-2-2, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « septième » ; amendement CL322 | |
Pour l’application des dispositions du présent article, les véhicules en circulation ne peuvent être immobilisés que le temps strictement nécessaire au déroulement de la visite qui doit avoir lieu en présence du conducteur. Lorsqu’elle porte sur un véhicule à l’arrêt ou en stationnement, la visite se déroule en présence du conducteur ou du propriétaire du véhicule ou, à défaut, d’une personne requise à cet effet par l’officier ou l’agent de police judiciaire et qui ne relève pas de son autorité administrative. La présence d’une personne extérieure n’est toutefois pas requise si la visite comporte des risques graves pour la sécurité des personnes et des biens. |
||
En cas de découverte d’une infraction ou si le conducteur ou le propriétaire du véhicule le demande ainsi que dans le cas où la visite se déroule en leur absence, il est établi un procès-verbal mentionnant le lieu et les dates et heures du début et de la fin de ces opérations. Un exemplaire en est remis à l’intéressé et un autre est transmis sans délai au procureur de la République. |
||
Toutefois, la visite des véhicules spécialement aménagés à usage d’habitation et effectivement utilisés comme résidence ne peut être faite que conformément aux dispositions relatives aux perquisitions et visites domiciliaires. |
||
Le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. |
||
Art. 78-2-4. – Pour prévenir une atteinte grave à la sécurité des personnes et des biens, les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l’article 21 peuvent procéder non seulement aux contrôles d’identité prévus au septième alinéa de l’article 78-2 mais aussi, avec l’accord du conducteur ou, à défaut, sur instructions du procureur de la République communiquées par tous moyens, à la visite des véhicules circulant, arrêtés ou stationnant sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public. |
4° (nouveau) Au premier alinéa de l’article 78-2-4, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « huitième ». amendement CL322 | |
Dans l’attente des instructions du procureur de la République, le véhicule peut être immobilisé pour une durée qui ne peut excéder trente minutes. |
||
Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article 78-2-2 sont applicables aux dispositions du présent article. |
||
Article 31 bis (nouveau) | ||
Code de l’environnement |
Le code de l’environnement est ainsi modifié : | |
Art. L. 218-30. – Le navire qui a servi à commettre l’une des infractions définies aux articles L. 218-11 à L. 218-19 peut être immobilisé sur décision du procureur de la République ou du juge d’instruction saisi. |
||
Cette immobilisation est faite aux frais de l’armateur. |
||
À tout moment, l’autorité judiciaire compétente peut ordonner la levée de l’immobilisation s’il est fourni un cautionnement dont elle fixe le montant et les modalités de versement. |
||
Les conditions d’affectation, d’emploi et de restitution du cautionnement sont réglées conformément aux dispositions des articles 142, 142-2 et 142-3 du code de procédure pénale. |
||
La décision d’immobilisation prise par l’autorité judiciaire peut être contestée dans le délai de cinq jours à compter de sa notification, par requête de l’intéressé devant le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance saisi de l’enquête. |
||
1° L’article L. 218-30 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés : | ||
« Le juge des libertés et de la détention peut confirmer la saisie ou ordonner la mainlevée de celle-ci, le cas échéant en la conditionnant au versement préalable d’un cautionnement dont il fixe le montant et les modalités de versement, dans les conditions prévues à l’article 142 du code de procédure pénale. | ||
« L’ordonnance du juge des libertés et de la détention doit être rendue dans un délai de trois jours ouvrés à compter de la réception de la requête mentionnée au cinquième alinéa du présent article. | ||
« Les ordonnances du juge des libertés et de la détention prises sur le fondement du présent article sont motivées et notifiées au procureur de la République, au juge d’instruction lorsqu’il est saisi, à la personne mise en cause et, s’ils sont connus, au propriétaire et aux tiers ayant des droits sur le navire, qui peuvent les déférer à la chambre de l’instruction par déclaration au greffe du tribunal dans les cinq jours qui suivent leur notification. La personne mise en cause, le propriétaire du navire et les tiers ayant des droits sur le navire peuvent adresser toutes observations écrites ou être entendus par la chambre de l’instruction. La chambre de l’instruction statue dans un délai de cinq jours à compter de la déclaration d’appel. | ||
« L’appel contre les ordonnances du juge des libertés et de la détention prises sur le fondement du présent article n’est pas suspensif. Toutefois, le procureur de la République peut demander au premier président près la cour d’appel ou à son délégué de déclarer le recours suspensif lorsque le juge des libertés et de la détention a ordonné la remise en circulation du navire et qu’il existe un risque sérieux de réitération de l’infraction ou qu’il est nécessaire de garantir le paiement des amendes. Dans ce cas, l’appel, accompagné de la demande qui se réfère au risque sérieux de réitération de l’infraction ou à la nécessité de garantir le paiement des amendes, est formé dans un délai de six heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur de la République et transmis au premier président de la cour d’appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction du risque sérieux de réitération de l’infraction ou de la nécessité de garantir le paiement des amendes ou de la confiscation du navire, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement qui n’est pas susceptible de recours. Le navire est maintenu à la disposition de l’autorité judiciaire jusqu’à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l’appel du procureur de la République, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond. » ; | ||
Art. L. 218-55. – Lorsque les nécessités de l’enquête ou de l’information ainsi que la gravité de l’infraction l’exigent, le navire, aéronef, plate-forme ou autre ouvrage qui a servi à commettre l’une des infractions visées aux articles L. 218-48, L. 218-50, L. 218-51 et L. 218-52 peut être immobilisé sur décision du procureur de la République ou du juge d’instruction saisi. |
||
À tout moment, l’autorité judiciaire compétente peut ordonner la levée de l’immobilisation s’il est fourni un cautionnement dont elle fixe le montant et les modalités de versement. |
||
Les conditions d’affectation, d’emploi et de restitution du cautionnement sont réglées conformément aux dispositions des articles 142,142-2 et 142-3 du code de procédure pénale. |
||
2° Les articles L. 218-55 et L. 218-68 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé : | ||
« La décision d’immobilisation prise par l’autorité judiciaire peut être contestée dans un délai de cinq jours à compter de sa notification, par requête de l’intéressé devant le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance saisi de l’enquête. Les quatre derniers alinéas de l’article L. 218-30 sont applicables. » amendement CL340 | ||
Art. L. 218-68. – Lorsque les nécessités de l’enquête ou de l’information ainsi que la gravité de l’infraction l’exigent, le navire qui a servi à commettre l’une des infractions visées aux articles L. 218-64 et L. 218-65 peut être immobilisé sur décision du procureur de la République ou du juge d’instruction saisi. |
||
À tout moment, l’autorité judiciaire compétente peut ordonner la levée de l’immobilisation s’il est fourni un cautionnement dont elle fixe le montant et les modalités de versement. |
||
Les conditions d’affectation, d’emploi et de restitution du cautionnement sont réglées conformément aux dispositions des articles 142,142-2 et 142-3 du code de procédure pénale. |
||
Code pénal |
||
Art. 132-20. – Lorsqu’une infraction est punie d’une peine d’amende, la juridiction peut prononcer une amende d’un montant inférieur à celle qui est encourue. |
Article 31 ter (nouveau) | |
Le montant de l’amende est déterminé en tenant compte des ressources et des charges de l’auteur de l’infraction. |
I. – L’article 132-20 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé : | |
« Les amendes prononcées en matière contraventionnelle, correctionnelle et criminelle, à l’exception des amendes forfaitaires, font l’objet d’une majoration, dans la limite de 10 % de leur montant, perçue lors de leur recouvrement. Cette majoration, prononcée dans les conditions prévues à l’article 707-6 du code de procédure pénale, est destinée à financer l’aide aux victimes. » | ||
II. – Après l’article 707-5 du code de procédure pénale, il est inséré un article 707-6 ainsi rédigé : | ||
« Art. 707-6. – Les amendes prononcées en matière contraventionnelle, correctionnelle et criminelle, à l’exception des amendes forfaitaires, font l’objet d’une majoration, dans la limite de 10 % de leur montant, perçue lors de leur recouvrement. Le montant de la majoration doit être fixé en fonction des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ainsi que de la situation matérielle, familiale et sociale de celui-ci. Ces mêmes motifs peuvent justifier, le cas échéant, de ne pas prononcer la majoration par une décision spécialement motivée de la juridiction. | ||
« Cette majoration est destinée à financer l’aide aux victimes. | ||
« Elle n’est pas applicable lorsque les amendes sont majorées en application des articles L. 211-27 et L. 421-8 du code des assurances. » | ||
III. – Le paragraphe 1 de la section 1 du chapitre VI du titre XII du code des douanes est complété par un article 409-1 ainsi rédigé : | ||
« Art. 409-1. – L’article 707-6 du code de procédure pénale est applicable aux amendes douanières. » | ||
IV. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié : | ||
Code monétaire et financier |
1° Le I de l’article L. 612-42 est ainsi rédigé : | |
Art. L. 612-42. – I. – Les montants des sanctions et astreintes prévues aux articles L. 612-39 à L. 612-41 sont recouvrés par le Trésor public et versées au budget de l’Etat. |
« I. – Les sanctions pécuniaires prononcées en application de la présente section font l’objet d’une majoration, dans la limite de 10 % de leur montant, mise à la charge de la personne sanctionnée et destinée à financer l’aide aux victimes. | |
« Le X de l’article L. 612-40 est applicable à cette majoration et les motifs qu’il énonce peuvent justifier d’en moduler le montant ou, le cas échéant, de ne pas la prononcer. | ||
« Les sanctions et astreintes prévues à la présente section sont recouvrées par le Trésor public et versées au budget de l’État. » ; | ||
II. – Un décret en Conseil d’Etat fixe les règles applicables à la présente section. |
||
Art. L. 621-15. – (…) |
||
III. – Les sanctions applicables sont : |
||
a) Pour les personnes mentionnées aux 1° à 8°, 11°, 12°, 15° à 17° du II de l’article L. 621-9, l’avertissement, le blâme, l’interdiction à titre temporaire ou définitif de l’exercice de tout ou partie des services fournis, la radiation du registre mentionné à l’article L. 546-1 ; la commission des sanctions peut prononcer soit à la place, soit en sus de ces sanctions une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à 100 millions d’euros ou au décuple du montant des profits éventuellement réalisés ; les sommes sont versées au fonds de garantie auquel est affiliée la personne sanctionnée ou, à défaut, au Trésor public ; |
||
b) Pour les personnes physiques placées sous l’autorité ou agissant pour le compte de l’une des personnes mentionnées aux 1° à 8°, 11°, 12°, 15° à 17° du II de l’article L. 621-9, l’avertissement, le blâme, le retrait temporaire ou définitif de la carte professionnelle, l’interdiction à titre temporaire ou définitif de l’exercice de tout ou partie des activités ; la commission des sanctions peut prononcer soit à la place, soit en sus de ces sanctions une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à 15 millions d’euros ou au décuple du montant des profits éventuellement réalisés en cas de pratiques mentionnées aux c à g du II ou à 300 000 euros ou au quintuple des profits éventuellement réalisés dans les autres cas ; les sommes sont versées au fonds de garantie auquel est affiliée la personne morale sous l’autorité ou pour le compte de qui agit la personne sanctionnée ou, à défaut, au Trésor public ; |
||
c) Pour les personnes autres que l’une des personnes mentionnées au II de l’article L. 621-9, auteurs des faits mentionnés aux c à g du II, une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à 100 millions d’euros ou au décuple du montant des profits éventuellement réalisés ; les sommes sont versées au Trésor public. |
||
2° L’avant-dernier alinéa du III de l’article L. 621-15 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : | ||
Le montant de la sanction doit être fixé en fonction de la gravité des manquements commis et en relation avec les avantages ou les profits éventuellement tirés de ces manquements. |
« Les sanctions pécuniaires prononcées en application du présent III font l’objet d’une majoration, dans la limite de 10 % de leur montant, mise à la charge de la personne sanctionnée et destinée à financer l’aide aux victimes. | |
« Le montant de la sanction et de la majoration doit être fixé en fonction de la gravité des manquements commis et en fonction des avantages ou des profits éventuellement tirés de ces manquements. Ces mêmes motifs peuvent justifier, le cas échéant, de ne pas prononcer la majoration. » | ||
Le fonds de garantie mentionné aux a et b peut, dans des conditions fixées par son règlement intérieur et dans la limite de 300 000 euros par an, affecter à des actions éducatives dans le domaine financier une partie du produit des sanctions pécuniaires prononcées par la commission des sanctions qu’il perçoit. (…) |
||
V. – Après l’article L. 464-5 du code de commerce, il est inséré un article L. 464-5-1 ainsi rédigé : | ||
« Art. L. 464-5-1. – Les sanctions pécuniaires prononcées en application des articles L. 464-2, L. 464-3 et L. 464-5 font l’objet d’une majoration, dans la limite de 10 % de leur montant, mise à la charge de l’organisme ou de l’entreprise sanctionné et destinée à financer l’aide aux victimes. | ||
« Le troisième alinéa du I de l’article L. 464-2 est applicable à cette majoration et les motifs qu’il énonce peuvent justifier d’en moduler le montant ou, le cas échéant, de ne pas la prononcer. » | ||
Loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne |
||
Art. 44. – I. – Les sanctions prévues à l’article 43 sont prononcées après que l’intéressé a reçu notification des griefs et a été mis à même de consulter le dossier et de présenter ses observations écrites ou orales. Les décisions de sanction sont motivées et notifiées à l’intéressé. |
||
VI. – Après le premier alinéa du I de l’article 44 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : | ||
« Les sanctions pécuniaires prononcées en application du même article 43 font l’objet d’une majoration, dans la limite de 10 % de leur montant, mise à la charge de l’opérateur sanctionné et destinée à financer l’aide aux victimes. | ||
« Le montant de la majoration doit être fixé en fonction de la gravité du manquement, de la situation de l’opérateur, de l’ampleur du dommage causé et des avantages qui en sont tirés. Ces mêmes motifs peuvent justifier, le cas échéant, de ne pas prononcer la majoration. » amendement CL154 | ||
Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l’Etat étrangères à l’impôt et au domaine. |
||
II. – Les décisions prononcées par la commission des sanctions peuvent faire l’objet d’un recours de pleine juridiction devant la juridiction administrative par les personnes sanctionnées et par le président de l’Autorité de régulation des jeux en ligne, après accord du collège. |
||
III. – La commission des sanctions de l’Autorité de régulation des jeux en ligne ne peut être saisie de faits remontant à plus de trois ans s’il n’a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction. |
||
IV. – Le président de l’Autorité de régulation des jeux en ligne ou celui de la commission des sanctions informe sans délai le procureur de la République des faits qui sont susceptibles de recevoir une qualification pénale. Lorsque le procureur de la République décide de mettre en mouvement l’action publique sur les faits objets de la transmission, il en informe sans délai l’Autorité de régulation des jeux en ligne. |
||
Code de procédure pénale |
Article 31 quater (nouveau) | |
Art. 28. – Les fonctionnaires et agents des administrations et services publics auxquels des lois spéciales attribuent certains pouvoirs de police judiciaire exercent ces pouvoirs dans les conditions et dans les limites fixées par ces lois. |
I. – L’article 28 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé : | |
« Lorsque ces fonctionnaires et agents sont autorisés à procéder à des auditions, l’article 61-1 est applicable dès lors qu’il existe à l’égard de la personne entendue des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction. » | ||
Code du travail |
||
Art. L. 8271-6-1. – Les agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 sont habilités à entendre, en quelque lieu que ce soit et avec son consentement, tout employeur ou son représentant et toute personne rémunérée, ayant été rémunérée ou présumée être ou avoir été rémunérée par l’employeur ou par un travailleur indépendant, afin de connaître la nature des activités de cette personne, ses conditions d’emploi et le montant des rémunérations s’y rapportant, y compris les avantages en nature. De même, ils peuvent entendre toute personne susceptible de fournir des informations utiles à l’accomplissement de leur mission de lutte contre le travail illégal. |
||
II. – Après le premier alinéa de l’article L. 8271-6-1 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : | ||
« Conformément à l’article 28 du code de procédure pénale, l’article 61-1 du même code est applicable lorsqu’il est procédé à l’audition d’une personne à l’égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction. » | ||
Ces auditions peuvent faire l’objet d’un procès-verbal signé des agents mentionnés au premier alinéa et des personnes entendues. |
||
Ces agents sont en outre habilités à demander aux employeurs, aux travailleurs indépendants, aux personnes employées dans l’entreprise ou sur le lieu de travail ainsi qu’à toute personne dont ils recueillent les déclarations dans l’exercice de leur mission de justifier de leur identité et de leur adresse. |
||
Code de l’environnement |
||
Art. L. 172-8. – Les fonctionnaires et agents mentionnés à l’article L. 172-4 peuvent recueillir, sur convocation ou sur place, les déclarations de toute personne susceptible d’apporter des éléments utiles à leurs constatations. Ils en dressent procès-verbal. Les personnes entendues procèdent elles-mêmes à sa lecture, peuvent y faire consigner leurs observations et y apposent leur signature. Si elles déclarent ne pas pouvoir lire, lecture leur en est faite par l’agent préalablement à la signature. En cas de refus de signer le procès-verbal, mention en est faite sur celui-ci. |
||
III. – L’article L. 172-8 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé : | ||
« Conformément à l’article 28 du code de procédure pénale, l’article 61-1 du même code est applicable lorsqu’il est procédé à l’audition d’une personne à l’égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction. » | ||
Code de commerce |
||
Art. L. 450-4. – Les agents mentionnés à l’article L. 450-1 ne peuvent procéder aux visites en tous lieux ainsi qu’à la saisie de documents et de tout support d’information que dans le cadre d’enquêtes demandées par la Commission européenne, le ministre chargé de l’économie ou le rapporteur général de l’Autorité de la concurrence sur proposition du rapporteur, sur autorisation judiciaire donnée par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter. Ils peuvent également, dans les mêmes conditions, procéder à la pose de scellés sur tous locaux commerciaux, documents et supports d’information dans la limite de la durée de la visite de ces locaux. Lorsque ces lieux sont situés dans le ressort de plusieurs juridictions et qu’une action simultanée doit être menée dans chacun d’eux, une ordonnance unique peut être délivrée par l’un des juges des libertés et de la détention compétents. |
||
Le juge doit vérifier que la demande d’autorisation qui lui est soumise est fondée ; cette demande doit comporter tous les éléments d’information en possession du demandeur de nature à justifier la visite. Lorsque la visite vise à permettre la constatation d’infractions aux dispositions du livre IV du présent code en train de se commettre, la demande d’autorisation peut ne comporter que les indices permettant de présumer, en l’espèce, l’existence des pratiques dont la preuve est recherchée. |
||
La visite et la saisie s’effectuent sous l’autorité et le contrôle du juge qui les a autorisées. Il désigne le chef du service qui devra nommer les officiers de police judiciaire chargés d’assister à ces opérations et d’apporter leur concours en procédant le cas échéant aux réquisitions nécessaires, ainsi que de le tenir informé de leur déroulement. Lorsqu’elles ont lieu en dehors du ressort de son tribunal de grande instance, il délivre une commission rogatoire pour exercer ce contrôle au juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel s’effectue la visite. |
||
Le juge peut se rendre dans les locaux pendant l’intervention. A tout moment, il peut décider la suspension ou l’arrêt de la visite. |
||
L’ordonnance est notifiée verbalement et sur place au moment de la visite à l’occupant des lieux ou à son représentant qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal. L’ordonnance comporte la mention de la faculté pour l’occupant des lieux ou son représentant de faire appel à un conseil de son choix. L’exercice de cette faculté n’entraîne pas la suspension des opérations de visite et saisie. En l’absence de l’occupant des lieux, l’ordonnance est notifiée après les opérations par lettre recommandée avec avis de réception. Il en va de même lorsqu’il n’est pas procédé à la visite dans un des lieux visés par l’ordonnance. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l’avis. |
||
L’ordonnance mentionnée au premier alinéa peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le juge a autorisé la mesure, suivant les règles prévues par le code de procédure pénale. Le ministère public et la personne à l’encontre de laquelle a été ordonnée cette mesure peuvent interjeter appel. Cet appel est formé par déclaration au greffe du tribunal de grande instance dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance. L’appel n’est pas suspensif. L’ordonnance du premier président de la cour d’appel est susceptible d’un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure pénale. Les pièces saisies sont conservées jusqu’à ce qu’une décision soit devenue définitive. |
||
La visite, qui ne peut commencer avant six heures ou après vingt et une heures, est effectuée en présence de l’occupant des lieux ou de son représentant. L’occupant des lieux peut désigner un ou plusieurs représentants pour assister à la visite et signer le procès-verbal. En cas d’impossibilité, l’officier de police judiciaire requiert deux témoins choisis en dehors des personnes relevant de son autorité, de celle de l’administration de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou de celle de l’Autorité de la concurrence. |
||
Les agents mentionnés à l’article L. 450-1, l’occupant des lieux ou son représentant ainsi que l’officier de police judiciaire et, le cas échéant, les agents et autres personnes mandatés par la Commission européenne peuvent seuls prendre connaissance des pièces et documents avant leur saisie. Les agents mentionnés à l’article L. 450-1 peuvent procéder au cours de la visite à des auditions de l’occupant des lieux ou de son représentant en vue de recueillir les informations ou explications utiles aux besoins de l’enquête. |
||
IV. – Après le huitième alinéa de l’article L. 450-4 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : | ||
« Conformément à l’article 28 du code de procédure pénale, l’article 61-1 du même code est applicable lorsqu’il est procédé à l’audition d’une personne à l’égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction. » | ||
Les inventaires et mises sous scellés sont réalisés conformément à l’article 56 du code de procédure pénale. |
||
Les originaux du procès-verbal et de l’inventaire sont transmis au juge qui a ordonné la visite. Une copie du procès-verbal et de l’inventaire est remise à l’occupant des lieux ou à son représentant. Une copie est également adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux personnes mises en cause ultérieurement par les pièces saisies au cours de l’opération. |
||
Les pièces et documents saisis sont restitués à l’occupant des lieux, dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle la décision de l’Autotrité de la concurrence est devenue définitive. L’occupant des lieux est mis en demeure, par lettre recommandée avec avis de réception, de venir les rechercher, dans un délai de deux mois. A l’expiration de ce délai et à défaut de diligences de sa part, les pièces et documents lui sont restitués, à ses frais. |
||
Le déroulement des opérations de visite et saisie peut faire l’objet d’un recours devant le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le juge a autorisé ces dernières, suivant les règles prévues par le code de procédure pénale. Le ministère public, la personne à l’encontre de laquelle a été prise l’ordonnance mentionnée au premier alinéa et les personnes mises en cause au moyen de pièces saisies au cours de ces opérations peuvent former ce recours. Ce dernier est formalisé par déclaration au greffe du tribunal de grande instance dans un délai de dix jours à compter de la remise ou de la réception du procès-verbal et de l’inventaire, ou, pour les personnes n’ayant pas fait l’objet de visite et de saisie et qui sont mises en cause, à compter de la date à laquelle elles ont reçu notification du procès-verbal et de l’inventaire et, au plus tard à compter de la notification de griefs prévue à l’article L. 463-2. Le recours n’est pas suspensif. L’ordonnance du premier président de la cour d’appel est susceptible d’un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure pénale. Les pièces saisies sont conservées jusqu’à ce qu’une décision soit devenue définitive. |
||
Code de la consommation |
||
Art. L. 215-18. – I. – Pour la recherche et la constatation des infractions au présent livre, les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ayant au moins le grade de contrôleur peuvent, sur demande du ministre chargé de l’économie, procéder à des opérations de visite et de saisie en tous lieux. |
||
II. – Chaque visite doit être autorisée par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter. Lorsque ces lieux sont situés dans le ressort de plusieurs juridictions et qu’une action simultanée doit être menée dans chacun d’eux, une ordonnance unique peut être délivrée par l’un des juges des libertés et de la détention compétents. |
||
Le juge vérifie que la demande d’autorisation qui lui est soumise est fondée. Cette demande doit comporter tous les éléments d’information en possession de l’administration de nature à justifier la visite. Il désigne le chef du service qui doit nommer les officiers de police judiciaire chargés d’assister aux opérations, de le tenir informé de leur déroulement et d’apporter leur concours en procédant aux réquisitions nécessaires. |
||
Le procureur de la République territorialement compétent est, préalablement à la saisine du juge des libertés et de la détention, informé par l’administration du projet d’opérations mentionnées au I et peut s’y opposer. |
||
III. – La visite et les saisies s’effectuent sous l’autorité et le contrôle du juge qui les a autorisées. Lorsqu’elles ont lieu en dehors du ressort de sa juridiction, il délivre une commission rogatoire pour exercer ce contrôle au juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel s’effectue la visite. |
||
Le juge peut se rendre dans les locaux visités pendant l’intervention. A tout moment, il peut décider la suspension ou l’arrêt de la visite. |
||
IV. – Les opérations de visite et de saisie ne peuvent être commencées ni avant 6 heures, ni après 21 heures. |
||
Toutefois, les agents mentionnés au I peuvent, lorsque les nécessités de l’enquête l’exigent, procéder à ces opérations en dehors des heures mentionnées au premier alinéa du présent IV dans les lieux utilisés à des fins professionnelles et dans les lieux d’exécution d’une prestation de services, sous réserve que l’ordonnance délivrée par le juge des libertés et de la détention le prévoie expressément et que ces lieux ne soient pas également à usage d’habitation. |
||
V. – La visite est effectuée en présence de l’occupant des lieux ou de son représentant. L’occupant des lieux peut désigner un ou plusieurs représentants pour assister à la visite et signer le procès-verbal. En cas d’impossibilité, l’officier de police judiciaire requiert deux témoins choisis en dehors des personnes relevant de son autorité ou de celle de l’administration de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. |
||
L’ordonnance est notifiée verbalement et sur place au moment de la visite à l’occupant des lieux ou à son représentant, qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal. L’ordonnance mentionne que l’occupant des lieux ou son représentant a la faculté de faire appel au conseil de son choix. L’exercice de cette faculté n’entraîne pas la suspension des opérations de visite et de saisie. |
||
En l’absence de l’occupant des lieux, l’ordonnance est notifiée après les opérations par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Il en va de même lorsqu’il n’est pas procédé à la visite de l’un des lieux visés par l’ordonnance. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l’avis. |
||
Au cours de la visite, les agents mentionnés au I peuvent procéder à la saisie de tous objets, documents et supports d’information utiles aux besoins de l’enquête. Ils peuvent prélever des échantillons. Ils peuvent également procéder à la pose de scellés sur tous locaux commerciaux, objets, documents et supports d’information, dans la limite de la durée de la visite de ces locaux. |
||
Les agents mentionnés au I, l’occupant des lieux ou son représentant ainsi que l’officier de police judiciaire peuvent seuls prendre connaissance des documents et des données contenues dans tout support d’information avant leur saisie. |
||
Tous objets, documents et supports d’information saisis sont inventoriés et placés sous scellés. |
||
Les agents mentionnés au I peuvent procéder au cours de la visite à des auditions de l’occupant des lieux, de son représentant ou de toute autre personne, en vue de recueillir les informations ou explications utiles aux besoins de l’enquête. |
||
V. – Après le septième alinéa du V de l’article L. 215-18 du code de la consommation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : | ||
« Conformément à l’article 28 du code de procédure pénale, l’article 61-1 du même code est applicable lorsqu’il est procédé à l’audition d’une personne à l’égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction. » | ||
Lorsque la visite est effectuée dans le cabinet d’un avocat ou à son domicile, dans les locaux d’une entreprise de presse ou de communication audiovisuelle, dans le cabinet d’un médecin, d’un notaire ou d’un huissier, les articles 56-1,56-2 ou 56-3 du code de procédure pénale, selon le cas, sont applicables. |
||
Les originaux du procès-verbal et de l’inventaire des objets, documents et supports d’information saisis sont transmis au juge qui a ordonné la visite. Une copie en est remise à l’occupant des lieux ou à son représentant. Le cas échéant, la copie de ces documents est également adressée, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, aux personnes mises en cause au moyen de pièces saisies au cours de l’opération. |
||
VI. – La personne à l’encontre de laquelle l’ordonnance mentionnée au II a été prise peut en interjeter appel devant le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le juge a autorisé la mesure, suivant les règles prévues au code de procédure pénale. L’appel est formé par déclaration au greffe du tribunal de grande instance dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance. Il n’est pas suspensif. L’ordonnance du premier président de la cour d’appel est susceptible d’un pourvoi en cassation, selon les règles prévues par le code de procédure pénale. Les pièces saisies sont conservées jusqu’à ce qu’une décision soit devenue définitive. |
||
Le déroulement des opérations de visite et de saisie peut faire l’objet d’un recours devant le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le juge a autorisé ces dernières, suivant les règles prévues par le code de procédure pénale. La personne à l’encontre de laquelle l’ordonnance mentionnée au II a été prise et les personnes mises en cause au moyen de pièces saisies au cours de ces opérations peuvent former ce recours. Ce dernier est formé par déclaration au greffe du tribunal de grande instance dans un délai de dix jours à compter de la remise ou de la réception du procès-verbal et de l’inventaire ou, pour les personnes n’ayant pas fait l’objet de visite et de saisie et qui sont mises en cause, à compter de la date à laquelle elles ont reçu notification du procès-verbal et de l’inventaire. Le recours n’est pas suspensif. L’ordonnance du premier président de la cour d’appel est susceptible d’un pourvoi en cassation, selon les règles prévues par le code de procédure pénale. Les pièces saisies sont conservées jusqu’à ce qu’une décision soit devenue définitive. |
||
Code de la propriété intellectuelle |
||
Art. L. 331-21-1. – Les membres de la commission de protection des droits, ainsi que ses agents habilités et assermentés devant l’autorité judiciaire mentionnés à l’article L. 331-21, peuvent constater les faits susceptibles de constituer des infractions prévues au présent titre lorsqu’elles sont punies de la peine complémentaire de suspension de l’accès à un service de communication au public en ligne mentionnée aux articles L. 335-7 et L. 335-7-1. |
||
Ils peuvent en outre recueillir les observations des personnes concernées. Il est fait mention de ce droit dans la lettre de convocation. |
||
Lorsque les personnes concernées demandent à être entendues, ils les convoquent et les entendent. Toute personne entendue a le droit de se faire assister d’un conseil de son choix. |
||
VI. – Après le troisième alinéa de l’article L. 331-21-1 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : | ||
« Conformément à l’article 28 du code de procédure pénale, l’article 61-1 du même code est applicable lorsqu’il est procédé à l’audition d’une personne à l’égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction. » | ||
Une copie du procès-verbal d’audition est remise à la personne concernée. |
||
Code de la santé publique |
||
Art. L. 3341-2. – Lorsqu’il est mis fin à la rétention en chambre de sûreté de la personne, son placement en garde à vue, si les conditions de cette mesure prévues par le code de procédure pénale sont réunies, n’est pas obligatoire dès lors qu’elle n’est pas tenue sous la contrainte de demeurer à la disposition des enquêteurs et qu’elle a été informée qu’elle peut à tout moment quitter les locaux de police ou de gendarmerie. |
VII. – À la fin de l’article L. 3341-2 du code de la santé publique et à la fin des articles L. 234-18 et L. 235-5 du code de la route, les mots : « qu’elle peut à tout moment quitter les locaux de police ou de gendarmerie » sont remplacés par les mots : « des droits mentionnés à l’article 61-1 du code de procédure pénale ». amendement CL328 | |
Code de la route |
||
Art. L. 234-18. – Lorsqu’il a été procédé aux épreuves de dépistage et aux vérifications prévues par les articles L. 234-3 et L. 234-5, le placement en garde à vue de la personne, si les conditions de cette mesure prévues par le code de procédure pénale sont réunies, n’est pas obligatoire dès lors qu’elle n’est pas tenue sous la contrainte de demeurer à la disposition des enquêteurs et qu’elle a été informée qu’elle peut à tout moment quitter les locaux de police ou de gendarmerie. |
||
Art. L. 235-5. – Lorsqu’il a été procédé aux épreuves de dépistage et aux vérifications prévues par l’article L. 235-2, le placement en garde à vue de la personne, si les conditions de cette mesure prévues par le code de procédure pénale sont réunies, n’est pas obligatoire dès lors qu’elle n’est pas tenue sous la contrainte de demeurer à la disposition des enquêteurs et qu’elle a été informée qu’elle peut à tout moment quitter les locaux de police ou de gendarmerie. |
||
Article 31 quinquies (nouveau) | ||
Code de procédure pénale |
Le code de procédure pénale est ainsi modifié : | |
Art. 41-4. – Au cours de l’enquête ou lorsqu’aucune juridiction n’a été saisie ou que la juridiction saisie a épuisé sa compétence sans avoir statué sur la restitution des objets placés sous main de justice, le procureur de la République ou le procureur général est compétent pour décider, d’office ou sur requête, de la restitution de ces objets lorsque la propriété n’en est pas sérieusement contestée. |
1° L’article 41-4 est ainsi modifié : | |
Il n’y a pas lieu à restitution lorsque celle-ci est de nature à créer un danger pour les personnes ou les biens ou lorsqu’une disposition particulière prévoit la destruction des objets placés sous main de justice ; la décision de non-restitution prise pour l’un de ces motifs ou pour tout autre motif, même d’office, par le procureur de la République ou le procureur général peut être déférée par l’intéressé à la chambre de l’instruction, dans le délai d’un mois suivant sa notification, par déclaration au greffe du tribunal ou de la cour ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ; ce recours est suspensif. |
a) Au deuxième alinéa, après le mot : « biens », sont insérés les mots : « , lorsque le bien saisi est l’instrument ou le produit direct ou indirect de l’infraction » ; | |
b) Le dernier alinéa est ainsi modifié : | ||
Si la restitution n’a pas été demandée ou décidée dans un délai de six mois à compter de la décision de classement ou de la décision par laquelle la dernière juridiction saisie a épuisé sa compétence, les objets non restitués deviennent propriété de l’Etat, sous réserve des droits des tiers. Il en est de même lorsque le propriétaire ou la personne à laquelle la restitution a été accordée ne réclame pas l’objet dans un délai de deux mois à compter d’une mise en demeure adressée à son domicile. Les objets dont la restitution est de nature à créer un danger pour les personnes ou les biens deviennent propriété de l’Etat, sous réserve des droits des tiers, dès que la décision de non-restitution ne peut plus être contestée, ou dès que le jugement ou l’arrêt de non-restitution est devenu définitif. |
– à la deuxième phrase, les mots : « de deux » sont remplacés par les mots : « d’un » ; | |
– à la dernière phrase, les mots : « le jugement ou » sont supprimés ; | ||
Art. 41-5. – Lorsqu’au cours de l’enquête la restitution des biens meubles saisis et dont la conservation n’est plus nécessaire à la manifestation de la vérité s’avère impossible, soit parce que le propriétaire ne peut être identifié, soit parce que le propriétaire ne réclame pas l’objet dans un délai d’un mois à compter d’une mise en demeure adressée à son dernier domicile connu, le procureur de la République peut, sous réserve des droits des tiers, autoriser la destruction de ces biens ou leur remise à l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués aux fins d’aliénation. |
2° Au premier alinéa de l’article 41-5, les mots : « dernier domicile connu » sont remplacés par le mot : « domicile » ; | |
Le procureur de la République peut également autoriser la remise à l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, en vue de leur aliénation, des biens meubles saisis dont la conservation en nature n’est plus nécessaire à la manifestation de la vérité et dont la confiscation est prévue par la loi, lorsque le maintien de la saisie serait de nature à diminuer la valeur du bien. S’il est procédé à la vente du bien, le produit de celle-ci est consigné. En cas de classement sans suite, de non-lieu ou de relaxe, ou lorsque la peine de confiscation n’est pas prononcée, ce produit est restitué au propriétaire des objets s’il en fait la demande. |
||
Lorsque le maintien de la saisie serait de nature à diminuer la valeur du bien, le procureur de la République peut également ordonner, sous réserve des droits des tiers, de remettre au service des domaines, en vue de leur affectation à titre gratuit par l’autorité administrative et après que leur valeur a été expertisée, à des services de police, des unités de gendarmerie ou des services de l’administration des douanes qui effectuent des missions de police judiciaire, des biens meubles placés sous main de justice dont la conservation n’est plus nécessaire à la manifestation de la vérité et dont la confiscation est prévue par la loi. En cas de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement, ou lorsque la peine de confiscation n’est pas prononcée, le propriétaire qui en fait la demande obtient la restitution du bien, assortie s’il y a lieu d’une indemnité compensant la perte de valeur qui a pu résulter de l’usage du bien. |
||
Au cours de l’enquête ou lorsqu’aucune juridiction n’a été saisie ou que la juridiction saisie a épuisé sa compétence sans avoir statué sur le sort des scellés, le procureur de la République peut ordonner la destruction des biens meubles saisis dont la conservation n’est plus nécessaire à la manifestation de la vérité, s’il s’agit d’objets qualifiés par la loi de dangereux ou nuisibles, ou dont la détention est illicite. |
||
Les décisions prises en application des quatre premiers alinéas sont motivées. Elles sont notifiées par tout moyen aux personnes ayant des droits sur le bien, si celles-ci sont connues, et aux personnes mises en cause. Ces personnes peuvent contester ces décisions devant la chambre de l’instruction afin de demander, le cas échéant, la restitution du bien saisi. Cette contestation doit intervenir dans les cinq jours qui suivent la notification de la décision, par déclaration au greffe du tribunal ou à l’autorité qui a procédé à cette notification ; en cas de notification orale d’une décision de destruction de produits stupéfiants prise en application du quatrième alinéa, le délai de contestation est de vingt-quatre heures. Ces délais et l’exercice du recours sont suspensifs. |
||
Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités d’application du présent article. |
||
Art. 99. – Au cours de l’information, le juge d’instruction est compétent pour décider de la restitution des objets placés sous main de justice. |
||
Il statue, par ordonnance motivée, soit sur réquisitions du procureur de la République, soit, après avis de ce dernier, d’office ou sur requête de la personne mise en examen, de la partie civile ou de toute autre personne qui prétend avoir droit sur l’objet. |
||
Il peut également, avec l’accord du procureur de la République, décider d’office de restituer ou de faire restituer à la victime de l’infraction les objets placés sous main de justice dont la propriété n’est pas contestée. |
||
Il n’y a pas lieu à restitution lorsque celle-ci est de nature à faire obstacle à la manifestation de la vérité ou à la sauvegarde des droits des parties ou lorsqu’elle présente un danger pour les personnes ou les biens. Elle peut être refusée lorsque la confiscation de l’objet est prévue par la loi. |
3° Au quatrième alinéa de l’article 99, après le mot : « parties », sont insérés les mots : « , lorsque le bien saisi est l’instrument ou le produit direct ou indirect de l’infraction » ; | |
L’ordonnance du juge d’instruction mentionnée au deuxième alinéa du présent article est notifiée soit au requérant en cas de rejet de la demande, soit au ministère public et à toute autre partie intéressée en cas de décision de restitution. Elle peut être déférée à la chambre de l’instruction, sur simple requête déposée au greffe du tribunal, dans le délai et selon les modalités prévus par le quatrième alinéa de l’article 186. Ce délai est suspensif. |
||
Le tiers peut, au même titre que les parties, être entendu par la chambre de l’instruction en ses observations, mais il ne peut prétendre à la mise à sa disposition de la procédure. |
||
4° L’article 99-2 est ainsi modifié : | ||
Art. 99-2. – Lorsque, au cours de l’instruction, la restitution des biens meubles placés sous main de justice et dont la conservation n’est plus nécessaire à la manifestation de la vérité s’avère impossible, soit parce que le propriétaire ne peut être identifié, soit parce que le propriétaire ne réclame pas l’objet dans un délai de deux mois à compter d’une mise en demeure adressée à son domicile, le juge d’instruction peut ordonner, sous réserve des droits des tiers, la destruction de ces biens ou leur remise à l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués aux fins d’aliénation. |
a) Au premier alinéa, les mots : « de deux » sont remplacés par les mots : « d’un » ; | |
Le juge d’instruction peut également ordonner, sous réserve des droits des tiers, de remettre à l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, en vue de leur aliénation, des biens meubles placés sous main de justice appartenant aux personnes poursuivies, dont la conservation n’est plus nécessaire à la manifestation de la vérité et dont la confiscation est prévue par la loi, lorsque le maintien de la saisie serait de nature à diminuer la valeur du bien.S’il est procédé à la vente du bien, le produit de celle-ci est consigné pendant une durée de dix ans. En cas de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement, ou lorsque la peine de confiscation n’est pas prononcée, ce produit est restitué au propriétaire des objets s’il en fait la demande. |
b) À la première phrase des deuxième et troisième alinéas, les mots : « appartenant aux personnes poursuivies » sont supprimés ; | |
Lorsque le maintien de la saisie serait de nature à diminuer la valeur du bien, le juge d’instruction peut également ordonner, sous réserve des droits des tiers, de remettre au service des domaines, en vue de leur affectation à titre gratuit par l’autorité administrative et après que leur valeur a été expertisée, à des services de police, des unités de gendarmerie ou des services de l’administration des douanes qui effectuent des missions de police judiciaire, des biens meubles placés sous main de justice appartenant aux personnes poursuivies, dont la conservation n’est plus nécessaire à la manifestation de la vérité et dont la confiscation est prévue par la loi. En cas de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement, ou lorsque la peine de confiscation n’est pas prononcée, le propriétaire qui en fait la demande obtient la restitution du bien, assortie s’il y a lieu d’une indemnité compensant la perte de valeur qui a pu résulter de l’usage du bien. |
||
Le juge d’instruction peut également ordonner la destruction des biens meubles placés sous main de justice dont la conservation n’est plus nécessaire à la manifestation de la vérité, lorsqu’il s’agit d’objets qualifiés par la loi de dangereux ou de nuisibles, ou dont la détention est illicite. |
c) L’avant-dernier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : | |
Les décisions prises en application du présent article font l’objet d’une ordonnance motivée. Cette ordonnance est prise soit sur réquisitions du procureur de la République, soit d’office après avis de ce dernier. Elle est notifiée au ministère public, aux parties intéressées et, s’ils sont connus, au propriétaire ainsi qu’aux tiers ayant des droits sur le bien, qui peuvent la déférer à la chambre de l’instruction dans les conditions prévues aux cinquième et sixième alinéas de l’article 99. |
« Toutefois, en cas de notification orale d’une décision, prise en application du quatrième alinéa du présent article, de destruction de produits stupéfiants susceptibles d’être saisis à l’occasion de l’exécution d’une commission rogatoire, cette décision peut être déférée dans les vingt-quatre heures devant la chambre de l’instruction, par déclaration au greffe du juge d’instruction ou à l’autorité qui a procédé à cette notification. Ces délais et l’exercice du recours sont suspensifs. » ; | |
Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités d’application du présent article. |
||
5° L’article 373 est ainsi modifié : | ||
Art. 373. – La cour peut ordonner d’office la restitution des objets placés sous la main de la justice. Toutefois, s’il y a eu condamnation, cette restitution n’est effectuée que si son bénéficiaire justifie que le condamné a laissé passer les délais sans se pourvoir en cassation, ou s’il s’est pourvu, que l’affaire est définitivement jugée. |
a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « d’office », sont remplacés par les mots : « , d’office ou sur demande d’une partie ou de toute personne intéressée, » ; | |
La cour peut refuser la restitution lorsque celle-ci présente un danger pour les personnes ou les biens. |
b) Le second alinéa est complété par les mots : « ou lorsque le bien saisi est l’instrument ou le produit direct ou indirect de l’infraction » ; | |
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : | ||
« En cas de demande de restitution émanant d’une personne autre que les parties, seuls les procès-verbaux relatifs à la saisie des biens peuvent lui être communiqués. » ; | ||
Art. 481. – Si le tribunal estime que les objets placés sous la main de la justice sont utiles à la manifestation de la vérité ou susceptibles de confiscation, il surseoit à statuer jusqu’à sa décision sur le fond. |
||
Dans ce cas, le jugement n’est susceptible d’aucun recours. |
||
Le tribunal peut refuser la restitution lorsque celle-ci présente un danger pour les personnes ou les biens. |
6° Le dernier alinéa de l’article 481 est complété par les mots : « ou lorsque le bien saisi est l’instrument ou le produit direct ou indirect de l’infraction » ; | |
7° Le paragraphe 2 de la section 6 du chapitre Ier du titre II du livre II est complété par un article 493-1 ainsi rédigé : | ||
« Art. 493-1. – En l’absence d’opposition, les biens confisqués par défaut deviennent la propriété de l’État à l’expiration du délai de prescription de la peine. » ; | ||
8° Le premier alinéa de l’article 706-11 est complété par une phrase ainsi rédigée : | ||
Art. 706-11. – Le fonds est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l’infraction ou tenues à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l’indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes. |
« Le recours du fonds ne peut s’exercer contre l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués. » ; | |
Art. 706-143. – Jusqu’à la mainlevée de la saisie ou la confiscation du bien saisi, le propriétaire ou, à défaut, le détenteur du bien est responsable de son entretien et de sa conservation. Il en supporte la charge, à l’exception des frais qui peuvent être à la charge de l’Etat. |
||
En cas de défaillance ou d’indisponibilité du propriétaire ou du détenteur du bien, et sous réserve des droits des tiers de bonne foi, le procureur de la République ou le juge d’instruction peuvent autoriser la remise à l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués du bien saisi dont la vente par anticipation n’est pas envisagée afin que cette agence réalise, dans la limite du mandat qui lui est confié, tous les actes juridiques et matériels nécessaires à la conservation, l’entretien et la valorisation de ce bien. |
||
Tout acte ayant pour conséquence de transformer, modifier substantiellement le bien ou d’en réduire la valeur est soumis à l’autorisation préalable du juge des libertés et de la détention, sur requête du procureur de la République qui en a ordonné ou autorisé la saisie, du juge d’instruction qui en a ordonné ou autorisé la saisie ou du juge d’instruction en cas d’ouverture d’une information judiciaire postérieurement à la saisie. |
||
9° L’article 706-143 est complété par deux alinéas ainsi rédigés : | ||
« Lorsque le bien saisi nécessite des frais de conservation disproportionnés par rapport à sa valeur en l’état, le juge des libertés et de la détention, sur requête du procureur de la République, ou le juge d’instruction peuvent autoriser l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués à l’aliéner par anticipation. La décision rendue en application du présent alinéa fait l’objet d’une ordonnance motivée, prise à la requête ou après avis du procureur de la République. Elle est notifiée aux parties intéressées ainsi qu’aux tiers ayant des droits sur le bien, qui peuvent la déférer à la chambre de l’instruction dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas de l’article 99. | ||
« Le produit de la vente est consigné. En cas de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement ou lorsque la peine de confiscation n’est pas prononcée, ce produit est restitué au propriétaire du bien s’il en fait la demande. » ; | ||
Art. 706-148. – Si l’enquête porte sur une infraction punie d’au moins cinq ans d’emprisonnement, le juge des libertés et de la détention peut, sur requête du procureur de la République, autoriser par ordonnance motivée la saisie, aux frais avancés du Trésor, des biens dont la confiscation est prévue en application des cinquième et sixième alinéas de l’article 131-21 du code pénal lorsque la loi qui réprime le crime ou le délit le prévoit ou lorsque l’origine de ces biens ne peut être établie. Le juge d’instruction peut, sur requête du procureur de la République ou d’office après avis du ministère public, ordonner cette saisie dans les mêmes conditions. |
10° À la première phrase du premier alinéa de l’article 706-148, les mots : « autoriser par ordonnance » sont remplacés par les mots : « ordonner par décision » ; | |
L’ordonnance prise en application du premier alinéa est notifiée au ministère public, au propriétaire du bien saisi et, s’ils sont connus, aux tiers ayant des droits sur ce bien, qui peuvent la déférer à la chambre de l’instruction par déclaration au greffe du tribunal dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance. Cet appel n’est pas suspensif. L’appelant ne peut prétendre dans ce cadre qu’à la mise à disposition des seules pièces de la procédure se rapportant à la saisie qu’il conteste. S’ils ne sont pas appelants, le propriétaire du bien et les tiers peuvent néanmoins être entendus par la chambre de l’instruction, sans toutefois pouvoir prétendre à la mise à disposition de la procédure. |
||
Art. 706-157. – La saisie d’un fonds de commerce est opposable aux tiers à compter de son inscription, aux frais avancés du Trésor, sur le registre des nantissements tenu au greffe du tribunal de commerce du lieu de situation du fonds. |
||
11° L’article 706-157 est complété par un alinéa ainsi rédigé : | ||
« Les formalités de cette publication sont réalisées, au nom du procureur de la République, du juge d’instruction ou de la juridiction de jugement, par l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués. » ; | ||
Art. 706-160. – L’agence est chargée d’assurer, sur l’ensemble du territoire et sur mandat de justice : |
||
1° La gestion de tous les biens, quelle que soit leur nature, saisis, confisqués ou faisant l’objet d’une mesure conservatoire au cours d’une procédure pénale, qui lui sont confiés et qui nécessitent, pour leur conservation ou leur valorisation, des actes d’administration ; |
||
2° La gestion centralisée de toutes les sommes saisies lors de procédures pénales ; |
||
3° L’aliénation ou la destruction des biens dont elle a été chargée d’assurer la gestion au titre du 1° et qui sont ordonnées, sans préjudice de l’affectation de ces biens dans les conditions prévues aux articles L. 2222-9 du code général de la propriété des personnes publiques et 707-1 du présent code ; |
||
4° L’aliénation des biens ordonnée ou autorisée dans les conditions prévues aux articles 41-5 et 99-2 du présent code. |
||
12° Après le 4° de l’article 706-160, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : | ||
« Les sommes transférées à l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués en application du 2° du présent article et dont l’origine ne peut être déterminée sont transférées à l’État à l’issue d’un délai de quatre ans après leur réception, lors de la clôture des comptes annuels. En cas de décision de restitution postérieure au délai de quatre ans, l’État rembourse à l’agence les sommes dues. » ; | ||
L’agence peut, dans les mêmes conditions, assurer la gestion des biens saisis, procéder à l’aliénation ou à la destruction des biens saisis ou confisqués et procéder à la répartition du produit de la vente en exécution de toute demande d’entraide ou de coopération émanant d’une autorité judiciaire étrangère. |
||
L’ensemble de ses compétences s’exerce pour les biens saisis ou confisqués, y compris ceux qui ne sont pas visés au titre XXIX. |
||
La décision de transfert des biens faisant l’objet d’une saisie pénale à l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués est notifiée ou publiée selon les règles applicables à la saisie elle-même. |
||
Dans l’exercice de ses compétences, l’agence peut obtenir le concours ainsi que toutes informations utiles auprès de toute personne physique ou morale, publique ou privée, sans que le secret professionnel lui soit opposable, sous réserve des dispositions de l’article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques. |
||
13° L’article 706-161 est ainsi modifié : | ||
Art. 706-161. – L’agence fournit aux juridictions pénales qui la sollicitent les orientations ainsi que l’aide juridique et pratique utiles à la réalisation des saisies et confiscations envisagées ou à la gestion des biens saisis et confisqués. |
a) Au premier alinéa, les mots : « qui la sollicitent » sont remplacés par les mots : « et aux procureurs de la République, à leur demande ou à son initiative, » ; | |
Elle peut mener toute action d’information ou de formation destinée à faire connaître son action et à promouvoir de bonnes pratiques en matière de saisie et de confiscation. |
||
L’agence veille à l’abondement du fonds de concours recevant les recettes provenant de la confiscation des biens mobiliers ou immobiliers des personnes reconnues coupables d’infraction en matière de trafic de stupéfiants. L’agence peut également verser à l’Etat des contributions destinées au financement de la lutte contre la délinquance et la criminalité. |
||
Elle peut informer les services compétents et les victimes, à leur demande ou à son initiative, sur les biens qui sont restitués sur décision de justice, afin d’assurer le paiement de leurs créances, notamment fiscales, douanières, sociales ou de dédommagement. |
||
L’agence met en œuvre un traitement de données à caractère personnel qui centralise les décisions de saisie et de confiscation dont elle est saisie quelle que soit la nature des biens, ainsi que toutes les informations utiles relatives aux biens visés, à leur localisation et à leurs propriétaires ou détenteurs. |
||
b) Avant le dernier alinéa de l’article 706-161, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : | ||
« Les magistrats et greffiers affectés au sein de l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués peuvent accéder directement aux informations et aux données à caractère personnel enregistrées dans le bureau d’ordre national automatisé des procédures judiciaires dans le cadre des attributions de l’agence, pour le besoin des procédures pour lesquelles sont envisagées ou ont été réalisées des saisies ou des confiscations et dans la mesure du besoin d’en connaître. » ; | ||
L’agence établit un rapport annuel d’activité, comprenant notamment un bilan statistique, ainsi que toute réflexion et toute proposition visant à l’amélioration du droit et des pratiques en matière de saisie et de confiscation. |
||
Art. 706-163. – Les ressources de l’agence comportent : |
||
1° Les subventions, avances et autres contributions de l’Etat et de ses établissements publics, de l’Union européenne, des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics ainsi que de toute autre personne morale publique ou privée ; |
||
2° Les recettes fiscales affectées par la loi ; |
||
3° Une partie, plafonnée conformément au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 des sommes confisquées gérées par l’agence ainsi que, du produit de la vente des biens confisqués lorsque l’agence est intervenue pour leur gestion ou leur vente, sauf lorsque la loi prévoit la restitution intégrale à la personne saisie de ce produit et des intérêts échus le cas échéant, et sous réserve de l’affectation de ces sommes ou de ce produit au fonds de concours recevant les recettes provenant de la confiscation des biens mobiliers ou immobiliers des personnes reconnues coupables d’infractions en matière de trafic de stupéfiants ; |
||
4° Le produit du placement des sommes saisies ou acquises par la gestion des avoirs saisis et versées sur son compte à la Caisse des dépôts et consignations, dans les mêmes limites et sous les mêmes réserves que pour les ventes visées au 3° ; |
||
5° Le produit des dons et legs. |
||
14° L’article 706-163 est complété par un 6° ainsi rédigé : | ||
« 6° Le produit du placement des sommes versées sur le compte de l’agence à la Caisse des dépôts et consignations en application du sixième alinéa de l’article 706-160. » ; | ||
15° L’article 706-164 est ainsi modifié : | ||
Art. 706-164. – Toute personne qui, s’étant constituée partie civile, a bénéficié d’une décision définitive lui accordant des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’elle a subi du fait d’une infraction pénale ainsi que des frais en application des articles 375 ou 475-1 et qui n’a pas obtenu d’indemnisation ou de réparation en application des articles 706-3 ou 706-14, ou une aide au recouvrement en application de l’article 706-15-1, peut obtenir de l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués que ces sommes lui soient payées prioritairement sur les biens de son débiteur dont la confiscation a été décidée par décision définitive. |
a) Après le mot : « payées », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « par prélèvement sur les fonds ou sur la valeur liquidative des biens de son débiteur dont la confiscation a été décidée par une décision définitive et dont l’agence est dépositaire en application des’ articles 706-160 ou’ 707-1. » ; | |
b) Après le premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés : | ||
« Cette demande de paiement doit, à peine de forclusion, être adressée par lettre recommandée à l’agence dans un délai de deux mois à compter du jour où la décision mentionnée au premier alinéa du présent article a acquis un caractère définitif. | ||
« En cas de pluralité de créanciers requérants et d’insuffisance d’actif pour les indemniser totalement, le paiement est réalisé au prix de la course et, en cas de demandes parvenues à même date, au marc l’euro. | ||
« Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables à la garantie des créances de l’État. » ; | ||
L’Etat est subrogé, à concurrence des sommes versées, dans les droits de la victime contre l’auteur de l’infraction dans le respect du rang des privilèges et sûretés de droit civil. |
||
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : | ||
« Les dossiers susceptibles d’ouvrir droit à cette action récursoire de l’État contre le condamné sont instruits par l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués puis communiqués au ministre chargé des finances qui en assure le recouvrement. » ; | ||
Art. 707-1. – Le ministère public et les parties poursuivent l’exécution de la sentence chacun en ce qui le concerne. |
||
Néanmoins, les poursuites pour le recouvrement des amendes et l’exécution des confiscations en valeur sont faites au nom du procureur de la République par le comptable public compétent ou, dans les cas où la confiscation en valeur s’exécute sur des biens préalablement saisis, par l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués. |
||
16° La dernière phrase du troisième alinéa de l’article 707-1 est ainsi rédigée : | ||
L’exécution des autres confiscations est réalisée au nom du procureur de la République par l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués lorsqu’elles portent sur des biens meubles ou immeubles mentionnés aux 1° et 2° de l’article 706-160, même s’ils ne lui ont pas été préalablement confiés. L’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués procède, s’il y a lieu, aux formalités de publication. |
« Sauf cas d’affectation, l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués procède à la vente de ces biens, s’il y a lieu, aux formalités de publication et, dans tous les cas, jusqu’à leur vente, aux actes d’administration nécessaires à leur conservation et à leur valorisation. » amendement CL227 | |
Le paiement du montant de l’amende doit toujours être recherché. Toutefois, le défaut total ou partiel du paiement de ce montant peut entraîner l’incarcération du condamné selon les conditions prévues par la loi. |
||
La prescription de la peine est interrompue par les actes ou décisions du ministère public, des juridictions de l’application des peines et, pour les peines d’amende ou de confiscation relevant de leur compétence, du Trésor ou de l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, qui tendent à son exécution. |
||
Le procureur de la République poursuit également l’exécution des sanctions pécuniaires prononcées par les autorités compétentes des Etats membres de l’Union européenne, conformément aux dispositions de la décision-cadre 2005/214/JAI du Conseil, du 24 février 2005, concernant l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux sanctions pécuniaires, selon des modalités fixées par décret. Ce décret précise également les modalités d’application à ces sanctions des articles 707-2 et 749 à 762 du présent code, ainsi que les règles applicables à la transmission pour mise à exécution dans un Etat membre de l’Union européenne des sanctions pécuniaires prononcées par les autorités françaises. |
||
Art. 48-1. – Le bureau d’ordre national automatisé des procédures judiciaires constitue une application automatisée, placée sous le contrôle d’un magistrat, contenant les informations nominatives relatives aux plaintes et dénonciations reçues par les procureurs de la République ou les juges d’instruction et aux suites qui leur ont été réservées, et qui est destinée à faciliter la gestion et le suivi des procédures judiciaires par les juridictions compétentes, l’information des victimes et la connaissance réciproque entre les juridictions des procédures concernant les mêmes faits ou mettant en cause les mêmes personnes, afin notamment d’éviter les doubles poursuites. |
||
Cette application a également pour objet l’exploitation des informations recueillies à des fins de recherches statistiques. |
||
Les données enregistrées dans le bureau d’ordre national automatisé portent notamment sur : |
||
1° Les date, lieu et qualification juridique des faits ; |
||
2° Lorsqu’ils sont connus, les nom, prénoms, date et lieu de naissance ou la raison sociale des personnes mises en cause et des victimes ; |
||
3° Les informations relatives aux décisions sur l’action publique, au déroulement de l’instruction, à la procédure de jugement et aux modalités d’exécution des peines ; |
||
4° Les informations relatives à la situation judiciaire, au cours de la procédure, de la personne mise en cause, poursuivie ou condamnée. |
||
Les informations contenues dans le bureau d’ordre national automatisé sont conservées, à compter de leur dernière mise à jour enregistrée, pendant une durée de dix ans ou, si elle est supérieure, pendant une durée égale au délai de la prescription de l’action publique ou, lorsqu’une condamnation a été prononcée, au délai de la prescription de la peine. |
||
Les informations relatives aux procédures suivies par chaque juridiction sont enregistrées sous la responsabilité, selon les cas, du procureur de la République ou des magistrats du siège exerçant des fonctions pénales de la juridiction territorialement compétente, par les greffiers ou les personnes habilitées qui assistent ces magistrats. |
||
Ces informations sont directement accessibles, pour les nécessités liées au seul traitement des infractions ou des procédures dont ils sont saisis, par les procureurs de la République et les magistrats du siège exerçant des fonctions pénales de l’ensemble des juridictions ainsi que leur greffier ou les personnes habilitées qui assistent ces magistrats. |
||
Elles sont également directement accessibles aux procureurs de la République et aux magistrats du siège exerçant des fonctions pénales des juridictions mentionnées aux articles 704, 706-2, 706-17, 706-75, 706-107 et 706-108 pour le traitement de l’ensemble des procédures susceptibles de relever de leur compétence territoriale élargie. |
Article 31 sexies (nouveau) | |
Elles sont de même directement accessibles aux procureurs généraux pour le traitement des procédures dont sont saisies les cours d’appel et pour l’application des dispositions des articles 35 et 37. |
Après le douzième alinéa de l’article 48-1 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : | |
« Elles sont en outre directement accessibles, pour l’exercice de leur mission, aux magistrats chargés par une disposition législative ou réglementaire du contrôle des fichiers de police judiciaire, du fichier national automatisé des empreintes génétiques et du fichier automatisé des empreintes digitales, ainsi qu’aux personnes habilitées qui les assistent. » amendement CL331 | ||
Sauf lorsqu’il s’agit de données non nominatives exploitées à des fins statistiques ou d’informations relevant de l’article 11-1, les informations figurant dans le bureau d’ordre national automatisé ne sont accessibles qu’aux autorités judiciaires. Lorsqu’elles concernent une enquête ou une instruction en cours, les dispositions de l’article 11 sont applicables. |
||
Un décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine les modalités d’application du présent article et précise notamment les conditions dans lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer leur droit d’accès. |
||
Article 31 septies (nouveau) | ||
Le code de procédure pénale est ainsi modifié : | ||
1° La section 1 du chapitre Ier du titre III du livre Ier est complétée par un article 84-1 ainsi rédigé : | ||
« Art. 84-1. – Lors de la première comparution de la personne mise en examen ou de la première audition de la partie civile ou du témoin assisté et à tout moment au cours de la procédure, le juge d’instruction peut demander à la partie, en présence de son avocat ou celui-ci dûment convoqué, après avoir porté à sa connaissance les articles 161-1 et 175, si elle déclare renoncer au bénéfice de ces articles. | ||
« La personne peut déclarer ne renoncer au bénéfice de l’article 161-1 que pour certaines catégories d’expertises qu’elle précise. | ||
« Elle peut déclarer ne renoncer au bénéfice de l’article 175 qu’en ce qui concerne le droit de faire des observations sur les réquisitions qui lui ont été communiquées. La renonciation au bénéfice de l’article 175 n’est toutefois valable que si elle a été faite par l’ensemble des parties de la procédure. » ; | ||
Art. 135-2. – Si la personne faisant l’objet d’un mandat d’arrêt est découverte après le règlement de l’information, il est procédé selon les dispositions du présent article. |
||
Le procureur de la République du lieu de l’arrestation est avisé dès le début de la rétention de la personne par les services de police ou de gendarmerie. Pendant cette rétention, il est fait application des dispositions des articles 63-2 et 63-3. La rétention ne peut durer plus de vingt-quatre heures. |
||
La personne est conduite dans les meilleurs délais et au plus tard dans les vingt-quatre heures de son arrestation devant le procureur de la République du tribunal de grande instance dans le ressort duquel siège la juridiction de jugement saisie des faits. Après avoir vérifié son identité et lui avoir notifié le mandat, ce magistrat la présente devant le juge des libertés et de la détention. |
||
Le juge des libertés et de la détention peut, sur les réquisitions du procureur de la République, soit placer la personne sous contrôle judiciaire, soit ordonner son placement en détention provisoire jusqu’à sa comparution devant la juridiction de jugement, par ordonnance motivée conformément aux dispositions de l’article 144, rendue à l’issue d’un débat contradictoire organisé conformément aux dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l’article 145. Si la personne est placée en détention, les délais prévus par les quatrième et cinquième alinéas de l’article 179 et par les huitième et neuvième alinéas de l’article 181 sont alors applicables et courent à compter de l’ordonnance de placement en détention. La décision du juge des libertés et de la détention peut faire, dans les dix jours de sa notification, l’objet d’un appel devant la chambre des appels correctionnels si la personne est renvoyée devant le tribunal correctionnel et devant la chambre de l’instruction si elle est renvoyée devant la cour d’assises. |
2° Le cinquième alinéa de l’article 135-2 est complété par deux phrases ainsi rédigées : | |
Si la personne a été arrêtée à plus de deux cents kilomètres du siège de la juridiction de jugement et qu’il n’est pas possible de la conduire dans le délai de vingt-quatre heures devant le procureur de la République mentionné au troisième alinéa, elle est conduite devant le juge des libertés et de la détention du lieu de son arrestation, qui vérifie son identité, lui notifie le mandat et reçoit ses éventuelles déclarations après l’avoir avertie qu’elle est libre de ne pas en faire. Ce magistrat met alors le mandat à exécution en faisant conduire la personne à la maison d’arrêt et il en avise le procureur de la République du tribunal de grande instance dans le ressort duquel siège la juridiction de jugement. Celui-ci ordonne le transfèrement de la personne, qui doit comparaître devant lui dans les quatre jours de la notification du mandat ; ce délai est porté à six jours en cas de transfèrement entre un département d’outre-mer et la France métropolitaine ou un autre département d’outre-mer. Il est alors procédé conformément aux dispositions des troisième et quatrième alinéas. |
« La comparution devant le procureur de la République et le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel siège la juridiction de jugement peut aussi être réalisée, avec l’accord de la personne et dans les délais précités, selon les modalités prévues à l’article 706-71. Il n’y a alors pas lieu d’ordonner le transfèrement de la personne. » ; | |
La présentation devant le juge des libertés et de la détention prévue par le quatrième alinéa n’est pas nécessaire si, dans les délais prévus pour cette présentation, la personne peut comparaître devant la juridiction de jugement saisie des faits. |
||
Les dispositions du présent article sont également applicables aux mandats d’arrêt délivrés après l’ordonnance de règlement. Elles ne sont toutefois pas applicables lorsque, postérieurement à la délivrance du mandat d’arrêt décerné au cours de l’instruction ou après son règlement, la personne a été condamnée à une peine privative de liberté, soit en matière correctionnelle par un jugement contradictoire ou réputé contradictoire, soit en matière criminelle par un arrêt rendu par défaut ; elles ne sont de même pas applicables lorsque le mandat a été délivré à la suite d’une telle condamnation. Dans ces cas, sans qu’il soit nécessaire de la présenter devant le juge des libertés et de la détention, la personne arrêtée est placée en détention provisoire jusqu’à l’expiration des délais de recours et, en cas de recours, jusqu’à sa comparution devant la juridiction de jugement, sans préjudice de son droit de former des demandes de mise en liberté. |
||
Art. 141-2. – Si la personne mise en examen se soustrait volontairement aux obligations du contrôle judiciaire, le juge d’instruction peut décerner à son encontre mandat d’arrêt ou d’amener. Il peut également, dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l’article 137-1, saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de placement en détention provisoire. Quelle que soit la peine d’emprisonnement encourue, le juge des libertés et de la détention peut décerner, à l’encontre de cette personne, un mandat de dépôt en vue de sa détention provisoire, sous réserve des dispositions de l’article 141-3. |
3° La dernière phrase du second alinéa de l’article 141-2 est ainsi modifiée : | |
Si la personne se soustrait aux obligations du contrôle judiciaire alors qu’elle est renvoyée devant la juridiction de jugement, le procureur de la République peut, hors le cas prévu par l’article 272-1, saisir le juge des libertés et de la détention pour que celui-ci décerne mandat d’arrêt ou d’amener à son encontre. Ce magistrat est également compétent pour ordonner, conformément aux dispositions de l’article 135-2, le placement en détention provisoire de l’intéressé. Les dispositions de l’article 141-4 sont applicables ; les attributions confiées au juge d’instruction par cet article sont alors exercées par le procureur de la République. |
a) Les mots : « dispositions de l’article 141-4 » sont remplacés par les références : « articles 141-4 et 141-5 » ; | |
b) Les mots : « cet article » sont remplacés par les mots : « les mêmes articles » ; | ||
Art. 161-1. – Copie de la décision ordonnant une expertise est adressée sans délai au procureur de la République et aux parties, qui disposent d’un délai de dix jours pour demander au juge d’instruction, selon les modalités prévues par l’avant-dernier alinéa de l’article 81, de modifier ou de compléter les questions posées à l’expert ou d’adjoindre à l’expert ou aux experts déjà désignés un expert de leur choix figurant sur une des listes mentionnées à l’article 157. |
||
Si le juge ne fait pas droit, dans un délai de dix jours à compter de leur réception, aux demandes prévues au premier alinéa, il rend une ordonnance motivée. Cette ordonnance ou l’absence d’ordonnance peut être contestée dans un délai de dix jours devant le président de la chambre de l’instruction. Ce dernier statue par décision motivée qui n’est pas susceptible de recours. |
||
Le présent article n’est pas applicable lorsque les opérations d’expertise et le dépôt des conclusions par l’expert doivent intervenir en urgence et ne peuvent être différés pendant le délai de dix jours prévu au premier alinéa ou lorsque la communication prévue au premier alinéa risque d’entraver l’accomplissement des investigations. |
||
Il n’est pas non plus applicable aux catégories d’expertises dont les conclusions n’ont pas d’incidence sur la détermination de la culpabilité de la personne mise en examen et dont la liste est fixée par décret. |
||
Les parties peuvent déclarer renoncer, en présence de leur avocat ou celui-ci dûment convoqué, à bénéficier des dispositions du présent article. |
4° Le dernier alinéa des articles 161-1 et 175 est supprimé ; | |
Art. 175. – Aussitôt que l’information lui paraît terminée, le juge d’instruction communique le dossier au procureur de la République et en avise en même temps les parties et leurs avocats soit verbalement avec émargement au dossier, soit par lettre recommandée. Lorsque la personne est détenue, cet avis peut également être notifié par les soins du chef de l’établissement pénitentiaire, qui adresse sans délai au juge d’instruction l’original ou la copie du récépissé signé par l’intéressé. |
||
Le procureur de la République dispose alors d’un délai d’un mois si une personne mise en examen est détenue ou de trois mois dans les autres cas pour adresser ses réquisitions motivées au juge d’instruction. Copie de ces réquisitions est adressée dans le même temps aux parties par lettre recommandée. |
||
Les parties disposent de ce même délai d’un mois ou de trois mois à compter de l’envoi de l’avis prévu au premier alinéa pour adresser des observations écrites au juge d’instruction, selon les modalités prévues par l’avant-dernier alinéa de l’article 81. Copie de ces observations est adressée en même temps au procureur de la République. |
||
Dans ce même délai d’un mois ou de trois mois, les parties peuvent formuler des demandes ou présenter des requêtes sur le fondement des articles 81, neuvième alinéa, 82-1,156, premier alinéa, et 173, troisième alinéa. À l’expiration de ce délai, elles ne sont plus recevables à formuler ou présenter de telles demandes ou requêtes. |
||
À l’issue du délai d’un mois ou de trois mois, le procureur de la République et les parties disposent d’un délai de dix jours si une personne mise en examen est détenue ou d’un mois dans les autres cas pour adresser au juge d’instruction des réquisitions ou des observations complémentaires au vu des observations ou des réquisitions qui leur ont été communiquées. |
||
À l’issue du délai de dix jours ou d’un mois prévu à l’alinéa précédent, le juge d’instruction peut rendre son ordonnance de règlement, y compris s’il n’a pas reçu de réquisitions ou d’observations dans le délai prescrit. |
||
Les premier, troisième et cinquième alinéas et, s’agissant des requêtes en nullité, le quatrième alinéa du présent article sont également applicables au témoin assisté. |
||
Les parties peuvent déclarer renoncer, en présence de leur avocat ou celui-ci dûment convoqué, à bénéficier des délais prévus par le présent article. |
||
Art. 706-71. – Lorsque les nécessités de l’enquête ou de l’instruction le justifient, l’audition ou l’interrogatoire d’une personne ainsi que la confrontation entre plusieurs personnes peuvent être effectués en plusieurs points du territoire de la République se trouvant reliés par des moyens de télécommunications garantissant la confidentialité de la transmission. Dans les mêmes conditions, la présentation aux fins de prolongation de la garde à vue ou de la retenue judiciaire peut être réalisée par l’utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle. Il est alors dressé, dans chacun des lieux, un procès-verbal des opérations qui y ont été effectuées. Ces opérations peuvent faire l’objet d’un enregistrement audiovisuel ou sonore, les dispositions des troisième à huitième alinéas de l’article 706-52 sont alors applicables. |
||
Les dispositions de l’alinéa précédent prévoyant l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle sont applicables devant la juridiction de jugement pour l’audition des témoins, des parties civiles et des experts. Elles sont également applicables, avec l’accord du procureur de la République et de l’ensemble des parties, pour la comparution du prévenu devant le tribunal correctionnel si celui-ci est détenu. |
||
Ces dispositions sont également applicables à l’audition ou à l’interrogatoire par un juge d’instruction d’une personne détenue, au débat contradictoire préalable au placement en détention provisoire d’une personne détenue pour une autre cause, au débat contradictoire prévu pour la prolongation de la détention provisoire, aux audiences relatives au contentieux de la détention provisoire devant la chambre de l’instruction ou la juridiction de jugement, à l’interrogatoire de l’accusé par le président de la cour d’assises en application de l’article 272, à la comparution d’une personne à l’audience au cours de laquelle est rendu un jugement ou un arrêt qui avait été mis en délibéré ou au cours de laquelle il est statué sur les seuls intérêts civils, à l’interrogatoire par le procureur ou le procureur général d’une personne arrêtée en vertu d’un mandat d’amener, d’un mandat d’arrêt, d’un mandat d’arrêt européen, d’une demande d’arrestation provisoire, d’une demande d’extradition ou d’une demande d’arrestation aux fins de remise, à la présentation au juge des libertés et de la détention, au premier président de la cour d’appel ou au magistrat désigné par lui en application des articles 627-5, 695-28,696-11 et 696-23 si la personne est détenue pour une autre cause, ou à l’interrogatoire du prévenu devant le tribunal de police ou devant la juridiction de proximité si celui-ci est détenu pour une autre cause. Lorsqu’il s’agit d’une audience au cours de laquelle il doit être statué sur le placement en détention provisoire ou la prolongation de la détention provisoire, la personne détenue peut refuser l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle, sauf si son transport paraît devoir être évité en raison des risques graves de trouble à l’ordre public ou d’évasion. |
5° À la dernière phrase du troisième alinéa de l’article 706-71, après le mot : « peut », sont insérés les mots : « , lorsqu’elle est informée de la date de l’audience et du fait que le recours à ce moyen est envisagé, ». amendement CL223 | |
Elles sont de même applicables devant la commission d’indemnisation des victimes d’infractions, devant le premier président de la cour d’appel statuant sur les demandes de réparation d’une détention provisoire, devant la Commission nationale de réparation des détentions, devant la commission d’instruction des demandes en révision et en réexamen et devant la cour de révision et de réexamen. |
||
Pour l’application des dispositions des trois alinéas précédents, si la personne est assistée par un avocat, celui-ci peut se trouver auprès du magistrat, de la juridiction ou de la commission compétents ou auprès de l’intéressé. Dans le premier cas, il doit pouvoir s’entretenir avec ce dernier, de façon confidentielle, en utilisant le moyen de télécommunication audiovisuelle. Dans le second cas, une copie de l’intégralité du dossier doit être mise à sa disposition dans les locaux de détention sauf si une copie de ce dossier a déjà été remise à l’avocat. |
||
Lorsqu’une personne est détenue, la notification d’une expertise par une juridiction doit se faire par l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle, sauf décision contraire motivée ou s’il doit être procédé concomitamment à un autre acte. |
||
En cas de nécessité, résultant de l’impossibilité pour un interprète de se déplacer, l’assistance de l’interprète au cours d’une audition, d’un interrogatoire ou d’une confrontation peut également se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunications. |
||
Un décret en Conseil d’Etat précise, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent article. |
||
Article 31 octies (nouveau) | ||
Le code de procédure pénale est ainsi modifié : | ||
1° Le titre IV du livre Ier est complété par un chapitre VI ainsi rédigé : | ||
« Chapitre VI | ||
« De la plate-forme nationale des interceptions judiciaires | ||
« Art. 230-45. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine les missions et les modalités de fonctionnement de la plate-forme nationale des interceptions judiciaires. | ||
« Sauf en cas d’impossibilité technique, les réquisitions adressées en application des articles 60-2, 77-1-2, 99-4, 100 à 100-7, 230-32 à 230-44 et 706-95 du présent code ou de l’article 67 bis-2 du code des douanes doivent être transmises par l’intermédiaire de la plate-forme nationale. | ||
« Le deuxième alinéa des articles 100-4, 100-6, 230-38 et 230-43 du présent code n’est pas applicable aux données conservées par la plate-forme nationale. » ; | ||
Art. 230-2. – Lorsque le procureur de la République, la juridiction d’instruction, l’officier de police judiciaire, sur autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction, ou la juridiction de jugement saisie de l’affaire décident d’avoir recours, pour les opérations mentionnées à l’article 230-1, aux moyens de l’Etat couverts par le secret de la défense nationale, la réquisition écrite doit être adressée à un organisme technique soumis au secret de la défense nationale, et désigné par décret, avec le support physique contenant les données à mettre au clair ou une copie de celui-ci. Cette réquisition fixe le délai dans lequel les opérations de mise au clair doivent être réalisées. Le délai peut être prorogé dans les mêmes conditions de forme. A tout moment, le procureur de la République, la juridiction d’instruction, l’officier de police judiciaire, sur autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction, ou la juridiction de jugement saisie de l’affaire ou ayant requis l’organisme technique peut ordonner l’interruption des opérations prescrites. |
||
Les données protégées au titre du secret de la défense nationale ne peuvent être communiquées que dans les conditions prévues par la loi n° 98-567 du 8 juillet 1998 instituant une Commission consultative du secret de la défense nationale. |
||
2° L’article 230-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé : | ||
« Lorsqu’il s’agit de données obtenues dans le cadre d’interceptions de communications électroniques, au sein du traitement mentionné à l’article 230-45, la réquisition est adressée directement à l’organisme technique désigné au deuxième alinéa du présent article. » ; | ||
Art. 230-3. – Dès l’achèvement des opérations ou dès qu’il apparaît que ces opérations sont techniquement impossibles ou à l’expiration du délai prescrit ou à la réception de l’ordre d’interruption émanant du procureur de la République, de la juridiction d’instruction, de l’officier de police judiciaire, sur autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction, ou de la juridiction de jugement saisie de l’affaire, les résultats obtenus et les pièces reçues sont retournés par le responsable de l’organisme technique à l’auteur de la réquisition. Sous réserve des obligations découlant du secret de la défense nationale, les résultats sont accompagnés des indications techniques utiles à la compréhension et à leur exploitation ainsi que d’une attestation visée par le responsable de l’organisme technique certifiant la sincérité des résultats transmis. |
3° À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article 230-3, les mots : « à l’auteur de la réquisition » sont remplacés par les mots : « soit à l’auteur de la réquisition, soit au magistrat mandant dans le cas où la réquisition a été adressée directement ». amendement CL228 | |
Les éléments ainsi obtenus font l’objet d’un procès-verbal de réception et sont versés au dossier de la procédure. |
||
Article 31 nonies (nouveau) | ||
Art. 308. – Dès l’ouverture de l’audience, l’emploi de tout appareil d’enregistrement ou de diffusion sonore, de caméra de télévision ou de cinéma, d’appareils photographiques est interdit sous peine de 18 000 euros d’amende, qui peut être prononcée dans les conditions prévues au titre VIII du livre IV. |
I. – L’article 308 du code de procédure pénale est ainsi modifié : | |
Toutefois, les débats de la cour d’assises font l’objet d’un enregistrement sonore sous le contrôle du président. Le président peut également, à la demande de la victime ou de la partie civile, ordonner que l’audition ou la déposition de ces dernières fassent l’objet, dans les mêmes conditions, d’un enregistrement audiovisuel. |
1° La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « lorsque la cour d’assises statue en appel, sauf renonciation expresse de l’ensemble des accusés ; lorsque la cour d’assises statue en premier ressort, le président peut, d’office ou à la demande du ministère public ou des parties, ordonner cet enregistrement » ; | |
Les supports de cet enregistrement sont placés sous scellés et déposés au greffe de la cour d’assises. |
||
L’enregistrement sonore audiovisuel peut être utilisé devant la cour d’assises, jusqu’au prononcé de l’arrêt ; s’il l’est au cours de la délibération, les formalités prévues au troisième alinéa de l’article 347 sont applicables. L’enregistrement sonore ou audiovisuel peut également être utilisé devant la cour d’assises statuant en appel, devant la cour de révision et de réexamen saisie d’une demande en révision, ou, après cassation ou annulation sur demande en révision, devant la juridiction de renvoi. |
||
Les scellés sont ouverts par le premier président ou par un magistrat délégué par lui, en présence du condamné assisté de son avocat, ou eux dûment appelés, ou en présence de l’une des personnes visées au 4° de l’article 622-2, ou elles dûment appelées. |
||
Après présentation des scellés, le premier président fait procéder par un expert à une transcription de l’enregistrement qui est jointe au dossier de la procédure. |
2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé : | |
Les dispositions ci-dessus ne sont pas prescrites à peine de nullité de la procédure. |
« Les dispositions du présent article ne sont pas prescrites à peine de nullité de la procédure ; toutefois, le défaut d’enregistrement sonore, lorsqu’il est obligatoire en application du deuxième alinéa, constitue une cause de cassation de l’arrêt de condamnation s’il est établi qu’il a eu effet de porter atteinte aux intérêts du demandeur au pourvoi. » | |
II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er septembre 2016. amendement CL333 | ||
Article 31 decies (nouveau) | ||
Le code de procédure pénale est ainsi modifié : | ||
1° Le premier alinéa de l’article 354 est complété par une phrase ainsi rédigée : | ||
Art. 354. – Le président fait retirer l’accusé de la salle d’audience. Si l’accusé est libre, il lui enjoint de ne pas quitter le palais de justice pendant la durée du délibéré, en indiquant, le cas échéant, le ou les locaux dans lesquels il doit demeurer, et invite le chef du service d’ordre à veiller au respect de cette injonction. |
« Si la longueur prévisible du délibéré le justifie, le président peut désigner tout lieu hors du palais de justice comme local dans lequel l’accusé devra demeurer. » ; | |
Il invite le chef du service d’ordre à faire garder les issues de la chambre des délibérations, dans laquelle nul ne pourra pénétrer, pour quelque cause que ce soit, sans autorisation du président. |
||
Le président déclare l’audience suspendue. |
||
Art. 355. – Les magistrats de la cour et les jurés se retirent dans la chambre des délibérations. |
||
Ils n’en peuvent sortir qu’après avoir pris leurs décisions. |
||
2° L’article 355 est complété par un alinéa ainsi rédigé : | ||
« Si la longueur prévisible du délibéré le justifie, le président peut désigner tout lieu hors du palais de justice comme chambre des délibérations. » amendement CL225 | ||
Article 31 undecies (nouveau) | ||
Art. 379-2. – L’accusé absent sans excuse valable à l’ouverture de l’audience est jugé par défaut conformément aux dispositions du présent chapitre. Il en est de même lorsque l’absence de l’accusé est constatée au cours des débats et qu’il n’est pas possible de les suspendre jusqu’à son retour. |
Le titre Ier du livre II du code de procédure pénale est ainsi modifié : | |
Toutefois, la cour peut également décider de renvoyer l’affaire à une session ultérieure, après avoir décerné mandat d’arrêt contre l’accusé si un tel mandat n’a pas déjà été décerné. |
1° Le dernier alinéa de l’article 379-2 est complété par deux phrases ainsi rédigées : | |
Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables dans les cas prévus par les articles 320 et 322. |
« Elles ne sont pas non plus applicables si l’absence du condamné au cours des débats est constatée alors que les interrogatoires de l’accusé sur les faits et sur sa personnalité ont déjà été réalisés ; dans ce cas, le procès se poursuit jusqu’à son terme, conformément aux articles 306 à 379-1, à l’exception des dispositions relatives à la présence de l’accusé, son avocat continuant d’assurer la défense de ses intérêts ; si l’accusé est condamné à une peine ferme privative de liberté non couverte par la détention provisoire, la cour décerne mandat d’arrêt contre l’accusé, sauf si ce mandat a déjà été décerné. Les délais d’appel ou de pourvoi en cassation courent à partir de la date à laquelle l’arrêt est porté à la connaissance de l’accusé. » ; | |
2° Le chapitre VIII est complété par un article 379-7 ainsi rédigé : | ||
« Art. 379-7. – Le présent chapitre n’est pas applicable lorsque l’absence de l’accusé, sans excuse valable, est constatée à l’ouverture de l’audience ou, à tout moment, au cours des débats, devant la cour d’assises désignée à la suite de l’appel formé par l’accusé. | ||
« Dans ce cas, le procès se déroule ou se poursuit jusqu’à son terme, conformément aux articles 306 à 379-1, à l’exception des dispositions relatives à l’interrogatoire et à la présence de l’accusé, en présence de l’avocat de l’accusé qui assure la défense de ses intérêts. | ||
« Si l’accusé est condamné à une peine ferme privative de liberté non couverte par la détention provisoire, la cour décerne mandat d’arrêt contre l’accusé, sauf si ce mandat a déjà été décerné. | ||
« Le délai de pourvoi en cassation court à partir de la date à laquelle l’arrêt est porté à la connaissance de l’accusé. » ; | ||
Art. 380-1. – Les arrêts de condamnation rendus par la cour d’assises en premier ressort peuvent faire l’objet d’un appel dans les conditions prévues par le présent chapitre. |
||
Cet appel est porté devant une autre cour d’assises désignée par la chambre criminelle de la Cour de cassation et qui procède au réexamen de l’affaire selon les modalités et dans les conditions prévues par les chapitres II à VII du présent titre. |
3° Au second alinéa de l’article 380-1, la référence : « VII » est remplacée par la référence : « VIII ». amendement CL358 | |
Article 31 duodecies (nouveau) | ||
Le code de procédure pénale est ainsi modifié : | ||
1° Les trois premiers alinéas de l’article 380-14 sont ainsi rédigés : | ||
Art. 380-14. – Dès que l’appel a été enregistré, le ministère public adresse sans délai au greffe de la chambre criminelle de la Cour de cassation, avec ses observations éventuelles, la décision attaquée et, le cas échéant, le dossier de la procédure. |
« Après avoir recueilli les observations écrites du ministère public et des parties ou de leurs avocats, le premier président de la cour d’appel désigne la cour d’assises chargée de statuer en appel parmi les autres cours d’assises du ressort de la cour d’appel. | |
Dans le mois qui suit la réception de l’appel, la chambre criminelle, après avoir recueilli les observations écrites du ministère public et des parties ou de leurs avocats, désigne la cour d’assises chargée de statuer en appel. |
« Toutefois, si le ministère public ou l’une des parties le demande ou si le premier président estime nécessaire la désignation d’une cour d’assises située hors de ce ressort, le ministère public adresse sans délai au greffe de la chambre criminelle de la Cour de cassation, avec ses observations éventuelles et celles des parties, l’arrêt attaquée et, le cas échéant, le dossier de la procédure. | |
Il est alors procédé comme en cas de renvoi après cassation. |
« Dans le mois qui suit la réception de l’appel, la chambre criminelle, après avoir recueilli, si elles n’ont pas déjà été données, les observations écrites du ministère public et des parties ou de leurs avocats, désigne la cour d’assises chargée de statuer en appel. Il est alors procédé comme en cas de renvoi après cassation. » ; | |
Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 380-1, en cas d’appel d’une décision de la cour d’assises d’un département d’outre-mer, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis et Futuna, la chambre criminelle peut désigner la même cour d’assises, autrement composée, pour connaître de l’appel. Les dispositions du présent alinéa sont également applicables en cas d’appel des décisions de la cour d’assises de Mayotte ou du tribunal criminel de Saint-Pierre-et-Miquelon. En cas de vacance de poste, d’absence, d’empêchement ou d’incompatibilité légale, les fonctions de président de la juridiction criminelle statuant en appel et, le cas échéant, des magistrats assesseurs qui la composent, sont exercées par des conseillers désignés, sur une liste arrêtée pour chaque année civile, par le premier président de la cour d’appel de Paris, ou, pour la cour d’assises de Mayotte, par le premier président de la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion. |
||
2° L’article 380-15 est ainsi rédigé : | ||
Art. 380-15. – Si la chambre criminelle de la Cour de cassation constate que l’appel n’a pas été formé dans les délais prévus par la loi ou porte sur un arrêt qui n’est pas susceptible d’appel, elle dit n’y avoir pas lieu à désignation d’une cour d’assises chargée de statuer en appel. |
« Art. 380-15. – Si l’appel n’a pas été formé dans les délais prévus par la loi ou porte sur un arrêt qui n’est pas susceptible d’appel, le premier président de la cour d’appel ou le président de la chambre criminelle de la Cour de cassation dit n’y avoir pas lieu à désignation d’une cour d’assises chargée de statuer en appel. » ; | |
|
Art. 500-1. – Lorsqu’il intervient dans un délai d’un mois à compter de l’appel, le désistement par le prévenu ou la partie civile de son appel principal entraîne la caducité des appels incidents, y compris celui du ministère public si ce désistement intervient dans les formes prévues pour la déclaration d’appel. Constitue un appel incident l’appel formé dans le délai prévu par l’article 500, ainsi que l’appel formé, à la suite d’un précédent appel, dans les délais prévus par les articles 498 ou 505, lorsque l’appelant précise qu’il s’agit d’un appel incident. Dans tous les cas, le ministère public peut toujours se désister de son appel formé après celui du prévenu en cas de désistement de celui-ci. Le désistement d’appel est constaté par ordonnance du président de la chambre des appels correctionnels. |
3° Au début de la première phrase de l’article 500-1, les mots : « Lorsqu’il intervient dans un délai d’un mois à compter de l’appel » sont remplacés par les mots : « Sauf lorsqu’il intervient moins de deux mois avant la date de l’audience devant la cour d’appel » ; | |
Art. 502. – La déclaration d’appel doit être faite au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée. |
||
4° Après le premier alinéa de l’article 502, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : | ||
« La déclaration peut indiquer que l’appel est limité aux peines prononcées, à certaines d’entre elles ou à leurs modalités d’application. » ; | ||
Elle doit être signée par le greffier et par l’appelant lui-même, ou par un avocat, ou par un fondé de pouvoir spécial ; dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé à l’acte dressé par le greffier. Si l’appelant ne peut signer, il en sera fait mention par le greffier. |
||
Elle est inscrite sur un registre public à ce destiné et toute personne a le droit de s’en faire délivrer une copie. |
||
Art. 505-1. – Lorsqu’il est fait appel après expiration des délais prévus aux articles 498, 500 ou 505, lorsque l’appel est devenu sans objet ou lorsque l’appelant s’est désisté de son appel, le président de la chambre des appels correctionnels rend d’office une ordonnance de non-admission de l’appel qui n’est pas susceptible de voies de recours. |
5° À l’article 505-1, après le mot « objet », sont insérés les mots : « , qu’il a été formé sans respecter les formalités prévues à l’article 502 ou qu’il a été formé hors les cas mentionnés à l’article 546 ». amendement CL360 | |
Article 31 terdecies (nouveau) | ||
Art. 394. – Le procureur de la République peut inviter la personne déférée à comparaître devant le tribunal dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours, sauf renonciation expresse de l’intéressé en présence de son avocat, ni supérieur à deux mois. Il lui notifie les faits retenus à son encontre ainsi que le lieu, la date et l’heure de l’audience. Il informe également le prévenu qu’il doit comparaître à l’audience en possession des justificatifs de ses revenus ainsi que de ses avis d’imposition ou de non-imposition. Cette notification, mentionnée au procès-verbal dont copie est remise sur-le-champ au prévenu, vaut citation à personne. |
À la première phrase du premier alinéa de l’article 394 du code de procédure pénale, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « six ». amendements CL156 et CL334 | |
L’avocat choisi ou le bâtonnier est informé, par tout moyen et sans délai, de la date et de l’heure de l’audience ; mention de cet avis est portée au procès-verbal. L’avocat ou la personne déférée lorsqu’elle n’est pas assistée d’un avocat peut, à tout moment, consulter le dossier. |
||
Si le procureur de la République estime nécessaire de soumettre le prévenu jusqu’à sa comparution devant le tribunal à une ou plusieurs obligations du contrôle judiciaire ou de le placer sous assignation à résidence avec surveillance électronique, il le traduit sur-le-champ devant le juge des libertés et de la détention, statuant en chambre du conseil avec l’assistance d’un greffier. Ce magistrat peut, après audition du prévenu, son avocat ayant été avisé et entendu en ses observations, s’il le demande, prononcer l’une de ces mesures dans les conditions et suivant les modalités prévues par les articles 138, 139, 142-5 et 142-6. Cette décision est notifiée verbalement au prévenu et mentionnée au procès-verbal dont copie lui est remise sur-le-champ. Si le prévenu placé sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique se soustrait aux obligations qui lui sont imposées, les dispositions du deuxième alinéa de l’article 141-2 sont applicables, ainsi que celles de l’article 141-4 ; les attributions confiées au juge d’instruction par cet article sont alors exercées par le procureur de la République. |
||
Lorsque le tribunal correctionnel a été saisi en application du présent article, il peut, à la demande des parties ou d’office, commettre par jugement l’un de ses membres ou l’un des juges d’instruction du tribunal désigné dans les conditions prévues à l’article 83 pour procéder à un supplément d’information ; l’article 463 est applicable. Le tribunal peut, dans les mêmes conditions, s’il estime que la complexité de l’affaire nécessite des investigations supplémentaires approfondies, renvoyer le dossier au procureur de la République afin que celui-ci requière l’ouverture d’une information. |
||
Article 31 quaterdecies (nouveau) | ||
Le chapitre II du titre Ier du livre III du code de procédure pénale est complété par des articles 590-1 et 590-2 ainsi rédigés : | ||
« Art. 590-1. – Le demandeur en cassation qui n’a pas constitué avocat et n’a pas déposé son mémoire dans le délai prévu à l’article 584 est déchu de son pourvoi. | ||
« Il en est de même, sauf dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, du demandeur condamné pénalement n’ayant pas constitué avocat et du ministère public qui n’ont pas fait parvenir leur mémoire au greffe de la Cour de cassation dans les délais prévus, respectivement, au premier alinéa de l’article 585-1et à l’article 585-2. | ||
« Le demandeur condamné à une peine non prévue par la loi ne peut toutefois être déchu de son pourvoi. | ||
« Art. 590-2. – La déchéance du pourvoi, dans les cas et conditions prévus aux articles 567-2, 574-1, 574-2 et 590-1, est prononcée par ordonnance du président de la chambre criminelle ou du conseiller par lui désigné. » amendement CL361 | ||
Art. 628-1. – Pour la poursuite, l’instruction et le jugement des infractions entrant dans le champ d’application de l’article 628, le procureur de la République, le pôle de l’instruction et la cour d’assises de Paris exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l’application des articles 43 et 52. |
||
En ce qui concerne les mineurs, le procureur de la République, le pôle de l’instruction, le tribunal pour enfants et la cour d’assises des mineurs de Paris exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l’application de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante. |
Article 31 quindecies (nouveau) | |
Lorsqu’ils sont compétents pour la poursuite et l’instruction des infractions entrant dans le champ d’application de l’article 628, le procureur de la République et le pôle de l’instruction de Paris exercent leurs attributions sur toute l’étendue du territoire national. |
L’article 628-1 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé : | |
« Par dérogation au second alinéa de l’article 380-1, en cas d’appel d’un arrêt de la cour d’assises de Paris compétente en application du présent article, le premier président de la cour d’appel de Paris ou la chambre criminelle de la Cour de cassation peut désigner cette même cour d’assises, autrement composée, pour connaître de l’appel. » amendement CL362 | ||
Article 31 sexdecies (nouveau) | ||
Art. 665. – Le renvoi d’une affaire d’une juridiction à une autre peut être ordonné pour cause de sûreté publique par la chambre criminelle, mais seulement à la requête du procureur général près la Cour de cassation. |
||
Le renvoi peut également être ordonné, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, par la chambre criminelle, soit sur requête du procureur général près la Cour de cassation, soit sur requête du procureur général près la cour d’appel dans le ressort de laquelle la juridiction saisie a son siège, agissant d’initiative ou sur demande des parties. |
||
La requête mentionnée au deuxième alinéa doit être signifiée à toutes les parties intéressées, qui ont un délai de huit jours pour déposer un mémoire au greffe de la Cour de cassation. |
Au troisième alinéa de l’article 665 du code de procédure pénale, les mots : « de huit jours » sont remplacés par les mots : « d’un mois ». amendement CL335 | |
Dans les dix jours de la réception de la demande et s’il n’y donne pas suite, le procureur général près la cour d’appel informe le demandeur des motifs de sa décision. Ce dernier peut alors former un recours devant le procureur général près la Cour de cassation qui, s’il ne saisit pas la chambre criminelle l’informe des motifs de sa décision. |
||
La chambre criminelle statue dans les huit jours de la requête. |
||
Art. 712-17. – Le juge de l’application des peines peut délivrer un mandat d’amener contre un condamné placé sous son contrôle en cas d’inobservation par ce dernier des obligations qui lui incombent. |
||
Si le condamné est en fuite ou réside à l’étranger, il peut délivrer un mandat d’arrêt. La délivrance du mandat d’arrêt suspend, jusqu’à son exécution, le délai d’exécution de la peine ou des mesures d’aménagement. |
||
En cas d’urgence et d’empêchement du juge de l’application des peines ainsi que du magistrat du siège qui le remplace, le mandat d’amener peut être délivré par le procureur de la République qui en informe dès que possible le juge de l’application des peines ; lorsqu’il n’a pas déjà été mis à exécution, ce mandat est caduc s’il n’est pas repris, dans le premier jour ouvrable qui suit, par le juge de l’application des peines. |
||
Si la personne est découverte, il est procédé conformément aux dispositions ci-après. |
||
Le procureur de la République du lieu de l’arrestation est avisé dès le début de la rétention de la personne par les services de police ou de gendarmerie. Pendant la rétention, qui ne peut durer plus de vingt-quatre heures, il est fait application des dispositions des articles 63-2 et 63-3. |
||
La personne est conduite dans les meilleurs délais, et au plus tard dans les vingt-quatre heures de son arrestation, devant le procureur de la République du tribunal de grande instance dans le ressort duquel siège le juge de l’application des peines compétent. Après avoir vérifié son identité et lui avoir notifié le mandat, ce magistrat la présente devant le juge de l’application des peines qui procède conformément aux dispositions de l’article 712-6. |
||
Si la présentation immédiate devant le juge de l’application des peines n’est pas possible, la personne est présentée devant le juge des libertés et de la détention. Ce juge peut, sur les réquisitions du procureur de la République, ordonner l’incarcération du condamné jusqu’à sa comparution, selon les cas, devant le juge de l’application des peines, qui doit intervenir dans un délai maximal de huit jours, ou devant le tribunal de l’application des peines, qui doit intervenir dans un délai maximal d’un mois. |
Article 31 septdecies (nouveau) | |
Si la personne est arrêtée à plus de 200 kilomètres du siège du juge de l’application des peines et qu’il n’est pas possible de la conduire dans le délai de vingt-quatre heures devant le procureur de la République compétent en vertu du sixième alinéa, elle est conduite devant le procureur de la République du lieu de son arrestation, qui vérifie son identité, lui notifie le mandat et reçoit ses éventuelles déclarations après l’avoir avertie qu’elle est libre de ne pas en faire. Ce magistrat met alors le mandat à exécution en faisant conduire la personne à la maison d’arrêt ; il en avise le juge de l’application des peines ayant délivré le mandat. Celui-ci ordonne le transfèrement de la personne, qui doit comparaître devant lui dans les quatre jours de la notification du mandat ; ce délai est porté à six jours en cas de transfèrement entre un département d’outre-mer et la France métropolitaine ou un autre département d’outre-mer. |
L’article 712-17 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé : | |
« Les comparutions devant le juge de l’application des peines ou le tribunal de l’application des peines prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article peuvent être réalisées selon les modalités prévues à l’article 706-71. Il n’y a alors pas lieu d’ordonner le transfèrement de la personne mentionné à l’avant-dernier alinéa du présent article. » amendement CL357 | ||
Article 31 octodecies (nouveau) | ||
Le titre Ier bis du livre V du code de procédure pénale est complété par un article 713-49 ainsi rédigé : | ||
« Art. 713-49. – Les décisions prises en application du deuxième alinéa de l’article 713-47 ou de l’article 713-48 mettant à exécution tout ou partie de l’emprisonnement sont exécutoires par provision. | ||
« Lorsque le condamné interjette appel contre ces décisions, son recours est examiné dans un délai de deux mois, à défaut de quoi il est remis en liberté s’il n’est pas détenu pour une autre cause. » amendement CL336 | ||
TITRE III |
TITRE III | |
DISPOSITIONS DIVERSES |
DISPOSITIONS DIVERSES | |
Chapitre Ier A | ||
Dispositions relatives aux peines (Division et intitulé nouveau) amendement CL365 | ||
Code pénal |
Article 32 A (nouveau) | |
Art. 131-5-1. – Lorsqu’un délit est puni d’une peine d’emprisonnement, la juridiction peut, à la place de l’emprisonnement, prescrire que le condamné devra accomplir un stage de citoyenneté, dont les modalités, la durée et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat, et qui a pour objet de lui rappeler les valeurs républicaines de tolérance et de respect de la dignité humaine sur lesquelles est fondée la société. La juridiction précise si ce stage, dont le coût ne peut excéder celui des amendes contraventionnelles de la troisième classe, doit être effectué aux frais du condamné. |
Le second alinéa de l’article 131-5-1 du code pénal est complété par une phrase ainsi rédigée : | |
Cette peine ne peut être prononcée contre le prévenu qui la refuse ou n’est pas présent à l’audience. |
« Toutefois, cette peine peut être prononcée lorsque le prévenu, absent à l’audience, a fait connaître par écrit son accord et qu’il est représenté par son avocat. » amendement CL324 | |
Article 32 B (nouveau) | ||
Art. 131-8. – Lorsqu’un délit est puni d’une peine d’emprisonnement, la juridiction peut prescrire, à la place de l’emprisonnement, que le condamné accomplira, pour une durée de vingt à deux cent quatre-vingts heures, un travail d’intérêt général non rémunéré au profit soit d’une personne morale de droit public, soit d’une personne morale de droit privé chargée d’une mission de service public ou d’une association habilitées à mettre en oeuvre des travaux d’intérêt général. |
||
La peine de travail d’intérêt général ne peut être prononcée contre le prévenu qui la refuse ou qui n’est pas présent à l’audience. Le président du tribunal, avant le prononcé du jugement, informe le prévenu de son droit de refuser l’accomplissement d’un travail d’intérêt général et reçoit sa réponse. |
||
L’article 131-8 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé : | ||
« La peine de travail d’intérêt général peut également être prononcée lorsque le prévenu, absent à l’audience, a fait connaître par écrit son accord et qu’il est représenté par son avocat. » amendement CL323 | ||
Article 32 C (nouveau) | ||
Après l’article 131-35-1 du code pénal, il est inséré un article 131-35-2 ainsi rédigé : | ||
« Art. 131-35-2. – Lorsqu’une peine consiste dans l’obligation d’accomplir un stage, la durée de celui-ci ne peut excéder un mois et son coût, s’il est à la charge du condamné, ne peut excéder le montant de l’amende encourue pour les contraventions de la troisième classe. » amendement CL226 | ||
Article 32 D (nouveau) | ||
Art. 132-54. – La juridiction peut, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 132-40 et 132-41, prévoir que le condamné accomplira, pour une durée de vingt à deux cent quatre-vingts heures, un travail d’intérêt général non rémunéré au profit soit d’une personne morale de droit public, soit d’une personne morale de droit privé chargée d’une mission de service public ou d’une association habilitées à mettre en œuvre des travaux d’intérêt général. |
||
La juridiction peut en outre soumettre le condamné à tout ou partie des obligations prévues à l’article 132-45 pour une durée qui ne peut excéder dix-huit mois. L’exécution du travail d’intérêt général avant la fin de ce délai ne met pas fin à ces obligations. |
Le troisième alinéa de l’article 132-54 du code pénal est complété par une phrase ainsi rédigée : | |
Le sursis assorti de l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général ne peut être ordonné lorsque le prévenu le refuse ou n’est pas présent à l’audience. |
« Toutefois, ce sursis peut être ordonné lorsque le prévenu, absent à l’audience, a fait connaître par écrit son accord et qu’il est représenté par son avocat. » amendement CL326 | |
Les modalités d’application de l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général sont régies par les dispositions des articles 131-22 à 131-24. Dès l’accomplissement de la totalité du travail d’intérêt général, la condamnation est considérée comme non avenue sauf s’il a été fait application des dispositions prévues au dernier alinéa de l’article 132-55. |
||
Chapitre Ier |
Chapitre Ier | |
Caméras |
Caméras mobiles amendement CL366 | |
Article 32 |
Article 32 | |
Il est rétabli un titre IV dans le livre II du code de la sécurité intérieure ainsi rédigé : |
(Alinéa sans modification) | |
« TITRE IV |
(Alinéa sans modification) | |
« CAMÉRAS |
« CAMÉRAS MOBILES amendement CL341 | |
« Chapitre unique |
(Alinéa sans modification) | |
« Art. L. 241-1. – Dans l’exercice de leurs missions de prévention des atteintes à l’ordre public et de protection de la sécurité des personnes et des biens ainsi que de leurs missions de police judiciaire, les agents de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale peuvent procéder en tous lieux, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions. |
« Art. L. 241-1. – (Alinéa sans modification) | |
« L’enregistrement n’est pas permanent. Il est déclenché lorsqu’un incident se produit ou, eu égard aux circonstances de l’intervention ou du comportement des personnes concernées, est susceptible de se produire. |
« L’enregistrement n’est pas permanent. Il est déclenché lorsqu’un incident se produit ou, eu égard aux circonstances de l’intervention ou du comportement des personnes concernées, est susceptible de se produire. Il est également déclenché à la demande des personnes concernées par les interventions des agents de la police nationale et des militaires de la gendarmerie nationale. amendement CL153 | |
« Les enregistrements ont pour finalités la prévention des incidents au cours des interventions des agents de la police nationale et des militaires de la gendarmerie nationale, le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves, le respect par les agents et militaires |
« Les enregistrements ont pour finalités la prévention des incidents au cours des interventions des agents de la police nationale et des militaires de la gendarmerie nationale, le constat des infractions, la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves, le respect par les agents et militaires de leurs obligations et la formation de ces agents et militaires. amendement CL342 | |
« Les caméras sont portées de façon apparente par les agents et les militaires. Un signal visuel spécifique indique si la caméra enregistre. Le déclenchement de l’enregistrement fait l’objet d’une information des personnes |
« Les caméras sont portées de façon apparente par les agents et les militaires. Un signal visuel spécifique indique si la caméra enregistre. Le déclenchement de l’enregistrement fait l’objet d’une information des personnes filmées, sauf si les circonstances l’interdisent. Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par le ministre de l’intérieur. Les personnels auxquels les caméras individuelles sont fournies ne peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent. amendement CL343 | |
« Les enregistrements audiovisuels, hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout de six mois. |
(Alinéa sans modification) | |
« Les modalités d’application du présent article et d’utilisation des données collectées sont précisées par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. » |
(Alinéa sans modification) | |
Chapitre II |
Chapitre II | |
Habilitation à légiférer par ordonnances |
Habilitation à légiférer par ordonnances | |
Article 33 |
Article 33 | |
I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin de : |
I. – (Alinéa sans modification) | |
1° Transposer la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission et adopter toute mesure de coordination et d’adaptation rendue nécessaire |
1° Transposer la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission et adopter toute mesure de coordination et d’adaptation rendue nécessaire en vue de rendre plus efficace la législation relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ; amendement CL344 | |
2° Définir les modalités d’assujettissement aux mesures de prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, de contrôle et de sanction de certaines professions et catégories d’entreprises autres que les entités visées à l’article 2 de la directive mentionnée au 1° ; |
2° (Sans modification) | |
3° Mettre la loi en conformité avec le règlement (UE) 2015/847 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 sur les informations accompagnant les transferts de fonds et abrogeant le règlement (CE) n° 1781/2006 et adopter toute mesure de coordination et d’adaptation rendue nécessaire ; |
3° (Sans modification) | |
4° Modifier les règles relatives à l’organisation et au fonctionnement de la commission mentionnée à l’article L. 561-38 du code monétaire et financier, en vue notamment de renforcer les garanties offertes aux personnes mises en cause et d’adapter la procédure applicable devant la commission ; |
4° (Sans modification) | |
5° Modifier les règles |
5° Modifier les règles figurant aux chapitres Ier et II du titre VI du livre V et au chapitre IV du titre Ier du livre VII du code monétaire et financier, en vue notamment d’étendre le champ des avoirs susceptibles d’être gelés et la définition des personnes assujetties au respect des mesures de gel et d’interdiction de mise à disposition des fonds, d’étendre le champ des échanges d’informations nécessaires à la préparation et à la mise en œuvre des mesures de gel et de préciser les modalités de déblocage des avoirs gelés ; amendement CL345 | |
6° Garantir la confidentialité des informations reçues et détenues par le service mentionné à l’article L. 561-23 du code monétaire et financier et élargir les possibilités pour ce service de recevoir et de communiquer des informations ; |
6° (Sans modification) | |
7° Apporter les corrections formelles et adaptations nécessaires à la simplification, la cohérence et l’intelligibilité du titre VI du livre V du code monétaire et financier ; |
7° (Sans modification) | |
8° |
8° Rendre applicables dans les îles Wallis et Futuna et, le cas échéant, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, avec les adaptations nécessaires, les articles du code monétaire et financier et, le cas échéant, d’autres dispositions législatives dans leur rédaction résultant des ordonnances prises en application des 1° à 7° ; amendement CL346 | |
8° bis (nouveau) Procéder aux adaptations nécessaires à l’application à Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon et Mayotte des dispositions législatives résultant des ordonnances prises en application des 1° à 7° ; amendement CL346 | ||
9° Rendre applicables dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, le cas échéant, les articles du code monétaire et financier et d’autres |
9° Rendre applicables dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, le cas échéant, les articles du code monétaire et financier et d’autres dispositions législatives relatives au gel des avoirs, à la lutte contre le blanchiment et à la lutte contre le financement du terrorisme, dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de cette ordonnance ; amendement CL347 | |
10° Rendre applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, à Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon, avec les adaptations nécessaires, les dispositions du règlement (UE) 2015/847 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 |
10° Rendre applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon, avec les adaptations nécessaires, les dispositions du règlement (UE) 2015/847 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 précité et les dispositions nécessaires à la coordination et à l’adaptation de la législation prises en application du 3°. amendement CL348 | |
II. – Le Gouvernement est également autorisé, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, à adopter par ordonnance les mesures |
II. – Le Gouvernement est également autorisé, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, à adopter par ordonnances les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour : amendement CL349 | |
|
1° Supprimé amendement CL350 | |
2° Transposer la directive 2014/41/UE du parlement européen et du conseil du 3 avril 2014 concernant la décision d’enquête européenne en matière pénale ; |
2° (Sans modification) | |
|
3° Supprimé amendement CL350 | |
|
||
|
||
|
||
|
||
|
4° Supprimé amendement CL350 | |
|
5° Supprimé amendement CL350 | |
|
6° Supprimé amendement CL350 | |
|
7° Supprimé amendement CL350 | |
|
8° Supprimé amendement CL350 | |
III. – Les ordonnances prévues aux I et II sont prises dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi. |
III. – (Sans modification) | |
IV. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de quatre mois à compter de la publication de |
IV. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de quatre mois à compter de la publication de chaque ordonnance. amendement CL351 | |
Chapitre III |
Chapitre III | |
|
Dispositions relatives aux outre-mer amendement CL352 | |
Article 34 |
Article 34 | |
I. – La présente loi est applicable sur l’ensemble du territoire de la République. |
I. – (Sans modification) | |
Code de la sécurité intérieure |
II. – Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié : |
II. – (Alinéa sans modification) |
Art. L. 287-1. – Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions suivantes : |
||
1° Au titre Ier : les articles L. 211-1 à L. 211-9, L. 211-11, L. 211-12, L. 211-15 et L. 211-16, L. 212-1, L. 213-1, L. 214-1 à L. 214-4 ; |
1° Au 1° de l’article L. 287-1, après les mots : « L. 211-11, » sont insérés les mots : « L. 211-11-1, » et, au 1° de chacun des articles L. 285-1, L. 286-1 et L. 287-1, après les mots : « L. 214-4 », sont insérés les mots : « dans leur rédaction résultant de la loi n° du renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale » ; |
1° (Sans modification) |
2° Au titre II : les articles L. 221-1, L. 222-1, L. 222-3, L. 223-1 à L. 223-9 et L. 224-1 ; |
||
3° Le titre III ; |
||
4° (Abrogé) |
||
5° Le titre V ; |
||
6° Au titre VI : l’article L. 262-1 ; |
||
7° Au titre VII : l’article L. 271-1. |
||
Art. L. 285-1. – Sont applicables en Polynésie française les dispositions suivantes : |
||
1° Au titre Ier : les articles L. 211-1 à L. 211-12, L. 211-15, L. 211-16, L. 212-1, L. 213-1, L. 214-1 à L. 214-4 ; |
||
2° Au titre II : les articles L. 221-1, L. 222-1, L. 222-3, L. 223-1 à L. 223-9 et L. 224-1 ; |
2° Au 2° de chacun des articles L. 285-1, L. 286-1, L. 287-1et L. 288-1, les mots : « et L. 224-1 » sont remplacés par les mots : « , L. 224-1 et L. 225-1 à L. 225-6 dans leur rédaction résultant de la loi n° du renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale » ; |
2° (Sans modification) |
3° Le titre III ; |
||
4° (Abrogé) |
||
5° Le titre V ; |
||
6° Au titre VI : l’article L. 262-1 ; |
||
7° Au titre VII : l’article L. 271-1. |
||
Art. L. 286-1. – Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions suivantes : |
||
1° Au titre Ier : les articles L. 211-1 à L. 211-12, L. 211-15, L. 211-16, L. 212-1, L. 213-1, L. 214-1 à L. 214-4 ; |
||
2° Au titre II : les articles L. 221-1, L. 222-1, L. 222-3, L. 223-1 à L. 223-9 et L. 224-1 ; |
||
3° Le titre III ; |
||
4° (Abrogé) |
||
5° Le titre V ; |
||
6° Au titre VI : l’article L. 262-1 ; |
||
7° Au titre VII : l’article L. 271-1. |
||
Art. L. 287-1. – Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions suivantes : |
||
1° Au titre Ier : les articles L. 211-1 à L. 211-9, L. 211-11, L. 211-12, L. 211-15 et L. 211-16, L. 212-1, L. 213-1, L. 214-1 à L. 214-4 ; |
||
2° Au titre II : les articles L. 221-1, L. 222-1, L. 222-3, L. 223-1 à L. 223-9 et L. 224-1 ; |
||
3° Le titre III ; |
||
4° (Abrogé) |
||
5° Le titre V ; |
||
6° Au titre VI : l’article L. 262-1 ; |
||
7° Au titre VII : l’article L. 271-1. |
||
Art. L. 288-1. – Sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises les dispositions suivantes : |
||
1° Au titre Ier : les articles L. 211-5 à L. 211-9, L. 211-11, L. 211-12, L. 211-15, L. 211-16, L. 214-1 à L. 214-3 ; |
||
2° Au titre II : les articles L. 222-1, L. 223-1 à L. 223-9 et L. 224-1 ; |
||
3° Au titre III : les articles L. 232-1 à L. 232-8, L. 234-1 à L. 234-3 ; |
||
4° Le titre V. |
||
Art. L. 285-1 – Sont applicables en Polynésie française les dispositions suivantes : |
||
1° Au titre Ier : les articles L. 211-1 à L. 211-12, L. 211-15, L. 211-16, L. 212-1, L. 213-1, L. 214-1 à L. 214-4 ; |
||
2° Au titre II : les articles L. 221-1, L. 222-1, L. 222-3, L. 223-1 à L. 223-9 et L. 224-1 ; |
||
3° Le titre III ; |
||
4° (Abrogé) |
||
|
5° Le titre V ; |
3° Au 5° des articles L. 285-1, L. 286-1 et L. 287-1, les mots : « Le titre V » sont remplacés par les mots : « Les titres IV et V » et il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : |
3° (Sans modification) |
« Les dispositions de l’article L. 241-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale. » ; |
||
6° Au titre VI : l’article L. 262-1 ; |
||
7° Au titre VII : l’article L. 271-1. |
||
Art. L. 286-1. – Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions suivantes : |
||
1° Au titre Ier : les articles L. 211-1 à L. 211-12, L. 211-15, L. 211-16, L. 212-1, L. 213-1, L. 214-1 à L. 214-4 ; |
||
2° Au titre II : les articles L. 221-1, L. 222-1, L. 222-3, L. 223-1 à L. 223-9 et L. 224-1 ; |
||
3° Le titre III ; |
||
4° (Abrogé) |
||
5° Le titre V ; |
||
6° Au titre VI : l’article L. 262-1 ; |
||
7° Au titre VII : l’article L. 271-1. |
||
Art. L. 287-1. – Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions suivantes : |
||
1° Au titre Ier : les articles L. 211-1 à L. 211-9, L. 211-11, L. 211-12, L. 211-15 et L. 211-16, L. 212-1, L. 213-1, L. 214-1 à L. 214-4 ; |
||
2° Au titre II : les articles L. 221-1, L. 222-1, L. 222-3, L. 223-1 à L. 223-9 et L. 224-1 ; |
||
3° Le titre III ; |
||
4° (Abrogé) |
||
5° Le titre V ; |
||
6° Au titre VI : l’article L. 262-1 ; |
||
7° Au titre VII : l’article L. 271-1. |
||
Art. L. 288-1. – Sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises les dispositions suivantes : |
||
1° Au titre Ier : les articles L. 211-5 à L. 211-9, L. 211-11, L. 211-12, L. 211-15, L. 211-16, L. 214-1 à L. 214-3 ; |
4° Le 1° de l’article L. 288-1 est remplacé par les dispositions suivantes : « 1° Au titre Ier : les articles L. 211-5 à L. 211-9, L. 211-11, L. 211-11-1, L. 211-12, L. 211-15, L. 211-16 et L. 214-1 à L. 214-3, dans leur rédaction résultant de la loi n° du renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale » ; |
4° (Sans modification) |
Art. L. 344-1. – Les dispositions suivantes sont applicables en Polynésie française : |
||
1° Le titre Ier ; |
5° Le 1° de chacun des articles L. 344-1, L. 345-1 et L. 346-1 est complété par les mots : « dans sa rédaction résultant de la loi n° du renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale » ; |
5° (Sans modification) |
2° Au titre II : les articles L. 322-1, L. 322-2, L. 322-2-1, L. 322-7, L. 323-1 à L. 324-1, les alinéas 1 et 2 de l’article L. 324-2, les articles L. 324-3 à L. 324-9 ; |
||
3° Au titre III : les articles L. 332-1, L. 333-1, L. 334-1 et L. 334-2. |
||
Art. L. 345-1. – Les dispositions suivantes sont applicables en Nouvelle-Calédonie : |
||
1° Le titre Ier ; |
||
2° Au titre II : les articles L. 321-5, L. 322-1 à L. 324-9. |
||
Art. L. 346-1. – Les dispositions suivantes du présent livre sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer : |
||
1° Le titre Ier ; |
||
2° Au titre II : l’article L. 321-3, les articles L. 322-1 à L. 322-4, L. 322-7, L. 323-1 à L. 324-1, les deux premiers alinéas de l’article L. 324-2 et les articles L. 324-3 à L. 324-9. |
||
Art. L. 347-1. – Les dispositions du titre Ier du présent livre sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises. |
6° À l’article L. 347-1, après les mots : « du titre Ier du présent livre », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction résultant de la loi n° du renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale » ; |
6° (Sans modification) |
|
Art. L. 445-1. – Le présent livre est applicable en Polynésie française, sous réserve des dispositions suivantes : |
7° Au premier alinéa des articles L. 445-1, L. 446-1 |
7° Au premier alinéa des articles L. 445-1, L. 446-1, L. 447-1 et L. 448-1, après le mot : « livre », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction résultant de la loi n° du renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale, ». amendement CL353 |
1° Lorsqu’ils sont exécutés en Polynésie française, le contrat de droit public des adjoints de sécurité mentionné à l’article L. 411-5 et le contrat d’accompagnement dans l’emploi mentionné à l’article L. 411-6 sont soumis, sauf stipulations expresses contraires, aux dispositions applicables localement ; |
||
2° L’article L. 411-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
||
« En Polynésie française, la réserve civile peut également être constituée par des fonctionnaires de l’État pour l’administration de la Polynésie française ayant exercé des missions de police, dans les conditions prévues par la loi n° 66-496 du 11 juillet 1966 relative à la création de corps de fonctionnaires de l’État pour l’administration de la Polynésie française. » ; |
||
3° Les articles L. 411-13, L. 411-14, L. 433-5 et L. 433-6 sont remplacés par les dispositions suivantes : |
||
« Les conditions dans lesquelles le réserviste de la police nationale et le volontaire du service volontaire citoyen de la police et de la gendarmerie nationales exercent une activité salariée pendant la période d’activité dans la réserve civile de la police nationale ou dans le service volontaire citoyen de la police et de la gendarmerie nationales sont fixées par une convention conclue entre l’autorité localement compétente et le haut-commissaire de la République en Polynésie française. » ; |
||
4° Pour l’application de l’article L. 433-2, la référence à l’article L. 314-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est remplacée par la référence à l’article 6 de l’ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française. |
||
Art. L. 446-1. – Le présent livre est applicable en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions suivantes : |
||
1° Lorsqu’ils sont exécutés en Nouvelle-Calédonie, le contrat de droit public des adjoints de sécurité mentionné à l’article L. 411-5 et le contrat d’accompagnement dans l’emploi mentionné à l’article L. 411-6 sont soumis, sauf stipulations expresses contraires, aux dispositions applicables localement ; |
||
2° Les articles L. 411-13, L. 411-14, L. 433-5 et L. 433-6 sont remplacés par les dispositions suivantes : |
||
« Les conditions dans lesquelles le réserviste de la police nationale et le volontaire du service volontaire citoyen de la police et de la gendarmerie nationales exercent une activité salariée pendant la période d’activité dans la réserve civile de la police nationale ou dans le service volontaire citoyen de la police et de la gendarmerie nationales sont fixées par une convention conclue entre l’autorité localement compétente et le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie. » ; |
||
3° Pour l’application de l’article L. 433-2, la référence à l’article L. 314-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est remplacée par la référence à l’article 6 de l’ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie. |
||
Art. L. 447-1. – Le présent livre est applicable dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions suivantes : |
||
1° Lorsqu’ils sont exécutés dans les îles Wallis et Futuna, le contrat de droit public des adjoints de sécurité mentionné à l’article L. 411-5 et le contrat d’accompagnement dans l’emploi mentionné à l’article L. 411-6 sont soumis, sauf stipulations expresses contraires, aux dispositions applicables localement ; |
||
2° Les articles L. 411-13, L. 411-14, L. 433-5 et L. 433-6 sont remplacés par les dispositions suivantes : |
||
« Les conditions dans lesquelles le réserviste de la police nationale et le volontaire du service volontaire citoyen de la police et de la gendarmerie nationales exercent une activité salariée pendant la période d’activité dans la réserve civile de la police nationale ou dans le service volontaire citoyen de la police et de la gendarmerie nationales sont fixées par une convention conclue entre l’autorité localement compétente et l’administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna. » |
||
3° Pour l’application de l’article L. 433-2, la référence à l’article L. 314-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est remplacée par la référence à l’article 6 de l’ordonnance n° 2002-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna. |
||
Code de la défense |
III. – Le code de la défense est ainsi modifié : |
III. – (Alinéa sans modification) |
Art. L. 1641-1. – Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles L. 1111-1 à L. 1333-20, L. 1411-1 à L. 1411-10 et L. 1521-1 à L. 1521-10. |
1° Dans chacun des articles L. 1641-1, L. 1651-1, L. 1661-1 et L. 1671-1 les mots : « et L. 1521-1 à L. 1521-10 » sont remplacés par les mots : « , L. 1521-1 à L. 1521-18 dans leur rédaction résultant de la loi n° du renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale » ; |
1° (Sans modification) |
Art. L. 1651-1. – Sont applicables en Polynésie française les dispositions des articles L. 1111-1 à L. 1333-20, L. 1411-1 à L. 1411-10 et L. 1521-1 à L. 1521-10. |
||
Art. L. 1661-1. – Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles L. 1111-1 à L. 1333-20, L. 1411-1 à L. 1411-10 et L. 1521-1 à L. 1521-10. |
||
Art. L. 1671-1. – Sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des stipulations du traité sur l’Antarctique publié par le décret n° 61-1300 du 30 novembre 1961, les dispositions des articles L. 1111-1 à L. 1333-20, L. 1411-1 à L. 1411-10 et L. 1521-1 à L. 1521-10. |
||
Art. L. 2441-1. – Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, les dispositions des articles L. 2113-1 à L. 2141-4, L. 2151-1 à L. 2161-3, L. 2211-1 à L. 2223-19, L. 2232-1 à L. 2236-7, L. 2311-1 à L. 2313-1, L. 2321-1 à L. 2321-3, L. 2322-1 à L. 2335-7, L. 2336-1 à L. 2353-13. |
||
Les dispositions de l’article L. 2332-6 sont applicables dans leur rédaction résultant de l’ ordonnance n° 2015-1534 du 26 novembre 2015 prise en application de l’ article 30 de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 et portant diverses dispositions concernant la défense, les anciens combattants et l’action de l’État en mer. |
||
2° Chacun des articles L. 2441-1, L. 2451-1, L. 2461-1 et L. 2471-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
2° (Sans modification) | |
« Les dispositions de l’article L. 2339-10 sont applicables dans sa rédaction résultant de la loi n° du renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale. » ; |
||
Art. L. 2451-1. – Sont applicables en Polynésie française, les dispositions des articles L. 2112-1 à L. 2161-3, L. 2211-1 à L. 2236-7, L. 2311-1 à L. 2312-8, L. 2313-4, L. 2321-1 à L. 2321-3, L. 2322-1 à L. 2335-7, L. 2336-1 à L. 2343-12, L. 2344-1 à L. 2344-11, L. 2352-2, L. 2353-4, L. 2353-11 à L. 2353-13. |
||
Les dispositions de l’article L. 2332-6 sont applicables dans leur rédaction résultant de l’ ordonnance n° 2015-1534 du 26 novembre 2015 prise en application de l’ article 30 de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 et portant diverses dispositions concernant la défense, les anciens combattants et l’action de l’État en mer. |
||
Art. L. 2461-1. – Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles L. 2112-1 à L. 2161-3, L. 2211-1 à L. 2223-19, L. 2232-1 à L. 2236-7, L. 2311-1 à L. 2312-8, L. 2321-1 à L. 2321-3, L. 2322-1 à L. 2335-7, L. 2336-1 à L. 2353-13. |
||
Les dispositions de l’article L. 2332-6 sont applicables dans leur rédaction résultant de l’ordonnance n° 2015-1534 du 26 novembre 2015 prise en application de l’article 30 de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 et portant diverses dispositions concernant la défense, les anciens combattants et l’action de l’État en mer. |
||
Art. L. 2471-1. – Sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des stipulations du traité sur l’Antarctique publié par le décret n° 61-1300 du 30 novembre 1961, les dispositions des articles L. 2113-1 à L. 2141-4, L. 2151-1 à L. 2161-3, L. 2211-1 à L. 2223-19, L. 2232-1 à L. 2236-7, L. 2311-1 à L. 2313-1, L. 2321-1 à L. 2321-3, L. 2322-1 à L. 2335-7, L. 2336-1 à L. 2353-13. |
||
Les dispositions de l’article L. 2332-6 sont applicables dans leur rédaction résultant de l’ ordonnance n° 2015-1534 du 26 novembre 2015 prise en application de l’ article 30 de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 et portant diverses dispositions concernant la défense, les anciens combattants et l’action de l’État en mer. |
||
|
Art. L. 4341-1. – Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles L. 4111-1 à L. 4271-5. |
3° |
3° Les articles L. 4341-1, L. 4351-1, L. 4361-1 et L. 4371-1 sont ainsi modifiés : |
a) Au premier alinéa, après le mot : « applicables », sont insérés les mots : « , dans leur rédaction résultant de la loi n° du renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale, » ; | ||
Les articles L. 4139-1, L. 4139-2, L. 4139-4 et L. 4139-14 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 actualisant la programmation militaire pour les années 2015 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense. |
b) (nouveau) Le second alinéa est supprimé. amendement CL354 | |
Art. L. 4351-1. – Sont applicables en Polynésie française les dispositions des articles L. 4111-1 à L. 4271-5. |
||
Les articles L. 4139-1, L. 4139-2, L. 4139-4 et L. 4139-14 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 actualisant la programmation militaire pour les années 2015 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense. |
||
Art. L. 4361-1. – Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles L. 4111-1 à L. 4271-5. |
||
Les articles L. 4139-1, L. 4139-2, L. 4139-4 et L. 4139-14 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 actualisant la programmation militaire pour les années 2015 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense. |
||
Art. L. 4371-1. – Sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises les dispositions des articles L. 4111-1 à L. 4145-3. |
||
Les articles L. 4139-1, L. 4139-2, L. 4139-4 et L. 4139-14 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 actualisant la programmation militaire pour les années 2015 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense. |
||
Code monétaire et financier |
||
|
Art. L. 743-7-2. – Le chapitre V du titre Ier du livre III est applicable en Nouvelle-Calédonie. |
IV. – Dans chacun des articles L. 743-7-2, L. 753-7-2 et L. 763-7-2 du code monétaire et financier, après les mots : « Le chapitre V du titre Ier du livre III » sont insérés les mots : « dans sa rédaction résultant de la loi n° du renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale, ». |
IV. – (Sans modification) |
Art. L. 753-7-2. – Le chapitre V du titre Ier du livre III est applicable en Polynésie française. |
||
Art. L. 763-7-2. – Le chapitre V du titre Ier du livre III est applicable dans les îles Wallis et Futuna. |
||
Code de procédure pénale |
Article 35 (nouveau) | |
Art. 926-1. – Pour l’application de l’article 474 à Saint-Pierre-et-Miquelon, le président du tribunal de première instance exerce les fonctions dévolues au service pénitentiaire d’insertion et de probation. |
L’article 926-1 du code de procédure pénale est abrogé. amendement CL359 |
PRÉSENTATION DES OBSERVATIONS SUR LES DOCUMENTS RENDANT COMPTE DE L’ÉTUDE D’IMPACT
(article 86, alinéa 9, du Règlement)
En application de l’article 86, alinéa 9, du Règlement de l’Assemblée nationale, les rapports faits sur un projet de loi déposé sur le bureau de l’Assemblée « comportent en annexe un document présentant les observations qui ont été recueillies sur les documents qui rendent compte de l’étude d’impact joints au projet de loi ».
Une contribution a été reçue. Toutefois, portant sur une disposition du projet de loi et non sur l’étude d’impact, il ne revient pas à vos rapporteurs d’en présenter la synthèse.
LISTE DES PERSONNES ENTENDUES PAR LES RAPPORTEURS
MINISTÈRES ET ADMINISTRATIONS
• Direction centrale de la police judiciaire
— M. Éric Voulleminot, directeur central adjoint de la police judiciaire
–– M. Frédéric Trannoy, chef de la division des études et de la prospective de la sous-direction des ressources, de l’évaluation et de la stratégie
• Direction générale de la gendarmerie nationale
— Général Jean-Pierre Michel, sous-directeur de la police judiciaire
— Colonel Fabrice Bouillié, chef du bureau de la police judiciaire
• État-major des armées
— MM. François Martineau et Pierre Ferran, commissaires en chef de 1ère classe
— M. Michaël Humbert, magistrat, lieutenant-colonel
• Ministère des Finances et des comptes publics - TRACFIN
— M. Bruno Dalls, directeur
JURIDICTIONS
• Cour de cassation
— M. Bertrand Louvel, premier président
–– M. Didier Guérin, président de la chambre criminelle
–– M. Jean-Claude Marin, procureur général
— M. François Cordier, premier avocat général à la chambre criminelle
— Mme Agnès Labrégère-Delorme, secrétaire générale du parquet général
• Conférence nationale des premiers présidents de cours d’appel
— Mme Dominique Lottin, première présidente de la cour d’appel de Versailles et présidente de la Conférence
— M. Jean-François Beynel, premier président de la cour d’appel de Grenoble
• Conférence nationale des présidents de tribunaux de grande instance
— M. Benjamin Deparis, président du tribunal de grande instance du Havre
• Conférence nationale des procureurs généraux
— Mme Catherine Pignon, procureure générale près la cour d’appel d’Angers et présidente de la Conférence
–– M. Jean-Jacques Bosc, procureur général près la cour d’appel de Dijon
–– M. Paul Michel, procureur général près la cour d’appel de Grenoble
• Conférence nationale des procureurs de la République
— Mme Nathalie Becache, procureur de la République près le tribunal de grande instance de Créteil
–– M. Brice Robin, procureur de la République près le tribunal de grande instance de Marseille
• Tribunal de grande instance de Paris
–– M. François Molins, procureur de la République, et Mme Camille Hennetier, vice-procureur, chef de la section antiterroriste
–– Mme Sabine Faivre, présidente de la 16ème chambre
–– Mme Laurence Le Vert, première vice-présidente chargée de l’instruction
REPRÉSENTANTS DE MAGISTRATS
• Syndicat de la magistrature
— Mme Clarisse Taron, présidente
— Mme Laurence Blisson, secrétaire générale
• Union syndicale des magistrats
— Mme Virginie Duval, présidente
— M. Olivier Janson, secrétaire général adjoint
REPRÉSENTANTS DE POLICIERS
• Syndicat indépendant des commissaires de police – CFE-CGC
— M. Mickaël Trehen, secrétaire national
• Alliance police nationale
— MM. Stanislas Gaudon, secrétaire administratif général adjoint, Pascal Disant, chargé de mission, et Stéphane Achab, chargé de mission
• Synergie-Officiers
— Mme Isabelle Trouslard, secrétaire nationale, et M. David Alberto, conseiller technique
• Union des officiers – Force ouvrière
–– MM. Hervé Emo, secrétaire général, et Bruno Forel, conseiller technique
• Unité SGP Police – Force ouvrière
— MM. Frédéric Galea, délégué national chargé des conditions de travail, et David Spehar, délégué de l’organisation syndicale à la direction centrale de la police judiciaire pour les offices centraux
• Syndicat des cadres de la sécurité intérieure
— Mme Chantal Pons-Mesouaki, secrétaire générale adjointe, et M. Christophe Rouget, chargé de mission au bureau national
REPRÉSENTANTS D’AVOCATS
• Représentants de l’Ordre des avocats
— Conseil national des barreaux : Mme Françoise Mathe, présidente de la commission Libertés et droits de l’Homme, et Mme Géraldine Cavaillé, directrice du service juridique
— Conférence des Bâtonniers : M. Marc Absire, vice-président
— Conseil de l’ordre des avocats de Paris : MM. Dominique Attias, vice-Bâtonnière de Paris, Xavier Autain, délégué du Bâtonnier aux affaires publiques, et Mme Françoise Louis-Tréfouret, chargée des relations avec le parlement
• Syndicats d’avocats
— Association des avocats pénalistes : Mme Corinne Dreyfus-Schmidt, présidente
— Syndicat des avocats de France : MM. Florian Borg, président, et Gérard Tcholakian, membre
AUTORITÉ ADMINISTRATIVE INDÉPENDANTE
• Défenseur des droits (354)
— M. Jacques Toubon, Défenseur des droits
— Mme Annick Feltz, directrice du département de la protection des personnes
— Mme Muriel Cauvin, juriste
–– Mme France de Saint Martin, attachée parlementaire
1 () Faustin Hélie, Traité de l’instruction criminelle ou théorie du Code d’instruction criminelle, t. 1, Paris, Plon, 2ème édition, 1866, p. 4.
2 () Mission d’information sur la réforme de la procédure pénale, audition de M. Robert Gelli, directeur des affaires criminelles et des grâces, le mardi 5 janvier 2016.
3 () Adopté par le Conseil européen le 11 décembre 2009, ce programme recommandait l’élaboration d’une stratégie de sécurité intérieure pour l’Union européenne et préconisait l’adoption d’une approche fondée notamment sur la reconnaissance des droits, sur le renforcement d’Eurojust, sur la mise en cohérence des sanctions pénales et sur la poursuite de la mise en œuvre de la reconnaissance mutuelle et de la confiance mutuelle dans le domaine de la justice.
4 () Commission de modernisation de l’action publique, Refonder le ministère public, La Documentation française, novembre 2013.
5 () Groupe de travail interministériel sur la lutte contre la cybercriminalité, Protéger les internautes. Rapport sur la cybercriminalité, La Documentation française, février 2014.
6 () M. Jacques Beaume, Rapport sur la procédure pénale, La Documentation française, juillet 2014.
7 () Rapport (Sénat, n° 388, session ordinaire 2014-2015) de M. Jean-Pierre Sueur au nom de la commission d’enquête sur l’organisation et les moyens de la lutte contre les réseaux djihadistes en France et en Europe, coprésidée par Mme Nathalie Goulet et M. André Reichardt, avril 2015, pp. 28-56.
8 () Olivier Roy, « Le djihadisme est une révolte générationnelle et nihiliste », Le Monde, 25 novembre 2015.
9 () Rapport (Assemblée nationale, n° 2828, XIVe législature) de M. Patrick Mennucci au nom de la commission d’enquête sur la surveillance des filières et des individus djihadistes, présidée par M. Éric Ciotti, juin 2015, pp. 19-36.
10 () Compte rendu n° 48 du mercredi 10 février 2016.
11 () Chiffres communiqués par M. François Mollins, procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris devant le Comité de suivi de l’état d’urgence du Sénat, le 9 décembre 2015.
12 () Voir le discours de M. Manuel Valls, Premier ministre, lors de la discussion du projet de loi constitutionnelle de protection de la Nation le vendredi 5 février 2016.
13 () Loi n° 86-1020 du 9 septembre 1986 relative à la lutte contre le terrorisme.
14 () Loi n° 96-647 du 22 juillet 1996 tendant à renforcer la répression du terrorisme et des atteintes aux personnes dépositaires de l’autorité publique ou chargées d’une mission de service public et comportant des dispositions relatives à la police judiciaire.
15 () Loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers.
16 () Loi n° 2011-392 du 14 avril 2011 relative à la garde à vue.
17 () Loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative.
18 () Loi n° 2012-1432 du 21 décembre 2012 relative à la sécurité et à la lutte contre le terrorisme.
19 () Sénat, M. Jean-Pierre Sueur, rapport fait au nom de la commission d’enquête sur les moyens de la lutte contre les réseaux djihadistes n° 388, avril 2015.
20 () Journal officiel – Assemblée nationale, question écrite, n° 34204, p. 2372, 10 mars 2009.
21 () Les trois premiers alinéas de l’article 30 du code de procédure pénale indiquent :
« Le ministre de la justice conduit la politique pénale déterminée par le Gouvernement. Il veille à la cohérence de son application sur le territoire de la République.
À cette fin, il adresse aux magistrats du ministère public des instructions générales.
Il ne peut leur adresser aucune instruction dans des affaires individuelles. »
Avant la réforme de 2013, le même article prévoyait que le ministre de la justice pouvait enjoindre au procureur général « d’engager ou de faire engager des poursuites ou de saisir la juridiction compétente de telles réquisitions écrites que le ministre juge opportunes ».
22 () Article 33 du code de procédure pénale, toujours en vigueur pour ce qui concerne les instructions données par le procureur général au procureur de la République. De là l’adage : « la plume est serve mais la parole est libre ».
23 () CEDH, 11 octobre 2012, Abdelali c. France, req. n° 43353/07. L’arrêt s’inscrit dans une longue lignée de décisions similaires : « La Cour a fréquemment rappelé que les garanties de l’article 6 pouvaient s’appliquer à l’ensemble de la procédure y compris aux phases de l’instruction préliminaire et de l’instruction judiciaire. »
24 () CEDH, 24 novembre 1993, Imbrioscia c. Suisse, req. n° 13972/88.
25 () Pour les crimes et délits de droit commun, le recours aux écoutes n’est possible que dans le cadre d’une instruction.
26 () Voir l’article 14 du projet de loi organique relatif aux garanties statutaires, aux obligations déontologiques et au recrutement des magistrats ainsi qu’au Conseil supérieur de la magistrature, adopté par le Sénat en première lecture le 4 novembre 2015.
27 () Article 79 du code de procédure pénale.
28 () En vertu de la circulaire du 5 décembre 2014 de présentation de la loi n° 2014-135 renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme – Renforcement de la coordination de la lutte antiterroriste, NOR : JUSD1429083C.
29 () Ordonnance n° 2004-1374 du 20 décembre 2004 relative à la partie législative du code de la défense.
30 () Loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l’établissement d’un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif.
31 () Décisions n° 2004-492 DC du 2 mars 2004, Loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, et n° 2013-679 DC du 4 décembre 2013, Loi relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière.
32 () Article 113-8 du code pénal.
33 () Groupe de travail interministériel sur la lutte contre la cybercriminalité, Protéger les internautes. Rapport sur la cybercriminalité, La Documentation française, février 2014.
34 () Loi n° 2014-1353 du 13 novembre 2014 renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme.
35 () Articles 706-75 à 706-79-1 du code de procédure pénale.
36 () Articles 706-89 à 706-94 du même code.
37 () Décisions n° 2004-492 DC du 2 mars 2004 et n° 2013-679 DC du 4 décembre 2013 précitées.
38 () Assemblée nationale, M. Patrick Mennucci, rapport de la commission d’enquête sur la surveillance des filières et des individus djihadistes, n° 2828, juin 2015.
39 () « Sauf dans le cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l’enquête et de l’instruction est secrète.
Toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines des articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
Toutefois, afin d’éviter la propagation d’informations parcellaires ou inexactes ou pour mettre fin à un trouble à l’ordre public, le procureur de la République peut, d’office et à la demande de la juridiction d’instruction ou des parties, rendre publics des éléments objectifs tirés de la procédure ne comportant aucune appréciation sur le bien-fondé des charges retenues contre les personnes mises en cause. »
40 () Voir l’avis du Défenseur des droits n° 16-04 du 12 février 2016.
41 () Décision n° 2004-492 DC du 2 mars 2004, Loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, considérant 46.
42 () Ibid, considérant 55.
43 () Ibid, considérant 56.
44 () Articles 221-1 à 221-5-1 et 221-6 à 221-6-2 du code pénal.
45 () Articles 222-1 à 222-6, 222-7 à 222-15-1, 222-19 à 222-20-2 et 222-22 à 222-31-2 du même code.
46 () Il est ainsi possible, depuis la loi n° 86-1020 du 9 septembre 1986 relative à la lutte contre le terrorisme et aux atteintes à la sûreté de l’État, de procéder à des perquisitions, visites domiciliaires et saisies, dans le cadre de l’enquête préliminaire, « sans l’assentiment de la personne concernée par ces actes » en matière de lutte contre le terrorisme.
47 () Voir l’avis du Défenseur des droits n° 16-04 du 12 février 2016.
48 () Voir supra, l’encadré sur la liste des infractions concernées par la procédure applicable à la criminalité et à la délinquance organisées au commentaire de l’article 1er.
49 () International Mobile Subscriber Identity : il s’agit d’un numéro identifiant unique contenu dans la carte SIM.
50 () Décision n° 2015-713 DC du 23 juillet 2015, Loi relative au renseignement, considérant 63.
51 () Articles 230-32 à 230-44 du code de procédure pénale.
52 () Articles 100 à 100-7 et 706-95 du même code.
53 () Article R. 226-3 du code pénal.
54 () Voir l’avis n° 16-04 du 12 février 2016 précité.
55 () Par la loi n° 2007-1598 du 13 novembre 2007 relative à la lutte contre la corruption et la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière.
56 () Il s’agit de la corruption passive et du trafic d’influence commis par une personne exerçant une fonction publique (article 432-11 du code pénal), de la corruption active et du trafic d’influence commis par un particulier (articles 433-1 et 433-2 du même code), de la corruption active ou passive d’une personne exerçant des fonctions juridictionnelles (article 434-9 du même code), du trafic d’influence en vue de l’obtention d’une décision judiciaire favorable (article 434-9-1 du même code) ainsi que de la corruption ou du trafic d’influence actifs ou passifs impliquant un agent public d’un État étranger ou d’une organisation internationale (articles 435-1 à 435-4 et 435-7 à 435-10 du même code).
57 () Compte rendu des débats de la 1ère séance du jeudi 22 mai 2003, publié au Journal officiel de la République française du vendredi 23 mai 2003.
58 () Voir supra, l’encadré sur la liste des infractions concernées par la procédure applicable à la criminalité et à la délinquance organisées au commentaire de l’article 1er.
59 () Rapport (Assemblée nationale, n° 2173, XIVe législature) de M. Sébastien Pietrasanta fait au nom de la commission des Lois sur le projet de loi renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme, p. 161.
60 () Voir supra, l’encadré sur la liste des infractions concernées par la procédure applicable à la criminalité et à la délinquance organisées au commentaire de l’article 1er.
61 () Décision n° 2004-492 DC du 2 mars 2004, Loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, considérant 6.
62 () Ibid, considérant 16.
63 () Ibid, considérant 19.
64 () La surveillance, l’infiltration, la garde à vue prolongée de 96 heures avec intervention différée de l’avocat si certaines circonstances particulières l’exigent, les écoutes téléphoniques, les sonorisations et fixations d’images, la captation de données informatiques et la possibilité d’ordonner des mesures conservatoires.
65 () Décision n° 2013-679 DC du 4 décembre 2013, Loi relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière, considérant 75.
66 () Décision n° 2015-713 DC du 23 juillet 2015, Loi relative au renseignement, considérants 72 et 73.
67 () CEDH, 29 mars 2005, n° 57752/00, Matheron c. France.
68 () CEDH, 24 avril 1990, n° 11801/85, Kruslin c. France ; 31 mai 2005, n° 59842/00, Vetter c. France.
69 () Cass. crim., 8 juillet 2015, n° 14-88.457 : « l’appréhension, l’enregistrement et la transcription de correspondances émises ou reçues par la voie des télécommunications antérieurement à la date de la décision écrite d’interception prise par le juge d’instruction » n’entrent pas dans les prévisions des articles 100 à 100-5 du code de procédure pénale relatifs aux interceptions de correspondances.
70 () Premier alinéa de l’article 706-95 du code de procédure pénale.
71 () 1° de l’article 230-33 du même code.
72 () Avis du Conseil d’État n° 391004 du 28 janvier 2016, p. 5.
73 () Loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers.
74 () Rapport (Assemblée nationale, n° 2681, XIIe législature) de M. Alain Marsaud fait au nom de la commission des Lois sur le projet de loi relatif à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers, novembre 2005, p. 80.
75 () Loi n° 2014-1353 du 13 novembre 2014 renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme.
76 () Voir l’étude d’impact annexée au présent projet de loi.
77 () Rapport (Assemblée nationale, n° 2828, XIVe législature) de M. Patrick Mennucci au nom de la commission d’enquête sur la surveillance des filières et des individus djihadistes, présidée par M. Éric Ciotti, juin 2015, pp. 104-105.
78 () Circulaire du 5 décembre 2014 de présentation de la loi n° 2014-135 renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme – Renforcement de la coordination de la lutte antiterroriste, NOR : JUSD1429083C.
79 () Voir l’article 13 de la proposition de loi n° 3469, adoptée par le Sénat le 2 février 2016, tendant à renforcer l’efficacité de la lutte antiterroriste, déposée sur le Bureau de l’Assemblée nationale le 3 février 2016.
80 () Arrêté du 9 juillet 2008 fixant l’organisation en bureaux de la direction de l’administration pénitentiaire.
81 () La direction générale de la sécurité extérieure, la direction de la protection et de la sécurité de la défense, la direction du renseignement militaire, la direction générale de la sécurité intérieure, la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières et le service à compétence nationale dénommé “ traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins ”.
82 () Rapports (n° 2868, XIVe législature et n° 520, session ordinaire de 2014-2015) de MM. Jean-Jacques Urvoas et Philippe Bas fait au nom de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif au renseignement, pp. 4-7.
83 () Article 442-1 du code de procédure pénale.
84 () Article 332 du même code.
85 () Cass. crim., 22 janvier 1852 : Bull. crim. 1852, n° 24.
86 () Voir supra, l’encadré sur la liste des infractions concernées par la procédure applicable à la criminalité et à la délinquance organisées au commentaire de l’article 1er.
87 () 7 de l’article 64 et 1 et 2 de l’article 68 de la Convention de Rome du 17 juillet 1998 portant statut de la Cour pénale internationale (CPI).
88 () Articles R. 129 à R. 132 du code de procédure pénale.
89 () Articles R. 133 à R. 138 du même code.
90 () Articles 31 et 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
91 () En application du 9° de l’article 138 du code de procédure pénale, le contrôle judiciaire astreint la personne concernée à se soumettre, selon la décision du juge d’instruction ou du juge des libertés et de la détention, à une ou plusieurs obligations, parmi lesquelles figure celle de « [s]’abstenir de recevoir ou de rencontrer certaines personnes spécialement désignées par le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention, ainsi que d’entrer en relation avec elles, de quelque façon que ce soit ».
92 () Le 2° de l’article 144 du même code dispose que la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s’il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu’elle constitue l’unique moyen de parvenir à l’un ou plusieurs des objectifs suivants et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d’assignation à résidence avec surveillance électronique, parmi lesquels figure celui d’« empêcher une pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ».
93 () CEDH, 20 novembre 1989, n° 11454/85, Kostovski c. Pays-Bas.
94 () CEDH, 19 décembre 1990, n° 11444/85, Delta c. France.
95 () CEDH, 15 juin 1992, n° 12433/86, Lüdi c. Suisse.
96 () Ils peuvent « [a]cquérir, détenir, transporter, livrer ou délivrer des substances, biens, produits, documents ou informations tirés de la commission des infractions ou servant à la commission de ces infractions » ; ils peuvent également « [u]tiliser ou mettre à disposition des personnes se livrant à ces infractions des moyens de caractère juridique ou financier ainsi que des moyens de transport, de dépôt, d’hébergement, de conservation et de télécommunication ».
97 () CEDH, 9 juin 1998, n° 25829/94, Teixeira de Castro c. Portugal ; 7 septembre 2004, n° 58753/00, Eurofinacom c. France.
98 () Voir supra, le 2 du commentaire de l’article 5.
99 () Idem.
100 () Voir supra, le 1 du commentaire de l’article 1er.
101 () Consacré à la « [p]rotection des personnes bénéficiant d’exemptions ou de réductions de peines pour avoir permis d’éviter la réalisation d’infractions, de faire cesser ou d’atténuer le dommage causé par une infraction, ou d’identifier les auteurs ou complices d’infractions ».
102 () Par la publication du décret n° 2014-346 du 17 mars 2014 relatif à la protection des personnes mentionnées à l’article 706-63-1 du code de procédure pénale bénéficiant d’exemptions ou de réductions de peine.
103 () Troisième alinéa de l’article 706-161 du code de procédure pénale.
104 () Un magistrat désigné par le ministre de la justice (qui la préside), un magistrat exerçant ou ayant exercé au sein d’une juridiction interrégionale spécialisée, un magistrat représentant la direction des affaires criminelles et des grâces.
105 () Un représentant de la direction générale de la police nationale, un représentant de la direction générale de la gendarmerie nationale et un représentant du ministre chargé des douanes.
106 () Article 14 du décret n° 2014-346 du 17 mars 2014 précité.
107 () Article 24 du même décret.
108 () Article 132-75 du code pénal.
109 () Meurtre ; assassinat ; empoisonnement.
110 () Tortures et actes de barbarie ; violences volontaires ; menaces d’atteintes aux personnes ; viol et agressions sexuelles ; harcèlement sexuel et moral ; enregistrement et diffusion d’images de violence ; trafic de stupéfiants.
111 () Enlèvement et séquestration ; détournement d’aéronef, de navire ou de tout autre moyen de transport.
112 () Traite des êtres humains ; proxénétisme et infractions qui en résultent ; recours à la prostitution des mineurs ou des personnes particulièrement vulnérables ; exploitation de la mendicité.
113 () Vols, extorsions et recel de ces infractions ; destructions, dégradations et détériorations dangereuses pour les personnes ou ne présentant pas de danger pour les personnes mais commises en état de récidive légale ; menaces de destruction, de dégradation et de détérioration et fausses alertes ; blanchiment.
114 () Participation à un attroupement, une manifestation ou une réunion publique en étant porteur d’une arme ; intrusion dans un établissement scolaire par une personne porteuse d’une arme et intrusion d’armes dans un tel établissement ; rébellion armée et rébellion armée en réunion.
115 () Fabrication ou commerce sans autorisation ; port, transport et expéditions d’armes soumises à enregistrement sans motif légitime ; importation sans autorisation de matériels ou d’armes ; fabrication, vente, exportation, sans autorisation, d’un engin ou produit explosif ou incendiaire ; port ou transport d’artifices non détonants.
116 () Il s’agit, notamment, des articles 131-16 et 131-43 en matière contraventionnelle, de l’article 221-8 pour les atteintes à la vie, de l’article 222-44 pour les atteintes à l’intégrité physique ou psychique de la personne, de l’article 223-18 en cas de condamnation pour mise en danger délibérée de la vie d’autrui, de l’article 225-20 pour les atteintes à la dignité de la personne, de l’article 226-31 pour les atteintes à la personnalité, des articles 311-14, 312-13 et 321-9 en cas de condamnation respectivement pour vol, extorsion et recel, de l’article 322-15 pour les destructions, dégradations ou détériorations, de l’article 324-7 en matière de blanchiment, de l’article 431-7 en cas de condamnation pour attroupement armé ou provocation à un tel attroupement, des articles 431-26 et 431-28 en cas respectivement d’intrusion dans un établissement scolaire et d’introduction d’armes dans un tel établissement, ou de l’article 433-24 pour la rébellion armée.
117 () « [n]e pas se signaler par un comportement laissant objectivement craindre une utilisation de l’arme ou du matériel dangereuse pour soi-même ou autrui »
118 () La loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne a ajouté les crimes d’atteintes volontaires à la vie de la personne, de torture et actes de barbarie et de violences volontaires, les crimes de vols, d’extorsions et de destructions, dégradations et détériorations dangereuses pour les personnes et les crimes constituant des actes de terrorisme.
119 () La loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure a ajouté les crimes contre l’humanité, les crimes et délits de menaces d’atteintes aux personnes, de trafic de stupéfiants, d’atteintes aux libertés de la personne, de traite des êtres humains, de proxénétisme, d’exploitation de la mendicité et de mise en péril des mineurs, les crimes et délits d’escroqueries et de menaces d’atteintes aux biens, les atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation, la fausse monnaie, l’association de malfaiteurs, certaines infractions en matière de détention d’armes ou de munitions de guerre et les infractions de recel ou de blanchiment du produit de l’une des infractions.
120 () La loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité a ajouté le délit d’exhibition sexuelle.
121 () La loi n° 2013-711 du 5 août 2013 portant diverses dispositions d’adaptation dans le domaine de la justice en application du droit de l’Union européenne et des engagements internationaux de la France a ajouté les crimes et délits de guerre.
122 () Décision n° 2010-25 QPC du 16 septembre 2010, M. Jean-Victor C. [Fichier empreintes génétiques], considérant 22.
123 () Ces textes anciens ont été abrogés par l’ordonnance n° 2004-1374 du 20 décembre 2004 par laquelle a été instituée la partie législative du code de la défense où figurent désormais ces infractions.
124 () Loi n° 2011-702 du 22 juin 2011 relative au contrôle des importations et des exportations de matériels de guerre et de matériels assimilés, à la simplification des transferts des produits liés à la défense dans l’Union européenne et aux marchés de défense et de sécurité.
125 () Voir supra, l’encadré sur la liste des infractions concernées par la procédure applicable à la criminalité et à la délinquance organisées au commentaire de l’article 1er.
126 () Le crime de meurtre commis en bande organisée (1°), le crime de tortures et d’actes de barbarie commis en bande organisée (2°), les crimes et délits de trafic de stupéfiants (3°), les crimes et délits d’enlèvement et de séquestration commis en bande organisée (4°), les crimes et délits aggravés de traite des êtres humains (5°), les crimes et délits aggravés de proxénétisme (6°), le crime de vol commis en bande organisée (7°), les crimes aggravés d’extorsion (8°), le crime de destruction, dégradation et détérioration d’un bien commis en bande organisée (9°), les crimes en matière de fausse monnaie (10°), les crimes et délits constituant des actes de terrorisme (11°), les délits en matière d’armes commis en bande organisée (12°), les délits d’aide à l’entrée, à la circulation et au séjour irréguliers d’un étranger en France commis en bande organisée (13°), les délits de blanchiment ou de recel du produit, des revenus, des choses provenant des infractions mentionnées aux 1° à 13° (14°) et les délits d’association de malfaiteurs lorsqu’ils ont pour objet la préparation de l’une des infractions mentionnées aux 1° à 14° (15°).
127 () Décision n° 2004-492 DC du 2 mars 2004 précitée, considérant 6.
128 () Décision n° 2013-679 DC du 4 décembre 2013 précitée, considérant 75.
129 () Ibid., considérant 77.
130 () Décision n° 2014-420/421 QPC du 9 octobre 2014, M. Maurice L. et autre [Prolongation exceptionnelle de la garde à vue pour des faits d’escroquerie en bande organisée], considérant 13.
131 () Décision n° 2015-508 QPC du 11 décembre 2015, M. Amir F. [Prolongation exceptionnelle de la garde à vue pour des faits de blanchiment, de recel et d’association de malfaiteurs en lien avec des faits d’escroquerie en bande organisée].
132 () Pour plus de précisions, voir l’étude d’impact annexée au présent projet de loi.
133 () La possibilité de mettre en œuvre des infiltrations aux fins de protection de tous les droits de propriété intellectuelle a été reconnue par la loi n° 2014-315 du 11 mars 2014 renforçant la lutte contre la contrefaçon.
134 () Voir supra, le b du 1 du commentaire de l’article 6.
135 () En application de l’article 706-32 du code de procédure pénale.
136 () Voir supra, le commentaire de l’article 8.
137 () Par la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012.
138 () Par la loi n° 2014-315 du 11 mars 2014 précitée.
139 () Source : Direction générale des douanes et droits indirects.
140 () En vertu des articles 706-81 à 706-87 du code de procédure pénale.
141 () Groupe de travail interministériel sur la lutte contre la cybercriminalité, op. cit., p. 211.
142 () Groupe de travail interministériel sur la lutte contre la cybercriminalité, op. cit., pp. 211-212.
143 () Décision n° 2004-492 DC du 2 mars 2004 précitée, considérant 6.
144 () Décision n° 2013-679 DC du 4 décembre 2013 précitée, considérant 77.
145 () Afin de tirer les conséquences de la décision n° 2014-420/421 QPC du 9 octobre 2014 par laquelle le Conseil constitutionnel avait estimé que, même lorsqu’il était commis en bande organisée, le délit d’escroquerie n’était pas susceptible de porter atteinte en lui-même à la sécurité, à la dignité ou à la vie des personnes. Par suite, le législateur ne pouvait autoriser la prolongation de la durée de la garde à vue jusqu’à 96 heures sans porter à la liberté individuelle et aux droits de la défense une atteinte qui ne pourrait être regardée comme proportionnée au but poursuivi.
146 () M. Jean–Luc Martinez, président–directeur du musée du Louvre, rapport au Président de la République sur « la protection du patrimoine en situation de conflit armé », novembre 2015.
147 () Ibid.
148 () Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (en anglais « United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization », UNESCO).
149 () Le rapport évoque de manière spécifique la problématique des ports francs dédiés à l’art (Genève, Luxembourg, Singapour, Shanghai). Ces ports doivent normalement servir à abriter des œuvres d’art en transit, en particulier pour des expositions ou des ventes. Les règles de ces ports varient selon les pays. Certains n’imposent aucune obligation d’inventaires à l’intention des douanes : la nature des biens entreposés, leur valeur et l’identité du propriétaire peuvent rester confidentiels.
150 () Ibid.
151 () Résolution 2100 (2013) du Conseil de sécurité des Nations Unies, adoptée le 25 avril 2013.
152 () Résolution 2199 (2015) du Conseil de sécurité des Nations Unies, adoptée le 21 février 2015.
153 () Cette définition des zones où opèrent des groupes terroristes est celle déjà retenue dans le code de la sécurité intérieure à l’article L. 224–1 s’agissant de l’interdiction de sortie du territoire.
154 () Conseil constitutionnel, décision n° 2004–492 DC du 2 mars 2004, Loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, cons. 5.
155 () Conseil constitutionnel, décision n° 2013–679 DC du 4 décembre 2013, Loi relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière, cons. 77.
156 () Article 2 de la directive précitée : « Parmi les facteurs à retenir dans leurs évaluations des risques, les États membres évaluent le degré de vulnérabilité des transactions applicables, notamment en ce qui concerne les méthodes de paiement utilisées. »
157 () Loi n° 90-614 du 12 juillet 1990 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic des stupéfiants.
158 () Voir le commentaire de l’article 13.
159 () Rapport d’activité de TRACFIN, 2014.
160 () Assemblée nationale, M. Yann Galut, rapport sur le projet de loi relatif à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière et le projet de loi organique relatif au procureur de la République financier, n°1011, 1019 et 1021, juin 2013.
161 () Voir le commentaire de l’article 14.
162 () Directive (UE) 2015/849 du Parlement Européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission.
163 () Loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale.
164 () Assemblée nationale, M. Yann Galut, rapport sur le projet de loi relatif à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière et le projet de loi organique relatif au procureur de la République financier, n°1011, 1019 et 1021, juin 2013.
165 () Cass. crim., arrêt QPC du 9 décembre 2015, n° 15–90.019.
166 () Article L. 152–1 du code monétaire et financier.
167 () Étude d’impact sur le présent projet de loi.
168 () Conseil constitutionnel, décision n° 2009–580 DC du 10 juin 2009, Loi favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet, cons. 17.
169 () CEDH, 7 octobre 1988, Salabiaku c. France, point 28.
170 () CEDH, 25 septembre 1992, Pham Hoang c. France, cons. 33 et 36.
171 () L’article 20 du code de procédure pénale qualifie d’agents de police judiciaire, d’une part, les gendarmes n’ayant pas la qualité d’officier de police judiciaire et, d’autre part, les fonctionnaires des services actifs de la police nationale, titulaires et stagiaires, n’ayant pas la qualité d’officier de police judiciaire. Ils ne peuvent toutefois se prévaloir de cette qualité « que s’ils sont affectés à un emploi comportant cet exercice ; l’exercice de ces attributions est momentanément suspendu pendant le temps où ils participent, en unité constituée, à une opération de maintien de l’ordre ». Le 1° de l’article 21 qualifie d’agents de police judiciaire adjoints « les fonctionnaires des services actifs de police nationale ne remplissant pas les conditions prévues par l’article 20 », ce qui concerne essentiellement certains gardiens de la paix.
172 () À la différence des policiers et gendarmes, les agents des douanes ne peuvent que « contrôler l’identité des personnes qui entrent dans le territoire douanier ou qui en sortent, ou qui circulent dans le rayon des douanes », qui correspond à la zone de surveillance spéciale instituée le long des frontières terrestres et maritimes (article 67 du code des douanes).
173 () L’article 78-3 du code de procédure pénale dispose que l’intéressé peut « être retenu sur place ou dans le local de police où il est conduit aux fins de vérification de son identité ». Il doit être présenté à un officier de police judiciaire et informé de son droit de faire aviser le procureur de la République et de prévenir à tout moment toute personne de son choix. Cette retenue doit intervenir « pendant le temps strictement exigé » par l’établissement de l’identité de la personne, sans pouvoir excéder quatre heures. Quand il n’est pas possible de procéder autrement, des empreintes digitales et des photographies de la personne retenue peuvent être prises, après autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction.
174 () Décision n° 93-323 DC du 5 août 1993, Loi relative aux contrôles et vérifications d’identité, cons. 9.
175 () Toutes trois déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2003-467 DC du 13 mars 2003, Loi pour la sécurité intérieure, cons. 12, 14 et 16.
176 () Il s’agit des actes de terrorisme visés par les articles 421-1 à 421-6 du code pénal, des infractions en matière de prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs visées aux 1° et 2° du I de l’article L. 1333-9, à l’article L. 1333-11, au II des articles L. 1333-13-3 et L. 1333-13-4 et aux articles L. 1333-13-5, L. 2339-14, L. 2339-15, L. 2341-1, L. 2341-2, L. 2341-4, L. 2342-59 et L. 2342-60 du code de la défense, d’armes et d’explosifs visées par les articles L. 2339-8 et L. 2353-4 du code de la défense et L. 317-8 du code de la sécurité intérieure, des infractions de vol visées par les articles 311-3 à 311-11 du code pénal, de recel visées par les articles 321-1 et 321-2 du même code ou des faits de trafic de stupéfiants visés par les articles 222-34 à 222-38 du même code.
177 () Décision du 13 mars 2003 précitée.
178 () Cass. crim., 21 mars 2012, n° 12-90.006 ; 13 juin 2012, n° 12-90.025 ; voir également Cass. crim., 25 janvier 2012, n° 11-84.876.
179 () Article 76 du code de procédure pénale.
180 () Cass. chambre criminelle, n° 83–93689, 15 octobre 1984 : « en demandant à X qui se trouvait à son domicile, de leur présenter son portefeuille et en fouillant à l’intérieur de celui–ci, les enquêteurs ne se sont pas bornés à user du droit de communication qui leur est conféré par l’article 65 du code des douanes mais ont procédé à un acte de perquisition ou de visite domiciliaire (…) ; la fouille du portefeuille à laquelle ont procédé les inspecteurs des douanes constitue, en l’espèce, une perquisition qui échappe, non seulement aux prévisions de l’article 64 du code des douanes, mais encore à toute disposition de la loi, en l’absence soit d’une infraction flagrante, soit d’un assentiment recueilli dans les conditions prescrites par l’article 76 du code de procédure pénale ou faute d’une commission rogatoire régulièrement délivrée par un magistrat instructeur. »
181 () Par dérogation à ces règles, en enquête préliminaire ou en flagrance, la fouille doit être exécutée par le procureur de la République lorsqu’elle est effectuée dans un lieu protégé à raison d’un secret (cabinet ou domicile d’un avocat, cabinet d’un médecin, étude d’un notaire, etc.).
182 () Cass. crim., 27 septembre 1988, n° 88-81.786.
183 () Article 203 du Règlement intérieur d’emploi des gradés et gardiens de la paix de la police nationale ; instructions ministérielles du 11 mars 2003 relatives à la garantie de la dignité des personnes placées en garde à vue.
184 () Ce fichier a été créé par le décret n° 2010–569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées. Il recense toutes les personnes faisant l’objet d’une mesure de recherche ou de vérification de leur situation juridique. Il est divisé en différentes fiches correspondant aux motifs de la recherche de la personne concernée, notamment les personnes faisant l’objet d’une fiche S, qui font l’objet de recherche pour prévenir des menaces graves pour la sécurité publique ou la sûreté de l’État dès lors que des informations ou des indices réels ont été recueillis à leur égard.
185 () Il s’agit des fichiers qui intéressent la sûreté de l’État, la défense ou la sécurité publique ou qui ont pour objet la prévention, la recherche, la constatation ou la poursuite des infractions pénales ou l’exécution des condamnations pénales ou des mesures de sûreté.
186 () Conseil constitutionnel, décision n° 2012–253 QPC, M. Mickaël D (Ivresse publique), 8 juin 2012, considérants 7 à 9.
187 () « 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi. 2. La mort n’est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d’un recours à la force rendu absolument nécessaire : a) pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale ; b) pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l’évasion d’une personne régulièrement détenue ; c) pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection. »
188 () « N’est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d’elle-même ou d’autrui, sauf s’il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l’atteinte. N’est pas pénalement responsable la personne qui, pour interrompre l’exécution d’un crime ou d’un délit contre un bien, accomplit un acte de défense, autre qu’un homicide volontaire, lorsque cet acte est strictement nécessaire au but poursuivi dès lors que les moyens employés sont proportionnés à la gravité de l’infraction. »
189 () Dans le silence de la loi, la jurisprudence a considéré que cette présomption était une présomption réfragable (Cass. crim., 15 février 1959, Bull. n° 121).
190 () Article L. 4123-12 du code de la défense : « Outre les cas de légitime défense, n’est pas pénalement responsable le militaire qui déploie, après sommations, la force armée absolument nécessaire pour empêcher ou interrompre toute intrusion dans une zone de défense hautement sensible et procéder à l’arrestation de l’auteur de cette intrusion. »
191 () CEDH, 27 septembre 1995, Mc Cann et autres c. Royaume–Uni. En l’espèce, l’affaire concernait le décès de trois membres de l’Irish Republican Army (IRA) soupçonnés de porter sur eux un détonateur pour déclencher une bombe à distance. Ils furent abattus dans la rue par des militaires. La Cour a conclu à la violation de l’article 2 de la convention au motif que l’opération aurait pu être organisée et contrôlée de telle manière qu’il ne fût pas nécessaire de tuer les suspects.
192 () CEDH, 5 juin 2012, Ulufer c. Turquie. En l’espèce la Cour a condamné l’usage de la force armée ayant entrainé la mort auquel a recouru un gendarme contre un fugitif, après sommation, dans un cadre légal proche de celui de l’article L. 2338–3 du code de la défense.
193 () CEDH, 6 juillet 2005, Natchova et autres c. Bulgarie. En l’espèce, des militaires avaient reçu l’ordre de recourir à tous les moyens nécessaires pour arrêter deux fugitifs, non armés. Ils furent tués à l’occasion de leur fuite, après que les militaires aient adressé une sommation. La Cour a relevé que le règlement bulgare sur le recours aux armes à feu par la police militaire permettait effectivement d’utiliser la force meurtrière pour arrêter un membre des forces armées soupçonné d’un délit, même très mineur, et que ce cadre juridique était fondamentalement insuffisant au regard des obligations posées par l’article 2 de la Convention.
194 () CEDH, 23 février 2010, Wasilewska et Kalucka c. Pologne. L’affaire concernait la mort d’un suspect au cours d’une opération terroriste. La Cour a estimé que le gouvernement polonais n’avait pas présenté d’observation concernant la proportionnalité de la force utilisée par la police, l’organisation de l’action policière et la question de savoir s’il existait ou non un cadre législatif et administratif pour protéger les personnes contre l’arbitraire et le recours abusif à la force. Pour d’autres exemples, voir CEDH, 9 octobre 1997, Andronicou et Constantinou c. Chypre, et CEDH, 4 mai 2001, McKerr c. Royaume–Uni.
195 () CEDH, 19 avril 2012, Saso Gorgiev c. l’ex–République yougoslave de Macédoine. L’affaire concernait un serveur victime de tirs ouverts dans le bar où il travaillait par un réserviste de la police censé être en service au commissariat. La Cour a jugé que le Gouvernement ne lui avait pas fourni des informations ni sur des règlements qui auraient porté sur la prévention de l’usage abusif des armes de service par ses agents, ni sur le point de savoir s’il avait été vérifié que le réserviste était apte à être recruté et à porter une arme. Voir également CEDH, Natchova et autres c. Bulgarie, n° 43577/98, 6 juillet 2005.
196 () Cass. crim., n° 02–80095, Bull. crim. n° 41, 18 février 2003. Pour confirmer qu’un gendarme était autorisé à faire usage de son arme sur le fondement de l’article 174 du décret du 20 mai 1903, qui n’est pas contraire à l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les juges doivent rechercher si l’usage était absolument nécessaire, tenir compte de la nature du but recherché, du danger pour les vies humaines et l’intégrité corporelle inhérente à la situation, et de l’ampleur du risque que la force employée fasse des victimes. La Cour d’appel aurait dû caractériser que la force utilisée par le gendarme était strictement proportionnée au danger de la situation ou que ce dernier était en état de légitime défense.
197 () Cass. crim., n° 94–81585, Bull. crim., n° 22, 16 janvier 1996. L’affaire concernait un gendarme qui, à l’occasion d’une enquête de police judiciaire, effectuait, en tenue civile, une surveillance à proximité d’une voiture automobile signalée volée et qui a fait usage de son arme à feu pour immobiliser le véhicule au moment où son occupant tentait de prendre la fuite sans avoir obtempéré aux ordres d’arrêt.
198 () CEDH, 17 mars 2005, Bubbins c. Royaume–Uni, et Cass. crim., n° 09–81–399, 9 février 2010.
199 () CEDH, 20 décembre 2011, Figogenov c. Russie.
200 () Cass. crim., n° 0483939, 13 avril 2005. La Cour a jugé que si aux termes de l’article 73 du code de procédure pénale, toute personne a qualité pour appréhender l’auteur présumé d’une infraction flagrante et le conduire devant l’officier de police judiciaire le plus proche, l’usage à cette fin, de la force doit être nécessaire et proportionné aux conditions de l’arrestation.
201 () Cass. crim., 16 juillet 1986. En l’espèce, un policier avait tiré un coup de feu au sol, blessant par ricochet un individu armé qui avait précédemment fait usage de son arme et se trouvait dans un état d’excitation violente. La Cour de cassation avait noté que, par ce geste, le policier avait cherché à intimider l’individu, et non à l’atteindre, et en a déduit que cet acte lui avait été commandé par la nécessité réelle et urgente de l’appréhender et que le risque pris apparaissait en rapport avec le danger créé par l’individu.
202 () Rapport rendu au ministre de l’Intérieur le 13 juillet 2012.
203 () Voir CEDH, Figogenov c. Russie, op. cit.
204 () Voir CEDH, Natchova et autres c. Bulgarie, op. cit.
205 () Assemblée nationale, M. Patrick Mennucci, rapport au nom de la commission d’enquête sur « la surveillance des filières et des individus djihadistes », n° 2828, juin 2015.
206 () Sénat, M. Jean–Pierre Sueur, rapport au nom de la commission d’enquête sur l’organisation et les moyens de la lutte contre les réseaux djihadistes en France et en Europe, n° 388, avril 2015.
207 () Assemblée nationale, rapport précité n° 2828.
208 () Assemblée nationale, rapport précité n° 2828.
209 () Assemblée nationale, rapport précité n° 2828.
210 () Conseil constitutionnel, décision n° 93-325 DC du 13 août 1993, Loi relative à la maîtrise de l’immigration et aux conditions d’entrée, d’accueil et de séjour des étrangers en France, cons. 3.
211 () Conseil constitutionnel, décision n° 2003-467 DC du 13 mars 2003, Loi pour la sécurité intérieure, cons. 9.
212 () Conseil constitutionnel, décision n° 2010-13 QPC du 9 juillet 2010, M. Orient O. et autres, cons. 8.
213 () Les cahiers du Conseil constitutionnel, commentaire de la décision n° 2015–527 QPC du 22 décembre 2015, M. Cédric D. (assignations à résidence dans le cadre de l’état d’urgence).
214 () CEDH, 28 novembre 2002, Lavents c. Lettonie.
215 () CEDH, 6 novembre 1980, Guzzardi c. Italie.
216 () CEDH, 9 février 2006, Freimanis et Lidumsc c. Lettonie.
217 () Conseil constitutionnel, décision n° 2015–527 QPC du 22 décembre 2015, op. cit.
218 () Conseil d’État, 28 octobre 1960, Martial de Laboulaye.
219 () Conseil constitutionnel, décision n° 83–156 DC du 28 mai 1983, Loi portant diverses mesures relatives aux prestations de vieillesse, cons. 8.
220 () Il s’agit des traitements de données à caractère personnel mis en œuvre pour le compte de l’État et : 1° Qui intéressent la sûreté de l’État, la défense ou la sécurité publique ; 2° Ou qui ont pour objet la prévention, la recherche, la constatation ou la poursuite des infractions pénales ou l’exécution des condamnations pénales ou des mesures de sûreté.
221 () Les trois derniers alinéas de l’article 62-3 du code de procédure pénale indiquent :
« Le procureur de la République apprécie si le maintien de la personne en garde à vue et, le cas échéant, la prolongation de cette mesure sont nécessaires à l’enquête et proportionnés à la gravité des faits que la personne est soupçonnée d’avoir commis ou tenté de commettre.
Il assure la sauvegarde des droits reconnus par la loi à la personne gardée à vue.
Il peut ordonner à tout moment que la personne gardée à vue soit présentée devant lui ou remise en liberté. »
222 () CEDH, 29 mars 2010, Medvedyev c. France et 23 novembre 2010, Moulin c. France.
223 () L’autorité judiciaire est composée à la fois des magistrats du siège et de ceux du parquet, conformément à la décision n° 93-326 DC du 11 août 1993, Loi modifiant la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme du code de procédure pénale.
224 () Les articles 2-1 à 2-23 du code de procédure pénale donnent ainsi intérêt à agir aux associations de défense des droits des victimes dès lors qu’elles remplissent une condition d’ancienneté de cinq ans. Si leur objet social est bien concerné, on ne saurait prétendre que ces groupements associatifs sont stricto sensu les « victimes » d’une infraction. Cette situation est d’ailleurs prise en considération par le code qui, à plusieurs reprises, soumet la qualité à agir de l’association à l’aval de la « victime » proprement dite. Ainsi, le deuxième alinéa de l’article 2-6 précise que « l’association n’est recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l’accord écrit de la personne intéressée, ou, si celle-ci est mineure et après l’avis de cette dernière, celui du titulaire de l’autorité parentale ou du représentant légal » (à propos de l’action des associations de lutte contre les discriminations fondées sur le sexe, sur les mœurs ou sur l’orientation ou l’identité sexuelle dans les affaires de discrimination à la suite d’un harcèlement sexuel).
225 () « Vidéo de viol présumé diffusée en ligne: la victime refuse de porter plainte », France Soir, 5 janvier 2016.
226 () Articles 225 et suivants du code de procédure pénale.
227 () « Les officiers et agents de police judiciaire sont placés sous la surveillance du procureur général. Il peut les charger de recueillir tous renseignements qu’il estime utiles à une bonne administration de la justice. »
228 () L’instruction non contradictoire existe également, dans les cas où elle est diligentée « contre X ».
229 () « Sur instructions du procureur de la République, l’officier de police judiciaire donne connaissance des résultats des examens techniques et scientifiques aux personnes à l’encontre desquelles il existe des indices faisant présumer qu’elles ont commis ou tenté de commettre une infraction, ainsi qu’aux victimes. »
230 () Le défèrement est la présentation d’une personne au procureur de la République afin qu’il décide de l’opportunité des poursuites.
231 () Loi n° 2014-535 du 27 mai 2014 portant transposition de la directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, relative au droit à l’information dans le cadre des procédures pénales.
232 () Cass. Crim., 26 juin 2013, n° 13-81491.
233 () CEDH, 9 avril 2015, ATC c. Luxembourg.
234 () Commission de modernisation de l’action publique sous la présidence de Jean-Louis Nadal, procureur général honoraire près la Cour de cassation, Refonder le ministère public, rapport à la garde des Sceaux, ministre de la Justice, novembre 2013, pp. 82-83.
235 () Perquisition aux fins de saisie (article 56), audition libre (article 61-1), garde à vue (article 62-2), perquisition domiciliaire (article 76) et saisies (articles 706-141 à 706-158).
236 () La comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, également appelée « plaider coupable », permet au procureur de la République de proposer, directement et sans procès, une ou plusieurs peines à une personne qui reconnaît les faits qui lui sont reprochés. Si la personne conteste les faits ou la peine proposée, le procureur peut alors saisir le tribunal correctionnel. Cette procédure a été créée par la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, dite « Loi Perben II » et introduite aux articles 495-7 à 495-16 du code de procédure pénale
237 () Article 393 du code de procédure pénale.
238 () Le statut de témoin assisté est un statut intermédiaire entre celui de simple témoin et de mis en examen. Il offre certaines garanties par rapport au statut de simple témoin mais les éléments à charge sont moins lourds que pour un mis en examen (articles 113-1 à 113-8 du code de procédure pénale).
239 () Le manquement à l’obligation d’organiser la discussion contradictoire serait une violation du droit au procès équitable et, fort probablement, qualifié de cause de nullité de la procédure.
240 () Ceci n’empêchera pas que les personnes apparaissant dans une procédure classée sans suite puissent demander à en connaître les éléments.
241 () Les droits de la défense, la liberté d’expression et la séparation des pouvoirs sont notamment à la source de ces protections supplémentaires.
242 () Cass. crim., 13 décembre 2006, n° 06-87.169.
243 () Décision n° 2015-506 QPC du 4 décembre 2015, M. Gilbert A. [Respect du secret professionnel et des droits de la défense lors d’une saisie de pièces à l’occasion d’une perquisition], considérant 15.
244 () Idem, considérant 13.
245 () Voir infra, le d du 3 du commentaire de l’article 33.
246 () Étude d’impact jointe au projet de loi, p. 111.
247 () N° 13-87.372, Bull. crim n° 36 et 13-87.897, Bull. crim. n°37.
248 () L’arrêt de la chambre criminelle du 18 août 2010, n°10-83656, a cependant établi la pratique d’une extension à la matière correctionnelle de la règle posée par la loi pour les affaires criminelles.
249 () Articles 148-2, 186-2, 186-4 et 194 du code de procédure pénale.
250 () Convention des Nations unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes du 20 décembre 1988, dite Convention de Vienne.
251 () La Convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée du 15 novembre 2000, dite Convention de Palerme, est complétée par trois protocoles additionnels relatifs à la traite des personnes, au trafic illicite de migrants, au blanchiment d’argent et à la fabrication et au trafic illicites d’armes à feu.
252 () Convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982, dite Convention de Montego Bay.
253 () CEDH, Ali Samatar et autres c. France et Hassan et autres c. France, 4 décembre 2014.
254 () CEDH, Rigopoulos c. Espagne, 12 janvier 1999 ; Medvedyev et autres c. France, 29 mars 2010 ; Vassis et autres c. France, 27 juin 2013.
255 () La présentation au procureur de la République ne suffit pas à satisfaire la Cour, dès lors que celle-ci ne le considère pas comme un magistrat indépendant (CEDH, Moulin c. France, 23 novembre 2010).
256 () Voir le commentaire de cet article dans le rapport (n° 2763, XIVe législature) fait par M. Dominique Raimbourg au nom de la commission des Lois sur le projet de loi, adopté par le Sénat, portant adaptation de la procédure pénale au droit de l’Union européenne, 13 mai 2015, pp. 89-91.
257 () Décision n° 2015-494 QPC du 16 octobre 2015, Consorts R. [Procédure de restitution, au cours de l’information judiciaire, des objets placés sous main de justice], considérant 7.
258 () Pour plus de précision, voir infra, le a du 3 du commentaire de l’article 33.
259 () Ces alinéas prévoient :« [d]ans les huit jours de la réception de ce dossier, le président décide, par une ordonnance qui n’est pas susceptible de voie de recours, s’il y a lieu ou non de saisir la chambre de l’instruction de cet appel » ; « [d]ans l’affirmative, il transmet le dossier au procureur général qui procède ainsi qu’il est dit aux articles 194 et suivants » ; « [d]ans la négative, il ordonne par décision motivée que le dossier de l’information soit renvoyé au juge d’instruction ».
260 () Voir infra, le c du 1 du commentaire de l’article 33.
261 () Voir le commentaire de cet article dans le rapport (n° 2977, XIVe législature) fait par M. Dominique Raimbourg au nom de la commission des Lois sur le projet de loi, modifié par l’Assemblée nationale, portant adaptation de la procédure pénale au droit de l’Union européenne, 15 juillet 2015, p. 28.
262 () Voir le commentaire de cet article dans le rapport (n° 2763, XIVe législature) précité, p. 96.
263 () Voir le commentaire de cet article dans le rapport (n° 2763, XIVe législature) précité, pp. 96-97.
264 () Voir le commentaire de cet article dans le rapport (n° 2763, XIVe législature) précité, pp. 97-98.
265 () La circulaire de la direction des affaires criminelles et des grâces 13/E5 du 16 juin 2008 relative à l’habilitation des officiers de police judiciaire et portant application du décret n° 2008-290 du 28 mars 2008 prévoit : « À titre temporaire et exceptionnel, et afin de permettre la continuité du service public, l’autorité judiciaire peut être amenée à habiliter un officier de police judiciaire afin de suppléer un officier de police judiciaire d’une autre circonscription territoriale. »
266 () Ces services et unités sont mentionnés aux articles R. 15-18 et suivants du code de procédure pénale.
267 () Articles R. 15-2 (gendarmerie nationale) et R. 15-16 (police nationale) du code de procédure pénale.
268 () Article 16, huitième alinéa, du code de procédure pénale.
269 () Si le juge d’instruction entend répondre favorablement à la demande, il n’est pas nécessaire d’en passer par cette procédure.
270 () L’article 144 du code de procédure pénale conditionne la détention provisoire au fait qu’elle constitue l’unique moyen de parvenir à l’un des objectifs suivants qui ne pourrait être atteint en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d’assignation à résidence avec surveillance électronique : conserver les preuves ou les indices matériels qui sont nécessaires à la manifestation de la vérité ; empêcher une pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ; empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses coauteurs ou complices ; protéger la personne mise en examen ; garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice ; mettre fin à l’infraction ou prévenir son renouvellement ; mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l’ordre public provoqué par la gravité de l’infraction, les circonstances de sa commission ou l’importance du préjudice qu’elle a causé, ce trouble ne pouvant résulter du seul retentissement médiatique de l’affaire.
271 () Cass. Crim., 30 avril 2002, n° 02-81.201.
272 () Cass. crim., 3 septembre 2003, Bull. crim. 2003, n° 152 ; Cass. crim., 1er février 2005, Bull. crim. 2005, n° 33.
273 () Saisine du juge des libertés et de la détention par ordonnance motivée du juge d’instruction, comparution de la personne assistée de son avocat, débat contradictoire.
274 () Cass. crim., 9 janvier 2013, n° 12-87016.
275 () La notification consécutive à une garde à vue ou à une audition libre ne soulève pas de difficulté pour les forces de l’ordre puisque la personne concernée se trouve déjà sur place.
276 () Ces quatre missions, qui correspondent aux mesures alternatives de sanction, sont : procéder au rappel auprès de l’auteur des faits des obligations résultant de la loi ; orienter l’auteur des faits vers une structure sanitaire, sociale ou professionnelle pour y accomplir, à ses frais, un stage ou une formation ; demander à l’auteur des faits de régulariser sa situation au regard de la loi ou des règlements ; demander à l’auteur des faits de réparer le dommage résultant de ceux-ci.
277 () Aux termes du premier alinéa de l’article 41-2 du code de procédure pénale, « le procureur de la République, tant que l’action publique n’a pas été mise en mouvement, peut proposer, directement ou par l’intermédiaire d’une personne habilitée, une composition pénale à une personne physique qui reconnaît avoir commis un ou plusieurs délits punis à titre de peine principale d’une peine d’amende ou d’une peine d’emprisonnement d’une durée inférieure ou égale à cinq ans. »
278 () « Faire procéder, à la demande ou avec l’accord de la victime, à une mission de médiation entre l’auteur des faits et la victime. »
279 () La disjonction est une décision d’ordre intérieur, rendue dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice (article 286 du code de procédure pénale), qui scinde une série de faits indépendants en deux affaires distinctes ou qui dissocie le sort de deux prévenus – le cas de l’un étant renvoyé à une audience ultérieure ou devant une autre juridiction.
280 () Article 495-3 du code de procédure pénale.
281 () Le mandat de dépôt est l’ordre donné par un juge au chef ou au directeur d’une prison de recevoir ou de maintenir en détention une personne condamnée à de la prison ferme ou un mis en examen placé en détention provisoire. Il n’existe pas de mandat de dépôt aux assises, l’arrêt de la cour valant titre de détention (article 367 du code de procédure pénale).
282 () En matière de comparution immédiate, le mandat de dépôt est la règle puisque l’article 397-4 du code de procédure pénale dispose expressément qu’en comparution immédiate le tribunal a la possibilité, « quelle que soit la durée de la peine », de décerner mandat de dépôt.
283 () Article 230-19 du code de procédure pénale. Le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées le décrit comme un « traitement automatisé de données à caractère personnel » qui « a pour finalité de faciliter les recherches et les contrôles effectués, dans le cadre de leurs attributions respectives, par les services de la police nationale, les unités de la gendarmerie nationale et les agents des douanes exerçant des missions de police judiciaire ou des missions administratives. »
284 () Considérant n° 14 de la décision précitée.
285 () Voir le commentaire de cet article dans le rapport (n° 2763, XIVe législature) fait par M. Dominique Raimbourg au nom de la commission des Lois sur le projet de loi, adopté par le Sénat, portant adaptation de la procédure pénale au droit de l’Union européenne, 13 mai 2015, pp. 72-75.
286 () Disposition relative à l’audition libre dans le cadre de l’enquête pénale.
287 () Il est notamment prévu à l’article 379-3 du code de procédure pénale que la décision de condamnation est non avenu si le condamné se constitue prisonnier ou s’il est arrêté avant que la peine soit éteinte par la prescription. Un nouveau procès est alors ordonné.
288 () Voir le commentaire de cet article dans le rapport (n° 2763, XIVe législature) fait par M. Dominique Raimbourg au nom de la commission des Lois sur le projet de loi, adopté par le Sénat, portant adaptation de la procédure pénale au droit de l’Union européenne, 13 mai 2015.
289 () Voir le commentaire de cet article dans le rapport (n° 2763, XIVe législature) fait par M. Dominique Raimbourg au nom de la commission des Lois sur le projet de loi, adopté par le Sénat, portant adaptation de la procédure pénale au droit de l’Union européenne, 13 mai 2015.
290 () Voir le commentaire de cet article dans le rapport (n° 2763, XIVe législature) fait par M. Dominique Raimbourg au nom de la commission des Lois sur le projet de loi, adopté par le Sénat, portant adaptation de la procédure pénale au droit de l’Union européenne, 13 mai 2015.
291 () Voir le commentaire de cet article dans le rapport (n° 2763, XIVe législature) fait par M. Dominique Raimbourg au nom de la commission des Lois sur le projet de loi, adopté par le Sénat, portant adaptation de la procédure pénale au droit de l’Union européenne, 13 mai 2015.
292 () Voir le commentaire de cet article dans le rapport (n° 2763, XIVe législature) fait par M. Dominique Raimbourg au nom de la commission des Lois sur le projet de loi, adopté par le Sénat, portant adaptation de la procédure pénale au droit de l’Union européenne, 13 mai 2015.
293 () Articles R. 251-7 et suivants du code de la sécurité intérieure.
294 () Article 226-1 du code pénal.
295 () Les forces de police disposent actuellement d’un peu moins de deux mille caméras individuelles, au coût unitaire de 1 200 euros. L’étude d’impact jointe au projet de loi estime le coût annuel d’une généralisation du déploiement pour les agents de la police nationale à 1,2 million d’euros pour mille caméras, avec au surplus un coût annuel de 150 000 euros pour les serveurs de stockage.
296 () Décision n° 2012-652 DC du 22 mars 2012, Loi relative à la protection de l’identité, considérant n° 8.
297 () CEDH, 26 mars 1987, Leander c. Suède, req. 9248/81 ; CEDH, 16 février 2000, Amann c. Suisse, req. 27798/95.
298 () CEDH, 11 janvier 2005, Sciacca c. Italie, req. 50774/99.
299 () Voir par exemple la décision n° 94-352 DC du 18 janvier 1995, Loi d’orientation et de programmation relative à la sécurité, considérant n° 3.
300 () L’avis de la CNIL sur les mesures réglementaires de constitution de fichiers contenant des données personnelles est prévu aux articles 26 et 27.
301 () La transposition en droit français a été effectuée par l’ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.
302 () Le Groupe d’action financière (GAFI) est un organisme intergouvernemental créé en 1989. Ses objectifs consistent en l’élaboration des normes législatives, réglementaires et opérationnelles en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et les menaces pour l’intégrité du système financier international. Le Groupe a élaboré une série de recommandations reconnues comme référence en 1990, et révisées en 1996, 2001, 2003 et 2012. Il réunit deux organisations régionales (l’Union européenne et le Conseil de coopération du Golfe) ainsi que trente-quatre États (Afrique du Sud, Allemagne, Argentine, Australie, Autriche, Belgique, Brésil, Canada, Chine, Corée du Sud, Danemark, Espagne, États-Unis, Russie, Finlande, France, Grèce, Chine, Inde, Irlande, Islande, Italie, Japon, Luxembourg, Mexique, Norvège, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, Singapour, Suède, Suisse et Turquie).
303 () La position franco-allemande en ce sens a reçu l’approbation de la Commission européenne le 6 mai 2013.
304 () L’article L. 561-10 du code monétaire et financier précise la notion de personne politiquement exposée « à des risques particuliers en raison des fonctions politiques, juridictionnelles ou administratives qu’elle exerce ou a exercées pour le compte d’un autre État ou de celles qu’exercent ou ont exercées des membres directs de sa famille ou des personnes connues pour lui être étroitement associées ». L’article R. 561-18 du même code dresse la liste des personnes concernées, dont notamment les chefs d’État, les membres de Gouvernement, les parlementaires ou encore les magistrats des hautes juridictions.
305 () Définies par l’article 2 de la directive, les entités assujetties sont les établissements financiers et de crédit, mais aussi toute personne physique ou morale exerçant une activité à risque (auditeurs, comptables, notaires, agents immobiliers, prestataires de services aux sociétés et aux fiducies, négociants et organismes de jeu de hasard).
306 () La notion d’« État ou territoire non coopératif » est codifiée en droit interne à l’article 238-0 A du code général des impôts.
307 () En France, la cellule de traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins (TRACFIN) est régie par les articles R. 561-33 et suivants du code monétaire et financier.
308 () Décret n° 2010-69 du 18 janvier 2010 instituant un conseil d’orientation de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
309 () Article L. 612-1 et suivants du code monétaire et financier.
310 () Article R. 561-10 du code monétaire et financier.
311 () Article 12§1 de la directive.
312 () Ce texte trouve son origine dans une proposition de loi déposée sur le Bureau de l’Assemblée nationale par MM. Jean-Luc Warsmann, alors président de la commission des Lois, et Guy Geoffroy. Ses objectifs sont détaillés dans le rapport n° 1689 présenté à la commission des Lois par M. Guy Geoffroy le 20 mai 2009.
313 () Dans la mesure où il est rendu par un jury populaire, la motivation d’un arrêt d’assises est plus limitée que celle d’un jugement correctionnel. Le deuxième alinéa de l’article 565-1 du code de procédure pénale indique : « En cas de condamnation, la motivation consiste dans l’énoncé des principaux éléments à charge qui, pour chacun des faits reprochés à l’accusé, ont convaincu la cour d’assises. Ces éléments sont ceux qui ont été exposés au cours des délibérations menées par la cour et le jury. »
314 () Article 15§1 de la directive.
315 () Article 116 du code de procédure pénale.
316 () Article 390 du code de procédure pénale.
317 () Article 417 du code de procédure pénale.
318 () Article 114 du code de procédure pénale.
319 () Article 393 du code de procédure pénale.
320 () Article 63-4-2 du code de procédure pénale.
321 () Article 61-2 du code de procédure pénale.
322 () Article 133 du code de procédure pénale.
323 () Article 122 du code de procédure pénale.
324 () Article 803-6 du code de procédure pénale.
325 () Article 63-2 du code de procédure pénale.
326 () Article 145-4 du code de procédure pénale et article 35 de la loi pénitentiaire n° 2009-1436 du 24 novembre 2009. Les articles 39 et 40 de cette dernière loi protègent par ailleurs le droit de téléphoner et de correspondre avec des tiers.
327 () Article 803-6 du code de procédure pénale.
328 () Article 695-27 du code de procédure pénale.
329 () Le Gouvernement envisage de conférer dans le même temps un accès comparable aux plaignants pour les reconstitutions et les séances d’identification, afin de protéger au mieux les droits de toutes les parties.
330 () Article 36§1 de la directive.
331 () Article 11§1 de la directive.
332 () Loi n° 2014-535 du 27 mai 2014 portant transposition de la directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, relative au droit à l’information dans le cadre des procédures pénales.
333 () Article L. 561-38 du code monétaire et financier.
334 () Article L. 562-1 du code monétaire et financier.
335 () Article L. 562-2 du code monétaire et financier.
336 () Cette définition reprend l’article 1er du règlement (CE) n° 2580/2001 du Conseil du 27 décembre 2001 modifié concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme.
337 () Article L. 562-5 du code monétaire et financier.
338 () Les procurations sur compte sont notamment visées : une personne peut voir ses avoirs gelés mais continuer à effectuer des opérations sur le compte d’un tiers sur lequel elle dispose d’un mandat.
339 () Les procédures et conditions d’application de la législation nationale dans les territoires ultramarins sont précisées dans le commentaire de l’article 34 du projet de loi.
340 () Les pays et territoires d’outre-mer (PTOM) sont des territoires d’outre-mer des États membres de l’Union européenne, mais qui ne font toutefois pas partie intégrante de l’Union européenne elle-même. Leurs statuts et les relations qu’ils entretiennent avec l’Union européenne sont régis au cas par cas. Les territoires français concernés sont la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, Saint-Pierre-et-Miquelon, les Terres australes et antarctiques françaises, Wallis-et-Futuna, et Saint-Barthélemy.
341 () Considérant n° 14 de la décision précitée.
342 () Rapport de M. Germinal Peiro au nom de la commission des Affaires économiques sur le projet de loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt (n° 2066), 26 juin 2014. La disposition en discussion était alors l’article 41 du projet de loi.
343 () L’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 proclame que « toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminés, n’a point de Constitution ».
344 () Considérant n° 16 de la décision précitée.
345 () Mme Mireille Imbert-Quaretta, précédemment présidente de la commission de protection des droits de la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur Internet (Hadopi), a été désignée par arrêté du ministre de la Justice du 27 novembre 2015.
346 () Article R. 40-49 du code de procédure pénale.
347 () Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française.
348 () Loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer.
349 () Loi n° 85-595 du 11 juin 1985 relative au statut de l’archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon.
350 () Loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d’outre-mer.
351 () Régis Fraisse, « Les collectivités territoriales régies par l’article 74 », Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel, n° 35, avril 2012.
352 () Article 4 de la loi du 29 juillet 1961 précitée.
353 () Ainsi disposent le 2° de l’article 14 du statut polynésien et le 2° du I de l’article 21 du statut néo-calédonien.
354 () Cet organisme a procédé à son inscription sur le registre de l’Assemblée nationale, s’engageant ainsi dans une démarche de transparence et de respect du code de conduite établi par le Bureau de l’Assemblée nationale.