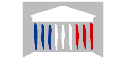______
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 2 mars 2016.
RAPPORT
FAIT
AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE SUR LA PROPOSITION DE LOI (n° 2931) portant réforme de la prescription en matière pénale
PAR M. Alain TOURRET
Député
——
SOMMAIRE
___
Pages
I. DES RÈGLES DE PRESCRIPTION ANCIENNES ET DEVENUES EN PARTIE INADAPTÉES 9
A. FRAGILISÉE DANS SES FONDEMENTS, LA PRESCRIPTION DEMEURE JUSTIFIÉE… 9
B. … MAIS LES RÈGLES QUI LA RÉGISSENT SE HEURTENT AUJOURD’HUI AUX EXIGENCES DE RÉPRESSION DES INFRACTIONS ET DE SÉCURITÉ JURIDIQUE 12
II. MODERNISER LE DROIT DE LA PRESCRIPTION AFIN DE MIEUX PROTÉGER LES INTÉRÊTS DE LA SOCIÉTÉ 14
A. ALLONGER LES DÉLAIS DE DROIT COMMUN 15
B. RENDRE IMPRESCRIPTIBLES LES CRIMES DE GUERRE 15
C. CLARIFIER LES MODALITÉS DE COMPUTATION DES DÉLAIS DE PRESCRIPTION DE L’ACTION PUBLIQUE 16
III. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR VOTRE COMMISSION DES LOIS 18
A. L’ENCADREMENT DE L’EXTENSION DE LA RÈGLE DE L’IMPRESCRIPTIBILITÉ AUX CRIMES DE GUERRE 18
1. Le cantonnement de la règle de l’imprescriptibilité aux crimes de guerre connexes à un ou plusieurs crimes contre l’humanité 18
2. La définition des modalités d’entrée en vigueur de cette règle 18
B. L’AMÉLIORATION DE LA DÉFINITION DES ACTES INTERRUPTIFS ET DE LEUR PORTÉE 19
CONTRIBUTION DE M. GEORGES FENECH, CO-RAPPORTEUR SUR LA MISE EN APPLICATION DE LA LOI (article 86, alinéa 7, du Règlement) 21
DISCUSSION GÉNÉRALE 25
EXAMEN DES ARTICLES 39
Article 1er (art. 7, 8, 9, 9-1 [nouveau], 9-2 [nouveau] et 9-3 [nouveau] du code de procédure pénale) : Modification des dispositions relatives à la prescription de l’action publique 39
Article 2 (art. 133-2, 133-3 et 133-4 du code pénal) : Modification des dispositions relatives à la prescription de la peine 105
Article 3 (art. 213-5, 215-4, 221-18, 434-25 et 462-10 du code pénal ; art. 85, 706-25-1, 706-31 et 706-175 du code de procédure pénale ; art. L. 211-12, L. 212-37, L. 212-38 et L. 212-39 du code de justice militaire) : Mesures de coordination 110
Article 4 (nouveau) : Modalités d’entrée en vigueur des dispositions relatives à l’imprescriptibilité des crimes de guerre 111
TABLEAU COMPARATIF 113
ANNEXE 1 : LES DÉLAIS DE PRESCRIPTION AVANT ET APRÈS LA RÉFORME PROPOSÉE 124
ANNEXE 2 : AVIS DU CONSEIL D’ÉTAT DU 1ER OCTOBRE 2015 SUR LA PROPOSITION DE LOI 129
PRINCIPAUX APPORTS DE LA COMMISSION
Lors de sa réunion du mercredi 2 mars 2016, la commission des Lois a apporté à la proposition de loi portant réforme de la prescription en matière pénale les principales modifications présentées ci-après.
–– Aux articles 1er et 2, à l’initiative de votre rapporteur, de M. Georges Fenech et du Gouvernement, elle a réservé l’imprescriptibilité, initialement étendue à l’action publique de l’ensemble des crimes de guerre et aux peines prononcées pour ces mêmes crimes, aux seuls crimes de guerre connexes à un ou plusieurs crimes contre l’humanité, eux-mêmes déjà imprescriptibles.
–– À l’article 1er, elle a précisé, sur proposition de votre rapporteur, que les plaintes adressées par la victime à un fonctionnaire auquel la mise en mouvement de l’action publique est confiée par la loi seraient interruptives de prescription, au même titre que celles déposées auprès d’un service de police judiciaire ou adressées au procureur de la République.
–– Au même article, elle a adopté un amendement de votre rapporteur rétablissant l’effet de l’acte interruptif sur le cours de la prescription de l’action publique tel qu’il est prévu par le droit actuel – tout acte interruptif fait courir un nouveau délai de prescription d’une durée égale à celle du délai initial – et supprimant le délai de prescription abrégé de moitié que l’alinéa 17 de cet article prévoyait de faire courir après un tel acte.
–– Au même article, elle a étendu l’effet des actes interruptifs à l’égard de toutes les personnes potentiellement impliquées – co-auteures ou complices – et des infractions connexes à l’infraction principale poursuivie, dans le prolongement de la jurisprudence de la Cour de cassation en la matière.
–– Enfin, elle a, sur proposition du rapporteur, introduit un nouvel article
– l’article 4 – qui définit les modalités d’entrée en vigueur des dispositions de la proposition de loi relatives à l’imprescriptibilité de l’action publique et des peines des crimes de guerre connexes à un ou plusieurs crimes contre l’humanité. Ainsi, l’imprescriptibilité de l’action publique s’appliquera aux faits commis postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi. L’imprescriptibilité des peines, quant à elle, concernera les condamnations définitives prononcées pour des faits commis postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi.
Mesdames, Messieurs,
La présente proposition de loi est le fruit d’un travail débuté au mois de janvier 2015. Elle est largement inspirée des conclusions de la mission d’information sur la prescription en matière pénale, créée par la commission des Lois de notre assemblée, que M. Georges Fenech et l’auteur de ces lignes ont conduite au printemps dernier (1). Elle illustre, comme la proposition de loi relative à la réforme des procédures de révision et de réexamen d’une condamnation pénale définitive, adoptée par l’Assemblée nationale le 11 juin 2014 en deuxième lecture (2), le rôle que peut et doit jouer le Parlement dans la conception de la loi.
Ce texte est aussi, et surtout, le support d’une réforme nécessaire, tant le droit de la prescription, largement hérité du code d’instruction criminelle de 1808, apparaît complexe, inadapté à l’exigence de répression des infractions, notamment criminelles, et insuffisamment respectueux du principe de sécurité juridique. Renoncer à adapter ce cadre juridique aux attentes de la société reviendrait d’ailleurs à ignorer les demandes des praticiens du droit, avocats comme magistrats, qui, dans leur très grande majorité, ne se satisfont plus d’un système à bout de souffle.
Ce constat n’est pas nouveau. Déjà, en 2007, les sénateurs Jean-Jacques Hyest, Hugues Portelli et Richard Yung avaient mis en lumière, dans le cadre d’une mission d’information sur le régime des prescriptions civiles et pénales (3), les failles de ce pan de notre procédure pénale. Hélas, de ses recommandations, seules celles relatives à la réforme de la prescription civile trouvèrent une traduction législative (4). La réflexion se poursuivit néanmoins. En mars 2010, un avant-projet de réforme du code de procédure pénale, soumis à concertation par Mme Michèle Alliot-Marie, alors garde des Sceaux, ministre de la justice et des libertés, proposait une réécriture, notamment, des dispositions encadrant la prescription pénale. Certes, ce projet est resté lettre morte. Mais comment ne pas y voir la traduction de l’impérieuse rénovation de notre régime de prescription ?
Éclairé par les travaux conduits sur le sujet à l’Assemblée nationale et au Sénat, le Parlement a – enfin – l’occasion d’apporter au droit de la prescription les modifications qui s’imposent. Les auteurs de la proposition de loi se félicitent que les parlementaires bénéficient, en l’espèce, de l’éclairage juridique précieux du Conseil d’État, saisi par le président de l’Assemblée nationale dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article 39 de la Constitution. Les discussions au sein de la section de l’intérieur, puis à l’occasion de la réunion de l’Assemblée générale, ont convaincu votre rapporteur et son collègue Georges Fenech de la nécessité de faire évoluer la rédaction de certaines dispositions du texte.
La commission des Lois est à présent appelée à examiner une proposition de loi qui s’efforce de répondre à l’inadaptation du cadre juridique actuel (I) afin de mieux protéger les intérêts de la société tout entière (II). L’Assemblée nationale se prononcera le jeudi 10 mars, dans le cadre de l’ordre du jour réservé aux initiatives du groupe Radical, républicain, démocrate et progressiste, conformément à l’article 48, alinéa 5, de la Constitution.
Institution séculaire, la prescription, dont les premières traces remontent au règne de l’empereur Auguste, repose sur des fondements fragiles pour certains, solides pour d’autres (A). S’il paraît indispensable de la conserver, il faut cependant adapter les dispositions qui la régissent à l’exigence de répression des infractions autant qu’à l’impératif de sécurité juridique (B).
La prescription connaît plusieurs fondements, plus ou moins anciens (5).
Longtemps, elle est apparue justifiée par l’écoulement du temps. Au-delà d’un certain délai, la « grande loi de l’oubli », l’un de ses fondements traditionnels, commandait de renoncer à mettre à exécution une décision pénale trop ancienne et donc dépourvue d’utilité. Parallèlement, la « souffrance du coupable », autre justification de la prescription, reposait sur l’idée que le temps avait pu lui permettre de s’amender : les remords et les angoisses liées à la peur d’être condamné remplaçaient, en quelque sorte, la peine.
Ces deux fondements, étroitement liés, sont désormais dépourvus d’une grande partie de leur force. Ils sont d’ailleurs contestés par la doctrine comme par les praticiens du droit. Il y a près de vingt ans, M. Jean-François Renucci, professeur à l’Université Nice Sophia Antipolis, s’interrogeait déjà en ces termes : « comment admettre l’oubli dès lors que la victime réclame réparation, même si cette demande est tardive ? Les remords sont-ils vraiment une réalité, en particulier pour les délinquants qui sont enracinés dans la marginalité ? D’autre part, on peut se demander si la prescription ne risque pas d’être ressentie comme un encouragement à la récidive (...). Le danger peut être toujours présent, de sorte que du point de vue de l’utilité sociale et de la défense de la société, la prescription de l’action publique n’est pas à l’abri de la critique » (6). Ce point de vue conserve toute son actualité. Pour l’Union syndicale des magistrats, dont les représentants ont été reçus par les auteurs de la proposition de loi à l’occasion des auditions de la mission d’information qu’ils ont conduite, « le dogme fondateur de la prescription, selon lequel la tranquillité publique serait troublée par des poursuites tardives, est largement remis en question, voire inversé, le bénéfice de ce droit à l’oubli [n’étant] plus admis, le temps n’atténuant pas le danger que les délinquants représentent pour la société » (7).
Autre fondement traditionnel de la prescription, le dépérissement des preuves est aujourd’hui, lui aussi, remis en question. Il est indiscutable que l’écoulement du temps efface certains éléments susceptibles de prouver la culpabilité ou l’innocence d’une personne, de même qu’il rend les témoignages humains fragiles, voire impossibles. Il n’en reste pas moins vrai que les progrès réalisés dans le recueil, l’exploitation et la conservation des preuves digitales et génétiques, mais aussi olfactives et acoustiques, permettent de faire progresser les enquêtes pénales, notamment criminelles, plusieurs années après la commission des faits. L’« affaire Roussel » en est une illustration : en 2009, à la demande de sa famille, une empreinte génétique fut, pour la première fois, relevée sur les sous-vêtements de Delphine Roussel, disparue le 17 mai 1994 à l’âge de dix-neuf ans et découverte étranglée six jours plus tard, ce qui permit de rapprocher le profil génétique établi de celui d’Éric G., condamné quelques années plus tard à la réclusion criminelle à perpétuité.
Indiscutablement, les progrès à venir dans les domaines de l’investigation et de la conservation des preuves continueront de contester au dépérissement des preuves son statut de fondement de la prescription.
Pour autant, faut-il considérer, à la lumière des éléments qui précèdent, que la prescription ne repose plus que sur des fondements sans consistance, appartenant plus au passé qu’au présent ? Faut-il se résigner à la voir disparaître ? Assurément non, car elle conserve une utilité indéniable.
D’abord, la prescription demeure, malgré les progrès scientifiques, un rempart contre les témoignages humains trop anciens et, partant, trop fragiles. Parce que la science ne peut prétendre résoudre l’intégralité des affaires pénales, il faut admettre que les innovations en la matière, aussi poussées soient-elles, ne sont pas un remède absolu au dépérissement des preuves.
Ensuite, elle est aussi, dans une certaine mesure, une forme de protection des victimes. C’est ce que soulignait, de manière convaincante, le Syndicat de la magistrature dans un document annexé au rapport d’information fait par les auteurs de la proposition de loi : « [l]’argument fort des partisans de l’allongement, voire de la suppression de la prescription est celui qui repose sur la prise en compte des victimes. Ils insistent sur la dimension thérapeutique du procès, qui permettrait seul à la victime de faire son deuil du traumatisme causé par l’infraction.
C’est oublier, d’abord, que le procès qui se termine par un acquittement ou une relaxe ʺ au bénéfice du doute ʺ en raison de l’absence ou de l’insuffisance des preuves est d’une très grande violence pour la victime. Elle vit ces décisions comme une négation de sa parole et ce, alors qu’elle a supporté la réactivation de son traumatisme et, parfois, le mépris renouvelé de la personne mise en cause tout au long de l’enquête et du procès.
Même en cas de déclaration de culpabilité, le procès qui intervient trop longtemps après les faits ne peut se terminer que par une ʺ peine symbolique ʺ. Il ne pourra donc apaiser les souffrances de la victime, car si la société démocratique admet et réclame l’individualisation des peines, la victime ne peut la supporter » (8).
En outre, conformément à une idée ancienne mais toujours vraie, la prescription constitue la sanction de l’inaction de l’autorité judiciaire. Pour reprendre les termes de Mme Dominique Noëlle Commaret, ancienne avocate générale à la Cour de cassation, « parce que tout temps mort excessif laisse présumer le désintérêt de la victime ou du ministère public et leur renoncement, dans un système marqué par le principe d’opportunité des poursuites, la prescription apparaît nettement comme la réponse procédurale apportée à l’inaction ou l’oubli, volontaire ou involontaire » (9).
Cette idée mérite toutefois d’être nuancée. En effet, la prescription de l’action publique ne saurait être considérée comme la sanction de l’inaction de l’autorité judiciaire ou des parties civiles qu’à la condition qu’elles aient été en mesure d’agir et ne l’aient pas fait. Elle serait donc davantage la « sanction d’un exercice tardif du droit de punir » (10), une fois les poursuites engageables ou engagées, plutôt que la sanction aveugle de la négligence des personnes susceptibles de mettre en mouvement l’action publique. Ainsi que l’indiquaient les auteurs de la présente proposition de loi dans leur rapport d’information sur la prescription en matière pénale, celle-ci « trouverait ici une justification plus contemporaine mais non moins solide : elle serait la traduction du droit à être jugé dans un délai raisonnable » (11).
Enfin, la prescription participe à la régulation de l’activité de notre système judiciaire, qui souffre d’un manque de moyens endémique. Y renoncer serait, en conséquence, irréaliste voire dangereux car cela placerait « la justice dans l’impossibilité de satisfaire les attentes de nos concitoyens » (12). Pour votre rapporteur, la prescription se justifie aussi par des considérations de bonne gestion de politique pénale. En effet, si notre société est indéniablement de plus en plus hermétique à la notion d’oubli, il n’en reste pas moins que l’action de l’autorité judiciaire doit être guidée par la nécessité de répondre en priorité aux troubles les plus récents et les plus graves à l’ordre public. Peut-on raisonnablement contester l’idée selon laquelle, dans l’immense majorité des cas, le trouble à l’ordre public causé par une infraction diminue au fur et à mesure que le temps s’écoule et disparaît même parfois complètement ? Sans doute pas. En définitive, pour reprendre les termes de M. Jean Danet, avocat honoraire et maître de conférences à l’Université de Nantes, « une bonne administration de la preuve nécessite (…) de facto une sélection des dossiers sur lesquels la police et la justice travaillent. Que cette sélection passe par le critère du temps qui s’est écoulé depuis la commission ou la découverte de l’infraction n’est pas choquant bien au contraire. Ce critère a l’avantage d’être général à gravité équivalente d’infraction. Il renvoie à la présomption, relative certes, mais bel et bien réelle de ce que le trouble à l’ordre public est plus vif sitôt les faits que longtemps après » (13).
B. … MAIS LES RÈGLES QUI LA RÉGISSENT SE HEURTENT AUJOURD’HUI AUX EXIGENCES DE RÉPRESSION DES INFRACTIONS ET DE SÉCURITÉ JURIDIQUE
Si le principe même de la prescription reste fondé et nécessaire en droit pénal français, les règles qui la régissent sont devenues, au fil du temps, en partie inadaptées aux attentes de la société en matière de répression des infractions et de sécurité juridique. Demeurées pratiquement inchangées depuis leur inscription aux articles 635 à 642 du code d’instruction criminelle de 1808, elles s’avèrent aujourd’hui datées tant sont nombreuses les initiatives législatives et les évolutions jurisprudentielles tendant à les modifier ponctuellement, voire à les contourner.
M. Georges Fenech et votre rapporteur ont souhaité inscrire leur projet de réforme du droit de la prescription pénale dans la continuité des réflexions menées, en 2007, par les sénateurs Jean-Jacques Hyest, Hugues Portelli et Richard Yung, auteurs du rapport d’information précité sur le régime des prescriptions civiles et pénales. Comme eux, ils considèrent que « [l]es délais de prescription de l’action publique apparaissent aujourd’hui excessivement courts » et font observer que « [l]’allongement des délais de prescription décidé par le législateur pour certaines catégories d’infraction, les initiatives jurisprudentielles tendant à reporter le point de départ du délai de prescription dans certains cas comme la multiplication des motifs d’interruption et de suspension de la prescription sont autant de témoignages de l’inadaptation des délais actuels de prescription aux attentes de la société » (14). Votre rapporteur se contentera de rappeler succinctement les grands traits de ces évolutions qui justifient plus que jamais une intervention du législateur.
Au départ, l’ordonnancement des délais de prescription était adossé à la classification tripartite des infractions – contraventions, délits et crimes. Aussi les délais de prescription de l’action publique étaient-ils fixés par les articles 7 à 9 du code de procédure pénale respectivement à un an, trois ans et dix ans et les peines se prescrivaient-elles par trois, cinq et vingt années révolues en application des articles 133-2 à 133-4 du code pénal (15). Ce bel ordonnancement a peu à peu éclaté avec la multiplication des régimes légaux de prescription abrégée ou allongée. Le législateur a, d’une part, instauré des délais de prescription de l’action publique écourtés, comme pour certaines infractions de presse, afin de préserver la liberté d’expression, ou certaines infractions prévues par le code électoral, pour éviter la remise en cause trop tardive d’un scrutin et ne pas bouleverser la composition d’un organe élu (16). Il a, d’autre part, prévu des délais de prescription allongés pour tenir compte de la vulnérabilité particulière des victimes et de la gravité ou du caractère particulièrement odieux de certaines infractions (infractions, notamment sexuelles, sur les mineurs ; actes terroristes ; trafic de stupéfiants…) (17).
Les modalités de computation du délai de prescription de l’action publique ont, elles aussi, connu de nombreux bouleversements. En principe fixé par les articles 7 à 9 précités au jour de la commission de l’infraction, le point de départ de ce délai a été décalé par le législateur à la majorité de la victime lorsqu’elle était mineure au moment des faits, « à compter du jour où l’infraction apparaît à la victime dans des conditions permettant l’exercice de l’action publique » lorsqu’elle était vulnérable ou, plus ponctuellement, à un autre moment précisément défini en raison de la spécificité de l’infraction (usure, banqueroute…).
De son côté, le juge s’est affranchi de la lettre des articles 7 à 9 du code de procédure pénale et a inauguré à partir des années 1930 une jurisprudence reportant le point de départ du délai de prescription de l’action publique de certaines infractions « astucieuses », occultes par nature ou dissimulées par des manœuvres, tout particulièrement en matière économique et financière (18).
Par ailleurs, la jurisprudence, une nouvelle fois en dehors de tout fondement légal, a multiplié les hypothèses dans lesquelles le cours du délai de prescription pouvait être modifié, d’une part, en développant une conception extensive des motifs d’interruption de ce délai, en principe limités par les mêmes articles aux actes « d’instruction ou de poursuite », et, d’autre part, en autorisant la suspension de ce délai lorsque l’exercice des poursuites se trouvait valablement empêché (19).
Ces évolutions sont préoccupantes. Fruits de décisions législatives et jurisprudentielles généralement ponctuelles, elles ont fait perdre au droit de la prescription sa cohérence, sa stabilité et sa lisibilité. Elles génèrent également, chez le justiciable, un sentiment légitime d’insécurité juridique lorsque le juge, contraint par son office, applique au cas par cas, parfois de manière erratique, des règles certes inspirées par l’équité mais contra legem.
Mais ces évolutions invitent surtout le législateur à adapter les règles régissant la prescription aux nouvelles attentes de la société et à clarifier et préciser leur rédaction dans le sens d’une plus grande sécurité juridique et d’une meilleure lisibilité du droit. Pour être utile, l’intervention du législateur doit respecter plusieurs exigences contradictoires, rassemblées par M. Jean Danet sous la forme d’« un quadruple équilibre :
–– équilibre entre le droit à la sécurité et celui du procès équitable ;
–– équilibre entre le droit des victimes d’obtenir réparation après une déclaration de culpabilité de l’auteur d’une infraction et celui de chacun d’être jugé dans un délai raisonnable ;
–– équilibre entre la mise en œuvre des moyens techniques d’élucidation des infractions, en constante évolution et qui justifient de laisser ouvertes des enquêtes avec la nécessité de délimiter le champ du travail de la police, de fixer des priorités pour éviter la paralysie, la dispersion des moyens, l’arbitraire de choix laissés aux forces de police ;
–– et enfin, équilibre entre les différents foyers de sens de la peine, entre le rappel de la loi et la défense de la société d’une part qui n’impliquent pas la prescription et d’autre part le sens éducatif, le principe de proportionnalité, la nécessité et l’utilité de la peine qui, eux, la justifient » (20).
Attendue, la réforme de la prescription pénale, tout entière guidée par le souci de mieux protéger les intérêts de notre société, passe essentiellement par l’allongement des délais de droit commun (A) et la clarification des modalités de computation de ces délais (C). Les auteurs de la proposition de loi ont, par ailleurs, tenu à tirer les conséquences de la proximité entre les crimes de guerre et les crimes contre l’humanité, et ont, à cette fin, rendu les premiers imprescriptibles, comme le sont déjà les seconds (B).
Tirant les conséquences de l’excessive brièveté des délais de prescription de l’action publique des crimes et des délits, notamment à la lumière des comparaisons internationales (21), l’article 1er de la proposition de loi, directement inspiré de la proposition n° 4 de la mission d’information sur la prescription en matière pénale, porte à vingt et six ans le délai respectivement applicable aux crimes et aux délits. Il ne revient pas, en revanche, sur les dispositions qui régissent à ce jour les délais de prescription dérogatoires au droit commun, allongés – comme en matière d’infractions terroristes ou de trafic de stupéfiants – ou abrégés – comme en matière de presse ou de droit électoral.
Par ailleurs, dans un souci de clarification du droit, largement réclamée par les professionnels, les articles 1er et 2 harmonisent la durée des délais de prescription de l’action publique et des peines en matière criminelle comme délictuelle. Ces mêmes articles s’efforcent, en outre, de remédier à l’éparpillement des dispositions encadrant les délais dérogatoires de prescription qui figurent actuellement tantôt dans le code de procédure pénale, tantôt dans le code pénal.
Comme l’atteste la multiplication des délais dérogatoires au droit commun applicables à certaines infractions troublant gravement l’ordre public ou particulièrement odieuses (terrorisme, stupéfiants, crimes de sang contre les mineurs…), les règles relatives à la prescription pénale apparaissent de plus en plus comme une échelle de gravité des infractions concurrente de celle des peines. En témoigne également le choix fait par le législateur de ne soumettre à aucune prescription certains faits atroces, ceux dont Paul Ricœur disait qu’ils « ont laissé leur empreinte traumatique dans les cœurs et sur les corps » (22).
En France, dans le prolongement du statut de Nuremberg du 8 août 1945, seuls sont imprescriptibles le crime de génocide et les autres crimes contre l’humanité, en vertu de l’article 213-5 du code pénal. À la suite des travaux qu’ils ont menés dans le cadre de la mission d’information sur la prescription en matière pénale, M. Georges Fenech et votre rapporteur estiment nécessaire d’étendre le champ de l’imprescriptibilité aux autres crimes dont la nature même est d’être imprescriptibles. Les articles 1er et 2 de la présente proposition de loi rendent ainsi imprescriptibles les crimes de guerre mentionnés au livre quatrième bis du code pénal, aujourd’hui soumis à un délai de prescription de l’action publique et des peines de trente ans.
Loin de traduire une banalisation de l’imprescriptibilité dans notre droit, ces articles tirent les conséquences de l’unité de régime applicable à l’ensemble des crimes contre l’humanité et des crimes de guerre au niveau international, lesquels relèvent généralement d’une même conception et constituent des faits susceptibles de recevoir la double qualification.
La proposition de loi ne se borne pas à adapter les délais de prescription de l’action publique et des peines aux exigences de répression des infractions et aux attentes des acteurs de la justice et de la société. Elle procède également à la modernisation des règles de computation des délais de prescription de l’action publique (point de départ, interruption et suspension), modernisation nécessaire et réclamée par de nombreux praticiens et universitaires devant la mission d’information sur la prescription en matière pénale.
En premier lieu, l’article 1erréaffirme le principe aujourd’hui en vigueur selon lequel le délai de prescription de l’action publique court à compter du jour où l’infraction a été commise mais lui apporte deux dérogations.
D’une part, il maintient le report du point de départ à la majorité de la victime pour les infractions commises sur les mineurs. Cette disposition, qui constitue un acquis ancien et constamment réaffirmé dans notre législation depuis 1989, est essentielle à la protection des mineurs. En revanche, compte tenu des difficultés pratiques qu’il soulève et de l’insécurité juridique qu’il génère, il supprime l’actuel dernier alinéa de l’article 8 précité, qui fait courir le délai de prescription de l’action publique de certains délits « commis à l’encontre d’une personne vulnérable du fait de son âge, d’une maladie, d’une infirmité, d’une déficience physique ou psychique ou de son état de grossesse (…) à compter du jour où l’infraction apparaît à la victime dans des conditions permettant l’exercice de l’action publique ».
D’autre part, il consacre dans un nouvel article 9-2 du code de procédure pénale la jurisprudence de la Cour de cassation relative au report du point de départ du délai de prescription de l’action publique en cas d’infraction occulte ou dissimulée (premier alinéa) et définit chacune de ces catégories d’infractions (deuxième et dernier alinéas).
En deuxième lieu, l’article 1er précise dans un nouvel article 9-1 du même code les modalités d’interruption du délai de prescription de l’action publique en s’inspirant de l’interprétation qu’a développée la Cour de cassation des dispositions imprécises de l’actuel article 7 du code de procédure pénale. Il clarifie la nature (« tout acte d’enquête, d’instruction ou de poursuite ») et les finalités des actes susceptibles d’être interruptifs (« tendant effectivement à la constatation des infractions ou à la recherche, à la poursuite ou au jugement de leurs auteurs »), qu’ils émanent de l’autorité judiciaire ou de la personne exerçant l’action civile. Tirant les conséquences de la place aujourd’hui reconnue à la victime dans le procès pénal, il ajoute à la liste de ces actes « les plaintes adressées au procureur de la République ou à un service de police judiciaire », ce que la jurisprudence s’était toujours refusée à faire (premier alinéa).
Le même article règle la question des effets de l’interruption dans le temps et à l’égard des personnes impliquées dans l’infraction.
À la différence de ce que prévoit le droit actuel, il dispose que tout acte interruptif ferait courir un délai de prescription abrégé de moitié par rapport au délai initial (deuxième alinéa). Votre rapporteur reviendra plus longuement sur l’objectif poursuivi à travers ce nouveau dispositif, destiné à sanctionner l’inaction prolongée de l’autorité judiciaire, mais aussi sur les difficultés soulevées par sa mise en œuvre concrète (23).
Des précisions sont apportées afin que les règles relatives à l’interruption « s’appliquent également aux personnes qui ne seraient pas visées par l’un des actes » précédemment mentionnés (dernier alinéa).
Enfin, l’article 1er insère un nouvel article 9-3 au sein du code de procédure pénale qui précise les conditions de suspension du délai de prescription de l’action publique en s’inspirant une nouvelle fois des critères dégagés par la Cour de cassation en l’absence de disposition générale en la matière. Il consacre au plan législatif la jurisprudence de la Cour relative à la suspension de la prescription en cas d’impossibilité d’agir pour les parties poursuivantes (« en présence soit d’un obstacle de droit, soit d’un obstacle de fait insurmontable, rendant impossible l’exercice des poursuites »).
La commission des Lois a précisé certaines dispositions de la proposition de loi par rapport à la version initialement proposée ses auteurs, notamment afin de tenir compte des remarques et suggestions formulées par le Conseil d’État dans son avis du 1er octobre 2015. Les principales modifications ont porté sur l’imprescriptibilité des crimes de guerre (A) ainsi que sur la définition et la portée des actes interruptifs du cours de la prescription de l’action publique (B).
1. Le cantonnement de la règle de l’imprescriptibilité aux crimes de guerre connexes à un ou plusieurs crimes contre l’humanité
Les auteurs de la proposition de loi ont été attentifs aux interrogations et aux inquiétudes soulevées par l’extension de la règle de l’imprescriptibilité aux crimes de guerre. Après avoir interrogé le Conseil d’État sur la conformité de cette disposition à la Constitution et à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ils ont réfléchi aux moyens d’en encadrer davantage la portée afin de conserver son caractère exceptionnel à la règle de l’imprescriptibilité et tenir compte de l’hétérogénéité des crimes de guerre, lesquels ne présentent pas tous la même gravité que les crimes contre l’humanité et ne touchent pas uniformément l’ensemble de la communauté internationale.
Tirant les conséquences de ces observations, la commission des Lois a adopté, respectivement aux articles 1er et 2, trois amendements identiques de votre rapporteur, de M. Georges Fenech et du Gouvernement réservant la règle de l’imprescriptibilité, aujourd’hui applicable aux seuls crimes contre l’humanité, aux crimes de guerre connexes à un ou plusieurs crimes contre l’humanité.
Sur proposition de votre rapporteur, la commission des Lois a introduit dans le présent texte un nouvel article – l’article 4 – destiné à préciser les modalités d’entrée en vigueur des dispositions relatives à l’imprescriptibilité de l’action publique et des peines des crimes de guerre connexes à un ou plusieurs crimes contre l’humanité.
Ainsi, la Commission, suivant la recommandation du Conseil d’État, a jugé pertinent de rendre applicable l’imprescriptibilité de l’action publique aux faits commis postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi qui résulterait de l’adoption de la présente proposition de loi. Elle a, par cohérence, souhaité que l’imprescriptibilité des peines s’applique aux condamnations définitives prononcées pour des faits commis postérieurement à l’entrée en vigueur de la même loi.
À l’article 1er, la commission des Lois a enrichi la définition et la portée des actes qui interrompent le délai de prescription de l’action publique :
–– sur proposition de votre rapporteur, elle a décidé que les plaintes adressées par la victime à un fonctionnaire auquel la mise en mouvement de l’action publique est confiée par la loi seraient interruptives de prescription, au même titre que celles déposées auprès d’un service de police judiciaire ou adressées au procureur de la République ;
–– elle a supprimé le délai de prescription abrégé de moitié que l’alinéa 17 de cet article prévoyait de faire courir après tout acte interruptif afin de tenir compte des difficultés juridiques soulevées par cette disposition et des réserves formulées à son encontre : au terme de la nouvelle rédaction de cet alinéa, tout acte interruptif fera courir un nouveau délai de prescription d’une durée égale à celle du délai initial, comme le prévoit le droit en vigueur ;
–– elle a étendu l’effet des actes interruptifs à l’égard de toutes les personnes potentiellement impliquées – co-auteures ou complices – et des infractions connexes à l’infraction principale qui est poursuivie, dans le prolongement de la jurisprudence de la Cour de cassation en la matière.
CONTRIBUTION DE M. GEORGES FENECH, CO-RAPPORTEUR SUR LA MISE EN APPLICATION DE LA LOI
(article 86, alinéa 7, du Règlement)
En mai 2015, le rapport de la mission d’information conduite par Alain Tourret et moi-même, relatif à la réforme du régime des prescriptions pénales, était adopté à l’unanimité des membres de la commission des Lois.
L’actuelle proposition de loi soumise à notre examen avait reçu l’aval de l’ancien président de notre commission, M. Jean-Jacques Urvoas, lequel avait saisi le président de l’Assemblée nationale pour transmission du texte au Conseil d’État. La haute assemblée a émis un avis favorable à l’ensemble du dispositif.
Cette procédure législative exceptionnelle se justifiait par l’importance que ce texte revêt pour la modernisation et la sécurisation de la justice pénale.
En effet, cette proposition de loi se veut équilibrée et protectrice à la fois de la société et du justiciable, conduisant, au-delà des clivages politiques traditionnels, à la recherche d’un consensus.
Il convient de rappeler les circonstances de la naissance de cette proposition de loi.
Nous sommes partis d’un double constat :
1) La perception que nous nous faisons du temps au 21ème siècle, y compris du temps judiciaire, n’est plus celle des contemporains du code pénal napoléonien. Nous vivons à l’heure de l’internet, de la mémoire conservée et de l’allongement de l’espérance de vie (plus de quatre-vingts ans aujourd’hui, quand elle n’était que de quarante-cinq ans sous Napoléon Premier). Dès lors, une société de la mémoire ne pouvait plus se satisfaire du fondement de l’oubli pour justifier des prescriptions perçues comme trop courtes, notamment pour les crimes les plus graves.
2) D’autre part, à l’époque des rédacteurs du code d’instruction criminelle de 1808, la police scientifique n’existait pas, on ne connaissait pas l’empreinte papillaire et encore moins la trace génétique. Dès lors, ce second fondement des courtes prescriptions, en l’espèce la disparition ou le dépérissement des preuves, ne tient plus à l’heure des formidables progrès de la preuve scientifique (expertise génétique, balistique, des voix et même des odeurs, etc.).
Ces fondements ne peuvent donc plus justifier une prescription de dix ans en matière criminelle et de trois ans en matière délictuelle.
D’ailleurs, à l’évidence, la justice recherche, sans le dire expressément, tous les moyens pour écarter la prescription, notamment face au trouble à l’ordre public profond et durable occasionné par certains crimes. Ainsi, dans l’affaire des disparues de l’Yonne, pour éviter de constater l’extinction de l’action publique, les juges ont utilisé un « subterfuge » juridique, en considérant qu’un simple « soit transmis » du parquet adressé à la DDASS (acte administratif et non judiciaire) avait interrompu la prescription. C’est ainsi qu’a pu se tenir le procès d’Émile Louis.
Si l’on peut légitimement émettre des critiques juridiques sur cette analyse, la solution retenue a répondu à une attente des familles des victimes, et de la société en général.
Nous ajouterons que la grande loi de l’oubli a en outre perdu de sa force face aux nombreuses associations de victimes en capacité de maintenir durablement la mémoire des faits et dénoncer une forme de déni de justice en raison de la prescription acquise.
Après ce double constat, le rapporteur et moi-même avons été convaincus de la nécessité de remettre de l’ordre dans des dispositions devenues incohérentes et inadaptées en raison des réformes législatives multiples, et des décisions jurisprudentielles prises « contra legem ».
Il appartenait en conséquence au législateur d’envisager une réforme d’ensemble pour mettre fin à l’insécurité juridique découlant de ces incohérences et incertitudes. À cet égard, lors de son audition devant les co-rapporteurs de la mission d’information, le procureur général près la Cour de cassation, M. Jean-Claude Marin, déclarait : « Il me semble opportun qu’une réforme législative cohérente et harmonisatrice des différentes règles s’agissant de la prescription de l’action publique soit mise en œuvre afin de lui redonner un sens et d’améliorer la prévisibilité juridique pour l’ensemble des justiciables. »
Saisissant l’occasion de cette réforme d’ensemble, le moment était venu, en conformité avec nos engagements internationaux, de vous proposer de rendre imprescriptibles les crimes de guerre connexes à un crime de guerre contre l’humanité.
J’insisterai enfin sur la construction jurisprudentielle relative aux infractions dites « occultes » et « dissimulées » consistant à retarder le point de départ de la prescription au jour de leur révélation.
Il en allait de même pour les situations dans lesquelles un obstacle rend l’exercice des poursuites impossible en application de la règle romaine « contra non valentem agere non currit praescriptio » (la prescription ne court pas contre celui qui se trouve dans l’impossibilité d’agir).
C’est sans doute l’un des points les plus délicats de ce texte. Il concerne essentiellement la matière économique et financière.
La question se posait dans les termes suivants :
Fallait-il mettre un terme à la jurisprudence « contra legem » qui fixe le point de départ de la prescription d’une infraction occulte et dissimulée au jour de sa révélation, et ce en conflit avec l’article 7 du code de procédure pénale qui, rappelons-le, fixe le point de départ de la prescription au jour où l’infraction a été commise ?
Ou bien fallait-il consacrer par la loi cette ancienne jurisprudence datant de 1935, pour sortir des critiques récurrentes de l’insécurité juridique tout en préservant l’efficacité de la lutte contre la délinquance astucieuse ?
C’est cette seconde solution que, d’un commun accord avec le rapporteur, nous avons retenue après avoir longuement consulté notamment les magistrats du pôle économique et financier.
En effet, face à la complexité et à la clandestinité de certaines infractions, tels que l’abus de biens sociaux ou la grande corruption internationale, qui se jouent des frontières, qui sont commises dans la plus grande opacité par de simples jeux d’écritures ou par la fabrication de faux très difficiles à déceler, la courte prescription en matière délictuelle de 3 ans, même portée à 6 ans, se révélait un obstacle majeur à la poursuite, et à la nécessaire lutte contre la corruption.
C’est pourquoi, il est proposé de consacrer l’arrêt de principe du 10 août 1981 de la Chambre criminelle de la cour de Cassation qui a énoncé que le point de départ de la prescription est fixé « au jour où le délit est apparu et a pu être constaté dans des conditions permettant l’exercice de l’action publique ».
Cette disposition, une fois adoptée, s’inscrira, en outre, dans la continuité des propositions déjà formulées, le 20 juin 2007, par la mission d’information du Sénat conduite par MM. Jean-Jacques Hyest, Hugues Portelli et Richard Yung.
Ce nouveau dispositif adaptera la justice à son temps. Tout en conservant le principe de la prescription auquel notre pays est attaché comme instrument d’apaisement social, nous le moderniserons et le sécuriserons dans l’intérêt du justiciable.
Lors de sa réunion du mercredi 2 mars 2016, la commission des Lois procède à l’examen, sur le rapport de M. Alain Tourret, de la proposition de loi portant réforme de la prescription en matière pénale (n° 2931).
M. le président Dominique Raimbourg. Je suis heureux d’accueillir à mes côtés les deux auteurs de la proposition de loi portant réforme de la prescription en matière pénale : M. Alain Tourret, qui en est le rapporteur, et M. Georges Fenech.
M. Alain Tourret, rapporteur. Cette proposition de loi, inscrite à l’ordre du jour du jeudi 10 mars proposé par le groupe Radical, républicain démocrate et progressiste (RRDP), est le résultat d’un immense travail que Georges Fenech et moi-même avons accompli ensemble. Nous avons préparé ce texte ensemble, et, ensemble, nous avons reçu un grand nombre de spécialistes du sujet.
La prescription est l’un des modes d’extinction de l’action publique. Son existence remonte à l’Empire romain et aux lois d’Auguste relatives, notamment, à l’adultère. Elle traverse l’histoire en se perfectionnant. On retrouve dès 1246, dans la charte d’Aigues-Mortes, octroyée par Louis IX, le futur Saint Louis, un système achevé extrêmement proche de celui en vigueur aujourd’hui. Le droit positif des articles 7 et 8 du code de procédure pénale procède directement du code napoléonien d’instruction criminelle de 1808, qui différencie nettement la prescription selon qu’elle s’applique à des contraventions, des délits ou des crimes. Les délais de prescription sont calculés à partir de la commission des faits. La prescription peut être relative à l’action publique : elle est alors acquise au terme d’un délai d’un an pour les contraventions, après trois ans pour les délits, et après dix ans pour les crimes. Le code pénal la prévoit également concernant l’exécution de la peine qui se prescrit par trois ans — en 1808, ce délai était de deux ans s’agissant des contraventions —, cinq ans et vingt ans.
Le système français caractérisé par sa grande complexité est unique au monde, mais, comme si cela ne suffisait pas, les textes ne sont pas respectés. À partir de 1935, la chambre criminelle de la Cour de cassation s’est en effet systématiquement opposée aux articles 7 et 8 du code de procédure pénale. Le phénomène est unique : depuis cette époque, la plus haute juridiction juge contra legem en toutes circonstances. Cela n’est pas sans poser quelques problèmes en termes de sécurité juridique.
De façon générale, les magistrats cherchent en permanence à faire tomber la prescription lorsqu’elle est invoquée. Comment admettre que l’assassinat de huit nouveau-nés ne soit pas poursuivi parce qu’il est découvert dix ans après les faits ? Chacun d’entre nous ressent bien que cela pose un problème. Les juristes français ont donc œuvré, au cas par cas, pour empêcher l’application de la prescription. Le développement de la criminalité économique n’a fait qu’accentuer cette tendance. Aucune des grandes affaires économiques actuelles n’aurait eu lieu si l’on avait appliqué les textes relatifs à la prescription — l’affaire Karachi ne pourrait plus donner lieu à des poursuites. Toute la délinquance en col blanc échapperait à ses responsabilités, ce qui serait intolérable.
Le législateur a donc progressivement fait voter des lois nouvelles visant à briser le carcan de la prescription triennale, en matière délictuelle, et décennale en matière criminelle. Il en résulte que nous sommes aujourd’hui dans le flou le plus complet : des délits sont prescrits par dix ou vingt ans, et le désordre est identique s’agissant des crimes. Ce maelström n’est pas favorable à la sécurité juridique.
La jurisprudence est devenue erratique, et le législateur ne respecte pas lui-même les grands principes. Lors de la précédente législature, des dispositions ont même été adoptées afin de reporter le point de départ de la prescription de certaines infractions aussi longtemps que les victimes sont malades ou enceintes — comme si la grossesse était une maladie !
Devant une telle faillite, nombreux ont été ceux qui ont tenté de trouver des solutions. Ce fut le cas du président Pierre Mazeaud, dont chacun se rappelle la finesse de l’analyse juridique et le talent politique. Il a échoué, tout comme M. Jean-Marie Coulon, premier président honoraire de la cour d’appel de Paris. Quant à M. Jean-Jacques Hyest, et à plusieurs sénateurs de grande qualité, ils proposèrent, en 2007, une réforme globale qui n’aboutit finalement qu’en matière civile avec la loi du 17 juin 2008. Elle fait l’unanimité, mais, en matière pénale, l’échec était à nouveau consommé.
Cet échec s’explique par de multiples causes, mais il faut tout de même en souligner une : de nombreux spécialistes ont intérêt à conserver les failles existant dans les textes afin de faire jouer la prescription en matière économique au profit de leurs clients.
Georges Fenech et moi-même avons voulu simplifier le droit de la prescription et le repenser de fond en comble. En la matière, nous avons constaté que la France était une exception dans le monde. La plupart des pays de common law ne font pas jouer de prescription. Cette proposition de loi est sans doute le dernier texte que nous votons avant l’imprescriptibilité.
Si, pour notre part, nous sommes persuadés qu’il faut une prescription, cette dernière ne doit pas être un moyen général d’impunité. Elle constitue plutôt une exception au principe qui veut que l’on réponde de ses actes.
À notre sens, ce qui fondait la prescription n’a pas disparu. La « grande loi de l’oubli » a encore du sens. Quant au « pardon légal », il s’appliquerait parce que la souffrance de celui qui a commis l’infraction a duré un certain temps — la notion de souffrance est, disons-le, assez judéo-chrétienne. On considérait aussi le risque de dépérissement des preuves, mais il a aujourd’hui largement disparu grâce aux progrès scientifiques et à l’identification par l’ADN.
De leur côté, les victimes, constituées en associations, n’admettent pas que la prescription leur soit opposée. Elles sont aussi victimes de la prescription si elles ne parviennent pas à obtenir de rendez-vous judiciaire. Il faut poser cette question et trouver un équilibre en la matière.
Je ne résiste pas à l’envie de vous lire ce que M. Jean Danet a écrit sur la nécessité d’un quadruple équilibre : « Pour être utile, l’intervention du législateur doit respecter plusieurs exigences contradictoires : équilibre entre le droit à la sécurité et celui au procès équitable ; équilibre entre le droit des victimes d’obtenir réparation et celui de chacun d’être jugé dans un délai raisonnable ; équilibre entre la mise en œuvre des moyens techniques d’élucidation des infractions en constante évolution et la nécessité de délimiter le champ du travail de la police, de fixer des priorités pour éviter la paralysie, la dispersion des moyens et l’arbitraire de choix laissés aux forces de police ; enfin, équilibre entre les différents foyers de sens de la peine, entre le rappel de la loi et la défense de la société, d’une part, qui n’impliquent pas la prescription, et, d’autre part, le sens éducatif, le principe de proportionnalité, la nécessité et l’utilité de la peine qui, eux, la justifient. »
C’est pourquoi, en même temps que nous estimons qu’il faut maintenir le principe d’une prescription, nous pensons qu’il faut totalement transformer notre système. Les modifications profondes que nous proposons concernent des délais aujourd’hui incontestablement trop courts. Rappelons qu’ils ont été mis en place en 1808, dans une société où les Français vivaient quarante ans en moyenne. Deux siècles après, la durée de vie moyenne a doublé : il reste aujourd’hui encore plus de quarante ans à vivre à celui qui a commis une infraction à l’âge de vingt ans
— ce n’était pas du tout le cas il y a deux siècles.
Nous proposons en conséquence de doubler le délai de prescription de l’action publique qui sera porté à six ans pour les délits et à vingt ans pour les crimes. À ceux qui nous diront que ce délai est trop long, je rappelle que des dizaines de lois prévoient déjà une prescription de trente ans. S’agissant des peines, nous avons voulu simplifier les choses en prévoyant la même prescription que pour les faits en matière délictuelle et criminelle.
Les infractions occultes et dissimulées sont des infractions d’intelligence criminelle qui nécessitent que des délinquants, le plus souvent économiques, réunissent des experts en comptabilité, en droit fiscal et en droit international, afin de construire un système mafieux. Les juges d’instruction spécialisés nous ont indiqué que le combat qu’ils menaient ne pouvait pas aboutir dans le cadre des règles de prescription en vigueur — soit une prescription par trois ans après la commission de l’infraction. Voulons-nous l’impunité pour la délinquance économique ? Il faut avoir le courage d’empêcher que cette délinquance passe au travers des mailles du filet de la répression. Nous avons en conséquence décidé de consacrer la jurisprudence de la chambre criminelle de la Cour de cassation relative aux infractions occultes et dissimulées.
S’est posée, ensuite, la question du délai de prescription rouvert par un acte de recherche ou d’instruction. Il ne nous a finalement pas été possible, comme nous l’avions envisagé dans nos premières propositions, de suivre M. Jean-Claude Marin, procureur général près la Cour de cassation, qui proposait que le premier acte interruptif rouvre un délai de prescription de trois ans. La prescription aurait ainsi constitué une forme de sanction de l’inaction des magistrats. En effet, cette proposition s’est heurtée à la totale opposition des procureurs de la République. Elle aurait conduit, en outre, à un système extraordinairement complexe.
Nous avons dû réfléchir à la très vaste question des crimes de guerre. Ceux-ci, je vous le rappelle, ne sont pas imprescriptibles en droit français, à la différence des crimes contre l’humanité. Le Statut de la Cour pénale internationale (CPI) prévoit l’imprescriptibilité des crimes de guerre, mais cette clause ne s’applique pas à la France — en tout cas pas de façon automatique. Nous étions séduits par l’argumentation de M. Jean-Jacques Urvoas, qui estimait, lors des débats sur le projet de loi portant adaptation du droit pénal à l’institution de la Cour pénale internationale, que, lorsqu’un juge d’instruction était saisi d’un crime de guerre, il pouvait éventuellement faire référence à la norme internationale et donc à l’imprescriptibilité plutôt qu’à la prescription — fixée à trente ans. Nous étions également séduits par l’argumentation de M. Bruno Cotte, qui souhaitait que les crimes de guerre soient désormais imprescriptibles en droit français. Nous avions pour cela l’accord de Mme la garde des Sceaux, puis celui du nouveau garde des Sceaux ; mais le ministère de la défense s’est frontalement opposé à nous sur ce point : il ne veut à aucun prix de l’imprescriptibilité des crimes de guerre.
Vous serez donc saisis de trois amendements identiques, l’un déposé par le Gouvernement, le deuxième par M. Georges Fenech et le troisième par moi-même. Ils proposent de considérer comme imprescriptibles les crimes de guerre connexes à un crime contre l’humanité. Cette solution nous semble excellente ; elle évite un affrontement qui nous paraissait mauvais pour notre démocratie.
Le président Claude Bartolone, en accord avec M. Jean-Jacques Urvoas, alors président de la commission des Lois, a saisi le Conseil d’État du travail que Georges Fenech et moi-même avions accompli. Nous avons été entendus par le rapporteur pendant trois heures, puis j’ai été entendu par le président Vigouroux pendant près de quatre heures. Nous sommes ensuite passés devant la section de l’intérieur, où nous avons défendu notre texte pendant sept heures d’affilée… Enfin, nous avons été entendus par l’Assemblée générale du Conseil d’État, de façon plus brève.
L’avis du Conseil d’État nous donne satisfaction sur l’ensemble de nos propositions. Je vous invite à le lire, car sa composition, son écriture et son analyse juridique sont remarquables. En particulier, il souligne que cette loi est une loi de procédure, et qu’elle est donc d’application immédiate. Enfin, pour tenir compte de l’impact de la modification relative aux crimes de guerre, nous avons dû établir deux systèmes d’entrée en vigueur de la loi différents : sur ce point, le Conseil d’État a donné un avis favorable.
Je ne serai pas plus long : notre rapport l’est déjà, et la proposition de loi également. J’ose dire ici que nous sommes fiers de cet énorme travail que nous soumettons aujourd’hui à votre examen.
M. Georges Fenech. Je serai bref : notre rapporteur vient d’exposer de façon excellente le contenu de cette proposition de loi, et la commission des Lois a, de plus, adopté à l’unanimité, au mois de mai dernier, notre rapport. Cette proposition de loi a, cela a été rappelé, suivi un cheminement particulier, puisque, en vertu des nouvelles dispositions constitutionnelles, elle a pu être soumise au Conseil d’État, dont l’avis a été très favorable.
Nous avons l’ambition de remettre de l’ordre dans un dispositif devenu incohérent, en raison de multiples réformes législatives, mais aussi des jurisprudences audacieuses de la Cour de cassation. L’état d’esprit n’est plus guère aujourd’hui à l’acceptation de la prescription, notamment lorsqu’il s’agit de crimes extrêmement graves.
Chacun se souvient de la sordide affaire des disparues de l’Yonne. Une analyse juridique stricte aurait dû conduire à la considérer comme prescrite lorsque l’auteur des faits, Émile Louis, a été identifié. Pourtant, les magistrats ont utilisé un subterfuge juridique, en jugeant qu’une simple demande de la justice à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales avait suspendu la prescription. Un acte administratif n’est pourtant pas interruptif de la prescription. Il me semble que l’opinion publique s’est satisfaite de cette décision qui a permis de renvoyer Émile Louis devant la cour d’assises.
Plus récemment, vous vous rappelez l’affaire de l’octuple infanticide jugée l’an dernier. En réalité, ces crimes auraient également dû être prescrits. Mais l’assemblée plénière de la Cour de cassation a retenu le fait que l’état d’obésité de la mère dissimulait ses grossesses, ce qui empêchait le déclenchement de l’action publique. Cette jurisprudence pour le moins audacieuse a permis de juger la mère infanticide.
Ces deux exemples montrent combien il était nécessaire de moderniser notre loi, qui remonte à Napoléon. Nous vivons désormais, à l’heure d’internet, dans une société de la mémoire et non plus de l’oubli, comme cela a été excellemment rappelé. Les associations jouent un grand rôle. N’oublions pas non plus l’extraordinaire modernisation de l’administration de la preuve : le dépérissement des preuves n’a plus cours. Que l’on songe aux expertises par balayage électronique, aux expertises balistiques, aux empreintes génétiques… On peut même utiliser le fait que les odeurs imprègnent très longtemps des vêtements. Ni l’oubli ni le dépérissement des preuves ne peuvent plus constituer le fondement de nos prescriptions, devenues trop courtes. Et le procureur général près la Cour de cassation a parlé, à propos de notre loi actuelle, de « chaos ».
Il appartient donc au législateur de remettre de l’ordre dans ce système qui a perdu toute cohérence, et de le moderniser.
Je rejoins entièrement notre rapporteur sur les infractions occultes ou dissimulées. Ce sont bien elles qui ont empêché toute réforme, notamment au Sénat. Nous étions là face à une alternative. Depuis 1935, la Cour de cassation, à l’encontre des dispositions des articles 7 et 8 du code de procédure pénale, considère qu’il faut retarder le point de départ de la prescription au jour de la révélation de l’infraction : soit nous mettions un terme à cette jurisprudence contra legem, soit nous la consacrions. Notre opinion n’était pas du tout arrêtée lorsque nous avons commencé nos travaux : c’est seulement après une longue réflexion et de multiples auditions de tous les acteurs judiciaires que nous nous sommes décidés. Je souligne ici que le monde judiciaire attend vraiment cette loi, qui aura des conséquences très importantes.
Nous avons décidé de vous proposer de consacrer dans la loi la jurisprudence de 1935, et donc la théorie de la révélation. Cela concerne notamment les infractions économiques et financières — abus de biens sociaux, mais aussi grande corruption internationale, par exemple.
M. Patrick Devedjian. Avec la révélation, on reste dans le domaine judéo-chrétien ! (Sourires.)
M. Georges Fenech. Je peux parfaitement entendre les inquiétudes : va-t-on rendre ces infractions imprescriptibles ? Je ne le crois pas. Ces préoccupations sont, à mon sens, caricaturales. Nous ne sommes pas dans un système de légalité des poursuites, mais d’opportunité des poursuites ; or des infractions anciennes perdent de leur intensité avec la disparition du trouble à l’ordre public. Dans les pays de common law, on ne poursuit pas les très vieilles infractions.
Il est indispensable de donner les moyens à la justice économique et financière de faire son travail sans se préoccuper des trop courts délais de prescription, notamment en matière délictuelle.
Voilà ce que je souhaitais ajouter non pas pour compléter, mais pour conforter les propos d’Alain Tourret. Je vous remercie, monsieur le président, de m’avoir permis de rejoindre notre rapporteur à cette tribune, même si je ne suis ici qu’un simple orateur. Alain Tourret et moi-même avons travaillé ensemble, avec le soutien de l’ancien président de la Commission et actuel garde des Sceaux Jean-Jacques Urvoas, comme avec le soutien de l’ancienne garde des Sceaux et de toute la Chancellerie. C’est avec confiance, et avec beaucoup de fierté, que nous vous soumettons cette proposition de loi.
M. Philippe Houillon. Je commence par saluer ce travail excellent — je n’en suis pas surpris, car je connais la qualité des auteurs de la proposition de loi.
Je demeure néanmoins un peu réservé ; je me ferai une religion définitive au fur et à mesure des débats. Vous parlez de simplification, de modernisation, mais les catégories ne changent pas : prescription criminelle de droit commun, prescription délictuelle de droit commun, prescription en matière de contravention… On retrouve les problèmes de la prescription en matière d’infractions occultes comme de crimes de guerre. Il est vrai qu’il serait difficile de modifier ces catégories.
Globalement, sauf pour les contraventions, ce que vous proposez est simple : c’est un doublement des délais actuels. Cette prescription peut être interrompue — c’était déjà le cas, mais la proposition de loi le rappelle. Vous prévoyez également qu’en cas d’interruption, la prescription repart pour un délai réduit de moitié.
M. le rapporteur. Non, nous allons supprimer ce point, sur la recommandation du Conseil d’État.
M. Philippe Houillon. Il n’y a donc plus de modification par rapport au régime actuel ?
M. le rapporteur. C’est cela.
M. Philippe Houillon. Toujours est-il qu’on va en arriver à des délais qui pourront être de trente ans, voire plus, et qui seront également considérablement allongés en matière délictuelle. Est-ce un progrès ? Je n’en suis pas sûr. Il ne me semble jamais sain — et combien de fois avons-nous pu le constater, notamment en matière économique et financière ! — que des infractions soient jugées bien après le trouble à l’ordre public, vingt ans, trente ans après. Les moyens techniques maintenant disponibles devraient, au contraire, permettre d’élucider plus vite les affaires, et donc de les juger plus rapidement. L’efficacité est en l’occurrence liée à la rapidité — à une rapidité aussi grande que possible en tout cas, car il existe bien sûr des affaires très complexes. Il faut juger au plus près de l’infraction ; or vous proposez là de donner des moyens à la justice pour juger très loin de l’infraction. Il serait aussi possible de débattre de l’imprescriptibilité vers laquelle nous allons, d’après le rapporteur — nous n’y sommes pas, mais nous n’en sommes pas loin.
Vous prévoyez également que la prescription est suspendue « en présence soit d’un obstacle de droit, soit d’un obstacle de fait insurmontable, rendant impossible l’exercice des poursuites ». C’est une expression susceptible d’interprétations très diverses.
Je demeure donc réservé à ce stade, mais peut-être évoluerai-je au fur et à mesure des débats.
M. Patrick Devedjian. À l’instar de Philippe Houillon, je salue le travail considérable accompli par les auteurs de la proposition de loi. Je ne doute pas de la nécessité d’une remise en ordre de notre système, devenu parfaitement anarchique — le législateur ayant d’ailleurs largement contribué à le désorganiser plus encore —, mais je m’interroge.
Sur le plan des principes, vous proposez finalement que le législateur s’incline devant la jurisprudence contra legem de la Cour de cassation : c’est un peu choquant. La Cour de cassation a ignoré la loi, imposé sa propre conception de la prescription, et nous devrions valider cette démarche ? Ce n’est pas un bon signal institutionnel.
La proposition de loi, cela a été dit, propose grosso modo un doublement des délais de prescription. Mais quid du jugement dans un délai raisonnable ? C’est, vous l’avez souligné, monsieur le rapporteur, une notion maintenant prise en considération ; or elle s’oppose plutôt à l’allongement des délais de prescription : les infractions seront jugées de plus en plus tardivement.
L’Italie vit — à moins que des évolutions récentes qui m’auraient échappé n’aient bouleversé ce système — selon le principe de la légalité des poursuites, et non de leur opportunité. Et je me demande si nous ne devrons pas aller vers un tel principe, qui constituerait un contrepoids au pouvoir d’un parquet appelé inéluctablement à devenir indépendant. Bien sûr, les magistrats ont une éthique, une conscience, nul n’en doute : mais quelle est la responsabilité politique de celui qui, en se fondant sur le principe d’opportunité des poursuites, décide de poursuivre ou de classer ? Il n’y en a pas. Or c’est un pouvoir considérable.
En Italie, ce principe de légalité des poursuites est en quelque sorte régulé par la prescription : évidemment, les magistrats sont submergés, et la prescription est une méthode de désengorgement des tribunaux. Les affaires qui ne méritent pas d’être poursuivies — celles qui, avec un principe d’opportunité, seraient simplement classées — sont mises en dessous de la pile en attendant qu’elles soient prescrites.
Dans un tel cadre, un allongement des prescriptions ne serait pas une bonne idée. C’est un problème avec lequel, malheureusement, je crains que nous n’en ayons pas fini. Les évolutions en cours de notre propre système judiciaire
— l’indépendance du parquet, en particulier — conduiront très probablement le législateur, dans un avenir qui n’est pas éloigné, à revenir sur ces principes que vous espérez stables.
La Cour de cassation étant ce qu’elle est, et prenant de plus en plus l’habitude de statuer contra legem, c’est-à-dire de prendre des libertés avec la loi, je redis que nous ne sommes pas « sortis de l’auberge ».
Vous l’avez compris, je m’interroge. La situation actuelle est en effet inacceptable. Vous proposez indiscutablement une remise en ordre : je la crois partielle et provisoire, mais elle sera salutaire.
Mme Colette Capdevielle. Ce n’est pas tous les jours, en effet, que nous examinons des textes qui bousculent à ce point notre droit pénal !
Cette proposition de loi ne comprend que trois articles, d’ailleurs extrêmement bien rédigés, mais elle aura des conséquences inversement proportionnelles à sa taille. La différence entre la prescription de l’action publique et la prescription des peines est essentielle, et votre texte ne les confond pas.
Je vous félicite d’avoir accomplir ce travail difficile. Nous sommes en effet à la croisée des chemins : le pardon fait partie de notre droit, mais nous glissons vers l’imprescriptibilité. Il n’est aujourd’hui pas facile de traiter de ces questions, et vous avez su le faire.
À mon sens, il faut absolument conserver la notion de prescription — tant la prescription de l’action publique que celle des peines — dans notre procédure pénale, et cela même si l’opinion publique n’y est pas favorable. C’est de toute façon indispensable pour respecter nos engagements conventionnels, notamment la Convention européenne des droits de l’homme — M. Devedjian l’a dit : tous les justiciables ont le droit d’être jugés dans un délai raisonnable. Cette question est cruciale, et il en va de même pour l’exécution des peines.
Dans notre tradition pénale, la prescription a un sens : nous sommes heureusement très loin de rendre toutes les infractions imprescriptibles. Cette loi sera votée, je pense, et elle remplacera des lois très anciennes : elle restera sans doute longtemps dans notre droit pénal. Je ne partage pas, monsieur le rapporteur, votre opinion sur l’idée que nous allons vers une imprescriptibilité. Ce serait à mon sens une erreur grave — mais vous connaissez le sujet mieux que moi.
Vous ne touchez pas aux principes fondamentaux de la prescription, qui demeure fonction des catégories d’infraction — contraventions, délits, crimes.
Vous êtes partis d’un constat que nous pouvons tous partager : nos règles sont devenues illisibles, et l’on voit se développer des stratégies judiciaires assez choquantes. Le législateur — en augmentant les délais de prescription pour certaines infractions —, mais aussi la jurisprudence ont créé beaucoup de confusion. Ici même, récemment encore, certains voulaient allonger les délais pour des infractions commises, par exemple, sur des mineurs, voire les rendre imprescriptibles. Notre système a perdu toute cohérence.
Il était temps de le clarifier et de le moderniser, et je vous remercie de cette proposition de loi. Nous admettons en effet moins facilement qu’auparavant le pardon légal, et il est vrai que la preuve judiciaire a énormément changé. Les principales mesures de la proposition de loi me semblent donc aller dans le bon sens, et cet allongement des délais est demandé. Clarifier les modalités de computation des délais est également important, comme me paraissent raisonnables vos propositions en matière de prescription des peines. Rappelons-nous toutefois que, pour les infractions les plus graves, les délais sont déjà allongés : je pense notamment au terrorisme et au trafic de stupéfiants.
Le groupe Socialiste, républicain et citoyen votera ce texte, une fois adoptés les amendements que vous proposez.
Toutefois, je m’interroge sur l’application de ce texte. Le Conseil d’État a été saisi par le président de l’Assemblée nationale sur le fondement du dernier alinéa de l’article 39 de la Constitution. Le Conseil vous invite notamment à préciser les modalités d’entrée en vigueur de la disposition qui prévoit la suppression du report du point de départ du délai de prescription pour certaines infractions commises sur des personnes vulnérables. Pouvez-vous préciser les conditions d’entrée en vigueur de la loi ? Les affaires en cours seront-elles affectées ? Des éclaircissements me paraissent indispensables.
M. Jacques Bompard. Je m’associe aux félicitations adressées aux auteurs de cette proposition de loi, initiative à la fois louable et cruciale. La différence entre la pratique juridique et la loi ne devrait pas être maintenue trop longtemps, dans ce cas comme dans bien d’autres : bravo.
S’agissant des règles applicables à la prescription de la peine, prévues à l’article 2, je voudrais revenir sur la question des crimes de guerre. L’Europe, et c’est tout à son honneur, a longtemps cherché à codifier la guerre. Toutefois, l’histoire récente a montré que les guerres sont souvent dirigées par des idéologues. Si, aujourd’hui, nos pays sont apparemment protégés de ce genre de conflits, nos sociétés connaissent des tensions telles qu’on peut de plus en plus redouter leur retour, notamment avec le développement du terrorisme. Ne faudrait-il pas nous attacher à mieux définir la guerre ?
La guerre d’Algérie, si elle fut traitée comme une opération de maintien de l’ordre, a longtemps divisé notre société ; c’est l’un des inspirateurs essentiels de l’actuel Gouvernement, François Mitterrand, qui essaya de ramener un peu de raison là où les passions s’exprimaient.
S’agissant de l’article 3, pourquoi préférez-vous le code de procédure pénale au code de justice militaire ? N’y a-t-il pas là une modification attentatoire à la particularité bien évidente du monde militaire ?
M. le président Dominique Raimbourg. Je m’associe aux chaleureuses félicitations déjà adressées aux deux auteurs de la proposition de loi. Cette initiative parlementaire est particulièrement heureuse.
En ce qui concerne l’application dans le temps, considérez-vous qu’il s’agit d’une loi de procédure, qui doit par conséquent s’appliquer immédiatement, mais qu’en revanche elle ne réanimerait pas les prescriptions d’ores et déjà acquises ?
Par ailleurs, monsieur Devedjian, nous sommes à mon avis déjà dans un système de légalité des poursuites : il y a quelque 5 millions de procès-verbaux chaque année, et 1,5 million d’affaires poursuivables ; or il est fait injonction aux procureurs d’avoir un taux de réponse pénale qui s’approche de 100 %. Ils s’acquittent de cette tâche en poursuivant certaines affaires devant le tribunal correctionnel, et d’autres, qui paraissent moins importantes, en recourant à ce que l’on appelle la troisième voie pénale. Nous sommes donc déjà dans une logique de légalité des peines.
M. Patrick Devedjian. C’est aussi la logique de l’indépendance du parquet.
M. le président Dominique Raimbourg. En effet.
M. Patrick Devedjian. Monsieur le rapporteur, qu’en est-il des prescriptions acquises aujourd’hui ?
M. le rapporteur. Elles le demeurent.
M. Patrick Devedjian. En revanche, en ce qui concerne les infractions déjà commises, mais dont la prescription n’est pas échue, le délai est prorogé ?
M. Georges Fenech. Oui.
M. le rapporteur. C’est une loi de procédure.
M. Patrick Devedjian. Il s’agit donc bien d’une aggravation de la répression pour des faits déjà commis.
M. le rapporteur. Je me félicite de la qualité des interventions que nous venons d’entendre.
Monsieur Houillon, dès lors que l’on double la durée des procédures, celles-ci pourront être plus longues. Dont acte. (Rires.)
M. Patrick Devedjian. C’est l’amendement La Palice !
M. le rapporteur. Ce que nous avons voulu, c’est que la prescription ne puisse pas être un moyen général d’impunité. Nous estimons que les choses ont évolué ; si l’on n’a pas pu jusqu’à aujourd’hui traiter ce problème, c’est parce que les infractions économiques ont toujours constitué un obstacle insurmontable. Pour en avoir beaucoup parlé avec de nombreuses personnalités, notamment M. Jean-Jacques Hyest, je peux vous le confirmer. Or, on ne peut pas permettre à la criminalité en col blanc de se soustraire à ses responsabilités !
Monsieur Devedjian, l’article 157 du code pénal italien prévoit que le délai de prescription est égal à la durée maximale de la peine encourue. Dès lors, les infractions punies de l’emprisonnement à vie sont imprescriptibles. Au Canada, aucune prescription n’est prévue pour les infractions graves. Je pourrais vous donner d’autres exemples, mais je vous assure que nous resterons un pays où les durées de prescription sont parmi les plus courtes ! De plus, des dizaines de lois, votées par des législateurs de tous bords politiques, prévoient des durées supérieures à celles que nous proposons ici.
M. Patrick Devedjian. Bien sûr ! C’est la dictature de l’émotion !
M. le rapporteur. La durée de trente ans devient systématique, comme c’est le cas pour les crimes de guerre. Quant aux délits de guerre, la prescription est déjà fixée à vingt ans. Le législateur n’a jamais diminué les durées de prescription ; il les a toujours augmentées. Ramenons donc les choses à leur juste mesure. Notre proposition de loi assure, en réalité, une protection.
J’entends aussi, monsieur Devedjian, ce que vous dites sur la Cour de cassation. Si nous étions toujours sous l’Ancien Régime, le roi de France — ou le Président de la République — arriverait avec son fouet et mettrait les magistrats à genoux… Ce serait une nouvelle Séance de la flagellation.
Vous n’empêcherez pas la Cour de cassation de juger comme elle l’entend. Que voulez-vous que je vous dise ? Vous pouvez bien l’accuser d’agir de façon attentatoire à la sûreté de l’État et la mettre en accusation, mais s’il fallait poursuivre les magistrats à chaque arrêt contra legem, il n’y aurait plus beaucoup de magistrats ! C’est peut-être regrettable, mais c’est ainsi, et, en l’occurrence, cela dure depuis 1935. Qui se trompe, de Napoléon en 1808 ou des magistrats depuis 1935 ? Napoléon, selon nous. En effet, les infractions dissimulées ont bouleversé la nature de la criminalité économique, et l’on ne saurait lutter avec les moyens du passé contre des associations de malfaiteurs rassemblant des spécialistes de toutes disciplines aux seules fins de planifier telle ou telle infraction. Ayons le courage d’affirmer que tout a changé ! J’ai écouté avec beaucoup d’attention les propos de M. Renaud van Ruymbeke, magistrat du pôle financier du tribunal de grande instance de Paris ; il nous appartient d’ouvrir ou de fermer les yeux sur ce type d’affaires. Pour éviter que soient prises des décisions contra legem, nous devons tenir compte de la nouvelle réalité économique et juridique qui s’impose.
M. Georges Fenech. Je ne partage pas le sentiment de M. Devedjian selon lequel le législateur « s’incline », car sa souveraineté demeure entière : vous conservez par exemple la possibilité de voter pour ou contre ce texte. Le choix que nous faisons tient à la conviction que la jurisprudence correspond à la société actuelle ; il ne s’agit donc pas de s’incliner devant elle, mais de la consacrer pleinement et souverainement.
Évitons toute confusion concernant le délai raisonnable, dont M. Devedjian et Mme Capdevielle se sont inquiétés : il s’agit du délai raisonnable du procès. Le délai de prescription, que la Cour européenne des droits de l’homme ne met d’ailleurs pas en cause, permet de découvrir un crime et son auteur lorsqu’ils ne sont pas encore connus. Au contraire, le délai raisonnable s’applique aux procès en cours dès lors que les crimes ou délits sont connus et leurs auteurs identifiés. Il ne peut donc constituer un obstacle. M. Houillon semblait établir un paradoxe entre la célérité des procédures et l’allongement du délai de prescription ; l’une et l’autre ne relèvent pas du même registre. Les procédures doivent être diligentées avec célérité en respectant un délai raisonnable.
M. Philippe Houillon. Mais les actes interruptifs en allongent la durée !
M. Georges Fenech. En effet, et c’est pourquoi nous proposons un délai de prescription plus long.
Je précise, madame Capdevielle, que les prescriptions acquises le sont définitivement. Celles qui ne le sont pas encore obéiront au nouveau régime. Pour mémoire, les lois relatives à la prescription étaient auparavant d’application immédiate, sauf quand elles avaient pour résultat d’aggraver la situation des intéressés, mais le législateur a décidé, en 2004, qu’elles le seraient dans tous les cas, même si le sort des intéressés est aggravé par l’allongement du délai de prescription.
M. Patrick Devedjian. Il se pose un problème de rétroactivité.
M. Georges Fenech. Enfin, les crimes de guerre connexes aux crimes contre l’humanité ne concerneront que les actes commis après l’entrée en vigueur de la loi, car la disposition consistant à allonger un délai de prescription et celle qui vise à rendre imprescriptibles des crimes autrefois prescriptibles sont de nature différente.
La Commission en vient à l’examen des articles.
Article 1er
(art. 7, 8, 9, 9-1 [nouveau], 9-2 [nouveau] et 9-3 [nouveau] du code de procédure pénale)
Modification des dispositions relatives à la prescription de l’action publique
Le présent article modifie de manière substantielle les dispositions relatives à la prescription de l’action publique. Il double la durée des délais applicables en matière criminelle et délictuelle régis par les articles 7 et 8 du code de procédure pénale (I) ; précise, aux nouveaux articles 9-1 à 9-3 du même code, les modalités de computation de ces délais (III) ; rend imprescriptible l’action publique de certains crimes de guerre (II).
L’article 1er de la proposition de loi réécrit les articles 7 et 8 du code de procédure pénale, qui traitent respectivement de la prescription de l’action publique des crimes (A) et des délits (B). Il modifie, de manière formelle, l’article 9 du même code, qui porte sur la prescription des contraventions (C).
L’article 1er double le délai de prescription de l’action publique de droit commun (1) et rassemble, au sein de l’article 7 du code de procédure pénale, les dispositions relatives aux délais dérogatoires applicables à certains crimes particulièrement graves, demeurées, à une exception près, inchangées (2).
Le premier alinéa de l’article 7 du code de procédure pénale dispose qu’« [e]n matière de crime et sous réserve des dispositions de l’article 213-5 du code pénal (24), l’action publique se prescrit par dix années révolues à compter du jour où le crime a été commis si, dans cet intervalle, il n’a été fait aucun acte d’instruction ou de poursuite ».
Héritage de l’article 637 du code d’instruction criminelle de 1808, la prescription décennale apparaît aujourd’hui obsolète, ainsi que l’ont indiqué nombre de praticiens du droit devant la mission d’information sur la prescription en matière pénale conduite par les auteurs de la présente proposition de loi. Votre rapporteur se contentera de formuler quelques brèves observations, plus amplement commentées dans le rapport d’information de la mission précitée (25).
Tout d’abord, le délai fixé par le premier alinéa de l’article 7 du code de procédure pénale est inadapté aux attentes de la société quant à la répression des infractions les plus graves. En effet, la « grande loi de l’oubli », autrefois considérée comme l’un des principaux fondements de la prescription pénale, semble appartenir au passé. À l’instar de M. Jean Danet, avocat honoraire et maître de conférences à l’Université de Nantes, votre rapporteur considère que cette « loi sociale ou sociologique un peu vague n’apparaît plus dans notre société, tout à la fois société médiatique et de mémoire, comme une loi sociale si évidente qu’elle puisse fonder la prescription de l’action publique » (26).
Il ne fait guère de doute, par ailleurs, que la prescription décennale est en décalage avec les progrès considérables réalisés dans le domaine de la conservation des preuves, notamment grâce à l’exploitation de l’ADN. Les directeurs des instituts nationaux de police technique et scientifique entendus par votre rapporteur et son collègue Georges Fenech dans le cadre de la mission d’information qu’ils ont conduite l’ont unanimement reconnu. Le colonel François Daoust, directeur de l’Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale (IRCGN), soulignait ainsi, dans un document remis à la mission, que « les progrès technico-scientifiques permettent de constater que dans de nombreux domaines, la recherche d’un résultat scientifique robuste et déterminant est possible au-delà des délais de prescription de l’action publique en matière de crime », ce qui le poussait à conclure « que le dépérissement des preuves ne peut plus être considéré comme un des fondements participant à la justification du délai de prescription de l’action publique » (27). De son côté, M. Frédéric Dupuch, directeur de l’Institut national de police scientifique (INPS), faisait remarquer que les techniques utilisées pour recueillir et exploiter les traces papillaires et l’ADN permettent désormais « d’exploiter non seulement des traces " riches " (sang, sperme, salive), mais aussi des traces faibles, pauvres en ADN, et de l’ADN dégradé (…) notamment des " traces de contact " issues de seuls frottements ou touchers ». En outre, il ajoutait que « des progrès encore plus considérables [étaient] attendus à un horizon assez proche » (28).
Autre fondement traditionnel de la prescription pénale, le dépérissement des preuves, jadis constituées des seuls témoignages humains, est indiscutablement remis en question par les progrès de la science.
Rappelons également que les dernières années ont été marquées par une relative amélioration des conditions de conservation des scellés criminels (29).
Enfin, le délai de prescription de dix ans paraît de nos jours excessivement court au regard de l’espérance de vie. En effet, si le principe de la prescription décennale pouvait s’envisager sans difficulté lorsque celle-là atteignait en moyenne quarante ans, au moment de l’élaboration du code d’instruction criminelle, tel n’est plus le cas aujourd’hui, alors qu’elle s’élève à près de quatre-vingt-cinq ans pour les femmes et à plus de soixante-dix-huit ans pour les hommes (30).
Tirant les conséquences des évolutions précédemment mentionnées, l’article 1er de la proposition de loi, directement inspiré de la proposition n° 4 de la mission d’information sur la prescription en matière pénale, réécrit le premier alinéa de l’article 7 du code de procédure pénale afin de porter à vingt ans le délai de prescription de l’action publique des crimes. La solution retenue est relativement proche de celle imaginée en 2007 par les sénateurs Jean-Jacques Hyest, Hugues Portelli et Richard Yung, lesquels proposaient, dans leur rapport d’information sur le régime des prescriptions civiles et pénales, de porter ce délai à quinze ans (31).
En tout état de cause, la modification aurait, aux yeux des auteurs de la proposition de loi, plusieurs avantages.
D’abord, la nouvelle disposition faciliterait la répression des infractions criminelles, susceptibles de ne se révéler que de longues années après la commission des faits, ainsi que l’« affaire Cottrez » l’a encore récemment démontré, puisque les poursuites pourraient être engagées, à l’initiative de l’autorité judiciaire ou des parties civiles, dans un délai deux fois plus long qu’aujourd’hui.
Ensuite, le doublement du délai de prescription de l’action publique des crimes conduirait à l’aligner sur le délai de prescription applicable aux peines criminelles, fixé à vingt ans par l’article 133-2 du code pénal (32). Cette évolution irait ainsi dans le sens d’une plus grande lisibilité des dispositions régissant la matière, très largement réclamée par les professionnels du droit, magistrats comme avocats.
Votre rapporteur remarque que la modification effectuée par l’article 1er aurait pour effet de rapprocher notre régime de prescription de celui de plusieurs de nos voisins. Un rapide aperçu des règles applicables dans plusieurs États européens montre, en effet, que le délai de prescription de l’action publique des crimes y est plus long qu’en France (33). À titre d’illustrations :
–– en Allemagne, il est fixé à trente ans si les faits sont punis de la réclusion criminelle à perpétuité et à vingt ans si la peine de prison est d’une durée supérieure à dix ans (34) ;
–– en Autriche, ce délai est de vingt ans si l’infraction est punie d’une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure à dix ans (35) ;
–– en Espagne, il est de vingt ans si la peine d’emprisonnement est d’une durée égale ou supérieure à quinze ans et de quinze ans si la durée de la peine d’emprisonnement est comprise entre dix et quinze ans (36) ;
–– aux Pays-Bas, il est fixé à vingt ans pour les crimes et les délits réprimés par une peine d’emprisonnement d’une durée de huit ans ou plus (37) ;
–– au Portugal, ce même délai s’élève à quinze ans lorsque l’infraction est punie d’une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure à dix ans.
Enfin, la rédaction du premier alinéa de l’article 7 réécrit du code de procédure pénale appelle deux remarques complémentaires :
–– d’une part, il y serait désormais indiqué que l’action publique des crimes se prescrirait par vingt années révolues « [s]auf dans les cas où la loi en dispose[rait] autrement ». Pour les auteurs de la proposition de loi, cette formule précise opportunément que les dispositions de cet alinéa constituent le cadre juridique de droit commun ;
–– d’autre part, il y serait rappelé que le délai de prescription courrait à compter du jour où l’infraction est commise. Le principe, déjà en vigueur, demeurerait donc inchangé, conformément à la proposition n° 7 de la mission d’information sur la prescription en matière pénale, et le report du point de départ du délai de prescription ne serait admis que dans certains cas désormais prévus par la loi (38).
Votre rapporteur se félicite que le Conseil d’État, saisi de la présente proposition de loi, ait estimé que le doublement des délais de prescription de l’action publique ne soulevait pas de difficultés de nature juridique (39). Pour reprendre les termes de son avis, cette modification du droit « ne traduit pas un déséquilibre, entre les nécessités de la répression, d’une part, et les exigences de sécurité juridique et de conservation des preuves propres aux faits que réprime la loi pénale, d’autre part, qui soit de nature à soulever une question de constitutionnalité » (40).
Soucieux d’accroître la répression des faits causant un trouble grave à l’ordre public et de ne pas laisser impunis des actes particulièrement odieux, le législateur a fait le choix, au cours des dernières décennies, d’allonger le délai de prescription de l’action publique applicable à certains crimes (41).
Se prescrit ainsi par vingt ans, en application du dernier alinéa de l’actuel article 7 du code de procédure pénale, l’action publique :
–– des crimes mentionnés à l’article 706-47 du même code lorsqu’ils sont commis sur un mineur : ainsi, par exemple, du meurtre ou de l’assassinat précédé ou accompagné d’un viol, de tortures ou d’actes de barbarie, ou encore du viol ;
–– du crime de violences commises sur un mineur ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente.
Conformément au dernier alinéa du même article 7 et par dérogation à la règle de droit commun, le délai de prescription de l’action publique court, dans ces cas-là, à compter de la majorité des victimes.
Par ailleurs, le délai de prescription de l’action publique est fixé à trente ans pour :
–– les crimes d’eugénisme et de clonage reproductif réprimés par le sous-titre II du titre Ier du livre deuxième du code pénal, en application du premier alinéa de l’article 215-4 du même code (42) ;
–– le crime de disparition forcée figurant à l’article 221-12 dudit code, conformément à l’article 221-18 ;
–– les crimes de trafic de stupéfiants mentionnés à la section 4 du chapitre II du titre II du livre deuxième du code pénal, conformément au premier alinéa de l’article 706-31 du code de procédure pénale ;
–– les crimes de nature terroriste prévus au chapitre Ier du titre II du livre quatrième du code pénal, en application du premier alinéa de l’article 706-25-1 du code de procédure pénale ;
–– les crimes de guerre prévus au livre quatrième bis du code pénal, en application du premier alinéa de son article 462-10 ;
–– les crimes relatifs à la prolifération d’armes de destruction massive et de leurs vecteurs mentionnés à l’article 706-167 du code de procédure pénale, conformément au premier alinéa de son article 706-175.
Enfin, l’article 213-5 du code pénal dispose que l’action publique des crimes contre l’humanité mentionnés au sous-titre Ier du titre Ier du livre II est imprescriptible.
On remarquera que ces dispositions figurent, à ce jour, tantôt dans le code de procédure pénale, tantôt dans le code pénal.
Dans le cadre des travaux de la mission d’information sur la prescription en matière pénale, les auteurs de la proposition de loi se sont interrogés sur le bien-fondé du maintien en vigueur des délais de prescription dérogatoires au droit commun, que certains de leurs interlocuteurs ont suggéré de supprimer.
Parmi eux, M. Jean Danet, avocat honoraire et maître de conférences à l’Université de Nantes, a, dans une note écrite, fait part de sa position en ces termes : « [p]eut-on nous citer un acte de terrorisme qui a dû faire l’objet d’un engagement de poursuites plus de dix ans après sa commission ? Sachant qu’une fois les poursuites engagées, la prescription peut être interrompue autant de fois que l’on veut, et que les juges d’instruction sont saisis in rem, ce délai d’exception n’a aucune utilité pratique. N’est-il pas d’ailleurs contradictoire avec la notion même de terrorisme qui suppose la volonté délibérée de semer la terreur et donc une recherche, hélas atroce, de publicité ? À quoi sert de laisser penser qu’on pourrait aujourd’hui découvrir un acte de terrorisme commis il y a vingt ans ? » (43) M. Bruno Cotte, président honoraire de la chambre criminelle de la Cour de cassation et ancien président de chambre de jugement à la Cour pénale internationale (CPI), soulignait, quant à lui, qu’une réduction du délai de prescription de trente à vingt ans ne désarmerait pas l’État dans sa lutte contre le terrorisme ou le trafic de stupéfiants, les informations judiciaires étant, dans ces domaines, « ouvertes très vite et les juges [étant] d’une extrême vigilance pour éviter l’acquisition de la prescription » (44).
Il ne fait pas de doute que la suppression, même partielle, des délais dérogatoires favoriserait la lisibilité des dispositions relatives à la prescription de l’action publique des crimes. Les auteurs de la présente proposition de loi n’en ont pas moins estimé inopportun de revenir sur ces délais allongés de prescription, qui se justifient par la nature particulière du trouble causé à l’ordre public par les infractions auxquelles ils se rapportent. Qui plus est, ramener ces délais de trente à vingt ans – le nouveau délai de droit commun – risquerait de laisser accroire à un assouplissement de la répression, que votre rapporteur n’appelle pas de ses vœux.
C’est pourquoi les deuxième et troisième alinéas de l’article 7 du code de procédure pénale, dans leur rédaction issue de l’article 1er de la proposition de loi, se contentent de reprendre les dispositions qui soumettent d’ores et déjà à vingt ou trente ans le délai de prescription de l’action publique de certains crimes (45). De con côté, le dernier alinéa de l’article 7 réécrit rappelle le caractère imprescriptible de l’action publique des crimes contre l’humanité mentionnés aux articles 211-1 à 212-3 du code pénal. Cet alinéa comporte cependant une nouveauté d’ampleur significative puisqu’il rend imprescriptible l’action publique de certains crimes de guerre réprimés par le livre quatrième bis du code pénal (46).
Dans la même logique, les règles propres à la computation du délai de prescription de l’action publique de plusieurs de ces crimes, notamment ceux commis sur des mineurs, sont conservées.
Ainsi, pour les crimes mentionnés aux articles 706-47 du code de procédure pénale et 222-10 du code pénal (47), la prescription continuerait de courir à compter de la majorité de la victime. Comme votre rapporteur et son collègue Georges Fenech le soulignaient dans leur rapport d’information déjà cité, « [c]es dispositions sont essentielles pour la protection des mineurs victimes et constituent un acquis ancien et constamment réaffirmé depuis leur instauration par la loi n° 89-487 du 10 juillet 1989 relative à la prévention des mauvais traitements à l’égard des mineurs et à la protection de l’enfance » (48). L’ensemble des personnes entendues par la mission d’information avaient d’ailleurs plaidé pour le maintien de ce régime particulier. À titre d’exemple, Mme Catherine Sultan, directrice de la protection judiciaire de la jeunesse au ministère de la justice, avait souligné le caractère impératif de la reconnaissance de la « spécificité pour les victimes mineures des infractions sexuelles au regard de leur très grande fragilité », « le choc émotionnel subi surtout quand les faits ont été commis sur la durée par un parent ou une personne ayant autorité [étant] de nature à provoquer un traumatisme profond » (49). Il n’est donc pas question de revenir sur cette règle. Plusieurs pays européens ont d’ailleurs fait le choix, eux aussi, de reporter au jour de la majorité (Autriche, Belgique, Espagne, Pays-Bas, Portugal) ou des vingt-et-un ans de la victime (Allemagne) le point de départ du délai de prescription de l’action publique des infractions sexuelles commises sur les mineurs.
De même, la disposition relative au report du point de départ du délai de prescription de l’action publique du crime de clonage reproductif prévu à l’article 214-2 du code pénal, qui ne commence à courir, dans le cas où le clonage conduit à la naissance d’un enfant, qu’à partir de la majorité de cet enfant, n’est pas modifiée.
Pour conclure sur ce point, votre rapporteur formulera deux observations :
–– d’une part, l’établissement à vingt ans du délai de prescription de l’action publique des crimes aurait pour conséquence de faire entrer dans le droit commun le délai de vingt ans auquel sont soumis aujourd’hui les crimes commis sur des mineurs réprimés par les articles 706-47 du code de procédure pénale et 222-10 du code pénal (50). Ainsi le cadre juridique s’en trouverait simplifié : en effet, alors qu’il existe, en l’état actuel du droit, trois délais différents (dix, vingt et trente ans), il n’en existerait plus que deux (vingt et trente ans) à l’issue de la réforme ;
–– d’autre part, l’article 1er de la proposition de loi rassemble, au sein de l’article 7 du code de procédure pénale, les dispositions propres aux délais de prescription dérogatoires aujourd’hui éparses dans le code de procédure pénale et le code pénal. Ce choix fait écho à la proposition n° 2 de la mission d’information que votre rapporteur a conduite aux côtés de son collègue Georges Fenech, laquelle avait mis en lumière la nécessité de remédier au « désordre » caractérisant l’ordonnancement des règles relatives à la prescription. À cet égard, le Conseil d’État a fait remarquer, dans son avis sur la présente proposition de loi, que la solution retenue était « de nature à améliorer l’accessibilité et la lisibilité du droit de la prescription en matière pénale » (51), ce dont votre rapporteur se félicite. En revanche, « la justification et la proportionnalité de chacun des délais dérogatoires existants et des différences de traitement qui en résultent ne [pouvant] être appréciées qu’au regard des infractions concernées, de l’ensemble du régime juridique dans lequel elles prennent place et des objectifs que le législateur entend poursuivre dans chaque cas », il a estimé que « l’examen de la proposition de loi ne pouvait pas le conduire à se prononcer sur la pertinence des délais dérogatoires existants, y compris dans le nouveau cadre juridique tracé par la proposition de loi » (52).
L’article 1er de la proposition de loi double également le délai de prescription de l’action publique de droit commun en matière délictuelle (1) et rassemble, au sein de l’article 8 du code de procédure pénale, les dispositions figurant dans les codes pénal et de procédure pénale relatives aux délais dérogatoires applicables à certains délits, sans toutefois les modifier sur le fond (2). Il supprime, en revanche, la disposition – aujourd’hui prévue au dernier alinéa du même article 8 – en vertu de laquelle la prescription de certaines infractions commises à l’encontre de personnes vulnérables court à compter du jour où les faits apparaissent aux victimes dans des conditions permettant l’exercice de l’action publique (3).
En application du premier alinéa de l’article 8 du code de procédure pénale, hérité de l’article 638 du code d’instruction criminelle de 1808, l’action publique des délits se prescrit par trois années révolues à compter du jour où le crime a été commis si, dans cet intervalle, il n’a été fait aucun acte d’instruction ou de poursuite.
La question de la modification du délai de prescription des infractions délictuelles fut l’un des points qui, tout au long des travaux de la mission d’information conduite par les auteurs de la présente proposition de loi, suscita le plus de débats. Peu de personnes entendues ont milité pour le maintien en l’état du délai de trois ans, si ce n’est les représentants du Syndicat de la magistrature, du Syndicat national des magistrats-FO et de l’Ordre des avocats. À l’inverse, de nombreux interlocuteurs de la mission se sont prononcés en faveur d’un allongement de ce délai, considéré comme excessivement bref (53). Certains d’entre eux ont préconisé d’instaurer plusieurs délais de prescription afin de tenir compte de la grande diversité des infractions délictuelles, à l’image de ce qu’avait proposé le groupe de travail sur la dépénalisation de la vie des affaires présidé par M. Jean-Marie Coulon, premier président honoraire de la cour d’appel de Paris, et de ce qu’avait prévu l’avant-projet de réforme du code de procédure pénale soumis à concertation en mars 2010 mais resté sans suite.
Tel est d’ailleurs le cas dans plusieurs pays européens (54) :
–– en Allemagne, le délai de prescription de l’action publique est de dix ans lorsque l’infraction est punie d’une peine d’emprisonnement d’une durée comprise entre cinq et dix ans ; de cinq ans lorsqu’elle est punie d’une peine d’emprisonnement dont la durée est comprise entre un an et cinq ans ; de trois ans dans les autres cas ;
–– en Autriche, ce délai est de dix ans si l’infraction est punie d’une peine d’emprisonnement d’une durée comprise entre cinq et dix ans ; de cinq ans si elle est punie d’une peine d’emprisonnement d’une durée comprise entre un an et cinq ans ; de trois ans si elle est punie d’une peine d’emprisonnement d’une durée comprise entre six mois et un an ; d’un an si elle est punie d’une peine d’emprisonnement d’une durée maximale de six mois ;
–– aux Pays-Bas, le délai est de vingt ans si le crime ou le délit est sanctionné par une peine de prison d’une durée égale ou supérieure à huit ans ; de douze ans si le crime ou le délit est passible d’une peine de prison d’une durée supérieure à trois ans ; de six ans si le délit est puni d’une amende ou d’une peine de prison d’une durée inférieure à trois ans ;
–– au Portugal, le délai est fixé à dix ans lorsque l’infraction est punie d’une peine d’emprisonnement d’une durée comprise entre cinq et dix ans ; à cinq ans lorsqu’elle est punie d’une peine d’emprisonnement d’une durée comprise entre un an et cinq ans ; à deux ans dans les autres cas.
Les auteurs de la proposition de loi, convaincus de la nécessité d’œuvrer en faveur d’une plus grande clarté et d’une meilleure lisibilité du droit de la prescription, ont écarté la solution consistant à établir plusieurs délais de prescription, dont la mise en œuvre se serait vraisemblablement heurtée aux incohérences de l’échelle des sanctions pénales.
Ils lui ont préféré la solution consistant à maintenir un délai de droit commun unique, fixé à six ans par le premier alinéa de l’article 8 du code de procédure pénale réécrit, applicable sauf dans les cas où la loi en disposerait autrement. Inspirée de la proposition n° 5 de la mission d’information sur la prescription en matière pénale, cette évolution « tire les conséquences de la brièveté du délai de trois ans, notamment à la lumière des comparaisons internationales » (55) et devrait « permettre de faciliter la répression des délits les plus graves et les plus complexes à poursuivre, notamment en matière économique et financière » (56). Votre rapporteur souligne également que cette modification aurait pour conséquence positive de rapprocher le délai de prescription de droit commun du délai applicable au délit de fraude fiscale, porté à six ans par la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière, « ce qui devrait aller dans le sens d’une meilleure appréhension des affaires complexes mêlant fraude fiscale et autres infractions astucieuses d’ordre économique et financier (l’escroquerie, le blanchiment…) » (57).
Cette solution est proche de celle qu’avaient retenue, dans leur rapport d’information sur le régime des prescriptions civiles et pénales, les sénateurs Jean-Jacques Hyest, Hugues Portelli et Richard Yung, lesquels proposaient de porter le délai de prescription de l’action publique des délits à cinq ans (58).
On remarquera que, dans sa nouvelle rédaction, le premier alinéa de l’article 8 disposerait expressément – ce qui n’est pas le cas actuellement – que le délai de prescription court à compter du jour où l’infraction est commise, conformément à la proposition n° 7 de la mission d’information sur la prescription en matière pénale aux termes de laquelle « cette règle mérite d’être réaffirmée et de figurer plus expressément dans le code de procédure pénale » (59).
Votre rapporteur n’ignore pas que le doublement du délai de prescription de l’action publique en matière délictuelle risque de se traduire par une augmentation du nombre des plaintes ou des dénonciations tardives, y compris pour des faits d’une gravité relative. Néanmoins, il ne doute pas que les magistrats du parquet apprécieront avec le plus grand discernement la suite à donner à chacune des affaires portées à leur connaissance.
Comme en matière criminelle, le législateur a fait le choix, pour renforcer la répression de certains délits, d’allonger le délai de prescription de l’action publique qui leur est applicable. À l’inverse, il a jugé pertinent de soumettre quelques infractions à un délai de prescription abrégé, en raison de la nature particulière des faits ou de la nécessité d’écarter tout risque de contentieux tardif.
En l’état du droit applicable, le délai allongé est fixé à tantôt six, dix ou vingt ans.
Tout d’abord, le législateur a soumis à un délai de prescription de six ans – soit deux fois plus que l’actuel délai de droit commun – l’action publique :
–– du délit de fraude fiscale prévu aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts, en application du premier alinéa de l’article L. 230 du livre des procédures fiscales ;
–– du délit de défrichement effectué en infraction à l’article L. 341-3 du code forestier, en application de l’article L. 363-3 du même code.
Pour ces deux délits, le point de départ du délai de prescription est reporté à une date ultérieure à celle de la commission des faits. Dans le premier cas, le délai court à compter du 1er janvier de l’année qui suit celle au cours de laquelle l’infraction a été commise et la prescription est suspendue pendant une durée de six mois au maximum entre la date de saisine de la commission des infractions fiscales et la date à laquelle celle-ci émet son avis (60) ; dans le second cas, le délai court « à compter de l’époque où le défrichement a été consommé ».
Ensuite, le législateur a décidé que le délai de prescription de l’action publique serait fixé à dix ans, ainsi qu’en dispose actuellement le deuxième alinéa de l’article 8 du code de procédure pénale, pour les délits mentionnés à l’article 706-47 du même code commis sur un mineur : traite des êtres humains, proxénétisme, atteintes sexuelles sans violence, contrainte, menace ni surprise sur un mineur âgé de plus de quinze ans, etc.
Enfin, il a fixé ce délai à vingt ans pour :
–– le délit de violences commises sur un mineur ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours, le délit d’agressions sexuelles autres que le viol commises sur un mineur et le délit d’atteintes sexuelles sans violence, contrainte, menace ni surprise sur un mineur de moins de quinze ans commises avec une circonstance aggravante (61) ;
–– les délits de trafic de stupéfiants réprimés par la section 4 du chapitre II du titre II du livre deuxième du code pénal, conformément au deuxième alinéa de l’article 706-31 du code de procédure pénale ;
–– les délits de nature terroriste mentionnés au chapitre Ier du titre II du livre quatrième du code pénal, en application du deuxième alinéa de l’article 706-25-1 du code de procédure pénale ;
–– les délits de guerre figurant au livre quatrième bis du code pénal, en application du second alinéa de son article 462-10 ;
–– les délits relatifs à la prolifération d’armes de destruction massive et de leurs vecteurs prévus à l’article 706-167 du code de procédure pénale, lorsqu’ils sont punis de dix ans d’emprisonnement, conformément au second alinéa de l’article 706-175 du même code.
Votre rapporteur observe que le délai de prescription des infractions prévues aux articles 706-47 du code de procédure pénale, d’une part, et aux articles 222-12, 222-29-1 et 227-26 du code pénal, d’autre part, court, lorsqu’elles sont commises sur un mineur, à compter de la majorité de la victime, conformément au deuxième alinéa de l’article 8 du code de procédure pénale. Pour les autres infractions, le délai de prescription court à compter de la commission des faits, conformément à la règle de droit commun, même si les articles susmentionnés ne le précisent pas expressément.
Dans d’autres cas, le législateur a décidé de soumettre la prescription de l’action publique de certains délits à un délai réduit (62).
D’une part, depuis près de deux siècles, les infractions de presse se prescrivent suivant des règles fortement dérogatoires au droit commun. Ainsi le premier alinéa de l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse dispose-t-il que l’action publique des crimes, délits et contraventions réprimés par cette loi se prescrit par trois mois révolus à compter de la commission des faits.
On remarquera que le dernier alinéa de l’article 434-25 du code pénal dispose également que l’action publique du délit réprimé par le premier alinéa de cet article, consistant à « chercher à jeter le discrédit, publiquement par actes, paroles, écrits ou images de toute nature, sur un acte ou une décision juridictionnelle, dans des conditions de nature à porter atteinte à l’autorité de la justice ou à son indépendance », se prescrit par trois mois révolus à compter de la commission des faits.
Depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, l’article 65-3 de la loi du 29 juillet 1881 fixe à un an le délai de prescription de l’action publique de certaines infractions de presse considérées comme particulièrement répréhensibles :
–– la provocation, par l’un des moyens énoncés à l’article 23 de cette loi (63), à la discrimination, à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée (septième alinéa de l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881) ;
–– la provocation, par les mêmes moyens, à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation ou identité sexuelle ou de leur handicap ou aux discriminations prévues aux articles 225-2 et 432-7 du code pénal (huitième alinéa de l’article 24 de la même loi) ;
–– la contestation, par les mêmes moyens, de l’existence d’un ou plusieurs crimes contre l’humanité tels qu’ils sont définis par l’article 6 du statut du tribunal militaire international annexé à l’accord de Londres du 8 août 1945 et qui ont été commis soit par les membres d’une organisation déclarée criminelle en application de l’article 9 dudit statut, soit par une personne reconnue coupable de tels crimes par une juridiction française ou internationale (article 24 bis de la même loi) ;
–– la diffamation, par les mêmes moyens, envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée (deuxième alinéa de l’article 32 de la même loi) ;
–– la diffamation, par les mêmes moyens, envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation ou identité sexuelle ou de leur handicap (troisième alinéa de l’article 32 de la même loi) ;
–– l’injure, par les mêmes moyens, envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée (troisième alinéa de l’article 33 de la même loi) ;
–– l’injure, par les mêmes moyens, envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation ou identité sexuelle ou de leur handicap (quatrième alinéa de l’article 33 de la même loi).
D’autre part, plusieurs infractions prévues par le code électoral sont, elles aussi, soumises à un délai de prescription abrégé. En effet, aux termes de l’article L. 114 de ce code, l’action publique des infractions mentionnées aux articles L. 61, L. 86, L. 87, L. 91 à L. 104, L. 106 à L. 108 et L. 113 se prescrit par six mois à compter du jour de la proclamation du résultat de l’élection.
Pour la clarté de l’exposé, votre rapporteur a choisi de faire état des délais de prescription abrégés que connaissent le droit de la presse et le droit électoral dans la partie de son rapport consacrée aux délits. Cependant, il souhaite préciser que, si l’immense majorité des infractions concernées s’avère être délictuelle, il n’en reste pas moins que certaines d’entre elles sont de nature criminelle. Une lecture attentive de l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse rappelle ainsi que le délai de prescription de trois mois s’applique notamment aux crimes que réprime cette loi. De même, l’action publique du crime puni par l’article L. 101 du code électoral, caractérisé par l’irruption violente dans un collège électoral en vue d’empêcher un choix, commis par suite d’un plan concerté pour être exécuté, soit dans toute la République, soit dans un ou plusieurs départements, soit dans un ou plusieurs arrondissements, se prescrit par six mois à partir du jour de la proclamation du résultat de l’élection (64).
Dans leur rapport d’information sur la prescription en matière pénale, les auteurs du présent texte avaient écarté – aux propositions nos 1 et 5 – la solution consistant à revenir sur le caractère dérogatoire des délais de prescription de l’action publique applicables à certains délits, que ces délais soient plus longs ou plus courts que le délai de droit commun.
Ils justifiaient, notamment, leur refus de réduire les délais plus longs en ces termes : « [l]a réduction de ces délais risquerait d’être interprétée par l’opinion publique comme une forme de laxisme, ce qui n’est clairement pas l’objectif de la réforme proposée (…). Cette remarque vaut tout particulièrement pour le régime dérogatoire applicable à certaines infractions commises à l’encontre des mineurs, mentionnées au deuxième alinéa de l’article 8 du code de procédure pénale. Vos rapporteurs considèrent en effet que les délais de prescription de l’action publique allongés sont justifiés, quand bien même les règles manqueraient de lisibilité, en raison de l’extrême gravité des infractions en question » (65).
Ils soulignaient, par ailleurs, que le caractère dérogatoire des délais de prescription applicables aux infractions réprimées par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse – trois mois ou un an – se justifiait par la protection particulière qu’il convient d’apporter à la liberté d’expression. À cet égard, la Cour de cassation a jugé que le délai de trois mois « ne porte pas au droit à un recours effectif une atteinte excessive dans la mesure où il procède d’un juste équilibre entre le droit d’accès au juge et les exigences de conservation des preuves propres aux faits que réprime [la loi de 1881] » (66).
Enfin, le délai de prescription de six mois prévu à l’article L. 114 du code électoral apparaît tout à fait pertinent en raison de « la nécessité de purger rapidement le contentieux de l’élection et [de] stabiliser la représentation démocratique » (67), pour reprendre les termes employés par le directeur des affaires criminelles et des grâces, M. Robert Gelli.
Les auteurs de la présente proposition de loi ont donc fait le choix de ne pas modifier les délais de prescription dérogatoires, allongés ou abrégés, qui régissent l’action publique de certains délits. Aussi les deuxième à avant-dernier alinéas de l’article 8 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de l’article 1er de la proposition de loi, se contentent-ils de reprendre les dispositions actuellement en vigueur qui encadrent les délais dérogatoires applicables en matière délictuelle (68). Seraient donc désormais mentionnées à l’article 8, à la suite de la disposition fixant à six ans le délai de prescription de droit commun, les infractions se prescrivant suivant un délai dérogatoire, du plus bref au plus long, à savoir :
–– le délit de discrédit jeté sur une décision de justice figurant à l’article 434-25 du code pénal (trois mois) ;
–– les délits de provocation à la commission d’actes terroristes et d’apologie du terrorisme prévus à l’article 421-2-5 du code pénal (trois ans) ;
–– les délits commis sur un mineur mentionnés à l’article 706-47 du code de procédure pénale (dix ans) ;
–– les délits commis sur un mineur réprimés par les articles 222-12, 222-29-1 et 227-26 du code pénal (vingt ans) ;
–– les délits de trafic de stupéfiants réprimés par la section 4 du chapitre II du titre II du livre deuxième du code pénal ; les délits de nature terroriste mentionnés au chapitre Ier du titre II du livre quatrième du même code ; les délits de guerre figurant au livre quatrième bis dudit code ; les délits relatifs à la prolifération d’armes de destruction massive et de leurs vecteurs mentionnés à l’article 706-167 du code de procédure pénale, lorsqu’ils sont punis de dix ans d’emprisonnement (vingt ans).
Votre rapporteur tient à faire remarquer que le délai de prescription de l’action publique des délits de provocation à la commission d’actes terroristes et d’apologie du terrorisme, fixé à trois ans depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2014-1353 du 13 novembre 2014 renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme, est maintenu en l’état (69). Ce délai, aujourd’hui aligné sur le délai de droit commun (trois ans), aurait pu être porté à six ans et, partant, être aligné sur le nouveau délai de droit commun. Toutefois, il n’a pas semblé opportun de modifier de nouveau le régime de la prescription de ces infractions commises par voie de presse qui, en dépit de leur gravité incontestable, ne sauraient se prescrire dans un délai déraisonnablement long.
L’article 1er de la présente proposition de loi ne modifie pas non plus les modalités de computation des délais de prescription des infractions délictuelles qui se prescrivent suivant un régime dérogatoire. Mieux, le principe selon lequel l’action publique des délits se prescrit à compter de la commission des faits est rappelé pour chacune des infractions concernées. Naturellement, la règle du report à la majorité de la victime du point de départ du délai de prescription des délits commis sur un mineur actuellement mentionnés au deuxième alinéa de l’article 8 du code de procédure pénale n’est pas remise en cause. Ce régime spécifique est parfaitement justifié, comme votre rapporteur l’a déjà souligné (70), car les mineurs, « en raison de leur jeune âge, peuvent éprouver des difficultés accrues lorsque les auteurs sont des proches ou des personnes ayant autorité sur eux, à dénoncer des agissements dont ils sont victimes » (71).
De même, la règle particulière relative au point de départ du délai de prescription du délit d’organisation frauduleuse de l’insolvabilité réprimé par l’article 314-7 du code pénal est maintenue. Elle figurerait désormais au dernier alinéa de l’article 8 du code de procédure pénale (72).
En définitive, l’article 1er de la proposition de loi a le mérite de rassembler au sein d’un article unique – l’article 8 du code de procédure pénale – les dispositions qui, à ce jour, encadrent, au sein du code de procédure pénale et du code pénal, les délais de prescription de l’action publique dérogatoires au droit commun ainsi que les modalités de leur computation.
En revanche, n’y figurent pas les dispositions contenues dans d’autres code ou lois qui dérogent au délai de droit commun ou à la règle selon laquelle celui-ci court à compter de la commission des faits. Ainsi, par exemple :
–– des infractions réprimées par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;
–– des infractions mentionnées à l’article L. 114 du code électoral ;
–– du délit d’usure, pour lequel la prescription de l’action publique « court à compter du jour de la dernière perception, soit d’intérêt, soit de capital », en application du dernier alinéa de l’article 313-5 du code de la consommation ;
–– du délit de banqueroute et des infractions assimilées, pour lesquels « la prescription de l’action publique ne court que du jour du jugement ouvrant la procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire lorsque les faits incriminés sont apparus avant cette date », conformément à l’article L. 654-16 du code de commerce ;
–– des infractions liées au non-paiement des cotisations de sécurité sociale par l’employeur ou le travailleur indépendant, pour lesquelles « les délais de prescription de l’action publique commencent à courir à compter de l’expiration du délai d’un mois qui suit, selon le cas, soit l’avertissement [de l’autorité compétente de l’État invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois dans le cas où la poursuite a lieu à la requête du ministère public], soit la mise en demeure [adressée par lettre recommandée à l’employeur ou au travailleur indépendant si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public] », en vertu de l’article L. 244-7 du code de la sécurité sociale ;
–– des crimes et délits d’insoumission ou de désertion, pour lesquels la prescription de l’action publique « ne commence à courir qu’à partir du jour où l’insoumis ou le déserteur a atteint l’âge le dispensant de satisfaire à toute obligation militaire » (73), en application de l’article L. 211-13 du code de justice militaire.
Il est apparu préférable de conserver ces dispositions à leurs emplacements actuels afin de ne pas altérer la cohérence du cadre juridique dans lequel chacune d’entre elles s’inscrit. Dans son avis sur la proposition de loi, le Conseil d’État, se prononçant en particulier sur le choix de ne pas transférer les dispositions encadrant les délais réduits de prescription, s’est montré favorable à la solution retenue par les auteurs du présent texte, rappelant que ces délais s’inscrivent « dans des régimes juridiques dont il est utile de conserver l’unité formelle » (74).
Depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure (LOPPSI) et en application de l’actuel dernier alinéa de l’article 8 du code de procédure pénale, le point de départ du délai de prescription de l’action publique de certains délits commis sur une personne vulnérable « du fait de son âge, d’une maladie, d’une infirmité, d’une déficience physique ou psychique ou de son état de grossesse » est reporté au jour où l’infraction « apparaît à la victime dans des conditions permettant l’exercice de l’action publique ».
Cette disposition, introduite pour améliorer la protection des « personnes qui, en raison de leur particulière vulnérabilité, n’ont pas conscience immédiatement de l’infraction dont elles sont victimes et la découvrent avec un retard tel qu’il n’est plus possible d’engager des poursuites » (75), ne s’applique que si la personne se trouve être victime d’un certain nombre d’infractions prévues par le code pénal : abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de la situation de faiblesse (article 223-15-2), vol et certains vols aggravés (articles 311-3 et 311-4), escroquerie et toute forme d’escroquerie aggravée (articles 313-1 et 313-2), abus de confiance et toute forme d’abus de confiance aggravé (articles 314-1 à 314-3), destruction ou détournement d’objet saisi (article 314-6), recel (article 321-1).
Les auteurs de la présente proposition de loi ne remettent naturellement pas en cause le bien-fondé des dispositions de notre corpus pénal qui protègent les personnes vulnérables. Néanmoins, ils ne peuvent que regretter l’imprécision de la rédaction de la disposition figurant au dernier alinéa de l’article 8 du code de procédure pénale et constater, à l’instar de nombreuses personnes entendues dans le cadre de la mission d’information sur la prescription en matière pénale, l’insécurité juridique qui en résulte. Tout comme la Conférence nationale des procureurs généraux, ils sont extrêmement réservés quant au principe même du report du point de départ de la prescription à l’initiative de la victime. Par ailleurs, ils s’interrogent sur la pertinence des critères de vulnérabilité retenus. Peut-on vraiment considérer que l’âge ou, plus encore, l’état de grossesse, justifie le principe du report du point de départ du délai de prescription ? En tout état de cause, face à « [l]a difficulté à définir le moment de la récupération par le sujet de ses pleines compétences » et parce que « la définition claire et consensuelle des critères de cette récupération pose des problèmes difficilement surmontables », il semble que la disposition soit en réalité inopérante, ainsi que l’a fait remarquer le professeur Philippe-Jean Parquet, psychiatre spécialiste de l’emprise mentale (76).
En définitive, pour les auteurs du présent texte, l’état de vulnérabilité de la victime ne saurait justifier, en dehors de la situation très particulière des mineurs, le principe du report du point de départ du délai de prescription au jour où ladite victime serait en mesure de prendre conscience de l’infraction qu’elle a subie. En effet, « s’il est aisé, pour une victime mineure, de déterminer le moment objectif à partir duquel elle peut raisonnablement agir, tel n’est pas le cas pour les autres victimes vulnérables pour lesquelles ce moment dépend de leur évolution psychique » (77).
Par conséquent, convaincus, comme le directeur des affaires criminelles et des grâces, que le « point de départ différé pour les personnes vulnérables (…) n’a pas de sens » (78), les auteurs de la proposition de loi ont fait le choix de supprimer la disposition qui figure, à ce jour, au dernier alinéa de l’article 8 du code de procédure pénale.
Si le doublement du délai de prescription de l’action publique applicable aux contraventions a pu, un temps, être envisagé (1), les auteurs de la proposition de loi ont finalement choisi de le maintenir en l’état (2).
En matière contraventionnelle, l’action publique se prescrit par une année révolue, en application de l’article 9 du code de procédure pénale, et les peines par trois années révolues, conformément à l’article 133-4 du code pénal.
Dans le cadre de leur mission d’information, votre rapporteur et son collègue Georges Fenech se sont interrogés sur la nécessité de modifier les délais de prescription de l’action publique et des peines applicables aux contraventions, qui, de l’avis des praticiens du droit, ne soulèvent pas de véritable difficulté. Dans un souci de simplification du droit et de cohérence avec le reste de la réforme, ils se sont prononcés en faveur de l’harmonisation des deux délais (79). Ils ont d’abord écarté la solution consistant à établir un délai unique à un an (alignement du délai de prescription de la peine sur celui de l’action publique), qui aurait comporté le risque d’entraver le recouvrement des amendes de nature contraventionnelle. Ils n’ont pas davantage retenu la solution consistant à porter le délai unique à trois ans (alignement du délai de prescription de l’action publique sur celui de la peine), qui aurait présenté l’inconvénient de permettre le déclenchement des poursuites trop longtemps après la commission de faits d’une gravité toute relative. In fine, ils ont proposé de fixer le nouveau délai unique à deux ans.
Les auteurs de la proposition de loi ont finalement renoncé à modifier les délais de prescription de l’action publique et des peines en matière contraventionnelle. Il leur est en effet apparu, à l’issue de l’examen de la proposition de loi par le Conseil d’État, que l’harmonisation envisagée n’apparaissait « pas souhaitable dès lors, d’une part, que la réduction du délai de prescription de la peine contraventionnelle ne permettrait pas d’assurer l’effectivité du recouvrement des amendes et, d’autre part, que l’allongement du délai de prescription de l’action publique des contraventions serait inutile, la caractérisation de la plupart de ces infractions étant immédiate » (80).
En définitive, l’article 1er de la proposition de loi se contente d’apporter à l’article 9 du code de procédure pénale des modifications purement formelles :
–– il reprend la formule, déjà utilisée aux articles 7 et 8 réécrits, selon laquelle le délai de prescription de l’action publique serait applicable « [s]auf dans les cas où la loi en dispose autrement » ;
–– il précise que ce délai courrait à compter du jour de la commission de l’infraction, ce qui est déjà le cas bien que l’article 9, dans sa rédaction actuelle, ne le prévoit pas de manière expresse.
L’article 1er de la présente proposition de loi ajoute à la liste des infractions imprescriptibles, constituée aujourd’hui des seuls crimes contre l’humanité (A), les crimes de guerre mentionnés au livre quatrième bis du code pénal (B). Compte tenu du cadre juridique applicable à cette disposition (C), la commission des Lois a réservé l’imprescriptibilité aux seuls crimes de guerre connexes à un ou plusieurs crimes contre l’humanité (D).
En l’état du droit, seuls les crimes contre l’humanité sont imprescriptibles (81). Cette imprescriptibilité a été pour la première fois introduite en droit français par la loi n° 64-1326 du 29 décembre 1964 tendant à constater l’imprescriptibilité des crimes contre l’humanité, qui a rendu « imprescriptibles par leur nature » « les crimes contre l’humanité, tels qu’ils sont définis par la résolution des Nations Unies du 13 février 1946, prenant acte de la définition des crimes contre l’humanité, telle qu’elle figure dans la charte du tribunal international du 8 août 1945 ». Pour la Cour de cassation, « la loi du 26 décembre 1964, en " constatant l’imprescriptibilité des crimes contre l’humanité ", s’est bornée à confirmer qu’était déjà acquise en droit interne, par l’effet des accords internationaux auxquels la France avait adhéré, l’intégration " à la fois de l’incrimination (…) et de l’imprescriptibilité de ces faits " » (82).
En 1992, le législateur a inscrit cette règle à l’article 213-5 du code pénal sans renvoyer à la définition retenue dans la charte du tribunal international du 8 août 1945 mais en l’appliquant aux crimes contre l’humanité visés aux articles 211-1 à 212-3 de ce code, le génocide et les autres crimes contre l’humanité (voir l’encadré ci-après).
Liste des crimes contre l’humanité mentionnés
aux articles 211-1 à 212-3 du code pénal
–– Le génocide (article 211-1), défini comme « le fait, en exécution d’un plan concerté tendant à la destruction totale ou partielle d’un groupe national, ethnique, racial ou religieux, ou d’un groupe déterminé à partir de tout autre critère arbitraire, de commettre ou de faire commettre, à l’encontre de membres de ce groupe, l’un des actes suivants :
« – atteinte volontaire à la vie ;
« – atteinte grave à l’intégrité physique ou psychique ;
« – soumission à des conditions d’existence de nature à entraîner la destruction totale ou partielle du groupe ;
« – mesures visant à entraver les naissances ;
« – transfert forcé d’enfants ».
–– La « provocation publique et directe, par tous moyens, à commettre un génocide » (article 211-2), lorsqu’elle a été suivie d’effet.
–– L’un des actes suivants « commis en exécution d’un plan concerté à l’encontre d’un groupe de population civile dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique » (article 212-1) :
« 1° L’atteinte volontaire à la vie ;
« 2° L’extermination ;
« 3° La réduction en esclavage ;
« 4° La déportation ou le transfert forcé de population ;
« 5° L’emprisonnement ou toute autre forme de privation grave de liberté physique en violation des dispositions fondamentales du droit international ;
« 6° La torture ;
« 7° Le viol, la prostitution forcée, la grossesse forcée, la stérilisation forcée ou toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable ;
« 8° La persécution de tout groupe ou de toute collectivité identifiable pour des motifs d’ordre politique, racial, national, ethnique, culturel, religieux ou sexiste ou en fonction d’autres critères universellement reconnus comme inadmissibles en droit international ;
« 9° La disparition forcée ;
« 10° Les actes de ségrégation commis dans le cadre d’un régime institutionnalisé d’oppression systématique et de domination d’un groupe racial sur tout autre groupe racial ou tous autres groupes raciaux et dans l’intention de maintenir ce régime ;
« 11° Les autres actes inhumains de caractère analogue causant intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à l’intégrité physique ou psychique. ».
–– L’un des actes visés à l’article 212-1 « [l]orsqu’ils sont commis en temps de guerre en exécution d’un plan concerté contre ceux qui combattent le système idéologique au nom duquel sont perpétrés des crimes contre l’humanité » (article 212-2).
–– « La participation à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, de l’un des crimes définis par les articles 211-1, 212-1 et 212-2 » (article 212-3).
Le dernier alinéa de l’article 7 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de l’article 1er de la proposition de loi, a pour objet de rendre imprescriptible l’action publique des crimes de guerre (2) aujourd’hui soumise à un délai de prescription allongé de trente ans (1).
Pendant longtemps, les faits susceptibles d’être qualifiés de crimes de guerre pouvaient être poursuivis en France sur la base des incriminations de droit commun du code pénal (comme le meurtre, la torture, le viol ou la séquestration) et du code de justice militaire (comme les crimes de droit commun contraires aux lois et coutumes de guerre et aux conventions internationales, les pillages, les destructions ou les abus d’autorité).
La signature, le 17 juillet 1998, de la Convention de Rome portant statut de la Cour pénale internationale (CPI), ratifiée par la France le 9 juin 2000, a redéfini le champ des infractions de guerre. À cette occasion, il est apparu que les incriminations françaises ne couvraient pas l’ensemble des actes mentionnés par l’article 8 du statut de Rome et ne permettaient de prendre en compte ni la spécificité des infractions liées à un conflit armé, ni leur particulière gravité au regard de la vulnérabilité des populations civiles. Par ailleurs, le droit international ignorant la distinction du droit français entre crimes et délits, le législateur devait effectuer un travail d’adaptation des incriminations visées par le statut de Rome en les distinguant selon leur gravité.
À cette fin, la loi n° 2010-930 du 9 août 2010 portant adaptation du droit pénal à l’institution de la Cour pénale internationale a introduit dans le code pénal un nouveau livre quatrième bis consacré aux crimes et délits de guerre. Elle a inséré dans ce livre un article 462-10 qui prévoit que l’action publique des crimes de guerre ainsi que les peines prononcées se prescrivent, par dérogation au droit commun, par trente ans, celles des délits de guerre se prescrivant par vingt ans.
La solution retenue par le législateur se démarque de l’article 29 du statut de Rome qui prévoit l’imprescriptibilité des crimes relevant de la compétence de la CPI. Pour le Gouvernement, cette solution procédait d’« un compromis entre la nécessité de ne pas " banaliser " en droit français la règle de l’imprescriptibilité de l’action publique à des infractions autres que les crimes contre l’humanité et l’intérêt de limiter au maximum les cas où la Cour pénale internationale pourrait se trouver saisie du seul fait de l’application des règles internes en matière de prescription » (83). Pour M. Thierry Mariani, rapporteur au nom de la commission des Lois de l’Assemblée nationale, « l’allongement des délais de prescription proposé [traduisait] pleinement la volonté d’un rapprochement avec les principes retenus par la Cour pénale internationale. (…) [P]assé un délai de trente ans, si les juridictions françaises ne pourront plus engager de poursuites à l’encontre de criminels de guerre français ou présents sur le territoire français, la Cour pénale internationale elle-même restera compétente, en application du principe de complémentarité. Il n’y aura donc aucun déni de justice » (84). Toutefois, certains parlementaires avaient défendu l’imprescriptibilité des crimes de guerre en droit français, à l’instar de M. Jean-Jacques Urvoas (85).
Le dernier alinéa de l’article 7 du code de procédure pénale, tel qu’il résulte de la présente proposition de loi, rend imprescriptibles tous les crimes de guerre mentionnés au livre quatrième bis du code pénal. Il reprend la proposition n° 3 de la mission d’information sur la prescription en matière pénale conduite par les auteurs de ce texte.
Seraient visés les crimes prévus aux articles 461-2 à 461-31 de ce code.
Il s’agirait, en premier lieu, des crimes de guerre communs aux conflits armés internationaux et non internationaux suivants :
–– certaines atteintes à la vie et à l’intégrité physique ou psychique :
• « les atteintes volontaires à la vie, les atteintes volontaires à l’intégrité physique ou psychique de la personne ainsi que l’enlèvement et la séquestration (…) commis à l’encontre d’une personne protégée par le droit international des conflits armés en vertu des lois et coutumes de guerre et du droit international humanitaire » (article 461-2) ;
• « [l]e fait de soumettre des personnes d’une partie adverse à des mutilations ou à des expériences médicales ou scientifiques qui ne sont ni justifiées par des raisons thérapeutiques, ni pratiquées dans l’intérêt de ces personnes et qui entraînent leur mort ou portent gravement atteinte à leur santé ou à leur intégrité physique ou psychique » (article 461-3) ;
• « [l]e fait de forcer une personne protégée par le droit international des conflits armés à se prostituer, de la contraindre à une grossesse non désirée, de la stériliser contre sa volonté ou d’exercer à son encontre toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable » (article 461-4) ;
• « [l]e fait de se livrer à des traitements humiliants et dégradants sur des personnes de la partie adverse et qui portent gravement atteinte à leur intégrité physique ou psychique » (article 461-5) ;
–– certaines « atteintes à la liberté individuelle définies à l’article 432-4 et commises à l’encontre d’une personne protégée par le droit international des conflits armés, en dehors des cas admis par les conventions internationales » (article 461-6) ;
–– « [l]e fait de procéder à la conscription ou à l’enrôlement de mineurs de dix-huit ans dans les forces armées ou dans des groupes armés, ou de les faire participer activement à des hostilités » (article 461-7) ;
–– le recours à des moyens et à des méthodes de combat prohibés :
• « [l]e fait d’ordonner qu’il n’y ait pas de survivants ou d’en menacer l’adversaire » (article 461-8) ;
• « [l]e fait de lancer des attaques délibérées contre la population civile en tant que telle ou contre des personnes civiles qui ne prennent pas part directement aux hostilités » (article 461-9) ;
• « [l]e fait de causer des blessures ayant porté gravement atteinte à son intégrité physique à un combattant de la partie adverse qui, ayant déposé les armes ou n’ayant plus de moyens de se défendre, s’est rendu » (article 461-10) ;
• « [l]e fait de causer, par traîtrise, à un individu appartenant à la Nation ou à l’armée adverse ou à un combattant de la partie adverse des blessures ayant porté gravement atteinte à son intégrité physique » (article 461-11) ;
• le lancement d’« attaques délibérées contre le personnel, les bâtiments, le matériel, les unités et les moyens de transport sanitaires portant, conformément au droit international, les signes distinctifs prévus par les conventions de Genève du 12 août 1949 ou leurs protocoles additionnels » ou « contre le personnel, les installations, le matériel, les unités ou les véhicules employés dans le cadre d’une mission d’aide humanitaire ou de maintien de la paix conformément à la Charte des Nations unies, pour autant qu’ils aient droit à la protection que le droit international des conflits armés garantit aux civils et aux biens de caractère civil » (article 461-12) ;
• le lancement d’« attaques délibérées contre des bâtiments consacrés à la religion, à l’enseignement, à l’art, à la science ou à l’action caritative, des monuments historiques, des hôpitaux et des lieux où des malades ou des blessés sont rassemblés, pour autant que ces bâtiments ne soient pas alors utilisés à des fins militaires » (article 461-13) ;
• le lancement d’« attaques délibérées contre des biens de caractère civil qui ne sont pas des objectifs militaires » (article 461-14) ;
–– certaines atteintes aux biens :
• « [l]e fait de se livrer, avec des armes ou à force ouverte, au pillage d’une ville ou d’une localité, même prise d’assaut » (article 461-15) ;
• certains « vols, (…) extorsions ainsi que [certaines] destructions, dégradations et détériorations de biens définis par le livre III du présent code » (1° de l’article 461-16), le recel de leurs produits (2° de l’article 461-16) et la tentative de l’une de ces infractions (article 461-17).
Il s’agirait, en deuxième lieu, des crimes de guerre propres aux conflits armés internationaux suivants :
–– certaines atteintes à la liberté et aux droits des personnes :
• l’emploi d’« une personne protégée par le droit international des conflits armés pour éviter que certains points, zones ou forces militaires ne soient la cible d’opérations militaires » (article 461-19) ;
• « [l]e fait, pour le compte d’une puissance belligérante (…) [d]e contraindre une personne protégée par le droit international des conflits armés à servir dans ses forces armées » ou « [d]e contraindre les nationaux de la partie adverse à prendre part aux opérations de guerre dirigées contre leur pays, même s’ils étaient au service de la puissance belligérante avant le commencement de la guerre » (article 461-20) ;
• « [l]e fait de faire obstacle au droit d’une personne protégée par le droit international des conflits armés d’être jugée régulièrement et impartialement, selon les prescriptions des conventions internationales applicables » (article 461-21) ;
• « [l]e fait de déclarer les droits et actions des nationaux de la partie adverse irrecevables en justice, forclos ou suspendus, en raison de la nationalité des requérants » (article 461-22) ;
–– le recours à des moyens et méthodes de combat prohibés :
• l’utilisation « du poison ou des armes empoisonnées », « des gaz asphyxiants, toxiques ou assimilés et tous liquides, matières ou procédés analogues », « des balles qui se déforment facilement dans le corps humain » ou l’emploi « des armes, des projectiles, des matériels ou des méthodes de combat ayant fait l’objet d’une interdiction générale et ayant été inscrits dans une annexe au statut de la Cour pénale internationale acceptée par la France » (article 461-23) ;
• l’attaque ou le bombardement, « par quelque moyen que ce soit, des villes, villages, habitations ou bâtiments, qui ne sont pas défendus et qui ne sont pas des objectifs militaires » (article 461-24) ;
• « [l]e fait d’affamer des personnes civiles, comme méthode de guerre, en les privant délibérément de biens indispensables à leur survie, y compris en empêchant intentionnellement l’envoi des secours prévus par les conventions de Genève du 12 août 1949 et leurs protocoles additionnels » (article 461-25) ;
• la participation « soit au transfert, direct ou indirect, par une puissance occupante, d’une partie de sa population civile dans le territoire qu’elle occupe, soit à la déportation ou au transfert à l’intérieur ou hors du territoire occupé de la totalité ou d’une partie de la population civile de ce territoire » (article 461-26) ;
• le lancement d’« une attaque délibérée en sachant qu’elle causera incidemment des pertes en vies humaines dans la population civile ou des blessures parmi cette population, qui seraient manifestement disproportionnées par rapport à l’avantage militaire concret et direct attendu de l’ensemble de l’attaque » (article 461-27) ;
• le lancement d’« une attaque délibérée en sachant qu’elle causera incidemment (…) [d]es dommages aux biens de caractère civil, qui seraient manifestement disproportionnés par rapport à l’avantage militaire concret et direct attendu de l’ensemble de l’attaque » ou « [d]es dommages étendus, durables et graves à l’environnement naturel, qui seraient manifestement disproportionnés par rapport à l’avantage militaire concret et direct attendu de l’ensemble de l’attaque » (article 461-28) ;
• « [l]e fait d’employer indûment le pavillon parlementaire, le drapeau ou les insignes militaires et l’uniforme de l’ennemi ou de l’Organisation des Nations unies, ainsi que les signes distinctifs prévus par les conventions de Genève du 12 août 1949 et leurs protocoles additionnels et, ce faisant, de causer à un combattant de la partie adverse des blessures ayant porté gravement atteinte à son intégrité physique » (article 461-29).
En dernier lieu, seraient visés les crimes de guerre propres aux conflits armés non internationaux :
–– « le fait d’ordonner le déplacement de la population civile pour des raisons ayant trait au conflit » à moins que la sécurité des personnes civiles ou des impératifs militaires ne l’exigent (article 461-30) ;
–– « [l]e fait de prononcer des condamnations et d’exécuter des peines sans un jugement préalable, rendu par un tribunal régulièrement constitué, assorti des garanties judiciaires prévues par les conventions de Genève du 12 août 1949 et leurs protocoles additionnels » (article 461-31).
Sur le plan formel, sont rassemblées au dernier alinéa de l’article 7 du code de procédure pénale réécrit des dispositions aujourd’hui éparses, celles relatives à l’imprescriptibilité de l’action publique des crimes contre l’humanité et à la prescription des crimes de guerre figurant respectivement à l’article 213-5 du code pénal et au premier alinéa de l’article 462-10 du même code.
La présente disposition soulève deux questions juridiques. D’une part, l’extension par la loi du régime de l’imprescriptibilité à d’autres crimes que les crimes contre l’humanité pourrait-elle contrevenir à une disposition conventionnelle ou constitutionnelle (1) ? D’autre part, l’imprescriptibilité des crimes de guerre constitue-t-elle une obligation juridique (2) ?
Saisi de la présente proposition de loi, le Conseil d’État s’est prononcé sur la compatibilité de cette disposition avec la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CESDH) ou la Constitution. Il a relevé qu’aucune de leurs stipulations ou dispositions ne régissait spécifiquement la prescription en matière pénale.
La Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) considère que le droit au procès équitable protégé par l’article 6 de la CESDH n’inclut pas un droit à la prescription et que les États disposent, en cette matière, d’une certaine marge d’appréciation. Statuant sur la compatibilité des délais de prescription en matière pénale avec le droit d’accès à un tribunal garanti par l’article 6 § 1 précité, elle a simplement considéré que les « délais de prescription dans les affaires d’atteinte à l’intégrité de la personne sont un trait commun aux systèmes juridiques des États contractants ». Elle a d’ailleurs ajouté que « [c]es délais ont plusieurs finalités importantes, à savoir garantir la sécurité juridique en fixant un terme aux actions, mettre les défendeurs potentiels à l’abri de plaintes tardives peut-être difficiles à contrer, et empêcher l’injustice qui pourrait se produire si les tribunaux étaient appelés à se prononcer sur des événements survenus loin dans le passé à partir d’éléments de preuve auxquels on ne pourrait plus ajouter foi et qui seraient incomplets en raison du temps écoulé » (86).
Le Conseil d’État a également examiné la jurisprudence constitutionnelle en la matière (voir l’encadré ci-après). Revenant sur une décision de 1996 par laquelle il avait considéré que l’existence d’une règle de prescription constituait un principe fondamental reconnu par les lois de la République, il a considéré « qu’aucun principe constitutionnel n’impose au législateur de prévoir un délai de prescription de l’action publique ou de la peine pour les infractions dont la nature n’est pas d’être imprescriptible » et que, par suite, « le législateur dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour décider du principe (…) de la prescription de l’action publique » (87).
La jurisprudence constitutionnelle relative au principe
de la prescription de l’action publique
Le Conseil constitutionnel
Le Conseil constitutionnel s’est prononcé, en 2010, sur la conformité à la Constitution de la disposition du projet de loi portant adaptation du droit pénal à l’institution de la Cour pénale internationale tendant à soumettre les crimes de guerre à un délai de prescription de trente ans à la différence des crimes contre l’humanité régis par l’imprescriptibilité. Il a estimé que la différence de traitement au regard de la prescription entre ces deux catégories de crimes était conforme à la Constitution, au motif que ces crimes « sont de nature différente » et que « le principe d’égalité devant la loi pénale, tel qu’il résulte de l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, ne fait pas obstacle à ce qu’une différenciation soit opérée par la loi pénale entre agissements de nature différente » (1).
Toutefois, appelé dix ans plus tôt à se prononcer sur la nécessité d’une révision de la Constitution préalablement à la ratification de la Convention de Rome précitée, il avait jugé qu’« aucune règle, ni aucun principe de valeur constitutionnelle, n’interdit l’imprescriptibilité des crimes les plus graves qui touchent l’ensemble de la communauté internationale » (2).
La Cour de cassation
Pour l’assemblée plénière de la Cour de cassation saisie de trois questions prioritaires de constitutionnalité en 2011, « la prescription de l’action publique ne revêt pas le caractère d’un principe fondamental reconnu par les lois de la République et ne procède pas des articles 7 et 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, ni d’aucune disposition, règle ou principe de valeur constitutionnelle » (3).
Le Conseil d’État
Pour la section de l’intérieur du Conseil d’État appelée à se prononcer en 1996 sur la conformité à la Constitution du projet de statut d’une Cour criminelle internationale, « l’existence d’une règle de prescription qui est un principe fondamental reconnu par les lois de la République exige que, pour les crimes dont la nature n’est pas d’être imprescriptibles, un délai de prescription soit fixé dans le statut, en fonction de la gravité des crimes commis » (4). Le Conseil d’État est toutefois revenu sur l’existence d’un tel principe dans son avis sur la présente proposition de loi.
(1) Décision n° 2010-612 DC du 5 août 2010, Loi portant adaptation du droit pénal à l’institution de la Cour pénale internationale, considérants 2 à 8.
(2) Décision n° 98-408 DC du 22 janvier 1999, Traité portant statut de la Cour pénale internationale, considérant 20.
(3) Cass. ass. plén., 20 mai 2011, nos 11-90.025, 11-90.032 et 11-90.033.
(4) CE, Section de l’intérieur, 29 février 1996, Avis « Cour pénale internationale », n° 358597.
La présente disposition vise à tirer les conséquences en droit interne des conventions internationales prévoyant l’imprescriptibilité des crimes de guerre considérés par la communauté internationale comme des crimes particulièrement graves, qui heurtent la conscience humaine.
Outre le statut de Rome de 1998, plusieurs conventions internationales prévoient que les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre sont imprescriptibles, notamment la Convention des Nations unies du 26 novembre 1968 et la Convention européenne du 25 janvier 1974 sur l’imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité.
Existe-t-il pour autant une obligation juridique imposant à la France de rendre les crimes de guerre imprescriptibles ? La France n’a ratifié ni la Convention des Nations unies de 1968, ni celle du Conseil de l’Europe de 1974. En revanche, la ratification par la France du statut de Rome a conduit à s’interroger sur la nature des obligations pesant sur elle au regard de ses stipulations. Lors de la discussion du projet de loi portant adaptation du droit pénal à l’institution de la Cour pénale internationale, le Gouvernement a expliqué que ce statut « [faisait] obligation à tous les États parties d’adapter leur législation interne afin de " coopérer pleinement " avec la Cour » mais « ne [fixait] aucune autre obligation notamment de transposition des infractions de la compétence de la CPI » (88).
Dans son avis, le Conseil d’État a confirmé cette interprétation au motif qu’« il ne découle d’aucun engagement international de la France, et notamment pas du Statut de la Cour pénale internationale, que les crimes de guerre prévus en droit français devraient être imprescriptibles » (89).
Mais si rien n’oblige le législateur français à se conformer aux stipulations de ces conventions internationales, rien ne lui interdit pour autant de soumettre les crimes de guerre à l’imprescriptibilité. Ainsi que l’a relevé le Conseil d’État dans son avis, « aucune exigence juridique supérieure ne conditionne la décision du Parlement en matière de prescription des crimes de guerre et le choix qui serait le sien de rendre ces crimes imprescriptibles » (90).
Plusieurs arguments plaident en faveur d’un tel choix, soutenu par des initiatives anciennes et nombreuses de parlementaires (91) et d’instances consultatives comme la Commission nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH) (92).
Tout d’abord, comme l’ont relevé plusieurs personnes entendues par la mission d’information précitée, le droit international a développé une conception unitaire des crimes internationaux en soumettant au même régime juridique le crime de génocide, les autres crimes contre l’humanité et les crimes de guerre. À cet égard, M. Bruno Cotte, président honoraire de la chambre criminelle de la Cour de cassation et ancien président de chambre de jugement à la CPI, a fait observer « que nombre de faits sont susceptibles de recevoir la double qualification de crimes contre l’humanité et de crimes de guerre (une dualité de prescription est dès lors surprenante) » (93). Ce constat a été corroboré par Mme Mirelle Delmas-Marty, professeure honoraire au Collège de France (94).
Cette conception unitaire, qui se retrouve dans l’intitulé même des conventions internationales de 1968 et 1974 précitées, transparait également dans d’autres textes. Il en va ainsi, par exemple, de la Convention et du Protocole relatifs au statut des réfugiés, dont « les dispositions (…) ne seront pas applicables aux personnes dont on aura des raisons sérieuses de penser (…) qu’elles ont commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l’humanité » (95).
Il paraît donc cohérent que ces faits soient imprescriptibles. C’est d’ailleurs le choix de nombreux pays européens. La Belgique, la Lituanie, le Portugal ou la Suisse ont rendu spécifiquement imprescriptible l’action publique des crimes contre l’humanité et des crimes de guerre. L’Allemagne, l’Autriche, l’Espagne, l’Italie, la Norvège ou les Pays-Bas ont fait de même mais en incluant ces crimes dans un ensemble plus vaste de « crimes de sang » particulièrement graves soumis à l’imprescriptibilité (96).
Par ailleurs, votre rapporteur remarque que la France tend à traiter ensemble les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre. En droit interne, des dispositions de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse portent sur l’apologie des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité (97) ; en 2013, le Gouvernement a transmis au Conseil d’État un projet de loi améliorant la répression de la contestation des crimes de génocide, des crimes contre l’humanité et des crimes de guerre (98). Au plan international, la France défend une proposition visant à encadrer le recours au droit de veto des cinq membres permanents du Conseil de sécurité des Nations unies en cas d’« atrocités de masse », c’est-à-dire « en cas de génocide, de crime contre l’humanité ou de crime de guerre à grande échelle » (99).
Enfin, l’imprescriptibilité des crimes de guerre se justifie par le niveau de gravité exceptionnelle qu’ils présentent généralement et l’atteinte inacceptable qu’ils portent à la conscience humaine. Ainsi que l’a indiqué M. Bruno Cotte devant la mission d’information précitée, « dans l’échelle de l’horreur, j’ai scrupule à utiliser de tels termes car je ne veux surtout pas banaliser les comportements atroces que nous avons tous en mémoire, les crimes de guerre peuvent malheureusement atteindre des sommets » (100). Nombre d’entre eux relèvent donc par leur nature, leur dimension et leur gravité, des crimes les plus graves qui touchent l’ensemble de la communauté internationale.
Votre rapporteur, dont l’intention n’est nullement de « banaliser » la gravité des crimes contre l’humanité, a été sensible aux interrogations soulevées par la présente disposition et à la grande diversité des crimes de guerre concernés.
Comme l’a souligné, en 1996, M. Robert Badinter lors de l’examen par le Sénat d’un projet de loi relatif au renforcement de la répression du terrorisme, « [l]’imprescriptibilité est née du refus de nos consciences d’accepter que demeurent impunis, après des décennies, les auteurs des crimes qui nient l’humanité. L’imprescriptibilité doit demeurer tout à fait exceptionnelle : elle doit être limitée aux crimes contre l’humanité et ne saurait être étendue, (…) dans une sorte de mouvement émotionnel, aux crimes qui sont en relation avec une entreprise terroriste » (101). Tel n’était d’ailleurs pas l’objet du présent texte.
Le Conseil d’État a rappelé dans son avis que « la Cour de cassation, le Conseil d’État et le Conseil constitutionnel [avaient] souligné que les crimes de guerre ne sont pas de même nature que les crimes contre l’humanité dont l’impunité affecterait l’ensemble de la communauté internationale » et que « [l]’imprescriptibilité des crimes de guerre remettrait ainsi en cause la spécificité jusqu’alors reconnue en droit français des crimes contre l’humanité » (102).
Afin de tenir compte de ces observations, la commission des Lois a adopté trois amendements identiques déposés par votre rapporteur, M. Georges Fenech et le Gouvernement tendant à réserver l’imprescriptibilité aux crimes de guerre connexes à un ou plusieurs crimes contre l’humanité (103), eux-mêmes imprescriptibles.
Cette solution, qui a le mérite de rapprocher notre législation du Statut de la Cour pénale internationale (CPI), fait écho à la remarque formulée devant la mission d’information sur la prescription en matière pénale par M. Bruno Cotte selon laquelle nombre de faits poursuivis devant la CPI sont susceptibles de recevoir la double qualification de crimes contre l’humanité et de crimes de guerre.
En outre, cette solution présente l’avantage de répondre aux remarques formulées par le Gouvernement à l’encontre de l’imprescriptibilité généralisée à l’ensemble des crimes de guerre, lequel, dans l’exposé sommaire de son amendement, estimait que le passage à un régime d’imprescriptibilité généralisée « mettrait les militaires français dans une situation juridiquement inégale, leurs ennemis étant davantage susceptibles d’être poursuivis pour des crimes terroristes restés prescriptibles que pour des crimes de guerre difficiles à prouver ». Selon lui, « il accroîtrait la tentation de certains acteurs politiques, visible aujourd’hui, de contraindre la souveraineté française et son action diplomatique et stratégique par l’arme de l’action judiciaire » et « se heurterait à la difficulté pour le juge national d’apprécier, des décennies après les faits, les éléments matériels de l’infraction qui reposent notamment sur une distinction entre objectifs militaires et objets civils dont les conflits modernes, et notamment celui qui oppose la France et la coalition à laquelle elle participe à Daech, montrent à quel point elle est délicate ».
Enfin, une telle modification rejoint les préoccupations formulées par le Conseil d’État pour lequel « [l]e délai d’extinction de l’action publique permettant de satisfaire l’objectif d’intérêt général de rétablissement de la paix sociale, (…) l’imprescriptibilité d’infractions pénales ne devrait être envisagée que lorsqu’elle concourt elle-même au rétablissement de la paix sociale » (104).
Le 2° de l’article 1er insère trois nouveaux articles 9-1 à 9-3 au sein du sous-titre Ier du titre préliminaire du code de procédure pénale. Le nouvel article 9-1 précise la définition (A) et la portée (B) des motifs d’interruption du délai de prescription de l’action publique. Le nouvel article 9-2 détermine les modalités de fixation de son point de départ pour les infractions occultes et dissimulées (C). Le nouvel article 9-3 pose les conditions de sa suspension (D).
Pour répondre aux insuffisances et imprécisions du droit en vigueur (1), le premier alinéa du nouvel article 9-1 tend à préciser et clarifier les motifs d’interruption du délai de prescription de l’action publique (2). La Commission a enrichi ces dispositions (3).
Les conditions d’interruption du délai de prescription de l’action publique sont aujourd’hui régies par les deux premiers alinéas de l’article 7 du code de procédure pénale qui prévoient que l’action publique en matière criminelle « se prescrit par dix années révolues à compter du jour où le crime a été commis si, dans cet intervalle, il n’a été fait aucun acte d’instruction ou de poursuite » et que « s’il en a été effectué dans cet intervalle, elle ne se prescrit qu’après dix années révolues à compter du dernier acte ». Les mêmes règles s’appliquent en matière délictuelle et contraventionnelle, les articles 8 et 9 du même code renvoyant aux distinctions spécifiées à l’article 7.
Ces règles, demeurées inchangées depuis le code d’instruction criminelle de 1808, ne prévoient donc en principe l’interruption du cours de la prescription de l’action publique que par un « acte d’instruction ou de poursuite ».
Dans le relatif silence de la loi et hors les cas dans lesquels des textes ont expressément défini des motifs d’interruption, la chambre criminelle de la Cour de cassation a interprété la notion d’acte d’instruction et de poursuite afin de l’adapter aux nouvelles réalités de la procédure pénale, reconnaissant le caractère d’actes de poursuite ou d’instruction à ceux « qui ont pour objet de constater une infraction, d’en rassembler les preuves et d’en rechercher les auteurs » (105).
D’une part, elle a développé une double acception formelle et matérielle de l’acte d’instruction, recouvrant non seulement l’acte établi par le juge d’instruction (106) mais aussi l’acte qui a pour but la recherche et la réunion des preuves d’une infraction au cours de l’instruction préparatoire, y compris s’il est pris par les policiers, gendarmes ou agents chargés de fonctions de police judiciaire (107).
D’autre part, elle a considéré que l’acte de poursuite s’entendait comme tout acte tendant à la mise en œuvre de l’action publique. Cette catégorie recouvre à la fois les actes qui visent à la simple constatation d’une infraction, les actes d’enquête et les actes tendant au jugement de l’auteur de l’infraction, qu’ils émanent du ministère public (108) ou de la partie civile (109), en particulier la plainte avec constitution de partie civile devant le juge d’instruction ou par voie d’intervention (110). Dans ce dernier cas, la chambre criminelle a toutefois subordonné le caractère interruptif de la plainte avec constitution de partie civile devant le juge d’instruction au versement de la consignation prévue par l’article 88 du code de procédure pénale dans le délai fixé par le juge (111) ou au bénéfice de l’aide juridictionnelle dispensant le plaignant de consigner (112).
2. La nécessité d’une intervention législative afin de clarifier et préciser la notion d’actes interruptifs
La mission d’information sur la prescription en matière pénale conduite par les auteurs de la proposition de loi a relevé le caractère particulièrement extensif de cette jurisprudence qui, tout en interprétant utilement les dispositions générales et datées du code de procédure pénale, a contribué à brouiller la frontière entre les actes de nature judiciaire et ceux à caractère administratif.
Car, tout en refusant de reconnaître un effet interruptif à la plupart des actes administratifs pris par l’autorité judiciaire dans l’exercice de ses missions, la chambre criminelle a conféré un tel effet à certains actes ne revêtant manifestement pas un caractère judiciaire, ceci aux seules fins d’écarter l’exception de prescription de faits particulièrement graves. Ainsi, en 2002, par un arrêt rendu dans l’affaire dite des « disparues de l’Yonne », la Cour de cassation a-t-elle conféré un effet interruptif au simple soit-transmis du procureur de la République adressé à la direction de l’aide sociale à l’enfance pour ne pas déclarer prescrits les faits d’enlèvement dont s’était rendu coupable Émile Louis entre 1975 et 1979 (113). Elle précisera, en 2005, que, pour être interruptif, le soit-transmis doit toutefois manifester « la volonté, après certaines vérifications, de mettre en mouvement l’action publique » (114).
En conséquence et compte tenu de l’ensemble de ces évolutions jurisprudentielles, la mission d’information appelait, dans sa proposition n° 12, à « clarifier et préciser la notion d’acte interruptif (…) en conférant un caractère interruptif à tout acte d’enquête, d’instruction ou de poursuite tendant effectivement à la recherche, à la poursuite et au jugement des auteurs d’infractions, même s’ils émanent de la personne exerçant l’action civile, y compris s’il s’agit d’une simple plainte adressée par la victime au procureur de la République ou déposée auprès d’un service de police judiciaire » (115). Tel est le triple objet de ce nouvel article 9-1.
En premier lieu, cette disposition ajoute les actes d’enquête à la liste des actes interruptifs afin de les faire figurer aux côtés des actes d’instruction et de poursuite. Ces actes constituent, en effet, la grande majorité des actes d’une procédure judiciaire et ils participent à la recherche des auteurs d’infractions. La jurisprudence leur ayant déjà reconnu un effet interruptif, cet ajout tendrait à actualiser et sécuriser juridiquement la liste des actes interruptifs.
En deuxième lieu, cette disposition précise que l’ensemble des actes interruptifs doivent avoir pour finalités effectives la constatation des infractions ou la recherche, la poursuite ou le jugement de leurs auteurs. À défaut de tendre à l’une au moins de ces finalités, l’acte ne saurait interrompre la prescription de l’action publique.
Cette disposition reprendrait en partie les solutions dégagées par la Cour de cassation :
–– elle permettrait de conférer un caractère interruptif aux actes qui visent à la simple constatation d’une infraction et à ceux qui tendent au jugement de leur auteur ;
–– elle constituerait un complément utile à la mention préalable des actes d’enquête, d’instruction et de poursuite : ces actes devraient s’analyser à l’aune de l’intention exprimée par la partie poursuivante qui devrait manifester expressément la volonté de poursuivre, d’instruire ou de juger ;
–– elle viserait à exclure de cette catégorie les actes de nature administrative ou d’ordre interne : l’effet de l’interruption sur le cours de la prescription – tout acte interruptif faisant courir un nouveau délai de prescription – exige en effet que seuls les actes judiciaires se voient reconnaître un caractère interruptif.
En dernier lieu, cette disposition prévoit qu’« [i]nterrompent également la prescription les actes qui émanent de la personne exerçant l’action civile, lorsqu’ils ont les mêmes finalités, et les plaintes adressées au procureur de la République ou à un service de police judiciaire ».
S’agissant des actes de la partie civile, elle inscrirait dans la loi la solution dégagée par la Cour de cassation qui, dans le silence du code de procédure pénale, a conféré un caractère interruptif aux actes d’instruction ou de poursuite émanant de la personne exerçant l’action civile. Aujourd’hui, cette jurisprudence couvre par exemple le cas du dépôt de plainte avec constitution de partie civile ou, en matière d’infractions de presse, la demande de report de l’ordonnance de clôture pour la production de pièces nouvelles.
Par ailleurs, elle ajouterait à la liste des actes interruptifs la plainte « simple » de la victime adressée au procureur de la République conformément à l’article 40 du code de procédure pénale ou déposée auprès d’un service de police judiciaire en application de l’article 15-3 du même code.
La Cour de cassation a développé une conception extensive de l’acte interruptif allant jusqu’à y inclure certains actes préalables à la poursuite ou à l’administration de la preuve, comme le procès-verbal contenant la dénonciation d’une infraction (116) ou la dénonciation officielle d’une infraction par une autorité étrangère (117). Mais elle a toujours refusé de considérer que la plainte adressée au procureur de la République pouvait interrompre le cours de la prescription (118), au motif qu’« une plainte, non assortie d’une constitution de partie civile, n’est pas un acte d’instruction ou de poursuite, même dans les matières où elle est la condition préalable et nécessaire de la mise en mouvement de l’action publique » (119).
Suivant les préconisations de la mission d’information qu’ils ont conduite, les auteurs de la proposition de loi ont, au contraire, estimé que les plaintes simples devaient pouvoir être considérées comme des actes interruptifs de prescription. Deux considérations justifient à leurs yeux ce choix :
–– d’une part, les finalités poursuivies par la victime lorsqu’elle décide de porter plainte : par leurs plaintes, les victimes portent à la connaissance des autorités de poursuite les infractions qu’elles subissent et manifestent leur intention de les voir constatées et sanctionnées ;
–– d’autre part, les actes considérés par la jurisprudence comme des actes d’instruction ou de poursuite : parmi eux, figurent des actes comparables à une plainte, comme le procès-verbal contenant la dénonciation d’une infraction (120) ou la simple consultation du fichier national des immatriculations (121).
De surcroît, si, en droit, nul ne conteste qu’elle a pour conséquence de mettre en mouvement l’action publique, en pratique, la constitution de partie civile est relativement méconnue de nos concitoyens, qui ignorent généralement ses conditions de recevabilité et la nécessité de déposer une consignation (voir l’encadré ci-après).
Au surplus, cette disposition complèterait utilement les prérogatives reconnues à la victime dans la procédure pénale, traductions du principe fixé par le II de l’article préliminaire du code de procédure pénale aux termes duquel « l’autorité judiciaire veille à l’information et à la garantie des droits des victimes au cours de toute procédure pénale ».
Les conditions du dépôt de plainte avec constitution
de partie civile devant le juge d’instruction
Recevabilité préalable de la plainte avec constitution de partie civile
Sauf en matière de crime, de délit de presse ou pour certains délits électoraux, la personne doit justifier « soit que le procureur de la République lui a fait connaître, à la suite d’une plainte déposée devant lui ou un service de police judiciaire, qu’il n’engagera pas lui-même des poursuites, soit qu’un délai de trois mois s’est écoulé depuis qu’elle a déposé plainte devant ce magistrat, contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, ou depuis qu’elle a adressé, selon les mêmes modalités, copie à ce magistrat de sa plainte déposée devant un service de police judiciaire » (deuxième alinéa de l’article 85 du code de procédure pénale).
Consignation
Après le dépôt de la plainte et afin de garantir le paiement de l’amende civile due en cas de constitution de partie civile abusive ou dilatoire, « [e]n fonction des ressources de la partie civile, [le juge d’instruction] fixe le montant de la consignation que celle-ci doit, si elle n’a obtenu l’aide juridictionnelle, déposer au greffe et le délai dans lequel elle devra être faite sous peine de non-recevabilité de la plainte », sauf s’il décide de la dispenser de consignation (articles 88 et 88-1 du même code).
L’effet interruptif de la plainte simple serait toutefois conditionné, comme en dispose le nouvel article 9-1 :
–– les plaintes devraient être adressées au procureur de la République ou déposées auprès d’un service de police judiciaire par la victime, ce qui exclurait les dénonciations ;
–– elles devraient tendre effectivement à la constatation des infractions ou à la recherche, à la poursuite ou au jugement de leurs auteurs, ce qui devrait exclure les plaintes manifestement abusives ou infondées.
En outre, il appartiendrait au juge de s’assurer qu’elles comportent une date certaine à partir de laquelle pourrait courir le nouveau délai de prescription.
3. Les modifications apportées par votre commission des Lois
À l’initiative de votre rapporteur, qui a repris les suggestions formulées par le Conseil d’État dans son avis du 1er octobre 2015 sur la présente proposition de loi, la commission des Lois a précisé la définition apportée à la notion d’acte interruptif par le premier alinéa du nouvel article 9-1.
En premier lieu, elle a veillé à assurer la bonne articulation de cet article avec les autres dispositions législatives qui prévoient une interruption du délai de prescription de l’action publique, notamment en matière de composition pénale (122) et de transaction pénale (123), qu’il s’agisse de dispositions du code de procédure pénale ou d’autres textes.
En second lieu, elle a élargi l’effet interruptif de prescription reconnu aux plaintes de la victime à celles adressées à un fonctionnaire auquel la mise en mouvement de l’action publique est confiée par la loi, ainsi que le prévoit l’article 1er du code de procédure pénale.
Les deux derniers alinéas du nouvel article 9-1 déterminent les effets de l’acte interruptif sur l’écoulement du délai de prescription de l’action publique (1), ainsi que sur la poursuite des personnes potentiellement impliquées et la répression des infractions concernées (2).
a. L’instauration d’un délai de prescription de l’action publique abrégé de moitié après l’acte interruptif
En l’état actuel du droit, tout acte interruptif efface le délai déjà écoulé et fait courir un nouveau délai de prescription d’une durée identique au délai initial, soit, pour le droit commun, dix ans en matière criminelle, trois ans en matière délictuelle et un an pour les contraventions. La même règle s’applique pour les délais de prescription dérogatoires au droit commun (124).
Le deuxième alinéa du nouvel article 9-1 rompt partiellement avec cette logique en prévoyant que, pour les seuls crimes et délits, tout acte interruptif ferait courir un nouveau délai de prescription d’une durée égale à la moitié du délai initial fixé par les articles 7 et 8 du code de procédure pénale. Compte tenu des nouveaux délais de droit commun (125), le délai abrégé serait de dix ans en matière criminelle et de trois ans en matière délictuelle. La même règle s’appliquerait pour les délais de prescription dérogatoires du droit commun mentionnés aux articles 7 et 8 précités.
Cette disposition s’inspire des préconisations de la mission d’information sur la prescription en matière pénale. Cette dernière recommandait d’« instituer de nouvelles règles qui obligeraient la justice, une fois saisie d’une affaire, à faire preuve de toute la célérité possible » et qui préviendraient « l’avènement d’une forme d’imprescriptibilité de fait (…) par le jeu des actes interruptifs ». Pour ce faire, elle proposait « de modifier la portée des actes interruptifs de prescription dès lors que les poursuites [seraient] engagées [à l’encontre d’une ou de plusieurs personnes nommément désignées], en rompant avec la règle selon laquelle chaque acte en question fait courir un délai identique au délai initial » (126). La mission suggérait, dans sa proposition n° 13, de fixer ce nouveau délai à trois ans, ainsi que l’avait proposé devant elle M. Jean-Claude Marin, procureur général près la Cour de cassation (127).
Cette mesure répondrait à deux justifications au moins.
D’une part, elle inciterait l’appareil judiciaire à agir avec célérité, incitation d’autant plus nécessaire que la présente proposition de loi prévoit un allongement significatif des délais de prescription de droit commun. En effet, il n’apparaît pas acceptable que plusieurs années s’écoulent sans qu’aucun acte d’enquête, d’instruction ou de poursuite ne soit réalisé à l’initiative des services d’enquête, de l’autorité judiciaire, de la partie civile ou de la victime. Comme le faisait remarquer M. Jean-Claude Marin, « dès lors que l’on allonge le délai de prescription de l’action publique, il semble difficile de faire bénéficier le train de la justice de cet allongement » (128).
D’autre part, elle contribuerait à garantir le droit de chacun à être jugé dans un délai raisonnable protégé par plusieurs dispositions (129), en particulier l’article 6 §1 de la CESDH qui prévoit que « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable ». La CEDH a jugé que le délai raisonnable, qui s’applique à la personne mise en cause, s’étendait du début des accusations portées contre celle-ci jusqu’à la date du jugement sur leur bien-fondé (voir l’encadré ci-après). Les mécanismes d’interruption du délai de prescription de l’action publique sont donc susceptibles d’interférer avec la mise en œuvre du droit à un jugement dans un délai raisonnable. Ainsi que l’a fait observer M. Bertrand Louvel, premier président de la Cour de cassation, devant la mission d’information, « il existe un risque de voir la durée des procédures s’accroître dès lors que la combinaison des différentes techniques de rallongement des délais de prescription, notamment celle des interruptions successives, permet que l’action engagée devienne, dans les faits, quasiment imprescriptible » (130).
Droit à être jugé dans un délai raisonnable :
point de départ et terme du délai pour la CEDH
La CEDH considère que le délai raisonnable commence à la « date à laquelle [sont] formulées les premières accusations » (1), date qui correspond à « la notification officielle, émanant de l’autorité compétente, du reproche d’avoir accompli une infraction pénale » (2), « idée qui correspond aussi à la notion de " répercussion importante sur la situation " du suspect » (3). Cette date peut être « antérieure à la saisine de la juridiction de jugement, celle notamment de l’arrestation, de l’inculpation et de l’ouverture des enquêtes préliminaires » (4).
Elle considère que la fin du délai est le jugement statuant sur le bien-fondé de l’accusation, même rendu en appel (5), et, en tout état de cause, le moment où la situation du requérant a cessé d’être affectée par l’accusation portée contre lui, ce qui inclut la procédure d’exécution du jugement (6).
(1) CEDH, 27 juin 1968, Wemhoff c. Allemagne, n° 2122/64.
(2) CEDH, 27 février 1980, Deweer c. Belgique, n° 6903/75.
(3) CEDH, 15 juillet 1982, Eckle c. Allemagne, n° 8130/78.
(4) CEDH, 31 mars 1998, Reinhardt et Slimane-Kaïd c. France, nos 21/1997/805/1008 et 22/1997/806/1009.
(5) CEDH, 27 juin 1968, Wemhoff c. Allemagne, n° 2122/64.
(6) CEDH, 26 septembre 1996, Di Pede c. Italie, n° 83/1995/589/675.
Les auteurs de la proposition de loi n’ont jamais ignoré les réserves suscitées par cette proposition au sein du monde judiciaire. Des échanges qu’ils ont eus avec la Chancellerie et le Conseil d’État, ils ont pris acte de la complexité et des difficultés juridiques susceptibles d’être soulevées par l’application concrète de cette disposition.
Ils en avaient déjà modifié la portée par rapport à la version qu’en avait proposée la mission d’information précitée, en substituant au mécanisme de prescription uniformément abrégée de trois ans la disposition conférant à l’acte d’enquête, d’instruction ou de poursuite un effet interruptif abrégé de moitié par rapport au délai initial. En effet, pour la Chancellerie, interrogée sur la proposition n° 13 de la mission d’information, l’exigence du délai raisonnable posée par l’article 6 de la CESDH est déjà contrôlée par la CEDH qui apprécie cette exigence in globo, « suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes » (131). Pour elle, si des condamnations étaient prononcées alors que cette exigence n’aurait pas été respectée en raison notamment de l’existence d’une ou de plusieurs périodes d’inaction prolongée au cours de la procédure, la France serait condamnée, même si ces inactions avaient duré moins de trois ans, durée actuelle de la prescription délictuelle. De surcroît, en matière criminelle, si l’auteur d’un crime n’avait pas pu être découvert à la suite d’une instruction criminelle conclue par un non-lieu mais que de nouvelles pistes ou preuves étaient découvertes presque dix ans plus tard, justifiant la réouverture d’une information permettant de confondre l’auteur du crime, l’institution d’un délai de prescription abrégée de trois ans après le dernier acte interruptif aurait assuré l’impunité à l’auteur des faits.
Avec le nouveau dispositif proposé par le deuxième alinéa de l’article 9-1, le délai de prescription se serait trouvé rouvert pour une durée équivalente aux délais actuels de prescription de l’action publique de droit commun en matière criminelle (dix ans) et délictuelle (trois ans). Ainsi fixés, ces nouveaux délais semblaient ne pas priver la justice des moyens d’agir tout en conservant le principe d’une sanction de l’inaction ou de la négligence des autorités de poursuite.
Toutefois, pour le Conseil d’État, ce dispositif soulève encore trois difficultés (132).
En premier lieu, « en raison de son caractère mécanique et inconditionné, l’application du deuxième alinéa de l’article 9-1 conduirait à diviser par deux le délai de prescription dès le premier acte interruptif, alors même que celui-ci pourrait intervenir très tôt après la commission de l’infraction. Cet effet serait amplifié par la reconnaissance du caractère interruptif des plaintes simples ». En conséquence, « cette disposition pourrait remettre en cause la cohérence de l’objectif poursuivi par les auteurs de la proposition ».
En deuxième lieu, « le dispositif retenu en l’état produirait des effets qui dépasseraient ceux recherchés par les auteurs de la proposition. En effet, s’il peut être jugé approprié de diviser par deux le délai de prescription recommençant à courir à titre de sanction de l’inaction des autorités judiciaires, une telle sanction paraît inappropriée lorsqu’elle n’est pas fondée sur le constat préalable d’une inertie prolongée ».
En dernier lieu, le Conseil d’État « attire l’attention des auteurs de la proposition de loi sur la difficulté qu’il y aurait, au regard du principe d’égalité devant la procédure pénale, à réserver l’application de cette disposition aux seuls délais de prescription fixés par les articles 7 et 8 du code de procédure pénale, alors que des délais de prescription identiques sont prévus par d’autres dispositions législatives ».
d. Les modifications apportées par votre commission des Lois
Seules les deux premières difficultés sont apparues dirimantes aux yeux de votre rapporteur – la troisième pourrait être levée en incluant dans le champ de la disposition les délais de prescription identiques à ceux mentionnés par les articles 7 et 8 mais figurant dans d’autres textes – et l’ont conduit à proposer à la Commission de supprimer ce dispositif.
Votre rapporteur estime en effet que la justice ne doit pas pâtir des effets d’un mécanisme destiné à sanctionner son inaction ou sa négligence et non l’impossibilité matérielle dans laquelle elle peut se trouver à poursuivre les auteurs d’une infraction. Du reste, les exigences liées au délai raisonnable telles qu’elles sont interprétées par la CEDH concernent la seule personne mise en cause et ne s’appliquent pas lorsque l’auteur de l’infraction est inconnu. La Cour tient compte, enfin, des situations dans lesquelles l’inaction de la justice n’est pas fautive mais résulte de l’absence de piste ou de preuve.
Une solution intermédiaire aurait pu consister à restreindre la portée du dispositif en donnant un effet interruptif abrégé aux seuls actes intervenus après l’écoulement d’une période marquant une inaction prolongée des autorités de poursuite. Le Conseil d’État suggérait ainsi aux auteurs de la proposition de loi, dans l’hypothèse où ils souhaiteraient maintenir le deuxième alinéa de l’article 9-1, de prévoir que, « lorsque tout acte [interruptif] (…) intervient après l’écoulement d’une période égale à la moitié du délai prévu aux articles 7 et 8, cet acte ainsi que tous les actes postérieurs de même nature font courir un nouveau délai de prescription d’une durée égale à la moitié de ce délai » (133). Cette solution permettrait de sanctionner doublement l’écoulement du délai de prescription :
–– il sanctionnerait d’un effet interruptif abrégé le premier acte d’enquête, d’instruction ou de poursuite dans l’unique hypothèse où il aurait été pris tardivement, après l’écoulement d’une période égale à la moitié du délai prévu aux articles 7 et 8 du code de procédure pénale : en matière criminelle, où le délai de prescription de droit commun est porté à vingt ans, lorsqu’un acte interviendrait la onzième année, cet acte et les actes suivants feraient courir un nouveau délai de prescription d’une durée de dix années ; en matière délictuelle, où le délai de prescription de droit commun est porté à six ans, lorsqu’un acte interviendrait la quatrième année, cet acte et les actes suivants feraient courir un nouveau délai de prescription d’une durée de trois années. En revanche, tout acte interruptif intervenant avant l’écoulement d’une période de dix ans en matière criminelle et de trois ans en matière délictuelle ferait courir un nouveau délai de prescription d’une durée égale à celle du délai initial, respectivement vingt et six ans ;
–– il sanctionnerait d’un effet interruptif abrégé n’importe quel acte d’enquête, d’instruction ou de poursuite dès lors qu’une longue période d’inactivité – pareillement égale à la moitié du délai prévu aux articles 7 et 8 du code de procédure pénale – s’écoulerait entre la date à laquelle interviendrait cet acte et la date à laquelle serait intervenu le précédent, soit une période d’inertie judiciaire marquée par l’absence d’acte d’enquête, d’instruction ou de poursuite pendant dix années en matière criminelle et trois années en matière délictuelle pour le droit commun.
Votre rapporteur a cependant estimé qu’un tel dispositif était trop complexe et insuffisamment lisible et compréhensible tant pour les magistrats appelés à le mettre en œuvre que pour les justiciables.
Au surplus, il a relevé qu’aucun des dispositifs envisagés ne suffirait à écarter le risque d’imprescriptibilité de fait généré par le simple jeu des actes interruptifs. En effet, rien n’interdirait à l’autorité judiciaire de réaliser un acte formel tous les trois ans en matière délictuelle ou dix ans en matière criminelle afin de relancer le délai de prescription de six ans dans le premier cas et de vingt ans dans le second et d’échapper ainsi au mécanisme de sanction de l’écoulement de la prescription.
Enfin, il a constaté que certaines règles du code de procédure pénale, même si elles étaient imparfaites, étaient déjà destinées à éviter qu’un juge d’instruction reste inactif ou prenne trop de temps pour clôturer un dossier, notamment :
–– le calendrier prévisionnel de l’instruction sur une année ou moins pour les délits et dix-huit mois ou moins pour les crimes, qui permet aux parties de demander, à l’issue de ce délai ou lorsqu’aucun acte d’instruction n’a été accompli pendant un délai de quatre mois, la clôture de l’instruction et, à défaut de réponse positive du juge, de saisir la chambre de l’instruction (deuxième alinéa de l’article 89-1, neuvième alinéa de l’article 116 et article 175-1) ;
–– le contrôle semestriel du fonctionnement des cabinets d’instruction par le président de la chambre de l’instruction (articles 220 et 221) ;
–– la possibilité pour une partie de saisir la chambre de l’instruction si aucun acte n’a été accompli depuis quatre mois, délai ramené à deux mois pour la personne mise en examen lorsqu’elle est placée en détention provisoire (article 221-2) ;
–– la possibilité pour le président de la chambre de l’instruction de saisir la chambre si aucun acte n’a été effectué depuis plus de quatre mois (article 221-1) ou si une détention provisoire dure depuis plus de trois mois (article 221-3).
Pour l’ensemble de ces raisons, la commission des Lois a adopté un amendement de votre rapporteur prévoyant, au deuxième alinéa de l’article 9-1, que tout acte interruptif ferait courir un nouveau délai de prescription égal au délai initial, comme le prévoit le droit en vigueur.
2. Les effets de l’acte interruptif à l’égard des personnes impliquées dans l’infraction et des infractions connexes
a. Le texte initial de l’article 1er
L’acte d’enquête, d’instruction ou de poursuite interrompt le délai de prescription de l’action publique de l’infraction à laquelle il se rapporte. L’action publique peut donc s’exercer à l’encontre de l’auteur présumé de l’infraction aussi longtemps que le délai de prescription a été rouvert. Qu’en est-il des potentiels co-auteurs ou complices ?
En l’état du droit, le deuxième alinéa de l’article 7 du code de procédure pénale – et, par renvoi, les articles 8 et 9 du même code – dispose qu’« [i]l en est ainsi même à l’égard des personnes qui ne seraient pas impliquées dans cet acte d’instruction ou de poursuite ».
Le dernier alinéa de l’article 9-1 introduit par l’article 1er de la présente proposition de loi reprend, à droit constant, l’actuel deuxième alinéa de l’article 7 du code de procédure pénale.
b. Les modifications apportées par votre commission des Lois
La Commission a adopté un amendement de votre rapporteur afin de tenir compte des recommandations formulées par le Conseil d’État dans son avis sur le présent texte, visant « à déterminer dans la loi de manière complète et cohérente le régime de la prescription de l’action publique » (134), et de consacrer la jurisprudence de la Cour de cassation en la matière.
La Cour de cassation a déduit de l’actuel deuxième alinéa de l’article 7 du code de procédure pénale que les actes interruptifs de prescription développent leurs effets à l’égard de toutes les personnes pouvant être concernées par la procédure, connues ou inconnues, effectivement poursuivies ou non, auteures, co-auteures et complices, même si elles ne sont pas personnellement concernées par l’acte interruptif et même si les poursuites n’ont été dirigées que contre une seule d’entre elles (135).
Dans le prolongement de cette jurisprudence, la Commission a clarifié la rédaction du dernier alinéa du nouvel article 9-1 afin de prévoir plus explicitement que ces actes sont interruptifs de prescription à l’égard des personnes, auteures ou complices, qui ne sont pas visées par l’un de ces actes.
Par ailleurs, la Commission a étendu l’effet interruptif de ces actes en cas d’infractions connexes. En principe, l’effet interruptif de l’acte d’enquête, d’instruction ou de poursuite ne s’applique qu’aux faits poursuivis qui sont l’objet de l’acte.
Toutefois, dans le silence de la loi, la jurisprudence a progressivement étendu l’effet interruptif aux infractions connexes ou indivisibles. Pour ce faire, la chambre criminelle ne s’est pas seulement fondée sur la définition de la connexité donnée par l’article 203 du code de procédure pénale ; elle est allée au-delà en développant une conception extensive de cette notion (voir l’encadré ci-après).
Ainsi, en cas d’infractions connexes, la chambre criminelle de la Cour de cassation a jugé qu’un acte interruptif de prescription concernant l’une d’elles produisait le même effet à l’égard de l’autre (136), quel que soit le mode d’exercice des poursuites – en cas de poursuites exercées séparément (137), par voie de réquisitions supplétives (138) ou même lorsque les procédures n’ont pas été jointes (139) – et même si les infractions poursuivies n’ont pas le même auteur (140), sous réserve toutefois que les infractions connexes ne soient pas prescrites lorsqu’a été réalisé l’acte interruptif (141). La chambre criminelle a par exemple appliqué cette jurisprudence aux crimes commis par des tueurs en série (142), aux infractions de déclarations mensongères de vol et d’escroquerie à l’assurance (143) ou aux infractions de recel de cadavre et d’homicide volontaire (144).
La définition des infractions connexes
Le législateur a reconnu quatre cas de connexité. Aux termes de l’article 203 du code de procédure pénale, « [l]es infractions sont connexes soit lorsqu’elles ont été commises en même temps par plusieurs personnes réunies, soit lorsqu’elles ont été commises par différentes personnes, même en différents temps et en divers lieux, mais par suite d’un concert formé à l’avance entre elles, soit lorsque les coupables ont commis les unes pour se procurer les moyens de commettre les autres, pour en faciliter, pour en consommer l’exécution ou pour en assurer l’impunité, soit lorsque des choses enlevées, détournées ou obtenues à l’aide d’un crime ou d’un délit ont été, en tout ou partie, recelées ».
La chambre criminelle de la Cour de cassation a tiré des dispositions de l’article 203 précité une définition plus large de la connexité. Elle l’a reconnue lorsqu’il existe entre les diverses infractions des « rapports étroits analogues à ceux que la loi a spécialement prévus » (1). De plus, « doivent être considérées comme connexes les infractions qui procèdent d’une même conception, relèvent du même mode opératoire et tendent au même but » (2).
(1) Cass. crim., 12 novembre 1981, n° 79-90.830 ; 28 mai 2003, n° 02-85.185 ; 19 septembre 2006, n° 05-83.536.
(2) Cass. crim., 18 janvier 2006, n° 05-85.858 ; 14 février 2007, n° 05-82.936.
Il en va de même en présence d’infractions indivisibles, dont le code de procédure pénale ne donne aucune définition précise (145) mais que la jurisprudence conçoit comme des infractions placées « dans un rapport mutuel de dépendance », rattachées entre elles « par un lien tellement intime, que l’existence des [unes] ne se comprendrait pas sans l’existence des autres » (146), fondées sur des « faits qui sont de nature à se succéder nécessairement » (147).
La chambre criminelle a ainsi jugé que l’acte interruptif réalisé pour le délit de blessures involontaires par imprudence interrompait la prescription de la contravention au règlement qui lui est indivisible (148) ou que l’information ouverte pour infraction à la législation sur les stupéfiants interrompait la prescription des délits indivisibles de contrebande et de complicité de contrebande par intérêt (149).
La solution retenue par votre Commission permet d’étendre l’effet interruptif des actes d’enquête, d’instruction ou de poursuite non seulement aux infractions connexes stricto sensu mais aussi aux infractions indivisibles. La doctrine considère en effet que la distinction entre ces deux catégories d’infractions a peu d’intérêt pratique sur le plan de la prescription et que les secondes se distinguent des premières non par la nature des liens étroits qui unissent plusieurs infractions mais par l’intensité de ces liens, l’indivisibilité supposant des liens plus étroits que la connexité (150).
C. LA CONSÉCRATION LÉGISLATIVE DE LA JURISPRUDENCE RELATIVE AU REPORT DU POINT DE DÉPART DU DÉLAI DE PRESCRIPTION DE L’ACTION PUBLIQUE DES INFRACTIONS OCCULTES ET DISSIMULÉES
L’article 1er de la présente proposition de loi crée un nouvel article 9-2 au sein du code de procédure pénale qui prévoit le report du point de départ du délai de prescription de l’action publique des infractions « astucieuses ». Seraient concernées, en application du premier alinéa, les infractions occultes ou dissimulées (1), lesquelles sont définies aux deux alinéas suivants (2).
1. Le report du point de départ du délai de prescription de l’action publique des infractions « astucieuses »
En principe et hors les cas dans lesquels la loi en dispose autrement, le point de départ du délai de prescription court à compter du jour où l’infraction a été commise. C’est ce que prévoient le premier alinéa de l’article 7 du code de procédure pénale (« [e]n matière de crime (…), l’action publique se prescrit par dix années révolues à compter du jour où le crime a été commis ») et, par renvoi à cette disposition, le premier alinéa de l’article 8 et l’article 9 du même code.
Par dérogation à ce principe, le législateur a organisé le report de ce point de départ pour certaines infractions, à raison de l’âge ou de la situation de la victime au moment des faits ou de la spécificité de l’infraction (151). Ces reports ne sont pas remis en cause par la présente disposition (152). En dehors de ces cas limitativement énumérés par la loi, le point de départ du délai de prescription de l’action publique devrait donc être le jour de la commission des faits.
Cette règle, d’application aisée lorsque le mode d’exécution de l’infraction ne soulève pas de difficulté quant à la détermination du jour de la commission de l’infraction – infraction instantanée, constituée d’un seul élément matériel se réalisant en un trait de temps – doit être adaptée pour tenir compte de la spécificité de l’élément matériel de l’infraction poursuivie (153).
Selon la définition qu’en donne le texte répressif, le jour de commission de l’infraction doit s’entendre du jour où tous les éléments constitutifs de celle-ci sont réunis, soit en raison de la nature de l’élément matériel, c’est-à-dire en cas d’infractions complexes (154), d’habitude (155) et de résultat (156), soit en raison de sa durée, dans l’hypothèse d’infractions continuées et continues (157).
En dehors de ces hypothèses, le juge a décidé de reporter le point de départ du délai de prescription de l’action publique de certaines infractions « astucieuses » au jour où elles apparaissent et peuvent être constatées dans des conditions permettant l’exercice de l’action publique. La mission d’information sur la prescription en matière pénale conduite par les auteurs de la proposition de loi a souligné le caractère contra legem de cette jurisprudence, née en dehors de tout fondement légal et en contradiction avec la lettre de l’article 7 précité.
Principalement appliquée aux infractions à caractère économique et financier, cette jurisprudence a historiquement été appliquée aux infractions d’abus de confiance et d’abus de bien social. Dès 1935, la chambre criminelle de la Cour de cassation a décidé, en matière d’abus de confiance, que le point de départ du délai de prescription devait être reporté lorsque l’auteur avait dissimulé ses détournements (158). Plus tard, elle a étendu cette solution à tous les abus de confiance, avec ou sans dissimulation (159). Par ailleurs, à partir de 1967, la chambre criminelle a considéré que, pour l’infraction d’abus de bien social, clandestine par nature, le point de départ du délai de prescription devait être reporté « au jour où ce délit est apparu et a pu être constaté » (160) ou, plus précisément, « au jour où le délit est apparu et a pu être constaté dans des conditions permettant l’exercice de l’action publique » (161). Puis, en 1997, elle a décidé que « la prescription de l’action publique du chef d’abus de biens sociaux [courrait], sauf dissimulation, à compter de la présentation des comptes annuels par lesquels les dépenses litigieuses sont mises indûment à la charge de la société » (162).
L’évolution des jurisprudences relatives à l’abus de confiance et à l’abus de bien social est révélatrice de la méthode utilisée par la Cour de cassation et de la direction qu’elle a souhaité donner à sa jurisprudence.
Procédant au cas par cas, elle a appliqué ses décisions à deux catégories d’infractions « astucieuses » (voir le tableau ci-après) qui, sans toutes revêtir une dimension économique et financière, en ont une forte coloration :
–– d’une part, les infractions occultes ou clandestines par nature, lorsque la clandestinité est un élément constitutif essentiel de ces infractions retardant l’exercice de l’action publique ;
–– d’autre part, les infractions dissimulées, commises à l’aide de manœuvres de dissimulation visant à empêcher d’en découvrir la commission.
REPORT DU POINT DE DÉPART DU DÉLAI DE PRESCRIPTION DE L’ACTION PUBLIQUE POUR CERTAINES INFRACTIONS OCCULTES PAR NATURE ET DISSIMULÉES (EXEMPLES)
Infractions |
Arrêts |
Infractions occultes par nature | |
Délit d’abus de confiance |
Cass. crim., 11 février 1981, n° 80-92.059 ; 8 février 2006, n° 05-80.301 |
Délit d’abus de bien social (sauf dissimulation, point de départ fixé au jour de la présentation des comptes annuels) |
Cass. crim., 5 mai 1997, n° 96-81.482 ; 27 juin 2001, n° 00-87.414 ; 28 mai 2003, n° 02-83.544 |
Délits d’atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui et de mise en mémoire informatisée, sans l’accord exprès de l’intéressé, de données nominatives |
Cass. crim., 4 mars 1997, n° 96-84.773 |
Délit de publicité trompeuse |
Cass. crim., 22 mai 2002, n° 01-85.763 |
Délits de simulation et de dissimulation d’enfant |
Cass. crim., 23 juin 2004, n° 03-82.371 |
Délit de malversation |
Cass. crim., 9 février 2005, n° 03-85.508 |
Délit de tromperie |
Cass. crim., 7 juillet 2005, n° 05-81.119 |
Infractions dissimulées | |
Délit d’abus de bien social (la dissimulation fait lever la présomption de révélation du délit au moment de l’inscription dans les comptes sociaux des dépenses litigieuses) |
Cass. crim., 25 février 2004, n° 03-81.673 |
Délit de trafic d’influence |
Cass. crim., 19 mars 2008, n° 07-82.124 |
Délit d’atteinte à la liberté d’accès et à l’égalité des candidats dans les marchés publics |
Cass. crim., 17 décembre 2008, n° 08-82.319 |
Délit de fraude fiscale (point de départ fixé au 1er janvier suivant l’exercice au cours duquel la déclaration n’a pas été déposée ou a été minorée) |
Cass. crim., 13 décembre 1982, n° 80-95.151 ; 20 février 1989, n° 87-90.806 |
Délit de participation frauduleuse à une entente prohibée |
Cass. crim., 20 février 2008, nos 02-82.676 et 07-82.110 |
Délit de prise illégale d’intérêts |
Cass. crim., 16 décembre 2014, n° 14-82.939 |
Coexistent donc, au sein du droit de la prescription pénale, deux régimes de point de départ du délai de prescription de l’action publique. D’une part, en droit positif, le point de départ est établi au jour de la commission de l’infraction, sous réserve des régimes légaux de report à une date ultérieure en raison de l’identité de la victime ou de la spécificité de l’infraction. D’autre part, un régime jurisprudentiel autonome et contra legem a été développé par la Cour de cassation, qui reporte le point de départ du délai applicable à certaines infractions « astucieuses ».
De nombreuses personnes entendues par la mission d’information sur la prescription en matière pénale – MM. Jean-Claude Marin, procureur général près la Cour de cassation (163), Didier Boccon-Gibod, premier avocat général à cette même Cour (164), Jean Maïa, directeur des affaires juridiques des ministères économique et financier (165) ou encore Me Dominique Foussard, avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation (166) – ont souligné que les conditions de développement de cette jurisprudence étaient susceptibles de porter atteinte aux exigences de sécurité juridique, d’accessibilité du droit et de confiance légitime constitutionnellement ou conventionnellement protégées. En effet, la démarche entreprise par la chambre criminelle de la Cour de cassation, casuistique et dépourvue de base légale, peut faire douter de la cohérence et de la prévisibilité de cette jurisprudence, ne permettant pas aux justiciables de connaître à l’avance la nature et l’étendue des obligations qui pèsent sur eux. Certains ont ainsi pu s’étonner que la chambre criminelle ait refusé d’appliquer sa jurisprudence aux délits de faux (167), de violation du secret professionnel et de recel de violation de ce secret (168) et au crime d’homicide volontaire pour une affaire dans laquelle avaient été découverts les ossements d’une personne signalée disparue onze ans plus tôt (169).
Suivant les préconisations de la mission d’information qu’ils ont conduite, les auteurs de la présente proposition de loi n’ont pas souhaité remettre en cause cette jurisprudence utile aux juges et nécessaire à la répression des infractions ainsi qu’à la poursuite de leurs auteurs.
À l’inverse, ils estiment que fixer invariablement le point de départ du délai de prescription de l’action publique au jour de la commission de l’infraction aurait encouragé la délinquance opaque et habile et entravé la répression des infractions les plus « astucieuses ». Nombre des personnes entendues par la mission ont fait remarquer que, même en allongeant significativement la durée des délais de prescription de droit commun, certaines infractions pourraient néanmoins échapper aux poursuites en raison de l’ingéniosité de leurs auteurs et des techniques aujourd’hui utilisées pour organiser et dissimuler la fraude (170).
C’était aussi le constat établi par la mission d’information conduite par les sénateurs Jean-Jacques Hyest, Hugues Portelli et Richard Yung en 2007 (171).
Le premier alinéa du nouvel article 9-2 concrétise la proposition n° 10 formulée par la mission d’information de l’Assemblée nationale sur la prescription en matière pénale. Il donne un fondement législatif à la jurisprudence relative au report du point de départ du délai de prescription de l’action publique des infractions occultes ou dissimulées au jour où l’infraction est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant l’exercice de l’action publique.
Deux précisions peuvent être apportées à ce dispositif au regard de sa rédaction et de son champ d’application.
La rédaction retenue par le nouvel article 9-1, qui ferait courir la prescription des infractions occultes ou dissimulées « à compter du jour où l’infraction est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant l’exercice des poursuites », reprend la formulation la plus souvent retenue par la chambre criminelle de la Cour de cassation. Est visé le jour où l’infraction peut raisonnablement être connue des personnes auxquelles l’article 1er du code de procédure pénale confie la mise en mouvement de l’action publique, les magistrats, les fonctionnaires auxquels elle est confiée par la loi et la partie lésée.
Quant à son champ d’application, la consécration de la jurisprudence de la Cour de cassation n’aurait pas vocation à s’appliquer seulement aux infractions à caractère économique et financier – qui constituent l’essentiel des infractions aujourd’hui concernées. La règle énoncée pourrait être étendue à d’autres infractions ou d’autres domaines du droit pénal selon les critères de l’infraction occulte ou dissimulée énoncés par les deux derniers alinéas du nouvel article 9-2. C’est ce que confirme le Conseil d’État dans son avis sur le présent texte lorsqu’il « observe que les définitions de l’infraction occulte et de l’infraction dissimulée (…) sont destinées à s’appliquer, s’agissant plus particulièrement des infractions dissimulées, à toutes les infractions » (172).
2. Le champ du report du point de départ : la définition de l’infraction occulte et de l’infraction dissimulée
Le deuxième alinéa de l’article 9-2 définit l’infraction occulte comme « l’infraction qui, en raison de ses éléments constitutifs, ne peut être connue ni de la victime, ni de l’autorité judiciaire ».
Cette définition tire les conclusions des nombreux arrêts rendus par la chambre criminelle de la Cour de cassation en matière de report du point de départ du délai de prescription des infractions occultes ou clandestines par nature. Il ressort de ces arrêts que les infractions visées sont celles dont les éléments matériels constitutifs sont par essence clandestins et maintiennent les autorités de poursuite dans l’ignorance des faits.
La Cour de cassation a ainsi jugé que, s’agissant des infractions d’atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui et de mise en mémoire informatisée de données nominatives, « les articles 368 ancien et 226-1 nouveau du Code pénal font de la clandestinité un élément constitutif essentiel du délit d’atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui, qui n’est caractérisé que lorsque la personne, dont les paroles ont été enregistrées sans son consentement est informée de leur captation ou de leur transmission » et que « la clandestinité est, de même, inhérente au délit, repris de la loi du 6 janvier 1978 dans l’article 226-19, constitué par la mise en mémoire informatisée, sans l’accord exprès de l’intéressé, de données nominatives faisant apparaître, notamment, ses opinions politiques, philosophiques ou religieuses » (173). Dans une autre affaire, elle a considéré que la tromperie était « un délit clandestin par nature, en ce qu’il a pour but de laisser le contractant dans l’ignorance des caractéristiques réelles d’un produit » (174).
En conséquence, la clandestinité devrait être constitutive de l’infraction et ne pas procéder de la simple « discrétion » de son auteur. À défaut, la plupart des infractions pourraient recevoir la qualification d’infraction occulte car, ainsi que l’a écrit Mme Dominique Noëlle Commaret, ancienne avocate générale à la Cour de cassation, « [d]ans l’immense majorité des cas, les auteurs d’infractions préfèrent agir dans l’ombre, l’anonymat et l’absence de témoins leur assurant, mieux que la publicité, l’espoir de l’impunité » (175).
Ainsi cantonnée, la définition proposée par la présente disposition aurait pour objet de rendre plus prévisible et stable la liste des infractions occultes soumises au report du point de départ de leur délai de prescription. S’il appartiendrait toujours au juge de statuer au cas par cas sur les infractions susceptibles d’être concernées, il devrait le faire selon les critères fixés par le législateur.
Le dernier alinéa de l’article 9-2 définit l’infraction dissimulée comme « l’infraction dont l’auteur accomplit délibérément toute manœuvre caractérisée tendant à en empêcher la découverte ».
Comme pour l’infraction occulte, cette définition s’inspire des arrêts rendus par la chambre criminelle de la Cour de cassation lorsqu’elle a décidé de reporter le point de départ du délai de prescription des infractions en cas de dissimulation. La chambre criminelle exige généralement que des manœuvres particulières aient été utilisées par l’auteur de l’infraction pour la dissimuler, le seul état d’ignorance de la victime ne suffisant pas à caractériser la dissimulation. Ces manœuvres peuvent consister en des actes d’omission ou en des abstentions (176)traduisant sans ambiguïté la volonté de l’auteur de cacher les faits délictueux (177).
En matière de favoritisme, la Cour de cassation a approuvé la décision d’une cour d’appel qui avait reconnu une dissimulation d’actes irréguliers dans « le recours à une structure de droit privé (…) [ayant] eu pour effet d’empêcher tous les contrôles habituels et [ayant] fait obstacle à la découverte de l’aspect irrégulier d’une opération dissimulée qui a été présentée comme s’inscrivant dans l’exécution d’un marché déjà passé alors qu’il s’agissait d’une opération autonome » (178). Dans une autre affaire, elle confirmait que constituait une dissimulation de la part du maire le fractionnement apparent du marché d’entretien de la voirie communale en réalité confié à une seule entreprise (179). En matière d’abus de bien social, elle a considéré que la dissimulation pouvait consister soit dans l’omission ou la présentation sous une fausse imputation d’une dépense litigieuse (180), soit dans l’établissement de « conventions fictives accompagnées de factures dont la fausseté ne pouvait être mise en évidence à l’occasion des vérifications habituelles, notamment de la part des commissaires aux comptes » (181).
L’emploi, au dernier alinéa de l’article 9-2, de l’adverbe « délibérément » et de l’adjectif « caractérisée » traduit dans notre droit les exigences posées par la jurisprudence de la Cour de cassation. Comme pour l’infraction occulte, il appartiendrait au juge de statuer au cas par cas mais en appliquant les critères fixés par le législateur. Une nouvelle fois, ces critères sont destinés à conserver son caractère exceptionnel au report du point de départ sans priver la justice des moyens de poursuivre les auteurs d’infractions particulièrement habiles.
Dans son avis sur la présente proposition de loi, le Conseil d’État « observe que les définitions de l’infraction occulte et de l’infraction dissimulée élaborées par les auteurs de la proposition de loi reprennent les principes et raisonnements qui fondent la jurisprudence de la Cour de cassation en la matière » (182).
D. LA CONSÉCRATION LÉGISLATIVE DES CAUSES DE SUSPENSION DU DÉLAI DE PRESCRIPTION DE L’ACTION PUBLIQUE EN CAS D’IMPOSSIBILITÉ ABSOLUE D’EXERCER LES POURSUITES
Le dernier alinéa de l’article 1er de la présente proposition de loi crée, enfin, un nouvel article 9-3 au sein du code de procédure pénale relatif aux conditions de suspension de la prescription. En l’absence de disposition générale de procédure pénale régissant la suspension du délai de prescription de l’action publique (1), le présent article donne un fondement légal à la jurisprudence de la Cour de cassation sur la suspension en cas d’obstacle à l’exercice des poursuites (2).
Le délai de prescription de l’action publique peut être non seulement interrompu mais également suspendu. À la différence de l’effet interruptif, qui anéantit le temps déjà écoulé et fait recourir le délai de prescription initial, l’effet suspensif ne remet pas en cause le temps déjà écoulé : le délai reprend là où il s’était arrêté dès lors que l’obstacle qui s’opposait au déroulement normal de la prescription disparaît.
Le droit en vigueur prévoit bien quelques motifs de suspension du délai de prescription de l’action publique mais aucune cause générale susceptible de traduire en droit l’impossibilité d’agir de la partie poursuivante. Dans le silence de la loi et en s’inspirant du droit civil, la Cour de cassation a donc progressivement dégagé de nouveaux motifs de suspension en cas d’obstacle à l’exercice des poursuites.
a. Seuls certains motifs de suspension du délai de prescription de l’action publique sont aujourd’hui prévus par le droit
Le législateur a reconnu un nombre limité de motifs de suspension du délai de prescription de l’action publique pour tenir compte des situations dans lesquelles la partie poursuivante est placée dans l’impossibilité d’agir. Sans prétendre à l’exhaustivité, peuvent être cités :
–– l’obstacle statutaire qui empêche provisoirement la poursuite d’une personne, notamment du Président de la République (deuxième alinéa de l’article 67 de la Constitution (183)) ou d’un membre du Parlement (avant-dernier alinéa de l’article 26 de la Constitution (184)) : même si ce motif n’est pas expressément mentionné dans ce dernier cas, il peut en être logiquement déduit ;
–– le recueil préalable d’un avis qui conditionne la mise en œuvre de l’action publique, comme en matière fiscale (dernier alinéa de l’article L. 230 du livre des procédures fiscales (185)) ;
–– la consultation d’une autorité administrative, comme l’Autorité de la concurrence saisie par une juridiction pénale sur des pratiques anticoncurrentielles (avant-dernier alinéa de l’article L. 462-3 du code de commerce (186)) ou la saisine par les parties de la commission de conciliation et d’expertise douanière (c du 1 de l’article 450 du code des douanes (187)) ;
–– certains évènements de procédure, comme l’examen de la recevabilité de la plainte avec constitution de partie civile (deuxième alinéa de l’article 85 du code de procédure pénale (188)) ou la mise en œuvre d’une mesure alternative aux poursuites (avant-dernier alinéa de l’article 41-1 du même code (189)) ;
–– la nature particulière de certaines infractions : il en est ainsi, par exemple, lorsque le jugement ou l’arrêt ayant déclaré l’action publique éteinte a été obtenu grâce à de faux documents (deuxième alinéa de l’article 6 du même code (190)).
b. La jurisprudence relative à la suspension du délai de prescription de l’action publique en cas d’obstacle à l’exercice des poursuites
Le principe même de la suspension, mesure d’équité en faveur de ceux qui sont mis dans l’impossibilité d’agir, trouve sa source dans l’adage civiliste contra non valentem agere non currit praescriptio, selon lequel la prescription ne saurait courir contre celui qui ne peut valablement agir.
Datant de l’ancien droit et fréquemment mis en œuvre par les parlements de l’Ancien Régime, les rédacteurs du code civil de 1804 le cantonnèrent strictement en inscrivant à l’ancien article 2251 que « la prescription court contre toutes personnes, à moins qu’elles ne soient dans quelque exception établie par une loi », les anciens articles 2252 à 2258 énumérant limitativement les cas de suspension (mineurs, époux, interdits…).
Les tribunaux continuèrent toutefois de dégager de nouveaux motifs de suspension dans les cas où les parties poursuivantes étaient placées dans l’impossibilité d’interrompre la prescription. La chambre civile a ainsi considéré que la prescription d’une action ne courait pas contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement quelconque résultant soit de la loi, soit de la convention, soit de la force majeure (191). La chambre sociale a également appliqué cet adage lorsque le créancier est dans l’impossibilité d’agir (192).
La loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile a consacré cet adage au nouvel article 2234 du code civil qui prévoit que « [l]a prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure ». Cette consécration visait à rapprocher le droit français des législations adoptées par d’autres pays européens (Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, Grèce, Italie, Pays-Bas et Portugal) et à permettre, selon les travaux préparatoires, d’« introduire de l’équité et de la souplesse dans la mise en œuvre de la législation » (193).
ii. Une jurisprudence appliquée en présence d’un obstacle de droit ou de fait mettant la partie poursuivante dans l’impossibilité d’agir
Cet adage civiliste n’est pas inconnu de la matière pénale ; il a au contraire progressivement irrigué nombre des arrêts rendus par la Cour de cassation lorsqu’elle a reconnu un caractère suspensif à certains obstacles mettant la partie poursuivante dans l’impossibilité d’agir.
En 1999, l’assemblée plénière de la Cour de cassation rappelait d’ailleurs ce principe général : « selon le principe contra non valentem agere non currit praescriptio la prescription est de droit suspendue à l’égard des parties poursuivantes dès lors que celles-ci ont manifesté expressément leur volonté d’agir et qu’elles se sont heurtées à un obstacle résultant de la loi elle-même » (194).
Parmi ces hypothèses de suspension de la prescription, la chambre criminelle de la Cour de cassation a reconnu deux grands motifs d’impossibilité d’agir pour la partie poursuivante :
–– les obstacles de droit, comme la demande de mainlevée de l’immunité parlementaire (195), l’exception préjudicielle (196), le pourvoi en cassation en matière d’infractions de presse (197) ou la disparation de pièces d’une procédure qui exige que l’instruction soit recommencée à partir du point où les pièces manquent (198) ;
–– les obstacles de fait absolus (199) et insurmontables (200), comme l’invasion du territoire par une armée ennemie lorsqu’elle a fait naître des circonstances spéciales (201) et, selon la doctrine, par assimilation à cette hypothèse, les cas de catastrophe naturelle (inondation, tremblement de terre…).
Comme les auteurs de la proposition de loi l’ont rappelé dans leur rapport d’information déjà cité, la Cour de cassation retient généralement une conception étroite de la notion d’obstacle de droit ou de fait à l’exercice des poursuites. Elle exige que les faits invoqués soient constitutifs de force majeure ou d’une circonstance insurmontable rendant impossibles les poursuites et que le ministère public ou la partie civile n’aient pas, par leur comportement, créé cet obstacle ou conduit à la paralysie de la procédure (202).
iii. L’arrêt de l’assemblée plénière de la Cour de cassation du 7 novembre 2014 dans l’affaire dite de « l’octuple infanticide »
Jusqu’alors, la Cour de cassation n’avait jamais appliqué un motif général de suspension du délai de prescription de l’action publique à la matière criminelle. Si, en 2011, dans une affaire d’homicide volontaire, la chambre criminelle avait considéré, pour la première fois, que « seul un obstacle insurmontable à l’exercice des poursuites peut justifier la suspension de la prescription de l’action publique », elle avait toutefois refusé d’admettre que constituaient un tel obstacle l’enfouissement des corps et les manœuvres tendant à accréditer l’illusion de l’existence des victimes (203).
En 2014, l’assemblée plénière de la Cour de cassation, mettant un terme à plusieurs arrêts contraires de cours d’appel et de la chambre criminelle, a décidé que la prescription de l’action publique pouvait être suspendue en matière criminelle en présence d’un obstacle insurmontable rendant les poursuites impossibles (204).
L’assemblée plénière devait déterminer si sept des huit infanticides commis dans des circonstances particulières par une mère plus de dix ans avant le premier acte interruptif étaient prescrits. Elle était saisie d’un pourvoi formé contre l’arrêt de la cour d’appel de renvoi (205) qui avait résisté à l’arrêt de la chambre criminelle ayant constaté la prescription de ces faits (206) en reconnaissant que les circonstances de la grossesse et des naissances constituaient un obstacle insurmontable à l’exercice des poursuites de nature à suspendre la prescription. L’assemblée plénière a confirmé l’interprétation de la cour d’appel de renvoi et rejeté la solution retenue par la chambre criminelle, en considérant que « si, selon l’article 7, alinéa 1er, du code de procédure pénale, l’action publique se prescrit à compter du jour où le crime a été commis, la prescription est suspendue en cas d’obstacle insurmontable à l’exercice des poursuites » (207).
Comme l’a fait observer devant la mission d’information précitée M. Jean Danet, avocat honoraire et maître de conférences à l’Université de Nantes, l’assemblée plénière ne se réfère à aucun moment aux notions d’infraction occulte ou de dissimulation : « elle ne fait pas entrer les crimes, et notamment les meurtres dans le champ de la construction prétorienne complexe des infractions occultes ou dissimulées dont le point de départ du délai de prescription est reporté » (208). En pratique cependant, l’assemblée plénière a reconnu en l’espèce un motif de suspension de la prescription ab initio, équivalant à un report du point de départ du délai de prescription, dans la mesure où l’obstacle insurmontable a commencé à exister avant que le délai de prescription de l’action publique des infanticides ait commencé à courir en raison de la clandestinité des grossesses.
2. L’inscription dans la loi de la suspension du délai de prescription de l’action publique en cas d’obstacle rendant impossible l’exercice des poursuites
Le nouvel article 9-3 créé par le dernier alinéa de l’article 1er de la présente proposition de loi consacre au plan législatif cette règle jurisprudentielle.
Il est la traduction de la proposition n° 11 de la mission d’information de l’Assemblée nationale sur la prescription en matière pénale. Cette dernière préconisait en effet de combler le vide juridique actuel né à la fois du caractère épars et partiel des motifs légaux de suspension du délai de prescription de l’action publique et de l’intervention erratique et en dehors de tout fondement légal de la jurisprudence (209). En visant la « présence soit d’un obstacle de droit, soit d’un obstacle de fait insurmontable, rendant impossible l’exercice des poursuites », le présent article inscrit dans le code de procédure pénale les causes générales de suspension du délai de prescription de l’action publique telles que la Cour de cassation les a identifiées.
Cette disposition tendrait à renforcer la sécurité juridique en donnant un fondement légal à une règle jurisprudentielle et en définissant avec précision son périmètre :
–– quant à la nature de l’obstacle : il devrait s’agir soit d’un obstacle de fait insurmontable, c’est-à-dire un cas de force majeure, soit d’un obstacle de droit ;
–– quant à l’effet de l’obstacle sur la conduite de l’action publique : il devrait « rendre impossible l’exercice des poursuites », c’est-à-dire empêcher soit la mise en mouvement, soit la conduite de l’action publique à l’initiative des autorités judiciaires ou des parties civiles.
Cette nouvelle règle aurait vocation à s’appliquer sans préjudice des autres obstacles de droit rendant impossible l’exercice des poursuites auxquels la loi a conféré un caractère suspensif en application de dispositions figurant dans le code de procédure pénale ou dans d’autres textes (210).
*
* *
La Commission adopte l’amendement rédactionnel CL17 du rapporteur.
Puis elle examine, en discussion commune, l’amendement CL16 du rapporteur et l’amendement CL4 de M. Jean-Christophe Lagarde.
M. le rapporteur. L’amendement CL16 est rédactionnel.
Mme Maina Sage. Je tiens avant toute chose à féliciter nos rapporteurs pour leur travail, tant le droit actuel de la prescription manque de clarté et de cohérence. Ce texte a le mérite d’y remettre de l’ordre, puisqu’il permet tout à la fois de clarifier les délais et de les adapter à la nature de chaque infraction.
Permettez-moi de défendre ensemble les différents amendements du groupe Union des démocrates et indépendants. La proposition qui nous est faite consiste à doubler les délais de prescription sauf en ce qui concerne les crimes et délits sexuels qui, aujourd’hui, obéissent à un régime dérogatoire et qui, puisqu’ils seront maintenus en l’état, relèveront désormais du régime ordinaire. L’an dernier, le groupe Union des démocrates et indépendants a défendu une proposition de loi visant à allonger de dix ans le délai de prescription applicable aux crimes et délits de ce type, non seulement compte tenu de la nature des actes commis, mais aussi parce que les victimes ne sont pas toujours capables d’enclencher une procédure judiciaire. Les retours d’expérience dont nous disposons aujourd’hui suffisent à démontrer qu’il existe des situations dans lesquelles elles ne peuvent pas toujours faire usage de leur droit de recours : il arrive en effet que ces crimes et délits provoquent des amnésies post-traumatiques. Les dérogations obtenues, avaient dans une certaine mesure, permis d’y remédier, mais il est statistiquement établi qu’elles sont insuffisantes, d’où la proposition que nous avons faite de prolonger le délai de prescription de dix ans.
Aujourd’hui, nous vous proposons de nouveau par voie d’amendement de distinguer ce type de crimes et de délits, qui sont tout à fait particuliers. À cet égard, j’ai beaucoup apprécié le fait que les rapporteurs aient tenu compte des spécificités des infractions occultes et dissimulées et jugé important de les distinguer en droit, étant donné la manière dont ces infractions sont organisées. De même, je vous demande de tenir compte de la situation particulière des victimes d’agressions sexuelles, qui entraînent de graves conséquences. À titre personnel, je suis favorable, à terme, à leur imprescriptibilité, même si je comprends que nous soyons encore attachés à préserver des délais de prescription dans notre droit.
L’amendement CL4 vise à augmenter de vingt à trente ans le délai de prescription des crimes de nature sexuelle. Nos amendements suivants, sur lesquels je reviendrai le moment venu, visent à augmenter de dix à vingt ans le délai applicable aux délits sexuels et à modifier la date à compter de laquelle le délai de prescription commence à courir.
La Commission adopte l’amendement CL16.
En conséquence, l’amendement CL4 tombe.
M. le président Dominique Raimbourg. Il vous faudra, madame Sage, reprendre la rédaction de cet amendement en vue du débat en séance. S’il est tombé pour une raison de procédure, j’ajoute, sur le fond, qu’il existe un régime dérogatoire concernant les agressions commises sur des mineurs, puisque le point de départ du délai de prescription est reporté à leur majorité. Dans les faits, ce délai court donc jusqu’à ce que les victimes atteignent l’âge de trente-huit ans
— autrement dit, certains faits peuvent être poursuivis jusqu’à une trentaine d’années après leur commission.
La Commission examine l’amendement CL6 de M. Jean-Christophe Lagarde.
Mme Maina Sage. Cet amendement vise précisément à modifier le point de départ du délai de prescription, de sorte qu’il commence à courir non pas à la majorité des victimes, mais à la date où l’infraction apparaît à la victime dans des conditions lui permettant d’exercer l’action publique. En effet, les victimes ne sont pas forcément capables d’enclencher une procédure de recours dès l’âge de dix-huit ans, même si la possibilité leur en est offerte.
M. le rapporteur. Il est très difficile de laisser à chaque victime le choix du moment à compter duquel le délai de prescription commence à courir. Une victime agressée à l’âge de cinq ans pourrait ainsi n’exercer l’action publique qu’à soixante-quinze ans, par exemple, ayant réalisé ce qui lui était arrivé soixante-dix ans plus tôt : cette seule hypothèse rend l’amendement inapplicable.
Mme Colette Capdevielle. Je comprends votre volonté de protéger les victimes, madame Sage, mais, par cette disposition, vous ne les protégeriez pas, bien au contraire. Vous rendez-vous compte de ce qu’il adviendrait d’une victime à qui l’on ferait croire que des poursuites sont possibles quarante ans après les faits ? Dois-je vous rappeler les affaires dans lesquelles des victimes se sont pendues suite à un non-lieu ou à un acquittement ? Cessons de laisser croire que nous protégerions les victimes en allongeant indéfiniment les délais de prescription ; c’est faux. Je sais bien à quelle affaire vous faites référence en évoquant l’amnésie post-traumatique, mais je vous invite à faire preuve de la plus grande prudence s’agissant d’affaires qui ont trait à des crimes sexuels.
Mme Maina Sage. Je respecte naturellement l’avis de Mme Capdevielle, mais notre rôle n’est pas de nous prononcer de manière subjective en fonction de tel ou tel cas particulier ; il est de permettre à tous de bénéficier d’une justice équitable et tenant compte des circonstances propres aux faits. Les agressions sexuelles sont distinctes par nature des infractions économiques ou financières ou des vols, par exemple. Leur spécificité doit être prise en compte, de même que la capacité de chaque victime de se saisir de son droit.
Il va de soi que toutes les victimes n’obtiennent pas réparation. Sachez cependant, chère collègue, que je ne me fonde pas sur un ou deux cas, mais sur des études concrètes qui démontrent que 10 % seulement des victimes lancent des procédures de recours, comme l’a établi un observatoire national. Tous les spécialistes vous confirmeront qu’en matière d’agressions sexuelles, la question du délai de prescription est capitale et que 99 % des victimes qui n’ont pas obtenu réparation à l’issue d’un recours déclarent toutefois ne pas regretter d’avoir engagé des poursuites. Certes, il existe des cas gravissimes et marquants au sujet desquels je comprends le point de vue de Mme Capdevielle, mais nous ne devons pas pour autant nous prononcer en fonction de telle ou telle affaire. Nous devons agir de la manière la plus juste et la plus équitable qui soit ; c’est précisément l’objet des amendements que nous défendons, et je demande à chacun d’y réfléchir d’ici au débat en séance publique.
La Commission rejette l’amendement.
Puis elle examine les amendements identiques CL18 du rapporteur, CL11 du Gouvernement et CL13 de M. Georges Fenech.
M. le rapporteur. Ces amendements visent à réserver l’imprescriptibilité des crimes de guerre à ceux qui sont connexes à un crime contre l’humanité. La définition de la connexité figure à l’article 203 du code de procédure pénale. C’est un très grand progrès.
La Commission adopte les amendements.
Puis elle adopte l’amendement de précision CL19 du rapporteur.
Elle passe ensuite à l’amendement CL5 de M. Jean-Christophe Lagarde.
Mme Maina Sage. Cet amendement est défendu, de même que les amendements CL7 et CL8.
Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement.
Puis, suivant l’avis défavorable du rapporteur, elle rejette successivement les amendements CL7 et CL8 de M. Jean-Christophe Lagarde.
Elle adopte ensuite les amendements rédactionnels CL20 et CL21 du rapporteur.
Elle examine l’amendement CL22 du rapporteur.
M. le rapporteur. Cet amendement vise à garantir la bonne articulation de l’article 9-1 du code de procédure pénale, créé par le présent article, avec les autres dispositions législatives qui prévoient une interruption du délai de prescription de l’action publique.
La Commission adopte l’amendement.
Puis elle adopte l’amendement CL23 du rapporteur.
Elle examine ensuite l’amendement CL24 du rapporteur.
M. le rapporteur. L’amendement CL24 est défendu.
M. Philippe Houillon. Cet amendement confirme la lapalissade de M. Tourret : il existera d’énormes prescriptions ! Certes, monsieur Fenech, le délai raisonnable ne s’applique qu’au procès, et non à la prescription, mais il s’agit bien là du procès lui-même, puisque tout acte interruptif est un acte de procédure qui aura pour effet d’en allonger la durée. Les délais de prescription sont doublés, me répondrez-vous : c’est tout le problème.
M. Georges Fenech. Les actes interruptifs relèvent de l’enquête, non du procès.
M. Philippe Houillon. Sans doute, mais ils allongent la durée du procès depuis l’enquête jusqu’au renvoi.
La Commission adopte l’amendement.
Elle examine ensuite, en discussion commune, les amendements CL15 de M. Patrick Devedjian et CL25 du rapporteur.
M. Patrick Devedjian. L’amendement CL15 est défendu.
M. le rapporteur. L’amendement CL25 vise, d’une part, à clarifier l’alinéa 18 de l’article 1er en précisant que les actes mentionnés au nouvel article 9-1 du code de procédure pénale sont interruptifs de prescription à l’égard de toutes les personnes potentiellement impliquées, c’est-à-dire les co-auteurs ou complices de l’infraction, et, d’autre part, à étendre l’effet interruptif desdits actes en cas d’infractions connexes et à inscrire par là même dans la loi une règle dégagée par la jurisprudence, conformément à la suggestion que le Conseil d’État a formulée dans son avis sur le présent texte.
Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement CL15.
Elle adopte l’amendement CL25.
Puis elle adopte successivement l’amendement rédactionnel CL27, l’amendement de précision CL26 et l’amendement rédactionnel CL28 du rapporteur.
Elle adopte enfin l’article 1ermodifié.
Article 2
(art. 133-2, 133-3 et 133-4 du code pénal)
Modification des dispositions relatives à la prescription de la peine
Le présent article modifie les dispositions, contenues pour l’essentiel dans le code pénal, qui traitent de la prescription des peines criminelles (I) et correctionnelles (II). En revanche, il ne modifie pas, sur le fond, l’article 133-4 de ce code, aux termes duquel les peines contraventionnelles se prescrivent par trois années révolues à compter de la date à laquelle la décision de condamnation est devenue définitive.
Le présent article ne modifie pas le délai de prescription de droit commun des peines criminelles (A) mais rassemble au sein d’un article unique, l’article 133-2 du code pénal, les dispositions encadrant les délais dérogatoires applicables aux peines qui répriment certains crimes (B). Il rend par ailleurs imprescriptibles les peines prononcées pour certains crimes de guerre (C).
L’article 133-2 du code pénal prévoit que, sous réserve de l’article 213-5 du même code relatif à l’imprescriptibilité de l’action publique et des peines des crimes contre l’humanité, les peines prononcées pour un crime se prescrivent par vingt années révolues à compter de la date à laquelle la décision de condamnation est devenue définitive.
Comme votre rapporteur l’a rappelé à plusieurs reprises, l’un des objectifs de la réforme du droit de la prescription consiste à apporter aux dispositions qui le régissent la lisibilité et la clarté qui font aujourd’hui défaut. Pour y parvenir, les auteurs du présent texte proposaient, dans leur rapport d’information déjà cité, d’harmoniser, en matière criminelle notamment, les délais de prescription de l’action publique et des peines. L’article 1er de la proposition de loi, en portant le délai de prescription de l’action publique des crimes à vingt ans (211), traduit, dans notre droit, cette recommandation.
L’article 2 ne modifie donc pas, sur le fond, l’article 133-2 du code pénal. Il y apporte simplement une modification de nature formelle destinée à ce qu’il y soit précisé que le délai de prescription de vingt ans s’appliquerait « [s]auf dans les cas où la loi en dispose autrement », afin de bien marquer qu’il s’agit de la règle de droit commun.
En l’état du droit, certaines peines criminelles, attachées à des infractions d’une particulière gravité, se prescrivent, comme l’action publique, suivant un délai dérogatoire, plus long que le délai de droit commun.
Ainsi, se prescrivent par trente années révolues à compter de la condamnation définitive les peines sanctionnant :
–– les crimes d’eugénisme et de clonage reproductif réprimés par le sous-titre II du titre Ier du livre deuxième du code pénal, en application du premier alinéa de son article 215-4 ;
–– le crime de disparition forcée figurant à l’article 221-12 du même code, conformément à l’article 221-18 ;
–– les crimes de trafic de stupéfiants mentionnés à la section 4 du chapitre II du titre II du livre deuxième du code pénal, conformément au premier alinéa de l’article 706-31 du code de procédure pénale ;
–– les crimes de nature terroriste prévus au chapitre Ier du titre II du livre quatrième du code pénal, en application du premier alinéa de l’article 706-25-1 du code de procédure pénale ;
–– les crimes de guerre réprimés par le livre quatrième bis du code pénal, en application du premier alinéa de son article 462-10 ;
–– les crimes relatifs à la prolifération d’armes de destruction massive et de leurs vecteurs mentionnés à l’article 706-167 du code de procédure pénale, conformément au premier alinéa de l’article 706-175 de ce code.
Enfin, les peines qui sanctionnent les crimes contre l’humanité mentionnés aux articles 211-1 à 212-3 du code pénal sont, aux termes de son article 213-5, imprescriptibles.
On remarquera que les dispositions qui encadrent les délais dérogatoires figurent à la fois dans le code de procédure pénale et le code pénal.
Ainsi que votre rapporteur a eu l’occasion de l’indiquer (212), les auteurs de la présente proposition de loi ont, dans leur rapport d’information sur la prescription en matière pénale, fait part de leurs réserves au sujet de la modification des délais de prescription de l’action publique et des peines dérogatoires au droit commun (213). En cohérence avec la solution retenue à l’article 1er, lequel ne revient pas sur les dispositions dérogatoires encadrant la prescription de l’action publique (214), ils ont souhaité conserver en l’état les dispositions qui régissent les délais de prescription des peines dérogatoires au droit commun.
En revanche, pour remédier à leur éparpillement dans le code pénal et le code de procédure pénale, qui nuit à l’accessibilité et à la lisibilité de la norme, l’article 2 les rassemble au sein de l’article 133-2 du code pénal, complété par deux alinéas traitant, pour le premier, des cas dans lesquels les peines se prescrivent par trente ans et, pour le second, des cas dans lesquels les peines ne se prescrivent pas (215).
1. Le texte initial de l’article 2
S’agissant des cas dans lesquels les peines ne se prescrivent pas, l’article 2 comporte une nouveauté d’ampleur significative en ce qu’il consacre l’imprescriptibilité des peines sanctionnant les crimes de guerre punis par le livre quatrième bis du code pénal.
Cette disposition s’inscrivait en parfaite cohérence avec l’article 1er de la proposition de loi qui rendait imprescriptible l’action publique de ces crimes. Votre rapporteur ne reviendra pas sur les raisons justifiant cette imprescriptibilité de l’action publique, lesquelles s’appliquent également à l’imprescriptibilité des peines prononcées (216). Il rappelle cependant qu’une telle mesure répondrait à la conception unitaire des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité défendue au niveau international (217). Il souligne qu’elle rapprocherait également la France des pays européens qui ne soumettent à aucun délai de prescription l’exécution de telles peines, comme la Belgique ou l’Espagne où sont imprescriptibles les peines prononcées pour les crimes de génocide, les crimes de guerre et les crimes contre l’humanité, ou l’Allemagne et l’Autriche où sont imprescriptibles les peines prononcées pour tous les crimes punies de la prison à perpétuité (218).
2. Les modifications apportées par votre commission des Lois
Pour les mêmes raisons que celles précédemment évoquées en matière d’imprescriptibilité de l’action publique, la commission des Lois a adopté trois amendements identiques présentés par votre rapporteur, M. Georges Fenech et le Gouvernement afin de cantonner cette imprescriptibilité aux peines prononcées pour crimes de guerre dès lors qu’ils sont connexes à un ou plusieurs crimes contre l’humanité.
L’article 2 modifie le délai de prescription de droit commun des peines correctionnelles (A) et rassemble, au sein d’un article unique, l’article 133-3 du code pénal, les dispositions relatives aux délais dérogatoires applicables aux peines qui répriment certains délits, sans toutefois les modifier sur le fond (B).
À ce jour, l’article 133-3 du code pénal prévoit que les peines prononcées pour un délit se prescrivent par cinq années révolues à compter de la date à laquelle la décision de condamnation est devenue définitive.
Même si ce délai n’apparaît pas excessivement bref et ne semble pas faire obstacle à la mise à exécution des sanctions prononcées, les auteurs de la proposition de loi ont fait le choix de le porter à six ans afin de l’aligner sur le nouveau délai de prescription de l’action publique des délits prévu à l’article 8 réécrit du code de procédure pénale (219) et, partant, de simplifier les règles en la matière. À cet égard, plusieurs interlocuteurs de la mission d’information sur la prescription en matière pénale, à l’instar de M. Bruno Cotte, président honoraire de la chambre criminelle de la Cour de cassation et ancien président de chambre de jugement à la CPI, avaient, dans un souci de clarification du cadre juridique, appelé à l’harmonisation des délais de prescription de l’action publique et des peines.
Outre cette modification de fond, l’article 2 de la proposition de loi effectue également une modification de forme à l’article 133-3 du code pénal puisqu’il prévoit que le nouveau délai de six ans s’appliquerait « [s]auf dans les cas où la loi en dispose autrement », afin de bien marquer, là encore, qu’il s’agit de la règle de droit commun.
Comme en matière criminelle, le législateur a jugé pertinent d’allonger le délai de prescription des peines réprimant certaines infractions délictuelles. Se prescrivent ainsi par vingt années révolues à compter de la condamnation définitive les peines sanctionnant :
–– les délits de trafic de stupéfiants prévus à la section 4 du chapitre II du titre II du livre deuxième du code pénal, conformément au deuxième alinéa de l’article 706-31 du code de procédure pénale ;
–– les délits de nature terroriste mentionnés au chapitre Ier du titre II du livre quatrième du code pénal, en application du deuxième alinéa de l’article 706-25-1 du code de procédure pénale ;
–– les délits de guerre figurant au livre quatrième bis du code pénal, en application du second alinéa de son article 462-10 ;
–– les délits relatifs à la prolifération d’armes de destruction massive et de leurs vecteurs mentionnés à l’article 706-167 du code de procédure pénale, lorsqu’ils sont punis de dix ans d’emprisonnement, conformément au second alinéa de l’article 706-175 de ce code.
On notera, en revanche, que les peines qui sanctionnent les délits commis sur des mineurs mentionnés aux articles 706-47 du code de procédure pénale et 222-12, 222-29-1 et 227-26 du code pénal, pour lesquels l’action publique se prescrit suivant un délai dérogatoire (dix ou vingt ans) (220), se prescrivent dans les conditions de droit commun. Il en est de même des peines attachées aux infractions qui se prescrivent dans des délais fortement abrégés (trois mois ou un an pour les infractions prévues par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, six mois pour les infractions mentionnées à l’article L. 114 du code électoral) (221).
Comme votre rapporteur l’a indiqué à plusieurs reprises, les auteurs du présent texte ne souhaitent pas modifier les délais de prescription dérogatoires actuellement en vigueur. D’après eux, « la réduction de ces délais risquerait d’être interprétée par l’opinion publique comme une forme de laxisme, ce qui n’est clairement pas l’objectif de la réforme proposée (…) » (222). Aussi l’article 2 de la proposition de loi ne modifie-t-il pas, sur le fond, les dispositions régissant les délais dérogatoires applicables à certaines peines délictuelles.
Néanmoins, fidèles à leur souhait d’accroître la lisibilité des dispositions régissant le droit de la prescription, les auteurs de la proposition de loi ont jugé pertinent de regrouper, dans un nouvel alinéa de l’article 133-3 du code pénal, les dispositions en application desquelles les peines réprimant certains délits se prescrivent par vingt années révolues à compter de la date à laquelle la décision de condamnation est devenue définitive.
*
* *
La Commission examine les amendements identiques CL29 du rapporteur, CL12 du Gouvernement et CL14 de M. Georges Fenech.
M. le rapporteur. Ces amendements visent à réserver l’imprescriptibilité des peines prononcées pour crimes de guerre à ceux d’entre eux qui sont connexes à un crime contre l’humanité.
La Commission adopte les amendements.
Puis elle adopte l’article 2 modifié.
Article 3
(art. 213-5, 215-4, 221-18, 434-25 et 462-10 du code pénal ;
art. 85, 706-25-1, 706-31 et 706-175 du code de procédure pénale ;
art. L. 211-12, L. 212-37, L. 212-38 et L. 212-39 du code de justice militaire)
Mesures de coordination
Le présent article procède à diverses coordinations dans le code pénal, le code de procédure pénale et le code de justice militaire.
Le I abroge les articles 213-5, 215-4, 221-18 et 462-10 du code pénal et supprime le dernier alinéa de l’article 434-25 du même code, dont les dispositions sont regroupées, par les articles 1er et 2 de la proposition de loi (223), aux articles 7 et 8 du code de procédure pénale, d’une part, et aux articles 133-2 et 133-3 du code pénal, d’autre part.
Le II abroge les articles 706-25-1 et 706-175 du code de procédure pénale et supprime les deux premiers alinéas de l’article 706-31 du même code, dont les dispositions sont regroupées, par les articles 1er et 2 précités (224), aux articles 7 et 8 du code de procédure pénale, d’une part, et aux articles 133-2 et 133-3 du code pénal, d’autre part.
Le III effectue plusieurs coordinations dans le code de justice militaire afin que s’appliquent aux infractions commises par un militaire les dispositions de droit commun figurant aux articles 7 à 9-3 du code de procédure pénale dans leur rédaction issue de la présente proposition de loi.
*
* *
La Commission adopte l’amendement de conséquence CL30, l’amendement de coordination CL31 et les amendements rédactionnels CL32 à CL34 du rapporteur.
Puis elle adopte l’article 3 modifié.
Article 4 (nouveau)
Modalités d’entrée en vigueur des dispositions relatives
à l’imprescriptibilité des crimes de guerre
Issu d’un amendement de votre rapporteur, le présent article définit les modalités d’entrée en vigueur des dispositions de la proposition de loi introduisant dans notre droit le principe de l’imprescriptibilité de l’action publique et des peines des crimes de guerre connexes à un ou plusieurs crimes contre l’humanité.
Le I prévoit que l’imprescriptibilité de l’action publique s’appliquera aux faits commis postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi qui résulterait de l’adoption de la présente proposition de loi.
Le II dispose que l’imprescriptibilité des peines s’appliquera aux condamnations définitives prononcées pour des faits commis postérieurement à l’entrée en vigueur de la même loi.
Au regard de la nature et des conséquences des dispositions qui rendent imprescriptibles l’action publique et les peines des crimes de guerre connexes à un ou plusieurs crimes contre l’humanité, il a semblé nécessaire et pertinent de déroger à la règle de l’application immédiate des lois relatives à la prescription, prévue au 4° de l’article 112-2 du code pénal, lesquelles sont susceptibles de s’appliquer à des faits commis antérieurement à l’entrée en vigueur des lois qui les créent.
Cet amendement tire les conséquences des remarques et suggestions faites par le Conseil d’État dans son avis du 1er octobre 2015.
*
* *
La Commission examine l’amendement CL35 du rapporteur.
M. le rapporteur. Cet amendement concerne les crimes de guerre connexes à un ou plusieurs crimes contre l’humanité : il vise à ce que l’imprescriptibilité de l’action publique et des peines ne s’applique qu’aux faits commis après l’entrée en vigueur du présent texte.
La Commission adopte l’amendement.
Puis elle adopte l’ensemble de la proposition de loi modifiée.
*
* *
En conséquence, la commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République vous demande d’adopter la proposition de loi portant réforme de la prescription en matière pénale (n° 3540), dans le texte figurant dans le document annexé au présent rapport.
___
Dispositions en vigueur ___ |
Texte de la proposition de loi ___ |
Texte adopté par la Commission ___ |
Proposition de loi portant réforme de la prescription en matière pénale |
Proposition de loi portant réforme de la prescription en matière pénale | |
Article 1er |
Article 1er | |
Le sous-titre Ier du titre préliminaire du code de procédure pénale est ainsi modifié : |
(Alinéa sans modification) | |
Code de procédure pénale |
1° Les articles 7 à 9 du code de procédure pénale sont ainsi rédigés : |
1° (Alinéa sans modification) |
Art. 7. – En matière de crime et sous réserve des dispositions de l'article 213-5 du code pénal, l'action publique se prescrit par dix années révolues à compter du jour où le crime a été commis si, dans cet intervalle, il n'a été fait aucun acte d'instruction ou de poursuite. |
« Art. 7. – Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, l’action publique des crimes se prescrit par vingt années révolues à compter du jour où l’infraction a été commise. |
« Art. 7. – (Alinéa sans modification) |
S'il en a été effectué dans cet intervalle, elle ne se prescrit qu'après dix années révolues à compter du dernier acte. Il en est ainsi même à l'égard des personnes qui ne seraient pas impliquées dans cet acte d'instruction ou de poursuite. |
||
Le délai de prescription de l'action publique des crimes mentionnés à l'article 706-47 du présent code et le crime prévu par l'article 222-10 du code pénal, lorsqu'ils sont commis sur des mineurs, est de vingt ans et ne commence à courir qu'à partir de la majorité de ces derniers. |
« L’action publique des crimes mentionnés aux articles 706-47 du présent code et 222-10 du code pénal |
« L’action publique des crimes mentionnés à l’article 706-47 du présent code et à l’article 222-10 du code pénal, lorsqu’ils sont commis sur des mineurs, se prescrit à compter de la majorité de ces derniers. amendements CL17 et CL16 |
« L’action publique des crimes mentionnés aux articles 706-16, 706-26 et 706-167 du présent code |
« L’action publique des crimes mentionnés aux articles 706-16, 706-26 et 706-167 du présent code, aux articles 214-1 à 214-4 et 221-12 du code pénal et au livre IV bis du même code, à l’exception de ceux mentionnés au dernier alinéa du présent article, se prescrit par trente années révolues à compter du jour où l’infraction a été commise. Toutefois, le délai de prescription de l’action publique du crime prévu à l’article 214-2 dudit code, lorsqu’il a conduit à la naissance d’un enfant, court à compter de la majorité de ce dernier. amendements CL11, CL13 | |
« L’action publique des crimes mentionnés aux articles 211-1 à 212-3 |
« L’action publique des crimes mentionnés aux articles 211-1 à 212-3 du code pénal et des crimes mentionnés au livre IV bis du même code, lorsqu’ils sont connexes à l’un des crimes mentionnés aux mêmes articles 211-1 à 212-3, est imprescriptible. amendements CL11, CL13 | |
Art. 8. – En matière de délit, la prescription de l'action publique est de trois années révolues ; elle s'accomplit selon les distinctions spécifiées à l'article précédent. |
« Art. 8. – Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, l’action publique des délits se prescrit par six années révolues à compter du jour où l’infraction a été commise. |
« Art. 8. – (Alinéa sans modification) |
« L’action publique du délit mentionné à l’article 434-25 du code pénal se prescrit par trois mois révolus à compter du jour où l’infraction a été commise. |
(Alinéa sans modification) | |
« L’action publique des délits mentionnés à l’article 421-2-5 du même code se prescrit par trois années révolues à compter du jour où l’infraction a été commise. |
(Alinéa sans modification) | |
Le délai de prescription de l'action publique des délits mentionnés à l'article 706-47 et commis contre des mineurs est de dix ans ; celui des délits prévus par les articles 222-12, 222-29-1 et 227-26 du code pénal est de vingt ans ; ces délais ne commencent à courir qu'à partir de la majorité de la victime. |
« L’action publique des délits mentionnés à l’article 706-47 du présent code |
« L’action publique des délits mentionnés à l’article 706-47 du présent code, lorsqu’ils sont commis sur des mineurs, à l’exception de ceux mentionnés aux articles 222-12 et 222-29-1 du code pénal, se prescrit par dix années révolues à compter de la majorité de ces derniers. amendement CL19 |
« L’action publique des délits mentionnés aux articles 222-12, 222-29-1 et 227-26 du code pénal |
« L’action publique des délits mentionnés aux articles 222-12, 222-29-1 et 227-26 du code pénal, lorsqu’ils sont commis sur des mineurs, se prescrit par vingt années révolues à compter de la majorité de ces derniers. amendement CL17 | |
Le délai de prescription de l'action publique des délits mentionnés aux articles 223-15-2, 311-3, 311-4, 313-1, 313-2, 314-1, 314-2, 314-3, 314-6 et 321-1 du code pénal, commis à l'encontre d'une personne vulnérable du fait de son âge, d'une maladie, d'une infirmité, d'une déficience physique ou psychique ou de son état de grossesse, court à compter du jour où l'infraction apparaît à la victime dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique. |
||
« L’action publique des délits mentionnés |
« L’action publique des délits mentionnés à l’article 706-16 du présent code, à l’exception de ceux mentionnés à l’article 421-2-5 du code pénal, et à l’article 706-26 du présent code, des délits mentionnés à l’article 706-167 du présent code, lorsqu’ils sont punis de dix ans d’emprisonnement, ainsi que de ceux mentionnés au livre IV bis du code pénal se prescrit par vingt années révolues à compter du jour où l’infraction a été commise. amendements CL20 et CL21 | |
« L’action publique du délit mentionné à l’article 314-7 du code pénal se prescrit dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article 314-8 du même code. |
(Alinéa sans modification) | |
Art. 9. – En matière de contravention, la prescription de l'action publique est d'une année révolue ; elle s'accomplit selon les distinctions spécifiées à l'article 7. |
« Art. 9. – Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, l’action publique des contraventions se prescrit par une année révolue à compter du jour où l’infraction a été commise. » ; |
« Art. 9. – (Sans modification) |
2° Après l’article 9, sont insérés trois articles 9-1 à 9-3 ainsi rédigés : |
2° (Alinéa sans modification) | |
« Art. 9-1. – |
« Art. 9-1. – Sans préjudice des autres causes d’interruption prévues par la loi, le délai de prescription de l’action publique est interrompu par tout acte d’enquête, d’instruction ou de poursuite tendant effectivement à la constatation des infractions ou à la recherche, à la poursuite ou au jugement de leurs auteurs. Interrompent également le délai de prescription de l’action publique, lorsqu’ils ont les mêmes finalités, les actes qui émanent de la personne exerçant l’action civile et les plaintes de la victime déposées auprès d’un service de police judiciaire ou adressées au procureur de la République ou à un fonctionnaire auquel la mise en mouvement de l’action publique est confiée par la loi. amendements CL22 et CL23 | |
« Tout acte mentionné au premier alinéa |
« Tout acte mentionné au premier alinéa fait courir un délai de prescription d’une durée égale au délai initial. amendement CL24 | |
« |
« Les deux premiers alinéas sont applicables lorsque des personnes, auteurs ou complices, ne sont pas visées par l’un des actes mentionnés à ces mêmes alinéas ou en cas d’infractions connexes. amendement CL25 | |
« Art. 9-2. – Par dérogation aux articles 7 à 9, |
« Art. 9-2. – Par dérogation aux articles 7 à 9, le délai de prescription de l’infraction occulte ou dissimulée court à compter du jour où l’infraction est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant la mise en mouvement ou l’exercice de l’action publique. amendements CL27 et CL26 | |
« Est occulte l’infraction qui, en raison de ses éléments constitutifs, ne peut être connue ni de la victime, ni de l’autorité judiciaire. |
(Alinéa sans modification) | |
« Est dissimulée l’infraction dont l’auteur accomplit délibérément toute manœuvre caractérisée tendant à en empêcher la découverte. |
(Alinéa sans modification) | |
« Art. 9-3. – La prescription est suspendue |
« Art. 9-3. – La prescription est suspendue lorsqu’un obstacle de droit ou un obstacle de fait insurmontable rend impossible la mise en mouvement ou l’exercice de l’action publique. » amendements CL28 et CL26 | |
Article 2 |
Article 2 | |
Le code pénal est ainsi modifié : |
(Alinéa sans modification) | |
Code pénal |
1° L’article 133-2 est ainsi modifié : |
1° (Alinéa sans modification) |
|
Art. 133-2. – Sous réserve des dispositions de l'article 213-5, les peines prononcées pour un crime se prescrivent par vingt années révolues à compter de la date à laquelle la décision de condamnation est devenue définitive. |
a) Le début est ainsi rédigé : « Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les peines (le reste sans changement) » ; |
a) (Sans modification) |
b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés : |
b) (Alinéa sans modification) | |
« Les peines prononcées pour les crimes mentionnés aux articles 214-1 à 214-4 et 221-12 du présent code et 706-16, 706-26 et 706-167 du code de procédure pénale se prescrivent par trente années révolues à compter de la date à laquelle la décision de condamnation est devenue définitive. |
« Les peines prononcées pour les crimes mentionnés aux articles 214-1 à 214-4 et 221-12 et au livre IV bis du présent code, à l’exception de ceux mentionnés au dernier alinéa du présent article, et aux articles 706-16, 706-26 et 706-167 du code de procédure pénale se prescrivent par trente années révolues à compter de la date à laquelle la décision de condamnation est devenue définitive. amendements CL12, CL14 | |
« Les peines prononcées pour les crimes mentionnés aux articles 211-1 à 212-3 et au livre IV bis du présent code sont imprescriptibles. » ; |
« Les peines prononcées pour les crimes mentionnés aux articles 211-1 à 212-3 et au livre IV bis du présent code, lorsqu’ils sont connexes à l’un des crimes mentionnés aux mêmes articles 211-1 à 212-3, sont imprescriptibles. » ; amendements CL12, CL14 | |
2° L’article 133-3 est ainsi modifié : |
2° (Sans modification) | |
|
Art. 133-3. – Les peines prononcées pour un délit se prescrivent par cinq années révolues à compter de la date à laquelle la décision de condamnation est devenue définitive. |
a) Le début est ainsi rédigé : « Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les peines prononcées pour un délit se prescrivent par six années … (le reste sans changement) » ; |
|
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : |
||
« Les peines prononcées pour les délits mentionnés par le livre IV bis du présent code, les articles 706-16 et 706-26 du code de procédure pénale et, lorsqu’ils sont punis de dix ans d’emprisonnement, pour ceux prévus à l’article 706-167 du même code se prescrivent par vingt années révolues à compter de la date à laquelle la décision de condamnation est devenue définitive. » ; |
||
|
Art. 133-4. – Les peines prononcées pour une contravention se prescrivent par trois années révolues à compter de la date à laquelle la décision de condamnation est devenue définitive. |
3° Au début de l’article 133-4, sont ajoutés les mots : « Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les peines… (le reste sans changement) ». |
3° (Sans modification) |
Article 3 |
Article 3 | |
I. – Le code pénal est ainsi modifié : |
I. – (Sans modification) | |
Art. 213-5. – L'action publique relative aux crimes prévus par le présent sous-titre, ainsi que les peines prononcées, sont imprescriptibles. |
1° Les articles 213-5, 215-4, 221-18 et 462-10 sont abrogés ; |
|
Art. 215-4. – L'action publique relative aux crimes prévus par le présent sous-titre, ainsi que les peines prononcées, se prescrivent par trente ans. |
||
En outre, pour le crime de clonage reproductif prévu par l'article 214-2, le délai de prescription de l'action publique ne commence à courir, lorsque le clonage a conduit à la naissance d'un enfant, qu'à partir de la majorité de cet enfant. |
||
Art. 221-18. – L'action publique à l'égard du crime défini à l'article 221-12 ainsi que les peines prononcées se prescrivent par trente ans. |
||
Art. 462-10. – L'action publique à l'égard des crimes de guerre définis au présent livre se prescrit par trente ans. La peine prononcée en cas de condamnation pour l'un de ces crimes se prescrit par trente ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive. |
||
L'action publique à l'égard des délits de guerre définis au présent livre se prescrit par vingt ans. La peine prononcée en cas de condamnation pour l'un de ces délits se prescrit par vingt ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive. |
||
Art. 434-25. – Le fait de chercher à jeter le discrédit, publiquement par actes, paroles, écrits ou images de toute nature, sur un acte ou une décision juridictionnelle, dans des conditions de nature à porter atteinte à l'autorité de la justice ou à son indépendance est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende. |
||
Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux commentaires techniques ni aux actes, paroles, écrits ou images de toute nature tendant à la réformation, la cassation ou la révision d'une décision. |
||
Lorsque l'infraction est commise par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables. |
||
L'action publique se prescrit par trois mois révolus, à compter du jour où l'infraction définie au présent article a été commise, si dans cet intervalle il n'a été fait aucun acte d'instruction ou de poursuite. |
2° Le dernier alinéa de l’article 434-25 est supprimé. |
|
Code de procédure pénale |
II. – Le |
II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié : amendement CL30 |
Art. 85. – Toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit peut en portant plainte se constituer partie civile devant le juge d'instruction compétent en application des dispositions des articles 52, 52-1 et 706-42. |
||
Toutefois, la plainte avec constitution de partie civile n'est recevable qu'à condition que la personne justifie soit que le procureur de la République lui a fait connaître, à la suite d'une plainte déposée devant lui ou un service de police judiciaire, qu'il n'engagera pas lui-même des poursuites, soit qu'un délai de trois mois s'est écoulé depuis qu'elle a déposé plainte devant ce magistrat, contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou depuis qu'elle a adressé, selon les mêmes modalités, copie à ce magistrat de sa plainte déposée devant un service de police judiciaire. Cette condition de recevabilité n'est pas requise s'il s'agit d'un crime ou s'il s'agit d'un délit prévu par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ou par les articles L. 86, L. 87, L. 91 à L. 100, L. 102 à L. 104, L. 106 à L. 108 et L. 113 du code électoral. La prescription de l'action publique est suspendue, au profit de la victime, du dépôt de la plainte jusqu'à la réponse du procureur de la République ou, au plus tard, une fois écoulé le délai de trois mois. |
1° A (nouveau) La dernière phrase du deuxième alinéa de l’article 85 est supprimée ; amendement CL31 | |
Lorsque la plainte avec constitution de partie civile est formée par une personne morale à but lucratif, elle n'est recevable qu'à condition que la personne morale justifie de ses ressources en joignant son bilan et son compte de résultat. |
||
Art. 706-25-1. – L'action publique des crimes mentionnés à l'article 706-16 se prescrit par trente ans. La peine prononcée en cas de condamnation pour l'un de ces crimes se prescrit par trente ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive. |
1° Les articles 706-25-1 et 706-175 sont abrogés ; |
1° (Sans modification) |
L'action publique relative aux délits mentionnés à l'article 706-16 se prescrit par vingt ans. La peine prononcée en cas de condamnation pour ces délits se prescrit par vingt ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive. |
||
Le présent article n'est pas applicable aux délits prévus à l'article 421-2-5 du code pénal. |
||
Art. 706-175. – L'action publique des crimes mentionnés à l'article 706-167 se prescrit par trente ans. La peine prononcée en cas de condamnation pour l'un de ces crimes se prescrit par trente ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive. |
||
L'action publique relative aux délits mentionnés à l'article 706-167, lorsqu'ils sont punis de dix ans d'emprisonnement, se prescrit par vingt ans. La peine prononcée en cas de condamnation pour ces délits se prescrit par vingt ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive. |
||
Art. 706-31. – L'action publique des crimes mentionnés à l'article 706-26 se prescrit par trente ans. La peine prononcée en cas de condamnation pour l'un de ces crimes se prescrit par trente ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive. |
2° Les deux premiers alinéas de l’article 706-31 sont supprimés. |
2° (Sans modification) |
L'action publique relative aux délits mentionnés à l'article 706-26 se prescrit par vingt ans. La peine prononcée en cas de condamnation pour l'un de ces délits se prescrit par vingt ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive. |
||
Par dérogation aux dispositions de l'article 750, le maximum de la durée de la contrainte judiciaire est fixée à un an lorsque l'amende et les condamnations pécuniaires prononcées pour l'une des infractions mentionnées à l'article 706-26 ou pour les infractions douanières connexes excèdent 100 000 euros. |
||
Code de justice militaire |
III. – Le titre Ier du livre II du code de justice militaire est ainsi modifié : |
III. – (Alinéa sans modification) |
Art. 211-12. – Les modes d'extinction de l'action publique prévus par les articles 6 à 9 du code de procédure pénale sont applicables devant les juridictions des forces armées, sous réserve des dispositions relatives à la prescription prévues à l'article L. 211-13. |
1° À l’article L. 211-12, la référence : « 9 » est remplacée par la référence : « 9-3 » ; |
1° (Alinéa sans modification) |
2° |
2° L’article L. 212-37 est ainsi rédigé : amendement CL32 | |
Art. 212-37. – En matière de crime et sous réserve des dispositions de l'article 213-5 du code pénal, l'action publique se prescrit par dix années révolues à compter du jour où le crime a été commis si, dans cet intervalle, il n'a été fait aucun acte d'instruction ou de poursuite. |
« L’action publique des crimes se prescrit selon les règles prévues aux |
« L’action publique des crimes se prescrit selon les règles prévues aux articles 7 et 9-1 à 9-3 du code de procédure pénale. » ; amendement CL33 |
S'il en a été effectué dans cet intervalle, elle ne se prescrit qu'après dix années révolues à compter du dernier acte. Il en est ainsi même à l'égard des personnes qui ne seraient pas impliquées dans cet acte d'instruction ou de poursuite. |
||
Lorsque la victime est mineure et que le crime a été commis par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par une personne ayant autorité sur elle, le délai de prescription ne commence à courir qu'à partir de sa majorité. |
||
3° Les articles L. 212-38 et L. 212-39 sont ainsi rédigés : |
3° (Alinéa sans modification) | |
Art. L. 212-38. – En matière de délit, la prescription de l'action publique est de trois années révolues ; elle s'accomplit selon les distinctions spécifiées à l'article L. 212-37. |
« Art. L. 212-38. – L’action publique des délits se prescrit selon les règles prévues |
« Art. L. 212-38. – L’action publique des délits se prescrit selon les règles prévues aux articles 8 et 9-1 à 9-3 du code de procédure pénale. amendement CL34 |
Art. L. 212-39. – En matière de contravention, la prescription de l'action publique est d'une année révolue ; elle s'accomplit selon les distinctions spécifiées à l'article L. 212-37. |
« Art. L. 212-39. – L’action publique des contraventions se prescrit selon les règles prévues à l’article 9, aux premier et dernier alinéas de l’article 9-1 et aux articles 9-2 et 9-3 du code de procédure pénale. » |
« Art. L. 212-39. – (Sans modification) |
Article 4 (nouveau) | ||
I. – L’imprescriptibilité de l’action publique des crimes mentionnés au livre IV bis du code pénal, telle qu’elle est prévue au quatrième alinéa de l’article 7 du code de procédure pénale, s’applique aux faits commis après l’entrée en vigueur de la présente loi. | ||
II. – L’imprescriptibilité des peines prononcées pour les crimes mentionnés au livre IV bis du code pénal, telle qu’elle est prévue au dernier alinéa de l’article 133-2 du même code, s’applique aux condamnations définitives prononcées pour des faits commis après l’entrée en vigueur de la présente loi. amendement CL35 |
ANNEXE 1 : LES DÉLAIS DE PRESCRIPTION
AVANT ET APRÈS LA RÉFORME PROPOSÉE (225)
LES DÉLAIS DE PRESCRIPTION DE L’ACTION PUBLIQUE
Infraction |
Délai de prescription avant la réforme Référence applicable |
Délai de prescription à l’issue de la réforme Référence applicable |
Les infractions criminelles | ||
Crimes (délai de droit commun) |
10 ans art. 7 CPP |
20 ans art. 7 CPP |
Crimes mentionnés aux art. 706-47 CPP et 222-10 CP commis sur les mineurs |
20 ans art. 7 CPP |
20 ans art. 7 CPP |
Crimes d’eugénisme et de clonage reproductif (sous-titre II du titre Ier du livre II CP), de disparition forcée (art. 221-12 CP), de trafic de stupéfiants (section 4 du chapitre II du titre II du livre II CP), de nature terroriste (chapitre Ier du titre II du livre IV CP) et crimes relatifs à la prolifération d’armes de destruction massive et de leurs vecteurs (art. 706-167 CPP) |
30 ans art. 215-4 CP, 221-18 CP, 706-31 CPP, 706-25-1 CPP et 706-175 CPP |
30 ans art. 7 CPP |
Crimes de guerre (livre IV bis CP) |
30 ans art. 462-10 CP |
– Crimes de guerre connexes à un ou plusieurs crimes contre l’humanité : imprescriptibles – Autres crimes de guerre : 30 ans art. 7 CPP |
Crimes contre l’humanité (sous-titre Ier du titre Ier du livre II CP) |
Imprescriptibles art. 213-5 CP |
Imprescriptibles art. 7 CPP |
Les infractions délictuelles | ||
Délits (délai de droit commun) |
3 ans art. 8 CPP |
6 ans art. 8 CPP |
Délit de discrédit jeté sur une décision de justice (art. 434-25 CP) |
3 mois art. 434-25 CP |
3 mois art. 8 CPP |
Délits de provocation à la commission d’actes terroristes et d’apologie du terrorisme (art. 421-2-5 CP) |
3 ans art. 706-25-1 CPP |
3 ans art. 8 CPP |
Délit de fraude fiscale (art. 1741 et 1743 du code général des impôts) |
6 ans art. L. 230 du livre des procédures fiscales |
6 ans art. L. 230 du livre des procédures fiscales |
Délit de défrichement irrégulier (effectué en infraction à l’art. L. 341-3 du code forestier) |
6 ans art. L. 363-3 du code forestier |
6 ans art. L. 363-3 du code forestier |
Délits mentionnés à l’art. 706-47 CPP commis sur les mineurs |
10 ans art. 8 CPP |
10 ans art. 8 CPP |
Délits de violences commises sur un mineur ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours (art. 222-12 CP), d’agressions sexuelles autres que le viol commises sur un mineur (art. 222-29-1 CP) et d’atteintes sexuelles sans violence, contrainte, menace ni surprise sur un mineur de moins de quinze ans commises avec une circonstance aggravante (art. 227-26 CP) |
20 ans art. 8 CPP |
20 ans art. 8 CPP |
Délits de trafic de stupéfiants (section 4 du chapitre II du titre II du livre II CP), de nature terroriste (chapitre Ier du titre II du livre IV CP) et délits relatifs à la prolifération d’armes de destruction massive et de leurs vecteurs (art. 706-167 CPP) |
20 ans art. 706-31, 706-25-1 et 706-175 CPP |
20 ans art. 8 CPP |
Délits de guerre (livre IV bis CP) |
20 ans art. 462-10 CP |
20 ans art. 8 CPP |
Les infractions contraventionnelles | ||
Contraventions (délai de droit commun) |
1 an art. 9 CPP |
1 an art. 9 CPP |
Cas particulier de certaines infractions au code électoral | ||
Délits et crime prévus aux art. L. 61, L. 86, L. 87, L. 91 à L. 104, L. 106 à L. 108 et L. 113 du code électoral |
6 mois art. L. 114 du code électoral |
6 mois art. L. 114 du code électoral |
Cas particulier des infractions de presse | ||
Crimes, délits et contraventions réprimés par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse (délai de droit commun) |
3 mois art. 65 de la loi de 1881 |
3 mois art. 65 de la loi de 1881 |
Délits réprimés par les art. 24 (al. 7 et 8), 24 bis, 32 (al. 2 et 3) et 33 (al. 3 et 4) de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse |
1 an art. 65-3 de la loi de 1881 |
1 an art. 65-3 de la loi de 1881 |
CP : code pénal.
CPP : code de procédure pénale.
LES DÉLAIS DE PRESCRIPTION DES PEINES
Infraction |
Délai de prescription avant la réforme Référence applicable |
Délai de prescription à l’issue de la réforme Référence applicable |
Les infractions criminelles | ||
Crimes (délai de droit commun) |
20 ans art. 133-2 CP |
20 ans art. 133-2 CP |
Crimes d’eugénisme et de clonage reproductif (sous-titre II du titre Ier du livre II CP), de disparition forcée (art. 221-12 CP), de trafic de stupéfiants (section 4 du chapitre II du titre II du livre II CP), de nature terroriste (chapitre Ier du titre II du livre IV CP) et crimes relatifs à la prolifération d’armes de destruction massive et de leurs vecteurs (art. 706-167 CPP) |
30 ans art. 215-4 CP, 221-18 CP, 706-31 CPP, 706-25-1 CPP et 706-175 CPP |
30 ans art. 133-2 CP |
Crimes de guerre (livre IV bis CP) |
30 ans art. 462-10 CP |
– Crimes de guerre connexes à un ou plusieurs crimes contre l’humanité : imprescriptibles – Autres crimes de guerre : 30 ans art. 133-2 CP |
Crimes contre l’humanité (sous-titre Ier du titre Ier du livre II CP) |
Imprescriptibles art. 213-5 CP |
Imprescriptibles art. 133-2 CP |
Les infractions délictuelles | ||
Délits (délai de droit commun) |
5 ans art. 133-3 CP |
6 ans art. 133-3 CP |
Délits de trafic de stupéfiants (section 4 du chapitre II du titre II du livre II CP), de nature terroriste (chapitre Ier du titre II du livre IV CP) et délits relatifs à la prolifération d’armes de destruction massive et de leurs vecteurs (art. 706-167 CPP) |
20 ans art. 706-31, 706-25-1 et 706-175 CPP |
20 ans art. 133-3 CP |
Délits de guerre (livre IV bis CP) |
20 ans art. 462-10 CP |
20 ans art. 133-3 CP |
Les infractions contraventionnelles | ||
Contraventions (délai de droit commun) |
3 ans art. 133-4 CP |
3 ans art. 133-4 CP |
CP : code pénal.
CPP : code de procédure pénale.
ANNEXE 2 : AVIS DU CONSEIL D’ÉTAT DU 1ER OCTOBRE 2015
SUR LA PROPOSITION DE LOI
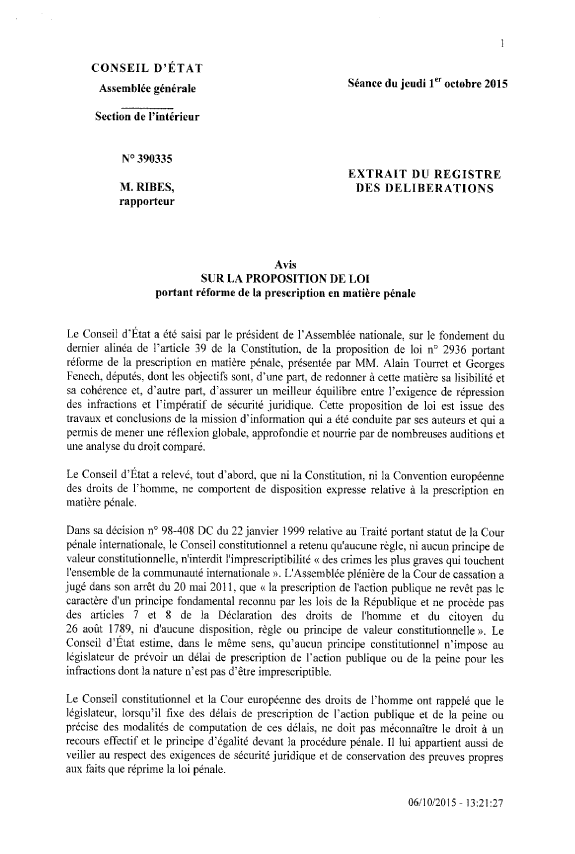
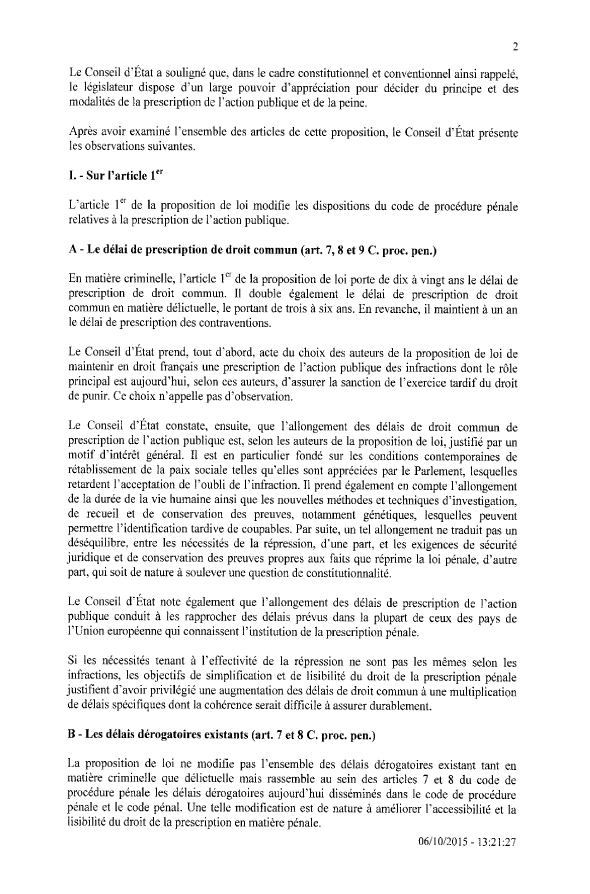
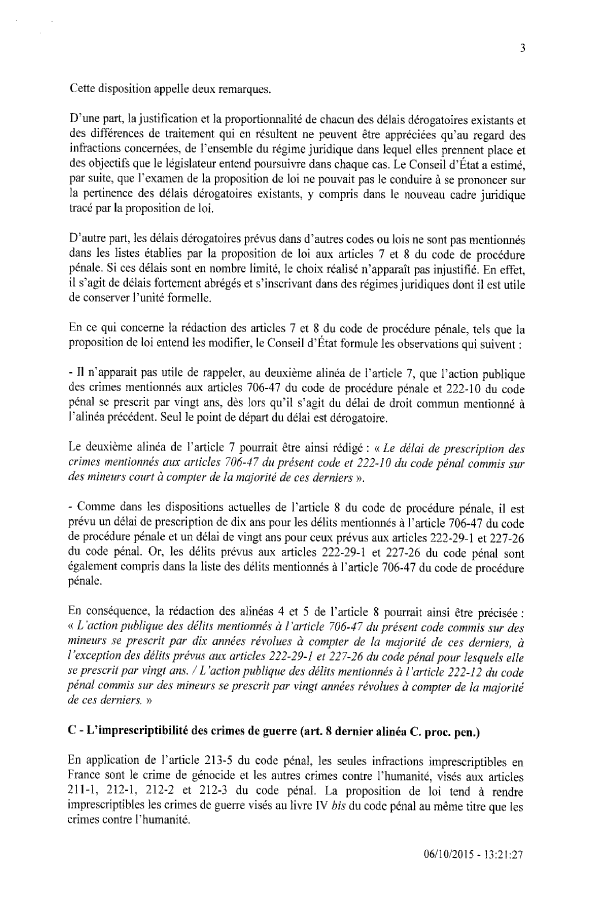
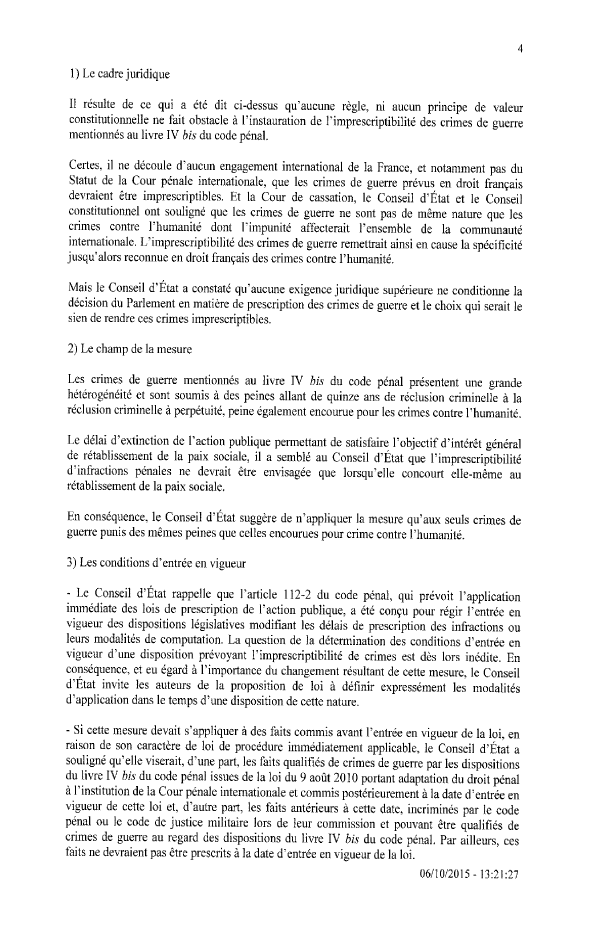
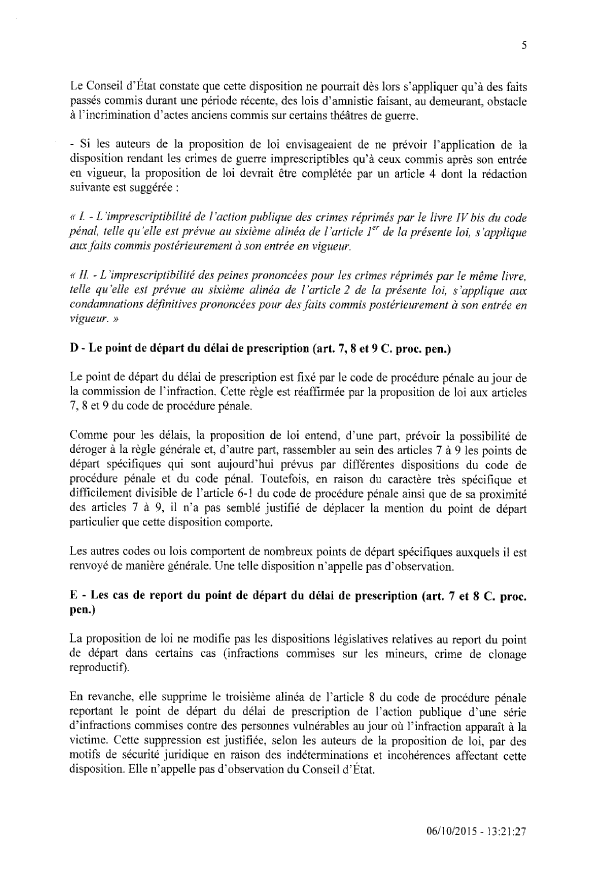
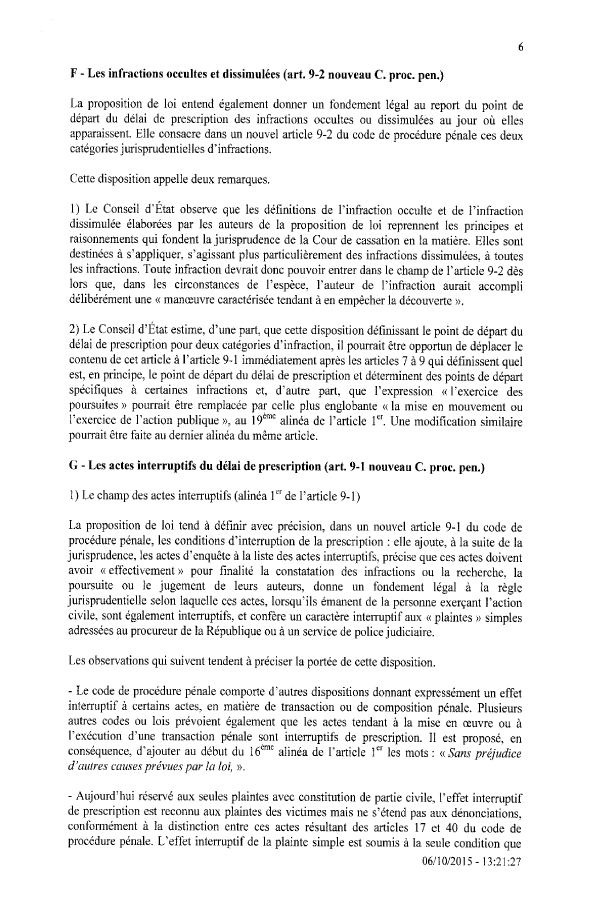
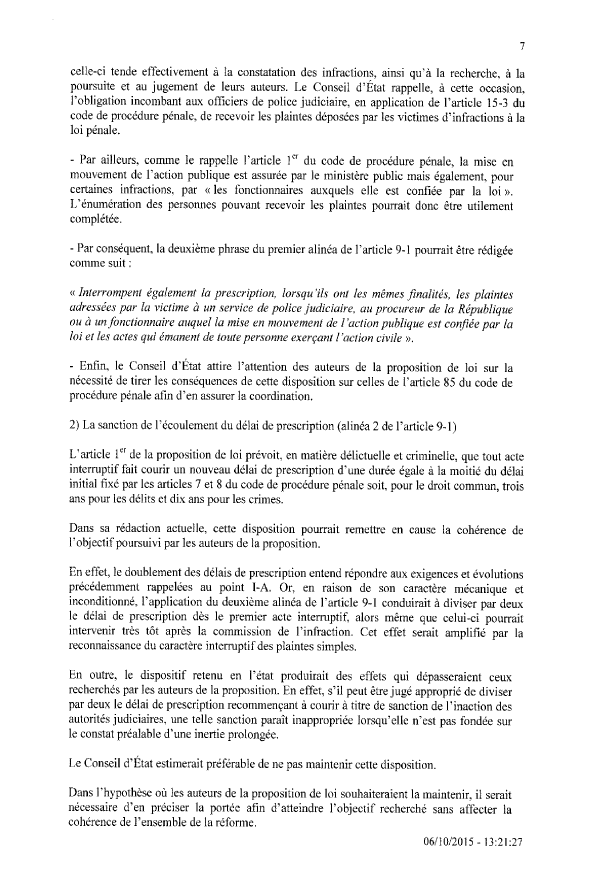
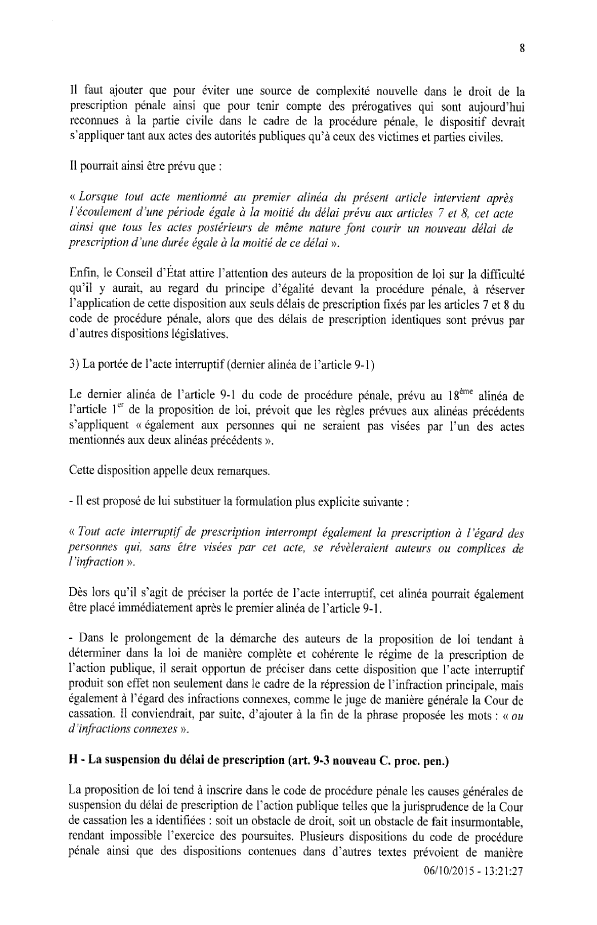
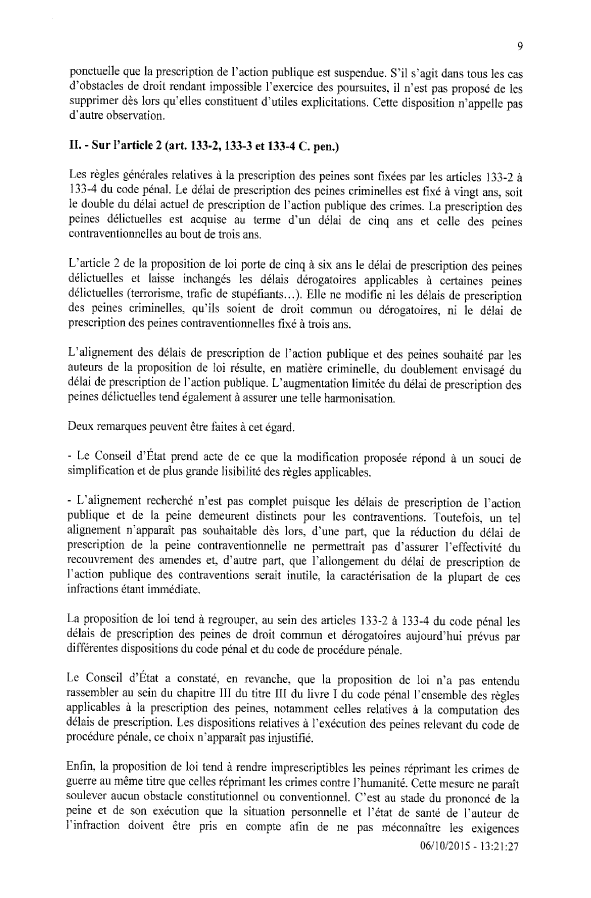
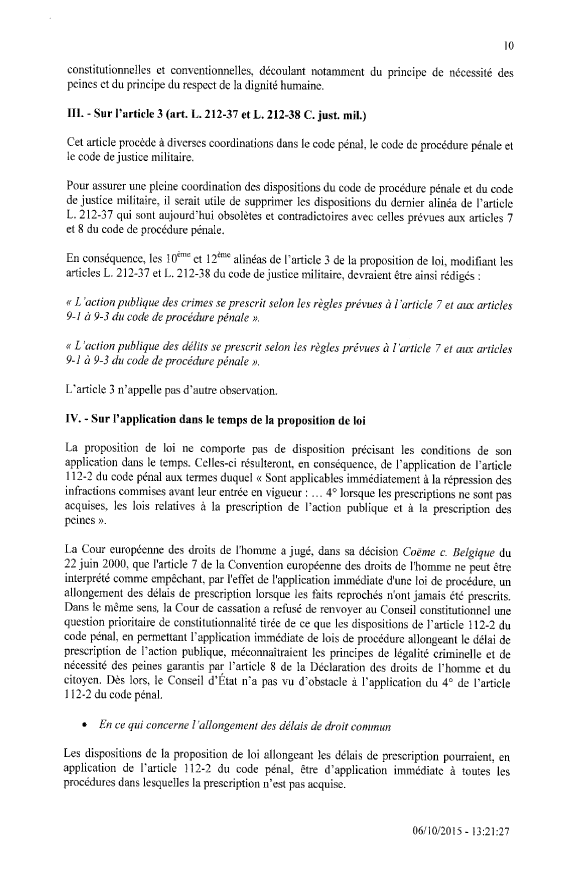
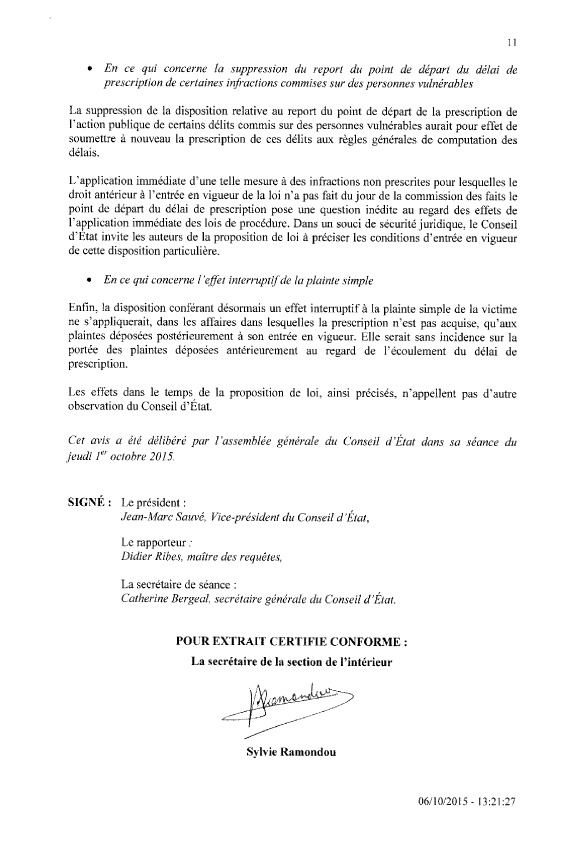
1 () Rapport d’information (n° 2778, XIVe législature) fait par MM. Alain Tourret et Georges Fenech au nom de la mission d’information sur la prescription en matière pénale, enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 20 mai 2015.
2 () Loi n° 2014-640 du 20 juin 2014 relative à la réforme des procédures de révision et de réexamen d’une condamnation pénale définitive.
3 () Rapport d’information (n° 338, session ordinaire de 2006-2007) fait par MM. Jean-Jacques Hyest, Hugues Portelli et Richard Yung au nom de la mission d’information sur le régime des prescriptions civiles et pénales, enregistré à la Présidence du Sénat le 20 juin 2007.
4 () Loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile.
5 () Rapport d’information (n° 2778, XIVe législature) précité, pp. 11-22.
6 () Jean-François Renucci, « Infractions d’affaires et prescription de l’action publique », Recueil Dalloz 1997, p. 23.
7 () Contribution écrite de l’Union syndicale des magistrats annexée au rapport d’information (n° 2778, XIVe législature) précité, p. 244.
8 () Contribution écrite du Syndicat de la magistrature annexée au rapport d’information (n° 2778, XIVe législature) précité, p. 256.
9 () Dominique Noëlle Commaret, « Point de départ du délai de prescription de l’action publique : des palliatifs jurisprudentiels, faute de réforme législative d’ensemble », Revue de science criminelle, 2004, p. 897.
10 () Contribution écrite de M. Jean Danet annexée au rapport d’information (n° 2778, XIVe législature) précité, p. 170.
11 () Rapport d’information (n° 2778, XIVe législature) précité, p. 17.
12 () Rapport d’information (n° 2778, XIVe législature) précité, p. 21.
13 () Contribution écrite de M. Jean Danet annexée au rapport d’information (n° 2778, XIVe législature) précité, p. 170.
14 () Rapport d’information (n° 338, session ordinaire de 2006-2007) précité, p. 40.
15 () Seul le délai de prescription des peines contraventionnelles, initialement fixé à deux ans, a été modifié par le législateur depuis 1808 lorsqu’il l’a porté en 2002 à trois ans.
16 () Voir le c du 1 du B du I du rapport d’information (n° 2778, XIVe législature) précité, pp. 40-45.
17 () Voir le b du même 1, pp. 27-40.
18 () Voir le a du 2 du même B, pp. 46-64.
19 () Voir le b du même 2, pp. 64-72.
20 () Contribution écrite de M. Jean Danet annexée au rapport d’information (n° 2778, XIVe législature) précité, pp. 171-172.
21 () Voir infra, les b du 1 du A et a du 1 du B du I du commentaire de l’article 1er.
22 () Paul Ricœur, La mémoire, l’histoire, l’oubli, Le Seuil, 2000, p. 648.
23 () Voir infra, le 1 du B du III du commentaire de l’article 1er.
24 () Cet article prévoit que l’action publique des crimes contre l’humanité comme les peines prononcées sont imprescriptibles.
25 () Voir le rapport d’information (n° 2778, XIVe législature) précité.
26 () Contribution écrite de M. Jean Danet annexée au rapport d’information (n° 2778, XIVe législature) précité, p. 169.
27 () Contribution écrite du colonel François Daoust annexée au rapport d’information (n° 2778, XIVe législature) précité, pp. 394 et 397.
28 () Contribution écrite de M. Frédéric Dupuch annexée au rapport d’information (n° 2778, XIVe législature) précité, pp. 453-454.
29 () Voir le rapport d’information (n° 2778, XIVe législature) précité, pp. 14-15.
30 () Ces données sont disponibles sur le site de l’INSEE.
31 () Recommandation n° 4 du rapport d’information (n° 338, session ordinaire de 2006-2007) précité, p. 41.
32 () La proposition de loi ne modifie pas ce délai (voir infra, le A du I du commentaire de l’article 2).
33 () Les données qui suivent sont issues d’une étude transmise à la mission d’information sur la prescription en matière pénale par le bureau du droit comparé du service des affaires européennes et internationales du ministère de la justice (voir l’annexe n° 1 de ce rapport). Les peines de prison d’une durée supérieure à dix ans sont assimilées à des peines criminelles au sens du droit pénal français. Il n’est donc pas tenu compte de la qualification juridique des infractions dans les pays en question. L’expression « peine d’emprisonnement » (qui figure dans le document transmis par le service des affaires européennes et internationales) est retenue y compris pour des peines de prison d’une durée supérieure à dix ans.
34 () Certains meurtres aggravés (notamment à caractère sexuel) sont imprescriptibles.
35 () Les infractions punies de la réclusion criminelle à perpétuité sont imprescriptibles.
36 () Les actes de terrorisme ne se prescrivent pas lorsqu’ils ont causé la mort.
37 () Les crimes et les délits réprimés par une peine d’emprisonnement d’une durée égale ou supérieure à douze ans ainsi que certains crimes et délits de nature sexuelle commis sur un mineur de dix-huit ans sont imprescriptibles.
38 () Voir infra, le III du présent commentaire d’article.
39 () Cette remarque vaut pour l’allongement du délai de prescription de l’action publique des crimes et des délits (voir infra, le B du présent I).
40 () Avis n° 390335 du 1er octobre 2015, reproduit en annexe au présent rapport, sur la proposition de loi portant réforme de la prescription en matière pénale, p. 2.
41 () Voir les a et b 1 du B du I du rapport d’information (n° 2778, XIVe législature) précité, pp. 22-40.
42 () Aux termes du second alinéa de l’article 215-4 du code pénal, le délai de prescription de l’action publique applicable au crime de clonage reproductif prévu à l’article 214-2 ne commence à courir, lorsque le clonage a conduit à la naissance d’un enfant, qu’à partir de la majorité de cet enfant.
43 () Contribution écrite de M. Jean Danet annexée au rapport d’information (n° 2778, XIVe législature) précité, p. 175.
44 () Contribution écrite de M. Bruno Cotte annexée au rapport d’information (n° 2778, XIVe législature) précité, p. 274.
45 () Le deuxième alinéa de l’article 7, dans sa nouvelle rédaction, reprend les dispositions aujourd’hui prévues au dernier alinéa de ce même article 7, selon lesquelles l’action publique de certains crimes commis contre les mineurs se prescrit par vingt années révolues à compter de la majorité de la victime. Le troisième alinéa reprend, quant à lui, les dispositions qui prévoient que l’action publique de plusieurs crimes se prescrit par trente ans.
46 () Cette modification fait l’objet des développements qui figurent au II du présent commentaire d’article.
47 () Voir supra, le a du présent 2.
48 () Rapport d’information (n° 2778, XIVe législature) précité, p. 110.
49 () Contribution écrite de Mme Catherine Sultan annexée au rapport d’information (n° 2778, XIVe législature) précité, pp. 384 et 387.
50 () Voir supra, le a du présent 2.
51 () Avis n° 390335 du 1er octobre 2015 précité, p. 2.
52 () Ibid., p. 3.
53 () Voir le b du 3 du B du II du rapport d’information (n° 2778, XIVe législature) précité, pp. 101-105.
54 () Ces données sont issues de l’étude réalisée par le bureau du droit comparé du service des affaires européennes et internationales du ministère de la justice transmise à la mission d’information sur la prescription en matière pénale (voir l’annexe n° 1 de ce rapport). Votre rapporteur a considéré que les peines de prison d’une durée maximale de dix ans s’analysaient, dans le cadre de la présente réflexion, comme des peines délictuelles au sens du droit pénal français.
55 () Rapport d’information (n° 2778, XIVe législature) précité, p. 104.
56 () Idem.
57 () Idem.
58 () Recommandation n° 4 du rapport d’information (n° 338, session ordinaire de 2006-2007) précité, p. 41.
59 () Rapport d’information (n° 2778, XIVe législature) précité, p. 107.
60 () Ce second point est prévu au dernier alinéa de l’article L. 230 du livre des procédures fiscales.
61 () Pour ces trois délits, le délai de prescription est prévu au deuxième alinéa de l’article 8 du code de procédure pénale dans sa rédaction actuelle.
62 () Voir le c du 1 du B du I du rapport d’information (n° 2778, XIVe législature) précité, pp. 40-45.
63 () Aux termes du premier alinéa de cet article, « [s]eront punis comme complices d’une action qualifiée crime ou délit ceux qui, soit par des discours, cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics, soit par des écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures, emblèmes, images ou tout autre support de l’écrit, de la parole ou de l’image vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunions publics, soit par des placards ou des affiches exposés au regard du public, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique, auront directement provoqué l’auteur ou les auteurs à commettre ladite action, si la provocation a été suivie d’effet ».
64 () Cette infraction est passible de vingt ans de réclusion criminelle.
65 () Rapport d’information (n° 2778, XIVe législature) précité, p. 105.
66 () Cass. civ. 1, 5 avril 2012, n° 11-25.290.
67 () Contribution écrite de M. Robert Gelli annexée au rapport d’information (n° 2778, XIVe législature) précité, p. 493.
68 () L’actuel dernier alinéa est supprimé par l’article 1er de la proposition de loi (voir infra, le 3 du présent B).
69 () À la suite de l’entrée en vigueur de la loi n° 2012-1432 du 21 décembre 2012 relative à la sécurité et à la lutte contre le terrorisme, l’action publique de ces infractions se prescrivait par une année révolue.
70 () Voir supra, le b du 2 du A du présent I.
71 () Contribution écrite de Mme Christine Courtin annexée au rapport d’information (n° 2778, XIVe législature) précité, p. 162.
72 () Aux termes du dernier alinéa de l’article 314-8 du code pénal, « [l]a prescription de l’action publique ne court qu’à compter de la condamnation à l’exécution de laquelle le débiteur a voulu se soustraire ; toutefois, elle ne court qu’à compter du dernier agissement ayant pour objet d’organiser ou d’aggraver l’insolvabilité du débiteur lorsque le dernier agissement est postérieur à cette condamnation ».
73 () Cet âge est fixé à cinquante ans par le premier alinéa de l’article L. 3 du code du service national.
74 () Avis n° 390335 du 1er octobre 2015 précité, p. 3.
75 () Exposé sommaire de l’amendement n° 62 rect. ter de M. Christian Demuynck adopté au Sénat en première lecture avec avis favorables de la commission des Lois et du Gouvernement (voir le compte rendu intégral de la séance du vendredi 10 septembre 2010 publié au Journal officiel de la République française du 11 septembre 2010).
76 () Contribution écrite de M. Philippe-Jean Parquet annexée au rapport d’information (n° 2778, XIVe législature) précité, p. 473.
77 () Rapport d’information (n° 2778, XIVe législature) précité, p. 109.
78 () Contribution écrite de M. Robert Gelli annexée au rapport d’information (n° 2778, XIVe législature) précité, p. 494.
79 () Voir la proposition n° 6 du rapport d’information (n° 2778, XIVe législature) précité, p. 106.
80 () Avis n° 390335 du 1er octobre 2015 précité, p. 9.
81 () Avant l’abrogation de cette disposition par l’ordonnance n° 2006-637 du 1er juin 2006 portant refonte du code de justice militaire, le second alinéa de l’article 94 de l’ancien code de justice militaire prévoyait que l’action publique ne se prescrivait pas pour les infractions de désertion à bande armée, de désertion à l’ennemi de tout militaire ou de tout individu non militaire faisant partie de l’équipage d’un bâtiment de la marine ou d’un aéronef militaire ou d’un navire de commerce convoyé, de désertion en présence de l’ennemi ou « lorsqu’un déserteur ou un insoumis s’[était] réfugié ou [était] resté à l’étranger en temps de guerre pour se soustraire à ses obligations militaires ».
82 () Cass. crim., 26 janvier 1984, n° 83-94.425.
83 () Exposé des motifs du projet de loi (n° 308) portant adaptation du droit pénal à l’institution de la Cour pénale internationale présenté par M. Pascal Clément, garde des Sceaux, ministre de la justice, enregistré à la Présidence du Sénat le 15 mai 2007.
84 () Rapport (n° 2517, XIIIe législature) fait par M. Thierry Mariani au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République sur le projet de loi, adopté par le Sénat (n° 951), portant adaptation du droit pénal à l’institution de la Cour pénale internationale, enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 19 mai 2010, p. 80.
85 () À l’Assemblée nationale, en commission des Lois (amendements CL 26 de M. Noël Mamère, CL 45 de M. François Vannson et CL 88 de M. Jean-Jacques Urvoas) et en séance publique (amendements n° 17 de M. Noël Mamère, n° 50 de M. Jean-Jacques Urvoas, n° 60 de Mme Françoise Hostalier et n° 65 de M. Jean-Pierre Grand).
86 () CEDH, 22 octobre 1996, Stubbings et autres c. Royaume-Uni, nos 22083/93 et 22095/93, § 51.
87 () Avis n° 390335 du 1er octobre 2015 précité, pp. 1-2.
88 () Réponse du ministre des affaires étrangères et européennes, publiée au Journal officiel de la République française le 17 février 2009, à la question écrite n° 39197 de Mme Danielle Bousquet, publiée au Journal officiel de la République française le 30 décembre 2008 (XIIIe législature).
89 () Avis n° 390335 du 1er octobre 2015 précité, p. 4.
90 () Idem.
91 () Voir les amendements discutés lors des débats sur le projet de loi portant adaptation du droit pénal à l’institution de la Cour pénale internationale, à l’Assemblée nationale, en commission des Lois (amendements CL 26 de M. Noël Mamère, CL 45 de M. François Vannson et CL 88 de M. Jean-Jacques Urvoas) et en séance publique (amendements n° 17 de M. Noël Mamère, n° 50 de M. Jean-Jacques Urvoas, n° 60 de Mme Françoise Hostalier et n° 65 de M. Jean-Pierre Grand).
92 () Avis de la Commission nationale consultative des droits de l’homme sur le projet de loi portant adaptation du droit pénal à l’institution de la Cour pénale internationale, adopté par l’Assemblée plénière du 6 novembre 2008, p. 2.
93 () Contribution écrite de M. Bruno Cotte annexée au rapport d’information (n° 2778, XIVe législature) précité, p. 272.
94 () Voir le 2 du B du II du rapport d’information (n° 2778, XIVe législature) précité, pp. 93-94.
95 () a du F de l’article 1er de la Convention de Genève de 1951 relative au statut des réfugiés.
96 () Voir l’étude de droit comparé annexée au rapport d’information (n° 2778, XIVe législature) précité, pp. 147-158 et Elisabeth Lambert Abdelgawad et Kathia Martin-Chenut, « La prescription en droit international : vers une imprescriptibilité de certains crimes ? » in Hélène Ruiz Fabri, Gabriele Della Morte, Elisabeth Lambert Abdelgawad, Kathia Martin-Chenut (dir.), La Clémence saisie par le droit. Amnistie, prescription et grâce en droit international et comparé, UMR de droit comparé de Paris, vol. 14, 2007, pp. 121-128.
97 () Articles 24 et 48-2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
98 () Selon l’avis du Conseil d’État n° 387525 du 18 avril 2013, le projet de loi « a pour objet d’instituer, dans la loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de la presse, une infraction sanctionnant des propos publics consistant à nier ou banaliser grossièrement les crimes de génocide et de réduction en esclavage, les autres crimes contre l’humanité et les crimes de guerre ».
99 () Voir la proposition française sur l’encadrement du droit de veto devant le Conseil de sécurité.
100 () Contribution écrite de M. Bruno Cotte annexée au rapport d’information (n° 2778, XIVe législature) précité, p. 272.
101 () Compte rendu de la séance du Sénat du jeudi 1er février 1996, publié au Journal officiel de la République française du vendredi 2 février 1996, consacrée à la discussion du projet de loi tendant à renforcer la répression du terrorisme et des atteintes aux personnes dépositaires de l’autorité publique ou chargées d’une mission de service public et comportant des dispositions relatives à la police judiciaire.
102 () Avis n° 390335 du 1er octobre 2015 précité, p. 4.
103 () En application de l’article 203 du code de procédure pénale, « les infractions sont connexes soit lorsqu’elles ont été commises en même temps par plusieurs personnes réunies, soit lorsqu’elles ont été commises par différentes personnes, même en différents temps et en divers lieux, mais par suite d’un concert formé à l’avance entre elles, soit lorsque les coupables ont commis les unes pour se procurer les moyens de commettre les autres, pour en faciliter, pour en consommer l’exécution ou pour en assurer l’impunité, soit lorsque des choses enlevées, détournées ou obtenues à l’aide d’un crime ou d’un délit ont été, en tout ou partie, recelées ».
104 () Avis n° 390335 du 1er octobre 2015 précité, p. 4.
105 () Cass. crim., 9 mai 1936.
106 () Comme la mise en examen (Cass. crim., 16 octobre 2002, n° 01-88.381), la commission rogatoire (Cass. crim., 12 novembre 2008, n° 08-80.381), l’avis à une partie civile lui notifiant son droit de formuler une demande d’acte ou de présenter une requête en annulation (Cass. crim., 9 juin 1998, n° 96-84.894), l’ordonnance de soit-communiqué saisissant le procureur de la République aux fins de réquisitions sur l’action publique (Cass. crim., 24 juin 1998, n° 98-80.995) ou, plus généralement, « toute ordonnance rendue par le juge d’instruction » (Cass. crim., 10 février 2004, n° 03-87.283).
107 () Comme les procès-verbaux des officiers et agents de police judiciaire tendant à la recherche et à la constatation d’une infraction (Cass. crim., 15 mai 1973, n° 71-93.648), le recueil de la plainte de la victime d’une infraction (Cass. crim., 24 juin 1998, n° 98-80.995), l’interrogation d’un fichier (Cass. crim., 19 juin 2012, n° 11-88.684) ou la réquisition par un officier de police judiciaire tendant à l’inscription au FNAEG d’un profil ADN (Cass. crim., 12 décembre 2012, n° 12-85.274).
108 () Comme l’information ouverte par le réquisitoire aux fins d’informer, quelle que soit la qualification pénale des faits qui sera finalement retenue (Cass. crim., 25 novembre 1969, n° 68-92.669), la citation directe du prévenu à la requête du ministère public devant le tribunal correctionnel (Cass. crim., 20 novembre 1968, n° 68-90.799), la convocation par le procureur de la République d’une personne en vue de l’entendre sur une plainte dont elle est l’objet (Cass. crim., 27 avril 2000, n° 99-81.415), les instructions et mandements délivrés par le procureur de la République aux officiers de police judiciaire (Cass. crim., 16 mai 1973, n° 71-92.496) et, plus généralement, toute réquisition du ministère public, notamment les réquisitions aux fins de mandement de citation (Cass. crim., 28 janvier 1988, n° 86-92.565), à condition que le mandement ait été transmis à l’huissier en vue de sa délivrance avant le terme de l’année de la prescription de la contravention (Cass. crim., 2 septembre 2004, n° 04-81.660).
109 () Comme la citation directe en cas de contravention ou de délit, l’appel formé contre une ordonnance de non-lieu rendue par le juge d’instruction (Cass. crim., 25 janvier 1993, n° 92-83.136) ou la demande de report de l’ordonnance de clôture pour produire des pièces nouvelles dans le cadre de l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 (Cass. civ. 1, 8 avril 2010, n° 09-65.032).
110 () Cass. crim., 1er octobre 2003, n° 03-83.582.
111 () Cass. crim., 9 décembre 1980, n° 80-91.546.
112 () Cass. crim., 14 novembre 1995, n° 94-83.837.
113 () Cass. crim., 20 février 2002, n° 01-85.042.
114 () Cass. crim., 28 juin 2005, n° 05-80.307.
115 () Voir le f du 4 du B du II du rapport d’information (n° 2778, XIVe législature) précité, pp. 113-115.
116 () Cass. crim., 9 juillet 2003, n° 03-82.063.
117 () Cass. crim., 12 octobre 2005, n° 05-80.189.
118 () Cass. crim., 11 juillet 2012, n° 11-87.583.
119 () Cass. crim., 10 mai 1972, n° 71-90.995
120 () Cass. crim., 24 juin 1998, n° 98-80.995.
121 () Cass. crim., 19 juin 2012, n° 11-88.684.
122 () En application du vingt-cinquième alinéa de l’article 41-2 du code de procédure pénale, « [l]es actes tendant à la mise en œuvre ou à l’exécution de la composition pénale sont interruptifs de la prescription de l’action publique ».
123 () En matière de règlement transactionnel pour les contraventions au code de commerce et au code de la consommation, l’avant-dernier alinéa des articles L. 141-2 et L. 216-11 du code de la consommation et le deuxième alinéa de l’article L. 470-4-1 du code de commerce disposent que « [l]’acte par lequel le procureur de la République donne son accord à la proposition de transaction est interruptif de la prescription de l’action publique ».
124 () Sauf en matière électorale, dans laquelle le juge a décidé que l’acte interruptif de la prescription dérogatoire de six mois fait courir non pas une nouvelle prescription abrégée mais la prescription de droit commun (Cass. crim., 3 juin 1986, n° 86-91.301).
125 () En matière criminelle, il serait fixé à vingt ans et en matière délictuelle, à six ans.
126 () Voir le 5 du B du II du rapport d’information (n° 2778, XIVe législature) précité, pp. 116-117.
127 () Contribution écrite de M. Jean-Claude Marin annexée au rapport d’information (n° 2778, XIVe législature) précité, p. 213.
128 () Idem.
129 () En droit interne, le cinquième alinéa du III de l’article préliminaire du code de procédure pénale dispose qu’« [i]l doit être définitivement statué sur l’accusation dont [la] personne [suspectée ou poursuivie] fait l’objet dans un délai raisonnable » et l’article L. 111-3 du code de l’organisation judiciaire prévoit que « [l]es décisions de justice sont rendues dans un délai raisonnable ».
130 () Contribution écrite de M. Bertrand Louvel annexée au rapport d’information (n° 2778, XIVe législature) précité, p. 316.
131 () CEDH, 15 octobre 2002, Vieziez c. France, n° 52116/99.
132 () Avis n° 390335 du 1er octobre 2015 précité, p. 7.
133 () Avis n° 390335 du 1er octobre 2015 précité, p. 8.
134 () Avis n° 390335 du 1er octobre 2015 précité, p. 8.
135 () Cass. crim., 11 juillet 1972, n° 72-90.719 ; 13 novembre 1973, n° 72-91.554 ; 5 juillet 1993, n° 92-82.799.
136 () Cass. crim., 28 octobre 1992, n° 91-84.341 ; 19 décembre 1995, n° 95-80.850 ; 27 mars 2002, nos 00-81.712 et 00-88.111 ; 7 juillet 2005, n° 05-81.119.
137 () Cass. crim., 28 octobre 1992, n° 91-84.341.
138 () Cass. crim., 15 janvier 1990, n° 86-96.469.
139 () Cass. crim., 1er décembre 2004, n° 03-87.883.
140 () Cass. crim., 6 juin 1996, n° 95-85.919.
141 () Cass. crim., 4 mars 1997, n° 96-84.773.
142 () Cass. crim., 18 janvier 2006, n° 05-85.858.
143 () Cass. crim., 19 septembre 2006, n° 05-83.536.
144 () Cass. crim., 15 février 2006, n° 03-84.159.
145 () L’article 382 du code de procédure pénale, relatif à la compétence du tribunal correctionnel, se borne à viser les « délits et contraventions qui forment avec l’infraction déférée au tribunal un ensemble indivisible ».
146 () Cass. crim., 29 juillet 1875, Bull. n° 239.
147 () Cass. crim., 8 février 1895, Bull. n° 54.
148 () Cass. crim., 13 novembre 1969, n° 68-91.862.
149 () Cass. crim., 12 janvier 1972, n° 70-91.562.
150 () Frédéric Desportes, Laurence Lazerges-Cousquer, Traité de procédure pénale, pp. 496-497, Economica, 2009.
151 () Voir le a du 2 du B du I du rapport d’information (n° 2778, XIVe législature) précité, pp. 59-64.
152 () Voir supra, les b des 2 du A du I du présent commentaire d’article.
153 () Voir le a du 2 du B du I du rapport d’information (n° 2778, XIVe législature) précité, pp. 49-52.
154 () Jour du dernier des actes matériels multiples de nature différente constitutifs de l’infraction complexe.
155 () Jour où se réalise le dernier acte matériel identique au premier caractérisant l’infraction d’habitude.
156 () Jour où le résultat se produit.
157 () Jour où l’activité reprochée prend fin en cas d’infraction continuée, consistant en une opération délictueuse unique mise en œuvre sous la forme de plusieurs infractions instantanées à exécution successive, ou d’infraction continue, dont l’acte matériel se prolonge dans le temps en raison de la volonté réitérée de son auteur.
158 () Cass. crim., 4 janvier 1935, Gaz. Pal., 1935, 1, Jur, p. 353.
159 () Cass. crim., 11 février 1981, n° 80-92.059 ; 8 février 2006, n° 05-80.301.
160 () Cass. crim., 7 décembre 1967, n° 66-91.972.
161 () Cass. crim., 10 août 1981, n° 80-93.092.
162 () Cass. crim., 5 mai 1997, n° 96-81.482 ; 27 juin 2001, n° 00-87.414 ; 28 mai 2003, n° 02-83.544.
163 () Contribution écrite de M. Jean-Claude Marin annexée au rapport d’information (n° 2778, XIVe législature) précité, p. 204.
164 () Contribution écrite de M. Didier Boccon-Gibod annexée au rapport d’information (n° 2778, XIVe législature) précité, p. 222.
165 () Contribution écrite de M. Jean Maïa annexée au rapport d’information (n° 2778, XIVe législature) précité, p. 279.
166 () Contribution écrite de Me Dominique Foussard annexée au rapport d’information (n° 2778, XIVe législature) précité, p. 292.
167 () Cass. crim., 19 mai 2004, n° 03-82.329.
168 () Cass. crim., 8 novembre 2005, n° 05-80.370.
169 () Cass. crim., 19 septembre 2006, n° 06-83.963.
170 () Voir le b du 2 du A du II du rapport d’information (n° 2778, XIVe législature) précité, pp. 85-86.
171 () Voir la recommandation n° 5 du rapport d’information (n° 338, session ordinaire de 2006-2007) précité, p. 42.
172 () Avis n° 390335 du 1er octobre 2015 précité, p. 6.
173 () Cass. crim., 4 mars 1997, n° 96-84.773.
174 () Cass. crim., 7 juillet 2005, n° 05-81.119.
175 () Dominique Noëlle Commaret, « Point de départ du délai de prescription de l’action publique : des palliatifs jurisprudentiels, faute de réforme législative d’ensemble », Revue de science criminelle, 2004, p. 897.
176 () Cass. crim., 25 février 2004, n° 03-82.048.
177 () Cass. crim., 14 janvier 2004, n° 03-82.492.
178 () Cass. crim., 5 mai 2004, n° 03-85.503.
179 () Cass. crim., 19 mai 2004, n° 03-86.192.
180 () Cass. crim., 27 juin 2001, n° 00-87.414.
181 () Cass. crim., 16 novembre 2005, n° 05-81.185.
182 () Avis n° 390335 du 1er octobre 2015 précité, p. 6.
183 () « Il ne peut, durant son mandat et devant aucune juridiction ou autorité administrative française, être requis de témoigner non plus que faire l’objet d’une action, d’un acte d’information, d’instruction ou de poursuite. Tout délai de prescription ou de forclusion est suspendu ».
184 () « La détention, les mesures privatives ou restrictives de liberté ou la poursuite d’un membre du Parlement sont suspendues pour la durée de la session si l’assemblée dont il fait partie le requiert ».
185 () « La prescription de l’action publique est suspendue pendant une durée maximum de six mois entre la date de saisine de la commission des infractions fiscales et la date à laquelle cette commission émet son avis ».
186 () « Le cours de la prescription est suspendu, le cas échéant, par la consultation de l’Autorité ».
187 () « [L]’avis de la commission de conciliation et d’expertise douanière doit être notifié aux parties dans un délai maximal de douze mois pendant lequel le cours des prescriptions visées aux articles 351 et 354 du présent code est suspendu ».
188 () « La prescription de l’action publique est suspendue, au profit de la victime, du dépôt de la plainte jusqu’à la réponse du procureur de la République ou, au plus tard, une fois écoulé le délai de trois mois ».
189 () « La procédure prévue au présent article suspend la prescription de l’action publique ».
190 () « Toutefois, si des poursuites ayant entraîné condamnation ont révélé la fausseté du jugement ou de l’arrêt qui a déclaré l’action publique éteinte, l’action publique pourra être reprise ; la prescription doit alors être considérée comme suspendue depuis le jour où le jugement ou arrêt était devenu définitif jusqu’à celui de la condamnation du coupable de faux ou usage de faux ».
191 () Cass. civ., 22 décembre 1959.
192 () Cass. soc., 18 décembre 1991, n° 88-45.083 ; 1er avril 1997, n° 94-43.381.
193 () Rapport de M. Laurent Béteille (n° 83, session ordinaire de 2007-2008) fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d’administration générale sur la proposition de loi de M. Jean-Jacques Hyest portant réforme de la prescription en matière civile, annexe au procès-verbal de la séance du 14 novembre 2007, pp. 43-44.
194 () Cass. ass. plén., 23 décembre 1999, n° 99-86.298.
195 () Cass. crim., 14 juin 1979, n° 78-91.277.
196 () Cass. crim., 28 mars 2000, n° 99-84.367.
197 () Cass. crim., 19 avril 1983, n° 82-92.366.
198 () Cass. crim., 26 septembre 2000, n° 99-86.348.
199 () Cass. crim., 3 décembre 1957, Bull. n° 794.
200 () Cass. crim., 8 août 1994, n° 93-84.847.
201 () Cass. crim., 1er août 1919.
202 () Voir le b du 2 du B du I du rapport d’information (n° 2778, XIVe législature) précité, p. 70.
203 () Cass. crim., 20 juillet 2011, n° 11-83.086.
204 () Cass. ass. plén., 7 novembre 2014, n° 14-83.739.
205 () CA Paris, 19 mai 2014, n° 2013/08837.
206 () Cass. crim., 16 octobre 2013, nos 11-89.002 et 13-85.232.
207 () Elle a jugé, en l’espèce, que « les grossesses de Mme Y..., masquées par son obésité, ne pouvaient être décelées par ses proches ni par les médecins consultés pour d’autres motifs médicaux, que les accouchements ont eu lieu sans témoin, que les naissances n’ont pas été déclarées à l’état civil, que les cadavres des nouveau-nés sont restés cachés jusqu’à la découverte fortuite des deux premiers corps le 24 juillet 2010 et que, dans ces conditions, nul n’a été en mesure de s’inquiéter de la disparition d’enfants nés clandestinement, morts dans l’anonymat et dont aucun indice apparent n’avait révélé l’existence ».
208 () Contribution écrite de M. Jean Danet annexée au rapport d’information (n° 2778, XIVe législature) précité, p. 188.
209 () Voir le e du 4 du B du II du rapport d’information (n° 2778, XIVe législature) précité, p. 112.
210 () Voir supra, le a du 1 du présent D.
211 () Voir supra, le b du 1 du A du I du commentaire de l’article 1er.
212 () Voir supra, les b des 2 des A et B du I du commentaire de l’article 1er.
213 () Voir les propositions nos 4 et 5 du rapport d’information (n° 2778, XIVe législature) précité, pp. 100 et 105.
214 () Sous réserve de la modification portant sur l’imprescriptibilité des crimes de guerre.
215 () Voir infra, le C du présent I.
216 () Voir supra, le II du commentaire de l’article 1er.
217 () Voir l’étude de droit comparé annexée au rapport d’information (n° 2778, XIVe législature) précité, pp. 147-158.
218 () L’article 4 de la Convention des Nations unies du 26 novembre 1968 sur l’imprescriptibilité des crimes de guerre, qui n’a été ni signée, ni ratifiée par la France, prévoit que « [l]es Etats Parties à la présente Convention s’engagent à prendre, conformément à leurs procédures constitutionnelles, toutes mesures législatives ou autres qui seraient nécessaires pour assurer l’imprescriptibilité des crimes visés aux articles premier et 2 de la présente Convention, tant en ce qui concerne les poursuites qu’en ce qui concerne la peine et des crimes contre l’humanité ». L’article 1er de la Convention européenne du 25 janvier 1974 sur l’imprescriptibilité des crimes contre l’humanité et des crimes de guerre, que la France a signée mais pas ratifiée, stipule que « [t]out Etat contractant s’engage à prendre les mesures nécessaires afin que la prescription soit inapplicable à la poursuite des infractions suivantes et à l’exécution des peines prononcées pour de telles infractions ». L’article 29 de la Convention de Rome du 17 juillet 1998 portant statut de la Cour pénale internationale, signée et ratifiée par la France, prévoit, sans autre précision, que « [l]es crimes relevant de la compétence de la Cour ne se prescrivent pas ».
219 () Voir supra, le b du 1 du B du I du commentaire de l’article 1er.
220 () Voir supra, le a du 2 du B du I du commentaire de l’article 1er.
221 () Voir supra, le même a.
222 () Rapport d’information (n° 2778, XIVe législature) précité, p. 105.
223 () Voir supra, le commentaire des articles 1er et 2.
224 () Voir supra.
225 () Ces deux tableaux font état des seules modifications apportées par la proposition de loi aux délais de prescription.