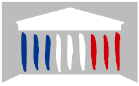N° 3675
______
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 7 avril 2016.
RAPPORT
FAIT
AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES SUR LE PROJET DE LOI visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections pour les entreprises et les actifs,
Par M. Christophe SIRUGUE,
Député.
——
Voir les numéros :
Assemblée nationale : 3600 et 3626.
SOMMAIRE
___
Pages
I. AUDITION DE LA MINISTRE ET DISCUSSION GÉNÉRALE 21
II. AUDITIONS DES PARTENAIRES SOCIAUX PAR LA COMMISSION 73
A. AUDITION DES ORGANISATIONS REPRÉSENTATIVES DES SALARIÉS (CFDT, CFE-CGC, CFTC, CGT, FO) 73
B. AUDITION DES ORGANISATIONS REPRÉSENTATIVES DES EMPLOYEURS (CGPME, MEDEF, UPA) 113
III. EXAMEN DES ARTICLES 147
TITRE PREMIER – REFONDER LE DROIT DU TRAVAIL ET DONNER PLUS DE POIDS À LA NÉGOCIATION COLLECTIVE 147
Chapitre Ier – Vers une refondation du code du travail 147
Article 1er : Commission de refondation et principes essentiels du droit du travail 147
Après l’article 1er 176
Chapitre Ierbis – Renforcer la lutte contre les discriminations, le harcèlement moral et sexuel et les agissements sexistes 182
Article 1erbis (Art. L. 1154-1 du code du travail) : Régime de la preuve en matière de harcèlement 182
Article 1erter (Art. L. 1321-2 du code du travail) : Interdiction des agissements sexistes par le règlement intérieur 184
Article 1erquater (Art. L. 4121-2 du code du travail) : Prise en compte des agissements sexistes dans les actions de prévention 186
Article 1erquinquies (Art. L. 4612-3 du code du travail) : Extension de la compétence des CHSCT aux agissements sexistes 187
Après l’article 1erquinquies 188
Chapitre II – Une nouvelle architecture des règles en matière de durée du travail et de congés 189
Article 2 (Art. L. 1225-9, L. 1263-3, L. 1271-5, L. 1272-4, L. 1273-3, L. 1273-5, L. 1274-2, L. 1522-8, L. 2323-3, L. 2323-17, L. 3111-1 et L. 3111-2, L. 3111-3 [nouveau], L. 3121-1 à L. 3121-48, L. 3121-49 à L. 3121-67 [nouveaux], L. 3122-1 à L. 3122-47, L. 3123-1 à L. 3123-37, L. 3123-38 [nouveau], L. 3131-1 et L. 3131-2, L. 3131-3 [nouveau], L. 3132-28, L. 3133-1 à L. 3133-12, L. 3134-1, L. 3134-16 [nouveau], L. 3141-1 à L. 3141-31, L. 3141-32 et L. 3141-33 [nouveau], L. 3164-4, L. 3171-1, L. 3253-23, L. 3422-1, L. 5125-1, L. 5132-6, L. 5132-7, L. 5134-60, L. 5134-63, L. 5134-126, L. 5221-7, L. 5544-10, L. 6222-25, L. 6325-10, L. 6331-35, L. 6343-2, L. 7122-24, L. 7213-1 et L. 7221-2 du code du travail ; art. L. 431-3, L. 432-2 et L. 433-1 du code de l’action sociale et des familles ; art. 39 du code général des impôts ; art. L. 191-2 du code minier ; art. L. 712-4, L. 712-6, L. 713-2, L. 713-3 à L. 713-5, L. 713-13, L. 713-19, L. 714-5, L. 714-6, L. 714-8 et L. 763-3 du code rural et de la pêche maritime ; art. L. 133-5, L. 133-5-1, L. 241-13, L. 241-3-1, L. 241-18, L. 242-8, L. 242-9 et L. 243-1-3 du code de la sécurité sociale ; art. L. 1321-6, L. 1321-7, L. 1321-10, L. 1821-8-1, L. 3312-1, L. 3312-3, L. 3313-2, L. 4511-1, L. 5544-1, L. 5544-3, L. 5544 8, L. 5544-10, L. 6525-1, L. 6525-3 et L. 6525-5 du code des transports ; art. 43 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011) : Durée du travail 189
Après l’article 2 275
Article 3 (Art. L. 1222-5, L. 3142-1 à L. 3142-116, L. 3142-117 à L. 3142-122 [nouveaux], L. 6313-1, L. 6315-1, L. 7211-3 et L. 7221-2 du code du travail ; art. L. 1114-3 et L. 1432-7-1 du code de la santé publique ; art. L. 161-9-3, L. 168-1, et L. 241-3-2 du code de la sécurité sociale ; art. L. 2123-9, L. 3123-7, L. 4135-7, L. 7125-7 et L. 7227-7 du code général des collectivités territoriales ; art. L. 114-24 du code de la mutualité ; art. L. 423-14 du code de l’action sociale et des familles ; art. L. 5544-25 et L. 6525-5 du code des transports) : Autres congés 276
Article 3 bis (Art. L. 1225-4 et L. 1225-4-1 du code du travail) : Extension de la durée de protection contre le licenciement à l’issue du congé de maternité 302
Article 4 (Art. L. 3151-1, L. 3151-2 à L. 3151-4 [nouveaux], L. 3152-1 à L. 3152-3, L. 3152-4 [nouveau], L. 3153-1 à L. 3154-3 et L. 3334-10 du code du travail ; art. 81, 163 A et 1417 du code général des impôts et art. 18 de la loi n° 2014-873 du 4 août 2014) : Compte épargne-temps 304
Article 5 : Sécurisation des conventions de forfait existantes 310
Article 6 (Art. L. 1321-7 et L. 4511-2 du code des transports) : Travail de nuit dans le domaine fluvial 317
TITRE II – FAVORISER UNE CULTURE DU DIALOGUE ET DE LA NÉGOCIATION 322
Chapitre Ier – Des règles de négociation plus souples et le renforcement de la loyauté de la négociation 322
Article 7 (Art. L. 2222-3, L. 2222-3-1 à L. 2222-3-3 [nouveaux], L. 2222-4, L. 2222-5-1 [nouveau], L. 2231-5-1 [nouveau] et L. 2232-20 du code du travail) : Préambule des accords, méthode et publicité 322
Article 8 (Art. L. 2232-21, L. 2232-22, L. 2232-24, L. 2232-24-1 [nouveau], L. 2261-7, L. 2261-7-1 [nouveau], L. 2261-10, L. 2261-13, L. 2261-14, L. 2261-14-2 à L. 2261-14-4 [nouveaux] du code du travail) : Mécanismes de révision et d’extinction d’un accord 339
Après l’article 8 362
Article 9 (Art. L.2232-22, L. 2322-5, L. 2323-9, L. 2323-26-1 [nouveau], L. 2323-60, L. 2325-14-1, L. 2326-5, L. 2327-15, L. 2392-4 et L. 4616-3 du code du travail) : Ajustements relatifs au fonctionnement des instances représentatives du personnel 363
Après l’article 9 379
Chapitre II – Renforcement de la légitimité des accords collectifs 381
Article 10 (Art. L. 2232-12, L. 2232-13, L. 2231-7 à L. 2231-9, L. 2242-20, L. 2391-1 et L. 7111-9 du code du travail, art. L. 6524-4 du code des transports) : Généralisation des accords majoritaires d’entreprise 381
Après l’article 10 407
Article 11 (Art. L. 2254-2 [nouveau], L. 2323-15 et L. 2325-35 du code du travail) : Accords de préservation ou de développement de l’emploi 410
Après l’article 11 437
Article 12 (Art. L. 2122-4, L. 2232-32 à L. 2232-35, L. 2232-36 à L. 2239 [nouveaux], L. 2253-5 et L. 2253-6 [nouveaux] du code du travail) : Sécurisation des accords de groupe et des accords interentreprises 438
Article 13 (Art. L. 2232-5-1 [nouveau], L. 2232-9 et L. 2261-32 du code du travail) : Missions des branches professionnelles 444
Article 14 (Art. L. 2261-32, L. 2261-33 et L. 2261-34 [nouveaux] du code du travail) : Restructuration des branches professionnelles 450
Chapitre III – Des acteurs du dialogue social renforcés 461
Article 15 (Art. L. 1311-18 [nouveau] et L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales) : Locaux mis à la disposition des syndicats par les collectivités territoriales 461
Après l’article 15 464
Article 16 (Art. L. 2143-13, L. 2143-15 et L. 2143-16 du code du travail) : Augmentation des heures de délégation des délégués syndicaux 465
Après l’article 16 467
Article 17 (Art. L. 4614-13, L. 4614-13-1 et L. 2325-41-1 [nouveaux] du code du travail) : Expertise du CHSCT 471
Après l’article 17 479
Article 18 (Art. L. 1232-12, L. 1442-2, L. 2135-11, L. 2145-1, L. 2145-5 à L. 2145-13 [nouveaux], L. 2212-1 et L. 2212-2 [nouveaux], L. 2325-43, L. 2325-44, L. 3142-7 à L. 3142-15, L. 3341-2, L. 3341-3 du code du travail) : Renforcement de la formation des acteurs de la négociation collective 481
Après l’article 18 488
Article 19 (Art. L. 2151-1, L. 2152-1, L. 2152-4 et L. 2261-19 du code du travail) : Mesure de l’audience patronale 489
Article 20 (Art. L. 2135-12 du code du travail) : Règles d’attribution des crédits du fonds de financement du dialogue social pour les professions du spectacle 501
TITRE III – SÉCURISER LES PARCOURS ET CONSTRUIRE LES BASES D’UN NOUVEAU MODÈLE SOCIAL À L’ÈRE DU NUMÉRIQUE 502
Chapitre Ier – Mise en place du compte personnel d’activité 502
Article 21 (Art. L. 5151-1 à L. 5151-12 [nouveaux], L. 6323-1, L. 6323-2, L. 6323-4, L. 6323-6, L. 6323-7, L. 6323-11-1 [nouveau], L. 6323-24 à L. 6323-31 [nouveaux], L. 6111-6 du code du travail) : Création du compte personnel d’activité 502
Après l’article 21 545
Article 21 bis : Ouverture d’une concertation relative à l’élargissement du compte personnel d’activité 546
Après l’article 21 bis 550
Article 22 : Habilitation à étendre par ordonnance le compte personnel d’activité aux agents publics 550
Article 23 (Art. L. 5131-3 à L. 5131-7 du code du travail) : Renforcement de l’accompagnement des jeunes vers l’emploi et l’autonomie 552
Après l’article 23 562
Article 23 bis : Rapport relatif à l’évaluation des emplois d’avenir 564
Article 24 (Art. L. 3243-2 du code du travail) : Dématérialisation du bulletin de paie 565
Chapitre II – Adaptation du droit du travail à l’ère du numérique 569
Article 25 (Art. L. 2248-2 du code du travail) : Modalités d’exercice du droit à la déconnexion 569
Article 26 : Ouverture d’une concertation relative au travail à distance et à l’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle 578
Après l’article 26 588
Article 27 (Art. L. 2142-6, L. 2324-19 et L. 2314-21 du code du travail) : Adaptation du dialogue social aux pratiques numériques 588
Article 27 bis (Art. L. 7341-1 à L. 7341-6 [nouveaux] du code du travail) : Définition de la responsabilité sociale des plateformes en ligne 592
TITRE IV – FAVORISER L’EMPLOI 594
Chapitre Ier – Faciliter la vie des TPE et des PME et favoriser l’embauche 594
Avant l’article 28 594
Article 28 (Art. L. 5143-1 [nouveau] du code du travail) : Droit à l’information des employeurs des entreprises de moins de 300 salariés 595
Après l’article 28 606
Article 28 bis (Art. L. 131-4-4 [nouveau] du code de la sécurité sociale) : Exonération de cotisations sociales sur les avantages et cadeaux accordés aux salariés par l’employeur 610
Après l’article 28 bis 611
Article 29 (Art. L. 2232-10-1 [nouveau] du code du travail) : Accords types de branche 612
Article 29 bis (Art. 39 du code général des impôts) : Provision pour risque pour les entreprises de moins de cinquante salariés 618
Après l’article 29 bis 622
Article 30 (Art. L. 1233-3, L. 1233-3-1 [nouveau] et L. 1233-3-2 [nouveau] du code du travail) : Motif économique de licenciement 623
Après l’article 30 656
Article 31 : Ratification de l’ordonnance relative aux garanties consistant en une prise de position formelle, opposable à l’administration, sur l’application d’une norme à la situation de fait ou au projet du demandeur 660
Chapitre II – Renforcer la formation professionnelle et l’apprentissage 661
Article 32 : (Art L. 6241-5, L. 6241-9, L. 6242-6 et L. 6332-16 du code du travail) Apprentissage 661
Après l’article 32 665
Article 33 : Adaptation expérimentale du contrat de professionnalisation pour les demandeurs d’emploi 670
Article 34 (Art. L. 335-5, L. 613-3, L. 613-4 du code de l’éducation et art. L. 6315-1 et L. 6422-2 du code du travail) : Assouplissement de la validation des acquis de l’expérience (VAE) 672
Article 35 (Art. L. 6323-16 du code du travail) : Sécurisation des listes des formations éligibles au compte personnel de formation (CPF) 677
Article 36 (Art. L. 6111-7, L. 6111-8 [nouveau] et L. 6353-10 [nouveau] du code du travail) : Information et évaluation des formations 681
Article 37 (Art. L. 6111-7, L. 6111-8 [nouveau] et L. 6353-10 [nouveau] du code du travail) : Recrutement d’agents contractuels par les groupements d’établissements (GRETA) et les établissements d’enseignement supérieur 684
Chapitre III – Préserver l’emploi 688
Article 38 (Art. L. 1254-9, L. 1255-11, L.1255-14 à L. 1255-16, L. 1255-17 et L. 1255-18 [nouveaux] et L. 5132-14 du code du travail, art. L. 5542-51 du code des transports, ordonnance n° 2015-380 du 2 avril 2015 relative au portage salarial) : Portage salarial 688
Article 39 (Art. L. 1242-2, L. 1242-7, L. 1244-1, L. 1244-2, L. 1244-4, L. 1251-6, L. 1251-11, L. 1251-37, L. 1251-60, L. 2412-2 à L. 2412-4, L. 2412-7 à L. 2412-9, L. 2412-13, L. 2421-8-1, L. 5135-7 et L. 6321-13 du code du travail) : Emploi saisonnier 694
Après l’article 39 697
Article 40 (Art. L. 1253-24 du code du travail) : Groupement d’employeurs 699
Après l’article 40 701
Article 40 bis (Art. L. 1253-19 du code du travail) : Constitution des groupements d’employeurs « mixtes » sous la forme de sociétés coopératives 702
Article 41 (Art. L. 1233-24-2, L. 1233-57-19, L. 1233-61 et L. 1233-62 du code du travail) : Transfert d’entités économiques 703
Après l’article 41 710
Article 41 bis (Art. L. 1233-71 du code du travail) : Rectification d’une erreur matérielle 712
Article 42 (Art. L. 1233-85 et L. 1233-90-1 [nouveau] du code du travail) : Revitalisation des bassins d’emplois 712
Article 43 (Art. 28 de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion) : Accès aux formations du CNFTP pour les salariés en contrat d’accompagnement dans l’emploi dans les collectivités territoriales 717
Après l’article 43 721
TITRE V – MODERNISER LA MÉDECINE DU TRAVAIL 721
Article 44 (Art. L. 1225-11, L. 1225-15, L. 1226-2, L. 1226-2-1 [nouveau], L. 1226-8, L. 1226-10, L. 1226-12, L. 1226-15, L. 1226-20, L. 1226-21, L. 3122-45, L. 4622-3, L. 4624-1 à L. 4624-10, L. , L. 4625-1-1 [nouveau] du code du travail et article L. 717-2 du code rural et de la pêche maritime) : Réforme de la médecine du travail 721
Après l’article 44 759
TITRE VI – RENFORCER LA LUTTE CONTRE LE DÉTACHEMENT ILLÉGAL 761
Article 45 (Art. L. 1262-4-1, L. 1262-4-4 [nouveau], L. 1264-1 et L. 1264-2 du code de travail) : Renforcement des obligations des maîtres d’ouvrage et des donneurs d’ordre lorsque ceux-ci ont recours à des prestataires établis à l’étranger 761
Après l’article 45 770
Article 46 (Art. L. 1262-4-5 [nouveau] du code du travail) : Création d’une contribution visant à compenser les coûts administratifs liés à la création d’un système de déclaration dématérialisé 771
Article 47 (Art. L. 1263-3, 1263-4-1 [nouveau], L. 1263-5 et L. 1263-6 du code du travail) : Application de la mesure administrative de suspension temporaire d’activité d’un prestataire étranger en cas d’absence de déclaration de détachement 774
Article 48 (Art. L. 1263-4 nouveau du code du travail) : Transposition de l’article 15 de la directive 2014/67/UE relative au recouvrement des sanctions prononcées par les autres États-membres à l’encontre d’entreprises françaises 779
Article 49 (Art. L. 1263-1 et L. 8271-3 du code du travail) : Élargissement de l’accès aux données issues des déclarations de détachement et aux établissements inspectés pour les interprètes assermentés 784
Article 50 (Art. L. 1263-3 et L. 4231-1 du code du travail) : Application de la suspension de la prestation de service internationale aux activités régies par le code rural et de la pêche maritime 789
Article 50 bis (Art. L. 1262-2 du code du travail) : Égalité de traitement entre travailleurs intérimaires détachés et travailleurs intérimaires locaux 791
TITRE VII – DISPOSITIONS DIVERSES 792
Article 51 (Art. L. 1233-30, L. 1253-6, L. 1263-3, L. 1263-6, L. 2143-7, L. 2313-11, L. 2314-10, L. 2315-12, L. 2323-18, L. 2323-24, L. 2324-8, L. 2324-12, L. 2325-19, L. 2326-5, L. 2392-2, L. 3121-7, L. 3121-36, L. 3122-23, L. 3123-2, L. 3171-3, L. 3172-1, L. 3221-9, L. 4132-3, L. 4154-2, L. 4311-6, L. 4526-1, L. 4612-7, L. 4613-1, L. 4614-11, L. 4614-8, L. 4616-2, L. 4624-3, L. 4711-3, L. 4721-1, L. 4721-2, L. 4721-4, L. 4721-5, L. 4744-7, L. 5213-5, L. 5424-16, L. 6225-4, L. 6361-5, L. 6363-1, L. 7122-18, L. 7232-9, L. 7413-3, L. 7421-2, L. 7424-3, L. 8112-3, L. 8113-1 à L. 8113-5, L. 8113-8, L. 8114-2, L. 8123-1, L. 8123-6, L. 8223-1-1, L. 8271-1-2, L. 8271-14, L. 8271-19 et L. 8291-2 du code du travail ; articles L. 1324-10, L. 5243-2-3, L. 5544-18, L. 5544-31, L. 5548-1 à L. 5548-4 et L. 5641-1 du code des transports) : Prolongation du plan de transformation des emplois de contrôleurs du travail en inspecteurs du travail 792
Article 52 (Art. L. 5426-1-1, L. 5426-8-1 et L. 5426-8-2 du code du travail) : Renforcement des sanctions en cas de versement indu de prestations d’assurance-chômage 797
Article 53 (nouveau) (Art. L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1235-4 et L. 1235-5 du code du travail) : Obligation pour l’entreprise de rembourser à Pôle emploi les indemnités chômage versées en cas de licenciement lié à un traitement discriminatoire ou à un harcèlement moral ou sexuel 806
Article 54 (nouveau) (Art. L. 1235-3-1[nouveau] du code du travail) : Versement d’une indemnité qui ne peut être inférieure à six mois en cas de licenciement lié à un traitement discriminatoire ou en raison de faits de harcèlement sexuel 807
Après l’article 54 808
Titre 809
ANNEXE 1 : LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES PAR LE RAPPORTEUR 811
ANNEXE 2 : LISTE DES CONTRIBUTIONS ÉCRITES ADRESSÉES AU RAPPORTEUR 815
PRINCIPAUX APPORTS DE LA COMMISSION
Lors de ses réunions du mardi 5 avril, du mercredi 6 avril et du jeudi 7 avril 2016, la commission des affaires sociales a adopté le projet de loi relatif à l’institution de nouvelles libertés et de nouvelles protections pour les entreprises et les actifs. La Commission y a apporté les principales modifications suivantes :
– à l’article 1er, la Commission a, à l’initiative du rapporteur, souhaité encadrer le travail de la commission de refondation du code du travail, en prévoyant d’une part que celle-ci procéderait à une refonte à droit constant s’agissant des règles qui auront vocation à s’appliquer de manière supplétive, et d’autre part, qu’elle remettrait ses conclusions au plus tard le 1er juillet 2018. En conséquence de la mise en place de cette obligation de principe de refonte à droit constant, la Commission a supprimé les 61 principes fondateurs censés encadrer les travaux de la commission de refondation.
– après l’article 1er, la Commission a adopté quatre amendements présentés par des membres de la Délégation aux droits des femmes afin, notamment, de mieux lutter contre les agissements sexistes au travail.
– après l’article 3, la Commission a adopté deux amendements identiques de Mme Dominique Orliac et ses collègues, et de la commission des affaires économiques, afin d’introduire dans le projet de loi les dispositions de la proposition de loi n° 2927 de Mme Dominique Orliac, visant à étendre la durée de la période légale de protection contre le licenciement des mères à l’issue de leur congé de maternité. Cette proposition de loi avait été adoptée en première lecture par l’Assemblée nationale, à l’unanimité, le 10 mars dernier.
– sur proposition du rapporteur, la Commission a adopté deux amendements visant respectivement à préciser que tout signataire peut s’opposer à la publication d’un accord collectif, et à reporter au 1er septembre 2017 les nouvelles modalités de publication des accords collectifs (article 7) ;
– la Commission a adopté deux amendements du rapporteur visant à reporter au 1er janvier 2017 l’entrée en vigueur des nouvelles règles de validité des accords portant sur la durée du travail, les repos et les congés, et à substituer à la généralisation des accords majoritaires au 1er septembre 2019, un rapport d’évaluation de l’application des nouvelles règles de majorité aux accords portant sur la durée du travail, les repos, les congés ainsi que les accords de préservation ou de développement de l’emploi (article 10) ;
– sur proposition du rapporteur, la Commission a adopté trois amendements à l’article 11 visant à préciser les modalités de négociation des accords de préservation ou de développement de l’emploi, ainsi que quatre amendements encadrant le contenu type d’un tel accord ;
– la Commission a adopté deux amendements présentés par le rapporteur visant à préciser les modalités de contestation du coût de l’expertise décidée par le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) (article 17) ;
– à l’initiative du rapporteur, la Commission a inscrit dans le texte le principe de fongibilité des droits, destiné à garantir la conversion des droits figurant sur le compte personnel d’activité (article 21) ;
– sur proposition de M. Yves Blein, rapporteur de la commission des affaires économiques, la commission des affaires sociales a adopté deux amendements visant à maintenir le compte personnel d’activité ouvert jusqu’au décès de son titulaire (article 21) ;
– à l’initiative du rapporteur, la Commission a adopté un amendement renvoyant à la négociation entre partenaires sociaux l’élargissement du compte personnel d’activité à des dispositifs supplémentaires (article 21 bis) ;
– la Commission a adopté un amendement du rapporteur complétant le droit à la déconnexion par un « devoir de déconnexion », c’est-à-dire la mise en place par l’entreprise de dispositifs de régulation de l’usage des outils numériques (article 25) ;
− la Commission a également adopté, sur proposition du rapporteur et de M. Yves Blein, deux amendements identiques permettant à une entreprise de moins de trois cents salariés d’attester de sa bonne foi en cas de contentieux, dès lors qu’elle a suivi les démarches et les procédures prescrites par l’administration pour faire face à une situation donnée (article 28) ;
– sur proposition du rapporteur, la Commission a adopté trois amendements proposant une importante réécriture de l’article 30 relatif à la définition du motif économique du licenciement. Elle a ainsi supprimé le renvoi à la négociation collective et, à défaut d’accord, à des dispositions supplétives pour déterminer les difficultés économiques d’une entreprise, en redonnant à la définition de ces difficultés un caractère d’ordre public. S’agissant de la définition des difficultés économiques, elle a maintenu le caractère mécanique d’un seul des indicateurs retenus par le projet de loi, celui de la baisse des commandes et du chiffre d’affaires pendant une durée déterminée : en conséquence, la Commission a introduit une différenciation de la durée exigée en fonction de la taille des entreprises. Les autres critères, auxquels la Commission a ajouté la dégradation de l’excédent brut d’exploitation, feront l’objet d’une appréciation du juge, qui continuera à se prononcer sur leur ampleur.
– sur proposition du rapporteur, la Commission a adopté un amendement permettant à Pôle emploi de disposer des informations relatives aux entrées, sorties et interruptions de formations des stagiaires de la formation professionnelle (article 36).
– sur proposition du rapporteur, la Commission a adopté une série d’amendements tendant à maintenir la notion d’emploi pour l’appréciation du reclassement des salariés déclarés inaptes et à revenir au droit en vigueur s’agissant des possibilités de reclassement (article 44).
– à l’initiative de Mme Catherine Coutelle, la Commission a adopté un amendement qui étend aux licenciements fautifs résultant de discrimination ou de harcèlement l’obligation pour l’employeur de rembourser à Pôle Emploi les indemnités versées par la victime (article 53).
– à l’initiative de Mme Catherine Coutelle, la Commission a adopté un amendement qui fixe un plancher d’indemnisation en cas de licenciement fautif lié à une discrimination, à des faits de harcèlement sexuel ou à une maternité (article 54).
Le projet de loi Instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections pour les entreprises et les actifs s’inscrit dans une logique selon laquelle le droit du travail doit à la fois garantir les droits essentiels des salariés et être au service de la performance des entreprises.
Il s’inscrit ainsi dans la continuité des lois votées depuis 2012 dans le domaine du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle – loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi, loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale et loi du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi.
Ces lois poursuivent un même objectif : moderniser notre système de relations collectives et individuelles du travail, afin de permettre à nos entreprises de s’adapter à un monde du travail de plus en plus mouvant, tout en maintenant et même en renforçant les protections couvrant l’ensemble des actifs. Le recours au dialogue social, synonyme de confiance entre les partenaires sociaux et les pouvoirs publics − confiance sans laquelle il ne saurait y avoir de progrès économique et social − est un fil conducteur de ces différentes lois.
Le présent projet de loi ajoute sa contribution à ce corpus législatif déjà riche, tout en portant en lui-même le terreau d’une réforme bien plus ambitieuse : celle de la modernisation de l’architecture du code du travail. Car rendre le droit du travail plus intelligible à la fois pour les salariés, pour leurs représentants et pour les entreprises, est un préalable indispensable pour redonner de la confiance à l’ensemble de ces acteurs.
Repenser l’architecture du code du travail implique néanmoins de ne pas perdre de vue les principes fondateurs de notre droit du travail, d’où l’intérêt qu’il faut accorder aux travaux de la commission présidée par M. Robert Badinter, qui a permis de dégager 61 principes essentiels à notre droit du travail.
L’ambition qui préside à la refondation du code du travail suppose également de repenser les règles d’articulation entre la loi et la négociation collective, l’articulation entre les différents niveaux de négociation, voire même l’articulation entre l’accord collectif et le contrat de travail. C’est dans cette perspective que le projet de loi donne autant que possible la priorité à la négociation collective, à tous les niveaux, car le Gouvernement, comme le rapporteur, sont convaincus que c’est au plus près du terrain que l’organisation et les conditions de travail sont le mieux définies.
Cette priorité donnée à la négociation collective suppose toutefois que les partenaires sociaux appelés à négocier, à réviser ou à dénoncer des accords collectifs soient investis d’une légitimité incontestable, ce qui justifie le renforcement, par le projet de loi, des moyens mis à leur disposition pour se former et pour exercer leurs mandats.
Le renforcement de la négociation collective devra également composer avec l’évolution de notre société, qui fait naître, notamment chez les jeunes, de nouvelles aspirations à l’autonomie : la généralisation de la « garantie jeunes » ou l’instauration d’un « droit à la déconnexion », sont autant de mesures fortes qui démontrent la volonté du Gouvernement de tenir compte de ces aspirations nouvelles.
Les mutations de l’économie, qui se traduisent depuis plusieurs années par la place accrue des services − secteur où les divergences sont les plus criantes entre l’organisation effective du travail et les règles sociales bâties initialement pour l’industrie − mais surtout par la place croissante du numérique, nous promettent par ailleurs des bouleversements dont personne n’est encore capable de mesurer les incidences futures. Le projet de loi s’efforce donc de répondre aux nouvelles attentes à l’égard de la sécurisation des parcours professionnels nées de ces mutations récentes, un effort qui se traduit notamment par la mise en place du compte personnel d’activité ou l’extension du compte personnel de formation aux non-salariés. Tout l’enjeu est de garantir la préservation des droits acquis sans créer de nouveaux obstacles aux changements de statut et d’emploi. À terme, c’est le fonctionnement même de notre système de protection sociale qui en ressortira transformé.
Par ailleurs, dans ce tissu économique de plus en plus mouvant, tous les instruments susceptibles de permettre aux entreprises de préserver ou de favoriser l’emploi doivent être mis à leur disposition : telle est la logique qui conduit à la création des accords de préservation ou de développement de l’emploi, mais aussi à des mesures visant à améliorer le recours au portage salarial, à l’emploi saisonnier ou encore aux groupements d’employeurs.
Le projet de loi met également un point d’honneur à favoriser les mesures en faveur des très petites et des petites et moyennes entreprises (TPE-PME), en veillant notamment à améliorer la prévisibilité des normes qui leur sont applicables et à leur apporter un soutien spécifique de la part de l’État et des branches professionnelles.
Le texte poursuit ensuite la réforme de la médecine du travail confrontée au défi démographique. Il maintient le principe du suivi individuel de l’état de santé des salariés, tout en recentrant les missions du médecin du travail sur les salariés pour lesquels un suivi particulier s’impose en raison de l’état de santé ou des risques encourus.
Enfin, le projet de loi complète l’arsenal législatif pour lutter contre le détachement illégal, prolonge le plan de transformation des corps de l’inspection du travail et donne plus de prérogatives à Pôle Emploi en cas de trop-perçus d’indemnités chômage.
L’article 1er propose d’instaurer une commission chargée de rendre plus intelligibles le code du travail tout en privilégiant les accords collectifs comme principale source du droit du travail.
Le projet de loi prévoyait que la commission devait s’appuyer sur les principes essentiels du droit du travail dégagés par la commission présidée par M. Robert Badinter. Ces principes sont tous issus du droit aujourd’hui applicable et se trouvent déjà inscrits dans des textes de niveau constitutionnel, conventionnel ou législatif. La volonté du rapporteur de faire travailler la commission créée à droit constant – c’est au législateur qu’il revient en effet de faire évoluer le droit – rend cependant inutile d’encadrer ses travaux par des principes. Ceux-ci restent toutefois fondamentaux pour la bonne intelligibilité du droit du travail et trouveront naturellement leur place à l’issue du processus de refondation engagé.
Comme on l’a vu, le renforcement du dialogue social sous toutes ses formes est l’un des axes directeurs de ce projet de loi. Le rapporteur est en effet convaincu que la négociation collective, au travers de laquelle s’exerce le dialogue social, peut également être un levier de performance pour les entreprises.
Les différentes mesures visant à insuffler un nouveau souffle à la négociation collective s’inspirent notamment du rapport de M. Jean-Denis Combrexelle, conseiller d’État et ancien Directeur général du travail, dont la lettre de mission invitait à réfléchir sur « l’élargissement de la place de l’accord collectif dans notre droit du travail et la construction de normes sociales », afin « de faire une plus grande place à la négociation collective et en particulier à la négociation d’entreprise, pour une meilleure adaptabilité des normes aux besoins des entreprises ainsi qu’aux aspirations des salariés ».
Il s’agit ainsi de donner, autant que faire se peut, la priorité et la primauté au niveau de l’entreprise, par l’application d’un principe de subsidiarité que le projet de loi traduit d’ores et déjà dans le code du travail, pour l’ensemble des dispositions relatives à la durée du travail, aux congés, ainsi qu’au compte épargne-temps.
La primauté de l’accord d’entreprise sur l’accord de branche consacre une démarche initiée il y a un peu plus de dix ans, et qui a consisté à dynamiser le dialogue social de proximité pour répondre aux besoins de souplesse des entreprises. Ce besoin de rapprocher le niveau de production de la norme conventionnelle de la vie quotidienne des entreprises est particulièrement évident s’agissant du temps de travail.
La démarche ne peut néanmoins être généralisée : il reste bien sûr des sujets pour lesquels le rôle de régulation sociale et économique de la branche ne saurait être écarté. C’est le cas par exemple en matière de travail à temps partiel, et c’est pourquoi le projet de loi maintient sur ce point le principe d’une primauté de l’accord de branche, les accords d’entreprise ne pouvant prévoir que des dispositions plus favorables.
Compte tenu de la diversité des sujets ayant vocation à être abordés par la voie du dialogue social dans l’entreprise, il va de soi que ces accords devront être marqués d’une légitimité incontestable : c’est ce raisonnement qui sous-tend l’extension des accords majoritaires d’entreprise proposée par le projet de loi.
Appliquée dans un premier temps aux seuls accords relatifs à la durée du travail, au repos et aux congés, ainsi qu’aux accords en faveur de l’emploi, l’obligation d’obtenir la signature de l’accord par la majorité des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise permettra d’assurer une pleine légitimité des accords ainsi négociés. Afin d’éviter toute paralysie du dialogue social lorsque la majorité s’avère difficile à obtenir, l’accord majoritaire est néanmoins complété d’une procédure de consultation directe des salariés permettant aux syndicats signataires de l’accord et représentant plus de 30 % des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles, de faire valider le projet d’accord.
Le renforcement du champ d’action de l’accord d’entreprise ne doit pas faire oublier les autres niveaux de négociation collective. En premier lieu, la branche professionnelle demeure, pour de nombreux secteurs d’activité, l’épicentre de la négociation collective. Elle joue également un rôle primordial en matière de régulation de la concurrence entre les entreprises d’un même secteur d’activité et de soutien aux très petites, petites et moyennes entreprises, un rôle qui est en conséquence réaffirmé par le projet de loi. Ce dernier envisage également d’accélérer le mouvement de restructuration des branches autour de deux cents branches – contre environ sept cents à ce jour – afin de renforcer l’efficacité de leur action. La sécurisation des accords de groupe et des accords interentreprises proposée en second lieu par le texte répond également au souhait d’encourager la négociation collective au niveau le plus pertinent.
Redorer le blason de la négociation collective suppose ensuite que les accords qui en résultent gagnent en intelligibilité ; car dans la mesure où les normes conventionnelles sont conduites à s’appliquer à de nouveaux pans de l’organisation du travail, cela suppose que l’ensemble des salariés et leurs représentants soient en mesure d’avoir connaissance de cette norme, de l’interpréter, voire de la dénoncer lorsqu’elle est devenue obsolète.
Le projet de loi s’efforce en conséquence de consolider les outils permettant d’améliorer la compréhension et la publicité des accords collectifs, grâce à l’instauration d’un « contenu-type » pour les accords collectifs, qui devront désormais contenir un préambule et des clauses de réexamen. Pour que chacune des parties autour de la table des négociations maîtrise les « règles du jeu » de la négociation collective, le projet de loi encourage également la conclusion d’accords de méthode.
La révision de l’architecture des accords collectifs s’accompagne par ailleurs d’une rénovation de leurs règles de révision et de dénonciation, dernière étape de la réforme de la représentativité syndicale proposée par la loi du 20 août 2008, qui vise à ouvrir les possibilités de mise en cause d’un accord à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives à un moment « t », et non plus aux seules organisations signataires de l’accord.
Le projet de loi intègre pleinement, par ailleurs, la nouvelle réalité du marché du travail et de l’emploi en procédant à un renforcement inédit des outils de sécurisation des parcours professionnels. Les mutations du marché du travail, la discontinuité des trajectoires professionnelles et la mise à l’épreuve du modèle salarial rendent indispensable d’adapter notre système de droits sociaux et professionnels et de les rattacher à la personne et non plus au statut ou au métier.
Le texte en tire toutes les conséquences en posant les fondements du compte personnel d’activité (CPA), dispositif construit autour d’un noyau dur de trois comptes destinés à faciliter l’accès aux droits. Le rapporteur appuie la démarche pragmatique du Gouvernement et insiste sur la nécessité de réfléchir dès à présent sur les dispositifs pouvant y être intégrés demain. Au-delà de son périmètre initial, le CPA a vocation à devenir le point d’accès à l’information sur l’ensemble des droits sociaux et au bulletin de paie dématérialisé qu’encourage le projet de loi. À ce titre, et dans la lignée de l’ouverture du compte personnel de formation (CPF) aux non-salariés, le CPA devra être progressivement universalisé et intégrer notamment les agents publics afin de garantir la préservation des droits tout au long du parcours professionnel.
Le rapporteur appuie, par ailleurs, l’attention particulière accordée aux jeunes et aux salariés sans qualification, placés au cœur de la démarche de qualification et de sécurisation de l’emploi. La généralisation de la « garantie jeunes », le financement d’une durée complémentaire de formation qualifiante pour les jeunes décrocheurs et l’alimentation renforcée du CPF des salariés sans qualification s’inscrivent dans cette démarche et participeront à l’objectif de sécurisation des parcours porté par le projet de loi.
Enfin, afin de renforcer l’accès aux droits, la validation des acquis de l’expérience est également facilitée. En effet, un an suffira pour y prétendre, au lieu de trois précédemment.
Le projet de loi contient également un ensemble cohérent de mesures orientées vers un objectif commun : le soutien à l’emploi.
Il comporte tout d’abord des mesures spécifiques en faveur des très petites et des petites et moyennes entreprises (TPE-PME) afin de remédier au relatif hermétisme du droit du travail. Le service d’appui de l’État aux TPE-PME en amont du contentieux et la mise en place des accords types de branche participent pleinement à cette démarche et permettront de réduire le poids des contraintes formelles et les incertitudes quant au droit en vigueur.
Il adapte, ensuite, notre code du travail à certaines formes d’emploi nécessitant un encadrement spécifique. Le texte proposé vise ainsi à sécuriser l’encadrement légal du portage salarial, à clarifier le régime des emplois saisonniers et à faire bénéficier les groupements d’employeurs des aides à l’emploi. Ces mesures devront permettre d’encourager le recours à ces formes d’emploi tout en clarifiant et en adaptant leur cadre juridique.
Pour donner aux entreprises la souplesse dont elles ont besoin pour conquérir un marché ou anticiper des difficultés, le projet de loi crée par ailleurs un nouveau type d’accord d’entreprise leur permettant d’ajuster temporairement l’organisation du travail, afin de poursuivre sans équivoque l’objectif de préservation ou de développement de l’emploi qu’elles se sont fixées.
Ce texte poursuit enfin l’objectif de donner davantage de lisibilité aux entreprises sur le plan juridique, en particulier aux plus petites d’entre elles, qui ne bénéficient souvent pas d’un conseil juridique suffisant et sont donc peu armées pour faire face à certains obstacles : c’est le cas notamment en cas de difficultés économiques, pour une entreprise amenée à faire face à un plan de licenciement.
Afin de permettre aux entreprises de mieux anticiper sur les conséquences potentielles d’un licenciement économique, le projet de loi propose de clarifier la définition des difficultés économiques qui rendent possible le recours à ce motif de licenciement, tout en revenant sur une interprétation jurisprudentielle large du périmètre d’évaluation de ces difficultés en présence d’un groupe exerçant ses activités à l’international.
Le souci d’offrir aux entreprises une meilleure lisibilité et une plus grande capacité d’anticipation en la matière ne saurait toutefois conduire à définir les critères présidant au licenciement économique de manière strictement mécanique : il est essentiel que le juge puisse conserver en aval une marge de manœuvre suffisante pour estimer la réalité et l’ampleur des difficultés économiques rencontrées, qui correspondent bien au caractère « réel » et « sérieux » du licenciement.
Par ailleurs, il est également important que la recherche d’une plus grande attractivité du territoire national pour les grands groupes internationaux n’interdise pas de juger invalides des licenciements qui sont le fait de groupes par ailleurs florissants économiquement.
En somme, le projet de loi pose les fondements d’un droit du travail rénové et adapté aux nouvelles réalités économiques. En faisant de la négociation collective un facteur de développement et de dialogue, il protège à la fois les droits des salariés et la compétitivité des entreprises et s’oriente en ce sens résolument vers le progrès économique et social.
La Commission procède à l’audition de Mme Myriam El Khomri, ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, sur le projet de loi visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections pour les entreprises et les actifs lors de sa séance du mardi 29 mars 2016.
Mme la présidente Catherine Lemorton. Je souhaite la bienvenue à Mme Myriam El Khomri, ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, que nous allons entendre sur le projet de loi visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections pour les entreprises et les actifs. Rarement un projet de loi aura fait autant parler de lui alors qu’il n’en était qu’au stade de l’avant-projet. Il était attendu pour de multiples raisons et peut-être est-il redouté par certains.
Demain matin, nous auditionnerons les syndicats de salariés et, demain après-midi, après les questions d’actualité, les organisations représentatives des employeurs.
La commission des affaires économiques s’est saisie pour avis de ce texte et a désigné Yves Blein rapporteur pour avis. Elle examinera ce projet de loi lundi après-midi, 4 avril. Pour notre part, nous commencerons l’examen des articles de ce texte le mardi 5 avril, examen qui se poursuivra toute la semaine.
Mme Myriam El Khomri, ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social. Je me réjouis de me retrouver devant vous pour une discussion constructive sur le projet de loi que je porte et qui a en effet suscité de nombreux débats avant même qu’il ne soit présenté. Le texte a été présenté jeudi dernier en conseil des ministres, et nous pouvons désormais en débattre sereinement.
Le délai supplémentaire que nous nous sommes donné a permis d’apporter les ajustements nécessaires issus des concertations avec l’ensemble des partenaires sociaux et des organisations de jeunesse. D’ailleurs, les syndicats représentant la majorité des salariés – je pense notamment à la Confédération française démocratique du travail (CFDT), à l’Union nationale des syndicats autonomes (UNSA), à la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) et à la Confédération générale des cadres (CGC) – ont salué ces avancées.
Ce nouveau texte trouve aujourd’hui son équilibre au service d’une double ambition : réformer profondément notre droit du travail en donnant beaucoup plus de place à la négociation collective, afin de développer l’emploi, d’améliorer la compétitivité de notre économie et de mieux protéger les salariés ; revivifier notre modèle social grâce au compte personnel d’activité (CPA) qui apporte de nouvelles protections, en particulier pour les salariés et les indépendants les plus fragiles.
Depuis la remise du rapport Combrexelle il y a quelques mois, j’ai rencontré l’ensemble des partenaires sociaux. J’aborde le débat parlementaire avec beaucoup d’enthousiasme, et je précise à l’ensemble des députés ici présents, ainsi qu’à ceux qui ne sont pas membres de la commission des affaires sociales, que je suis à leur entière disposition pour prolonger les échanges, afin que ce travail d’enrichissement se poursuive, sans en dénaturer la philosophie.
Des désaccords peuvent exister ; ils sont légitimes. Certains doivent pouvoir se surmonter ou du moins s’atténuer. Je suis en tout cas certaine que nous saurons nous retrouver sur certains constats et sur la nécessité de ne pas nous en accommoder. On a parfois parlé de « préférence française pour le chômage ». Le fait est là : nous restons invariablement confrontés à un chômage de masse depuis plus de trente ans – nous ne sommes jamais passés sous la barre des 8 % – et nous créons aujourd’hui moins d’emplois que nos voisins européens, même si nous avons créé 100 000 emplois en 2015 après plusieurs années de destructions d’emplois.
Le monde du travail connaît chez nous une segmentation très forte, reléguant une grande partie de nos concitoyens à ses marges. Plus de 750 000 personnes sont aujourd’hui dans une spirale infernale, faite de chômage, d’intérim et de contrats très courts. Pour ces personnes, l’hyper-précarité est une réalité quotidienne et durable.
Pour un nombre croissant de jeunes, l’horizon du contrat à durée indéterminée (CDI) confine parfois au mirage. En vingt ans, l’âge moyen d’accès au premier CDI est passé de vingt-deux à vingt-sept ans.
Pour toutes ces raisons, pour toutes ces personnes, il nous revient d’agir avec la plus grande détermination.
Permettez-moi tout d’abord de revenir en quelques mots sur la philosophie de ce texte. Je crois que c’est essentiel avant d’évoquer plus précisément les principales mesures qui en constituent l’architecture.
Ce projet s’inscrit dans la continuité et la cohérence de l’action gouvernementale depuis le début du quinquennat. Depuis 2012, en effet, les lois successives dans le domaine du travail poursuivent la même finalité : renforcer le dialogue social et le rôle des partenaires sociaux pour construire dans notre pays une vraie culture de la négociation. La loi de sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013, puis celle relative à la formation professionnelle et à la démocratie sociale du 5 mars 2014, et enfin celle relative au dialogue social du 17 août dernier ont confirmé cette vision.
Je citerai ici quelques avancées : l’association des comités d’entreprise aux orientations stratégiques des entreprises et la participation des salariés aux conseils d’administration de toutes les entreprises de plus de 1 000 salariés ; la création de la base de données unique, des négociations et consultations rénovées autour des enjeux les plus stratégiques ; la capacité à anticiper davantage pour éviter les licenciements et un renforcement de l’activité partielle, désormais au même niveau que celui de l’Allemagne ; un cadre entièrement refondu des procédures de licenciement collectif avec un poids majeur donné à l’accord majoritaire.
La liste serait longue si je devais détailler toutes ces avancées. Je citerai quelques points : le constat à la fois d’un formalisme trop grand de notre dialogue social qui s’éloigne des préoccupations des salariés et des vrais enjeux et la conviction qu’il n’y a pas de dialogue social sans acteurs forts de ce dialogue. Le projet de loi que je vous présente prolonge et amplifie ce mouvement. C’était d’ailleurs l’ambition des quarante-quatre propositions du rapport que Jean-Denis Combrexelle a remis au Premier ministre et à moi-même au mois de septembre dernier. Il renforce considérablement le dialogue social, notamment au sein de l’entreprise, mais aussi au niveau de la branche.
Cette confiance et cette place inédites accordées aux partenaires sociaux, et ce choix de la régulation par le dialogue social, sont à mon sens la voie la plus pertinente, à la fois pour la pérennité de notre modèle social et pour la compétitivité de notre économie. Car notre code du travail, à force de multiplier les dérogations, s’est complexifié au point de devenir illisible et parfois contre-productif.
La solution n’est sûrement pas dans la déréglementation sauvage, comme l’ont expérimenté certains pays en renvoyant massivement au contrat de travail ou en abolissant le monopole syndical de la négociation collective, comme le suggèrent d’autres. Car cela reviendrait à laisser le salarié livré à lui-même dans une relation de travail déséquilibrée. Ma conviction, au contraire, c’est que c’est par le collectif que le salarié est mieux défendu, que ses aspirations individuelles sont les mieux prises en compte. Et c’est par le collectif que l’entreprise peut trouver les marges de souplesse nécessaires à sa compétitivité, sans renoncer à rien sur le plan social. C’est ce que nous montrent certaines expériences étrangères.
Il ne s’agit pas d’avoir une vision angélique du dialogue social. Des blocages, des échecs, des pressions existent parfois. Je résumerai la philosophie de ce texte par l’équation suivante : aucune souplesse ne sera possible sans négociation. Et comme les entreprises ont besoin de souplesse, la négociation débouchera sur des accords équitables. Ces accords devront recueillir l’assentiment des organisations représentant la majorité des salariés, ce qui est une grande avancée, même si elle suscite des craintes de blocage. À défaut d’accord, les protections seront exactement au même niveau qu’aujourd’hui. S’il n’y a pas d’accord, c’est le droit actuel qui s’applique. Cela signifie que tout le monde sera gagnant : les salariés, qui seront mieux représentés et défendus ; les entreprises qui gagneront en capacité d’adaptation et de souplesse, pour mieux répondre à un pic d’activité, à un pic de commandes, pour ne pas perdre de clients. Cela améliorera la compétitivité de notre économie.
J’en viens au contenu du texte. Il consacre de nouveaux droits pour les travailleurs, quel que soit leur statut, en réaffirmant les droits fondamentaux des travailleurs, selon les principes dégagés par le comité de sages présidé par Robert Badinter. Bien qu’ils ne doivent pas constituer le préambule du futur code du travail, ces principes guideront le travail de réécriture qui s’achèvera en 2019.
Permettez-moi de dire quelques mots sur un sujet que certains ont tenté d’instrumentaliser, à savoir le fait religieux en entreprise. Nous savons tous que le principe de laïcité s’applique à l’État, aux administrations publiques et aux entreprises chargées d’une délégation de service public, mais pas à l’entreprise, laquelle n’est pas tenue à un devoir de neutralité. Le principe issu des travaux du comité Badinter rappelle le droit actuel, c’est-à-dire la jurisprudence issue à la fois de la Cour européenne des droits de l’homme, de la Cour de cassation et du Conseil d’État, à savoir la liberté d’exprimer ses convictions, y compris religieuses. Il précise aussi et surtout que des restrictions à cette liberté sont possibles au sein de l’entreprise lorsque sont en cause le bon fonctionnement de celle-ci ou l’exercice d’autres libertés. Si la rédaction actuelle a suscité des débats, elle pourra bien évidemment évoluer pendant la discussion parlementaire pour mieux mettre en lumière la possibilité de restrictions. Mais ne faisons pas croire que la loi modifie le droit actuel puisque ce n’est pas le cas.
Le projet de loi consacre aussi de nouveaux droits en développant le compte personnel d’activité, base d’une véritable sécurité sociale professionnelle. Le compte personnel d’activité doit nous permettre de répondre à la réalité du monde du travail d’aujourd’hui. Une personne n’entre plus dans une entreprise à l’âge de dix-huit ans pour en ressortir à soixante ans. La carrière professionnelle sera faite de plusieurs employeurs, de la possibilité de passer du statut de salarié à d’autres statuts. Il fallait donc à la fois répondre à la demande de nos concitoyens et anticiper leurs besoins futurs, sachant que la question de la reconversion professionnelle pose encore aujourd’hui des difficultés.
Il faut rendre nos concitoyens acteurs de leur parcours professionnel. De ce point de vue, le compte personnel d’activité constitue une avancée majeure en instaurant un droit universel à la formation, quel que soit son statut. Chacun sera doté de droits cumulables tout au long de son parcours, pour acquérir de nouvelles compétences, changer de métier, créer son entreprise. Tout le monde pourra en bénéficier : salariés, demandeurs d’emploi, indépendants, artisans, fonctionnaires. Et, surtout, ceux qui en ont le plus besoin seront davantage aidés : les jeunes décrocheurs auront droit à une nouvelle chance via le droit au retour en formation et la possibilité d’accéder tout au long de leur vie à un premier niveau de qualification ; les salariés sans qualification, qui sont les décrocheurs d’hier et d’avant-hier, verront leurs heures de formation significativement augmentées de vingt-quatre à quarante heures par an et leur plafond maximum relevé de 150 à 400 heures. Pour les demandeurs d’emploi, nous avons fait cette année un effort considérable avec le plan « 500 000 formations ». Je souhaite que les partenaires sociaux puissent pérenniser un soutien à la formation des demandeurs d’emploi les moins qualifiés.
Le CPA valorisera également l’engagement citoyen, avec la création du compte engagement citoyen. Un crédit d’heures de formation sera alloué en contrepartie d’activités reconnues pour leur utilité collective. Je pense aux maîtres d’apprentissage, au service civique, aux périodes de réserves, à ceux qui ont des responsabilités associatives. Avec le CPA, je n’hésite pas à le dire, nous posons les fondements d’un nouveau modèle social, celui du XXIe siècle, qui permet de rendre les Français acteurs de leur parcours professionnel.
Le projet de loi consacre encore de nouveaux droits, en généralisant la garantie jeunes pour tous nos concitoyens de moins de vingt-six ans qui sont en situation de grande précarité, c’est-à-dire sans qualification, sans formation, sans emploi – les fameux NEET, not in education, employment or training – et acceptent de s’inscrire dans un parcours d’insertion exigeant et adossé à une allocation. Je sais l’apport que ce dispositif peut apporter, dans vos circonscriptions, là où est expérimentée la garantie jeunes, notamment pour les jeunes, mais aussi pour les conseillers de la mission locale, pour les entreprises au plus près des territoires. La garantie jeunes, ce n’est pas une allocation, mais un dispositif d’accompagnement avec un contrat donnant-donnant en direction des jeunes qui sont volontaires et motivés pour s’engager dans ce dispositif.
Le projet de loi crée également un droit à la déconnexion pour tous les salariés, pour que le numérique ne soit pas facteur de souffrance au travail, mais une opportunité pour améliorer la qualité de vie. Sa mise en œuvre sera un item de la négociation obligatoire sur la qualité de vie au travail et, à défaut d’accord, les entreprises de plus de 300 salariés devront mettre en place une charte. Dans tous les cas, ce droit sera donc garanti, et il prendra en compte la réalité de l’entreprise. La situation n’est pas la même pour un cadre informatique que pour une plateforme d’appel. Ce droit majeur a été proposé par Bruno Mettling dans son rapport.
Enfin, le texte prévoit de réformer la médecine du travail, pour rendre le suivi médical des salariés plus effectif et mieux protéger ceux qui en ont le plus besoin. Ces dispositions s’inspirent des travaux menés par votre collègue Michel Issindou, qui a remis un rapport l’an dernier, ainsi que des travaux du Conseil d’orientation des conditions de travail, qui ont débouché sur des pistes novatrices, pour répondre aux enjeux en matière de santé au travail et de prévention.
Le projet ouvre ensuite de nouvelles marges d’adaptation pour les entreprises et les salariés par accord d’entreprise.
Toute la partie du code sur le temps de travail est réécrite pour donner à la négociation collective une place prépondérante. Cette nouvelle architecture du code du travail est issue des préconisations du rapport Combrexelle dont les conclusions ont été largement saluées au mois de septembre dernier.
Le Gouvernement a fait le choix de la transparence et de la clarté en réécrivant in extenso cette partie, y compris lorsque les règles ne changent pas, pour beaucoup mieux distinguer ce qui relève de l’ordre public, ce qui relève du champ de l’accord, et les dispositions dites « supplétives » qui s’appliquent en l’absence d’accord.
Cette clarification a conduit à des critiques souvent infondées, car elles sont dirigées contre des règles qui existent depuis bien longtemps et qui ne sont pas modifiées dans ma loi. Je pense notamment à la possibilité de travailler jusqu’à soixante heures par semaine ou jusqu’à douze heures par jour, à certaines conditions particulières que nous n’avons nullement modifiées.
Le Gouvernement a en revanche ouvert de nouvelles souplesses, par accord d’entreprise majoritaire, pour organiser le temps de travail au plus près du terrain. Beaucoup était déjà possible, et il s’agit de donner toute la cohérence à cette négociation d’entreprise. Soyons clairs, il n’y a pas non plus inversion de la hiérarchie des normes. Enfin, plusieurs thèmes resteront, même pour la durée du travail, du ressort de la branche : je pense au temps partiel ou à la modulation du temps de travail au-delà de l’année.
Le texte marque en outre une nouvelle étape ambitieuse dans la rénovation de la démocratie sociale.
Il généralise les accords majoritaires au niveau de l’entreprise pour tous les accords concernant le chapitre réécrit du code du travail. Pour être valides, les accords devront être signés par des organisations syndicales qui rassemblent 50 % des suffrages. Ce sera la règle générale qui a vocation à s’étendre en 2019 à l’ensemble du champ de la négociation collective d’entreprise. De manière exceptionnelle, dans les cas où l’enjeu de l’accord le justifiera aux yeux des organisations syndicales qui l’auront signé, un accord signé à 30 % sans atteindre la majorité pourra être soumis à la consultation des salariés.
Il me semble étrange de considérer que la consultation des salariés, à l’initiative des organisations syndicales, sur leurs conditions de vie au travail et les choix qui les concernent directement, serait une régression.
Ensuite, le texte clarifie la place des accords qui pourront, avec l’accord du salarié, se substituer aux contrats de travail lorsqu’ils visent à préserver ou à développer l’emploi. Là encore, il s’agit de donner plus de poids aux compromis collectifs dès lors que l’accord est majoritaire. De tels accords ne pourront évidemment pas avoir pour effet de diminuer la rémunération mensuelle des salariés. C’est un acte de confiance dans le dialogue social, dans le caractère majoritaire des accords.
Le projet de loi améliore également les moyens des acteurs du dialogue social, dans le prolongement des lois précédentes, en augmentant de 20 % le crédit d’heures des délégués syndicaux et en protégeant mieux les bourses du travail.
Enfin, les règles de négociation et de révision sont profondément rénovées, pour favoriser la loyauté et le dynamisme des accords.
Le texte comporte un volet ambitieux pour mieux accompagner les petites et moyennes entreprises (PME) et les très petites entreprises (TPE), et favoriser l’emploi. Nous savons que c’est là que tout se joue en matière de création d’emplois.
Il élargit les sujets sur lesquels les salariés et élus mandatés peuvent négocier dans les petites entreprises, ce qui leur permettra d’utiliser toutes les souplesses permises par notre droit.
Il met en place des cellules d’appui dans les territoires qui proposeront des réponses rapides aux questions juridiques des PME et TPE.
Il restructure les branches professionnelles – cela fait plus de trente ans que l’on en parle –, dont le nombre sera réduit de plus de 700 à environ 200. On ne peut pas en effet renforcer le rôle des branches professionnelles si on reste dans le champ conventionnel actuel.
Il permet de créer des accords types de branche, spécifiquement dédiés aux PME et TPE. C’est une innovation qui a été insuffisamment mise en lumière et dont j’espère fortement qu’elle redonnera de la vigueur à la négociation de branche et la souplesse nécessaire pour les PME et TPE.
Le projet de loi clarifie la définition du motif économique. Je crois qu’il faut entendre le besoin de prévisibilité qui s’exprime fortement du côté des entreprises, notamment les petites entreprises qui ne peuvent pas s’appuyer sur des armées d’experts juridiques et pour lesquelles la complexité de la rupture peut être un frein à l’embauche, au moins en CDI.
À travers cette loi, je le dis avec force, notre objectif n’est pas de faciliter les licenciements, ce qui serait pour le moins paradoxal pour la ministre de l’emploi que je suis. Il est de poser des règles claires et intelligibles.
Ainsi, la précision du motif du licenciement économique permettra de lutter contre la précarité des salariés. D’une part, elle favorisera les recrutements en CDI, car on sait que le taux élevé de recours aux contrats à durée déterminée (CDD) – neuf embauches sur dix – est en partie dû aux craintes du contentieux de la rupture des CDI. D’autre part, elle évitera des licenciements fondés à tort sur un motif personnel, ou des ruptures conventionnelles parfois abusives, là où c’est un licenciement économique qui devrait être décidé, avec tout l’accompagnement qu’il comporte pour le salarié concerné.
La loi clarifie donc les conditions du licenciement économique, en reprenant très largement la jurisprudence et en précisant les situations qui justifient de se séparer d’un salarié, par exemple une baisse importante des commandes sur plusieurs trimestres.
Elle aligne notre droit sur celui de nos voisins européens pour les groupes implantés à l’international. En même temps, elle permet de lutter contre les contournements en prévoyant que, lorsque les difficultés économiques ont été créées artificiellement à la seule fin de supprimer des emplois, le licenciement sera dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Il nous faut entendre et répondre aux difficultés des petites et moyennes entreprises et prendre la responsabilité, sur ce sujet, de faire bouger les lignes.
Sachez que j’examinerai avec beaucoup intérêt toute proposition complémentaire s’inscrivant dans l’esprit de cette loi et visant à soutenir les TPE et les PME. C’est un enjeu fort pour dynamiser notre tissu économique.
Voilà ce que je souhaitais vous dire pour expliquer à la fois la logique profonde de ce projet de loi et ses objectifs.
Bien sûr, le Gouvernement aurait pu choisir de ne rien faire, dressant le constat que notre démocratie sociale est encore perfectible, que les acteurs en sont souvent trop faibles, qu’il faut attendre qu’elle soit mûre pour lui donner de nouveaux espaces. Mais c’est précisément le pari inverse que fait le Gouvernement, parce que nous sommes convaincus qu’il existe un cercle vertueux à tracer. Il faut, dans un même mouvement, donner plus de moyens aux acteurs du dialogue social et plus de pouvoir, à travers une plus grande place et capacité de décision à la négociation au plus près du terrain. C’est la seule façon de faire bouger en profondeur les lignes dans notre pays.
Je comprends qu’un texte aussi profondément réformateur suscite des questionnements et nécessite des débats. Ceux-ci doivent se poursuivre et je vous redis ma volonté d’être à l’écoute de la représentation nationale pour construire collectivement une société où progrès économique et progrès social sont liés.
Mme la présidente Catherine Lemorton. Madame la ministre, je vous remercie d’avoir présenté ce projet de loi en insistant sur ses grandes lignes.
Je me rends compte que les députés de l’opposition sont ébahis par l’aspect réformateur de cette loi !
Mes chers collègues, je vous rappelle que le projet de loi et l’étude d’impact ont été mis à votre disposition, jeudi dernier, à vingt heures quarante, et que les amendements pourront être déposés jusqu’à vendredi prochain, dix-sept heures.
M. Christophe Sirugue, rapporteur. Madame la ministre, votre présence parmi nous est l’occasion d’instaurer un dialogue sur le projet de loi tel qu’il a été présenté en conseil des ministres – et non pas sur la première version, même si, je l’ai constaté, certaines analyses persistent à s’appuyer sur le texte tel qu’il était avant d’être modifié. J’aurai l’occasion, le moment venu, de développer l’argumentation du rapporteur que je suis. Pour l’heure, afin que nous soyons parfaitement éclairés, je voudrais vous interroger sur quelques points spécifiques.
Ma première question porte sur la création de la commission de refondation du code prévue à l’article 1er, dont l’enjeu est important. Je n’ai pas vu de précisions sur sa composition. De quelle manière les partenaires sociaux seront-ils associés à ses travaux ? Il est important qu’ils soient des acteurs essentiels des échanges qui pourraient avoir lieu avec cette commission.
Je rappelle que les principes qui doivent encadrer les travaux de ladite commission existent déjà à des niveaux différents, constitutionnels, conventionnels. Ils me paraissent parfois porteurs d’ambiguïté. Pourquoi leur a-t-on retiré la valeur de préambule, ce que je crois satisfaisant, tout en les laissant dans le texte, sans que l’on sache quelle sera leur portée ?
La consécration de la primauté de l’accord d’entreprise sur l’accord de branche pour tous les sujets liés à la durée du travail peut poser quelques questions. Je pense, en particulier, à la fixation du taux de majoration des heures supplémentaires pour laquelle une entreprise pourrait désormais déroger au taux de majoration fixé par la branche dont elle relève dans un sens moins favorable aux salariés, ce qui pourrait favoriser une sorte de moins-disant social, pour ne pas parler de dumping social. Pouvez-vous nous éclairer sur ce point ?
La généralisation des accords majoritaires proposée par l’article 10 permettra à l’évidence de renforcer la légitimité des accords collectifs d’entreprise. Cependant, l’accord majoritaire peut également entraîner des blocages de la négociation collective. C’est pourquoi le Premier ministre avait proposé de procéder par étapes. Or le projet de loi prévoit une entrée en vigueur mécanique des accords majoritaires au 1er septembre 2019. Ne vaudrait-il pas mieux n’envisager la généralisation des accords majoritaires que si les retours d’expérience sont positifs ?
S’agissant des accords de préservation et de développement de l’emploi, l’article 11 crée des modalités de licenciement sui generis qui ne correspondent ni à un licenciement pour motif économique ni à un licenciement pour motif personnel. Or l’objet du licenciement est bien de nature économique, puisqu’il s’agit de préserver ou de développer l’emploi. Madame la ministre, pouvez-vous nous expliquer pourquoi le Gouvernement n’a pas choisi la qualification de licenciement pour motif économique dès lors qu’un salarié refuserait un accord dit « offensif » ?
J’en viens au compte personnel d’activité. Il s’agit en effet d’une avancée extrêmement positive pour les droits des salariés, d’un dispositif clef de sécurisation des parcours et de préservation des droits acquis. Nous voulons travailler sur le CPA afin de nous assurer que la portabilité et la fongibilité des droits fonctionnent de manière simple. Il faut que le salarié puisse « lire » facilement les droits qu’il a acquis tout au long de sa carrière.
Par ailleurs, si l’on souhaite que le CPA soit réellement universel, que se passe-t-il pour les agents publics ? Actuellement, ceux-ci n’ont ni compte personnel de formation ni compte personnel de prévention de la pénibilité. Renvoie-t-on cette question à plus tard ? Si tel est le cas, quel est le calendrier envisagé ?
J’en arrive à un point difficile : le motif économique du licenciement. À l’article 30 du projet de loi, vous proposez de préciser, d’une part, la définition des difficultés économiques et, d’autre part, le niveau d’appréciation de ces difficultés.
Sur le premier point, je remarque que les indicateurs choisis – dont je ne discute pas la pertinence – reposent sur un critère unique de durée – pendant laquelle il y a une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, ou des pertes d’exploitation –, mais qu’ils ne comportent aucune référence à une quelconque ampleur des difficultés de l’entreprise, sauf pour la dégradation de la trésorerie. Or l’ampleur des difficultés rencontrées n’est pas la même pour une petite ou pour une grande entreprise. Dès lors, ne serait-il pas utile de définir une ampleur minimale pour caractériser les difficultés économiques ?
Sur le second point, je comprends le souci qui a conduit, pour les entreprises relevant d’un groupe, à fixer au niveau national le périmètre d’appréciation des difficultés économiques, a fortiori dans la mesure où la quasi-totalité de nos voisins européens font de même. Toutefois, tel n’est pas le cas de l’Espagne. Le texte précise – c’est une avancée importante – que le juge pourra continuer de juger dépourvus de cause réelle et sérieuse des licenciements liés à la création artificielle de difficultés économiques. Cependant, qu’est-ce qu’une « création artificielle » ? Comment le juge pourra-t-il exercer ce contrôle à l’avenir si son périmètre d’appréciation est cantonné au territoire national ? Comment pourra-t-il vérifier que c’est bien l’ensemble du groupe qui rencontre des difficultés ? Ce point me paraît très important.
Je termine par les mesures destinées à faciliter la vie des TPE et des PME. L’article 28 inscrit dans le code du travail le droit, pour les entreprises de moins de 300 salariés, d’obtenir une information précise sur l’application du droit du travail. Il est très important, madame la ministre, que nous travaillions à améliorer l’accès des PME au droit. Or l’article 28 tel qu’il est formulé actuellement a une portée normative très faible. Quid d’un service public de l’information et de l’accès au droit pour les chefs d’entreprise et les artisans ? Quid des propositions qui pourraient être faites en matière de rescrit social, dont certains éléments existent déjà, sachant que nous avons mis en place le rescrit fiscal ? D’autre part, comment peut-on associer l’ensemble des acteurs, notamment les chambres de commerce et d’industrie et les chambres des métiers, à ce devoir d’information et de réponse aux entreprises ? Cet élément me paraît déterminant.
Bref, madame la ministre, ce texte mérite encore d’être précisé, notamment sur la question du licenciement économique, afin qu’il n’y ait pas de doute sur la réalité des difficultés économiques ou financières auxquelles sont confrontées les entreprises. Ce texte doit aussi évoluer au regard des demandes des TPE et des PME, ainsi qu’en matière de protection des salariés. S’il est exact que les entreprises doivent pouvoir s’adapter au contexte économique, nous devons aussi prendre en compte le fait que les salariés sont inquiets pour leur avenir et qu’ils ont besoin d’être rassurés. Ma volonté, en tant que rapporteur, est de travailler sur ces deux points : des assouplissements pour être compétitifs dans le contexte de crise économique que nous connaissons ; des protections pour les salariés, qui ne doivent pas être sacrifiés au nom de ces enjeux.
Mme Monique Iborra. Merci, madame la ministre, pour votre intervention claire, qui peut paraître technique, mais a évidemment des implications politiques. Celles-ci concernent non seulement les partenaires sociaux et les salariés, mais aussi et d’abord les citoyens.
Vous avez donné des éléments de contexte qu’il est utile de rappeler : plus de neuf embauches sur dix se font aujourd’hui sous la forme d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat d’intérim de moins de trois mois – cette précarité croissante ne date pas de 2012 et touche principalement les jeunes ; les CDD de moins de trois mois représentent 40 % des embauches ; beaucoup, y compris parmi les représentants des salariés, conviennent aujourd’hui du fait que le code du travail n’est plus adapté au marché du travail.
Ces éléments de contexte nous obligent et vous obligent à l’action. C’est bien ce dont il s’agit aujourd’hui. Le chômage reste élevé dans notre pays, plus que chez nos voisins européens qui ont engagé des réformes du marché du travail. Pourtant, certains estiment que cette réforme n’était pas nécessaire. Tel n’est pas notre avis, et nous saluons le volontarisme politique dont fait preuve le Gouvernement.
Néanmoins, madame la ministre, cette loi suscite des interrogations légitimes, car elle induit de vrais changements et une véritable réforme dans les relations entre salariés et employeurs, en donnant aux accords d’entreprise une place prépondérante qu’ils n’avaient que partiellement jusqu’à ce jour, même s’ils étaient effectifs et signés par l’ensemble des organisations syndicales. Vous consacrez ainsi le dialogue social comme un élément prépondérant au sein de l’entreprise, et plus seulement au niveau de la branche. En d’autres termes, vous tentez de remplacer la culture de l’affrontement par celle de la négociation. Les décisions concernant la durée du travail, l’aménagement et la répartition des horaires, le repos quotidien, les jours fériés et les congés payés pourront faire l’objet d’accords majoritaires au sein de l’entreprise.
Les difficultés de l’entreprise qu’il convient de prendre en compte ne sont plus seulement structurelles, mais également conjoncturelles, c’est-à-dire liées à la vie de chaque entreprise. Lorsqu’elles sont réelles, elles doivent être prises en compte tant par le chef d’entreprise que par les salariés. Il était nécessaire, ainsi que vous entendez le faire avec ce projet de loi, d’élargir et de clarifier les possibilités qui existaient déjà en la matière, afin que les entreprises et leurs salariés s’en emparent plus facilement. Mais il fallait également borner ces possibilités et garantir aux salariés – qui sont, par définition, dans un rapport de subordination à l’égard de l’employeur – que leur statut serait préservé en cas d’absence d’accord, en prévoyant que l’accord de branche s’applique alors.
Cette nouvelle approche nécessite non seulement la mise en place de formations pour les partenaires sociaux, négociateurs au niveau local, mais également un bon niveau d’information des salariés, afin qu’ils puissent appréhender plus efficacement la situation de l’entreprise en cas de difficultés, notamment lorsqu’un référendum est organisé à l’initiative des organisations syndicales. Qu’envisagez-vous dans ce domaine ? Les entreprises auront-elles l’obligation de publier les accords d’entreprise ? Si tel est le cas, sous quelle forme ? Ne doit-on pas envisager une meilleure diffusion de l’information, afin que les salariés aient une connaissance plus précise de leurs droits et participent réellement et activement à la négociation d’entreprise ?
Enfin, avec le compte personnel d’activité, les droits seront désormais attachés à la personne plutôt qu’à son statut. Tel qu’il est prévu dans le projet de loi, le CPA s’adresse d’abord aux décrocheurs et aux jeunes en grande précarité, notamment par le biais de la garantie jeunes. Ne pourrait-on pas introduire également – nous y réfléchissons – une disposition qui concerne les jeunes diplômés, lesquels paient eux aussi un lourd tribut en termes de précarité et de chômage ?
M. Gérard Cherpion. Vous avez dit, madame la ministre, qu’il fallait donner plus de moyens et plus de pouvoir aux acteurs du dialogue social. Votre gouvernement se voulait exemplaire en matière de dialogue social. Or, à cette aune, le parcours de ce projet de loi est plutôt raté : certes, vous avez mené un certain nombre de concertations – personne ne le remet en cause –, mais le Gouvernement lui-même ne s’est pas donné les moyens de respecter l’article L. l du code du travail : avez-vous ouvert une concertation préalable en vue de proposer l’ouverture d’une négociation ? Avez-vous communiqué aux partenaires sociaux un document d’orientation en ce sens ? La réponse est non – sauf, je le reconnais, en ce qui concerne le compte personnel d’activité, qui a fait l’objet d’une négociation en soi. Comment expliquer sinon le besoin de démarrer un nouveau cycle de concertation après transmission du texte au Conseil d’État ? Comme toujours, ce contretemps va nuire au travail parlementaire. D’ailleurs, les rapporteurs des commissions saisies pour avis ne sont pas intervenus aujourd’hui devant notre commission, ce qui prouve à quel point il est difficile de travailler dans ces conditions.
L’inscription des « principes Badinter » dans l’article 1er suscite des interrogations : si vous renvoyez l’écriture du code à une commission, pourquoi inscrire les bases de sa refondation dans une loi préalable ? Ces principes n’avaient sûrement pas vocation à devenir un préambule – ce n’est plus le cas et c’est heureux. Ils n’ont pas davantage vocation à figurer dans la loi ! En plus d’être un objet législatif non identifié, ils sont contre-productifs : ils figent les travaux de la future commission. Et je ne parle pas du 6° de cet article sur le fait religieux, dont la rédaction cristallise les inquiétudes et risque d’éclipser la philosophie de l’ensemble du projet. Il y a deux ans, le groupe Les Républicains avait déposé une proposition de loi qui visait à donner à l’entreprise la responsabilité de fixer des règles en la matière dans son règlement intérieur.
Concernant l’article 2, la triple architecture que vous retenez pour la réécriture du code est intéressante. Elle va de pair avec la primauté donnée à l’accord d’entreprise pour un certain nombre de dispositions, notamment la modulation des heures supplémentaires, les temps de repos, les astreintes, etc. À cet égard, permettez-moi de faire une remarque : nous saluons les circonvolutions auxquelles vous vous prêtez pour remettre en cause les 35 heures sans le dire ! Tel est bien le cas avec la possibilité de négocier des taux de majoration des heures supplémentaires qui ne peuvent être inférieurs à 10 % et avec les accords offensifs, que nous avons proposés régulièrement depuis trois ans et que vous reprenez – à titre personnel, j’en suis heureux !
Cependant, nous avons un regret : les quinze jours de négociation qui se sont écoulés entre l’examen du texte par le Conseil d’État et son adoption en Conseil des ministres ont été marqués par le retour du monopole syndical en matière de négociation. Avec l’extension du mandatement, on ne laisse toujours pas sa place au dialogue social direct qui est caractéristique des petites entreprises. Or vous le rappelez vous-même dans l’étude d’impact : ce sont elles qui produisent des emplois, ce sont elles qu’il faut soutenir et laisser respirer. Avant même l’ouverture des discussions, nous regrettons le recul du champ que le premier projet laissait à la décision unilatérale de l’employeur. Ainsi, la période de référence en matière d’aménagement du temps de travail est passée de seize à neuf semaines en cas de décision unilatérale, et il est désormais impossible à l’employeur d’instaurer des forfaits en jours par décision unilatérale.
Le retour du monopole syndical marque profondément ce texte. Celui-ci se voulait un appui aux TPE, mais il en reste à des logiques qui sont celles des entreprises qui ont les moyens de mener le dialogue social tel que nous le connaissons aujourd’hui. Où est donc le changement de paradigme ? Toutefois, avec la redéfinition du rôle de la branche et les accords types, vous avez amorcé une réflexion qui nous semble intéressante et que nous suivrons.
S’agissant du compte personnel d’activité et de la garantie jeunes, nous notons le renforcement des droits des décrocheurs et des salariés peu qualifiés au titre du compte personnel de formation, mais nous posons la question de son impact sur le financement la formation professionnelle.
Sachez que nous ne baisserons par les bras en ce qui concerne la pénibilité, qui reste un sujet majeur d’inquiétude, en particulier pour les petites entreprises. Nous aurons l’occasion d’y revenir.
Comme tout le monde, nous avons assisté à la naissance du compte engagement citoyen. Bien sûr, vous nous prenez par les sentiments en y intégrant l’activité des maîtres d’apprentissage et des bénévoles qui prennent des responsabilités au sein de leurs associations. L’étude d’impact mentionne un coût relativement bas – 46 millions d’euros seulement, qu’il faudra tout de même trouver – et un taux de recours très bas lui aussi – 20 %. Ces hypothèses nous paraissent très risquées.
Nous pouvons soutenir le dispositif de la garantie jeunes, qui a fait ses preuves, ainsi que vous l’avez indiqué, madame la ministre, mais à condition que les choses soient parfaitement claires. Si le droit « universel » mentionné par le Président de la République est, ainsi que nous croyons le comprendre à ce stade, un droit réservé à certains jeunes selon certains critères de situation et de motivation, alors nous envisageons cette extension de manière positive. Mais nous serons opposés, je vous l’ai dit, à toute dénaturation de cette garantie jeunes qui en ferait un droit universel à une allocation sans la contrepartie d’un engagement fort de la part du jeune et celle de son suivi.
J’ai senti une inquiétude dans les propos du rapporteur. Pour notre part, ce qui nous inquiète, c’est le recul du Gouvernement depuis la première version du projet de loi. Il ne faut pas que vous reculiez davantage, madame la ministre : vous devez rester ferme sur les positions que vous avez exposées aujourd’hui.
M. Arnaud Richard. Nous commençons aujourd’hui l’examen tant attendu non pas d’un grand texte, mais d’un gros texte. Je tiens à saluer votre présence devant notre commission, madame la ministre. Sans vouloir raviver la polémique, le groupe Union des démocrates et indépendants regrette que le Parlement n’ait pas été associé à l’élaboration de ce texte, surtout les groupes qui composent l’actuelle opposition.
Bien que nous soyons convaincus de la nécessité de réformer le code du travail, nous ne pouvons que condamner la méthode. Quoi que vous en disiez, madame la ministre, cette réforme n’a pas été discutée en amont avec les partenaires sociaux et les représentants des branches autant qu’elle aurait dû l’être. C’est même un comble : vous contrevenez à l’article L. 1 du code du travail, qui prévoit – faut-il vous le rappeler, madame la ministre : « Tout projet de réforme envisagé par le Gouvernement qui porte sur les relations individuelles et collectives du travail, l’emploi et la formation professionnelle et qui relève du champ de la négociation nationale et interprofessionnelle fait l’objet d’une concertation préalable avec les organisations syndicales de salariés et d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel en vue de l’ouverture éventuelle d’une telle négociation. » Je le cite, car je pense que vous ne l’avez pas lu, madame la ministre.
M. Richard Ferrand. Quel mufle !
M. Arnaud Richard. Non seulement l’absence de concertation a nui au dialogue social, mais la présentation d’un second projet de loi a mis à mal la crédibilité de l’exécutif et de la majorité, et, de vous à moi, jette l’opprobre sur l’ensemble de la classe politique.
Au groupe Union des démocrates et indépendants, vous le savez, nous croyons à la démocratie et au dialogue social, qui constituent des leviers puissants pour moderniser et réformer notre pays. Ces outils de négociation et de compromis permettent de privilégier une approche globale des questions soulevées par les imperfections, réelles, de notre système et de prendre en compte l’ensemble des enjeux : la protection des salariés et la sécurisation des parcours professionnels, l’amélioration de la compétitivité, l’anticipation des mutations économiques et sociales.
Nous sommes convaincus qu’il faut faire évoluer notre code du travail, mais comment ne pas regretter que le Gouvernement choisisse la dernière année du quinquennat, alors qu’il aurait pu engager cette réforme bien plus tôt ? Depuis le début du quinquennat, le groupe Union des démocrates et indépendants propose sans succès des mesures concrètes afin de réformer le marché du travail et de renforcer le champ de la négociation collective.
Je ne m’attarderai que sur quelques articles – nous ne serons pas sans nous revoir, madame la ministre.
S’agissant, d’abord, de l’article 1er, la feuille de route et la composition de la commission de refondation sont au mieux – le rapporteur l’a dit – floues et inexploitables.
M. le rapporteur. Ne me faites pas dire ce que je n’ai pas dit !
M. Arnaud Richard. Au pire, elles constituent un affront à l’égard du Parlement. D’après l’exposé des motifs, il est prévu que la commission dispose d’un délai de deux ans pour récrire chaque subdivision du code, puis que le Gouvernement lui-même dispose d’un délai de trois mois pour indiquer au Parlement les suites qu’il entend donner à ces travaux. Or, dans le texte de la loi, on ne trouve nulle trace d’un calendrier, ainsi que le rapporteur l’a relevé. Madame la ministre, vous conviendrez aisément qu’il faut éclairer la représentation nationale sur ce point précis du calendrier.
On ne peut que saluer – nos collègues du groupe Socialiste, républicain et citoyen le font également, ce qui est nouveau pour eux – le fait que la primauté soit donnée aux accords d’entreprise : il s’agit d’une mesure importante que nous attendions tous, dans l’opposition, de longue date. Cela peut paraître paradoxal, mais elle devra nécessairement s’accompagner d’un renforcement des acteurs du dialogue social dans l’entreprise. À titre personnel, je doute que l’augmentation de 20 % des heures de délégation soit suffisante. Pouvez-vous nous présenter de manière plus détaillée les mesures prévues à destination des partenaires sociaux ?
En outre, madame la ministre, comment se satisfaire d’un texte qui ne prend pas en compte les nouvelles opportunités économiques et ne contient aucune proposition pour prendre en compte les nouvelles formes de salariat ?
Le compte personnel d’activité aurait pu être une solution, si vous y aviez pleinement intégré le compte personnel de formation et le compte personnel de prévention de la pénibilité. Se limiter au compte engagement citoyen, c’est un peu le miroir aux alouettes ! Vous ne ferez rien en termes de sécurisation des parcours des actifs tout au long de leur carrière. À force de concessions, vous avez transformé le CPA en une usine à gaz, dont le Gouvernement lui-même ne semble plus vraiment saisir les contours. Je note que le rapporteur se pose la question de l’extension du CPA aux agents de la fonction publique.
Si, sur le principe, nous ne sommes pas opposés à la généralisation de la garantie jeunes sur tout le territoire, nous aurions aimé qu’il y ait un retour d’expérience, une étude d’impact et un financement. Pourriez-vous nous préciser, madame la ministre, sur quelles bases le coût total de 600 millions d’euros pour 2017 a été estimé ?
Le groupe Union des démocrates et indépendants aurait pu suivre le Gouvernement sur la base du texte initial, dans la mesure où de nombreuses mesures attendues y figuraient. Mais, pour embaucher, les entreprises ont besoin de visibilité et de confiance. Or, à force de dérobades et de descentes en slalom spécial, nous craignons fort que ce projet de loi n’assombrisse l’avenir du marché du travail.
Mme la présidente Catherine Lemorton. Monsieur Richard, même si vous n’êtes pas d’accord avec une partie du texte, rien ne vous empêche de rester courtois et respectueux à l’égard de la ministre. Affirmer qu’elle n’a pas lu l’article L. 1 du code du travail me paraît déplacé, d’autant que ce n’est pas vrai.
M. Christophe Cavard. Madame la ministre, je suis heureux de vous accueillir aujourd’hui avec mes collègues pour avoir un échange franc et constructif à propos de ce projet de loi, dit précédemment « loi El Khomri », puis « loi travail » et, désormais, « projet de loi visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections pour les entreprises et les actifs ». Ce texte a déjà beaucoup fait parler de lui, alors que nous-mêmes, parlementaires, n’avons pas commencé à l’étudier ensemble en profondeur, afin de proposer et d’apporter des améliorations. Car, vous vous en doutez, madame la ministre, nous allons y travailler sérieusement !
Entre le texte que nous avons sous les yeux et l’avant-projet initial, qui a été retiré afin de prendre en compte les principales craintes qui se sont exprimées dans le pays, les choses ont évolué. Pour ma part, je m’en félicite. Ce texte est issu de multiples travaux et rapports, qui ont formulé des propositions dans la perspective d’une refondation de notre code du travail et de l’amélioration du dialogue social dans les entreprises. Ceci, dans la continuité des textes que nous avons votés précédemment sur ces mêmes sujets, à savoir la loi relative à la sécurisation de l’emploi, la loi relative à la formation professionnelle et la loi relative au dialogue social.
Les travaux de la commission Badinter ont vocation à former le socle de cette refondation, bien au-delà du seul article 1er de ce projet de loi. Les principes dégagés par la commission ont vocation à devenir le préambule du code du travail et doivent inspirer l’ensemble de ce qui suivra, car ce sont les droits fondamentaux de chacune et de chacun au travail.
Le rapport de Jean-Denis Combrexelle sur la négociation collective, le rapport Mettling sur la transformation numérique et la vie au travail, le rapport sur le compte personnel d’activité, et d’autres encore, ont nourri ce texte.
Puisque je n’aurai pas le temps d’aborder en détail tous ces sujets – nous y reviendrons bien sûr au cours des travaux de la Commission –, je voudrais m’exprimer brièvement sur l’esprit de ce projet de loi, dans lequel vous vous préoccupez de dialogue social, de sécurité professionnelle et de flexibilité.
Pour ce qui est du dialogue social, je défends avec conviction, en tant qu’écologiste, la démocratie sociale et la négociation au plus près des spécificités de la production et de l’organisation du travail, au plus près des acteurs concernés, au sein de chaque entreprise. Les écologistes souhaitent favoriser et renforcer la possible participation des salariés dans leurs entreprises. C’est pourquoi ils sont porteurs du modèle de l’économie sociale, où prévaut le principe « un homme, une voix ». Ils sont donc naturellement favorables au dialogue social et à la négociation collective au sein de l’entreprise.
Mais nous savons que, pour parvenir à des négociations réussies, il faut garantir que les conditions de la négociation sont loyales et équilibrées entre les parties. Il faut de l’information, de la confiance et de la compréhension mutuelle entre les négociateurs. Il faut donc définir au préalable les règles du jeu, de façon claire et avec les outils adéquats. La négociation est une culture : elle s’apprend, de part et d’autre. Nous y reviendrons au cours du débat parlementaire. Cela concerne au premier chef les accords de méthode, mais aussi le rôle des branches professionnelles.
Je défends également, bien entendu, la sécurisation des parcours professionnels. Nous avons commencé à y travailler avec le compte personnel de formation, qui est l’amorce d’une possibilité de formation tout au long de la vie. De ce point de vue, l’augmentation des heures attribuées au CPF pour les personnes peu ou pas qualifiées est une bonne nouvelle. Nous pouvons nous féliciter de la création du compte personnel d’activité – qui intègre de multiples dimensions non seulement de la vie professionnelle, mais aussi de la vie sociale –, de la garantie jeunes ou du renforcement de la validation des acquis de l’expérience. Reste la question du compte épargne-temps et de son association au CPA.
Au-delà de ces évolutions majeures, il y a néanmoins, dans ce texte, un sujet qui pose problème : celui de la flexibilité. Pourquoi ce sujet est-il sensible ? Parce qu’il est nécessaire, aujourd’hui, de différencier ce qu’on appelle l’économie réelle de l’économie virtuelle. Si nous voulons aider les très petites entreprises, les artisans, les petites et les moyennes entreprises ou les entrepreneurs de l’économie sociale et solidaire, chefs d’entreprise et salariés, à s’adapter pour développer l’emploi, nous ne voulons pas pour autant faciliter la tâche du « monde de la finance ».
Ce texte doit apporter de nouvelles libertés et de nouvelles protections pour les actifs, mais pas pour les inactifs. Il ne faut pas offrir la possibilité d’accroître des dividendes issus de la spéculation et produits sur le dos des salariés tout autant que sur celui des entreprises sous-traitantes. Nous vivons dans un monde où, désormais, les rapports de subordination ne sont plus exclusivement entre employeurs et salariés, mais également entre entreprises multinationales ou donneuses d’ordres et leurs sous-traitants. Le débat n’est donc plus seulement entre salariés et patrons, mais entre économie réelle et économie virtuelle. Nous aborderons cette question dans les discussions et chercherons à proposer les meilleures solutions pour garantir les droits des salariés.
En conclusion, dans l’esprit de la loi, c’est-à-dire en faisant confiance à la négociation entre exécutif et parlementaires, et pour donner tout son sens à la démocratie parlementaire, je souhaite que nous continuions, dans les semaines qui viennent, à améliorer ce texte et à évacuer les peurs, par l’écoute et le dialogue, avec toutes celles et tous ceux qui souhaitent participer, hors des logiques de postures et de façon constructive.
Mme Dominique Orliac. Je vous remercie, madame la ministre, pour la présentation que vous avez faite aujourd’hui devant notre commission.
Chaque remaniement au ministère du travail est accompagné d’un nouveau projet de loi : après le texte portant sur la formation professionnelle et la démocratie sociale, puis le texte sur le dialogue social, voici maintenant ce projet de loi, qui vise à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections pour les entreprises et les actifs. Je note, au passage, qu’il n’y a aucune référence directe aux « salariés » ou aux « travailleurs » dans le titre de votre projet de loi.
Après des semaines de déclarations, de pas en avant et en arrière, et une contestation sociale qui a parfois pris un visage violent, tant du côté des manifestants que des forces de sécurité, notre commission va se pencher dès la semaine prochaine sur les amendements à ce projet de loi. Il convient de relever l’ampleur prise par la contestation, tant sur les réseaux sociaux, avec cette fameuse pétition – qui, s’il y a des choses à dire sur le procédé, ne peut pas être écartée d’un revers de main –, que dans la rue, compte tenu de la position des partenaires sociaux, certains d’entre eux ayant néanmoins décidé de soutenir le texte après modifications. Cependant, celles-ci ont braqué les organisations patronales, pourtant acquises à la première version du projet de loi. Enfin, il est important de noter que de nombreux jeunes – certes, pas tous, je vous l’accorde – se sont montrés hostiles au projet de loi. Il faudra donc rassurer.
Disons-le d’emblée : ce texte contient des dispositions très intéressantes. Le groupe Radical, républicain, démocrate et progressiste reconnaît que, avec le code du travail actuel, la situation est compliquée tant pour les TPE et les PME que pour les salariés, qui peuvent se perdre dans la lecture d’un code parfois illisible et qui ne les aide guère à comprendre leurs droits.
Lors de la conférence de presse qu’il a donnée le 7 septembre dernier, le Président de la République a d’ailleurs déclaré : « Réformer, c’est aussi rendre lisible le code du travail, parce que c’est ce qui protège, parce que c’est aussi ce qui permet de créer de l’emploi. Nous donnerons toute la place nécessaire à la négociation collective et aux accords d’entreprise, pour permettre justement qu’il y ait une meilleure adaptation du droit du travail à la réalité des entreprises. »
Le Premier ministre, quant à lui, a déclaré lors du congrès des Radicaux de gauche à Montpellier, le 20 septembre 2015 : « Réformer, c’est enfin réformer notre marché du travail, avec un objectif : plus de souplesse, mais pas moins de protection. Le constat est très largement partagé : notre code du travail est trop rigide, trop complexe, au point même que les salariés ont du mal à connaître leurs droits. Il y a une perte de temps et d’énergie pour tout le monde. »
Sur la forme, nous déplorons à nouveau les délais relativement courts impartis à l’étude de ce texte important, ainsi que les multiples renvois à des décrets en Conseil d’État.
Sur le fond, nous avons plusieurs remarques à faire, notamment sur l’alinéa 11 de l’article 1er, qui porte sur les questions relatives à la laïcité en entreprise. Le groupe Radical, républicain, démocrate et progressiste et apparentés vous demande, madame la ministre, une clarification du texte en la matière.
L’article 2 récrit la totalité des dispositions du code portant sur la durée du travail, l’aménagement et la répartition des horaires, le repos quotidien, les jours fériés et les congés payés. Nous avons bien noté la volonté du Gouvernement de mettre en avant la négociation en entreprise.
L’article 3 assure pour chaque congé spécifique actuellement prévu par le code du travail une distinction claire entre, d’une part, les droits à congés ouverts aux salariés relevant de l’ordre public et, donc, non négociables et, d’autre part, les dispositions qui peuvent faire l’objet de négociations, pour plus de souplesse d’organisation au sein de l’entreprise. Toutefois, nous nous étonnons que les dispositions supplétives fixées par décret en Conseil d’État viennent presque systématiquement compléter ces dispositions, ainsi que je l’ai déjà indiqué. Cela n’augure pas nécessairement d’une réelle appropriation de cette nouvelle méthode par les partenaires que sont les employés et le patronat.
Nous sommes satisfaits de la suppression de la première version de l’article 6, qui portait sur le travail des apprentis mineurs.
Nous notons que l’article 7 concerne la méthode pour contracter des accords collectifs, ainsi que leur durée, et prévoit que les accords d’entreprise sont rendus publics sauf si l’employeur s’oppose à cette publicité notamment pour des raisons de non-divulgation d’informations sensibles sur la stratégie de l’entreprise. Nous émettons des réserves sur le fait que l’employeur puisse s’opposer à la transparence au motif de préserver la stratégie d’entreprise.
Nous soutenons, bien évidemment, l’idée de créer un compte personnel d’activité, qui fait l’objet des articles 21 et 22, ainsi que la généralisation de la garantie jeunes prévue à l’article 23. De même, nous portons une attention bienveillante aux dispositions concernant l’apprentissage, qui visent à simplifier son organisation. Ainsi que nous l’avons déjà évoqué à plusieurs reprises, tout ce qui peut contribuer à ce qu’on se défasse du sentiment que l’apprentissage est une « voie de garage » est bon à prendre.
Dans le temps limité qui m’est imparti, j’aimerais également revenir sur les dispositions de l’article 44 concernant la médecine du travail. Cet article réforme le suivi des salariés par la médecine du travail pour mieux concentrer les moyens sur les salariés exposés à des risques particuliers. Il supprime la visite médicale d’aptitude systématique à l’embauche et renforce le suivi personnalisé des salariés tout au long de leur carrière, en reconnaissant ce droit aux salariés intérimaires et titulaires de contrats courts. À ce stade de la discussion, notre groupe estime que ce changement est positif, car, dans les faits, cette visite ne semble pas toujours répondre à son objectif premier, puisque le médecin du travail n’a pas accès au dossier médical du patient et que ce dernier peut éventuellement omettre des informations. Un protocole défini par la médecine du travail et mis en œuvre par un professionnel de santé serait nécessaire, le médecin du travail validant l’aptitude ou convoquant la personne concernée.
Lors de l’examen des amendements par notre commission la semaine prochaine, nous serons extrêmement vigilants sur les avancées qui concerneront les artisans, les TPE et les PME, ainsi que sur la protection des salariés.
Mme Jacqueline Fraysse. Madame la ministre, comme vous le savez, nous rejetons ce projet de loi, en raison tant de la philosophie qui le sous-tend que de l’essentiel de son contenu. Il s’agit, ainsi que le précise l’exposé des motifs, de « refonder notre modèle social », car « les modes d’organisation du travail évoluent ». C’est une affirmation incontestable, que nous partageons, et qui justifie de « revisiter » le code du travail pour l’adapter à la société d’aujourd’hui, à l’ère du numérique, de l’Europe et de la mondialisation, qui ont d’ailleurs déjà induit une certaine réorganisation du travail.
Mais, avant toute réforme profonde du code du travail, il convient de répondre à cette question, que je me permets de vous poser : quelle réorganisation du travail voulons-nous promouvoir, pour quelle société demain ? Dans quel sens et au service de qui ? De la réponse à ces questions découle, évidemment, le type de réforme que l’on veut faire. Et, manifestement, nous formulons des réponses diamétralement opposées aux vôtres.
La vocation initiale du code du travail est la protection des salariés. Non seulement elle ne saurait être remise en cause, mais elle devrait être améliorée. Or vous faites le contraire : recul sur le temps de travail, recul sur la protection contre les licenciements abusifs, recul sur la santé au travail. Bref, ce n’est pas d’une modernisation qu’il s’agit, mais d’un retour en arrière, pour ne pas dire très en arrière. Nos concitoyens l’ont évidemment bien compris, et cela explique cette levée de boucliers dans tout le pays, d’autant plus légitime que votre texte s’appuie sur le postulat jamais démontré selon lequel il y aurait un lien entre le code du travail, autrement dit la protection des salariés, et le niveau de chômage.
Mais en quoi la création d’emplois serait-elle empêchée par une trop grande protection des salariés ? Autrement dit, en quoi permettre de licencier plus facilement, comme le prévoit le texte soumis à notre examen, stimulerait-il un marché de l’emploi dont chacun sait qu’il dépend essentiellement du carnet de commandes des entreprises ? Vous répondez en fait au détriment des salariés à une demande ancienne du patronat, sans lien avec l’emploi. Cette grossière mise en accusation du code du travail occulte les vraies raisons du chômage massif, qui sont de nature économique.
Vous dites vouloir redonner du pouvoir aux travailleurs, mais vous privez la loi de son caractère protecteur et subordonnez des pans entiers du contrat de travail à la conclusion d’accords collectifs d’entreprise qui prévaudront sur les conventions collectives de branche, y compris s’ils sont moins favorables pour les salariés – c’est la fameuse inversion de la hiérarchie des normes. Pensez-vous vraiment, madame la ministre, qu’en période de fort chômage et alors que les licenciements seront encore plus faciles les représentants du personnel pourront résister aux exigences d’un patronat qui exercera plus facilement qu’auparavant le chantage à l’emploi ? Et je ne parle pas du référendum, qui pourra être organisé pour court-circuiter les organisations syndicales et diviser les salariés.
Si votre projet de loi était voté en l’état, le contrat de travail ne vaudrait plus rien, puisqu’il pourrait à tout moment être remis en cause par des accords offensifs. Votre texte va jusqu’à permettre le licenciement pur et simple d’un salarié qui refuserait ces modifications de son contrat de travail ! Nul doute que les salariés les moins qualifiés, les femmes et les jeunes seront encore une fois les plus exposés. Il ne faut donc pas vous étonner que la jeunesse exige le retrait de ce texte et vous auriez tort de sous-estimer ce mouvement.
Nous ne voulons pas nous en tenir à un statu quo inopérant, mais travailler à des dispositions modernes et équilibrées, qui explorent des formes nouvelles de salariat et offrent des droits nouveaux qui tiennent compte de la diversité et des contraintes des entreprises. En un mot, nous souhaitons un texte ouvert sur l’avenir, et le moins que l’on puisse dire est que celui-ci est loin du compte. Voilà pourquoi les députés du Front de Gauche et l’ensemble du groupe de la Gauche démocrate et républicaine combattront résolument ce texte.
Mme Isabelle Le Callennec. Nous pourrions souscrire, madame la ministre, à l’objectif d’« instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections pour les entreprises et les actifs » affiché dans le titre du projet de loi, mais nous aurions aimé être certains qu’il a aussi pour objectif de dé-rigidifier le marché du travail pour offrir des perspectives aux 6 millions de Français inscrits à Pôle emploi. Or, si la première version de ce texte contentait les entreprises, il n’en est plus de même de la deuxième. Ce sont pourtant les entreprises, singulièrement les PME et les TPE, qui créent les emplois, et elles hésitent à embaucher même lorsqu’elles le voudraient. Comment ferez-vous pour concilier des points de vue diamétralement opposés ? Pour qu’il y ait dialogue social, il faut être deux, et force est de constater que les ambitions divergent, comme nous le vérifierons demain en commission des affaires sociales : les auditions des organisations patronales et syndicales nous permettront de mesurer les désaccords. Vous avez dit, madame la ministre, que des désaccords étaient surmontables. Auxquels pensez-vous ?
Avant l’examen détaillé des articles la semaine prochaine, j’aborderai brièvement trois points. Tout d’abord, je m’interroge, comme le rapporteur Christophe Sirugue, sur la composition de cette commission d’experts qui va réécrire le code du travail. Je pensais que cette loi avait précisément pour ambition de réformer ce code et qu’il était donc demandé au législateur de le réécrire. Or l’article 1er du chapitre I confie ce soin à une commission d’experts.
Ensuite, sachez, madame la ministre, que la mise en œuvre du compte pénibilité, dont je crois savoir que vous le glissez dans le compte personnel d’activité, est très difficile dans la plupart des entreprises et que cela un coût pour elles.
Enfin, vous nous avez expliqué que le plafonnement des dommages et intérêts accordés par les prud’hommes ne serait pas discuté et que vous considériez que cela avait été évoqué dans la loi Macron. Le confirmez-vous ?
Par ailleurs, avez-vous compté les décrets auxquels renvoie ce projet de loi ? Leur nombre nous fait penser qu’il s’écoulera du temps d’ici à son application.
Mme la présidente Catherine Lemorton. C’est le cas pour beaucoup d’autres lois, chère collègue.
M. Gérard Sebaoun. La très grande majorité des économistes, et non des moindres – de la présidente du Conseil d’analyse économique auprès du Premier ministre à Daniel Cohen –, se sont exprimés sur le projet de loi. Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’ils ne sont guère favorables à votre postulat selon lequel elle entraînera la création d’emplois. En fait, ils ne savent pas. Pouvez-vous fournir à la Commission des éléments prouvant que cette modification du code du travail permettra bien la création d’emplois ? Les investissements des entreprises étrangères en France montrent plutôt que notre droit du travail n’est probablement pas le repoussoir absolu décrit par le MEDEF. Le rapport 2015 de Business France, qui vient de paraître, vante l’attractivité de notre pays. Avec 1 000 décisions d’investissements et 34 000 emplois, ce sont cinquante-trois pays qui croient à l’avenir de la France avec le code du travail tel qu’il est actuellement rédigé.
Ma seconde question porte sur les heures supplémentaires. Le projet de loi prévoit de généraliser la primauté de l’accord d’entreprise sur la convention de branche en matière de temps du travail. Très souvent, heureusement, les conventions de branche se sont opposées à ce que le taux de majoration de la rémunération des heures supplémentaires soit abaissé au-dessous de 25 %, même si un taux de 10 % est déjà possible. Demain, avec ce projet de loi, les accords d’entreprise risquent de limiter cette majoration à 10 %, au détriment des salariés. J’y vois là une possibilité de baisse du salaire. Ajoutons à cela que la possibilité de moduler le temps de travail non sur un, mais sur trois ans – certes sous réserve d’un accord de branche –, risque d’entraîner la disparition quasi automatique des heures supplémentaires.
M. Denis Jacquat. Pour embaucher, les entreprises ont besoin avant tout de lisibilité, de visibilité et, surtout, de pérennité. Ayons constamment ces mots à l’esprit avant de prendre une décision, surtout quand un texte aussi complexe nous est présenté.
Je voudrais en savoir plus sur la garantie jeunes, dont Gérard Cherpion a déjà parlé, et sur la pénibilité, dont nous avons déjà longuement discuté dans cette commission. Ce texte nous offre la possibilité de répondre au souhait des TPE d’être soulagées de la lourdeur administrative résultant des textes précédents.
M. Michel Liebgott. Il y a une semaine, Le Figaro indiquait que le taux de croissance serait bien plus important que prévu, que le taux d’investissement des entreprises était en progression et que la consommation des ménages était également au-delà des prévisions. On pourrait donc se demander pourquoi le Gouvernement met en œuvre une nouvelle réforme qui suscite tant de débats et de contestation, et qui ne sera appliquée qu’après les élections de 2017. C’est tout simplement parce qu’il est un gouvernement de réforme, parce qu’il veut développer le dialogue social et qu’il a déjà multiplié les textes dans ce domaine, de l’accord national interprofessionnel (ANI) de 2013 au texte plus récent de François Rebsamen sur le dialogue social et l’emploi. C’est surtout parce que les chiffres du chômage n’ont pas encore baissé. Ces réformes ont bien un effet sur les créations d’emploi – plus nombreuses que les suppressions –, mais, le solde démographique nous étant pour l’instant défavorable, cela ne suffit pas.
Ce texte entend trouver un équilibre entre flexibilité et sécurité pour l’ensemble des salariés et, bien sûr, de créer des emplois – mais il ne s’agit pas de permettre le développement des mini-jobs comme en Angleterre, ou de faire disparaître le salaire minimum, comme c’était encore le cas récemment en Allemagne, mais de conserver l’essentiel de notre contrat social, tout en l’améliorant, parce qu’il est notoirement insuffisant. On peut, pour cela, s’inspirer de ce qui s’est passé dans ma région, avec l’exemple de l’usine de Florange. La nationalisation, qui fut envisagée, aurait été un échec total. Un accord, placé sous le signe du dialogue social avec des syndicats, a été passé entre le Gouvernement et ArcelorMittal, et, aujourd’hui, dans la sidérurgie, on embauche.
M. Francis Vercamer. La flexisécurité est un enjeu majeur et un défi. La mondialisation, l’environnement technologique, les évolutions du numérique transforment profondément le monde du travail, la manière de travailler dans l’entreprise, les relations du travail et la relation au travail. Nous pouvions espérer que le Gouvernement avait l’ambition de relever ce défi. Force est de constater qu’il n’en est rien. À défaut, peut-être, d’avoir plus ouvertement affiché l’objectif, d’avoir plus précisément défini son ambition de parvenir à trouver ce nécessaire équilibre entre flexibilité et sécurité, il aboutit à un texte mal compris qui suscite l’inquiétude et a mis la jeunesse dans la rue.
D’une manière générale, nous n’avons pas l’impression que ce texte permette de dépasser la vision de l’entreprise comme lieu d’opposition entre les salariés et les employeurs. Bien sûr, vous ouvrez des espaces de négociation dans l’entreprise, et c’est évidemment une bonne chose, mais ils sont tellement encadrés, normés, bornés – dans tous les sens du terme, allais-je dire – que la liberté de négociation reconnue aux partenaires sociaux est quand même très relative. Les dispositions de ce texte, particulièrement dans la partie consacrée à l’emploi, sont trop orientées, à quelques exceptions près, vers le constat des difficultés de l’entreprise, alors qu’il s’agit, pour elle, d’anticiper pour relever les défis qu’elle doit affronter.
Au terme de nos débats en commission et en séance, nous verrons si ces quelques espaces de liberté laissés à la négociation auront subsisté. Pour le Gouvernement et la majorité, donner une place plus importante à la négociation en entreprise, je l’admets, constitue un pas en avant important. Il en reste cependant un à franchir pour que ce texte puisse être perçu comme un véritable acte de confiance dans l’entreprise.
Par ailleurs, le projet de loi ne parvient pas à relever le défi de la sécurité des transitions professionnelles, à sécuriser la mobilité professionnelle. Rendre les formations plus accessibles à ceux qui en ont le plus besoin, faciliter l’accès à la formation, la reconversion, le passage d’un emploi salarié au statut de travailleur indépendant, faciliter la reprise d’entreprises artisanales, la mobilité géographique ou professionnelle, voilà l’enjeu de la transition professionnelle, et le compte personnel d’activité ne donne pas la visibilité nécessaire. Madame la ministre, comment ce texte peut-il permettre un équilibre entre flexibilité et sécurité ?
Mme Chaynesse Khirouni. Ce projet de loi, madame la ministre, suscite de grandes inquiétudes et j’ai rencontré de nombreux chefs d’entreprise qui pensent que, loin de simplifier le droit du travail, il risque au contraire de le complexifier. En effet, la remise en cause de la hiérarchie des normes, permettant de déroger à des accords de branche, notamment en matière de durée du travail ou de congés, fait craindre à de nombreuses TPE et PME une distorsion de la concurrence, une plus grande complexité et le risque d’une plus grande subordination dans les rapports de sous-traitance. Cela nous a été confirmé par les représentants de l’Union professionnelle artisanale et de la Confédération de l’artisanat et des petites entreprises du bâtiment (CAPEB), qui estiment que le dialogue social au niveau de la branche est une source de sécurité juridique et d’harmonisation des règles sociales, et évite le dumping social. La négociation sociale nécessite une expertise et une méthode. Avec la loi de 2015, visant à renforcer le dialogue social, nous avions créé les commissions paritaires régionales, qui doivent constituer un cadre de discussion et de négociation efficace. Pourquoi, aujourd’hui, revoir ce dispositif, en privilégiant les accords d’entreprise ?
Évoquons aussi la situation des femmes au travail. Le Conseil supérieur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (CSEP) a émis des réserves significatives sur ce projet de loi. Or, nous le savons, sur le marché du travail, les femmes subissent plus que les hommes la précarité. Ainsi représentent-elles 80 % des salariés à temps partiel et des contrats précaires. Dans le même temps, elles sont les moins flexibles dans leur vie personnelle, puisqu’elles assument toujours, et bien plus que les hommes, les obligations familiales et domestiques. Je m’inquiète donc du risque qu’elles ne subissent davantage de pression dans les négociations qui s’ouvriront pour permettre des adaptations au niveau de l’entreprise. Il en va de même avec la possibilité de baisser la rémunération des heures complémentaires. Les femmes étant plus présentes dans les TPE et PME, il existe un risque accru de les fragiliser en renvoyant au niveau de l’entreprise la négociation sur les questions de temps de travail. Quelle est votre réponse face à ce risque et en quoi la fragilisation des droits des salariés permettrait-elle le développement de l’emploi ?
M. Gilles Lurton. Madame la ministre, quelles sont donc les « nouvelles libertés » que, selon son titre, vise à instituer ce projet de loi ? De mon point de vue, nos réflexions doivent se concentrer sur ce fait très concret : nous ne pouvons tolérer que 3,5 millions de personnes soient privées d’emploi – et les derniers chiffres ne sont pas faits pour nous rassurer, qui traduisent à eux seuls l’échec de votre gouvernement.
J’avais parfaitement compris en quoi certaines dispositions de la première version de votre projet de loi étaient susceptibles de redonner confiance aux entreprises et de relancer l’emploi des salariés. Aujourd’hui, pouvez-vous préciser quelles dispositions de cette deuxième version peuvent avoir cet effet ?
Le Premier ministre a insisté au début du mois de mars sur le fait que le CDI devait devenir la règle. Il concluait en affirmant que ce projet de loi offrait plus de visibilité pour les entreprises et plus de protection pour les salariés. Pouvez-vous préciser en quoi cette version édulcorée, exempte de toute mesure novatrice, donne plus de visibilité aux entreprises et plus de protection aux salariés ? Et en quoi s’adresse-t-elle aux petites et moyennes entreprises, comme l’affirme encore le Premier ministre, alors que tout passe par la négociation syndicale ?
Ma dernière question porte sur l’apprentissage. Le Président de la République s’est fixé comme objectif de parvenir à 500 000 apprentis à la fin de son mandat. J’ai bien compris que votre projet de loi comportait un certain nombre de dispositions sur l’apprentissage dans ses articles 32 à 37. J’ai bien compris, aussi, qu’il prévoyait une revalorisation des carrières des maîtres d’apprentissage, mais comment permettra-t-il d’atteindre les objectifs fixés par le Président de la République en matière d’apprentissage ?
Mme Fanélie Carrey-Conte. De nombreux économistes universitaires, des syndicalistes et des politiques, dont je fais partie, considèrent qu’il serait efficace, pour lutter contre le chômage, de poursuivre et d’amplifier le mouvement de réduction du temps de travail amorcé par la gauche en 1997. Je voudrais comprendre pourquoi le Gouvernement tourne aujourd’hui le dos à cet objectif, à cette ambition, en choisissant à l’inverse de favoriser l’allongement du temps de travail, notamment en facilitant la diminution, par voie d’accords d’entreprise, du taux de majoration de la rémunération des heures supplémentaires, en facilitant le dépassement de la durée quotidienne et hebdomadaire du temps de travail ou en mettant en place les accords dits « offensifs » de maintien dans l’emploi. Pour ma part, je vois dans cette logique une véritable régression et un contresens économique et social.
Ma deuxième question concerne le référendum qui pourrait être organisé à la demande des organisations syndicales atteignant 30 % des suffrages. Il ne s’agit pas d’être hostile par principe à toute forme de référendum, mais tout dépend, on le sait, des sujets sur lesquels ils porteraient et des contextes dans lesquels ils interviendraient. Avec le texte proposé aujourd’hui, les référendums qui se tiendront demain imposeront des choix cornéliens aux salariés, par exemple entre, d’une part, une augmentation du temps de travail ou une baisse de la rémunération et, d’autre part, des suppressions d’emplois ou des délocalisations. De quelle liberté de choix les salariés disposeront-ils dans ces conditions ? Pour qu’un référendum soit vraiment l’expression de la liberté de toutes les parties, il faut une égalité entre tous et non un lien de subordination. Or, il y aura, de toute façon, un lien de subordination. Je vois donc là une régression, parmi d’autres sur lesquelles nous aurons l’occasion de revenir longuement dans les débats en commission et dans l’hémicycle.
M. Yves Censi. Je suis assez impressionné par le flou des objectifs du projet de loi : on a beaucoup de mal à les retrouver dans la masse des articles. Quant aux quelques droits fondamentaux énumérés à l’article 1er, tels le respect de la dignité ou la protection des données personnelles, il ne s’agit là que d’une répétition de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et celle-ci s’applique, avec ou sans votre projet de loi. En fait de droits fondamentaux, c’est un peu de l’esbroufe : ces droits fondamentaux existent déjà et sont protégés.
En ce qui concerne l’expression des convictions religieuses, je ne fais pas partie de ceux qui vous accusent de faire entrer le communautarisme dans l’entreprise, mais je suis très étonné par votre rédaction : « La liberté du salarié de manifester ses convictions, y compris religieuses, ne peut connaître de restrictions que si elles sont justifiées par l’exercice d’autres libertés et droits fondamentaux ou par les nécessités du bon fonctionnement de l’entreprise et si elles sont proportionnées au but recherché ». Aujourd’hui, pour restreindre le droit de manifester ces convictions, il faut que la restriction présente un lien avec la tâche à accomplir et qu’elle soit proportionnée au but recherché. Si vous avez repris la dernière condition, quel est votre but lorsque vous supprimez la première ? De même, il n’y a pas de référence à une « exigence professionnelle essentielle et déterminante », formule qui figure pourtant dans le droit en vigueur.
Par ailleurs, vous indiquiez que « la loi détermine les conditions et limites dans lesquelles les conventions et accords collectifs peuvent prévoir des normes différentes » et que, « en cas de conflit de normes, la plus favorable s’applique aux salariés si la loi n’en dispose pas autrement ». C’est d’une grande ambiguïté. Je voudrais une réponse claire : êtes-vous d’accord pour qu’un accord d’entreprise puisse être moins favorable qu’un accord de branche ?
M. Jean-Patrick Gille. Je m’interroge sur le statut des principes essentiels du droit du travail, formulés par la commission Badinter. Dans le projet de loi, ils ne forment pas un simple préambule, et sont soumis à notre délibération. L’excellent travail accompli par la commission Badinter semble satisfaire tout le monde. Gérard Cherpion et moi-même avons proposé de suivre la même démarche pour la formation professionnelle, afin d’aider tout le monde à se repérer. Cependant, si nous délibérons de ces principes, je comprends mal le statut qu’ils auront. Pour tout dire, est-il vraiment nécessaire de les inscrire dans le texte ?
Le compte personnel d’activité regroupera le compte personnel de formation, qu’il faudrait consolider mais qui marche plutôt bien, le compte pénibilité, qui a déjà un impact sur le compte personnel de formation, et un compte engagement citoyen. Son champ sera étendu aux travailleurs indépendants et même, par ordonnance, à l’ensemble des agents publics – c’est l’objet de l’article 22. Les personnes qui n’ont pas atteint un niveau de formation sanctionné par un diplôme national ou un titre professionnel enregistré et classé au niveau V du répertoire national des certifications professionnelles bénéficieraient d’une surdotation – l’alimentation de leur compte se ferait à hauteur de quarante heures par an et le plafond serait porté à quatre cents heures. Je proposerais pour ma part de porter le crédit annuel à quarante-huit heures pour les autres, mais je me demande si cela se cumule.
Cela dit, ne devrait-on pas envisager d’indiquer que le compte d’activité est un compte temps ? Dans ce cas, je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas intégrer au compte d’activité le compte épargne-temps. Ce n’est peut-être pas encore abouti techniquement, mais nous pourrions envisager une externalisation de ce compte épargne-temps, dont certains sont déjà titulaires, à la Caisse des dépôts. Dans un deuxième temps, le principe du compte épargne-temps serait généralisé, et les comptes seraient externalisés à la Caisse des dépôts. Pourrait-on avancer sur cette voie ?
M. Arnaud Viala. Parce que votre texte intervient dans une période très délicate pour les territoires, les entreprises et les salariés, parce que vous l’avez présenté dans les médias comme la panacée, il a suscité trois grands espoirs : il allait résoudre tous les problèmes du moment ; il allait permettre une vraie discussion sur le rôle et la place du travail dans notre société, sur le rôle et la place des acteurs – entreprises et salariés – les uns par rapport aux autres ; il allait enfin déverrouiller la création d’emploi en donnant de la lisibilité aux entrepreneurs. Au bout du compte, je crains qu’il ne se solde par trois grandes déceptions.
Si l’on compare la première version et celle que vous défendez aujourd’hui – et qui serait en fait la troisième –, on voit que l’on a affaire à deux textes complètement différents. Le premier recueillait l’assentiment d’un grand nombre d’acteurs. Le dernier semble faire à peu près l’unanimité contre lui – nos échanges de cet après-midi le confirment. La méthode de la négociation que vous prônez et qui est au cœur du texte révèle son échec avant même que le Parlement n’entame l’examen du projet de loi : vous venez de passer des semaines, des mois, à discuter avec les uns et les autres, et aucun consensus ne s’est dégagé !
Enfin, le calendrier de la réforme déçoit. À plusieurs reprises dans votre exposé liminaire, vous avez évoqué 2019 comme la date à laquelle nous pourrions en voir les premiers effets. Je crains fort qu’il n’y ait plus alors 4 ou 5 millions de chômeurs, mais 6 ou 7, voire 8 millions, et que nombre d’entreprises n’aient disparu des écrans radars.
Madame la ministre, pouvez-vous citer une disposition de ce texte qui marquerait une avancée pour le salarié et une autre qui marquerait une avancée pour les PME-TPE ? Et pouvez-vous indiquer par quelles mesures ce texte est susceptible de relancer l’emploi ?
Mme Martine Carrillon-Couvreur. Madame la ministre, il était nécessaire de prendre, comme vous l’avez fait, le temps de la concertation, grâce auquel des mesures importantes ont pu être inscrites dans le projet de loi. Nous partageons bien sûr votre souci de la négociation collective, du dialogue social et de la protection des salariés, comme de l’accompagnement des entreprises, en particulier les PME et les TPE, et nous aurons l’occasion de faire des propositions au cours des débats pour enrichir encore le texte. Mais j’appelle votre attention sur la situation des salariés en situation de handicap. Leur taux de chômage, qui atteint 22 %, demeure deux fois plus élevé que celui des autres salariés. Ils représentent la moitié des chômeurs de longue durée, et le handicap est la deuxième cause de discrimination à l’embauche, comme le rappelait le Défenseur des droits. Nous connaissons les raisons de cette situation : un manque de qualification, l’absence de formations adaptées, des lourdeurs administratives, un manque d’accompagnement des entreprises.
Le texte comporte des dispositions de droit commun qui bénéficieront aux travailleurs handicapés, par exemple le congé de proche aidant prévu par l’article 3, le compte personnel d’activité, le compte personnel de formation, qui sera d’ailleurs abondé par l’Association de gestion du fonds pour l’insertion professionnelle des personnes handicapées (AGEFIPH), la garantie jeunes, le droit à la déconnexion, le développement du télétravail, etc. Cela ne suffit cependant pas, il faut aller plus loin. Je voudrais, madame la ministre, que nous puissions examiner la possibilité d’un cadre national unique pour les accords handicap dans les entreprises, avec des critères d’agrément et des outils de suivi communs, mais nous aurons l’occasion d’y revenir.
M. Rémi Delatte. Votre motivation initiale, madame la ministre, nous paraissait plutôt intéressante, et nous pouvions adhérer à plusieurs points de votre projet de loi. Mais nous ne voyons pas très bien, dans cette deuxième ou troisième version, comment sera limité le « formalisme » si contraignant du dialogue social – je ne fais là que reprendre votre expression.
Nous ne voyons pas non plus en quoi ce projet de loi va mettre le droit du travail au service de l’emploi. Or c’est bien cette préoccupation qui doit rapprocher les uns et les autres. Nos entrepreneurs attendent que l’on clarifie et que l’on simplifie, ils attendent également que les contraintes soient limitées. Or, aujourd’hui, vous prenez la direction opposée. Ainsi êtes-vous revenue sur le plafonnement des indemnités prud’homales. Accepterez-vous, madame la ministre, de réintroduire ce facteur de visibilité pour l’entreprise ? Accepterez-vous également de réintroduire le forfait jour dans les PME ? Ce levier a toute sa pertinence dans les petites entreprises. Enfin, pourquoi être revenue sur la possibilité d’offrir une certaine souplesse en matière d’apprentissage, en particulier sur le temps de travail ? Cela aurait indéniablement constitué un encouragement pour l’apprentissage.
Mme Isabelle Attard. Madame la ministre, en 2015, la France est le quatrième pays au monde à avoir versé le plus de dividendes à ses actionnaires : 47 milliards de dollars ! Dans le même temps, la fraude fiscale des plus riches continue de battre des records. Selon le rapport du sénateur Éric Bocquet, c’est un montant compris entre 60 et 80 milliards d’euros qui échappent aux caisses de l’État en raison de l’évasion fiscale. Or cet argent qui manque est la justification des politiques d’austérité des gouvernements UMP puis socialiste, de cette austérité qui grippe toute l’économie de la France en vidant les carnets de commandes.
Madame la ministre, pourquoi voulez-vous que les travailleurs portent le poids des problèmes des entreprises ? Pourquoi le code du travail, qui protège la santé des travailleurs, leur vie privée, leur vie tout court, devrait-il servir de variable d’ajustement ? Vous parlez de le simplifier, et, certes, il est un peu compliqué, mais pas autant qu’on tente de le faire croire. Pourquoi une loi qui le complexifie et le rallonge ? La partie du code consacré au temps de travail fait aujourd’hui 100 pages, votre projet de loi en ajouterait une vingtaine.
Le mouvement citoyen « On vaut mieux que ça ! » a récolté des milliers de témoignages. En voici quelques-uns : « nous survivons à deux sur mon SMIC » ; « mon patron me demande de faire avorter ma conjointe » ; « régulièrement, je me brûlais chimiquement le genou » ; « on me refusait les heures supp », parce que, « tu comprends, déjà que tu es là que la moitié du temps et que tu as des congés… » ; « licencié en apprentissage pour avoir été malade » ; « elles n’arrivent même plus à crier tellement on leur a fait entrer dans le crâne qu’elles n’avaient pas le droit ». Il y a aussi, en plus de ces milliers de témoignages, des citations d’employeurs : « c’est déjà une faveur que je vous fais en vous donnant du travail » ou bien « il y en a plein d’autres derrière toi qui attendent, estime-toi heureux ! » C’est aussi cela, la réalité en entreprise, des relations déséquilibrées entre un employeur qui ordonne et un salarié qui doit obéir.
Vouloir renvoyer au niveau de l’entreprise la négociation des droits, c’est prendre le risque que des salariés sous pression acceptent de céder le peu qu’ils ont. Les salariés ont bien du mal aujourd’hui à connaître les droits que leur accorde le code du travail, et encore plus de mal à les faire respecter. Qu’en sera-t-il demain, quand ils devront apprendre de nouveaux accords d’entreprise et de branche à chaque nouvel emploi ?
Madame la ministre, dix députés du groupe écologiste demandent le retrait pur et simple de ce projet. Quant à moi, il me reste une place de disponible à dix-neuf heures dans la salle de cinéma de l’Assemblée pour voir Merci patron ! Vous êtes la bienvenue !
Mme la présidente Catherine Lemorton. Chère collègue, il existe aussi des employeurs respectueux des salariés et des entreprises dans lesquelles les choses se passent bien !
M. Jean-Louis Costes. Nous sommes tous conscients de la nécessité de réformer en profondeur le droit du travail et les relations sociales dans notre pays. Si besoin était, les 38 000 chômeurs supplémentaires enregistrés au mois de février nous le rappelleraient avec cruauté. Mais il nous faut une véritable réforme, pas une réformette ou, en l’espèce, un texte fourre-tout dont certaines dispositions peuvent même se révéler contre-productives – en ramenant de trois à un an la durée de l’expérience requise pour entrer dans les dispositifs de valorisation des acquis de l’expérience (VAE), vous risquez, par exemple, de déstabiliser notre système de formation professionnelle.
La relation entre les entreprises et l’inspection du travail doit impérativement faire l’objet d’une modernisation. L’article 28 du projet de loi donne à l’employeur d’une entreprise de moins de trois cents salariés le « droit d’obtenir une information précise et délivrée dans un délai raisonnable lorsqu’il sollicite l’administration sur une question relative à l’application d’une disposition du droit du travail ». Cela crée une insécurité juridique durant une période incertaine. Pourquoi ne pas évoluer vers la formule, désormais courante dans notre droit, selon laquelle la non-réponse de l’administration vaut acceptation implicite après un délai donné ?
Vous n’osez pas aborder directement la question de la représentativité des organisations syndicales, bien qu’elle se lise en filigrane dans votre texte. Vous avez réintroduit l’extension du mandatement, ce qui va constituer un véritable problème pour nos petites entreprises.
M. Richard Ferrand. Les articles 45 à 50 du projet de loi forment son titre VI. Dans le cadre de la lutte contre le détachement illégal ou abusif de travailleurs, ils prévoient le renforcement de diverses obligations, notamment celle de vigilance du donneur d’ordres et du maître d’ouvrage à l’égard des sous-traitants.
On ne peut que se féliciter de l’action constante qu’ont menée le Gouvernement et la majorité sur ce sujet depuis 2012, tant sur le plan européen, avec la révision de la directive de 1996 sur le détachement des travailleurs, qu’au plan national, puisque les mesures qui nous sont proposées s’inscrivent dans la continuité des dispositions votées dans la loi du 10 juillet 2014 visant à lutter contre la concurrence sociale déloyale, et dans celle du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques.
L’article 46 créé une contribution visant à compenser les coûts administratifs engendrés par le détachement en France de salariés par des employeurs établis à l’étranger. La contribution sera due pour tout détachement de salarié en France, son montant étant fixé par décret. Comment envisagez-vous l’articulation de cette « taxe » avec le droit européen ? Ne craignez-vous pas qu’elle puisse être considérée comme une entrave à la libre circulation des travailleurs ? En la matière, nous savons qu’il n’est nul besoin de seuil d’effectivité : la potentialité d’une entrave peut être suffisante pour que l’on juge que nos pratiques sont contraires aux règles européennes. Entendez-vous légitimer cette contribution au motif du service rendu ? Comment comptez-vous surmonter ce risque juridique au regard du droit européen ?
La Commission européenne a présenté, le 8 mars dernier, sa proposition de directive d’application de la directive de 1996 sur le détachement des travailleurs. L’une de ses dispositions encadre l’un des trois types de détachement : celui effectué via des entreprises de travail temporaire – on compte 33 000 travailleurs détachés en France par ce type d’entreprise. Il est ainsi proposé qu’un travailleur intérimaire soit employé aux mêmes conditions, qu’il relève d’une agence d’intérim française ou qu’il soit détaché en France par une agence transfrontalière de travail temporaire. Cela permettra de supprimer l’avantage concurrentiel issu du différentiel de coût du travail entre États membres, sachant qu’en 2011 on dénombrait 18 000 Français détachés en France via des agences d’intérim luxembourgeoises. Comment accueilleriez-vous un amendement qui viserait à transposer « par anticipation » une telle mesure ?
M. Bernard Perrut. Madame la ministre, en vous écoutant, je songeais aux 6 millions de personnes à la recherche d’un emploi, qui se battent et qui galèrent. Ce texte constitue-t-il un espoir pour eux ? Que changera-t-il vraiment ?
Je ne doute pas de votre volonté, et je constate que votre texte propose certaines évolutions. Quels que soient les bancs sur lesquels nous siégeons, nous souhaitons évidemment tous favoriser l’emploi, permettre aux entreprises d’anticiper les mutations économiques, protéger les salariés, favoriser le dialogue social, mais aussi adapter les règles du travail aux réalités de l’activité économique. J’ose parler du besoin de « flexisécurité », thème sur lequel une mission d’information de la commission des affaires sociales de notre assemblée avait travaillé lors de la précédente législature.
La réforme du code du travail n’aura vraiment son plein effet que si la croissance et la confiance sont au rendez-vous, si l’on baisse les charges et les contraintes, et si les carnets de commandes se remplissent parce que la consommation reprend, que les marchés extérieurs se développent et que les investissements redémarrent – je pense aux coupes claires de l’État dans les ressources des collectivités locales qui ne peuvent plus investir.
Nous sommes favorables à la garantie jeunes à condition qu’elle soit assortie de critères stricts en matière de motivation et de situation. Il ne doit pas s’agir d’un droit universel sans contrepartie mais, au contraire, d’une véritable prise en compte du cas individuel de chaque jeune pour permettre son insertion et sa formation, afin qu’il soit guidé vers l’emploi.
Les emplois saisonniers concernent de nombreux jeunes. Sur 1,5 million d’emplois de ce type, les deux tiers doivent se trouver dans le secteur agricole. J’aimerais être sûr que les mesures que vous proposez en la matière vont dans le bon sens, car notre agriculture a besoin de souplesse – pensez à la cueillette des fruits ou à la viticulture…
Il est vrai qu’il existe aujourd’hui un vide juridique pour les salariés en contrat aidé des collectivités territoriales : ceux qui ont signé un contrat d’accompagnement dans l’emploi ne bénéficient d’aucune formation. Cependant, la mesure que vous proposez pour résoudre ce problème aura un coût pour les collectivités correspondant à 0,05 % de leur masse salariale. Les soutiendrez-vous ? Comment le dispositif sera-t-il mis en place ?
Il faut renforcer la formation professionnelle en apprentissage. Je salue votre volonté de compléter la liste des établissements qui pourront bénéficier de la taxe d’apprentissage : elle comprendra désormais les établissements privés sous contrat d’association avec l’État. Il faut affirmer encore plus clairement une réelle motivation à ce sujet, et mettre des moyens sur la table pour soutenir les jeunes qui choisissent cette voie.
M. Michel Issindou. Madame la ministre, votre projet de loi va dans le bon sens : celui du dialogue social, celui des textes que nous examinons depuis quatre ans dans notre commission. Il poursuit un objectif partagé par tous : redonner aux entreprises la capacité de créer de l’emploi. Il prouve que l’on peut conjuguer la nécessaire flexibilité avec la sécurité des salariés, qui est tout aussi nécessaire. Le compte personnel d’activité, tel qu’il a été enrichi ces derniers jours, le montre amplement.
Depuis quarante ans, nul n’a trouvé la solution miracle pour juguler le fléau du chômage. Si beaucoup de croyances circulent, et si ceux qui ont des réponses sont nombreux, l’immobilisme serait la pire des solutions : c’est celle que vous n’avez pas choisie.
L’article 44 est consacré à la médecine du travail, sujet sur lequel le Gouvernement m’avait confié une mission l’année dernière. J’ai constaté ses carences. Elle ne parvient pas à accomplir les tâches que le législateur lui a confiées. Sa situation continue de se dégrader : l’effectif actuel de 5 000 médecins du travail sera divisé par deux d’ici à moins de quinze ans. Sur les 30 millions de visites médicales annuelles obligatoires, seules 9 millions ont vraiment lieu. Il faut agir rapidement pour que la médecine du travail reste ce qu’elle doit être : une bonne médecine au service des salariés et de leur santé.
Il faut aussi agir davantage en matière de prévention – autant éviter que la santé ne se dégrade –, et tout faire pour maintenir dans l’emploi ceux qui le peuvent grâce au médecin du travail, en bannissant les solutions systématiques et en donnant la priorité à ceux qui en ont besoin.
Madame la ministre, je ne doute pas que, après nos travaux, votre texte trouvera une majorité pour l’adopter. Ce projet de loi est absolument nécessaire pour essayer d’en finir avec le véritable cancer que le chômage représente pour notre société.
M. Dominique Tian. Madame la ministre, je vous ai déjà alertée sur les difficultés économiques que rencontre la mission locale de la ville de Marseille. Elle traite tous les ans les dossiers d’environ mille jeunes. Les aspects financiers de la garantie jeunes ont donc retenu mon attention.
Ce dispositif ne figurait pas dans le texte initial : il a été introduit après que les jeunes sont descendus dans la rue. Le Premier ministre aurait même parlé d’une garantie jeunes universelle, mais il ne me semble pas que son financement soit prévu.
Vous souhaitez que la garantie jeunes s’applique à plus de 100 000 jeunes alors que vous n’envisagez de consacrer au dispositif que 600 millions d’euros, en appelant l’Union européenne à la rescousse par l’intermédiaire du Fonds social européen (FSE). Or nous savons que nous ne récupérons le FSE qu’avec un an et demi ou deux ans de retard – sans même compter la longueur de l’établissement des dossiers administratifs. Nous risquons donc d’avoir un problème de financement. De plus, vous avez décidé que 70 % du paiement serait effectué sur des objectifs, et 30 % sur des variables dont l’État serait le maître d’œuvre. Cela représenterait beaucoup d’incertitudes pour les missions locales qui dépendent des villes. À Marseille, le travail accompli est utile, c’est certain, mais, financièrement, nous ne pourrons pas suivre. Pouvez-vous nous rassurer sur ce sujet ?
Mme Annie Le Houerou. Les travailleurs handicapés sont les plus exposés au chômage, mais aussi au licenciement suite à une inaptitude. Pourtant, depuis la loi de 2005, nous sommes engagés dans la construction d’une société inclusive. Cela vaut pour l’école, mais également pour l’entreprise qui doit pouvoir offrir des emplois en milieu ordinaire. C’est pourquoi je souhaite, madame la ministre, que votre projet de loi fasse une meilleure place aux travailleurs handicapés – 80 % le sont devenus au cours de leur vie professionnelle. La médecine du travail doit être mobilisée pour prévenir la désinsertion professionnelle. Il faut trouver, avec les employeurs, les salariés et les partenaires, des solutions d’accompagnement dans l’emploi. L’entreprise doit être davantage sensibilisée à ces questions.
Je proposerai que votre texte prévoie de donner explicitement une nouvelle mission au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) pour contribuer à faciliter le maintien dans l’emploi ou l’accès à l’emploi des personnes handicapées. L’emploi accompagné dans l’entreprise, y compris par une aide humaine, doit avoir été envisagé et étudié avant que l’employeur ne se sépare d’un salarié rencontrant des difficultés d’intégration professionnelle du fait de la survenue d’un handicap. L’employeur doit tout mettre en œuvre pour maintenir dans l’emploi une personne confrontée au handicap. Ce n’est pas le cas aujourd’hui ; l’inaptitude est trop souvent proposée.
M. Philippe Noguès. Les jeunes sont inquiets, et je crains que cela ne soit à juste titre. Vous avez annoncé, le 15 mars dernier, que la garantie jeunes, dispositif visant les jeunes de moins de vingt-cinq ans en difficulté d’insertion, deviendrait un droit universel. Selon vos propos, 900 000 jeunes de moins de vingt-cinq ans sont en situation de précarité. Ils seraient donc éligibles à cette garantie jeunes. Même si tous ne la demandent pas – on voit ce qu’il en est de la prime d’activité par exemple –, le nombre de personnes potentiellement concernées resterait vertigineux, ce qui pose un certain nombre de questions. Si l’on table sur le fait que 500 000 jeunes recevraient 460 euros par mois, le coût estimé dépasserait légèrement 1,5 milliard d’euros par an. Comment le Gouvernement compte-t-il financer cette mesure ?
La garantie jeunes était jusqu’à ce jour gérée par des missions locales qui n’ont accompagné que 46 000 précaires en deux ans. Comment feront-elles, demain, face à un afflux de demandeurs sans augmentation de leurs moyens humains et financiers ? Je sais que le Gouvernement vise en réalité l’entrée dans ce dispositif de 200 000 jeunes d’ici à 2017, mais peut-on alors encore parler d’universalité, sachant que le public potentiel est de 900 000 personnes ?
Mme Bernadette Laclais. Madame la ministre, je vous remercie d’avoir donné votre accord, dès votre nomination, à la poursuite des travaux que mène, sur l’initiative de votre prédécesseur, un groupe de députés et de sénateurs, concernant la question du travail saisonnier.
Le phénomène est si complexe, avec une multitude de types de contrats et de secteurs concernés, qu’il est parfois bien difficile de savoir comment il évolue. Il touche en tout cas plus particulièrement les jeunes et les femmes. Les travaux effectués relèvent généralement de métiers peu qualifiés, souvent payés au SMIC, ou à peine plus, pour des horaires atypiques. Ces emplois cumulent donc toutes les caractéristiques des emplois précaires et de mauvaise qualité, sachant que les personnes concernées rencontrent aussi des problèmes spécifiques liés au travail saisonnier comme ceux relatifs à l’accès au logement et au transport.
Le Premier ministre avait donné son accord pour que ce projet de loi permette des évolutions positives pour les travailleurs et les salariés saisonniers. Je constate que ses articles 39 et 40 reprennent en partie les préconisations que nous avons formulées, Annie Genevard et moi, dans le rapport que nous avons remis au Gouvernement, en septembre dernier, sur l’évolution de la loi montagne. Il reste toutefois encore du chemin à parcourir.
Madame la ministre, comment accueilleriez-vous une proposition concernant le contrat de travail intermittent ? Le projet de loi pourrait traiter des deux causes qui expliquent qu’il ne soit pas utilisé. Seriez-vous prête à vous prononcer positivement sur des évolutions en matière de groupements d’employeurs ? L’article 40 constitue une première étape, mais nous pouvons aller plus loin.
Il faut trouver une solution gagnant-gagnant. Les entreprises ont besoin de salariés qualifiés, de plus en plus qualifiés, y compris dans le secteur du tourisme. Pour rester leader, notre économie touristique de montagne a besoin de salariés formés et « stabilisés ». Les salariés, de leur côté, ont besoin de sécurité. Comment être efficace dans son travail lorsque de multiples contraintes et incertitudes pèsent sur sa vie personnelle et professionnelle ?
M. Jean-Pierre Door. Madame la ministre, l’attente créée par votre projet de loi ne doit pas être déçue si nous voulons relancer une dynamique de création d’emplois. Vous le disiez d’ailleurs vous-même en visitant, la semaine dernière, l’usine Toutenkamion de Ladon, dans ma circonscription.
Votre projet de loi était ambitieux, dans sa première version. Il va indéniablement dans le bon sens, car il est susceptible de faire bouger les lignes sur le front de la création d’emplois. Il faut cependant parvenir à se placer loin des postures politiques et des contraintes d’appareil. J’espère que l’intérêt collectif va redevenir le centre de nos discussions. Pour une fois, l’opposition ne vient pas d’où vous l’auriez attendue ! J’espère que le climat redeviendra serein dans votre majorité et que nous pourrons avancer ensemble avec ce projet fondamental pour l’avenir.
Mme Kheira Bouziane-Laroussi. Madame la ministre, vous avez affirmé que votre texte avait pour objectif de renforcer le dialogue social. On peut toutefois se demander si la modification de l’article L. 2232-12 du code du travail relatif aux conditions de signature d’un accord collectif – qui semble s’inspirer de ce qui s’est produit à la FNAC pour l’ouverture du dimanche – n’aura pas pour conséquence un recul du poids des organisations syndicales.
Le vingt-sixième des principes essentiels du droit du travail cités dans l’article 1er du projet de loi est ainsi rédigé : « Tout licenciement doit être justifié par un motif réel et sérieux. » Ce motif sera-t-il toujours contrôlé par un juge, ou le Gouvernement compte-t-il dresser une liste des motifs qui seront considérés par avance comme « réels et sérieux », comme cela est déjà le cas pour les accords de mobilité ? Quel sera le pouvoir du juge sur le contrôle du motif du licenciement ?
Le vingt-neuvième principe prévoit notamment que « le licenciement est précédé d’un préavis d’une durée raisonnable ». Pourquoi ne pas maintenir les délais de préavis déjà prévus par la loi ? Ce délai est indispensable pour que le salarié retrouve un emploi et prenne certaines dispositions.
M. Philip Cordery. Madame la ministre, je me félicite des avancées récentes de ce texte et de la capacité de dialogue dont vous avez fait preuve, que ce soit avec les partenaires sociaux, les organisations de jeunesse ou les parlementaires. Il dessine aujourd’hui les contours d’une flexisécurité à la française qui permet d’allier une souplesse encadrée, un renforcement des droits des salariés et un dialogue social assumé.
Ce texte crée de nouveaux droits et permet de faire de nouveaux progrès. Je pense à la garantie jeunes, au droit du salarié à la déconnexion, aux évolutions en matière de détachement de travailleurs, mais aussi, évidemment, au compte personnel d’activité qui en constitue le cœur.
Le CPA donnera aux salariés une véritable sécurité dans leur parcours professionnel. Il leur permettra de mieux passer d’un emploi à un autre, en particulier grâce aux droits à la formation et à la fongibilité. Je m’interroge néanmoins sur son périmètre. Pensez-vous que, au cours du débat, nous pourrons l’élargir au compte épargne-temps et aux droits à congé afin de renforcer les possibilités de formation des salariés ?
Il est également essentiel que l’accompagnement soit personnalisé pour que ceux qui sont le plus loin de l’emploi puissent en bénéficier.
Seule la visibilité pourra créer les vraies conditions de l’appropriation du dispositif par les salariés. Le portail en ligne du CPA doit être le plus clair possible. Une carte, du type carte Vitale, pourrait permettre à chaque salarié de connaître les droits attachés à son compte.
La mobilité étant aussi européenne, il faudra également faire en sorte que les droits restent acquis aux salariés, notamment les droits à la formation, lorsqu’ils partent travailler dans un autre pays de l’Union européenne. Ce sujet sera au cœur du rapport d’information sur le projet de loi, que je présenterai mardi prochain devant la commission des affaires européennes.
Mme la présidente Catherine Lemorton. Madame la ministre, je souhaite à mon tour vous interroger, sur la définition du motif du licenciement économique telle qu’elle est précisée à l’article 30. Les difficultés économiques y sont en effet « caractérisées » soit par divers indicateurs précis et chiffrés – baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, pertes d’exploitation, dégradation de la trésorerie –, soit par « tout élément de nature à justifier de ces difficultés ». Il me semble que l’on peut tout mettre dans cette dernière formule pour justifier un licenciement. Je souhaiterais avoir un éclaircissement sur ce point.
Mme la ministre. Vous me permettrez de faire une remarque d’ordre général avant que je ne réponde à vos questions. Le code du travail est épais parce que nous avons tenté de nous adapter à la multiplicité des besoins qui émergeaient sur le terrain – les dérogations étaient d’ailleurs souvent demandées par la partie patronale. Je crois que ce système est aujourd’hui à bout de souffle.
Avoir confiance dans la négociation, en réaffirmant le rôle de la branche et celui de l’entreprise, ce n’est absolument pas donner un chèque en blanc aux entreprises. C’est avoir conscience qu’il faut trouver au plus près du terrain, avec les représentants légitimes des salariés que sont les syndicats, les moyens de s’adapter. L’acte de confiance se fait à la fois en direction des organisations syndicales, des salariés et des chefs d’entreprise.
Combien de fois entendons-nous dire qu’une entreprise n’a pas pu répondre à un pic d’activité ou à une grosse commande ? Aujourd’hui, il n’existe que des solutions de contournement. On contourne en faisant appel aux travailleurs détachés ou aux indépendants, en ayant recours à l’intérim de façon massive, en donnant la préférence à la signature d’un CDD, même si cela coûte beaucoup plus cher, plutôt qu’à un recrutement en CDI parce que l’on pourrait perdre un client ou un contrat dans les huit mois à venir. Voilà la réalité que je me suis attelée à traiter dans ce projet de loi !
Ma vision du dialogue social n’est ni naïve ni béate : je ne considère pas que le salarié se trouve à égalité face à son employeur. J’ai pleinement conscience que cette relation est déséquilibrée. Mais parce que j’ai confiance dans le dialogue social, je sais que les militants syndicaux sont accompagnés et formés par des structures, je sais qu’ils sont défendus par le collectif, tout comme les salariés. Cette cohérence est au cœur de ce projet de loi qui renforce la formation et la position des acteurs du dialogue social. Je le répète : ce texte n’est pas un chèque en blanc donné aux entreprises.
En France, seulement 18 % de la population fait confiance aux représentants syndicaux – cette proportion descend à 11 % s’agissant du personnel politique. Je ne veux pas dénigrer les corps intermédiaires : toute démocratie en a besoin. C’est pour cela que le projet de loi ne laisse en aucun cas le salarié seul à l’employeur. Il renforce les acteurs du dialogue social.
Notre droit est protecteur, et on ne peut que s’en réjouir. La santé et la sécurité au travail restent évidemment des piliers de notre droit. Mais nous perdons des postes dans l’industrie depuis le deuxième trimestre de 2001 : en quoi nos protections ont-elles évité des licenciements dans l’industrie ? Comment l’Allemagne a-t-elle surmonté la crise de 2008 ? Elle a d’abord eu recours à l’activité partielle. Nous pouvons être fiers d’avoir porté la réforme de l’activité partielle en 2013 : nous avons rejoint l’Allemagne sur ce plan. Elle a aussi été en mesure de moduler, d’introduire de la souplesse en matière de travail. Résultat : en Allemagne, les salariés travaillaient à temps partiel et bénéficiaient de formations, alors qu’en France on licenciait. La reprise économique venue, les Allemands disposaient d’une main-d’œuvre qualifiée et toujours en poste ; ce n’était pas notre cas.
Je suis convaincue que la démarche que nous adoptons est la bonne. Je suis convaincue que, pour lever les blocages, nous devons trouver de nouvelles formes de régulation sociale qui passent par un dialogue social au plus près de l’entreprise. Dès lors que le droit actuel s’applique si aucun accord n’est signé, quel risque prend-on en essayant de conclure un accord ? C’est, en quelque sorte, un aveu de faiblesse de refuser que la négociation ait lieu au plus près de l’entreprise. Je crois aux organisations syndicales et en leur pouvoir en matière de négociation. C’est cela qui se joue aujourd’hui.
Certains syndicats considèrent que nous sommes à la croisée des chemins en matière de dialogue social. C’est vrai, et ce texte leur permet justement de redonner du sens au dialogue social et de renforcer leur légitimité. C’est pour cela qu’il s’agit à mes yeux d’un projet social-démocrate complètement assumé.
Je sais très bien ce qui se passe chez nos voisins européens. Je rencontre mes homologues. Nous ne proposons ni le contrat zéro heure ni les mini-jobs à l’allemande. Ce n’est pas cela, notre projet ! Nous proposons au contraire un renforcement du dialogue social pour mieux nous adapter à la demande. Bien sûr, l’embauche passe par un carnet de commandes rempli, mais il faut traiter la réticence à signer des CDI, qu’elle soit fondée sur des faits réels ou des éléments ressentis. En tant que ministre du travail et de l’emploi, je souhaite la traiter.
Monsieur le rapporteur, madame Le Callennec, les partenaires sociaux ne seront pas membres de la commission de refondation, dont le rôle sera de fournir une expertise au Gouvernement et non de négocier une réforme du droit du travail. Ils seront néanmoins très étroitement et concrètement associés à ses travaux. C’est à la fois une question de principe et une nécessité, puisque la réforme donnera une place sans précédent à la négociation, ce qui va dans le sens du rapport Combrexelle.
À ce sujet, sachez que j’ai non seulement lu l’article L. 1 du code du travail, mais que je l’ai appliqué ! Le 16 septembre dernier, j’ai demandé par courrier à l’ensemble des partenaires sociaux s’ils souhaitaient ouvrir une négociation sur les suites au rapport Combrexelle. Comme ils ne l’ont pas souhaité, nous avons mené des concertations bilatérales avec chacun d’entre eux.
Les partenaires sociaux ont toujours été associés à toutes les grandes réformes en matière de travail et d’emploi. J’ai mené une concertation avec eux sur l’intégralité du projet de loi. Certains arbitrages ayant été rendus tardivement, l’article relatif aux licenciements économiques n’était pas encore sur la table lors de cette première phase. Nous avons déjà reconnu qu’il avait manqué un temps d’explication, d’autant que des fuites avaient eu lieu dans la presse – je me souviens que M. Gérard Cherpion a été fort mécontent de découvrir le texte du projet de loi dans Le Parisien.
Les partenaires sociaux seront donc évidemment associés au travail de la commission de refondation. Je souhaite aussi qu’elle puisse accueillir en son sein des personnalités ayant un passé de syndicaliste, mais également des chefs d’entreprise. Sa composition n’aura rien à voir avec celle du comité chargé de définir les principes essentiels du droit du travail, présidé par M. Robert Badinter, dont les membres étaient des juristes.
Il est vrai que les soixante et un principes dégagés par le comité Badinter ont été établis à droit constant. À l’instar de M. Jean-Denis Combrexelle, plusieurs voix ont toutefois fait remarquer que leur insertion en tête du code du travail présentait un risque en termes de sécurité juridique au regard du nombre de textes en vigueur. Nous avons en conséquence souhaité ne pas en faire un préambule du code tout en nous assurant qu’ils guideraient le travail de la commission de refondation. Certains d’entre vous m’interrogent sur l’opportunité de les inscrire dans la loi. Il vous revient de prendre une décision en la matière, et il ne me revient pas de donner des injonctions au législateur.
Devrions-nous attendre les retours d’expérience pour généraliser les accords majoritaires ? Dès lors que nous élargissons l’objet des négociations, il est à mon sens essentiel d’affirmer le principe majoritaire qui garantit que les accords sont fondés sur un consensus large. Aujourd’hui, personne n’est dupe : tout le monde sait que l’on peut moduler le temps de travail sur la base d’un accord signé par des organisations syndicales représentant 30 % des salariés. Demain, ce ratio passera à 50 %. Les accords pourront ainsi être plus ambitieux en termes de contenu et plus efficaces dans leur mise en œuvre. Je tiens en conséquence à ce que le principe majoritaire soit inscrit dans la loi. Il s’agit d’une garantie apportée aux salariés et d’une évolution majeure.
J’entends cependant ceux qui s’inquiètent qu’une telle disposition puisse bloquer le dialogue social. Nous avons déjà prévu qu’elle s’applique, dès l’entrée en vigueur de la loi, pour les accords collectifs qui portent, par exemple, sur la durée du travail, les repos et les congés, mais, seulement à partir du 1er septembre 2019 pour ceux qui concernent une série d’autres sujets.
Le Premier ministre s’est engagé à présenter le bilan d’étape que vous réclamez à juste titre. Il sera présenté avant la généralisation du dispositif, et je suis évidemment prête à ce que cette précision soit apportée dans la loi.
Quant à la portabilité des droits acquis par le salarié et inscrits sur son CPA, elle sera pleine et entière grâce à ce dispositif : qu’il change d’emploi ou même de statut, ils lui seront conservés tout au long de sa carrière professionnelle. Aujourd’hui, la portabilité ne concerne que le secteur privé. Elle sera étendue aux travailleurs indépendants et aux travailleurs des plateformes collaboratives pour lesquels le droit à la formation sera ainsi ouvert dès 2018. Le principe de la portabilité fera l’objet d’un article dans le code.
S’agissant de la fongibilité des droits ouverts sur un CPA, nous voulons surtout que la personne titulaire décide elle-même de les exercer ou non. Cette capacité de décision sera augmentée. Les droits acquis pourront être utilisés pour de la formation, mais aussi pour de la validation des acquis de l’expérience ou de l’appui à la création d’entreprise, grâce à un soutien en management, en comptabilité ou au financement d’un bilan de compétences. Le nouvel espace numérique qui sera mis en place facilitera la conversion des droits inscrits sur le compte pénibilité en droit à la formation.
Qu’en est-il des agents publics, pour que le CPA soit réellement universel ? Je suis naturellement cette question avec ma collègue Annick Girardin. Il s’agit d’une revendication des syndicats, et nous devons nous donner le temps de la concertation. En l’occurrence, la fonction publique ne part pas du même point que le privé : elle n’a pas de compte personnel de formation (CPF), la question des parcours professionnels ne se pose pas pour elle dans les mêmes termes, elle bénéficie de la garantie de l’emploi et le statut des fonctionnaires garantit déjà la portabilité de certains droits d’une fonction publique à l’autre. L’article d’habilitation contenu dans le projet de loi prend en compte le temps nécessaire de la concertation avec les syndicats, pour que, d’ici à la fin de la législature, la portabilité des droits des salariés soit également garantie, qu’ils passent du secteur privé au secteur public ou du secteur public au secteur privé.
En ce qui concerne les accords pour favoriser l’emploi prévus dans ce projet, ils sont très différents des accords de maintien dans l’emploi prévus par l’accord national interprofessionnel (ANI) de sécurisation de l’emploi ; il est normal qu’ils obéissent à d’autres règles. Les accords de maintien dans l’emploi s’adressent aux entreprises qui sont confrontées à des difficultés économiques importantes. Plutôt que de supprimer des emplois, elles peuvent, dans le cadre de ces accords, recourir à la flexibilité interne. Le licenciement du salarié qui refuse le contenu de l’accord est un licenciement économique, la loi prenant en compte l’absence de plan de sauvegarde de l’emploi ou de l’obligation de mettre en place des mesures de reclassement.
Les accords pour développer l’emploi vont quant à eux s’appliquer à toutes les entreprises, qu’elles soient ou non en difficulté, hors du cadre des licenciements pour motif économique au sens juridique. Ces accords créent donc un licenciement sui generis qui ne sera analysé ni comme un licenciement pour faute ni comme une démission, comme en Allemagne. Nous ne voulons pas sanctionner un salarié, mais plutôt prendre acte d’un compromis collectif qui a été trouvé. Le dispositif est le même que celui qui avait été prévu par la loi Aubry sur l’aménagement du temps de travail. Dans le cadre de ce licenciement sui generis, le salarié conserve ses droits à indemnité de licenciement comme ses droits à l’indemnisation chômage.
Vous m’avez interrogée sur l’ampleur de la baisse minimale évoquée à l’article 30 relatif aux licenciements économiques. La définition de l’ampleur de cette baisse minimale est bien sûr assez délicate, monsieur le rapporteur. Quelle ampleur doit-on fixer dans la loi ? Nous avons pensé la qualifier simplement de « significative », mais une baisse, même peu importante, de chiffre d’affaires, ou une perte d’exploitation peut déjà être parfois le signe d’une détérioration de la situation économique de l’entreprise, l’incitant à réagir vite pour éviter d’être défaillante. Introduire le terme « significatif » ne ferait naître que de l’insécurité juridique, alors que la loi veut au contraire clarifier.
Je crois en revanche qu’il faut envisager une différenciation des critères économiques, selon qu’ils s’appliquent aux TPE et PME ou aux grandes entreprises. Car les employeurs des TPE et PME n’ont pas recours aujourd’hui au licenciement pour motif économique, pourtant plus protecteur du salarié, et n’utilisent pour ainsi dire que le licenciement pour motif personnel. C’est pourquoi cette précision est importante à apporter.
Vous m’avez interrogée aussi sur l’article 28 et les aides accordées aux TPE et PME, en particulier les services d’information dédiés. Je suis tout à fait favorable à votre approche opérationnelle de cette question. Des cellules d’information et d’appui aux TPE leur apporteront leur aide sur toute question relative au droit du travail et sur la manière d’accéder à un dispositif d’emploi. Elles ne connaissent en effet pas toujours les dispositifs existants, par exemple en matière de temps partiel. Après les attentats, grâce aux directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE), d’intenses démarches ont été menées auprès d’entreprises des secteurs de l’hôtellerie et de la restauration, comme de l’événementiel et du secteur touristique ; au bout d’une semaine, les entreprises se sont emparées enfin de ces dispositifs, qu’elles connaissaient mal a priori.
Le coût de l’embauche fait l’objet d’une même méconnaissance, en témoigne celle de la nouvelle aide en faveur des TPE et PME. Dans le cadre du conseil de simplification, nous travaillons en ce moment à un simulateur du coût de l’embauche. C’est essentiel pour ces entreprises, qui ne disposent pas d’armées d’experts.
En tout état de cause, ces cellules ne se substitueraient pas aux DIRECCTE, mais compléteraient leur travail en s’appuyant sur les chambres consulaires, sur les branches et sur les commissions paritaires régionales. Naturellement, il reviendra aux travaux parlementaires d’apporter des améliorations ou des ajustements. Pour ma part, j’appelle de mes vœux un environnement plus simple et plus sûr pour les TPE et PME.
Vous m’avez interrogée, madame Iborra, sur la publicité des accords passés. Elle sera en effet prévue, sauf lorsque employeurs et salariés estiment qu’ils doivent rester confidentiels. Je suis, comme vous, favorable à une réelle transparence, dès lors qu’il est fait plus de place à la négociation collective.
S’agissant de la formation des acteurs du dialogue social, elle sera renforcée. Des formations conjointes aux représentants des salariés et aux représentants des employeurs auront lieu. Prévues par le projet de loi, de telles formations pourront être en outre financées sur le budget de fonctionnement du comité d’entreprise.
Quant au CPA, il n’est pas seulement destiné aux décrocheurs, mais à tous les jeunes, et même à tous les actifs en général, dès l’âge de seize ans. Vous avez eu raison de m’interroger en ce sens. Le compte engagement permettra aux jeunes diplômés qui s’engagent dans le service civique de bénéficier d’un abondement.
Je connais les difficultés des décrocheurs et je sais que la formation professionnelle ne va pas à ceux qui en ont le plus besoin. Oui, je m’efforce d’abonder le CPA en direction des demandeurs d’emploi et des jeunes les moins qualifiés, qui connaissent des difficultés à entrer sur le marché du travail. Il faut faciliter le développement de l’emploi durable. Les économistes Jean Tirole et Philippe Aghion mettent l’accent sur la nécessité de lever les incertitudes liées aux contentieux nés de la rupture de CDI, pour ouvrir l’emploi aux catégories les plus précaires, comme les jeunes ou les femmes. Certes, d’autres économistes sont d’un autre avis ; il n’y a pas d’unanimité ici non plus. Cette incertitude à embaucher en CDI doit être traitée. Apporter de la clarté, ce n’est pas faciliter le licenciement, mais mieux définir ce que recouvre la notion de « difficultés économiques ».
L’apport des maîtres d’apprentissage sera reconnu à travers l’abondement des comptes engagement.
Messieurs Cherpion et Richard, depuis le début du quinquennat, le Gouvernement a toujours associé les partenaires sociaux aux grandes réformes. Le 16 septembre 2015, après la remise du rapport Combrexelle, j’ai adressé une lettre à tous les partenaires sociaux pour les inviter à négocier. Comme ils ne le faisaient pas, le Gouvernement a repris la main. Le Premier ministre a indiqué en novembre les grandes orientations du texte, sur la base desquelles mon ministère a travaillé pour élaborer le projet de loi qui vous est soumis aujourd’hui. Entre septembre et février, j’ai reçu à plusieurs reprises les numéros un des organisations tant patronales que syndicales ; ils pourront en témoigner. L’article L. 1 a donc été respecté, comme l’a souligné le Conseil d’État dans son avis, dont je vous invite à prendre connaissance.
Des négociations intenses ont eu lieu ces dernières semaines, tant à mon niveau qu’au niveau du Premier ministre et auprès d’Emmanuel Macron. Le projet de loi en est sorti amélioré et plus équilibré. Sans cette phase d’écoute, nous aurions été acculés à un retrait. En quinze jours, nous avons regagné de la confiance. Certes, ce texte de compromis ne recueille pas l’unanimité, mais les organisations syndicales majoritaires et des organisations de jeunesse ont salué son dépôt. Il est important de le souligner.
Monsieur Richard, vous avez évoqué la question du calendrier des travaux de la commission de refondation du code. Le Conseil d’État a souhaité enlever cette mention, estimant qu’il s’agirait d’une injonction que se donnerait le législateur à lui-même, ce qui serait inconstitutionnel. S’il n’y a pas de calendrier prévu dans le corps de la loi, son exposé des motifs contient cependant des indications très claires à ce sujet. Le Gouvernement s’y tiendra, soyez-en assuré.
Des mesures seront prises pour renforcer les syndicats. Les accords sur la flexibilité ne pourront être passés sans recours à la négociation ; les syndicats seront ainsi plus écoutés et auront plus de poids. De même, nous généralisons les accords majoritaires, ce qui rééquilibrera également les choses en leur faveur. Les délégués syndicaux bénéficieront d’une hausse de 20 % de leur décharge, tandis que la formation des négociateurs et des représentants du personnel sera renforcée ; de même, nous protégerons davantage les bourses du travail.
Cette démarche s’inscrit dans la lignée de lois déjà votées depuis 2012, telles que la loi d’août 2015 sur l’emploi et le dialogue, qui renforce les moyens des représentants du personnel dans les entreprises et a créé, notamment, une garantie de non-discrimination salariale pour les syndicalistes.
Quant au budget alloué à la garantie jeunes, la dernière loi de finances a prévu 256 millions d’euros en crédits de paiement supplémentaires, pour faire face à l’extension de cette garantie, 100 000 jeunes étant entrés dans ce dispositif d’ici à la fin 2016. Si 150 000 jeunes y entraient d’ici à la fin 2017, cela représenterait un coût de 600 millions d’euros. L’État et l’Union européenne continueront à le supporter, la garantie européenne à la jeunesse finançant une part de la garantie nationale.
Madame Attard, l’analyse d’Eurostat de 2013, reprise par la Cour des comptes dans son rapport de décembre 2015, évoque 750 000 jeunes NEET, qui ne sont ni étudiant, ni employé, ni stagiaire. Ces jeunes ne sont pourtant pas tous en grande précarité, ce qui limite le nombre de ceux qui entrent dans la garantie jeunes. En outre, tous ceux qui peuvent y entrer n’acceptent pas forcément un dispositif d’accompagnement intensif. Pour eux, nous prévoyons plusieurs niveaux dans la loi : le retour à la formation initiale, tout jeune ayant le droit de se voir payer l’accès à un premier niveau de qualification ; d’autres dispositifs sont également mis en œuvre par la garantie jeunes, tels le contrat d’insertion dans la vie sociale (CIVIS) ou les emplois d’avenir. Le droit universel de la garantie jeunes vise à garantir que tout jeune en situation de précarité qui a le droit d’entrer dans ce dispositif puisse réellement le faire, s’il est volontaire et motivé, et qu’il appartient à la catégorie des NEET.
La garantie jeunes n’est pas une allocation, mais un contrat donnant-donnant qui prévoit l’accompagnement intensif de quinze jeunes, sous une forme collective, par deux intervenants des missions locales pendant six semaines. Il est l’occasion de faire un point sur ce qu’ils souhaitent faire, sur la voie dans laquelle ils voudraient s’engager, vers quelle orientation professionnelle. Ce dispositif, qui comporte une semaine de mise en situation professionnelle, est véritablement du cousu main. C’est ce qui promet des effets efficaces sur l’emploi. Dès le 1er janvier 2017, tout jeune qui remplit les critères de la garantie jeunes devra pouvoir bénéficier de ce dispositif.
S’agissant des fonds européens, nous travaillons avec la Caisse des dépôts et consignations pour étudier comment elle pourrait avancer des crédits, nous mettant à l’abri des fluctuations de paiement, notamment sur les écoles de la deuxième chance ou certaines missions locales en difficulté. Un comité scientifique travaille sur l’évaluation de la garantie jeunes sur tout le territoire ; il rendra ses conclusions d’ici au mois de juin. D’ici à la fin 2016, elle sera disponible dans 80 % des missions locales.
Chaque mission locale recevra 1 600 euros par jeune accompagné dans le cadre de ce dispositif. Rappelons qu’entre 100 000 et 200 000 jeunes, ou même davantage, pourront y accéder. Les moyens des missions locales seront donc renforcés, de façon qu’elles puissent recruter le personnel nécessaire à la mise en place de ce dispositif. Nous traitons d’ailleurs la question des locaux nécessaires à leur accueil, dans sa dimension collective. Tout sera prêt d’ici au 1er janvier 2017. L’Union nationale des missions locales (UNML) s’est déjà déclarée prête, si des moyens renforcés lui sont alloués, comme je m’y engage.
Monsieur Cavard, j’apprécie votre état d’esprit, certes sans concession, mais constructif. Le CPA doit assurer la continuité avec les lois déjà votées, notamment s’agissant du CPF. Tel est du moins le souci qui m’anime.
Mme Orliac, vous vous êtes inquiétée du renvoi à la norme supplétive. Que faut-il appliquer s’il n’y a pas d’accord ? Il paraît plus rassurant, y compris pour les salariés et pour les syndicats, de prévoir que ce sera le droit supplétif. Quant au départ opéré entre loi et règlement pour définir ce dernier, le projet de loi se calque sur l’équilibre actuel. Un droit supplétif sera de toute façon défini, que ce soit par la loi ou par le décret.
S’agissant de la laïcité, elle ne s’applique pas aujourd’hui au monde de l’entreprise. Je suis ouverte à une réécriture de l’article, mais je souligne que, loin de favoriser le communautarisme religieux, il reprend au contraire le droit constant. Nous sommes en train d’élaborer, avec les partenaires sociaux, un guide du fait religieux en entreprise, rédigé tant du point de vue des employeurs que du point de vue des salariés ; il faudra par exemple débattre de la question des règlements intérieurs. Rappelons toutefois à nos concitoyens que la laïcité en entreprise n’existe pas aujourd’hui, du moins en tant que principe.
Madame Fraysse, vous ne pouvez pas dire que le projet de loi vise à faciliter les licenciements. Ce serait d’ailleurs absurde, et assez paradoxal, pour une ministre de l’emploi, de proposer une telle mesure. Il s’agit seulement de donner une meilleure visibilité aux salariés et aux entreprises sur les cas dans lesquels, en raison de difficultés économiques, il peut être mis fin au contrat de travail. Nous précisons ce que peuvent être des difficultés économiques ; nous n’ajoutons pas de nouvelles formes de licenciement économique.
Certes, vous pouvez ne pas être d’accord, mais nous avons retenu le critère de quatre trimestres consécutifs de baisse du chiffre d’affaires. Sur cette question, le droit, largement issu de la jurisprudence, n’est pas clair. Il est pourtant légitime que les chefs d’entreprise demandent des règles claires en ce domaine. À défaut, les TPE et PME préfèrent ne pas embaucher en CDI. Les premières victimes en sont les salariés en butte à la précarité, alternant périodes d’intérim, contrats courts et périodes de chômage. C’est pourquoi nous reprenons la jurisprudence de la Cour de cassation pour définir, dans la loi, ce qu’est la motivation d’un licenciement économique. Rappelons d’ailleurs que le licenciement économique ouvre au salarié plus de droits qu’un licenciement pour motif personnel ou une rupture conventionnelle.
Il est faux de dire que le projet de loi inverse la hiérarchie des normes. Cela signifierait que les accords, ou même le contrat de travail, seraient l’outil de la régulation du droit commun, sur lequel ils auraient prééminence. Il n’en est rien. Mon projet de loi ne laisse pas employeur et salariés seuls face à face. La loi continuera à protéger le salarié. Elle fixe ce qui relève d’elle-même ou de la négociation d’entreprise ; le champ des accords ne pourra être élargi que dans la mesure où la loi le permet. S’il n’y a pas d’accord, le droit actuel s’appliquera. Nous réaffirmons également le rôle des branches et des accords qu’elles passent. Ils sont essentiels sur des sujets comme la durée minimale du travail, notamment en temps partiel, les qualifications, les salaires, la protection sociale complémentaire, la lutte contre le dumping social… Les accords de branche continueront de l’emporter sur les accords d’entreprise en ces matières. D’ailleurs, ils pourront moduler le temps de travail sur une période plus longue qu’une année.
Nombre d’entre vous ont critiqué la consultation des salariés. Je souligne qu’elle ne peut avoir lieu qu’à la demande des syndicats. Il est donc impossible de les contourner ; c’est même un moyen de les renforcer. Le chef d’entreprise ne peut recourir de lui-même à cette consultation, qui doit être demandée par des organisations syndicales représentant 30 % des salariés. Elle peut offrir le moyen de surmonter un blocage. Le niveau de 30 % est celui qui est retenu pour la signature d’un accord. Même les modalités de la consultation font l’objet d’un accord avec les syndicats ; elle peut les relégitimer. Certains y sont d’ailleurs favorables – mais il n’y a pas unanimité, ni chez les syndicats ni chez les employeurs, sur l’ensemble du projet de loi.
J’en viens à la majoration des heures supplémentaires. Monsieur Sebaoun, un accord d’entreprise peut aujourd’hui fixer un taux de majoration de 10 % des heures supplémentaires, inférieur à celui que l’accord de branche a prévu, si celui-ci n’a pas entendu verrouiller lui-même ce taux. Concrètement, sur les cinquante branches les plus importantes – celles qui sont suivies dans le cadre du pacte de responsabilité –, il n’y en a que cinq où les accords d’entreprise peuvent réellement prévoir un taux de majoration inférieur à celui qui est prévu par l’accord de branche. Pourtant, un taux de majoration élevé peut être insoutenable pour des TPE, leur interdisant de recourir aux heures supplémentaires.
Le projet de loi vise à remédier à cette situation en prévoyant que les accords d’entreprise fixent, comme aujourd’hui, le taux de majoration des heures supplémentaires, tout en garantissant aux salariés une majoration minimale de 10 %. Quand un taux de 25 % est applicable, comme dans les grandes entreprises, il ne faut pas s’attendre à ce que les syndicats signent des accords au moins-disant. Mais, dans les TPE et PME, le projet de loi ouvrira des possibilités nouvelles de recourir aux heures supplémentaires, alors que, aujourd’hui, elles ne le peuvent pas.
En quoi cette loi créera-t-elle de l’emploi ? Elle s’inscrit dans la lignée de celles qui ont été adoptées depuis le début du quinquennat. Elle vise à renforcer la compétitivité de notre économie et sa capacité d’adaptation au plus près du terrain. En donnant plus de clarté aux entreprises, elle donnera de l’emploi durable. Vais-je m’engager sur des chiffres de création d’emplois à deux mois ou à trois mois ? Certes non. Il y a d’une part des mesures conjoncturelles, telles que le plan « 500 000 emplois », la baisse du coût du travail à travers le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE) dans le cadre du pacte de responsabilité et l’aide à l’embauche dans les PME. Il y a d’autre part des mesures structurelles dont notre pays a besoin et qui produiront des effets à moyen terme. Je ne vais pas m’engager devant nous sur le nombre d’emplois qui seront créés. Mais, en tout état de cause, cette loi favorisera l’emploi, en permettant davantage de souplesse et une meilleure adaptation, par la négociation, à un contexte économique changeant. Elle pourra permettre d’éviter le recours au détachement des travailleurs, en offrant par exemple plus de modulation du temps de travail. Elle sera ainsi favorable tant à la compétitivité de notre économie qu’à l’emploi.
Le compte personnel de prévention de la pénibilité (C3P), qui fait partie du compte personnel d’activité, est pour moi une avancée sociale importante. Nous sommes en train de travailler avec l’Agence nationale d’amélioration des conditions de travail (ANACT) sur certains référentiels de branche, notamment dans l’agriculture, ainsi que sur les incidences de la transposition de la directive européenne relative à la valeur limite d’exposition professionnelle pour la filière bois.
Monsieur Vercamer, vous m’avez interrogée sur la flexisécurité. Toute la philosophie de ma loi consiste à concilier flexibilité et sécurité. Je crois qu’il est possible de renforcer la capacité d’adaptation de nos entreprises tout en garantissant des droits aux salariés. Poser le principe qu’en l’absence d’accord, le droit actuel s’applique, voici une des garanties que nous apportons. Donner au salarié la capacité d’être acteur de son parcours professionnel et d’activer ses droits tout au long de sa carrière à travers le CPA, voici un droit nouveau que nous instaurons, qui correspond à une réalité vécue. Nous savons bien en effet que notre pays n’est pas bon en matière de reconversion professionnelle ou de formation professionnelle, laquelle ne bénéficie pas à ceux qui en ont le plus besoin. La convention de l’assurance chômage est un autre élément de sécurité pour les salariés. Une négociation est en cours : comme elle relève, par définition, des partenaires sociaux, je ne peux rien en dire, mais je reste vigilante. Les dispositions concernant le niveau d’indemnisation tout comme la durée d’indemnisation contribuent également à améliorer la sécurité.
Mesures structurelles et mesures conjoncturelles sont liées et participent à l’élaboration d’une flexisécurité à la française – je dis « à la française », car mon but n’est pas de copier des modèles étrangers. Le taux de syndicalisation n’est pas aussi important qu’ailleurs dans notre pays. Nous ne connaissons pas de syndicalisme de services. Faut-il pour autant se contenter d’un taux de confiance dans les syndicats de 18 % ? Je ne le crois pas. En ouvrant le champ de la négociation, nous renforcerons la légitimité des acteurs.
Monsieur Lurton, je vais vous dire en quoi nous aidons les TPE et les PME. Tout d’abord, j’insisterai sur les accords types de branche, qui sont négociés au niveau de la branche et applicables directement. Comme il existe 700 branches, je conçois fort bien qu’il soit difficile de se figurer leurs résultats. Je suis toutefois persuadée qu’ils seront essentiels pour les TPE et les PME.
Par ailleurs, le projet de loi permet d’élargir le champ de la négociation avec les salariés mandatés. Je sais la crainte que soulève chez certains ce salarié mandaté : ils ont peur d’une incompatibilité culturelle. Que les choses soient claires : ce n’est pas un militant syndical qui va débarquer dans une entreprise qu’il ne connaît pas ! Ce mandat est donné par une organisation syndicale à un salarié de l’entreprise. Le regard des organisations patronales sur le mandatement sera sans doute appelé à changer.
Autre mesure : nous donnons concrètement la possibilité de moduler le temps de travail non plus sur vingt-huit jours, mais sur neuf semaines. Cela correspond à un besoin exprimé sur le terrain.
Enfin, nous voulons permettre aux entreprises appartenant à des groupements d’employeurs de bénéficier d’aides auxquelles elles seraient éligibles si le nombre de leurs salariés était seul pris en compte. C’est le cas, par exemple, des aides à l’embauche destinées aux PME.
Madame Khirouni, s’agissant du temps partiel, je dois vous dire que le projet de loi ne revient absolument pas sur l’avancée introduite par la loi relative à la sécurisation de l’emploi qu’a été l’instauration d’une durée minimale hebdomadaire de travail de vingt-quatre heures. Il n’y a pas de changement : à défaut d’accord de branche étendu, c’est la règle des vingt-quatre heures qui s’applique. De la même manière, le projet de loi ne modifie pas la rémunération des heures complémentaires.
Vous évoquez les droits des femmes. Sachez que je suis, comme vous, déterminée à mener le combat pour l’égalité entre hommes et femmes. Demain, devant la délégation aux droits des femmes, je présenterai les modifications apportées à la première mouture du projet de loi qui touchent à cet aspect, notamment la meilleure prise en compte de la formation des femmes dans le compte personnel d’activité. Nous avons également pris en compte les observations qui ont été faites à propos des négociations annuelles et les recommandations formulées par certaines instances, tel le CSEP. Je me montrerai ouverte aux amendements proposés.
Mme Carrey-Conte m’interrogeait sur les durées maximales, mais, comme elle n’est plus là, je passe à la question suivante.
Monsieur Viala, vous me demandez de citer une avancée du projet de loi en faveur des salariés : le compte personnel d’activité, vous dirai-je. Le droit à la formation pour les moins qualifiés est un vrai progrès social. Vous ne pouvez pas imaginer le nombre de courriers que je reçois de la part de demandeurs d’emploi qui ne trouvent pas de financement pour leur formation ou qui trouvent la bonne personne mais pas le cadre de formation. Vous me demandez encore de citer une avancée pour les TPE : l’accord type de branche, salué par l’Union professionnelle artisanale (UPA), qui favorisera l’emploi.
Monsieur Gille, vous émettez l’idée d’intégrer le compte épargne-temps dans le compte personnel d’activité, idée très intéressante qui soulève de nombreuses questions en termes d’opérationnalité. Nous avons besoin de davantage de temps pour y travailler avec les partenaires sociaux. Pour éviter que, au 1er janvier 2017, le CPA ne soit une usine à gaz, nous avons préféré n’y faire figurer que les éléments en mesure d’être mis en œuvre à cette date, comme le compte engagement citoyen, beaucoup plus simple à intégrer.
M. Delatte n’est plus là, lui non plus.
En matière de validation des acquis de l’expérience, monsieur Costes, il est clair que nous pouvons mieux faire. Depuis la mise en place du dispositif en 2002, 230 000 personnes ont été certifiées par la voie de la VAE. Depuis 2010, on enregistre une baisse du nombre de candidats s’étant présentés devant les jurys ainsi qu’une baisse du nombre des candidats ayant obtenu des certifications complètes. On constate un accès plutôt bon des publics de premier niveau, mais notre objectif est de renforcer par la loi l’accès au dispositif pour les moins qualifiés. Je me suis fondée sur le rapport qui m’a été remis par le Conseil national du numérique sur la validation des acquis de l’expérience.
La durée d’expérience en relation avec la certification visée passe certes de trois ans à un an, mais nous avons voulu élargir les conditions d’éligibilité. Les périodes de formation initiale ou continue en milieu professionnel sont prises en compte. Nous nous adaptons aux enjeux de mobilité professionnelle en reconnaissant les pistes de certification et nous rapprochons la VAE des salariés en introduisant une information à son sujet dans l’entretien professionnel. Enfin, nous supprimons les conditions d’ancienneté d’activité pour l’ouverture du droit au congé VAE en ce qui concerne les contrats à durée déterminée.
Monsieur Issindou, votre rapport sur la médecine du travail a été unanimement salué. Aujourd’hui, sur 20 millions d’embauches, seules 3 millions font l’objet d’une visite médicale préalable. Autrement dit, des personnes occupant des emplois à risques ne bénéficient pas de visite médicale. La conclusion qui s’impose est qu’il faut massivement recruter des médecins du travail, d’autant que la pénurie va aller croissant : d’ici à 2020, nous passerons de 5 000 à 2 500 médecins du travail. Le problème est qu’il n’y a pas assez de candidatures aux concours. Nous inspirant de vos recommandations, nous pensons qu’il importe de s’assurer que les personnes les plus exposées professionnellement bénéficient de la visite de médecins du travail et que les autres salariés reçoivent la visite d’infirmiers pour les former aux gestes de prévention. Vous le voyez, je m’attache à traiter les problèmes non pas en théorie, mais dans les faits.
S’agissant de l’éligibilité à la garantie jeunes, il y avait certes, en 2013, 900 000 jeunes relevant de la catégorie NEET, 750 000 selon le rapport de la Cour des comptes fondé sur les données Eurostat 2014. Toutefois, d’après les analyses de la direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques (DARES), les dispositifs relatifs à la précarité concerneraient 300 000 jeunes. Comme le taux de recours n’atteindra sans doute pas 100 %, notre fourchette située entre 100 000 et 200 000 jeunes paraît pertinente. Toujours est-il que nous nous engageons à ce que tout jeune éligible à la garantie jeunes puisse en bénéficier.
Le droit de timbre que nous instituons dans le projet de loi ne fait que prolonger notre arsenal législatif, qui est l’un des plus stricts d’Europe grâce à la loi Savary et à la loi pour la croissance et à l’activité de l’été dernier. Le Conseil d’État, dans son avis, indique clairement que la mesure ne crée pas de « restriction à la libre prestation de services au sein de l’Union et ne présente pas de caractère discriminatoire », car son montant reste modeste et proportionné à l’objectif recherché. Cette contribution vise à couvrir le coût de la mise en place du traitement informatique des données relatives au détachement dans un contexte d’augmentation continue du recours à cette pratique.
J’en viens au principe selon lequel les règles du pays d’accueil s’appliquent aux intérimaires. Je suis d’accord avec vous, monsieur Savary. Dans le cadre de l’élaboration du paquet pour la mobilité des travailleurs dont a la charge la commissaire européenne à l’emploi, Mme Thyssen, la France avait formulé six demandes, notamment l’interdiction du travail intérimaire, du double détachement, de la pratique des entreprises boîtes aux lettres, qui ne se créent que pour détacher des travailleurs, la prise en compte d’une durée minimale contractuelle et la nécessité pour une entreprise ayant recours à des travailleurs détachés d’avoir une activité substantielle dans le pays. Les propositions présentées par Mme Thyssen devront s’appliquer aux intérimaires détachés. Même si je considère que le droit national le prévoit déjà, je conçois que certains députés souhaitent faire de ce projet de loi un instrument de lobbying auprès des institutions européennes. Je suis d’accord pour que nous intégrions dans ce texte l’interdiction des détachements en cascade de salariés intérimaires.
Concernant les travailleurs saisonniers, nous avons eu une approche pragmatique. Il s’est d’abord agi pour nous de définir le travail saisonnier. Les branches concernées devront engager des négociations sur les modalités de reconduction d’année en année pour donner plus de visibilité aux salariés. À défaut, une ordonnance fixera les règles supplétives. Nous donnons la priorité à l’accord de branche. J’entends, monsieur Perrut, madame Laclais, que vous appeliez de vos vœux des améliorations. Je suis tout à fait prête à ce que mes équipes travaillent avec vous autour d’amendements.
Nous avons également intégré une mesure sur les groupements d’employeurs et les aides à l’emploi. Lors de ma rencontre la semaine dernière avec la Fédération nationale des groupements d’employeurs agricoles et ruraux (FNGEAR), j’ai eu l’occasion de parler de ces questions, notamment des enjeux pour l’agriculture. Je suis également prête à travailler avec vous sur ce point.
La question de l’accompagnement des salariés dans l’appropriation du compte personnel d’activité est essentielle, monsieur Cordery. Et le projet de loi pourrait davantage affirmer cet impératif, si cela vous paraît souhaitable.
Je serai aussi très attentive à la question de la mobilité européenne des travailleurs. Il faut que nous sécurisions ces parcours, notamment dans le cas des retours d’expatriation. Là encore, nous pourrons travailler le texte en ce sens.
Venons-en aux travailleurs handicapés. L’article L. 4612-11 du code du travail prévoit déjà que le CHSCT est consulté sur les mesures mises en œuvre en faveur des travailleurs handicapés. Par ailleurs, la loi sur le dialogue social fait de l’emploi des travailleurs handicapés l’un des objets de la consultation du comité d’entreprise sur les politiques sociales et prévoit l’appui d’un expert. C’est, en outre, un sujet de négociation obligatoire sur la qualité de vie au travail et sur l’égalité professionnelle. Je propose d’évaluer l’impact de la loi en ce domaine, comme nous le faisons en matière d’égalité professionnelle, avant de légiférer sur cette question.
Depuis 2012, nous avons accru de 20 % les moyens de la politique de l’emploi en faveur des travailleurs handicapés : augmentation des aides au poste, élargissement de l’accès aux contrats aidés, amélioration de la formation. J’ai moi-même tenu avec Ségolène Neuville une conférence sociale avec les partenaires sociaux qui m’a permis de constater qu’il serait bon de redynamiser le dialogue social sur la question du handicap.
Se pose une question en particulier : l’accès des travailleurs handicapés à la formation. Cela renvoie à deux problèmes : d’une part, l’autocensure, car les travailleurs handicapés ou leur famille estiment que certains métiers sont hors d’atteinte ; d’autre part, l’attitude des entreprises. À cet égard, l’organisation des Abilympics, olympiades des métiers pour les personnes handicapées auxquelles je me suis rendue la semaine dernière à Bordeaux, revêt une grande importance pour faire changer le regard non seulement des intéressés mais aussi des entreprises. En outre, nous devons trouver le moyen de donner la priorité aux personnes en situation de handicap par le biais du financement de la formation professionnelle. Nous savons que ces personnes sont parmi les moins qualifiées, et c’est pourquoi leur taux d’emploi est particulièrement bas.
Je suis prête à ce que mes équipes travaillent avec vous en ce sens. Nous pouvons améliorer les choses ensemble.
M. Yves Censi. Madame la ministre, permettez-moi de vous rappeler mes deux questions.
Premièrement, quels sont vos objectifs en matière de restrictions apportées à la liberté du salarié de manifester ses convictions religieuses dans l’entreprise ?
Deuxièmement, pouvez-vous nous dire clairement si vous acceptez qu’un accord d’entreprise puisse être plus défavorable qu’un accord de branche ?
Mme la ministre. En l’absence d’accord, c’est le droit existant qui s’applique. Le principe de faveur n’existe plus depuis 2004. L’objet de la négociation sera élargi et l’accord se fera sur la base du donnant-donnant. Les branches professionnelles continueront de négocier sur la classification et les salaires, entre autres, et l’accord d’entreprise prévaudra en matière de temps de travail et de congés.
Pour ce qui est du principe de laïcité, nous avons conservé la rédaction issue de la commission Badinter. Je ne sais pas quels débats ont présidé à ce choix juridique. Libre à vous d’amender les soixante et un principes retenus par la commission Badinter ou de faire en sorte de ne les faire figurer que dans la partie réglementaire. Ce n’est pas à moi de vous imposer mes vues. Nous pourrons en débattre à nouveau dans l’hémicycle.
Je terminerai par la question de Mme la présidente. Le juge apprécie, bien sûr, le motif économique lorsqu’un salarié conteste son licenciement. C’est le cas aujourd’hui et ce sera encore le cas demain. L’employeur, dans ce cadre, doit apporter des éléments qui justifient les difficultés économiques de son entreprise. Cette liste ne peut pas être limitative, car chaque entreprise est un cas particulier. C’est le sens de la décision du Conseil constitutionnel du 12 janvier 2012. Et je veux éviter tout risque de censure. L’expression que vous avez soulignée vise précisément à permettre de produire d’autres éléments que ceux énumérés. C’est au juge qu’il reviendra d’établir si ces éléments constituent ou non un motif économique de licenciement. Le projet de loi a pour but de donner des exemples clairs de critères pour les PME. Il ne vise pas l’exhaustivité.
Mme la présidente Catherine Lemorton. Merci, madame la ministre, pour toutes les réponses que vous avez apportées au cours de cet exercice aussi difficile pour nous que pour vous. J’adhère entièrement à votre choix de ne pas répondre aux questions des députés qui se sont absentés. S’agissant d’un texte de cette importance, chacun a le devoir de tout faire pour assister jusqu’à la fin à l’audition du ministre.
La Commission procède à l’audition des organisations représentatives des salariés (CFDT, CFE-CGC, CFTC, CGT, FO) lors de sa première séance du mercredi 30 mars 2016.
Mme la présidente Catherine Lemorton. Nous poursuivons le marathon qui a débuté hier sur le projet de loi visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections pour les entreprises et les actifs.
Après l’audition de la ministre Myriam El Khomri hier après-midi, dans un calme relatif malgré la présence de nombreux députés et l’existence d’un grand nombre d’incertitudes, nous ouvrons à présent la discussion avec les partenaires sociaux. Cet échange est un moment essentiel, et ce pas uniquement parce que ce serait un passage obligatoire quand il s’agit de modifier le code du travail.
La seule question que je poserai à nos invités avant de leur donner la parole, c’est s’ils ont le sentiment d’avoir été associés par le Gouvernement à l’écriture du projet de loi. Ont-ils été consultés et combien de fois ?
Mme Véronique Descacq, secrétaire générale adjointe de la CFDT. La concertation a été insuffisante avant la première version du texte. Non que nous n’ayons pas été invités à des discussions au ministère du travail, mais nous n’avons jamais eu l’occasion de discuter sur un texte. Nous avons été consultés sur un certain nombre de dispositions, avant de voir apparaître, dans la version initiale, des dispositions dont n’avions jamais entendu parler, en particulier l’ex-article 30 bis sur le licenciement économique. La CFDT et d’autres organisations ont donc demandé un report de la présentation du texte en conseil des ministres afin de laisser du temps à la concertation. C’est ce qui a été fait.
La CFDT a exprimé de nombreux désaccords avec la version initiale, qu’elle jugeait très déséquilibrée. À côté de réelles avancées sociales, telles que le compte personnel d’activité et la partie sur la lutte contre le travail détaché illégal, nous considérions que les mesures de sécurisation des parcours professionnels proposées étaient insuffisantes, et que certaines dispositions étaient dangereuses en raison de leur caractère libéral, en particulier la trop grande place laissée au pouvoir unilatéral de l’employeur, des licenciements économiques moins contrôlés, le barème des indemnités prud’homales – contre lequel la CFDT s’est toujours élevée depuis son introduction par la loi Macron –, un encadrement insuffisant des accords de préservation ou de développement de l’emploi, ainsi que des mesures sur le temps de travail pouvant porter atteinte à la santé des salariés, notamment le forfait-jours et les astreintes.
Nous avons mis le report à profit pour présenter des contre-propositions. Si l’objectif de ce texte était de faire croire qu’une réforme du marché du travail créerait des millions d’emplois en luttant contre une prétendue « peur de l’embauche », nous n’y avons jamais cru. Les travaux auxquels nous avons participé au Conseil d’orientation pour l’emploi montrent qu’un cycle économique déprimé n’est pas le bon moment pour prendre des mesures de réforme du marché du travail qui risquent d’augmenter encore la précarisation.
Nous sommes convaincus que, pour conduire les réformes nécessaires au progrès social dans une économie compétitive, trois choses sont nécessaires, que ce texte nous donne l’opportunité de faire : améliorer la sécurisation des parcours professionnels, permettre la montée en compétences des travailleurs – salariés, jeunes et demandeurs d’emploi – et favoriser un dialogue social de qualité capable de construire au niveau le plus pertinent les garanties dont les salariés ont besoin, la loi quand il s’agit de donner des garanties à tout le monde, la branche quand il faut faire de la régulation économique et sociale, enfin l’entreprise. En l’occurrence, sur la partie du code du travail récrite dans cette loi, à savoir le temps de travail, nous pensons que le lieu pertinent est, dans bien des cas, l’entreprise.
La deuxième version nous convient beaucoup mieux car nous avons réussi à effacer nombre de dispositions qui rendaient le projet trop déséquilibré et trop libéral. Cette nouvelle rédaction revient ainsi sur l’augmentation du pouvoir unilatéral de l’employeur. Sur le temps de travail, tout le droit supplétif, à quelques exceptions près, est revenu à droit constant. Le compte personnel d’activité a été renforcé de façon très sensible, en particulier pour améliorer la formation de ceux qui en ont le plus besoin : ces mesures parachèvent la réforme de la formation professionnelle que la CFDT demandait en 2014. Le barème, qui ne permettait pas l’indemnisation totale des salariés injustement licenciés aux prud’hommes, a été supprimé. L’article sur le licenciement économique a été partiellement récrit.
J’ai avec moi un document d’une cinquantaine de pages décrivant l’ensemble des demandes de la CFDT qui demeurent. Je reviendrai devant votre commission sur quatre points importants.
Tout d’abord, la partie concernant le dialogue social nous convient plutôt bien, car elle permet de le renforcer. On a fait reculer la possibilité de prise de décision unilatérale par l’employeur. En outre, le texte prévoit désormais le mandatement partout, y compris dans les très petites entreprises : un salarié de ces entreprises pourra être accompagné par une organisation syndicale pour mener une négociation. Cela nous semble important car c’est nous mettre en conformité avec le principe constitutionnel selon lequel tous les salariés ont droit à une représentation – droit que nous avions déjà fait avancer dans la loi Rebsamen.
L’article 1er de la loi reprend les principes généraux, à la suite du rapport Badinter. Nous pensons qu’il serait utile d’y ajouter les principes d’articulation des normes tels qu’ils sont proposés par le texte et que ces principes intègrent le code du travail à partir de 2019.
Le fait de passer à 50 % pour la validation des accords d’entreprise ou de branche est un élément extrêmement important du rapport de force nécessaire dans les entreprises pour que la négociation soit équitable ; c’est pour nous la condition sine qua non d’une nouvelle réécriture du code du travail. À nos yeux, ce texte ne porte pas une inversion de la hiérarchie des normes mais une nouvelle architecture, en raison de deux éléments encadrant le rapport de force : l’accord majoritaire et un droit supplétif à droit constant.
En ce qui concerne la consultation des salariés sur un accord négocié et signé, ce que l’on appelle le référendum, ce n’est pas la CFDT qui a demandé cette mesure : celle-ci est arrivée dans le texte car certains craignaient que le passage de 30 à 50 % diminue le dynamisme conventionnel dans les entreprises. Nous considérons que c’est une façon intelligente d’articuler la démocratie représentative et la démocratie participative, et qu’une organisation syndicale proche des salariés n’a rien à craindre de la validation par les salariés de textes préalablement négociés.
J’en viens aux trois points principaux sur lesquels nous demandons encore des modifications. Le premier est le compte personnel d’activité. Je répète que la CFDT se félicite du renforcement des droits des personnes qui en ont le plus besoin, mais nous pensons que la loi ne doit pas passer à côté de cette occasion de traiter la question du temps. Eu égard à l’allongement inéluctable de la durée de vie au travail, liée à l’augmentation de la durée de vie, nous pensons que la possibilité d’épargner du temps doit être au moins actée dans ce texte, quitte à renvoyer la construction des dispositifs à la négociation.
Le deuxième point concerne les licenciements économiques, qui nous paraissent encore insuffisamment sécurisants pour les salariés. Le droit supplétif est trop faible. Les quantums retenus pour la baisse de chiffre d’affaires ou la perte d’activité sont trop peu élevés. Le pouvoir du juge n’est pas suffisamment rétabli, en particulier dans sa capacité à vérifier qu’il n’y a pas d’organisation artificielle de la baisse du chiffre d’affaires ou de la perte d’activité. Par le pouvoir d’appréciation du juge ou des DIRECCTE (direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi), il nous paraît possible de rétablir un contrôle, administratif d’abord, juridictionnel ensuite.
Nous souhaitons également que l’encadrement des accords de maintien dans l’emploi soit renforcé selon trois modalités. Il convient tout d’abord de revenir à des durées déterminées. Il faut ensuite que les négociateurs syndicaux soient systématiquement accompagnés par un expert, qu’il y ait un comité d’entreprise ou non ; cet expert pourrait régulièrement – une durée de cinq ans semble raisonnable –, réévaluer avec les représentants du personnel la situation ayant conduit à la négociation des accords de maintien dans l’emploi. Enfin, nous souhaitons que les négociateurs soient invités à prévoir des portes de sortie en faveur des salariés pour lesquels les modifications qui s’imposeraient à leur contrat de travail seraient disproportionnées compte tenu de leur situation personnelle.
Le dernier point concerne la médecine du travail. Nous partageons les orientations générales de la réforme et nous avons travaillé avec l’ensemble des autres organisations syndicales dans le cadre du Conseil d’orientation des conditions de travail (COCT). Le reclassement des salariés déclarés inaptes est cependant limité à une proposition de reclassement, et nous souhaitons le voir élargi.
En conclusion, la seconde version du texte, encore améliorée par les propositions de la CFDT, nous paraît susceptible de moderniser le dialogue social et de mieux protéger les salariés dans les mutations que connaît notre économie.
M. Jean-Claude Mailly, secrétaire général de FO. La France est un pays de pluralisme politique ; vous allez voir que c’est aussi un pays de pluralisme syndical. Nous n’avons pas les mêmes analyses sur ce projet de loi.
La concertation préalable n’a abordé que certains points : nous n’avons jamais eu un texte complet en main. Nous avons reçu la version initiale en même temps que les médias. Quelques consultations ont eu lieu ensuite sur la base du texte, avec la ministre du travail et le Premier ministre, au cours desquelles nous sommes convenus que nos conceptions étaient très différentes.
Nous pensons que ce texte introduit une rupture dans l’histoire de nos relations sociales. La France est le premier pays au monde en termes de couverture conventionnelle ou statutaire : plus de 90 % des salariés français sont couverts par une convention collective ou un statut. À titre de comparaison, dans un pays comme l’Allemagne, seuls 60 % des travailleurs sont couverts par une convention collective car, depuis dix ou quinze ans, le patronat allemand a remis en cause une série de branches, qui ne fonctionnent plus ; c’est d’ailleurs pourquoi les Allemands ont recréé un SMIC, parce que certains salariés ne bénéficiaient plus d’aucun salaire minimum, ce salaire étant négocié par branche.
Notre articulation des niveaux de négociation collective est républicaine. Nous tenons à ce que, dans ce que l’on appelle la hiérarchie des normes, il y ait la loi, des accords nationaux interprofessionnels, des accords de branche et des accords d’entreprise. Tous ces niveaux doivent être respectés. Or on est en train de remettre en cause cette articulation. Dans certains cas, la branche est contournée. Par exemple, sur les heures supplémentaires, les premières heures payées au-delà de la durée légale du travail sont actuellement payées 25 % de plus, les suivantes 50 %. On peut, par un accord de branche étendu, passer de 25 à 10 %. Une seule branche – dans le secteur du tourisme et des loisirs – a négocié ce type d’accord, ce qui signifie qu’il n’y a pas eu de demande en ce sens dans les autres branches, y compris du côté patronal. Avec ce texte, la branche n’existe plus, on passe directement à l’entreprise. Je pourrais multiplier les exemples. La supplétivité n’est pas toujours à droit constant, contrairement à ce que pensent certains : des possibilités de déroger à certaines normes supplétives sont laissées aux employeurs.
On peut aussi se poser des questions sur la manière dont sera conçue demain la branche. Des commissions paritaires nationales vont être créées, dont on ne connaît pas le statut juridique, et qui seraient à la fois des structures d’interprétation des accords, comme cela existe aujourd’hui, et de négociation. La branche pourrait être au service des entreprises. De fil en aiguille, son rôle est remis en cause, et cela ne se passe pas qu’en France. Dans de nombreux pays européens, il existe la même volonté de remettre en cause les niveaux nationaux de négociation au profit de négociations d’entreprise. Je vous renvoie à l’avis de la Commission européenne du 13 mai 2015 sur le Programme national de réforme français, dans lequel elle conseille à la France de faciliter « les dérogations aux dispositions juridiques générales, notamment en ce qui concerne l’organisation du temps de travail ». D’autres points de cet avis se retrouvent dans le projet de loi. La politique économique suivie au plan européen est aujourd’hui de caractère libéral et elle impose plus de flexibilité et de précarité.
Mon deuxième point porte sur les modalités de négociation. L’entreprise est le lieu où la pression peut être la plus forte sur les salariés, tandis que la liberté est plus grande au niveau de la branche, ce qui n’exclut pas, bien sûr, les négociations d’entreprise – et nous avons signé des accords dans toute une série d’entreprises quand il y avait des difficultés. Si l’on prévoit, ce qui était déjà prévu en 2008, un critère de 50 % et aujourd’hui un critère de 30 % plus référendum, c’est bien pour justifier une dérogation en moins pour les salariés. Nous sommes donc opposés au référendum. Nous pensons qu’il serait beaucoup plus responsable de rester par exemple à 30 % et de laisser vivre le droit d’opposition. Un syndicat a trois possibilités : ou il signe un accord, ou il ne le signe pas mais ne s’y oppose pas, ou il ne le signe pas et s’y oppose. Nous pensons que c’est plus démocratique qu’un système dans lequel une organisation syndicale qui aurait obtenu 32 % des votes a huit jours pour essayer de convaincre une autre organisation et parvenir à 50 % : cela fait huit jours de bordel dans l’entreprise, avant de pouvoir demander un référendum.
La démocratie sociale n’est pas la démocratie politique. Il faut une majorité de voix des députés pour qu’une loi soit votée, mais nous ne sommes pas quant à nous en mesure de décider seuls ; nous sommes plusieurs organisations mais surtout nous avons en face de nous des employeurs. On ne peut calquer un modèle sur l’autre. Nous considérons que le référendum est un outil de court-circuitage des organisations syndicales.
En ce qui concerne les accords de maintien de l’emploi, lorsque vous avez voté en 2013 la loi sur la sécurisation de l’emploi qui faisait suite à l’accord national interprofessionnel que n’avait pas signé FO, un salarié refusant de voir modifier son contrat de travail était, aux termes de l’accord, licencié pour motif personnel. FO a obtenu des élus de la Nation que ce soit un licenciement économique personnel, ce qui signifie que le salarié bénéficie des procédures de reclassement et d’accompagnement. Dans le présent projet de loi, ce n’est plus un licenciement économique : on retrouve le licenciement individuel, allant contre ce que vous avez voté en 2013.
Les négociations annuelles obligatoires (NAO), ensuite, passent à trois ans et, si l’inflation repart, seuls ceux qui ont signé l’accord sur trois ans pourront demander une réouverture de la négociation.
S’agissant de la durée du travail, tous les congés ne sont pas garantis dans le supplétif. On peut, par accord majoritaire ou référendum dans l’entreprise, remettre en cause certains congés existants.
Sur la médecine du travail, nous étions opposés à ce qu’a dit le COCT. Alors que l’on comptait 7 000 médecins du travail il y a quelques années, il n’y en a plus que 5 000 aujourd’hui. Comme on ne veut pas recruter, on espace les visites, auxquelles tous les salariés n’auront plus droit. Sur le travail de nuit, par exemple, l’obligation de visite préalable et le contrôle tous les six mois par le médecin du travail disparaissent.
Le licenciement économique est un des points que nous avons découverts à la dernière minute et auquel tient beaucoup M. Gattaz, président du MEDEF. Contrairement aux propos que celui-ci a tenus à la sortie de la rencontre du 14 mars, à Matignon, il a dit dans la salle de réunion que, mise à part la remise en cause du barème, la réforme allait dans le bon sens.
Cela pose le problème du périmètre – national ou international – car une grande entreprise sait mettre un établissement en difficulté par des prix de transferts, des fonds propres, etc. On met en avant la présence du juge ; or celui-ci peut d’ores et déjà se prononcer. Entre-temps, il aura fallu que le comité d’entreprise prenne un expert, que l’étude soit réalisée et que, si l’on constate que c’est abusif, on saisisse le juge… Et les gens auront été licenciés ! C’est là un des points clés.
S’agissant des TPE et des PME, il y a d’autres solutions. Il est ainsi tout à fait possible de passer des accords de branche d’application directe, ce que réclament d’ailleurs certaines organisations patronales telles celle des artisans. On peut négocier pour les TPE et PME des accords spécifiques. Nous ne sommes pas favorables au mandatement. Lorsqu’il a été institué, nous pratiquions le double mandatement : nous mandations une première fois le salarié pour négocier et une seconde fois pour vérifier le contenu de l’accord. Il est vrai qu’à l’époque, les chefs d’entreprise envoyaient un salarié vers une organisation syndicale afin de le mandater pour bénéficier des exonérations de cotisations sociales, tout en proposant de payer sa cotisation syndicale…
Si l’on procède en revanche par accord de branche, et qu’on permet à un syndicat de désigner un représentant syndical membre de l’entreprise, y compris dans les TPE et PME, sans pour autant demander d’heures de délégation – ce qui n’est pas concevable dans une entreprise de huit salariés –, le rôle du syndicat sera préservé sans le court-circuiter.
Sur le CPA, nous avons joué un rôle clé dans les négociations que nous avons menées à cet égard avec les organisations patronales. Certes, l’accord n’est pas encore signé, car deux d’entre elles ont dit qu’elles ne le feraient pas – c’est sans doute dû au débat sur le projet de loi, et j’ignore ce que fera le MEDEF. Deux points ont été intégrés : le compte personnel de formation (CPF) et le compte personnel de prévention de la pénibilité (CPPP). Si nous voulons que cet outil fonctionne, il ne faut pas charger la bourrique en intégrant par exemple d’autres dispositifs tels le compte épargne temps (CET). Veillons à ne pas créer une usine à gaz ! Il faut commencer par appliquer le dispositif, en vérifier ensuite le fonctionnement et le compléter le cas échéant. Je rappelle à cet égard que seuls 10 % à 15 % des salariés bénéficient d’un CET.
Nous avions demandé au Gouvernement la suspension du projet de loi – et non son report. Nous militons aujourd’hui pour son retrait, la philosophie générale du texte, qui nous pose un problème de fond, n’ayant pas été discutée, et de nombreuses dispositions constituant pour nous des remises en cause de droits. Nous participerons donc aux actions du 31 mars.
M. Bernard Sagez, secrétaire générale de la CFTC. L’an dernier, nous avons été associés à des discussions relatives au code du travail. En revanche, nous n’avons pas été consultés en amont s’agissant de ce projet de loi. C’est seulement au mois de mars, à l’occasion du report de la présentation du texte que nous avons pu apporter nos réponses aux différents problèmes qu’il pose.
La CFTC avait réservé à la première version un accueil très mitigé, considérant qu’elle ne présentait pas un équilibre satisfaisant entre flexibilité et sécurité des salariés. Nous ne souhaitions cependant pas le retrait du texte dans la mesure où il comportait aussi des avancées.
Au titre de ce que nous souhaitons voir conserver figurent les éléments suivants.
La nouvelle architecture du code du travail, que chacun s’accordait à considérer trop compliqué, voire illisible, nous paraît beaucoup plus compréhensible, tant pour les salariés que pour le patronat, grâce à l’articulation entre dispositions d’ordre public, négociation collective et enfin mesures supplétives.
Le CPA constitue l’une des pierres angulaires du nouveau contrat social que la CFTC appelle de ses vœux : il s’agit d’attacher des droits à la personne, et il faudra, comme cela a déjà été dit, aller plus loin.
Le projet de loi revoit en profondeur le dispositif de la validation des acquis de l’expérience (VAE) afin de le rendre moins contraignant, et de ce fait, plus attractif : il permettra aux jeunes décrocheurs d’obtenir ainsi plus rapidement un diplôme.
Nous sommes également favorables à d’autres mesures importantes telles la lutte contre le détachement illégal, le droit à la déconnexion, le mandatement
– dès lors qu’une organisation syndicale mandate une personne au sein d’une entreprise. En outre, la notion de référendum ne nous fait pas peur, dès lors qu’il est organisé à l’initiative des organisations syndicales recueillant 30 % des suffrages exprimés au premier tour des élections professionnelles. Nous considérons en effet que cela renforce les syndicats signataires.
La deuxième version du projet de loi apporte plus de garanties dans le domaine de la sécurité des salariés. Les organisations patronales se sont inquiétées de l’évolution du texte mais il était important d’en améliorer l’équilibre général. Nous estimons toutefois que des points restent à améliorer dans quatre domaines.
S’agissant des branches, tout d’abord, et même si certaines de nos observations ont été reprises, des modifications rédactionnelles doivent encore être apportées. La branche constitue en effet, pour nous, le meilleur rempart à la concurrence déloyale entre les entreprises, dont les salariés font souvent les frais. Elle doit donc rester un pivot de régulation. Le texte donne une définition de la branche qui ne prend pas assez en compte ce rôle, elle doit donc être revue dans quatre articles.
L’article 1er, qui affiche des principes, comporte un alinéa 55 qui limite les conditions dans lesquelles la convention collective peut prévoir des normes ; il devrait préciser que la négociation de branche définit les garanties communes aux salariés employés par les entreprises d’un même secteur ou ayant la même activité, et tient, à ce titre, un rôle pivot dans la négociation. Cela permettrait de confirmer que le projet de loi ne procède pas à un renversement de la hiérarchie des normes, et qu’il conforte la notion de branche.
L’article 7 dispose qu’un accord de branche peut définir la méthode de négociation d’entreprise applicable : nous souhaitons qu’il soit simplement écrit qu’un accord de branche définit la méthode de négociation d’entreprise applicable, pour éviter la caducité des négociations d’entreprise. De même, à l’article 13, qui définit la notion de branche, il faut préciser que la négociation de branche « définit », et non pas « peut définir » des garanties. Il importe de ne pas pouvoir écarter la branche.
L’article 29 concerne l’accord de branche étendu contenant des accords types applicables dans les PME ; il suffirait de prévoir des stipulations spécifiques pour les petites et moyennes entreprises, et de supprimer la mention des entreprises de moins de 50 salariés. Les PME n’emploient pas en effet nécessairement moins de 50 salariés – je rappelle que la loi Rebsamen a retenu le chiffre de 300.
L’article 7 traite encore des clauses de revoyure. Nous considérons qu’elles doivent être obligatoires au lieu d’être simplement possibles. Cela apportera une sécurité juridique aux accords.
S’agissant des accords sur le développement de l’emploi mentionnés à l’article 11, nous considérons qu’il n’est pas possible d’accoler dans la même expression les termes « développement » et « préservation », car la préservation, c’est le maintien l’emploi. Les accords de maintien existent et sont normés. Ne mélangeons pas les deux notions : le développement de l’emploi renvoie à la création d’emplois. Cet article comporte donc une ambiguïté qu’il faut supprimer.
La rédaction de l’article 30, qui concerne le licenciement économique, doit être précisée. Les critères justifiant le licenciement doivent être explicités : aux termes de « baisse des commandes », par exemple, il faut ajouter le mot « conséquente », ce qui est susceptible d’être pris en compte par le juge. De même, la rédaction « tout élément de nature à justifier ces difficultés » est trop vague, il convient de préciser que ces éléments revêtent un caractère significatif. Par ailleurs, le périmètre d’appréciation des motifs de licenciement économique doit être étendu au-delà du seul territoire national. Nous proposons d’ajouter les termes « quelle que soit leur implantation territoriale ou géographique », afin d’inclure les grands groupes.
L’article 44 concerne la médecine du travail sur les deux plans des maladies et accidents non professionnels et des maladies et accidents professionnels. Nous considérons qu’un salarié ne doit pas pouvoir être licencié avant la consolidation de son état de santé – ce serait contraire aux principes fondamentaux de la suspension de l’exécution du contrat de travail. Nous proposons donc de revenir à la rédaction de l’article L. 1226-2 du code du travail qui ne prévoit pas cette possibilité de licenciement.
Ce même article 44 crée une présomption de respect de l’obligation de reclassement pour l’employeur qui se voit ainsi libéré de cette contrainte dès lors qu’il a proposé un poste au salarié. Il faut retirer de la rédaction de l’article L. 1226-12 la partie mentionnant que l’obligation de reclassement est réputée satisfaite dès lors que l’employeur a proposé un poste.
Sur le CPA, une autre organisation syndicale a déjà estimé que les dispositions proposées devaient être améliorées : nous partageons cet avis.
Mme la présidente Catherine Lemorton. Lorsque vous évoquez les PME, j’imagine que c’est au sens de la définition donnée par la loi du 4 août 2008 de modernisation de l’économie qui retient le critère de moins de 250 salariés.
M. Bernard Sagez. C’est cela même.
M. Franck Mikula, secrétaire national au secteur emploi et formation professionnelle de la CFE-CGC. En amont de la présentation du projet de loi, un certain nombre de rapports ont été publiés à l’occasion desquels nous avons été entendus. Je pense notamment à ceux de Jean-Denis Combrexelle, de Terra Nova, de Bruno Mettling ou de Robert Badinter. Nous avons, quant à nous, exprimé le plus souvent nos désaccords. Ainsi, si nous étions favorables à la première partie du rapport de Jean-Denis Combrexelle qui consistait à renforcer le dialogue social en donnant plus de moyens, de temps et de formation aux acteurs de ce dialogue, nous ne pouvions approuver toutes les orientations visant à renvoyer la négociation prétendument au plus près du terrain, mais en réalité au plus loin des syndicats.
De notre point de vue, le dialogue social doit être renforcé au niveau de la branche, car c’est là que se construisent les lois de chacune des professions. La ministre nous a demandé la raison du verrouillage dans la négociation de branche, qui empêche de moins bien rémunérer les heures supplémentaires. Nous lui avons expliqué que c’était le souhait des partenaires sociaux au niveau des branches. Il est en effet aussi de l’intérêt des chefs d’entreprise de maintenir cette régulation pour empêcher le dumping social.
Certes, les représentants interprofessionnels nationaux tiennent un autre discours. Ainsi, M. Gattaz dira exactement le contraire de ce que disent ses représentants dans les branches qui, eux, ont bien compris l’intérêt d’harmoniser les conditions sociales pour permettre le développement des entreprises. Faute de quoi, ce sera la loi de la jungle avec un code du travail par entreprise, et tout le monde se fera concurrence.
Le fondement même de ce projet de loi nous paraît profondément choquant. Il est bien illustré par une phrase de l’ouvrage de Robert Badinter et Antoine Lyon-Caen Le travail et la loi qui lie le chômage et le droit social. Cette position a suscité bien des polémiques : c’était la première fois, en effet que d’aussi éminentes personnalités établissaient ainsi un lien que nous contestons. Si un tel lien existait, il y a belle lurette qu’il n’y aurait plus de chômage en France, puisque, depuis au moins trente ans, on ne cesse de rendre plus flexibles les conditions sociales et d’assouplir le code du travail ! Cela a commencé avec un certain Yvon Gattaz, qui promettait la création de milliers d’emplois si l’autorisation administrative de licenciement était supprimée ! Aujourd’hui, c’est un autre Gattaz, Pierre, qui promet des millions d’emplois si on lui donne beaucoup d’argent avec le pacte de responsabilité et si le code du travail devient plus souple. Malheureusement, aucune de ces mesures n’a produit les résultats annoncés et la France compte plus de cinq millions de chômeurs.
S’agissant du présent projet de loi, je n’évoquerai que quelques points qui montrent bien la nouvelle architecture souhaitée du code du travail.
Aujourd’hui, le forfait-jours constitue un dispositif dérogatoire au régime normal de la durée du temps de travail très faiblement encadré par la loi ; ce qui a conduit la Chambre sociale de la Cour de cassation à invalider la plupart des accords de branche s’y rapportant, car ils ne respectaient pas les impératifs de santé et de sécurité des travailleurs.
Il était donc temps de donner un cadre législatif à ce dispositif. Mais ce texte le fait très mal, à notre sens. De fait, dans cette nouvelle architecture et cette nouvelle hiérarchie, il ne reste pratiquement plus rien dans la loi, désormais appelée ordre public. Nous proposons donc d’enrichir le dispositif législatif en inscrivant dans l’ordre public la durée maximale du temps de travail en jours – qui n’est pas définie aujourd’hui –, la durée des repos quotidiens, et la durée des repos hebdomadaires, que nous souhaitons voir exprimés en forfait de jours civils et non plus en heures, ce qui est par trop complexe. Nous proposons un jour civil minimum de repos par semaine, mais huit jours de repos par mois et vingt-six jours par trimestre de façon à garantir la santé et la sécurité des travailleurs tout en permettant une certaine flexibilité.
Il faudra aussi inscrire dans l’ordre public la définition du temps partiel, l’obligation de visites médicales effectuées par un médecin pour les salariés employés en forfait-jours, la définition d’un niveau minimum de rémunération, quitte à renvoyer la détermination de ce dernier à la négociation tout comme le nombre d’entretiens portant sur la charge de travail avec l’employeur ou son représentant.
Il importe d’organiser le contrôle et la mesure de la charge de travail : c’est le cœur du dispositif. C’est au plus près de l’entreprise qu’il faudra trouver les bonnes méthodes pour y parvenir – en s’appuyant peut-être sur le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), avec une mesure annuelle.
Ce projet de loi cherche par ailleurs à simplifier le régime du licenciement économique en partant du principe que faciliter les licenciements favorisera l’embauche. Certes, les choses ne sont pas dites ainsi et nous savons à quel point cela est faux ! Le texte devrait prévoir au contraire qu’avant de procéder aux licenciements économiques, il faut utiliser tous les moyens alternatifs pour éviter de devoir y recourir, tels le chômage partiel, la réduction du temps de travail ou le non-renouvellement des contrats précaires. Il faut tout tenter pour préserver les emplois dans l’entreprise. C’est précisément ce qu’ont fait les Allemands en 2008, alors que nous faisions, nous, le choix des licenciements et de la rupture conventionnelle.
Nous sommes favorables aux accords majoritaires mais pas à la procédure de référendum. Nous pensons que le dialogue social est assez mûr pour adopter une telle disposition. Les difficultés qui surviendront dans un premier temps ne dureront pas longtemps : le même prétexte avait été avancé en 2008 au moment de passer à 30 %. Les accords gagneront en légitimité en passant à 50 % sans que les syndicats soient contournés par le référendum.
Nous demandons le retrait des accords offensifs. La loi de sécurisation de l’emploi a créé les accords de maintien de l’emploi. Le présent texte propose des accords préservant l’emploi : cela existe déjà. Certes, on peut considérait qu’ils ne sont pas assez nombreux : on en comptait sept ou dix lorsque nous avons établi le bilan à l’occasion de l’accord national interprofessionnel (ANI) en janvier 2013 avec le cabinet du ministère du travail. À cette occasion, le MEDEF avait expliqué que le développement de ce type d’emploi était freiné par l’obligation de licencier pour raison économique les salariés qui n’étaient pas d’accord et préconisait leur démission, ce qui était totalement inacceptable. Aujourd’hui, un tel dispositif revient par la fenêtre avec les accords dits offensifs, dans le cadre desquels lorsque les salariés refusent, ils sont licenciés pour un motif personnel – ce sont des licenciements sui generis.
Cette disposition est totalement inutile, puisque les accords de maintien dans l’emploi existent déjà et offrent de réelles garanties de préservation de l’emploi, de durée. L’ensemble des représentants participent à l’établissement du diagnostic préalable et les efforts sont partagés entre les salariés et la direction
– les dirigeants ne reçoivent pas de majoration de salaire contrairement à la pratique à la mode et il n’y a pas de distribution d’actions supplémentaires. L’article du projet de loi sur les accords offensifs sur l’emploi n’offre aucune de ces garanties et nous en demandons le retrait.
Le compte personnel d’activité (CPA) repose sur le compte personnel de prévention de la pénibilité (CPPP) et sur le compte personnel de formation (CPF), et, à l’issue de la concertation, s’est enrichi d’un compte citoyen. Il nous semble indispensable de créer un compte temps, même si la loi n’a pas à fixer son contenu ; il suffit ainsi qu’une case soit insérée dans le CPA, afin que le salarié puisse y stocker du temps. Il pourra l’utiliser pour abonder son compte de formation et pour gérer sa vie professionnelle. Cela constituerait les prémices d’une généralisation du compte épargne-temps (CET) que nous appelons de nos vœux ; ce processus prendra du temps, mais le législateur doit insérer cet étage dans le CPA afin de convenir dans le futur de dispositifs de portabilité et de fongibilité. Ceux-ci ne créeront certes pas d’emplois – pas plus que les mesures du projet de loi que vous examinerez –, mais nous devons favoriser l’autonomie à laquelle les salariés aspirent et les transferts d’activité entre la fonction publique, le secteur privé, le statut d’autoentrepreneur et le salariat.
L’avenir de la France dépend davantage de l’innovation et de la qualité du travail que d’un assouplissement du droit social. L’augmentation de la productivité ne sera possible qu’avec des salariés bien traités et plus autonomes, et en donnant davantage de pouvoir aux représentants des salariés. Il faut avancer vers la codécision que pratiquent d’autres pays et qui permet d’enrichir le dialogue social, de partager la définition de la stratégie de l’entreprise et de faciliter la gestion des emplois dans les périodes de crise.
M. Fabrice Angei, membre de la direction confédérale de la CGT. La CGT a découvert le projet de loi dans la presse et a reçu une convocation pour en discuter la semaine suivante. La CGT n’a pas participé au déjeuner de réécriture du projet de loi, celle-ci résultant de la mobilisation citoyenne et syndicale.
La CGT est opposée à ce projet de loi, même remanié, comme sept Français sur dix si l’on en croit les sondages ; si l’on organisait un référendum dans le pays sur ce texte, on n’aurait plus besoin d’en discuter. Nous demandons le retrait du texte, mais nous ne défendons pas le statu quo, puisque nous avons proposé un code du travail pour le XXIe siècle poursuivant une tout autre logique. Nous ne nous inscrivons pas dans une démarche d’amendement à la marge du texte, puisque l’ensemble de sa philosophie ne nous convient pas. Je me retrouve néanmoins dans 98 % des propos de mon camarade de la CGC – ou inversement –, ce qui remet en question la vision simpliste de la division syndicale.
Le projet de loi repose sur l’idée que les droits et les garanties des salariés doivent s’effacer devant les impératifs économiques et les intérêts financiers. Il promeut la baisse du coût du travail et fait du salarié une variable d’ajustement et de déflation pour conquérir des parts de marché. Cette philosophie s’oppose au droit du travail, qui vise à rééquilibrer le lien de subordination existant entre l’employeur et le salarié. Les droits et les protections des salariés n’ont jamais constitué un frein à l’efficacité économique, bien au contraire. La loi du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail et celle du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi ont instauré les ruptures conventionnelles – dont le nombre atteint des records – et les plans de maintien dans l’emploi, qui s’avèrent un échec ; si ces mesures de flexibilité avaient amélioré la situation de l’emploi, cela se saurait, puisque le chômage n’a jamais été aussi élevé dans toutes les catégories de la population. Il conviendrait d’analyser également les exemples européens avec attention, car les assouplissements y ont accru la précarité et la pauvreté, principalement celles des jeunes et des femmes.
Le projet de loi bâtit une nouvelle architecture des relations sociales : la loi fixe des grands principes, la négociation collective définit le droit et le volet supplétif instaure des minima inférieurs aux dispositions législatives actuelles. Les dérogations découlant des accords de branche permettent déjà d’indemniser les heures supplémentaires à un simple supplément de 10 %, mais une seule branche applique ce niveau. Les accords d’entreprise engendreront donc une régression sociale dans ce domaine, et il s’agit là d’un exemple parmi tant d’autres.
Le projet de loi donne la primauté aux accords d’entreprise, inversant ainsi la hiérarchie des normes, la loi cessant de fixer un socle commun et de prévoir des dérogations. Il y aura donc autant de codes du travail que d’entreprises, et le degré de protection des salariés dépendra de la présence de forces syndicales. En outre, l’inspection du travail rencontrera des difficultés pour jouer son rôle. Ce projet ne procède à aucune simplification, complexifie les relations sociales, ne supprime aucune rigidité et aggravera la situation économique et le chômage.
Mme Myriam El Khomri souhaite fluidifier le dialogue social, mais les accords d’entreprise le nient. Lors de l’examen de la loi du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l’emploi, dite loi Fillon, le groupe parlementaire socialiste s’était opposé au renversement de la hiérarchie des normes en saisissant le Conseil constitutionnel.
L’adaptation ne doit pas entraîner de régression sociale, mais maintenir des droits voire apporter de nouvelles garanties pour les salariés. Voilà ce qu’est le progrès social ! Le Gouvernement ne veut pas entendre sur ce point les jeunes et les salariés, qui seront massivement en grève demain.
Les accords d’entreprise génèrent, dans la très grande majorité des cas, une régression sociale. Dans les deux tiers des établissements, il n’y a pas de délégués syndicaux ; cette situation concerne toutes les structures employant de dix à vingt salariés et dans la majorité de celles en comptant entre cinquante et cent. Par ailleurs, les négociations obligatoires n’ont pas lieu dans notre pays. La peur des représailles s’est répandue dans les entreprises, et l’action syndicale se trouve criminalisée – on attend toujours que vous votiez la loi d’amnistie. Des personnes souhaitant monter des listes pour les élections professionnelles se font licencier, et un chantage permanent à l’emploi est organisé.
Le référendum chez Smart sur l’augmentation du temps de travail hebdomadaire à 39 heures payées 37 a soulevé de nombreuses questions, notamment celle du corps électoral puisque les cadres, qui sont au forfait-jours et donc ne sont pas concernés par cette modification, ont pu voter. On ne peut pas confondre le référendum d’entreprise et le droit à la consultation des salariés, car le premier diffère de la démocratie sociale ; la CGT défend la seconde, les salariés devant disposer de temps pour analyser les accords et en discuter. Il serait opportun de prendre en compte dans les négociations les cahiers revendicatifs élaborés dans les entreprises. Si l’on veut soutenir la démocratie sociale, reprenons également la périodicité biennale des élections professionnelles.
Au lieu d’accorder des droits aux salariés, la loi du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi, dite loi Rebsamen, a réduit le rôle des organisations syndicales et des délégués du personnel. On ne croit pas au mandatement de salariés dans les conditions prévues par ce texte ; on devrait plutôt conférer un pouvoir de négociation aux commissions régionales instaurées par cette loi.
Neuf salariés sur dix sont couverts par un accord de branche et une convention collective, et il est nécessaire de renforcer le poids de ces accords dans notre droit social.
L’inversion de la hiérarchie des normes et la flexibilité ont été mises en place en Allemagne, en Espagne, au Portugal et en Italie. On a constaté une chute sans précédent des accords de branche en Espagne et au Portugal – ce qui est logique puisqu’ils ont été vidés de leur substance –, mais également une diminution du nombre d’accords d’entreprise. On vise à renforcer le dialogue social et, au final, on l’affaiblit. Quant aux salariés, ils ont toujours été perdants dans cette évolution.
Ainsi, le référendum d’entreprise, que l’on appelle le référendum chantage, peut être déclenché à partir d’un accord signé entre un employeur et des organisations syndicales ne représentant que 30 % des salariés. Cela constitue une atteinte portée à la représentativité, au droit d’opposition, et nous réclamons, conformément aux principes de la démocratie sociale, une application stricte de l’accord majoritaire, signé par des syndicats représentant 50 % des salariés. Les accords minoritaires ne sont qu’un contournement des organisations syndicales et un encouragement à la création de syndicats maison ; en outre, ils n’améliorent en rien la situation de l’emploi, celle-ci nécessitant d’autres politiques économiques et sociales.
Les médecins du travail sont moins de 5 000 aujourd’hui en France et ont 55 ans en moyenne. Le projet de loi porté par Mme El Khomri ne cherche pas à régler ce problème, mais à gérer la pénurie. Ainsi, la médecine du travail est éloignée des salariés qui en ont besoin ; l’impossibilité de reclasser un salarié inapte se trouvera renforcée par cette inaction, ce qui multipliera les licenciements. Le projet de loi devrait plutôt se concentrer sur l’aménagement et la transformation du poste de travail ou sur la mutation du salarié vers un autre poste.
Mme Catherine Perret, membre de la direction confédérale de la CGT. Au printemps 2015, le président de la République avait annoncé un projet de loi destiné à compenser tous les efforts réalisés par les salariés depuis 2012. On attendait donc un texte sur la sécurité sociale professionnelle améliorant la situation des salariés. Or le projet de loi que vous examinerez ne comporte pas beaucoup d’éléments de progrès social et de sécurisation.
En 1999, la CGT a créé le concept de sécurité sociale professionnelle, qui a inspiré d’autres organisations et d’autres partis politiques de droite comme de gauche. Nous avons donc la prétention de penser posséder une certaine expertise en la matière.
La négociation sur le CPA a échoué puisqu’il n’y a eu ni accord, ni même de position commune, les organisations patronales ayant refusé de signer le texte qu’elles avaient écrit ! Elles n’acceptaient pas en effet les dispositions relatives au CPPP. Ce dernier n’a pas d’existence réelle dans le projet de loi, qui reprend même la définition de situations de travail par référentiel de branche, ce qui complexifiera davantage la question de la portabilité, essentielle pour le CPA. Dans ce dernier, il n’y a donc que le CPF et quelques dispositions de la deuxième version du projet de loi de Mme El Khomri sur la formation et les jeunes.
La CGT propose deux mesures qu’il aurait été intéressant d’étudier pour poser les premières pierres de la sécurisation des personnes pendant leur parcours professionnel – sécuriser les parcours, donc l’employabilité, et sécuriser les personnes différant grandement dans un contexte de fortes mutations technologiques qui crée beaucoup d’instabilité et de précarité. La première a trait à la progressivité de la qualification et à sa reconnaissance tout au long du parcours professionnel, celle-ci étant consignée dans un CPA pour sécuriser les personnes et accroître la prévisibilité de leur parcours professionnel. La population demande une telle évolution, car elle souhaite davantage de visibilité et de stabilité. Une telle réforme augmenterait l’attractivité de la formation continue : on a envie de se former quand on nourrit l’espoir d’en retirer quelque chose dans sa vie quotidienne, dans son entreprise, dans son évolution professionnelle et en matière de progression salariale. On entre là dans une démarche de progrès social, les augmentations salariales tout au long de la vie nourrissant les droits sociaux, notamment ceux à la retraite. La seconde proposition vise à maintenir le contrat de travail en cas de mobilité choisie ou subie ; aujourd’hui, bon nombre de salariés connaissant de grandes périodes de rupture et éprouvant des difficultés à retrouver un emploi appartiennent aux très petites (TPE) ou aux petites et moyennes entreprises (PME). Ces entreprises travaillent souvent comme sous-traitantes de grands donneurs d’ordres, qui utilisent ces salariés comme variables d’ajustement, y compris pour leurs dividendes. Les grandes entreprises doivent assumer une responsabilité sociale et assurer une sécurisation des contrats de travail des salariés de leurs filiales ou de TPE. On créerait ainsi une solidarité entre les entreprises et les branches pour que ces salariés ne soient pas trop tributaires des bons de commande des grandes entreprises.
La deuxième version du projet de loi porté par Mme El Khomri recycle beaucoup de mesures déjà présentes ailleurs ; j’attire notamment votre attention sur la généralisation de la garantie jeunes, disposition du projet de loi relatif à l’égalité et à la citoyenneté, présenté au conseil des ministres du 6 avril prochain. Elle a d’ailleurs davantage sa place dans ce projet de loi que dans celui sur le travail. Le Gouvernement effectue là un affichage grossier destiné à calmer la jeunesse qui descend dans la rue. C’est la CGT qui a négocié en Europe l’accord sur la garantie jeunes, signé unanimement ; notre Confédération défend donc cette mesure, mais l’expérimentation en cours depuis trois ans fait apparaître de nombreux problèmes, qui empêchent aujourd’hui sa généralisation. Parmi ces difficultés figurent la mise en péril des missions locales – qui se trouvent en déficit à cause de cette garantie, le forfait attribué à chaque jeune se révélant insuffisant – et l’absence de retour à un emploi stable pour les jeunes.
Les annonces sur la formation professionnelle représentent un coût de 500 millions d’euros par an, financé par des fonds mutualisés d’un milliard d’euros qui consacrent déjà 300 millions d’euros aux demandeurs d’emploi. Si cette mesure n’était pas financée, elle mettrait en péril l’ensemble des dispositifs de formation professionnelle destinés à tous les salariés.
M. Christophe Sirugue, rapporteur. Comme j’ai eu l’occasion d’auditionner de manière individuelle chacune des organisations syndicales – à l’exception de l’une d’entre elle, faute d’avoir trouvé une date –, je vais me concentrer sur un seul point. Ce texte traite fondamentalement des accords d’entreprises et d’une nouvelle articulation des normes. À défaut d’une approbation majoritaire par les partenaires sociaux sur un accord d’entreprise, l’accord de branche s’applique. Le dispositif traduit notre confiance en la capacité des partenaires sociaux à nouer un accord.
Cela étant, je suis sensible au déséquilibre qui peut exister dans l’entreprise entre l’employeur et les salariés – ou ceux qui négocient pour leur compte. Nous y avons répondu dans le texte par le principe du mandatement. Cependant, je me pose une question : les organisations syndicales sont-elles capables de couvrir la demande de mandatement qui pourrait surgir dans le cas d’une multiplication des accords d’entreprises ? J’aimerais avoir votre avis sur deux moyens de remédier à d’éventuels soucis en la matière. À côté du mandatement, ne pourrait-il pas y avoir aussi des accords validés par les DIRECCTE, ou des accords validés puis examinés a posteriori par les organisations syndicales qui en vérifieraient la pertinence ?
Pour que ces accords aient du sens, il faut qu’ils soient négociés dans de bonnes conditions, ce qui suppose l’accompagnement des organisations syndicales. Si celles-ci ne sont pas suffisamment mobilisables, pour une raison ou une autre, pensez-vous que les deux solutions que je viens d’évoquer pourraient faire office de complément ?
Mme Monique Iborra. Au nom du groupe Socialiste, républicain et citoyen, je vous remercie les uns et les autres de vos interventions argumentées. Nous aurions évidemment préféré que cette loi soit négociée avec les partenaires sociaux qui sont les premiers concernés – mais pas les seuls, j’y insiste – par le sujet. Ce texte marquant une évolution – et non une rupture –, notre groupe considère qu’il est légitime que les partenaires sociaux, les salariés et aussi les citoyens s’en emparent. Il vaut toujours mieux voir le réel que de vivre avec des représentations. Ce projet de loi va précisément au-delà des représentations que peuvent avoir les non-spécialistes du sujet, les personnes qui ne sont pas en entreprise tous les jours, ce qui peut d’ailleurs être notre cas.
Nous ne sommes pas favorables au statu quo. Il ne s’agit pas de réformer pour réformer, mais la situation nous impose d’agir. Rappelons que plus de neuf embauches sur dix se font sous la forme d’un CDD ou d’un contrat d’intérim d’une durée de moins de trois mois. Rappelons qu’il y a en France une précarité croissante qui ne date pas de 2012, au point que les CDD de moins de trois mois représentent désormais 40 % des embauches. La réforme du code du travail n’est pas forcément la seule réponse, mais c’est l’une des réponses.
Le débat est légitime puisque le chômage reste à un niveau très élevé. Nos voisins européens ont engagé des réformes du marché du travail. Je n’en ai pas la même vision que vous et je ne fais pas la même lecture que vous du rapport du Conseil d’orientation pour l’emploi. Je ne mets pas en cause votre interprétation, mais ce n’est pas la mienne. Cela étant, s’il y avait une recette miracle, nous la connaîtrions.
Certains estiment que cette réforme n’est pas nécessaire. Pour notre part, nous saluons le volontarisme politique de notre gouvernement et sa décision de faire bouger les choses. Est-ce que cela signifie forcément une confrontation ? Les uns nous reprochent de donner trop aux chefs d’entreprise, les autres de trop favoriser les salariés, ce qui tendrait à prouver que le texte est équilibré, comme nous le souhaitons. Notre problème est de faire émerger une nouvelle culture, basée sur la négociation et non sur la confrontation. C’est la raison pour laquelle nous sommes globalement favorables aux accords d’entreprise, à condition que les accords de branches soient préservés et qu’ils s’appliquent en cas de non-accord dans l’entreprise. C’est ce que prévoit le texte.
Cependant, nous devons encore travailler sur le projet de loi car un rapport de subordination existe indéniablement entre les salariés et les dirigeants d’une entreprise. Notre démarche consiste à rendre certaines situations négociables, partant du constat que les salariés comme les citoyens sont en demande d’un minimum d’autonomie dans leurs décisions. Nous insistons aussi sur la transparence : il est important que les accords soient publiés puis, passé un certain temps, évalués soit par le Parlement soit par les partenaires sociaux eux-mêmes.
Tel est notre état d’esprit à ce stade d’un débat qui doit se poursuivre : tous les acteurs, y compris les citoyens, doivent être entendus.
Mme Isabelle Le Callennec. Au nom du groupe Les Républicains, je voulais remercier les organisations syndicales pour leur contribution au débat. Hier, nous recevions la ministre du travail et, cet après-midi, nous auditionnerons les organisations patronales.
Mme Myriam El Khomri nous a rappelé l’ambition du projet de loi, contenue dans le titre : « Instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections pour les entreprises et les actifs. » Nous lui avons indiqué que, si notre groupe partageait cet objectif, nous aurions aimé être rassurés sur son intention de redonner des perspectives aux 6 millions de Français inscrits à Pôle emploi. Ce matin, il n’a pas été beaucoup question des demandeurs d’emploi.
Il y a eu une première version du texte. Les organisations patronales estimaient qu’elle allait dans le bon sens. Ce n’était manifestement pas votre cas puisque certains d’entre vous réclamaient le retrait du texte tandis que d’autres plaidaient pour sa réécriture. Il existe bien un pluralisme syndical, nous l’avons mesuré ce matin, mais chacun doit s’interroger sur le très faible taux de syndicalisation dans les entreprises françaises : 6 %. Soyez rassurés, le désamour vis-à-vis des partis politiques est à peu près du même niveau.
Si nous sommes ici ce matin, c’est parce que le choix de faire évoluer le texte a primé, mais la nouvelle version disconvient, pour ne pas dire davantage, aux représentants des entreprises. Les entreprises soutenaient en effet plusieurs mesures : la légalisation des accords offensifs, la possibilité pour une TPE d’appliquer unilatéralement un accord-type, la sécurisation du licenciement pour motif économique, le plafonnement des dommages et intérêts dus en cas de licenciement.
La deuxième version du texte les inquiète. Elles craignent que les avancées ne soient remises en cause, notamment celles qui sont relatives aux critères de définition du licenciement économique, dont vous avez parlé les uns et les autres. Elles citent de nets reculs : l’extension du mandatement dans les TPE
– qui fait peur – ; la suppression du forfait-jours avec un risque d’insécurité des accords antérieurs ; la suppression de l’adaptation du temps de travail des apprentis en fonction du temps de travail de leur tuteur. Je passe sur la possibilité de fractionner le repos et sur l’augmentation de 20 % des heures de délégations syndicales, sans parler du compte pénibilité.
Si je rappelle cela, c’est parce qu’en vous écoutant, j’ai le sentiment que le consensus va être extrêmement difficile à trouver. La ministre du travail estime que le texte présenté en conseil des ministres est équilibré. Ce n’est absolument pas l’avis de ceux qui créent l’emploi dans notre pays, c’est-à-dire les entreprises, singulièrement les PME. Ce n’est pas non plus l’avis de certains d’entre vous, mais pour des raisons opposées.
Alors je me pose la question. Est-il possible de réformer dans notre pays ? Allons-nous rester le dernier pays en Europe à subir le chômage de masse ? Est-il possible de concilier compétitivité économique et cohésion sociale, dans un monde économique ouvert et en mutation profonde ? Peut-on donner plus de souplesse aux entreprises et fluidifier le marché du travail, tout en offrant plus de sécurité aux actifs et de l’espoir aux demandeurs d’emploi, ceux que l’on appelle les outsiders ?
Nous voudrions le croire. Quand je vous entends dire que vous souhaitez favoriser le dialogue social au niveau le plus pertinent, c’est-à-dire de la loi, de la branche ou de l’entreprise, je me dis que tout espoir est permis. C’est la raison pour laquelle notre groupe va examiner cette loi article par article, avec le souci de soutenir tout ce qui va dans le bon sens, c’est-à-dire tout ce qui permet de lutter efficacement contre le chômage et institue vraiment de nouvelles libertés et de nouvelles protections pour les entreprises et les actifs.
Nous souhaitons surtout que l’examen de ce texte soit l’occasion d’un diagnostic partagé sur la situation de l’emploi dans notre pays. Nous réalisons en effet que dans les entreprises, dans les régions, au plus près du terrain, quand le diagnostic est partagé entre les partenaires sociaux, patronat et syndicats, il est beaucoup plus facile de se fixer des objectifs communs. Le dialogue social devient alors une réalité vécue positivement. J’en veux pour preuve les démarches de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences que nous élaborons à l’échelle de nos territoires, dans l’intérêt des entreprises, des salariés et – ne les oublions pas – des demandeurs d’emploi.
Pour conclure, j’aurai trois questions. L’article 1er du chapitre Ier, intitulé « Vers une refondation du code du travail », institue une commission d’experts et de praticiens des relations sociales, afin de proposer au Gouvernement une refondation de la partie législative du code du travail – ce que nous estimions être l’objectif premier de ce texte. Cette commission vous associe à ses travaux. Partagez-vous tous les principes mentionnés dans cet article 1er ?
Vous avez travaillé avec les organisations patronales sur les critères, énoncés dans une lettre paritaire datée du 28 janvier, permettant d’accompagner la restructuration des branches dont le nombre doit être ramené de 700 à 100 ou 200. Avez-vous bon espoir de convaincre le Gouvernement de leur bien-fondé ?
J’ai bien entendu tout ce que vous avez dit au sujet des branches. Vous avez évoqué le pouvoir unilatéral de l’employeur. Ne pensez-vous pas que la décision unilatérale de l’employeur, la DUE, qui est une procédure simple, popularisée par la mise en place de la complémentaire santé, soit une voie d’avenir ?
M. Francis Vercamer. M’exprimant au nom du groupe Union des démocrates et indépendants, je dirais que nous avons un défi à relever ensemble : l’adaptation de la société à la mondialisation, à l’évolution de la technologie et du monde en général. Ce projet de loi devait permettre à l’entreprise de s’adapter tout en garantissant au salarié une certaine sécurisation dans l’emploi. Je dis bien dans l’emploi et non dans son emploi. La véritable sécurité du salarié est d’avoir un emploi, ce n’est pas d’être sclérosé dans son emploi même quand celui-ci est menacé de disparaître avec une entreprise incapable de s’adapter à son environnement.
Dans ce texte, il manque une réflexion sur le coût du travail, qui est un frein à l’embauche, sur le financement de la protection sociale, et sur l’écart qui s’amenuise entre les revenus des travailleurs pauvres et ceux des allocataires de revenus sociaux.
Deuxième sujet : la complexité du code du travail. Avec ses 134 pages, ce texte ne va pas contribuer à clarifier ce code. Nous-mêmes, nous avons du mal à nous repérer dans l’article 2 sur le temps de travail, qui fait cinquante pages. Comment va faire un patron de TPE ou de PME qui peine déjà à s’y retrouver dans les textes actuels ? Comme d’habitude, ce projet de loi est fait pour les grands groupes plutôt que pour les PME. Nous avons encore une fois raté la cible : les PME qui créent de l’emploi mais qui sont plus petites que leurs homologues européennes parce qu’on les empêche de se développer.
Troisième sujet : la formation. Il vaudrait mieux améliorer l’orientation et l’accès à la formation que d’augmenter le nombre d’heures qui y sont consacrées. À chaque fois que nous avons augmenté le temps de formation, nous avons constaté que la mesure profitait à ceux qui en avaient le moins besoin, et non pas à ceux qui étaient les plus éloignés de l’emploi. Ce texte devrait être revu sur ce point car il ne résout pas le problème.
Quatrième sujet : le CPA qui, je suis d’accord avec vous, est important. Il tend à attacher la sécurité à la personne et non plus au contrat de travail, et donc à désolidariser le salarié de son entreprise. Quand les représentants de la CFDT ont évoqué ce compte, à plusieurs reprises, j’ai été frappé par leur vision d’une sécurisation du salarié dans son entreprise. Si l’on veut réformer structurellement le code du travail, il faut permettre au salarié de changer d’emploi sans perdre ses droits, pour qu’il puisse s’adapter à la société et ne pas s’accrocher à un métier du passé.
Cinquième sujet : la hiérarchie des normes. Comme vous, je pense qu’il faut que la branche puisse éviter la concurrence déloyale. Il ne faut pas que l’entreprise puisse déroger à tout prix à cette hiérarchie des normes ou aux règles des branches. L’entreprise doit certes pouvoir s’adapter, notamment quand elle est en difficulté, quand elle affronte sur ses marchés à l’exportation des concurrentes qui ne sont pas soumises au même droit social qu’elle, quand elle subit le dumping social d’une voisine, située juste de l’autre côté d’une frontière. Il faut permettre à l’entreprise de s’adapter, mais je suis assez d’accord avec vous sur la hiérarchie des normes.
À cet égard, j’ai une question simple : pour remédier à la faiblesse du nombre des syndiqués, pourquoi ne pas changer de paradigme en faisant un syndicalisme de service ou simplement en supprimant l’effet erga omnes ? Seuls les syndiqués bénéficieraient des accords signés, ce qui obligerait les salariés à se positionner par rapport aux syndicats. En outre, tous les salariés étant syndiqués, les référendums auraient lieu à l’intérieur du syndicat plutôt que de l’entreprise.
Mme Éva Sas. Je vous remercie de m’accueillir au sein de votre commission pour représenter le groupe Écologiste. Je remercie également les représentants des organisations syndicales pour la qualité de leurs éclairages.
J’avais cinq questions, dont les deux premières s’adressent plutôt à la CFDT et à la CFTC. Les accords de branche permettent d’éviter la concurrence déloyale et la course au moins-disant social. Pensez-vous pertinent qu’un accord d’entreprise puisse fixer la majoration des heures supplémentaires tel que le prévoit l’article 2 du projet de loi ? Je ne crois pas que vous vous soyez exprimés sur ce point.
Ma deuxième question porte sur l’article 11. Comment justifiez-vous qu’un salarié, qui refuse la modification de son contrat de travail dans le cadre d’un accord de préservation et de développement de l’emploi, puisse être licencié pour motif personnel et non plus pour motif économique comme c’est le cas actuellement ?
Ma troisième question s’adresse à l’ensemble des organisations syndicales. J’ai entendu peu de propositions sur la médecine du travail. Le projet de loi a introduit un doute et un risque d’affaiblissement du travail de prévention effectué dans ce cadre. La prévention ne peut se limiter aux métiers à risques, toutes les professions étant exposées notamment aux risques psychosociaux. Comment maintenir le rôle de prévention de la médecine du travail tout en tenant compte des difficultés de recrutement avérées dans ce secteur ?
En termes de propositions et de protections nouvelles pour les salariés, avez-vous des mesures à préconiser pour les travailleurs de l’économie collaborative ? Comment intégrer ces derniers dans le code du travail ? La majorité d’entre eux subissent un lien de subordination réelle sans bénéficier de droits sociaux. Comment remédier à cela ?
Enfin, quelle est votre position sur le renforcement de la présence des salariés dans les conseils d’administration, qui pourrait être une façon d’introduire une gestion partagée de l’entreprise ?
Mme Dominique Orliac. Au nom du groupe Radical, républicain, démocrate et progressiste, je vous remercie, mesdames et messieurs les représentants des syndicats, pour votre présentation et pour votre présence, ce matin, au sein de notre commission.
Ma première question se rapporte à l’article 10. Dans l’exposé des motifs, il est indiqué : « L’article 10 renforce la légitimité des accords d’entreprise en modifiant la règle de validité des accords d’entreprise : la règle de l’accord majoritaire sera progressivement étendue. » Cela signifie que la validité de l’accord est subordonnée à la signature d’une organisation syndicale représentative ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés. À défaut, l’accord pourra être valide s’il est signé par des organisations syndicales représentatives ayant obtenu 30 % des suffrages exprimés, et approuvé par une majorité de salariés directement consultés sur demande de ces organisations syndicales. Ces nouvelles dispositions reviennent donc sur la loi de 2008 relative à la représentativité syndicale ; elles subordonnent la validité d’un accord à un seuil de 30 %, tout en prévoyant un droit d’opposition majoritaire. Les syndicats ayant adopté des positions très divergentes sur le sujet, j’aurais aimé avoir l’avis de ceux qui ne se sont pas encore exprimés.
L’article 15, quant à lui, prévoit que les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent mettre des locaux à disposition des syndicats, lorsque ces derniers en font la demande. La mise à disposition de locaux au profit des syndicats est un usage répandu dans de nombreuses collectivités territoriales. Toutefois, le cadre juridique de ces pratiques est très incomplet. Les nouvelles dispositions vous semblent-elles aller dans le bon sens ? Répondent-elles aux demandes adressées l’an passé à François Rebsamen ? Les estimez-vous encore incomplètes ?
L’article 25 étend le champ de la négociation annuelle relative à la qualité de vie au travail aux modalités d’exercice par le salarié de son droit à la déconnexion. L’inscription de ce nouveau droit vise à prendre en compte les contraintes afférentes aux outils numériques mis à disposition par l’employeur et pesant sur les salariés. Il est présenté comme un enjeu majeur pour certaines catégories de salariés. Qu’en pensez-vous ? Le texte prévoit une entrée en vigueur de la mesure au 31 décembre 2017, afin de permettre la négociation. À défaut, les modalités d’exercice de ce droit seront définies par l’employeur. Le délai accordé est-il suffisant pour permettre à l’ensemble des acteurs sociaux de s’accorder sur ces modalités ?
Ma dernière question porte sur l’article 27 qui vise à renforcer l’utilisation des outils électroniques et numériques de l’entreprise par les organisations syndicales, et à permettre le recours au vote électronique simplifié. Selon l’étude d’impact, le vote électronique offrirait de nombreux atouts : simplification de l’organisation du scrutin, limitation des risques d’erreurs et de fraude lors du dépouillement, augmentation du taux de participation avec la possibilité de voter à distance pendant plusieurs jours, inscription du processus électoral dans une démarche de préservation de l’environnement. Quel est votre avis ?
Mme Jacqueline Fraysse. Au nom du groupe de la Gauche démocrate et républicaine, je voudrais à mon tour remercier les organisations syndicales qui ont bien voulu participer à ces débats et qui nous éclairent sur leurs préoccupations. Pour l’essentiel, leurs préoccupations confirment les miennes.
Comme je l’ai dit hier, lors de l’audition de Mme la ministre, nous rejetons tant la philosophie qui sous-tend ce projet de loi que l’essentiel de son contenu. Il est absolument inacceptable d’établir un lien entre la baisse des protections des salariés et les créations d’emploi. Ce lien n’a jamais été démontré. J’ai interrogé Mme la ministre à ce sujet mais elle ne m’a pas répondu. Quelle étude permet d’établir un tel lien ? J’aimerais le savoir.
Le débat ne porte pas sur la nécessité de développer, de fluidifier, d’améliorer, de faciliter le dialogue social. Nous sommes tous d’accord là-dessus. Mais il faut prendre en compte un rapport hiérarchique lourd. Dans quelles conditions le dialogue social se déroule-t-il ? C’est tout le problème qui nous est posé.
Comme certains l’ont rappelé, la vocation initiale du code du travail est la protection des salariés. Non seulement cette protection ne doit pas être remise en cause mais elle devrait être améliorée, modernisée, mieux adaptée à la société actuelle. Or le texte, y compris dans sa deuxième version, marque des reculs en matière de temps de travail, de protection contre les licenciements abusifs, de santé, etc. Ce n’est pas une modernisation, c’est un retour en arrière.
Pour conclure ces observations générales, je précise que nous ne prônons pas pour autant le statu quo. Il s’agit évidemment de travailler avec tous, organisations syndicales et citoyens, afin de mettre en place des dispositions modernes et équilibrées, qui permettront d’explorer des formes nouvelles de salariat et des droits nouveaux, tout en tenant compte de la diversité des contraintes des entreprises, que personne ne nie et qu’il faut effectivement examiner. Nous devrions débattre d’un autre texte, ouvert sur l’avenir. C’est la raison pour laquelle nous souhaitons que celui-ci soit retiré.
Vous avez déjà répondu aux questions que je désirais vous poser sur le CPA et le mandatement. Il m’en reste trois autres.
Comment souhaitez-vous être associés à la commission qui est chargée de la refondation du code du travail ?
Le texte prétend renforcer les moyens qui sont accordés aux représentants des personnels. Que pensez-vous des articles 15 et 16 qui traitent des locaux et des heures de délégation ?
Concernant la hiérarchie des normes, je crois savoir que la CGT évoque la constitutionnalisation du principe de faveur pour ne pas risquer ces retours en arrière. Que pensent les autres organisations syndicales de cette proposition qui me paraît intéressante ?
Mme la présidente Catherine Lemorton. Nous en venons aux questions des députés.
M. Gilles Lurton. Le code du travail, selon M. Mikula, n’a cessé d’être assoupli depuis trente ans. Cependant, nombreux sont ceux qui estiment que les lois adoptées au fil des dernières années n’ont fait qu’y ajouter des pages supplémentaires, le rendant ainsi plus complexe au point d’être incompréhensible par les entreprises, en particulier les PME, qui sont pourtant les plus créatrices d’emploi. La loi impose la consultation des partenaires sociaux lors de toute modification du code du travail. Je vous pose donc la question : êtes-vous tous convaincus que le code du travail doit être simplifié – ce qui constitue l’un des premiers objectifs de ce projet de loi ?
D’autre part, j’estime qu’une réforme du code du travail ne doit avoir pour seul objectif que la relance de l’emploi afin de permettre aux jeunes, aux personnes peu qualifiées et aux seniors au chômage de retrouver un emploi. Selon la CGT, les droits et intérêts des salariés ne doivent pas s’effacer derrière les intérêts économiques et financiers, et je pourrais partager ce point de vue ; il n’est pas tolérable, néanmoins, que notre pays compte plus de 3,7 millions de chômeurs et que les contrats précaires s’y multiplient. En quoi ce projet de loi, dans la version qui nous est présentée aujourd’hui, est-il susceptible de relancer l’emploi ?
Enfin, le plafonnement ou la fixation d’un barème des indemnités prud’homales ne figure plus dans cette version du projet. Pourquoi cette disposition, telle qu’elle était initialement conçue, était-elle selon vous inacceptable ?
Mme Martine Carrillon-Couvreur. Ainsi conçu, le compte personnel d’activité, qui permet d’attacher des droits à la personne tout au long de son parcours, constitue la pierre angulaire d’un nouveau contrat social. Nos concitoyens attendent une plus grande autonomie des décisions qui les concernent. Vous avez été plusieurs à soulever la notion du temps concernant le CPA, et je partage cette préoccupation. Comment entendez-vous poursuivre le travail en la matière ? Il semble que des difficultés empêchent d’aller plus loin et de bâtir un CPA tenant pleinement compte de la notion de temps, pourtant essentielle.
D’autre part, chacun connaît les situations dramatiques que créent les problèmes de reclassement dans les entreprises. Le projet de loi ne saurait éluder cette question. Une seule proposition de reclassement ne peut suffire : il faut veiller à ce que plusieurs propositions soient faites et prévoir l’accompagnement adapté pour que les intéressés retrouvent concrètement un poste et s’y maintiennent. Nous améliorerons ce faisant la sécurisation des parcours professionnels.
M. Jean-Louis Costes. Il existe un principe général de laïcité dans le secteur public. Ne serait-il pas temps d’établir enfin un principe identique dans les entreprises du secteur privé ?
M. Michel Liebgott. Votre franchise, mesdames et messieurs les représentants des syndicats, a fait apparaître de profondes divergences, au point que l’on peut s’interroger sur ce qu’aurait été la version initiale de ce projet de loi si elle avait été maintenue – ou si d’autres devaient y revenir un jour. Je comprends mieux pourquoi M. Fillon, par exemple, déclarait récemment qu’il gouvernerait par ordonnances au cours des deux mois suivant son élection.
Nous sommes tous témoins sur le terrain d’accords passés par les organisations syndicales dans les entreprises – la CGT signe environ 84 % des textes, la CFDT 94 %. Autrement dit, la volonté de dialogue social existe. Paradoxalement, comme le rappelait M. Combrexelle, on semble préférer que la loi, plutôt que le dialogue social et les échanges qui ont lieu au sein de l’entreprise, impose les règles. Certains d’entre vous souhaitent se dessaisir de ce pouvoir, ce qui me semble préjudiciable pour les salariés, car nul ne connaît mieux une situation que celui qui la vit sur le terrain. Ainsi, dans le secteur sidérurgique à Florange, les accords passés n’ont pu être signés que parce que les syndicats étaient forts. Certes, je ne suis pas favorable au modèle allemand, dans lequel il est nécessaire d’adhérer à un syndicat pour bénéficier des avantages d’un accord. Nous pourrions cependant nous inspirer de la qualité du dialogue social qui existe dans ce pays et de mesures très concrètes concernant le temps partiel, par exemple, qui ont permis à l’Allemagne de traverser la crise sans compromettre la formation professionnelle.
Je conclurai par un point positif. « L’État n’avait jamais concédé le pilotage de ce type d’opération de formation aux conseils régionaux, et je m’en félicite », déclarait récemment le président de la nouvelle région Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine : c’est la preuve que nous pouvons encore avancer ensemble, de manière concrète et pragmatique !
M. Arnaud Viala. Ce projet de loi vise à « instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections pour les entreprises et les actifs » et à apporter des solutions au contexte économique pour le moins dégradé que nous connaissons. Il a également été présenté comme un outil permettant d’établir un dialogue constructif entre les différentes parties prenantes de l’économie et de l’emploi.
Selon vous, la réforme du code du travail n’améliorera pas les conditions économiques de notre pays. Pouvez-vous nous donner quelques pistes qui permettraient d’y parvenir ? Cette question est le nœud du problème, en effet ; faute d’y répondre, nous nous contenterions de postures, les organisations syndicales se contentant de défendre les salariés, les organisations patronales de défendre le patronat et les formations politiques de se ranger derrière ceux qu’ils estiment – parfois à tort – constituer leur électorat.
J’en viens à la question de la méthode, que j’ai posée hier à la ministre sans obtenir de réelles réponses. Vous avez eu connaissance bien avant nous de ce texte – à cet égard, Madame la présidente, les membres de la commission ne disposent toujours pas d’un exemplaire imprimé du texte, ce qui me semble tout à fait anormal – qui tend à placer le dialogue et la négociation au cœur du dispositif. Or, vous avez tous déploré le fait que vous n’auriez pas été suffisamment consultés. Qu’en est-il ?
Mme la présidente Catherine Lemorton. Le texte est disponible en ligne depuis jeudi dernier comme cela vous a été rappelé par mail hier. Libre à vous de l’imprimer, monsieur Viala.
Mme Chaynesse Khirouni. Concernant la question de savoir si l’entreprise serait le meilleur niveau auquel conduire certaines négociations, en particulier sur le temps de travail, nos auditions ont permis de recueillir plusieurs inquiétudes. Certains employeurs nous ont rappelé que les TPE et les PME craignent des distorsions de concurrence en raison de la coexistence de conditions de travail et d’organisation différentes dans un même secteur d’activité, d’où une préférence pour les accords de branche ; ils s’inquiètent également de la pression accrue des sous-traitants. Du point de vue des salariés, les accords d’entreprise peuvent prévoir des dispositions moins favorables que les accords de branche ce qui, dans un contexte économique difficile, modifie forcément le rapport de force et fragilise la situation et les droits des salariés, les pressions s’exerçant au sein de l’entreprise étant plus fortes. Quelle réponse faites-vous à ces différentes craintes ?
D’autre part, en quoi la multiplication des accords d’entreprise permettrait-elle de simplifier et de fluidifier le marché du travail ?
M. Bernard Perrut. Les jeunes sont au cœur de nos préoccupations en matière d’emploi. Le Premier ministre a déclaré que la garantie jeunes serait une révolution pour la jeunesse – encore faut-il que cela se vérifie dans les faits, ce qui n’est pas certain. Le représentant de la CGT a évoqué son rôle au niveau européen en faveur du financement de cette mesure. Avons-nous seulement la même vision de cette garantie ? À mon sens, elle ne doit pas constituer un droit universel sans contrepartie, ni une nouvelle trappe à précarité. Convenez-vous des strictes obligations dont elle doit être assortie en termes de sélection, d’engagement, de détermination et de motivation des jeunes concernés ?
Que pensez-vous d’autre part du budget nécessaire au déploiement de cette mesure, la presse s’étant fait l’écho d’un débat imprécis sur cette question ? Quoi qu’il en soit, la garantie jeunes ne réussira que si les obligations et exigences qui l’accompagnent sont respectées afin de conduire les jeunes vers la formation et l’emploi.
Mme Kheira Bouziane-Laroussi. L’un des objectifs de ce projet de loi vise à répondre au besoin des chefs d’entreprise de disposer d’une meilleure visibilité dans les situations de contentieux, ce qui permettrait, semble-t-il, de favoriser les créations d’emplois. Les organisations syndicales, qui font partie des juridictions prud’homales compétentes en la matière, ont-elles des propositions à formuler pour améliorer le règlement des litiges, lesquels ne constituent pas une période plus facile pour les salariés que pour les employeurs ?
M. Yves Censi. Le droit du travail est de nature éminemment jurisprudentielle ; c’est pourtant une dimension que l’on néglige souvent lorsque l’on envisage la simplification du code du travail, dont la complexité tient pour l’essentiel à la somme de jurisprudence émise par la chambre sociale de la Cour de cassation. Tout comme les organisations d’employeurs, les organisations syndicales sont des acteurs de la justice prud’homale ; ne pensez-vous qu’en la matière, ce projet de loi passe à côté de quelque chose ?
D’autre part, le sixième principe énoncé à l’article 1er ne contient aucune nouveauté concernant la liberté d’expression des salariés ; en revanche, certaines dispositions disparaissent. Ainsi, pour s’opposer à la libre expression religieuse d’un salarié, un employeur doit aujourd’hui arguer non seulement de nécessités proportionnées au but recherché – ce qui est maintenu dans le texte – mais aussi d’exigences essentielles et déterminantes, en lien avec la tâche à accomplir – qui disparaissent. Qu’en pensez-vous ?
Enfin, ce projet de loi me semble se caractériser par une profonde ambiguïté concernant la hiérarchie des normes. Il dispose que « En cas de conflit de normes, la plus favorable s’applique aux salariés si la loi n’en dispose pas autrement ». Une telle rédaction laisse à penser qu’il n’a pas été mis fin au principe de faveur – bien au contraire, elle le renforce. Êtes-vous opposés à la suppression de ce principe et pensez-vous que la chambre sociale de la Cour de cassation et les autorités jurisprudentielles l’accepteraient aisément ?
M. Gérard Sebaoun. Par principe, je suis favorable à l’article 25, relatif au droit à la déconnexion, mais je reste tout de même très dubitatif. En effet, aborder ce sujet revient à aborder celui de la place des outils numériques dans notre vie professionnelle et personnelle. Or, le chevauchement de l’une et de l’autre ne trouvera pas de solution dans la loi, car les usages n’ont pas le même poids selon les individus, les organisations, les entreprises. L’arc des champs concernés s’étend de la protection des salariés – qui incombe naturellement aux employeurs – à une autonomie revendiquée, laquelle peut aussi se traduire par un mieux-être – et non un mal-être – au travail. On ne saurait traiter de la même manière la situation des salariés qui gèrent leur messagerie au moment de leur choix et ne le font pas toujours depuis leur lieu de travail, et ceux qui reçoivent des instructions à toute heure du jour voire de la nuit, ce qui constitue manifestement un facteur de risque et de stress. Autrement dit, le texte peut-il se limiter à prévoir une charte élaborée après avis des instances représentatives du personnel ?
D’autre part, le télétravail – objet de l’article 26 – connaît un certain retard en France. Avez-vous une idée de son développement actuel ? Je suis favorable à ce qu’il se développe par la négociation, à domicile comme dans des espaces de co-working.
Ces deux articles entraîneront un profond bouleversement de l’architecture très hiérarchisée de nos entreprises et provoqueront une véritable révolution du rôle des managers.
Mme Véronique Descacq. L’insuffisance de la couverture des mandatés dans les petites entreprises – à laquelle M. Sirugue a proposé de remédier par deux pistes alternatives – n’est pas un sujet de préoccupation pour la CFDT, qui ne s’inquiète pas de l’éventualité qu’un salarié éprouve des difficultés à trouver une organisation syndicale qui le mandaterait, et pour cause : nous avons déjà fait cette expérience lors des accords sur la réduction du temps de travail, dans le cadre de l’application des lois Aubry, sans rencontrer de problèmes. Les organisations syndicales étant organisées par profession et par territoire, et compte tenu des moyens de communication modernes, il est toujours aisé de trouver la porte d’entrée menant à l’interlocuteur susceptible de mandater un salarié.
Quant à votre proposition de faire valider les accords issus de la négociation dans les petites entreprises par les directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE), ce n’est pas une piste que nous envisageons : une telle mesure ne relève en effet plus du champ de la négociation collective, mais d’une décision administrative. Nous préférons en l’occurrence prévoir à l’échelle de la branche la négociation d’accords-types de deux catégories : les accords-types d’application directe et les accords-types pouvant être appliqués par la branche sous réserve de leur adaptation dans les entreprises, le mandatement pouvant alors intervenir. Dans ce domaine, la branche a toute sa place à tenir : songez aux dispositions de la loi Rebsamen concernant les commissions paritaires des TPE, qui ont permis à certaines branches de créer des commissions spécifiques aux TPE pouvant utilement contribuer à la négociation d’accords-types applicables à ces entreprises.
S’agissant du principe de publication des accords, madame Iborra, nous proposons qu’il n’appartienne plus à l’employeur de choisir unilatéralement si les accords doivent ou non être publiés. D’autre part, la question de l’évaluation est majeure : au fil des réformes adoptées ces dernières années, le contenu du modèle social et la manière dont il se construit ont profondément changé. Il est impératif d’en évaluer les résultats, ce qui a d’ailleurs été fait suite aux accords nationaux interprofessionnels de 2008 et 2013. Nous devons reconnaître que notre première réponse n’est pas forcément la bonne : il faut poursuivre le changement lorsque l’on constate que les orientations prises étaient malvenues ou insuffisantes. C’est précisément ce que nous avons fait au sujet des accords de maintien dans l’emploi : nous avons estimé que les mesures prises en 2013 n’avaient pas permis de développer ces dispositifs parfois utiles pour les entreprises et pour les salariés. En clair, il est légitime que les lois reviennent sur des expériences qui ont montré leurs limites.
La CFDT, madame Le Callennec, ne souhaite pas réformer à tout prix pour flexibiliser un marché du travail déjà très flexible. Nous ne croyons pas non plus un seul instant à la solution miracle d’une réforme du marché du travail qui libérerait les employeurs de leurs angoisses existentielles en matière d’embauche et qui, du même coup, donnerait naissance à une génération spontanée d’emplois. En revanche, nous croyons que la société et l’économie traversent des mutations profondes. Or, à n’y répondre qu’en réduisant le coût du travail et les contraintes, on s’engagerait dans une spirale qui tirerait vers le bas non seulement les droits des salariés, mais aussi l’économie dans son ensemble.
C’est pourquoi les réformes mises en œuvre doivent selon nous poursuivre un triple objectif. Le premier vise à permettre aux entreprises de s’adapter au contexte nouveau en renforçant leur compétitivité ; de ce point de vue, le dialogue social est le moyen le plus pertinent de faire coïncider le nécessaire objectif de compétitivité des entreprises et celui de la protection des salariés. Le deuxième objectif consiste à attacher des droits à la personne afin de permettre aux personnes d’être plus mobiles et de changer de métier à mesure que les secteurs d’activité, qu’ils soient industriels ou agricoles, évoluent. C’est précisément le sens du compte personnel d’activité et de la sécurisation des parcours professionnels. Le troisième objectif, enfin, a trait à la montée en compétences et à l’ensemble des orientations relatives à la formation professionnelle, dont on ne saurait prétendre qu’elle continue encore aujourd’hui à favoriser les salariés les mieux formés. C’était le cas autrefois, en effet, mais la réforme de la formation professionnelle de 2014 était justement destinée à mettre fin à cette situation. Elle commence seulement à produire ses effets, mais elle va réorienter massivement les fonds alloués à la formation professionnelle en direction des personnes les moins qualifiées, qu’il s’agisse de salariés, de demandeurs d’emploi ou de jeunes en insertion ou en recherche d’emploi. Si je me félicite de cette deuxième version du projet de loi, c’est parce qu’elle parachève l’ambition défendue dans la réforme de 2014 en privilégiant les personnes les moins qualifiées.
Il va de soi que nous souhaitons être associés aux travaux de la commission d’experts créée par l’article 1er, au moyen d’échanges intelligents permettant aux organisations syndicales de formuler des contre-propositions. C’est d’ailleurs cette démarche pertinente qui a été adoptée avec le comité présidé par M. Badinter.
J’en viens au fameux principe n° 6 de l’article 1er concernant la laïcité en entreprise. Cette disposition suscite nombre de polémiques et de malentendus. Nous pensons que son retrait ne serait pas préjudiciable : l’article 1er suffirait en lui-même à conserver les règles telles qu’elles existent aujourd’hui dans le droit du travail et, en grande partie, dans la jurisprudence, comme l’a rappelé M. Censi. Toutefois, on peut légitimement se demander s’il suffit de préserver le droit actuel. Pour la CFDT, la question de la laïcité relève en partie de la pratique et du dialogue social. Légiférer sur ce sujet très sensible ne permet pas forcément de répondre aux nombreuses questions qui se posent dans les entreprises – nombreux sont nos militants qui nous signalent des problèmes liés non seulement à la pratique religieuse en entreprise, mais aussi aux relations entre les hommes et les femmes. Cela étant, s’il est tout de même décidé de modifier le droit positif, ce n’est sans doute pas dans le présent texte qu’il convient de le faire, car il ne permettra pas de s’appuyer sur un nécessaire débat citoyen plus large et instruit. À ce stade, nous en proposons le retrait, le premier principe suffisant à répondre à la question.
Je rappelle que la mise en place d’un régime complémentaire de santé, qui peut relever de la décision unilatérale de l’employeur, se fait toujours par la négociation – soit d’entreprise, soit de branche, comme nous le souhaiterions davantage. Autrement dit, le pouvoir unilatéral de l’employeur est extrêmement limité puisqu’il consiste à signer – sans le négocier – le contrat avec l’organisme prestataire.
Ce projet de loi permettra-t-il de remédier à la complexité du code du travail ? Il n’est guère possible de répondre à la complexité du marché du travail par un principe simple et unique. En revanche, cette nouvelle architecture nous paraît très pertinente, puisqu’elle vise à établir pour tous des règles qui protègent. La CFDT s’est notamment battue pour que la règle des 35 heures soit préservée dans l’ordre public social afin de protéger tous les salariés. En clair, il nous semble important que cet ordre public social protège tous les salariés, qu’il s’agisse des grands principes ou de règles plus détaillées concernant le volume horaire hebdomadaire ou le contrat de travail. Cela étant, certaines branches professionnelles ont toute légitimité pour négocier telle ou telle mesure, en matière de classifications par exemple. Ainsi, il nous semble pertinent que les branches se saisissent de la question des parcours professionnels au sein de chaque métier. De même, pour protéger les salariés, nous avons souhaité que la négociation qui permet de déroger à la durée minimale hebdomadaire du travail à temps partiel demeure de la responsabilité de la branche, car c’est là que se font la régulation économique et la concurrence entre les entreprises en la matière.
Le renvoi à la négociation d’entreprise nous semble intelligent à quelques conditions près, qui ont trait à la question du rapport de force. De fait, ce rapport de force est déjà pris en compte par la loi, qui prévoit la protection des salariés mandatés. De ce point de vue, le discours du patronat concernant le dialogue social direct – qui n’est pas synonyme de management – est un leurre, car il ne saurait y avoir de dialogue social direct entre personnes qui entretiennent un lien de subordination. L’intermédiation des organisations syndicales et la protection des salariés mandatés, dont nous souhaitons qu’elle soit étendue aux commissions paritaires de branche, sont des éléments essentiels. Autre élément essentiel : les accords majoritaires. Enfin, le rapport de force s’appuie sur un socle supplétif. Dès lors qu’il est à droit constant, l’employeur sait que s’il veut négocier, il doit passer par un accord d’entreprise et, par conséquent, donner des contreparties.
J’en reviens à la question du temps de travail et de la rémunération des heures supplémentaires. Il faut arrêter de dire que désormais, dans les entreprises, il sera possible de rémunérer les heures supplémentaires à un taux de majoration inférieur à 25 % et qui pourra descendre à 10 % : c’est faux. Quelle organisation syndicale signerait sans aucune contrepartie un accord majoritaire prévoyant une moindre rémunération des heures supplémentaires ? Cela n’a aucun sens. S’il peut y avoir une marge de manœuvre entre 10 % et 25 %, c’est parce que, dans le cadre de la négociation au sein de l’entreprise, des contreparties peuvent être proposées qui sembleront pertinentes aux organisations syndicales, donc aux salariés : possibilité de choisir l’organisation de son travail, de faire financer le mode de garde de ses enfants, d’être indemnisé pour un transport en taxi selon l’heure à laquelle on termine, etc. Toutes ces modalités qui complètent ou remplacent les 25 % de majoration du paiement des heures supplémentaires ne peuvent être fixées ni par une loi ni par un accord de branche, mais par une approche au plus près des réalités et des besoins des salariés, afin de savoir ce que ces derniers demandent en contrepartie de l’abandon de ce seuil – qui, en mettant les choses au pire, atteindrait 10 %.
Voici ce que je veux dire sur ce sujet, et qui permet aussi de répondre à la question sur la hiérarchie des normes et le principe de faveur. Celui-ci est facile à appliquer lorsque l’on négocie sur les salaires : quand on parle chiffres, savoir ce qui est plus ou moins favorable relève de l’arithmétique élémentaire. Mais les accords que négocient aujourd’hui les représentants du personnel dans les entreprises et dans les branches sont beaucoup plus complexes : il s’agit d’un enchevêtrement de dispositions, de contreparties, de dérogations, d’avantages qui peuvent être appliqués au niveau de l’entreprise bien que l’on n’y ait pas nécessairement pensé au niveau de la loi ni de la branche. Dans cet enchevêtrement, qui va juger de ce qui est plus ou moins favorable ? Si l’on ne veut pas que ce soit le juge, afin de ne pas judiciariser les relations sociales, il faut que ce soient les organisations syndicales légitimement élues par les salariés et qui représentent au moins 50 % des voix. Je ne vois pas comment décréter un principe de faveur dans des accords qui ne sont pas uniquement financiers, mais qui constituent un ensemble complexe de contreparties touchant notamment à l’emploi.
Faute de temps pour m’exprimer plus longuement, j’espère que vous trouverez les autres réponses à vos questions dans le texte qui présente les propositions de modification formulées par la CFDT.
Mme la présidente Catherine Lemorton. Pour la parfaite transparence de nos débats, je rappelle que le rapporteur procède depuis la semaine dernière à des auditions en vue desquelles des convocations sont envoyées à tous les députés de la commission. La plupart des syndicats ont répondu favorablement à son invitation, mais il y a une organisation syndicale dont nous attendons toujours la réponse. Or, même si l’on souhaite le retrait du texte, il est important, à des fins de transparence et d’échange, de répondre aux demandes d’audition du rapporteur, d’autant que celui-ci a su s’adapter, proposant beaucoup de dates différentes. Je lance donc un nouvel appel, en toute cordialité et amitié, au syndicat qui n’a pas répondu.
M. Fabrice Angei. Le 31 mars, c’est un peu compliqué !
Mme la présidente Catherine Lemorton. Nous avons proposé d’autres dates, par exemple la semaine dernière. Il ne s’agit pas de polémiquer, simplement de signaler que les autres syndicats ont répondu et que nous avons déjà beaucoup échangé.
M. Bernard Sagez. Pour ma part, je répondrai d’abord aux questions concernant les accords.
Nous sommes favorables au mandatement : au mandatement a priori
– puisque, à un moment donné, il faut bien mandater un salarié en l’absence de délégué syndical –, mais aussi à un contrôle a posteriori des termes de l’accord par l’organisation mandante : cela relève de sa responsabilité, qu’elle a engagée en désignant un mandataire.
Nous sommes également tout à fait favorables à la transparence complète des accords ainsi qu’à leur évaluation.
Sans être opposés aux accords majoritaires, nous restons favorables à la possibilité également offerte aux syndicats représentant au moins 30 % des suffrages de soumettre l’accord qu’ils approuvent au référendum des salariés. Elle ne met pas les syndicats hors-jeu, mais tient compte du fait que, dans une entreprise, il n’est pas toujours possible de faire approuver un accord par des organisations représentant 50 % des voix. On a d’ailleurs pu signer dans la fonction publique des accords qui étaient bien loin de susciter ce degré d’approbation et qui n’en ont pas moins permis des avancées pour les salariés. Cette seconde option permet aux organisations syndicales qui ont négocié l’accord de s’assurer qu’elles sont sur la bonne voie : le référendum est une confirmation. Nous souhaitons donc, je le répète, le maintien de ces deux niveaux de validation des accords sur le terrain.
Favorable à l’idée de subsidiarité permanente, la CFTC estime que ses délégués syndicaux ont toute compétence pour négocier au plus près des entreprises et faire en sorte que les accords soient équilibrés, et qu’ils doivent être formés à cette fin par l’organisation.
En ce qui concerne les questions de flexibilité, de précarité et d’emploi, il serait exagéré d’affirmer que ce projet de loi va créer de l’emploi. Toutefois, dans un monde en bouleversement où apparaissent de nouveaux métiers, il faut fluidifier le marché du travail. Les salariés doivent occuper un emploi, mais ils ne garderont pas le même pendant quarante-deux ans ; or cette fluidification sera impossible si ce n’est pas à la personne que les droits sont attachés. C’est donc ainsi qu’il faut procéder, sur le modèle du CPA, et dans le cadre des négociations locales. Ainsi, le salarié sait qu’il pourra rebondir – dans une autre entreprise, comme autoentrepreneur – même si, pour telle ou telle raison, l’emploi qu’il occupe devait ne plus exister. Nous ne parlons donc pas à ce sujet de précarité, mais de parcours professionnel et personnel. Il faut évidemment que le dispositif soit équilibré.
S’agissant du fameux sixième principe de l’article 1er, nous estimons nous aussi qu’il n’apporte rien de nouveau par rapport aux dispositions existantes et devrait donc être retiré, à moins de mentionner la laïcité au premier principe, comme cela a été proposé.
En ce qui concerne la décision unilatérale de l’employeur, nous avions contesté la place qui lui était faite dans la première version du texte, aux termes de laquelle elle s’imposait en l’absence d’accord. Or cet aspect a été largement remis en cause : dans la version actuelle, on reste presque toujours à droit constant lorsqu’il n’existe pas d’accord, ce qui nous paraît satisfaisant.
Enfin, sans revenir en détail sur notre position concernant la branche, nous approuvons l’application d’accords-types négociés par la branche aux PME et TPE, où elle permettra une régulation.
M. Franck Mikula. Je répondrai pour ma part à Mme Iborra que le débat traditionnel qui oppose CDD et CDI, travail indépendant et travail salarié, mérite d’être modernisé : aujourd’hui, c’est l’opposition entre consommateur et salarié qui se développe. D’où le recours au low cost : « ce n’est pas bien d’acheter ses billets d’avion chez Ryanair, mais ce n’est pas cher, et je n’ai pas trop les moyens, donc je le fais quand même » ; « ta fille ne pourra pas devenir hôtesse de l’air, travailler dans cette entreprise où elle sera payée moins du SMIC ! – c’est vrai, mais tant pis ; je le dénonce, mais je l’accepte ». Or je suis de ceux qui pensent que l’on ne fera qu’accentuer cette opposition en ramenant la négociation au niveau de l’entreprise. Prenez l’exemple de Walmart, aux États-Unis : partout où l’entreprise s’implante, elle ruine tous les épiciers de la ville, car, en rémunérant moins les heures supplémentaires, elle réduit les garanties dont bénéficient tous les salariés qui font le même métier ; c’est exactement ce que l’on est en train de faire ici. C’est ainsi que l’on détruit la régulation existante et celle que l’on tente de construire par les accords de branche. Mme Iborra a salué le « volontarisme » du Gouvernement, qui entend « faire bouger les choses » ; je suggère simplement de prendre garde au « bougisme », qui ne crée pas d’emplois.
Madame Fraysse, lors de la concertation qui a eu lieu dans le cadre de la mission Badinter, nous avions proposé de constitutionnaliser les principes du droit du travail, à l’instar de la Charte de l’environnement, pour en garantir la solidité. M. Badinter nous avait répondu que ce n’était pas nécessaire : il suffisait d’en faire le préambule du code du travail, sur le modèle du code de procédure pénale dont chacun sait que c’est du solide et que l’on n’y touche plus. Je n’y connais rien, n’ayant jamais été garde des Sceaux, n’étant pas appelé à le devenir : je l’ai cru. Or je constate aujourd’hui que ces principes ont presque totalement disparu, au point que je me demande à quoi ils vont servir. Antoine Lyon-Caen lui-même, qui faisait partie du comité Badinter, ne cautionne pas du tout le présent projet de loi et critique ce qu’y deviennent les principes qu’il avait contribué à dégager.
M. Viala nous a demandé ce que nous, syndicats, proposions puisque nous n’acceptons rien.
M. Arnaud Viala. Ce n’est pas ce que j’ai dit !
M. Franck Mikula. Je vous l’accorde. Mais c’est une objection que nous entendons souvent – il y a quelques jours encore de la part de vos collègues. Ma réponse est toujours la même : je ne suis pas chargé de l’intérêt général, contrairement à vous dont c’est la responsabilité et l’honneur ; je suis compétent dans le domaine de l’entreprise et du dialogue social ; il m’est très difficile d’aller plus loin.
Simplement, dans le champ social, nous évaluons dès que possible les accords qui ont été négociés. C’est dans ce cadre que nous nous sommes penchés sur les accords nationaux interprofessionnels (ANI) de 2008 et de 2013, ce qui nous a conduits à nous interroger sur la loi relative à la sécurisation de l’emploi de juin 2013. Je ne partage d’ailleurs pas le point de vue de Véronique Descacq sur les accords de maintien de l’emploi.
Pourquoi ne faites-vous pas de même, comme législateur, en ce qui concerne les lois adoptées en matière économique et financière ? Je ne citerai qu’un exemple, celui d’un illustre ministre de l’économie, M. Strauss-Kahn, qui brisa un tabou séculaire en autorisant le rachat par les entreprises de leurs propres actions. S’est-on jamais interrogé sur l’efficacité de cette mesure du point de vue de la compétitivité des entreprises ou de notre pays ?
Avant de s’attaquer au droit social et au code du travail, rien n’interdit de les simplifier. Réformer le code du travail, c’est ce que nous faisons en permanence : c’est notre travail – et le vôtre. Mais, chaque fois que nous y touchons, nous lui ajoutons dix ou quinze pages. C’est ce que vient de faire la loi Macron. Voilà pourquoi M. Lurton peut m’objecter que l’assouplissement du code de travail depuis trente ans n’a fait qu’en accroître le volume. S’il existait une seule règle, la loi, uniformément applicable sur tout le territoire, le code du travail occuperait quatre pages. Mais, à force de vouloir l’adapter au terrain, on ne cesse de le compliquer.
Ne méconnaissons pas les problèmes de compréhension que soulève ce code. Vous me dites que vous-mêmes, législateur, n’y comprenez plus rien : je vous avoue qu’il nous arrive, à nous aussi, de rencontrer quelques difficultés. Cependant, une entreprise n’utilise jamais la totalité du code : une PME en applique un tiers à peine, voire 20 %. Si c’est cela qui pose problème, alors sortons du code les règles applicables aux PME, éditons un code des PME, et l’on ne verra plus aucun candidat à l’élection présidentielle balancer sur la table, devant les journalistes, un code du travail pesant quatre kilos – oubliant de parler du code de l’environnement, du code général des impôts, du code du commerce, tout aussi épais et compliqués que le code du travail !
Mme Le Callennec a posé une autre question récurrente : celle de la proportion de syndiqués. La CFE-CGC est l’un des plus petits syndicats représentatifs en France ; pourtant, elle compte plus d’adhérents que la plupart de vos partis. Mais peu importe, car là n’est pas la question, et heureusement : votre légitimité, c’est de l’élection que vous la tenez, comme nous. Or les élections professionnelles bénéficient d’un taux de participation qui vaut bien celui des élections politiques, voire le dépasse. Dès lors, quand on parle emploi, entreprise ou négociation, nous sommes légitimes. Et nous sommes favorables aux accords majoritaires car c’est une source de légitimité supplémentaire. Née des urnes, notre légitimité est aussi valable et respectable que celle des élus et des hommes politiques.
M. Didier Porte, secrétaire confédéral de FO. Monsieur Sirugue, la pression est plus forte au niveau des entreprises, et la négociation peut s’y dérouler sous la contrainte d’un chantage à l’emploi ou d’éléments propres à l’entreprise. Lorsque la marge de manœuvre de nos équipes se limite à négocier une remise en cause du code du travail, ce n’est plus une question de confiance vis-à-vis des syndicats d’entreprise. Il faut se mettre à la place de ces syndicats : on est en train de leur refiler cette remise en cause du code !
Quant aux deux propositions destinées à faire face à une multiplication des demandes de mandatement, je rappellerai notre position : nous souhaitons qu’il soit possible de désigner des représentants syndicaux à la main des syndicats et de travailler sur des accords de branche d’application directe. Ici, on prend le problème à l’envers. S’il faut une validation de branche comme il a pu en exister auparavant, pourquoi pas ? Mais telle est bien notre revendication.
Je le répète, il ne s’agit pas pour nous d’une évolution, mais d’une remise en cause, dans le cadre de la négociation collective, de l’un des piliers du pacte républicain et de notre République sociale : c’est une véritable rupture. Tous les citoyens sont concernés par le droit du travail, notamment les jeunes qui vivent actuellement une prise de conscience. Pour notre part, nous n’avons jamais confondu l’intérêt général, qui est de votre ressort comme parlementaires, avec l’intérêt particulier des salariés. Le droit du travail s’applique aux salariés, mais tout le monde a conscience du fait que ce projet de loi remet fortement en cause leurs droits.
En ce qui concerne les CDD et les CDI, l’importante négociation de la convention d’assurance chômage, qui est en cours, va peut-être sécuriser l’embauche en CDI en soumettant les employeurs à un dispositif de bonus-malus. En revanche, je ne vois pas ce qui, dans le présent projet de loi, garantira l’embauche en CDI.
Quant aux conséquences de la décentralisation du dialogue social au niveau européen, je citerai quelques chiffres. En Espagne, entre 2008 et 2013, le nombre d’accords de branche ou nationaux est passé de 1 448 à 706 ; le nombre d’accords d’entreprise, de 4 539 à 1 702 – on voit combien les Espagnols, eux aussi, font confiance à leurs syndicats d’entreprise ! – et le nombre de salariés couverts de 12 à 7 millions. Ces chiffres, qui émanent d’un institut syndical rattaché à la Confédération européenne des syndicats, ne sont pas contestables, eux non plus ! Au Portugal, l’évolution est comparable puisque le nombre de salariés couverts y a été ramené de 1,9 million à 328 000. La situation est un peu différente en Allemagne ; je n’y reviens pas.
La publication des accords d’entreprise sera bien une obligation. Peut-être faudra-t-il envisager de créer un site Négofrance, sur le modèle de Légifrance, auquel le juge chargé de trancher un contentieux pourrait se reporter au lieu de devoir se mettre en quête d’accords très disparates, de même que les avocats ou les défenseurs syndicaux. Cela risque d’être problématique.
Si nous n’avons pas parlé des demandeurs d’emploi, la question n’en a pas moins été évoquée. Nous attendons toujours l’étude qui nous prouvera que la déréglementation crée des emplois. Nous sommes solidaires des demandeurs d’emploi ; nous ne croyons pas que les salariés veulent garder jalousement leur emploi aux dépens des chômeurs, ni que la déréglementation permettra à ces derniers de retrouver des emplois corrects.
Tous s’accordent à considérer qu’il faut réduire le nombre de branches et redynamiser celles-ci. J’ai entendu la proposition concernant les commissions paritaires régionales interprofessionnelles issues de la loi Rebsamen mais, pour notre organisation, ces CPRI, qui peuvent apporter des éléments favorables au droit du travail au sein des petites entreprises, ne sauraient être un lieu de négociation. Le risque est de dévitaliser la négociation de branche au profit d’une négociation interprofessionnelle pour les TPE.
S’agissant du CPA, il faudra aussi prendre garde qu’il ne devienne pas un outil de remise en cause des grandes garanties collectives et d’individualisation des droits. De ce dernier point de vue, il peut être dangereux d’affecter des droits non plus à un statut, mais à une personne.
La hiérarchie des normes contribue à la lutte contre le dumping social ; c’est l’une des raisons pour lesquelles nous y sommes attachés ainsi qu’au principe de faveur. L’égalité de droits et de traitement au niveau national, dont on entend parler en ce moment, fait partie des valeurs républicaines auxquelles nous tenons. Faire primer l’accord d’entreprise représenterait une véritable inversion de la hiérarchie des normes, favoriserait le dumping social et balkaniserait le droit des salariés. Comme l’a dit mon camarade, il y aura bientôt autant de codes du travail que d’entreprises : du point de vue des valeurs, cela pose d’énormes problèmes.
En ce qui concerne le dialogue social direct, il s’agit d’une revendication patronale destinée à contourner les syndicats, qui sont pourtant les représentants officiels et légitimes des salariés, désignés par leur vote. Alors que la loi de 2008, défendue par le patronat et certaines organisations syndicales, visait à accroître la légitimité syndicale – je le dis d’autant plus librement que nous n’en étions pas signataires –, cette légitimité même est aujourd’hui battue en brèche ! Sachez que 80 % du contentieux prud’homal émane de salariés d’entreprises dépourvues de syndicat. En d’autres termes, lorsque les organisations syndicales sont présentes au sein des entreprises, le contentieux est réglé en amont, sans qu’il soit nécessaire de le porter devant les prud’hommes. Lorsque le patronat le comprendra, il aura fait de gros progrès !
Quant au taux de syndicalisation, je pourrais évoquer à ce sujet la discrimination syndicale, mais il me faudrait beaucoup plus de temps.
Le problème de la médecine du travail est lié au manque d’attractivité de cette profession. Il faut y remédier au lieu d’adopter des dispositifs destinés à contourner le déficit de médecins du travail.
Par ailleurs, notre organisation syndicale est également à l’initiative de l’article de loi relatif à la mise à disposition de locaux aux syndicats. Je vous invite à relire le rapport de l’IGAS, dans lequel M. Dole préconisait une loi obligeant les communes, les départements et les régions, à héberger les syndicats, conformément à un usage datant de la création des bourses du travail. On nous a expliqué qu’on ne pouvait pas aller aussi loin : pour une raison de constitutionnalité, il n’était pas possible en effet d’imposer à des structures régionales, départementales, ou municipales, une telle obligation. Pour autant, l’hébergement des syndicats pose des difficultés dans les grandes villes. Donner aux organisations syndicales les moyens de représenter les salariés passe par la mise à disposition de locaux leur permettant de travailler dans de bonnes conditions. C’est une question de démocratie.
S’agissant du droit à la déconnexion, j’ai l’impression que l’on réinvente le droit au repos. Il est clair, là encore, que le texte ne va pas assez loin. D’abord, l’entrée en vigueur de ce droit va devoir attendre le 31 décembre 2018. Ensuite, on manque de précision sur sa teneur. Enfin, son application ne sera pas uniforme, ce qui aboutira à renforcer les différences de conditions de travail. Il semble en effet que certaines modalités seront réservées aux entreprises de moins de 300 salariés, tandis que les entreprises de plus de 300 salariés bénéficieront d’une charte. Nous revendiquons la mise en place d’une vraie négociation dans le cadre d’un ANI, pour assurer l’égalité de traitement entre les salariés s’agissant du droit à la déconnexion. Je rappelle en outre qu’aucune sanction n’est prévue en cas de non-respect de la disposition dans les entreprises. C’est donc complètement insuffisant.
En matière de télétravail, on progresse, même si c’est encore insuffisant. Ce sujet doit faire l’objet de négociations, et aboutir à un accord véritablement encadré. Il faut se pencher sur la question de l’isolement des salariés en télétravail, sur les conditions matérielles assurées aux intéressés. Les grands principes ont été mis en place : il faut à présent les renforcer. Le télétravail évite en effet à certains salariés de faire trois heures de transport par jour. C’est particulièrement appréciable en région parisienne.
Pour le CPA, il faut commencer par travailler sur le contenant ; nous verrons pour la suite. Comme l’a dit la ministre, nous ne participons pas à la commission de réécriture.
Par ailleurs, la constitutionnalisation du principe de faveur est une idée intéressante. Je n’ai pas de mandat pour en parler devant vous, mais, a priori, nous ne sommes pas contre.
J’en viens au code du travail. Aujourd’hui, il ne convient à personne. Mais il faut que l’on s’accorde sur certains objectifs. Ainsi, le code du travail n’est pas fait pour créer des emplois. Cela étant, notre organisation s’interroge. Que font les chambres consulaires ? Que font les organisations patronales ? Elles devraient, elles aussi, assurer un suivi et une assistance aux employeurs. En effet, personne ne peut connaître le code du travail sur le bout des doigts ; il faut être juriste pour cela. On veut simplifier le code du travail pour le rendre accessible aux employeurs des TPE et PME. Mais un code du travail réduit à quelques feuillets risque d’être problématique.
Je terminerai sur notre opposition au plafonnement des indemnités en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, dans la mesure où cela ne permettait pas de prendre en compte l’ensemble des préjudices subis par les salariés. Seul le critère de l’ancienneté était retenu. Mais quid de l’âge du salarié licencié ? Quid de sa situation par rapport à l’emploi ? Il est parfois plus compliqué de retrouver du travail dans certains bassins d’emploi, quand on a cinquante ans, que l’on est moins mobile, etc.
Sans compter que l’on était dans une stratégie d’évitement du juge. Je rappelle tout de même que les juges sont paritaires – il y a des employeurs, et des salariés. On met en avant l’insécurité juridique. Mais le code du travail visait à l’origine à apporter de la sécurité juridique aux salariés, et pas aux employeurs. Or certaines dispositions, notamment dans le cadre du licenciement économique pour cause personnelle, peuvent aboutir au licenciement du salarié qui n’accepte pas la mise en place d’un accord pour l’emploi. Dans ces conditions, le salarié peut-il avoir une vision à long terme ?
M. Fabrice Angei. Je voudrais dire à M. le rapporteur que nous sommes disponibles pour trouver une date. De même, nous pourrons rencontrer l’ensemble des groupes qui nous ont sollicités – à l’exception bien sûr des députés Front national.
Sur la question du mandatement, nous avons une position commune avec la CFDT. Nous ne soutenons pas la proposition consistant à faire valider des accords par la DIRECCTE pour suppléer les difficultés de mandatement, dans la mesure où il s’agit là d’une autorisation administrative. Je rappelle que le droit à la négociation est un droit des salariés, qui figure dans le Préambule de la Constitution et qui est exercé par les représentants syndicaux. Il est important de s’y tenir. D’autres moyens existent que l’on a évoqués tout à l’heure et sur lesquels je ne reviendrai pas.
Nous avons également la même position que la CFDT s’agissant de la laïcité. Nous sommes favorables, nous aussi, au retrait du sixième principe. Il n’est pas nécessaire de légiférer en la matière, cela ne ferait qu’entraîner des complications. Un travail intéressant est actuellement conduit avec le ministère et l’ensemble des acteurs sociaux pour définir une sorte de déontologie en ce domaine. Une telle façon de procéder est préférable.
Sur le vote électronique, qui a été largement développé dans la fonction publique, nous avons constaté que sa mise en place ne facilitait pas la participation électorale. D’ailleurs, celle-ci est élevée dans les élections professionnelles – en cas de dépôt de listes. Cela étant, nous ne sommes pas opposés à une extension des modalités de vote. Pour élire les représentants du personnel au niveau de l’entreprise, le principe doit être le vote sur place. Mais les salariés et les cadres sont nombreux à se déplacer. Il faut donc trouver de nouvelles modalités pour tenir compte des spécificités de certains.
S’agissant de la représentation des salariés au conseil d’administration, nous y sommes favorables et nous avons des propositions précises à faire en ce domaine – nous vous les communiquerons. Malgré tout, nous raisonnons différemment : il ne suffit pas, selon nous, d’élargir la représentation dans les CA. Nous considérons qu’il faut doter les instances représentatives du personnel de droits élargis, notamment en matière de contrôle des aides aux entreprises, et de droit de suspension pour s’assurer du « bien-fondé », ou plutôt de la réalité des licenciements économiques décidés par une entreprise. Mieux vaut donner davantage de droits, que d’élargir la représentation.
Concernant ce que l’on appelle, et cela nous est insupportable, les « insiders » et les « outsiders », avec des salariés protégés par un contrat en CDI, qui empêcheraient les chômeurs d’accéder à l’emploi, les politiques que vous êtes doivent se méfier de ce genre de raisonnement qui désigne des boucs émissaires, favorise la division et renforce finalement l’extrémisme et le Front national, comme on le constate à chaque élection. Cela étant, il y a des choses à faire.
Je pense à la taxation des CDD, que la ministre a rejetée en expliquant que cela relevait de la négociation sur l’UNEDIC. Pourtant, elle l’avait proposée. Je ne vois pas pourquoi on ne s’engagerait pas sur cette piste, ni pourquoi on n’entend pas de recommandations fortes en ce sens – le Gouvernement sait le faire, dans les négociations qui se déroulent aujourd’hui.
Deuxièmement, le nombre des ruptures conventionnelles a explosé. En fait, ces ruptures permettent de pallier la pénibilité au travail qui est mal prise en compte, constituent une réponse à l’intensification du travail, à l’allongement de l’âge de départ en retraite et à la souffrance au travail. Ce sont les séniors qui ont le plus souvent recours à la rupture conventionnelle – déguisée ou non. Comme ils sont à bout, ils quittent l’entreprise. On les retrouve ensuite à l’UNEDIC, ce qui aggrave le déficit par ailleurs.
Pour favoriser l’accès à l’emploi, et dès lors que la rupture conventionnelle n’est pas motivée par un licenciement économique, mais découle d’une volonté contractuelle, il faudrait assujettir chaque rupture à un recrutement. Il faut aller jusqu’au bout de la logique. Sinon, il y a détournement du dispositif.
S’agissant de la complexité du code du travail, il faut relativiser les choses. Sur les 3 580 pages de l’édition Dalloz, 2 500 concernent la santé et la sécurité des travailleurs ; ce sont des dispositions très précises sur certains métiers et certaines activités. Chacun a donc du code une lecture sélective, « à la carte ». De la même façon, les TPE ou les entreprises de moins de 50 salariés ne sont pas concernées par les dispositions relatives aux délégués du personnel ou aux comités d’entreprise. Ainsi, l’ensemble du code ne s’applique pas à tout le monde.
En Grande-Bretagne, il n’y a pas de code du travail mais 500 dispositifs législatifs régissent les relations sociales du droit du travail. On ne peut pas dire que certains pays ont un droit surabondant, et d’autres pas. Le volume de notre législation du travail n’est pas plus important que celle de nos voisins, que l’on ne critique pas par ailleurs.
Bref, il convient de relativiser la complexité de notre code. Pour autant, à la CGT, nous ne sommes pas pour le statu quo. Nous sommes favorables à la simplification, à condition qu’elle ne se traduise pas par l’amoindrissement des droits et des garanties effectives. C’est en ce sens que nous prenons nos distances avec ce qui se passe aujourd’hui – l’ordre public social que l’on veut mettre en place, et le renversement de la hiérarchie des normes que l’on veut imposer.
Comment créer de l’emploi ? Tout le monde le dit : la situation de l’économie et de l’emploi est grave et l’heure est à l’action. Dans le même temps, chacun reconnaît – y compris le MEDEF – que ce n’est pas le code du travail qui va permettre de créer de l’emploi. Pour nous, il peut créer de l’emploi, mais pas par la flexibilité. Par exemple, la réduction du temps de travail, mesure de progrès social, est créatrice d’emploi. Pourquoi ne pas fixer la norme à 32 heures hebdomadaires, puis l’aménager selon les métiers et les entreprises ?
Les petites entreprises souffrent de la minceur de leurs carnets de commandes pas d’un manque de flexibilité. On ne crée pas assez d’emplois, parce que notre croissance est atone : moins de 60 000 emplois ont été créés en 2015. C’est donc bien un changement de politique économique qui est nécessaire. Et celui-ci passe, notamment, par l’augmentation des salaires, la réduction du temps de travail et le contrôle des aides.
La réponse est économique. Elle n’est pas dans le code du travail qui sert depuis deux cents ans à protéger les salariés. Notons qu’à l’époque, cette protection avait été demandée par les entreprises. Lorsqu’en 1918, on est passé à huit heures de travail par jour, c’était pour prendre en compte les personnes qui revenaient de la guerre. Il s’agissait de travailler moins pour que tous travaillent. Ainsi, la protection n’est pas l’ennemi de l’emploi. Bien au contraire.
Madame la présidente, je pense avoir dit l’essentiel. Je terminerai par un point sur lequel nous n’avons pas la même position que Force Ouvrière – mais plutôt la même que la CFDT : les commissions paritaires régionales interprofessionnelles (CPRI). Nous considérons en effet que la sous-commission doit être un lieu de négociation pour les petites entreprises et les TPE.
Mme la présidente Catherine Lemorton. Merci à tous de vous être prêtés à cet échange.
La Commission procède à l’audition des organisations représentatives des employeurs (CGPME, MEDEF, UPA) lors de sa seconde séance du mercredi 30 mars 2016.
Mme la présidente Catherine Lemorton. Nous poursuivons notre marathon sur le projet de loi visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections pour les entreprises et les actifs en entendant la voix des instances patronales.
Comme nous, vous avez noté qu’il existe une version 1 et une version 2 du projet de loi et vous avez le sentiment de ne pas y avoir été associés. Nous avons donc au moins deux points communs.
Avez-vous été un tant soit peu associés à l’élaboration de ce projet de loi avant qu’il en soit fait état dans la presse ? Comme je l’ai dit hier à la ministre, jamais on n’a autant débattu d’un avant-projet de loi. C’est une première dans ma vie de parlementaire que de discuter d’un texte qui n’a pas encore été soumis au Conseil d’État.
M. Alexandre Saubot, président du pôle social du Mouvement des entreprises de France (MEDEF). L’évolution du droit social et du code du travail fait l’objet d’échanges réguliers avec le Gouvernement. Nous savions qu’un projet de loi El Khomri était en préparation, notamment pour transposer le rapport Combrexelle. Mais l’avant-projet de loi, avant sa parution dans la presse, n’a pas fait l’objet d’une concertation complète et détaillée sur l’ensemble de ses dispositions. Certains des éléments qui le composent – la déclinaison du rapport Combrexelle, l’évolution du droit du licenciement – ont toutefois donné lieu à des discussions récurrentes avec le Gouvernement. Comme tout le monde, nous avons découvert, avec la version finale du projet, les arbitrages par rapport à la première version dont l’ambition résidait non pas tant dans les mesures prises séparément que dans la cohérence de celles-ci.
Je ferai deux remarques préliminaires. D’abord, il faut être conscient de la gravité de la situation économique de notre pays. Depuis trois ou quatre ans, on observe une divergence assez nette entre la croissance économique française et celle de ses grands voisins européens. Ce constat vaut également pour l’évolution du taux de chômage. Face à l’urgence économique et sociale, le monde patronal
– mes voisins ne me contrediront pas – considère que des mesures ambitieuses et courageuses sont nécessaires pour inverser la situation et proposer aux entreprises un cadre plus adapté à la prise de risques et à la création d’emplois.
Les chiffres sont éloquents. Depuis 2012, la croissance française est sensiblement inférieure à la croissance moyenne de la zone euro. Quant au nombre de chômeurs sur les quatre dernières années, tandis qu’il augmentait en France de 600 000, il a baissé en Allemagne de 400 000 et de 800 000 en Angleterre. Cette situation atypique justifie, à tout le moins, de prendre certaines mesures.
Seconde remarque visant à lever toute ambiguïté, la réforme du code du travail ne peut pas être l’alpha et l’oméga d’une politique de l’emploi. Elle n’est qu’une brique de l’édifice, à côté de la réforme de la compétitivité qui, avec le pacte de responsabilité et le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE), vise à rapprocher la fiscalité française de la moyenne européenne, et du choc de simplification, dont les résultats sont malheureusement très limités sur le terrain. La construction normative et réglementaire, qui se poursuit, vient tous les jours compliquer la vie de nos entreprises, en particulier la « surtransposition » du droit européen que nous sommes les seuls à pratiquer. Certaines idées sont compréhensibles sur le plan philosophique mais nous sommes les seuls à vouloir les mettre en œuvre. En instaurant de nouvelles obligations sans en mesurer les conséquences sur l’emploi et sur la capacité de nos entreprises à se développer, on maintient ces dernières dans un environnement difficile.
Je le redis, la première version du texte traitait de manière assez cohérente des situations classiques que peuvent rencontrer les entreprises et proposait, de façon assez simple, des règles en matière d’emploi et de licenciement, économique ou individuel. Nos grands voisins européens connaissent ces dispositifs dont les effets sont incontestablement positifs sur l’emploi et neutres en termes de précarisation ou d’aggravation de la situation du marché de l’emploi.
Le débat né de la première version nous a paru assez surréaliste : le plafonnement des dommages et intérêts aux prud’hommes, et un régime clair du licenciement économique existent en Allemagne et dans d’autres pays européens ; le périmètre national pour apprécier les difficultés économiques de l’entreprise a été retenu dans tous les pays européens. Nous sommes le seul pays dans lequel cette appréciation porte sur un autre périmètre. L’Europe est certes un grand marché, mais avec des cycles économiques différents et des règles fiscales et sociales variables d’un pays à l’autre. La santé d’une entreprise présente dans trois ou quatre pays d’Europe est très rarement liée à des arbitrages de localisation ou d’optimisation, mais, comme on l’a observé ces dernières années, à la situation économique plus ou moins favorable dans chacun des pays. En termes d’attractivité pour les investisseurs, les spécificités françaises sont dissuasives.
La première version apportait des réponses au besoin de conquête de nouveaux marchés, avec les accords de développement de l’emploi. Ces accords traduisent la capacité à trouver dans l’entreprise des solutions pour être plus réactif et plus compétitif. Ils sont actuellement réservés aux entreprises disposant d’une représentation syndicale. Or 4 % seulement des entreprises françaises sont dotées d’une telle représentation. Cela signifie que 96 % des entreprises ne peuvent pas profiter de ce dispositif. Les solutions proposées gagneraient beaucoup à être enrichies pour tenir compte de cette réalité et de l’incapacité structurelle des syndicats à offrir une réponse à ces situations. Il ne faut y voir aucune tentative de contourner qui que ce soit. La grande majorité des entreprises françaises travaille très bien avec leurs représentants syndicaux, mais elles sont peu nombreuses à disposer d’interlocuteurs pour le faire.
Le retrait des dispositions relatives au plafonnement de l’indemnité prononcée par le conseil de prud’hommes fait également partie de nos regrets. Dans la première version, un salarié ayant vingt ans d’ancienneté était susceptible de partir avec vingt-cinq mois de salaire si le licenciement était reconnu comme dépourvu de cause réelle et sérieuse. On peut considérer que ce n’est pas assez. Cependant, je ne connais aucun chef d’entreprise qui regarde ce montant avec détachement et qui le considère comme une incitation à licencier ou un blanc-seing pour faire ce qu’il veut, bien au contraire. Je ne connais aucun chef d’entreprise qui embauche en pensant à licencier. En revanche, nous le savons tous, le recrutement est une matière difficile : il arrive que le salarié se trompe d’entreprise ou que l’employeur se trompe dans le choix de son collaborateur. Lorsque cette incompatibilité est constatée, avoir de la visibilité évite à l’entreprise d’entrer dans une période d’aléa économique qui peut aboutir, en particulier pour les plus petites entreprises, à des situations compliquées. Les exemples sont nombreux d’entreprises mises en difficulté par des décisions du conseil des prud’hommes. A contrario, certaines décisions des conseils de prud’hommes sont peu généreuses. L’absence de barème crée une inégalité dans les conditions de départ, assez étonnante, qui doit nous faire réfléchir sur le fonctionnement de notre justice.
Autre pilier du projet de loi, la clarification des motifs de licenciement économique. La France a fait le choix, que certains regrettent, de s’inscrire dans une Europe ouverte et de jouer le jeu de la mondialisation. Dans ce monde ouvert, la croissance de l’activité n’est plus assurée, comme lors des Trente Glorieuses, pendant de nombreuses années. Dans les bonnes périodes, le chef d’entreprise doit penser sa capacité à réagir lorsque l’activité économique se contracte ou lorsque les commandes se tarissent. Dans ces circonstances, l’incertitude juridique et calendaire est un frein au développement des affaires ainsi qu’au recrutement.
La version initiale du projet de loi présentait une opportunité de réduire la dualité actuelle du marché du travail en offrant la perspective aux personnes qui sont au chômage ou dans des contrats précaires d’accéder plus facilement au Graal que peut être le CDI.
À notre grand dam, la faculté pour les PME de se saisir de certains outils
– mesure unilatérale, temps de travail des apprentis, et autres – a également été supprimée.
La seconde version a fortement réduit l’ambition de rapprocher le droit social français des standards européens que portait la première version. Tout nouveau recul, à travers l’examen de ce texte, serait perçu comme une grave erreur et une occasion manquée de donner une chance à notre pays d’entrer de plain-pied dans un environnement concurrentiel. Les entrepreneurs français aspirent seulement à bénéficier des mêmes règles que nos voisins et à travailler dans un monde ouvert, avec ni plus ni moins de boulets attachés aux pieds que leurs concurrents.
M. Pierre Burban, secrétaire général de l’Union professionnelle artisanale (UPA). La première version du projet de loi comportait un certain nombre de dispositions qui concernaient directement les TPE et les PME. L’UPA regrette vivement qu’elles aient été retirées dans le projet de loi qui a été déposé.
Nous sommes particulièrement critiques sur la philosophie du texte. Nous sommes d’accord pour assouplir et simplifier un code du travail très complexe et sédimenté. C’est la raison pour laquelle nous avons beaucoup travaillé dans le cadre de la mission Badinter et de la mission Combrexelle. Mais, dans le texte tel qu’il vous est présenté, la mise en œuvre des quelques dispositions qui demeurent apportant des assouplissements dans l’entreprise est conditionnée à la signature d’un accord d’entreprise.
Je conteste l’idée, ancienne et qui dépasse les clivages politiques, selon laquelle on peut régler tous les problèmes sans s’attaquer au cœur du sujet qu’est le code du travail, et contourner certaines dispositions par des accords d’entreprise. Je préfère vous le dire tout de suite, cela ne marchera pas.
Pourquoi ? Ce n’est pas moi qui le dis mais la Commission nationale de la négociation collective. La France compte, hors agriculture, 1 160 000 entreprises dont 98 % sont des entreprises de moins de cinquante salariés ; ces dernières emploient 53 % des salariés français. Les grands groupes de plus de 500 salariés ne représentent que 10 % du salariat. On semble parfois croire que la France n’est composée que de grands groupes, mais ce n’est pas la réalité. Chaque année, 40 000 accords d’entreprise sont signés – cela ne signifie pas 40 000 entreprises signataires puisqu’une même entreprise peut signer plusieurs accords. Admettons cependant que 40 000 entreprises négocient de tels accords, il n’en reste pas moins que 1 120 000 entreprises ne le font jamais et le chiffre est certainement plus élevé.
La solution du mandatement est une illusion. Les entreprises de moins de cinquante salariés n’ont pas envie d’y recourir et ne sont pas outillées pour le faire. Les accords demandent à être négociés par des spécialistes dont la quasi-totalité de ces entreprises sont dépourvues.
Nous ne sommes pas favorables au verrouillage des accords d’entreprise, tout en reconnaissant l’existence de besoins spécifiques selon la taille de l’entreprise. L’UPA n’a jamais milité pour le renversement de la hiérarchie des normes. Nous considérons que l’ordre public social doit continuer à relever de la loi. En revanche, certaines dispositions devraient relever de la branche, voire de l’entreprise. Pour les règles sur le temps d’habillage et de déshabillage, par exemple, la branche semble le niveau approprié. La branche doit définir ce que j’appelle l’ordre public de branche, c’est-à-dire déterminer les dispositions auxquelles il est possible ou pas de déroger. Autour de la table d’une branche, les acteurs sont responsables. Ce système pouvait apporter une respiration aux entreprises.
Le déverrouillage total – lorsque tous les sujets sont renvoyés à l’accord d’entreprise qui peut déroger à l’accord de branche – risque de poser des problèmes dans certains secteurs d’activité, en particulier le bâtiment. Dans ce secteur, les problématiques ne sont pas les mêmes pour l’artisanat, qui réalise 50 % de l’activité, et pour les « majors », qui représentent 30 % de celle-ci. Dans certains cas, il est nécessaire de fixer des règles de solidarité entre toutes les entreprises, quelle que soit leur taille. Nous restons attachés à ce principe.
Je caricature volontairement un peu. D’après un sondage que nous avons réalisé localement, les TPE et les PME considèrent que le texte ne les concerne pas. Non seulement le projet de loi n’est pas fait pour ces entreprises, mais l’article 19, dont il n’a pas été fait état devant la ministre lors de son audition hier, me semble-t-il, vise à revoir la représentativité patronale telle qu’elle a été modifiée par la loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale.
J’en profite pour répondre à votre question, madame la présidente. Le ministère du travail est traditionnellement un ministère qui discute avec les partenaires sociaux – c’est toujours vrai. Toutefois, la rédaction de ce projet de loi n’a pas donné lieu à une concertation spécifique. Tous les points qu’elle aborde ont été discutés de manière informelle. L’avant-projet nous a été présenté – et non remis – quelques jours avant sa publication dans Le Parisien.
L’article 19 revient sur la représentativité patronale alors que de nouvelles règles ont été fixées, voici quelques mois seulement, par la loi précitée, qui, elle, avait fait l’objet d’une concertation approfondie. Les organisations patronales n’avaient pas réussi à s’entendre sur un élément de pondération, mais elles avaient retenu le critère du nombre d’entreprises adhérentes pour mesurer la représentativité. Considérant que nous n’étions pas allés assez loin, le Gouvernement avait confié à Jean-Denis Combrexelle une mission. Les propositions législatives de son rapport sur la réforme de la représentativité patronale, qui était le fruit d’une large concertation, ont été reprises dans la loi.
Depuis 2015, le MEDEF ainsi que certaines fédérations représentant des grands groupes contestent les règles qui ont été arrêtées. Le décret d’application de la loi de 2014 a fait l’objet d’un recours devant le Conseil d’État, fondé sur l’inégalité de traitement, qui a donné lieu à une question prioritaire de constitutionnalité. Le Conseil constitutionnel a considéré, dans sa décision du 3 février 2016, que les dispositions concernant la représentativité étaient conformes à la Constitution. À l’époque, le Premier ministre défendait la réforme au motif que de nombreuses organisations représentant des TPE et des PME risquaient d’être écartées.
Les dispositions de l’article 19 ne feront pas disparaître l’UPA mais elles en limiteront assurément le poids. Plus grave, elles priveront de représentativité de très nombreuses fédérations dans toutes les branches professionnelles qui représentent les TPE et PME. L’histoire des organisations patronales depuis 1945 est ainsi faite que certaines fédérations représentent plutôt des grands groupes, et d’autres plutôt des petites ou moyennes entreprises, quelques organisations de branche représentant tout le monde.
On ne peut pas, d’un côté, vouloir redynamiser la négociation sociale et, de l’autre, faire en sorte que les TPE-PME ne puissent plus avoir voix au chapitre dans les négociations au niveau des branches. Le Conseil d’État, dans son avis sur le projet de loi, souligne que ces dispositions n’ont fait l’objet d’aucune évaluation.
Le MEDEF et la CGPME ont signé un accord, que j’appelle occulte, car nous n’avons jamais pu en prendre connaissance. Pour justifier l’article 19, le Gouvernement prétend intégrer cet accord dans la loi. La loi du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi prévoyait une concertation, qui devait prendre fin au plus tard le 15 novembre sur les évolutions possibles des règles de répartition des crédits et de gouvernance du fonds paritaire. La concertation a lieu le 16 novembre. Le président Crouzet n’a jamais dit que l’UPA ne voulait pas discuter.
Il nous semble que ce serait une erreur de changer le critère du nombre d’entreprises adhérentes servant à définir qui est autour de la table dans les négociations de branche ou interprofessionnelles. Puisque problème d’argent ou de répartition de sièges il y a, semble-t-il, l’UPA est tout à fait ouverte à la discussion sur ces sujets. Nous sommes prêts à examiner, par exemple, l’idée d’une répartition des crédits qui ne repose pas sur le nombre d’entreprises.
Il serait très grave que certaines fédérations ne soient plus représentatives et qu’elles ne s’assoient plus autour de la table de négociation. Cela posera un problème évident à de nombreuses branches professionnelles.
S’agissant des dispositions sur la modulation du temps de travail, nous notons qu’elles portent aujourd’hui sur neuf semaines, contre seize dans la première version.
Nous nous interrogeons aussi sur la réforme concernant la médecine du travail. La suppression de la visite d’aptitude ne nous semble pas une bonne chose, notamment pour les plus petites entreprises. Le code du travail impose au chef d’entreprise une obligation, non de moyens, mais de résultat. Or les artisans et les commerçants ne sont pas des médecins. Le fait qu’il n’y ait plus de visite d’aptitude va poser problème. Je pense même que cette suppression porte en germe la fin de la médecine du travail, qui trouvait son fondement précisément dans cette visite d’aptitude.
Certes, on a beaucoup fait pour améliorer la prévention, en s’inspirant notamment de ce qui existe dans les autres pays de l’Union européenne. Reste que je ne sais pas comment je vais expliquer aux artisans et aux commerçants qu’il leur faut cotiser sans pouvoir leur dire pourquoi.
M. Jean-Michel Pottier, vice-président de la CGPME, chargé des affaires sociales et de la formation. On ne peut pas dire qu’il n’y a pas eu concertation : une concertation bilatérale a été organisée en décembre et en janvier. En revanche, la CGPME n’a eu connaissance du texte que le 18 février, une semaine après tout le monde et après que le rendez-vous a été reporté deux fois, c’est-à-dire le jour où la première version a été transmise au Conseil d’État, ce qui en dit long sur la prise en considération de l’appréciation de notre organisation. Autant dire que les carottes étaient déjà cuites…
Notre grande revendication, à la CGPME, est qu’un jour, le code du travail tienne compte de la réalité des TPE-PME, qu’il les distingue des grandes entreprises. Comme je le dis souvent, une petite entreprise n’est pas un modèle réduit de la grande. Nous avons eu un petit espoir puisqu’une fenêtre s’était ouverte dans la première version. Sans correspondre tout à fait aux propositions que nous avions faites, elle proposait trois ou quatre points intéressants.
Il y avait d’abord une disposition emblématique, que la loi Macron a failli nous accorder, mais qui a ensuite disparu : le plafonnement des dommages et intérêts, suite à un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou à un licenciement abusif, sachant que des licenciements sont classés dans la première catégorie pour de simples problèmes de forme. Nombreux sont les chefs de TPE-PME qui, par maladresse ou méconnaissance, se voient reprocher un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Et cela arrive – cela m’est arrivé – même lorsque l’employeur apporte la preuve de méfaits commis par le salarié, car le juge a un pouvoir d’appréciation. Il faudrait canaliser les choses, car ce pouvoir d’appréciation peut conduire à des situations catastrophiques pour l’emploi et pour l’entreprise. Quinze mois correspondant à vingt ans d’ancienneté, plus les indemnités légales conventionnelles, soit vingt-quatre à trente mois de salaire à la sortie, c’est, pour une TPE, purement et simplement mortel.
Autre point important pour nous, le licenciement économique après quatre trimestres consécutifs de baisse du chiffre d’affaires. Quand une TPE ou une PME subit une baisse de son chiffre d’affaires pendant quatre trimestres consécutifs, le licenciement se fait, en général, à la barre du tribunal de commerce. Il est trop tard ! Cela n’est peut-être pas vrai dans tous les cas, pour autant, c’est une réalité. Quand les employeurs, dans les TPE-PME, embauchent quelqu’un, c’est pour le garder. En cas de difficultés, ils font tout pour essayer de conserver leur personnel. Les TPE-PME ont-elles massivement licencié pendant la période de crise que nous vivons depuis 2008 ? Non. Le chef de TPE-PME n’utilise pas le licenciement comme un outil de régulation, simplement parce qu’il travaille au milieu de ses salariés. Leurs conditions de travail sont aussi les siennes ; il pousse le même caddie qu’eux au supermarché, pour faire ses courses. La qualité des relations humaines qu’il entretient avec ses salariés fait qu’en cas de problème, il ne pense pas au licenciement comme première mesure à prendre.
Il y avait deux dispositions intéressantes à conserver, qui ne relevaient pas, contrairement à ce qui a pu être dit, de la décision unilatérale de l’employeur : le forfait-jours, accessible dans les entreprises de moins de cinquante salariés, et la modulation du temps de travail. Il ne s’agissait que de la possibilité de proposer une modulation au salarié, celle-ci ne pouvant entrer dans les faits qu’après obtention de l’accord individuel du salarié. Là encore, on n’oblige personne ; on travaille ensemble, on discute, et on peut, de temps en temps, se mettre d’accord dans le cadre d’un intérêt partagé. Nombreux sont les salariés au forfait-jours qui veulent y rester ; tout aussi nombreux sont ceux qui voudraient bien y être parce que le système les intéresse. S’ils ont, par exemple, trois clients à voir sur différents chantiers, ils peuvent, s’ils le veulent, les voir dans la journée et rentrer chez eux. Le travail est terminé. Un forfait-jours, c’est beaucoup plus pratique, et de nombreux salariés le considèrent comme tel.
Au titre des mesures susceptibles d’améliorer le dialogue social, nous n’avons pas obtenu ce que nous réclamons depuis toujours : la possibilité d’avoir un dialogue social direct, mais encadré, au sein de l’entreprise. Les accords, dans les entreprises ne disposant pas de représentants syndicaux, seraient conclus avec les représentants élus du personnel. Ils seraient validés par un référendum dans l’entreprise et soumis à un contrôle de légalité par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE), pour vérifier que personne n’a été abusé dans l’opération.
Outre ces garanties, déjà importantes, pour les deux parties, nous avons réfléchi à une garantie supplémentaire pour le salarié, qui serait, nous dit-on, moins capable dans une TPE-PME – je ne sais pas pourquoi – de résister à l’insatiable cruauté de son employeur. Nous proposons donc que ces salariés puissent accéder à une session de formation leur permettant d’avoir le même niveau de connaissance – bon nombre d’employeurs de TPE-PME pourraient, d’ailleurs, participer à cette session, dans la mesure où ils n’ont pas non plus forcément tous les éléments en leur possession.
Finalement, nous sommes devant une deuxième version assez désastreuse, qui fait naître, chez les chefs de TPE-PME, un sentiment d’exaspération que j’ai pu mesurer dans les territoires, ces dernières semaines. Une fenêtre s’était ouverte sur la prise en compte de la réalité de nos entreprises, mais elle s’est subitement refermée. Alors qu’on est en train d’élaborer un plan pour former 500 000 personnes supplémentaires, dans le même temps, on envoie à ceux dont on attend qu’ils créent de l’emploi un message qui les exaspère. C’est regrettable.
En fin de compte, que va-t-il rester dans le projet de loi ? Des charges supplémentaires financières et administratives liées à l’ouverture du CPA et aux nouveaux droits associés, charges dont on ne mesure pas les conséquences, en particulier au regard de la mise en œuvre complète du compte personnel de prévention de la pénibilité. Ce compte, c’est une arme de dissuasion massive pour les chefs de TPE-PME en matière d’emploi, un casse-tête épouvantable.
Reste, en outre, le problème de la distorsion de concurrence. Parce qu’elles ont des contreparties à donner dans la négociation et la possibilité de passer des accords d’entreprise, les grandes entreprises pourront négocier un coût du travail minoré par rapport aux petites et moyennes entreprises qui, elles, resteront au même point. Tout cela laisse un sentiment amer.
Il n’est pas trop tard pour améliorer les choses, reprendre certaines dispositions de la première version, voire les compléter par des propositions. La CGPME en fait tous les jours. Franchement, il est grand temps, dans ce pays, de prendre en compte la réalité que vivent les TPE-PME.
M. Christophe Sirugue, rapporteur. Merci, messieurs, pour votre présentation et pour les éclairages que vous nous donnez sur ce projet de loi. Pour ma part je m’en tiendrai au texte qui est en discussion à l’Assemblée nationale.
En ce qui concerne l’article 19 et la question de la représentativité, j’étais rapporteur du texte de la loi Rebsamen. À l’époque, on nous avait expressément demandé de laisser le soin aux organisations patronales de s’entendre entre elles, de ne pas inscrire dans la loi une disposition qui serait en contradiction avec leurs propres intérêts. J’entends que des accords ont été passés, mais pas entre toutes les organisations, selon le représentant de l’UPA. Je trouve toujours dommage que le législateur soit obligé de sanctionner un accord qui n’est pas unanime. Néanmoins, nous sommes ouverts pour avancer dans le sens d’une représentativité respectueuse de l’ensemble des organisations patronales.
Pour en revenir au fond, le texte a pour objectif de renforcer le dialogue social afin de trouver une adéquation entre l’accroissement de la compétitivité de nos entreprises et la préservation, voire l’amplification des droits des salariés. C’est à cet équilibre qu’il faut parvenir.
Pour ce faire, le texte propose des mesures qui constituent des avancées significatives. L’accord d’entreprise en fait partie. J’ai entendu la position de l’UPA. Elle ne me semble pas contradictoire avec le projet de loi, qui rappelle l’importance des accords de branche tout en faisant le pari de la confiance dans les partenaires sociaux à négocier au sein de l’entreprise pour trouver des accords majoritaires d’entreprise. Il s’agit d’assurer une forme de protection, au travers du supplétif ou des accords de branche, s’il n’y a pas d’accord d’entreprise. Cependant, il faut, en face, des contreparties. Or je n’ai pas entendu grand-chose sur le compte personnel d’activité, alors qu’il participe des éléments concourant à l’équilibre sans lequel le texte ne peut progresser.
Restent des difficultés, et des points qui méritent d’être précisés, en premier lieu, la clarification des motifs de licenciement. Aujourd’hui, le texte retient comme critère d’appréciation de la situation difficile de l’entreprise la durée : quatre trimestres, deux ou un, selon qu’on est sur l’ordre public, l’accord d’entreprise ou le supplétif.
Faut-il en retenir d’autres ? On peut comprendre que, pour certaines petites entreprises, un trimestre peut malheureusement suffire à les mettre en situation de fragilité, voire de fin d’activité. Je sais ce qui a été dit sur la distinction par la taille de l’entreprise, mais celle-ci vous paraît-elle un élément pertinent à retenir ?
En ce qui concerne l’ampleur de la difficulté économique, étant entendu qu’une baisse de 0,2 % peut être dramatique pour certaines entreprises mais pas forcément fragilisante pour les autres, quels pourraient être des motifs de licenciement qui ne porteraient pas seulement sur la durée ? Quatre mois, cela me paraît très long pour certaines entreprises.
J’en viens à la question du périmètre. J’entends l’argument de M. Saubot, selon lequel il y a, en Europe, des modèles différents du nôtre, et que nous sommes peut-être, de ce point de vue, une exception. Or la question du périmètre n’est pas neutre. J’ai, dans ma circonscription, un exemple qui illustre précisément ce que je crains. Il s’agit d’une entreprise locale, rachetée il y a près de deux ans par un groupe étranger qui avait promis des investissements. Or les investissements n’ont pas eu lieu et plus aucune commande n’a été donnée à l’entreprise locale, qui s’est retrouvée contrainte de licencier le personnel, puis les représentants syndicaux. Les licenciements ont été refusés par l’inspection du travail, qui n’a pas considéré que la situation économique était difficile. C’est là le type de situation que nous risquons d’avoir, c’est-à-dire une entreprise fragilisée, pas forcément volontairement, par un groupe parce qu’il peut y avoir des réalités propres au territoire. Comment anticiper, voire corriger ce type de difficulté ?
Je me demande s’il ne serait pas possible de faire une distinction entre des groupes qui n’ont qu’une même activité et qui peuvent se retrouver fragilisés par un retour de conjoncture, et une holding dont les activités sont diversifiées et qui pourrait être moins légitime à considérer qu’une entreprise, quelque part en France, est en situation fragile alors que l’ensemble du groupe pourrait être appelé à la solidarité. Ces considérations peuvent-elles constituer une piste de réflexion ?
Enfin, s’agissant des TPE-PME, une remarque m’a été faite, au cours des auditions, sur l’impossibilité de provisionner pour anticiper un risque de contestation ou la programmation d’un licenciement. Avez-vous, sur ce point, des éléments qui pourraient nous éclairer ?
Mme Monique Iborra. Nous avons bien compris, messieurs, que vos espoirs étaient déçus. Pourtant, lors des auditions que nous avons menées avec d’autres de vos représentants, ce texte ne paraissait pas aussi négatif que ce que vous nous décrivez aujourd’hui. Certes, nous vous demandons de nous dire ce qui ne va pas, mais il semble tout de même que ce projet de loi donne une souplesse qui n’existait pas auparavant.
Monsieur Burban, vous avez dit qu’il n’y avait pas grand-chose à négocier dans les entreprises de moins de cinquante salariés, et que la négociation au niveau de l’entreprise ne changerait rien. Selon vous, il faut se référer aux accords de branche, et on déroge ou on ne déroge pas. Dans ce cas, c’est la décision du chef d’entreprise qui prime sur toute autre négociation. Il est difficile de l’admettre.
La suppression de la visite d’aptitude va entraîner, dites-vous, la disparition de la médecine du travail. En tant que chef d’entreprise, en quoi cette suppression peut-elle vous gêner ?
Monsieur Pottier, vous avez fait des propositions que nous n’avions pas entendues jusqu’à présent, s’agissant notamment du référendum. Notre groupe est, en effet, très préoccupé par l’application de cette loi dans les petites et moyennes entreprises. Nous avons compris que les organisations syndicales tenaient à ce que le mandatement soit mis en place, arguant que ce dispositif avait bien fonctionné pour la mise en place des 35 heures.
Les accords de branche spécifiques adaptés aux TPE et aux PME pourraient-ils vous satisfaire ? Cette éventualité vous paraît-elle préférable au mandatement ?
M. Gérard Cherpion. J’ai le sentiment que l’article L. 1 du code du travail n’a pas été respecté. Nous l’avons entendu tant ce matin que cet après-midi, en fin de compte, il n’y a pas eu d’ouverture de négociation, la ministre se référant à une demande qui aurait été faite dans le cadre du rapport Combrexelle. Lorsqu’on veut parler de dialogue social, il faut respecter la règle.
En ce qui concerne les retours en arrière de la version 2 par rapport à la version 1, avec la fin du barème des indemnités prud’homales qui, de contraignant, devient uniquement indicatif, on revient finalement à la loi Macron, avec un décret qui devrait être publié avant juillet 2016. Cela va être un véritable problème pour les petites entreprises. Dans des cas d’ancienneté importante, on atteint des sommes qui représentent plus de quinze mois de salaire. Nombre de petites entreprises sont déjà confrontées à ce problème. On a vu des dépôts de bilan liés à des condamnations par le conseil de prud’hommes. J’aimerais que vous alliez un peu plus loin dans votre explication.
En ce qui concerne le retour du monopole syndical en matière de négociation collective, la version 1 prévoyait de donner une place plus importante au dialogue social direct entre les salariés des TPE et les employeurs, avec, notamment, l’aménagement du temps de travail sur seize semaines, contre quatre actuellement, et neuf semaines dans la version qui nous est proposée aujourd’hui.
Seul M. Saubot s’est exprimé sur le problème du forfait en jours et du mandatement dans les entreprises de moins de cinquante salariés. J’aimerais que vous alliez plus loin dans votre analyse.
Vous n’avez pas exprimé votre position sur le recul des mesures de simplification de l’apprentissage et de l’alignement du temps d’apprentissage sur le temps du chantier, qui pourrait être modulé. Cet article, en effet, a disparu du texte.
Par contre, le compte personnel d’activité sort renforcé de la deuxième version. La question sera de savoir s’il intégrera le compte épargne-temps. Il faudrait aussi revenir sur le compte personnel de prévention de la pénibilité. Enfin, le compte personnel de formation (CPF) a bien du mal à prendre son envol, comme le montre l’excellent rapport déposé récemment par deux parlementaires.
Vous n’avez pas évoqué l’introduction, par le 6° de l’article 1er du fait religieux dans l’entreprise, que le Gouvernement assure être à droit constant, reprenant la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) et de la Cour de cassation, mais qui cristallise un certain nombre d’inquiétudes. Est-ce vraiment le moment de présenter ce type de dispositions ?
S’agissant du licenciement économique, j’estime que le critère des quatre trimestres consécutifs de baisse du chiffre d’affaires est trop restrictif. Certaines entreprises risquent de mourir avant cette échéance. Il faut retenir une autre durée. Pensez-vous que le choix de deux trimestres serait pertinent ?
Enfin, d’autres points apparaissent préoccupants, tels le passage de la modulation du temps de travail de seize à neuf semaines et le fractionnement du temps de repos en fonction de l’astreinte dans le forfait en jours. Serait-il possible, selon vous, de revenir à la première version, sous réserve d’un accord de branche, en particulier dans les TPE et les PME ?
M. Arnaud Richard. Le groupe UDI est très satisfait que notre commission auditionne ce matin et cet après-midi les partenaires sociaux. Bien que nous soyons convaincus de la nécessité de réformer le code du travail, nous ne pouvons que désapprouver la méthode retenue par le Gouvernement. Ce texte n’a pas été discuté en amont dans le détail, et le diable se cache précisément dans les détails. Rédiger un texte aussi vaste, aussi important, avec autant de conséquences sur l’ensemble des partenaires sociaux sans appliquer le premier article du code du travail ne me paraît pas sérieux.
Ce cadre général posé, j’en viens à des questions plus précises.
Estimez-vous, messieurs, que ce projet de loi instaure de nouvelles libertés et de nouvelles protections pour les entreprises et les actifs, comme son titre extrêmement vendeur voudrait le suggérer ? En d’autres termes, est-il en mesure de créer des emplois ou permettra-t-il seulement de sécuriser les licenciements ?
Les TPE et les PME apparaissent comme les grandes oubliées. Quelles mesures les concernant auriez-vous souhaité voir figurer ?
Le Gouvernement entend développer, à travers cette loi, la culture de la négociation, mais il apparaît que les mesures liées au renforcement du dialogue social – augmentation des heures de délégation pour les délégués syndicaux, restructuration des branches – ne font pas consensus. Nous aimerions connaître vos différents points de vue sur ces sujets.
L’article 10 prévoit le renforcement de la légitimité des accords collectifs : pour être valide, un accord devra désormais être approuvé par des syndicats ayant recueilli au moins 50 % des suffrages. Dans le même temps, il ouvre la voie à la consultation des salariés à l’initiative des organisations syndicales. Êtes-vous satisfaits de ce nouveau dispositif ? Faut-il, selon vous, aller plus loin ?
Le Gouvernement envisage une réforme de la représentativité patronale à l’article 19 et prévoit une pondération selon le nombre de salariés. Quel regard celles des organisations qui ne se sont pas encore exprimées portent-elles sur ces dispositions ?
Le droit à la déconnexion a été introduit dans le projet de loi mais reste, à ce stade, extrêmement sommaire. Une place pleine et entière est laissée en ce domaine à la négociation d’entreprise. Avez-vous des propositions à faire pour mieux encadrer l’usage des nouvelles technologies et améliorer l’articulation entre vie professionnelle et vie familiale ?
Concernant l’apprentissage, quelles seraient vos préconisations pour le développer et mieux intégrer l’apprenti dans la sphère professionnelle ?
Mme Dominique Orliac. Beaucoup de choses ont déjà été dites en amont sur ce projet de loi. Sortant d’une réunion à Matignon, Pierre Gattaz avait haussé le ton et dit sa déception devant les dispositions concernant les prud’hommes et la suppression unilatérale de mesures pour les PME, « grandes victimes de la version 2 du projet de loi », selon lui. Du côté de la CGPME, le constat est amer : son président, François Asselin, a déclaré que ce projet de loi n’allait rien changer dans la vie d’une entreprise patrimoniale et qu’il serait source de difficultés qui n’existaient pas avant. Enfin, les représentants de l’UPA ont dit avoir été entendus mais pas écoutés.
Y a-t-il, dans ce projet de loi, des points que vous considérez comme intéressants et positifs ?
J’aurais aimé avoir votre sentiment sur le compte personnel d’activité. Les organisations patronales avaient estimé que la mise en place du compte personnel de prévention de la pénibilité, entré en vigueur le 1er janvier 2015, posait problème – ce que je peux concevoir dans certains cas. Le délai pour l’entrée en vigueur du CPA, fixée au 1er janvier 2017, ne vous paraît-il pas trop court ?
L’article 8 ajuste les règles de révision des accords pour tenir compte de la réforme de la représentativité syndicale et patronale, avec une pondération selon le nombre de salariés. Il clarifie les conséquences de la dénonciation ou de la mise en cause d’un accord en vue de sécuriser tant les employeurs que les salariés concernés. Il ouvre également la possibilité de réviser des accords d’entreprise par la négociation dérogatoire, y compris dans les entreprises dépourvues de délégué syndical par le biais d’un salarié mandaté. Ces nouvelles dispositions sont-elles, selon vous, de nature à provoquer des difficultés pour les TPE et les PME ?
Je souhaiterais également avoir l’avis des représentants du MEDEF et de la CGPME sur la visite médicale à l’embauche, puisque M. Burban s’est déjà exprimé sur ce sujet.
M. Michel Liebgott. Vos interventions laissent apparaître une évidence : un fossé sépare les grandes entreprises des PMI et des PME.
Les grandes entreprises s’en sortent plutôt bien, grâce notamment au CICE que nous avons mis en œuvre. La situation des grands groupes le montre. Dans ma région, frontalière de l’Allemagne et du Luxembourg, je constate qu’ArcelorMittal, Tata Steel, ThyssenKrupp n’ont jamais aussi bien fonctionné. Elles embauchent alors qu’on laisse entendre que la croissance n’est pas encore de retour. En outre, de 2014 à 2015, le nombre d’emplois créés en France par des entreprises étrangères a augmenté de 30 %. Les entreprises d’une certaine importance ne me paraissent donc pas aujourd’hui être en difficulté, bien au contraire.
En revanche, se pose un problème pour les PMI et les PME.
Je constate, depuis ma circonscription voisine de l’Allemagne, des différences sensibles entre la conception très familiale des entreprises allemandes et la conception que nous avons en France. J’aimerais que vous m’éclairiez sur ces différences, d’un point de vue historique et prospectif.
Je suis surpris que vous refusiez la démarche du mandatement. Vous soulignez souvent que l’on se parle au sein de la petite entreprise, mais parler ne suffit pas, il faut qu’un dialogue social puisse déboucher sur des résultats concrets. Les échanges au sein d’une entreprise ne se résument pas aux relations amicales.
S’agissant des branches, leur nombre est sans doute beaucoup trop important en France, la comparaison avec l’Allemagne ne le montre que trop. Le projet de loi ne prévoit pas véritablement de définition pour la branche. Comment la définiriez-vous ? Comment imaginez-vous le fonctionnement des branches si leur nombre est ramené à deux cents ?
Enfin, je considère que vous avez tort de vous opposer au compte personnel d’activité. C’est un excellent dispositif, appelé à fonctionner non seulement à l’intérieur de l’entreprise mais également à l’extérieur. Il sera utile pour les salariés, qui seront appelés à souvent changer de métier dans les années qui viennent.
Mme Isabelle Le Callennec. Nous partageons, messieurs, votre analyse sur la gravité de la situation de l’emploi dans notre pays et la nécessité d’établir un nouveau cadre plus adapté à la prise de risques des entreprises et à la création d’emplois.
Nous avons auditionné ce matin même les organisations syndicales. Inutile de vous dire qu’elles sont assez divisées et que leurs positions sont aux antipodes de celles que vous venez d’exprimer. Avec ce que nous entendons de part et d’autre, nous nous demandons à quel consensus il sera possible de parvenir, quel équilibre pourra être atteint pour répondre à l’ambition que cette loi affiche dans son titre.
Vous nous avez beaucoup parlé de la première version que vous trouviez intéressante, en particulier du point de vue des critères de licenciement. Vous aimeriez les voir évoluer en fonction de la taille et de la situation des entreprises. L’ancien ministre du travail nous a expliqué que la diminution du chiffre d’affaires devait se maintenir sur une période encore plus longue pour motiver des licenciements économiques ; j’imagine que vous aimeriez plutôt une évolution inverse.
J’ai cru comprendre que le mandatement constituait un vrai chiffon rouge pour vous. Vous avez pris soin de rappeler la très faible proportion d’entreprises pourvues de délégués syndicaux. Cela me semble faire partie des sujets sur lesquels vous ne voulez pas céder, comme les syndicats n’entendent pas céder sur d’autres.
S’agissant des accords-types, la ministre nous a expliqué que certaines organisations patronales y étaient assez favorables afin d’éviter les distorsions de concurrence à l’intérieur des branches. Il y aura, d’ailleurs, un énorme travail à effectuer pour réduire le nombre de ces branches.
Certains d’entre vous souhaitent conserver la visite d’embauche et l’avis d’aptitude pour ceux des métiers les plus exposés, car il y a un risque pour les entreprises. Pouvez-vous nous en dire plus ?
Enfin, l’article 1er définit des principes essentiels sur lesquels devra se fonder une commission d’experts chargée de travailler à une nouvelle rédaction du code du travail. Auxquels de ces principes tenez-vous particulièrement ? Quels sont ceux que vous rejetez ?
M. Gérard Sebaoun. Le compte personnel de prévention de la pénibilité semble faire figure d’épouvantail. Je m’étonne que les organisations patronales en soient encore là après tous les débats que nous avons eus, les différentes missions qui ont été menées et les simplifications qui ont été apportées dans la loi.
Depuis la loi de 2010, je note que dans le BTP, où la prévention est essentielle compte tenu des forts risques d’accidents, un accord relatif à la prévention de la pénibilité et à l’amélioration des conditions de travail a été signé le 20 décembre 2011. Vous trouverez dans ses cent vingt pages l’ensemble des facteurs de risques que nous avons inscrits dans la loi. Nous dire qu’aujourd’hui les branches ne sont pas en mesure d’effectuer ce travail relève donc de l’intoxication, il n’y a pas d’autre mot. Je ne comprends pas ce combat d’arrière-garde. La pénibilité, messieurs, fait partie de la vie de vos salariés. Je sais que vous la prenez déjà en considération. Maintenant, il faut faire en sorte que les branches accomplissent ce nécessaire travail.
Ma deuxième question portera sur l’inaptitude. Le texte renvoie aux prud’hommes et à un expert près la cour d’appel ; le droit existant à l’inspection du travail et aux médecins contrôleurs régionaux. Il me semble que le droit actuel est suffisant ne serait-ce que parce que les prud’hommes ont déjà beaucoup à faire, et les experts en matière de médecine du travail près les cours d’appel n’existent pas.
M. Jean-Louis Costes. Messieurs, je vais vous poser une question que j’ai adressée ce matin aux représentants des organisations syndicales des salariés. Cette loi est présentée comme une remise à plat des relations sociales dans l’entreprise. Dans le secteur public, un principe général de laïcité s’applique. Ne serait-il pas temps d’appliquer ce principe au secteur privé pour résoudre certains problèmes dont nous avons pu avoir connaissance dans les années passées ?
Mme Fanélie Carrey-Conte. Merci, messieurs, de nous permettre de saisir la diversité de vos positions, en particulier sur la question qui est au cœur de nos débats : l’inversion de la hiérarchie des normes.
Ma question s’adresse à ceux qui, parmi vous, sont favorables à la possibilité de déroger par accord d’entreprise à l’accord de branche dans un sens moins favorable pour les salariés. Comment, selon vous, éviter, dans un tel schéma, la concurrence au sein d’une même branche et les risques de dumping à la baisse sur, par exemple, la rémunération des heures supplémentaires ou le temps de travail ? J’ai la conviction que nous avons besoin, en ce domaine, d’éléments forts de régulation.
Par ailleurs, j’aimerais avoir votre avis sur la possibilité pour les organisations syndicales recueillant 30 % des suffrages de déclencher un référendum d’entreprise.
M. Gilles Lurton. Alors que nous n’en étions qu’à la première version de la loi, le Premier ministre avait clairement affirmé que ce texte était fait pour les TPE et les PME. « C’est là où il y a la peur d’embaucher, nous devons lever cette crainte » a-t-il déclaré il y a environ un mois. Je ne cesse de le dire depuis le début de ces auditions, une réforme du code du travail doit effectivement avoir pour objectif de créer les conditions propices à la redynamisation de l’emploi et à l’inversion de la courbe du chômage, qui doivent être notre préoccupation à tous. Quand je vous écoute, messieurs, j’ai plutôt le sentiment que cette loi ne concerne absolument pas les PME et les TPE.
Dans ces conditions, quel est l’intérêt d’une telle loi, qui ne comporte pas moins de cinquante-deux articles ? Quels sont les éléments qui, selon vous, seraient susceptibles d’intéresser les entreprises ? Quels points mériteraient d’être retenus pour leur faciliter la vie ?
S’agissant de la pénibilité, je ne partage pas l’analyse de M. Sebaoun. J’aurais voulu avoir votre avis sur les dispositions intégrant le compte personnel de prévention de la pénibilité dans le compte personnel d’activité. Le calcul de la pénibilité a posé de nombreuses difficultés depuis l’instauration du compte pénibilité dans la loi sur les retraites de 2013. Ces difficultés, mes collègues du groupe Les Républicains et moi-même les avions pressenties et nous les avions largement dénoncées au cours des débats dans l’hémicycle. La loi s’est d’ailleurs révélée inapplicable et le Gouvernement a dû confier une mission à Michel de Virville pour trouver une solution applicable dans les entreprises. Quels constats tirez-vous de l’application des dispositions relatives à la pénibilité dans les entreprises, notamment les TPE et les PME ?
M. Michel Issindou. Merci, messieurs, de vos propos francs et directs. C’est sur le même ton que je m’adresserai à vous.
J’aimerais vous faire part du décalage qui sépare les propos des chefs d’entreprise sur le terrain des discours que vous tenez dans cette enceinte. Vous avez des mots durs pour cette deuxième version du projet de loi, qui vous semble non seulement moins bonne que la première, mais de nature à aggraver la situation actuelle.
Les chefs d’entreprise que je rencontre se plaignent des complexités du code du travail, des lourdeurs à l’embauche, du poids des charges et des difficultés à trouver du personnel qualifié. Nous avons procédé à des allégements de charges à travers le pacte de responsabilité et le CICE. Les 41 milliards d’allégements de charges patronales ont d’ailleurs fait débat parmi nous. Nous avons mis en place, sous la responsabilité commune de l’État, des régions et des partenaires sociaux, une formation professionnelle de qualité, axée notamment sur les chômeurs.
Et après que nous avons consenti tous ces efforts, vous nous dites qu’ils ne serviront à rien. Comprenez notre déception ! J’aimerais que vous nous expliquiez comment faire.
Pour ce qui est de la médecine du travail, votre volonté de conserver la visite d’embauche est une double illusion, et vous le savez tous. Premièrement, seules 3 millions sont aujourd’hui effectuées sur les 20 millions qu’il faudrait faire passer, compte tenu du très grand nombre de contrats à durée déterminée. Nous n’avons plus la capacité de les mener à bien. Qui plus est, dans les quinze années à venir, le nombre de médecins du travail sera diminué par deux. Expliquez-moi comment faire face à une telle réalité ? Deuxièmement, ces visites ne protègent pas les entreprises, qui sont soumises à une obligation de résultat. D’ailleurs, la visite d’aptitude se conclut par 99 % de réussite, personne n’ayant intérêt à dévoiler ses problèmes de santé éventuels.
Le véritable intérêt de la médecine du travail, à laquelle je crois beaucoup, réside dans la prévention, comme vous l’avez souligné, monsieur Burban. Son rôle est de maintenir les salariés en bonne santé. Or conserver la visite d’embauche systématique se fera au détriment de la prévention et de la prise en charge des cas difficiles.
Mme la présidente Catherine Lemorton. Vous avez raison de rappeler ces difficultés. Il m’est arrivé, en tant qu’employeur, de demander la visite d’un médecin du travail : elle est intervenue après la fin du CDD du salarié concerné, mais la note m’a quand même été envoyée !
M. Bernard Perrut. Nous sommes bien conscients que cette loi, quels que soient ses mérites, ne résoudra pas tout. Sur le terrain, nos commerçants, nos artisans, nos agriculteurs attendent beaucoup d’une réforme qui ne sera, à mon sens, pas suffisante.
S’agissant du compte personnel d’activité, vous indiquez qu’il nécessite une véritable réflexion, tant au regard de son contenu que de sa mise en œuvre, car les conditions ne sont pas toutes remplies. Quelle solution pourrait vous satisfaire ? Peut-on ajouter au compte personnel de formation un nouveau compte engagement citoyen ? J’aimerais avoir votre avis sur cette question.
Vous voyez dans le compte personnel de prévention de la pénibilité, le C3P, inclus dans le périmètre du CPA, une source d’incertitude forte pour les entreprises : contraintes, coûts administratifs, interprétation de critères obscurs susceptible de fragiliser les petites entreprises. Ne faudrait-il pas d’abord expérimenter le C3P avant de le généraliser ? Quelles sont vos préconisations en ce domaine ?
J’aimerais aussi vous entendre à propos de l’apprentissage pour savoir si les mesures qui le concernent vous paraissent suffisantes, s’agissant notamment de la simplification de la collecte et de la répartition de la taxe d’apprentissage.
Quelle est votre position sur l’expérimentation du contrat de professionnalisation pour le demandeur d’emploi ?
Enfin, que pensez-vous des nouvelles mesures relatives à la garantie jeunes ? Quelles seraient vos exigences pour qu’elle soit efficace en termes de formation et d’emploi afin de conduire les jeunes dans la voie qui semble la meilleure ?
Mme Kheira Bouziane-Laroussi. Merci, messieurs, pour vos interventions qui ont mis en lumière le fait que vos préoccupations divergeaient selon la taille des entreprises. Je partage les propos qu’ont tenus certains de mes collègues à propos des TPE et des PME qui n’ont pas les moyens des grandes entreprises, cela va de soi.
Monsieur Saubot, vous avez affirmé que ce texte ne réglerait pas le problème de l’emploi. J’ai toutefois le sentiment que la création d’emplois est la raison première qui a présidé à son élaboration. D’où ce toilettage du code du travail qui pose problème aux entreprises.
Je m’attarderai sur l’argument du risque de contentieux qui empêcherait les entreprises d’embaucher. Il est sûr que les délais de règlement des litiges sont beaucoup trop longs et qu’ils sont anxiogènes pour les chefs d’entreprise, mais aussi pour les salariés.
Selon vous, la détermination des indemnités de licenciement pourrait remettre en cause jusqu’à l’existence d’une entreprise. Or les juridictions prud’homales sont paritaires, vos organisations en font donc partie. Sauf erreur de ma part, le juge dispose d’un pouvoir d’appréciation : il peut tenir compte de la réalité économique et sociale de l’entreprise pour déterminer les indemnités. Avez-vous des propositions pour améliorer le règlement de ces litiges autres que la systématisation des indemnités, solution qui n’est ni juste ni réaliste ?
Embaucher semble être vécu comme un risque. Peut-on imaginer un système assurantiel avec un fonds mutualisé pour couvrir les risques que vous invoquez ?
Enfin, comment voyez-vous le rôle des chambres consulaires en termes d’accompagnement et de conseil auprès de leurs membres, surtout lorsqu’il s’agit de petites et moyennes entreprises ?
M. Jean-Patrick Gille. Je suis troublé par vos positions. Il est malaisé de discerner une doctrine du patronat sur l’articulation entre le niveau de la branche et le niveau de l’entreprise, qui sera au cœur de nos discussions.
Je suis un peu déçu par vos réticences à propos du compte personnel d’activité. Elles sont sans doute liées au compte pénibilité, car il me semble que vous étiez initialement plutôt favorables au CPA. Pour ma part, je milite pour une voie audacieuse qui consisterait à intégrer un compte épargne-temps.
À propos de la représentativité, M. Burban n’a pas tout à fait tort. Il n’y a plus de pondération puisque le calcul est fondé à 20 % sur le nombre d’entreprises adhérentes et à 80 % sur le nombre de salariés. Je pense que nous aurons à préciser cette question, d’autant qu’elle est au cœur du débat sur l’articulation entre les grandes entreprises et les petites entreprises et sur le poids des branches. Tous ces sujets se tiennent. Il faut éviter un décrochage entre les différents niveaux d’entreprise. La solution n’est certainement pas simple. En outre, les autres secteurs d’entreprises, qui relèvent de ce que l’on nomme le multi-professionnel, ne se retrouvent pas dans les propositions faites.
Enfin, j’aimerais avoir votre retour sur des propositions peu évoquées mais qui sont importantes, car elles sont au cœur des débats qui agitent les Français et des enjeux liés du marché de l’emploi. Je veux parler de la lutte contre la fraude au détachement des travailleurs.
M. Bernard Accoyer. Le Gouvernement a reculé sur la barémisation des indemnités prud’homales. Cela implique un retour au barème indicatif de la loi Macron, dont les juridictions prud’homales feront ce qu’elles voudront. Il représente déjà, pour les petites entreprises, des montants très élevés, sources de grandes difficultés qui aboutissent parfois à leur mort.
Quelle est la position de vos organisations sur ce point ? Qu’attendez-vous des parlementaires en termes d’amendements ?
M. Richard Ferrand. Deux points m’étonnent particulièrement.
Voici quelques années, on nous expliquait que le problème principal rencontré par les entreprises, c’était le coût du travail : nous avons essayé d’apporter des réponses, notamment par le CICE et les quelque 40 milliards déjà rappelés par Michel Issindou. Certains ont même arboré un pin’s laissant entendre qu’il existait un lien automatique entre la baisse du coût du travail et la création de nombreux emplois. On connaît la suite.
Ensuite, on nous a dit qu’il fallait renforcer le dialogue social dans l’entreprise, ce que ce projet de loi s’efforce, je crois, de faire. Nous entendons vos réticences sur le mandatement, qui est pourtant monnaie courante dans le modèle allemand qu’on nous cite souvent en exemple. Là encore, je voudrais comprendre : peut-on, au sein du modèle allemand, effectuer de cette façon un tri sélectif ?
Je rappelle, par ailleurs, que le barème dont il est question ici ne concerne pas les indemnités de licenciement, mais les dommages et intérêts en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse ou abusif. L’enjeu est plutôt, me semble-t-il, d’encadrer la qualification du caractère abusif d’un licenciement que de borner ce qui doit relever de la liberté des juges, c’est-à-dire l’ampleur de la réparation d’un préjudice. Le Conseil constitutionnel a d’ailleurs jugé, dans sa censure de l’article concerné de la loi Macron, que l’on ne peut pas faire varier le barème suivant la taille de l’entreprise.
Vous paraîtrait-il, messieurs, préférable que le conseil des prud’hommes fonctionne sur le mode de l’échevinage, c’est-à-dire qu’il soit présidé par un magistrat professionnel ?
Enfin, le projet de loi part du postulat que ce sont la complexité et la rigidité du code de travail qui découragent les chefs d’entreprise d’embaucher. Est-ce vraiment le cas ? Les dirigeants d’entreprise sont-ils à ce point inhibés ? Je précise ici que j’ai moi-même créé quelques entreprises, et que j’en ai dirigé toute ma vie.
M. Yves Censi. Monsieur Burban, l’exposé des motifs de ce projet de loi et tous les textes qui l’accompagnent font moult références aux changements de la société et de l’environnement économique, ainsi qu’à la complexité du code du travail. Mais je ne vois, dans le texte du Gouvernement, aucune mesure qui amènerait un changement profond – pour l’essentiel, il ne fait que confirmer la jurisprudence de la Cour de cassation. Le droit du travail est, en effet, pour l’essentiel jurisprudentiel : la complexité ne vient pas tant de la loi que de l’instabilité de la jurisprudence. Voyez-vous vraiment dans ce projet de loi un changement profond ? Ne se contente-t-il pas de confirmer une jurisprudence qui, devenue loi, fera à son tour l’objet d’une nouvelle jurisprudence, tout aussi instable, de la chambre sociale de la Cour de cassation ? Ce n’est pas un reproche que j’adresse à la Cour de cassation, mais enfin nous savons tous que c’est la justice qui est à l’origine de ces variations de la norme.
Par ailleurs, le projet de loi indique qu’en cas de conflits de normes, notamment entre accords d’entreprise et accords de branche, c’est la norme la plus avantageuse qui s’appliquera. Mais l’on entend aussi que le principe de faveur sera en réalité abandonné. Où est, d’après vous, la vérité ? Les juges ne vont-ils pas, une fois encore, fixer la norme, et rendre ce projet caduc ?
Mme la présidente Catherine Lemorton. Je m’interroge, comme Kheira Bouziane-Laroussi, sur le rôle des chambres de commerce et d’industrie (CCI) et des chambres de métiers et de l’artisanat : sont-elles pleinement utilisées ? Remplissent-elles leurs missions au service des artisans et des commerçants – qui cotisent ?
S’agissant de l’article 19, comme la CGPME et l’UPA, je m’interroge : élue du territoire où est implanté Airbus, je peux vous assurer que la situation n’est pas la même dans cette très grosse société et dans les nombreuses PME sous-traitantes de la région. Si nous n’y prenons pas garde, il peut y avoir une inégalité des voix qui sont entendues.
L’article 29 va, me semble-t-il, plutôt dans le sens des PME – même si l’on pourrait, suivant la proposition d’un syndicat de salariés ce matin, porter le seuil de 50 à 250 salariés, par cohérence avec la définition des PME retenue par la loi de modernisation de l’économie. Cet article n’est-il pas un signal envoyé aux dirigeants des TPE et PME, qui pourront appliquer des accords-types spécifiques et les adapter à leur entreprise à travers un document unilatéral qu’ils porteront à la connaissance des salariés ? Ma lecture est-elle bonne ou mauvaise ?
M. Alexandre Saubot. Merci de ces nombreuses questions, auxquelles je vais essayer de répondre de façon synthétique.
En ce qui concerne, tout d’abord, les prud’hommes et le fameux barème, on ne peut pas nier la forte dualité de notre marché du travail : 80 % du stock de contrats composé des CDI, mais 80 % des embauches en CDD. C’est là l’un des effets de notre code du travail, même s’il n’est, bien sûr, pas la seule cause de ce phénomène ; dire le contraire, refuser de reconnaître là la peur du recrutement en CDI, c’est méconnaître les chiffres.
Il faut souligner, en outre, que ce barème intervient à la quatrième étape d’un licenciement : lorsqu’une entreprise est obligée – et c’est toujours dans des circonstances malheureuses, voire dramatiques – de se séparer d’un salarié, elle lui verse des indemnités légales, et le plus souvent aussi des indemnités conventionnelles. S’il y a discussion, transaction, début de négociation, alors l’entreprise lui verse souvent des indemnités supplémentaires. Ce n’est que si, une fois déterminées ces indemnités, le salarié allait devant les prud’hommes et que ceux-ci jugeaient le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, que le barème proposé par le projet de loi s’appliquerait. Il n’y a donc là aucune précarisation, aucune fragilisation ; il s’agit de clarifier et d’encadrer, afin que les uns et les autres puissent prévoir ce qui peut arriver en cas de recours devant le juge prud’homal. Dans de nombreux domaines, les dommages et intérêts sont encadrés, sans que cela pose de difficulté majeure ; des dispositifs de ce type existent dans de nombreux pays. Il y a eu beaucoup de désinformation sur ce sujet. Je redis donc qu’il s’agit seulement de clarifier et d’encadrer.
Aujourd’hui, cela a été dit, 80 % des annulations de licenciements par les prud’hommes se fondent sur des motifs de forme, c’est-à-dire des motifs complètement indépendants de ce qui s’est réellement passé dans l’entreprise. Nos propositions visent à faire prévaloir le fond sur la forme dans les décisions des prud’hommes : elles permettraient d’atténuer la peur de l’embauche et le sentiment d’injustice souvent éprouvé aujourd’hui.
La question de la nature des causes réelles et sérieuses a également été évoquée. Souvent, je viens de le dire, le juge s’arrête aux questions de forme ; mais il faut aussi souligner que le droit français confie au juge un pouvoir d’appréciation très large. Dans les faits, les prud’hommes essayent de réparer ce qu’ils perçoivent comme des injustices : la séparation étant le plus souvent à l’initiative de l’employeur, ils essaient de réparer le dommage. Les critères de licenciement individuels sont larges, et devraient la plupart du temps permettre au juge de constater la réalité du motif invoqué ; mais, souvent, celle-ci n’est pas reconnue, et la lecture de la loi qui a cours aujourd’hui conduit fréquemment à la condamnation de l’employeur.
Le barème était un vrai outil qui permettait d’aller au-delà de ces questions de forme et de clarification du droit, qui sont juridiquement très complexes : les réponses des experts et des avocats spécialisés aux questions qui leur sont posées sont très variées. La limitation des dommages et intérêts à des niveaux raisonnables et surtout clairs permettait de redonner de la visibilité. Le premier effet de ce dispositif aurait été de vider les tribunaux prud’homaux, puisqu’au moment de la discussion, le gain financier espéré de cette activité contentieuse aurait été mieux estimé. La probabilité de trouver un accord aurait augmenté ; l’on aurait infiniment moins sollicité les prud’hommes pour obtenir un supplément par nature extrêmement aléatoire, parfois très bon et parfois très mauvais.
Beaucoup de questions portaient également sur le licenciement économique et les critères qui permettent de l’apprécier. Le projet de loi, je le redis, ne fait que clarifier ou mettre noir sur blanc la jurisprudence actuelle.
Cela a été dit : quatre trimestres de baisse d’activité, dans la vie de beaucoup d’entreprises, surtout des petites, c’est beaucoup trop. En inscrivant dans la loi, pour des entreprises plus petites ou pour certaines catégories d’entreprises, des durées plus courtes, on se rapprocherait de la réalité économique et du fonctionnement des entreprises. Cela permettrait aux entreprises de réagir avant d’être en péril, comme elles le font dans leur activité économique.
En revanche, monsieur le rapporteur, nous sommes très réservés, voire franchement hostiles, à l’ajout de nouveaux critères – quantification, par exemple, de la baisse du chiffre d’affaires. On apporterait une rigidité qui n’existe pas aujourd’hui, et on réduirait encore la capacité des entreprises à démontrer une difficulté économique ! Mieux vaudrait retirer tous les critères du texte et en rester au droit actuel, quelque imparfait qu’il soit.
La médecine du travail a été évoquée à de nombreuses reprises. Le projet de loi prévoit, non pas de supprimer la visite d’aptitude, mais de la réserver aux situations où elle a une valeur de protection du salarié et de la responsabilité de l’employeur. Nous sommes favorables à cette mesure : il paraît raisonnable de considérer qu’un employé de bureau, assis toute la journée devant un ordinateur, ne rencontre pas les mêmes problèmes qu’un ouvrier travaillant en usine ou sur des chantiers, dont la condition physique et la capacité à faire le boulot sont essentielles. L’employeur a une responsabilité pour la période où ce salarié aura travaillé : nous sommes, dès lors, attachés à l’idée de disposer d’un point de référence au moment où débute la carrière dans l’entreprise. La mesure inscrite dans le projet de loi répond surtout à la pénurie actuelle de médecins du travail, à laquelle personne n’a apporté de réponse satisfaisante.
S’agissant de la responsabilité, nous sommes porteurs d’amendements en ce domaine : un chef d’entreprise qui a fait toute diligence pour organiser la visite ne doit pas se voir reprocher un retard ! Mme la présidente disait elle-même qu’elle avait connu un cas où une date de visite médicale d’aptitude avait été proposée trois mois après la fin du CDD. Nous sommes prêts à assumer toutes nos responsabilités, mais les obligations qui pèsent sur l’employeur doivent être raisonnables : un peu de clarification s’impose.
La question de la capacité des TPE et PME à se saisir des accords est revenue régulièrement ; elle est liée à celle du mandatement. Il faut le redire, le mandatement existe depuis une bonne quinzaine d’années, et il ne marche pas. Il n’a fonctionné que lorsque les 35 heures ont rendu obligatoire de négocier, dans chaque entreprise, un accord destiné à limiter les conséquences dramatiques de ce choc considérable qui s’est abattu sur l’économie française.
Nous ne parlons pas ici d’accords obligatoires partout, mais d’occasions données de faire des choses de façon plus intelligente et plus souple. J’ai entendu parler de moins-disant, de réduction des droits. Ce n’est pas de cela qu’il s’agit. Ces accords doivent permettre aux entreprises non pas de faire la même chose en moins bien, mais de faire des choses qu’elles ne feraient pas si elles ne pouvaient pas s’adapter. Quel chef d’entreprise va proposer à ses salariés un accord prévoyant une majoration de la rémunération des heures supplémentaires de 10 % au lieu de 25 % si ce n’est pas pour explorer un nouveau marché, pour saisir une opportunité ? C’est dans ce type de circonstances qu’un accord pourra être obtenu. Imaginez une entreprise qui a une nouvelle affaire en Pologne, une opportunité aux États-Unis, mais qui fait face à une forte concurrence : les règles habituelles ne permettront pas de prendre ce business ; il faut alors donner de la souplesse pour aller chercher cette nouvelle activité. Les heures supplémentaires rémunérées à 10 % de plus, il ne faut pas les comparer à des heures supplémentaires rémunérées à 25 % de plus, mais à pas d’heures supplémentaires du tout, voire à pas de boulot du tout ! C’est ainsi que, dans la majorité des cas, se poseront les questions, puisque ces outils seront accessibles par accord au sein de l’entreprise.
Le mandatement ne fonctionnant pas, nous avons fait des propositions sur le dialogue social dans l’entreprise. À notre sens, syndicats ou pas, tous les systèmes qui fonctionnent – la comparaison avec nos voisins le montre – reposent sur la légitimité de l’interlocuteur du chef d’entreprise. Or la vraie légitimité passe par l’élection.
Il ne s’agit nullement pour nous d’engager quelque contournement des syndicats que ce soit, car il y a de la compétence chez eux, et nous avons besoin, sur des sujets complexes, d’interlocuteurs formés et compétents. Mais nous avons d’abord besoin d’interlocuteurs légitimes : quelle que soit la structure retenue, le chef d’entreprise doit discuter avec des salariés élus – syndiqués ou pas, peu importe, car ces élus pourront aller chercher du conseil et du soutien auprès des syndicats à chaque fois que c’est nécessaire.
Dans les plus petites entreprises, il n’y a pas d’élus : notre proposition
– dont nous sommes prêts à discuter – est que les salariés désignent en leur sein un interlocuteur pour la négociation. C’est la meilleure solution ; on peut ensuite, comme l’a dit Jean-Michel Pottier, imaginer qu’un référendum ratifie l’accord.
De nombreux petits assouplissements, concernant par exemple les astreintes et les temps de repos, ont disparu du texte, comme l’a remarqué M. Cherpion. Pourtant, autoriser la modification de ces règles par un accord de branche ou d’entreprise permettrait aux entreprises de s’adapter à un monde qui change et où le temps de travail ne se calcule plus comme avant. Il s’agit, en fait, de ne pas obliger ces entreprises à vivre dans l’illégalité – illégalité subie, contrainte, et d’ailleurs parfaitement acceptée par les salariés concernés, dans des banques ou des assurances par exemple. S’il y a une surcharge ponctuelle dans un service, les salariés concernés ne pourront pas respecter les règles légales, tout le monde le sait : en accord avec eux, un dispositif est mis en place, et les salariés reçoivent une rémunération complémentaire, une prime, un soutien. Ces situations sont bien identifiées ; elles sont techniquement illégales, mais acceptées des salariés. Ensuite, l’inspection du travail passe derrière et aligne les gens : dans le monde d’aujourd’hui, on ne peut pas travailler dans le parfait respect des règles.
Il s’agit donc uniquement de permettre à un corps collectif – branche ou entreprise – de fractionner le temps de repos, et non de le réduire, ou bien de gérer autrement les astreintes. Ce sont de petites choses, mais qui pourraient apporter beaucoup à la qualité de la vie dans l’entreprise et au dialogue social. Ces mesures allaient dans le bon sens, et nous nous réjouirions qu’elles soient réintégrées dans le texte.
Il a aussi beaucoup été question du C3P. Je le redis avec une certaine solennité : avant la loi de 2014, les critères de pénibilité s’attachaient au poste de travail ; dans le dispositif de 2014, ces critères s’appliquent à la personne, qui se voit octroyer des droits.
Il y a dès lors deux problèmes : celui de la polyvalence, puisqu’il n’y a pas une seule entreprise – et c’est encore plus vrai des plus petites – qui sache dire ce que fait exactement tel employé à tel moment de la journée ; celui des droits créés, qui engendrent un appétit du salarié pour occuper le poste réputé pénible. Le lien entre l’appréciation théorique de la pénibilité d’une tâche et les conditions de travail ressenties par le salarié est en effet, notamment dans l’industrie mais pas seulement, tout à fait ténu : il y a donc des gens qui veulent occuper ou continuer d’occuper des postes pénibles, parce qu’ils y gagnent des points. Un tel dispositif décourage de surcroît la prévention.
Le monde patronal présent ici sera unanime, je crois, pour dire qu’il faut réfléchir à la pénibilité et à sa prévention, ne serait-ce qu’en raison de l’allongement de la durée de vie au travail. Mais le dispositif retenu fait courir un risque considérable à l’attractivité de notre pays et au fonctionnement de nos entreprises.
D’autres questions portaient sur l’ambition de la loi ou sur son manque d’ambition. À l’évidence, ce projet contient des dispositions intéressantes, même si elles concernent finalement peu d’entreprises ; d’autres nous inquiètent plus ou nous paraissent difficilement applicables. Dans mon introduction, j’ai voulu me demander si cette loi était à la hauteur de l’enjeu : 5,5 millions de chômeurs, un pays qui décroche par rapport à ses grands voisins. Sommes-nous capables d’apporter à cette situation des réponses équivalentes à celles qui l’ont été en Allemagne, en Italie, en Espagne, au Royaume-Uni ? Sommes-nous prêts à utiliser des outils qui ont fait leurs preuves chez nos voisins pour endiguer enfin le fléau du chômage ? Voilà les questions que nous devons nous poser.
S’agissant du CICE, je rappelle qu’il concerne tout le monde. Je rappelle également que la baisse des charges de 2014 à 2017 ne permet que de revenir à la situation de la fin de 2010 : à 40 milliards d’augmentation des charges ont répondu 40 milliards d’allégements. Et l’on ne peut pas dire que notre situation économique était florissante en 2010.
Néanmoins, le CICE constitue à l’évidence un pas dans la bonne direction, reconnu et salué comme tel par l’ensemble des organisations patronales à de nombreuses reprises. Ce que nous demandons, que ce soit en matière fiscale ou plus largement juridique, c’est de pouvoir travailler dans un environnement équivalent à celui de nos concurrents allemands, anglais, italiens ou espagnols. Ce n’est pas le cas aujourd’hui.
S’agissant de l’apprentissage, nous soutenons pleinement l’idée de bon sens que si un apprenti mineur pouvait avoir le même temps de travail que son tuteur, on faciliterait considérablement le fonctionnement de ce dispositif. Il ne s’agit pas d’exploiter qui que ce soit, mais d’emmener un apprenti sur un chantier, par exemple : si tuteur et apprenti travaillent aux mêmes horaires, le binôme fonctionnera mieux. Nous ne demandons rien d’autre dans le cadre de ce projet de loi. Nous avons, par ailleurs, d’autres propositions pour une réforme en profondeur de l’apprentissage, mais cela dépasse le cadre fixé ici.
S’agissant enfin de la garantie jeunes, c’est un dispositif récent et dont l’efficacité a été très peu évaluée. Si je puis émettre un avis éclairé, il me semble que le seul critère de performance de ces outils devrait être celui du retour à l’emploi ; mais je n’ai pas l’impression que le recul soit suffisant aujourd’hui pour apprécier la pertinence de cette mesure.
M. Pierre Burban. Plusieurs questions portaient sur la question des accords d’entreprise, des accords de branches et de la hiérarchie des normes. Nous restons convaincus, par pragmatisme et absolument pas par idéologie, que l’accord de branche est indispensable à l’immense majorité des entreprises françaises. Permettre aux accords d’entreprise de déroger à ces accords de branche n’est pas forcément une bonne chose : nous considérons qu’il aurait été préférable que les assouplissements soient prévus par l’accord de branche.
Le mandatement peut évidemment poser problème, et d’abord un problème symbolique, puisqu’un syndicat envoie quelqu’un dans votre entreprise. Et, très concrètement, ce qui est facile à Paris ne l’est pas toujours ailleurs. Je peux vous l’assurer pour l’avoir constaté au moment des négociations des 35 heures. D’abord, il fallait que l’artisan trouve une organisation syndicale de salariés, ce qui n’est pas évident dans tous les départements ; ensuite, malgré mon affection et mon grand respect pour ces syndicats, je dois bien dire qu’elles ne répondaient pas toujours !
Par ailleurs, je me suis mal fait comprendre, je crois, ce qui veut dire que je m’explique mal. Croyez-vous que le PDG de Renault négocie lui-même tous les accords et connaisse le code du travail par cœur ? Évidemment non : il dispose d’experts ; il adhère, qui plus est, à une bonne organisation qui aide les services compétents au sein de Renault. Mais à un artisan, à un commerçant, même s’il a vingt ou trente salariés, on demande tout : c’est l’homme-orchestre ! Il doit être parfait : bon à la production, bon commercial, bon dans la relation avec ses fournisseurs… Doit-il en plus devenir un spécialiste du code du travail ?
Vous me direz qu’en obligeant ces entreprises à recruter quelqu’un pour gérer ces problèmes, on va créer des emplois. Mais c’est une illusion !
Prenons des exemples très concrets. Lors de l’instauration des 35 heures, la branche de la boucherie a voulu attendre, pour élaborer son accord de branche, qu’arrive l’échéance pour les entreprises de moins de vingt salariés. Les adhérents de la confédération, dont certains étaient des entreprises de plus de vingt salariés, ont protesté. Leurs cotisations devaient servir, précisément parce qu’ils ne disposaient pas des compétences nécessaires en interne, à ce qu’elle s’occupe de leur accord de branche.
Autre exemple, nous venons de renégocier un accord avec les syndicats de salariés. Il nous a fallu cinq mois et six réunions pour y arriver. C’est du boulot de négocier ! Cela ne fait pas partie du quotidien de toutes les entreprises de France. Ce n’est pas qu’il faille interdire la négociation, mais ce n’est pas la vraie vie, ne nous berçons pas d’illusions.
Si l’on ressent une forme d’exaspération chez les chefs d’entreprise, mais aussi chez le citoyen de base, c’est parce qu’ils ne voient pas les effets des lois votées. Les entreprises que nous représentons nous disent toutes que le code du travail est compliqué, mais elles n’ont pas le sentiment, pour l’instant, que ce projet de loi leur simplifiera la vie. Gare aux illusions ! Au bout du compte, ce sont les extrêmes et le mécontentement qui progressent.
S’agissant du critère de licenciement économique, Jean-Michel Pottier l’a dit, la condition de durée des difficultés rencontrées n’est pas du tout adaptée pour les plus petites entreprises. Au bout d’un tel délai, elles sont déjà devant le tribunal de commerce ! L’un des gros problèmes des TPE-PME est celui des fonds propres, et, globalement, de la trésorerie. Aujourd’hui, on ne peut provisionner que pour un risque avéré ; mais lorsqu’il est avéré, il est trop tard. Le président de l’UPA Jean-Pierre Crouzet a fait une proposition qui consisterait à envisager un mécanisme de provisionnement pour le risque de rupture du contrat de travail.
En ce qui concerne la laïcité, l’article 1er ne fait effectivement que reprendre la jurisprudence actuelle. Mais voir cela écrit noir sur blanc, c’est tout de même autre chose, et cela suscite beaucoup d’inquiétudes. Je ne suis pas mandaté pour le dire mais, on ne peut pas poser le principe de laïcité dans l’entreprise de la même manière que dans la sphère publique. Pour des raisons historiques et culturelles, la vie de certaines professions est ponctuée par des fêtes liées à la religion – songeons à la Saint-Honoré, par exemple. Nous sommes attachés au principe de laïcité, mais je pense qu’il faut examiner la question de manière approfondie.
Enfin, la lutte contre la fraude au détachement est une bonne chose. Il faut être très attentif à cette pratique, car, dans certains secteurs, il n’y aura bientôt plus que des salariés détachés – le mouvement est déjà bien engagé. Je sais bien qu’il est illusoire de l’envisager, mais il faut réviser la directive détachement de telle sorte que la protection sociale accordée au salarié soit celle du pays d’accueil et non plus celle du pays d’origine. Ainsi, le problème du détachement serait immédiatement réglé.
M. Jean-Michel Pottier. En ce qui concerne les critères du licenciement économique, je le répète, la pratique des PME n’est pas de licencier à tout-va, bien au contraire. On a vu, pendant la crise économique que, globalement, les chefs de TPE-PME ont tout fait pour conserver leur personnel. Certains ont même trop tardé à licencier et c’est le tribunal de commerce qui s’en est chargé.
Je l’ai dit tout à l’heure, en quatre trimestres, on se retrouve devant le tribunal de commerce. Retenir une telle durée ne sert donc pas à grand-chose.
Dès lors, quel autre critère retenir ? C’est extrêmement compliqué. Que fait un chef d’entreprise quand il a des difficultés ? Pour ma part, lorsque j’ai été condamné à payer 65 000 euros pour un licenciement sans cause réelle et sérieuse, je ne me suis pas payé pendant six mois et j’ai remis de l’argent dans l’entreprise. De ce fait, si l’on avait pris comme critères la situation de la trésorerie et celle du compte d’exploitation, on aurait vu une amélioration. Aurait-on pu, pour autant, en déduire qu’il y avait ou non matière à licenciement économique ? Si j’avais voulu procéder à un licenciement économique, à tous les coups, le juge m’aurait condamné. Pourtant, la situation de l’entreprise ne s’est pas redressée pour des raisons économiques, c’est moi qui l’ai sauvée.
En ce qui concerne le mandatement syndical, nous avons l’expérience des 35 heures. Pourquoi le mandatement syndical est-il compliqué en France ? L’idée est communément répandue que les patrons de PME ne veulent pas entendre parler des syndicats. Mais croyez-vous que leurs salariés le veuillent ? Pas du tout ! D’ailleurs, dans 94 % ou 96 % des entreprises, ils ne sont pas syndiqués. Cette très faible syndicalisation tient au discours même des grandes organisations syndicales, un discours formaté pour la grande entreprise, où règne un climat de lutte et de conflit qui n’a rien à voir avec ce que vivent les salariés de PME au quotidien : ils travaillent ensemble avec leur patron et sont plus préoccupés de trouver des solutions communes que d’entretenir un conflit permanent.
Le leurre du dialogue social, c’est le privilège syndical : rien ne se fait si on ne passe pas par une organisation syndicale. Nous proposons une autre approche, avec des garanties multiples : un accord négocié avec un salarié élu, validé par référendum à la majorité qualifiée et soumis à un contrôle de légalité. Ce dernier, en détectant immédiatement si tel ou tel point du code du travail n’est pas respecté, permet de situer d’emblée un accord dans les clous. Je ne vois pas l’intérêt du rescrit social : il n’empêche pas le contrôle du juge et ne permet pas d’éviter les contestations puisque le rapport est contractuel. Ce n’est pas la même chose qu’en cas de rescrit sur une cotisation due par l’entreprise.
Nous proposons comme autre garantie un accès facilité à la formation pour les salariés élus d’une TPE-PME qui s’engagent dans une négociation, mais ce pourrait être intéressant également pour le chef d’entreprise. On pourrait même imaginer – mais cela n’engage que moi – que cette formation soit éligible de droit au compte personnel de formation. La qualité des acteurs et de leur dialogue serait ainsi garantie.
On parle toujours des indemnités prud’homales, mais il s’agit, en fait, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou pour un motif dit « abusif ». Nous l’avons dit, dans bien des cas, la forme l’a emporté sur le fond. Il y a peut-être là quelque chose à améliorer. Une autre piste d’amélioration consisterait à favoriser la conciliation, ce que ne fait pas le système actuel. Plutôt qu’une prime fiscale et sociale au jugement en dernier ressort, mieux vaudrait donner une prime à la conciliation le plus tôt possible. Inversons les choses.
Quant au plafonnement, si vous m’interrogez sur son intérêt, je vais raconter mon histoire de licenciement sans cause réelle et sérieuse pour la vingt-quatrième fois…
Aujourd’hui, le provisionnement est fiscalement impossible. Je vous livre une réflexion personnelle sur laquelle la CGPME n’a pas pris position. De même que les entreprises peuvent aujourd’hui se prémunir de la charge que représentent les indemnités de départ à la retraite, on pourrait imaginer d’avoir dans un même cadre fiscal cette possibilité d’une provision externe pour ce type de risque. Des expérimentations sont en cours et cette piste mériterait d’être creusée.
S’agissant de la visite médicale d’aptitude, si on ne la supprime que pour une partie du personnel, qui déterminera quels sont les postes dits « à risque » pour lesquels elle devra être maintenue ? Comme d’habitude, cela restera de la responsabilité de l’employeur ! S’il y a un manquement de la médecine du travail, c’est l’employeur qui en est responsable. Mme la présidente a fait part de son expérience, permettez-moi de vous raconter la mienne. Vous le savez, toute entreprise qui emploie plus de dix salariés doit faire établir par le médecin du travail une fiche d’entreprise dans laquelle celui-ci répertorie les risques et les moyens de protection collectifs ou individuels qu’il préconise. Des mois durant, j’ai réclamé cette fiche, j’ai envoyé deux lettres de relance à la médecine du travail, et, pour finir, après une descente de la patrouille, on m’a collé un avertissement parce que je n’avais pas de fiche d’entreprise ! Attention, donc, à tout cela. Je ne suis pas sûr que la suppression de la visite médicale d’aptitude soit de nature à offrir à l’employeur cette sécurité annoncée dans l’exposé des motifs du projet de loi.
La CGPME a toujours été très favorable aux accords types de branche ; nous l’avons dit à l’époque du rapport Combrexelle et nous n’avons pas changé d’avis. Seulement, aujourd’hui, le projet de loi prévoit que les accords devront être approuvés par une majorité de 50 %. Ce sera déjà difficile pour un accord de branche tout court, alors pour des accords types de branche, c’est-à-dire des accords pour les TPE-PME discutés avec des représentants syndicaux issus de la grande entreprise, cela risque de prendre vraiment beaucoup de temps. D’ici à ce que cela produise des effets, la prochaine législature sera terminée ! Nous soutenons donc l’esprit, mais pas cette condition de majorité de 50 %.
D’autant que ces accords types ne sont même pas fléchés dans cette deuxième version du projet de loi. Faut-il vraiment attendre des accords types de branche pour régler les problèmes d’aménagement du temps de travail ? Excusez-moi, mais, c’est en interne, entre le patron et les salariés de la TPE-PME, que cela se règle. On n’a pas besoin d’un outil complètement démesuré sur un sujet, du reste, consensuel. Quand il y a du boulot, on voit ensemble comment faire face au carnet de commandes ; quand il y a moins de commandes, on s’organise ensemble aussi. Pour une fois, ne pourrait-on nous faire confiance ? Au fond, c’est tout ce que nous demandons.
Sur le fait religieux, la CGPME voit une différence entre la jurisprudence et la transcription qui en a été faite dans le texte : la jurisprudence est en creux, alors que, dans le projet de loi, l’article est en relief. Il retient comme postulat qu’« il est possible de… sauf… », alors que la jurisprudence procède par la démarche inverse.
J’ai oublié de citer, parmi les améliorations possibles, la réduction du délai de contestation du licenciement, qui est de six mois en France. En Allemagne, il est de deux semaines ! Nous ne demandons pas qu’il soit raccourci à ce point, mais nous voudrions un début de sécurité juridique.
Pourquoi le compte personnel d’activité nous inspire-t-il quelque réticence ? J’ai demandé aux branches professionnelles pourquoi elles n’étaient pas en mesure, aujourd’hui, de faire des référentiels de branche. La première difficulté, c’est la confusion entre le poste de travail et l’individu, comme l’a dit Alexandre Saubot. Le compte de pénibilité s’adresse à l’individu et pas au poste. Le deuxième problème tient à la polyvalence qui caractérise l’activité des salariés dans les TPE-PME. Dans mon entreprise, il faudrait que je les équipe d’une caméra GoPro ! En fonction des nécessités de production, ils passent d’un travail répétitif sur une machine pendant deux heures à autre chose. J’invite les sceptiques à passer une journée dans mon entreprise. Qu’ils viennent avec le code du travail, les arrêtés et les machins et qu’ils m’expliquent à quel point tout cela est simple !
M. Gérard Sebaoun. Ce n’est pas le sujet !
M. Jean-Michel Pottier. Si !
Les branches professionnelles ont deux problèmes. Si elles édictent des référentiels, elles vont ipso facto faire basculer des salariés polyvalents des TPE-PME, qui ne sont pourtant pas exposés. De surcroît, la loi impose à la branche, dans le cadre du référentiel, de dénoncer les coupables, c’est-à-dire de désigner dans la branche tel pourcentage de salariés soumis aux facteurs de pénibilité. À moins de vouloir faire voler en éclats la branche professionnelle, il s’agit d’une injonction impossible à réaliser.
Puisqu’on ne veut pas nous croire, nous proposons de faire fonctionner le système à blanc pendant un an. On verra si c’est si facile que cela et si tous les problèmes sont résolus. On verra aussi combien cela va coûter et comment on va le financer – vous aurez aussi remarqué, en effet, qu’un décret relatif au financement du compte personnel d’activité a été annulé. On parle beaucoup d’allégements, mais, en l’occurrence, ce n’est pas du tout un allégement.
J’en termine par l’apprentissage. De ce point de vue, alors que nous allons bientôt atteindre les 100 000 jeunes qui n’auront pas bénéficié de contrat d’apprentissage depuis trois ans, le texte est d’une faiblesse insigne – comme sur la formation professionnelle. Il faudrait déjà pouvoir aligner, avec tout un luxe de précautions, le temps de travail de l’apprenti sur celui de son maître d’apprentissage. Ce serait quand même logique dans la mesure où ils partent ensemble dans la même camionnette sur un chantier ou participent à un même cycle de production. Si nous n’y arrivons pas, c’est bien dommage.
M. Alexandre Saubot. En ce qui concerne la laïcité, méfions-nous de toute mesure générale. N’imposons pas une laïcité qui n’aurait aucun sens aux entreprises qui se sont construites avec une vraie problématique religieuse, et utilisons, dans chaque entreprise, l’outil du règlement intérieur, en redéfinissant correctement sa valeur juridique et les effets qu’emportent son non-respect ou son refus par les salariés. Cela permettrait de régler le problème sans engager de nouvelles guerres de religion. Qui plus est, l’application au privé du dispositif en vigueur dans le public se heurterait à la liberté d’entreprendre et à des situations très diverses.
L’accord type ne pourra jamais couvrir l’intégralité des situations en matière d’organisation du temps de travail – puisque c’est ce dont il est surtout question. Il faudra des parties adaptées à la réalité de chaque entreprise. Même si la branche dessine un canevas ou un modèle d’accord, il faudra bien que l’entreprise remplisse de petites cases avec des éléments précis, et il faudra valider ce dispositif au sein de l’entreprise.
Cela m’amène à la validation de l’accord. La règle actuelle la conditionne à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins 30 % des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, et à l’absence d’opposition d’une ou de plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli 50 % des suffrages exprimés à ces mêmes élections. C’est le reflet de l’abstention, c’est-à-dire que, dans le système français, vous ne pouvez pas vous abstenir. Si vous exigez une majorité de 50 %, cela veut dire que vous inventez un système dans lequel l’entrée en vigueur d’un accord requiert l’accord, non de 50 % des votants, mais de 50 % des inscrits. La règle des « 30 % sauf si 50 % s’y opposent » avait essentiellement pour but de couvrir la problématique de l’abstention. Évidemment, si, demain, la validation d’un accord était obtenue à la majorité des membres d’un comité d’entreprise, d’une instance unique, la difficulté serait réglée. Nous retrouvons là des schémas qu’en tant que députés vous connaissez bien. La majorité des inscrits serait réservée à des situations très particulières.
J’ai oublié d’évoquer le périmètre retenu pour la définition du licenciement économique. Les dispositions prévues par le texte, à la suite du travail d’orfèvre fait par le Conseil d’État, permettent au juge de vérifier qu’il n’y a pas eu d’abus sans faire courir à l’entreprise de risque juridique majeur. Toucher au texte tel qu’il est rédigé rouvrirait la boîte de Pandore des menaces pesant sur l’attractivité de notre pays. Cela dissuaderait tous les groupes et toutes les entreprises qui l’envisagent de s’installer, revenir ou se développer en France, car le droit en vigueur est une grande source d’incertitude. Les chiffres montrent qu’il n’a pas bénéficié à notre pays. Nous étions les seuls, ces quinze dernières années, en Europe, à avoir un dispositif de ce type. A-t-il empêché quelque fermeture d’usine que ce soit ? A-t-il empêché que notre déclin industriel soit beaucoup plus marqué que celui d’aucun autre grand pays d’Europe ? C’est un dispositif repoussoir dont l’efficacité réelle sur les quelques situations critiques est marginale en termes de délai ou de coût. S’il a pu retarder l’échéance de six mois ou un an, avec un surcoût de quelques dizaines de milliers d’euros par tête à la clé, il n’a jamais empêché la moindre fermeture.
En revanche, croyez-moi, cela a décidé de nombreuses entreprises à ne pas s’installer ou se réinstaller en France. J’en veux pour exemple l’un de nos grands adhérents, dans le secteur de la métallurgie, qui a longtemps fabriqué des téléviseurs en France. Alors que toute sa production était partie en Chine et en Corée, le juge a décidé que cette société n’avait pas le droit de fermer son activité française de fabrication de téléviseurs, à l’évidence pourtant non rentable. Cette situation ne relevait pas d’une décision stratégique, mais était le fruit de l’évolution de la concurrence et du marché. Le jour où cette entreprise a été condamnée à plusieurs dizaines de milliers d’euros, elle a fait une croix sur la France comme territoire d’activité industrielle, et on ne l’a jamais revue. La décision procédait très clairement de notre droit, qui n’était pas attractif. Pour ce qui est d’éviter les abus et les pratiques scandaleuses, je répète que le texte issu des travaux du Conseil d’État est équilibré. Y toucher affecterait son efficacité économique et son message d’attractivité. Compte tenu du niveau du chômage dans notre beau pays, ce serait très dommage.
Mme la présidente Catherine Lemorton. Merci, messieurs, d’avoir répondu à toutes les questions et pour votre disponibilité.
TITRE PREMIER
REFONDER LE DROIT DU TRAVAIL ET DONNER PLUS DE POIDS À LA NÉGOCIATION COLLECTIVE
Chapitre Ier
Vers une refondation du code du travail
Article 1er
Commission de refondation et principes essentiels du droit du travail
Cet article vise à créer une commission « d’experts et de praticiens » du droit du travail qui proposera au Gouvernement une réécriture intégrale du code du travail.
I. RENDRE LE CODE DU TRAVAIL PLUS INTELLIGIBLE ET FAIRE UNE PLACE PLUS IMPORTANTE À LA NÉGOCIATION COLLECTIVE
Le code du travail regroupe l’ensemble des lois et règles ayant trait au droit salarié et aux relations professionnelles qui l’entourent. Il est consubstantiel du lien de subordination qui existe entre l’employeur et le salarié. En effet, c’est ce lien qui justifie que des protections spécifiques soient garanties à la partie la plus faible des deux signataires du contrat de travail.
La loi ne doit et ne peut cependant pas encadrer l’activité dans toutes les entreprises du pays qui connaissent des réalités diverses. Ainsi existent des accords de branches professionnelles qui jouent notamment un rôle de régulation économique et sociale et des accords d’entreprises, négociés au plus près du terrain, destinés à donner de l’agilité à l’organisation du travail.
Or le débat public est depuis plusieurs années saturé par les différentes expressions politiques et médiatiques sur un code du travail censé être devenu « obèse » et constituant de ce fait un « frein à l’emploi ». La « modernité » consisterait de ce fait à réduire le code du travail avec comme seul critère le nombre de pages supprimées. De nombreuses propositions ont fleuri pour réduire le code à la portion congrue, voire le supprimer avec en filigrane une préférence de principe pour la négociation collective, si possible au niveau de l’entreprise, censément la plus vertueuse.
Cette approche est à l’évidence simpliste. En effet, renvoyer l’ensemble des dispositions régissant la vie des salariés à une myriade d’accords spécifiques sans encadrement conduirait non seulement à renoncer à la régulation de la concurrence en laissant libre cours au moins-disant social mais également à remplacer tout un code du travail « indigeste » par autant de « codes du travail de l’entreprise » aussi « indigestes ». En outre le salarié qui change d’entreprise ou l’employeur qui change de secteur d’activité devrait s’adapter à une réglementation complètement nouvelle.
Il ne s’agit pas de supprimer le code du travail, ni même de le raboter mais simplement de l’adapter afin de le rendre plus lisible et de faire une plus grande place au dialogue social. En effet, parmi les difficultés qui affectent nos entreprises figure un dialogue social insuffisant. Or depuis quatre ans, sous l’impulsion du Président de la République, le Gouvernement et la majorité ont privilégié le dialogue social comme méthode principale de la réforme. Le dialogue social est synonyme de confiance, confiance entre des partenaires capables de trouver des compromis, confiance dans un avenir à inventer ensemble, confiance in fine dans les potentialités du pays. Dès le 11 janvier 2013, les partenaires sociaux ont signé l’accord national interprofessionnel sur la compétitivité et la sécurisation de l’emploi, transposé depuis dans la loi déjà évoquée. À la suite de cet accord, de nombreux accords de branches ont également été trouvés. Toutefois, la qualité du dialogue social dans l’entreprise, celui qui a lieu au plus près des acteurs, reste encore à fluidifier afin d’en faire un véritable levier de compétitivité et de progrès social.
Il ne s’agit pas en définitive de choisir entre d’un côté un code du travail protecteur et de l’autre un dialogue social permissif mais de créer les conditions d’une complémentarité fructueuse entre les deux sources du droit social, étant observé que la loi doit continuer et continuera d’encadrer le dialogue social.
Fort de ce constat, le Premier ministre a chargé, par lettre de mission du 1er avril 2015, M. Jean-Denis Combrexelle, président de la section sociale du Conseil d’État et ancien Directeur général du travail, d’une mission sur « l’élargissement de la place de l’accord collectif dans notre droit du travail et la construction de normes sociales. Il s’agira (…) de faire une plus grande place à la négociation collective et en particulier à la négociation d’entreprise, pour une meilleure adaptabilité des normes aux besoins des entreprises ainsi qu’aux aspirations des salariés. »
Le rapport remis au Premier ministre propose notamment une nouvelle architecture du code du travail pour distinguer, dans l’ensemble des dispositions, ce qui relève de l’ordre public, du renvoi encadré à la négociation collective et ce qui revêt un caractère supplétif en l’absence de conclusion d’un accord.
Le projet de loi s’inscrit dans cette nouvelle architecture visant à clarifier le code du travail, le rendre plus aisément applicable et en assurer l’adéquation aux réalités du terrain. Les articles 2, 3 et 4 constituent ainsi une « vitrine » de ce que sera le nouveau code du travail tel qu’envisagé à ce stade par le Gouvernement.
Ce nouveau code serait organisé sur chaque sujet en trois blocs :
– Des dispositions d’ordre public issues de grands principes auxquels il sera impossible de déroger par accord. Elles fixent les garanties minimales accordées aux salariés, ainsi que le cadre de référence de l’organisation collective du travail. À titre d’exemple, l’article 2 prévoit que : « La durée effective du travail est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles » ou : « Au cours d’une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures » ou encore : « La durée légale du travail effectif des salariés à temps complet est fixée à 35 heures par semaine ». Telles sont les bases à partir desquelles devra s’engager le dialogue social.
– Le champ de la négociation collective : celui-ci donne la priorité aux conventions et aux accords de branche d’entreprise ou d’établissement. On relèvera l’accent mis sur la négociation au niveau de l’entreprise. En matière de temps de travail par exemple, ce n’est en principe qu’à défaut d’accord d’entreprise que la branche recouvre une compétence. L’article 2 prévoit ainsi que : « une convention ou un accord collectif d’entreprise… ou à défaut, une convention ou un accord de branche prévoit le taux de majoration des heures supplémentaires (…). Ce taux ne peut être inférieur à 10 % » contre 25 % actuellement pour les 8 premières heures et 50 % au-delà. Toutefois, le niveau conventionnel de droit commun peut varier selon les sujets et il serait prématuré, voire faux, de considérer que l’accord d’entreprise prime sur l’accord de branche dans tous les aspects de cette réforme.
– Le retour à la loi en l’absence d’accord, par l’application de dispositions dites supplétives. En cas d’absence d’accord, les dispositions législatives reprennent la main sous la forme de dispositions supplétives renforçant les garanties minimales découlant de l’ordre public. Par exemple, l’article 2 prévoit, s’agissant de majoration des heures supplémentaires, que « les heures accomplies au-delà de la durée légale (…) donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour les 8 premières heures et (…) de 50 % pour les suivantes », soit le droit existant.
La nouvelle architecture issue du rapport Combrexelle et du projet de loi ne constitue pas une inversion de la hiérarchie des normes puisque les accords d’entreprises ou de branche restent encadrés par les termes de la loi mais un nouvel assouplissement de l’articulation des normes conventionnelles, antérieurement fondées sur le principe de faveur en vertu duquel une norme inférieure ne pouvait déroger à une norme supérieure que dans un sens plus favorable aux salariés.
Au-delà de la mise en place immédiate de la nouvelle architecture concernant la durée du travail, les congés et le compte épargne-temps proposée par les articles 2, 3 et 4, le présent article propose la création d’une commission chargée de refonder l’ensemble du code du travail sur le même modèle.
Ainsi il est prévu que la « commission d’experts et de praticiens des relations sociales » propose « au Gouvernement une refondation de la partie législative du code du travail ».
Il ne s’agit ni d’une injonction au Gouvernement, car celui-ci aura tout le loisir de s’inspirer des conclusions de la commission pour déposer un projet de loi à la date qu’il trouvera opportune ou d’ailleurs ne pas le faire, ni d’une injonction au législateur qui garde bien sûr l’ensemble de sa compétence si un projet de loi venait à être déposé.
La commission est amenée à faire des propositions de modifications sur la partie législative en attribuant « une place centrale à la négociation collective » sans toutefois méconnaître les dispositions de l’article 34 de la Constitution qui prévoit que la loi seule détermine les principes fondamentaux du droit du travail et du droit syndical. La feuille de route est bien en conséquence de réorganiser le code du travail selon l’architecture définie ci-dessus.
Enfin, le troisième alinéa de l’article 1er prévoit que la commission « associe à ses travaux les organisations professionnelles d’employeurs et syndicales de salariés représentatives au niveau national ». Au cours des auditions organisées par le rapporteur, il a été précisé que la commission entendra périodiquement les partenaires sociaux à différents stades de l’avancement de ses travaux afin de prendre en compte leurs remarques et avis. Le rôle des partenaires sociaux est purement consultatif s’agissant des travaux de la commission mais le processus d’élaboration d’un code du travail remanié devant passer par un projet de loi puis par un examen au Parlement, l’article L. 1 du code du travail qui dispose que « tout projet de réforme envisagé par le Gouvernement qui porte sur les relations individuelles et collectives du travail, l’emploi et la formation professionnelle et qui relève du champ de la négociation (…) fait l’objet d’une concertation préalable avec les organisations syndicales de salariés et d’employeurs représentatives » devra être bien évidemment respecté. Les partenaires sociaux joueront en conséquence tout leur rôle dans la refondation du code du travail.
Le véritable enjeu de cette nouvelle architecture réside dans la répartition opérée entre les mesures d’ordre public, la négociation collective et les dispositions supplétives et le niveau auquel placer le curseur de celles-ci, afin que les partenaires sociaux aient un intérêt à négocier un accord. Si le droit supplétif est vécu comme faible par rapport au droit actuel, les organisations patronales n’auront pas d’intérêt à négocier : s’il offre un niveau trop élevé de protections ou de droits aux salariés, ce sont les organisations syndicales de salariés qui n’auront plus intérêt à négocier.
Le deuxième alinéa de l’article donne une feuille de route à la commission mais est muet sur cette question pourtant essentielle. Le législateur ne peut laisser à une commission composée « d’experts et de praticiens des relations sociales », sans doute compétents mais sans légitimité suffisante, le soin de proposer des dispositions supplétives constituant le droit applicable en cas d’absence d’accord d’entreprise ou de branche et de déterminer le cadre des futures négociations. Le projet de loi initial ne comportait aucune autre précision sur la composition de la commission qui ne relevait pas du domaine de la loi. En revanche, il est apparu utile de prévoir dans celle-ci le principe de la parité de cette composition. La commission des affaires sociales a adopté à cet effet un amendement AS612 présenté par Mme Coutelle.
De ce fait, sans toucher à la composition de la commission, – qui deviendrait une enceinte purement technique chargée de faire des propositions, le rapporteur propose d’inscrire dans son mandat que l’ensemble des dispositions supplétives devront correspondre aux règles légales aujourd’hui applicables. En revanche, la commission aura toute latitude, dans le respect de l’ordre public et des dispositions supplétives, pour proposer les règles minimales encadrant la négociation collective. La rédaction des dispositions supplétives devra donc être opérée à droit constant. C’est le sens de l’amendement AS874 proposé par le rapporteur et adopté par la Commission.
Enfin, si l’étude d’impact accompagnant le projet de loi indique que les travaux de la commission seront menés « sur deux ans », aucune disposition ne fixe dans l’article de terme pour ses travaux. Le rapporteur a proposé, dans un amendement AS875 adopté par la Commission, qu’elle rende ses travaux au plus tard le 1er juillet 2018.
Par lettre de mission du 24 novembre 2015, le Premier ministre a confié à un comité de sages, présidé par M. Robert Badinter, le soin de « dégager les principes juridiques les plus importants » du droit du travail.
Au cours de son audition par le rapporteur, M. Robert Badinter a précisé qu’il s’agissait de bien opérer la différence entre le principe – intangible – et la règle qui en découle et qui est soumise aux contextes politique, économique et social du moment. La démarche s’est inspirée de celle utilisée par le Conseil d’État lorsqu’il dégage un principe général du droit ou de la Cour de cassation lorsqu’elle s’appuie sur un principe fondamental.
Les 61 principes ainsi dégagés procèdent soit de dispositions constitutionnelles – Déclaration des droits de l’homme et de citoyen de 1789, Préambule de la Constitution de 1946 – soit de textes internationaux – Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948, Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales – ou simplement de la jurisprudence nationale constante.
La commission « Badinter » a dégagé 61 principes relevant des 8 grands domaines suivants :
Le premier principe prévoit que « les libertés et droits fondamentaux de la personne sont garantis dans toute relation du travail » et que des limitations peuvent leur être apportées si d’autres libertés sont en jeu ou si les nécessités du bon fonctionnement de l’entreprise le justifient et ce, selon un strict principe de proportionnalité.
La liberté est bien la règle et les restrictions apportées à celle-ci l’exception lorsque la situation le commande et seulement en respectant le principe de proportionnalité.
Les autres principes rappellent le droit au respect et la dignité dans le travail, le droit au secret de la vie privée, la liberté du salarié de manifester ses convictions, le principe d’égalité entre les femmes et les hommes, l’interdiction des discriminations et du harcèlement moral et la nécessaire conciliation entre vie privée et vie professionnelle.
Ces principes sont au nombre de 10.
Cette section comprend 19 principes. Ceux-ci rappellent principalement des dispositions déjà présentes dans le code du travail actuel.
Il est rappelé que le contrat est la loi des parties et doit de ce fait se former et s’exécuter de bonne foi. Il est conclu pour une durée indéterminée sauf dans des cas précis prévus par la loi. Il comprend une période d’essai d’une durée raisonnable.
Un principe concerne le transfert du contrat de travail en cas de transfert d’entreprise.
Par ailleurs, plusieurs principes rappellent le droit de chacun à la formation professionnelle tout au long de sa vie et l’obligation faite à l’employeur d’assurer l’adaptation du salarié à l’évolution de l’emploi.
Enfin, huit principes règlent les questions liées à la rupture du contrat de travail. Ainsi les principes 26 à 29 rappellent ceux de la convention 158 de l’Organisation internationale du travail (OIT) qui distingue le licenciement pour motif personnel devant reposer sur un motif réel et sérieux et le licenciement pour motif économique donnant droit à un reclassement.
Ces trois principes édictent que la rémunération doit assurer une vie digne au salarié, qu’elle doit être versée selon une périodicité régulière et que l’employeur assure une égale rémunération aux salariés pour un même travail.
Le temps de travail est fixé par la loi sauf dérogation. La durée légale du travail n’est pas une limite mais fixe seulement le seuil au-delà duquel débute le régime des heures supplémentaires et des contreparties qu’elles comportent.
Les 6 principes de cette section rappellent l’existence de durées maximales de travail, d’un repos quotidien et hebdomadaire minimum, du droit à des congés payés à la charge de l’employeur et prévoient un régime spécifique pour le travail de nuit.
Cinq principes, progressivement élaborés depuis la grande loi du 9 avril 1898, constituent selon la commission « Badinter » ceux applicables à la santé et à la sécurité du travail : la responsabilité de l’employeur auquel il incombe d’assurer la sécurité et de protéger la santé des salariés, le droit de retrait en cas de situation de danger grave et imminent mais aussi l’importance de la médecine du travail et la nécessité de mesures spécifiques en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle.
Le droit du travail réglemente les rapports individuels mais également les rapports collectifs, ceux qui se nouent entre un employeur ou un groupement d’employeurs et un groupement de salarié.
Sept principes viennent en rappeler les fondements à savoir la liberté syndicale, le principe de non-discrimination syndicale, le rôle des syndicats dans l’entreprise, le statut de salarié protégé ainsi que le droit de grève et les limites qui encadrent celui-ci.
Ce champ comporte également sept principes. Le principe n° 51 reformule l’article L. 1 du code du travail qui dispose que les partenaires doivent être consultés avant toute réforme dans le champ du droit du travail.
Les autres principes dégagent le socle sur lequel doit s’articuler la négociation collective, notamment le principe de faveur, « sauf si la loi en dispose autrement ».
Enfin, la dernière section concerne le contrôle administratif – rôle de l’inspection du travail – et la liberté d’accès à une juridiction aussi bien pour un salarié que pour une organisation syndicale.
Les principes présentés ci-dessus devaient initialement constituer le préambule du code du travail. Cependant, leurs origines disparates ne leur confèrent pas la même portée.
En effet, ces 61 principes sont tous issus du droit aujourd’hui applicable et se trouvent déjà inscrits dans des textes de niveau constitutionnel, conventionnel ou législatif sous une rédaction identique ou dont l’esprit est similaire sans être parfaitement identique. La présence de deux principes « similaires », de même niveau dans la hiérarchie des normes juridiques est ainsi susceptible de générer des divergences de jurisprudence selon que le juge s’attache à l’une ou l’autre des dispositions, divergences qui seraient malvenues à l’heure où il est question de rendre le code du travail plus intelligible pour les employeurs et les salariés.
Le Gouvernement a donc décidé de proposer que les principes constituent seulement un guide pour la commission de refondation du code.
Sans contester le bien-fondé de principes qui figurent déjà dans le droit positif, ou solidement ancrés dans la jurisprudence, leur place n’apparaît toujours pas clairement.
En effet, le quatrième alinéa prévoit que les « travaux [de la commission] s’appuient sur les principes essentiels du droit du travail » présentés ci-dessus. Or la commission devra organiser le code du travail selon le triptyque ordre public
– négociation collective – dispositions supplétives. Les dispositions d’ordre public sont bien plus précises que les simples principes. À titre d’exemple, le principe n° 33 énonce que « la durée normale du travail est fixée par la loi » et l’ordre public tel qu’il est prévu par l’article 2 du présent projet de loi dispose que « la durée légale du travail effectif des salariés (…) est fixée à trente-cinq heures ». Il apparaît alors clairement que le principe dans sa rédaction même a une prétention supra légale sans en avoir pour autant la valeur.
La volonté du rapporteur de faire travailler la commission à droit constant – au moins en ce qui concerne les mesures supplétives, ainsi, par essence, que pour les dispositions d’ordre public – rend inutile l’existence de dispositions normatives pour encadrer ses travaux.
La commission et le futur projet de loi qui s’appuiera sur ses travaux pourront reprendre les principes dégagés par la commission « Badinter » comme source d’inspiration, proposer d’en faire un préambule au code du travail refondu, voire même proposer de les adosser à la Constitution sur le modèle de la charte de l’environnement. À ce stade, leur suppression apparaît non comme une renonciation mais comme un facteur de clarification répondant à l’un des objectifs majeurs du projet de loi.
En conséquence, sur proposition du rapporteur, la commission des affaires sociales a supprimé les alinéas 4 à 73, renvoyant aux principes, en votant l’amendement AS876 du rapporteur et cinq amendements identiques.
*
La commission examine les amendements identiques AS33 de M. Patrick Hetzel, AS42 de M. Lionel Tardy, AS256 de Mme Jacqueline Fraysse, AS447 de M. Alain Tourret, AS569 de M. Arnaud Richard et AS742 de Mme Eva Sas.
M. Patrick Hetzel. L’amendement AS33 vise à supprimer l’article 1er, car les principes qui y figurent, proposés par le comité que présidait Robert Badinter, ne sont pas de nature normative et ne doivent donc pas figurer dans le code du travail. Dans le cas contraire, nous créerions ipso facto une insécurité juridique considérable. Les experts qui se sont exprimés sur le sujet estiment en effet que si l’article 1er tel qu’il est rédigé était adopté, s’ouvrirait une période de cinq à dix ans d’instabilité de la jurisprudence, négative pour nos entreprises.
M. Lionel Tardy. Le projet de loi commence bien mal, puisque son article 1er compte soixante-treize alinéas correspondant aux principes qui serviront de base de réflexion à une commission chargée de réécrire le code du travail. Certes, les principes ainsi énoncés ne viennent pas alourdir celui-ci, mais il ne s’agit que de bavardage puisqu’ils ne font que reprendre, sous une formulation différente, des textes existants dans le code du travail. Au lieu de nous concentrer sur l’essentiel, nous allons discuter de ces principes alors qu’une simple feuille de route destinée à la commission aurait suffi. À part figer des choses parfois contestables, ils n’apportent rien. Or, dans la loi, tout ce qui n’est pas nécessaire doit être évacué. C’est pourquoi nous proposons, par l’amendement AS42, de supprimer l’article 1er.
Mme Jacqueline Fraysse. L’article 1er, qui porte sur les modalités de la refondation du code du travail, est emblématique de la philosophie de ce projet de loi, que nous contestons tant sur la forme que sur le fond. Sur la forme, « une commission d’experts et de praticiens des relations sociales » sera chargée de la réécriture du code du travail ; les organisations professionnelles d’employeurs et syndicales de salariés y seront seulement « associées ». Cette démarche, qui n’est pas sans rappeler celle du comité Badinter, simplement composé d’éminents spécialistes du droit, nous paraît très insuffisante pour accomplir une tâche d’une telle ampleur qui concernera au premier chef les travailleurs et leurs employeurs.
Sur le fond, cet article consacre l’inversion de la hiérarchie des normes, puisqu’il s’agira d’attribuer une place centrale à la négociation collective d’entreprise, en remettant en cause le principe de faveur. Ainsi, les principes nos 56 et 57 du comité Badinter, désormais réduit à guider la main de la commission chargée d’écrire le nouveau code du travail, ouvrent clairement la porte à la conclusion d’accords collectifs moins favorables que la loi.
Pour ces différentes raisons, qui sont diamétralement opposées à celles que viennent d’exposer les orateurs qui m’ont précédée, nous demandons la suppression de l’article 1er.
Mme Dominique Orliac. Les principes essentiels définis par le comité Badinter, même s’ils constituent l’armature des normes applicables en droit du travail, n’ont pas à figurer dans un texte de loi par essence normatif, d’autant qu’ils mêlent des normes législatives, constitutionnelles, conventionnelles, européennes et jurisprudentielles. S’appuyer sur de telles propositions tout en donnant une place centrale à la négociation collective est un facteur d’imprécision et une source de difficultés contentieuses, car, dans chaque conflit, les parties ne manqueront pas d’invoquer la violation de tel ou tel des soixante et un principes établis par le rapport Badinter. Il est donc proposé de supprimer l’article 1er.
M. Arnaud Richard. L’article 1er soulève deux difficultés : la première concerne la fameuse commission de refondation du code du travail ; la seconde a trait à l’énumération des principes essentiels du droit du travail. Si, bien entendu, la plupart de ces principes nous conviennent, la méthode choisie par le Gouvernement nous étonne, pour plusieurs raisons.
Tout d’abord, il nous semble étrange de confier à une commission ad hoc le soin de réécrire le code du travail en lieu et place du Parlement, sachant qu’une fois les travaux de cette commission achevés, à une date d’ailleurs inconnue, le Gouvernement décidera des suites à leur donner. En outre, les partenaires sociaux n’ont manifestement pas été consultés sur le projet de loi, puisque M. Mailly a indiqué dans une lettre adressée à la ministre que le fameux document d’orientation qui doit leur être transmis n’existe pas. De ce fait, le projet de loi ne respecte pas le premier article du code du travail. J’ajoute que nous aurions pu examiner en premier lieu l’amendement AS876 du rapporteur, qui vise à supprimer, comme nous le souhaitons tous, les principes « Badinter » figurant à l’article 1er. Ainsi nous aurions pu débattre plus sereinement de la création de cette commission.
Telles sont les raisons qui nous conduisent à demander la suppression de l’article 1er.
Mme la présidente Catherine Lemorton. Je vous rappelle, monsieur Richard, que nous commençons toujours par examiner les amendements de suppression d’un article.
Mme Eva Sas. Contrairement à l’ambition affichée, le projet de loi ne réécrit que les passages du code du travail consacrés au temps de travail. L’article 1er vise, pour le reste, à confier la réécriture du code à un groupe d’experts dont la composition ne figure pas à l’article 1er. En encadrant cette réécriture par l’énonciation de principes essentiels du code du travail, cet article fait passer pour une opération technique un sujet éminemment politique. Il est important de noter, en outre, que les principes censés guider la réécriture du code ont, eux aussi, changé de statut, puisqu’ils ne constituent plus un préambule. Surtout, l’article 1er consacre l’inversion de la hiérarchie des normes.
De plus, contrairement à ce que prétend la communication officielle, le texte ne simplifie pas le code du travail. En effet, si la législation actuelle, que le projet entend modifier, représente environ 151 000 caractères, soit une centaine de pages, selon le groupe de recherche « Pour un autre code du travail », sa réécriture augmenterait ce volume de 27 %. Du reste, cette épaisseur est relative, compte tenu de l’importance des sujets traités : le code monétaire et financier pèse le double du code du travail et le livre du code du commerce consacré aux sociétés commerciales plus du triple ! Le véritable problème du droit du travail est son caractère mouvant et l’absence de mécanismes de conseil et d’accompagnement qui aideraient les salariés et les employeurs à se repérer dans ces changements permanents. Il nous paraît donc judicieux de supprimer l’article 1er.
M. Christophe Sirugue, rapporteur. J’avoue que je me suis moi-même demandé s’il fallait supprimer l’article 1er, qui comporte deux éléments distincts : d’une part, la création et la composition de la commission et, d’autre part, la liste des soixante et un principes dits du comité Badinter.
Tout d’abord, je précise qu’il n’est aucunement question que cette commission réécrive le code du travail, tout simplement parce que cela n’entre pas dans ses prérogatives. Elle proposera des conclusions, que le Gouvernement retiendra – en totalité ou en partie – ou non. Du reste, il m’a paru important de bien limiter le rôle de cette commission – et c’est l’objet de plusieurs de mes amendements – à celui d’une commission technique, en précisant qu’elle doit travailler à droit constant et que sa vocation est d’éclairer le Gouvernement. Encore une fois, ne lui prêtons pas des objectifs et des prérogatives qu’elle n’aura pas. Quant aux principes dits du comité Badinter, j’ai considéré – c’est l’objet d’un amendement que nous examinerons ultérieurement – qu’ils n’avaient pas de raison de figurer dans l’article 1er.
En résumé, je suis donc défavorable aux amendements de suppression de cet article, qui amalgament la question de la commission – dont le rôle est de réfléchir et d’éclairer le législateur, lequel prendra ses responsabilités le moment venu – et celle des soixante et un principes.
Mme Isabelle Le Callennec. Vous nous dites, monsieur le rapporteur, que cette commission sera chargée de faire des propositions, mais c’était également la mission du comité présidé par M. Badinter. Pourquoi le Gouvernement n’a-t-il pas rendu ses premiers arbitrages sur les préconisations de ce comité ? Pourrions-nous déjà avoir connaissance de la liste des experts qui composeront cette commission ? Combien de temps se donne-t-on pour réformer le code du travail ? M. Combrexelle, lors de son audition, avait évoqué un délai de trois ans. Des entreprises auront disparu, d’ici là !
M. Christophe Cavard. La suppression des soixante et un principes proposés par le comité Badinter semble faire l’unanimité. Or je souhaiterais rappeler que la plupart de ces principes ont été formulés à droit constant.
Mme Jacqueline Fraysse. Cela ne sert donc à rien !
M. Christophe Cavard. Je mets chacun d’entre vous au défi de me dire où se trouvent précisément ces soixante et un principes dans le code du travail. Cette liste présente l’avantage de rappeler les droits fondamentaux des salariés – je pense, par exemple, à l’égalité entre les hommes et les femmes ou à la question du harcèlement – de manière claire et précise, si bien que quiconque lit ce seul article comprend la réalité du droit du travail. C’est, du reste, la raison pour laquelle je proposerai, par l’amendement AS401, que ces principes fassent « office de préambule au code du travail ».
M. Patrick Hetzel. Monsieur le rapporteur, vous vous êtes vous-même interrogé, et vous l’avez rappelé, sur la possible suppression de l’article 1er, en insistant notamment sur les risques d’insécurité juridique qu’il comporte. Pourquoi n’avez-vous pas évoqué ce risque tout à l’heure ?
Mme Jacqueline Fraysse. Comme l’a souligné le rapporteur, l’article 1er comporte deux aspects : d’une part, la liste des soixante et un principes formulés à droit constant – qui ne présente, selon moi, aucun intérêt puisque ces principes figurent déjà dans le droit – et, d’autre part, la création et la composition de la commission. Or, sur ce dernier point, le résultat des comités présidés par M. Combrexelle et M. Badinter ne nous incite pas à renouveler l’expérience. C’est pourquoi j’estime nécessaire de supprimer l’article 1er dans son ensemble et de confier le soin de réfléchir à ces questions à la société – y compris à des experts, mais pas exclusivement – dans des formes que nous saurons certainement définir. Je maintiens donc mon amendement de suppression.
M. Francis Vercamer. Dès lors que le rapporteur entend supprimer les soixante et un principes de l’article 1er, je m’étonne qu’il souhaite y maintenir la création et la composition de la commission qui, comme l’a fait remarquer le Conseil d’État, relèvent du domaine réglementaire. Par ailleurs, certains de ces principes peuvent poser problème. Je n’en citerai qu’un seul exemple : il est énoncé au 25° que « le salarié peut librement mettre fin au contrat à durée indéterminée ». Or ce principe est contraire au code du travail, puisque celui-ci impose un préavis au salarié. Que ferait le juge dans un tel cas ?
J’ajoute que ces principes sont en partie issus de la jurisprudence. Mais depuis quand la jurisprudence est-elle la loi ? Jusqu’à nouvel ordre, le Parlement est seul habilité à la voter ; la jurisprudence n’est que l’interprétation que les juges font de la loi et elle ne peut en aucun cas y être transposée sans avoir été discutée au Parlement.
Mme Dominique Orliac. Monsieur le rapporteur, j’ai bien entendu vos arguments, mais je maintiens, au nom de mon groupe, mon amendement de suppression. La loi ne peut pas comporter un article qui renvoie à une commission d’experts. C’est au Parlement de voter la loi. Le Gouvernement peut toujours solliciter, s’il le souhaite, l’avis de tel ou tel expert sans pour autant faire de cet avis une refondation législative du code du travail.
M. Bernard Accoyer. L’article 1er, qui est un objet législatif absolument inqualifiable, au sens littéral du terme, est l’illustration d’un mauvais travail législatif. Ces soixante et un paragraphes seront autant de prétextes à des décisions judiciaires qui contribueront à rendre notre droit du travail encore plus complexe et instable, et donc encore plus dissuasif pour un employeur qui souhaite embaucher. L’article 1er est ainsi totalement contraire non seulement au bon travail législatif, mais aussi à l’emploi et aux droits des salariés. En conséquence, il convient de le supprimer.
M. Gérard Sebaoun. Je soutiens, quant à moi, la position équilibrée du rapporteur. Ayant assisté à l’ensemble des auditions, j’ai été très impressionné par le président Badinter et Antoine Lyon-Caen, éminent professeur de droit du travail, lorsqu’ils sont venus nous présenter leurs travaux auxquels ont contribué les sommités du droit de notre pays, travaux qui avaient pour objectif de synthétiser l’ensemble des textes relatifs au travail. Le fait que nous prévoyions dans la loi la création d’une commission d’experts – même si elle relève, selon certains, du domaine réglementaire – me paraît donc une bonne idée, d’autant que le champ de réflexion des membres de cette commission – qui, bien évidemment, n’ont pas encore été nommés, madame Le Callennec – a déjà été largement exploré par des spécialistes du droit du travail.
Mme Eva Sas. Comme l’a indiqué notre collègue Vercamer, on peut s’étonner qu’une telle commission soit instituée par la loi : cela ne paraît pas nécessaire. Par ailleurs, les différents principes énoncés à l’article 1er consacrent déjà, de fait, une inversion de la hiérarchie des normes. En effet, en précisant que certains domaines relèvent du domaine de la loi – « La durée normale du travail est fixée par la loi […] », « Tout salarié a droit chaque année à des congés payés […], dont la durée minimale est fixée par la loi » –, ils laissent entendre a contrario que le reste est du ressort de la négociation de branche ou de la négociation d’entreprise. Il me paraît donc plus sage de supprimer l’article 1er.
M. Rémi Delatte. L’article 1er envoie d’emblée un mauvais signal, puisqu’il place des verrous là où il faudrait donner de l’air. Les principes du comité Badinter verrouilleraient en effet la réflexion de la commission de refondation du code du travail et créeraient de la confusion plus qu’ils n’apporteraient de la clarté. Or, aujourd’hui, on attend de la souplesse, de l’audace, de la lisibilité : bref, les conditions d’une confiance retrouvée entre les employeurs et les salariés. C’est pourquoi je suis favorable à la suppression de l’article 1er.
M. Richard Ferrand. J’estime, à l’instar de mon collègue Sebaoun, que la position du rapporteur est parfaitement équilibrée. Tout d’abord, il serait paradoxal que le législateur renonce à créer une commission, préférant en confier le soin au pouvoir réglementaire. Il est en effet de notre devoir d’exercer autant que possible nos compétences et de ne pas en laisser toujours plus au pouvoir exécutif. Cet argument ne me paraît donc pas recevable, surtout dans cette enceinte.
Ensuite, l’un de nos collègues a affirmé que la jurisprudence n’était pas la loi. C’est une découverte assez ancienne… Il n’en reste pas moins que la jurisprudence s’applique dans le règlement des conflits. Aussi convient-il de se réjouir lorsque la loi vient opportunément la codifier, car, ce faisant, elle crée de la sécurité en en supprimant les aléas et les variations.
Quant à l’argument selon lequel l’article 1er enverrait un mauvais signal parce qu’il poserait un verrou là on attendrait de l’air, il n’est pas non plus valable. Il me semble, au contraire, que définir précisément les principes crée l’espace requis pour l’organisation des relations sociales. « Donner de l’air », comme le souhaite l’un de nos collègues, permettrait toutes les variations et insécuriserait les rapports sociaux.
L’article 1er tel que le conçoit notre rapporteur est donc équilibré. C’est pourquoi il faut accepter sa proposition.
M. Arnaud Richard. Je tiens à préciser qu’il ne s’agit pas, pour nous, de critiquer les travaux du comité Badinter, qui seront utiles à l’avenir, mais ses conclusions qui, selon l’engagement qu’avait pris le Gouvernement, devaient être le grand préambule du code du travail – à l’instar de ce qu’est la Charte pour l’environnement pour la Constitution – ne sont finalement que la feuille de route d’une commission. J’en suis désolé, mais il est temps de mettre fin à ce triste épisode.
M. Bernard Perrut. Évoquant la commission d’experts et de praticiens mentionnée à l’article 1er, le rapporteur nous a indiqué qu’il s’agissait d’une « commission technique ». À quoi bon prévoir dans la loi la création d’une simple commission technique, sur laquelle nous avons, de surcroît, peu de précisions ? Surtout, les principes essentiels du droit du travail énoncés par MM. Badinter et Lyon-Caen n’ont pas à figurer dans un texte de loi par définition normatif, d’autant qu’ils mêlent des normes législatives, constitutionnelles, européennes et conventionnelles. On imagine sans peine les difficultés contentieuses que provoquerait, dans un droit du travail avant tout jurisprudentiel, l’inscription dans la loi de ces principes.
Par ailleurs, si l’on veut que cette commission propose un nouveau code du travail, on doit lui laisser toute liberté de juger par elle-même quels sont les points les plus importants, ceux qui méritent d’être repris. Je pense notamment au principe relatif au fait religieux : on ne peut lui imposer qu’un tel principe soit mentionné dans le texte.
M. le rapporteur. Je ne reviendrai pas en détail sur les soixante et un principes, puisque je défendrai dans un instant un amendement visant à les supprimer de l’article 1er – et j’expliquerai les raisons d’une telle proposition. Néanmoins, sur le rôle de ces principes, j’ai entendu tout et son contraire : certains estiment qu’ils devraient avoir valeur constitutionnelle tandis que d’autres ne veulent pas qu’ils perturbent la législation existante. J’y reviendrai.
En ce qui concerne la commission, on ne peut pas à la fois regretter de n’en rien savoir et nous reprocher de la mentionner dans le texte pour qu’elle ait une place et pour qu’une réflexion s’engage sur son rôle et sa composition. J’ajoute que nous devons être prudents. En effet, cette commission devant avoir une influence sur le débat, il est préférable que nous l’encadrions par la loi. Comme Mme Fraysse le disait elle-même, consulter des experts n’est pas en soi scandaleux. Ainsi, si l’on poussait son raisonnement jusqu’au bout, cette commission pourrait exister, mais elle serait en dehors de la loi. Je préfère, quant à moi, qu’elle soit encadrée.
Pour ces différentes raisons, je maintiens mon avis défavorable sur les amendements de suppression de l’article 1er.
La Commission rejette les amendements.
Puis elle examine, en discussion commune, l’amendement AS232 de Mme Marie-Lou Marcel et les amendements AS175 et AS178 de Mme Isabelle Bruneau.
Mme Marie-Lou Marcel. Il n’apparaît pas souhaitable qu’une commission composée d’experts et de praticiens des relations sociales se charge de la refondation de la partie législative du code du travail, qui doit demeurer du ressort du législateur. Je propose donc de substituer aux alinéas 1 à 4 de l’article 1er l’alinéa suivant : « La refondation du code du travail s’appuie sur les principes essentiels. »
Mme Isabelle Bruneau. Dans sa version actuelle, l’article 1er confie à une commission d’experts et de praticiens la responsabilité de refonder le code du travail. Or le mode de désignation des membres de cette commission n’est pas précisé, non plus que l’obligation de respecter le principe de parité. Les parlementaires ayant la légitimité et les compétences pour engager une réflexion visant à refonder le code du travail selon les principes établis à l’article 1er, mes deux amendements visent donc à substituer à la commission dont la création est proposée par le Gouvernement une commission mixte composée de parlementaires des deux assemblées issus des commissions et délégations compétentes en matière de droit du travail, et ce, afin de garantir la transparence des discussions, d’assurer la légitimité de la commission et d’associer le Parlement, en amont et dans un délai raisonnable, à toute réforme du droit du travail.
M. le rapporteur. Avis défavorable à l’amendement AS232. J’ai en effet indiqué les raisons pour lesquelles il me paraît important que cette commission soit créée.
S’agissant des amendements AS175 et AS178, il me paraît contradictoire de refuser que la commission ait des prérogatives qui donneraient à ses propositions une force particulière, notamment par rapport à la loi, et de vouloir dans le même temps qu’elle soit composée de parlementaires. Que ces derniers souhaitent auditionner les membres de la commission et qu’il existe un lien particulier entre celle-ci et le Parlement me paraît tout à fait légitime. Mais, si la commission était composée de parlementaires, elle aurait une force que je ne souhaite pas lui donner, préférant lui réserver un caractère technique. Avis défavorable, donc.
Mme Isabelle Le Callennec. Madame la présidente, comment expliquer que ce texte ne soit pas examiné, à l’instar du projet de loi Macron, par une commission spéciale qui aurait réuni, outre les membres de la commission des affaires sociales, ceux des commissions des affaires économiques et des affaires européennes, qui se sont saisies du projet de loi pour avis, ainsi que de la délégation aux droits des femmes ?
Mme la présidente Catherine Lemorton. Madame Le Callennec, il faudrait que vous vous mettiez d’accord avec les autres membres de votre groupe, car certains d’entre eux m’ont remerciée d’avoir su défendre notre commission. Certes, d’autres commissions se sont saisies pour avis du texte, comme c’est le cas pour de nombreux autres textes. Mais le projet de loi relève essentiellement du droit du travail et il n’y avait aucune raison de créer une commission spéciale.
La Commission rejette successivement les amendements AS232, AS175 et AS178.
Puis elle examine l’amendement AS433 de Mme Dominique Orliac.
Mme Dominique Orliac. La loi n’a pas à comporter, à titre de prolégomènes, un article prévoyant la création d’une commission d’experts. C’est au Parlement de voter la loi. Le Gouvernement peut toujours solliciter, s’il le souhaite, l’avis de tel ou tel expert sans pour autant qualifier cet avis de refondation législative du code du travail.
M. le rapporteur. Je partage entièrement votre avis, Madame Orliac. Je ne confonds pas le travail parlementaire et la mission de la commission. Que les choses soient claires : celle-ci n’a pas le pouvoir de modifier la loi. En outre, votre amendement présente un problème de rédaction, puisque vous maintenez le mot : « commission » alors que vous entendez supprimer celui-ci. Avis défavorable.
La Commission rejette l’amendement.
Puis elle examine l’amendement AS612 de Mme Catherine Coutelle.
Mme Catherine Coutelle, présidente de la délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes. Merci, madame la présidente, de m’accueillir au sein de votre commission. Mes collègues et moi défendrons un certain nombre d’amendements qui ont été examinés par la délégation aux droits des femmes.
Par l’amendement AS612, nous demandons que la commission qui sera créée afin de proposer une refondation de la partie législative du code du travail soit composée à parité de femmes et d’hommes. La commission Badinter, où siégeaient, d’après ce que nous a dit le ministère du travail, « les figures les plus reconnues en matière de droit du travail », ne comptait qu’une seule femme parmi ses six membres. La commission Combrexelle comprenait seize membres, dont seulement quatre femmes. J’incline à penser qu’il y a, en France, quelques femmes reconnues pour leur compétence en droit du travail. S’il y a des difficultés pour trouver des chercheures ou des femmes personnalités qualifiées, nous pouvons donner des noms.
Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement.
Puis elle examine l’amendement AS705 de Mme Monique Orphé.
M. Gérard Sebaoun. Je défends cet amendement au nom de Mme Orphé. Elle souhaite que la commission d’experts et de praticiens des relations sociales qui sera instituée prenne en compte la spécificité des outre-mer, car elle constate, dans sa pratique quotidienne d’élue locale et de députée d’outre-mer, des difficultés d’application de la loi dans les outre-mer, en dépit du principe d’assimilation législative prévu par la Constitution pour les départements et les régions d’outre-mer.
M. le rapporteur. Je vous invite à retirer cet amendement. Les départements d’outre-mer sont régis par l’article 73 de la Constitution et ne bénéficient pas du principe de spécialité législative : la loi s’y applique systématiquement, contrairement à ce qui se passe dans les collectivités d’outre-mer qui relèvent de l’article 74 de la Constitution. D’autre part, le problème soulevé par Mme Orphé est celui de l’application des conventions collectives outre-mer. Nous sommes convenus de travailler ensemble sur ce point.
L’amendement est retiré.
La Commission en vient à l’amendement AS874 du rapporteur.
M. le rapporteur. Il s’agit de faire en sorte que la commission d’experts travaille à droit constant. Ainsi que je l’ai expliqué précédemment, je ne souhaite pas que nous lui reconnaissions une capacité à modifier la loi.
M. Francis Vercamer. Je n’ai pas compris votre explication, monsieur le rapporteur.
M. Jean-Patrick Gille. Pour ma part, j’ai compris, mais je suis un peu surpris. Selon moi, le terme de « refondation » n’est pas approprié, car « refonder », cela signifie « revenir sur les principes ». Or il est précisé que la commission devra s’appuyer sur les principes de la commission Badinter, laquelle a fait un travail – tout le monde en convient – à droit constant. Donc, en réalité, la commission sera chargée de proposer une « réécriture » du code du travail, simplifiée par rapport à la version actuelle, en passant de la hiérarchie entre la loi, l’accord de branche et l’accord d’entreprise à une organisation entre l’ordre public, le champ de la négociation collective et les dispositions supplétives. C’est ce qui a été fait dans les articles 2, 3 et 4 du projet de loi. Sauf que je n’ai pas le sentiment que ces articles ont été rédigés totalement à droit constant. D’où mes interrogations : ces articles n’ont pas été rédigés à droit constant, mais on explique que le reste du code du travail devra être rédigé, lui, à droit constant. C’est bien le cœur du sujet.
M. le rapporteur. Il y a une confusion entre le rôle de la commission et celui du Parlement. Je souhaite que la commission travaille à droit constant, notamment en ce qui concerne les dispositions supplétives, car je ne souhaite pas que nous lui reconnaissions des prérogatives qui appartiennent au législateur.
M. Gérard Cherpion. Je crains de ne pas avoir bien compris non plus. Comment peut-on introduire des dispositions supplétives à droit constant ? Il y a, selon moi, un problème d’incompatibilité.
M. Christophe Cavard. Jusqu’à preuve du contraire, le droit, c’est la loi. Dès lors que nous aurons voté les articles qui modifient le droit actuel, cela deviendra du droit constant.
Je regrette que l’amendement suivant du rapporteur fasse disparaître du texte les soixante et un grands principes de la commission Badinter, car ceux-ci rappelaient de manière très claire et lisible ce qu’était le droit constant. Tout le monde pouvait en prendre connaissance. Certes, ces soixante et un principes figurent déjà dans le code du travail, mais je défie quiconque de les y retrouver ! Ceux-là mêmes qui, hier, dénonçaient un code du travail illisible de plus de 1 000 pages, renoncent finalement à ces principes, qui nous auraient pourtant simplifié la vie.
Ainsi que l’a relevé M. Vercamer, nous aurions d’ailleurs pu avoir un débat sur certains de ces principes, notamment sur ceux qui figurent respectivement à l’alinéa 6 et à l’alinéa 25. Il est dommage de reporter ce débat.
Néanmoins, l’amendement du rapporteur protégera le droit constant, ce qui est déjà une bonne chose.
M. Francis Vercamer. Que se passera-t-il entre la promulgation de la présente loi et le moment où la commission rendra son travail ? Comment fera-t-on si, après l’adoption de ce texte, un projet ou une proposition de loi, voire des amendements à des textes qui ne portent pas sur le champ social, modifient le droit ? Dans votre amendement, vous indiquez que la commission devra travailler à droit constant en se basant sur les « règles légales en vigueur à la date de promulgation de la présente loi ». J’en déduis qu’on ne fera aucun cas de ce qui peut se passer ensuite.
M. Jean-Patrick Gille. Si j’ai bien compris la démarche telle qu’elle a été clairement expliquée par le rapporteur, la commission procédera non pas à une « refondation », mais à une « réécriture », avec une nouvelle organisation du code, mais non avec de nouveaux principes. Selon moi, il faudra récrire l’alinéa 1er en séance publique, car, si l’on indique qu’il s’agit d’une refondation, cela signifie que l’on s’interrogera à nouveau sur les principes. Quant aux soixante et un principes de la commission Badinter, si on les retire du texte, on ne les renie pas pour autant.
M. Arnaud Richard. Le présent amendement, qui a l’air anodin, n’est vraiment pas neutre. Il est même fondamental. C’est « Signé Furax » ! Monsieur le rapporteur, vous laissez entendre que les articles 2, 3 et 4 ne changent rien ou presque au droit actuel. Tel n’est pas, cependant, l’avis de M. Gille ni le mien. En tout état de cause, vous considérez que le travail de la commission ne devra, pour sa part, rien changer au droit. Je m’inquiète en peu de l’interprétation qui sera faite de cette disposition.
M. le rapporteur. Je redis les choses clairement : le droit peut être modifié par le législateur chaque fois qu’il le souhaite et qu’il dispose de la majorité pour le faire. Quant à la commission, elle travaillera à droit constant. Elle pourra le cas échéant suggérer, dans ses conclusions, de faire évoluer le droit sur tel ou tel point, mais il appartiendra au législateur d’en décider ensuite. Je ne veux pas donner à la commission le droit de modifier, par elle-même, la législation en vigueur. C’est d’ailleurs pour cette raison que la présence de parlementaires au sein de la commission n’est, selon moi, pas souhaitable. Il ne faut pas qu’il y ait de confusion entre le travail de la commission et celui de la représentation nationale, qui a seule la légitimité pour modifier le droit, à tout moment.
La Commission adopte l’amendement.
Puis elle examine l’amendement AS566 de M. Arnaud Richard.
M. Arnaud Richard. Nous nous apprêtons à créer une commission de « refondation », ou plutôt de « réécriture » ou de « chambardement », qui va discuter sur la base des travaux d’une autre commission, lesquels travaux ont été repris dans le texte… Il nous paraît nécessaire que le Parlement exerce un contrôle sur la composition de cette commission. Par cet amendement, nous proposons, d’une part, que ses membres soient auditionnés, préalablement à leur nomination, par les commissions parlementaires compétentes et, d’autre part, que la désignation de son président fasse l’objet d’un vote conforme desdites commissions parlementaires. Il s’agit d’un ultime amendement de repli.
M. le rapporteur. Avis défavorable. Si l’on vous suivait, ces dispositions devraient relever de la loi organique.
Mme Isabelle Le Callennec. Pardon d’insister, mais il faudrait que nous ayons des éléments plus concrets sur cette commission et sur sa composition : combien de membres comptera-t-elle ? Combien de temps lui donnera-t-on ? Qui envisage-t-on d’y nommer ? Cette dernière question est importante, car, en fonction des personnes que l’on choisira, on orientera les fameux principes dont nous parlons – d’autant que, si j’ai bien compris, nous allons retirer du texte les principes de la commission Badinter. On fait toujours appel aux mêmes experts du droit du travail. Ils font des propositions, mais, à un moment donné, il faut que les responsables politiques, au Gouvernement et au Parlement, arbitrent et fassent des choix. J’ai le sentiment qu’on ne cesse de repousser la réécriture du code du travail, qui était pourtant, a priori, une des ambitions de ce texte. Or notre pays ne peut plus attendre. L’article 1er va se résumer à la création d’une commission d’experts sans qu’on en sache davantage, si ce n’est qu’elle sera composée à parité, conformément à l’amendement que nous avons voté. Je trouve que cela ne fait pas très sérieux.
M. le rapporteur. J’avoue que je ne sais plus trop comment vous répondre... Il s’agit d’une commission d’experts, qui sera en effet composée à parité. Je ne me vois pas inscrire les noms de ses membres dans la loi. Mme Fraysse a demandé tout à l’heure si les organisations syndicales et patronales pourraient disposer de représentants en son sein. Nous pourrions en débattre. Cependant, à mon sens, le terme « expert » est assez large et n’interdit pas d’y nommer, le cas échéant, des représentants syndicaux ou patronaux, lesquels disposent souvent, en tout cas de mon point de vue, d’une expertise réelle. Si nous commençons à dresser une liste, je crains que nous ne « fermions » cette commission. Notre objectif, c’est qu’elle soit composée de personnes qui ont une compétence relative au monde du travail.
La Commission rejette l’amendement.
Elle en vient à l’amendement AS665 de M. Jean-Patrick Gille.
M. Jean-Patrick Gille. Le projet de loi prévoit que la commission associera à ses travaux les organisations professionnelles d’employeurs et syndicales de salariés représentatives au niveau national. Pour ce qui est des organisations professionnelles d’employeurs, je propose de préciser qu’il s’agit des organisations représentatives « au niveau interprofessionnel et multi-professionnel ». Au niveau interprofessionnel, il s’agit du Mouvement des entreprises de France (MEDEF), de la confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) et de l’Union professionnelle artisanale (UPA). Dans la loi relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale, nous avons reconnu en outre la représentativité au niveau multi-professionnel, dans le domaine de l’agriculture, dans celui de l’économie sociale et solidaire, ainsi que pour les professions libérales. Le projet de loi relatif à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine prévoit de la reconnaître également dans le domaine de la culture. L’amendement vise donc à ce que toutes les organisations patronales représentatives à ces niveaux soient associées aux travaux de la commission.
Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement.
La Commission est saisie de l’amendement AS613 de Mme Catherine Coutelle.
Mme Catherine Coutelle, présidente de la délégation aux droits des femmes. Outre les organisations patronales et syndicales, nous demandons que la commission chargée de la refondation du code du travail associe à ses travaux le Conseil supérieur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (CSEP). Je tiens à souligner l’importance et la qualité du travail du CSEP. Nous aimerions d’ailleurs que ses avis soient rendus publics plus tôt. Nous présenterons tout à l’heure un amendement à cette fin.
S’agissant des principes de la commission Badinter repris à l’article 1er, le CSEP nous a alertés sur un certain nombre de formulations qu’il conviendrait, selon lui, de modifier. Nous avons déposé des amendements en ce sens.
À l’alinéa 9, nous demandons que l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes soit non pas « respectée », mais « assurée » dans l’entreprise. Ce terme figure déjà dans notre législation.
À l’alinéa 10, il conviendrait de préciser que les discriminations sont interdites non seulement « dans toute relation de travail », mais aussi « à l’embauche », avant que la relation de travail soit établie.
À l’alinéa 14, nous souhaitons qu’il soit question non pas de « conciliation », mais d’« articulation » entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale, afin de les mettre sur un pied d’égalité.
La rédaction du principe repris à l’alinéa 23 – « La grossesse et la maternité ne peuvent entraîner des mesures spécifiques autres que celles requises par l’état de la femme » – est un peu surprenante. Elle montre que les commissions ne sont pas assez féminines ou féministes. Nous souhaiterions écrire : « Pendant la grossesse et la maternité, les salariées bénéficient de mesures spécifiques en cas de risque pour leur santé et leur sécurité. »
Enfin, l’alinéa 38 dispose : « L’employeur assure l’égalité de rémunération entre les salariés pour un même travail ou un travail de valeur égale. » Nous ajouterions que cette égalité doit être assurée « entre les femmes et les hommes » et préciserions que « les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits ».
Mme la présidente Catherine Lemorton. Je précise que Mme Coutelle m’avait demandé la permission d’intervenir à propos des principes dont la rédaction pose problème au regard de l’égalité entre les femmes et les hommes. L’avenir de ces alinéas étant incertain, j’ai jugé important qu’elle puisse le faire.
M. le rapporteur. Je ne reviens pas sur les principes eux-mêmes : j’expliquerai ma position lorsque je présenterai mon amendement qui vise à les supprimer.
Le projet de loi précise que la commission associera les partenaires sociaux à ses travaux, ce qui me paraît important. En revanche, je ne suis pas favorable à ce que nous inscrivions dans le texte le fait qu’elle doit y associer également le CSEP. Si nous le faisons, nous risquons d’avoir à dresser la liste de tous les conseils et organismes qui pourraient légitimement être consultés par la commission, ce qui surchargerait inutilement le texte. Rien n’interdira à la commission de se rapprocher du CSEP et de travailler avec lui. Je partage d’ailleurs votre avis, madame Coutelle, sur la qualité des travaux du CSEP. Je vous invite à retirer votre amendement. À défaut, je donnerai un avis défavorable.
Mme Isabelle Le Callennec. Lorsqu’elles seront associées aux travaux de la commission, les organisations patronales et syndicales devront-elles être représentées à parité par des femmes et des hommes ? La parité s’imposera-t-elle à elles ou bien seulement à la commission elle-même ?
M. le rapporteur. « Être associé aux travaux de la commission » ne signifie pas « participer à tous ses travaux ». Aux termes de l’amendement AS612 de Mme Coutelle que nous avons adopté, la parité s’appliquera à la composition de la commission, mais non à celle des délégations patronales et syndicales qui participeront ponctuellement à ses travaux. Selon moi, nous ne pourrions d’ailleurs pas prévoir une telle disposition dans le cadre de ce texte.
Mme Catherine Coutelle, présidente de la délégation aux droits des femmes. Je me rends aux arguments du rapporteur. Je rappelle néanmoins que le CSEP doit être consulté par le Gouvernement sur tous les projets de loi ayant trait à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Je précise à l’attention de Mme Le Callennec que nous avons instauré la parité dans les institutions représentatives du personnel. Les syndicats ont d’ailleurs parfois des difficultés à trouver des femmes et à les placer à des postes de responsabilité, ainsi que nous le constatons dans d’autres domaines.
L’amendement est retiré.
La Commission examine l’amendement AS704 de Mme Monique Orphé.
Mme Monique Orphé. Bien que le principe de l’assimilation législative prévu à l’article 73 de la Constitution prévoie l’application systématique du droit national dans les départements et collectivités d’outre-mer, l’expérience révèle souvent une inadaptation du droit aux spécificités de nos territoires. C’est notamment le cas en matière de droit du travail, le présent projet de loi ne faisant pas exception à la règle. Son ambition de refondation pourrait être l’occasion de remédier définitivement à ce problème.
La commission d’experts et de praticiens des relations sociales créée par l’article 1er est présentée comme une instance fondamentale de cette refondation. Sa tâche serait incomplète si son mode de fonctionnement ne permettait pas de tenir compte des problématiques spécifiques aux territoires d’outre-mer. C’est pourquoi cet amendement vise à y associer les représentants des organisations d’employeurs et de salariés représentatives dans les territoires d’outre-mer, dont la représentativité aura été établie conformément au nouvel article L. 2121-1-1, à côté de ceux des organisations nationales.
M. le rapporteur. Je comprends votre intention, madame Orphé, mais il me semble qu’il n’existe aucune organisation syndicale ou patronale compétente dans l’ensemble des départements et territoires d’outre-mer. Or il est naturellement impossible d’ajouter à cette commission l’ensemble des organisations professionnelles de chacun de ces territoires. En l’état, je vous suggère donc de retirer cet amendement.
Mme Monique Orphé. Il est vrai qu’il n’existe pas de représentant compétent pour l’ensemble des territoires d’outre-mer.
L’amendement est retiré.
La Commission examine, en discussion commune, les amendements AS875 du rapporteur et AS567 de M. Arnaud Richard.
M. le rapporteur. L’étude d’impact prévoit que la commission remet ses travaux au Gouvernement dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la loi, mais l’article ne mentionne aucun délai. Par cohérence, cet amendement vise à ce que ces travaux soient remis au plus tard en juillet 2018, étant entendu que le Gouvernement sera libre de proposer au Parlement de suivre – ou non – les recommandations de la commission.
M. Arnaud Richard. Dans le même esprit, l’amendement AS567 vise à donner un cadre temporel aux travaux de cette commission. Il nous a semblé qu’un délai de dix-huit mois, quoique discordant par rapport à l’étude d’impact, serait plus pertinent puisqu’il aboutirait à fixer une date de remise en octobre 2017, après les élections législatives. Contrairement au comité Badinter, cette commission aurait ainsi travaillé utilement pour la prochaine majorité.
M. le rapporteur. Je préfère un délai cohérent avec l’étude d’impact. Quoi qu’il en soit, la date de remise des travaux sera postérieure aux élections législatives – un horizon dont j’ai préféré ne pas tenir compte en l’occurrence. Votre objectif est donc satisfait.
M. Bernard Accoyer. Ne s’agit-il pas d’une injonction au Gouvernement ?
M. le rapporteur. Encore une fois, il n’y a là nulle injonction au Gouvernement : une fois saisi du rapport de la commission, le Gouvernement aura toute liberté de retenir en tout ou partie les recommandations qui y figurent. Sa liberté de choix et celle du législateur demeurent donc entières.
Mme Bérengère Poletti. Compte tenu des délais de publication des décrets d’application de la loi, qui retardent souvent la mise en œuvre concrète des textes, je m’interroge sur la pertinence d’un tel délai.
Mme Isabelle Le Callennec. La commission devra proposer au Gouvernement une réécriture intégrale du code du travail. Est-ce à dire qu’elle dispose de deux ans pour accomplir cette tâche ?
M. le rapporteur. À droit constant, ce délai, prévu dans l’étude d’impact, devrait suffire. Quant aux délais de publication des décrets, madame Poletti, les dispositions créant la commission de refondation donneront lieu à des décrets d’application directe.
M. Arnaud Richard. Par souci de concorde, je me range à l’avis du rapporteur.
L’amendement AS567 est retiré.
La Commission adopte l’amendement AS875.
Puis elle examine les amendements identiques AS876 du rapporteur, AS157 de M. Gérard Cherpion, AS324 de M. Élie Aboud, AS568 de M. Arnaud Richard, AS598 de M. Rémi Delatte et AS604 de M. Bernard Perrut.
M. le rapporteur. Cet amendement vise à supprimer les alinéas 4 à 73 de l’article 1er, afin d’en ôter les soixante et un principes énoncés par le comité Badinter. Permettez-moi d’emblée de souligner la valeur des travaux et des réflexions de cette instance. Comme plusieurs d’entre vous l’ont dit, ces soixante et un principes ne sont pas nouveaux : ils existent déjà, tantôt dans la Constitution, tantôt dans la jurisprudence ou dans le droit international. Tous ont leur pertinence, en dépit de leurs origines disparates.
Ces principes n’ont pas force constitutionnelle, mais, s’ils étaient intégrés au préambule du code du travail, ils se superposeraient à la législation existante. Il en résulterait un risque important de contentieux et le juge pourrait peiner à interpréter la loi au regard de ces principes. Soyons clairs : le texte ne prévoit pas qu’ils soient inscrits dans le préambule, mais qu’ils éclairent les travaux de la commission de refondation. En toute franchise, je n’imagine guère qu’elle ne s’en inspire pas, puisque le débat public sur le code du travail se les est déjà appropriés. Nonobstant leur qualité et leur raison d’être, je vous propose donc de retirer ces soixante et un principes du texte dès lors qu’ils ne possèdent plus de valeur législative.
M. Gérard Cherpion. L’article 1er inscrit dans la loi les soixante et un principes issus des conclusions du comité Badinter afin de fonder les travaux de la commission d’experts qui est appelée à proposer au Gouvernement une nouvelle rédaction de la partie législative du code du travail. Aussi essentiels soient-ils, ces principes n’ont pas davantage vocation à figurer dans la loi que dans un préambule du code du travail créé spécialement pour l’occasion : nul besoin, en effet, de les graver dans le marbre législatif pour guider la réécriture du futur code.
Pour mémoire, nous avons déposé, il y a environ deux ans, une proposition de loi signée par quatre-vingts de nos collègues, qui visait la réécriture du code du travail et fixait même la composition de la commission qui en serait chargée ; vous l’avez balayée d’un revers de main sans même vouloir l’examiner. Je me réjouis de constater que l’idée nous revient aujourd’hui, même si nous avons perdu deux ans.
Quoi qu’il en soit, l’inscription dans la loi de normes de valeur différente
– qu’elle soit constitutionnelle, législative ou jurisprudentielle – qui se superposent au code du travail ne peut que favoriser la complexité et même l’illisibilité du droit et nourrir les inquiétudes des salariés et des employeurs, comme en témoigne l’accueil qui a été fait au sixième de ces principes relatif au fait religieux. C’est pourquoi l’amendement AS157 vise à s’en tenir aux premiers alinéas de l’article et à supprimer les alinéas 4 à 73.
M. Élie Aboud. Pour simplifier et oxygéner le code du travail, l’inscription de ces principes est inutile, voire contre-productive. Il serait salutaire de les supprimer.
M. Arnaud Richard. Nous ne remettons nullement en cause les travaux du comité Badinter et les différents rapports qui l’ont précédé, mais l’inscription dans la loi de ces soixante et un prolégomènes dits « essentiels » nous pose plusieurs problèmes. Dans la version initiale du texte, ces principes devaient constituer le préambule du code du travail. Dans le projet de loi dont nous sommes saisis aujourd’hui, leur énumération constitue une sorte de guide légistique sur lequel la commission de refondation devra s’appuyer en vue de réécrire le code du travail. A priori, ces principes n’ont pourtant pas de valeur normative ; ils demeureraient pourtant in fine inscrits dans une loi votée par le Parlement, et nul ne sait le sort qui pourrait leur être réservé.
Autre reproche : ces principes, qui sont à droit constant, ne répondent pas à l’évolution du code du travail initialement souhaitée. Pire, s’ils étaient repris dans la loi, ils s’ajouteraient aux principes du droit actuel, créant une complexité et une instabilité juridiques aussi bien pour les salariés que pour les employeurs.
Enfin, il faut envisager avec la plus grande prudence toute remise en cause de la jurisprudence établie. De ce point de vue, il nous semble maladroit d’avoir consacré le 6° aux questions de neutralité et de laïcité, qui sont encore très sensibles dans notre pays, et que l’on ne saurait traiter par une simple ligne dans un guide légistique. Pour aborder ce sujet plus en détail, nous défendrons un amendement visant à offrir la possibilité aux chefs d’entreprise d’inscrire le principe de laïcité dans le règlement intérieur de leur société.
Mme Véronique Louwagie. L’amendement AS598 vise également à supprimer les alinéas 4 à 73 de l’article, et ce pour plusieurs raisons. Tout d’abord, nous devons, en ce domaine comme en d’autres, rechercher la simplification, la lisibilité et la visibilité des mesures. Pour ce faire, il faut se contenter de cadres généraux et de principes essentiels sans pour autant s’abandonner dans un enchevêtrement complexe.
Ensuite, l’article 1er doit demeurer général et ne pas enfermer les choses, ce que ne permettraient pas des normes aussi précises et détaillées.
Enfin, il y aurait beaucoup à dire des valeurs contenues dans ces principes, dont certaines ne sont pas partagées – je pense à la mention, pour la première fois, du fait religieux dans l’entreprise.
M. Bernard Perrut. L’article 1er vise à apporter une reconnaissance à des principes qui sont issus de travaux et de rapports et qui n’ont pas leur place dans la loi, comme le reconnaît le rapporteur lui-même. Nous pouvons tous en convenir : pourquoi ajouter de la complexité, de l’illisibilité, de l’instabilité juridique alors qu’il vaudrait mieux ménager la liberté de cette commission de refondation sans lui imposer un quelconque principe relatif au fait religieux, par exemple ? On ne saurait pas davantage mélanger des règles de niveaux différents, certaines étant législatives, d’autres constitutionnelles, d’autres encore conventionnelles. Chacun sait en effet que le droit du travail est essentiellement jurisprudentiel ; s’ils avaient force législative, ces principes pourraient être utilisés devant une juridiction, ce qui nuirait à la clarté du code du travail que nous souhaitons tous.
M. Christophe Cavard. Je ne soutiendrai pas ces amendements précisément parce que nous souhaitons un code du travail clair. Certes, l’absence de ces soixante et un principes dans le texte facilitera sans doute les travaux de la commission, mais je rappelle qu’ils existent en droit, ce qui permet aux juridictions de s’appuyer sur eux, en dépit de leurs origines variées. Il me semble utile que ces soixante et un principes rassemblent une série de droits créés au fil des années dans les textes et par la jurisprudence. En les ôtant du texte, nous prendrions le risque qu’ils soient revus dans leur ensemble, même à droit constant. Le juge est libre de décider s’il souhaite ou non suivre la jurisprudence, nous dit-on ; au contraire, il me semble pertinent de faire de la jurisprudence un élément de droit qui protège les salariés.
Plusieurs alinéas – le 6° et le 25°, par exemple – auraient certes pu donner lieu à un débat, et nous aurions même pu préciser que la commission a la possibilité, et non le devoir, de fonder ses travaux sur eux. Quoi qu’il en soit, la lecture de ces soixante et un principes permet à tout salarié, à tout chef d’entreprise de comprendre ce qu’est le code du travail en l’état. Sans en faire un article opposable à part entière, il me semble judicieux de les placer en préambule du code du travail pour rappeler leurs droits aux salariés – car, soyons francs, ils les ignorent souvent.
M. Gérard Sebaoun. Je soutiendrai quant à moi ces amendements. Concernant la laïcité, j’estime néanmoins que certains de nos collègues commettent un contresens profond. Une entreprise est un lieu privé, et le droit actuel reconnaît tout à fait la liberté de chacun d’exprimer ses convictions religieuses, sous réserve qu’un règlement intérieur ne limite la manière dont peut s’exprimer cette liberté à l’intérieur de l’entreprise. Ainsi, le débat parfois polémique ouvert au sujet du 6° méconnaît totalement le droit en vigueur qu’a repris le comité Badinter.
Mme Dominique Orliac. Je voterai contre ces amendements, puisque nous souhaitions la suppression de l’ensemble de l’article 1er. La loi n’a pas à contenir un article renvoyant à une commission d’experts.
Je me félicite tout de même de la suppression de certains alinéas, en particulier l’alinéa 11. En effet, la liberté de manifester ses convictions, y compris religieuses, dans l’entreprise, reflète la jurisprudence actuelle. Rappelons toutefois que le rôle du législateur ne consiste pas à enregistrer passivement la jurisprudence, mais à fixer le cas échéant des règles plus appropriées. De surcroît, la formulation retenue – « manifester ses convictions, y compris religieuses » – est très proche du prosélytisme. Or, l’entreprise ne saurait devenir un lieu de propagande confessionnelle sans que cela se traduise par des clivages et des tensions. En revanche, le principe de neutralité permet à tous de vivre et de travailler ensemble par-delà les diverses appartenances religieuses.
Mme Isabelle Le Callennec. En clair, si ces amendements sont adoptés, l’article 1er ne comportera plus que trois alinéas portant création d’une commission d’experts, précisant que la refondation attribue une place centrale à la négociation collective et que la commission associe à ses travaux les organisations professionnelles d’employeurs et syndicales de salariés. Cependant, le chapitre Ier est intitulé « Vers une refondation du code du travail », tandis que l’étude d’impact utilise l’expression de « réécriture » dudit code.
Dès lors, je m’interroge sur le démarrage de nos travaux : nous examinons un texte portant refondation du code du travail en édulcorant d’emblée l’article 1er, et en parlant tantôt de refondation, tantôt de réécriture – deux mots qui ne sont pas synonymes. Les intentions ne sont pas claires, y compris aux yeux de l’opinion publique. Sans doute s’agit-il d’éviter telle ou telle discussion, mais j’estime que nous ne donnons pas un signal fort de notre volonté de refonder le code du travail de telle sorte qu’il soit plus adapté à la période de mutations que nous traversons et à la volonté manifeste – exprimée dans le titre du projet – de donner davantage de libertés et de protections aux entreprises et aux actifs.
Mme Eva Sas. L’amendement du rapporteur est tout à fait judicieux, car il permet de ne pas ériger en guide présidant aux travaux de la commission des orientations que nous estimons contraires au principe de faveur. Il me semble particulièrement important de supprimer le 6°, qui crée plus de problèmes que de solutions ; il n’est pas opportun d’aborder la question des libertés religieuses dans l’entreprise d’une façon aussi lapidaire.
M. Élie Aboud. Personne, monsieur Sebaoun, n’a condamné l’esprit des travaux du comité Badinter. Toutefois, s’il faut naturellement tenir compte de l’esprit des textes et de l’interprétation qui peut en être faite, il faut aussi prendre garde aux éventuelles dérives. Même dans une entreprise privée, il est essentiel d’être intraitable en matière de laïcité.
M. Gérard Sebaoun. Vous faites un contresens sur la laïcité !
M. Jean-Patrick Gille. Le rapporteur a la sagesse de nous proposer de ne pas entrer dans un débat sur les travaux du comité Badinter. Nous sommes nombreux à saluer la qualité de ces travaux et même à regretter qu’ils n’aient pas été le fait de parlementaires, tant on nous accuse souvent de complexifier les choses – je crains de ce point de vue que, à l’issue de nos débats, nous ne soyons pas parvenus à simplifier le code du travail… Quoi qu’il en soit, le comité Badinter a fourni un remarquable travail qui permet à chacun de s’approprier l’esprit du code du travail tel qu’il existe. Si nous entrions dans un débat sur le contenu de ces principes, en particulier le sixième, nous en modifierions la teneur ; quel serait alors le statut du texte que nous rédigeons ? Il me semble plus sage de ne pas faire figurer ces principes dans le texte.
S’agissant de la distinction entre réécriture et refondation, précisons que la commission est chargée de réécrire le code du travail à droit constant en vue de préparer un travail de refondation qu’il appartiendra au législateur de mener le moment venu – travail déjà effectué pour partie dans les articles 2, 3 et 4. Le titre est donc exact : la réécriture est préalable à la refondation. En l’occurrence, il me semble que nous avons nettement clarifié la portée de l’article 1er.
Enfin, je m’interroge sur l’opportunité de supprimer non seulement les principes eux-mêmes, mais aussi toute référence auxdits principes. Sans doute pourrons-nous y revenir en séance publique.
M. Lionel Tardy. Je soutiens cet amendement, qui fera tomber un certain nombre d’amendements ultérieurs. Le sixième principe a suscité de nombreux débats et, à juste titre, des inquiétudes : à quoi bon lier religion et entreprise en en faisant un principe fondamental, si ce n’est pour ouvrir une brèche favorable au communautarisme ? Laissons les entreprises et le monde du travail en dehors de tout cela. Encore une fois, il est risqué d’inscrire dans la loi des dispositions dont on ne mesure pas toujours la portée.
M. Arnaud Viala. À ce compte-là, monsieur Gille, mieux vaut tout simplement supprimer le texte entier ; le Premier ministre pourra nommer une commission sur les travaux de laquelle nous nous contenterons de nous prononcer dans un an. Si le débat sur les intentions du Gouvernement n’a plus lieu d’être en commission saisie du texte, je me demande à quoi nous servons et pourquoi nous nous apprêtons à discuter de dispositions dont nous savons qu’elles ne seront pas appliquées. Pourquoi Mme El Khomri et le Premier ministre ont-ils fait tout ce barouf médiatique concernant leur intention d’améliorer les conditions économiques du pays, pour que nous envisagions maintenant de supprimer l’essentiel des alinéas, voire des articles et pourquoi pas du texte, afin de laisser travailler une commission dont nous ignorons la composition, qui rendra des conclusions dans un délai indéterminé et qui nous conduira à prendre des décisions dont nous ignorons la nature ?
M. le rapporteur. Je précise à M. Gille que l’amendement tel qu’il est proposé vise notamment à supprimer l’alinéa 4.
Si je propose la suppression des principes du comité Badinter, ce n’est pas pour éviter le débat sur tel ou tel d’entre eux. La question que je pose est la suivante : quelle légitimité auraient ces soixante et un principes dès lors qu’il a été décidé de ne pas les insérer dans le préambule du code du travail ? Je ne répondrai donc pas à l’interprétation qui a été faite de tel principe particulier : je ne crains pas le débat, mais il n’est pas mon objectif.
J’ajoute, monsieur Viala, que les articles 2, 3 et 4 constituent déjà une modification dont la commission devra tenir compte. Il est faux de prétendre que nous sommes passifs alors que nous modifions déjà l’architecture du code.
La Commission adopte les amendements.
En conséquence, les amendements AS401 de M. Christophe Cavard, AS243 de M. Yannick Moreau, AS319 de M. Christophe Cavard, AS585 de M. Philippe Houillon, AS614 à AS616 de Mme Catherine Coutelle, AS34 de M. Patrick Hetzel, AS43 de M. Lionel Tardy, AS158 de M. Gérard Cherpion, AS377 de M. Arnaud Viala, AS434 de M. Roger-Gérard Schwartzenberg, AS565 de M. Arnaud Richard, AS610 de M. Bernard Perrut, AS759 de Mme Eva Sas, AS510 de M. Jean-Louis Costes, AS182 de Mme Isabelle Bruneau, AS159 de M. Gérard Cherpion, AS571 de Mme Anne-Yvonne Le Dain, AS231 de M. Marcel Rogemont, AS233 de Mme Marie-Lou Marcel, AS497 de Mme Anne-Yvonne Le Dain, AS32 de M. Patrick Hetzel, AS617 et AS618 de Mme Catherine Coutelle, AS741 de Mme Eva Sas, AS564 de M. Arnaud Richard, AS436 et AS435 de M. Alain Tourret, AS547 de M. Arnaud Richard, AS619 de Mme Catherine Coutelle, AS437 de M. Alain Tourret, AS290 de M. Christophe Cavard, AS438, AS439 et AS441 de M. Alain Tourret, AS620 de Mme Catherine Coutelle, AS402 de M. Christophe Cavard, AS378 de M. Arnaud Viala, AS1 de Mme Nathalie Kosciusko-Morizet, AS379 de M. Arnaud Viala, AS442 de M. Alain Tourret, AS740 de Mme Eva Sas, AS440 de M. Alain Tourret, AS292 de M. Christophe Cavard, AS443 et AS444 de M. Alain Tourret, AS31 de M. Patrick Hetzel, AS45 de M. Lionel Tardy, AS730 de Mme Eva Sas, AS445 et AS446 de M. Alain Tourret et AS727 de M. Jean-Louis Roumégas n’ont plus d’objet.
La Commission adopte l’article 1ermodifié.
*
* *
La Commission examine l’amendement AS537 de M. Arnaud Richard.
M. Arnaud Richard. La notion de neutralité religieuse est très débattue en France. La laïcité est un principe constitutionnel énoncé dès l’article 1er de la Constitution de 1958. Le principe de neutralité religieuse s’applique aux agents publics ; il est rappelé par la charte de la laïcité dans les services publics du 13 avril 2007, qui précise que « tout agent public a un devoir de stricte neutralité ». En revanche, aucun texte législatif ou réglementaire n’impose cette obligation de neutralité aux salariés des entreprises privées. Les employeurs qui désirent limiter la liberté d’expression religieuse de leurs employés ne peuvent le faire que dans un cadre précis, pour des motifs déjà admis par la jurisprudence tels que l’hygiène, la santé, la sécurité ou les relations avec la clientèle accueillie.
L’amendement AS537 propose une solution – certes imparfaite – concernant la neutralité dans l’entreprise et visant à renforcer la sécurité juridique, en inscrivant dans la loi la possibilité pour le chef d’entreprise d’inscrire dans le règlement intérieur le principe de neutralité et de définir ses modalités d’application en s’inspirant de la charte de la laïcité et de la diversité adoptée par une fameuse entreprise de recyclage de papier voici quelques années.
Il serait ainsi possible de transcrire dans les entreprises la règle existant dans les administrations et les services publics, déduite du principe de neutralité des pouvoirs publics et d’interdiction générale pour leurs agents du port de signes religieux. En un mot, il s’agit d’appliquer le modèle de la République dans l’entreprise.
M. le rapporteur. Le 1° et le 2° de cet amendement me semblent entrer en contradiction. Le 1° prévoit la possibilité de faire figurer des règles relatives au principe de laïcité dans le règlement intérieur de l’entreprise : pourquoi pas ? Mais, dans le même temps, le 2° vise à abroger le troisième alinéa de l’article L. 1321-3 du code du travail qui dispose que le règlement intérieur ne peut contenir « des dispositions discriminant les salariés dans leur emploi ou leur travail, à capacité professionnelle égale, en raison de leur origine, de leur sexe, de leurs mœurs, de leur orientation sexuelle, de leur âge, de leur situation de famille ou de leur grossesse, de leurs caractéristiques génétiques, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales ou mutualistes, de leurs convictions religieuses, de leur apparence physique, de leur nom de famille ou en raison de leur état de santé ou de leur handicap ». Avis défavorable.
Mme Isabelle Le Callennec. Si nous déposons en séance publique un amendement comportant le 1°, mais pas le 2° de cet amendement AS537, y serez-vous favorable ?
M. le rapporteur. Je ne me prononce pour l’instant que sur les amendements déposés.
M. Arnaud Richard. Puis-je proposer une rectification supprimant le 2° de mon amendement ? Compte tenu des remarques de notre rapporteur, nous ne pourrions que l’adopter.
M. le rapporteur. Je souhaiterais pouvoir expertiser le fait que ce soit « à l’initiative de l’employeur » que le règlement intérieur peut définir les modalités d’application du principe de neutralité religieuse. Si l’amendement, même rectifié, n’est pas retiré, j’y serai défavorable.
M. Jean-Louis Roumégas. Il paraît sage, en effet, de rejeter cet amendement, de même qu’il faut refuser la consécration d’un droit à l’expression religieuse dans l’entreprise. Les deux positions sont tout aussi risquées. On ne peut parler des « modalités d’application du principe de neutralité religieuse » alors qu’il ne s’applique pas aujourd’hui aux lieux privés. Mieux vaut en rester à la situation actuelle.
M. Jean-Patrick Gille. La proposition de M. Richard n’est pas inintéressante. Mais, s’il proposait, dans le 2°, de supprimer l’article L. 1321-3 du code du travail, c’est que cet article dispose qu’un règlement intérieur ne peut contenir de dispositions discriminantes à l’égard du salarié, du fait de ses convictions religieuses. On ne peut supprimer complètement cet article sans ouvrir une brèche considérable, mais, dans le même temps, nous devons trouver un équilibre. L’introduction du principe de neutralité est peut-être une idée à creuser – elle est en tout cas attendue par beaucoup. Mais, en attendant que la bonne formulation soit trouvée, le rapporteur a raison de proposer de retravailler sereinement l’amendement.
M. Gérard Cherpion. Cet amendement est intéressant, à condition d’en supprimer le 2°, car le règlement intérieur est en règle générale élaboré à l’initiative de l’employeur. D’autre part, il existe aujourd’hui dans certaines entreprises des salles de prière qui ont été autorisées par le règlement intérieur. Il me semble donc possible d’adopter cet amendement rectifié.
M. Hervé Morin. Cet amendement permet de donner une base légale à des initiatives qui ont été prises dans nombre d’entreprises. Ainsi, le groupe PAPREC a adopté une charte de laïcité dont tout le monde s’accorde à reconnaître qu’elle manque de fondement légal, mais l’opinion publique a salué cette initiative. Nous ne créons pas ici les conditions de l’affrontement, mais, au contraire, celles de la sérénité dans l’entreprise.
M. Arnaud Richard. Ceux de nos collègues qui considèrent que cet amendement est imparfait ont raison. Le mieux serait certainement de ne pas légiférer. Mais le problème devient de plus en plus criant. Voilà des années que nous parlons du fait religieux en droit du travail et nous savons qu’il va falloir traiter le sujet. Il n’y aura pas mort d’homme si nous ne le faisons pas dans cette loi, et peut-être la France serait-elle condamnée par la Cour européenne des droits de l’homme si nous votions mon amendement. Cependant, des entreprises pourraient avoir besoin d’utiliser un tel dispositif. Il me paraît donc sage de permettre aux chefs d’entreprise, qui ont à affronter des problèmes de ce genre et qui sont désemparés face au vide sidéral de la loi en la matière, de faire figurer les modalités d’application du principe de neutralité religieuse dans leur règlement intérieur.
Je m’en suis entretenu hier encore au ministère du travail avec les représentants patronaux. Le représentant du MEDEF, que j’ai interrogé à la fin de son intervention sur cet amendement, a répondu qu’il lui paraissait fondé de donner la possibilité aux chefs d’entreprise d’intégrer ces modalités d’application dans le règlement intérieur.
J’entends les positions des uns et des autres sur ce sujet délicat. Même s’il ne faut peut-être pas légiférer, je vous propose d’adopter la position qui me paraît la plus sage.
Mme Bérengère Poletti. Il faut de toute urgence légiférer sur ce sujet, car certaines entreprises ayant déjà décidé de modifier leur règlement intérieur, elles se trouvent dans une situation d’insécurité juridique : en cas de recours, cette décision, demandée par l’employeur et validée par les partenaires sociaux présents au sein de l’entreprise, sera annulée. Il est donc indispensable que nous assurions rapidement la possibilité d’appliquer le principe de laïcité dans l’entreprise, à l’initiative de l’employeur et après vote du comité d’entreprise.
M. Jean-Louis Costes. Nous ne pouvons pas, alors que nous travaillons sur un texte qui a la prétention de refonder les relations en entreprise, ne pas y inscrire le principe de neutralité. Il ne serait pas sérieux de renvoyer à une commission le soin d’étudier ce problème quand les incidents se multiplient dans les entreprises. Cet amendement me semble tout à fait satisfaisant, puisque, en faisant référence au règlement intérieur, il laisse la liberté, tant à l’employeur qu’aux organisations syndicales, de trouver un accord. Sans doute pourrait-il être réécrit, mais à condition de conserver le principe qu’il énonce.
M. Jean-Louis Roumégas. Le mieux est parfois l’ennemi du bien. Contrairement à la loi en vigueur, cet amendement permettrait à un employeur d’interdire le port de la croix, de la kippa ou du voile dans une entreprise. Ce débat me paraît excessif et cette disposition risque de créer plus de problèmes qu’elle n’en résoudra. Autant il était dangereux de consacrer un droit à l’expression religieuse, autant vous allez ici beaucoup trop loin et donnez trop de pouvoir à l’employeur. La loi ne prévoit pas aujourd’hui l’application du principe de neutralité religieuse dans l’entreprise : elle réserve cette application à l’école et aux lieux publics.
M. Francis Vercamer. Le projet de loi dispose que le salarié a la liberté de manifester ses convictions à condition que cela n’entrave pas le bon fonctionnement de l’entreprise. Or c’est bien le règlement intérieur qui fixe les modalités de ce fonctionnement. Il ne me semble donc pas contraire au droit européen ni au droit en vigueur de permettre au règlement intérieur de définir les modalités d’application du principe de neutralité religieuse. Il s’agit simplement d’acter dans un texte que la manifestation de convictions religieuses peut contrevenir au fonctionnement normal de l’entreprise et de conforter le chef d’entreprise au cas où un salarié se targuerait de la loi actuelle pour manifester de telles convictions. Le règlement intérieur permettra de régler les litiges potentiels.
M. Jean-Louis Costes. Monsieur Roumégas, nous demandons seulement l’application du principe de laïcité.
Mme Isabelle Le Callennec. En permettant au règlement intérieur de traiter cette question, nous apporterions de la sécurité juridique à des situations de plus en plus nombreuses. Nous venons de supprimer du projet de loi l’énoncé des soixante et un principes fondamentaux du rapport Badinter qui allait assez loin – partant du principe que la liberté religieuse primait. C’est cela qui inquiétait à la fois des chefs d’entreprise et des salariés. Si nous n’adoptons pas l’amendement d’Arnaud Richard, très pragmatique en ce qu’il fait référence au règlement intérieur, nous risquons encore de passer à côté de l’occasion d’apporter dans la loi des précisions qui sont très attendues et le débat risque de s’envenimer. Au lieu de renvoyer à cette fameuse commission d’experts le soin de traiter ce sujet récurrent, n’avons-nous pas intérêt à trancher ?
Mme Véronique Louwagie. Ne nous voilons pas la face. La question de la neutralité religieuse se pose sur le terrain dans les entreprises. Il nous faut donc l’aborder. J’ai entendu un de nos collègues qualifier ce débat d’excessif : il porte au contraire sur un sujet délicat, nous devons avoir le courage de le mener et nous avons la responsabilité de proposer des solutions. Le règlement intérieur, dont l’objet est de prendre en compte les particularités de l’entreprise en matière de relations avec le public, de métier et d’environnement, me semble l’outil adapté pour répondre aux situations susceptibles de créer des tensions dans l’entreprise. Ce serait commettre une faute que de ne pas aborder la question du principe de neutralité religieuse alors même que le débat a été ouvert parmi les Français.
M. Alain Calmette. Il s’agit bel et bien d’un débat d’actualité : des questions concrètes, pragmatiques, se posent sur le terrain, auxquelles il est de notre devoir de répondre. Mais encore faut-il évaluer l’ensemble des conséquences juridiques et pratiques de l’adoption d’un tel amendement. Si je suis d’accord avec l’esprit de cette proposition, il me semble prématuré de la voter.
M. Jean-Patrick Gille. Chacun conviendra que personne ne refuse de débattre. Nous sommes face à un amendement, introduisant un principe de neutralité religieuse, qu’il a fallu rectifier, son auteur lui-même ayant compris qu’on ne pouvait, sans créer de difficultés, supprimer un alinéa du code du travail interdisant les dispositions discriminatoires dans le règlement intérieur. Mais cet amendement me semble encore devoir faire l’objet d’une expertise plus approfondie. Si nous l’adoptons, certains employeurs pourront interdire tout signe religieux dans l’entreprise – ce qui, d’ailleurs, satisfera beaucoup de gens – à la suite de quoi des salariés objecteront que cela est contraire au droit européen. Je salue le travail d’Arnaud Richard, mais il me semble que cela ne tient pas juridiquement.
M. Jean-Louis Bricout. Il me semble que le règlement intérieur n’est obligatoire que dans les entreprises de plus de vingt salariés. En passant par ce biais pour faire appliquer le principe de neutralité religieuse, on risquerait donc de créer une différence de traitement entre les petites entreprises et les autres – à moins de rendre le règlement obligatoire dans toutes les entreprises, ce qui serait source de complexité.
M. Arnaud Richard. Je tiens à saluer la sagesse du rapporteur qui a proposé un amendement, identique au nôtre, de suppression des alinéas 4 à 73 de l’article 1er. Si nous avions eu cette discussion sur le fait religieux dans l’entreprise au regard du 6° de cet article, sans doute l’ambiance et la qualité du débat n’auraient-elles pas été les mêmes.
Très satisfait de partir sur cette base, j’entends l’argument de Jean-Patrick Gille. Il est vrai que nous proposons une évolution importante, mais cela fait plusieurs années que, en tant qu’élu de Chanteloup-les-Vignes, je réfléchis à la question de la laïcité au travail. Bien qu’imparfaite, la réponse forte que nous proposons d’apporter permettra d’appliquer le modèle de la République dans l’entreprise.
M. Gérard Sebaoun. Je vous renvoie à la lecture exacte et exhaustive du 6° proposé par Robert Badinter et ses collègues. Cet alinéa fait référence non seulement à la liberté du salarié de manifester ses convictions, y compris religieuses, mais aussi aux restrictions « justifiées par l’exercice d’autres libertés et droits fondamentaux ou par les nécessités du bon fonctionnement de l’entreprise et si elles sont proportionnées au but recherché ». Cette liberté était donc tout de même extraordinairement encadrée et cet alinéa ne faisait que rappeler le droit en vigueur.
Nous nous accordons tous à dire que nous nous exposons à un océan de difficultés si nous n’expertisons pas l’amendement d’Arnaud Richard. Lors d’une audition, le professeur Antoine Lyon-Caen, à qui je demandais si les salariés qui le souhaitaient pouvaient prier pendant les pauses qui leur étaient accordées, a répondu que personne n’était empêché de méditer. Nous ne pourrons pas empêcher un salarié de prier. Si, demain, une entreprise emploie comme salariés des moines ou des religieuses, leur interdirons-nous de porter l’habit ? On sait qu’il y a des activistes dans certaines entreprises. Légiférer à la va-vite comme nous le faisons leur donnerait l’oriflamme de la discrimination. Je vous demande donc à tous d’être extrêmement prudents.
M. le rapporteur. Ce sujet étant en effet très présent aujourd’hui dans le débat politique, il mérite que nous y réfléchissions. Mais, en levant une insécurité juridique par le biais de l’outil le plus faible dans l’échelle normative, nous prendrions un risque considérable. Une multitude de normes relevant de la loi, du droit européen et du droit international, sans parler de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, s’impose au règlement intérieur. C’est pourquoi je réitère ma proposition, qui n’est pas une fin de non-recevoir, et vous suggère, monsieur Richard, de retirer cet amendement pour que je puisse l’expertiser et vous transmettre mon analyse. À défaut, j’y serai défavorable.
M. Arnaud Richard. Je maintiens mon amendement.
La Commission rejette l’amendement AS537 rectifié.
*
* *
Chapitre Ierbis
Renforcer la lutte contre les discriminations, le harcèlement moral et sexuel et les agissements sexistes
Article 1erbis
(Art. L. 1154-1 du code du travail)
Régime de la preuve en matière de harcèlement
Cet article est issu de l’amendement AS634 présenté par Mme Coutelle. Il vise à renforcer la lutte contre le harcèlement moral et sexuel et à créer une nouvelle division dans le projet de loi accueillant ces dispositions ainsi que celles, du même auteur, relatives aux agissements sexistes.
Aux termes de l’article L. 1154-1 du code du travail relatif au harcèlement sexuel ou moral, « Lorsque survient un litige (…), le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement ». En revanche, en matière de discriminations, l’article L. 1134-1 prévoit que le salarié « présente des éléments de fait laissant supposer l’existence » d’un harcèlement.
Le régime est donc différent selon qu’il s’agisse d’un contentieux lié à une discrimination ou à un harcèlement qu’il soit moral ou sexuel. En effet, la personne doit présenter les faits dans le premier cas mais en revanche les établir dans le second. Établir les faits renvoie à une démonstration et va au-delà de la simple présentation, ce qui bien évidemment amoindrit les chances du plaignant de voir sa plainte aboutir car il est généralement très difficile d’apporter des preuves tangibles et directes dans les cas de harcèlement.
Le présent article vise donc à créer un régime commun aux discriminations et aux harcèlements afin de permettre aux plaignants d’apporter des éléments de faits constituant un faisceau de présomptions.
*
La Commission examine les amendements AS635 et AS634 de Mme Catherine Coutelle, qui peuvent faire l’objet d’une présentation commune.
Mme Catherine Coutelle, présidente de la délégation aux droits des femmes. La délégation aux droits des femmes a adopté cinq amendements relatifs au harcèlement sexuel au travail et aux agissements sexistes dans l’entreprise.
Lors d’une audition, une association de défense des salariés a attiré l’attention de la délégation aux droits des femmes sur la difficulté de faire la preuve du harcèlement sexuel au travail. Je rappelle que nous avions défini cette notion dans une loi de 2012 pour ensuite la faire figurer dans le code du travail. Cette association nous a fait remarquer que, lorsqu’une personne se considérait comme victime d’une discrimination, elle ne devait présenter, aux termes de l’article L. 1134-1 du code du travail, que des « éléments de fait laissant supposer l’existence » d’un tel acte et que c’était à l’employeur de démontrer que ces éléments n’étaient pas réunis. Lorsque, en revanche, un salarié se considère comme victime de harcèlement sexuel ou moral, il doit, selon l’article L. 1154-1 du même code, en faire la preuve, c’est-à-dire établir les faits, ce qui lui est beaucoup plus difficile. Nous voudrions donc aligner le régime probatoire du harcèlement sexuel sur celui des discriminations.
Quant à l’amendement AS635, il concerne les agissements sexistes. Lors du vote de la loi du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi, nous avons prévu dans le code du travail que « nul ne doit subir d’agissement sexiste […] ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant ». Nous n’avons cependant pas précisé à l’époque le régime de probation applicable. Or il semble là aussi très difficile de faire la preuve de tels agissements. Nous proposons donc là encore d’aligner le régime probatoire des agissements sexistes sur celui des discriminations.
M. le rapporteur. Je suis favorable à l’amendement AS634 et à un alignement des régimes probatoires. J’ai cependant une difficulté concernant l’amendement AS635. Car, lorsque l’on parle de discriminations, les faits sont là. Vous proposez une inversion de la charge de la preuve en matière d’agissements sexistes : ce serait à l’employeur de justifier qu’il n’y a pas eu d’agissements sexistes. Cela me paraît très difficile à définir. Avis défavorable.
Mme Catherine Coutelle, présidente de la délégation aux droits des femmes. Des études ont montré que les agissements sexistes au travail peuvent dégrader la santé des salariés, provoquer des arrêts de travail... Nous avons inscrit ces agissements dans le code du travail, en les définissant comme, notamment, « créant un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant ». Toutefois, le régime de la preuve rend difficile la tenue d’un procès et les salariés n’arrivent pas à faire condamner ces agissements. Il faut résoudre ce problème.
M. Hervé Morin. Nous avons voté une loi relative au harcèlement sexuel en 2012 et de nouvelles dispositions en 2015. L’encre de ces textes est à peine sèche, il n’y a pas encore la moindre jurisprudence, et voilà qu’on voudrait légiférer à nouveau ! Cela me paraît ahurissant. La situation en matière de harcèlement sexuel et d’agissements sexistes a-t-elle vraiment beaucoup changé en deux ans ? Ces textes étaient-ils vraiment bien rédigés ? N’y a-t-il pas là un dysfonctionnement de la fabrique de la loi ?
M. le rapporteur. Monsieur Morin, cet amendement ne traite pas de harcèlement sexuel, mais d’agissements sexistes – dont les dommages sont en effet démontrés. Certes, le problème est réel, madame Coutelle, et je partage votre analyse sur ce point ; mais je n’en tire pas les mêmes conclusions. Demander à l’employeur de prouver qu’il n’y a pas d’atteinte à la personne ne me paraît pas une réponse adaptée.
La Commission rejette l’amendement AS635.
Puis elle adopte l’amendement AS634.
*
* *
Article 1erter
(Art. L. 1321-2 du code du travail)
Interdiction des agissements sexistes par le règlement intérieur
Cet article est issu de l’amendement AS638 présenté par Mme Coutelle. Il prévoit le rappel obligatoire de l’interdiction de tout agissement sexiste dans le règlement intérieur.
En application de l’article L. 1321-2 du code du travail, le règlement intérieur de l’entreprise rappelle les dispositions relatives aux droits de la défense des salariés ainsi que « les dispositions relatives aux harcèlements moral et sexuel prévues par le présent code ».
L’article L. 1142-2-1 issu de la loi du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi a défini les agissements sexistes, prévoyant que : « nul ne doit subir d’agissement sexiste défini comme tout agissement lié au sexe d’une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité… ».
Le présent article a pour objet de prévoir le rappel obligatoire de l’interdiction de ces agissements dans le règlement intérieur de l’entreprise.
*
La Commission examine l’amendement AS638 de Mme Catherine Coutelle.
Mme Catherine Coutelle, présidente de la délégation aux droits des femmes. Il s’agit de prévoir un rappel obligatoire dans le règlement intérieur des entreprises des dispositions relatives au harcèlement moral ainsi qu’au harcèlement sexuel. Le droit européen va d’ailleurs dans le même sens de promotion d’une égalité de traitement des femmes et des hommes.
M. Bernard Accoyer. Comme l’exposé des motifs de l’amendement le précise lui-même, la législation réprimant le harcèlement sexuel est déjà abondante. Il n’y a pas lieu d’en rajouter.
M. le rapporteur. Je ne commenterai pas les propos de M. Accoyer.
Avis favorable à l’amendement.
Mme Isabelle Le Callennec. Quid des entreprises qui n’ont pas de règlement intérieur, c’est-à-dire celles qui comptent moins de vingt salariés ?
M. Francis Vercamer. Quand il s’agit du fait religieux, monsieur le rapporteur, vous dites que le règlement intérieur est l’outil le plus bas de la hiérarchie normative ; par contre, pour traiter d’agissements sexistes, il vous paraît adapté ! On voit bien quelle est votre échelle de valeurs.
M. Élie Aboud. La remarque de Mme Le Callenec est d’autant plus judicieuse que c’est souvent dans les TPE, peu structurées, pas assez organisées, que l’on voit ce genre de comportements. À ce niveau-là, le vide demeure.
M. le rapporteur. Monsieur Vercamer, je rappelle simplement qu’il existe, dans le cas des agissements sexistes, une base législative : c’est l’article L. 1142-2-1 du code du travail. Nous ne parlons pas ici d’une liberté, mais au contraire d’un délit ! Le sujet n’a rien à voir.
Avis favorable à l’amendement.
M. Francis Vercamer. On voit bien quelle est votre échelle de valeurs !
M. le rapporteur. Je le dis de façon quelque peu solennelle, monsieur Vercamer : une lutte doit être menée contre les agissements sexistes, et évoquer ma soi-disant échelle de valeurs comme vous le faites me paraît particulièrement déplacé.
M. Francis Vercamer. N’exagérons rien : il y a cinq minutes, le règlement intérieur, c’était le plus bas niveau de l’échelle normative, mais, pour les agissements sexistes, il est parfaitement adapté. Et c’est moi qui dévaloriserais les femmes ? Soyons sérieux !
M. le rapporteur. Je viens de vous dire, monsieur Vercamer, que les agissements sexistes étaient réprimés par la loi – ce qui n’est pas le cas du sujet dont nous traitions précédemment. Vos propos sont honteux !
Mme Catherine Coutelle, présidente de la délégation aux droits des femmes. Je ne comprends pas bien vos propos, monsieur Vercamer : harcèlement sexuel et agissements sexistes figurent dans la loi ; ils se déclinent ensuite dans le règlement intérieur des entreprises.
La Commission adopte l’amendement.
*
* *
Article 1erquater
(Art. L. 4121-2 du code du travail)
Prise en compte des agissements sexistes dans les actions de prévention
Cet article est issu de l’amendement AS637 présenté par Mme Coutelle. Il prévoit les agissements sexistes doivent être pris en compte dans les actions de prévention en matière de santé et de sécurité.
En application de l’article L. 4121-2 du code du travail, les employeurs doivent mettre en œuvre des actions de prévention fondées sur neuf principes généraux, parmi lesquels : « planifier la prévention en y intégrant… l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel ».
Or, L’article L. 1142-2-1 issu de la loi du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi a défini les agissements sexistes, prévoyant que : « nul ne doit subir d’agissement sexiste défini comme tout agissement lié au sexe d’une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité… ».
Dans la mesure où les agissements sexistes peuvent avoir des répercussions sur la santé des salariés, le présent article a pour objet de les prendre en compte au même titre que le harcèlement dans les actions de prévention en matière de santé et de sécurité des salariés.
*
La Commission examine l’amendement AS637 de Mme Catherine Coutelle.
L’employeur est aujourd’hui tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de ses salariés. Dans la logique des amendements précédents, l’amendement AS637 vise à prévoir que la prévention des agissements sexistes est incluse dans ces actions.
Ces agissements sont nombreux, des études le montrent, et pas seulement dans les TPE, mais dans l’ensemble des entreprises ; or la santé des femmes victimes de ces agissements peut être gravement atteinte. Certaines sont mêmes amenées à démissionner. J’ai recueilli des témoignages qui montrent la gravité de ces faits.
M. le rapporteur. Je vous suggère de retirer cet amendement : il me paraît faire double emploi avec le suivant, AS636, qui renforce les missions du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), et qui me paraît préférable.
Mme Catherine Coutelle, présidente de la délégation aux droits des femmes. Je vous fais confiance, monsieur le rapporteur ; il me semblait qu’il s’agissait de deux étapes quelque peu différentes : le CHSCT doit s’impliquer dans la prévention des agissements sexistes – ce qui vaut la peine d’être précisé, car rien ne dit que tous les représentants du personnel sont sensibilisés à ces problèmes –, mais l’employeur met ensuite les mesures en œuvre.
Mme Jacqueline Fraysse. Je voudrais insister sur l’importance des problèmes soulevés par Mme Coutelle. Il y a là des problèmes de santé, sans aucun doute, mais aussi tout simplement de respect de la personne, quelle qu’elle soit.
Mme Isabelle Le Callennec. Toutes les entreprises n’ont pas de CHSCT.
Mme Catherine Coutelle, présidente de la délégation aux droits des femmes. D’où la pertinence de cet amendement, peut-être plus protecteur de tous les salariés.
M. le rapporteur. Ces arguments sont convaincants : avis favorable.
La Commission adopte l’amendement.
*
* *
Article 1erquinquies
(Art. L. 4612-3 du code du travail)
Extension de la compétence des CHSCT aux agissements sexistes
Cet article est issu de l’amendement AS636 présenté par Mme Coutelle. Il vise à élargir les compétences des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) afin que ceux-ci participent à la prévention des agissements sexistes.
En application de l’article L. 4612-3 du code du travail, le CHSCT « peut proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral et du harcèlement sexuel ».
Par ailleurs, l’article L. 1142-2-1 issu de la loi du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi a défini les agissements sexistes, prévoyant que : « nul ne doit subir d’agissement sexiste défini comme tout agissement lié au sexe d’une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité… ».
Le présent article a pour objet d’élargir les compétences du CHSCT pour lui permettre de mener des actions de prévention des agissements sexistes.
*
La Commission examine l’amendement AS636 de Mme Catherine Coutelle.
Suivant l’avis favorable du rapporteur, elle adopte l’amendement.
*
* *
La Commission examine, en discussion commune, les amendements AS180 de M. Élie Aboud et AS14 de M. Jean-Charles Taugourdeau.
M. Élie Aboud. Il s’agit de permettre aux entreprises de prendre toutes les mesures nécessaires pour ajuster par accord collectif les conditions de travail à leurs besoins spécifiques, en donnant ainsi la parole aux salariés d’une entreprise, lesquels auraient ainsi directement prise sur leurs conditions de travail.
M. Christophe Sirugue, rapporteur. Ces deux amendements proposent en réalité de généraliser l’accord d’entreprise, au détriment des accords de branche. Cette inversion ne nous paraît pas opportune. Avis défavorable.
La Commission rejette successivement les amendements AS180 et AS14.
Puis elle est saisie de l’amendement AS412 de Mme Jacqueline Fraysse.
Mme Jacqueline Fraysse. Nous souhaitons avec cet amendement rétablir le principe de faveur en matière de négociations collectives, un principe fondamental sur lequel s’est construit notre droit du travail. En vertu de ce principe, un accord d’entreprise ne peut comporter que des dispositions plus favorables aux salariés que celles inscrites dans l’accord de branche, lui-même ne pouvant contenir que des dispositions plus favorables que celles inscrites dans la loi.
Plusieurs interventions législatives ont progressivement remis en cause ce principe, notamment en ce qui concerne le temps de travail – je pense à la loi du 4 mai 2004 ainsi qu’à celle du 20 août 2008 qui fait primer l’accord d’entreprise en matière de temps de travail.
Loin de simplifier le code du travail et de protéger les salariés, le développement de la négociation dérogatoire a, au contraire, complexifié ce droit en même temps qu’il revenait sur des acquis sociaux essentiels, la remise en cause la plus significative étant l’assouplissement de la durée légale des trente-cinq heures.
Avec ce projet de loi, il nous est proposé de franchir une étape supplémentaire en ce sens, puisqu’il s’agit de consacrer cette négociation dérogatoire, ce que nous refusons.
J’ajoute que cet amendement prévoit également la suppression de l’article L. 3122-6 du code du travail, issu de la loi Warsmann de mars 2012, qui permet d’imposer par accord d’entreprise l’annualisation de la durée du travail aux salariés. Cette annualisation constitue un bouleversement des conditions de travail et devrait, à ce titre, être considérée comme une modification essentielle du contrat de travail et, de ce fait, nécessiter pour sa mise en place l’accord préalable du salarié.
M. le rapporteur. Vous souhaitez revenir à l’état du droit antérieur à 2004 et interdire à un accord d’entreprise de déroger aux dispositions d’un accord de branche, sauf si ces dispositions sont plus favorables. Si nous devions suivre votre proposition, nous nous interdirions toute possibilité d’évoluer à l’échelon de proximité, ce qui ne me semble pas correspondre à l’esprit du texte. Avis défavorable.
La Commission rejette l’amendement.
*
* *
Chapitre II
Une nouvelle architecture des règles en matière de durée du travail et de congés
Article 2
(Art. L. 1225-9, L. 1263-3, L. 1271-5, L. 1272-4, L. 1273-3, L. 1273-5, L. 1274-2, L. 1522-8, L. 2323-3, L. 2323-17, L. 3111-1 et L. 3111-2, L. 3111-3 [nouveau], L. 3121-1 à L. 3121-48, L. 3121-49 à L. 3121-67 [nouveaux], L. 3122-1 à L. 3122-47, L. 3123-1 à L. 3123-37, L. 3123-38 [nouveau], L. 3131-1 et L. 3131-2, L. 3131-3 [nouveau], L. 3132-28, L. 3133-1 à L. 3133-12, L. 3134-1, L. 3134-16 [nouveau], L. 3141-1 à L. 3141-31, L. 3141-32 et L. 3141-33 [nouveau], L. 3164-4, L. 3171-1, L. 3253-23, L. 3422-1, L. 5125-1, L. 5132-6, L. 5132-7, L. 5134-60, L. 5134-63, L. 5134-126, L. 5221-7, L. 5544-10, L. 6222-25, L. 6325-10, L. 6331-35, L. 6343-2, L. 7122-24, L. 7213-1 et L. 7221-2 du code du travail ; art. L. 431-3, L. 432-2 et L. 433-1 du code de l’action sociale et des familles ; art. 39 du code général des impôts ; art. L. 191-2 du code minier ; art. L. 712-4, L. 712-6, L. 713-2, L. 713-3 à L. 713-5, L. 713-13, L. 713-19, L. 714-5, L. 714-6, L. 714-8 et L. 763-3 du code rural et de la pêche maritime ; art. L. 133-5, L. 133-5-1, L. 241-13, L. 241-3-1, L. 241-18, L. 242-8, L. 242-9 et L. 243-1-3 du code de la sécurité sociale ; art. L. 1321-6, L. 1321-7, L. 1321-10, L. 1821-8-1, L. 3312-1, L. 3312-3, L. 3313-2, L. 4511-1, L. 5544-1, L. 5544-3, L. 5544 8, L. 5544-10, L. 6525-1, L. 6525-3 et L. 6525-5 du code des transports ;
art. 43 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011)
Durée du travail
Cet article applique aux dispositions du livre Ier de la troisième partie du code du travail, relatif à la durée du travail, aux repos et aux congés, la nouvelle architecture préconisée par le rapport de M. Jean-Denis Combrexelle remis au Premier ministre le 9 septembre 2015. Il s’agit d’articuler les normes autour de trois niveaux : en premier lieu, les règles qui relèvent de l’ordre public et qui s’imposent de manière absolue au niveau conventionnel ; en deuxième lieu, les règles renvoyées à la négociation collective ; et enfin, en dernier lieu, les dispositions supplétives, applicables à défaut d’accord. Il s’agit par ce biais de donner plus d’espace à la négociation collective.
Sur le fond, cet article entend également déterminer le niveau le plus approprié de fixation de la norme. Le rapport de M. Jean-Denis Combrexelle préconise en effet l’application d’un principe de subsidiarité, qui consiste à privilégier autant que faire se peut l’accord d’entreprise, pour redonner au niveau de la branche son rôle traditionnel de régulation sociale et économique. Il s’agit bien de mettre le dialogue social en pleine capacité de régulation, dans le respect d’un socle législatif de principes relevant de l’ordre public.
I. UNE TRADUCTION DE LA PHILOSOPHIE GÉNÉRALE DU PROJET DE LOI POUR LES DISPOSITIONS RELATIVES À LA DURÉE DU TRAVAIL ET AUX CONGÉS PAYÉS
A. LA DURÉE DU TRAVAIL, « VITRINE » DE L’AXE CENTRAL DU PROJET DE LOI : DONNER PLUS DE PLACE À LA NÉGOCIATION COLLECTIVE
Cet article traduit, dans le code du travail, les préconisations du rapport de M. Jean-Denis Combrexelle, en faveur d’une nouvelle architecture des normes du droit du travail qui passe par le renforcement du rôle donné à la négociation collective. En effet, comme l’indique ce rapport, « à la loi de fixer les grands principes du travail et de l’emploi, aux accords de branche de fixer l’ordre public conventionnel et aux accords d’entreprise de définir en priorité le droit conventionnel du travail sur tous les sujets qui ne relèvent pas de l’ordre public ».
La longueur de cet article tient essentiellement à ce choix d’une nouvelle articulation des normes, qui se voit appliquée à la quasi-totalité des dispositions du livre premier de la troisième partie du code du travail, qui couvrent les règles applicables à la durée du travail, au repos et aux congés.
Sont ainsi réorganisées autour du triptyque : ordre public ; champ de la négociation collective ; dispositions supplétives, l’ensemble des dispositions suivantes :
– celles qui concernent le travail effectif, les astreintes et le régime des équivalences ;
– celles relatives à la durée légale et aux heures supplémentaires ;
– les règles fixant les durées maximales du travail ;
– les conventions de forfait ;
– les mesures de répartition et d’aménagement des horaires et les règles relatives au travail de nuit ;
– les règles relatives au travail à temps partiel et au travail intermittent ;
– les dispositions sur le repos quotidien et les jours fériés ;
– et enfin, les règles relatives aux congés payés.
Sont exclues de cette réorganisation les dispositions relatives au repos hebdomadaire qui ont été amplement et récemment revues dans le cadre de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques.
Pour l’ensemble des mesures précitées, le présent article propose une refonte de leur architecture : sont ainsi constitutives de l’ordre public la plupart des règles fixant un cadre global aux différentes dispositions concernées. Le champ de la négociation collective couvre l’ensemble des règles auxquelles il est ouvert une possibilité d’adaptation par voie conventionnelle, dans le respect bien entendu des dispositions d’ordre public. Enfin, sont renvoyées au rang des dispositions supplétives la majorité des règles fixant des minima, des planchers ou encore des délais. Celles-ci n’auront plus vocation à s’appliquer qu’à défaut d’accord collectif.
Notons toutefois que dans certains cas, le champ de la négociation collective se voit tout de même contraint par des règles minimales. C’est le cas par exemple en matière d’heures supplémentaires, puisque les accords collectifs conclus dans ce domaine ne pourront pas fixer un taux de majoration inférieur à 10 % ou encore prévoir une contrepartie obligatoire en repos des heures accomplies au-delà du contingent annuel de moins de 50 % pour les entreprises d’au moins 20 salariés et de moins de 100 % pour les entreprises de plus de 20 salariés. C’est également le cas pour la durée quotidienne maximale de travail, pour laquelle les règles négociées par voie d’accord ne peuvent excéder le plafond de douze heures de travail quotidien.
Notons également que l’ensemble des dispositions supplétives correspondent à des règles légales aujourd’hui applicables et sont donc recodifiées à droit constant.
Le véritable enjeu de cette nouvelle architecture réside dans la répartition opérée entre les mesures d’ordre public et les dispositions supplétives : où doit-on placer le curseur pour laisser à la fois plus de marge de manœuvre à la négociation collective, sans sombrer dans une situation où l’hétérogénéité des règles serait totale, laissant libre cours aux pratiques de dumping social et à une politique du moins-disant sur le plan de la protection des travailleurs ?
Dans la continuité des lois du 4 mai 2004 et du 20 août 2008, le projet de loi propose d’aller au bout de la démarche de renforcement du niveau de l’entreprise, au sein de la hiérarchie des normes conventionnelles.
Rappelons que la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et du dialogue social a permis dans certains cas à l’accord d’entreprise de déroger aux dispositions d’un accord de branche dans un sens moins favorable aux salariés, à moins que ce dernier ne l’ait expressément exclu. Cette possibilité était en tout état de cause exclue en matière de salaires minima, de classifications, de garanties collectives et enfin, en matière de mutualisation des fonds de la formation professionnelle.
La loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail est allée plus loin en faisant primer l’accord d’entreprise sur l’accord de branche même dans l’hypothèse où ce dernier l’exclurait, dans les six catégories suivantes relatives au temps de travail :
– fixation du contingent d’heures supplémentaires et conditions de son dépassement ;
– mise en place d’un repos compensateur de remplacement et conditions de prise du repos ;
– conventions de forfait en heures ou en jours sur l’année ;
– aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année ;
– mise en place d’un compte épargne-temps ;
– et, enfin, choix de la date de la journée de solidarité.
Le projet de loi souhaite achever ce processus de renforcement du rôle de la négociation collective en entreprise, en accordant désormais un primat généralisé à ce dernier sur l’accord de branche, y compris pour fixer des règles moins favorables aux salariés, pour l’ensemble des règles applicables à la durée du travail, aux repos et aux congés payés. Cette primauté donnée à l’accord d’entreprise aurait donc vocation à s’appliquer désormais :
– à la rémunération spécifique possible des temps de pause et de restauration ;
– à l’assimilation des temps d’habillage ou de déshabillage à du temps de travail effectif ou à la fixation de contreparties à ces opérations ;
– à la fixation de contreparties aux temps de trajets inhabituels ;
– à la mise en place des astreintes ;
– à la fixation de temps de pause supérieurs à vingt minutes toutes les six heures ;
– au dépassement de la durée quotidienne maximale de douze heures ;
– au dépassement de la durée hebdomadaire maximale de travail, dans la limite de 46 heures sur une période de douze semaines ;
– à la fixation du taux de majoration des heures supplémentaires ;
– aux modalités de report d’heures en cas d’horaires individualisés et de récupération des heures perdues ;
– au recours au travail de nuit, à la dérogation à la définition légale de la période de nuit, et au dépassement de la durée maximale de travail du travailleur de nuit ;
– à la mise en place d’horaires à temps partiel, à la détermination du contingent d’heures complémentaires et aux modalités de modification de la répartition des horaires des salariés à temps partiel ;
– à la mise en place du travail intermittent ;
– au dépassement de la durée minimale de repos quotidien ;
– à la définition des jours fériés chômés ;
– et à la mise en œuvre des congés payés dans l’entreprise : fixation de la période de référence pour l’acquisition des congés, majoration en raison de l’âge ou de l’ancienneté, fixation de la période de prise des congés, fixation de l’ordre des départs, ainsi que des règles de fractionnement et de report des congés.
On notera toutefois que dans quelques domaines, le texte proposé maintient la primauté donnée à l’accord de branche : c’est le cas en matière de temps partiel, pour la fixation d’une durée minimale de travail inférieure au socle légal de 24 heures, pour la détermination du taux de majoration des heures complémentaires, pour la mise en place de compléments d’heures par avenant au contrat de travail, ainsi que pour les modalités de regroupement des horaires des salariés à temps partiel. Dans chacun de ces domaines, la loi prévoit aujourd’hui que ces modalités relèvent d’un accord de branche étendu. Le texte proposé maintient ce niveau de négociation, à l’exclusion de tout autre.
C’est le cas aussi pour la mise en place d’un régime d’équivalences, pour laquelle il est aujourd’hui prévu qu’elle relève d’une convention ou d’un accord de branche, validé par un décret et, à défaut d’accord de branche, d’un décret en Conseil d’État : le présent article propose de maintenir le niveau de négociation de la branche, en prévoyant qu’un régime d’équivalences peut être mis en place par un accord de branche étendu, celui-ci n’ayant toutefois plus besoin d’être validé par décret. À défaut d’un tel accord, un décret en Conseil d’État peut le prévoir.
C. LA PRISE EN COMPTE DES BESOINS SPÉCIFIQUES DES ENTREPRISES EN MATIÈRE DE MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Le troisième objectif du présent article est de mieux répondre aux besoins des entreprises – petites et grandes – en matière d’aménagement du temps de travail. Il s’agit d’une part de l’allongement, jusqu’à trois ans, de la période de référence pour la mise en place d’un accord d’aménagement du temps de travail, et d’autre part, d’un allongement de cette même période de référence à neuf semaines pour les entreprises de moins de 50 salariés, dans le cadre du dispositif spécifique d’aménagement du temps de travail par la voie unilatérale.
Ÿ La loi du 20 août 2008 déjà citée a unifié les dispositifs d’aménagement du temps de travail au sein d’un outil unique d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année. Ce dispositif est mis en place par accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par accord de branche. On notera que la primauté de l’accord d’entreprise sur l’accord de branche existe donc déjà sur cette thématique.
Si ce dispositif est relativement souple, il ne répond pas complètement aux besoins de certaines entreprises : comme l’indique l’étude d’impact, certaines « entreprises industrielles dont l’activité porte par nature sur des projets pluriannuels (construction aéronautique, navale, automobile, transport, etc.) » ou encore « certaines entreprises du secteur tertiaire qui remportent un marché » et bénéficient par ce biais d’une visibilité accrue, peuvent avoir besoin d’une capacité d’organiser la durée du travail sur une période excédant un an.
Pour répondre à cette problématique spécifique, le présent article propose de porter jusqu’à trois ans la période de référence qui sert de socle à l’aménagement négocié du temps de travail, tout en réservant la possibilité d’aller au-delà d’un an au seul accord de branche.
Ÿ Il existe aujourd’hui un dispositif permettant d’aménager le temps de travail de manière unilatérale sur une durée pouvant aller jusqu’à quatre semaines. Cet outil, prévu au dernier alinéa de l’article L. 3122-2 dans sa rédaction actuelle, est aménagé par décret (articles D. 3122-7-1 à D. 3122-7-3). Il permet à toute entreprise non couverte par un accord d’aménagement du temps de travail, de procéder à une telle modulation sur une période de quatre semaines au maximum.
Plusieurs conditions sont fixées à ce dispositif d’aménagement du temps de travail : en premier lieu, les heures effectuées au-delà de 39 heures par semaine sont en tout état de cause considérées comme des heures supplémentaires rémunérées à la fin du mois, de même que les heures effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires calculées sur la période de référence, déduction faite le cas échéant des heures supplémentaires comptabilisées au titre du dépassement de la durée hebdomadaire. Il fixe également à sept jours ouvrés au moins le délai de prévenance des éventuels changements d’horaires des salariés. Il prévoit enfin le lissage de la rémunération des salariés, en précisant qu’elle est indépendante de l’horaire réel et est calculée sur la base de 35 heures hebdomadaires (article D. 3122-7-2).
Le présent article propose de porter à neuf semaines la période de référence pour l’aménagement du temps de travail par voie unilatérale pour les entreprises de moins de 50 salariés. La période de référence de quatre semaines demeure pour les entreprises de plus de 50 salariés.
Il s’agit là de répondre à la problématique spécifique des petites entreprises, non dotées de délégués syndicaux, et dans lesquelles il est donc concrètement impossible de négocier un accord d’entreprise d’aménagement du temps de travail. Ces petites entreprises sont ainsi soumises à d’éventuelles dispositions en matière d’aménagement du temps de travail négociées au niveau de la branche dont elles relèvent, celles-ci n’étant le plus souvent pas adaptées aux caractéristiques propres des petites entreprises. Ces dernières se trouvent donc souvent handicapées par rapport aux autres entreprises et privées d’un instrument de souplesse qui leur serait pourtant d’un grand secours. Le dispositif proposé vise à lever cet obstacle.
Les quelque cinquante-six pages de dispositif juridique que présente cet article font l’objet de plus substantiels commentaires ci-dessous.
Le I modifie tout d’abord le champ d’application du livre Ier de la troisième partie du code du travail, relatif à la durée du travail, aux repos et aux congés. L’article L. 3111-2 exclut du champ d’application de ces dispositions les cadres dirigeants. Son deuxième alinéa définit plus précisément ce que recouvre cette catégorie : « sont [ainsi] considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement ».
Le I propose de préciser que les cadres concernés sont bien ceux qui participent à la direction de l’entreprise. Il s’agit de consacrer au plan législatif une définition donnée de manière constante par la jurisprudence. En effet, saisi dans le cadre de contentieux relatifs à l’application des règles relatives à la durée du travail – et en particulier au paiement des heures supplémentaires –, le juge a extrait des trois critères légaux un critère de finalité, celui de la participation à la direction de l’entreprise. Dans un arrêt du 31 janvier 2012, la chambre sociale de la Cour de cassation a ainsi refusé de reconnaître le statut de cadre dirigeant à un cadre classé au plus haut niveau de coefficient de la convention collective applicable, qui disposait d’une véritable autonomie dans l’organisation de son travail et avait de hautes responsabilités, mais qui ne participait pas à la direction de l’entreprise. Cette position de principe a été confirmée par un arrêt du 26 novembre 2013, et plus récemment encore, par un arrêt du 2 juillet 2014, dans lequel le juge a considéré que les trois critères cumulatifs légaux impliquaient que seuls les cadres participant à la direction de l’entreprise relèvent de la catégorie des cadres dirigeants : en l’espèce, un cadre qui a la responsabilité d’une agence, dispose de toute son autonomie dans l’organisation de son emploi du temps, et perçoit la rémunération la plus élevée de tous les salariés de deux agences, ne peut être pour ces seules raisons reconnu comme étant un cadre dirigeant, s’il ne participe pas à la direction de l’entreprise.
Il s’agit donc simplement d’entériner la jurisprudence, en reprenant ce critère essentiel qu’elle a dégagé, qui a des conséquences importantes : si la qualification de cadre dirigeant n’est pas reconnue à un salarié, celui-ci peut obtenir le paiement des heures supplémentaires.
Le II insère un nouvel article L. 3111-3 dans le titre relatif au champ d’application des dispositions relatives à la durée du travail, aux repos et aux congés, qui prévoit que celles-ci définissent les règles d’ordre public, le champ de la négociation collective et les règles supplétives applicables en l’absence d’accord. Ne sont pas concernées par cette nouvelle architecture le chapitre II du titre III, relatif au repos hebdomadaire, et les titres VI et VII, respectivement relatifs aux jeunes travailleurs et au contrôle de la durée du travail et des repos.
La nouvelle architecture des normes préconisée par le rapport issu des travaux menés par M. Jean-Denis Combrexelle sous l’égide de France Stratégie et remis au Premier Ministre le 9 septembre 2015 est appliquée aux autres dispositions de ce livre, à savoir à la durée du travail et à la répartition et à l’aménagement des horaires (titre II), aux repos et aux jours fériés (titre III) à l’exclusion donc des règles encadrant le repos hebdomadaire, aux congés payés et aux autres congés (titre IV) – en partie dans le présent article et pour le reste, au sein de l’article 3 du projet de loi, et au compte épargne-temps (titre V) dans le cadre de l’article 4 du projet de loi.
Ÿ Les dispositions relatives au temps de travail effectif font l’objet des articles L. 3121-1 à L. 3121-4 dans leur rédaction actuelle : elles définissent le temps de travail effectif et traitent du statut des différents moments qui scandent le temps de travail : temps de pause, temps de restauration, temps d’habillage et de déshabillage et temps de trajet.
Dans le droit actuel, les temps de pause et de restauration sont par défaut considérés comme du temps de travail effectif (article L. 3121-2) ; les temps d’habillage et de déshabillage ne relèvent pas, par défaut, du temps de travail effectif, mais font l’objet d’une contrepartie financière ou sous forme de repos (article L. 3121-3) ; enfin, le temps de déplacement professionnel n’est pas considéré comme du temps de travail. S’il dépasse le temps normal de trajet, il fait l’objet d’une contrepartie soit financière, soit sous forme de repos et n’entraîne pas de perte de salaire.
La loi laisse un champ à la négociation collective. Ainsi :
– une convention ou un accord collectif de travail ou, à défaut, le contrat de travail peut prévoir la rémunération spécifique des temps de pause et de restauration ;
– une convention ou un accord collectif de travail ou, à défaut, le contrat de travail, prévoit en revanche obligatoirement les contreparties aux opérations d’habillage et de déshabillage, sauf si le temps qui leur est consacré est par ailleurs considéré comme du temps de travail effectif ;
– enfin, une convention ou un accord collectif de travail ou, à défaut d’accord, une décision unilatérale de l’employeur prise après consultation du comité d’entreprise ou des délégués du personnel, s’ils existent, prévoit obligatoirement les contreparties au temps de trajet inhabituel.
Ÿ Le présent article revoit l’architecture de la sous-section consacrée au travail effectif, en l’organisant autour du triptyque : ordre public ; champ de la négociation collective ; dispositions supplétives, au sein des articles L. 3121-1 à L. 3121-7 nouvellement rédigés.
Si le champ de la négociation collective reste inchangé, l’accord d’entreprise ou d’établissement doit désormais primer sur l’accord de branche pour prévoir, le cas échéant, une rémunération des temps de pause et de restauration, et pour prévoir obligatoirement les contreparties aux temps d’habillage et de déshabillage et aux temps de déplacement professionnel qui dépassent le temps normal de trajet (articles L. 3121-5 et L. 3121-6 dans leur nouvelle rédaction).
Enfin, l’article L. 3121-7 dans sa nouvelle rédaction énonce les dispositions supplétives, applicables en l’absence d’accord : dans ce cas, le contrat de travail peut fixer la rémunération des temps de restauration et de pause. En outre, il prévoit obligatoirement d’accorder des contreparties aux temps d’habillage et de déshabillage ou d’assimiler ces temps à du temps de travail effectif. Enfin, les contreparties – toujours à défaut d’accord – aux temps de trajet dépassant le temps de trajet habituel sont obligatoirement déterminées par l’employeur après consultation du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
Aucune modification de fond n’affecte donc les règles encadrant ces différents temps, leur rémunération ou les contreparties auxquelles ils peuvent donner lieu, en dehors de la primauté désormais donnée à l’accord d’entreprise sur l’accord de branche, ce dernier ne s’appliquant plus qu’à défaut d’accord conclu au niveau de l’entreprise ou de l’établissement.
Ÿ Le dispositif actuel des astreintes est prévu aux articles L. 3121-5 à L. 3121-8 : il définit en premier lieu l’astreinte comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au sein de l’entreprise. La durée de l’intervention est considérée comme du temps de travail effectif. Exception faite de la durée d’intervention, la période d’astreinte est prise en compte pour le calcul des durées minimales de repos quotidien et de repos hebdomadaire. En l’occurrence, si une intervention a lieu pendant l’astreinte, le repos quotidien ou hebdomadaire doit être donné intégralement à compter de la fin de l’intervention sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement avant le début de celle-ci, de la durée minimale de repos continue (11 heures pour le repos quotidien, 35 heures pour le repos hebdomadaire).
L’article L. 3121-7 dans sa rédaction actuelle prévoit que les astreintes sont mises en place par convention ou accord collectif étendu, d’entreprise ou d’établissement, qui doit fixer leur mode d’organisation et la compensation, financière ou sous forme de repos, à laquelle elles donnent lieu.
À défaut d’accord, ces modalités sont fixées par l’employeur après information et consultation du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s’ils existent, et après information de l’inspecteur du travail.
L’employeur est tenu de porter à la connaissance de chaque salarié la programmation individuelle de ses astreintes quinze jours à l’avance, sauf en cas de circonstances exceptionnelles, auquel cas le salarié doit avoir été averti au moins un jour franc à l’avance.
Ÿ Le présent article procède à la réécriture de la sous-section 2 relative aux astreintes, et la réorganise autour de la nouvelle architecture en trois niveaux de règles, autour des articles L. 3121-8 à L. 3121-11.
Le texte commence par modifier la définition des astreintes sur un point : alors qu’elles supposaient jusqu’alors pour le salarié de demeurer à domicile ou à proximité de ce dernier, il est proposé de prévoir que le salarié est simplement absent de son lieu de travail (article L. 3121-8 dans sa nouvelle rédaction).
Le principe de la contrepartie aux astreintes reste d’ordre public. Toutefois, la programmation individuelle des périodes d’astreinte doit faire l’objet d’une information des salariés concernés « dans un délai raisonnable », et non plus comme c’est le cas pour l’heure quinze jours à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles où ce délai de prévenance peut être réduit à un jour franc.
Le texte renvoie à la négociation collective pour fixer le mode d’organisation des astreintes, les modalités d’information des salariés et la compensation sous forme financière ou sous forme de repos à laquelle elles donnent lieu. Par rapport au droit existant, on constate donc deux modifications :
– Tout d’abord, la priorité est donnée à l’accord d’entreprise ou d’établissement sur l’accord de branche, qui devient donc supplétif et n’aura vocation à s’appliquer qu’en l’absence d’accord collectif de niveau inférieur.
– Ensuite, si les modalités d’organisation des astreintes et leur compensation sont déjà du ressort de la négociation collective, le seront désormais aussi les modalités d’information des salariés.
Ce n’est qu’à défaut d’accord collectif que, comme aujourd’hui, le mode d’organisation des astreintes et leur compensation sont fixés par décision unilatérale de l’employeur après avis du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s’ils existent et après information de l’inspecteur du travail. Les modalités d’information des salariés et les délais de prévenance en la matière doivent, en l’absence d’accord, être prévus par décret en Conseil d’État.
Le régime d’équivalence, prévu à l’article L. 3121-9 dans sa rédaction actuelle, peut être mis en place pour des professions et des emplois déterminés comportant des périodes d’inaction. Une telle durée du travail équivalente à la durée légale peut être instituée par décret pris après conclusion d’une convention ou d’un accord de branche. À défaut, ce régime peut être mis en place par décret en Conseil d’État.
Le présent article réaménage les dispositions relatives au régime d’équivalence au sein des articles L. 3121-12 à L. 3121-14, sans modification substantielle de fond.
Deux changements affectent néanmoins le dispositif : d’une part, ce régime sera désormais mis en place par une convention ou un accord de branche étendu, sans qu’il soit nécessaire de l’avaliser par décret ; d’autre part, le texte précise que l’accord en question doit notamment déterminer la rémunération des périodes d’inaction.
À défaut d’accord de branche, le régime peut toujours être institué par décret en Conseil d’État (article L. 3121-14 dans sa nouvelle rédaction).
Les durées maximales de travail font l’objet des articles L. 3121-33 à L. 3121-37 dans leur rédaction actuelle. Comme pour l’ensemble des dispositions relatives à la durée du travail, le présent article revoit leur architecture pour les réorganiser sous la forme du triptyque : mesures d’ordre public; champ de la négociation collective; dispositions supplétives.
En la matière, la nouvelle architecture ne s’applique pas pleinement. La règle selon laquelle toutes les six heures, le salarié a droit à au moins vingt minutes de pause est réaffirmée comme une règle d’ordre public (article L. 3121-15 dans sa nouvelle rédaction). La possibilité pour des dispositions conventionnelles de fixer un temps de pause supérieur est renvoyée dans un paragraphe isolé, consacré au champ de la négociation collective : l’article L. 3121-16 dans sa nouvelle rédaction prévoit en outre désormais de donner la priorité à l’accord d’entreprise ou d’établissement sur l’accord de branche en la matière. Il n’existe pas de dispositions supplétives.
Ÿ L’article L. 3121-34 dans sa rédaction actuelle fixe la durée maximale quotidienne de travail à 10 heures. Aujourd’hui, les seules dérogations sont déterminées par décret.
En effet, les articles D. 3121-15 à D. 3121-19 aménagent les conditions de dérogation à la durée maximale de douze heures. Elles sont de trois ordres :
– Une dérogation peut être accordée par l’inspection du travail en cas de surcroît temporaire d’activité (travaux devant être exécutés dans un délai déterminé en raison de leur nature, des charges imposées à l’entreprise ou des engagements de celle-ci) ;
– Elle peut être initiée par l’employeur sous sa propre responsabilité en cas d’urgence, sous réserve que la régularisation de sa demande de dérogation auprès de l’inspection du travail intervienne dans les plus brefs délais ;
– Enfin, elle peut être initiée par accord de branche étendu ou par accord d’entreprise ou d’établissement, dans la limite de douze heures.
L’article L. 3121-17 dans sa nouvelle rédaction pose la durée de dix heures comme étant d’ordre public, en ménageant toutefois la possibilité d’y déroger en cas d’autorisation accordée par la Direccte ou en cas d’urgence. Dans les deux cas, les conditions de ces dérogations sont renvoyées au décret.
Conformément au droit existant, aujourd’hui prévu au niveau réglementaire, le projet de loi propose qu’il soit possible de déroger à la durée maximale de dix heures par accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par accord de branche, « en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise », dans la limite de douze heures (article L. 3121-18 dans sa nouvelle rédaction). Si le renvoi à la négociation collective existe donc bien aujourd’hui, il sera désormais possible de faire prévaloir la durée fixée par accord d’entreprise sur celle par accord de branche.
Le rapporteur rappelle donc que le plafond de douze heures n’est en réalité applicable qu’aux dérogations à la durée maximale quotidienne de travail prévues par accord collectif. Les deux autres modalités ne sont pas aujourd’hui plafonnées, ce qui s’explique aisément : en cas d’urgence, pour la réalisation de certains travaux spécifiques, il est légitime que ce plafond ne trouve pas à s’appliquer, dans la mesure où il s’agit d’une situation temporaire, liée à un surcroît d’activité pendant une période déterminée.
À l’instar du temps de pause, il n’est pas prévu de dispositions supplétives dans ce domaine.
Ÿ Le droit existant prévoit que la durée hebdomadaire maximale de travail est de 48 heures, cette durée ne pouvant excéder 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives (articles L. 3121-35 et L. 3121-36). Aujourd’hui, les seules dérogations à ces règles sont les suivantes :
– pour certaines entreprises qui y ont été dûment autorisées par les DIRECCTE, il est possible de dépasser le plafond de 48 heures pour une période limitée, en cas de circonstances exceptionnelles, dans la limite de 60 heures par semaine. L’article R. 3121-23 précise que ces circonstances exceptionnelles doivent entraîner un « surcroît extraordinaire d’activité » ;
– un décret pris après conclusion d’une convention ou d’un accord collectif de branche peut permettre de dépasser la durée maximale de 44 heures sur 12 semaines, à condition de ne pas aller au-delà de 46 heures sur 12 semaines. Cette dérogation est pour l’heure très peu utilisée : d’après les informations transmises au rapporteur, il n’a ainsi pas été possible de trouver trace de décret entérinant les stipulations d’un accord de branche qui prévoirait la possibilité de dépasser la durée maximale évoquée ;
– enfin, à titre exceptionnel, dans certains secteurs, dans certaines régions ou dans certaines entreprises, des dérogations peuvent être accordées à cette limite de 46 heures pour des périodes déterminées. En pratique, ces dérogations sont accordées lors de la survenance d’événements exceptionnels (Euro 2016, salons et défilés de mode, surcroît de commandes), ceux-ci pouvant au demeurant être saisonniers (travaux agricoles lors de récoltes ou de vendanges).
Ÿ Le texte maintient les plafonds existants de 48 heures sur une semaine, de 44 heures sur 12 semaines et de 46 heures sur 12 semaines en présence d’un accord : toutefois, alors que cette possibilité n’était pour l’heure autorisée que par la conclusion d’un accord de branche validé par un décret, il sera désormais possible de passer par un accord d’entreprise ou d’établissement, et ce dernier niveau de norme conventionnelle sera d’ailleurs prioritaire sur l’accord de branche. Il ne sera enfin plus nécessaire de faire « valider » par décret l’accord ainsi conclu.
À défaut d’accord, l’autorité administrative pourra accorder un dépassement de la durée maximale hebdomadaire dans la limite de 46 heures sur douze semaines et la possibilité exceptionnelle de dépasser la durée de 46 heures dans certains secteurs, dans certaines entreprises ou dans certaines régions est conservée intacte.
Dans les deux cas, ces autorisations accordées par l’autorité administrative font l’objet d’un avis du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s’ils existent ; cet avis est transmis à l’inspecteur du travail.
Cette nouvelle architecture des règles fait l’objet des articles L. 3121-20 à L. 3121-26 dans leur nouvelle rédaction.
Ÿ Les dispositions actuelles relatives à la durée légale du travail et aux heures supplémentaires figurent aux articles L. 3121-10 à L. 3121-25.
La durée légale du travail effectif des salariés est fixée à 35 heures par semaine civile (article L. 3121-10) ; au-delà de cette durée, les heures effectuées sont donc des heures supplémentaires.
Celles-ci sont accomplies dans la limite d’un contingent annuel, dont le dépassement constitue le seuil de déclenchement de la contrepartie obligatoire en repos. Ce contingent annuel relève du champ de la négociation collective. Ainsi, la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 a, pour la première fois, permis à l’accord d’entreprise de primer sur l’accord de branche en matière de fixation du contingent d’heures supplémentaires et des conditions de son dépassement. Aux termes de l’article L. 3121-11 dans sa rédaction actuelle, le contingent annuel d’heures supplémentaires – avec leur majoration – est défini par une convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche, de même que les conditions d’accomplissement des heures supplémentaires au-delà du contingent avec contrepartie obligatoire en repos. Autrement dit, un accord d’entreprise ou d’établissement peut fixer un contingent supérieur à celui éventuellement prévu par accord de branche.
À défaut d’accord, un décret détermine le contingent annuel et les conditions du repos compensateur pour les heures accomplies au-delà du contingent. Le contingent réglementaire est fixé à 220 heures.
De la même manière, la loi de 2008 a permis à l’accord d’entreprise de primer sur l’accord de branche pour prévoir un repos compensateur pour les heures accomplies dans la limite du contingent. L’accord collectif peut aussi remplacer tout ou partie du paiement des heures supplémentaires ainsi que de leur majoration par un repos compensateur équivalent. Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical et non assujetties à l’obligation annuelle de négocier, l’employeur peut prévoir ce remplacement de manière unilatérale, avec toutefois l’approbation du comité d’entreprise ou des délégués du personnel, s’ils existent.
La loi fixe, par principe, le taux de majoration des heures supplémentaires à 25 % pour les huit premières heures et à 50 % pour les heures suivantes (article L. 3121-22). Dans le droit actuel, un accord de branche étendu ou une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement peut prévoir un taux de majoration différent, celui-ci ne pouvant en tout état de cause être inférieur à 10 %.
Ÿ Le projet donne aux principes suivants un caractère d’ordre public :
– la durée légale du travail effectif, qui est de trente-cinq heures (article L. 3121-26 dans sa nouvelle rédaction) ;
– les principes selon lesquels, d’une part, toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée équivalente est une heure supplémentaire, ouvrant droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent ; et, d’autre part, les heures supplémentaires se décomptent par semaine. Le premier principe n’est aujourd’hui pas affirmé en tant que tel par la loi, bien qu’il existe et soit néanmoins déjà appliqué (article L. 3121-27 dans sa nouvelle rédaction) ;
– la règle selon laquelle les heures supplémentaires sont accomplies dans la limite d’un contingent annuel ; au-delà de ce contingent, les heures accomplies font l’objet d’une contrepartie obligatoire en repos. Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel sont celles accomplies au-delà de la durée légale. Les heures donnant lieu à un repos compensateur équivalent ou celles accomplies dans le cadre de travaux urgents ne s’imputent pas sur le contingent annuel ;
– enfin, le principe de l’annualisation de la durée du travail qui permet aux entreprises dont la durée collective hebdomadaire est supérieure à 35 heures de mensualiser les heures comprises entre 35 heures et la durée collective (article L. 3121-30 dans sa nouvelle rédaction).
L’ensemble de ces règles sont d’ores et déjà applicables : elles ne font l’objet d’aucune modification de fond, à l’exception du principe de la majoration ou, à défaut, du repos compensateur auquel ouvrent droit les heures supplémentaires qui est désormais explicitement affirmé.
Ÿ Le champ relevant de la négociation collective est élargi par le présent article.
En premier lieu, alors que l’article L. 3121-10 pose le principe selon lequel la semaine civile commence le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures, la règle d’ordre public se contente désormais de renvoyer à la notion de « semaine » (article L. 3121-26 dans sa nouvelle rédaction), et permet à une convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut à une convention ou un accord de branche de fixer toute autre période de sept jours consécutifs pour décompter la durée hebdomadaire de travail (article L. 3121-31 dans sa nouvelle rédaction). Cette possibilité n’est pas entièrement nouvelle, puisque l’article L. 3122-1 prévoyait déjà que la période correspondant à la semaine civile s’appliquait sauf dispositions contraires prévues par accord d’entreprise ou d’établissement ; désormais un accord collectif de branche pourra également définir cette période. Il s’agit de permettre aux petites entreprises qui ne seraient pas couvertes par un accord d’entreprise de bénéficier de cette souplesse par le biais d’un accord de branche.
L’article L. 3121-32 dans sa nouvelle rédaction reprend les dispositions prévues par la loi du 20 août 2008, tout en élargissant le périmètre de ce qui relève désormais en priorité de l’accord d’entreprise ou d’établissement, en y intégrant le taux de majoration des heures supplémentaires.
Ainsi, un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, un accord de branche définit le contingent annuel d’heures supplémentaires et fixe les conditions d’accomplissement des heures supplémentaires au-delà de ce contingent ainsi que la durée, les caractéristiques et les conditions de prise de contrepartie obligatoire sous forme de repos compensateur, comme c’est déjà le cas aujourd’hui.
La priorité est également, fait nouveau, donnée à l’accord d’entreprise pour fixer le taux de majoration des heures supplémentaires, qui est au minimum de 10 %. Jusqu’alors, l’accord de branche étendu prévalait sur tout accord d’entreprise ou d’établissement.
Si la loi du 20 août 2008 avait déjà permis à un accord d’entreprise de primer sur un accord de branche pour définir le contingent annuel d’heures supplémentaires et les conditions de son dépassement, ainsi que la mise en place d’un repos compensateur de remplacement et les conditions de prise de ce repos, en revanche, la fixation de taux de majoration des heures supplémentaires continue aujourd’hui de relever en priorité et par primauté à l’accord de branche : en effet, l’article L. 3121-22 soumet de ce point de vue les dispositions prises par accord d’entreprise aux conditions éventuellement prévues par un accord de branche, à moins que ce dernier n’ait expressément prévu la possibilité pour un accord de branche d’y déroger. Tel ne sera donc plus le cas à l’avenir, puisqu’un accord d’entreprise pourra, sous réserve de respecter le taux plancher de 10 %, fixer un taux de majoration inférieur à celui qui s’applique en vertu de l’accord de branche.
Le texte précise également que le repos compensateur obligatoire pour les heures accomplies au-delà du contingent, qui est défini par accord collectif, ne peut être inférieur à 50 % pour les entreprise jusqu’à 20 salariés et à 100 % pour les entreprises de plus de 20 salariés: il s’agit là d’une disposition déjà existante, mais non codifiée, puisqu’elle figure au IV de l’article 18 de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008.
Il s’agissait initialement de dispositions transitoires qui avaient vocation à s’appliquer jusqu’au 31 décembre 2009 : or, dans sa décision n° 2008-568 DC du 7 août 2008, le Conseil constitutionnel a jugé contraire à la Constitution, en l’absence de toute autre garantie légale, le renvoi à la négociation collective pour fixer « la durée, les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie » en repos et a ainsi, par voie de conséquence, pérennisé ces dispositions que le projet de loi propose donc de codifier.
Le II de l’article L. 3121-32 dans sa nouvelle rédaction reprend également, sans les modifier, les possibilités déjà existantes pour un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, pour un accord de branche, d’une part de prévoir qu’un repos compensateur est accordé au titre des heures supplémentaires accomplies dans la limite du contingent annuel, et d’autre part d’organiser le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires et de leur majoration par un repos compensateur équivalent.
Le III de l’article L. 3121-32 prévoit enfin que la convention ou l’accord d’entreprise peut adapter les conditions et les modalités d’attribution et de prise du repos compensateur de remplacement à l’entreprise. Ces dispositions, qui existent depuis la loi n° 93-1313 du 21 décembre 1993 relative au travail, à l’emploi et à la formation professionnelle ne concernent pas le niveau de l’établissement : toutefois, rien n’empêcherait que cette possibilité soit ouverte également à ce niveau-là.
Ÿ Le projet d’article énumère enfin les dispositions supplétives, qui s’appliqueront à défaut d’accord collectif, aux articles L. 3121-34 à L. 3121-38 dans leur nouvelle rédaction.
– La définition de la semaine civile du lundi à 0 heure au dimanche à 24 heures est d’ordre supplétif ; elle s’applique seulement par défaut, en l’absence d’accord collectif. Tel est déjà le cas dans le droit actuel qui réserve cependant la possibilité d’un accord en la matière à l’entreprise ou l’établissement, qui sera désormais ouvert à la branche.
– La majoration des heures supplémentaires est, par défaut, de 25 % pour les huit premières heures, puis de 50 % pour les heures suivantes. Ce principe posé à l’article L. 3121-22 figurera désormais à l’article L. 3121-36 dans sa nouvelle rédaction.
– Comme aujourd’hui, dans les entreprises dépourvues de délégué syndical, où la conclusion d’un accord collectif n’est pas possible, l’employeur peut, de manière unilatérale, prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires et de leur majoration par un repos compensateur équivalent (sous réserve de la non opposition du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s’ils existent).
Dans ces mêmes entreprises, l’employeur peut, comme aujourd’hui, adapter les conditions et modalités d’attribution et de prise du repos compensateur de remplacement, après avis des mêmes instances représentatives du personnel.
– Toujours à défaut d’accord, la contrepartie en repos obligatoirement accordée pour les heures effectuées au-delà du contingent est de 50 % dans les entreprises de moins de 20 salariés et de 100 % dans les entreprises de plus de 20 salariés.
– Enfin, en l’absence d’accord, un décret fixe le contingent annuel d’heures supplémentaires et le régime du repos compensateur pour les heures accomplies au-delà de ce contingent.
Les règles relatives à l’aménagement du temps de travail font l’objet des articles L. 3122-1 à L. 3122-6 dans leur rédaction actuelle.
Elles organisent deux modalités d’aménagement sur plusieurs semaines ou sur l’année : l’une qui relève de la négociation collective, et qui permet l’aménagement des horaires sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année, et l’autre qui constitue un régime réglementaire supplétif qui permet d’aménager les horaires sur quatre semaines au maximum.
L’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égal à l’année est possible par accord collectif d’entreprise ou d’établissement, ou à défaut, par convention ou accord de branche. Celui-ci prévoit obligatoirement : les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaire de travail ; les limites de décompte des heures supplémentaires ; les conditions de prise en compte des absences, arrivées et départs sur la période. L’accord collectif peut également prévoir, le cas échéant, les modalités particulières applicables aux salariés à temps partiel (communication et modification de la répartition de la durée et des horaires). Par défaut, le délai de prévenance des changements de durée ou d’horaire est de sept jours.
Notons que la primauté donnée à l’accord d’entreprise sur l’accord de branche en matière d’aménagement du temps de travail a été ouverte par la loi du 20 août 2008.
En l’absence d’accord, c’est le dispositif réglementaire supplétif qui trouve à s’appliquer. Ces dispositions sont détaillées aux articles D. 3122-7-1 à D. 3122-7-3 : elles permettent, dans toute entreprise non couverte par un accord collectif en la matière, d’aménager par la voie unilatérale le temps de travail des salariés sur une période de quatre semaines au maximum, comme détaillé supra.
Notons également qu’aux termes de l’article L. 3122-3 dans sa rédaction actuelle, dans les entreprises fonctionnant en continu, le temps de travail peut être organisé sur plusieurs semaines par décision unilatérale de l’employeur.
En cas d’aménagement du temps de travail sur tout ou partie de l’année, par accord ou par décret, sont considérées comme des heures supplémentaires, en vertu de l’article L. 3122-4 :
– les heures effectuées au-delà de 1 607 heures annuelles ou de la limite inférieure fixée par l’accord (déduction faite des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire éventuellement fixée par l’accord et déjà comptabilisées)
– les heures effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur la période de référence fixée par l’accord ou le décret, déduction faite le cas échéant des mêmes heures.
Un accord collectif peut prévoir que la rémunération des salariés est indépendante de l’horaire réel. Toutefois, lorsque les heures supplémentaires sont accomplies au-delà des limites prévues par l’accord, les rémunérations correspondantes sont payées avec le salaire du mois considéré (article L. 3122-5).
La mise en place d’un dispositif d’aménagement du temps de travail par accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet (article L. 3122-6).
Le présent article procède à la réorganisation des règles encadrant l’aménagement du temps de travail, qui occupent désormais les articles L. 3121-39 à L. 3121-45.
Ÿ Les articles L. 3121-39 à L. 3121-41 comportent les dispositions d’ordre public. Il s’agit des principes suivants:
– en présence d’un dispositif d’aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires sont décomptées à l’issue de la période de référence, qui ne peut dépasser trois ans en cas d’accord collectif et neuf semaines en cas de décision unilatérale.
Il s’agit là de deux changements majeurs par rapport au droit actuel : d’une part, la période de référence peut désormais excéder un an, pour aller jusqu’à trois ans ; d’autre part, la loi prévoit désormais la possibilité de mettre en place un dispositif d’aménagement du temps de travail par voie unilatérale, sur une période pouvant aller jusqu’à neuf semaines.
Le texte prévoit également que pour une période de référence annuelle, les heures supplémentaires sont celles effectuées au-delà de 1 607 heures. Pour toute autre période de référence, les heures supplémentaires sont celles effectuées au-delà d’une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures calculées sur la période de référence.
Le rapporteur s’est interrogé sur la compatibilité de l’introduction d’une période de référence allant au-delà de l’année avec le droit communautaire : en effet, l’article 19 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail dispose que la prise de mesures dérogatoires aux durées minimales de repos et aux durées maximales de travail « ne peut avoir pour effet l’établissement d’une période de référence dépassant six mois. Toutefois, les États membres ont la faculté, tout en respectant les principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs, de permettre que, pour des raisons objectives ou techniques ou pour des raisons ayant trait à l’organisation du travail, les conventions collectives ou accords conclus entre partenaires sociaux fixent des périodes de référence ne dépassant en aucun cas douze mois ».
Dans le cadre d’une pluri-annualisation du temps de travail, l’employeur restera en réalité tenu de respecter ces durées minimales et maximales, ainsi que les périodes de référence pour leur décompte ; la pluri-annualisation est simplement destinée à lisser les heures supplémentaires sur une période supérieure à l’année.
– Sont également d’ordre public les règles relatives à l’information des salariés de tout changement dans la répartition de la durée du travail dans un délai de prévenance raisonnable, et le principe selon lequel l’aménagement du temps de travail par voie d’accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet.
Ÿ S’agissant du champ de la négociation collective, l’article L. 3121-42 dans sa nouvelle rédaction précise que l’accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, l’accord de branche fixe la période de référence, qui ne peut excéder un an ou, si un accord de branche l’autorise, trois ans.
Sont également précisés les éléments suivants :
– l’accord collectif peut prévoir une limite annuelle inférieure à 1 607 heures pour le décompte des heures supplémentaires ;
– si la période de référence est supérieure à un an, il prévoit obligatoirement une limite hebdomadaire supérieure à 35 heures au-delà de laquelle les heures effectuées sont en tout état de cause des heures supplémentaires rémunérées avec le salaire du mois considéré. Il s’agit par ce biais d’atténuer pour les salariés le mécanisme de compensation des « semaines hautes » et des « semaines basses », en prévoyant que tout heure travaillée au-delà de cette limite haute est considérée comme une heure supplémentaire et est rémunérée à la fin du mois au cours duquel elle a été effectuée ;
– si la période de référence est inférieure ou égale à l’année, l’accord peut également prévoir cette même limite hebdomadaire. Cela reste donc une simple possibilité dans le cadre d’un aménagement du temps de travail sur une durée infra-annuelle.
Ces heures ne sont pas décomptées des heures travaillées à l’issue de la période de référence retenue par l’accord.
Ÿ Enfin, le projet d’article pose, aux articles L. 3121-43 à L. 3121-45 les dispositions supplétives applicables en l’absence d’accord collectif.
On remarquera en premier lieu qu’est supprimé le dispositif réglementaire supplétif d’aménagement du temps de travail sur une période pouvant aller jusqu’à quatre semaines. En effet, désormais, à défaut d’accord collectif, l’aménagement du temps de travail pourra se faire sur décision unilatérale de l’employeur, au maximum sur 9 semaines pour les entreprises de moins de 50 salariés et sur 4 semaines pour les entreprises de plus de 50 salariés. Le projet d’article substitue donc au dispositif actuel, prévu par voie réglementaire, d’organisation du travail sous forme de périodes de quatre semaines au plus, un dispositif plus large et plus souple, en particulier pour les entreprises de moins de 50 salariés qui pourraient ainsi plus facilement recourir à l’aménagement du temps de travail sur une période allant jusqu’à neuf semaines.
Le texte reprend sans changement le principe de la mise en place d’une répartition de la durée du travail sur plusieurs semaines dans les entreprises qui fonctionnent en continu.
Enfin, le délai de prévenance en cas de changement de durée ou d’horaires reste bien fixé à sept jours en l’absence de stipulations contraires prévues par accord collectif.
Le dispositif des horaires individualisés, prévu aux articles L. 3122-23 à L. 3122-26 est en principe subordonné à une demande expresse du personnel : il permet, à la demande du salarié, d’organiser le temps de travail à l’intérieur de plages fixes, correspondant à des périodes de présence obligatoire et de plages mobiles pendant lesquelles sa présence est facultative. Ce dispositif permet de reporter des heures d’une semaine à une autre sans paiement d’heures supplémentaires. La mise en place d’horaires individualisés requiert l’avis conforme du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et l’information de l’inspecteur du travail, ce dernier devant en autoriser le recours dans le cas où l’entreprise est dépourvue de représentants du personnel. Ce dispositif peut aussi bénéficier, à leur demande, aux travailleurs handicapés et aux aidants familiaux ou aux proches d’une personne handicapée.
L’article L. 3122-27 pose les conditions de possibilité de récupération des heures perdues, qui sont limitées à trois cas d’interruption collective du travail : soit une cause accidentelle, une intempérie ou un cas de force majeure ; soit un inventaire ; soit le chômage d’un ou de deux jours ouvrables compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou un jour précédant les congés annuels.
Le projet réorganise ces deux dispositifs, qui ne relèvent aucunement dans le droit existant de la négociation collective, autour du triptyque : ordre public ; négociation collective ; dispositions supplétives. Autrement dit, il sera désormais possible d’aménager les règles relatives aux horaires individualisés et de recourir au mécanisme de récupération des heures perdues par voie d’accord collectif.
S’agissant des mesures d’ordre public, le texte propose, aux articles L. 3121-46 à L. 3121-48 dans leur nouvelle rédaction, en premier lieu de se passer de l’information de l’inspecteur du travail en présence d’institutions représentatives du personnel qui seraient néanmoins toujours appelées à donner leur aval à la mise en place d’horaires individualisés. Rappelons que cet outil n’est mis en place qu’à la demande d’un salarié. L’inspecteur du travail continuerait en revanche d’être consulté pour la mise en place de tels horaires dans les entreprises dépourvues de représentants du personnel.
Le présent article propose également de renvoyer à la négociation collective pour prévoir les limites et modalités de report d’heures d’une semaine à l’autre en cas de mise en place d’horaires individualisés, ainsi que pour fixer les modalités de récupération des heures perdues (article L. 3121-49 dans sa nouvelle rédaction). À défaut d’accord, ces limites et modalités sont déterminées par décret en Conseil d’État : elles ont vocation à demeurer inchangées.
Ÿ Les règles relatives aux conventions de forfait figurent aujourd’hui aux articles L. 3121-38 à L. 3121-48 du code du travail.
Il existe deux types de conventionnement : l’un, au forfait en heures sur la semaine ou le mois, qui peut concerner tout salarié et n’est pas soumis à des modalités relevant de la négociation collective ; l’autre, au forfait annuel en heures ou en jours, qui ne peut concerner que certaines catégories de salariés, et dont les modalités relèvent obligatoirement d’un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, d’un accord de branche. Dans tous les cas, une convention individuelle de forfait écrite doit être conclue avec l’accord du salarié.
Dans le cas du forfait annuel, l’accord collectif en question détermine les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait, la durée annuelle du travail sur laquelle le forfait est établi ainsi que les caractéristiques principales des conventions individuelles. En effet, comme on l’a dit, le forfait en heures ou en jours sur l’année ne peut être prévu que pour des catégories délimitées de salariés :
– s’agissant du forfait en heures sur l’année, ne peuvent être concernés que les cadres dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ou les salariés disposant d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps ;
– s’agissant du forfait en jours sur l’année, ne sont potentiellement concernés que les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif, ainsi que les salariés dont la durée du travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Si la possibilité de mettre en place des forfaits annuels, en heures ou en jours, a été ouverte par la loi « Aubry II » – loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail –, c’est la loi du 20 août 2008 qui a permis à l’accord d’entreprise de primer sur l’accord de branche pour la mise en place de forfaits en heures ou en jours sur l’année.
Qu’il s’agisse du forfait hebdomadaire ou mensuel ou du forfait annuel, la rémunération du salarié au forfait en heures est au moins égale à la rémunération minimale applicable dans l’entreprise pour le nombre d’heures correspondant à son forfait, augmentée des majorations afférentes pour heures supplémentaires.
S’agissant du forfait annuel en jours, l’accord collectif qui en aménage les modalités ne peut aller au-delà de 218 jours travaillés sur l’année (article L. 3121-44), ce qui correspond au plafond légal existant depuis la création du dispositif du forfait jours en 2000. Aux termes de l’article L. 3121-45, le salarié peut, en accord avec son employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de salaire, sous réserve de ne pas aller au-delà d’un plafond de jours travaillés fixé par l’accord collectif. À défaut de fixation de ce plafond par accord, celui-ci est fixé à 235 jours. Le taux de la majoration applicable à ce travail supplémentaire, qui ne peut être inférieur à 10 %, fait l’objet d’un avenant à la convention de forfait. Dans tous les cas, le nombre de jours travaillés doit être compatible avec les dispositions relatives au repos quotidien et hebdomadaire, aux jours fériés chômés dans l’entreprise et aux congés payés.
Les salariés au forfait annuel en jours bénéficient d’un entretien annuel individuel avec l’employeur, destiné à évaluer la charge de travail du salarié, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que la rémunération du salarié (article L. 3121-46).
L’article L. 3142-47 prévoit que, sur saisine du juge judiciaire, une indemnité peut être allouée à un salarié au forfait jours qui percevrait une rémunération manifestement sans rapport avec les sujétions qui lui sont imposées.
Contrairement aux salariés au forfait hebdomadaire ou mensuel ou à ceux qui relèvent d’un forfait annuel en heures, qui se voient appliquer les mêmes règles de durée du travail que les autres salariés, l’article L. 3121-48 prévoit que les salariés au forfait jours ne sont soumis ni à la durée légale hebdomadaire du travail de trente-cinq heures, ni à la durée quotidienne maximale de travail de dix heures, ni aux durées maximales hebdomadaires de 48 heures et de 44 heures
– 46 heures par décret pris après conclusion d’un accord de branche – sur douze semaines, ni aux règles relatives aux heures supplémentaires. Ils bénéficient en revanche des repos quotidien et hebdomadaire.
Ÿ Le présent article propose de revoir la structure des dispositions relatives aux conventions de forfait, qui figureraient désormais aux articles L. 3121-51 à L. 3121-64, en les réorganisant autour de la nouvelle architecture globale : dispositions d’ordre public ; champ de la négociation collective ; et dispositions supplétives.
Néanmoins, le texte proposé reprend pour l’essentiel les dispositions existantes. Les seules modifications apportées sur le fond sont les suivantes :
– Pour le forfait en jours sur l’année, la possibilité pour le salarié de renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de salaire fait l’objet d’un avenant qui est valable seulement pour l’année en cours, et qui ne peut être reconduit de manière tacite.
– L’employeur est tenu, en cas de forfait jours, de s’assurer que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail. Cet ajout par rapport au droit existant a vocation à entériner les exigences de la jurisprudence : en effet, depuis un arrêt de principe du 29 juin 2011, la Cour de cassation juge de manière constante que les stipulations d’un accord collectif instaurant un forfait jours doivent assurer le respect du droit à la santé et à la sécurité du salarié et, pour ce faire, doivent garantir que sa charge de travail reste raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail.
En outre, lorsque l’employeur a fixé des échéances et une charge de travail compatibles avec le respect des repos quotidien et hebdomadaire et des congés du salarié, sa responsabilité ne peut être engagée au seul motif que le salarié n’a, de sa propre initiative, pas bénéficié de ces repos ou congés. Cette précision vise à éviter qu’un employeur ne soit abusivement mis en cause par un salarié qui lui reprocherait le non-respect de ses droits à repos et congés alors qu’il choisit lui-même de ne pas en bénéficier. On peut toutefois s’interroger sur les conséquences du tempérament apporté à ce sujet par le projet de loi, au regard en particulier de l’obligation générale incombant à l’employeur de veiller au respect de la charge de travail des salariés.
– La mise en place de forfaits annuels (en heures ou en jours) reste soumise à la conclusion d’un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, à un accord de branche, celui-ci devant déterminer la période de référence du forfait, qui peut être l’année civile ou toute autre période de douze mois consécutifs. L’accord doit également spécifier le nombre d’heures ou de jours compris dans le forfait dans la limite de 218 jours pour le forfait jours, ce plafond demeurant inchangé par rapport au droit existant. La nouvelle rédaction proposée prévoit également que l’accord doit fixer les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période, ainsi que les caractéristiques principales des conventions individuelles, en particulier le nombre d’heures ou de jours compris dans chaque forfait individuel.
Dès lors qu’est prévue la conclusion de forfaits jours, l’accord doit également fixer les modalités d’évaluation et de suivi régulier de la charge de travail du salarié au forfait, ainsi que les modalités d’échange sur la charge de travail du salarié, l’articulation entre sa vie personnelle et son activité professionnelle, sa rémunération et l’organisation du travail dans l’entreprise (1) . L’accord détermine également les modalités selon lesquelles le salarié peut exercer son droit à la déconnexion. Il peut également fixer le nombre maximal de jours travaillés dans l’année lorsque le salarié renonce à une partie de ses jours de repos.
– Enfin, s’agissant du forfait jours, dans l’hypothèse où un accord collectif ne prévoit pas de dispositions spécifiques concernant le suivi de la charge de travail du salarié et l’échange périodique entre l’employeur et le salarié, l’employeur est tenu d’établir un document de contrôle du nombre de jours travaillés – celui-ci peut être établi par le salarié, sous le contrôle de l’employeur – ; il doit également s’assurer que la charge de travail du salarié est compatible avec le respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire, et organiser une fois par an un entretien avec le salarié pour évoquer sa charge de travail, l’organisation de son travail, l’articulation entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle, ainsi que sa rémunération. Cet entretien annuel est déjà prévu par la loi dans le droit actuel.
Lorsque le salarié renonce à des jours de repos et dans l’hypothèse où l’accord collectif ne prévoit rien en la matière, le nombre maximal de jours travaillés dans l’année est de 235 jours.
Le présent article propose de restructurer la section 3 du chapitre II consacrée au travail de nuit (articles L. 3122-29 à L. 3122-45 dans leur rédaction actuelle), qui devient le chapitre II du titre II, autour de trois sections, la première comportant les dispositions d’ordre public, la deuxième les dispositions relevant de la négociation collective et enfin, la troisième énumérant les dispositions supplétives.
Rappelons que cette section a été modifiée récemment, par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, pour intégrer la possibilité pour les commerces de détail situés en zone touristique internationale d’employer des salariés et donc d’ouvrir jusqu’à minuit.
Très peu de modifications de fond sont en réalité apportée au contenu de ces dispositions, qui font surtout l’objet d’une refonte formelle.
Ÿ Ainsi, sont d’ordre public les règles suivantes :
– le caractère exceptionnel du recours au travail de nuit (article L. 3122-1 dans sa nouvelle rédaction), qui prend en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs et est justifié par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique ou des services d’utilité sociale, ces principes fondamentaux demeurant inchangés par rapport au droit existant ;
– la définition du travail de nuit comme période d’au moins neuf heures consécutives comprises entre minuit et cinq heures, cette période commençant au plus tôt à 21 heures et s’achevant au plus tard à 7 heures. Pour les activités de production rédactionnelle et industrielle de presse, de radio, de télévision, de production et d’exploitation cinématographiques, de spectacles vivants et de discothèque, la période de nuit est d’au moins sept heures consécutives, comprenant l’intervalle entre minuit et 5 heures. Si ces règles font l’objet d’une réécriture, aucun changement n’est en réalité opéré sur le fond (articles L. 3122-2 et L. 3122-3 dans leur nouvelle rédaction). Les précisions selon lesquelles, en l’absence d’accord, le travail de nuit correspond à la période 21 heures – 6 heures (24 heures – 7 heures pour les activités spécifiques précitées), qui figurent aujourd’hui respectivement aux articles L. 3122-29 et L. 3122-30, sont renvoyées au niveau des dispositions supplétives, à l’article L. 3122-20 dans sa nouvelle rédaction.
Le travail de nuit dans les commerces de détail est en revanche modifié : alors que le texte actuel de l’article L. 3122-29-1 prévoit que le début de la période de nuit peut être reporté jusqu’à minuit et que s’il est fixé au-delà de 22 heures, la période de nuit se termine à 7 heures, le projet de loi propose, à l’article L. 3122-4 dans sa nouvelle rédaction, de définir la période de nuit comme la période d’au moins 7 heures consécutives comprenant l’intervalle entre minuit et 7 heures, dans le cas où le début de la période de nuit est fixé après 22 heures.
– la définition du travailleur de nuit, qui reste inchangée et qui correspond soit au fait de travailler au moins deux fois par semaine, selon un horaire de travail habituel, trois heures de travail pendant la période de nuit ; soit d’accomplir, au cours d’une période de référence, un nombre minimal d’heures de travail de nuit. Ce plancher est aujourd’hui fixé soit par un accord collectif étendu, soit par décret en Conseil d’État pris après consultation des organisations représentatives des employeurs et des salariés au niveau national. Il est de 270 heures sur 12 mois consécutifs, aux termes de l’actuel article R. 3122-8. Le projet d’article reprend ces deux modalités de fixation du plancher : l’article L. 3122-16 prévoit qu’il peut être fixé par un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par un accord de branche étendu, tandis que l’article L. 3122-23 définit le plancher applicable de manière supplétive, en l’absence d’accord collectif, celui-ci ayant désormais valeur légale, à hauteur – inchangée – de 270 heures sur douze mois consécutifs.
– la durée quotidienne maximale de travail d’un travailleur de nuit, qui ne peut excéder huit heures (article L. 3122-6 dans sa nouvelle rédaction), sauf en présence d’un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, un accord de branche étendu (article L. 3122-17 dans sa nouvelle rédaction), en présence d’équipes de suppléance, ou en cas de circonstances exceptionnelles sur autorisation de l’inspecteur du travail, après consultation des délégués syndicaux et après avis du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s’ils existent, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État. Ces dispositions ne subissent pas de modification de fond, hormis le procédé qui consiste à désormais donner la priorité à l’accord d’entreprise sur l’accord de branche pour fixer la durée quotidienne maximale de travail de nuit ;
– la durée hebdomadaire maximale de travail d’un travailleur de nuit, de quarante heures sur douze semaines, comme dans le droit actuel. Ce plafond peut être porté à 44 heures sur 12 semaines consécutives – comme c’est déjà le cas aujourd’hui – lorsque les caractéristiques propres à l’activité d’un secteur le justifient, par accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par accord de branche. D’une part, il n’est plus requis de ce dernier qu’il soit étendu et, d’autre part, c’est désormais l’accord d’entreprise ou d’établissement qui prime sur les dispositions prévues par accord de branche.
– le régime des contreparties accordées aux salariés travaillant la nuit
– sous forme de repos compensateur et, le cas échéant, sous forme de compensation salariale –, la consultation du médecin du travail en amont de la mise en place ou de la modification de l’organisation du travail de nuit, ainsi que le principe d’une surveillance médicale particulière des travailleurs de nuit, demeurent inchangés. La seule modification concerne précisément cette surveillance médicale, dont il est aujourd’hui prévu qu’elle s’exerce au moins tous les six mois : à l’avenir, ces conditions sont renvoyées à un décret en Conseil d’État, ce qui ne permet plus de garantir que la périodicité de cette surveillance médicale soit au maximum de six mois. En effet, l’article 44 du projet de loi prévoit notamment de modifier la teneur et la périodicité du suivi médical spécifique des travailleurs de nuit : il est apparu qu’un suivi semestriel n’était pas forcément garant d’une meilleure protection de cette catégorie de salariés ; en revanche, ce suivi médical doit pouvoir être plus approfondi. Si le texte revient donc ici sur cette périodicité, c’est dans le cadre d’une réforme plus vaste du contrôle exercé par la médecine du travail, qui est opérée à l’article 44 du projet de loi.
– L’ensemble des dispositions qui encadrent la possibilité pour le salarié de refuser le passage au travail de nuit ou celle de demander l’affectation à un poste de jour en cas d’obligations familiales impérieuses, le mécanisme de priorité à occuper un poste de jour ou inversement, et enfin, l’affectation sur un poste de jour pour des raisons de santé constatées par un médecin du travail, demeurent inchangées sur le fond. Elles sont désormais prévues aux articles L. 3122-12 à L. 3122-14.
S’agissant du champ laissé à la négociation collective, l’article L. 3122-15 dans sa nouvelle rédaction récapitule les modalités de la négociation collective pour la mise en place du travail de nuit ou pour son extension à de nouvelles catégories de salariés. Ainsi, un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, un accord de branche peut mettre en place le travail de nuit ou l’étendre à de nouvelles catégories de salariés, sous réserve de comporter les justifications du recours au travail de nuit, la définition de la période de travail de nuit, une contrepartie sous forme de repos compensateur et, le cas échéant, sous forme de compensation salariale, les mesures destinées à améliorer les conditions de travail des salariés, celles destinées à faciliter l’articulation entre l’activité professionnelle nocturne et la vie personnelle, celles destinées à assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, et enfin, l’organisation des temps de pause.
La seule modification notable qui est opérée par le présent article réside dans la primauté accordée à l’accord d’entreprise ou d’établissement sur l’accord de branche ; notons enfin que ce dernier ne nécessite plus de procédure d’extension. Ainsi, un accord d’entreprise pourra fixer désormais le niveau de la contrepartie obligatoire sous forme de repos, et le cas échéant, sous forme de compensation salariale, les dispositions qu’il prévoit s’imposant face aux contreparties éventuelles figurant dans un accord de branche, même si ces dernières sont plus favorables.
L’article L. 3122-19 dans sa nouvelle rédaction reprend sans changement sur le fond les dispositions relatives aux accords collectifs requis pour instaurer le travail de nuit dans les commerces de détail situés dans les zones touristiques internationales (article L. 3132-24).
Ÿ Enfin, au rang des dispositions supplétives, outre la définition de la période nocturne applicable en l’absence d’accord (entre 21 heures et 6 heures du matin ; entre minuit et 7 heures pour les activités culturelles, audiovisuelles, de presse et les discothèques) et les dispositions supplétives déjà évoquées, on retrouve :
– la possibilité, inchangée, d’affecter des travailleurs à des postes de nuit sur autorisation de l’inspecteur du travail, en l’absence d’accord et à condition que l’employeur ait engagé sérieusement et loyalement des négociations sur ce thème;
– ainsi que la possibilité de fixer par décret la liste des secteurs pour lesquels la durée maximale hebdomadaire de travail est fixée entre 40 et 44 heures.
Ces deux modalités sont prévues aux articles L. 3122-21 et L. 3122-24 dans leur nouvelle rédaction (articles L. 3122-36 et L. 3122-35 actuels).
Le présent article revoit également la structuration de la section 1 (travail à temps partiel) du chapitre III du titre II relatif à la durée du travail, et à la répartition et l’aménagement des horaires : la hiérarchie de cette section est revue comme toutes les autres dispositions relatives à la durée du travail pour intégrer la nouvelle articulation des normes autour, en premier lieu, des mesures d’ordre public, en deuxième lieu, des règles relevant de la négociation collective, et en dernier lieu, des dispositions supplétives.
Ÿ Figurent désormais au rang des règles d’ordre public, prévues à la sous-section 1, les dispositions suivantes :
– la définition du temps partiel, prévue à l’article L. 3123-1, qui ne fait l’objet d’aucune modification. Rappelons qu’est considéré comme étant à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure à celle d’un salarié à temps plein, celui-ci correspondant à la durée légale du travail ou, si elle est lui est inférieure, à la durée du travail fixée pour la branche, l’entreprise ou l’établissement ;
– les modalités de passage à temps partiel ou à temps complet, qui demeurent également inchangées sur le fond, et qui font désormais l’objet des articles L. 3123-2 et L. 3123-3. Seules sont reformulées les dispositions relatives à la possibilité pour l’employeur de proposer un emploi présentant des « caractéristiques différentes » à un salarié à temps partiel souhaitant reprendre un emploi à temps complet ou inversement, à un salarié à temps complet souhaitant occuper un poste à temps partiel : cette possibilité doit avoir été prévue par une convention ou un accord de branche étendu, ce qui est déjà le cas aujourd’hui. Le texte proposé se contente en fait de parler de caractéristiques différentes là où le droit actuel évoque un emploi ne ressortissant pas à la catégorie professionnelle du salarié ou un emploi non équivalent ;
– le principe du refus du salarié de passer à temps partiel, qui ne peut être considéré ni comme une faute, ni comme un motif de licenciement (article L. 3123-4 sans changement);
– les mesures destinées à garantir l’égalité de traitement entre les salariés à temps partiel et les salariés à temps complet (article L. 3123-5 qui se substitue sans aucune modification de fond aux actuels articles L. 3123-9 à L. 3123-13) ;
– les dispositions relatives au contrat de travail et les mentions obligatoires que ce dernier doit comporter (actuel article L. 3123-14 qui devient l’article L. 3123-6 sans modifications autres que de coordination) ;
– le principe d’une durée minimale hebdomadaire de travail, dont seule la formulation est nouvelle (cette durée minimale existe déjà aujourd’hui à l’article L. 3123-14-1), qui figure à l’article L. 3123-7 dans sa nouvelle rédaction, et qui continue de ne pas s’appliquer aux contrats dont la durée est inférieure ou égale à sept jours, aux CDD de remplacement de même qu’aux contrats de travail temporaire de remplacement ;
– les dérogations, déjà existantes, à la durée minimale hebdomadaire de travail, à la demande du salarié soumis à des contraintes personnelles ou qui cumule plusieurs activités, ainsi qu’au salarié de moins de 26 ans poursuivant ses études (article L 3123-7 qui se substitue aux actuels articles L. 3123-14-2 et L. 3123-14-5) ;
– les règles encadrant les heures complémentaires aux articles L. 3123-8 à L. 3123-10 dans leur nouvelle rédaction (principe de la majoration des heures complémentaires, interdiction de porter l’horaire de travail au niveau du temps complet par le biais de ces heures, interdiction de licencier un salarié refusant d’accomplir les heures complémentaires ou refusant d’accomplir des heures dont il a été informé moins de trois jours avant). Aucune modification de fond n’affecte ces dispositions ;
– les règles qui encadrent la répartition de la durée du travail (principe d’un délai de prévenance pour modifier la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; conditions du refus du salarié de modifier la répartition de sa durée du travail ; modification de l’horaire prévu au contrat en cas de dépassement de l’horaire moyen accompli par le salarié pendant une période donnée). Ces dispositions, prévues aux articles L.3123-11 à L. 3123-13 ne sont modifiées que sur un seul point : celui du délai de prévenance pour la modification de la répartition de la durée du travail, pour lequel le délai de sept jours est renvoyé au niveau des dispositions supplétives ;
– les dispositions relatives à l’utilisation du crédit d’heures d’un salarié à temps partiel titulaire d’un mandat de représentant du personnel, reprises sans modification (article L. 3123-14 dans sa nouvelle rédaction) ;
– et enfin, les mécanismes d’information des représentants du personnel sur le recours au temps partiel dans l’entreprise. Le texte intègre d’ailleurs le principe du bilan annuel du travail à temps partiel présenté au comité d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel, s’ils existent, à la consultation sur la politique sociale de l’entreprise.
Ÿ La sous-section 2 est consacrée à l’ensemble des règles pour lesquelles il est renvoyé à la négociation collective.
Le texte propose de faire primer désormais l’accord d’entreprise ou d’établissement sur un accord de branche étendu pour :
– mettre en œuvre des horaires de travail à temps partiel à l’initiative de l’employeur ;
– fixer les conditions de mise en place d’horaires à temps partiel à la demande des salariés (article L. 3123-17 dans sa nouvelle rédaction).
En revanche, les autres conditions d’encadrement du temps partiel qui relèvent exclusivement d’une convention ou d’un accord de branche étendu, sont maintenues dans ce cadre conventionnel strict : il s’agit en premier lieu des modalités selon lesquelles il est possible de proposer au salarié à temps partiel un emploi à temps complet ou équivalent à la durée conventionnelle applicable dans l’entreprise ne ressortissant pas à sa catégorie professionnelle ou un emploi à temps complet non équivalent, et inversement les modalités selon lesquelles l’employeur peut proposer au salarié à temps complet un emploi à temps partiel ne ressortissant pas à sa catégorie professionnelle ou un emploi à temps partiel non équivalent. Si la première option figure déjà aujourd’hui à l’article L. 3123-8, la seconde (proposer à un salarié à temps complet un emploi à temps partiel non équivalent) est nouvelle.
En second lieu, le texte reprend aussi, en se contentant de modifications formelles, les modalités selon lesquelles seul un accord de branche étendu peut fixer une durée minimale de travail inférieure à 24 heures hebdomadaires (garanties d’horaires réguliers, possibilité de cumul de plusieurs activités, et regroupement des horaires du salarié à temps partiel sur des journées ou demi-journées régulières ou complètes).
S’agissant des heures complémentaires, le projet d’article donne la primauté à l’accord d’entreprise sur l’accord de branche pour porter jusqu’au tiers de la durée hebdomadaire ou mensuelle la limite dans laquelle peuvent être accomplies des heures complémentaires.
Seul un accord de branche étendu peut en revanche, comme aujourd’hui, fixer le taux de majoration de ces heures, qui est au minimum de 10 %.
De même, le monopole de la convention ou de l’accord de branche étendu est maintenu s’agissant des compléments d’heures : ainsi, le projet reprend sans modification le dispositif du complément d’heures par avenant au contrat de travail qui figure aujourd’hui à l’article L. 3123-25 et devient l’article L. 3123-22.
Les conditions de répartition de la durée du travail, qui figurent aujourd’hui aux articles L. 3123-16 et L. 3123-22 sont en revanche modifiées : alors que les dispositions actuelles renvoient à une convention ou un accord de branche étendu ou à un accord d’entreprise ou d’établissement le soin d’organiser la répartition des horaires de travail des salariés à temps partiel dans la journée de travail, la primauté sera désormais accordée à l’accord d’entreprise ou d’établissement, même en cas de conditions moins favorables aux salariés.
Ainsi, si un accord collectif prévoit plus d’une interruption d’activité ou une interruption supérieure à deux heures, ledit accord doit définir les amplitudes horaires auxquelles sont soumis les salariés et prévoir des contreparties spécifiques en tenant compte des exigences propres à l’activité exercée.
S’agissant des règles relatives au délai dans lequel la modification de la répartition de la durée du travail est notifiée au salarié, le texte conserve le délai minimum de trois jours ouvrés, et l’existence de contreparties au salarié dès lors que ce délai est inférieur à sept jours ouvrés. La seule différence consiste également à privilégier désormais l’accord d’entreprise ou d’établissement, en ne faisant intervenir l’accord de branche qu’en second lieu, à défaut d’accord d’entreprise ou d’établissement et en faisant primer les dispositions d’un accord d’entreprise sur celles d’un accord de branche, même si ces dernières sont plus favorables.
Ces dispositions figurent désormais aux articles L. 3123-23 et L. 3123-24 dans leur nouvelle rédaction.
Ÿ La sous-section 3 comporte l’ensemble des dispositions supplétives, applicables en l’absence d’accord collectif. Ces règles sont les suivantes :
– Tout d’abord, s’agissant de la mise en place d’horaires à temps partiel, l’article L. 3123-26 dans sa nouvelle rédaction reprend sans modification de fond la possibilité, en l’absence d’accord collectif, de mettre en place des horaires à temps partiel à l’initiative de l’employeur après consultation des institutions représentatives du personnel. En l’absence de telles instances, des horaires à temps partiel peuvent être instaurés à l’initiative de l’employeur ou à la demande des salariés, après information de l’inspecteur du travail, comme c’est déjà le cas aujourd’hui. Enfin, toujours à défaut d’accord, un salarié peut demander à bénéficier d’horaires à temps partiel dans des conditions fixées par voie réglementaire ; le refus de l’employeur de faire droit à cette demande est strictement encadré, mais les conditions demeurent inchangées.
– En matière de durée minimale du travail et d’heures complémentaires, le présent article reprend, par défaut, la durée minimale de travail de 24 heures par semaine (ou l’équivalent mensuel de cette durée ou l’équivalent sur la période de référence éventuellement retenue par un accord d’aménagement du temps de travail) ; il laisse également inchangées les règles encadrant le recours aux heures complémentaires, qui ne doivent pas dépasser un dixième de la durée prévue au contrat ou sur la période de référence déjà citée, pas plus qu’elles ne peuvent porter la durée accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale ou conventionnelle du travail. Enfin, sont également repris les deux taux de majoration des heures complémentaires applicables à défaut d’accord collectif – de 10 % pour les heures complémentaires dans la limite du dixième des heures prévues au contrat, et de 25 % entre le dixième et le tiers des heures prévues au contrat.
– Enfin, les règles supplétives applicables en l’absence d’accord en matière de répartition de la durée du travail sont reprises sans changement : d’une part, l’interdiction d’imposer plus d’une interruption de travail ou une interruption de plus de deux heures à un salarié à temps partiel ; et d’autre part, le délai de prévenance d’au moins sept jours ouvrés pour notifier au salarié toute modification de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.
Les dispositions relatives au travail intermittent sont réorganisées autour de deux sous-sections, l’une comportant les dispositions d’ordre public, l’autre les règles relevant du champ de la négociation collective. On notera donc l’absence de dispositions supplétives dans ce domaine, pour des raisons évidentes : le recours au travail intermittent ne peut être aménagé que par voie d’accord ; autrement dit, en l’absence d’accord, aucune disposition supplétive ne s’applique. De ce point de vue, le projet d’article se contente de modifier l’ordre de priorité donné aux accords collectifs, en privilégiant l’accord d’entreprise ou d’établissement par rapport à l’accord de branche étendu. Les dispositions prévues par accord d’entreprise auront donc désormais vocation à primer sur les conditions prévues dans un accord de branche, même si ces dernières sont plus favorables.
Les caractéristiques principales du contrat de travail intermittent sont en revanche reprises sans modification : c’est le cas pour les mentions devant obligatoirement figurer dans le contrat de travail, le plafond d’heures fixé à ce type de contrat (un tiers de la durée annuelle minimale prévue au contrat, sauf accord du salarié), l’alignement des droits du salarié en contrat de travail intermittent sur ceux du salarié à plein temps, ainsi que la possibilité de recourir à travail intermittent en l’absence d’accord dans les seules entreprises adaptées.
Le champ de la négociation collective se voit enrichi par le projet d’article qui précise que l’accord collectif qui autorise le recours au travail intermittent :
– définit les emplois permanents pouvant être pourvus par des salariés en contrat de travail intermittent ;
– détermine le cas échéant les droits conventionnels spécifiques de ces salariés ;
– peut prévoir que la rémunération de ces salariés est indépendante de l’horaire réel, auquel cas il en définit les modalités de calcul. Ce dispositif est déjà prévu dans le droit existant ;
– et enfin, détermine les adaptations nécessaires et les conditions du refus du salarié des dates et horaires de travail proposés, dans les secteurs particuliers dans lesquels la nature de l’activité ne permet pas de prédéterminer précisément les périodes de travail et la répartition des heures de travail au sein de ces périodes.
Le titre III consacré aux repos et aux jours fériés subit les mêmes modifications que le titre II relatif à la durée du travail et à la répartition et l’aménagement des horaires, avec l’introduction de la nouvelle architecture en triptyque : ordre public, champ de la négociation collective, dispositions supplétives. Toutefois, seuls les chapitres Ier – relatif au repos quotidien – et III
– relatif aux jours fériés – sont concernés par ces changements, le chapitre II qui porte sur le repos hebdomadaire ne fait l’objet d’aucune modification. Les modifications afférentes figurent au IV du présent article.
Sur le fond, les dispositions relatives au repos quotidien figurant aux articles L. 3131-1 et L. 3131-2 ne sont pas modifiées : seules le sont leur architecture et la place de l’accord collectif d’entreprise. Ainsi, le principe d’un repos quotidien d’une durée minimale de onze heures consécutives reste affirmé, avec trois dérogations possibles :
– la première, par une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par un accord de branche – et non plus seulement par un accord de branche étendu –, qui concerne les activités caractérisées par la nécessité d’assurer une continuité du service ou par des périodes d’intervention fractionnées. C’est l’objet de l’article L. 3131-2 qui constitue la sous-section relative au champ de la négociation collective. Désormais, un accord d’entreprise pourra donc déroger à la durée minimale de repos de onze heures en fixant des conditions moins favorables à celles qui figureraient dans un accord de branche ;
– la deuxième, en l’absence d’accord, en cas de surcroît exceptionnel d’activité, dans des conditions définies par décret. Ce cas correspond aux dispositions supplétives ;
– et enfin, en cas d’urgence dans des conditions déterminées par décret, celles-ci devant a priori recouvrir les dispositions actuelles qui renvoient à des travaux urgents en raison d’un accident ou d’une menace d’accident.
Seules sont concernées par des modifications les sections consacrées aux jours fériés légaux (section 1) et à la journée de solidarité (section 3). La section 2, qui recouvre le 1er mai, reste inchangée.
Le projet d’article reprend les dispositions existantes figurant aux articles L. 3133-1 à L. 3133-3 relatives aux onze jours fériés légaux. Il complète ces dispositions par deux nouveaux articles L. 3133-3-1 et L. 3133-3-2, qui correspondent respectivement au champ de la négociation collective et aux dispositions supplétives : ainsi, un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, un accord de branche définit les jours fériés chômés ; à défaut d’accord, l’employeur fixe les jours fériés chômés.
Que change cette nouvelle architecture par rapport au droit actuel ?
Les jours fériés légaux ne sont, dans le droit actuel, pas obligatoirement chômés : ils ne le sont en effet légalement que pour les moins de 18 ans (article L. 3164-6) et en Alsace-Moselle (article L. 3134-13). Néanmoins, des conventions collectives, de même que des accords collectifs prévoient d’ores et déjà que les jours fériés, ou un certain nombre d’entre eux, sont chômés. Ainsi, en 2015, sept accords de branche ont été conclus, qui prévoient des dispositions plus favorables que celles du code du travail en la matière.
En l’absence d’accord, l’employeur peut fixer de manière unilatérale si et combien de jours fériés sont chômés. L’employeur peut aujourd’hui déjà prendre un engagement unilatéral pour rémunérer tout ou partie des jours fériés. Bien que le code du travail ne prévoie pas de manière expresse que les jours fériés puissent être fixés par usage, il n’est pas rare qu’un tel usage règle cette question.
La principale différence par rapport au droit actuel repose sur la primauté donnée à l’accord d’entreprise : si les conventions collectives qui s’appliquent aujourd’hui demeureront applicables, il n’en demeure pas moins qu’un accord d’entreprise ou d’établissement pourra dorénavant primer sur ces règles prévues par convention collective, soit en prévoyant d’autres jours fériés chômés, soit en en prévoyant moins. La convention collective n’aura plus alors vocation qu’à s’appliquer dans les entreprises où il n’y a pas d’accord conclu à ce niveau.
Les dispositions relatives à la journée de solidarité ne sont modifiées que très formellement. Ainsi, les actuels articles L. 3133-7 et L. 3133-10 à L. 3133-12 sont regroupés au sein des règles d’ordre public : il s’agit de la définition de la journée de solidarité, du principe de l’absence de rémunération pour les sept heures de travail accomplies au titre de cette journée, des modalités applicables aux salariés à temps partiel, ainsi que des règles relatives à une seconde journée de solidarité qui serait demandée aux salariés en cas de changement d’employeur.
L’actuel article L. 3133-8 est scindé en trois parties :
– les cinq premiers alinéas de cet article deviennent l’article L. 3133-11 : il comporte, à droit constant, les règles de conclusion d’un accord collectif fixant les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité. Autrement dit, le texte ne revient pas sur la possibilité, ouverte par la loi du 20 août 2008, de fixer les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité par le biais d’un accord d’entreprise ou d’établissement et seulement par défaut par un accord de branche ;
– le sixième alinéa de cet article devient l’article L. 3133-12, qui constitue la sous-section relative aux dispositions supplétives : il prévoit qu’en l’absence d’accord, les modalités d’accomplissement de cette journée sont définies par l’employeur, après consultation des instances représentatives du personnel ;
– enfin, le dernier alinéa de cet article, relatif aux départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, est basculé dans un chapitre IV déjà existant et entièrement dédié au régime particulier de l’Alsace-Moselle, avec un nouvel article L. 3134-16, qui prévoit que dans ces départements, ni le 25, ni le 26 décembre, ni le Vendredi Saint ne peuvent être désignés comme la date de la journée de solidarité.
Le présent article revoit l’architecture du chapitre Ier du titre IV, consacré aux congés payés, en procédant à la même structuration que pour les dispositions relatives à la durée du travail et au repos, en trois niveaux : les mesures d’ordre public, les règles relevant de la négociation collective et enfin, les dispositions supplétives.
Ÿ La section 1 qui définit le droit au congé ne subit pas de modification de fond : elle comporte les articles L. 3141-1 et L. 3141-2, dont la numérotation reste par ailleurs inchangée.
Ÿ On constate un quasi maintien en l’état des dispositions relatives à la durée du congé : elles figurent à la section 2 et couvrent les articles L. 3141-3 à L. 3141-9, et sont désormais intégrées au sein d’une sous-section 1 qui comporte les mesures d’ordre public. Notons qu’un seul article disparaît de cette sous-section : il s’agit de l’actuel article L. 3141-8, dont le contenu est renvoyé dans la sous-section 2 relative au champ de la négociation collective, puisqu’il prévoit la possibilité, par accord collectif, de majorer la durée du congé en raison de l’âge ou de l’ancienneté.
La sous-section 2 déjà évoquée retrace donc l’article L. 3141-10 dans sa nouvelle rédaction, qui prévoit qu’un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, un accord de branche peut fixer le début de la période de référence pour l’acquisition des congés, ainsi que – comme on vient de l’évoquer – majorer la durée du congé en fonction de l’âge ou de l’ancienneté. Jusqu’à présent, la loi prévoyait que le début de la période de référence pour l’acquisition des congés pouvait être fixée par un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut par un accord collectif de branche portant aménagement du temps de travail. La majoration de la durée du congé en fonction de l’ancienneté était déterminée par convention ou accord collectif de travail, sans plus de précision: autrement dit, sur ce dernier aspect, un accord d’entreprise ne pouvait pas prévaloir sur les dispositions d’un accord de branche, ce qui ne sera plus le cas à l’avenir puisque l’accord d’entreprise primera sur l’accord de branche
Enfin, la sous-section 3 comporte le seul article L. 3141-11 qui prévoit qu’à défaut d’accord, le début de la période de référence pour l’acquisition des congés est fixé par décret en Conseil d’État : il s’agit du droit existant. Ce point de départ, prévu par l’article R. 3141-3 correspond au 1er juin de chaque année.
Ÿ La section 3 concerne la prise des congés.
La sous-section 1 traite de la période de congés et de l’ordre des départs.
Sont d’ordre public :
– le principe de la prise de congés dès l’ouverture des droits, sans préjudice des règles de détermination de la période de prise des congés et de l’ordre des départs, ainsi que des règles de fractionnement du congé ;
– la période de prise des congés, qui comprend nécessairement la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année ;
– le principe du droit à congé simultané pour les conjoints et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité.
Ces principes sont réunis au sein des articles L. 3141-12 à L. 3141-14 et ne font l’objet d’aucune modification de fond.
Relèvent de la négociation collective, c’est-à-dire, en premier lieu, de l’accord d’entreprise ou d’établissement et, à défaut d’un accord de branche :
– la période de prise de congé ;
– l’ordre des départs pendant cette période ;
– et les délais à respecter par l’employeur pour modifier l’ordre et les dates des départs.
La priorité est donc donnée à l’accord d’entreprise ou d’établissement, dont les dispositions pourront s’imposer face à celles prévues par un accord de branche.
Rappelons qu’aujourd’hui, ces règles sont fixées par les conventions collectives ; à défaut, c’est l’employeur qui les définit. Désormais, si une entreprise ou un établissement signe un accord sur ce sujet, ce dernier primera sur celui de la branche ; autrement dit, la convention collective ne trouvera plus à s’appliquer que dans les entreprises où il n’y aura pas d’accord conclu à ce niveau.
Enfin, à défaut d’accord, les dispositions supplétives suivantes s’appliquent :
– L’employeur fixe, après avis des instances représentatives du personnel, la période de prise de congés et l’ordre des départs (en tenant compte de la situation de famille des bénéficiaires, de la durée des services chez l’employeur et de l’éventuelle activité chez un ou plusieurs autres employeurs). Ces dispositions supplétives et les critères sur lesquels elles reposent demeurent inchangés ;
– Sauf circonstances exceptionnelles, l’employeur ne peut modifier l’ordre et les dates de départ moins d’un mois avant le départ prévu. Ce délai existe déjà dans le droit actuel.
S’agissant de la sous-section 2 relative aux règles de fractionnement et de report, sont maintenus – et figurent désormais au sein du paragraphe 1, parmi les mesures d’ordre public – les articles L. 3141-17, L. 3141-18 et L. 3141-20, qui deviennent les articles L. 3141-17 à L. 3141-19 : la seule modification apportée consiste à supprimer l’avis conforme des délégués du personnel ou, à défaut, l’accord des salariés pour fractionner les congés en cas de fermeture de l’établissement.
Le paragraphe 2, qui définit le champ de la négociation collective prévoit qu’un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, un accord de branche :
– fixe, en cas de fractionnement, la période pendant laquelle la fraction d’au moins douze jours ouvrables est attribuée ainsi que les règles de fractionnement du congé au-delà du douzième jour ;
– peut prévoir, en cas de décompte de la durée du travail sur l’année, une possibilité de report des congés ouverts au titre de l’année de référence, sans modifier les conditions dans lesquelles ce report peut être organisé.
Pour l’heure, les règles de fractionnement des congés sont d’ordre légal, et ne peuvent pas être adaptées par voie de convention ou d’accord collectif. Les règles de report sont indifféremment fixées par un accord collectif étendu ou par un accord d’entreprise ou d’établissement : ce sera désormais ce dernier qui s’imposera en cas de coexistence d’accords de niveaux différents portant sur cette question.
Enfin, l’article L. 3141-23 dans sa nouvelle rédaction comporte les dispositions supplétives suivantes, qui reprennent sans modification de fond les mesures déjà existantes :
– En cas de fractionnement, et en l’absence d’accord, la fraction d’au moins douze jours ouvrables continus est attribuée pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.
– Les règles de fractionnement des congés au-delà du douzième jour sont reprises telles quelles : possibilité d’accorder les jours restants en une ou plusieurs fois en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre ; attribution de deux jours ouvrables de congé supplémentaire lorsqu’au moins six jours ont été attribués hors de cette période, et d’un seul si entre trois et cinq jours l’ont été. Les jours de congé principal dus en plus de vingt-quatre jours ouvrables ne sont pas pris en compte pour l’ouverture du droit à ce supplément.
Il reste possible de déroger à ces conditions après accord individuel du salarié.
Ÿ Les indemnités de congés et les caisses de congés payés
Les sections 4 et 5 relatives respectivement aux indemnités de congés et aux caisses de congés payés sont reprises sans autre modifications que rédactionnelles.
Dispositions concernées |
Droit existant |
Droit proposé |
Travail effectif, astreintes et équivalences | ||
Temps de travail effectif : temps de pause et de restauration, temps d’habillage et de déshabillage, temps de trajet inhabituel |
– Rémunération spécifique possible des temps de pause et de restauration par accord collectif ou dans le contrat de travail – Contreparties obligatoires aux opérations d’habillage ou de déshabillage par accord collectif ou par le contrat de travail (sauf si considérées comme du temps de travail effectif) ; – Obligation de prévoir les contreparties au temps de trajet inhabituel par accord collectif ou, à défaut, par DUE. |
– Primauté donnée à l’accord d’entreprise sur l’accord de branche pour fixer ces contreparties – À défaut d’accord, pas de changement. |
Astreintes |
Accord collectif |
Primauté donnée à l’accord d’entreprise sur l’accord de branche |
Équivalences |
Convention ou accord de branche + décret et, à défaut, d’accord de branche, décret en Conseil d’État |
Accord de branche étendu simple et, à défaut, décret en Conseil d’État |
Durées maximales du travail | ||
Temps de pause |
Possibilité de fixer une durée supérieure par voie d’accord |
Primauté à l’accord d’entreprise sur l’accord de branche |
Durée quotidienne maximale |
Dérogation par voie de décret |
Dérogation par accord d’entreprise qui prime sur l’accord de branche et seulement à défaut d’accord, dérogation par décret. |
Durée hebdomadaire maximale |
Dérogations par décret en cas de circonstances exceptionnelles ou à titre exceptionnelle ou, par accord de branche validé par un décret |
Maintien de dérogations par décret / Dérogation par accord d’entreprise primant sur l’accord de branche (non validé par un décret). |
Durée légale et heures supplémentaires | ||
Contingent d’heures supplémentaires |
Primauté de l’accord d’entreprise sur l’accord de branche pour fixer le contingent d’heures supplémentaires et les conditions de son dépassement (loi du 20 août 2008) |
Inchangé |
Repos compensateur de remplacement |
Primauté de l’accord d’entreprise sur l’accord de branche pour prévoir un repos compensateur de remplacement et conditions de prise du repos (loi du 20 août 2008) Pour les entreprises dépourvues de délégué syndical, DUE soumise à l’approbation des représentants du personnel. |
Inchangé |
Taux de majoration des heures supplémentaires |
Possibilité de déroger par accord collectif de branche étendu ou par accord d’entreprise ou d’établissement, avec plancher de 10 % minimum. |
Primauté de l’accord d’entreprise sur l’accord de branche pour fixer le taux de majoration des heures supplémentaires, avec plancher maintenu à 10 %. |
Définition de la semaine |
Aujourd’hui, semaine civile, sauf accord d’entreprise ou d’établissement |
Primauté de l’accord d’entreprise sur l’accord de branche pour fixer sept jours consécutifs. |
Aménagement du temps de travail |
Primauté de l’accord d’entreprise sur l’accord de branche (loi du 20 août 2008) |
Inchangé (sauf période de référence qui passe potentiellement à trois ans par accord de branche) |
Horaires individualisés et récupération des heures perdues |
– Horaires individualisés uniquement à la demande des salariés et après approbation des représentants du personnel et information de l’inspecteur du travail – Récupération des heures perdues par décret |
Primauté donnée à l’accord d’entreprise sur l’accord de branche (maintien de l’approbation des représentants du personnel, mais information de l’inspecteur du travail seulement en l’absence de représentants du personnel). |
Conventions de forfait | ||
Forfait en heures sur la semaine ou le mois |
Possibilité d’ordre public |
Inchangé |
Forfait annuel en heures ou en jours |
Primauté de l’accord d’entreprise sur l’accord de branche (loi du 20 août 2008). |
Inchangé |
Travail de nuit |
||
Détermination de la « période » de travail de nuit |
Dérogation à la période légale par accord de branche étendu ou par accord d’entreprise ou d’établissement |
Primauté donnée à l’accord d’entreprise sur l’accord de branche |
Mise en place du travail de nuit, justifications du recours au travail de nuit et fixation des contreparties |
Convention ou accord de branche étendu ou accord d’entreprise ou d’établissement |
Primauté donnée à l’accord d’entreprise sur l’accord de branche |
Durée quotidienne maximale de travail de nuit |
Dérogation par accord de branche étendu ou accord d’entreprise ou d’établissement (conditions fixées par décret) |
Primauté donnée à l’accord d’entreprise sur l’accord de branche (conditions fixées par décret) |
Durée hebdomadaire maximale de travail de nuit |
Dérogation par accord de branche étendu ou accord d’entreprise ou d’établissement dans la limite de 44 heures sur 12 semaines consécutives |
Primauté donnée à l’accord d’entreprise sur l’accord de branche, mais maintien du plafond de 44 heures sur 12 semaines |
Travail à temps partiel | ||
Mise en place du travail à temps partiel |
Accord collectif de branche étendu ou accord collectif d’entreprise ou d’établissement |
Primauté donnée à l’accord d’entreprise sur l’accord de branche |
Proposition de l’employeur d’un poste à temps complet à un salarié à temps partiel et inversement |
Accord de branche étendu |
Inchangé : maintien du niveau de l’accord de branche étendu |
Fixation de la durée minimale de travail | ||
Heures complémentaires |
Accord de branche étendu ou accord d’entreprise ou d’établissement |
Primauté donnée à l’accord d’entreprise sur l’accord de branche |
Taux de majoration des heures complémentaires |
Accord de branche étendu, avec plancher à 10 % |
Inchangé |
Complément d’heures par avenant |
Accord de branche étendu |
Inchangé |
Modalités de regroupement des horaires des salariés à temps partiel |
Accord de branche étendu ou accord d’entreprise |
Inchangé |
Répartition des horaires et modification de la répartition des horaires de travail |
Accord de branche étendu ou accord d’entreprise ou d’établissement |
Primauté donnée à l’accord d’entreprise sur l’accord de branche |
Travail intermittent |
Accord de branche étendu ou accord d’entreprise ou d’établissement |
Primauté donnée à l’accord d’entreprise sur l’accord de branche |
Repos et jours fériés | ||
Repos quotidien |
Dérogation par accord de branche étendu ou par accord d’entreprise ou d’établissement, dans des conditions fixées par décret |
Primauté donnée à l’accord d’entreprise sur l’accord de branche, dans des conditions fixées par décret. |
Jours fériés |
Silence de la loi |
Primauté de l’accord d’entreprise sur l’accord de branche |
Journée de solidarité |
Primauté de l’accord d’entreprise sur l’accord de branche (loi du 20 août 2008). |
Inchangé : Primauté de l’accord d’entreprise sur l’accord de branche |
Congés payés |
||
Fixation du début de la période de référence pour l’acquisition des congés |
Accord collectif |
Primauté de l’accord d’entreprise sur l’accord de branche |
Majoration en raison de l’âge ou de l’ancienneté |
Accord collectif |
Primauté de l’accord d’entreprise sur l’accord de branche |
Fixation de la période de prise des congés |
Accord collectif |
Primauté de l’accord d’entreprise sur l’accord de branche |
Fixation de l’ordre des départs |
Accord collectif |
Primauté de l’accord d’entreprise sur l’accord de branche |
Fractionnement et report des congés |
Ordre public pour le fractionnement / Accord d’entreprise ou d’établissement pour le report |
Primauté de l’accord d’entreprise sur l’accord de branche |
*
Lors de son examen du texte, votre commission a adopté une série d’amendements, qui visent :
– à rétablir l’information ou la consultation des institutions représentatives du personnel en cas de demande d’autorisation de dépassement de la durée maximale hebdomadaire de travail dans la limite de soixante heures, dans le cadre de l’accomplissement d’heures supplémentaires dans la limite et au-delà du contingent annuel ainsi que des modalités de son utilisation et de son éventuel dépassement (amendements AS921, AS920 et AS912 de votre rapporteur) ;
– à supprimer le principe du non engagement de la responsabilité de l’employeur concernant la charge de travail d’un salarié au forfait jours dès lors que les échéances et la charge de travail prévue sont compatibles avec le respect des repos quotidien et hebdomadaire et des congés du salarié (amendements identiques AS296 de M. Cavard, AS675 de Mme Linkenheld et AS762 de Mme Fraysse) ;
– à préciser que la rupture du contrat d’un travailleur de nuit déclaré inapte à son poste est soumise à l’impossibilité pour l’employeur de proposer tout autre poste correspondant à la qualification de ce salarié et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, la rédaction actuelle pouvant laisser entendre que l’employeur pourrait se contenter de ne proposer qu’un seul autre poste (amendement AS504 de M. Sebaoun) ;
– à supprimer la possibilité de déroger par voie d’accord collectif à la durée minimale de repos quotidien de onze heures (amendement AS739 de Mme Sas) ;
– à ouvrir au salarié la possibilité de prendre ses congés dès l’embauche et non plus dès l’ouverture de ses droits (amendement AS579 de Mme Clergeau) ainsi qu’à ouvrir le bénéfice de l’indemnité de congés payés aux salariés licenciées pour faute lourde qui en sont aujourd’hui privés (amendement AS580 Rect. de Mme Clergeau).
*
La Commission est saisie de deux amendements de suppression identiques AS411 de Mme Jacqueline Fraysse et AS756 de Mme Éva Sas.
Mme Jacqueline Fraysse. L’article 2 est révélateur de la philosophie du projet de loi. En réécrivant toute la partie du code du travail relative à la durée du travail, à l’aménagement des horaires, aux repos et aux congés payés, il met en place une architecture à trois niveaux qui étend la primauté de l’accord d’entreprise sur l’accord de branche et sur la loi.
Pour les salariés, cette décentralisation de la négociation collective au niveau de l’entreprise, combinée à une remise en cause du principe de faveur, se traduira inévitablement par un recul des protections actuellement garanties par la loi.
Vous prétendez que cette réécriture est faite à droit constant ; nous pensons que ce n’est pas vrai. En effet, plusieurs dispositions dans cet article de quarante pages démontrent le contraire : je pense à la possibilité pour les accords d’entreprise de fixer le niveau de rémunération des heures supplémentaires, avec un taux plancher à 10 % et sans tenir compte de l’accord de branche – à l’alinéa 9 ; à la modulation du temps de travail, qui serait désormais possible sur trois ans et non plus sur une année seulement – à l’alinéa 132. De plus, la nouvelle mouture du projet de loi laisse inchangée la possibilité pour l’employeur de décider unilatéralement une modulation du temps de travail sur neuf semaines, au lieu de quatre actuellement dans les entreprises de moins de cinquante salariés – à l’alinéa 149 –, sachant que ces nouvelles possibilités de modulation vont se traduire par une intensification du travail pour les salariés et une perte de salaire immédiate, puisque les heures supplémentaires seront calculées et payées non pas chaque semaine mais à la fin du cycle.
Enfin, vous nous dites que cette nouvelle architecture va contribuer à simplifier le droit du travail. Là encore nous le contestons, puisque la nouvelle rédaction augmente de 27 % le volume de texte sur la partie relative au temps de travail.
Mme Éva Sas. L’article 2 va clairement dans le sens d’un allongement du temps de travail des salariés. Ainsi, une journée de travail pourra-t-elle atteindre douze heures, contre dix aujourd’hui, et la moyenne hebdomadaire sur douze semaines atteindre quarante-six heures contre quarante-quatre actuellement. La modulation du temps de travail sera, quant à elle, possible sur trois ans, contre un an aujourd’hui, façon pour les employeurs de ne pas régler les heures supplémentaires. De plus, pour les entreprises de moins de cinquante salariés, l’employeur pourra décider unilatéralement d’une modulation du temps de travail sur neuf semaines contre quatre dans le droit actuel.
Cet article va donc à contre-courant de ce qui est souhaitable et nécessaire pour la société, c’est-à-dire la reprise du mouvement historique de réduction du temps de travail, qui s’est interrompu en 2002 sans raison apparente, alors qu’elle est un instrument de lutte contre le chômage et permet la création d’emplois.
M. le rapporteur. Ces deux amendements ont pour objectif de revenir sur la nouvelle architecture préconisée par le rapport Combrexelle, qui organise le droit du travail en trois parties : les règles d’ordre public, le champ renvoyé à la négociation collective et les règles supplétives. Ils me paraissent procéder de l’idée que les accords d’entreprise devraient automatiquement induire une dégradation de la situation des salariés.
Je rappelle que le texte prévoit, d’une part, que les règles supplétives protègent le salarié en l’absence d’accord et, d’autre part, que les accords sont des accords majoritaires. A-t-on si peu confiance dans les partenaires sociaux qu’on imagine qu’ils pourraient signer des accords majoritaires contribuant à dégrader la situation des salariés ? Soyons plus mesurés : s’il peut y avoir dans un accord global des éléments défavorables aux salariés, c’est en général en contrepartie d’améliorations.
Au-delà des mesures d’ordre public, auxquelles on ne pourra déroger, le nouveau droit du travail offrira aux entreprises – grâce aux accords majoritaires – davantage de souplesse, pour leur permettre de s’adapter à un contexte économique et à un monde du travail en pleine évolution. Pour l’ensemble de ces raisons, j’émets un avis défavorable.
M. Jean-Patrick Gille. Renvoyant dos à dos ceux qui proposent que les accords d’entreprise puissent déroger aux dispositions légales en matière de temps de travail et ceux qui, à l’instar de la CGT, prônent un retour au principe de faveur et à la hiérarchie des normes, ce projet de loi propose une nouvelle architecture en trois strates : l’ordre public, la négociation collective et le supplétif, sachant que la question de la négociation collective est d’articulation complexe entre ce qui relève de la branche et ce qui relève de l’entreprise.
Il faut admettre que, pour ceux qui attendaient une simplification, cette nouvelle organisation requiert dans un premier temps une certaine gymnastique. Quoi qu’il en soit, une fois son principe acté, le législateur va devoir opérer des choix au cas par cas et déterminer si la réforme s’opère à droit constant ou non.
Il me semble que nous devons être prudents sur les décisions que nous allons prendre. Nous ne pouvons revenir au principe de faveur, car l’organisation du temps de travail doit pouvoir se mettre en place au niveau de l’entreprise. Soyons très vigilants néanmoins sur la question des dérogations : elles sont au cœur de la problématique de ce projet de loi qui entend substituer à un système de normes strictement descendant, un système descendant qui comporte également des portions ascendantes.
Mme Monique Iborra. La plupart des organisations syndicales sont d’accord pour admettre que le code du travail aujourd’hui ne protège plus les salariés. Devons-nous continuer à prétendre le contraire ?
Par ailleurs, depuis 2013, ce sont 44 000 accords d’entreprise qui ont été signés, et pas par une organisation syndicale unique mais, pour la plupart d’entre eux, par l’ensemble des organisations.
Il est donc faux de parler d’inversion de la hiérarchie des normes, alors qu’il ne s’agit que d’acter, dans la loi, un élargissement du champ des accords d’entreprise, sachant que la validité de ces accords sera désormais subordonnée à leur approbation par des syndicats majoritaires à 50 %, contre 30 % aujourd’hui, ce qui fait d’ailleurs dire à certains qu’il sera extrêmement difficile de parvenir à ces accords. Nous pensons nous, que ce taux protège les salariés tout en permettant la négociation.
Enfin, la plupart des salariés ne sont pas favorables à la centralisation des négociations autour des accords de branche, car ils veulent légitimement pouvoir être impliqués dans l’organisation de leurs conditions de travail, d’où également l’idée du référendum d’entreprise. Quant aux accords nationaux, on ne peut considérer qu’ils sont le seul niveau de négociation valable lorsque l’on constate à quel point, sur le terrain, ils sont mal appliqués, très peu appliqués, voire pas appliqués du tout.
C’est au regard de cette réalité que ce projet de loi entend privilégier la négociation tout en protégeant les salariés.
Mme Éva Sas. Le rapporteur s’interrogeait – de manière purement rhétorique, il me semble – sur le fait de savoir pourquoi des organisations syndicales accepteraient des conditions de travail globalement moins favorables aux salariés de leur entreprise : il ne lui aura pas échappé que c’est tout simplement pour s’aligner sur les entreprises concurrentes. C’est la raison pour laquelle c’est au niveau de la branche qu’il faut favoriser les négociations.
Mme Isabelle Le Callennec. Ce projet de loi réorganise le droit du travail selon trois niveaux : les règles d’ordre public, auxquelles personne ne peut déroger et qui constituent les droits et devoirs fondamentaux du chef d’entreprise et de ses salariés ; ce qui relève du champ de la négociation collective, partie sur laquelle les entreprises attendent que nous leur procurions de la souplesse et la possibilité, notamment pour les PME, d’organiser le travail en fonction des réalités du terrain ; les règles supplétives enfin, en l’absence d’accord d’entreprise ou d’accord de branche.
Tout cela est séduisant au premier abord, mais le diable se cache dans les détails et, selon les amendements qui seront ou non adoptés, le degré de liberté accordé aux entreprises et le niveau de sécurité dont bénéficieront les salariés vont varier.
Je ne pense pas, contrairement à Mme Fraysse, que le projet de loi diminue d’emblée le niveau de protection des salariés, et je considère que nous devons avant tout l’examiner à l’aune des 6 millions de chômeurs inscrits à Pôle emploi. Notre divergence tient au fait que Mme Fraysse considère que renforcer la protection des salariés – lesquels sont à 80 % employés en CDI – n’empêchera pas les chômeurs d’avoir accès à l’emploi – dans 80 % des cas en CDD. Nous ne sommes pas d’accord avec cette analyse, et c’est la raison pour laquelle nous défendons cet article 2, qui redonne des marges de manœuvre aux entreprises et entend favoriser le dialogue social. Soyons attentifs néanmoins à ce que contiennent ses nombreux alinéas, et efforçons-nous d’aboutir à un résultat simple et lisible pour les chefs d’entreprise.
Mme Jacqueline Fraysse. Il n’est pas question pour nous de s’en tenir à un statu quo. Nous pensons qu’il est indispensable de réviser le code du travail pour l’adapter à la société d’aujourd’hui. Nous sommes conscients qu’il faut, dans certaines activités, introduire, grâce à la négociation collective, de la souplesse dans l’organisation du travail, mais il n’est pas question pour nous d’acter des reculs dans la protection des salariés. C’est la raison pour laquelle nous tenons au principe de faveur.
Loin de moi, monsieur le rapporteur, l’idée que les accords d’entreprise seront systématiquement défavorables aux salariés mais, compte tenu de la situation économique et du poids du chômage, on ne peut exclure que les négociations soient biaisées par une forme de chantage à l’emploi. Or, en la matière, le texte affaiblit la protection des salariés. C’est la raison pour laquelle nous pensons que cet article doit être réécrit, et nous vous ferons, ultérieurement, des propositions en ce sens.
M. Bernard Accoyer. Le texte qui nous est soumis et qui correspond à la version revue par le Gouvernement a été vidé de plusieurs dispositions qui étaient favorables aux PME. C’est d’autant plus regrettable que ce sont elles qui créent le plus d’emplois. Nous proposerons donc de les réintroduire par voie d’amendements.
M. le rapporteur. Vouloir revenir à l’état du droit antérieur à 2004 revient à défendre un principe de faveur exclusif, ce qui est incompatible avec l’introduction de souplesse dans le dispositif, ou alors uniquement en faveur des salariés. Nous devons tenir compte du fait que le monde économique a évolué.
Le chantage à l’emploi existe déjà aujourd’hui et on ne peut imaginer d’en revenir à une organisation pyramidale qui interdirait toute discussion au sein de l’entreprise et empêcherait les organisations syndicales d’accepter éventuellement, dans le cadre d’un accord majoritaire, des dispositions défavorables aux salariés en contrepartie d’avancées en leur faveur.
C’est point par point que nous devons examiner cet article. Dans certains domaines, nous entendons renforcer le principe de l’accord de branche ; dans d’autres, au contraire, nous nous efforcerons d’introduire davantage de souplesse dans le dispositif.
Éva Sas évoque le risque de dumping social. C’est un risque réel en effet, et nous devrons être d’autant plus vigilants dans certains domaines que ce risque est grand.
M. Jean-Louis Bricout. L’idée de privilégier l’accord d’entreprise m’inquiète, car les négociations dans un tel contexte peuvent être perturbées par le facteur humain et la complexité des relations entre les différents acteurs. Par ailleurs, outre le risque de chantage à l’emploi que l’on a évoqué, ces accords peuvent également aboutir à des distorsions de concurrence au sein d’une même branche.
La Commission rejette les amendements.
Puis elle en vient à l’examen des amendements identiques AS215 de Mme Bernadette Laclais et AS448 de M. Joël Giraud.
M. Michel Liebgott. Dans le cas des salariés n’ayant pas de « lieu habituel de travail » se pose la question du premier déplacement, entre le lieu de résidence et le premier lieu d’intervention, qui peut être très éloigné du domicile. Cet amendement a donc pour objet d’interpeller le Gouvernement et d’obtenir de sa part des réponses, pour que la prise en compte de ces déplacements soit favorable aux salariés.
Mme Dominique Orliac. Les travailleurs itinérants sont en effet de plus en plus nombreux. Si le temps de déplacement entre deux interventions est compris dans le temps de travail quotidien, ce n’est pas le cas du trajet – parfois fort long – qu’ils doivent effectuer entre leur domicile et le lieu de leur première intervention.
M. Gérard Sebaoun. En intégrant ce premier déplacement dans le temps de travail, nous ouvririons un champ qui dépasse largement l’objectif de ces amendements. J’y suis donc défavorable.
M. Élie Aboud. Il me semble en effet que ce sont des éléments qu’il est difficile de figer dans la loi.
M. le rapporteur. Ces amendements sont des amendements d’appel. Le problème est que la solution qu’ils proposent n’est pas conforme à la définition du temps de travail effectif qui ressort de la jurisprudence, laquelle ne prend en compte que les trajets effectués entre les interventions du salarié. En outre, si l’on adoptait ces amendements, certains salariés, qui ne sont pas ceux visés ici, pourraient légitimement prétendre à bénéficier des mêmes avantages. Avis défavorable.
Mme Bérengère Poletti. Cela pourrait également constituer une source de discrimination lors du recrutement, notamment pour les salariés habitant en milieu rural.
L’amendement AS215 est retiré.
La Commission rejette l’amendement AS448.
La Commission examine les amendements identiques AS449 de M. Alain Tourret et AS596 de M. Gilles Lurton.
Mme Dominique Orliac. L’accord de branche permet de garantir une égalité de traitement à des salariés exerçant les mêmes métiers et d’éviter ainsi une concurrence déloyale entre les entreprises par le biais d’un dumping social.
De plus, dans les TPE, l’application directe d’un accord de branche apporte une réelle sécurité juridique puisqu’elle ne les expose pas au contentieux, à l’inverse du recours au mandatement syndical avec lequel elles seraient livrées à elles-mêmes.
M. Gilles Lurton. Je partage l’argumentation de Mme Orliac. Il y a lieu de replacer l’accord de branche au-dessus de l’accord d’entreprise car, comme l’a dit le rapporteur, celui-ci sécurise le cadre juridique pour les TPE.
M. le rapporteur. Autant je comprends la position de Mme Orliac, autant je m’étonne d’un tel amendement venant des bancs de l’opposition.
Votre amendement fait écho à notre discussion précédente. Sur certains sujets, l’accord de branche sera plus intéressant car plus protecteur – la branche jouant pleinement son rôle de régulation sociale – tandis que sur d’autres sujets, qui relèvent de l’organisation de chaque entreprise – le temps de pause, le temps d’habillage et de déshabillage –, l’accord d’entreprise sera plus approprié.
Ces amendements prévoient la primauté de l’accord de branche sur l’accord d’entreprise, assortie d’une clause de verrouillage. Je ne peux donc pas y être favorable. Je redis mon étonnement de voir cet amendement émaner des rangs de l’opposition.
M. Gilles Lurton. Je suis parfaitement cohérent. Je n’ai signé aucun des amendements précédents de mes collègues.
M. Jean-Louis Roumégas. Nonobstant ses signataires, je soutiens cet amendement qui protège les petites entreprises et évite le dumping social en donnant la primauté à la branche. Il faut se départir de son a priori sur les signataires de cet amendement qui me paraît presque de gauche.
La Commission rejette ces amendements.
La Commission est saisie de l’amendement AS743 de Mme Éva Sas.
Mme Éva Sas. La négociation du temps de travail dans chaque entreprise comporte un risque de course au moins-disant social. Ce projet de loi va encore plus loin puisqu’il permet, par le biais des accords d’établissement, de mettre les sites d’une même entreprise en compétition. C’est d’autant plus dangereux que c’est au niveau de l’entreprise ou de l’établissement que le lien de subordination entre salarié et employeur pèse de tout son poids et que les menaces de ce qu’il faut bien appeler le chantage à l’emploi sont les plus fortes. En outre, l’argument de la souplesse ne peut pas être invoqué puisqu’un accord d’entreprise peut prévoir des modalités différentes selon les établissements.
M. le rapporteur. Votre amendement a pour conséquence de supprimer la possibilité de négocier des accords d’établissement dans l’ensemble de l’article 2. Il témoigne d’une méfiance de principe à l’égard de ces accords qui seraient nécessairement défavorables aux salariés de l’établissement.
Je ne nie pas les risques mais il me semble préférable d’examiner au cas par cas dans l’article 2 comment les limiter.
M. Jean-Patrick Gille. Cet amendement pose un problème de forme puisqu’il s’applique à l’ensemble de l’article. Il n’en demeure pas moins que nous devons préciser les sujets de négociation susceptibles d’être verrouillés au niveau de la branche. Le texte présente lui aussi un caractère systématique : dans la plupart de cas, il fixe le niveau de négociation
– entreprise, établissement, branche. Il nous appartient d’apporter des nuances.
Mme Isabelle Le Callennec. Le projet de loi indique : « à défaut, un accord de branche », conformément au principe de subsidiarité. L’amendement propose de renverser cette logique.
La Commission rejette l’amendement.
La Commission passe à l’amendement AS358 de M. Serge Bardy.
M. Serge Bardy. Cet amendement prévoit que le temps de déplacement accompli lors de périodes d’astreintes constitue un temps de travail effectif. Il vise, dans un souci de clarté et de lisibilité du droit du travail, à transcrire dans la loi la jurisprudence en vigueur.
M. le rapporteur. Quel est l’intérêt d’inscrire dans la loi une jurisprudence qui n’est pas contestée ?
Mme Isabelle Le Callennec. L’amendement est en contradiction avec l’alinéa 18 aux termes duquel « le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif. »
M. le rapporteur. L’amendement concerne le cas particulier des astreintes.
Mme Jacqueline Fraysse. Je regrette la réponse du rapporteur. Je considère pour ma part préférable d’inscrire la jurisprudence dans la loi .
M. Christophe Cavard. On m’a expliqué tout à l’heure, pour justifier la suppression des principes définis par le comité Badinter, qu’il fallait s’en tenir à la jurisprudence. Il faut être cohérent !
Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement.
La Commission en vient à l’amendement AS94 de M. Gérard Cherpion.
M. Gérard Cherpion. Cet amendement prévoit le fractionnement du temps de repos en cas d’intervention pendant une période d’astreinte.
Il permet de combler un vide juridique en répondant à des situations qui peuvent se présenter en pratique et ainsi d’éviter des non-sens dans l’application du respect des temps de repos.
En effet, l’intervention est la seule période considérée comme une période effective de travail méritant un repos compensateur égal au temps utilisé pendant l’astreinte. Quant au temps d’astreinte sans intervention, il fait l’objet d’une contrepartie spécifique justifiée par l’entrave à la liberté d’agir du salarié. Ainsi, le salarié doit rester à disposition mais ne travaille pas effectivement pendant l’astreinte sauf au moment de l’intervention. Or, le repos quotidien ou hebdomadaire est nécessaire en cas d’intervention. Dès lors, il paraît normal de prévoir que le temps antérieur à une intervention sous astreinte est pris en compte dans le décompte du temps de repos. L’intervention n’a plus pour effet d’interrompre le temps de repos mais de le suspendre.
Par ailleurs, les règles actuelles posent des difficultés d’organisation du temps de travail dans les TPE-PME.
La précision qu’apporte cet amendement met fin à une ambiguïté juridique sans pour autant porter préjudice au salarié, qui voit son temps de repos respecté mais fractionné.
M. le rapporteur. J’émets un avis très défavorable sur cet amendement qui remet en cause le principe de continuité du repos compensateur et qui risque de nuire à la santé des salariés.
M. Bernard Accoyer. Je conteste l’analyse erronée du rapporteur sur cet amendement qui nous paraît particulièrement adapté aux problèmes rencontrés par les PME.
La Commission rejette l’amendement.
La Commission est saisie de l’amendement AS356 de M. Serge Bardy.
M. Serge Bardy. Aujourd’hui, la programmation individuelle des périodes d’astreinte est portée à la connaissance de chaque salarié concerné quinze jours à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles. Le projet de loi prévoit de renvoyer à un décret les modalités d’information et les délais de prévenance, seul le caractère raisonnable des délais demeurant prescrit par la loi. On ne comprend pas pourquoi ces dispositions sortent du champ de la loi.
En l’absence d’accord collectif, il convient d’allonger les délais de prévenance en les portant à quatre semaines hors circonstances exceptionnelles. Cela paraît tout à fait raisonnable et devrait inciter l’employeur à la négociation.
M. Bernard Accoyer. Je suis défavorable à cet amendement qui accentue encore un peu plus la rigidité dont le Gouvernement entend corriger les excès qui sont à l’origine des difficultés de notre économie.
Cet amendement durcit, complique et alourdit le droit du travail. Si ce n’est pas l’objectif du Gouvernement, il semble que ce soit celui de sa majorité.
M. Patrick Hetzel. Cet amendement est étonnant. Les responsables de TPE-PME se plaignent déjà du caractère très contraignant du délai de quinze jours. Votre amendement les obligeant à informer le salarié des périodes d’astreinte un mois avant contribue à alourdir les obligations qui pèsent sur les entreprises, à contre-courant de la pratique dans les autres pays de l’Union européenne.
Si notre droit du travail se doit d’être protecteur, il doit aussi être en adéquation avec celui des autres pays européens sous peine de nuire à la compétitivité de nos entreprises. Veillons à ne pas être contre-productifs.
M. Gérard Sebaoun. Le droit actuel – le délai de quinze jours – me paraît raisonnable. En revanche, je m’interroge sur le choix de laisser le soin à un décret en Conseil d’État de fixer le délai de prévenance. Je vous invite à la plus grande vigilance sur ce point, monsieur le rapporteur.
M. le rapporteur. Je partage l’avis de M. Sebaoun sur l’inutilité de doubler le délai de prévenance.
Le Gouvernement m’a confirmé que le décret serait rédigé à droit constant. Je demanderai à la ministre de le repréciser en séance. D’une manière générale, pour les dispositions supplétives, le principe est de codifier à droit constant.
M. Serge Bardy. Je retire l’amendement.
L’amendement est retiré.
La Commission examine l’amendement AS357 de M. Serge Bardy.
M. Serge Bardy. Cet amendement prévoit que « l’instauration d’astreintes ou la modification des éléments prévus au premier alinéa constitue une modification du contrat de travail et doit donc recueillir l’accord du salarié. »
Dans un souci de clarté et de lisibilité du droit du travail, il vise à transcrire dans la loi la jurisprudence en vigueur, notamment un arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 31 mai 2000.
M. le rapporteur. Avis défavorable. Vous vous référez à un arrêt de la Cour de cassation mais un autre arrêt de la même cour du 16 décembre 1998 considère que l’accord du salarié n’est pas requis si les astreintes sont prévues par un accord collectif. Il me paraît donc difficile de transposer une jurisprudence qui n’est pas univoque.
L’amendement est retiré.
La Commission en vient à l’amendement AS467 de Mme Jeanine Dubié.
Mme Dominique Orliac. Cet amendement vise à supprimer l’alinéa 64 dans la mesure où, contrairement à l’avant-projet, la limite de douze heures de travail quotidien n’est plus garantie par le projet de loi.
M. le rapporteur. Je suis gêné car l’alinéa visé par votre amendement porte en réalité sur le temps de pause de vingt minutes après six heures de travail.
Mme Dominique Orliac. Il y a sans doute une erreur dans l’alinéa. Je retire l’amendement.
L’amendement est retiré.
La Commission passe à l’amendement AS642 de Mme Fanélie Carrey-Conte.
M. Gérard Sebaoun. Cet amendement tend à maintenir le principe d’une durée maximale quotidienne de travail de dix heures.
L’alinéa 78 qu’il propose de supprimer permet de déroger à ce principe par simple accord d’entreprise, en portant cette durée à douze heures, en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise. Cette dernière notion me paraît extrêmement large.
Cette disposition comporte des risques non seulement pour les salariés, en particulier les femmes, mais aussi de dumping social entre les entreprises.
M. Élie Aboud. Lorsqu’on parle d’organisation de l’entreprise, on fait allusion à la gestion des carnets de commandes, par exemple.
M. Bernard Accoyer. Heureusement que nous sommes là pour soutenir le Gouvernement et les avancées qu’il propose pour permettre aux entreprises de mieux résister à la concurrence mondiale et ainsi lutter contre le chômage !
M. le rapporteur. La disposition prévue par l’alinéa 78 figure déjà dans l’article D. 3121-19 du code du travail qui énonce qu’« une convention ou un accord collectif de travail étendu ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement peut prévoir le dépassement de la durée maximale quotidienne de travail à condition que ce dépassement n’ait pas pour effet de porter cette durée à plus de douze heures. »
Le projet de loi précise la primauté de l’accord d’entreprise sur l’accord de branche dans cette matière – et je connais votre appréciation de cette architecture – mais le reste de l’article n’introduit aucune nouveauté.
La Commission rejette l’amendement.
La Commission est saisie des amendements identiques AS293 de M. Christophe Cavard, AS450 de Mme Jeanine Dubié et AS561 de M. Arnaud Richard.
M. Christophe Cavard. C’est l’un des rares sujets sur lequel les dispositions supplétives ne sont pas prévues. Si l’ordre public et le champ de la négociation collective sont décrits respectivement dans les paragraphes 1 et 2, le paragraphe 3 qui figurait dans l’avant-projet a en effet disparu du projet de loi. Afin que la limite de douze heures quotidiennes maximales de travail soit garantie en l’absence d’accord collectif, il est nécessaire de réintroduire cette disposition dans le texte.
Mme Dominique Orliac. L’amendement AS450 est défendu.
M. Arnaud Richard. L’amendement propose de rétablir l’article L. 3121-18-1 qui figurait dans l’avant-projet de loi. Il nous paraît souhaitable que la limite de douze heures de travail quotidien soit garantie par la loi.
M. Bernard Accoyer. Cet amendement n’apporte rien au regard des objectifs qui sont poursuivis par ce projet de loi.
M. le rapporteur. Je vous invite à retirer ces amendements puisque votre exigence est satisfaite au-delà même de ce que vous demandiez. La question de la dérogation à la durée quotidienne de travail est traitée dans l’alinéa 73 du projet de loi, parmi les mesures d’ordre public.
Mme Isabelle Le Callennec. L’alinéa 73 fait référence à un décret pour déterminer les conditions de dérogation.
M. le rapporteur. C’est déjà le cas aujourd’hui. Il est plutôt encourageant que cette disposition, jusqu’à présent prévue par la partie réglementaire du code du travail, figure désormais dans les dispositions d’ordre public.
M. Christophe Cavard. Je fais évidemment confiance au rapporteur. Mais quelle garantie avons-nous que le décret prévu par l’alinéa 73 fixera la durée maximale à douze heures ?
M. Arnaud Richard. M. Cavard a raison, il y a un loup, monsieur le rapporteur.
M. le rapporteur. La limite des douze heures a été supprimée car elle n’est pas appliquée aujourd’hui. Je vous rappelle en outre que la dérogation est soumise à l’autorisation de l’inspection du travail. Il me semble que toutes les garanties sont apportées. Mais je demanderai à la ministre de le préciser en séance.
Mme la présidente Catherine Lemorton. Le rapporteur vous a-t-il rassuré ?
Mme Dominique Orliac. Je maintiens l’amendement car je ne vois pas ce qui empêche de le voter.
La Commission rejette ces amendements.
La Commission examine, en discussion commune, les amendements AS921 du rapporteur et AS295 de M. Christophe Cavard.
M. le rapporteur. Cet amendement vise à rétablir la consultation des instances représentatives du personnel, prévue aujourd’hui, en cas d’autorisation octroyée par la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) de dépassement de la durée maximale hebdomadaire de travail du fait de circonstances exceptionnelles.
M. Christophe Cavard. Dans le même esprit, notre amendement prévoit un avis conforme du comité d’entreprise ou des délégués du personnel, conformément aux prescriptions de la directive européenne 203/88/CE.
M. Gérard Cherpion. Il me semble préférable de nous en tenir à la rédaction du projet de loi. Il n’est pas nécessaire de complexifier un texte dont, je vous le rappelle, le titre fait référence aux nouvelles libertés pour les entreprises
Mme Isabelle Le Callennec. Si les instances émettent un avis négatif, quelle est la marge de manœuvre de l’inspection du travail ? Leur avis est-il simplement consultatif ?
M. le rapporteur. L’avis est transmis à l’agent de contrôle de l’inspection du travail. Mon amendement se borne à revenir au droit actuel tandis que celui de M. Cavard prévoit un avis conforme des instances représentatives. Je lui propose de retirer son amendement.
M. Gérard Sebaoun. Monsieur le rapporteur, pouvez-vous préciser ce que sont les circonstances exceptionnelles ?
M. Christophe Cavard. Je suis satisfait du rétablissement de la consultation des instances du personnel que propose le rapporteur. Je retire donc mon amendement.
M. Francis Vercamer. Cette disposition conduirait à un allongement des délais de décision.
M. Bernard Accoyer. Il s’agit d’une nouvelle complexification du code du travail. Je ne comprends pas pourquoi le rapporteur va dans cette direction alors qu’il est prévu un décret en Conseil d’État.
M. Gérard Cherpion. Nous nous situons dans le cadre d’une activité exceptionnelle. Or la transmission de l’avis introduira des délais supplémentaires.
Je ne m’imagine pas qu’un inspecteur du travail puisse trancher sans disposer d’une explication sur les circonstances exceptionnelles pour donner sa réponse. Restons-en au texte du Gouvernement, qui correspond bien à la réalité des choses.
M. le rapporteur. Monsieur Cherpion, cette procédure existe aujourd’hui et fonctionne. Pourquoi inventer des freins ?
Pour répondre à votre question, monsieur Sebaoun, je précise que la dérogation à la durée maximale hebdomadaire ne peut être accordée « qu’en cas de circonstances exceptionnelles entraînant temporairement un surcroît extraordinaire de travail », impliquant par exemple un travail d’urgence.
L’amendement AS295 est retiré.
La Commission adopte l’amendement.
Elle examine ensuite les amendements identiques AS95 de M. Gérard Cherpion et AS541 de M. Arnaud Richard.
M. Gérard Cherpion. L’objet de cet amendement est de rétablir la rédaction initiale du projet de loi, qui prévoyait la possibilité, par accord collectif, de dépasser la durée maximale hebdomadaire jusqu’à quarante-quatre heures sur une période de seize semaines, et non de douze, afin de donner plus de souplesse à l’entreprise pour gérer des pics d’activité.
M. Arnaud Richard. Cet amendement vise à porter à seize semaines la période de référence. Cette extension permettrait d’apporter davantage de souplesse face aux variations d’activité. En l’absence de cette possibilité d’ajustement, les entreprises peinent à faire face aux hausses temporaires d’activité. Précisons que cette durée est conforme à la législation européenne : elle est déjà prévue par l’article 16 de la directive européenne sur le temps de travail.
M. le rapporteur. Monsieur Cherpion, je ne connais qu’un texte du Gouvernement, c’est celui qui a été adopté par le conseil des ministres. Je ne souhaite pas revenir sur le droit constant établi à propos de cet élément. Avis défavorable sur ces amendements.
M. Élie Aboud. Ce projet de loi va faire des mécontents partout, monsieur le rapporteur. Avec ces amendements, vous tenez une occasion unique d’envoyer un signal clair au monde économique. Pourquoi la rater ?
Croyez-vous vraiment que les entreprises décident d’allonger la durée maximale hebdomadaire pour leur plaisir ? Non, vous le savez bien : elles veulent pouvoir faire face aux surcroîts d’activité.
Mme Isabelle Le Callennec. Il est tout de même difficile d’ignorer qu’il y a eu une première version de ce projet de loi, monsieur le rapporteur, même si elle n’a pas été examinée par le conseil des ministres. Nous n’avons pas inventé les échanges qui ont eu lieu et nous savons tous qu’une période de seize semaines était prévue. J’ajoute qu’une organisation syndicale est même prête à ester en justice parce qu’elle estime que l’article L. 1 du code du travail n’a pas été respecté.
M. Arnaud Richard. Monsieur le rapporteur, vous vous êtes contenté d’une réponse formelle. Que vous ne vouliez pas entendre parler de cette première version, je le conçois, vous êtes pleinement dans votre rôle, compte tenu de la difficulté de la tâche qui vous incombe. Touefois, vous ne pouvez pas faire comme si elle n’avait jamais existé. Nous attendons des arguments de fond.
M. Gérard Sebaoun. J’estime au contraire très heureux que le Gouvernement soit revenu à douze semaines. Rappelons tout de même que les salariés pourront travailler quarante-quatre heures par semaine pendant trois mois consécutifs, ce qui n’est pas rien.
Mme la présidente Catherine Lemorton. C’est juste. S’agissant d’une période aussi longue, l’entreprise pourrait même recruter une personne sous CDD.
M. Rémi Delatte. Il y a des moments où il faut savoir donner des signes au monde économique. L’activité dans l’entreprise est souvent aléatoire. Il faut faire preuve de pragmatisme et permettre de déroger à la règle. Ne pensons pas que les décisions sont toujours imposées par le chef d’entreprise à ses salariés, elles s’inscrivent aussi dans une relation de confiance et dans une logique gagnant-gagnant.
Mme Monique Iborra. Cette logique du gagnant-gagnant est tellement manifeste que le texte prévoit des accords d’entreprise !
Nous le voyons, pour certains, le projet de loi n’irait pas assez loin quand pour d’autres, il irait trop loin. C’est le propre d’un texte équilibré que de susciter de telles réactions.
M. Jean-Louis Bricout. Quarante-quatre heures hebdomadaires pendant douze semaines, cela me semble déjà beaucoup, surtout dans certains métiers. Rappelons qu’il existe d’autres outils de flexibilité pour répondre aux surcroîts d’activité. Pensons, par exemple, à l’intérim.
La Commission rejette ces amendements.
Elle en vient ensuite à l’amendement AS563 de M. Arnaud Richard.
M. Arnaud Richard. Cet amendement, que je qualifierai d’amendement d’appel, vise à porter la durée hebdomadaire légale du travail de trente-cinq heures à trente-neuf heures. Nous sommes convaincus que la politique en matière de temps de travail et d’organisation du temps de travail peut constituer un formidable levier d’action pour renouer durablement avec la croissance et transformer en profondeur notre société.
La réflexion sur le temps de travail est ancienne à l’UDI. Elle nous a conduits à demander la création d’une commission d’enquête sur ce sujet en 2014 : commission d’enquête relative à l’impact sociétal, social, économique et financier de la réduction progressive du temps de travail dont le président était Thierry Benoit et la rapporteure Barbara Romagnan.
Selon nous, le temps de travail et son organisation doivent s’inscrire au-delà des débats partisans et des oppositions stériles sur les trente-cinq heures, lesquelles doivent progressivement devenir une durée théorique puisqu’en pratique la durée de travail hebdomadaire habituelle dépasse le seuil légal et s’élève à près de 39,4 heures. Porter la durée hebdomadaire légale à trente-neuf heures payées trente-neuf heures augmenterait le pouvoir d’achat de certains salariés aujourd’hui contraints de travailler trente-cinq heures.
D’après un rapport du Sénat de janvier 2016, « une augmentation de la durée légale de trente-cinq heures à trente-sept heures par semaine serait équivalente à une baisse du coût du travail de l’ordre de 3 %, correspondant à une hausse de la part de la valeur ajoutée revenant aux entreprises d’un montant de 22 milliards, soit une hausse de leurs marges de 2 % ». Cela constituerait, selon le rapporteur général du Sénat, « un choc de compétitivité ».
Monsieur le rapporteur, que ces propos vous fassent sourire m’inquiète car nous tenons enfin là une solution pour le problème de la compétitivité dans notre pays.
M. Bernard Accoyer. Cet amendement me paraît particulièrement opportun. Les multiples commissions d’enquête et missions d’information conduites dans cette maison, par la droite comme par la gauche, ont démontré l’ampleur des conséquences du passage aux trente-cinq heures. Dans le secteur concurrentiel, il a provoqué une hausse du coût du travail, une baisse de la compétitivité des entreprises, et une augmentation du chômage. Dans la fonction publique, initialement non concernée, il a conduit à une hausse du coût du travail des fonctionnaires de plus de 11 % par an. Le chiffre de 20 milliards d’euros par an est couramment admis pour évaluer le coût global des trente-cinq heures.
Compte tenu de notre dette publique et du déficit annuel du budget de la nation, nous mettre à travailler davantage est une priorité.
M. Gérard Sebaoun. Ayant été membre de cette commission d’enquête, je me souviens que les conclusions de la rapporteure, Barbara Romagnan, n’étaient pas tout à fait les mêmes que celles de Thierry Benoit. Je rappellerai aussi que le passage aux trente-cinq heures a été une période faste pour notre société puisque cela a permis la création de 350 000 emplois.
Les Français travaillent environ trente-neuf heures, monsieur Richard. Autrement dit, les quatre heures de travail qu’ils effectuent au-delà de la durée légale de trente-cinq heures leur sont payées en heures supplémentaires et je trouve cela très bien. Pourquoi vouloir porter la durée légale à trente-neuf heures payées trente-neuf heures ?
M. le rapporteur. Je ne vais pas me lancer dans un grand débat sur les trente-cinq heures. Vous savez tous quelle est ma position à ce sujet. Compte tenu du nombre de demandeurs d’emploi, je ne pense pas qu’il soit très légitime de songer à revenir aux trente-neuf heures.
Avis défavorable.
La Commission rejette l’amendement.
Elle examine ensuite l’amendement AS562 de M. Arnaud Richard.
M. Arnaud Richard. Avant d’atteindre notre objectif de retour aux trente-neuf heures, il serait intéressant d’inscrire au sein des dispositions relevant de l’ordre public que le taux de majoration pour les quatre premières heures supplémentaires – soit jusqu’à trente-neuf heures – est fixé à 10 %, sans ouvrir ce champ à la négociation. Cette bonification permettrait d’augmenter progressivement la durée hebdomadaire jusqu’à trente-neuf heures tout en confortant notre compétitivité et la flexibilité du marché du travail. In fine, cet amendement reviendrait à établir une durée de travail de trente-neuf heures payées 39,4 heures.
Et pour ne pas diminuer le pouvoir d’achat des salariés qui travaillent plus de trente-cinq heures, et qui bénéficient d’un taux de majoration des heures supplémentaires de 25 %, nous proposons la défiscalisation des heures supplémentaires.
M. le rapporteur. Votre amendement reviendrait à inscrire dans les dispositions relevant de l’ordre public une modification qui se situe en deçà du supplétif. Avis défavorable.
La Commission rejette l’amendement.
Elle en vient à l’amendement AS676 de M. Serge Bardy.
M. Serge Bardy. Le 15 septembre 2013, François Hollande déclarait que 100 000 emplois avaient été perdus à cause de la défiscalisation des heures supplémentaires décidée sous la présidence de Nicolas Sarkozy dans la loi TEPA. L’exonération des heures supplémentaires de cotisations sociales patronales a en effet favorisé le recours aux heures supplémentaires en cas de hausse de l’activité et a désincité les employeurs à embaucher. Ses effets nuisibles sur l’emploi ont été maintes fois dénoncés.
Et qu’observe-t-on trois ans plus tard ? Non seulement les heures supplémentaires ont été refiscalisées, ce qui a entraîné une perte de pouvoir d’achat pour les salariés, mais l’article 2 du projet de loi permet de diminuer leur rémunération plus facilement. Les alinéas 108 et 109 prévoient en effet que leur taux de majoration peut passer de 25 % à 10 % par simple accord d’entreprise et non plus via un accord de branche alors que les branches dans leur écrasante majorité ont maintenu une majoration de 25 %. À l’heure où l’emploi est affirmé comme la priorité du Gouvernement, il semble paradoxal de faciliter le recours aux heures supplémentaires : elles ne créeront pas d’embauches supplémentaires et les salariés travailleront davantage tout en étant payés moins qu’auparavant.
Si cette disposition entre en vigueur, elle aura deux effets. À court terme, elle aura un impact sur l’emploi en freinant les embauches nouvelles. À moyen terme, elle introduira un dumping social au sein de chaque branche pouvant entraîner une baisse généralisée des salaires. En cas de difficulté dans un secteur, l’existence d’un accord d’entreprise prévoyant une majoration de 10 % des heures supplémentaires au sein d’une entreprise créera un précédent dans la branche. Peu à peu, les entreprises s’aligneront sur les accords les moins favorables qui auront été négociés dans les entreprises où les syndicats sont les plus faibles.
Cet amendement entend rétablir le maintien de la hiérarchie des normes et du principe de faveur en prévoyant qu’une diminution de la majoration des heures supplémentaires ne puisse être possible que dans le cadre d’un accord de branche.
M. le rapporteur. Nous évoquions l’équilibre entre ce qui relève de l’accord de branche et ce qui relève de l’accord d’entreprise. L’un des points forts du projet de loi est de permettre aux entreprises de trouver de la souplesse à travers la primauté de l’accord d’entreprise sur l’accord de branche sur divers points, dont celui que vous évoquez. Avis défavorable.
Mme Isabelle Le Callennec. Autant j’abonde dans le sens de M. Bardy lorsqu’il souligne que la refiscalisation des heures supplémentaires a entraîné une perte de pouvoir d’achat pour les salariés, autant je me sépare de lui lorsqu’il affirme que leur défiscalisation a désincité les employeurs à embaucher. Les chefs d’entreprise nous expliquent tous que lorsqu’ils ont recours aux heures supplémentaires, c’est seulement pour un faible volume qu’ils demandent à un salarié de l’entreprise déjà formé d’effectuer. Cela n’est pas suffisant pour créer un emploi pour un nouveau salarié.
Mme Monique Iborra. Je partage l’avis du rapporteur.
D’une part, le recours aux heures supplémentaires peut constituer une réponse à un surcroît d’activité, conjoncturel par définition.
D’autre part, l’accord d’entreprise, dont relèverait la majoration des heures supplémentaires, est un accord signé par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins 50 % des suffrages, et non plus 30 %. Ne l’oublions pas.
Je comprends que certains estiment que ces dispositions ne sont pas entièrement satisfaisantes mais on ne peut pas dire que le salarié serait placé dans une position défavorable pendant un temps très long.
La Commission rejette cet amendement.
Elle examine ensuite l’amendement AS738 de Mme Éva Sas.
Mme Éva Sas. Vous nous disiez, monsieur le rapporteur, que la course au moins-disant social était un risque avéré mais qu’il fallait examiner cette question point par point. En l’occurrence, les heures supplémentaires sont susceptibles de faire l’objet d’une concurrence entre entreprises. Il nous semble donc pertinent de maintenir la possibilité pour les branches de négocier des accords pour déterminer l’ensemble des éléments relatifs aux heures supplémentaires, à savoir leur taux de majoration, leur contingent et leur contrepartie en repos.
Mme Jacqueline Fraysse. Je soutiens cet amendement. Il est nécessaire de maintenir l’accord de branche comme niveau pertinent pour ce qui relève des heures supplémentaires.
M. Jean-Patrick Gille. J’invite mes collègues à bien réfléchir à cet amendement. S’agissant des heures supplémentaires, nous estimons que la négociation ne peut descendre au niveau de l’accord d’entreprise, sinon une spirale déflationniste portant sur les salaires et les heures supplémentaires apparaîtra rapidement et les petites entreprises, en particulier, risqueront d’être mises en difficulté. S’il y a des branches, c’est pour fixer des règles claires de nature à maintenir une concurrence équilibrée entre les entreprises d’un même secteur, quelle que soit leur taille.
M. Christophe Cavard. Lors des auditions, les représentants des PME, notamment la CGPME, ont souligné que les entreprises de plus petite taille ne seraient pas forcément en mesure de négocier des accords d’entreprise équilibrés. Le rapport Combrexelle, référence de ce projet de loi, avait lui-même mis en avant le fait que la négociation ne pouvait être de même nature selon la nature et la taille des entreprises. On ne peut généraliser ce type de disposition à toutes les entreprises.
J’ajoute n’avoir toujours pas compris d’où provenait ce taux de 10 % pour la majoration des heures supplémentaires. Pourquoi pas 15 % ou 20 % ? N’y a-t-il pas un risque de distorsion trop fort compte tenu de l’écart avec le taux de 25 % qui prévaut actuellement ?
M. Gérard Cherpion. Je suis toujours surpris par cette suspicion dont font l’objet les accords collectifs d’entreprise. Qu’ils aient été signés veut bien dire que les salariés se sont mis d’accord et ont pris leurs responsabilités. En outre, en l’absence d’accord d’entreprise, l’accord de branche prévaut ce qui apporte une sécurité.
M. le rapporteur. J’indique tout d’abord à M. Cavard qu’il est d’ores et déjà possible dans le cadre d’un accord de descendre jusqu’au taux de 10 %.
S’agissant de l’amendement de Mme Sas, mes chers collègues, je trouverais cocasse que la commission l’adopte alors qu’elle a rejeté l’amendement précédent, moins radical. Il vise à interdire l’accord d’entreprise, alors que celui-ci est autorisé aujourd’hui, même si primauté est donnée à l’accord de branche. Autrement dit, il retirerait toute possibilité de souplesse.
Mme Éva Sas. Monsieur le rapporteur, mon amendement n’interdit pas l’accord d’entreprise, il vise seulement à éviter que celui-ci ne soit moins favorable que l’accord de branche.
Le projet de loi aboutit à placer les TPE et PME en position défavorable car il y a très peu de chances pour qu’elles puissent conclure un accord d’entreprise, par exemple pour diminuer le taux de majoration des heures supplémentaires. Cela les expose à subir la concurrence déloyale des grandes entreprises. Je vous invite à discuter de ce point avec elles.
Ce ne serait pas seulement les entreprises qui seraient mises en concurrence entre elles, incitées qu’elles seraient à fixer un taux de majoration le plus faible possible, mais aussi les sites d’une même entreprise car un accord d’établissement pourrait aboutir à une diminution du taux de majoration. Vous savez bien, monsieur le rapporteur, que les sites d’une même entreprise sont déjà mis en concurrence.
M. le rapporteur. Je maintiens, madame Sas, que votre amendement revient à interdire les accords d’entreprise puisqu’il vise à supprimer à l’alinéa 108 les mots « Une convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement » pour ne laisser que les mots « une convention ou un accord de branche ». Ce n’était peut-être pas votre objectif mais cela aboutit à ce résultat.
La Commission rejette cet amendement.
Elle est saisie de l’amendement AS744 de Mme Éva Sas.
Mme Éva Sas. Cet amendement de repli vise à limiter aux accords de branche la possibilité de dérogation dans un sens moins favorable s’agissant de la majoration des heures supplémentaires, sur laquelle les entreprises et les sites d’une même entreprise risquent très fortement d’être mis en concurrence.
M. le rapporteur. Aujourd’hui, il est possible par accord de fixer un taux de majoration à 10 %. Votre amendement ne le permettrait plus. Avis défavorable.
Mme Éva Sas. Sauf erreur de ma part, cette diminution est possible par accord de branche et non par accord d’entreprise.
M. le rapporteur. Il est possible de descendre à 10 % par accord d’entreprise, à défaut d’accord de branche.
La Commission rejette cet amendement.
Elle en vient à l’amendement AS234 de Mme Marie-Lou Marcel.
Mme Marie-Lou Marcel. Le taux de majoration des heures supplémentaires doit être identique à celui prévu au premier alinéa de l’article L. 3121-22 du code du travail, soit 25 % pour les huit premières heures et 50 % au-delà. La fixation d’un taux de 10 % est aujourd’hui possible par accord de branche mais dans les faits, très peu de branches ont retenu cette valeur. La généralisation d’un taux de 10 % par accord d’entreprise aurait un impact négatif sur le revenu des salariés. C’est la raison pour laquelle mon amendement propose de fixer le taux minimal à 25 % et non pas 10 %.
M. le rapporteur. Il y a peu d’accords à 10 % – Mme Marcel a raison – mais il en existe. Vous suggérez de supprimer la possibilité de descendre en dessous du taux de majoration de 25 %. Pourquoi revenir sur des possibilités qui existent ? Puisque ces accords sont peu nombreux, ils ne devraient pas vous effrayer à ce point. Tout le monde ne parle que de négociation collective mais dès qu’il est question de la mettre en pratique, on veut impérativement la corseter. Avis défavorable.
M. Bernard Accoyer. Nous sommes vraiment à front renversé par rapport à l’esprit du texte. Cet amendement introduit une rigidité supplémentaire et, dans bien des cas, une hausse du coût du travail et une perte de compétitivité. On ne voit pas comment l’objectif du texte – résoudre le problème du chômage – pourrait être atteint de cette façon.
Mme Isabelle Le Callennec. Monsieur le rapporteur, vous disiez que peu de branches avaient adopté un taux de majoration des heures supplémentaires à 10 %. Pourriez-vous nous citer des exemples ?
M. le rapporteur. Il s’agit essentiellement, voire exclusivement, de l’hôtellerie et du tourisme.
Mme Marie-Lou Marcel. J’entends bien ce que l’on me dit sur les entreprises mais je reprendrai le titre du texte : « Projet de loi visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections pour les entreprises et les actifs. » Je ne pense pas que généraliser à 10 % le taux de majoration des heures supplémentaires soit une nouvelle protection pour les salariés.
La Commission rejette l’amendement.
Puis elle en vient à l’amendement AS920 du rapporteur.
M. le rapporteur. Cet amendement propose de rétablir une disposition qui a été omise à la faveur de l’introduction de la nouvelle architecture des normes, à savoir l’information des instances représentatives du personnel pour les heures supplémentaires accomplies dans l’entreprise dans le cadre du contingent annuel, et la consultation de ces mêmes instances pour les heures accomplies au-delà du contingent annuel.
La Commission adopte l’amendement.
Elle examine ensuite l’amendement AS912 du rapporteur.
M. le rapporteur. C’est le même sujet : le rétablissement de la consultation des institutions représentatives du personnel.
Mme Isabelle Le Callennec. S’agit-il d’un avis consultatif ou d’un avis conforme ?
M. le rapporteur. Il s’agit d’un avis consultatif.
La Commission adopte l’amendement.
Puis elle examine, en discussion commune, les amendements AS235 de Mme Marie-Lou Marcel et AS751 de Mme Éva Sas.
Mme Marie-Lou Marcel. Les alinéas 132, 133 et 134 prévoient une période de référence pour le déclenchement des heures supplémentaires allant jusqu’à trois ans. Or la prise en compte d’une telle durée est préjudiciable à l’organisation de vie et de travail des salariés. De plus, elle peut engendrer, pour les femmes en particulier, des charges supplémentaires de garde d’enfant ou autres. C’est pourquoi je propose que la période de référence pour le déclenchement des heures supplémentaires ne puisse excéder un an comme mentionné aux articles L. 3122-1 à L. 3122-6 du code du travail.
M. Bernard Accoyer. Encore de la rigidité à la place d’une certaine souplesse et d’une certaine stabilité. L’amendement va à contresens de l’objectif du texte.
M. le rapporteur. Je me suis moi-même interrogé sur cette période de trois ans et, objectivement, je comprends l’argumentation développée. Cela étant, même dans le cadre de ce qui est proposé aujourd’hui, l’accord devra fixer une limite au-delà de laquelle les heures supplémentaires effectuées seront considérées comme des heures supplémentaires, et le cadre de référence pour le calcul des durées maximales de travail restera calqué sur les limites de droit commun.
En outre, votre amendement pose un problème de forme : vous supprimez les deux alinéas qui fixent le cadre de référence – indispensable même si l’on reste dans un horizon annuel.
Enfin, la suppression sèche de la possibilité de procéder par voie unilatérale ne me semble pas souhaitable : c’est l’une des mesures du projet de loi favorable aux petites entreprises qui ne sont pas outillées pour négocier des accords de modulation du temps de travail. Cette possibilité de modulation unilatérale existe déjà actuellement dans une limite de quatre semaines.
Pour résumer, il existe des dispositions qui permettent de répondre à votre inquiétude légitime, et votre amendement supprime des éléments importants, ce qui ne me semble pas être votre intention de départ. Avis défavorable.
M. Gérard Sebaoun. Comme le rapporteur vient de le souligner, ce n’est pas une bonne idée de supprimer les alinéas 133 et 134. En revanche, je mets en garde contre l’idée de faire passer la période de référence à trois ans : je doute de la capacité d’un salarié à faire valoir ses droits sur une période aussi longue. Cela me paraît extrêmement compliqué. Je comprends les réticences – partagées par le rapporteur – à faire passer la période d’un à trois ans. En revanche, tel que rédigé, l’amendement supprime des alinéas utiles.
M. Jean-Patrick Gille. On peut rectifier l’amendement en supprimant le II. Je tiens à rappeler que la mesure étudiée figure dans l’ordre public, c’est-à-dire qu’elle deviendra la règle pour tous.
Mme la présidente Catherine Lemorton. Ce n’est pas possible car il y a trop de sous-amendements de conséquence.
M. le rapporteur. Le premier élément implique en effet trop de sous-amendements de conséquence.
Mme Éva Sas. Mon amendement va dans le même sens que celui de ma collègue puisqu’il vise à supprimer la possibilité de moduler les heures supplémentaires sur une période de trois ans. Ce délai est trop important parce qu’il entraîne un paiement différé qui peut mettre en difficulté certaines familles, sans parler du risque de non-paiement des heures supplémentaires. En outre, une telle disposition va à l’encontre de la prévisibilité du temps libre. Comme mon amendement ne demande que la modification de l’alinéa 132, il me semble répondre à la préoccupation du rapporteur. Nous pouvons rediscuter de sa rédaction avant le passage du texte en séance, mais il nous semble important de revenir à la période d’un an.
M. Jean-Louis Bricout. La longueur de cette période peut aussi être compliquée à gérer pour les entreprises : le report de ces charges salariales sera décalé par rapport à d’autres calculs – fiscaux notamment – qui s’effectuent sur un an.
M. Christophe Cavard. Les chefs d’entreprise – je le dis à nos collègues enclins à prendre leur défense – vont avoir du mal à tenir une comptabilité de ces heures sur une période de trois ans. En outre, si je lis bien l’alinéa 140, il est possible de revenir à une période de référence d’un an dans le champ de la négociation collective. J’avoue que je suis un peu perdu et que j’aurais besoin des éclaircissements du rapporteur.
Mme Marie-Lou Marcel. Pour en revenir à l’amendement AS235, l’alinéa 133 n’a effectivement pas à être supprimé. En revanche, il faudrait apporter une modification à l’alinéa 134 : écrire « inférieure ou égale à un an » au lieu d’« inférieure ou supérieure à un an ».
M. le rapporteur. Madame Marcel, votre amendement n’est pas rédigé en ce sens. Je confirme qu’il ne peut être retenu tel que rédigé. Vous pouvez le réécrire avant l’examen du projet de loi en séance publique. En l’état actuel des choses, je ne peux qu’émettre un avis défavorable, nonobstant mon propos sur l’ensemble de votre argumentaire.
En réponse à Christophe Cavard, j’indique que l’ordre public fixe le délai maximal, c’est-à-dire une période de référence pouvant aller jusqu’à trois ans. Ensuite, l’accord de branche se situe à l’intérieur de ce délai maximum.
M. Gérard Cherpion. Cette période de trois ans n’a pas été définie par hasard. Elle correspond à des entreprises – celles du secteur automobile, par exemple – pour lesquelles les variations économiques sont extrêmement importantes. D’ailleurs, cet alinéa 132 est ainsi rédigé : « Cette période de référence ne peut pas dépasser trois ans en cas d’accord collectif et neuf semaines en cas de décision unilatérale. » Il marque bien une différence de traitement entre les grandes entreprises et les petites entreprises. Ces dernières ne peuvent pas, en effet, prévoir sur des durées très longues. Mais je ne vois pas la difficulté qu’il y a à prendre une période de trois ans pour de grandes entreprises.
M. le rapporteur. Pour résumer, je réitère mon avis défavorable à ces deux amendements pour des raisons à la fois de fond et de forme.
La Commission rejette successivement les amendements AS235 et AS751.
Puis elle examine, en discussion commune, l’amendement AS236 de Mme Marie-Lou Marcel et AS96 de M. Gérard Cherpion.
Mme Marie-Lou Marcel. Mon argumentaire reste le même, mais il s’applique cette fois à l’alinéa 140.
M. Gérard Cherpion. On arrive à l’alinéa 140 dont parlait Christophe Cavard : « La période de référence, qui ne peut excéder un an ou, si un accord de branche l’autorise, trois ans. » Il faut supprimer la limite d’un an pour rester en cohérence avec ce que nous avons déjà adopté.
M. le rapporteur. S’agissant de l’amendement de Mme Marcel, le raisonnement est le même que tout à l’heure, sauf que nous nous situons maintenant dans le champ de la négociation. Je suis défavorable à ces amendements, pour des raisons de fond et de forme.
La Commission rejette successivement les amendements AS236 et AS96.
Elle en vient ensuite à l’amendement AS237 de Mme Marie-Lou Marcel.
Mme Marie-Lou Marcel. Toujours dans la même logique, je propose de réécrire l’alinéa 145, en gardant une période de référence inférieure à un an.
M. le rapporteur. Mme Marcel a raison : il s’agit d’un amendement de conséquence. Étant conséquent avec moi-même, j’émets un avis défavorable.
La Commission rejette l’amendement.
Puis elle examine, en discussion commune, l’amendement AS878 du rapporteur pour avis de la Commission des affaires économiques et l’amendement AS160 de M. Gérard Cherpion.
M. Yves Blein, rapporteur pour avis de la Commission des affaires économiques. Cet amendement a été adopté par la Commission des affaires économiques où nous avons réfléchi sur la pertinence qu’il y avait à retenir une période de référence plutôt qu’une autre en matière d’aménagement du temps de travail. Le projet de loi veut porter cette période de quatre à neuf semaines, c’est-à-dire deux mois et une semaine, alors que le rythme de vie est plutôt indexé sur le mois. L’entreprise paie les salaires tous les mois, et le trimestre est souvent la période de référence pour arrêter des comptes intermédiaires et faire le point sur les commandes. Pour le salarié, le trimestre peut aussi être le bon cycle d’aménagement de son temps, notamment parce qu’il permet d’intégrer le rythme de la scolarité et des vacances des enfants. Avec une visibilité de trois mois, le salarié est en mesure de mieux s’organiser. Par cet amendement, nous proposons donc de modifier l’alinéa 149, et de prévoir une répartition de la durée du travail sur douze semaines, dans l’intérêt bien compris des salariés et des entreprises.
M. Gérard Cherpion. Mon amendement propose d’en revenir au projet initial et d’opter pour une durée de seize semaines. Cela étant, je me rallie à la position équilibrée de M. Blein, et je retire mon amendement.
L’amendement AS160 est retiré.
M. le rapporteur. Le texte prévoit neuf semaines pour les entreprises de moins de cinquante salariés et quatre semaines pour les autres. J’entends l’argumentaire du rapporteur pour avis, mais je rappelle que le choix qui a été fait est le fruit d’une concertation engagée avec les partenaires sociaux. C’est pourquoi j’émets un avis défavorable à l’amendement.
M. Lionel Tardy. Douze semaines, c’est-à-dire un trimestre, me semble une période raisonnable. En plus, cet amendement est l’un des rares présentés par la Commission des affaires économiques dont je fais partie ainsi que d’autres ici qui n’ont pas le droit de voter. Comme notre commission n’a pas été saisie au fond sur ce texte, il serait bon que quelques-uns de ses amendements puissent être adoptés.
Mme la présidente Catherine Lemorton. Monsieur Tardy, jusqu’à preuve du contraire, le code du travail relève plutôt du domaine de la Commission des affaires sociales. Il fallait venir nous rejoindre dès le début de la législature.
La Commission rejette l’amendement AS878.
Puis elle en vient à l’amendement AS359 de M. Serge Bardy.
M. Serge Bardy. Cet amendement vise à supprimer l’alinéa 151 qui crée une ambiguïté. L’alinéa 149 indique : « À défaut d’accord mentionné à l’article L.3121-42, l’employeur peut mettre en place une répartition de la durée du travail sur plusieurs semaines, dans la limite de neuf semaines pour les entreprises employant moins de cinquante salariés et de quatre semaines pour les entreprises de cinquante salariés et plus, dans des conditions fixées par décret. » Or à l’alinéa 150, il est précisé : « Dans les entreprises qui fonctionnent en continu, l’employeur peut mettre en place une répartition de la durée du travail sur plusieurs semaines. » Ces alinéas sont potentiellement contradictoires ou, du moins, leur articulation est trop imprécise. De manière générale, l’extension du pouvoir unilatéral de l’employeur sur la répartition de la durée du travail sur plusieurs semaines n’est pas souhaitable et n’incite pas à la négociation collective.
M. le rapporteur. Je ne comprends pas très bien l’amendement. Il vise à supprimer une disposition sur le délai de prévenance des salariés en cas de changement d’horaire ou de durée du travail, applicable de manière supplétive, et qui reprend le délai actuel de sept jours. Vous renvoyez aux deux articles précédents mais il s’agit, d’une part, de la possibilité d’aménager le temps de travail de manière unilatérale, et, d’autre part, de cas particuliers d’entreprises fonctionnant en continu. À mon avis, ils n’ont rien à voir avec ces délais de prévenance qui s’appliquent dans tous les cas d’aménagement du temps de travail, dans l’hypothèse où l’accord collectif sur le sujet ne fixerait pas de délai spécifique. Je pense qu’il est plutôt prudent de conserver cet alinéa 151. Je propose que l’on se voie pour retravailler le sujet. Si vous maintenez votre amendement, je vais être obligé d’émettre un avis défavorable parce que je ne comprends pas bien ce que vous voulez faire.
M. Serge Bardy. Je suis d’accord pour retravailler le sujet.
L’amendement est retiré.
La Commission examine l’amendement AS97 de M. Gérard Cherpion.
M. Gérard Cherpion. Cet amendement a pour objet de rétablir la rédaction initiale du projet de loi, en ce qui concerne la possibilité donnée à l’employeur de mettre en place un dispositif d’heures individualisées, qui permet un report d’heures d’une semaine sur l’autre. Actuellement, un tel dispositif peut être mis en place par l’employeur, dès lors qu’il n’y a pas d’opposition du comité d’entreprise, ou à défaut, des délégués du personnel. Imposer un avis conforme conduirait à rendre plus compliqué la mise en œuvre de ce dispositif, sans justification. En l’absence de représentants du personnel, il convient de revenir à la rédaction initiale du projet de loi, à savoir une information de l’inspection du travail.
Mme la présidente Catherine Lemorton. Il n’y a pas de projet de loi initial ! Il y a le projet de loi, celui que nous avons entre les mains.
M. le rapporteur. Nous avons d’autant plus besoin de l’accord des instances représentatives du personnel qu’il est question d’horaires individualisés. Il n’y a aucune raison que ces instances soient amoindries à la faveur de l’amendement que vous proposez et de la nouvelle architecture de normes mises en œuvres dans le cadre de cet article. Avis défavorable.
La Commission rejette l’amendement.
Puis elle en vient à l’amendement AS255 de M. Gérard Cherpion.
M. Gérard Cherpion. L’objet de cet amendement, relatif à l’alinéa 157, est de revenir au texte que nous avions eu – qui n’est peut-être pas la rédaction initiale – en ce qui concerne la possibilité donnée à l’employeur de mettre en place un dispositif d’heures individualisées. L’exposé des motifs est le même que pour l’amendement précédent.
M. le rapporteur. Là encore, je ne vois pas pourquoi l’on passerait d’une autorisation à une simple information de l’inspecteur du travail. Les horaires individualisés méritent, au contraire, d’être particulièrement suivis : ils permettent un report d’heures d’une semaine sur l’autre, ce qui évite le paiement d’heures supplémentaires. Ils doivent rester exceptionnels et n’être mis en œuvre qu’à la demande du salarié. Il convient de conserver leur régime protecteur. Avis défavorable.
Mme Isabelle Le Callennec. L’histoire ne dit pas de combien de temps dispose l’inspecteur du travail pour rendre son avis. Autoriser peut prendre plus de temps qu’être informé.
M. le rapporteur. C’est le système actuellement en vigueur et il fonctionne.
M. Gérard Cherpion. À partir du moment où l’inspection du travail est informée, elle peut prendre toutes les dispositions qu’elle souhaite. L’autorisation allonge les délais et supprime de la souplesse pour un résultat identique.
M. Bernard Accoyer. On se demande pourquoi le Gouvernement ne se met pas d’accord avec nous. Vous voyez bien que nous soutenons les dispositions qui avaient été proposées au départ. Il y a une majorité alternative qui permettrait de réelles avancées en ce qui concerne le code du travail. On aiderait ainsi François Hollande à peut-être obtenir le résultat qu’il nous promet depuis le début de son mandat.
Mme la présidente Catherine Lemorton. Monsieur Accoyer, je vous invite à le soutenir jusqu’à jeudi ou vendredi si nous sommes encore ici.
La Commission rejette l’amendement.
Elle examine ensuite l’amendement AS238 de Mme Marie-Lou Marcel.
Mme Marie-Lou Marcel. Il est défendu.
M. le rapporteur. Cet amendement vise à supprimer le dispositif de renoncement du salarié à des jours de repos dans le cadre d’une convention de forfait en jours. Je pense que nous devons rester à droit constant parce qu’il n’y a pas de raison de supprimer cet élément. Avis défavorable.
La Commission rejette l’amendement.
Elle en vient ensuite aux amendements identiques AS296 de M. Christophe Cavard, AS675 de Mme Audrey Linkenheld et AS762 de Mme Jacqueline Fraysse.
M. Christophe Cavard. Cet amendement propose de supprimer l’alinéa 196 : « Lorsque l’employeur a fixé des échéances et une charge de travail compatibles avec le respect du repos quotidien et hebdomadaire et des congés du salarié, sa responsabilité ne peut être engagée au seul motif que le salarié n’a, de sa propre initiative, pas bénéficié de ces repos ou congés. » Cette disposition contredit en effet une jurisprudence constante de la Cour de cassation selon laquelle il est de la responsabilité de l’employeur d’assurer la prise des congés par les salariés.
Mme Marie-Lou Marcel. Je considère que mon amendement identique est défendu.
Mme Jacqueline Fraysse. Par cet amendement, il s’agit de supprimer l’alinéa 196 qui inverse la charge de la preuve en matière de responsabilité de contrôle du temps de travail des salariés en forfait en jours. Ce dispositif est régulièrement sanctionné par le Comité européen des droits sociaux pour sa non-conformité avec la Charte sociale européenne. En effet, le contrôle du temps de travail relève de la responsabilité de l’employeur. Or la rédaction, que vous proposez à cet alinéa, implique que l’employeur est exonéré de toute responsabilité dès lors que celui-ci « a fixé des échéances et une charge de travail compatibles avec le respect du repos quotidien et hebdomadaire et des congés du salarié. » Cette formulation fait donc peser sur le salarié en forfait en jours, la responsabilité du contrôle du temps de travail, ce qui va à l’encontre de la jurisprudence de la Cour de cassation. Celle-ci précise en effet que l’employeur est tenu d’établir un contrôle régulier de la charge de travail, à travers un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées de travail, ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos. Cette responsabilité du contrôle du temps de travail qui incombe à l’employeur s’explique également par l’obligation de résultat qui pèse sur lui afin de préserver la sécurité et la santé du salarié soumis au régime du forfait en jours. Pour toutes ces raisons, nous souhaitons supprimer cet alinéa.
M. le rapporteur. Je partage les interrogations des porteurs des trois amendements qui viennent d’être présentés. À l’évidence, il y a un renversement de la charge de la preuve que je n’arrive pas à comprendre. J’émets donc un avis favorable aux amendements.
M. Gérard Cherpion. Il faut reprendre le texte de cet alinéa. Il est indiqué que l’employeur a fixé une charge de travail compatible avec le respect du repos et des congés du salarié. C’est dans le cas où le salarié, de sa propre initiative, n’a pas pris ces repos ou congés, que la responsabilité de l’employeur n’est pas en cause. Il me semble que c’est la moindre des choses.
Mme Jacqueline Fraysse. Est-il fréquent que les salariés renoncent à leur repos et congés ?
M. Gérard Cherpion. Je rappelle que nous sommes dans le cas de forfaits en jours. Je ne comprends pas votre position.
M. Gérard Sebaoun. Imaginons que le salarié mette sa santé en danger en maximisant son nombre d’heures de travail. L’employeur a une responsabilité pleine et entière : c’est le droit.
M. Alain Fauré. Certains salariés – j’en connais dans mon entourage – accumulent des heures supplémentaires pour pouvoir prendre des jours de congé. C’est peut-être dommage de priver des personnes de la possibilité de gérer leur temps de cette façon.
La Commission adopte les amendements.
La Commission examine l’amendement AS98 de M. Gérard Cherpion.
M. Gérard Cherpion. Mon amendement s’applique au travail et aux travailleurs de nuit, et permet de sécuriser les accords sur le forfait en jours, en n’appliquant pas les mesures sur le travail de nuit afin d’éviter une nouvelle renégociation.
M. le rapporteur. Sur la forme, je crains qu’il n’y ait un problème de référence sur les deux articles cités, dont la numérotation n’est pas exacte. Sur le fond, s’il faut comprendre que les critères du travail de nuit et la réglementation de la période de nuit ne s’appliquent pas aux salariés soumis au forfait en jours, je ne peux qu’y être farouchement opposé. Je ne vois pas ce qui justifierait une telle exception.
Je rappelle que le dispositif du forfait en jours a déjà fait l’objet de plusieurs condamnations au niveau européen et au niveau communautaire, au motif qu’il ne garantissait pas suffisamment la santé et la protection des salariés. Le statut du travailleur de nuit concerne les employés qui travaillent deux fois trois heures par semaine sur les périodes de nuit comprises entre vingt et une et six heures du matin, ou sur une période différente définie par accord, ou 270 heures par an.
Ne revenons pas, avec votre amendement, sur les acquis de ce statut particulier, qui me paraissent essentiels. Avis défavorable.
La Commission rejette l’amendement.
Puis elle examine l’amendement AS99 de M. Gérard Cherpion.
M. Gérard Cherpion. L’objet de cet amendement est de rétablir la rédaction initiale du projet de loi sur la possibilité dans le cadre de l’accord collectif instituant le forfait en jours de prévoir des modalités de fractionnement du repos afin de tenir compte des nouvelles modalités d’organisation du travail liées à l’usage des outils numériques. Le retrait de cette disposition du texte est d’autant moins compréhensible que ce fractionnement doit être prévu par accord collectif, faire l’objet d’un accord du salarié et garantir une durée minimale de repos, soit des garanties significatives.
M. le rapporteur. Monsieur Cherpion, vous défendez l’idée d’un fractionnement du repos quotidien et du repos hebdomadaire du salarié en forfait jours. J’attire de nouveau votre attention sur les risques juridiques qui s’attachent au forfait en jours.
La possibilité d’un fractionnement est envisagée à l’article 26 du projet de loi, article relatif au développement du télétravail et du travail à distance. Pour l’heure, il me semble que votre proposition est défavorable aux intérêts du salarié. Avis défavorable.
Mme Isabelle Le Callennec. Il faut pourtant avoir en tête l’exemple des femmes qui ont le statut de cadres et repartent travailler après être allées chercher leurs enfants à l’école. Cet amendement a pour objet de sécuriser les conditions de travail de ces personnes, qui sont de plus en plus nombreuses.
La Commission rejette l’amendement.
Elle examine ensuite l’amendement AS360 de M. Serge Bardy.
M. Serge Bardy. À travers cet amendement, je propose de supprimer les alinéas 216 à 222 de l’article. Car il n’est pas souhaitable qu’une entreprise puisse conclure des conventions de forfaits en jours en l’absence d’accord collectif.
M. le rapporteur. Vous proposez de supprimer des dispositions supplétives ! Elles seules peuvent justement apporter des éléments de sécurité au salarié en l’absence d’accord. Je plaide donc pour un retrait.
L’amendement est retiré.
La Commission en vient à l’amendement AS361 de M. Serge Bardy.
M. Serge Bardy. Je propose de limiter le forfait en jours à 203 jours par an. En admettant que l’on soit prêt à envisager que des entreprises puissent conclure des conventions de forfait hors accord collectif, il conviendrait alors que les dispositions supplétives soient très incitatives à la négociation et encadrent significativement le pouvoir unilatéral de l’employeur.
Dans cet esprit, cet amendement propose de maintenir la possibilité pour les entreprises de conclure des conventions de ce type hors accord collectif, à condition que le plancher du forfait en jours soit sensiblement plus avantageux. Il est proposé de fixer le plafond à 203 jours, soit trois semaines de jours de repos en plus que pour les entreprises bénéficiant d’un accord. Cette durée de 203 jours n’a rien d’exceptionnel : de nombreuses entreprises appliquent des forfaits en jours de cet ordre de grandeur.
M. le rapporteur. Je ne sais pas à quoi correspondent ces 203 jours. Je rappelle que le plafond fixé aujourd’hui dans le cadre de la négociation collective s’établit à 218 jours, qui peuvent monter jusqu’à 235 en cas de renonciation du salarié à ses jours de repos. Vous ne supprimez d’ailleurs pas ces alinéas-là, de sorte que des nombres de jours différents seraient applicables… Il y a un problème de cohérence. Avis défavorable.
La Commission rejette l’amendement.
Puis elle examine l’amendement AS75 de M. Lionel Tardy.
M. Martial Saddier. L’avant-projet soumis au Conseil d’État offrait la possibilité de négocier directement et individuellement avec les salariés la modulation du temps de travail, en particulier l’instauration d’un forfait en jours. Alors qu’elle autorise plus de flexibilité sur la base d’un dialogue, cette mesure ne figure pas finalement dans le projet de loi.
Cet amendement propose donc de la rétablir en prévoyant que les conventions de forfait en jours sont accessibles aux PME de moins de 50 salariés par simple accord entre l’employeur et son salarié.
M. le rapporteur. Avis défavorable. Vous nous proposez en fait l’inverse de ce que proposait M. Bardy, puisque vous voulez procéder de manière unilatérale, ce qui est exorbitant du droit commun. Cela me semble délicat pour le forfait en jours, dispositif qui doit rester réservé à une catégorie restreinte de salariés, car il n’est pas, selon le droit européen, suffisamment protecteur du salarié.
Mme Isabelle Le Callennec. Que faut-il comprendre par « catégorie restreinte de salariés » ?
M. le rapporteur. Selon le projet de loi, il s’agit des cadres dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés, ou bien les salariés qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.
La Commission rejette l’amendement.
Elle en vient ensuite à l’amendement AS362 de M. Serge Bardy.
M. Serge Bardy. Dans une entreprise n’ayant pas conclu d’accord collectif, il convient d’encadrer au maximum le pouvoir unilatéral de l’employeur pour éviter les dérives. Ainsi, on ne peut pas laisser ouvert le risque de « triple peine » : non-respect du temps de travail normal, absence de congés compensateurs, et absence d’accord collectif.
C’est pourquoi cet amendement préconise d’abaisser à 225 jours plutôt que 235 jours le plafond du nombre de jours maximum travaillés dans l’année, même lorsque le salarié renonce à des journées de repos en compensation d’une rémunération. On sait très bien que, dans les faits, cette situation se produit le plus souvent du fait d’une surcharge de travail empêchant les salariés de poser normalement leurs journées de repos, ce qu’il convient de ne pas encourager dans les entreprises où le garde-fou du CHSCT et des délégués syndicaux n’existent pas.
Comme vous l’avez rappelé, les salariés concernés par le forfait en jours sont normalement ceux qui jouissent d’une réelle autonomie d’emploi du temps.
M. le rapporteur. De nouveau, je ne sais pas à quoi correspondent ces 225 jours.
M. Serge Bardy. Il s’agit d’inciter à un accord collectif, plutôt qu’à une négociation de gré à gré entre employeur et salarié.
Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement.
Puis elle examine, en discussion commune, les amendements AS161 de M. Gérard Cherpion et AS599 de M. Rémi Delatte.
M. Bernard Accoyer. La première version du texte prévoyait la possibilité de conclure des conventions de forfaits en dehors d’accords collectifs dans les entreprises de moins de cinquante salariés. Cette disposition a été retirée du texte avant sa présentation en conseil des ministres.
Or les entreprises concernées sont des petites structures où la proximité entre l’employeur et ses salariés interdit de facto au chef d’entreprise d’imposer à ses salariés un rythme qui leur serait une contrainte en désaccord avec eux. Sans véhiculer une vision angélique et béate de l’entreprise, il convient de faire confiance au dialogue social particulier qui est celui des petites structures.
C’est pourquoi cet amendement propose de réintroduire la conclusion de conventions individuelles de forfaits en heures ou en jours dans les petites entreprises par décision unilatérale de l’employeur, seule possibilité de donner de la souplesse aux employeurs et aux salariés concernés, lorsqu’ils le souhaitent.
M. Rémi Delatte. Le présent amendement vise à autoriser les entreprises de moins de 50 salariés à mettre en place des forfaits en jours sans accord collectif, répondant ainsi à une demande récurrente tant des entreprises que des salariés concernés, qui veulent avoir prise sur leur vie au travail. Il va ainsi dans le sens d’un pragmatisme et d’une souplesse accrus dans l’organisation du travail. Lui aussi revient au texte de l’avant-projet de loi.
M. le rapporteur. Le problème réside à mes yeux tant dans la possibilité unilatérale ainsi ouverte à l’employeur que dans le fait que le régime des conventions de forfait, encadré et contraint, a déjà fait l’objet de condamnations au niveau européen. Le dispositif que vous suggérez, par surcroît mis en œuvre de manière unilatérale, me semble inapproprié. Avis défavorable.
La Commission rejette successivement les deux amendements.
Elle en vient ensuite à l’amendement AS241 de Mme Marie-Lou Marcel.
Mme Marie-Lou Marcel. Cet amendement pose la question du travail de nuit. Il convient de réaffirmer dans la loi les dispositions actuellement prévues dans le code du travail. Elles permettent un suivi médical sérieux et effectif des salariés travaillant en horaires de nuit. C’est pourquoi je propose d’ajouter, après l’alinéa 242, différentes précisions sur la surveillance particulière des travailleurs de nuit.
M. le rapporteur. Je suis, par principe, plutôt hostile à la démarche consistant à donner valeur législative à des normes qui relèvent du niveau réglementaire. Par ailleurs, l’on peut discuter, sur le plan législatif, de la fréquence du suivi requis. La séance publique nous donnera peut-être l’occasion d’avancer sur ce sujet, mais non sur le reste : avis défavorable.
M. Gilles Lurton. Comment appliquer de telles dispositions avec seulement 5 000 inspecteurs du travail ?
La Commission rejette l’amendement.
Puis elle examine l’amendement AS100 de M. Gérard Cherpion.
Mme Isabelle Le Callennec. Cet amendement porte sur les dispositions d’ordre public relatives au travail de nuit. Il porte à seize semaines la période de référence pour apprécier la durée maximale hebdomadaire. Il s’agit simplement de s’aligner sur la norme européenne.
M. le rapporteur. Contrairement à ce que dit votre amendement, la directive du 4 novembre 2003 sur l’aménagement du temps de travail ne fixe pas à seize semaines la période de référence pour définir le travail de nuit. Elle la retient pour apprécier la durée hebdomadaire de travail. En tout état de cause, cette période ne constitue qu’un maximum, qui n’exclut pas la possibilité que la législation d’un État membre soit plus favorable au salarié. Autrement dit, la législation européenne ne fixe qu’une période maximale. Rien ne nous oblige à aligner les périodes de référence dans notre législation sur ces définitions européennes.
La Commission rejette l’amendement.
Elle en vient ensuite à l’amendement AS748 de Mme Éva Sas.
M. Philippe Noguès. Le travail de nuit constitue un danger reconnu pour la santé des travailleurs et il fait à ce titre partie des facteurs de pénibilité qui sont pris en compte dans le compte personnel de prévention de la pénibilité.
Travailler de nuit affecte la mémoire, l’attention et la réactivité de l’individu. Plus grave encore des études récentes ont montré l’impact du travail de nuit sur le système cardio- vasculaire et le développement de cancers. Il est donc inquiétant d’envisager de diminuer le suivi médical des salariés qui travaillent de nuit. Cet amendement vise donc à rétablir leur suivi semestriel.
M. Michel Issindou. Les professionnels reconnaissent que le travail de nuit amène des difficultés de santé, mais un suivi semestriel n’apporte pas grand-chose de plus. Eux-mêmes disent qu’il faut seulement un suivi régulier, probablement annuel, mais pas davantage. La Haute autorité de santé (HAS) ne dit rien d’autre non plus.
M. Gérard Sebaoun. Je suis d’accord avec l’exposé des motifs, mais je partage l’avis de notre collègue Michel Issindou. Le salarié en difficulté peut, de toute façon, demander à tout moment à voir le médecin du travail.
M. le rapporteur. C’est le contenu du suivi qui doit nous occuper, plutôt que sa périodicité. Avis défavorable.
La Commission rejette l’amendement.
Puis elle examine l’amendement AS504 de M. Gérard Sebaoun.
M. Gérard Sebaoun. Lorsqu’un salarié devient inapte au travail de nuit, il doit récupérer un emploi de jour. Par mon amendement, je voudrais garantir que ce salarié peut avoir le choix entre différents emplois de jour, quand c’est possible. Le choix de l’article indéfini « un » me semble risquer en effet de limiter l’employeur à ne proposer qu’un seul poste.
M. le rapporteur. Je partage cette préoccupation. La rédaction actuelle laisse entendre que ce choix multiple est ouvert, mais précisons-le si c’est nécessaire. Avis favorable.
La Commission adopte l’amendement.
Elle en vient ensuite à l’amendement AS750 de Mme Éva Sas.
M. Philippe Noguès. Cet amendement vise à rétablir le délai minimum de sept jours ouvrés comme délai de prévenance des salariés quant à leurs changements d’emploi du temps. Il tend ainsi à garantir aux travailleurs une certaine prévisibilité de l’organisation de leur travail. C’est leur qualité de vie qui est en jeu. Le temps qui n’est pas consacré au travail peut être du repos, mais aussi être mis à profit pour une activité sociale. Il est donc important de pouvoir prévoir l’organisation de son temps.
M. le rapporteur. Je partage cette préoccupation, mais je ne suis pas sûr que ces dispositions doivent être mises au nombre des dispositions d’ordre public. Elles relèvent davantage du droit supplétif, me semble-t-il. Avis défavorable.
La Commission rejette l’amendement.
Puis elle examine l’amendement AS621 de Mme Catherine Coutelle, présidente de la délégation aux droits des femmes.
Mme Catherine Coutelle, présidente de la délégation aux droits des femmes. Je voudrais poser le problème du temps partiel, qui concerne principalement les femmes. Son essor dans les années 1980 conduit à ce que 3,7 millions de femmes travaillent aujourd’hui à temps partiel – 31 % de salariées femmes contre seulement 6 % de salariés hommes.
La pratique du temps partiel est rarement un choix et entraîne des salaires faibles. Ce travail se caractérise aussi par des horaires atypiques. Des salaires horaires à temps plein se sont révélés plus élevés, à 14,60 euros de l’heure, que le salaire horaire à temps partiel, à 12,23 euros de l’heure.
Lors de la validation de l’accord national interprofessionnel de 2013, nous avions fait adopter un article L. 3123-14-1 du code du travail, pour que le temps partiel ne puisse être inférieur à vingt-quatre heures par semaine, sauf dérogation législative expresse ou accord de branche. Si ce dernier passait en dessous de cette limite, les horaires de travail devaient du moins être réguliers. Soixante accords de branche ont déjà été négociés, dont dix-sept acceptent effectivement des durées de temps partiel nettement inférieures. Dans les négociations, les salariées sont moins défendues et moins protégées, servant parfois de variable d’ajustement.
Aussi voulons-nous faire remonter dans les dispositions d’ordre public ce qui n’est aujourd’hui que du droit supplétif.
M. le rapporteur. Vous renversez en effet la logique du texte. Au lieu de fixer la durée légale à vingt-quatre heures en permettant aux accords de branche d’y déroger, le projet de loi dispose que les accords de branche peuvent prévoir une durée inférieure, à la condition d’apporter des garanties équivalentes à celles qui existent aujourd’hui.
Par ailleurs, il me paraît préjudiciable de renvoyer au décret toutes les dérogations qui sont inscrites aujourd’hui dans la loi. Cela me semble régressif. Avis défavorable.
La Commission rejette l’amendement.
Elle en vient ensuite à l’amendement AS101 de M. Gérard Cherpion.
M. Bernard Accoyer. Dans la logique du projet de loi qui est de donner la priorité au niveau de l’entreprise en matière d’organisation du travail, afin d’être le plus près des spécificités du terrain, l’objet de cet amendement est de prévoir que le niveau de majoration des heures complémentaires effectuées par les salariés à temps partiel peut être fixé par accord d’entreprise, et à défaut, par accord de branche – dans la limite du plancher légal de 10 % –, à l’instar de ce qui est prévu pour les heures supplémentaires. Une différence de traitement entre heures supplémentaires et heures complémentaires ne se justifie pas.
M. Michel Liebgott. Le texte que nous examinons est simplement issu d’un dialogue entre le Gouvernement et le Parlement, comme il peut en exister.
M. Jean-Louis Roumegas. Je m’élève résolument contre cet amendement, qui fait le contraire de ce qu’il prétend. Il permet d’organiser le dumping social entre les entreprises d’une même branche, au détriment des PME et TPE de celle-ci. Or ce sont elles qui créent le plus d’emplois. Vraiment, je m’étonne de retrouver parmi les auteurs de ces amendements des gens qui se prétendent des chantres de la compétitivité.
M. Arnaud Richard. Je m’étonne quant à moi que le Gouvernement ait proposé une telle disposition dans son avant-projet.
M. le rapporteur. Le Gouvernement a pour objectif de donner la primauté à l’accord collectif pour fixer le taux de majoration des heures complémentaires dans le cadre du travail à temps partiel. Compte tenu des enjeux spécifiques de ce travail et des risques évoqués par notre collègue Jean-Louis Roumegas, j’émets un avis défavorable.
La Commission rejette l’amendement.
Puis elle examine l’amendement AS622 de la présidente de la délégation aux droits des femmes.
Mme Catherine Coutelle, présidente de la délégation aux droits des femmes. Mon amendement porte sur les heures complémentaires. Il nous apparaît que le projet de loi risque de limiter leur majoration à 10 %, le taux de 25 % ne devenant plus qu’une exception. Nous souhaitons quant à nous que, dès qu’elles représentent un dixième du volume horaire, elles soient majorées à 25 %.
M. le rapporteur. Je plaide plutôt en faveur d’un maintien du droit actuel : le taux de majoration des heures complémentaires dans le cadre du travail à temps partiel est fixé à 10 %, pourquoi le fixer à 25 % ? Avis défavorable.
La Commission rejette l’amendement.
La Commission est saisie de l’amendement AS749 de Mme Éva Sas.
M. Jean-Louis Roumégas. Cet amendement vise à supprimer la possibilité d’imposer des interruptions d’activité d’une durée supérieure à deux heures. En effet, les horaires des salariés à temps partiel sont déjà très irréguliers. Permettre de leur imposer des interruptions d’activité trop importantes serait préjudiciable à leur temps de repos, surtout lorsqu’ils ont des temps de trajet importants. J’ajoute que cette problématique touche particulièrement les femmes, puisque les contrats à temps partiel leur sont majoritairement dévolus – je devrais dire imposés.
M. le rapporteur. Là encore, cette proposition va au-delà du droit existant, puisque l’article L. 3123-16 du code du travail précise que, si l’horaire de travail du salarié à temps partiel comporte, au cours d’une même journée, plus d’une interruption d’activité ou une interruption supérieure à deux heures, il est indispensable qu’une convention ou un accord collectif définisse précisément les amplitudes horaires pendant lesquelles les salariés doivent exercer leur activité et leur répartition dans la journée de travail, moyennant des contreparties spécifiques. Souhaitant rester autant que faire se peut à droit constant, j’émets un avis défavorable à cet amendement.
La Commission rejette l’amendement.
Elle examine ensuite l’amendement AS623 de la présidente de la délégation aux droits des femmes.
Mme Catherine Coutelle, présidente de la délégation aux droits des femmes. Alors que le délai de prévenance est aujourd’hui de sept jours et ne peut être ramené à trois jours que par convention, l’alinéa 390 de l’article 2 a pour effet de le réduire à trois jours. L’amendement AS623 vise à ce que le délai légal de sept jours soit maintenu, afin de protéger les personnes qui sont le plus souvent à temps partiel – à savoir les femmes, à 80 %. Une modification des horaires de travail entraîne en effet de grandes difficultés d’organisation pour les femmes, à qui il revient souvent, par exemple, de trouver des solutions pour la garde des enfants. De ce point de vue, un délai de prévenance de sept jours ne paraît pas superflu.
M. le rapporteur. Je rappelle que, dans les cas où le délai de prévenance est ramené en deçà du seuil légal par convention, des contreparties sont apportées au salarié concerné, conformément à l’article L. 3123-22 du code du travail. Je préfère en rester aux dispositions actuelles et suis donc défavorable à cet amendement.
Mme Catherine Coutelle, présidente de la délégation aux droits des femmes. À chaque fois que nous examinons un texte portant sur le droit du travail – je pense à la loi de 2013 relative à la sécurisation de l’emploi ou à celle de 2014 relative à la formation professionnelle –, la délégation aux droits des femmes fait des propositions visant à améliorer le droit constant pour les femmes. Tel est le sens de notre amendement.
La Commission rejette l’amendement.
La Commission est saisie de l’amendement AS242 de Mme Marie-Lou Marcel.
Mme Marie-Lou Marcel. Il est indiqué, à l’alinéa 398 de l’article 2, que « dans les entreprises dépourvues d’institutions représentatives du personnel, les horaires à temps partiel peuvent être pratiqués à l’initiative de l’employeur ou à la demande des salariés, après information de l’inspecteur du travail ». L’amendement AS242 vise à remplacer le mot « information » par « avis », la mise en place d’horaires à temps partiel nous paraissant trop importante pour ne nécessiter qu’une information de l’inspecteur du travail.
M. le rapporteur. Avis défavorable : la loi ne prévoit actuellement qu’une simple information de l’inspecteur du travail et il ne me semble pas opportun de modifier cette procédure.
La Commission rejette l’amendement.
Elle est ensuite saisie de l’amendement AS245 de Mme Marie-Lou Marcel.
Mme Marie-Lou Marcel. L’amendement AS245 vise à ce que les heures complémentaires des salariés à temps partiel soient majorées à 25 % pour les huit premières heures et 50 % au-delà, même si quelques rares accords de branche ont mis en place une majoration à 10 %. Les salariés à temps partiel, dont 80 % sont des femmes, sont particulièrement fragiles, tant du point de vue du statut que de la rémunération. Permettre que la majoration s’appliquant aux heures complémentaires puisse descendre à 10 % risque d’accroître encore la précarité de la situation des personnes concernées, c’est pourquoi je propose de modifier l’alinéa 405 de l’article 2.
M. le rapporteur. Si je partage votre analyse sur la précarité de la situation des salariés à temps partiel, j’estime que la mise en œuvre de votre proposition aurait pour effet de fragiliser considérablement toutes les structures ayant recours à l’activité à temps partiel, donc de mettre en péril l’emploi qu’elles fournissent. En effet, ce que vous suggérez est très contraignant par rapport aux dispositions actuelles, qui prévoient une majoration de 10 % pour les heures complémentaires effectuées dans la limite du dixième des heures prévues au contrat et de 25 % pour celles comprises entre le dixième et le tiers des heures prévues au contrat.
La Commission rejette l’amendement.
Puis elle examine les amendements identiques AS286 de Mme Bernadette Laclais et AS451 de M. Joël Giraud.
Mme Bernadette Laclais. L’amendement AS286 a pour objet de simplifier la signature de contrats de travail intermittents dans les petites entreprises. En effet, ce type de contrat est très peu utilisé du fait qu’il nécessite un accord préalable quasiment impossible à mettre en œuvre dans les entreprises de moins de vingt salariés, qui représentent l’immense majorité des entreprises à activité saisonnière. Cette impossibilité n’est pas compensée par les accords de branche, puisqu’on estime que huit seulement auraient été conclus à ce jour.
La rareté des contrats de travail intermittents dans les petites entreprises s’explique également par la non-indemnisation des périodes non travaillées, contrairement à ce qui se fait dans le cadre du CDD saisonnier.
Je précise que notre rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques présentera un amendement similaire à celui-ci et reprenant un amendement déposé en commission par Mme Got, que j’ai cosigné. Je propose donc de retirer l’amendement AS286 au profit de celui de la commission des affaires économiques.
Mme Dominique Orliac. L’amendement AS451 est défendu.
M. le rapporteur. J’invite Mme Orliac à retirer son amendement, qui me paraît totalement satisfait par l’alinéa 420 de l’article 2.
Les amendements AS286 et AS451 sont retirés.
La Commission examine les amendements identiques AS879 du rapporteur pour avis et AS646 de Mme Pascale Got.
Mme Bernadette Laclais. Nous constatons sur le terrain – et tous les acteurs concernés nous le confirment, qu’il s’agisse des syndicats de salariés, des fédérations professionnelles ou des représentants patronaux – que le contrat de travail intermittent ne trouve pas aujourd’hui la place qu’il devrait pour les activités saisonnières, en raison de sa trop grande complexité et de l’impossibilité de le négocier. La commission des affaires économiques propose donc de simplifier les choses et de donner la possibilité de conclure un contrat de travail intermittent même en l’absence d’accord collectif. Ne perdons pas de vue que les entreprises ayant des activités saisonnières comptent souvent moins de vingt salariés - et même moins de dix salariés dans la grande majorité des cas.
M. Arnaud Richard. Les activités saisonnières méritent effectivement de faire l’objet d’un contrat de travail beaucoup plus souple. Il me semble qu’adopter une disposition en ce sens reviendrait à envoyer un signe positif en direction des PME et TPE concernées.
M. le rapporteur. Cet amendement présente un problème de rédaction, puisqu’il fait référence à « l’absence de convention ou d’accord collectif ou de convention ou d’accord d’entreprise ou d’établissement ».
Sur le fond, il ne me paraît pas opportun de permettre de conclure des contrats spécifiques en l’absence d’accord collectif. Je vous invite donc à retirer cet amendement afin que nous le retravaillions avec le Gouvernement, et émettrai à défaut un avis défavorable.
M. Yves Blein, rapporteur pour avis. J’attire votre attention sur la nécessité de prendre en compte l’infinie variété du travail saisonnier – souvent effectué dans le cadre de micro-entreprises – qui rend ce type d’activité très difficile à couvrir par des accords de branche. Il me paraît donc indispensable de donner plus de souplesse aux entrepreneurs concernés afin que leurs salariés puissent bénéficier d’un encadrement réglementaire adapté à leur situation. Cela dit, nous acceptons de retirer cet amendement pour le retravailler en vue de la séance publique, sous réserve d’un engagement de votre part en ce sens, monsieur le rapporteur.
M. Christophe Cavard. Sauf erreur de ma part, cet amendement comporte un autre enjeu que celui de la signature du contrat de travail intermittent : je veux parler de la rupture du contrat, et du fait que les personnes perdant leur statut de saisonnier se voient du même coup privées de leur couverture par l’assurance chômage.
M. Arnaud Richard. Dans la mesure où la ministre s’est engagée à être à l’écoute du groupe majoritaire, il me semblait préférable que le rapporteur accepte cet amendement en faveur des PME et TPE, même si cet amendement est imparfait en son état actuel : ce serait un signe positif adressé aux petites entreprises du secteur du tourisme.
J’entends la préoccupation de M. Cavard, mais il me semble que le fait qu’il s’agisse qu’un contrat à durée indéterminée s’adressant spécifiquement aux travailleurs saisonniers est sans doute plus sécurisant pour les salariés, notamment en termes de droit aux indemnités de chômage.
Mme Bernadette Laclais. Nous sommes bien d’accord sur le fait que le contrat intermittent à durée indéterminée (CDII) présente un intérêt particulier. Cela dit, si le texte contient des avancées relatives aux contrats saisonniers et à leur renouvellement, il n’en contient aucune relative au CDII, en dépit du travail effectué par plusieurs parlementaires et de la feuille de route de la ministre. Je vous fais confiance pour être notre porte-parole sur ce point, monsieur le rapporteur. C’est important pour les petites entreprises concernées et leurs salariés, auxquels ce type de contrat apportera de la stabilité.
Les amendements AS879 et AS646 sont retirés.
La Commission est ensuite saisie de l’amendement AS739 de Mme Éva Sas.
M. Jean-Louis Roumégas. Cet amendement vise à supprimer la possibilité de déroger au repos quotidien de onze heures consécutives, sauf dans les cas d’urgence renvoyés à décret, qui sont maintenus. Le repos quotidien de onze heures consécutives constitue en effet un impératif sanitaire et un élément de la qualité de vie des salariés : on ne voit pas comment une personne peut se reposer, se laver, et manger en moins de onze heures – même si cela nous est parfois imposé à l’Assemblée nationale, comme ce sera le cas cette nuit, mais peut-être sommes-nous dans un cas d’urgence…
M. le rapporteur. On peut d’ores et déjà déroger à la règle d’ordre public par voie d’accord collectif, sans même devoir justifier d’un surcroît exceptionnel d’activité. Je m’en remets à la sagesse de la Commission.
La Commission adopte l’amendement.
Elle est ensuite saisie des amendements identiques AS188 de Mme Bernadette Laclais et AS452 de M. Joël Giraud.
Mme Bernadette Laclais. Il importe que les titulaires de contrats intermittents ou saisonniers reconduits bénéficient des mêmes avantages que les salariés en CDI classique, notamment le paiement des salaires des jours fériés chômés. Pour cela, nous proposons avec l’amendement AS188 de supprimer l’alinéa 472 de l’article 2.
Mme Dominique Orliac. L’amendement AS452 est défendu.
M. le rapporteur. L’objet de ces amendements semble si large que je ne suis pas sûr d’en mesurer l’étendue. Je vous invite par conséquent à les retirer afin que nous les retravaillions ensemble avant la séance publique.
Les amendements AS188 et AS452 sont retirés.
La Commission examine les amendements identiques AS207 de Mme Bernadette Laclais et AS453 de M. Joël Giraud.
Mme Bernadette Laclais. L’amendement AS207 est presque identique à celui que je viens de présenter, si ce n’est que son bénéfice est réservé aux salariés cumulant une ancienneté totale d’au moins trois mois dans l’entreprise.
Mme Dominique Orliac. L’amendement AS453 est défendu.
M. le rapporteur. Même avis : l’objet de ces amendements justifie que nous les retravaillions ensemble.
Mme Bernadette Laclais. J’accepte de retirer mon amendement si cela peut aider à ce que la Commission défende la cause des travailleurs saisonniers.
M. le rapporteur. Les travailleurs saisonniers constituent effectivement une vraie problématique, que je vous confirme avoir la volonté de faire progresser. Le caractère très spécifique de cette activité me conduit cependant à souhaiter que nous le fassions avec la plus grande prudence, c’est pourquoi je vous ai invitées à retirer vos amendements afin que nous puissions aboutir à une rédaction plus aboutie, au terme d’une discussion avec le Gouvernement.
Les amendements AS207 et AS453 sont retirés.
La Commission est saisie de l’amendement AS363 de M. Serge Bardy.
M. Serge Bardy. Défendu.
M. le rapporteur. Défavorable.
La Commission rejette l’amendement.
Elle examine ensuite l’amendement AS181 de Mme Marie-Françoise Clergeau.
Mme Marie-Françoise Clergeau. Les alinéas 525 à 531 de l’article 2 reprennent les dispositions de l’article L. 3141-5 du code du travail assimilant certaines périodes non travaillées à du temps de travail effectif pour le calcul de la durée des congés payés. Or, d’une part, ne figurent pas dans cette liste les arrêts pour maladie non professionnelle ; d’autre part, l’acquisition en cas de maladie professionnelle est limitée à une période ininterrompue d’un an.
Par un arrêt du 24 janvier 2012, la Cour de justice de l’Union européenne a indiqué que ces deux dispositions sont contraires à l’article 7 de la directive 2003/88/CE relative à l’aménagement du temps de travail. Selon cette jurisprudence, tout salarié, qu’il ait ou non effectivement travaillé pendant la période de référence, et quelle que soit l’origine de son absence, a droit à un congé payé annuel d’au moins quatre semaines.
Compte tenu de la rédaction actuelle de l’article L. 3141-5-5° du code du travail, les conséquences sont discriminantes selon les employeurs des salariés : l’article 7 de la directive 2003/88 et la jurisprudence de la CJUE sont d’application directe pour les employeurs chargés d’accomplir un service d’intérêt public sous le contrôle d’une autorité publique, et d’application indirecte pour les employeurs de droit privé.
M. le rapporteur. La jurisprudence que vous évoquez n’est pas aussi large que le laisse supposer l’amendement, puisque le droit au congé annuel qui vaut de manière absolue, même si la personne est en arrêt maladie, est de quatre semaines. Je m’interroge sincèrement sur la légitimité du droit qui serait donné à un salarié resté en arrêt maladie durant six mois ou un an de poser plusieurs semaines de congé à son retour ; en tout état de cause, si votre proposition devait être adoptée, je souhaiterais que la limite de quatre semaines retenue par la jurisprudence soit maintenue. En l’état actuel, je vous invite à retirer cet amendement pour le retravailler avant la séance publique, et émettrai à défaut un avis défavorable.
Mme Marie-Françoise Clergeau. Je retire cet amendement afin de le retravailler.
L’amendement AS181 est retiré.
La Commission est saisie de l’amendement AS579 de Mme Marie-Françoise Clergeau.
Mme Marie-Françoise Clergeau. Cet amendement reprend l’esprit de l’une des dispositions de la proposition de loi n° 3029 relative aux droits à congés.
Cette proposition visait à assouplir les effets de la période de référence, période au cours de laquelle le salarié acquiert ses congés payés. Car, concrètement, chaque salarié doit d’abord acquérir des droits à congés pendant la période de référence, avant de pouvoir prendre ses congés pendant la période prévue pour cela.
Des exceptions à la période de référence et à la période de prise de congés sont prévues par le code du travail. Elles se justifient tant pour éviter aux salariés un temps de présence parfois long dans l’entreprise avant de pouvoir bénéficier des premiers congés que pour mieux prendre en compte les intérêts d’un salarié.
Sans supprimer la période de référence, ni modifier les règles générales relatives aux droits à congés, ni les prérogatives des employeurs, le présent amendement précise que les congés peuvent être pris dès l’embauche du salarié.
M. le rapporteur. Cette disposition me semble intéressante, car le délai situé entre le moment où la personne arrive dans l’entreprise et celui où elle peut poser des congés payés est relativement long. En tout état de cause, il faudra que le salarié ait acquis des jours de congé avant d’en poser. Je suis donc favorable à cet amendement.
La Commission adopte l’amendement.
La Commission examine ensuite l’amendement AS102 de M. Gérard Cherpion.
M. Gilles Lurton. Cet amendement vise, à la fin de l’alinéa 578, à supprimer les mots « compris entre deux jours de repos hebdomadaire ».
Imposer, en cas de fractionnement des congés, l’attribution d’une fraction de congé au moins égale à douze jours ouvrables continus entre deux jours de repos hebdomadaires ne se fait pas sans difficulté, notamment lorsqu’un jour férié est compris dans ces douze jours. En effet, en vue de respecter le caractère continu, il convient de prolonger le congé d’un jour ouvrable, ce qui conduit de facto à ne pas respecter la règle selon laquelle les douze jours doivent être compris entre deux jours de repos hebdomadaire.
Pour remédier à ces difficultés, il nous semble préférable de supprimer l’exigence selon laquelle les douze jours de congé doivent être pris entre deux jours de repos hebdomadaire. Tel est l’objet de l’amendement AS102.
M. le rapporteur. Je trouve que vous y allez fort, en proposant de fractionner les congés payés des salariés de façon qu’ils ne puissent même plus disposer de douze jours consécutifs ! Cela aurait, à mon sens, de graves conséquences sur la vie familiale des salariés, c’est pourquoi j’émets un avis défavorable à cet amendement.
La Commission rejette l’amendement.
La Commission est saisie de l’amendement AS580 rectifié de Mme Marie-Françoise Clergeau.
Mme Marie-Françoise Clergeau. Cet amendement reprend également l’une des dispositions de la proposition de loi n° 3029 relative aux droits à congés. Il vise à supprimer la perte de congés payés en cas de licenciement pour faute lourde et ainsi à intégrer dans la loi les positions concordantes du Conseil constitutionnel et de la Cour de cassation.
L’alinéa 620 de l’article 2 prévoit qu’en cas de rupture du contrat de travail, la faute lourde du salarié entraîne la suppression de l’indemnité compensatrice pour la fraction des congés payés acquis mais dont le salarié n’a pas bénéficié. Cette suppression pour faute lourde constitue une rupture de l’égalité des salariés devant la loi, comme vient de le rappeler le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2015-523. À l’occasion d’une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel a jugé non conformes à la Constitution les mots « dès lors que la rupture du contrat de travail n’a pas été provoquée par la faute lourde du salarié ».
La Cour de cassation avait déjà rappelé la nécessité de modifier le code du travail en ce sens dans son rapport annuel pour 2013. En effet, la perte de congés payés en cas de licenciement pour faute lourde prive le salarié de la garantie européenne de quatre semaines de droits à congés et, par ailleurs, de droits qu’il avait acquis.
M. le rapporteur. Favorable.
La Commission adopte l’amendement.
Puis elle adopte l’article 2 modifié.
*
* *
La Commission examine, en discussion commune, les amendements AS543 de M. Arnaud Richard et AS454 de M. Alain Tourret.
M. Arnaud Richard. En 2007, une loi permettait une exonération d’impôt sur le revenu et une réduction des cotisations sociales au titre des heures supplémentaires. En défendant le pouvoir d’achat des salariés et la compétitivité des entreprises, cette mesure répondait à un vrai besoin. Malheureusement, la majorité que vous représentez a abrogé ce dispositif dans son intégralité dans le cadre d’un projet de loi de finances rectificative de juillet 2012, ce qui fut une funeste erreur, comme la plupart d’entre vous en conviennent.
Aujourd’hui, ce sont 9,5 millions de salariés, qui perdent 500 euros de revenu par an et voient leurs impôts augmenter dans le même temps, qui en pâtissent. L’amendement AS543 a pour objet de rétablir le dispositif de défiscalisation des heures supplémentaires, qui permettait aux entreprises de mieux répondre aux variations d’activité imposées par la crise, et avait constitué un facteur de compétitivité pour les PME. En le votant, vous avez l’occasion de rattraper l’erreur ayant entaché le début du quinquennat qui touche aujourd’hui à sa fin.
Mme Dominique Orliac. L’amendement AS454 dispose que toute heure effectuée au-delà de la durée légale du travail telle que déterminée par la législation relative au travail en tant qu’heure supplémentaire ou complémentaire ouvre droit à une exonération de l’impôt sur le revenu, pour les salaires inférieurs à 2,5 SMIC.
Cette mesure a pour objectif de permettre, d’une part, d’offrir aux salariés une garantie d’augmentation réelle de leurs revenus, d’autre part, aux entreprises de répondre aux demandes du marché par l’adaptation du volume des heures de travail appliquées dans l’entreprise.
M. le rapporteur. Nous n’allons pas rouvrir un débat qui a été tranché par la majorité en début de législature. En une période où le nombre de demandeurs d’emploi reste élevé, il serait difficile d’expliquer à nos concitoyens que nous allons accorder une défiscalisation des heures supplémentaires à ceux qui ont un emploi, alors que l’argent public est nécessaire à ceux qui n’en ont pas. En tout état de cause, il s’agit là d’une question ayant plutôt vocation à être abordée dans le cadre de l’examen du projet de loi de finances ou du PLFSS. Si vous le souhaitez, vous déposerez à nouveau vos amendements dans ce cadre budgétaire. Pour le moment, j’émets un avis défavorable.
La Commission rejette successivement les amendements AS543 et AS454.
Puis elle est saisie de l’amendement AS542 de M. Arnaud Richard.
M. Arnaud Richard. Cet amendement vise à assouplir la date à laquelle le maire doit fixer la liste des dimanches au cours desquels les commerces sont autorisés à ouvrir.
M. le rapporteur. Avis défavorable.
La Commission rejette l’amendement.
*
* *
Article 3
(Art. L. 1222-5, L. 3142-1 à L. 3142-116, L. 3142-117 à L. 3142-122 [nouveaux], L. 6313-1, L. 6315-1, L. 7211-3 et L. 7221-2 du code du travail ; art. L. 1114-3 et L. 1432-7-1 du code de la santé publique ; art. L. 161-9-3, L. 168-1, et L. 241-3-2 du code de la sécurité sociale ; art. L. 2123-9, L. 3123-7, L. 4135-7, L. 7125-7 et L. 7227-7 du code général des collectivités territoriales ;
art. L. 114-24 du code de la mutualité ; art. L. 423-14 du code de l’action sociale et des familles ;
art. L. 5544-25 et L. 6525-5 du code des transports)
Autres congés
Cet article propose une refonte complète de la structure du chapitre II : « Autres congés », du titre IV relatif aux congés payés et aux autres congés, du livre Ier de la troisième partie du code du travail.
Notons avant tout qu’il ne procède à aucune suppression, mais bien à la réorganisation de ce chapitre, qui distingue aujourd’hui les congés rémunérés et les congés non rémunérés, en trois sections respectivement consacrées :
– aux congés de conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle (section 1), section qui comprend désormais le congé pour événements familiaux, le congé de solidarité familiale et le congé du proche aidant ;
– aux congés pour engagement associatif, politique ou militant, au sein de la section 2, qui recouvre désormais le congé mutualiste de formation, le congé de participation aux instances d’emploi et de formation professionnelle ou à un jury d’examen, le congé pour catastrophe naturelle, le congé de formation de cadres et d’animateurs pour la jeunesse, le congé de représentation, le congé de solidarité internationale, le congé pour acquisition de la nationalité, le congé des salariés candidats ou élus à un mandat parlementaire ou local, la réserve opérationnelle et le service national, et enfin, la réserve dans la sécurité civile, les opérations de secours et la réserve sanitaire ;
– et enfin, aux congés d’évolution des parcours professionnels, au sein d’une nouvelle section 3, consacrée au congé et à la période de travail à temps partiel pour la création ou la reprise d’entreprise et au congé sabbatique.
Au-delà de cette modification complète de la structuration du chapitre consacré aux congés, le présent article reconstruit également la hiérarchie interne de cette partie du code, en réorganisant le contenu des dispositions encadrant la quasi-totalité de ces congés autour des trois niveaux de règles que retient désormais le projet de loi : les règles d’ordre public, les règles relevant de la négociation collective, et enfin, les dispositions supplétives, applicables en l’absence d’accord.
Certaines dispositions ne sont toutefois pas concernées par la mise en place de cette nouvelle architecture : il s’agit d’une part du congé de formation économique, sociale et syndicale et, d’autre part, des congés suivants : le congé des salariés candidats ou élus à un mandat parlementaire ou local, la réserve opérationnelle et le service national, ainsi que la réserve dans la sécurité civile les opérations de secours et la réserve sanitaire. En effet, pour ces derniers, il n’y a pas de raison de renvoyer leurs conditions et modalités de mise en œuvre à la négociation collective, en raison de leur nature qui relève tout naturellement de l’ordre public.
L’application de cette nouvelle architecture aux congés spécifiques constitue, comme l’indique l’étude d’impact, « une des premières illustrations des nouvelles marges de négociation que le gouvernement entend donner aux partenaires sociaux dans le cadre de cette réforme ».
Cette nouvelle articulation des normes a en réalité deux conséquences sur les règles encadrant ces congés spécifiques :
– d’une part, ceux-ci vont désormais être du ressort de la négociation collective, alors que pour l’heure, les dispositions les encadrant étaient d’ordre public et qu’il n’était donc pas possible d’y déroger. Concrètement, pourront donc faire l’objet d’adaptations les durées de ces congés, le nombre de leurs renouvellements, les conditions requises pour en bénéficier ou encore les délais de prévenance applicables à leur prise. À défaut de la détermination de ces différents aspects par accord collectif, les règles supplétives trouveront à s’appliquer. Ces règles reprennent les dispositions légales actuelles : les dispositions supplétives sont donc bien à droit constant ;
– d’autre part, s’agissant du champ de la négociation collective, et comme pour la durée du travail, les repos et les congés payés, le texte donne la primauté à l’accord d’entreprise sur l’accord de branche. Il s’agit en effet de permettre une adaptation des règles au plus proche de la réalité et des besoins des entreprises. Dans les faits, la négociation de branche s’est d’ores et déjà emparée du sujet des congés spécifiques : conformément aux principes combinés de l’ordre public social et du principe de faveur, dans de nombreux secteurs d’activité, les conventions collectives prévoient des mesures plus favorables aux salariés pour la prise de ces congés spécifiques. Ainsi, comme le note l’étude d’impact, sur 23,8 millions de salariés, 9,5 millions sont couverts par une convention collective plus favorable en matière de congé pour événements familiaux, en octroyant entre 3 à 5 jours de congé en cas de décès du conjoint du salarié.
Toutefois, la démarche qui consiste à donner la priorité et la primauté à la négociation d’entreprise est entièrement nouvelle.
En outre, dans le silence de la loi, dans le droit actuel, les conventions ou accords de branche – ou, par extension, tout accord collectif quel que soit son niveau – traitant de cette question ne peuvent fixer que des règles plus favorables aux salariés en la matière.
Le texte proposé conduit à permettre aux accords d’entreprise ou, à défaut, aux accords de branche, de fixer des règles moins favorables aux salariés que les règles minimales prévues de manière supplétive : en effet, les dispositions supplétives n’ont vocation qu’à s’appliquer « par défaut » ; elles n’ont pas vocation à constituer un plancher ou une norme minimale, à l’exception notable des congés pour événements familiaux, pour lesquels la loi fixe à la négociation collective des planchers applicables à la durée de ces congés.
En revanche, on voit mal comment dans le cadre de la négociation d’un accord collectif, il serait possible de mettre en place des règles moins favorables que les dispositions supplétives. Les parties prenantes au dialogue social d’entreprise ou de branche n’ont en effet aucun intérêt à négocier par exemple une durée de congé qui serait en deçà de la durée qui s’appliquerait en l’absence d’accord. Cet argument doit néanmoins être tempéré : cet intérêt pourrait théoriquement exister dans l’hypothèse d’un accord « global », portant sur une diversité de points, et qui conduirait à « mettre dans la balance » tel avantage en échange du renoncement à tel autre.
Le tableau figurant en annexe au commentaire du présent article retrace la répartition des dispositions entre les trois niveaux de normes.
On notera que, s’agissant des dispositions supplétives applicables en l’absence d’accord, sont directement fixées par la loi :
– la durée de ces congés ;
– les conditions de leur renouvellement ;
– ainsi que les conditions d’ancienneté requises le cas échéant pour en bénéficier.
La loi renvoie en revanche au niveau réglementaire la fixation des délais de prévenance, des modalités du plafonnement du nombre de salariés pouvant prendre un même congé de manière simultanée, ainsi que les modalités de saisine du bureau de jugement du conseil de prud’hommes en cas de contestation.
Comme l’indique l’étude d’impact, s’agissant des délais de prévenance de l’employeur par le salarié, le renvoi au décret « permettra de continuer à appliquer les délais de prévenance aujourd’hui déjà prévus par dispositions réglementaires ». Le même principe de reprise du droit existant sera retenu s’agissant des autres mesures renvoyées au niveau réglementaire.
Ces congés ne faisaient pour l’heure l’objet que de deux articles du code : les articles L. 3142-1 et L. 3142-2. Ce sont désormais trois articles supplémentaires qui complètent les dispositions relatives à ces congés auxquels a droit le salarié pour son mariage ou la conclusion de son pacte civil de solidarité, la naissance ou l’adoption d’un enfant ou encore le décès d’un membre de la famille proche (enfant, conjoint, partenaire lié par un PACS, père, mère, beau-père, belle-mère, beau-père, frère ou sœur).
La durée de ces congés – respectivement de quatre jours pour le mariage ou la conclusion du PACS du salarié, un jour pour le mariage d’un enfant, trois jours pour une naissance ou une adoption, deux jours pour le décès d’un enfant ou d’un conjoint et un jour pour le décès d’un autre parent proche –, aujourd’hui prévue à l’article L. 3142-1, est désormais renvoyée à deux niveaux, l’un comme plancher de la durée fixée par voie d’accord, l’autre comme durée supplétive trouvant à s’appliquer à défaut d’accord.
En outre, le projet de loi harmonise à la hausse le nombre de jours de congés octroyés pour le décès d’un parent proche, en portant à deux le nombre de jours de congé du salarié pour le décès du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère d’un frère ou d’une sœur, comme pour le décès du conjoint ou d’un enfant.
Ainsi :
– d’une part, une convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, un accord de branche détermine la durée de ces congés, sans pouvoir toutefois fixer une durée inférieure à quatre jours pour le mariage ou la conclusion d’un PACS par le salarié ; un jour pour le mariage d’un enfant ; trois jours par naissance ou pour l’adoption d’un enfant ; et deux jours pour le décès d’un membre proche de la famille. Le champ ainsi laissé à la négociation collective fait l’objet de l’article L. 3142-4 dans sa nouvelle rédaction ;
– d’autre part, à défaut d’accord, ces durées respectives s’appliquent de droit aux salariés (article L. 3142-5 dans sa nouvelle rédaction).
Autrement dit, un accord collectif ne pourra en réalité que fixer une durée supérieure à la durée supplétive prévue par la loi.
Notons également que le texte procède à une harmonisation des dispositions applicables à l’ensemble des catégories de congés en précisant :
– d’une part que la durée de ces congés pour événements familiaux ne peut être imputée sur celle du congé payé annuel (deuxième alinéa de l’article L. 3142-2) ;
– et d’autre part, qu’en cas de différend, le refus de l’employeur d’accorder un tel congé peut être directement contesté devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
Il s’agit du seul congé pour lequel le choix a été opéré de fixer un socle minimal que doivent respecter les accords collectifs conclus à ce sujet. En effet, pour l’ensemble des autres congés, les dispositions relatives à leur durée sont renvoyées au niveau des règles supplétives, qui ne trouveront à s’appliquer qu’à défaut d’accord.
Le congé de solidarité familiale, actuellement codifié aux articles L. 3142-16 à L. 3142-21 permet au salarié dont un proche souffre d’une pathologie grave de bénéficier d’un congé non rémunéré de trois mois au maximum, renouvelable une fois et fractionnable, ou d’une période de travail à temps partiel de la même durée. En proposant une rédaction complète de ces dispositions aux articles L. 3142-6 à L. 3142-14, le projet de loi ne revient pas sur le principe de ce congé, mais se contente d’en réorganiser les conditions de mise en œuvre, en prévoyant, au nouvel article L. 3142-13, qu’un accord collectif d’entreprise ou, à défaut, un accord de branche détermine :
– la durée maximale du congé – qui peut donc excéder trois mois, mais qui peut aussi être plus court ;
– le nombre de renouvellements possibles – un ou deux, par exemple, mais l’accord collectif ne pourra pas prévoir l’absence de renouvellement, celui-ci constituant un principe d’ordre public ;
– les conditions de fractionnement du congé ou de sa transformation en activité à temps partiel ;
– les délais d’information de l’employeur par le salarié concernant sa prise de congé, sa durée, son renouvellement, la durée de son préavis en cas de retour anticipé ;
– ainsi que les mesures permettant de maintenir le lien entre l’entreprise et le salarié pendant la durée du congé et les modalités d’accompagnement dont il peut bénéficier à son retour.
L’article L. 3142-14 dans sa nouvelle rédaction énonce les dispositions supplétives applicables au congé de solidarité familiale, en l’absence d’accord collectif sur le sujet : ce n’est donc que par défaut que la durée du congé sera désormais de trois mois, et renouvelable une seule fois. L’article prévoit également que les modalités de fractionnement et de transformation du congé en activité à temps partiel font l’objet d’un décret, de même que les délais d’information de l’employeur par le salarié.
L’article D. 3142-6 prévoit, pour l’heure, que le salarié doit faire part à l’employeur de son souhait de partir en congé, de sa demande de fractionnement du congé ou de sa transformation en temps partiel quinze jours à l’avance. Ce délai ne s’applique pas en cas d’urgence (article D. 3142-7). De même, pour le renouvellement du congé ou de l’activité à temps partiel, le salarié doit informer l’employeur quinze jours avant le terme initialement fixé (article D. 3142-8).
Enfin, la réécriture proposée par le présent article apporte une série de précisions ou d’harmonisations avec le régime applicable aux autres types de congés : ainsi, la nouvelle rédaction de l’article L. 3142-7 prévoit que le congé débute ou est renouvelé à l’initiative du salarié ; que celui-ci débute ou peut être renouvelé sans délai en cas d’urgence absolue constatée par écrit par le médecin. De même que pour les autres congés, il est proposé de préciser que la durée du congé de solidarité familiale ne peut être imputée sur celle du congé payé annuel et qu’en cas de différend, le refus de l’employeur peut directement être contesté devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
Codifié aux actuels articles L. 3142-22 à L. 3142-31, le congé de proche aidant permet à un salarié ayant au moins deux ans d’ancienneté de bénéficier d’un congé non rémunéré de trois mois renouvelable, dans la limite d’un an sur l’ensemble de la carrière, pour s’occuper d’un proche présentant un handicap ou une perte d’autonomie importante.
Le présent article réorganise les conditions de ce congé, sans en modifier les contours, par une nouvelle rédaction des articles L. 3142-15 à L. 3142-26. Il propose de préciser, comme pour le congé de solidarité familiale, qu’il débute ou est renouvelé à l’initiative du salarié ; qu’il peut débuter ou être renouvelé sans délai en cas de dégradation soudaine de l’état de santé de la personne aidée ou en cas de cessation brutale de son hébergement en établissement. Sa durée maximale d’un an sur l’ensemble de la carrière, renouvellement compris, reste d’ordre public (article L. 3142-18 dans sa nouvelle rédaction), mais la durée du congé en lui-même, de trois mois renouvelable, ne l’est plus. Enfin, sont apportées les mêmes précisions que pour les autres congés, relatives à la non imputation du congé sur les congés payés annuels et à la saisine du bureau de jugement du conseil de prud’hommes en cas de différend.
L’article L. 3142-25 dans sa nouvelle rédaction prévoit qu’un accord collectif d’entreprise ou, à défaut, un accord de branche détermine :
– la durée maximale du congé – qui peut donc être supérieure ou inférieure à trois mois – ;
– le nombre de renouvellements possibles – un, deux ou trois, mais le principe d’un renouvellement est d’ordre public – ;
– la condition d’ancienneté requise pour ouvrir droit au congé, l’actuelle condition légale de deux ans d’ancienneté devenant d’ordre supplétif. Cela signifie qu’un accord peut prévoir une ancienneté moins importante, mais aussi plus importante pour les salariés souhaitant bénéficier de ce congé. Le rapporteur juge peu opportun de renvoyer à la négociation collective pour fixer l’ancienneté requise pour bénéficier d’un congé qui permet à un salarié de venir en aide à un proche en situation de handicap ou de perte d’autonomie ;
– les délais d’information de l’employeur par le salarié concernant la prise de son congé, son renouvellement, la durée de son préavis en cas de retour anticipé ;
– ainsi que les délais de demande du salarié et de réponse de l’employeur concernant le fractionnement éventuel du congé.
Ce n’est qu’en l’absence d’accord que s’appliquent les dispositions supplétives prévues à l’article L. 3142-26 dans sa nouvelle rédaction, à savoir que le congé est d’une durée de trois mois renouvelable et que ce congé ne peut bénéficier qu’aux salariés ayant acquis deux ans d’ancienneté. Les délais d’information de l’employeur par le salarié concernant sa prise de congé, son renouvellement éventuel, la durée de son préavis et la réponse de l’employeur quant au fractionnement éventuel du congé sont renvoyés au décret : l’ensemble de ces modalités devraient être identiques à celles qui sont applicables actuellement. Des ajustements pourraient être prévus pour que celles-ci soient mises en cohérence avec les dispositions de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement.
Les articles D. 3142-9 à D. 3142-13 actuels précisent ces délais. Le délai de prévenance de l’employeur par le salarié pour la prise d’un congé de proche aidant est de deux mois, et d’un mois avant le terme initialement fixé pour un renouvellement. Ces délais sont réduits à quinze jours en cas d’urgence liée à la dégradation soudaine de l’état de santé de la personne aidée ou de cessation brutale de l’hébergement de cette dernière : de ce point de vue, le projet de loi procède à une avancée qu’il faut saluer, puisqu’il prévoit que dans ces deux cas, le congé débute sans délai, ces dispositions étant désormais d’ordre public. Le délai pour mettre fin de manière anticipée au congé est d’un mois.
Il convient avant toute chose de noter que le congé de formation économique, sociale et syndicale, qui aurait pu avoir vocation à être intégré à la catégorie des congés pour engagement associatif, politique ou militant est basculé au titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code du travail, au sein des dispositions relatives à l’exercice du droit syndical, dans la partie du code consacrée aux syndicats professionnels. En vertu du 4° du IV de l’article 18 du présent projet de loi, les actuels articles L. 3142-7 à L. 3142-15 qui y sont relatifs deviennent ainsi les articles L. 2145-5 à L. 2145-13, leur architecture demeurant inchangée. Autrement dit, les conditions de mise en œuvre de ce congé de formation ne sont pas renvoyées à la négociation collective.
Codifié aux actuels articles L. 3142-47 à L. 3142-50, le congé mutualiste de formation, non rémunéré, d’une durée de neuf jours ouvrables maximum par an, s’adresse à tous les administrateurs de mutuelles.
Le présent article procède à une nouvelle écriture des articles L. 3142-27 à L. 3142-32 désormais relatifs à ce congé. Sans en modifier la teneur, il propose, comme pour les autres congés, d’en confier les modalités de mise en œuvre à la négociation collective, en prévoyant comme pour les autres congés que la primauté est donnée à l’accord d’entreprise sur l’accord de branche. De ce point de vue, la durée de neuf jours ouvrables au maximum chaque année devient d’ordre supplétif ; elle n’est plus d’ordre public.
L’article L. 3142-29 dans sa nouvelle rédaction prévoit qu’un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles :
– l’employeur peut différer le congé en raison des nécessités propres de son entreprise ou de son exploitation ;
– est établie la liste des stages ou organismes ouvrant droit à ce congé ;
– le congé est attribué aux agents des services publics et des entreprises publiques. Cette condition semble inadaptée au cas des mutuelles, qui sont des personnes morales de droit privé au sens de l’article L. 111-1 du code de la mutualité ;
– et enfin, les conditions dans lesquelles le congé est attribué au salarié bénéficiant d’un régime de congé plus avantageux que celui qui résulte du chapitre premier.
Il s’agit en réalité d’un ensemble de conditions qui sont déjà prévues dans le droit actuel, respectivement aux articles L. 3142-48 et L. 3142-50.
Comme pour les autres congés, le texte précise les conditions de contestation en cas de différend et la non imputabilité de ce congé sur la durée du congé payé annuel.
L’article L. 3142-31 dans sa nouvelle rédaction laisse donc à un accord collectif d’entreprise ou, à défaut, un accord de branche, le soin de déterminer :
– la durée totale maximale du congé – qui peut donc être supérieure ou inférieure à neuf jours par an – ;
– le délai dans lequel le salarié informe l’employeur de sa demande de congé ;
– ainsi que les règles de détermination, par établissement, du nombre maximum de salariés susceptibles de bénéficier de ce congé au cours d’une année.
L’article L. 3142-32 pose les dispositions supplétives, applicables en l’absence d’accord, en fixant à neuf le nombre maximal de jours pouvant être pris par salarié au titre de ce congé, et en renvoyant au décret le soin de fixer le délai dans lequel le salarié informe l’employeur de sa demande de congé et les règles de détermination du nombre de salariés, par établissement, susceptibles de bénéficier de ce congé au cours d’une année.
Pour l’heure, l’article D. 3142-25 impose un délai d’au moins trente jours pour toute demande de congé adressée par le salarié à son employeur. S’agissant du nombre de salariés pouvant bénéficier du congé au cours d’une même année, elles demeureront également inchangées : s’appliquent aujourd’hui les limites prévues pour le congé de formation de cadres et d’animateurs pour la jeunesse (cf. infra).
2. Le congé de participation aux instances d’emploi et de formation professionnelle ou à un jury d’examen
Ce congé rémunéré, codifié aux actuels articles L. 3142-3 à L. 3142-6, qui consiste pour l’employeur à autoriser un salarié à s’absenter pour siéger dans une commission, un conseil ou un comité administratif ou paritaire appelé à traiter des problèmes d’emploi et de formation ou encore pour participer à un jury d’examen ou de validation des acquis de l’expérience, ne fait pas l’objet de modifications majeures sur le fond.
Le présent article propose d’inscrire les conditions applicables à ce congé aux articles L. 3142-33 à L. 3142-38, sans autre modification de fond que la précision de la non imputabilité de ce congé sur le congé payé annuel ainsi que les modalités de contestation en cas de différend : en effet, pour l’heure, en cas de différend, l’inspecteur du travail peut être saisi par l’une des parties et pris pour arbitre. Le projet d’article substitue à cette saisine de l’inspecteur du travail les modalités de contestation identiques à celles prévues pour les autres congés, autrement dit la possibilité de contester l’éventuel refus de l’employeur devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes.
L’article L. 3142-37, dans sa nouvelle rédaction, prévoit qu’un accord collectif d’entreprise ou, à défaut, un accord collectif de branche, fixe « notamment » les délais dans lesquels le salarié adresse sa demande de congé. En l’absence d’accord, ce délai est fixé par décret (article L. 3142-48). Le principe d’une fixation de ces délais par voie réglementaire existe déjà dans le droit actuel ; la seule différence à l’avenir est que ces délais pourront être modifiés par voie d’accord, celui-ci pouvant fixer un délai plus court ou plus long que celui prévu par décret.
L’article D. 3142-5-1 prévoit actuellement que pour participer à un jury d’examen ou de validation des acquis de l’expérience (VAE), le salarié doit adresser sa demande à l’employeur dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours calendaires. Ce délai a vocation à demeurer inchangé.
Ce congé de vingt jours maximum, non rémunérés, et fractionnables, est aujourd’hui prévu par les articles L. 3142-41 et L. 3142-42. Le présent article ne modifie en rien le contenu de ce congé qui peut être pris par le salarié qui réside ou est habituellement employé dans une zone touchée par une catastrophe naturelle pour apporter de l’aide aux victimes.
Le texte confie le soin à un accord collectif d’entreprise ou, à défaut, à un accord de branche, de déterminer la durée maximale du congé – qui peut donc être supérieure ou inférieure à vingt jours – ainsi que les délais dans lesquels le salarié adresse sa demande de congé (article L. 3142-43 dans sa nouvelle rédaction). Ce n’est qu’à défaut d’accord que la durée maximale de ce congé est fixée à vingt jours et qu’un décret doit venir fixer les délais impartis au salarié pour adresser sa demande (article L. 3142-44) : aucun délai n’est à ce jour fixé dans ce domaine. D’après les informations transmises au rapporteur, ce délai d’ordre supplétif devrait être de vingt-quatre heures.
Les mêmes précisions que pour les autres congés – sur la non imputabilité du congé sur le congé payé annuel et sur les modalités de contestation en cas de différend – sont apportées au congé pour catastrophe naturelle.
Ce congé non rémunéré de six jours ouvrables par an est ouvert aux salariés de moins de vingt-cinq ans qui souhaitent participer aux activités des organisations de jeunesse et d’éducation populaire, des fédérations et des associations sportives destinées à favoriser la préparation et la formation ou le perfectionnement de cadres et animateurs : il est pour l’heure codifié aux articles L. 3142-43 à L. 3142-46.
Sans en modifier les contours, le présent article propose, à l’article L. 3142-49 dans sa nouvelle rédaction, de renvoyer à un accord collectif d’entreprise ou, à défaut, un accord de branche, le soin de déterminer la durée totale maximale du congé – qui peut donc être supérieure ou inférieure à six jours ouvrables par an – et les conditions de son cumul avec le congé de formation économique, sociale et syndicale, mais aussi le délai dans lequel le salarié adresse sa demande de congé à l’employeur et enfin, les règles permettant de déterminer, par établissement, le nombre maximum de salariés susceptibles de bénéficier de ce congé.
En l’absence d’accord, l’article L. 3142-50 prévoit que le nombre maximal de journées de congé à ce titre est de six jours ouvrables et que le cumul entre ce congé et le congé de formation économique, sociale et syndicale est limité à douze jours ouvrables sur l’année. Il renvoie au décret pour fixer le délai dans lequel le salarié adresse sa demande à l’employeur ainsi que les règles relatives au maximum de salariés susceptibles de bénéficier de ce congé.
L’article D. 3142-17 prévoit que la demande de congé doit être adressée à l’employeur au moins trente jours avant le début de ce congé ; l’éventuel refus du congé est notifié par l’employeur dans les huit jours à compter de la réception de la demande (article D. 3142-20).
S’agissant du plafond de salariés par établissement ayant bénéficié du congé au cours de l’année et qui peut fonder le refus de l’employeur d’y faire droit, celui-ci est fixé par l’article D. 3142-18 à : un bénéficiaire dans les établissements de moins de 50 salariés ; deux bénéficiaires dans les établissements de 50 à 99 salariés ; trois dans les établissements de 100 à 199 salariés ; quatre dans les établissements de 200 à 499 salariés ; cinq dans les établissements de 500 à 999 salariés ; six dans les établissements de 1 000 à 1 999 salariés ; et au-delà, un bénéficiaire de plus par tranche supplémentaire de 1 000 salariés.
L’ensemble de ces dispositions réglementaires seront reprises sans modification.
Ce congé permet à des salariés membres d’une association ou d’une mutuelle de la représenter au sein d’une instance, dans la limite de neuf jours ouvrables par an. La diminution de rémunération potentiellement occasionnée par ce congé fait l’objet d’une indemnité compensatrice versée par l’État ou la collectivité territoriale (articles L. 3142-51 à L. 3142-55).
Le présent article replace ce congé aux articles L. 3142-51 à L. 3142-57 dans leur nouvelle rédaction. L’article L. 3142-56 renvoie à un accord collectif d’entreprise ou, à défaut, de branche, le soin de déterminer la durée de ce congé
– qui peut donc être supérieure ou inférieure à neuf jours ouvrables –, le délai dans lequel le salarié adresse sa demande de congé à son employeur, et enfin, le nombre maximum de salariés par établissement susceptibles de bénéficier de ce congé au cours d’une année. Ce n’est qu’en l’absence d’accord que cette durée est fixée à neuf jours ouvrables, tandis qu’un décret doit déterminer le délai dans lequel le salarié doit adresser sa demande à l’employeur ainsi que les règles de détermination du nombre de salariés pouvant bénéficier de ce congé au cours d’une même année.
Pour l’heure, l’article D. 3142-27 prévoit que la demande de congé doit être adressée à l’employeur au moins quinze jours à l’avance. S’agissant des règles relatives au plafond de salariés ayant bénéficié du congé en cours d’année qui permet à l’employeur de refuser de faire droit aux demandes supplémentaires de congé qui lui sont adressées, l’article D. 3142-28 fixe les plafonds suivants : un bénéficiaire pour les établissements de moins de 50 salariés ; deux bénéficiaires dans les établissements de 50 à 99 salariés ; trois dans les établissements de 100 à 199 salariés ; huit dans les établissements de 200 à 499 salariés ; dix dans les établissements de 500 à 999 salariés ; douze dans les établissements de 1 000 à 1 999 salariés ; et au-delà, deux bénéficiaires de plus par tranche supplémentaire de 1 000 salariés. Ces délais et plafonds ont vocation à être repris sans modification.
Prévu aux actuels articles L. 3142-32 à L. 3142-40, le congé de solidarité internationale permet à un salarié ayant au moins douze mois d’ancienneté dans son entreprise d’accomplir une mission humanitaire de maximum six mois. En cas d’urgence, il peut bénéficier d’un congé de six semaines sous préavis de quarante-huit heures.
Les principales caractéristiques et conditions applicables au congé, prévues aux articles L. 3142-68 à L. 3142-75 dans leur nouvelle rédaction, demeurent inchangées. Ce congé fait désormais l’objet des dispositions prévues aux articles L. 3142-58 à L. 3142-65.
L’article L. 3142-64 dans sa nouvelle rédaction prévoit qu’un accord collectif d’entreprise ou, à défaut, de branche, fixe la durée maximale du congé
– qui peut donc être supérieure ou inférieure à six mois –, l’ancienneté requise pour bénéficier du congé, le nombre maximum de salariés susceptibles de bénéficier simultanément d’un tel congé en fonction de la taille de l’établissement, les délais dans lesquels le salarié adresse sa demande à l’employeur, ainsi que les mesures permettant de maintenir un lien entre l’entreprise et le salarié pendant le congé et le cas échéant, les modalités d’accompagnement dont il peut bénéficier à son retour.
L’article L. 3142-65 dans sa nouvelle rédaction introduit les dispositions supplétives, applicables en l’absence d’accord : dans ce cas, la durée maximale du congé est de six mois, et de six semaines en cas d’urgence, de même que l’ancienneté requise du salarié dans l’entreprise est de douze mois. Un décret doit fixer les règles de détermination du nombre maximum de salariés pouvant bénéficier simultanément du congé et les délais dans lesquels le salarié doit adresser sa demande de congé à l’employeur.
L’article D. 3142-14 impose un délai minimum de prévenance de trente jours avant le début du congé. L’article D. 3142-15 fixe également les mêmes plafonds de salariés ayant bénéficié d’un congé au cours de la même année que ceux applicables pour le congé de formation de cadres et d’animateurs pour la jeunesse (article D. 3142-18).
Figurant pour l’heure à l’article L. 3142-116, le congé pour acquisition de la nationalité permet à un salarié de s’absenter une demi-journée pour assister à sa cérémonie d’accueil dans la citoyenneté française.
Le présent article propose de faire figurer les dispositions relatives à ce congé aux articles L. 3142-66 à L. 3142-69. Sans modifier les caractéristiques de ce congé, il prévoit les mêmes harmonisations que pour les autres congés (non imputabilité sur le congé payé annuel, contestation devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes en cas de différend), et renvoie à un accord collectif d’entreprise ou, à défaut, de branche, le soin de déterminer « notamment » sa durée. Par défaut, en l’absence d’accord, celle-ci sera d’une demi-journée (article L. 3142-79).
*
Les II et III du présent article procèdent ensuite à la renumérotation des articles figurant aux sous-sections 8 et 9, et respectivement consacrés aux congés des salariés candidats ou élus à un parlementaire ou local et à la réserve opérationnelle et au service national, sans apporter de modification à leur contenu.
Le IV du présent article complète cette section consacrée aux congés pour engagement associatif, politique ou militant en y intégrant l’actuelle sous-section 11 qui a trait à la réserve dans la sécurité civile, les opérations de secours et la réserve sanitaire et qui devient la sous-section 10. Aucune modification n’est apportée au contenu de cette sous-section.
L’ensemble de ces congés relève en effet naturellement de l’ordre public ; il ne saurait être question de renvoyer leur mise en œuvre à la négociation collective.
Le V du présent article complète les dispositions relatives aux congés en insérant une nouvelle section 3 qui recouvre les congés d’évolution des parcours professionnels: il s’agit d’une part du congé et de la période de travail à temps partiel pour la création ou la reprise d’entreprise et d’autre part du congé sabbatique.
Ÿ Prévus aux articles L. 3142-78 à L. 3142-90, le congé et la période de travail à temps partiel pour la création ou la reprise d’entreprise permettent à un salarié disposant d’au moins vingt-quatre mois d’ancienneté qui crée ou reprend une entreprise de bénéficier soit d’un congé d’au maximum un an reconductible pendant lequel le contrat de travail est suspendu, soit d’une période de travail à temps partiel.
Le salarié doit préalablement informer son employeur de la date envisagée de son départ en congé ou de la date et de l’amplitude de la réduction de temps de travail qu’il sollicite. L’employeur peut différer le départ en congé ou le début de la période de travail à temps partiel de six mois à compter du moment où la demande est formulée. Il peut également différer le départ en congé en fonction du nombre de salariés simultanément absents au titre de ce congé ou du pourcentage de jour d’absence à ce titre.
À l’issue du congé, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération équivalente. Toutefois, le salarié ne peut prétendre à être réemployé avant l’expiration de son congé. Les mêmes conditions s’appliquent en cas de passage à temps partiel.
Le passage à une période de travail à temps partiel doit faire l’objet d’un avenant au contrat de travail, et toute prolongation de cette période donne lieu à la signature d’un nouvel avenant. Dans les entreprises de moins de 200 salariés, l’employeur qui juge que le congé ou le passage à temps partiel d’un salarié aurait des conséquences préjudiciables sur la production et la bonne marche de l’entreprise peut refuser ce passage. Dans les entreprises de plus de 200 salariés, il peut différer la signature de l’avenant au contrat de travail si le pourcentage de salarié simultanément à temps partiel atteint 2 %, et ce jusqu’à ce que cette part soit de nouveau inférieure à 2 %.
Ÿ Le présent article apporte une série de modifications au dispositif du congé et de la période de travail à temps partiel pour la création ou la reprise d’entreprise, tout en procédant, comme pour les autres congés, à la modification de la hiérarchie des normes qui l’encadrent, en prévoyant de renvoyer à l’accord d’entreprise ou, à défaut, à l’accord de branche, pour déterminer certaines caractéristiques du dispositif qui ne sont pas d’ordre public, les dispositions supplétives s’appliquant alors seulement en l’absence d’accord.
Les règles relatives à ce congé figureraient désormais aux articles L. 3142-96 à L. 3142-114.
S’agissant des règles d’ordre public, on constate en premier lieu que la condition d’ancienneté pour bénéficier du congé n’est plus d’ordre public. Le texte précise toutefois que l’ancienneté acquise dans toute entreprise du même groupe est prise en compte. Le seuil d’effectifs d’entreprise en-deçà duquel l’employeur peut refuser le congé est porté de deux cents à trois cents salariés, tandis que le texte précise les voies de recours en cas de différend. S’agissant de la capacité de l’employeur à différer le départ en congé ou le passage à temps partiel, le texte conserve cette possibilité pour l’employeur pendant six mois. Il conserve également les deux autres modalités qui permettent à l’employeur de différer la prise de congé ou le passage à temps partiel : d’une part, si le nombre de jours d’absence ou le nombre de salariés simultanément absents atteint un niveau excessif par rapport à l’effectif total de l’entreprise ou au nombre de jours travaillés ; et d’autre part, dans les entreprises de plus de 300 salariés, si le nombre de salariés à temps partiel atteint un niveau excessif, le texte gommant la référence au taux de 2 %.
L’article L. 3142-106 dans sa nouvelle rédaction prévoit que l’employeur informe le salarié de son accord, du report de la date souhaitée de départ du salarié ou de son refus. En l’absence de réponse, l’accord de l’employeur est réputé acquis.
Les articles L. 3142-107 et L. 3142-108 renvoient à la négociation collective – en l’occurrence, à un accord d’entreprise ou, à défaut, à un accord de branche – pour déterminer l’ensemble des conditions applicables au congé ou à la période de temps partiel:
– sa durée maximale – qui peut donc être supérieure ou inférieure à un an - et le nombre de renouvellements possibles – un, deux, ou plus, le principe du renouvellement étant d’ordre public – ;
– la condition d’ancienneté requise du salarié pour en bénéficier ;
– les délais impartis au salarié pour informer l’employeur, soit de son départ en congé, soit de son passage à temps partiel et de l’amplitude de la réduction du temps de travail envisagée, ainsi que de la durée de ce congé ou de cette réduction ;
– les conditions et délais d’une éventuelle demande de prolongation ;
– celles d’une éventuelle intention de rompre le contrat ou de réintégrer l’entreprise à l’issue du congé ou de la période de travail à temps partiel ;
– les niveaux maximaux de salariés absents, de nombre de jours d’absence ou de salariés employés à temps partiel pouvant fonder le report par l’employeur d’un congé ou d’une transformation en temps partiel à ce titre ;
– et enfin, les conditions permettant le maintien d’un lien entre l’entreprise et le salarié pendant son congé ainsi que les modalités d’accompagnement et de réadaptation professionnelle à son retour.
L’accord collectif en question doit également traiter des modalités de report des congés payés dus au salarié bénéficiant d’un congé.
Les articles L. 3142-109 à L. 3142-114 portent l’ensemble des dispositions supplétives, applicables au congé ou au passage à temps partiel pour la création ou la reprise d’une entreprise en l’absence d’accord collectif. Ainsi, ce n’est que par défaut que la durée du congé ou de la période de travail à temps partiel est d’un an reconductible pour la même période, et qu’une ancienneté de vingt-quatre mois est requise du salarié pour bénéficier de ce dispositif. Autrement dit, un accord d’entreprise ou, à défaut, un accord de branche, pourra fixer des conditions plus ou moins avantageuses que les dispositions légales, qui deviennent supplétives par rapport à la norme conventionnelle, cette dernière faisant qui plus est prévaloir l’accord d’entreprise sur l’accord de branche.
À défaut d’accord, les conditions et délais d’information de l’employeur quant à la prorogation du congé, la poursuite du contrat ou sa rupture à l’issue du congé, ainsi que le niveau de salariés absents qui rend possible pour l’employeur de différer un départ en congé, sont fixés par décret.
Les articles D. 3142-41 à D. 3142-46 imposent actuellement un délai de prévenance minimal de deux mois pour la prise du congé ou le passage à temps partiel ; ce délai est fixé à un mois avant le terme initialement prévu pour toute demande de prolongation. Dans les deux cas, l’accord de l’employeur est réputé acquis en l’absence de réponse de sa part dans un délai de trente jours à compter de la réception de la demande. L’employeur peut différer le départ en congé ou le passage à temps partiel dans la limite de six mois à compter de la réception de la demande. Le salarié est tenu d’informer l’employeur de son souhait de rompre le contrat ou de le poursuivre au moins trois mois avant la fin de son congé. L’employeur peut enfin différer la signature de l’avenant nécessaire pour le passage à temps partiel d’un salarié : il doit en informer le salarié par lettre recommandée ; à défaut de réponse de sa part dans un délai de trente jours, son accord est réputé acquis. Aucune modification n’est prévue s’agissant de ces délais.
S’agissant de la proportion de salariés autorisés à s’absenter au titre de ce congé, d’un congé pour l’exercice de responsabilités de direction au sein d’une jeune entreprise innovante (JEI) et d’un congé sabbatique, les articles D. 3142-49 et D. 3142-50 fixent ce taux à 2 % pour les entreprises d’au moins 200 salariés – 1,5 % lorsqu’il s’agit du seul congé sabbatique –. Dans les entreprises de moins de 200 salariés, c’est le nombre de jours d’absence au titre des congés pour la création d’entreprise qui est pris en compte : il est fixé à 2 % du nombre total de jours de travail effectués dans les douze mois précédant le départ en congé, et à 1,5 % pour le seul congé sabbatique.
Rigoureusement, ces règles devraient être reprises avec une fixation des seuils d’effectifs pivots à 300 salariés.
L’ensemble des règles relatives au report de congés payés qui figurent actuellement aux articles L. 3142-100 à L. 3142-104 et qui s’appliquent au congé pour la création d’entreprise comme au congé sabbatique, sont renvoyées au niveau des dispositions supplétives et ne trouveront à s’appliquer qu’en l’absence d’accord collectif fixant des règles propres de report des congés payés.
Le congé sabbatique fait actuellement l’objet des articles L. 3142-91 à L. 3142-95 : il permet au salarié ayant au moins trente-six mois d’ancienneté – consécutifs ou non – et six années d’activité professionnelle de bénéficier d’un congé d’une durée minimale de six mois et d’une durée maximale de onze mois, pendant laquelle son contrat de travail est suspendu.
Le salarié est tenu d’informer son employeur de la date de départ en congé en précisant la durée de ce dernier. L’employeur peut différer son départ jusqu’à six mois – jusqu’à neuf mois dans les entreprises de moins de 200 salariés.
À l’issue de son congé, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente et bénéficie d’un entretien professionnel ; il ne peut toutefois invoquer aucun droit à être réemployé avant l’expiration du congé.
Le présent article propose d’inscrire les dispositions encadrant le congé sabbatique aux articles L. 3142-115 à L. 3142-122.
Il pose comme étant d’ordre public :
– le principe de l’exercice préalable d’une activité professionnelle pendant six ans pour bénéficier du droit à congé. On notera en revanche que la condition d’ancienneté de trente-six mois et celle de ne pas avoir bénéficié pendant les six années précédentes d’un congé sabbatique, d’un congé pour création d’entreprise ou d’un congé individuel de formation d’une durée d’au moins six mois ne figurent pas parmi les mesures d’ordre public. Le texte précise également que l’ancienneté acquise dans toute autre entreprise du même groupe est prise en compte. Enfin, les règles d’ordre public ne posent pas de limites temporelles au congé ;
– la possibilité pour l’employeur de différer le départ en congé dans la limite de six mois. Toutefois, le texte précise que cette possibilité est liée au niveau de salariés absents au titre du congé dans l’entreprise ou de jours d’absence prévus au titre du congé. Il porte également de 200 à 300 salariés le seuil d’effectifs en deçà duquel la possibilité pour l’employeur de différer le départ en congé est élargie à 9 mois. Par rapport au droit existant, le texte propose également d’ajouter un nouveau motif permettant à l’employeur de différer le départ en congé, s’il estime que le nombre de salariés absents ou le nombre de jours d’absence est porté à un niveau excessif. Dans les entreprises de moins de 300 salariés, l’employeur se voit même autorisé à refuser un tel congé s’il estime, après consultation du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, que son octroi aurait des conséquences préjudiciables à la marche de l’entreprise ;
– les conditions d’information du salarié par l’employeur de son accord ou de son refus et celles dans lesquelles le salarié retrouve son emploi ou un emploi équivalent à l’issue de son congé sont reprises sans modification. Le texte se contente de supprimer le principe du « silence vaut accord ».
Le texte ouvre donc la possibilité de négocier les conditions du congé sabbatique. Ainsi, l’article L. 3142-119 dans sa nouvelle rédaction prévoit qu’un accord d’entreprise ou à défaut un accord de branche :
– fixe les durées minimale et maximale du congé et le nombre de renouvellements. Un accord collectif pourrait donc fixer une durée minimale de moins de 6 mois et une durée maximale de moins de 11 mois, tout comme prévoir des dispositions plus avantageuses que celles qui figurent aujourd’hui dans la loi ;
– détermine la condition d’ancienneté requise pour ouvrir droit à congé ;
– fixe la durée minimale dans l’entreprise durant laquelle le salarié ne doit pas avoir bénéficié d’un congé ;
– fixe les plafonds en matière de nombre de salariés absents ou de jours d’absence pour apprécier le droit au congé d’un salarié ;
L’article L. 3142-120 prévoit également que l’accord collectif en question détermine les modalités de report des congés payés dus au salarié, les règles qui sont aujourd’hui d’ordre public devenant dans le droit proposé des modalités supplétives, applicables seulement en l’absence d’accord.
Enfin, constituent donc désormais des dispositions supplétives les règles suivantes :
– la durée minimale du congé de six mois et sa durée maximale de neuf mois ;
– la condition d’ancienneté dans l’entreprise d’au moins 36 mois pour bénéficier du congé sabbatique, l’exercice de 6 années d’activité professionnelle, et le fait de ne pas avoir bénéficié d’un congé sabbatique, d’un congé pour création d’entreprise ou d’un congé individuel de formation dans les six dernières années ;
– les plafonds en matière de nombre de salariés absents ou de jours d’absence qui permettent à l’employeur de différer ou, le cas échéant, de refuser le départ en congé, sont fixés par décret ;
– ainsi que les plafonds mentionnés à l’article L. 3142-116.
L’article D. 3142-47 prévoit actuellement que le délai de prévenance pour un départ en congé sabbatique est de trois mois au minimum. Les mêmes plafonds relatifs au nombre de salariés absents et aux jours d’absence sont applicables que ceux prévus pour le congé pour la création d’entreprise.
Enfin, à défaut de stipulations dans l’accord, les règles de report des congés payés qui s’appliquent, comme aujourd’hui, sont celles prévues aux articles L. 3142-110 à L 3142-114 pour le congé ou la période de temps partiel pour la création ou la reprise d’entreprise.
Congé |
Ordre public |
Champ de la négociation collective |
Dispositions supplétives |
Congés de conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle | |||
1. Congés pour événements familiaux |
Principe des congés Maintien de la rémunération, non imputation du congé sur le congé payé annuel et assimilation à du temps de travail effectif |
Durée des congés, avec planchers fixés par la loi et qui s’imposent à la négociation collective (durées actuelles) |
Durées actuelles des congés |
2. Congé de solidarité familiale |
Principe du congé Non imputation sur le congé payé annuel Possibilité de transformation du congé en travail à temps partiel ou de fractionnement Principe du renouvellement possible du congé Droit de retrouver son emploi à l’issue du congé Possibilité de demander à bénéficier du congé dans des conditions d’urgence |
Durée maximale du congé Nombre de renouvellements possibles Conditions de fractionnement du congé ou de transformation en temps partiel Délais de prévenance Maintien du lien avec l’entreprise et modalités d’accompagnement au retour du salarié |
Durée maximale du congé : 3 mois, renouvelable une fois. Condition d’ancienneté : 2 ans Modalités de fractionnement ou de transformation à temps partiel par décret Délais de prévenance par décret |
3. Congé de proche aidant |
Principe du congé Condition de résidence en France Principe du renouvellement possible du congé dans la limite d’un an au total sur l’ensemble de la carrière Conditions de prise du congé en cas d’urgence Possibilité de transformation du congé en travail à temps partiel ou de fractionnement Non imputation sur le congé annuel et maintien des avantages acquis Droit de retrouver son emploi à l’issue du congé Droit à un entretien professionnel avant et après le congé |
Durée maximale du congé Nombre de renouvellements possibles Conditions d’ancienneté requises Délais de prévenance |
Durée maximale du congé : 3 mois renouvelable, dans la limite d’1 an au total sur la carrière. Ancienneté requise de 2 ans. Délais de prévenance fixés par décret. |
Congés pour engagement associatif, politique ou militant | |||
4. Congé mutualiste de formation |
Principe du congé Non imputation sur le congé annuel, assimilation à du temps de travail effectif |
Durée totale maximale du congé Délais de prévenance Règles de plafonnement du nombre maximal de salariés pouvant bénéficier du congé |
Durée maximale du congé : 9 jours Délais de prévenance fixé par décret Règles de plafonnement du nombre de salariés pouvant bénéficier du congé au cours de l’année fixées par décret |
5. Congés de participation aux instances d’emploi et de formation professionnelle ou à un jury d’examen |
Principe de l’autorisation d’absence Principe du maintien de la rémunération et non imputation du congé sur le congé annuel Conditions de refus de l’employeur après consultation des IRP |
Délais de prévenance |
Délais de prévenance fixés par décret |
5. Congé pour catastrophe naturelle |
Principe du congé Conditions de prise du congé en urgence Non imputation sur le congé annuel Conditions de refus de l’employeur après avis des IRP |
Durée maximale du congé Délais de prévenance |
Durée maximale du congé : 20 jours Délais de prévenance fixés par décret |
6. Congés de formation de cadres et d’animateurs pour la jeunesse |
Principe du congé annuel en une ou deux fois pour les salariés de moins de 25 ans Non imputation sur le congé annuel, assimilation à du temps de travail effectif Conditions de report du congé par l’employeur dont les modalités sont renvoyées au décret |
Durée totale maximale du congé et conditions de cumul avec le congé de formation économique, sociale et syndicale Délais de prévenance Règles de plafonnement du nombre maximal de salariés pouvant en bénéficier |
Durée totale maximale du congé : 6 jours ouvrables Cumul avec le congé de FESS : 12 jours ouvrables sur l’année Délais de prévenance fixés par décret Plafond de salariés bénéficiant du congé par décret |
7. Congé de représentation |
Principe du congé Principe d’une indemnisation en cas de perte de rémunération ou maintien de la rémunération Possibilité de fractionnement en demi-journées Non imputation sur le congé annuel, assimilation à du temps de travail effectif Conditions de refus de l’employeur après avis des IRP |
Durée du congé Délais de prévenance Règles de plafonnement du nombre maximal de salariés pouvant en bénéficier |
Durée maximale du congé : 9 jours ouvrables par an Délais de prévenance et plafonds de salariés pouvant bénéficier du congé fixés par décret |
8. Congé de solidarité internationale |
Principe du congé Non imputation sur le congé annuel et assimilation à du temps de travail effectif Conditions de refus par l’employeur après avis des IRP Conditions applicables en cas d’urgence Droit de retrouver son emploi à l’issue du congé Attestation obligatoire à l’issue du congé |
Durée maximale du congé Conditions d’ancienneté Règles de plafonnement du nombre maximal de salariés pouvant en bénéficier Délais de prévenance Maintien du lien avec l’entreprise et modalités d’accompagnement au retour du salarié |
Durée maximale du congé : 6 mois ; 6 semaines en cas d’urgence Ancienneté de 12 mois, consécutifs ou non Règles de plafonnement du nombre de salariés pouvant bénéficier du congé et délais de prévenance fixés par décret |
9. Congé pour acquisition de la nationalité |
Droit au congé Non imputation sur le congé annuel |
Durée du congé |
Durée du congé : une demi-journée. |
Congés d’évolution des parcours professionnels | |||
10. Congé et période de travail à temps partiel pour la création ou la reprise d’entreprise |
Principe du droit à congé ou au passage à temps partiel Condition d’ancienneté Conditions de report de la prise de congé par l’employeur Droit de retrouver son emploi à l’issue du congé et principe d’une réadaptation professionnelle si nécessaire Principe de l’avenant au contrat de travail en cas de passage à temps partiel Conditions de refus par l’employeur (entreprises de moins de 300 salariés) ou de différer le congé ou le passage à temps partiel |
Durée maximale du congé ou de la période de travail à temps partiel Nombre de renouvellements possible Condition d’ancienneté requise Délais de prévenance et d’information Plafonds et nivaux maximum de salariés bénéficiant du congé ou du passage à temps partiel Conditions du maintien du lien avec l’entreprise et modalités d’accompagnement et de réadaptation professionnelle au retour du salarié Modalités de report des congés payés |
Durée maximale du congé ou de la période de travail à temps partiel : 1 an, avec possibilité de prolonger jusqu’à 1 an de plus Ancienneté requise : 24 mois, consécutifs ou non Délais de prévenance et d’information prévus par décret Plafonnement du nombre de salariés absents au titre du congé fixé par décret Règles supplétives de report des congés payés |
11. Congé sabbatique |
Principe du droit à congé Condition d’ancienneté Condition de ne pas avoir bénéficié d’un congé d’au moins 6 mois pendant une période donnée Possibilité de report par l’employeur Droit à retrouver son emploi à l’issue du congé |
Durées minimale et maximale du congé et nombre de renouvellements Condition d’ancienneté requise Durée minimale pendant laquelle le salarié ne doit pas avoir bénéficié d’un congé Plafonds de salariés absents simultanément Conditions et délais d’information Modalités de report des congés payés |
Durée minimale du congé : 6 mois Durée maximale du congé : 11 mois Condition d’ancienneté : 36 mois, consécutifs ou non et 6 années d’activité professionnelle Condition de ne pas avoir bénéficié d’un congé pendant les 6 années précédentes Plafond de salariés et délais fixés par décret Règles supplétives de report des congés payés |
*
Lors de l’examen de cet article, la Commission a adopté sept amendements :
– un amendement de M. Hetzel (AS30) proposant de réintituler les congés de conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle, en y ajoutant la mention « familiale » ;
– deux amendements à l’initiative de Mme Delaunay (AS320 et AS321) qui portent à cinq jours – au lieu de deux jours – le congé dont bénéficie le salarié en cas de décès d’un enfant ;
– s’agissant du congé de proche aidant, à l’initiative du rapporteur, trois amendements (AS914, AS913 et AS915) qui proposent de fixer l’ancienneté de deux ans requise du salarié pour bénéficier de ce congé dans les règles d’ordre public, et de supprimer tout renvoi à la négociation collective sur ce point ;
– un amendement de Mme Dominique Orliac (AS456) qui précise que le congé mutualiste de formation bénéficie aux administrateurs des mutuelles, de leurs « unions » comme de leurs « fédérations ».
*
La Commission examine l’amendement AS413 de Mme Jacqueline Fraysse.
Mme Jacqueline Fraysse. Nous demandons la suppression de cet article, qui traite des différents congés, pour les mêmes raisons qui nous avaient conduits à demander la suppression de l’article 2 sur le temps de travail.
M. Christophe Sirugue, rapporteur. Défavorable. C’est à l’architecture même du texte que s’oppose Mme Fraysse.
La Commission rejette cet amendement.
Elle examine ensuite l’amendement AS30 de M. Patrick Hetzel.
M. Patrick Hetzel. Cet amendement de précision et de cohérence tend à compléter l’intitulé de la sous-section 1 : « Congés de conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle » par les mots « et familiale ».
M. le rapporteur. Nous pourrions longuement disserter sur la question de savoir si la vie familiale est une sous-catégorie de la vie personnelle, mais je pense que cette proposition va dans le bon sens. Avis favorable.
M. Élie Aboud. Cela commence bien, aujourd’hui !
La Commission adopte cet amendement.
Elle examine ensuite les deux amendements identiques AS455 de M. Alain Tourret et AS597 de M. Gilles Lurton.
Mme Dominique Orliac. L’accord de branche, signé à un niveau supérieur à celui de l’accord d’entreprise, a pour objet de garantir une égalité de traitement entre salariés exerçant les mêmes métiers et d’éviter ainsi une concurrence déloyale entre entreprises par le biais du dumping social. De plus, dans les TPE, l’application directe d’un accord de branche constitue une réelle sécurité juridique, qui n’expose pas ces entreprises au contentieux, à l’inverse du recours au mandatement syndical par lequel elles seraient livrées à elles-mêmes. D’où la substitution proposée par notre amendement AS455.
M. Élie Aboud. Nous retirons notre amendement AS597.
M. le rapporteur. Par cohérence, compte tenu de nos échanges d’hier, je suppose… Quoi qu’il en soit, je ne peux que m’en féliciter.
Mme Orliac suggère de revenir sur l’architecture du texte. Avis défavorable.
Mme Isabelle Le Callennec. Dans l’ordre public, on précise parfois les choses ; dans le cas présent, s’agissant des congés, aucune durée n’est précisée.
M. le rapporteur. On ne porte dans l’ordre public que les principes et on renvoie la durée, l’organisation et autres soit à la négociation collective, soit, à défaut d’accord, au supplétif.
L’amendement AS597 est retiré.
La Commission rejette l’amendement AS455.
Elle examine ensuite l’amendement AS320 de Mme Michèle Delaunay.
Mme Michèle Delaunay. Cet amendement vise à porter de deux à cinq jours la durée du congé exceptionnel dans le cas du décès d’un enfant. Une convention, un accord d’entreprise ou de branche ne pourra prévoir un seuil inférieur.
Cet amendement est dans le prolongement d’une proposition de loi adoptée par l’Assemblée nationale le 23 novembre 2011 et par le Sénat le 1er avril 2015. Le décès d’un enfant est un moment extrêmement douloureux. Chaque année en France, près de 8 000 enfants et jeunes décèdent avant d’atteindre vingt-cinq ans, et près de deux tiers de ces décès sont dus à l’évolution d’une maladie – toujours la même dans la majorité des cas : 37 % touchent les enfants de moins d’un an, 18 % des enfants d’un an à quatorze ans, 45 % des adolescents.
Il est peu compréhensible que le congé pour décès d’un enfant soit plus court que le congé pour mariage. Un congé de moins de cinq jours ne permet même pas d’organiser l’inhumation et laisse les parents dans un état de totale sidération. Je vous invite à donner aux Français un signe de compréhension et de compassion.
Mme Martine Carrillon-Couvreur. Je soutiens cet amendement dont je suis cosignataire : cette inéquité entre les congés exceptionnels accordés à l’occasion de certains événements de la vie, alors que celui-ci est un véritable drame pour les familles, doit être corrigée. J’espère que cet amendement recevra un avis favorable.
M. Élie Aboud. On ne saurait s’opposer sur le fond à une telle proposition. Au-delà de l’aspect émotionnel, il faut regarder comment cela se passe dans la vie réelle. Un chef d’entreprise, quand un tel drame se produit, ne peut-il accorder plus que cinq jours ? C’est la seule question que l’on peut se poser.
Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte cet amendement à l’unanimité.
Elle en vient à l’amendement AS321 de Mme Michèle Delaunay.
Mme Michèle Delaunay. Il s’agit d’un complément au précédent amendement, afin que la même règle s’applique en cas d’absence de convention, d’accord d’entreprise ou de branche.
M. le rapporteur. Avis favorable à cet amendement de pure cohérence. C’est le complément dans le dispositif supplétif.
La Commission adopte cet amendement.
Elle examine ensuite l’amendement AS914 du rapporteur.
M. le rapporteur. L’ancienneté requise pour bénéficier du congé de proche aidant est aujourd’hui de deux ans. Cette durée est reprise au niveau des dispositions supplétives applicables en l’absence d’accord. Toutefois, au regard de la spécificité de ce congé qui relève de la catégorie des congés de conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle, il ne me semble pas que la condition d’ancienneté pour en bénéficier soit négociable, autrement dit qu’une ancienneté supérieure puisse être exigée pour l’ouverture de ce droit.
La Commission adopte cet amendement.
Elle adopte ensuite successivement les amendements de conséquence AS913 et AS915 du rapporteur.
Elle en vient à l’amendement AS518 de M. Christophe Cavard.
M. Christophe Cavard. Cet amendement vise à inscrire le congé sabbatique dans les congés de conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle plutôt que dans les congés d’évolution professionnelle.
M. le rapporteur. J’y suis plutôt favorable, mais votre amendement pose un problème de positionnement : en insérant votre dispositif après l’alinéa 105, vous créez une nouvelle sous-section 4 dans la section 2 alors qu’il devrait s’insérer dans la sous-section 2 de la section 3. Je vous propose de le retirer, afin que nous travaillions ensemble à une nouvelle rédaction d’ici à la séance.
M. Christophe Cavard. Avec plaisir, dès lors qu’il est adopté dans le principe…
L’amendement est retiré.
La Commission examine l’amendement AS456 de Mme Dominique Orliac.
Mme Dominique Orliac. Cet amendement vise à préciser le code du travail, qui ne vise expressément que les mutuelles, alors que l’article L. 114-16 du code de la mutualité concerne également les administrateurs des unions et des fédérations. En effet, cet alinéa se trouve au paragraphe concernant les mesures d’ordre public. Or la jurisprudence actuelle interprète généralement les mesures d’ordre public de manière restrictive. Les employeurs ayant tendance à limiter au maximum les droits des administrateurs mutualistes, cette précision permettra d’éviter toute difficulté d’interprétation du champ d’application de cette mesure essentielle pour la formation des élus des organismes mutualistes dans leur ensemble.
M. le rapporteur. Ce n’est pas parce que c’est inscrit dans l’ordre public que c’est forcément plus strict, mais il peut en effet exister une inquiétude ; si votre amendement cela peut être de nature à rassurer les représentants des mutuelles, j’y suis plutôt favorable.
La Commission adopte cet amendement.
Elle examine ensuite l’amendement AS457 de Mme Dominique Orliac.
Mme Dominique Orliac. Cet amendement vise à étendre le congé mutualiste de formation aux bénévoles n’ayant pas la qualité d’administrateur, particulièrement impliqués dans le fonctionnement. Ainsi, ne seront concernés que les bénévoles titulaires d’un mandat prévu par la loi – notamment les délégués siégeant aux assemblées générales – ou par les statuts des organismes – délégués de territoires, membres des commissions départementales. Cette modification est cohérente avec la réflexion en cours sur l’évolution du code de la mutualité, dont l’une des orientations est le statut de mandataire mutualiste, tel que défini dans le présent amendement.
M. le rapporteur. Défavorable. Si nous étendons le congé de formation aux bénévoles, où nous arrêterons-nous ? Le compte engagement citoyen que nous créons dans le cadre du compte personnel d’activité (CPA) peut répondre à l’objectif que vous visez.
Mme Isabelle Le Callennec. Le compte engagement citoyen ouvre des droits à la formation, alors qu’il est ici question de droits à congé.
M. le rapporteur. Il s’agit d’un congé de formation. Nous aurons l’occasion d’en reparler plus précisément le moment venu, lorsque nous traiterons du compte personnel d’activité.
La Commission rejette cet amendement.
Elle examine ensuite l’amendement AS458 de Mme Dominique Orliac.
Mme Dominique Orliac. Cet amendement précise que les bénévoles titulaires d’un mandat prévu par la loi ou les statuts des organismes peuvent bénéficier d’un congé de formation d’une durée maximale de quatre jours.
Ces militants sont indispensables au fonctionnement démocratique des mutuelles ; leur formation est fondamentale pour leur permettre notamment d’acquérir un socle de connaissances indispensable à la bonne compréhension des problématiques, dont la technicité est croissante, les règles prudentielles qui s’imposent aux organismes mutualistes nécessitant un niveau d’expertise important. Le processus de professionnalisation des militants mutualistes, voulu par les directives européennes, doit donc s’accompagner d’une formation adéquate.
Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette cet amendement.
Elle adopte ensuite l’article 3 modifié.
*
* *
Article 3 bis
(Art. L. 1225-4 et L. 1225-4-1 du code du travail)
Extension de la durée de protection contre le licenciement
à l’issue du congé de maternité
Cet article est issu de l’adoption par la commission de deux amendements identiques de la commission des affaires économiques (AS974 Rect.) et de Mme Dominique Orliac (AS23).
Ces amendements reprennent les principales dispositions de la proposition de loi n° 2927 de Mme Dominique Orliac, cosignée par l’ensemble des députés du groupe Radical, Républicain, Démocrate et Progressiste (RRDP) et adoptée, en première lecture, à l’unanimité par l’Assemblée nationale le 10 mars 2016.
Il s’agit d’étendre la durée de la période légale de protection contre le licenciement pour les mères à l’issue de leur congé de maternité, en la faisant passer de quatre à dix semaines.
Cette extension de quatre à dix semaines de la protection contre le licenciement est également prévue pour le père.
Enfin, les congés payés pris à l’issue du congé de maternité sont expressément inclus dans la période de protection contre le licenciement.
Seules ne sont pas reprises les dispositions visant à interdire à l’employeur de prendre des mesures préparatoires au licenciement pendant la période de protection relative du contrat de travail de la salariée, qui avaient été intégrées à la proposition de loi dans le cadre de l’examen du texte dans l’hémicycle.
*
La Commission examine les deux amendements identiques AS974 rectifié de M. Yves Blein, rapporteur pour avis de la Commission des affaires économiques, et AS23 de Mme Dominique Orliac.
M. Yves Blein, rapporteur pour avis de la Commission des affaires économiques. Ces deux amendements reprennent une proposition de loi déposée par Mme Orliac et adoptée à l’unanimité par l’Assemblée. Je laisse notre collègue les présenter.
Mme Dominique Orliac. L’amendement AS23 reprend les principales dispositions de la proposition de loi n° 2927 cosignée par l’ensemble des députés du groupe RRDP et adoptée à l’unanimité à l’Assemblée nationale le 10 mars 2016.
À l’instar de cette proposition de loi, l’amendement propose d’étendre la durée de la période légale de protection contre le licenciement pour les mères à l’issue de leur congé de maternité, en la faisant passer de quatre à dix semaines. L’extension de cette période de protection s’applique également au second parent, qui en bénéficie à compter de la naissance de l’enfant, ainsi qu’aux parents adoptants.
L’amendement vise également à inscrire dans la loi l’évolution récente de la jurisprudence consistant à reporter le point de départ de cette période de protection à l’expiration des congés payés quand ces derniers sont pris directement après le congé de maternité. En effet, par son arrêt Société Foncia groupe, société anonyme, contre Mme Agnès X du 30 avril 2014, la chambre sociale de la Cour de cassation a estimé que « la période de protection de quatre semaines suivant le congé maternité étant suspendue par la prise des congés payés, son point de départ était reporté à la date de la reprise du travail par la salariée ».
L’amendement vise à sécuriser le parcours professionnel des parents après l’arrivée d’un enfant, sans remettre en cause le caractère relatif de la protection. Au cours de cette période, l’employeur peut en effet toujours licencier le ou la salariée en cas de « faute grave non liée à l’état de grossesse » ou en cas d’« impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à la grossesse ou à l’accouchement », conformément aux dispositions de l’alinéa 2 de l’article L. 1225-4 du code du travail.
La proposition de loi a reçu le soutien du Défenseur des droits, qui s’est saisi de ce texte avant son examen à l’Assemblée nationale. Dans son avis du 24 février 2016, celui-ci a estimé que les dispositions prévues constituaient « un moyen juridique pertinent » pour remédier à des éventuelles situations de discrimination et affirmé soutenir « pleinement l’opportunité de cette proposition de loi ».
Cet amendement reprend ma proposition, à deux dispositions près. Les dispositions relatives à l’interdiction pour l’employeur de prendre des mesures préparatoires au licenciement lors de la période de protection n’ont en effet pas été retenues. Ce retrait s’explique du fait qu’avec le recul je partage la position de Mme la ministre en ce qui concerne la difficulté de définir juridiquement la notion de « mesures préparatoires au licenciement ». L’amendement ne réduit pas l’apport de la proposition de loi puisque la Cour de cassation adopte déjà cette position dans sa jurisprudence.
M. le rapporteur. Avis favorable. Je me demandais justement pourquoi votre amendement ne reprenait pas l’intégralité de votre proposition de loi ; vous venez d’y répondre.
M. Gilles Lurton. Même si nous avions des réticences sur l’extension de la mesure au deuxième parent, notre groupe avait voté la proposition de loi. Je voterai donc pour ces amendements, par cohérence.
La Commission adopte ces amendements.
*
* *
Article 4
(Art. L. 3151-1, L. 3151-2 à L. 3151-4 [nouveaux], L. 3152-1 à L. 3152-3, L. 3152-4 [nouveau], L. 3153-1 à L. 3154-3 et L. 3334-10 du code du travail ; art. 81, 163 A et 1417 du code général des impôts et art. 18 de la loi n° 2014-873 du 4 août 2014)
Compte épargne-temps
Le compte épargne-temps est un instrument individuel d’organisation du temps de travail, dont la mise en place est conditionnée à la conclusion d’un accord collectif.
S’inspirant du modèle préconisé par le rapport de Jean-Denis Combrexelle, remis au Premier ministre le 9 septembre 2015, d’une nouvelle architecture du code du travail, le présent article s’attache à appliquer cette nouvelle organisation des normes aux dispositions relatives au compte épargne-temps.
D’après les dernières données de la Direction de l’animation de la recherche et des études statistiques (2), seul un tiers des salariés déclare qu’il est possible d’ouvrir un compte épargne-temps dans leur entreprise et, parmi eux, quatre salariés sur dix en possèdent un.
Seuls 12 % de l’ensemble des salariés disposent d’un compte épargne-temps : 32 % parmi les salariés au forfait jours et 10 % parmi les autres salariés. Quel que soit le secteur d’activité, les ingénieurs et cadres sont plus fréquemment concernés : un quatre d’entre eux est titulaire d’un compte épargne-temps, contre 15 % des techniciens et agents de maîtrise et 7 % des employés et ouvriers. Les salariés des secteurs financier, de l’immobilier, de l’industrie ou des transports sont les plus fréquemment titulaires d’un compte épargne-temps. Les ingénieurs et cadres de ces secteurs sont particulièrement concernés (33 % en sont titulaires), mais aussi les employés des secteurs financier et immobilier (23 %) et les ouvriers et employés de l’industrie (11 %).
S’il existe aujourd’hui 88 accords de branche qui traitent du compte épargne-temps, ils renvoient quasi systématiquement à des accords d’entreprise pour la mise en place d’un tel compte. Seuls cinq d’etre eux correspondent à des accords portant mise en place d’un compte épargne-temps, qui permet un accès direct des salariés de la branche à ce compte.
Chaque année, environ un millier d’accords d’entreprise et d’avenants traitent de cette thématique, la plupart correspondant à des avenants à des accords existants.
Les dispositions relatives au compte épargne-temps sont prévues par le titre V du livre Ier du code du travail, ce livre traitant de la durée du travail, des repos et des congés. Il fait l’objet des articles L. 3151-1 à L. 3154-3 et est organisé en quatre chapitres :
– le premier, qui fixe l’objet du compte épargne-temps ;
– le deuxième, qui traite de sa mise en place ;
– le troisième, relatif à son utilisation ;
– et le dernier, qui règle les questions de la garantie du compte épargne-temps et de la liquidation des droits qui y sont relatifs.
Le compte épargne-temps permet au salarié d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de se constituer une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises ou des sommes qu’il y a affectées. Il est mis en place par voie d’accord collectif, la loi du 20 août 2008 ayant sur ce sujet donné la primauté à l’accord d’entreprise ou d’établissement sur l’accord de branche, quelle que soit la date de conclusion de ce dernier (article L. 3152-1).
L’accord collectif en question :
– prévoit les conditions et les limites dans lesquelles le compte peut être alimenté en temps ou en argent à l’initiative du salarié ou, pour les heures accomplies au-delà de la durée collective, à l’initiative de l’employeur. Le congé payé annuel ne peut être affecté au compte épargne-temps que pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables (article L. 3152-2).
Ainsi, si l’accord le prévoit, le compte épargne-temps peut être alimenté par tout ou partie des primes d’intéressement, par tout ou partie des sommes issues de la répartition de la réserve de participation – à l’issue toutefois de leur période d’indisponibilité –, par les sommes versées par le salarié sur un plan d’épargne d’entreprise et par l’abondement de l’employeur sur un plan d’épargne salariale ;
– définit les modalités de gestion du compte, notamment de conversion monétaire et de revalorisation des droits ;
– et détermine les conditions d’utilisation, de liquidation et de transfert des droits d’un employeur à un autre.
Il est ainsi possible par voie conventionnelle d’autoriser les salariés à utiliser le compte épargne-temps pour se faire indemniser des périodes d’absence (de formation, de congé sans solde, de passage à temps partiel ou encore de cessation totale ou progressive d’activité) ou pour obtenir un complément de rémunération, autrement dit en monétisant ses droits, voire pour alimenter leur épargne retraite.
La possibilité de mobiliser son compte épargne-temps pour compléter sa rémunération ou cesser progressivement son activité peut être ouverte même si la convention ou l’accord collectif ne le prévoit pas, à l’initiative du salarié et en accord avec l’employeur (article L. 3153-1).
En revanche, la cinquième semaine de congés payés ne peut jamais être monétisée (article L. 3153-2).
Aux termes de l’article L. 3154-1, les droits acquis dans le cadre d’un compte épargne-temps sont garantis par l’association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS), au titre du régime de garantie des salaires, à hauteur du plus élevé des plafonds de garantie de cette assurance. En revanche, en vertu de l’article L. 3154-2, un dispositif d’assurance ou de garantie pour la fraction dépassant ce plafond doit être prévu par l’accord collectif.
Le même article fixe le cadre applicable en l’absence de dispositif de garantie. À défaut, un dispositif de garantie financière est mis en place par l’employeur. À défaut soit de dispositif conventionnel, soit de système mis en place par l’employeur, les droits inscrits au compte épargne-temps qui dépassent le plafond de garantie sont liquidés : c’est ce que prévoient les articles D. 3154-1 et D. 3154-2 issus du décret n° 2009-1184 du 5 octobre 2009.
Enfin, la convention ou l’accord collectif détermine les conditions de liquidation et de transfert des droits d’un employeur à un autre (article L. 3154-3). À défaut de stipulations conventionnelles relatives à un tel transfert, le salarié peut :
– soit percevoir, en cas de rupture du contrat de travail, une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits acquis ;
– soit demander, en accord avec l’employeur, la consignation de ses droits acquis auprès de la Caisse des dépôts et consignations (CDC), qui sont alors convertis aussi en unités monétaires.
Dans ce dernier cas, le déblocage des droits consignés peut se faire :
– soit à la demande du salarié bénéficiaire, par le transfert de ces sommes sur le compte épargne-temps, le plan d’épargne d’entreprise, interentreprises ou le plan d’épargne pour la retraite collectif (PERCO) du nouvel employeur ;
– soit, toujours à la demande du salarié ou de ses ayants droit, par le paiement, à tout moment, de tout ou partie des sommes consignées.
S’agissant du régime fiscal et social applicable aux sommes versées lors de la monétisation des droits ou aux indemnités versées lors de la prise du congé (article L. 3153-3) :
– l’ensemble des sommes et indemnités sont soumises aux cotisations sociales et aux taxes et prélèvements assimilés (autres que la taxe sur les salaires), y compris lorsqu’elles proviennent de la participation, de l’intéressement ou du plan d’épargne d’entreprise (PEE) ;
– ces sommes sont soumises à la taxe sur les salaires, à la contribution sociale généralisée (CSG) et à la contribution au remboursement de la dette locale (CRDS), sauf lorsqu’elles proviennent de la participation ou de l’intéressement, ou d’un abondement de l’employeur à un PEE ;
– les sommes issues du compte épargne-temps sont soumises à l’impôt sur le revenu – en contrepartie, les rémunérations affectées au compte ne sont pas imposées lors de leur affectation –, à l’exception de celles provenant de la participation ou des plans d’épargne salariale et des primes d’intéressement, ces dernières étant imposées l’année de leur versement.
Par exception, l’article L. 3153-3 du code du travail prévoit que les droits affectés à l’initiative du salarié pour alimenter un PERCO ou financer des prestations de retraite à caractère collectif et obligatoire sont assimilés, s’ils proviennent d’un abondement en temps ou en argent de l’employeur, à un abondement de l’employeur au PERCO ou à des contributions patronales aux régimes supplémentaires de retraite (au sens de l’article L. 911-1 du code de la sécurité sociale) : ils sont donc exclus de l’assiette des cotisations sociales et déduits du revenu imposable au titre de l’impôt sur le revenu (2° et 2° bis de l’article 83 du code général des impôts) dans les mêmes conditions que ces avantages.
Le même article L. 3153-3 précise que les droits ne provenant pas d’un abondement de l’employeur sont, dans la limite de dix jours par an, exonérés de cotisations sociales (en vertu de l’article L. 242-4-3 du code de la sécurité sociale), mais ils sont assujettis aux prélèvements sociaux, aux cotisations de retraite complémentaire et d’assurance chômage, ainsi qu’aux taxes et participations sur les salaires. Ils sont déductibles du revenu imposable au titre de l’impôt sur le revenu en cas d’affectation à un PERCO ou affranchis de l’impôt en tant qu’ils sont assimilés à des cotisations déductibles sous certaines conditions et limites (b du 18° de l’article 81 du code général des impôts).
Le I de l’article réorganise les dispositions du titre V du livre Ier du code du travail relatives au compte épargne-temps autour de la nouvelle architecture retenue par le projet de loi, à savoir le triptyque : ordre public ; champ de la négociation collective ; dispositions supplétives.
Le chapitre premier regroupe les règles d’ordre public suivantes :
– le principe selon lequel le compte épargne-temps est mis en place par accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par convention ou accord de branche. La primauté donnée à l’accord d’entreprise est donc bien réaffirmée (nouvelle rédaction de l’article L. 3151-1) ;
– la définition du compte épargne-temps comme outil permettant au salarié d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération immédiate ou différée, ainsi que la précision relative à la possibilité d’affecter au compte la seule fraction du congé annuel au-delà de vingt-quatre jours ouvrables (article L. 3151-2 nouveau) ;
– la possibilité pour le salarié, avec l’accord de l’employeur, d’utiliser les droits affectés sur le compte pour compléter sa rémunération ou cesser progressivement son activité, ainsi que l’autorisation d’utiliser les droits au titre des jours de congé pour compléter sa rémunération uniquement pour la fraction au-delà de trente jours (article L. 3151-3 nouveau) ;
– et enfin, le principe de la garantie par l’AGS des droits acquis dans le cadre du compte épargne-temps (article L. 3151-4 nouveau).
Le chapitre 2 encadre la négociation collective, en reprenant les règles qui s’imposent à la convention ou l’accord collectif qui aménage le compte épargne-temps. Celui-ci doit en effet :
– déterminer les règles d’alimentation du compte, en temps ou en argent, par le salarié, ou, pour les heures au-delà de la durée collective, par l’employeur (nouvelle rédaction de l’article L. 3152-1) ;
– définir les modalités de gestion du compte, ses conditions d’utilisation, de liquidation et de transfert des droits d’un employeur à un autre (nouvelle rédaction de l’article L. 3152-2) ;
– établir un dispositif d’assurance ou de garantie pour les droits excédant le plafond d’assurance de l’AGS (nouvelle rédaction de l’article L. 3152-3) ;
Enfin, la convention ou l’accord a la possibilité de prévoir que tout ou partie des droits affectés au compte épargne-temps sont utilisés pour contribuer au financement de prestations de retraite supplémentaire ou pour réaliser des versements sur un ou plusieurs plans d’épargne retraite collectifs, en reprenant le régime fiscal et social associé à ces sommes (article L. 3152-4 nouveau).
Le troisième chapitre comporte les dispositions supplétives, qui ont vocation à s’appliquer lorsque l’accord ou la convention mettant en place le compte épargne-temps ne prévoit pas de dispositions spécifiques à ce sujet.
Ainsi, à défaut de mise en place par accord d’un dispositif de garantie pour les droits excédant le plafond garanti par l’AGS, le mécanisme actuel a vocation à s’appliquer : ce dispositif de garantie doit être mis en place par l’employeur ; à défaut, des dispositions réglementaires prévoient la liquidation des droits excédant ce plafond (nouvelle rédaction de l’article L. 3153-1).
Enfin, en l’absence de stipulations conventionnelles, le mécanisme existant de portabilité des droits continuera de s’appliquer, avec la possibilité pour le salarié de demander à percevoir au moment de la rupture de son contrat de travail une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble de ses droits acquis, ou la consignation auprès de la Caisse des dépôts de ses droits convertis en unités monétaires, cette dernière possibilité requérant toutefois l’accord de l’employeur (nouvelle rédaction de l’article L. 3153-2).
Le II de l’article se borne à effectuer les coordinations rédactionnelles rendues nécessaires par la réécriture du titre V du livre Ier du code du travail.
*
Le présent article reprend donc sans modification de fond l’ensemble des dispositions qui s’appliquent actuellement au compte épargne-temps : seule se trouve modifiée l’architecture du titre V.
*
La Commission examine l’amendement AS414 de Mme Jacqueline Fraysse.
Mme Jacqueline Fraysse. L’article 4 récrit toute la partie du code du travail relative au compte épargne-temps. Comme pour les articles précédents, nous refusons la primauté donnée à l’accord collectif d’entreprise, qui est la porte ouverte à la remise en cause de la protection des salariés garantie par la loi, car c’est seulement l’absence d’accord d’entreprise que les règles légales supplétives s’appliqueront. C’est la raison pour laquelle nous demandons sa suppression.
Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette cet amendement.
La Commission adopte ensuite, successivement, les amendements rédactionnels AS650, AS660, AS662, AS671, et AS688 du rapporteur.
Elle examine ensuite l’amendement AS761 du rapporteur.
M. le rapporteur. Il s’agit d’un amendement rédactionnel visant à restructurer l’alinéa 20, sans modification de fond.
La Commission adopte cet amendement.
Elle adopte ensuite successivement l’amendement de précision AS764 et l’amendement rédactionnel AS768 du rapporteur.
Ensuite de quoi, elle adopte l’article 4 modifié.
*
* *
Article 5
Sécurisation des conventions de forfait existantes
Cet article a pour objectif principal de sécuriser les conventions individuelles de forfaits annuels en heures ou en jours existantes, en tirant les conséquences des modifications apportées à celles-ci dans le cadre de l’article 2 du projet de loi.
Rappelons qu’outre une réorganisation des dispositions relatives aux conventions de forfait pour les soumettre à la nouvelle architecture retenue en application du rapport dit « Combrexelle », l’article 2 procède à une série de modifications de fond des conditions applicables aux forfaits en jours, pour les mettre en conformité avec les exigences posées par la jurisprudence.
Cet article vise à sécuriser les conventions de forfait déjà conclues sur le fondement d’un accord collectif qui ne respecterait pas les exigences dégagées par la jurisprudence, et demain, par la loi.
1. Des forfaits jours qui doivent garantir la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs
Le dispositif des conventions de forfait annuel en jours – qui concerne aujourd’hui 1,41 million de salariés, soit un peu plus de 13 % des salariés des entreprises de plus de 10 salariés – a été jugé non conforme à des exigences minimales de santé et de sécurité des travailleurs, au regard du droit européen puis, en conséquence, du droit interne.
La Charte sociale européenne du 18 octobre 1961 pose le principe d’un droit à des conditions de travail équitables, et en particulier à une durée du travail raisonnable (article 2.1) et à une rémunération équitable (article 4.2). Dans une décision rendue le 14 janvier 2011, le comité européen des droits sociaux (CEDS) du Conseil de l’Europe a considéré que les dispositions sur le forfait en jours ne respectaient aucun de ces deux articles. En effet :
– la loi n’impose pas que les conventions collectives prévoient une durée maximale, journalière et hebdomadaire, pas plus qu’elle n’impose à celles-ci de fixer des modalités de suivi de la durée quotidienne et de la charge de travail. En conséquence, le Comité a considéré que « la situation des salariés avec forfaits en jours sur l’année constitue une violation de l’article 2§1 de la Charte révisée en raison de la durée excessive du travail hebdomadaire autorisée ainsi que de l’absence de garanties suffisantes » ;
– les heures de travail effectuées par les salariés au forfait jours – qui ne bénéficient au titre de la flexibilité du temps de travail, d’aucune majoration de rémunération – sont anormalement élevées. Cette situation a été jugée contraire à l’article 4§2 de la Charte.
En outre, la directive communautaire 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail prévoit qu’il est possible de déroger aux règles relatives aux repos journalier et hebdomadaire, au temps de pause, à la durée maximale hebdomadaire du travail et du travail de nuit, pour les cadres dirigeants ou autres personnes ayant un pouvoir de décision autonome, sous réserve de respecter les principes généraux de protection de la santé des travailleurs.
Dans un arrêt de principe du 29 juin 2011, la chambre sociale de la Cour de cassation a, sur le fondement des textes européens, estimé que « toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires ».
L’absence de telles garanties prive d’effet la convention individuelle de forfait et ouvre droit pour le salarié au paiement d’heures supplémentaires dont le juge doit vérifier l’existence et le nombre.
Elle a ensuite jugé que « l’amplitude et la charge de travail [doivent être] raisonnables et [assurer] une bonne répartition, dans le temps du travail de l’intéressé [afin d’] assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié » (Cass., soc., 24 avril 2013).
Cette décision de principe a entraîné l’invalidation, par le juge d’une proportion importante des accords de branche qui avaient été conclus sur la mise en place de forfaits en jours. C’est le cas, entre autres :
– de l’accord-cadre du 8 février 1999 sur l’organisation et la durée du travail dans l’industrie chimique (Cass., soc., 31 janvier 2012) ;
– de l’accord d’aménagement et de réduction du temps de travail du 14 décembre 2001 pris en application de la convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970 (Cass., soc., 26 septembre 2012) ;
– pour les bureaux d’études techniques, les cabinets d’ingénieurs-conseils et sociétés de conseils, de l’accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail pris en application de la convention SYNTEC (Cass. soc., 23 mai 2013) ;
– de la convention collective nationale des experts-comptables et des commissaires aux comptes (Cass. soc., 14 mai 2014) ;
– de l’accord national du 6 novembre 1998 relatif à la durée du travail dans les entreprises du bâtiment et des travaux publics (Cass. soc., 11 juin 2014) ;
– de la convention collective des notaires (Cass. soc., 13 novembre 2014).
Au total, seules deux conventions collectives de branche ont été expressément validées par le juge depuis l’arrêt de principe sur le sujet : la convention de la métallurgie dans l’arrêt inaugural du 29 juin 2011, et celle des banques (Cass. soc., 17 décembre 2014) : ces deux conventions comportent un dispositif de contrôle de la charge de travail du salarié, assorti d’un suivi régulier par la hiérarchie, qui ne se limite pas à un entretien annuel.
Dans ce dernier arrêt, la chambre sociale de la Cour de cassation évoque la nécessité pour l’employeur de garantir aux salariés au forfait en jours le respect d’une « durée maximale raisonnable de travail », renonçant, semble-t-il, à la mention de la durée maximale du travail utilisée précédemment, qui avait pu laisser penser que la validité des conventions individuelle de forfait en jours était soumise à la fixation d’une durée maximale quotidienne et hebdomadaire de travail.
L’invalidation de très nombreux accords collectifs aménageant les conditions de forfaits-jours conduit à l’annulation de l’ensemble des conventions individuelles conclues sur leur fondement.
Contrairement à la jurisprudence antérieure sur le sujet (Cass., soc., 10 janvier 2010) qui prévoyait que les salariés en forfaits jours qui se retrouvaient lésés avaient uniquement droit à des dommages et intérêts, la jurisprudence de la chambre sociale depuis 2011 prévoit désormais que le salarié lésé est présumé ne pas être soumis au forfait-jours et peut donc réclamer le paiement des heures supplémentaires qu’il a effectuées au-delà de 35 heures, et cela sur les cinq dernières années.
Cette jurisprudence sévère a conduit de nombreuses branches professionnelles à entamer une procédure de révision de leur accord afin de sécuriser les conventions de forfait d’ores et déjà conclues, afin de se mettre en conformité avec les exigences de protection de la sécurité et de la santé des salariés, par la mise en place d’un dispositif de suivi et de contrôle régulier de la charge de travail des salariés.
L’article 2 du projet de loi propose d’intégrer au dispositif légal des conventions de forfait les obligations permettant de garantir un niveau de protection suffisant pour les salariés. Ainsi, sans entrer dans le détail de ces mesures qui font l’objet de plus amples analyses dans le cadre du commentaire de l’article 2 du projet de loi, on rappellera que le texte propose :
– de fixer dans l’ordre public le principe selon lequel l’employeur s’assure que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail, tout en prévoyant que dès lors que l’employeur a fixé des échéances et une charge de travail compatibles avec le respect des repos quotidien et hebdomadaire et des congés du salarié, sa responsabilité ne peut être engagée au seul motif que le salarié n’a, de sa propre initiative, pas bénéficié de ces repos ou congés ;
– de prévoir que l’accord collectif autorisant le recours aux forfaits-jours détermine les modalités selon lesquelles l’employeur assure l’évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié, ainsi que les modalités selon lesquelles l’employeur et le salarié échangent périodiquement sur la charge de travail de ce dernier, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sa rémunération, ainsi que sur l’organisation du travail dans l’entreprise ;
– qu’à défaut d’accord, trois conditions doivent être respectées par une convention individuelle de forfait en jours pour être valable : en premier lieu, un document de contrôle du nombre de jours travaillés doit être établi par l’employeur ou sous sa responsabilité ; deuxièmement, l’employeur s’assure que la charge de travail du salarié est compatible avec le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires ; enfin, l’employeur doit organiser un entretien annuel avec le salarié pour évoquer sa charge de travail qui doit être raisonnable, l’organisation de son travail, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, ainsi que sa rémunération.
Ces dispositions doivent permettre de sécuriser les conditions dans lesquelles doivent être révisés les accords de branche ou d’entreprise qui ne seraient aujourd’hui pas conformes à ces exigences.
La question se pose néanmoins de savoir quelle conséquence entraînerait la révision d’un accord sur les conventions individuelles de forfait d’ores et déjà conclues.
● Pour pallier le risque d’insécurité juridique auquel sont exposées les conventions individuelles de forfait d’ores et déjà conclues sur le fondement d’accords collectifs qui ont vocation à être révisés, le présent article pose deux principes.
En premier lieu, le I de l’article prévoit que lorsqu’une convention ou un accord de branche ou un accord d’entreprise ou d’établissement conclu antérieurement à la publication de la présente loi et autorisant la conclusion de forfaits annuels en heures ou en jours est révisé pour être mis en conformité avec les nouvelles conditions prévues à l’article L. 3121-62, – à savoir l’ensemble des conditions requises d’un accord collectif autorisant le recours à de telles conventions de forfait, y compris celles relatives au suivi de la charge de travail du salarié –, l’exécution de la convention individuelle de forfait annuel en heures ou en jours se poursuit sans qu’il y ait lieu de requérir l’accord du salarié.
Il s’agit de sécuriser l’ensemble des accords collectifs qui fondent les conventions individuelles de forfait, en jours comme en heures : en effet, l’article 2 du projet de loi ne renforce pas seulement le contenu des accords instituant des forfaits jours, mais aussi les clauses obligatoires communes aux deux types de forfaits annuels, qu’ils soient en jours ou en heures : ainsi, il sera désormais obligatoire de préciser la période de référence du forfait et de prévoir l’incidence sur la rémunération des arrivées, départs et absences en cours de période. Il s’agit ainsi d’inciter les entreprises « vertueuses » à tirer les conséquences, dans leurs accords collectifs, non seulement des nouvelles dispositions relatives au suivi de la charge de travail des salariés au forfait jours, mais aussi de l’ensemble des nouvelles obligations prévues.
En revanche, les modifications de l’accord qui ne constitueraient pas une mise en conformité par rapport aux nouvelles dispositions législatives mais un changement de paramètres de l’accord, continueront à nécessiter l’obtention de l’accord exprès du salarié pour pouvoir s’appliquer : par exemple, un accord qui prévoirait de relever le plafond de jours travaillés requerrait l’accord exprès du salarié et donc la renégociation de sa convention individuelle de forfait.
En second lieu, le II du présent article propose de sécuriser les accords collectifs qui, à la date de publication de la loi ne respecteraient pas les conditions spécifiques requises à l’avenir de tels accords – suivi régulier de la charge de travail du salarié et échange période sur sa charge de travail, etc. – en prévoyant que les conventions individuelles conclues sur leur fondement restent exécutoires sous réserve que l’employeur respecte les dispositions supplétives déjà évoquées (document de contrôle du nombre de jours travaillés, contrôle de la charge de travail du salarié, entretien annuel avec le salarié).
Il s’agit par ce biais de tenir compte en particulier des plus petites entreprises, dans lesquelles la convention individuelle de forfait s’appuie non pas sur un accord d’entreprise, mais sur un accord de branche. Compte tenu de leur difficulté à négocier des accords, il est indispensable, pour ces petites entreprises, de sécuriser l’accord de branche sur lequel elles s’appuient : en effet, un employeur serait bien impuissant en cas de blocage des négociations de branche pour réviser l’accord encadrant le recours au forfait. Il convient de souligner que ce dispositif de « béquille » n’a pas vocation à sécuriser l’accord collectif quelles que soient ses lacunes, mais uniquement à compenser ses éventuelles insuffisances en termes de suivi de la charge de travail. Ainsi, un accord qui omettrait d’autres clauses obligatoires comme par exemple le plafond de jours ou encore les catégories de salariés visés, serait nul.
● Le III de l’article propose également que les dispositions relatives à l’obligation de mise en place d’un programme indicatif, applicables par le passé aux accords collectifs conclus au titre de la modulation du temps de travail, cessent de l’être.
En effet, entre 1987 et 2008, les législations successives sur la modulation du temps de travail ont prévu, parmi les clauses obligatoires de l’accord collectif instituant ce dispositif, la précision du programme indicatif de mise en œuvre de la modulation.
Ainsi, l’article L. 212-8-4 du code du travail dans sa version applicable entre le 20 juin 1987 et le 19 janvier 2000 prévoyait qu’une convention ou un accord collectif étendu ou un accord d’entreprise ou d’établissement relatif à la modulation du temps de travail devait préciser les données économiques et sociales justifiant le recours à cette modulation et devait comporter une série de dispositions obligatoires, au titre desquelles figurait l’instauration d’un programme indicatif concernant la mise en œuvre de la modulation.
Un tel programme indicatif consiste pour l’employeur à présenter sur les douze mois à venir le volume de production et la charge de travail qui lui correspond.
Dans un arrêt du 2 juillet 2014, la Cour de cassation a jugé que l’absence d’un tel programme indicatif de la modulation horaire dans une entreprise soumise à un accord d’entreprise relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail qui le prévoyait, conduisait à priver d’effet l’accord en question et que le salarié requérant pouvait donc sur ce fondement prétendre au paiement d’heures supplémentaires décomptées sur la base de 35 heures hebdomadaires.
L’article L. 212-2-1 du code du travail dans sa version applicable entre le 21 décembre 1993 et le 19 janvier 2000 comporte les mêmes obligations de mise en place d’un programme indicatif de la modulation des horaires dans le cadre d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail, assorti notamment d’une réduction de la durée collective du travail.
Ce programme indicatif est également prévu par l’article L. 212-8 dans sa version applicable entre le 20 janvier 2000 et le 30 avril 2008, par l’article L. 3122-11 dans sa version applicable entre le 1er mai 2008 et le 20 août 2008, et enfin, par l’article L. 713-16 du code rural et de la pêche maritime dans sa version applicable entre le 22 juin 2000 et le 20 août 2008.
Cette clause, très exigeante, est strictement interprétée par la Cour de cassation qui constate régulièrement qu’elle est absente ou incomplète dans les accords collectifs conclus pendant cette période (notamment deux arrêts du 12 mars 2008 et du 27 mars 2013). Ces accords sont alors jugés nuls, ce qui implique, pour l’employeur, l’impossibilité de moduler le temps de travail des salariés tant qu’un nouvel accord collectif n’est pas conclu, et donc l’obligation de décompter le temps de travail dans le cadre hebdomadaire de droit commun. Ce retour au droit commun peut s’avérer extrêmement coûteux, notamment dans les petites entreprises dont l’activité est saisonnière et qui, compte tenu de leur taille et de leur difficulté à négocier un accord à leur niveau, pratiquent la modulation sur la base d’un accord de branche (c’est notamment le cas dans la branche des hôtels cafés restaurants ou de la « branche agricole »).
Depuis la loi du 20 août 2008, les accords de modulation n’ont plus à prévoir de programme indicatif. Mais cette clause reste « exigible » dans les accords conclus avant 2008, car la légalité de ces derniers est examinée à l’aune du droit applicable lors de leur conclusion et non au regard du nouveau droit applicable (via le mécanisme dit de « sécurisation »). Seule une renégociation de ces anciens accords permet l’application du nouveau cadre légal (article L. 3122-2).
Le III du présent article propose donc de prévoir que l’absence de clause relative au programme indicatif de la modulation du temps de travail n’est plus une cause d’annulation des accords conclus sous l’empire de cette obligation.
*
La Commission examine l’amendement AS520 de M. Christophe Cavard.
M. Christophe Cavard. En proposant d’ajouter, à l’alinéa 2, après les mots « présente loi », les mots « et après avoir échoué à trouver un accord mentionné à l’article L. 3121-61 du code du travail », cet amendement vise à encourager une nouvelle négociation pour obtenir un accord sur le forfait en jours, en cas d’échec, en particulier pour prolonger l’existant.
M. le rapporteur. Défavorable. Le dispositif que propose M. Cavard est relativement compliqué. Cela revient à exiger une nouvelle négociation pour que celle-ci échoue afin de permettre la poursuite des conventions actuelles…
La Commission rejette cet amendement.
Elle adopte ensuite successivement les amendements AS770 et AS771 du rapporteur, corrigeant chacun une erreur matérielle.
Ensuite de quoi, elle adopte l’article 5 modifié.
*
* *
Article 6
(Art. L. 1321-7 et L. 4511-2 du code des transports)
Travail de nuit dans le domaine fluvial
Le présent article procède à la transposition de la directive 2014/112/UE du Conseil du 19 décembre 2014 portant application de l’accord européen concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail dans le secteur de la navigation intérieure (3).
1. Les règles spécifiques relatives au travail de nuit dans le secteur fluvial ont été modifiées par la directive du 19 décembre 2014
Le livre III de la première partie « Dispositions communes » du code des transports, relatif à la réglementation sociale du transport pose dans son article L. 1311-1 le principe de l’application du code du travail aux employeurs et salariés relevant du code des transports. Toutefois, il assortit ce principe d’une réserve tenant aux « dispositions particulières ou d’adaptation » prévues par le code des transports, sauf mention contraire dans celui-ci ou dans le code du travail.
C’est à l’aune de cet article qu’il convient d’analyser les règles spécifiques au travail de nuit dans le secteur fluvial.
● Le livre III du code des transports édicte les règles spécifiques au secteur des transports en matière de droit social. Le chapitre premier de son titre II porte sur l’ensemble des dispositions relatives à la durée du travail, au travail de nuit et au repos des salariés des entreprises de transport. Au sein de ce chapitre, la section 5 est relative au travail de nuit du personnel roulant et navigant.
L’article L. 1321-7 du code des transports définit une période de nuit spécifique au personnel roulant et navigant : il s’agit de la période comprise entre 22 heures et 5 heures.
Toutefois, une autre période de sept heures consécutives comprise entre 21 heures et 7 heures et incluant obligatoirement l’intervalle entre 24 heures et 5 heures, peut être substituée à la période applicable par défaut (22 heures – 5 heures) par une convention ou un accord collectif de branche étendu ou une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement.
À défaut d’accord et lorsque les caractéristiques particulières de l’entreprise le justifient, cette substitution peut être autorisée par l’inspecteur du travail, après consultation des délégués syndicaux et avis du comité d’entreprise ou des délégués du personnel, s’ils existent.
À l’instar de ce que prévoit le code du travail, le même article prévoit la possibilité de déroger à la période de nuit définie par la loi, par accord collectif ou, en l’absence d’accord, sur autorisation de l’inspecteur du travail.
En revanche, l’article L. 1321-6 du code des transports exclut expressément l’application aux salariés du secteur de la navigation intérieure des dispositions des articles L. 3122-34 et L. 3122-35 du code du travail relatives aux durées du travail applicables aux travailleurs de nuit.
Rappelons qu’aux termes de l’article L. 3122-34 du code du travail dans sa rédaction actuelle, la durée quotidienne du travail accompli par un travailleur de nuit ne peut excéder huit heures, avec trois possibilités de déroger à cette durée :
– par voie de convention ou d’accord collectif de branche étendu ou par convention ou accord d’entreprise ou d’établissement, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État ;
– en présence d’une organisation du travail par équipes de suppléance ;
– ou en cas de circonstances exceptionnelles, sur autorisation de l’inspecteur du travail donnée après consultation des délégués syndicaux et après avis du comité d’entreprise ou des délégués du personnel s’ils existent, selon des modalités prévues par décret.
L’article L. 1321-8 du code des transports détermine en conséquence la durée quotidienne maximale de travail effectuée des travailleurs de nuit du secteur, soit huit heures en moyenne par période de vingt-quatre heures sur une période de référence définie par convention ou accord collectif étendu ou, à défaut, par décret en Conseil d’État, après consultation des organisations syndicales et patronales des secteurs d’activité concernés. L’article R. 1321-1 prévoit qu’en l’absence d’accord collectif, cette période de référence est de deux semaines.
Il peut être dérogé à la durée quotidienne de huit heures par période de vingt-quatre heures ainsi fixée sur une période de référence par convention ou accord collectif étendu ou par convention ou accord d’entreprise ou d’établissement, sous réserve que ces conventions ou accords prévoient, en contrepartie, des périodes équivalentes de repos compensateur de remplacement.
● La quatrième partie du code des transports a trait à la navigation intérieure et au transport fluvial : au sein de cette partie, le titre Ier du livre V porte sur les régimes de travail des personnels des entreprises de navigation intérieure.
– Les dispositions de l’article L. 1321-7 relatives à la définition de la période de nuit s’appliquent.
– L’article L. 4511-1 du code des transports dispose que, pour le personnel navigant travaillant sur des bateaux exploités en relèves, une convention ou un accord collectif de branche étendu peut déroger aux durées quotidienne et hebdomadaire maximales de travail prévues – en sus de la dérogation générale aux articles L. 3121-34 et L. 3121-35 du code du travail prévue par l’article L. 1321-6 du code des transports – aux articles L. 3121-34 à L. 3121-36 du code du travail, dans le cadre d’un accord d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année.
Rappelons que les durées maximales de travail de droit commun sont de dix heures pour la durée quotidienne, de 48 heures pour la durée hebdomadaire, et de 44 heures pour la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période de 12 semaines.
– S’agissant du travail de nuit, l’article L. 4511-2 du même code prévoit que, pour le personnel navigant des entreprises de transport fluvial, une convention ou un accord de branche peut déroger à la durée quotidienne du travail des travailleurs de nuit fixée à l’article L. 1321-8.
Pour le personnel navigant des entreprises de transport fluvial, il est donc possible de déroger à cette durée quotidienne de travail sous réserve de prévoir, pour les travailleurs de nuit, une durée quotidienne du travail qui n’excède pas douze heures par période de vingt-quatre heures et que ceux-ci bénéficient, outre les jours de repos et de congés légaux, de jours de repos supplémentaires en nombre suffisant.
b. les modifications apportées par la directive 2014/112/UE sur l’aménagement du temps de travail dans le secteur de la navigation intérieure
La directive 2014/112/UE est issue d’un accord signé le 15 février 2012 par les organisations représentatives au niveau européen du secteur de la navigation intérieure, qui ont demandé, conformément à l’article 155, paragraphe 2 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, que cet accord soit mis en œuvre par une réglementation communautaire appropriée, en l’occurrence une directive, qui a été définitivement adoptée par le Conseil le 19 décembre 2014, et qui reprend en annexe le texte même de l’accord.
Sans revenir sur le détail de cette directive qui comporte des règles particulières d’aménagement du temps de travail dans le secteur de la navigation intérieure, indiquons qu’elle couvre, dans sa clause 1, « l’ensemble des travailleurs mobiles en tant que membres du personnel navigant (équipage) ou dans une autre fonction (personnel de bord) à bord d’un bâtiment exploité sur le territoire d’un État membre dans le secteur de la navigation intérieure commerciale ».
L’accord européen figurant en annexe de la directive définit en particulier :
– le temps de travail journalier et hebdomadaire, dans sa clause 4, en prévoyant que le nombre d’heures de travail ne doit pas dépasser 14 heures par période de 24 heures et 84 heures par période de 7 jours. Toutefois, lorsque le tableau de service prévoit plus de jours de travail que de jours de repos, une moyenne de 72 heures de travail par semaine ne peut être dépassée sur une période de quatre mois ;
– la période nocturne comme la période comprise entre 23 heures et 6 heures ;
– et sa clause 9 fixe le temps de travail maximal pendant la période nocturne, en prévoyant qu’au vu de la période de nuit de 7 heures, le nombre maximal hebdomadaire d’heures de travail pendant la période nocturne – sur une période de 7 jours – s’élève à 42 heures.
2. La transposition de la directive sur l’aménagement du temps de travail dans le domaine fluvial en droit interne
Le présent article procède à la transposition de la directive 2014/112/UE du 19 décembre 2014, en introduisant les modifications législatives afférentes dans le code des transports.
Le 1° modifie l’article L. 1321-7 du code des transports, en posant le principe selon lequel la période de travail de nuit correspond à l’intervalle entre 23 heures et 6 heures pour le personnel navigant. Notons que l’intervalle entre 22 heures et 5 heures, qui correspond au droit actuel, est maintenu pour les autres personnels concernés, autrement dit pour le personnel roulant.
En conséquence de cette modification, le 2° précise que les possibilités dérogatoires s’appliquent bien à la période 22 heures – 5 heures, et non à la nouvelle période de nuit qui concernera les personnels navigants. Autrement dit, il demeurera possible seulement pour les personnels roulants de déroger par accord à la période de travail de nuit comprise entre 22 heures et 5 heures, en fixant toute autre période de sept heures consécutives entre 21 heures et 7 heures, pourvu qu’elle comprenne bien l’intervalle entre minuit et cinq heures ; de même, une telle substitution peut être autorisée par l’inspecteur du travail après consultation des délégués syndicaux et avis du comité d’entreprise ou des délégués du personnel, s’ils existent, à défaut d’accord et lorsque les caractéristiques particulières de l’entreprise le justifient.
S’agissant des personnels navigants, il ne sera plus possible de déroger par accord ou sur autorisation de l’inspecteur du travail à la période nocturne 23 heures – 6 heures. Pour l’heure, aucune dérogation à la période de travail de nuit n’a été identifiée dans les conventions collectives applicables au secteur.
Le 3° complète l’article L. 4511-1 du code des transports pour préciser que la convention ou l’accord collectif de branche étendu autorisé à déroger aux durées quotidienne et hebdomadaire maximales de travail pour les personnels navigants travaillant sur des bateaux exploités en relèves, doit respecter les durées maximales suivantes :
– 14 heures de durée quotidienne du travail ;
– 84 heures de durée hebdomadaire de travail ;
– et 72 heures de durée hebdomadaire calculée sur une période quelconque de 16 semaines consécutives.
Le 4° complète l’article L. 4511-2 du code des transports relatif à la durée quotidienne maximale du travail pour les personnels navigants travailleurs de nuit, en prévoyant qu’outre la durée maximale de douze heures par période de vingt-quatre heures, la durée maximale hebdomadaire de travail pendant la période nocturne ne peut excéder 42 heures sur une période de sept jours.
La Commission adopte l’article 6.
*
* *
TITRE II
FAVORISER UNE CULTURE DU DIALOGUE ET DE LA NÉGOCIATION
Chapitre Ier
Des règles de négociation plus souples
et le renforcement de la loyauté de la négociation
Article 7
(Art. L. 2222-3, L. 2222-3-1 à L. 2222-3-3 [nouveaux], L. 2222-4, L. 2222-5-1 [nouveau], L. 2231-5-1 [nouveau] et L. 2232-20 du code du travail)
Préambule des accords, méthode et publicité
Dans son rapport remis au Premier ministre en septembre 2015 (4), M. Jean-Denis Combrexelle estimait que « la formalisation des conditions du dialogue social en entreprise est une des conditions essentielles » de la réussite de la négociation collective. Or en l’état du droit, peu d’exigences formelles pèsent sur les accords collectifs, qu’il s’agisse de la méthode de négociation, de leur durée ou de leurs modalités de présentation.
Partant de ce constat, cet article poursuit trois objectifs : promouvoir la mise en place de bonnes pratiques de négociation grâce au recours aux accords de méthode, encourager la révision des accords via les clauses de rendez-vous et la limitation de leur durée dans le temps, et enfin renforcer la lisibilité et la publicité des accords pour assurer une plus grande transparence des normes conventionnelles.
Ranimer la dynamique de la négociation collective suppose que le cadre dans lequel se déroule la négociation permette à l’ensemble des parties prenantes de connaître à la fois les enjeux de la négociation qui s’engage, son objet et son calendrier.
L’article L. 2232-20 du code du travail permet d’ores et déjà à l’employeur et aux organisations syndicales représentatives de fixer, par accord d’entreprise, « l’objet et la périodicité des négociations » ainsi que les informations nécessaires à remettre aux délégués syndicaux. Mais ce dispositif, qui ne s’applique qu’au niveau de l’entreprise, est très peu utilisé puisque selon l’étude d’impact, seuls 783 accords de méthode ont été conclus en 2014.
Pour soutenir la formalisation du dialogue social en donnant un rythme et un cadre à la négociation collective, et en limitant les pratiques qui nuisent à son efficacité, le c du 1° du I crée deux articles L. 2222-3-1 et L. 2222-3-2 qui encouragent l’élaboration d’accords de méthode.
● L’article L. 2222-3-1 nouveau invite dans un premier temps l’ensemble des niveaux de négociation − interprofessionnel, branche ou entreprise − à conclure de tels accords de méthode, dont l’objectif est de permettre à la négociation de s’accomplir « dans des conditions de loyauté et de confiance mutuelle entre les parties », un objectif qui s’inspire directement de la proposition n° 7 du rapport de M. Combrexelle.
À cette fin, l’accord doit préciser notamment la nature des informations partagées entre les négociateurs. Il peut s’agir soit d’informations relatives à la méthode de négociation – calendrier, information des salariés sur le contenu des négociations en cours –, soit d’informations relatives au contenu de la négociation. Dans ce dernier cas et lorsque la négociation a lieu dans l’entreprise, le deuxième alinéa de l’article L. 2222-3-1 précise que le partage d’informations peut s’appuyer sur la base de données économiques et sociales définie à l’article L. 2323-8 du code du travail.
● L’article L. 2222-3-2 nouveau encourage également la conclusion d’accords de méthode, mais cette fois-ci au niveau de la branche, pour une application au niveau de l’entreprise. Pour permettre à la branche de jouer véritablement son rôle de soutien aux entreprises, le projet de loi propose de conférer à ce type d’accord une portée contraignante, puisqu’à moins qu’il n’en dispose autrement, l’accord type de méthode élaboré par la branche s’imposerait aux entreprises n’ayant pas elles-mêmes conclu de convention ou d’accord de méthode dans les conditions prévues à l’article L. 2222-3-1.
Cette disposition s’inspire là encore directement d’une proposition du rapport de M. Combrexelle invitant les branches à élaborer des « accords de méthode type » afin de jouer pleinement leur rôle de « prestation de services » à l’égard des entreprises. La rédaction retenue par le projet de loi est plus large que celle imaginée par la proposition n° 38 du rapport de M. Combrexelle, qui proposait de réserver l’utilisation des accords type aux très petites entreprises (TPE) « qui, en droit, ne disposent pas d’instance de négociation ». Or, limiter ces accords aux seules entreprises de moins de onze salariés aurait sans doute privé de nombreuses petites et moyennes entreprises, souvent dépourvues de délégué syndical, d’un cadre propice à l’engagement et à la conduite d’une négociation dans les meilleures conditions.
● Quel que soit le niveau de négociation considéré, la conclusion d’un accord de méthode est une faculté et non une obligation. En conséquence, les articles L. 2222-3-1 et L. 2222-3-2 précisent que la méconnaissance de la méthode de négociation définie par la convention ou l’accord ne peut entraîner la nullité des accords conclus, sous réserve toutefois du respect du principe de loyauté entre les parties, et sauf si l’accord en stipule autrement.
Comme l’ont rappelé la plupart des personnes auditionnées par le rapporteur, l’architecture et le contenu de notre droit conventionnel sont devenus illisibles, pour les salariés eux-mêmes, bien sûr, mais aussi pour leurs représentants et pour les employeurs.
Dans son rapport, M. Jean-Denis Combrexelle déplorait en effet que certains accords ne soient compréhensibles « que par référence à une multitude d’accords antérieurs et au déroulement de la négociation, au point que seuls les négociateurs patronaux et syndicaux comprennent les enjeux et la portée de tel ou tel alinéa ajouté juste avant la signature… ». Eu égard à la place de plus en plus importante de la négociation collective dans notre droit du travail, renforcée de surcroît par ce projet de loi, cette complexité de la norme conventionnelle est évidemment très problématique.
Pour faciliter la compréhension du contenu des accords, cet article propose donc de préciser à la fois leur structure type et les clauses qui peuvent y figurer.
En premier lieu, le 2° du I crée une section 2 bis au sein du chapitre II du titre II du livre II de la deuxième partie du code du travail, intitulée : « Préambule des conventions et accords ».
Comme son nom l’indique, cette nouvelle section, composée d’un unique article L. 2222-3-3, prévoit que les accords et conventions collectives contiennent un préambule, qui présente « de manière succincte leurs objectifs et leur contenu ». L’objectif poursuivi ici est d’améliorer considérablement la lisibilité et la bonne compréhension des accords, qu’il s’agisse d’accords de branche ou d’entreprise.
En toute rigueur, il faut noter que certains accords contiennent déjà des préambules, puisque rien ne l’interdit en l’état du droit. Toutefois, leur contenu et leur portée sont, d’après l’étude d’impact, très disparates, certains préambules se contentant de décrire très sommairement le contenu de l’accord, d’autres décrivant plus en détail le texte afin d’en faciliter l’interprétation par le lecteur et, le cas échéant, par le juge.
La description succincte des objectifs et du contenu de l’accord demandée par l’article L. 2222-3-2 devrait permettre d’harmoniser les pratiques existantes, mais surtout d’encourager l’ensemble des négociateurs à y avoir recours. Le préambule permettrait ainsi a minima d’inviter l’ensemble des parties prenantes à la négociation à expliquer l’économie générale de l’accord voire, comme le préconisait M. Combrexelle, à préciser le sens et la portée de certaines stipulations essentielles de cet accord.
L’intérêt du préambule est évident pour l’ensemble des salariés ou des entreprises couverts par l’accord, qui bénéficieront dès lors d’une meilleure connaissance des normes conventionnelles qui leur sont applicables.
Toutefois, à l’instar des autres nouvelles modalités de présentation formelle des accords prévues au I, le projet de loi prévoit de ne pas sanctionner l’absence de préambule par la nullité des accords et conventions conclus − sauf mention contraire de l’accord − et ce afin d’éviter de faire peser une nouvelle obligation sur les organisations syndicales.
Le b du 1° du I propose ensuite de compléter l’article L. 2222-3 afin de permettre aux négociateurs de définir, au sein de l’accord ou de la convention, un calendrier des négociations à venir au niveau de la branche ou de l’entreprise.
La définition de cet agenda de négociations permet également de moduler, « pour tout ou partie des thèmes », la périodicité des négociations obligatoires prévues respectivement au chapitre Ier du titre IV du livre II de la deuxième partie du code du travail, pour les branches, et au chapitre II du titre IV du livre II de la deuxième partie du même code pour les entreprises.
Cette mesure permet ainsi de renforcer la prévisibilité des négociations obligatoires, en contrepartie d’une éventuelle diminution de la fréquence de ces négociations, dans certaines limites néanmoins : la périodicité des négociations annuelles pourrait être relevée jusqu’à trois ans, celle des négociations triennales jusqu’à cinq ans, et celle des négociations quinquennales jusqu’à sept ans.
Deux types de négociations font toutefois l’objet d’un traitement spécifique :
− la négociation sur les salaires, d’abord. Selon l’article L. 2242-9-1, cette négociation doit se tenir selon une fréquence annuelle dans l’entreprise. L’article L. 2222-3 modifié dispose que cette négociation peut être engagée pendant la durée de l’accord sur simple demande d’une organisation signataire, même si le calendrier des négociations prévoyait la tenue de cette négociation à un autre moment. Le thème de cette négociation est alors « sans délai mis à l’ordre du jour de la négociation » ;
− la modulation de la fréquence des négociations, ensuite, n’est pas valable en cas d’absence d’accord sur l’égalité professionnelle portant sur les objectifs et les mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes : à défaut d’accord, conformément aux dispositions de l’article L. 2242-8 du même code, l’employeur reste ainsi tenu d’établir « un plan d’action destiné à assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes », sans pouvoir reporter l’échéance annuelle.
Dans un souci de coordination, le premier alinéa de l’article L. 2222-3 relatif à la prise en compte des demandes relatives aux thèmes de négociation émanant d’une ou de plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives est modifié, afin de supprimer la référence aux thèmes de négociation obligatoires.
De même, le 2° du II précise que la définition de l’objet de la périodicité des négociations prévue à l’article L. 2232-20 du même code devra désormais respecter les conditions prévues aux articles L. 2222-3 et L. 2222-3-1 respectivement relatifs, comme on l’a vu, à l’instauration du calendrier de négociation et aux accords de méthode.
Étape supplémentaire dans la formalisation du contenu des accords collectifs, le b du 4° du I crée au sein de la section IV du chapitre II du titre II du livre II de la deuxième partie du code du travail un nouvel article L. 2222-5-1 prévoyant que les accords et conventions collectifs définissent leurs conditions de suivi et comportent des clauses de rendez-vous. De l’avis des personnes auditionnées par le rapporteur, ces clauses permettront aux partenaires sociaux de faire le point sur la mise en œuvre des accords conclus, et de décider, le cas échéant, d’engager une procédure de révision de ces accords, ce qui ne peut que stimuler le dialogue social.
À l’instar des autres exigences fixées par le I, l’absence ou la méconnaissance des clauses prévues à l’article L. 2222-5-1 ne peut entraîner la nullité des accords et conventions.
Par coordination, le a du 4° du I modifie l’intitulé de la section IV afin d’y faire figurer les modalités de « suivi » des accords et conventions.
Les règles relatives à la durée des accords collectifs reposent actuellement sur les dispositions de l’article L. 2222-4 du code du travail, selon lesquelles les conventions et accords peuvent être conclus « pour une durée indéterminée ou pour une durée déterminée ». Lorsqu’ils sont conclus pour une durée déterminée, les conventions et accords sont soumis à deux conditions spécifiques :
– d’une part, ils ne peuvent pas être conclus pour une durée supérieure à cinq ans ;
– d’autre part, lorsque la convention ou l’accord à durée déterminée arrive à expiration et, à moins qu’il n’en soit stipulé expressément autrement, cette convention ou cet accord continue de produire ses effets, ce qui lui confère de fait une durée indéterminée, confirmée par la jurisprudence de la Cour de cassation (5).
Or, le recours fréquent aux accords à durée indéterminée et la tacite reconduction des accords à durée déterminée n’incitent guère les différents acteurs du dialogue social à réviser à échéance régulière les accords collectifs. Le maintien des accords anciens est dès lors responsable d’un faible dynamisme de la négociation collective et, logiquement, des normes conventionnelles qui en découlent.
Le 3° du I fait par conséquent le choix de renverser la logique poursuivie à l’article L. 2222-4 et modifie à cet effet les deux derniers alinéas de cet article.
En premier lieu, est fixée une durée « par défaut » des accords. Ainsi, dès lors qu’aucune durée – qu’elle soit déterminée ou indéterminée − n’est expressément prévue par l’accord ou par la convention, sa durée de validité sera désormais de cinq ans.
L’option retenue par le projet de loi est plus souple que celle esquissée dans le rapport de M. Combrexelle, qui préconisait de prévoir une durée de vie maximale de quatre ans pour l’ensemble des accords, actant ainsi la disparition de l’accord à durée indéterminée. Cette option présentait en effet le risque d’une forte instabilité des normes conventionnelles.
En second lieu, le 3° prévoit qu’à l’expiration de l’accord ou de la convention à l’échéance qu’il a définie, il cessera de produire ses effets, contrairement à la logique qui prévaut aujourd’hui.
L’expiration de l’accord vise à éviter que certaines normes conventionnelles deviennent manifestement obsolètes. Les partenaires sociaux seront également incités à engager de nouvelles négociations pour décider du sort du texte venant à expiration, par exemple pour en prolonger l’application ou, le cas échéant, pour conclure un nouvel accord ayant vocation à s’y suppléer. Le risque, dans le cas contraire, serait en effet de laisser s’instaurer des « déserts conventionnels », faute de négociation récente à l’expiration des accords.
Le rapport de M. Combrexelle a enfin mis en évidence la relative méconnaissance, en France, de l’importance de la négociation collective par les salariés, un constat qui peut paraître surprenant alors que 95 % d’entre eux sont couverts par des accords de branche.
La méconnaissance des normes conventionnelles est d’autant plus surprenante que plusieurs outils juridiques ont d’ores et déjà vocation à assurer une large diffusion des textes conventionnels.
Au sein de l’entreprise, par exemple, la partie réglementaire du code du travail prévoit l’obligation pour l’employeur d’informer ses salariés sur le droit conventionnel qui leur est applicable (6). Les modalités de l’obligation d’information de l’employeur peuvent notamment faire l’objet d’un accord entre l’employeur et les partenaires sociaux ; à défaut d’accord, la communication des normes conventionnelles applicables se fait au moment de l’embauche, puis par la mise à disposition des salariés des textes qui leur sont applicables, sur le lieu de travail ou sur l’intranet de l’entreprise, étant entendu que ceux-ci doivent être tenus à jour.
Au niveau des branches, la diffusion des textes conventionnels est assurée par leur mise à disposition sous la forme d’un Bulletin officiel hebdomadaire publié sur le site des journaux officiels. La version consolidée des conventions collectives de branche nationales étendues est également disponible sur le site Internet Legifrance (7).
Or ces modalités d’information sont aujourd’hui dépassées, en particulier en ce qui concerne les entreprises, au regard notamment du développement des nouvelles technologies de l’information et de la communication. En ce qui concerne les branches, la publication des textes sur Legifrance ne suffit pas à résoudre la problématique de l’accessibilité de ces textes et, partant, de leur connaissance et de l’appropriation de leurs enjeux par les entreprises concernées.
Regrettant ainsi le caractère encore trop « confidentiel » des normes conventionnelles, le rapport de M. Combrexelle préconisait une plus large diffusion des accords, par exemple par le biais d’une stipulation contenue dans l’accord collectif « définissant les conditions dans lesquelles son contenu sera porté à la connaissance des salariés concernés » (proposition n° 15). À plus grande échelle, le rapport suggérait la mise en place d’une plateforme nationale « permettant la mise en commun et la diffusion des données et des connaissances sur la négociation collective » (proposition n° 17).
Le II reprend et étend la portée de ces deux propositions afin d’assurer une très large publicité des accords collectifs.
En l’état du droit, la section III du chapitre Ier du titre III du livre II de la deuxième partie du code du travail ne traite que de la notification et du dépôt des accords et conventions. Le 1° du II complète cette section afin de définir également les règles de publicité des accords collectifs ; l’intitulé de la section 3 est en conséquence modifié par le a du 1°.
En outre, le b du 1° crée l’article L. 2231-5-1 qui précise les conditions de publicité des accords. Le premier alinéa de ce nouvel article précise que tous les accords collectifs sont rendus publics et « versés dans une base de données nationale », consultable en ligne, dans un format réutilisable. L’étude d’impact précise que l’accès à cette base de données sera bien évidemment gratuit.
Cette publicité s’applique à l’ensemble des accords, quel que soit le niveau de négociation considéré. Toutefois, au niveau de l’entreprise, un employeur peut s’opposer à la publication d’un accord lorsque sa diffusion serait « préjudiciable à son entreprise », compte tenu par exemple de la présence d’informations sensibles sur la situation de l’entreprise ou sur sa politique de ressources humaines. L’employeur doit alors notifier son opposition aux signataires de l’accord ainsi qu’à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (Direccte), qui est l’autorité administrative compétente pour le dépôt de l’accord.
Le rapporteur regrette cependant que seul l’employeur puisse s’opposer à la publication d’un accord, considérant que les autres parties à la négociation peuvent également avoir de bonnes raisons de refuser la publication d’un accord, si celui-ci comporte des données sensibles.
Les modalités pratiques relatives à la publicité des accords seront définies par décret en Conseil d’État.
Le III précise que les dispositions de cet article s’appliquent aux accords conclus après la promulgation de la loi.
*
La Commission a adopté :
– l’amendement AS297 visant à rendre obligatoire la définition d’un calendrier de négociations par l’accord ou la convention de branche et d’entreprise ;
– s’agissant des modalités de publicité des accords, deux amendements du rapporteur, l’un visant à préciser que tout signataire peut s’opposer à la publication d’un accord, l’autre reportant au 1er septembre 2017 ces modalités de publication, afin que la base de données soit opérationnelle ;
– six amendements rédactionnels à cet article.
*
La Commission examine l’amendement AS735 de Mme Éva Sas.
Mme Éva Sas. Le présent amendement vise à supprimer les alinéas 7 et 8 qui permettent de modifier les périodicités des négociations. En application de ces deux alinéas, les négociations annuelles pourraient devenir triennales. Ces négociations sont essentielles pour de nombreux aspects de la vie en entreprise et les rapports entre salariés et employeurs. Allonger leur périodicité ne nous semble pas judicieux. Les négociations annuelles incluent aujourd’hui les rémunérations ; avec le nouveau dispositif, seules les organisations signataires de l’accord pourraient demander une périodicité annuelle.
M. le rapporteur. Défavorable. Ces alinéas n’ont pas pour objet de restreindre le dialogue social ; au contraire, ils permettront plus de souplesse dans les négociations obligatoires, pour que celles-ci aient lieu au moment le plus opportun. J’ajoute que la négociation sur les salaires pourra être conduite annuellement si une organisation syndicale le souhaite. Par ailleurs, le plan d’action de l’employeur pour l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes devra également être remis chaque année à défaut d’accord.
Mme Éva Sas. Ces alinéas ne visent pas à adapter la périodicité des négociations au moment le plus opportun, mais bien à l’allonger, puisqu’une négociation annuelle pourra devenir triennale. Par ailleurs, seule une organisation signataire de l’accord pourra demander une négociation sur les salaires ; il aurait fallu pour le moins en donner le droit aux autres.
Mme Monique Iborra. Il faut trouver un équilibre. Nous sommes très favorables aux négociations d’entreprise – j’avais cru comprendre que Mme Sas ne l’était pas particulièrement – mais on ne saurait pour autant prévoir des négociations à répétition, et de surcroît dépourvues d’objet réel dans la mesure où, sur un certain nombre de questions, les choses peuvent être reprises à l’initiative des organisations syndicales. La légitime préoccupation de Mme Sas est satisfaite par le texte tel qu’il nous est présenté.
M. Gérard Cherpion. L’alinéa 8 est très clair : une organisation signataire peut demander des négociations sur les salaires. Il est logique que ce soit l’organisation signataire d’un accord qui en demande la révision, et elle peut le faire tous les ans. Il n’y a donc pas de souci.
La Commission rejette cet amendement.
Elle examine ensuite l’amendement AS297 de M. Christophe Cavard.
M. Christophe Cavard. La question de la méthode des négociations n’est pas à négliger. Si la méthode n’est pas claire et cautionnée par les deux parties dès le départ, la négociation peut en souffrir. Le présent amendement porte sur le calendrier et la périodicité : alors que le texte prévoit seulement la possibilité d’établir un accord de méthode, il me semble important d’en faire une obligation.
M. le rapporteur. Ce que vous proposez n’est pas dans l’accord de méthode. J’y suis néanmoins favorable, car cela rendrait obligatoire la définition d’un calendrier de négociations. Je trouve intéressant que les partenaires définissent leur agenda, d’autant plus que nous leur permettons de moduler la périodicité des négociations.
M. Gérard Cherpion. J’y suis opposé. Il sera plus difficile de relancer la négociation s’il faut impérativement définir un calendrier dès le départ. Cela crée un risque de blocage.
La Commission adopte cet amendement.
Elle en vient à l’amendement AS624 de Mme Catherine Coutelle.
Mme Catherine Coutelle. Cet amendement traite de la périodicité de la négociation des accords d’égalité professionnelle. Nous proposons qu’en l’absence d’accord, la périodicité reste d’un an : l’entreprise sera obligée de relancer les négociations dans ce délai. Comme M. Cherpion l’a rappelé tout à l’heure, l’alinéa 8 dispose qu’une organisation signataire peut demander une renégociation ; mais dans le cas visé en l’espèce, il n’y a pas d’organisation signataire puisque le plan « égalité professionnelle » a été refusé. L’égalité salariale et professionnelle est toujours le parent pauvre dans les négociations : ce n’est jamais la priorité. Si l’on veut qu’elle avance, il faut qu’elle soit renégociée tant qu’il n’y a pas de plan.
M. le rapporteur. L’alinéa 9 traite déjà des situations dans lesquelles une entreprise n’a pas conclu d’accord sur l’égalité professionnelle, en précisant que l’employeur est tenu d’établir chaque année un plan d’action pour l’égalité professionnelle, sans pouvoir reporter cette échéance. Mais si nous adoptions votre amendement, madame Coutelle, cette interdiction vaudrait pour tous les autres accords ; je ne saurais donner un avis favorable à une mesure aussi disproportionnée, même si je sais l’importance du combat que vous menez.
M. Élie Aboud. Votre amendement est satisfait, madame la présidente Coutelle. Pourquoi ne pas fixer un délai inférieur, chaque semestre ou trimestre ?
Mme Catherine Coutelle. L’égalité professionnelle se négocie chaque année en l’absence d’accord, mais le rattrapage des salaires entre les femmes et les hommes reste le parent pauvre de la négociation, alors que nous souhaitons depuis déjà un certain temps, à l’occasion de chaque texte de loi, en faire une priorité. Nous réécrirons notre proposition d’ici à la séance publique, afin de préciser que s’il n’y a qu’un plan unilatéral dans l’entreprise, ce point spécifique de l’égalité professionnelle devra être renégocié chaque année.
Je retire mon amendement.
L’amendement est retiré.
La Commission adopte l’amendement de précision AS791 du rapporteur.
Puis elle examine l’amendement AS310 de M. Christophe Cavard.
M. Christophe Cavard. Le texte proposé pour l’article L. 2222-3-1, à l’alinéa 11 de l’article 7, prévoit qu’une convention ou un accord collectif « peut » définir la méthode permettant à la négociation de s’accomplir dans des conditions de loyauté et de confiance mutuelle entre les parties. Je propose de remplacer « peut » par « doit ». Si on ne rend pas obligatoire la définition de la méthode de la négociation, des discussions pourront s’engager sans accord de méthode préalable. Or le rapport de M. Jean-Denis Combrexelle insiste sur la nécessité de fixer précisément le cadre et les règles de la démocratie sociale pour que celle-ci fonctionne. Il faut donc contraindre les parties à s’accorder sur la méthode.
M. le rapporteur. J’avais dans un premier temps la même idée que la vôtre, monsieur Cavard, mais je me suis ravisé en me rendant compte qu’une telle obligation pourrait allonger considérablement le temps des négociations, dans la mesure où il faudrait conclure un premier accord avant de discuter sur l’accord lui-même, au risque de les bloquer totalement dans les petites entreprises. Le rapport Combrexelle lui-même soulignait qu’une négociation sur la négociation pourrait s’avérer déstabilisante et stérilisante dans la pratique. En outre, si l’absence d’accord de méthode préalable entraînait la nullité des accords conclus, cela pourrait décourager la négociation collective, notamment dans les petites structures qui y sont peu habituées. Nous irions à l’inverse de l’objectif que nous recherchons. J’émets donc un avis défavorable à l’adoption de cet amendement.
M. Christophe Cavard. Le rapport Combrexelle défend l’idée que le temps passé à discuter de la méthode n’est pas perdu, mais bien gagné dans la mesure où cela permet à la négociation de se dérouler dans de bonnes conditions. Le texte prévoit des accords types, qui pourraient exister pour les accords de méthode au niveau de la branche, ce qui aiderait la concertation dans les petites entreprises. Il serait dommage que les accords de méthode ne soient pas obligatoires, car ce serait prendre le risque de voir des négociations déraper.
Mme Isabelle Le Callennec. Il est intéressant de se mettre d’accord sur une méthode, mais il ne faudrait pas que cette discussion en vienne à bloquer la négociation. Incitons les partenaires sociaux à arrêter une méthode, dont l’intérêt pour eux est évident, mais ne la rendons pas obligatoire.
M. Gérard Cherpion. La majorité des entreprises de notre pays sont de petite taille. Si on obligeait les parties à s’accorder sur la méthode – même au niveau de la branche –, on bloquerait le système. Rappelons que le titre de ce chapitre Ier s’intitule : « Des règles de négociation plus souples et le renforcement de la loyauté de la négociation ». Ne rajoutons pas d’étage supplémentaire à la négociation si l’on vise la souplesse ! Dans les grandes entreprises, la négociation sur la méthode s’effectue presque spontanément, mais on risque d’empêcher tout accord dans les petites entreprises.
La Commission rejette l’amendement.
Puis elle étudie l’amendement AS214 de M. Patrick Hetzel.
M. Élie Aboud. Nous proposons de supprimer la fin de l’alinéa 11, à l’évidence pléonastique : une négociation doit de fait s’accomplir dans des « conditions de loyauté et de confiance mutuelle entre les parties ».
M. le rapporteur. Je n’y vois aucun pléonasme, mon cher collègue, dans la mesure où la jurisprudence invoque régulièrement la loyauté de la négociation. C’est précisément pour lui donner une assise juridique plus ferme que l’article 7 propose de l’inscrire dans le droit du travail. Je suggère d’en rester à la rédaction actuelle du texte et j’émets donc un avis défavorable à l’adoption de votre amendement.
Mme Isabelle Le Callennec. Tout le monde n’a pas la même appréciation de ce que sont des conditions de loyauté et de confiance mutuelle entre les parties… Tout porte à croire que cela donnera lieu à des interprétations très différentes.
La Commission rejette l’amendement.
Puis elle adopte l’amendement rédactionnel AS792 du rapporteur.
La Commission en vient à l’amendement AS667 de M. Jean-Louis Bricout.
M. Jean-Louis Bricout. Nous souhaitons le renforcement du dialogue social, mais nous connaissons également les exigences de nos concitoyens pour ce qui touche à l’utilisation des aides publiques aux entreprises. Mon amendement propose de confier aux partenaires sociaux, dans le cadre de la négociation des accords d’entreprise, l’affectation et la répartition des différentes aides publiques, afin qu’un contrôle transparent puisse s’exercer. Les partenaires sociaux pourraient ainsi s’entendre sur la répartition du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE) entre la création d’emplois, l’investissement ou le renforcement de la trésorerie.
M. le rapporteur. Monsieur Bricout, votre proposition n’a rien à voir avec l’accord de méthode et se trouve déjà mise en œuvre. En effet, la loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi a instauré la base de données économiques et sociales (BDES), qui comporte des indications sur les flux financiers, les aides publiques et les crédits d’impôt dont bénéficie l’entreprise, autant d’informations données aux différents négociateurs. J’émets un avis défavorable à l’adoption de votre amendement.
La Commission rejette l’amendement.
Puis elle adopte successivement les amendements rédactionnels AS793 et AS794 du rapporteur.
La Commission est saisie des amendements identiques AS29 de M. Patrick Hetzel et AS48 de M. Lionel Tardy.
M. Élie Aboud. L’amendement AS29 est défendu.
M. Lionel Tardy. Le Gouvernement a un goût immodéré pour les préambules et les bavardages législatifs sans force juridique. Ainsi, le projet prévoit que les conventions et les accords contiennent un préambule présentant de manière succincte leurs objectifs et leur contenu. Cela ne présente aucune utilité, car le texte mentionne que « l’absence de préambule n’est pas de nature à entraîner la nullité de la convention ou de l’accord ». Autant donc s’en passer, comme le propose mon amendement AS48.
M. le rapporteur. Le préambule n’est pas obligatoire. Je trouve curieux que vous en souhaitiez la suppression alors que vous avez insisté tout à l’heure sur la nécessité de bien préparer les conditions de la négociation… Le préambule invite les parties prenantes à expliquer l’économie générale de la convention et accroît la lisibilité et la bonne compréhension des accords collectifs. J’émets donc un avis défavorable à l’adoption de cet amendement.
M. Gérard Cherpion. Monsieur le rapporteur, vous venez de dire que le préambule n’est pas obligatoire, mais l’alinéa 19 spécifie bien que la convention ou l’accord contient un préambule.
M. le rapporteur. Je vous renvoie à l’alinéa suivant : « L’absence de préambule n’est pas de nature à entraîner la nullité de la convention ou de l’accord ». Ce n’est donc qu’une possibilité.
M. Gérard Cherpion. Le préambule est obligatoire, et le fait que son absence n’entraîne pas la nullité de l’accord constitue un élément distinct.
M. Gérard Sebaoun. Soit on part de l’idée que l’ensemble des négociateurs peuvent intégrer la totalité d’un accord de 150 à 200 pages techniques, soit on pense qu’une note de synthèse initiale permettant d’entrer dans la négociation est utile. Je penche pour la deuxième hypothèse…
Mme Isabelle Le Callennec. Le texte affirme que la convention ou l’accord contient un préambule, mais que l’absence de celui-ci n’entraîne aucune nullité. Cela signifie que le préambule peut être utile. On pourrait rejoindre les propos de M. Cavard et vouloir que le préambule présente succinctement les objectifs, les contenus et la méthode de l’accord. Il faudrait écrire que la convention « peut » contenir un préambule, puisque son absence n’engendre pas de nullité.
La Commission rejette les amendements.
Puis elle aborde l’amendement AS409 de M. Christophe Cavard.
M. Christophe Cavard. Madame Le Callennec, on pourrait envisager que l’absence de préambule entraîne la nullité de l’accord.
Mon amendement vise à ce que le préambule, tout en restant succinct, ne présente pas uniquement les objectifs et le contenu de la convention, mais également les moyens et les délais.
Monsieur Cherpion, il importe de bien définir l’accord de méthode dans l’intérêt des salariés. Je vois à quel genre de souplesse vous pensez lorsque vous ne souhaitez pas rendre obligatoire l’accord de méthode.
M. le rapporteur. Votre argumentaire ne correspond pas à l’exposé sommaire de votre amendement, puisque vous souhaitez préciser les contours de l’accord de méthode tout en amendant la disposition portant sur le préambule. Par ailleurs, ce dernier n’a vocation à fixer ni les délais – qui regardent plutôt les clauses de suivi – ni les moyens de l’accord ; à quoi ces derniers renvoient-ils d’ailleurs ? J’émets un avis défavorable à l’adoption de votre amendement.
M. Jean-Pierre Barbier. Cherchons-nous vraiment à opérer un choc de simplification du code du travail ? En entendant cette discussion, j’ai plutôt l’impression que l’on va complexifier le dialogue social, car toutes ces dispositions auront au final un effet catastrophique sur la vie de nos entreprises.
M. Christophe Cavard. Monsieur le rapporteur, oublions l’exposé sommaire que l’on rédige parfois rapidement ; le préambule des conventions doit en exposer succinctement les objectifs. Il me serait intéressant que le préambule puisse indiquer les moyens, notamment en termes de temps accordé aux négociateurs, que l’on se donne pour atteindre les objectifs de l’accord. Les délais seront évidemment fonction du temps consacré à la négociation.
M. le rapporteur. Monsieur Cavard, le préambule ne peut pas être un préaccord. J’ai du mal à comprendre l’objet de votre amendement.
La Commission rejette l’amendement.
Puis elle examine l’amendement AS415 de Mme Jacqueline Fraysse.
Mme Jacqueline Fraysse. Les alinéas 21 à 23 de l’article 7 instaurent une durée de validité par défaut de cinq ans pour les accords collectifs signés dans des branches ou dans des entreprises. Le droit existant offre aux organisations syndicales la liberté de fixer une durée limitée ou illimitée aux accords collectifs. L’instauration d’une durée de validité par défaut n’apporte rien et risque même de se révéler régressive dans la mesure où cela autorisera à revenir sur la règle des avantages individuels acquis, le texte précisant que « lorsque la convention ou l’accord arrive à expiration, la convention ou l’accord cesse de produire ses effets ». Je propose de supprimer ces dispositions dangereuses.
M. le rapporteur. Ces mesures ne dégradent pas la situation actuelle, à moins de considérer par principe que tout accord sera forcément défavorable aux salariés. Je ne partage pas cette vision. L’article 10 du projet de loi propose de généraliser l’accord majoritaire d’entreprise et garantit davantage l’équilibre entre la protection des salariés et les nécessités de l’entreprise. La suppression de la durée de validité par défaut des accords ne présente pas d’intérêt. Avis défavorable.
Mme Jacqueline Fraysse. Quel est l’intérêt de la fixer à cinq ans ?
M. le rapporteur. À défaut de son maintien dans l’accord, il faut bien une référence.
La Commission rejette l’amendement.
Puis elle étudie l’amendement AS734 de Mme Éva Sas.
Mme Éva Sas. L’alinéa 22 de l’article 7 du projet de loi prévoit une durée de validité des accords par défaut de cinq ans. Les modalités actuelles de dénonciation des accords sont satisfaisantes ; du coup, la fixation d’une durée de validité par défaut ne constitue pas une avancée et s’oppose même aux objectifs de souplesse, d’adaptation aux réalités de l’entreprise et de redynamisation du dialogue social. En effet, un accord apportant des garanties aux salariés ne serait pas pérenne et serait renégocié par défaut au bout de cinq ans. Il nous paraît plus simple et plus sage de ne pas fixer de durée par défaut, qui n’apporterait aucune garantie et aucune protection supplémentaires aux actifs.
M. le rapporteur. S’il n’y a pas de délai, la seule solution consiste à dénoncer un accord, et l’exercice n’est pas des plus faciles. En l’absence de durée de validité par défaut, un accord intervenu pendant la crise de 2008, par exemple, pourrait ainsi perdurer pendant un temps indéterminé. Je ne vois pas en quoi le fait de fixer une durée de validité constituerait un frein : ce peut être l’occasion de faire le point sur les normes conventionnelles, dont certaines seront peut-être devenues obsolètes. Votre proposition ne me paraît pas aller dans le sens de la négociation collective que l’article 7 vise précisément à encourager. Avis défavorable.
La Commission rejette l’amendement.
Puis elle est saisie de l’amendement AS103 de M. Gérard Cherpion.
Mme Isabelle Le Callennec. Cet amendement a pour objet la suppression des alinéas 24 à 28 de l’article 7. Le projet de loi impose aux partenaires sociaux de prévoir dans l’accord les conditions de son suivi ainsi qu’une clause de rendez-vous. La fréquence des réunions obligatoires des partenaires sociaux s’en trouvera augmentée alors que l’on a récemment multiplié les thèmes imposés de négociation, qu’ils soient annuels, triennaux ou quinquennaux.
M. le rapporteur. Avis défavorable. L’absence de clause de rendez-vous et de suivi de l’accord n’entraîne pas la nullité de celui-ci.
La Commission rejette l’amendement.
Puis elle adopte l’amendement rédactionnel AS797 du rapporteur.
La Commission en vient à l’amendement AS416 de Mme Jacqueline Fraysse.
Mme Jacqueline Fraysse. L’alinéa 34 de l’article 7 prévoit que l’employeur peut s’opposer à la publication d’un accord dans une base de données nationale s’il estime que sa diffusion porterait préjudice à son entreprise. Cette disposition heurte les exigences de publicité et de transparence des accords collectifs. Le droit actuel impose le dépôt – sous forme papier et électronique – des accords collectifs auprès des services du ministère chargé du travail. En vertu de l’article R. 2231-9 du code du travail, toute personne intéressée peut prendre connaissance gratuitement des conventions et des accords collectifs auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) ou du service départemental de l’inspection du travail. La rédaction actuelle de l’article 7 remet en cause cette possibilité. Nous ne voyons pas, dès lors que l’employeur a signé l’accord, en quoi la diffusion de son contenu pourrait être préjudiciable à l’entreprise.
Nous proposons donc de supprimer cet alinéa.
M. le rapporteur. Madame Fraysse, l’obligation de dépôt existant aujourd’hui ne signifie pas que le texte de l’accord soit obligatoirement rendu public – à l’exception des conventions collectives de branche. Les accords peuvent contenir des éléments relatifs à la politique salariale et à la stratégie de l’entreprise qui peuvent exposer celle-ci à la concurrence. Je propose du reste dans l’amendement suivant, AS905, de rééquilibrer le dispositif en étendant aux salariés cette possibilité de s’opposer à la publication de l’accord. En effet, on peut imaginer que les salariés, pour des raisons de stratégie, ne tiennent pas à la publication d’informations qui pourraient être préjudiciables à l’action des organisations syndicales.
J’émets un avis défavorable à l’adoption de votre amendement.
M. Alain Fauré. Je rejoins les propos de M. le rapporteur : certains éléments doivent rester confidentiels, car ils pourraient se retourner contre les salariés au moment des négociations, de même que certaines entreprises évoluant dans des marchés très compétitifs peuvent refuser la publication de leurs bilans, qui pourrait porter préjudice à leur avenir et à celui de leurs salariés.
Mme Jacqueline Fraysse. Monsieur le rapporteur, j’apprécie que vous donniez aux salariés les mêmes droits qu’aux employeurs, mais vos propos ne me convainquent pas. Cet alinéa vise à empêcher la connaissance du contenu des accords et procède d’une volonté de dissimulation qui me dérange.
La Commission rejette l’amendement.
Puis elle aborde l’amendement AS905 du rapporteur.
M. le rapporteur. Je l’ai défendu à l’instant.
La Commission adopte l’amendement.
Puis elle adopte l’amendement rédactionnel AS906 du rapporteur.
La Commission examine l’amendement AS311 de M. Christophe Cavard.
M. Christophe Cavard. Si la publicité faite aux accords collectifs est renforcée, l’employeur peut en l’état seul s’y opposer, simplement en le notifiant aux signataires et à l’administration, et sans justification. Il est nécessaire que cette opposition soit motivée dans le cadre d’une clause figurant dans l’accord lui-même. Réinstaurer la confiance dans les accords collectifs en dépend. Mon amendement diffère donc quelque peu du vôtre, monsieur le rapporteur, car je souhaite amener les deux parties à s’entendre sur la non-publication de l’accord au lieu d’autoriser l’une ou l’autre à imposer unilatéralement son choix.
M. le rapporteur. Autrement dit, il faudrait donc s’entendre avant même la signature de l’accord sur la publication des éléments partagés, sans forcément savoir à cet instant quels éléments ont été partagés… Ce système me paraît bien compliqué et pourrait même empêcher la négociation d’aboutir. Monsieur Cavard, je vous demande de retirer votre amendement.
M. Gérard Cherpion. La publicité des accords est tout à fait normale et même légitime ; et si, dans un certain nombre de cas, il peut y avoir un besoin de confidentialité, le projet de loi le prévoit, il ne faudrait pas généraliser les clauses de motivation de non-publication de l’accord, sous peine d’aller à l’encontre du but recherché.
M. Christophe Cavard. Monsieur Cherpion, je ne comprends pas votre propos, puisque tout signataire pourra désormais s’opposer à la publication de l’accord. Cela ne facilitera donc pas sa publicité !
Monsieur le rapporteur, au moment de la signature de l’accord, la négociation est terminée : les parties en connaissent le contenu, et c’est à ce moment-là qu’elles décideront ensemble d’autoriser ou non sa publication, et non au départ.
M. le rapporteur. Mais on peut imaginer qu’un accord ait abouti, mais que les deux parties restent en désaccord sur sa publication. Du coup, c’est l’accord lui-même qui s’en trouverait compromis… Pour cette raison, votre amendement ne me paraît pas opportun. Je maintiens donc ma demande de retrait ou, à défaut, mon avis défavorable.
La Commission rejette l’amendement.
Elle en vient alors à l’amendement AS907 du rapporteur.
M. le rapporteur. Cet amendement vise à reporter au 1er septembre 2017 l’entrée en vigueur des nouvelles conditions de publicité des accords. Aujourd’hui, ceux-ci sont déposés auprès de la direction générale du travail (DGT) pour les accords de branche et des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) pour les accords d’entreprise. Or la base de données qui les regroupe a besoin d’être adaptée à une consultation publique.
La Commission adopte l’amendement.
Puis elle adopte l’article 7 modifié.
*
* *
Article 8
(Art. L. 2232-21, L. 2232-22, L. 2232-24, L. 2232-24-1 [nouveau], L. 2261-7,
L. 2261-7-1 [nouveau], L. 2261-10, L. 2261-13, L. 2261-14, L. 2261-14-2 à L. 2261-14-4 [nouveaux] du code du travail)
Mécanismes de révision et d’extinction d’un accord
Cet article vise à modifier les règles de révision et de dénonciation d’un accord. Il propose notamment :
− de simplifier les règles de révision et de dénonciation des accords ;
− de sécuriser les modalités de conclusion, de révision ou de dénonciation des accords collectifs dans les entreprises dépourvues de délégué syndical ;
− de clarifier les effets de la dénonciation ou de la mise en cause des accords collectifs, notamment en ce qui concerne les avantages individuels acquis.
Cet article étend également les possibilités de négociation d’un accord d’entreprise avec des salariés mandatés par une organisation syndicale.
Pour tenir compte de l’évolution du contexte économique dans lequel ils s’inscrivent, les accords collectifs peuvent toujours être modifiés ou adaptés : c’est le fondement de la révision, que le professeur Jean-François Cesaro (8) définit comme « l’acte qui, d’un commun accord, permet de modifier, d’ajouter ou de retrancher aux stipulations d’un autre acte ».
En application de l’article L. 2222-5 du code du travail, les modalités formelles de la révision ainsi que le délai au terme duquel la convention ou l’accord peut être renouvelé ne peuvent être définis que par la convention ou par l’accord eux-mêmes (9).
L’avenant portant révision de tout ou partie de la convention ou de l’accord collectif se substitue de plein droit aux stipulations de la convention ou de l’accord qu’il modifie. Il devient dès lors opposable à l’ensemble des employeurs et des salariés liés par la convention ou l’accord.
Aux termes de l’article L. 2261-7 du même code, les seules organisations habilitées à signer les avenants de révision d’une convention ou d’un accord sont les organisations syndicales de salariés représentatives et ayant obtenu 30 % des suffrages exprimés lors des élections professionnelles, qui sont soit signataires de la convention ou de l’accord, soit adhérentes à l’accord, dans les conditions prévues à l’article L. 2261-3 du même code.
Le code du travail ne mentionne pas la procédure applicable aux organisations professionnelles d’employeurs, mais conformément à la logique contractuelle selon laquelle le droit de réviser un acte revient uniquement aux parties qui en sont à l’origine, seules les organisations professionnelles d’employeurs signataires ou adhérentes d’un accord sont actuellement habilitées à réviser un accord.
Ces modalités de révision soulèvent néanmoins des difficultés.
En effet, la logique contractuelle visant à confier aux seules organisations signataires ou adhérentes à un accord, qui prévaut pour les syndicats de salariés comme pour les organisations professionnelles d’employeurs, n’est plus adaptée aux récentes évolutions des règles de la représentativité des partenaires sociaux engagées par la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 et par la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014, qui ont accordé une place majeure à la mesure de l’audience.
Selon l’étude d’impact, la coexistence des règles actuelles de révision des accords avec les nouvelles règles de représentativité a « généré des situations de blocage rendant l’exercice de la révision très difficile », et ce pour plusieurs raisons :
− en vertu des règles actuelles de révision, toute organisation signataire conserve la possibilité de s’opposer à l’engagement d’une procédure de révision, même si, à l’issue des élections professionnelles, elle n’est plus considérée comme représentative, faute d’avoir franchi le seuil de 10 % des suffrages ;
− de surcroît, les conditions actuelles de validité d’un avenant de révision, qui supposent de franchir le seuil des 30 %, pour les organisations syndicales représentatives, ne sont plus forcément adaptées lorsque les organisations signataires de l’accord ont recueilli des scores inférieurs à l’occasion des élections professionnelles.
Dans ces différents cas de figure, toute révision de l’accord devient impossible, à moins que des organisations syndicales de salariés représentatives mais initialement non signataires de l’accord, décident d’y adhérer.
Pour lever cet écueil, l’adaptation des règles de révision des accords aux nouvelles règles de représentativité des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d’employeurs paraît donc inéluctable.
Le rapport de M. Cesaro relève deux options possibles pour engager la révision des accords, chacune relevant d’une logique propre.
La première option consiste à maintenir la possibilité pour les seules parties signataires la possibilité de réviser l’accord, en vertu de la logique contractuelle qui prévaut actuellement.
La seconde option consiste à admettre que « la révision n’appartient pas à celui qui en est signataire », permettant ainsi à « toute personne susceptible de représenter la collectivité » d’engager une procédure de révision, sous réserve d’une majorité suffisante.
Chacune de ces options présente des avantages et des inconvénients ; le I de cet article propose donc de mettre en place un dispositif hybride. Il instaure deux procédures de révision distinctes, selon que le cycle électoral est en cours ou achevé. Il distingue également les modalités de révision applicables au niveau interprofessionnel ou au niveau de la branche, d’une part, et au niveau de l’entreprise, d’autre part.
A. LES NOUVELLES MODALITÉS DE RÉVISION D’UN ACCORD INTERPROFESSIONNEL, D’UNE CONVENTION OU D’UN ACCORD DE BRANCHE
Le a du 1° du I modifie tout d’abord l’article L. 2261-7 afin de déterminer les organisations habilitées à engager la procédure de révision d’un accord interprofessionnel, d’une convention ou d’un accord de branche.
Le I de l’article L. 2261-7 modifié détermine les organisations habilitées à engager la procédure de révision en fonction de la période considérée.
Pendant cette période, conformément à la logique contractuelle, la procédure de révision ne peut être engagée que par les organisations signataires ou adhérentes de l’accord.
Cette règle vaut pour les organisations syndicales de salariés représentatives (a du 1° du I de l’article L. 2261-7) comme pour les organisations professionnelles d’employeurs (b du 1° du I du même article), qu’elles soient représentatives ou non (10). En effet, la représentativité des employeurs n’est pas une condition nécessaire à la conclusion d’un accord ; il n’y a donc pas lieu de l’imposer en ce qui concerne leur révision. Toutefois, lorsque un accord est étendu − c’est-à-dire qu’il a été rendu obligatoire pour toutes les entreprises comprises dans son champ d’application, même si ces entreprises ne sont pas signataires ni membres d’une organisation signataire de l’accord −, les organisations professionnelles d’employeurs doivent être représentatives pour engager sa révision, puisqu’aux termes de l’article L. 2261-19 du code du travail, la représentativité est une condition préalable à l’extension d’un accord.
Lorsqu’une nouvelle mesure de la représentativité a eu lieu, et que les organisations syndicales signataires de l’accord considéré ne sont plus nécessairement représentatives, le 2° du I de l’article L. 2261-7 propose d’étendre la possibilité de déclencher une procédure de révision à l’ensemble des organisations dans le champ d’application de la convention ou de l’accord, sans aucune condition d’adhésion ou de signature de l’accord, sous réserve que l’organisation syndicale des salariés soit représentative, ou s’il s’agit d’une organisation professionnelle d’employeurs, seulement si l’accord considéré est étendu.
La principale nouveauté prévue au 2° de l’article L. 2261-7 est donc d’élargir la procédure de révision, à l’issue du cycle électoral, à l’ensemble des organisations dans le champ d’application de la convention ou de l’accord, sans aucune condition d’adhésion ou de signature de l’accord.
Néanmoins, selon le professeur Cesaro, le fait d’autoriser une organisation professionnelle d’employeurs non signataire à réviser un accord à l’issue d’un cycle électoral est potentiellement problématique. Son rapport souligne en effet que la mesure de l’audience des organisations professionnelles d’employeurs − qui doit intervenir pour la première fois en 2017, en application de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 − est susceptible de révéler que « certaines conventions ou certains accords étendus ne sont signés que par des organisations professionnelles d’employeurs qui ne sont pas représentatives ». Or dans cette hypothèse, l’accord révisé ne pourrait faire l’objet d’une extension, étant donné que l’extension est liée à la représentativité.
En revanche, une organisation d’employeurs remplissant les critères de représentativité fixés par la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 et représentant 8 % des adhérents pourrait engager une procédure de révision donnant lieu à un arrêté d’extension « alors même que les signataires de l’acte principal, opposés à cette révision, pourraient représenter un pourcentage plus élevé d’entreprises, même s’ils ne sont pas représentatifs », si par exemple l’accord était initialement signé par trois organisations représentant chacune 4 % des entreprises.
Pour lever cette difficulté, le rapport de M. Cesaro suggérait de subordonner une révision « susceptible d’extension » à un seuil d’engagement de 24 %, c’est-à-dire que la ou les organisations professionnelles d’employeurs souhaitant engager une procédure de révision devraient justifier de représenter au moins 24 % des entreprises et ce, afin de donner, davantage de légitimité à la révision. Le projet de loi n’a toutefois pas retenu cette proposition.
Le II de l’article L. 2261-7 modifié précise que les avenants de révision obéissent aux conditions de validité des accords mentionnées aux sections 1 et 2 du chapitre II du titre III du livre II de la deuxième partie du code du travail, c’est-à-dire aux règles de validité de droit commun relatives respectivement aux règles applicables aux accords interprofessionnels, d’une part, et à celles applicables aux conventions de branche et accords professionnels, d’autre part.
B. LES NOUVELLES MODALITÉS DE RÉVISION D’UNE CONVENTION OU D’UN ACCORD D’ENTREPRISE OU D’ÉTABLISSEMENT
Le b du 1° du I insère ensuite un nouvel article L. 2261-7-1 nouveau au sein de la section 4 du chapitre Ier du titre VI du livre II de la deuxième partie du code du travail, qui vise à déterminer les organisations habilitées à engager la procédure de révision d’une convention ou d’un accord d’entreprise ou d’établissement.
À l’instar des nouvelles règles applicables aux accords interprofessionnels ou de branche, le I de ce nouvel article opère également une distinction en fonction du moment du cycle électoral considéré. Sont ainsi habilitées à engager la procédure de révision d’un tel accord ou d’une telle convention :
– jusqu’à la fin du cycle électoral (1°), une ou plusieurs organisations syndicales de salariés à la fois représentatives et signataires ou adhérentes de l’accord ;
– à l’issue de ce cycle (2°), une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives, sans que ces organisations soient nécessairement signataires ou adhérentes de l’accord.
II. L’ÉLARGISSEMENT DES ATTRIBUTIONS DES SALARIÉS MANDATÉS EN MATIÈRE DE NÉGOCIATION ET DE RÉVISION DES ACCORDS COLLECTIFS
Afin d’encourager la conclusion d’accords d’entreprise ou d’établissement dans les petites structures, l’article 21 de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi a significativement consolidé les règles de négociation et de conclusion des accords, par la voie du mandatement, dans les entreprises dépourvues de représentant du personnel, ou au sein desquelles aucun élu du personnel n’a manifesté son souhait de négocier.
Cet article propose de renforcer encore le rôle des salariés mandatés, dès la phase de négociation et jusqu’à la révision d’un accord.
Les nouvelles modalités de négociation et de conclusion d’un accord prévues par la loi du 17 août 2015 dans les entreprises dépourvues de délégué syndical ou de représentants élus du personnel
L’article L. 2232-24 du code du travail prévoit qu’un accord d’entreprise ou d’établissement peut être négocié et conclu par un ou plusieurs salariés mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche ou, à défaut, au niveau national et interprofessionnel, dans les entreprises ou établissements :
− où aucun élu n’a manifesté son intention de négocier ;
− où un procès-verbal a établi l’absence de représentant du personnel ;
− ou employant moins de onze salariés.
Il doit être approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés et dans le respect des principes généraux du droit électoral.
Aux termes de l’article L. 2232-24 du code du travail, l’accord négocié par un salarié mandaté ne peut porter que sur des mesures dont la mise en œuvre est subordonnée par la loi à un accord collectif, à l’exception des accords mentionnés à l’article L. 1233-21 permettant de fixer les modalités d’information et de consultation du comité d’entreprise applicables lorsque l’employeur envisage de prononcer le licenciement économique d’au moins dix salariés dans une période de trente jours.
Le 5° du I propose de lever cette restriction : il crée à cette fin un article L. 2232-24-1 disposant que les accords négociés et conclus par un ou plusieurs salariés mandatés peuvent porter sur « toutes les mesures qui peuvent être négociées par accord d’entreprise ou d’établissement » en application du code du travail. Par coordination, le b du 4° du I supprime la restriction en vigueur à l’article L. 2232-24.
Compte tenu de la volonté poursuivie par ce projet de loi d’encourager la négociation collective au niveau de l’entreprise, l’extension du rôle des salariés mandatés proposée par cet article est significative, puisque ces nouvelles dispositions leur permettront de négocier non seulement sur les thématiques de négociation obligatoire prévues par le code du travail, mais aussi sur l’ensemble des autres sujets relevant de la négociation collective en entreprise.
B. DES MODALITÉS DE RÉVISION DÉROGATOIRES DANS LES ENTREPRISES DÉPOURVUES DE DÉLÉGUÉ SYNDICAL OU DE REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL
Alors que la loi du 17 août 2015 a renforcé la capacité de négocier des salariés mandatés, aucune procédure de révision des accords n’est prévue lorsqu’une entreprise n’a plus de délégué syndical, de délégué du personnel désigné comme tel ou de représentant du personnel. Dans ces circonstances, les accords ne peuvent donc plus être révisés, quand bien même leurs dispositions seraient devenues obsolètes.
Pour ces entreprises, les 2°, 3° et 4° du I de l’article 10 créent donc des règles dérogatoires de révision des accords collectifs, alignées sur les nouvelles règles applicables à la négociation des accords, parachevant ainsi la réforme engagée par la loi du 17 août 2015.
S’agissant des entreprises ou des établissements qui ne disposent plus de délégués syndicaux ou, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, de délégués du personnel désignés comme tels, le 2° du I modifie l’article L. 2232-21 du code du travail afin de permettre aux représentants élus du personnel au comité d’entreprise, à la délégation unique du personnel (DUP) ou au sein de l’instance unifiée de représentation du personnel mentionnée à l’article L. 2391-1 du même code ou, à défaut, aux délégués du personnel, de réviser les accords collectifs.
Cette capacité à engager la révision d’un accord est toutefois subordonnée, comme pour la négociation et la conclusion d’un accord, au mandatement exprès de ces personnels par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de la branche dont relève l’entreprise ou, à défaut, au niveau national ou interprofessionnel.
À défaut de mandatement d’un représentant élu du personnel par une organisation syndicale, le a du 3° du I modifie l’article L. 2232-22 afin d’autoriser les représentants élus titulaires du personnel au comité d’entreprise, à la DUP, à l’instance unifiée de représentation du personnel ou, à défaut, les délégués titulaires du personnel non expressément mandatés par une organisation syndicale, à réviser les accords collectifs de travail.
Les b, c et d du 3° du I étendent aux avenants de révision les règles de validité des accords prévues à l’article L. 2232-22. Pour être valides, les avenants seront ainsi préalablement soumis à la signature des membres titulaires élus au comité d’entreprise ou à la DUP ou, à défaut, des délégués du personnel titulaires représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, et à l’approbation par la commission paritaire de branche. À défaut, l’avenant de révision serait réputé non écrit.
2. Procédure de révision applicable aux entreprises dépourvues de représentants du personnel ou au sein desquelles aucun élu n’a manifesté son souhait de négocier
S’agissant des entreprises dépourvues de représentants du personnel ou dans lesquelles aucun élu n’a manifesté son souhait de négocier, le a du 4° du I modifie l’article L. 2232-24 afin de permettre à une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au niveau de la branche dont dépend l’entreprise ou, à défaut, au niveau national et interprofessionnel, de mandater un salarié pour engager la procédure de révision d’un accord.
Par coordination avec le 5° du I qui autorise le salarié mandaté à négocier l’ensemble des accords d’entreprise, le b du 4° du I étend à l’ensemble des accords collectifs conclus au sein de ces entreprises les nouvelles modalités de révision par les salariés mandatés dans les conditions prévues à l’article L. 2232-24.
Lorsque la révision ne suffit pas, le code du travail prévoit deux types de procédure permettant de mettre fin à un accord : la dénonciation et la mise en cause.
Les II et III proposent d’ajuster et de sécuriser les règles applicables à ces deux dispositifs d’extinction des accords collectifs.
Aux termes de l’article L. 2261-9 du code du travail, tous les syndicats signataires, y compris ceux qui ont perdu leur représentativité entre la date de signature et celle de la dénonciation, peuvent dénoncer un accord. En outre, selon l’article L. 2261-4, les syndicats qui ont adhéré à un accord après sa signature peuvent également le dénoncer.
L’accord doit fixer un préavis avant que la dénonciation devienne effective ; par défaut, la durée de ce préavis est de trois mois. En outre, la dénonciation doit impérativement être accompagnée d’un projet de substitution, sous peine de nullité (11).
Aux termes de l’article L. 2261-10 du code du travail, lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou salariés, la négociation de l’accord ayant vocation à se substituer à l’accord dénoncé s’engage, à la demande d’une des parties intéressées, dans les trois mois suivant la date effective de la dénonciation.
Pendant toute la période de préavis, ainsi que dans l’intervalle entre la déclaration de dénonciation et la négociation d’un accord de substitution, l’accord dénoncé continue à s’appliquer provisoirement, ce qui ne paraît pas optimal compte tenu de l’insatisfaction suscitée par les clauses de cet accord.
Pour répondre à cette difficulté, le 1° du II propose donc de modifier le deuxième alinéa de l’article L. 2261-10 pour permettre aux différentes parties prenantes d’engager la négociation en vue de conclure un accord de substitution dès le début du préavis mentionné à l’article L. 2261-9, fixé par défaut à trois mois.
Selon les informations transmises au rapporteur, il appartiendra aux parties de définir les conditions d’entrée en vigueur de l’accord de substitution. Si elles le prévoient, cet accord peut entrer en vigueur avant l’expiration du délai de préavis.
Aux termes de l’article L. 2261-14 du code du travail, lorsqu’une entreprise ou l’un de ses établissements est transféré en raison d’une fusion, d’une cession, d’une scission ou d’un changement d’activité, l’application d’une convention ou d’un accord est de facto mise en cause.
En principe, une nouvelle négociation visant soit à adapter les dispositions conventionnelles applicables jusqu’alors, soit à élaborer de nouvelles stipulations, doit être engagée dans les trois mois suivant la mise en cause effective des accords collectifs, dans la mesure où aucune disposition du code du travail ne prévoit la possibilité d’engager les négociations en amont de la restructuration.
La jurisprudence de la Cour de cassation a toutefois progressivement admis que dans des cas de fusion d’entreprise, les négociations puissent être engagées avant que survienne l’évènement générateur de la mise en cause de l’accord. Dans un arrêt du 13 octobre 2010 (12), la Cour de cassation a admis que les négociations puissent être conduites en amont de la mise en cause, tout en soulignant que la signature de l’accord de substitution ne pouvait intervenir qu’après la mise en cause effective. Un arrêt du 28 octobre 2015 (13) a franchi une étape supplémentaire en qualifiant « d’accord de substitution » un accord conclu avant l’opération provoquant la mise en cause. La jurisprudence considère que, lorsque les organisations syndicales sont les mêmes dans l’entreprise restructurée et dans l’entreprise d’accueil, l’employeur n’est pas tenu de rouvrir les négociations après la mise en cause, l’accord négocié faisant office d’accord de substitution.
Attendre la mise en cause effective de l’accord avant d’engager le processus de négociation paraît en effet inadapté, eu égard aux demandes des partenaires sociaux eux-mêmes, qui souhaiteraient pouvoir s’engager dans une négociation anticipée dès qu’un projet de restructuration est envisagé, afin de sécuriser au plus vite les normes conventionnelles applicables aux salariés de l’entreprise ayant vocation à être restructurée. L’étude d’impact souligne en effet que les services du ministère du travail ont régulièrement vent de ces négociations anticipées, or les accords ainsi conclus s’exposent à un risque juridique certain à défaut de clause exprès du droit du travail l’autorisant.
L’extension de la jurisprudence de la Cour de cassation à l’ensemble des cas de restructuration devrait permettre à la fois de sécuriser juridiquement les pratiques existantes et d’améliorer la couverture conventionnelle des salariés des entreprises affectées par une restructuration.
Le 2° du III de cet article propose ainsi d’encourager et de sécuriser le recours à ces négociations d’anticipation, grâce à deux types d’accords de substitution.
Le premier type d’accord de substitution est mentionné à l’article L. 2261-14-1-1 créé par le 2° du III. C’est un accord dit « de transition », selon l’expression empruntée au professeur Jean-François Cesaro, auteur d’un rapport relatif au droit du renouvellement et de l’extinction des conventions et accords collectifs de travail (14).
Cet accord a vocation à assurer la transition avec les normes conventionnelles applicables à l’entreprise d’accueil ; il ne s’applique donc qu’aux salariés de l’entreprise dont la convention ou l’accord est susceptible d’être mis en cause en raison d’un projet de fusion, de cession, de scission ou de « toute autre modification juridique » ayant pour effet la mise en cause de l’accord.
Les salariés de l’entreprise d’accueil n’étant pas concernés par cet accord, seuls les employeurs des deux entreprises – l’entreprise s’apprêtant à être restructurée et l’entreprise d’accueil − ainsi que les organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise s’apprêtant à être restructurée peuvent négocier et conclure cet accord de substitution.
Compte tenu de son caractère transitoire, cet accord a une durée de vie déterminée et limitée : le second alinéa de l’article L. 2261-14-2 précise que sa durée ne peut excéder trois ans. En outre, son entrée en vigueur est conditionnée à la réalisation de l’opération de restructuration.
L’objectif poursuivi par ce type d’accord est à la fois d’opérer un rapprochement entre les stipulations de l’accord mis en cause et celles en vigueur dans l’entreprise d’accueil, afin de les rendre dans la mesure du possible compatibles, et bien évidemment de sécuriser la période transitoire pour les salariés.
Le second type d’accord de substitution, décrit à l’article L. 2261-14-3 également créé par le 2° du III, est dit « d’adaptation », c’est-à-dire qu’il a vocation à harmoniser les normes conventionnelles applicables non seulement aux salariés de l’entreprise appelée à être restructurée, mais aussi aux salariés de l’entreprise d’accueil.
L’accord d’adaptation se substitue donc à l’accord mis en cause dans l’entreprise restructurée, mais il révise, dans le même temps, les accords ou conventions applicables dans l’entreprise d’accueil, de telle manière qu’un seul statut s’applique finalement à l’ensemble des salariés des deux entreprises. Contrairement à l’accord de transition, l’accord d’adaptation peut donc avoir une durée de vie supérieure à trois ans.
Eu égard aux conséquences de cet accord à la fois dans l’entreprise restructurée et dans l’entreprise d’accueil, les employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives des deux entreprises ou des établissements concernés sont invités à négocier cet accord d’adaptation.
Les conditions de validité de ces deux types d’accord de substitution sont les conditions de validité de droit commun des accords d’entreprise ou d’établissement précisées respectivement aux articles L. 2232-12 et L. 2232-13, dans leur rédaction issue de l’article 10 de ce projet de loi.
Ainsi, à compter de la promulgation de la loi, les accords de transition devront être approuvés par des organisations syndicales représentatives à hauteur de 30 % dans l’entreprise ou l’établissement ayant vocation à être restructuré. À compter du 1er septembre 2019 ou dans un délai d’un an à compter de la remise du rapport de la commission de refondation du code du travail mentionnée à l’article 1er de ce projet de loi, l’accord devra être approuvé dans les mêmes conditions mais à la majorité. À défaut d’accord majoritaire et dans l’hypothèse où les organisations syndicales de salariés précitées ont obtenu plus de 30 % des suffrages, les employeurs pourront organiser une consultation des salariés de l’entreprise ou de l’établissement ayant vocation à être restructuré dans les conditions prévues aux articles L. 2232-12 et L. 2232-13, afin de valider l’accord à la majorité.
La même règle s’applique aux accords d’adaptation, dont la validité sera conditionnée dans un premier temps à leur signature par 30 % des organisations syndicales de salariés représentatives sur le périmètre de l’ensemble des entreprises ou établissements concernés par le projet de restructuration, y compris l’entreprise d’accueil. À compter de la généralisation des accords majoritaires prévue à l’article 10 de ce projet de loi, les accords devront être validés à la majorité et, à défaut d’accord majoritaire et dans l’hypothèse où les organisations syndicales de salariés précitées ont obtenu plus de 30 % des suffrages, les employeurs pourront organiser une consultation des salariés de l’ensemble des entreprises concernées, y compris ceux de l’entreprise d’accueil, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-12 et L. 2232-13, afin de valider l’accord à la majorité.
Afin d’éviter tout vide juridique dans l’intervalle entre la dénonciation ou la mise en cause de l’accord et l’entrée en vigueur de l’accord ou de la convention qui s’y substitue, les articles L. 2261-13 et L. 2261-14 du code du travail maintiennent, pour les salariés des entreprises concernées, les avantages individuels acquis en application de la convention ou de l’accord, dans un délai maximal d’un an à compter de l’expiration du préavis, sauf clause prévoyant une durée supérieure.
Si, à l’expiration de ce délai dit de « survie » de l’accord, aucun accord n’est venu se substituer à l’accord dénoncé, la convention ou l’accord collectif cesse alors de s’appliquer. Dans cette hypothèse, seuls les avantages acquis à titre individuel sont alors maintenus. Selon le professeur Cesaro, ce dispositif entend « prévenir un vide conventionnel qui se traduirait par une extinction brutale des avantages que les salariés retiraient des conventions collectives ».
Le principe des avantages individuels acquis est relativement consensuel, puisqu’il vise à assurer aux salariés une certaine stabilité de leurs droits. En revanche, la mise en œuvre pratique de ces avantages, bien plus complexe compte tenu de l’imprécision des contours de cette notion, appelle de nécessaires évolutions.
Les avantages individuels acquis sont intégrés au contrat de travail, ce qui signifie que l’employeur ne peut procéder à une modification unilatérale du contrat de travail supprimant un avantage individuel acquis sans l’accord du salarié. La délimitation du périmètre des avantages individuels acquis est donc cruciale. Or, en l’absence de définition dans le code du travail, cette notion s’avère particulièrement difficile à appréhender.
Historiquement, la notion d’avantages individuels a fait son apparition dans le code du travail à l’occasion des lois dites « Auroux » de 1982.
M. Jean Auroux, alors ministre du Travail, en avait proposé la définition suivante : « on appelle avantages individuels des éléments comme le salaire, le congé d’ancienneté, les primes d’ancienneté qui sont intégrés au contrat de travail et qui, à ce titre, ont été acquis, utilisés ou perçus par le salarié ».
Par opposition, les avantages dits collectifs sont, selon M. Auroux, « des éléments un peu virtuels, mais qui ont un caractère plus général, tels que, par exemple la durée du travail, les niveaux d’indemnité de licenciement, les primes de départ en retraite, les dispositions à l’égard de la maladie, qui concernent – avec des modalités variables – l’ensemble des membres de la collectivité de travail ».
Cette définition des avantages individuels acquis − ni aucune autre d’ailleurs − n’a jamais été introduite dans le code du travail. Or la distinction entre les avantages individuels et les avantages collectifs est souvent malaisée, comme en témoigne l’abondant contentieux sur ce sujet.
La Cour de cassation a avancé, dans un arrêt du 13 mars 2001, une nouvelle définition de l’avantage individuel acquis au sens de l’article L. 2261-13 du code du travail : il s’agit de l’avantage « qui, au jour de la dénonciation de la convention ou de l’accord collectif, procurait au salarié une rémunération ou un droit dont il bénéficiait à titre personnel et qui correspondait à un droit déjà ouvert et non simplement éventuel » (15). Mais en pratique, la notion fluctue au rythme des cas d’espèce et c’est donc bien souvent au juge qu’il revient de définir ce qui relève ou non d’un avantage individuel acquis dans le contrat de travail du salarié.
Certaines matières telles que la rémunération font l’objet d’une jurisprudence relativement constante de la Cour de cassation. À l’inverse, l’intégration des jours de congés ou des temps de pause dans les avantages individuels acquis est particulièrement discutée : par exemple, si l’octroi de jours supplémentaires de congés a pu être considéré comme un avantage individuel acquis devant être intégré au contrat de travail (16), en revanche, des jours de repos supplémentaires accordés par un accord collectif dénoncé, en sus de ceux déjà inclus dans une convention de forfait en jours, n’ont pas été considérés comme un avantage individuel acquis (17) .
De même, le caractère « acquis » ou non d’un droit est également sujet à interprétation : la Cour de cassation a ainsi considéré que lorsque le bénéfice d’un avantage est lié à la naissance d’un enfant, il ne peut être maintenu au titre d’avantage individuel acquis pour un enfant né au terme du délai d’un an après la dénonciation de l’accord (18).
Le flou, voire le « mystère » (19) qui entoure la notion d’avantages individuels acquis est donc une source d’insécurité pour les entreprises et pour les salariés. Elle est également une source d’inégalité entre les salariés, certains ignorant tout de leur droit au maintien d’avantages individuels acquis. Le professeur Cesaro souligne également que les avantages individuels acquis sont susceptibles de réduire le champ de la négociation collective « puisque par définition, ce qui est acquis n’est plus un sujet de discussion ».
Afin de clarifier les effets de la dénonciation et de préciser ce qui doit être maintenu dans le contrat de travail du salarié, le 2° du II et le 1° du III proposent de substituer à la notion d’ « avantages individuels acquis » celle de « rémunération perçue » :
− s’agissant de la dénonciation, le 2° du II modifie l’intitulé de la sous-section 4 de la section 5 du chapitre Ier du titre VI du livre II de la deuxième partie du code du travail, et propose une rédaction globale de l’article L. 2261-13 ;
− s’agissant de la mise en cause de l’accord ou de la convention, une nouvelle rédaction de l’article L. 2261-14 est proposée par le 1° du III.
Le montant de la rémunération perçue en application de la convention ou de l’accord dénoncé ou mis en cause « ne peut être inférieur à la rémunération versée lors des douze derniers mois », sous réserve que la durée de travail soit inchangée.
La rémunération s’entend au sens des dispositions de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, c’est-à-dire « toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l’entremise d’un tiers à titre de pourboire ».
De même, « la compensation salariale d’une perte de rémunération induite par une mesure de réduction du temps de travail est également considérée comme une rémunération ». Toutefois, ni l’intéressement, ni les stock-options, mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 242-1, ne sont retenus dans la définition de la rémunération.
Cette définition exclut donc a priori l’ensemble des avantages individuels acquis non liés à la rémunération, tels que les avantages liés aux congés ou les stipulations conventionnelles relatives aux classifications et à la qualification des salariés.
Par ailleurs, lorsqu’une stipulation prévoyant qu’une convention ou un accord dénoncé continue à produire ses effets pendant un délai supérieur à un an, il est précisé que cette clause s’applique, à compter de l’expiration de ce délai d’un an, seulement en l’absence d’un accord ou d’une convention de substitution.
Ces dispositions ne s’appliquent toutefois qu’aux accords et conventions conclus après l’entrée en vigueur de la loi.
Si, en apparence, la notion de « rémunération perçue » est bien plus facile à appréhender que celle d’« avantages individuels acquis », il subsiste encore, à ce stade de l’examen du texte, plusieurs zones d’ombre. Ceci pour une raison simple : en l’état du droit, toutes les composantes de la rémunération ne sont pas des avantages individuels acquis. En d’autres termes, certains éléments de la rémunération qui n’étaient pas maintenus avant ce projet de loi car ils ne constituaient pas des avantages individuels acquis pourraient l’être après son entrée en vigueur et inversement, les avantages individuels acquis non liés expressément à la rémunération disparaîtront.
De l’avis du professeur Cesaro, le maintien de la rémunération plutôt que celui des avantages individuels acquis pourrait se révéler tantôt bénéfique pour le salarié, en raison de l’incorporation systématique de toutes les sommes conventionnelles anciennement versées, alors qu’aujourd’hui, « le juge est conduit à trier parmi les sources de rémunération pour déterminer celles qui seront maintenues et celles qui ne le seront pas » ; à l’inverse, la disparition de certains avantages acquis pourrait désavantager d’autres salariés par rapport au droit existant.
La prise en compte des éléments de rémunération variable liés à la performance illustre bien cette affirmation : dans son rapport, le professeur Cesaro explique que « le montant moyen, dans la période de référence, sera maintenu, transformant la nature juridique même de l’avantage ». En fonction du niveau de la rémunération variable sur la période considérée – soit douze mois –, le maintien du montant moyen de cette rémunération « risque de défavoriser ou de favoriser artificiellement ceux qui, dans la période de référence, ont peu ou beaucoup retiré de leur ancienne convention collective ».
Il convient de souligner ensuite que certains doutes subsistent quant à la portée exacte de la notion de « rémunération perçue ».
Le rapport de M. Cesaro relève par exemple qu’en droit du travail, les règles relatives à l’occupation du temps sont très fréquemment liées à des questions de rémunération. Or, la définition de la rémunération retenue ne permet pas de déterminer si les niveaux de rémunération correspondant à un certain temps devront être maintenus ou non : la rémunération d’un temps de pause, par exemple, avait été considérée comme pouvant constituer un avantage individuel acquis (20). Serait-elle maintenue avec la nouvelle définition ? En l’attente d’éléments de réponse de la part du Gouvernement, la réponse ne peut encore être affirmée avec certitude.
Ensuite, les modalités pratiques de calcul de la rémunération ne sont abordées ni dans le projet de loi, ni dans l’étude d’impact. De ce fait, certaines questions relatives à la mise en place de ces modalités restent en suspens : M. Cesaro soulignait par exemple dans son rapport qu’il conviendrait de traiter les périodes de suspension du contrat de travail, « ce qui imposera de procéder à des « reconstitutions » ». À défaut de disposer de ces éléments, le professeur Cesaro estime que « la détermination de l’assiette des sommes devant être prises en considération pour le calcul de l’indemnité pour le calcul de l’indemnité risque d’être une source de contentieux ».
Néanmoins, le président de la chambre sociale de la Cour de cassation a indiqué lors de son audition par le rapporteur qu’en dépit du risque contentieux, qu’il n’est pas possible de nier, la réponse apportée le cas échéant par le juge serait certainement bien moins obscure que celle relative à la détermination d’un avantage individuel acquis, compte tenu, comme on l’a vu, de l’extrême instabilité de cette notion.
Au regard de cette analyse, le rapporteur est conscient de la nécessité de favoriser la notion de « rémunération perçue » qui, même si elle soulève encore quelques incertitudes, est bien plus sécurisante à la fois pour les employeurs et pour les salariés que celle d’avantages individuels acquis. Le rapporteur sera toutefois vigilant sur les modalités de calcul de la rémunération perçue, compte tenu des réponses qu’elles appellent encore à ce stade.
*
La commission des affaires sociales a adopté onze amendements rédactionnels à cet article.
*
La Commission est saisie de l’amendement AS687 de Mme Jacqueline Fraysse.
Mme Jacqueline Fraysse. L’article 8 contient au moins deux dispositions constituant à nos yeux des régressions des droits des salariés.
D’abord, la possibilité de mandatement des salariés est étendue à tous les types d’accords dans les entreprises dépourvues de délégué syndical. Actuellement, ce mode de négociation dérogatoire n’est possible que dans les domaines où la loi rend l’accord d’entreprise obligatoire pour appliquer une mesure, par exemple en matière d’intéressement ou de forfait jours. L’article 8 va donc contribuer à réduire encore un peu plus la place des délégués syndicaux, en leur retirant le monopole dont ils disposent pour négocier, sans résoudre le problème de la présence syndicale dans les entreprises – je rappelle que, à l’heure actuelle, deux tiers des établissements sont dépourvus de délégués syndicaux.
Alors que le projet de loi supprime le principe de faveur en rendant supplétive la convention collective de branche, le mandatement syndical risque d’entraîner une rupture d’égalité entre les entreprises d’un même secteur d’activité et la précarisation des conditions de travail des salariés concernés par cette négociation dérogatoire.
Qui plus est, l’article 8 remet en cause un principe essentiel du droit du travail : celui des avantages individuels acquis, en vertu duquel les salariés non couverts par un accord conservent ces avantages, c’est-à-dire non seulement leur salaire, mais aussi les droits relatifs aux congés ou aux conditions de travail : cela va bien plus loin que le seul maintien de la rémunération versée au cours des douze derniers mois.
Autant de raisons pour lesquelles nous demandons la suppression de cet article.
M. le rapporteur. Sur le premier point, je ne partage pas du tout votre analyse. Vous ne pouvez pas dire à la fois que deux tiers des entreprises sont sans délégué syndical et que le mandatement, qui permet justement aux organisations syndicales d’accompagner les salariés lorsqu’il s’agit d’engager des négociations, leur serait défavorable ! Assurément, on peut regretter que les syndicats ne se soient pas davantage implantés dans les petites entreprises au cours de notre histoire. Mais le mandatement vise justement à leur permettre d’accompagner les négociateurs, notamment les salariés des petites entreprises. C’est précisément parce que la relation de subordination est une réalité dans l’entreprise que l’accompagnement des salariés, donc le mandatement, contribue à préserver les garanties dont ils bénéficient, ce qui est notre objectif commun.
Pour ce qui est de votre second argument, j’avais à l’origine le même point de vue que vous, mais les auditions de chercheurs et de juristes que j’ai menées m’ont fait changer d’avis. Tous considèrent en effet que les avantages individuels acquis correspondent à une notion très floue, plutôt favorable aux salariés dans certains cas, aux entreprises dans d’autres ; il en ressort au total qu’elle n’est sécurisante pour personne. Le professeur Cesaro, qui a beaucoup travaillé sur cette question, a lui-même indiqué que le maintien de la rémunération pourrait dans bien des situations être plus avantageux pour les salariés que le maintien des avantages individuels acquis. En tout état de cause, il permettra à chaque salarié de savoir plus précisément ce à quoi il peut prétendre en cas de transfert de son contrat de travail.
J’émets donc un avis défavorable à votre amendement.
Mme Isabelle Le Callennec. Avec le mandatement, l’article 8 touche à un point dur, un sujet de forte divergence entre les organisations syndicales et les organisations patronales que nous avons auditionnées. Les petites et très petites entreprises notamment ne voient pas cette formule d’un bon œil. Je suis d’accord avec le rapporteur : l’exposé sommaire de l’amendement contient une contradiction. Les chefs d’entreprise, notamment de petites entreprises, nous assurent qu’ils sont tout à fait capables de négocier avec leurs salariés et qu’ils n’ont pas besoin d’une personne extérieure à l’entreprise pour cela.
M. le rapporteur. Avec le mandatement, l’interlocuteur n’est justement pas une personne extérieure à l’entreprise.
Mme Isabelle Le Callennec. Nous allons en reparler ; toujours est-il que cette forme d’accompagnement fait craindre aux employeurs l’insertion d’organisations syndicales dans l’entreprise. C’est là un point sensible et nous devons en avoir conscience.
La Commission rejette l’amendement.
Puis elle adopte successivement plusieurs amendements du rapporteur : l’amendement de précision AS908, puis les amendements rédactionnels AS798, AS799, AS800, AS801 et AS802.
Elle aborde ensuite l’amendement AS601 de M. Rémi Delatte.
M. Rémi Delatte. Nous sommes déterminés à utiliser ce texte pour assouplir et simplifier le fonctionnement de l’entreprise. C’était du reste un des objectifs du projet de loi, du moins à en croire ce que l’on nous en a dit ; surtout, c’est une exigence des entreprises, en particulier des plus petites d’entre elles, qui, en France, sont de loin les plus nombreuses.
L’amendement AS601 tend donc à supprimer le mandatement syndical pour permettre à l’entrepreneur de négocier directement les accords collectifs avec les salariés dès lors qu’il n’y a pas de délégué syndical dans l’entreprise.
M. le rapporteur. Sur ce point, un désaccord de fond nous oppose.
Certes, Mme Le Callennec dit vrai : les organisations patronales de l’artisanat et des PME sont hostiles au mandatement. Ce n’est pas nouveau : nous avons déjà eu ce débat lors de l’examen de la loi Rebsamen, à propos de l’instauration des commissions paritaires régionales interprofessionnelles (CPRI).
Je défendrai pour ma part ce que je considère comme une approche saine : personne ne nie la réalité du dialogue social dans les entreprises artisanales et dans les petites entreprises, mais il ne faut pas confondre dialogue social et capacité de négociation. Et sur ce dernier plan, le fait que les parties prenantes aient les mêmes possibilités de négociation, d’information, de formation est pour moi une garantie de la solidité des accords. Les employeurs ont derrière eux leurs organisations patronales ou leur expert-comptable, ce qui est tout à fait légitime ; de même, nous devons permettre aux salariés qui négocient, en l’absence de délégué syndical, de bénéficier de l’expertise et de l’accompagnement juridique des organisations syndicales.
Je le répète, le mandatement n’implique pas l’arrivée dans l’entreprise d’un personnel qui lui serait étranger : c’est un salarié de l’entreprise qui est mandaté par une organisation syndicale. Ne laissons donc pas penser qu’il s’agirait d’une intrusion.
Si notre objectif commun est de permettre que les négociations aient lieu, nous avons tout intérêt à ce que chaque partie ait à sa disposition tous les moyens de conclure un bon accord. Je ne saurais donc soutenir une suppression du mandatement.
Je le dis sans acrimonie : cessons de donner de l’écho à une position très souvent idéologique. Je comprends la peur des artisans et des chefs de petites entreprises, mais c’est se raconter une histoire que de voir forcément un adversaire dans l’organisation syndicale. Dans un texte qui porte sur la négociation collective, le fait que les parties prenantes disposent de tous les atouts pour négocier ne peut être que positif.
Avis défavorable.
M. Élie Aboud. C’est un vrai sujet. La première entreprise de France nous écoute. Sur quel fondement affirmez-vous, monsieur le rapporteur, que la personne mandatée n’est pas extérieure à l’entreprise ? Que se passera-t-il si, au sein de l’entreprise, aucun salarié n’accepte d’être mandaté ? Que les choses soient dites clairement…
M. le rapporteur. Dans ce cas, il n’y aura pas de mandatement. Les règles sont très claires.
M. Élie Aboud. Très bien.
Mme Isabelle Le Callennec. Monsieur le rapporteur, vous sous-entendez que nous entretenons l’idée selon laquelle les organisations syndicales, dans l’histoire de l’entreprise, joueraient systématiquement comme des freins ou des enquiquineurs. Mais voyez les images qui sont diffusées depuis plusieurs semaines. Les organisations syndicales que nous avons auditionnées sur ce texte ont des positions très diverses, elles le reconnaissent elles-mêmes, et ne partagent pas le même état d’esprit. Reste qu’elles existent et que certaines, pour des raisons historiques, ne peuvent être laissées de côté dans les négociations. Mettez-vous à la place des chefs d’entreprise : ils préfèrent avoir en face d’eux les organisations dites réformatrices, qui essaient de discuter, de contribuer à l’intérêt général. Mais toutes ne se comportent pas ainsi, il suffit d’allumer sa télévision pour le constater. Ce n’est pas une histoire que nous entretiendrions : c’est une réalité vécue sur le terrain en ce moment même. On a parlé de loyauté, d’un dialogue social apaisé : force est de constater que tout le monde n’est pas dans cet état d’esprit.
Nos collègues Arnaud Richard et Jean-Marc Germain conduisent actuellement une mission d’information sur le paritarisme dont nous attendons les conclusions avec impatience, mais il faut reconnaître que l’état d’esprit sur ce sujet n’est pas le même en France et en Allemagne. On nous invite à voter le présent texte comme si tout allait pour le mieux dans le meilleur des mondes ; ce n’est malheureusement pas le cas. Pour négocier, un chef d’entreprise préférera toujours avoir affaire à des interlocuteurs formés et soucieux de l’intérêt général.
M. Rémi Delatte. On a plusieurs fois invoqué l’équilibre de ce texte, qui vise, rappelons-le, « à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections pour les entreprises et les actifs ». Or j’ai parfois l’impression que notre rapporteur nourrit quelques soupçons quant à la capacité à négocier des petites entreprises. C’est vraiment dommage. J’ai parlé hier de confiance entre l’employeur et ses salariés ; c’est bien cette confiance qui, en règle générale, anime la vie quotidienne de l’entreprise.
Je rappelle enfin que l’amendement AS601 permet la négociation directe entre employeur et salariés mais n’empêche pas le recours au mandatement s’ils ne parviennent pas à s’entendre.
M. Michel Liebgott. Il faut trouver une solution équilibrée, qui fasse progresser le dialogue social. Toutes les organisations syndicales ne sont pas irresponsables : nombre d’entre elles souhaitent que des accords soient conclus. C’est d’ailleurs ce qui se produit dans la majorité des cas. Quant au salarié, pour prendre position au sein de l’entreprise, il doit aussi faire preuve d’un certain courage qui mérite d’être reconnu.
Assurément, notre pays n’a pas l’habitude de dialoguer, notamment dans l’entreprise. Mais nous devons faire confiance au dialogue social. C’est ce que souhaite le Gouvernement. Peut-être pourrons-nous, par voie d’amendement, améliorer encore le mandatement en le sécurisant davantage – mais nous y reviendrons.
M. le rapporteur. Au risque de heurter certains, ce sont vraiment des positions de principe qui sont en jeu. Aujourd’hui, 94 % des 36 000 accords d’entreprise conclus chaque année sont signés par les organisations syndicales, dont 80 % par la CGT – que je ne cite pas pour la stigmatiser mais parce qu’il me semble qu’il y a été fait allusion. Cessons donc de laisser penser qu’il n’y a pas de discussions dans nos entreprises ! Ces chiffres montrent au contraire qu’elles ont lieu et qu’elles fonctionnent. Dans ces 36 000 cas, il y a eu une discussion entre l’employeur et les organisations syndicales. Et l’essentiel, c’est bien qu’au bout du compte on négocie au sein de l’entreprise.
La Commission rejette l’amendement.
Puis elle aborde l’amendement AS697 de M. Alain Fauré.
M. Alain Fauré. Je propose que la désignation d’un salarié mandaté reçoive l’avis conforme de la commission mentionnée à l’article L. 23-111-1, autrement dit la commission paritaire régionale interprofessionnelle.
Nous devons tenir compte de la composition du tissu économique de notre pays : sur 3,9 millions d’entreprises, 3,8 millions sont de toutes petites entreprises. Nous venons d’entendre que 36 000 accords d’entreprise sont signés chaque année, dont 80 % par le syndicat que le rapporteur a cité. Dans les petites entreprises, les négociations sont parfois nécessaires et tous les salariés en mesure de les mener. Nous devrions les y encourager en prévoyant la désignation d’un salarié reconnu par la commission paritaire régionale interprofessionnelle, afin de soutenir la négociation. Si la décision unilatérale de l’employeur peut être inévitable dans certaines toutes petites entreprises, dans d’autres, il est utile que les salariés interviennent en étant secondés. Cela permettra d’y développer le syndicalisme. Nous avons besoin de dialogue et, pour dialoguer, il faut pouvoir s’appuyer sur des connaissances et sur des compétences.
M. le rapporteur. Je comprends votre propos, mais je ne vois pas en quoi les CPRI issues de la loi Rebsamen du 17 août 2015, qui les charge d’une mission de conseil et d’information, seraient légitimes lorsqu’il s’agit de valider ou d’invalider la désignation d’un salarié mandaté.
En outre, la procédure de désignation en serait significativement prolongée.
Enfin et surtout, comment une commission régionale pourrait-elle écarter un salarié mandaté, qui, je le rappelle, fait partie de l’entreprise ? Cela me paraît très risqué.
Pour ces raisons, et même si je comprends l’esprit de votre proposition, qui pourrait du reste rassurer sans doute une partie des employeurs, votre amendement ne me paraît pas applicable.
Avis défavorable.
L’amendement est retiré.
La Commission aborde quatre amendements identiques : les amendements AS155 de M. Lionel Tardy, AS163 de M. Gérard Cherpion, AS544 de M. Arnaud Richard et AS588 de M. Bernard Perrut.
M. Lionel Tardy. La loi sur le dialogue social votée l’été dernier permet le mandatement par une organisation syndicale d’un salarié extérieur à l’entreprise, mais qui peut aussi être totalement extérieur à la région et au secteur. Cela n’a pas vraiment de sens. Je doute de l’efficacité du mandatement dans les TPE et PME. Pourtant, vous voulez déjà étendre ce mécanisme qui vient à peine d’être adopté. Ce n’est pas souhaitable s’agissant de la négociation d’accords d’entreprise. D’où mon amendement AS155.
Mme Isabelle Le Callennec. Un mot, d’abord, à l’intention de M. le rapporteur : pour ma part, je n’ai cité aucune organisation syndicale. Je me permets simplement de vous dire que celle que vous avez mentionnée manifeste dans la rue pour demander le retrait du texte que nous examinons ! Mais je suis d’accord avec vous : sur le terrain, il y a sans doute beaucoup moins de postures, et des personnes tout à fait responsables, capables de juger au plus près de l’entreprise de ce qui est bon pour elle comme pour les salariés.
J’en viens à mon amendement AS163. La décision unilatérale de l’entreprise, lorsqu’elle est encadrée, peut être une bonne solution, à laquelle on ne fait pas suffisamment appel et qui n’est pas toujours connue dans les petites entreprises. Nous devrions insister sur cette formule au lieu d’agiter le chiffon rouge du mandatement.
M. Arnaud Richard. Je remercie Mme Le Callennec d’avoir cité la mission d’information sur le paritarisme dont je conduis les travaux avec Jean-Marc Germain. On ne peut pas me reprocher de manquer de bonne volonté lorsqu’il s’agit du dialogue social. Mais il est, me semble-t-il, beaucoup trop tôt pour en venir au mandatement dans les TPE, même si ce peut être un objectif : le dialogue social n’est pas suffisamment mûr.
Dans sa rédaction actuelle, la loi de 2015 permet, à certaines conditions, la conclusion d’accords collectifs d’entreprise dans le cadre d’un mandatement syndical, s’agissant de mesures dont la loi subordonne la mise en œuvre à un accord collectif. En pratique, le mandatement syndical est très rare : il concerne moins de 2 % des accords d’entreprise signés dans les domaines où il est déjà possible. Rien ne permet de penser que cette modalité est appelée à se développer en l’absence de volonté des salariés.
En outre, même si le mandatement syndical permet à certaines catégories d’entreprises de négocier un accord d’entreprise, ce mode dérogatoire devrait rester réservé aux mesures dont la loi subordonne la mise en œuvre à un accord collectif, afin de conserver un socle de négociation cohérent.
Enfin, et même si ce point de vue peut vous paraître très subjectif, le mandatement syndical ne permettrait pas de garantir l’égalité de traitement entre les salariés exerçant les mêmes métiers, ce qui exposerait les entreprises à une concurrence déloyale.
Le groupe de l’Union des démocrates et indépendants souhaite donc que soit conservé pour l’instant le périmètre actuel du mandatement, tout en ayant conscience que l’idéal, pour le bien du dialogue social, serait de l’étendre lorsque les parties seront mûres pour cela. D’où notre amendement AS544.
M. Bernard Perrut. Mon amendement AS588 est identique.
L’article L. 2232-24 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 17 août 2015, prévoit, sous conditions, la conclusion d’accords collectifs d’entreprise dans le cadre du mandatement syndical pour des mesures dont la mise en œuvre est subordonnée par la loi à un accord collectif.
Il convient de maintenir le périmètre actuel de la négociation ouverte au mandatement syndical et, au contraire, de ne pas l’étendre à tous les sujets relatifs au code du travail.
En effet, même si le mandatement syndical constitue un moyen ouvert à certaines catégories d’entreprises d’accéder à la négociation d’un accord d’entreprise, il n’en demeure pas moins que ce mode dérogatoire doit continuer à être réservé aux mesures dont la mise en œuvre est subordonnée par la loi à un accord collectif, afin de conserver un socle cohérent de négociation.
À défaut, en plus de l’inversion de la hiérarchie des normes entre l’accord d’entreprise et l’accord de branche, le mandatement syndical ne permettrait pas de garantir une égalité de traitement entre des salariés exerçant les mêmes métiers et exposerait les entreprises à un risque de concurrence déloyale, ce qui inquiète de très nombreux chefs d’entreprise, notamment dans les métiers de l’artisanat, du bâtiment et des travaux publics.
M. le rapporteur. À l’heure actuelle, les salariés mandatés ne peuvent négocier que sur des mesures dont la loi subordonne la mise en œuvre à un accord collectif. Or les représentants de la DGT que nous avons auditionnés nous ont eux-mêmes indiqué qu’il était impossible de définir précisément ce périmètre. Voilà pourquoi le texte permet aux salariés mandatés de négocier tous les types d’accords collectifs. Pourquoi restreindre cette possibilité si l’on veut développer la négociation collective, sachant que le mandatement permet aux salariés mandatés d’être accompagnés ? Je suis défavorable à ces amendements.
M. Gérard Cherpion. Au risque de déplaire au rapporteur, dans la première version du texte qui nous a été transmise, c’était la décision unilatérale de l’employeur qui valait. Elle a été retirée, et c’est alors seulement que le Gouvernement s’est penché sur le problème du monopole syndical en matière de négociation collective et a décidé d’étendre le périmètre du mandatement. Cette disposition marque donc un recul du Gouvernement, qui va mettre en difficulté nombre d’entreprises.
M. le rapporteur. Je considère pour ma part que les négociations qui se sont engagées depuis ont permis d’en revenir à une forme de sagesse. La sagesse, ce n’est pas la décision unilatérale de l’employeur, mais la confiance dans la négociation collective dont toutes les parties prenantes doivent être présentes. Je maintiens donc mon argumentation et mon avis défavorable.
La Commission rejette les amendements identiques.
Puis elle adopte successivement plusieurs amendements rédactionnels du rapporteur : les amendements AS803, AS909, AS804, AS805 et AS806.
Elle adopte ensuite l’article 8 modifié.
*
* *
La Commission est saisie de l’amendement AS36 de M. Patrick Hetzel.
M. Lionel Tardy. Cet amendement tend à préciser que l’égalité de rémunération est appréciée au regard de la globalité des éléments qui la composent.
M. le rapporteur. Et vous proposez d’introduire cette précision dans une partie du code du travail relative à l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes… J’imagine que la délégation aux droits des femmes sera particulièrement vigilante ! Car, en réalité, votre amendement reviendrait à vider de son sens le principe « à travail égal, salaire égal ». Prenez le cas d’une commerciale, qui percevrait une rémunération identique à son collègue masculin exerçant les mêmes fonctions, mais dans laquelle la part variable, liée à ses ventes, serait beaucoup plus importante : elle ne pourrait pas faire valoir qu’elle n’est pas traitée à égalité sur sa part fixe…
Je ne comprends vraiment pas cet amendement et j’émets un avis très défavorable.
M. Jean-Patrick Gille, président. On avait bien senti que M. Tardy l’avait défendu sans grand enthousiasme…
M. Lionel Tardy. J’en étais cosignataire, monsieur le rapporteur…
La Commission rejette l’amendement.
*
* *
Article 9
(Art. L.2232-22, L. 2322-5, L. 2323-9, L. 2323-26-1 [nouveau], L. 2323-60, L. 2325-14-1,
L. 2326-5, L. 2327-15, L. 2392-4 et L. 4616-3 du code du travail)
Ajustements relatifs au fonctionnement des instances représentatives
du personnel
Cet article propose plusieurs ajustements visant à parachever les réformes du fonctionnement des institutions représentatives du personnel (IRP) entreprises, notamment, par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques et par la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi. Il procède aux six modifications suivantes :
– l’octroi au juge judiciaire de l’intégralité de la compétence en matière préélectorale ;
– l’encadrement des conditions de validité d’un accord d’entreprise ou d’établissement ;
– l’extension de la possibilité de recourir à la visioconférence aux réunions de la délégation unique du personnel ;
– la clarification des règles de communication d’informations aux institutions représentatives du personnel ;
– la consolidation de la définition du franchissement du seuil de trois cents salariés ;
– la précision du périmètre des établissements distincts et de l’ordre de consultation en cas de double consultation.
Toute entreprise de plus de 11 salariés doit organiser à échéance régulière des élections professionnelles : élection des délégués du personnel pour les entreprises d’au moins 11 salariés, élection des membres du comité d’entreprise pour les entreprises d’au moins 50 salariés.
L’organisation de ces élections professionnelles relève de la compétence de l’employeur, qui doit inviter toutes les organisations syndicales remplissant les conditions fixées respectivement aux articles L. 2314-3 pour les délégués du personnel et L. 2324-4 pour les membres du comité d’entreprise, à négocier le protocole préélectoral et à établir leurs listes de candidats.
La négociation du protocole d’accord préélectoral
Lors de la négociation du protocole d’accord préélectoral, les organisations syndicales doivent trouver un accord sur les clauses suivantes :
− La répartition du personnel dans les collèges électoraux (art. L. 2314-11 pour les délégués du personnel et art. L. 2324-13 pour les membres du comité d’entreprise) ;
− La répartition des sièges entre les différentes catégories de personnels (art. L. 2314-11 et art. L. 2324-13) ;
− La division de l’entreprise en établissements distincts (art. L. 2314-31 et L. 2322-5) ;
− Les voies et moyens permettant d’atteindre une représentation équilibrée des femmes et des hommes sur les listes de candidats (art. L. 2324-6) ;
− Les modalités d’organisation et de déroulement des opérations électorales, telles que la date de dépôt des candidatures, le lieu du déroulement du scrutin, les règles de vote, la composition du bureau de vote, etc.
Jusqu’à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, en cas de contestation survenant au cours des négociations préalables à la conclusion du protocole d’accord préélectoral, le litige était tranché, en fonction de sa nature :
– soit par le juge judiciaire, pour le contentieux de l’électorat, de l’éligibilité et de la régularité des opérations électorales ;
– soit, à titre résiduel, par l’autorité administrative, pour trancher les différents points de désaccord du protocole électoral. En l’absence d’accord entre l’employeur et les organisations syndicales sur les différentes clauses obligatoires de négociation du protocole, il revenait ainsi au Directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (Direccte) de déterminer le périmètre de déroulement des élections, la répartition des électeurs ou la répartition des sièges entre les différents collèges. Les litiges liés aux décisions du Direccte faisaient l’objet d’un recours devant le juge administratif.
Cette répartition des compétences était parfois devenue source de complexité et de confusion pour les entreprises : par exemple, seul le juge judiciaire était compétent pour statuer sur une demande de modification de la composition des collèges par catégorie, alors que la répartition du personnel entre les collèges relevait de la compétence exclusive de l’autorité administrative et relevait donc, en cas de recours, de la compétence du juge administratif.
La loi du 6 août 2015 précitée a en conséquence unifié les compétences en matière d’élections professionnelles :
– en reconnaissant la compétence intégrale de l’autorité administrative pour l’organisation des élections professionnelles, d’une part ;
– en confiant au juge judiciaire l’ensemble du contentieux relatif aux décisions de l’autorité administrative, d’autre part.
Si la volonté du législateur était bel et bien de confier au juge judiciaire l’intégralité de la compétence en matière de règlement des différends liés aux élections professionnelles dans les entreprises, l’article L. 2322-5 du code du travail, qui donne compétence au Direccte pour reconnaître le caractère d’établissement distinct pour l’élection du comité d’établissement, n’a cependant pas été modifié.
Le I du présent article propose donc de compléter l’article L. 2322-5 afin de confier au juge judiciaire le contentieux des différends relatifs aux décisions de l’autorité administrative liées à la détermination du nombre d’établissements distincts.
2. Conditions de validité des accords d’entreprise ou d’établissement par les commissions paritaires de validation
Aux termes de l’article L. 2232-22 du code du travail, lorsqu’une entreprise ne dispose pas de la présence d’un délégué syndical, les accords d’entreprise ou d’établissement peuvent être conclus par des membres titulaires élus au comité d’entreprise ou, à défaut, par des délégués du personnel titulaires (21), à deux conditions :
– ces représentants doivent représenter la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles ;
– en outre, pour être validés, les accords doivent être approuvés par la commission paritaire de branche, dont le rôle est de contrôler que l’accord n’enfreint pas les dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles applicables.
Avant la loi du 17 août 2015 précitée, le code du travail prévoyait un délai de quatre mois au-delà duquel les accords étaient réputés approuvés, à défaut d’avis exprès de la commission. Ce délai d’acceptation tacite a été supprimé par la loi du 17 août 2015. L’étude d’impact du présent projet de loi précise que la suppression de ce délai peut s’avérer « bloquante ».
Pour éviter que la validation de l’accord ne soit retardée du fait des délais d’examen imputables à la commission paritaire de branche, le II propose donc d’ajouter un alinéa à l’article L. 2232-22 indiquant que si la commission ne se prononce pas dans les quatre mois suivant la transmission de l’accord, celui-ci est réputé avoir été validé.
Cette disposition permettra aux commissions paritaires de se concentrer sur les accords susceptibles d’entrer en contradiction avec les normes existantes, sans paralyser l’entrée en vigueur des accords qui ne posent manifestement pas de difficultés à cet égard.
3. Recours possible à la visioconférence pour les réunions de la délégation unique du personnel (DUP)
● L’article 17 de la loi du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi a consacré la possibilité pour l’employeur de recourir à un dispositif de visioconférence pour tenir les réunions avec chacune des institutions représentatives du personnel, c’est-à-dire : le comité d’entreprise (article L. 2325-5-1), le comité central d’entreprise (article L. 2327-13-1), le comité de groupe (article L. 2334-2), le comité d’entreprise européen (article L. 2341-12) et le comité de la société européenne (article L. 2353-27-1) (22).
Les dispositifs de visioconférence visent à simplifier l’organisation de certaines réunions, en particulier celles des grandes instances réunissant des membres qui peuvent être très éloignés géographiquement, telles que les réunions du comité d’entreprise européen.
● La loi du 17 août 2015 a également revu les conditions de mise en place et de fonctionnement de la délégation unique du personnel (DUP). Tout employeur d’une entreprise de moins de 300 salariés peut ainsi mettre en place, par décision unilatérale, une DUP réunissant les délégués du personnel, les membres du comité d’entreprise et du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), sous réserve de les avoir consultés au préalable.
Dans le cadre de la DUP, les délégués du personnel, le comité d’entreprise et le CHSCT conservent leurs attributions ainsi que leurs règles de fonctionnement respectives, à l’exception des adaptations prévues par l’article L. 2326-5 du code du travail, qui concernent notamment l’échéance des réunions à l’initiative de l’employeur, la désignation d’un secrétaire et d’un secrétaire adjoint ainsi que l’établissement conjoint de l’ordre du jour par l’employeur et le secrétaire de la DUP.
Alors que la loi du 17 août 2015 a sécurisé le recours à la visioconférence respectivement pour les réunions du comité d’entreprise et du CHSCT, aucune disposition n’a prévu expressément le recours à la visioconférence pour les réunions de la DUP. Or, les réunions de cette instance peuvent être soumises aux mêmes contraintes d’éloignement géographique de ses membres que le CHSCT ou le comité d’entreprise pris indépendamment.
C’est pourquoi le III de l’article 11 propose de modifier l’article L. 2326-5 afin de préciser que les réunions de la délégation peuvent également recourir aux dispositifs de visioconférence.
Cette possibilité est encadrée dans les mêmes conditions que celles mentionnées à l’article L. 2325-5-1 du même code s’agissant des réunions du comité d’entreprise :
– en premier lieu, le recours à la visioconférence pour les réunions de la DUP doit être autorisé par accord entre l’employeur et les membres de la délégation. En l’absence d’accord, ce recours est limité à trois réunions par année civile. Cette limitation du nombre de réunions tenues par visioconférence, qui avait été ajoutée à l’initiative du rapporteur de la commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale lors des débats en première lecture sur le projet de loi relatif au dialogue social et à l’emploi, vise à éviter que le recours à la visioconférence soit systématique, afin de laisser aux membres des instances représentatives la possibilité de se rencontrer physiquement et d’échanger de manière directe ;
– en second lieu, un décret doit déterminer les conditions dans lesquelles le comité peut procéder à un vote à bulletin secret lorsqu’une réunion se tient en visioconférence.
Le III précise en outre que les réunions de la délégation peuvent recourir à la visioconférence « y compris lorsque l’ordre du jour comporte des points relevant uniquement des attributions des délégués du personnel », précision justifiée par l’absence de dispositions existantes permettant le recours à la visioconférence par les délégués du personnel du fait de l’absence de réunion formelle entre ceux-ci et l’employeur.
Le X précise enfin que ces nouvelles dispositions sont également applicables aux entreprises dans lesquelles l’employeur a décidé le maintien de la délégation unique du personnel dans les conditions antérieures à l’entrée en vigueur de l’article 13 de la loi du 17 août 2015.
a. Communication au CHSCT des informations et rapports contenus dans la base de données économiques et sociales
Depuis le 14 juin 2014, toutes les entreprises d’au moins 50 salariés doivent mettre en place la base de données économiques et sociales prévue à l’article L. 2323-8 du code du travail. Mise en place au niveau de l’entreprise et régulièrement mise à jour, cette base de données vise à rationaliser et à regrouper les informations obligatoirement transmises aux instances représentatives du personnel.
La loi du 17 août 2015 précitée a considérablement renforcé la portée de cette base de données, en faisant d’elle un élément clé de la procédure d’information-consultation du comité d’entreprise : outre la mise à disposition des informations nécessaires aux consultations annuelles du comité d’entreprise, la base de données doit également donner une vision claire et globale de la formation et de la répartition de la valeur créée par l’activité de l’entreprise. Elle doit également faciliter l’accès à l’ensemble des informations communiquées de manière récurrente aux membres du comité d’entreprise et aux membres du CHSCT.
L’article L. 2323-9 précise que la mise à disposition des éléments d’information transmis de manière récurrente au comité d’entreprise et au CHSCT au sein de la base de données « vaut communication des rapports et informations » au comité d’entreprise.
Le IV propose de préciser que cette mise à disposition vaut également communication des rapports et informations au CHSCT, corrigeant ainsi un oubli.
L’article L. 2323-60 prévoit l’information trimestrielle du comité d’entreprise dans les entreprises de plus de 300 salariés sur l’évolution générale des commandes et de la situation financière de l’entreprise, les éventuels retards de paiement de cotisations sociales par l’entreprise, ainsi que sur le nombre de contrats de mission conclus avec une entreprise de travail temporaire.
Le VI propose de remplacer la communication de ces informations par leur mise à disposition au sein de la base de données économiques et sociales mentionnée à l’article L. 2323-8.
Toute entreprise de plus de cinquante salariés doit disposer de délégués du personnel, d’un comité d’entreprise et d’un comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT).
Dans les entreprises d’au moins trois cents salariés, les attributions du comité d’entreprise sont renforcées :
– dans le cadre de la consultation annuelle sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi, l’employeur doit mettre à la disposition du comité d’entreprise l’ensemble des informations relatives à cette consultation (article L. 2323-15) ainsi que les données relatives au bilan social, document qui doit impérativement accompagner la consultation lorsque l’entreprise compte plus de trois cents salariés (article L. 2323-22) ;
– par ailleurs, chaque trimestre, l’employeur d’une entreprise de plus de trois cents salariés doit communiquer au comité d’entreprise des informations sur l’évolution générale des commandes, les éventuels retards de paiement de cotisations sociales ou encore le nombre de contrats de mission conclus avec une entreprise de travail temporaire (article L. 2323-60).
Le franchissement du seuil de trois cents salariés entraîne également des modifications du fonctionnement du comité d’entreprise, qui doit impérativement créer en son sein une commission de la formation (article L. 2325-26), une commission d’information et d’aide au logement (article L. 2325-27) ainsi qu’une commission de l’égalité professionnelle (article L. 2325-34). Il peut également décider de recourir à un expert technique (article L. 2325-38).
Afin de lever toute ambigüité sur les modalités de prise en compte du franchissement du seuil de trois cents salariés justifiant la mise en place de ces attributions complémentaires pour le comité d’entreprise, le V propose d’étendre la définition du franchissement de ce seuil, qui ne figure en l’état du droit qu’à l’article L. 2325-14-1 relatif à la périodicité des réunions du comité d’entreprise, à l’ensemble des chapitres III et V du titre II du livre III de la deuxième partie du code du travail, relatifs respectivement aux attributions et au fonctionnement du comité d’entreprise :
– le 1° du V crée un article L. 2323-26-1 qui dispose que le seuil de trois cents salariés mentionné au chapitre III est réputé franchi « lorsque l’effectif de l’entreprise dépasse ce seuil pendant douze mois », dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État. Il est précisé qu’à compter du franchissement de ce seuil, l’employeur dispose d’un délai d’un an pour se conformer intégralement aux obligations d’information du comité d’entreprise qui en découlent ;
– le 2° du V modifie l’article L. 2325-14-1 afin d’étendre cette définition à l’ensemble du chapitre V.
Le IX vise à permettre à l’accord de regroupement des institutions représentatives du personnel de déterminer le nombre et le périmètre des établissements distincts pour les élections de l’instance unifiée, en lieu et place du protocole d’accord préélectoral.
L’établissement distinct correspond à une unité d’exploitation ou de production géographiquement et structurellement individualisée, mais dépendante d’une entreprise.
La division d’une entreprise en établissements distincts a des conséquences sur l’organisation des élections des représentants du personnel : le protocole préélectoral doit en effet prévoir la division de l’entreprise en établissements distincts, c’est-à-dire qu’il doit non seulement reconnaître le caractère d’établissement distinct, mais également le nombre d’établissements, leur périmètre et la répartition des sièges entre les différents établissements et les différentes catégories d’emploi, tant pour l’élection des délégués du personnel que pour celle des membres du comité d’entreprise ou du comité central d’entreprise.
À défaut d’accord, le code du travail renvoie la détermination du périmètre et du nombre d’établissements distincts à l’arbitrage de l’autorité administrative, à la condition qu’une organisation syndicale, au moins, ait répondu à l’invitation à négocier de l’employeur − dans le cas contraire, l’employeur doit procéder de lui-même au découpage de l’entreprise en établissements distincts.
Or ces règles ne tiennent pas compte de la possibilité d’unifier les différentes instances représentatives du personnel pour les entreprises de plus de trois cents salariés, qui est désormais possible depuis l’entrée en vigueur de la loi du 17 août 2015.
En effet, l’article 14 de cette loi a autorisé le regroupement des instances représentatives du personnel dans les entreprises de plus de trois cents salariés. Sous réserve d’un accord majoritaire, ces entreprises peuvent ainsi regrouper tout ou partie des instances représentatives du personnel, c’est-à-dire les délégués du personnel, le comité d’entreprise et le CHSCT. Cette instance unifiée a vocation à exercer l’ensemble des attributions des instances auxquelles elle se substitue.
Si l’article 14 prévoit que les règles relatives à la composition et à l’élection de l’instance unifiée doivent être définies par l’accord d’entreprise ou d’établissement qui initie le regroupement de deux ou trois des instances représentatives du personnel (article L. 2391-1), il ne mentionne nullement la définition du périmètre des établissements distincts.
Cette omission peut se révéler problématique dans l’hypothèse où deux instances représentatives ne fixeraient pas le même nombre d’établissements distincts ou, plus vraisemblablement, ne répartiraient pas les sièges de la même manière. Quelle option l’accord devrait-il retenir, dans ce cas, pour la fixation des règles relatives à la composition et à l’élection des membres de l’instance unifiée ?
Pour éviter cet écueil, le IX crée un article L. 2392-4 qui permet à l’accord d’entreprise prévoyant le regroupement des différentes instances représentatives de déterminer le nombre et le périmètre des établissements distincts pour les élections de la ou des instances regroupées, par dérogation à la voie de l’accord préélectoral.
Cette dérogation permettant de déterminer le périmètre de l’établissement distinct est étendue à l’accord d’établissement qui peut également, aux termes de l’article L. 2391-3 et en l’absence d’accord d’entreprise, procéder, dans les mêmes conditions, au regroupement des instances représentatives du personnel.
La loi du 17 août 2015 précitée est également revenue sur les compétences respectives des instances représentatives du personnel dans les entreprises comportant des établissements distincts.
Dans ce cadre, il existe en effet deux niveaux de représentation du personnel : l’entreprise et l’établissement. Ceux-ci sont respectivement représentés :
− dans la majorité des cas, par le comité central d’entreprise et par les comités d’établissement (article L. 2327-1) ;
− le cas échéant, lorsque les consultations portent sur un projet commun à plusieurs établissements et ont des effets sur la santé, sur la sécurité et sur les conditions de travail, par l’instance de coordination des CHSCT – si elle existe − et par les CHSCT propres à chaque établissement (article L. 4616-1).
La loi du 17 août 2015 a clarifié les compétences respectives de chacune de ces instances et fixé les règles applicables en cas de double consultation.
• Double consultation du comité central d’entreprise et des comités d’établissement
La répartition des compétences consultatives entre le comité central d’établissement et les comités d’établissement est définie à l’article L. 2327-15, dans sa rédaction issue de l’article 15 de la loi du 17 août 2015 :
– le comité central d’entreprise est ainsi consulté sur les projets décidés au niveau de l’entreprise et qui ne comportent pas de mesures d’adaptation spécifiques à un ou plusieurs établissements, ainsi que sur les projets décidés au niveau de l’entreprise, lorsque leurs éventuelles mesures de mise en œuvre ne sont pas encore définies ;
– les comités d’établissement sont consultés sur les mesures d’adaptation des projets décidés au niveau de l’entreprise spécifiques à leur établissement et qui relèvent de la compétence du chef de cet établissement.
Lorsque ce partage des compétences ne permet pas, en pratique, de déterminer si le projet relève exclusivement d’un ou de plusieurs établissements ou de l’entreprise, une double consultation peut être mise en place. Se pose alors la question de l’ordre de consultation.
L’article 15 de la loi du 17 août a fait le choix d’une information ascendante : les comités d’établissements, consultés en premier lieu, sont chargés de transmettre leur position au comité central d’entreprise, dans des délais fixés par décret en Conseil d’État. Il paraissait en effet pertinent de faire en sorte que le comité central d’entreprise soit en mesure de prendre en compte l’avis des comités d’établissement avant de se prononcer.
Or l’étude d’impact indique que plusieurs entreprises ont déploré ce choix, celles-ci faisant valoir que l’ordre de consultation retenu par le législateur les privait d’une consultation unique du comité central d’entreprise, lorsque le projet finalement retenu n’avait finalement pas vocation à être décliné dans les établissements. Ces entreprises soulignaient également qu’il n’était pas toujours aisé pour les comités d’établissement de se prononcer sans connaître l’avis du comité central d’entreprise, ou en l’absence de présentation générale du projet au niveau central.
Le VII du présent article propose donc que l’ordre de consultation soit défini par accord, et que l’ordre fixé par la loi du 17 août 2015 n’intervienne qu’à titre subsidiaire.
Le 1° du VII modifie donc l’article L. 2327-15 afin de renvoyer à un accord la définition de l’ordre de consultation ainsi que les délais dans lesquels le comité central d’entreprise et le ou les comités d’établissement sont respectivement consultés.
La consultation préalable des comités d’établissement chargés de transmettre leur avis au comité central d’entreprise et la fixation des délais par décret en Conseil d’État n’interviendraient, selon le 2° du VII, qu’à défaut d’accord. Le renvoi à un accord devrait ainsi permettre à chaque entreprise d’optimiser l’utilité de la procédure d’information-consultation des représentants du personnel en fonction de ses contraintes propres.
Notons que laisser le choix de l’ordre de consultation aux partenaires sociaux ne paraît pas contraire au principe communautaire de l’effet utile des procédures d’information et de consultation posé par la directive 2002/14/CE relative à l’information et à la consultation des travailleurs. L’article 4 de cette directive prévoit en particulier que « l’information s’effectue à un moment, d’une façon et avec un contenu appropriés, susceptibles notamment de permettre aux représentants des travailleurs de procéder à un examen adéquat et de préparer, le cas échéant, la consultation ».
• Double consultation de l’instance de coordination des CHSCT et des CHSCT des établissements
S’agissant de l’instance de coordination des CHSCT et des CHSCT d’établissement, la loi du 17 août 2015 a procédé à la même clarification des compétences que celle opérée pour le comité central d’entreprise et les comités d’établissement.
Ainsi, en application de l’article L. 4616-1, l’instance de coordination, lorsqu’elle existe, a pour mission d’organiser le recours à une expertise unique par un expert agréé.
Selon l’article L. 4616-3, l’instance de coordination doit se prononcer sur le rapport de l’expert dans des délais prévus par décret en Conseil d’État. Les CHSCT concernés par le projet ne sont consultés que sur les éventuelles mesures d’adaptation du projet spécifiques à leur établissement et qui relèvent de la compétence de ce chef d’établissement.
L’article 15 de la loi du 17 août 2015 a par ailleurs renforcé la place des avis des différents CHSCT, en prévoyant que lorsqu’il y a lieu de consulter à la fois l’instance de coordination et un ou plusieurs CHSCT, chaque CHSCT rend un avis, qui est également transmis à l’instance de coordination des CHSCT dans des délais fixés par décret en Conseil d’État.
En conséquence, suivant cette logique, l’instance de coordination dispose de l’ensemble des avis des CHSCT avant de se prononcer sur l’ensemble du projet ; son avis se substitue dès lors aux avis des CHSCT concernés par le projet commun. Or, d’après l’étude d’impact, ce choix pose les mêmes difficultés que pour la double consultation du comité central d’entreprise et des comités d’établissement.
À l’instar de ce que propose le VII pour la double consultation du comité central d’entreprise et des comités d’établissement, les 1° et 2° du VIII proposent donc également de rendre cette règle subsidiaire.
La modification proposée de l’article L. 4616-3 donne davantage de souplesse aux différentes instances pour définir, par accord, l’ordre et les délais dans lesquels l’instance de coordination et le ou les CHSCT sont respectivement consultés. À défaut d’accord, les délais de consultation de chaque instance seraient fixés par décret en Conseil d’État, comme le prévoit le droit existant.
En pratique, cette disposition signifie que l’avis de l’instance de coordination ne se substituerait plus nécessairement à l’avis des différents CHSCT d’établissement concernés par le projet. En outre, l’instance de coordination ne pourrait plus forcément tenir compte des avis des comités d’établissement avant de se prononcer. Elle conserve toutefois la possibilité de se prononcer sur le fondement du rapport de l’expert désigné lors de la première réunion de l’instance de coordination.
À l’inverse, dans l’hypothèse où l’accord prévoit la remise du rapport de l’instance de coordination en premier lieu, les comités d’établissement disposeraient à la fois de l’avis de cette instance et du rapport de l’expert pour se prononcer. Selon la nature des projets considérés, il peut s’avérer en effet plus utile de retenir cet ordre de consultation.
*
Outre quatre amendements rédactionnels, la Commission a adopté quatre amendements à cet article.
En premier lieu, l’amendement AS910 du rapporteur précise que l’unification des compétences au profit du juge judiciaire en matière de contestation des élections professionnelles se fait à l’exclusion de tout autre recours exclusif ou contentieux.
Deux amendements proposent ensuite de préciser le contenu des informations contenues dans la base de données économiques et sociales mentionnée à l’article L. 2323-8 du code du travail :
− l’amendement AS211 de M. Lionel Tardy précise que les informations de la base de données économiques et sociales relatives à l’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle concernent également l’articulation entre la vie professionnelle et la « vie familiale » ;
− l’amendement AS625 présenté par Mme Catherine Coutelle, présidente de la délégation aux droits des femmes, précise que la base de données économiques et sociales contient un diagnostic et une analyse de la situation « comparée » − et non plus respective – des femmes et des hommes en matière d’embauche, de formation, de promotion professionnelle, etc.
Enfin, l’amendement AS911 du rapporteur étend le recours à la visioconférence aux réunions de la société coopérative européenne et à celles du comité de la société issue de la société transfrontalière,
*
La Commission examine l’amendement AS910 du rapporteur.
M. le rapporteur. Il s’agit d’un amendement de clarification, qui précise, à la suite de la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, que l’unification des compétences au profit du juge judiciaire en matière de contestation des élections professionnelles exclut tout autre recours administratif ou contentieux.
La Commission adopte l’amendement.
Puis elle adopte l’amendement rédactionnel AS807 du rapporteur.
Elle aborde ensuite l’amendement AS628 de Mme Catherine Coutelle.
Mme Marie-Noëlle Battistel. La délégation aux droits des femmes a examiné le texte et procédé à de nombreuses auditions, notamment du Conseil supérieur de l’égalité professionnelle (CSEP) et des partenaires sociaux. Elle a conclu que la négociation est un moment très important au sein d’une entreprise dont il importe de clarifier, du moins de hiérarchiser les différentes étapes, alors que le texte, en l’état, introduit une certaine complexité.
Ainsi, aux termes de l’article du code du travail relatif à la négociation, celle-ci s’appuie sur les seules informations contenues dans la base de données économiques et sociales (BDES) : le plan d’action, en tant que document de travail présenté par l’employeur, ne fait plus partie des éléments soumis à la négociation. Or la qualité de la négociation dépend évidemment des éléments préparatoires fournis par l’employeur, dont le plan d’action doit faire partie.
Nous proposons donc de modifier cet article du code du travail pour que la négociation s’appuie obligatoirement non seulement sur la BDES, mais aussi sur le plan d’action de l’employeur prévu à l’article L. 2323-17 du même code.
Cela permettra de clarifier la méthode comme suit : premièrement, le plan d’action doit être distingué de la BDES ; ensuite a lieu la consultation ; enfin, la négociation, qui doit déboucher sur un accord ou sur un plan unilatéral de l’employeur.
M. le rapporteur. La nouvelle mouture issue de la loi du 17 août 2015 visait précisément à éviter une confusion entre deux plans d’action : le plan d’action de l’employeur intervenant en amont des négociations, qui était assorti d’un rapport de situation comparée, et le plan d’action unilatéral de l’employeur en cas d’échec des négociations. Ce faisant, nous n’avons pas pris de risques : les éléments pertinents sont de toute façon communiqués à l’ensemble des acteurs dans le cadre de la négociation. Il me paraît un peu compliqué de revenir six mois après sur un dispositif que nous avons adopté en 2015. Vous savez comme moi que cette confusion existait. Veillons à ne pas rétablir ce que nous avions supprimé, par souci de simplicité, avec la loi du 17 août 2015.
Mme Catherine Coutelle. Je me permets d’insister sur ce point très important, dont nous avons beaucoup discuté lors de l’examen de la loi Rebsamen ; or celle-ci a un peu brouillé les messages.
Je ne remets pas en cause la base de données économiques et sociales (BDES), qui a le mérite de simplifier les choses en rassemblant toutes les données dans une base unique que tout le monde peut consulter. Mais ce que nous demandons, c’est que l’employeur mette en forme les données qui concernent l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, en indiquant quels sont les salaires perçus par les hommes et les femmes, quelles sont les promotions, quelles sont les formations, combien de femmes ont été embauchées et à quel niveau, etc. Les syndicats et, plus largement, les partenaires sociaux y tiennent beaucoup.
En réalité, ce que nous vous demandons, monsieur le rapporteur, c’est de rétablir le rapport de situation comparée. Je ne sais pas pourquoi ce terme est devenu tabou, pourquoi il provoque de l’urticaire – peut-être faudrait-il l’appeler « bilan de situation comparée » ? C’est pourtant le document dont les négociateurs s’étaient emparés, et qui allait dans le sens de la simplification. Si nous rétablissions ce rapport, nous n’aurions pas besoin de multiplier les plans d’action – sur ce point, je suis d’accord avec vous, monsieur le rapporteur. Ce dont nous avons besoin, c’est d’une situation comparée. Or ce n’est pas dit ainsi dans la loi.
Je précise que les décrets d’application correspondants de la loi Rebsamen ne sont pas encore parus. Les entreprises n’appliquant pas encore la loi Rebsamen, elles ne risquent pas de s’embrouiller.
M. Christophe Cavard. Il s’agit d’une question très importante, qui pourrait être traitée dans le cadre des accords de méthode. Je trouve dommage que notre proposition de rendre obligatoires les accords de méthode n’ait pas été davantage soutenue. Elle aurait permis de mettre en avant les enjeux que défend Mme Coutelle.
M. le rapporteur. Je comprends bien l’objectif que poursuivent Mme Battistel et Mme Coutelle et je le partage. Ce que vous souhaitez, chères collègues, c’est qu’on identifie mieux les données relatives à l’égalité professionnelle au sein de la base de données ; nous répondrons à cette préoccupation avec un amendement suivant. Cela me paraît préférable au fait de s’accrocher à tout prix au rapport de situation comparée, lequel présente peut-être moins d’intérêt que la base de données, dans la mesure où il est actualisé moins souvent. Avec votre amendement, vous réintroduisez un plan d’action, ce qui n’est pas souhaitable. Tout en partageant votre souci, je maintiens mon avis défavorable.
La Commission rejette l’amendement.
Puis elle examine l’amendement AS629 de Mme Catherine Coutelle.
Mme Marie-Noëlle Battistel. Actuellement, en l’absence d’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, l’article L. 2242-8 du code du travail dispose que la synthèse du plan d’action unilatéral établi par l’employeur est portée à la connaissance des salariés. Cependant, l’article ne prévoit pas d’obligation d’informer les salariés sur l’existence et le contenu synthétique de l’accord lorsqu’il en existe un. Il convient donc de préciser que, en cas d’accord, la synthèse de cet accord doit être portée à la connaissance des salariés.
M. le rapporteur. Il est normal que le plan d’action unilatéral de l’employeur fasse l’objet d’une diffusion spécifique. En revanche, il n’y a pas de raison, selon moi, que les modalités de publicité des accords conclus en matière d’égalité professionnelle dérogent aux règles de droit commun, que nous venons d’ailleurs de renforcer en adoptant l’article 7, lequel prévoit la possibilité de faire précéder les accords d’un préambule et impose la diffusion de tous les accords via une base de données nationale accessible à tous. Pourquoi faire un cas particulier ? Avis défavorable.
Mme Catherine Coutelle. L’étude d’impact – très intéressante à lire et qui s’apparente plutôt à un diagnostic, notamment en ce qui concerne les femmes – préconise d’accroître la transparence sur les accords, car les salariés les méconnaissent souvent et parfois même en ignorent l’existence. Nous avions le sentiment que l’obligation de publicité ne concernait que le plan d’action unilatéral de l’employeur, et non un éventuel plan d’action négocié et signé par les partenaires sociaux en matière d’égalité professionnelle. Si vous nous assurez qu’un tel accord fera bien partie de l’ensemble des documents auxquels s’appliquent les règles de transparence et qu’il sera affiché dans l’entreprise de manière à ce que l’on sache notamment comment les choses vont avancer en matière d’égalité salariale et combien de femmes pourront partir en formation, nous sommes prêts à retirer notre amendement.
M. le rapporteur. Je vous le confirme.
L’amendement est retiré.
La Commission est saisie de l’amendement AS211 rectifié de M. Lionel Tardy.
M. Lionel Tardy. Le principe énoncé au 9° de l’article 1er parlant de « vie personnelle et familiale », il faut faire de même à l’article L. 2323-8 du code du travail, en ajoutant « et familiale ». Nous avons adopté un amendement analogue à l’article 3, l’amendement AS30 de mon collègue Patrick Hetzel.
Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement.
Puis elle adopte l’amendement rédactionnel AS808 du rapporteur.
Elle en vient à l’amendement AS911 du rapporteur.
M. le rapporteur. Cet amendement vise à corriger un oubli dans la loi du 17 août 2015 : il étend la possibilité de recourir à une visioconférence aux réunions du comité de la société coopérative européenne et à celles du comité de la société issue de la fusion transfrontalière.
La Commission adopte l’amendement.
Puis elle examine l’amendement AS627 de Mme Catherine Coutelle.
Mme Catherine Coutelle. Avant la loi Rebsamen – toujours inappliquée faute de décrets –, lorsque le comité d’entreprise négociait en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, il avait en sa possession deux documents : les données relatives à l’égalité et un plan d’action proposé par l’employeur. Si la négociation aboutissait, le plan d’action était le cas échéant modifié et donnait lieu à un accord. Si la négociation échouait, le plan d’action proposé initialement devenait le plan d’action unilatéral de l’employeur.
Aujourd’hui, les choses ne sont vraiment pas claires – vous l’avez vous-même reconnu, monsieur le rapporteur. Lorsqu’on lit les dispositions actuelles, on a l’impression que le comité d’entreprise reçoit des informations et qu’il est consulté sur un rapport déjà négocié. Quel est le sens d’une discussion sur un rapport déjà négocié ?
D’où notre amendement, qui vise à réintégrer tous les éléments pertinents dans la négociation. Il précise que le plan d’action doit porter sur un nombre minimum de domaines prévus par décret et qu’un rapport de situation comparée est produit à l’issue de cette consultation. Ce rapport n’est pas figé. On le soumet au comité d’entreprise, puis on consulte, on négocie et, in fine, on signe ou non.
M. le rapporteur. Madame Coutelle, lors de l’examen de la loi Rebsamen, vous vous êtes vous-même battue – c’est le moins que l’on puisse dire – pour que tous les éléments qui figuraient dans le rapport de situation comparée, sans exception, soient repris dans la BDES. Et c’est le cas aujourd’hui. Dès lors, je ne vois pas pourquoi il faudrait rétablir le rapport de situation comparée. Avis défavorable.
M. Christophe Cavard. Toutes les dispositions que vous défendez, madame Coutelle, pourraient être intégrées dans notre réflexion sur les accords de méthode, lesquels visent précisément à définir le cadre général de la négociation, les thèmes de discussion et les informations qui sont portées à la connaissance des négociateurs. Je vous invite vraiment à travailler sur ce point avec nous d’ici à la séance publique.
La Commission rejette l’amendement.
Puis elle est saisie de l’amendement AS632 de Mme Catherine Coutelle.
Mme Catherine Coutelle. Il s’agit d’un amendement de repli.
Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement.
Puis elle adopte successivement les amendements rédactionnels AS916 et AS809 du rapporteur.
Elle en vient à l’amendement AS625 de Mme Catherine Coutelle.
Mme Catherine Coutelle. Nous aimerions que le même vocabulaire soit utilisé dans la totalité du code du travail. Nous proposons donc d’utiliser, à l’article L. 2323-8, les termes de « situation comparée » des femmes et des hommes, plutôt que ceux de « situation respective », peu habituels.
M. le rapporteur. Cela participe de la clarification que vous souhaitez. Avis favorable.
La Commission adopte l’amendement.
Puis elle examine l’amendement AS626 de Mme Catherine Coutelle.
Mme Catherine Coutelle. Cet amendement vise à préciser que le diagnostic et l’analyse de la situation comparée des femmes et des hommes reposent sur un ensemble d’indicateurs chiffrés.
M. le rapporteur. Je vous invite à retirer votre amendement, car il est, selon moi, satisfait : l’article L. 2323-17 du code du travail mentionne expressément les indicateurs chiffrés visant à établir l’analyse de la situation comparée entre les femmes et les hommes.
L’amendement est retiré.
La Commission adopte l’article 9 modifié.
*
* *
La Commission est saisie de l’amendement AS728 de Mme Éva Sas.
Mme Éva Sas. Notre objectif est que ce projet de loi contienne également des avancées pour les salariés. Il s’agit notamment de renforcer leur représentation dans les conseils d’administration, car nous croyons à une gestion partagée de l’entreprise. Le conseil d’administration est une instance stratégique pour l’entreprise, ses dirigeants et ses salariés, dans laquelle le pluralisme des visions et des légitimités doit s’exprimer. Si l’ambition du Gouvernement est véritablement d’améliorer le dialogue social, il nous suivra dans cette analyse.
À la suite de l’accord national interprofessionnel conclu entre les partenaires sociaux le 11 janvier 2013, la France a rejoint douze pays européens qui assurent la représentation des salariés au conseil d’administration des entreprises. Mais les premiers bilans et témoignages sur l’application de cette mesure nous enseignent que la représentation des salariés ne peut être efficace qui si ces derniers se partagent un nombre suffisant de postes d’administrateurs au sein des conseils.
Dans l’état actuel du droit, comprennent des administrateurs représentant les salariés les conseils d’administration et de surveillance des entreprises employant au moins 5 000 salariés permanents dans la société et ses filiales, dont le siège social est fixé sur le territoire français, ou au moins 10 000 salariés permanents dans la société et ses filiales, dont le siège social est fixé sur le territoire français et à l’étranger.
De surcroît, le code de commerce dispose que le nombre d’administrateurs salariés ne peut excéder le tiers des administrateurs. Notre amendement AS728 vise à faire de ce seuil maximum un seuil minimum de représentation des salariés.
M. le rapporteur. Nous avons déjà évoqué la question des administrateurs salariés dans le cadre de la loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi. Nous avons alors fait progresser les choses de manière significative en abaissant de 5 000 à 1 000 salariés en France, et de 10 000 à 5 000 salariés à l’échelle du monde, le seuil effectif à partir duquel les groupes sont obligés de prévoir la présence d’administrateurs salariés au sein de leur conseil d’administration. Cette mesure a permis, à elle seule, de multiplier par cinq le nombre de groupes concernés : il est passé de 90 à un peu plus de 400.
Je rappelle, en outre, que l’entrée en vigueur de ce dispositif est échelonnée : elle doit intervenir au plus tard dans les six mois suivant la clôture de l’exercice 2016 ou 2017. Nous sommes en phase de progression. Le calendrier prévu n’étant pas encore arrivé à son terme, il serait judicieux de ne pas revenir dès maintenant sur ce dispositif, même si je partage l’idée qu’il faudra encore faire progresser la présence des administrateurs salariés au sein des conseils d’administration. En l’état actuel des choses, j’émets un avis défavorable.
La Commission rejette l’amendement.
Puis elle examine l’amendement AS729 de Mme Éva Sas.
Mme Éva Sas. Le code de commerce prévoit des dispositions spécifiques pour les entreprises de petite taille en matière de représentation des salariés au conseil d’administration. En cohérence avec l’amendement précédent, nous proposons d’instaurer un seuil minimum de deux administrateurs salariés, sauf lorsque le conseil d’administration n’est composé que de trois membres.
Il est important de prendre en compte le rapport de force au sein de l’entreprise et, plus précisément, l’inégalité entre employeurs et salariés. Monsieur le rapporteur, il s’agit peut-être d’une des dernières occasions de progresser sur cette question au cours de cette législature – j’ai quelques doutes sur la suivante.
M. Élie Aboud. Ils ont le moral !
Mme Éva Sas. Il ne faut pas la manquer. C’est pourquoi nous avons proposé, avec cet amendement et le précédent, que les administrateurs salariés représentent un tiers des administrateurs et soient deux au minimum. Je sais par expérience, qu’un administrateur isolé a beaucoup de mal à exercer son mandat.
M. le rapporteur. Avis défavorable, pour la même raison que précédemment.
M. Jean-Patrick Gille, président. Le cœur et la raison…
La Commission rejette l’amendement.
Elle en vient à l’amendement AS212 de M. Lionel Tardy.
M. Lionel Tardy. Encore une erreur dans la loi relative au dialogue social votée l’été dernier ! Avec ce texte, on s’était vanté d’étendre le recours à la visioconférence pour les réunions avec la délégation unique du personnel, mais vous avez introduit de la complexité et un principe de méfiance à l’égard de l’employeur en limitant cette possibilité. Il faudrait savoir !
Dans l’état actuel du droit, le recours à la visioconférence pour les réunions avec les différentes institutions représentatives du personnel ne peut être autorisé que par accord entre l’employeur et les membres élus du comité. En l’absence d’accord, ce recours est limité à trois réunions par année civile. On ne peut pas à la fois affirmer que l’on veut développer le dialogue social et imposer de tels freins. En outre, c’est contradictoire avec le développement des outils numériques. Il faut inverser la logique en prévoyant que l’employeur peut recourir à la visioconférence pour ces réunions, tout simplement.
M. le rapporteur. Je vous remercie, monsieur Tardy, de nous faire rajeunir de quelques mois : le même amendement avait déjà été déposé lors de l’examen de la loi relative au dialogue social. J’avais alors expliqué qu’il ne me semblait pas opportun de prévoir une décision unilatérale de l’employeur en la matière et qu’il fallait plutôt privilégier les accords collectifs. Je ne me déjugerai pas : avis défavorable.
M. Gérard Cherpion. En adoptant l’amendement AS911, nous avons étendu le recours à la visioconférence. Ce faisant, nous avons, selon les termes du rapporteur, rectifié ce qu’il qualifiait d’oubli, mais ce n’en était pas forcément un. Nous pouvons, là encore, encourager l’utilisation de la visioconférence, qui représente un gain de temps. Ce qui n’exclut pas de tenir des réunions formelles.
M. Lionel Tardy. Nous ne revenons pas sur la nécessité d’un accord entre l’employeur et les membres élus du comité, mais il ne nous semble pas normal de limiter le recours à la visioconférence à trois réunions en l’absence d’accord. Pourquoi trois réunions plutôt que deux, quatre ou cinq ? Cela n’a pas de sens.
La Commission rejette l’amendement.
*
* *
Chapitre II
Renforcement de la légitimité des accords collectifs
Article 10
(Art. L. 2232-12, L. 2232-13, L. 2231-7 à L. 2231-9, L. 2242-20, L. 2391-1 et L. 7111-9 du code du travail, art. L. 6524-4 du code des transports)
Généralisation des accords majoritaires d’entreprise
S’inscrivant pleinement dans la volonté de renforcer la place de la négociation collective prônée par le projet de loi, cet article propose de réviser les règles de validité des accords d’entreprise afin d’en renforcer la légitimité. Il propose à cette fin :
− de généraliser d’ici à 2019 le principe de l’accord majoritaire au niveau de l’entreprise ;
− d’introduire une possibilité de consultation des salariés pour valider un accord, lorsque celui-ci n’a pas recueilli l’aval d’une majorité de syndicats représentatifs dans l’entreprise.
Au niveau de l’entreprise, les accords collectifs sont négociés entre l’employeur et les syndicats représentatifs au sein de celle-ci.
Toutefois, en l’absence de syndicats représentatifs, les représentants élus du personnel, mandatés ou non, peuvent également prendre part aux négociations, de même que, dans certaines circonstances, les salariés mandatés. L’article 21 de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi a d’ailleurs largement étendu les conditions de conclusion d’un accord d’entreprise en l’absence de délégués syndicaux. Trois cas de figure applicables aux entreprises dépourvues de délégué syndical sont distingués :
− aux termes de l’article L. 2232-21 du code du travail, l’employeur peut négocier et conclure des accords collectifs avec les représentants élus du personnel au comité d’entreprise, à la délégation unique du personnel (DUP) ou à l’instance unique mentionnée à l’article L. 2391-1 ou, à défaut, avec les délégués du personnel, si ces élus sont expressément mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche dont relève l’entreprise ou, à défaut au niveau national et interprofessionnel.
− à défaut de représentant élu du personnel mandaté, l’article L. 2232-22 permet aux représentants élus non mandatés de négocier et conclure des accords collectifs ;
− enfin, selon l’article L. 2232-24, dans les entreprises où aucun élu n’a manifesté son intention de négocier, dans les entreprises où un procès-verbal de carence a établi l’absence de représentant du personnel, ou encore dans les entreprises dont l’effectif est inférieur à onze salariés, la négociation peut être engagée par un ou plusieurs salariés expressément mandatés à cette fin.
Les conditions de validité d’un accord conclu par des représentants élus du personnel, qu’ils soient mandatés ou non, ne sont pas les mêmes que lorsque l’accord est négocié directement par les délégués syndicaux.
Les règles actuelles de validité d’un accord d’entreprise ou d’établissement ont été fixées par la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail.
Aux termes de l’article L. 2232-12 du code du travail, la validité d’un accord d’entreprise est subordonnée à deux conditions cumulatives.
● La première condition est la signature de l’accord par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins 30 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d’entreprise ou de la délégation unique du personnel (DUP) ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants.
La représentativité des organisations syndicales de salariés
La loi du 20 août 2008 a également réformé en profondeur les conditions de la représentativité des organisations syndicales de salariés.
Selon l’article L. 2121-1 du code du travail, pour être reconnue représentative, une organisation syndicale doit désormais cumuler sept critères :
− le respect des valeurs républicaines ;
− l’indépendance ;
− la transparence financière ;
− une ancienneté minimale de deux ans dans le champ professionnel et géographique couvrant le niveau de négociation ;
− l’audience, qui est établie différemment selon le niveau de négociation considéré (23) ;
− l’influence, principalement caractérisée par l’activité et l’expérience ;
− les effectifs d’adhérents et les cotisations.
● La seconde condition est l’absence d’opposition majoritaire. Les syndicats représentatifs non signataires de l’accord et ayant recueilli la majorité des suffrages aux élections professionnelles (50 %) ont en effet la possibilité d’exercer un droit d’opposition, dont les modalités sont précisées aux articles L. 2231-8 et L. 2231-9 du même code.
Le droit d’opposition est une disposition suspensive de l’applicabilité de l’accord ; il ne peut donc être exercé que durant un délai de huit jours à compter de la date de notification de l’accord. En outre, pour être valide, l’opposition doit être exprimée par écrit et motivée. Elle doit également préciser les points de désaccord, en vue d’une éventuelle nouvelle négociation.
Les accords frappés d’opposition majoritaire sont réputés non écrits.
2 Lorsque l’accord est négocié par des représentants élus du personnel mandatés par une organisation syndicale représentative
En application de l’article L. 2232-21-1 du même code, tout accord signé par un représentant élu du personnel mandaté par une organisation syndicale de salariés représentative doit être approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés, dans des conditions déterminées par décret et dans le respect des principes généraux du droit électoral.
En application de l’article L. 2232-22 du même code, lorsque les signataires de l’accord sont des représentants du personnel non mandatés, l’accord doit être conclu par des élus titulaires représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles. En outre, l’accord doit recevoir l’approbation d’une commission paritaire de branche, qui contrôle que le texte ne contrevient pas aux dispositions légales réglementaires ou conventionnelles applicables.
Dans cette hypothèse, aux termes de l’article L. 2232-27 du même code, l’accord doit être approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés.
L’article 5 de la position commune du 9 avril 2008 sur la représentativité, le développement du dialogue social et le financement du syndicalisme, qui avait servi de base à l’élaboration de la loi du 20 août 2008, indiquait que les nouvelles conditions de validité des accords collectifs devaient être regardées comme « une étape préparant à un mode de conclusion majoritaire des accords ».
Depuis, la volonté du législateur de promouvoir ce type d’accords au sein de l’entreprise s’est confirmée.
L’une des premières marques d’intérêt significatives à l’égard de l’accord majoritaire est la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail, qui a subordonné le droit aux allégements de cotisations accompagnant le passage aux trente-cinq heures à la signature des accords d’entreprise par une ou plusieurs organisations syndicales ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections.
À la suite de la position commune de 2008, plusieurs étapes importantes ont été franchies, marquant un tournant décisif en faveur du développement de ce type d’accords.
C’est en premier lieu la loi dite de « sécurisation de l’emploi » du 14 juin 2013 (24) qui a opté pour le principe majoritaire, en conditionnant la validité des accords de maintien de l’emploi et des accords conclus dans le cadre de plans de sauvegarde de l’emploi à leur signature par des organisations syndicales ayant obtenu plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations syndicales représentatives lors des dernières élections professionnelles.
Eu égard à la sensibilité des accords considérés, qui interviennent dans des contextes économiques défavorables et impliquent une réduction – temporaire – des droits des salariés en contrepartie d’une meilleure santé économique de l’entreprise, il apparaissait en effet que seul un soutien majoritaire de la part des syndicats était susceptible de légitimer ce type d’accord.
La loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale a ensuite prévu la possibilité, dans les entreprises de plus de 300 salariés, de regrouper, par accord majoritaire, les différentes institutions de représentation du personnel – comité d’entreprise, délégués du personnel, comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) – au sein d’une instance unique.
Dernièrement, la possibilité de modifier par accord majoritaire la périodicité des négociations obligatoires dans l’entreprise a été consacrée par la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi.
Le recours au principe majoritaire semble également avoir fait son chemin au sein des entreprises, même lorsqu’elles n’y sont pas juridiquement contraintes. L’étude d’impact explique ainsi que de nombreuses entreprises, et notamment de grandes entreprises, appliquent déjà de fait le principe majoritaire ; elle cite notamment l’exemple d’une grande entreprise ayant pris l’engagement de ne conclure que des accords signés par des organisations majoritaires aux dernières élections professionnelles.
Dans son rapport, M. Combrexelle explique que le législateur pourrait tout à fait « s’en tenir à cette ligne de conduite qui consiste à réserver l’accord majoritaire aux accords collectifs que l’on considère comme plus sensibles que d’autres ». Il considère cependant que le statu quo n’est pas forcément l’option à retenir :
− d’une part, compte tenu de la forte imbrication des matières, il deviendrait de plus en plus complexe de faire le partage entre ce qui devrait relever ou non de l’accord majoritaire ;
− d’autre part, il rappelle que l’accord majoritaire est « de nature à légitimer les accords aux yeux des salariés et à responsabiliser les organisations syndicales » ce qui, au regard de la volonté de consolider la place de la négociation collective, doit être regardé comme une priorité et comme l’une des conditions de la pérennité des accords.
Afin de renforcer la légitimité des accords d’entreprise, cet article propose donc de généraliser le principe de l’accord majoritaire. Pour dépasser, le cas échéant, les éventuels blocages de la négociation collective liés à l’absence de majorité absolue, il autorise les organisations syndicales signataires et minoritaires à solliciter la consultation directe des salariés, pour que ces derniers se prononcent sur le projet d’accord.
A. LES NOUVELLES RÈGLES DE VALIDITÉ PRIVILÉGIENT L’ACCORD MAJORITAIRE ET, À DÉFAUT, LA CONSULTATION DES SALARIÉS
Dans un premier temps, le a du 1° du I propose de modifier le premier alinéa de l’article L. 2232-12 afin de généraliser le principe de l’accord majoritaire.
La validité d’un accord d’entreprise ou d’établissement serait subordonnée à sa signature par :
− l’employeur « ou son représentant », d’une part ;
− et une ou plusieurs organisations syndicales de salariés ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d’entreprise ou de la délégation unique du personnel (DUP) ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, d’autre part.
Ces nouvelles règles appellent plusieurs remarques.
En premier lieu, il convient de souligner que la condition de majorité est strictement considérée : en effet, le recueil de plus de 50 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles est calculé proportionnellement au nombre de suffrages exprimés « en faveur d’organisations représentatives », ce qui signifie que les suffrages exprimés en faveur d’organisations non représentatives ne sont pas comptabilisés. Notons également qu’aucun quorum de votants n’est exigé, comme c’est déjà le cas en l’état du droit.
En second lieu, la généralisation de l’accord majoritaire entraîne, en toute logique, la suppression du droit d’opposition d’une ou de plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés à ces mêmes élections. En effet, la condition de majorité imposée pour valider l’accord est incompatible avec la possibilité de rejeter ce même projet d’accord à la majorité.
Les 3° et 4° du I suppriment en conséquence l’article L. 2231-7 relatif au dépôt des accords à l’expiration du délai d’opposition, ainsi que les articles L. 2231-8 et L. 2231-9 relatifs aux modalités de mise en place de l’opposition, ce qui conduit à abroger la section 4 du chapitre Ier du titre III du livre II de la deuxième partie du code du travail.
La généralisation de l’accord majoritaire d’entreprise doit enfin être analysée au regard du principe de participation posé par le huitième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, en vertu duquel « tout travailleur participe, par l’intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu’à la gestion des entreprises ». En invitant les organisations syndicales de salariés à se prononcer clairement en faveur ou en défaveur d’un compromis négocié, l’accord majoritaire accentue la responsabilité des syndicats, tout en consolidant la légitimité de l’accord. Sur le fondement de ce constat, le Conseil d’État a estimé, dans son avis sur le projet de loi, que la généralisation de l’accord majoritaire était de nature à renforcer le principe de participation des travailleurs.
La validation des accords à la majorité suppose d’élaborer des compromis. Toutefois, lorsque les organisations syndicales représentatives échouent manifestement à s’entendre pour se prononcer majoritairement en faveur d’un projet d’accord, le risque est d’aboutir à une paralysie du dialogue social. Le b du 1° du I propose donc une alternative permettant de consulter directement les salariés sur le projet d’accord ; il substitue à cette fin sept nouveaux alinéas au deuxième alinéa de l’article L. 2232-12.
Pour que la consultation des salariés puisse avoir lieu, il faut tout d’abord que l’accord ait été préalablement signé par l’employeur et par des organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au premier tour des élections professionnelles – ce qui revient au droit existant.
Lorsque l’accord est signé par une ou plusieurs organisations syndicales représentant entre 30 % et 50 % des suffrages aux dernières élections professionnelles, celles-ci peuvent demander une consultation des salariés visant à valider l’accord.
Afin de permettre aux syndicats de décider de maintenir ou de faire évoluer leurs positions avant que la consultation ait lieu en vue de recueillir une majorité, la consultation ne peut se tenir que dans un délai de huit jours à compter de la demande : les organisations syndicales représentatives ont donc une dernière chance de se prononcer majoritairement en faveur du projet d’accord. À défaut d’accord, la consultation peut avoir lieu, étant précisé qu’elle doit se dérouler « dans le respect des principes généraux du droit électoral ».
Les principes généraux du droit électoral
Les contours de ces principes généraux, dont la première occurrence législative date de 1982 (actuel article L. 2314-23 du code du travail), ont été progressivement précisés par la jurisprudence de la Cour de cassation.
Cette dernière considère notamment que le respect d’une stricte égalité entre les électeurs, la liberté des candidatures, ou encore le secret et la sincérité du scrutin sont des principes généraux du droit électoral en droit du travail.
Selon la Cour de cassation, les irrégularités contrevenant aux principes généraux du droit électoral justifient de plein droit l’annulation des élections, sans qu’il soit nécessaire de démontrer une éventuelle influence de ces manquements sur le résultat du vote.
À titre d’exemple, ont été considérées comme des irrégularités contrevenant aux principes généraux du droit électoral :
− le défaut d’information des électeurs sur l’organisation d’élections (Cass. soc., 3 avril 2002, n° 01-60.464) ;
− la violation par l’employeur de son obligation de neutralité (Cass. soc., 10 mai 2012, n° 11-14.178).
Les modalités de la consultation, telles que les dates et lieux du scrutin, doivent être précisées par un protocole spécifique conclu entre l’employeur et les organisations signataires du projet d’accord.
La consultation peut également être organisée par voie électronique, selon les conditions prévues par le protocole et dans le respect des principes généraux du droit électoral, qui garantissent l’équité entre les candidats ainsi que la sincérité et la confidentialité du vote.
Selon les informations transmises au rapporteur, le fait de réserver la conclusion du protocole aux seules organisations signataires vise à éviter de nouvelles situations de blocage, la définition du contenu du protocole n’ayant pas vocation à ré-ouvrir la négociation sur l’accord lui-même.
Lorsqu’une entreprise comporte plusieurs établissements, seuls les salariés du ou des établissements couverts par l’accord peuvent participer à la consultation. Ces derniers doivent en outre être impérativement électeurs aux élections des délégués du personnel, ce qui revient en pratique à exclure du champ de la consultation les personnels travaillant au sein d’un établissement ou d’une entreprise en qualité d’intérimaires ou de sous-traitants.
À l’issue de la consultation, deux options sont possibles :
− si l’accord est approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés, il est alors considéré comme validé ;
− inversement, si le projet d’accord remporte moins de la moitié des suffrages exprimés, il est réputé non écrit.
Un décret en Conseil d’État doit prévoir les modalités d’application de cet article.
À l’instar de la généralisation de l’accord majoritaire, l’introduction d’une participation directe des salariés à la détermination de leurs conditions de travail doit également être analysée au regard du principe de participation, dans la mesure où le Préambule de la Constitution de 1946 privilégie la voie de la représentation des salariés, et n’envisage la participation de ceux-ci que par l’intermédiaire de leurs « délégués ».
La consultation directe du personnel en vue de la ratification d’un accord a cependant déjà été consacrée à plusieurs reprises en droit. L’article L. 2232-14 du code du travail prévoit par exemple qu’en cas de carence au premier tour des élections professionnelles, la validité d’un accord d’entreprise négocié et conclu avec le représentant de la section syndicale est subordonnée à son approbation par les salariés à la majorité des suffrages exprimés. De même, le code du travail autorise la ratification par approbation à la majorité des salariés de certains types d’accords d’entreprise, relatifs par exemple à la mise en place de plans d’intéressement (article L. 3312-5) ou d’épargne salariale (article L. 3332-3).
En outre, la consultation directe des salariés prévue par le présent article n’est qu’une condition complémentaire de l’exigence d’approbation de l’accord par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages aux dernières élections professionnelles. Selon le mécanisme retenu, la représentation des salariés est bien effective et se vérifie dans les mêmes conditions qu’en l’état du droit – à la différence près que le droit de véto de la majorité des organisations syndicales est supprimé – ; à défaut de majorité, la participation directe des salariés par référendum permet simplement de confirmer – ou d’infirmer − le projet d’accord approuvé par les organisations syndicales signataires. En tout état de cause, le Conseil d’État a considéré que la consultation directe des salariés dans les conditions prévues à cet article ne porte pas atteinte au principe de participation.
Les règles présentées aux 1°, 3° et 4° du I sont applicables à la majorité des accords d’entreprise ou d’établissement. Elles requièrent toutefois certaines adaptations.
En l’état du droit, les règles de validité d’un accord catégoriel, c’est-à-dire un accord qui n’est applicable qu’à une seule catégorie de salariés, sont les mêmes que celles applicables aux accords d’entreprise de droit commun.
Par exception toutefois, les syndicats catégoriels affiliés à une confédération syndicale catégorielle, lorsqu’ils sont reconnus représentatifs au titre des salariés qu’ils ont vocation à représenter, peuvent participer à la négociation des accords applicables, en tout ou partie, à cette catégorie de salariés : c’est le sens de l’article L. 2232-13 du code du travail.
Le 2° du I transpose par conséquent les nouvelles règles de validation des accords collectifs d’entreprise aux accords catégoriels mentionnés à l’article L. 2232-13.
Le a ajoute la signature de l’employeur comme condition de validité de l’accord, pose le principe de la validation des accords à la majorité et supprime le droit d’opposition des organisations syndicales représentatives majoritaires.
Le b complète l’article L. 2232-13 afin de préciser, d’une part, que les règles de validité applicables sont celles prévues à l’article L. 2232-12, ce qui inclut la possibilité de consulter les salariés lorsqu’un accord n’est approuvé que par 30 à 50 % de la ou des organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise.
Il est précisé d’autre part que dans le cadre d’un accord catégoriel, les proportions de 30 % et de 50 % des suffrages exprimés au premier tour des élections professionnelles en faveur d’organisations syndicales représentatives sont appréciées « à l’échelle du collège ». Le cas échéant, la consultation des salariés s’effectue également à l’échelle du collège.
S’agissant des accords ou conventions mentionnés à l’article L. 7111-9 du même code qui ne concernent que les journalistes ou assimilés, lorsqu’un collège électoral spécifique est créé à leur intention dans une entreprise, la validité de l’accord est actuellement subordonnée aux mêmes conditions que celles mentionnées à l’article L. 2232-12, à la différence près que l’échelle considérée pour la prise en compte des suffrages exprimés est l’échelle du collège électoral spécifique.
Par analogie avec les modifications précédemment présentées, le IV propose de modifier l’article L. 7111-9 afin de généraliser les accords majoritaires aux accords concernant les journalistes et salariés et de permettre la validation de ces accords par approbation des salariés :
− les a et b du 1° substituent à la proportion de 30 % de suffrages exprimés celle de 50 % de suffrages exprimés « en faveur d’organisations représentatives » ;
− le c du 1° supprime le droit d’opposition d’une ou de plusieurs organisations syndicales représentatives ;
− enfin, le 2° précise que les nouvelles règles de validité sont celles prévues à l’article L. 2232-12, ce qui revient à autoriser la mise en place d’une consultation des salariés, sous réserve que le projet d’accord ait été signé par au moins 30 % des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise à l’échelle du collège considéré. Les proportions de 30 % et de 50 % sont également appréciées à l’échelle du collège de journalistes et assimilés.
Selon l’article L. 6524-4 du code des transports, dans les entreprises dans lesquelles un collège électoral spécifique est créé pour les personnels navigants techniques et lorsqu’un accord ne concerne que ces personnels, la validité de cet accord est constatée dans les conditions définies à l’article L. 2232-12 du code du travail.
Le V modifie cet article afin de préciser que les poids de 30 % et de 50 % sont appréciés à l’échelle de ce collège électoral spécifique.
Dans toutes les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d’organisations représentatives, l’employeur a l’obligation d’ouvrir des négociations avec les syndicats au moins une fois par an ou une fois tous les trois ans au niveau de l’entreprise, de l’établissement ou du groupe.
Depuis le 1er janvier 2016, les négociations annuelles et pluriannuelles obligatoires existantes sont regroupées autour de trois grandes thématiques :
− la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée (négociation annuelle) ;
− l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail (négociation annuelle) ;
− et, uniquement dans les entreprises ou groupe d’entreprises d’au moins trois cents salariés, la gestion prévisionnelle des emplois, la formation professionnelle et la mobilité professionnelle (négociation triennale).
Aux termes de l’article L. 2242-20, tel qu’il résulte de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi, lorsque l’entreprise satisfait à l’obligation d’accord ou, à défaut, de plan d’action relatif à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, un accord d’entreprise majoritaire peut modifier la périodicité de chacune des négociations obligatoires, dans la limite de trois ans pour les deux négociations annuelles et de cinq ans pour la négociation triennale.
Pour être valide, l’accord d’entreprise doit être signé par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au premier tour des élections de titulaires au comité d’entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants.
Le II supprime la référence à ce mécanisme de validation par accord majoritaire, dans la mesure où le présent article propose de l’étendre à l’ensemble des accords collectifs d’entreprise. Toutefois, le VI ne précise pas que l’accord majoritaire s’applique dès la promulgation de la loi. Il conviendra donc de modifier cet alinéa.
L’article L. 2391-1 du code du travail permet aux entreprises de trois cents salariés et plus de prévoir, par accord majoritaire, le regroupement des délégués du personnel, du comité d’entreprise et du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), ou de deux de ces institutions représentatives, au sein d’une seule instance exerçant l’ensemble des attributions des institutions regroupées.
En l’état du droit, l’accord doit répondre aux mêmes exigences que celles posées à l’article L. 2242-20, c’est-à-dire la signature par des organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au premier tour des élections professionnelles et l’absence d’opposition majoritaire.
Le III supprime la référence à l’accord majoritaire pour les mêmes raisons qu’au II. Il conviendra donc également de modifier le VI afin de prévoir que les accords majoritaires sont applicables aux accords prévoyant le regroupement des institutions représentatives du personnel dès la promulgation de la loi.
Le VI de cet article prévoit l’entrée en vigueur de cet article dès la promulgation de la loi, pour deux types d’accords collectifs : ceux portant sur la durée du travail, les repos et les congés, et ceux mentionnés à l’article L. 2254-2 du code du travail dans sa rédaction issue de l’article 11 de ce projet de loi, c’est-à-dire les accords de préservation et de développement de l’emploi.
Pour les autres types d’accords d’entreprise, à l’exception des accords de maintien de l’emploi mentionnés à l’article L. 5125-1, l’entrée en vigueur de la généralisation du principe majoritaire est fixée dans un délai d’un an à compter de la remise du rapport de la commission de refondation du code du travail prévue à l’article 2 de ce projet de loi et, au plus tard, le 1er septembre 2019.
*
Outre cinq amendements rédactionnels, la Commission a adopté deux amendements de M. Christophe Cavard visant à encadrer la demande de consultation des salariés de la part des organisations syndicales signataires dans un délai d’un mois (AS313) et à préciser que ladite consultation doit se tenir dans un délai de deux mois (AS315).
La Commission a ensuite adopté trois amendements identiques présentés par M. Yves Blein au nom de la commission des affaires économiques (AS880), par M. Hervé Pellois (AS124) et par Mme Jeanine Dubié (AS460), qui visent à étendre aux chambres d’agriculture les nouvelles modalités de validation des accords collectifs présentées à l’article 10.
Sur proposition du rapporteur, la Commission a enfin adopté deux amendements :
– l’un reportant au 1er janvier 2017 l’entrée en vigueur des nouvelles règles de validité des accords portant sur la durée du travail, les repos et les congés ;
– l’autre substituant à l’entrée en vigueur de la généralisation des accords majoritaires au 1er septembre 2019 un rapport d’évaluation de l’application des nouvelles règles de majorité aux accords portant sur la durée du travail, les repos, les congés ainsi que les accords de préservation ou de développement de l’emploi. Ce rapport remis par le Gouvernement permettra au Parlement d’évaluer l’opportunité de généraliser, par un nouvel acte législatif, les nouvelles règles de validité à l’ensemble des accords collectifs.
*
La Commission est saisie de l’amendement AS560 de M. Arnaud Richard, tendant à supprimer l’article.
M. Arnaud Richard. Appelons un chat un chat : la représentativité syndicale peut entraîner, dans certaines entreprises, une forme de paralysie du dialogue social. La règle actuelle de validation des accords permet aux organisations syndicales défavorables de maintenir une position de neutralité sans pour autant bloquer systématiquement les accords négociés au sein de l’entreprise. À l’article 10, vous entérinez le principe d’une validation majoritaire des accords. De ce fait, certaines organisations auront désormais un droit de blocage automatique de tout accord, ce qui pourrait priver certaines entreprises de leur capacité à adapter leur organisation – pour parler de manière très diplomatique. En outre, face à la possibilité de telles situations de blocage, le recours au référendum n’est pas nécessairement une solution, dans la mesure où son organisation implique une préparation matérielle lourde et coûteuse à mettre en œuvre. Telles sont les raisons pour lesquelles nous avons déposé cet amendement de suppression, qui est aussi un amendement d’appel.
M. le rapporteur. Ainsi que cela nous a été rappelé au cours des auditions, lorsque le taux de 30 % a été fixé comme seuil de validité des accords, on nous expliquait déjà que cela empêcherait tout accord dans les entreprises. Or tel n’a pas été le cas. Aujourd’hui nous considérons, et les auditions ont conforté notre point de vue, que le passage de ce seuil à 50 % ne constituera pas non plus un frein à la négociation collective. J’en veux pour preuve que certaines entreprises, et non des moindres, ont d’ores et déjà instauré le principe de l’accord majoritaire.
Dès 2008, lors de la mise en place des accords à 30 %, il avait été précisé qu’il s’agissait d’une « étape préparant au passage à un mode de conclusion majoritaire des accords ». Nous ne faisons que nous inscrire dans cette tendance.
L’accord majoritaire prend tout son sens aujourd’hui, car il s’agit de donner un nouveau souffle à la négociation collective d’entreprise. C’est aussi un moyen de sécurisation. Je rappelle que ce texte doit nous permettre de maintenir un équilibre. En allant trop dans un sens ou trop dans l’autre, nous romprions cet équilibre, ce qui n’est ni le souhait du Gouvernement ni le mien. Avis défavorable.
La Commission rejette l’amendement.
Puis elle examine les amendements identiques AS334 de M. Gérard Cherpion et AS429 de M. Christophe Caresche.
M. Gérard Cherpion. J’ai bien entendu l’argumentaire que vous venez de développer, monsieur le rapporteur. D’un point de vue philosophique, on ne peut qu’être d’accord avec l’idée de progresser vers des accords à 50 %. Cela étant, aujourd’hui, un certain nombre d’entreprises – notamment une que vous avez certainement reçue en audition – sont totalement incapables d’obtenir un accord à 50 %. Combien de temps faudra-t-il à ces entreprises pour parvenir à un tel accord ? Que se passera-t-il pendant ce temps-là ? Il faut absolument maintenir les règles actuelles. À moins que vous n’ayez prévu un système qui ménage une transition ? À défaut, nous risquons d’être confrontés à un blocage de la négociation dans un certain nombre d’entreprises. Quant au référendum, pourquoi pas, mais il doit pouvoir être demandé non seulement par les syndicats de salariés, mais aussi par le chef d’entreprise. Tel est l’objet de l’amendement AS222 que je présenterai.
M. Christophe Caresche. Parmi les deux évolutions qui nous sont proposées, la généralisation de l’accord majoritaire est à mon avis l’évolution la plus notable et la plus importante : dans les faits, le recours au référendum restera exceptionnel. D’un point de vue purement intellectuel, il est difficile d’être contre cette généralisation ; c’est même plutôt une évolution intéressante. Toutefois, à ma connaissance, un certain nombre d’entreprises auront des difficultés à signer des accords dans ces conditions. Ainsi que le rapporteur l’a relevé, le dispositif actuel a plutôt bien fonctionné : de nombreux accords d’entreprise sont signés aujourd’hui, mais en appliquant les règles de validité actuelles. En généralisant les accords majoritaires, nous faisons un peu un saut dans l’inconnu. D’ailleurs, M. Combrexelle lui-même a considéré que cette évolution pouvait poser problème, puisqu’il a proposé une option intermédiaire dans son rapport, qui consisterait à réserver le système de validation majoritaire à un certain nombre de domaines de la négociation. Peut-être serait-il possible de travailler sur ce point d’ici à la séance publique ; mais pour l’heure, je propose, par mon amendement AS429, que nous en restions à la situation actuelle.
M. le rapporteur. Avec ces deux amendements, chers collègues, vous ne laissez aucune chance aux accords à 50 %, puisque vous les supprimez purement et simplement.
M. Christophe Caresche. Certes.
M. le rapporteur. D’autre part, je vous proposerai par amendement que la généralisation de l’accord majoritaire n’intervienne qu’à l’issue d’un retour d’expérience. D’ici là, le seuil de validité de 50 % s’appliquera exclusivement aux accords portant sur la durée du travail, les repos et les congés et aux accords de préservation et de développement de l’emploi.
Je n’ai pas la même appréciation que vous : je pense qu’il est possible de conclure des accords majoritaires dans les entreprises, de même qu’il a été possible de conclure des accords à 30 % en dépit des objections que l’on avançait à l’époque. Il faut aller dans le sens d’une légitimation des accords collectifs. Cela me paraît un élément important en termes de participation. Avis défavorable aux deux amendements : le dispositif proposé me paraît exagérément complexe au regard des objectifs que nous poursuivons.
M. Daniel Goldberg. D’après leur exposé sommaire, ces deux amendements visent à maintenir les règles actuelles. Or, selon celles-ci, les syndicats ayant obtenu la majorité des voix aux élections professionnelles peuvent s’opposer à un accord. En d’autres termes, les organisations syndicales ont, aujourd’hui, trois possibilités : signer l’accord, ne pas le signer, ne pas le signer et s’y opposer. Si vous adoptiez ces amendements, cette troisième possibilité disparaîtrait. Ce serait donc non pas un maintien des règles actuelles, mais une nouvelle donne très défavorable aux syndicats qui ont recueilli la majorité des voix des salariés.
L’amendement AS429 est retiré.
La Commission rejette l’amendement AS334.
La Commission examine l’amendement AS559 de M. Arnaud Richard.
M. Arnaud Richard. Pour que la règle évolue peu à peu vers celle de l’accord majoritaire, cet amendement de compromis vise à soumettre la validation d’un accord à sa signature par des organisations ayant obtenu au moins 40 % des suffrages. La légitimité des accords s’en trouverait renforcée, cependant que certaines organisations conserveraient la possibilité d’occuper une position de neutralité. Ce pas supplémentaire va dans le sens de l’histoire.
M. le rapporteur. Avis défavorable : si le passage d’un taux de représentativité de 30 % à un taux de 50 % a du sens, car il instaure le principe de l’accord majoritaire, le passage à un taux de 40 %, en revanche, me semble dépourvu de tout intérêt.
La Commission rejette l’amendement AS559.
Puis elle examine les amendements identiques AS417 de Mme Jacqueline Fraysse, AS644 de Mme Fanélie Carrey-Conte et AS745 de Mme Éva Sas.
Mme Jacqueline Fraysse. Par l’amendement AS417, nous entendons nous opposer à l’organisation d’un référendum d’entreprise à l’initiative d’organisations syndicales représentatives minoritaires ayant obtenu 30 % des suffrages. L’expérience montre en effet que ce serait ouvrir la porte aux manœuvres destinées à court-circuiter les organisations syndicales majoritaires. Sous prétexte de démocratie directe, cette mesure affaiblirait en réalité la légitimité syndicale, alors qu’aucun dialogue social n’est possible sans les syndicats. Cette disposition aurait pour résultat de favoriser les syndicats les plus « modérés » pour obtenir des accords favorables au patronat.
Certes, nul ne saurait croire que l’entreprise est un lieu de débat serein et neutre – même s’il arrive, et c’est heureux, que des accords positifs soient signés. Non, l’entreprise est un lieu rarement serein et jamais neutre, car des rapports de force et de domination s’y exercent, particulièrement en période de chômage où les tensions sont vives. Il va de soi que l’arme du référendum permettra au patronat d’isoler les salariés en empêchant la réflexion collective, car il est naturellement plus aisé d’obtenir des concessions d’individus que d’une collectivité, surtout lorsqu’il s’agit de conserver son emploi – l’affaire Smart a tristement illustré cette réalité que je n’invente nullement.
En clair, nous estimons qu’il s’agit d’une disposition extrêmement grave dont nous demandons la suppression.
Mme Fanélie Carrey-Conte. L’amendement AS644 vise lui aussi à supprimer les alinéas 8 à 15 de l’article. Je ne suis pas opposée par principe à l’idée de consulter les salariés mais, en l’occurrence, le référendum proposé présente plusieurs dangers pour les salariés. D’une part, il réduit à néant l’avancée que constitue l’accord majoritaire à 50 %, qui permet de sécuriser et de légitimer la négociation dans l’entreprise. D’autre part, le contexte étant ce qu’il est, les référendums ne porteront pas sur des nouveaux droits pour les salariés, mais plus vraisemblablement sur des mesures de modération salariale ou d’augmentation du temps de travail, comme l’illustrent deux référendums récents – sur le travail de nuit chez Séphora et sur le passage aux trente-neuf heures chez Smart.
Le référendum permettrait la pleine expression de la liberté des salariés, nous dit-on souvent. Cependant, les différentes parties prenantes d’une entreprise ne sont pas à égalité, puisque les salariés entretiennent un lien de subordination avec leur employeur. Quelle liberté peut-on donc exprimer lorsque la solution alternative consiste en une mesure de modération salariale, de délocalisation ou de licenciement, comme le montrent de nombreux exemples ?
Enfin, méfions-nous de cette fausse idée selon laquelle l’expression directe des salariés serait toujours le meilleur moyen de défendre les intérêts de tous et notamment des plus fragiles. C’est particulièrement le cas dans le domaine de l’égalité entre femmes et hommes : dans de nombreux secteurs professionnels où les femmes sont minoritaires, la volonté de la majorité, exprimée par référendum, pourrait aller à l’encontre des intérêts des salariées pour tout ce qui touche, entre autres, à l’organisation du temps de travail, le travail en soirée et le travail nocturne – toutes questions dont on sait bien qu’elles sont très discriminantes à l’égard des femmes.
Mme Isabelle Attard. Nous soutenons nous aussi la logique des accords majoritaires à 50 %, qui est la plus adaptée pour légitimer et responsabiliser les acteurs du dialogue social. L’instauration d’un droit de recours au référendum nous semble contre-productive et de nature à déresponsabiliser les partenaires sociaux dans la recherche de compromis efficaces et acceptables, tout en reniant les résultats des élections professionnelles. L’objectif d’un tel référendum est tout à fait discutable, puisque son instauration va de pair avec la volonté de privilégier la négociation collective à l’échelon de l’entreprise, là où le lien de subordination entre salariés et employeurs pèse de tout son poids et où les menaces de chantage à l’emploi sont les plus fortes. Songez à ce à quoi ont abouti des années de négociation sur le site de PSA à Aulnay, et à l’influence que peuvent avoir les syndicats « maison » dans les entreprises ! Quel pourrait être le résultat d’un référendum dès lors que les personnes qui y prennent part ne sont pas à égalité ?
Par principe, le référendum est souhaitable lorsque tous les participants sont à égalité et qu’il n’existe aucun lien de subordination entre eux. Il nous paraît très dangereux de permettre l’organisation d’un référendum dans l’entreprise, où il n’existe aucune garantie d’égalité entre les citoyens.
M. Bernard Accoyer. Ce refus catégorique de tout référendum d’entreprise nous inquiète et nous étonne. Il s’agit pourtant d’un mécanisme de démocratie directe portant sur des questions sociales. Confier une prééminence, voire une hégémonie à des groupes forcément éloignés des problèmes de chaque individu nuit à l’expression des libertés individuelles fondamentales. La méthode en vigueur jusqu’ici a montré à de nombreuses reprises qu’elle donnait lieu au sein de l’entreprise à des blocages qui pouvaient se traduire par des catastrophes économiques, et donc sociales. J’appelle nos collègues à porter un regard nouveau sur la réalité de l’économie d’aujourd’hui !
M. Gérard Sebaoun. Je retiens des auditions que nous avons conduites que le référendum est une procédure lourde, et que la seule demande de référendum – d’où qu’elle émane – produira des tensions dans de nombreuses entreprises où il existe pourtant un accord majoritaire. Je ne suis donc pas certain que la liberté et les rapports sociaux dans l’entreprise y gagnent ; c’est pourquoi je soutiendrai ces amendements.
Mme Jacqueline Fraysse. Les propos de M. Accoyer confirment la pertinence de mon amendement : pour qu’elle puisse s’exercer, la liberté d’expression, à laquelle je suis très attachée, suppose une réelle égalité entre les citoyens – qui n’existe pas dans l’entreprise. Que diraient les parlementaires de la majorité si les textes qu’ils adoptent étaient soumis à référendum par leurs collègues minoritaires ? Je doute qu’ils apprécieraient…
M. le rapporteur. La priorité demeure la recherche d’un accord majoritaire. Le référendum, madame Fraysse, ne remet aucunement en cause les organisations syndicales majoritaires, puisqu’il est clairement prévu que le recours au référendum soit possible en l’absence d’accord majoritaire, autrement dit lorsque les organisations signataires ont recueilli entre 30 % et 49,99 % des suffrages ; cet argument souvent entendu est donc inexact.
Néanmoins, les organisations syndicales ayant recueilli au moins 30 % des suffrages peuvent – sans que l’obligation leur en soit faite – demander la consultation des salariés afin de légitimer les accords conclus. De ce point de vue, l’alinéa 9 est extrêmement précis et permettra d’éviter toute confusion.
En clair, loin de remettre en cause le principe majoritaire et la recherche d’un accord majoritaire, cette disposition vise simplement à débloquer la situation en ouvrant la possibilité de consulter les salariés lorsqu’un accord a été conclu par des organisations ayant recueilli entre 30 % et 50 % des suffrages.
La Commission rejette les amendements AS417, AS644 et AS745.
Puis elle adopte l’amendement rédactionnel AS917 du rapporteur.
Elle passe à l’amendement AS329 de M. Élie Aboud.
M. Élie Aboud. Mme Fraysse a évoqué avec raison certaines lois adoptées ici et qui pourraient connaître un sort inverse si elles étaient soumises à un verdict populaire ; permettez-moi de citer le cas d’un grand projet structurant de la région nantaise qui a été validé par toutes les voies juridiques et administratives, et pour lequel un référendum sera tout de même organisé ! La France serait donc une grande entreprise où le référendum est possible, tandis qu’il ne le serait pas dans une véritable entreprise qui crée des emplois !
Mon amendement AS329 vise à valoriser la consultation des salariés, car ce sont eux qui font la vie de l’entreprise !
M. le rapporteur. Avis défavorable. Il serait étonnant de confier l’initiative de la consultation des salariés à l’employeur alors que notre objectif est de permettre aux organisations syndicales de chercher à légitimer leurs positions par un référendum d’entreprise ! Au demeurant, une telle inversion bloquerait complètement le dialogue social et risquerait, comme le faisait remarquer M. Sebaoun, de créer de fortes tensions dans l’entreprise, a fortiori si l’employeur décidait de tenir une consultation contre l’avis des organisations syndicales.
La Commission rejette l’amendement AS329.
Puis elle examine, en discussion commune, les amendements AS602 de M. Rémi Delatte et AS299 de M. Daniel Goldberg.
M. Élie Aboud. L’amendement AS602 est défendu.
M. Daniel Goldberg. Mon amendement AS299 vise à ce que la tenue d’un référendum d’entreprise puisse être proposée non pas par une seule organisation syndicale, mais par plusieurs. Dans certaines entreprises, une organisation syndicale peut avoir obtenu 30 % des suffrages : en décidant de consulter les salariés, elle pourrait contourner la voix de celles qui ont rassemblé les 70 % de suffrages restants. Si la possibilité du référendum doit être ouverte, malgré les craintes qu’elle suscite, je propose qu’elle ne soit donc réservée qu’à plusieurs syndicats.
M. le rapporteur. Avis défavorable. Votre proposition, monsieur Goldberg, reviendrait à créer un droit de veto majoritaire. Si, dans une entreprise donnée, deux organisations syndicales ont chacune obtenu 40 % des suffrages et une troisième en a recueilli 20 %, l’une des deux premières ne pourrait pas demander l’organisation d’un référendum puisque les deux autres pourraient s’y opposer. Cela ne me semble pas être l’esprit de la mesure que nous voulons adopter.
M. Rémi Delatte. Il me semble très important de donner la possibilité à l’employeur de recourir au référendum d’entreprise. Tout d’abord, c’est une mesure d’équité, de justice et d’équilibre. Par ailleurs, j’ai bien compris que la pertinence du référendum d’entreprise est diversement appréciée ; ce mécanisme me semble pourtant utile, ne serait-ce que parce qu’il permet d’exercer une liberté d’expression fondamentale. Je m’étonne des critiques qui ont été formulées à son égard, qui sont en pleine contradiction avec l’objectif de protection des salariés.
M. Yves Censi. À entendre le rapporteur, le chef d’entreprise n’a aucune légitimité pour organiser un référendum : cette vision théorique, idéologique même, de la lutte des classes ne correspond en rien à la réalité de l’entreprise. Au contraire, cette mesure salutaire permettrait de débloquer certaines situations. Le référendum est une forme de respiration démocratique dans l’entreprise qui est susceptible de relancer un débat totalement bloqué sur des questions relatives au temps de travail, par exemple, jusqu’à aboutir à un accord qui n’aurait pas été possible sans consultation des salariés. Abandonnons l’idée selon laquelle il existe une véritable séparation de classes entre employeur et salariés : c’est faux.
La Commission rejette les amendements AS602 et AS299.
Elle passe à l’amendement AS300 de M. Daniel Goldberg.
M. Daniel Goldberg. Je suis favorable à la tenue de référendums pourvu qu’ils soient organisés dans des conditions qui ne mettent pas en péril les organisations professionnelles et qui permettent à chacun, employeurs comme salariés, de se sentir à l’aise dans l’entreprise et d’y négocier des accords. Cela étant, la possibilité de déclencher un référendum, telle qu’elle est prévue en l’état actuel du texte, c’est-à-dire à l’initiative d’organisations syndicales ayant recueilli 30 % des suffrages, pose problème. Imaginons que, dans une commune, l’opposition municipale représentant 30 % des voix ait ainsi un droit de tirage automatique lui permettant de consulter la population. Qu’en dirait la majorité ?
L’entreprise, comme la collectivité locale, est une communauté humaine. Il me semble souhaitable de permettre aux organisations syndicales ayant recueilli 50 % des suffrages et n’ayant pas signé un accord, de pouvoir déclencher un référendum – lequel renforcera la légitimité de l’accord s’il lui est favorable.
M. le rapporteur. En l’état, le texte n’ouvre cette possibilité qu’aux organisations signataires de l’accord. J’ajoute, monsieur Goldberg, que si l’organisation syndicale en question a obtenu 50 % des suffrages, alors l’accord est majoritaire et validé, et aucune consultation n’est possible.
M. Alain Calmette. L’analogie entre les entreprises et les collectivités locales ne me semble pas valable. En cas d’accord majoritaire, aucun référendum n’est possible. En l’état, le texte trouve un équilibre très pertinent dans lequel les accords majoritaires peuvent en priorité découler de la signature d’organisations syndicales représentant plus de 50 % des suffrages ou – en contrepartie, en quelque sorte, du passage de 30 % à 50 % – de la consultation des salariés. Je comprends mal les réticences que suscite un tel mécanisme.
M. Daniel Goldberg. Imaginons le cas d’une entreprise où une organisation syndicale représentant 30 % des suffrages signerait un accord – mais ne pourrait désormais plus le faire valider sans consultation – et une autre, qui ne représenterait que 20 % des suffrages, ne signerait pas l’accord mais en accepterait certains des points et approuverait le principe du référendum.
Il se peut certes que mon amendement pose un problème de forme : soit, nous y reviendrons avant la séance. Entendons-nous néanmoins sur le principe consistant à permettre à des organisations signataires ou non signataires d’un accord et représentant ensemble 50 % des suffrages de déclencher un référendum. Aux trois possibilités actuelles – signer l’accord, ne pas le signer et s’y opposer – se substitueraient donc les possibilités suivantes : on signe l’accord sans demander de référendum, on signe et on en demande un, ou on ne signe mais on en demande un. Un référendum positif donnerait une assise supplémentaire à l’accord et favoriserait le dialogue social.
M. le rapporteur. Sur la forme, il est exact que votre amendement, en l’état, n’est pas applicable. Sur le fond, je comprends votre intention de ne pas réserver aux seules organisations signataires le droit de participer au débat. Cependant, le fait que certaines ne soient pas signataires signifie qu’il n’y a pas eu d’accord entre elles. Il serait étonnant, dans ces conditions, que l’on recherche tout de même un accord sur le principe de la consultation… Le fait que le seul point d’accord soit l’organisation d’un référendum se traduirait par une belle instabilité dans l’entreprise ! Je maintiens donc mon avis défavorable, tant sur la forme que sur le fond.
La Commission rejette l’amendement AS300.
Puis elle examine l’amendement AS222 de M. Gérard Cherpion.
M. Gérard Cherpion. L’article 10 prévoit d’étendre le champ de l’accord majoritaire, ce qui risque de rendre plus difficile la conclusion d’accords collectifs dans certaines entreprises, d’où des situations de blocage. Une modalité alternative est donc prévue de telle sorte que les organisations syndicales signataires représentant entre 30 % et 50 % des suffrages puissent demander la consultation des salariés, étant entendu que si la majorité des salariés s’exprime en faveur de l’accord, celui-ci est réputé valide.
Mon amendement AS222 vise à étendre le recours à la consultation directe à l’initiative de l’employeur, afin de rééquilibrer le dispositif.
M. le rapporteur. Nous revenons au débat de tout à l’heure. Avis défavorable.
La Commission rejette l’amendement AS222.
Elle examine l’amendement AS313 de M. Christophe Cavard.
M. Christophe Cavard. Il me semble important d’encadrer la procédure du référendum dans le temps, comme le souhaitent certains partenaires sociaux. L’amendement AS313 vise à préciser que les organisations disposent de huit jours pour indiquer qu’elles souhaitent une consultation des salariés. En l’état, le texte ne fixe aucun délai.
M. le rapporteur. Je suis favorable au principe consistant à fixer un délai, mais le délai de huit jours me paraît trop court, notamment en cas de vacances scolaires. Je propose à M. Cavard de retirer son amendement pour le préciser d’ici la séance.
M. Christophe Cavard. Je vous fais la contre-proposition suivante : je veux bien rectifier mon amendement de telle sorte que le délai soit plus long.
M. le rapporteur. Un délai d’un mois me paraît tout à fait compatible avec les enjeux.
M. Christophe Cavard. D’accord.
M. Yves Censi. Tout cela n’est pas sérieux. On passe de huit jours à un mois… Voilà précisément un cas de complexification du code du travail où les procédures se chevauchent entre elles. La moindre erreur commise par un chef d’entreprise ou par un cadre concernant ce délai deviendra source de confrontations en tous genres. Il ne me paraît pas raisonnable d’adopter des amendements fixant de tels délais qui, loin de simplifier le texte, le complexifient. Prenons au moins le temps d’un débat sérieux sur la question !
M. le rapporteur. Le délai d’un mois sécurise le dispositif. Le changement de délai n’a aucun effet sur la complexité du texte ; au contraire, il laisse le temps de rassembler tous les éléments relatifs à l’accord qui sont nécessaires à la tenue d’un référendum.
La Commission adopte l’amendement AS313 tel qu’il vient d’être rectifié.
La Commission examine l’amendement AS315 de M. Christophe Cavard.
M. Christophe Cavard. Cet amendement prévoit que la consultation des salariés visant à valider l’accord d’entreprise doit intervenir dans un délai maximum de deux mois ; ce délai qui me paraît suffisant pour permettre à tous de bien s’organiser.
Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement.
Puis elle en vient à l’amendement AS589 de M. Gilles Savary.
M. Gilles Savary. Aux termes de l’alinéa 11, la définition des modalités de la consultation prévue à l’alinéa 9 doit faire l’objet d’un protocole spécifique conclu entre l’employeur et les organisations syndicales signataires de l’accord à valider. Rien n’est cependant prévu en cas de refus d’une organisation signataire de conclure ce protocole ni dans l’hypothèse où une organisation, hostile à cette consultation, ferait traîner la négociation du protocole. Nous proposons donc de supprimer purement et simplement celui-ci pour nous en tenir au droit électoral général et de permettre de placer les opérations de vote sous contrôle de l’autorité publique – préfet ou direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) – à la simple demande de l’employeur ou d’un salarié de l’entreprise concernée.
M. le rapporteur. Je ne partage pas votre appréciation. Le protocole est un élément essentiel de la consultation : il permet notamment de définir les modalités d’information des salariés ainsi que les modalités d’organisation et de déroulement du vote. De toute façon, si le protocole n’est pas approuvé, l’accord ne le sera pas davantage. Rien ne justifie par conséquent la suppression de ce protocole.
D’autre part, je doute de l’opportunité de faire appel à l’autorité administrative en amont de toute contestation. Non seulement cela risque d’alourdir considérablement l’organisation de la consultation mais je ne suis pas convaincu que cette autorité dispose aujourd’hui des moyens suffisants pour répondre aux demandes qui pourraient lui être adressées.
Avis défavorable.
La Commission rejette l’amendement.
Elle aborde l’amendement AS301 de M. Daniel Goldberg.
M. Daniel Goldberg. Le fait que le protocole soit qualifié de « spécifique » nous pose un problème d’interprétation. Les modalités d’organisation de la consultation des salariés doivent-elles être négociées une fois pour toutes dans l’entreprise ou bien faut-il établir un protocole d’organisation électorale propre à chaque référendum ? Dans le second cas, la durée de six mois prévue dans mon amendement ne tient pas. Mais si nous retenons la rédaction actuelle de l’alinéa 11, seules les organisations favorables à l’accord et l’employeur définiront les modalités précises de la consultation. Si nous voulons garantir à coup sûr l’honnêteté des opérations électorales, il conviendrait pour le moins d’y associer le plus largement possible toutes les parties prenantes et que, dans chaque entreprise, le protocole d’organisation des référendums soit discuté à froid par toutes les organisations syndicales et non par les seules signataires de l’accord à valider.
M. le rapporteur. Rien ne l’empêche aujourd’hui. Le protocole n’est pas forcément lié à un accord donné : il peut très bien être générique et couvrir tous les accords. Qui plus est, votre proposition est contradictoire avec l’amendement AS315 que nous venons d’adopter et qui prévoit que la consultation des salariés visant à valider l’accord d’entreprise doit intervenir dans un délai de deux mois. Avis défavorable.
M. Richard Ferrand. La négociation d’un protocole spécifique aux opérations électorales porte en soi le ferment de contestations éventuelles, y compris devant les juridictions compétentes. Compte tenu des multiples délais que nous venons d’insérer dans le texte, nous risquons, si nous n’adoptons pas cet amendement, de créer un système de contestations permanentes et de faire de cette consultation un serpent de mer qui polluera en permanence la vie dans l’entreprise. Il me semblerait donc infiniment plus simple de fixer par voie réglementaire les modalités d’organisation de cette consultation et d’en informer chaque salaire par le biais d’une circulaire. Alors que nous essayons justement de simplifier les procédures et de donner une plus large part à la démocratie directe, nous risquons, en multipliant les étapes de pré-négociation, de créer un bazar sans nom, au point d’en faire un véritable antidote à l’organisation de ce référendum. Simplifions tout cela en le renvoyant à une norme, réglementaire ou autre, faute de quoi nous allons lasser tout le monde.
M. Rémi Delatte. Très bien !
M. Yves Censi. Je comprends que le rapporteur soit dans une position difficile, lui qui est obligé de négocier avec le Gouvernement et les différents courants de la majorité. Cela étant, je l’engage à ne pas céder aux différentes propositions qui lui sont faites. Notre discussion illustre parfaitement ce que je disais tout à l’heure : nous avons voté un amendement instaurant un délai et voilà que nous débattons à nouveau de l’instauration d’un autre délai – de six mois entre l’adoption du protocole et la consultation. C’est à la fois déraisonnable, et surtout complètement théorique. Il serait bon que nous évitions d’ajouter par amendement toute forme de délai au dispositif : comme vient de le dire notre collègue, cette question relève du décret et aurait dû faire l’objet de négociations avec les partenaires sociaux, acteurs qui connaissent très bien le détail des procédures.
M. Gérard Sebaoun. Les modalités de contestation de la consultation électorale seront-elles fixées par décret ? Devant qui pourra-t-on contester ?
M. Richard Ferrand. Devant le tribunal d’instance.
M. Daniel Goldberg. Je partage les remarques de mes collègues : les modalités d’organisation du référendum ne doivent laisser aucune place à la contestation. Or ce projet de loi prévoit que seules les parties favorables à l’accord – le chef d’entreprise et une minorité de 30 % des organisations syndicales – organiseront le scrutin, ce qui n’est pas sans poser problème. J’entends bien que la rédaction de mon amendement laisse à penser qu’il y aurait un délai de six mois entre l’adoption du protocole et la date de chaque consultation. Cela n’étant pas mon souhait, je vais le retirer et propose soit qu’un décret stabilise les règles applicables, soit que l’on prévoie une négociation à froid entre toutes les parties en présence dans l’entreprise sur l’organisation d’un référendum.
M. le rapporteur. Je vous propose, cher collègue, que nous retravaillions ensemble cette question afin de mettre au point les dispositions à prendre à défaut de protocole. Nous avons intérêt à sécuriser tout cela.
L’amendement AS301 est retiré.
La Commission est saisie de l’amendement rédactionnel AS810 du rapporteur.
M. Gérard Cherpion. Je ne suis pas certain que cet amendement ait une portée strictement rédactionnelle… Et s’il n’y a qu’un établissement ?
M. le rapporteur. L’article indéfini « des » recouvre « un ou plusieurs ».
La Commission adopte l’amendement.
Elle adopte ensuite l’amendement de précision AS811 du rapporteur.
Puis elle examine l’amendement AS302 de M. Daniel Goldberg.
M. Daniel Goldberg. Cet amendement concerne lui aussi l’organisation du référendum, qui prendra le pas sur l’accord majoritaire. Souvenez-vous du débat que nous avions eu l’an dernier sur l’extension du travail dominical : la règle annoncée était qu’en l’absence d’accord, il n’y aurait pas d’ouverture des magasins le dimanche. Avec le projet de loi, même en l’absence d’accord, cette ouverture serait finalement possible si les salaires l’acceptent par référendum. Cela concerne notamment une grande enseigne de distribution culturelle qui, sans doute, a voulu avancer sur ce terrain…
Se pose néanmoins la question de la participation minimale des salariés au référendum dès lors que ce dernier prendra le pas sur le contrat de travail. Je propose donc que le résultat du référendum ne soit valide que si le taux de participation atteint celui enregistré lors des élections professionnelles.
M. le rapporteur. Je connais peu de cas dans lesquels le code du travail impose un taux de participation minimal. Qui plus est, si nous en instaurions un dans ce texte, cela pourrait entraîner des conséquences sur d’autres consultations. Votre amendement me semble davantage porteur de difficultés que de solutions. Dès lors qu’une consultation est ouverte, chaque salarié peut y participer. S’il s’en abstient, cela peut constituer un élément d’analyse du scrutin mais on ne peut subordonner la validation de ce dernier à l’atteinte d’un taux minimal de participation. Avis défavorable.
La Commission rejette l’amendement.
Elle adopte successivement l’amendement rédactionnel AS812 et l’amendement de coordination AS918 du rapporteur.
Elle en vient ensuite aux amendements identiques AS880 de la Commission des affaires économiques, AS124 de M. Hervé Pellois et AS460 de Mme Jeanine Dubié.
M. Yves Blein, rapporteur pour avis de la Commission des affaires économiques. Ces amendements visent le problème spécifique de l’organisation du dialogue social dans les chambres d’agriculture. Si la loi d’avenir pour l’agriculture a instauré une règle de mesure de la représentativité syndicale, il n’existe aucune norme applicable en matière de capacité à négocier ni de conditions de validité des accords. Ainsi, dans le réseau des chambres d’agriculture, une organisation syndicale non représentative est invitée à négocier et peut conclure un accord s’appliquant à tous les salariés. Sachant que les négociations vont être indispensables pour organiser la régionalisation et la modernisation du réseau, il est essentiel de conforter la légitimité des accords collectifs en renforçant la majorité dite d’engagement. Tel est l’objet de l’amendement AS880.
Mme Annie Le Houerou. L’amendement AS124 est défendu.
Mme Dominique Orliac. Dans les chambres d’agriculture, le cadre statutaire est peu propice à la négociation que la présente loi vise à favoriser aux niveaux les plus pertinents. Notre amendement AS460 est calqué sur les dispositions prévues par le code du travail et la présente loi.
Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte les amendements identiques AS880, AS124 et AS460.
Puis elle est saisie de l’amendement AS1040 du rapporteur.
M. le rapporteur. Cet amendement vise à reporter au 1er janvier 2017 la généralisation des accords majoritaires relatifs à la durée du travail, aux repos et aux congés. L’objectif est de permettre aux partenaires sociaux de mieux s’approprier les nouvelles règles de validité des accords collectifs et de ne pas compromettre les négociations en cours.
La Commission adopte l’amendement.
Elle aborde l’amendement AS919 du rapporteur.
M. le rapporteur. Cet amendement tient compte des déclarations du Premier ministre sur la nécessité d’avoir un retour d’expérience à partir des accords relatifs à l’organisation du temps de travail. Nous demandons au Gouvernement de remettre au Parlement un rapport présentant un bilan de l’application des nouvelles conditions de validité des accords collectifs portant sur la durée du travail, les repos et les congés. Ces retours d’expérience doivent également nous permettre d’évaluer l’opportunité d’une généralisation de ces dispositions à d’autres domaines – le texte actuel prévoyant quant à lui l’automaticité de cette dernière.
M. Daniel Goldberg. Si j’approuve la démarche du rapporteur, quel rôle le Parlement aura-t-il à jouer une fois que ce rapport lui aura été remis ? Pourra-t-il se prononcer, par voie législative ou autre, avant que le nouveau dispositif ne soit généralisé aux autres questions de droit que la durée du travail, les repos et les congés ?
M. le rapporteur. Je vous confirme que mon amendement implique l’adoption d’un nouvel acte législatif préalablement à la généralisation du dispositif.
M. Daniel Goldberg. Dans ce cas, je retire mon amendement AS304.
L’amendement AS304 est retiré.
La Commission adopte l’amendement AS919.
En conséquence les amendements identiques AS881, AS303 et AS305 tombent.
Enfin, la Commission adopte l’article 10 modifié.
*
* *
La Commission examine l’amendement AS882 de la Commission des affaires économiques.
M. Yves Blein, rapporteur pour avis de la Commission des affaires économiques. Ce projet de loi traduit le choix de renforcer la négociation collective dans les entreprises afin que s’élaborent au plus près du terrain les règles permettant le développement économique de notre pays. Pour que les effets de ce pari se fassent pleinement ressentir, il est impératif que cette capacité de discussion puisse atteindre tout le tissu des TPE et des PME dans lesquelles les organisations syndicales sont souvent faiblement représentées. Il nous faut développer la culture et la pratique du dialogue social et ainsi permettre progressivement aux organisations syndicales de réussir et parfaire leur implantation.
Pour ce faire, il convient d’autoriser plus largement les représentants du personnel, même lorsqu’ils ne sont pas mandatés, à conclure des accords collectifs de travail, comme le prévoit le I de cet amendement adopté par la Commission des affaires économiques. Dans les entreprises de moins de cinquante salariés dépourvues de représentants du personnel, est prévue au IV la possibilité qu’un ou plusieurs salariés soient spécifiquement élus par leurs pairs pour négocier un accord avec l’employeur. Cet accord devrait ensuite être validé par au moins deux tiers des personnels de l’entreprise.
Ces propositions n’ont pas été conçues dans l’objectif de contourner la représentation syndicale mais bien dans celui de favoriser la culture du dialogue et de la négociation, propice au développement de la syndicalisation dans les entreprises – les organisations syndicales ayant aujourd’hui du mal à pénétrer dans le tissu des TPE-PME. Un salarié qui sera demain désigné par ses pairs pour négocier un accord aura forcément, à un moment ou à un autre, besoin d’un expert qui puisse lui apporter un regard sur la situation dans laquelle il se trouve : il se tournera alors naturellement vers les organisations syndicales – de gré plutôt que de force. La représentation syndicale devrait donc s’en trouver encouragée dans les petites entreprises où elles sont pour l’heure peu présentes.
M. le rapporteur. Je suis résolument hostile à cet amendement qui, d’une part, est en contradiction avec l’argumentation que nous avons soutenue tout au long de nos travaux sur le mandatement et, d’autre part, présente une difficulté : non seulement vous supprimez la priorité accordée aux élus et aux salariés mandatés mais, plus grave encore, vous autorisez des élus non mandatés à négocier des accords non pas par défaut, mais au même titre que les élus mandatés. Vous autorisez par ailleurs des salariés non mandatés élus par leurs pairs à négocier tout type d’accord. C’est là une négation totale de l’équilibre du projet de loi et de la nécessaire prise en compte de l’ensemble des partenaires. Autrement dit, vous nous suggérez de prendre le risque de permettre à des salariés ne bénéficiant pas de l’assistance d’une organisation syndicale de négocier des accords susceptibles d’être moins protecteurs. D’autre part, votre amendement permettrait de ratifier à la majorité des deux tiers un projet d’accord unilatéral de l’employeur si aucun salarié n’a souhaité négocier. Cela me paraît totalement inacceptable.
M. Christophe Cavard. Je souhaite apporter mon soutien au rapporteur. L’argument consistant à dire que cet amendement renforcerait le désir de négociation des salariés pourrait être entendu si la mesure proposée n’était pas aussi prématurée. Le projet de loi permet d’ouvrir le dialogue social dans le cadre du mandat et de règles définissant les modalités de la négociation : s’il a des effets positifs, cette culture de la négociation se développera au niveau de l’entreprise, avec des salariés mieux formés, mieux syndiqués. Peut-être pourra-t-on alors envisager l’adoption de dispositifs du type de celui que vous proposez. Mais pour l’heure, ce serait extrêmement risqué.
M. Gérard Sebaoun. J’abonderai moi aussi dans le sens du rapporteur. Nous voulons des salariés rompus à la négociation, car c’est un exercice extrêmement compliqué. Je vous laisse imaginer le déséquilibre qu’instaurerait cet amendement.
M. Alain Calmette. On ne peut pas non plus écarter d’un revers de main l’absence de dialogue social dans nombre de PME où le seul fait de parler de mandatement est immédiatement ressenti comme posant une difficulté majeure. Si nous nous accordons tous pour favoriser le dialogue social et l’implantation syndicale dans les petites entreprises, nous sommes tout de même confrontés à une attitude systématique de refus, voire de rejet réciproque. Il me semblerait donc intéressant d’expérimenter une formule préfigurant le mandatement, sans le contourner, qui permettrait de favoriser la syndicalisation au fil du temps au sein des PME.
M. Gérard Cherpion. Je soutiens cet amendement qui me semble tout à fait conforme à l’esprit du projet de loi dans la mesure où il vise, de façon tout à la fois ouverte et encadrée, au renforcement de la négociation collective dans les entreprises.
La Commission rejette l’amendement AS882.
Elle est saisie de l’amendement AS118 de Mme Isabelle Le Callennec.
M. Gérard Cherpion. En prévoyant l’extension des accords majoritaires dans l’entreprise aux accords collectifs relatifs à la durée du travail, aux repos et aux congés ainsi que la généralisation de cette extension dès septembre 2019 à l’ensemble des accords collectifs, le projet de loi fait le choix de placer l’entreprise au cœur du dialogue social. C’est bien au niveau de l’entreprise qu’il faut arrimer la négociation collective. Cette avancée ne trouvera toutefois pas à s’appliquer dans un grand nombre de PME et d’ETI dépourvues d’organisations syndicales représentatives.
En élargissant le champ de la négociation collective, le présent amendement prévoit donc la possibilité pour ces PME et ETI de négocier et de signer des accords tout en définissant les conditions de validité et d’application de ces derniers. Il s’agit ainsi de dynamiser et de renforcer la démocratie sociale dans ces entreprises.
M. le rapporteur. Avis défavorable. Non seulement vous proposez de modifier les conditions de validation d’un accord négocié par des représentants élus non mandatés, mais vous supprimez l’obligation de validation de l’accord par la commission paritaire de branche – qui, exerçant un contrôle de légalité, est un garde-fou important. Enfin, vous souhaitez instaurer l’obligation de recueillir l’approbation des salariés pour pouvoir valider chaque accord ainsi négocié. Vous qui parliez d’alléger, vous proposez largement ce qu’il faut sur le plan des lourdeurs administratives…
La Commission rejette l’amendement.
*
* *
Article 11
(Art. L. 2254-2 [nouveau], L. 2323-15 et L. 2325-35 du code du travail)
Accords de préservation ou de développement de l’emploi
Cet article crée un nouveau cadre juridique permettant aux entreprises de conclure, par la voie de la négociation collective dans l’entreprise, un accord destiné à préserver ou à développer l’emploi.
En matière de préservation de l’emploi, la volonté de privilégier le dialogue social n’est pas inédite : plusieurs dispositifs de flexibilité existent dans notre droit du travail, tels que les accords de maintien de l’emploi, créés par la loi n° 2013-504 relative à la sécurisation de l’emploi, ou les accords d’aménagement du temps de travail créés par la loi n° 2008-789 du 20 août 2008. Ces dispositifs ont permis de développer des alternatives aux licenciements par l’intermédiaire de la négociation collective, dans une logique de préservation de la compétitivité. Toutefois, ils ne permettent pas de répondre à l’ensemble des situations dans lesquelles il est nécessaire de préserver ou de développer l’emploi :
− en premier lieu, les dispositifs existants s’adressent principalement à des entreprises confrontées à des difficultés économiques conjoncturelles avérées. Or le besoin de souplesse d’une entreprise peut tout aussi bien survenir en amont, voire en dehors de difficultés économiques marquées, pour soutenir, par exemple, une logique de croissance et de développement de l’entreprise − et donc de l’emploi ;
− en second lieu, lorsque ces dispositifs sont le fruit d’un accord collectif, leur mise en œuvre dépend le plus souvent de l’adhésion individuelle des salariés. En d’autres termes, tout salarié peut refuser de se voir appliquer l’accord, sans que ce refus représente en lui-même un motif de licenciement. Or, ces stratégies individuelles peuvent avoir pour effet de vider de leur portée les accords négociés.
Les accords de préservation et de maintien de l’emploi visent à surmonter ces deux écueils. Par ailleurs, dans le prolongement de la volonté réaffirmée par ce projet de loi de faire confiance aux partenaires sociaux pour la conduite de la négociation collective dans l’entreprise, cet article confie aux syndicats la responsabilité de trouver un équilibre entre l’indispensable recherche de protection de l’emploi des salariés et le maintien ou le développement de l’activité dans l’entreprise.
La mise en place d’un accord de préservation ou de maintien de l’emploi est néanmoins assortie de plusieurs garde-fous, tels que la possibilité d’avoir recours à une expertise indépendante, le maintien de la rémunération mensuelle et la validation par accord majoritaire.
Les accords de préservation et de développement de l’emploi sont créés par le I, qui complète par un nouvel article L. 2254-2 le chapitre IV du titre V du livre II de la deuxième partie du travail relatif aux rapports entre les conventions et accords collectifs de travail et le contrat de travail.
Le choix de cet emplacement n’est pas anodin : contrairement aux autres dispositifs en faveur de l’emploi, qui relèvent de la partie du code du travail consacrée à l’emploi (titre II du livre Ier de la cinquième partie du code du travail), cette nouvelle catégorie d’accords propose en effet non seulement de donner aux entreprises les moyens de préserver ou de développer l’emploi, mais également une nouvelle articulation des rapports entre accords collectifs et contrats de travail, en faisant primer l’accord sur le contrat.
L’accord de préservation ou de développement de l’emploi relève du droit commun applicable aux accords collectifs ; sont ainsi conviées à la négociation par l’employeur les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Le deuxième alinéa du III de l’article L. 2254-2 précise que le comité d’entreprise peut mandater un expert-comptable afin d’assister les organisations syndicales dans la négociation. L’analyse apportée par l’expert-comptable permettra aux membres du comité d’entreprise d’être éclairés sur la situation financière de l’entreprise, compte tenu par exemple de l’évolution de son chiffre d’affaires ou de l’état prévisionnel de sa trésorerie.
En vertu de l’article L. 2325-35 du même code, les frais de l’expertise indépendante sont supportés par l’employeur. Le III modifie par conséquent l’article L. 2325-35 afin d’ajouter ce type d’expertise à la liste des situations dans lesquelles l’employeur peut se faire assister par un expert-comptable.
Le rapporteur regrette toutefois que l’expertise soit conditionnée à l’existence d’un comité d’entreprise. Dans les entreprises de moins de cinquante salariés dépourvues de comité d’entreprise, les organisations syndicales se verraient ainsi dans l’incapacité de recourir à une expertise indépendante.
L’article L. 2254-2 précise que l’accord est conclu au niveau de l’entreprise, ce qui exclut a priori la possibilité de conclure un accord au niveau de l’établissement. En revanche, il résulte de la nouvelle rédaction de l’article L. 2232-33 du code du travail proposée au 3° de l’article 12 du présent projet de loi qu’une négociation en vue de conclure un accord de préservation ou de développement de l’emploi peut être engagée au niveau d’un groupe d’entreprises. Dans cette hypothèse, les organisations syndicales de salariés représentatives dans chacune des entreprises comprises dans le périmètre de l’accord sont spécifiquement informées de l’ouverture de la négociation.
Contrairement aux accords de maintien de l’emploi prévus par la loi du 14 juin 2013, qui sont conclus pour une durée limitée – initialement fixée à deux ans, mais relevée à cinq ans par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 relative à la croissance, à l’activité et à l’égalité des chances économiques −, cet article ne prévoit aucune durée préfixée de validité des accords de préservation et de développement de l’emploi.
En conséquence, à défaut de stipulation expresse, ces accords auront une durée de vie de cinq ans, comme le prévoit l’article 7 du projet de loi. En application du premier alinéa de l’article L. 2222-4 du code du travail, les syndicats pourront toutefois prévoir que l’accord s’applique pour une durée déterminée différente de celle applicable par défaut, voire pour une durée indéterminée. Remarquons cependant qu’il paraît peu pertinent, au regard de l’objectif poursuivi par les accords de préservation ou de développement de l’emploi, de retenir une durée déterminée, dans la mesure où le besoin de flexibilité de l’employeur correspond à un contexte économique donné, qui n’a pas forcément vocation à s’inscrire dans la durée. Il paraît nécessaire a minima de prévoir la révision des conditions ayant conduit à l’adoption de l’accord.
Le I de l’article L. 2254-2 dispose que les stipulations des accords visant à préserver ou à développer l’emploi « se substituent de plein droit aux clauses contraires et incompatibles du contrat de travail ».
La primauté de l’accord sur le contrat individuel proposée ici est une disposition tout à fait exorbitante du régime de droit commun mentionné à l’article L. 2254-1 du même code et habituellement applicable aux rapports entre les conventions et accords collectifs et le contrat de travail : cet article précise en effet que « lorsqu’un employeur est lié par les clauses d’une convention ou d’un accord, ces clauses s’appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf stipulations plus favorables ». En vertu de ce principe de faveur, l’employeur ne peut modifier un élément essentiel du contrat de travail – tel que la rémunération ou le lieu de travail − portant sur une disposition quelconque moins favorable liée à un accord.
Plusieurs exceptions à la règle posée à l’article L. 2254-1 ont toutefois déjà été consacrées par le code du travail − l’étude d’impact en recense quatre. L’article L. 1222-7 dispose par exemple que la diminution du nombre d’heures stipulé au contrat de travail en application d’un accord de réduction de la durée du travail ne constitue pas une modification du contrat de travail.
Dans son rapport (25), M. Jean-Denis Combrexelle s’interrogeait sur la pertinence de déroger à l’article L. 2254-1 de manière plus large, lorsque l’emploi est en cause et que l’accord vise « à le protéger, le maintenir, le préserver et le développer ». Considérant que le maintien dans l’emploi « doit impérativement être regardé par l’ensemble des juges comme un motif d’intérêt général », ce dernier ayant été par deux fois (26) reconnu par le Conseil constitutionnel comme un motif légitime de prévalence de l’accord collectif sur le contrat de travail, l’ancien Directeur général du Travail préconisait d’instituer dans la loi une règle faisant prévaloir les accords collectifs préservant l’emploi sur les contrats de travail, dans l’intérêt général et l’intérêt collectif des salariés pour l’emploi.
Le présent article franchit donc une étape supplémentaire en autorisant cette dérogation pour l’ensemble des accords dont l’objectif est de préserver ou de développer l’emploi, cette condition de préservation ou de développement de l’emploi ayant vocation à être appréciée, d’après l’étude d’impact, « par les partenaires sociaux » appelés à négocier l’accord.
La primauté de l’accord de préservation ou de développement de l’emploi se traduit concrètement, pour les salariés qui en acceptent les termes, par la substitution des clauses de l’accord aux clauses incompatibles de leur contrat de travail. En d’autres termes, l’accord ne suspend pas les clauses incompatibles du contrat de travail pour une durée déterminée, comme c’était le cas pour les accords de maintien de l’emploi prévus par la loi du 13 juin 2014. Les clauses du contrat de travail compatibles avec l’accord continuent néanmoins de s’appliquer.
La substitution des stipulations de l’accord d’entreprise à celles du contrat de travail s’applique également en matière de rémunération et de durée du travail. Toutefois, l’accord « ne peut avoir pour effet de diminuer la rémunération mensuelle du salarié » ; les contours de cette rémunération mensuelle doivent être définis par décret (III de l’art. L. 2254-2).
Compte tenu de la prévalence de l’accord de préservation ou de développement de l’emploi sur le contrat de travail des salariés, cet article propose de renforcer les modalités de consultation des organisations syndicales représentatives et signataires de l’accord et des institutions représentatives du personnel. Le premier alinéa du III de l’article L. 2254-2 précise qu’un décret doit définir les modalités selon lesquelles celles-ci sont consultées sur les conséquences de l’accord pour les salariés.
Le II dispose par ailleurs que la consultation annuelle sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi mentionnée à l’article L. 2323-15 peut porter également sur les conséquences pour les salariés des accords de préservation ou de développement de l’emploi.
c. Les modalités de licenciement « sui generis » applicables en cas de refus du salarié de se voir appliquer l’accord
Le II de l’article L. 2254-2 précise que le salarié peut refuser, par écrit, la modification de son contrat de travail résultant de l’application de l’accord de préservation ou de développement de l’emploi. En effet, l’application au contrat de travail des stipulations de l’accord ne constitue pas une simple transformation des conditions de travail du salarié et implique donc de recueillir préalablement l’accord du salarié. Les modalités selon lesquelles les salariés font connaître leur refus sont définies par décret.
Si le salarié refuse de se voir appliquer l’accord, l’employeur peut engager une procédure de licenciement à son encontre. Il est précisé que ce licenciement « ne constitue pas un licenciement pour motif économique ». Ce licenciement, qui est présumé reposer « sur une cause réelle et sérieuse », est soumis aux dispositions relatives à la rupture du contrat de travail « pour motif personnel ».
Ces modalités de licenciement sui generis appellent plusieurs remarques.
● En premier lieu, la préqualification de licenciement pour cause réelle et sérieuse pose question au regard du droit effectif au recours contre le licenciement dont dispose tout travailleur estimant avoir fait l’objet d’une mesure de licenciement injustifiée. Ce droit au recours contre le licenciement est garanti notamment par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH), par l’article 24 de la Charte sociale européenne relatif au droit à la protection des travailleurs en cas de licenciement – qui dispose que le licenciement doit reposer sur un motif valable à l’aptitude ou à la conduite des travailleurs, ou être fondé sur les nécessités du fonctionnement de l’entreprise. En outre, l’article 9 de la convention n° 158 de l’Organisation internationale du travail (OIT) habilite le juge à examiner les motifs invoqués pour justifier le licenciement.
À l’issue des débats parlementaires relatifs à la mise en place des accords de maintien de l’emploi, en 2013, le législateur avait finalement considéré que l’affirmation selon laquelle le licenciement du salarié repose sur une cause réelle et sérieuse en raison de l’accord de maintien de l’emploi rendait impossible pour les salariés toute possibilité de recours effectif contre le licenciement, avant de revenir sur cette qualification à l’occasion de la loi du 6 août 2015. Le projet de loi reprend donc cette présomption de cause réelle et sérieuse.
● En second lieu, le choix d’écarter l’application du licenciement pour motif économique au profit d’un licenciement « sui generis » soumis aux dispositions relatives à la rupture du contrat de travail pour motif personnel, doit également être examiné.
Tel que défini à l’article L. 1233-3 du code du travail, le licenciement pour motif économique doit être justifié par un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié, consécutifs notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ayant une incidence sur l’emploi, c’est-à-dire qu’il doit conduire à une suppression ou transformation d’emploi, ou à une modification du contrat de travail refusée par le salarié. Le licenciement pour motif économique implique pour l’employeur de respecter les procédures spécifiques fixées par le code du travail, qui diffèrent en fonction de l’ampleur du licenciement et de l’effectif de l’entreprise. En tout état de cause, l’employeur a l’obligation de rechercher le reclassement des salariés, et de respecter un ordre de licenciement.
Considérant que les accords de préservation ou de développement de l’emploi n’interviennent pas nécessairement dans un contexte de difficultés économiques, ni d’introduction de mutations technologiques, le projet de loi a préféré écarter ce motif, exonérant ainsi l’employeur du respect des obligations applicables en cas de licenciement économique, mais privant les salariés de leur droit au reclassement.
● Le licenciement retenu en cas de refus de modification du contrat de travail résultant de l’application de l’accord de préservation ou de développement de l’emploi ne répond pas non plus aux conditions du licenciement pour motif personnel mentionné au chapitre II du titre III du livre premier de la première partie du code du travail. Le licenciement pour motif personnel doit en effet reposer sur des faits personnellement imputables au salarié, soit parce qu’il a commis une faute, soit pour d’autres motifs tels que l’insuffisance professionnelle, l’insuffisance de résultats ou encore la mésentente du salarié avec une partie du personnel.
Le type de licenciement prévu par cet article n’est donc ni un licenciement pour motif économique, ni un licenciement pour motif personnel. Toutefois, pour garantir aux salariés une protection suffisante, il est précisé que les conditions relatives à la rupture du contrat de travail pour motif personnel sont applicables. Le salarié doit donc obligatoirement être convoqué par son employeur à un entretien préalable, puis recevoir la notification de son licenciement. En outre, le licenciement pour motif personnel autre que la faute grave ou la faute lourde ouvre droit au versement d’indemnités pour le salarié, présentées dans le tableau ci-après.
Indemnités versées en cas de licenciement
Le salarié licencié, en dehors d’une procédure de licenciement pour faute grave ou pour faute lourde, a droit aux indemnités suivantes :
– une indemnité légale de licenciement (sous réserve de justifier d’un an d’ancienneté), calculée en fonction de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise. Cette indemnité ne peut être inférieure à 1/5ème de mois de salaire par année d’ancienneté pendant les dix premières années, puis 1/3 de mois de salaire pour chaque année suivante. L’assiette est égale au douzième de la rémunération brute des douze derniers mois précédant le licenciement ou, si elle s’avère plus avantageuse, à 1/3 des trois derniers mois ;
– le cas échéant, une indemnité légale de préavis, en cas d’inobservation du délai de préavis par l’employeur (article L. 1234-5) : forfaitaire et proportionnelle à la durée du préavis non exécuté, elle est égale au montant de la rémunération qu’aurait perçue le salarié s’il avait travaillé pendant cette période ;
Le salarié licencié a également droit, sous condition d’une durée minimale d’affiliation, au versement des allocations chômage.
Pour ces trois types d’indemnisation, – indemnité de préavis, indemnité de licenciement et allocation chômage –, le calcul se fera sur la base de la rémunération la plus avantageuse pour le salarié et non dans les conditions de droit commun.
Dans son avis sur le projet de loi, le Conseil d’État a validé cette qualification sui generis, considérant que l’objectif de préservation et de maintien de l’emploi correspond à un motif « valable » de licenciement, au sens de l’article 4 de la convention de l’OIT, fondé sur les nécessités de fonctionnement de l’entreprise.
Le VI de l’article 10 de ce projet de loi précise que les dispositions relatives à la généralisation des accords majoritaires d’entreprise sont applicables, dès l’entrée en vigueur de la loi, aux accords de préservation et de développement de l’emploi. Il s’agit d’un garde-fou important : cela signifie que les accords de préservation ou de développement de l’emploi devront être approuvés à la majorité des organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise ou, à défaut, par une majorité de 30 % de ces mêmes organisations et par une majorité de salariés.
*
La Commission a adopté sept amendements du rapporteur à cet article, dont un amendement de correction d’une erreur matérielle (AS 795).
En premier lieu, la Commission a adopté trois amendements visant à préciser les modalités de négociation des accords de préservation ou de développement de l’emploi :
– l’amendement AS1006 précise que les accords de préservation ou de développement de l’emploi ne peuvent être conclus que par des représentants du personnel élus et mandatés ou par des salariés mandatés ;
– l’amendement AS1005 impose à l’employeur qui envisage d’engager des négociations relatives à la conclusion d’un accord de préservation et de développement de l’emploi, de transmettre, en amont de la négociation, toutes les informations nécessaires aux organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise en vue de l’établissement d’un diagnostic partagé sur la situation de l’entreprise ;
– l’amendement AS1007 étend par ailleurs aux entreprises qui ne disposent pas de comité d’entreprise la possibilité de mandater un expert-comptable pour assister les négociateurs.
Ensuite, la Commission a adopté plusieurs amendements encadrant le contenu type d’un accord de préservation ou de développement de l’emploi :
– l’amendement AS1005 précise ainsi que l’accord doit impérativement contenir un préambule, sous peine de nullité ;
– l’amendement AS939 précité précise en outre que l’accord doit prendre en compte la situation des salariés invoquant une atteinte disproportionnée à leur vie personnelle ou familiale, définir les modalités d’information des salariés quant à son application et prévoir ses modalités de suivi ;
– l’amendement AS922 précise que ces accords ne peuvent être conclus que pour une durée déterminée, celle-ci étant laissée à l’appréciation des négociateurs. Toutefois, en l’absence de clause expresse dans l’accord, la durée par défaut de ces accords est fixée à cinq ans.
La Commission a enfin adopté l’amendement AS1045 du rapporteur, qui précise qu’en cas de refus du salarié de la modification de son contrat de travail, la procédure de licenciement applicable est la procédure de licenciement individuel pour motif économique.
*
La Commission examine les amendements AS257 de Mme Jacqueline Fraysse, AS340 rectifié de M. Gérard Sebaoun, AS643 rectifié de Mme Fanélie Carrey-Conte et AS754 de Mme Éva Sas.
Mme Jacqueline Fraysse. Les accords de maintien dans l’emploi introduits dans le code du travail par la loi de sécurisation de l’emploi permettent déjà à une entreprise en difficulté économique de conclure un accord afin de diminuer la rémunération des salariés à temps de travail constant ou d’augmenter la durée du temps de travail sans contrepartie.
L’article 11 du présent projet de loi va plus loin encore : il suffira, pour signer un accord, de déclarer avoir pour objectif le développement ou la préservation de l’emploi, ce qui est si flou, si vaste, que cela peut concerner n’importe quelle entreprise à n’importe quel moment. De plus, une fois adopté, cet accord s’impose aux salariés, même si ses dispositions sont moins favorables que celles prévues par la loi ou par le contrat de travail.
Il s’agit donc bien d’une remise en cause du principe de faveur, et dans des proportions exorbitantes.
En outre, le salarié qui refuserait de se soumettre aux nouvelles dispositions pourra être licencié pour motif personnel, et donc privé de tous les droits liés au licenciement économique – reclassement, contrat de sécurisation professionnelle ou encore priorité à l’embauche.
C’est pourquoi, avec l’amendement AS257, nous demandons la suppression de cet article.
M. Gérard Sebaoun. Je ne répète pas les analyses de Jacqueline Fraysse ; je les partage. J’ai voté, en 2013, la création des accords de maintien de l’emploi (AME) ; mais ceux-ci étaient très encadrés. Ces accords-ci ne sont pas les jumeaux des premiers ! Ils sont extrêmement dangereux. Pour préserver ou développer l’emploi, ce qui doit être la première évidence pour l’entreprise, cet article offre à ses dirigeants des prérogatives insensées - licencier, par exemple, pour motif personnel et non pour motif économique, des salariés qui n’ont eu que la malchance d’être là au mauvais moment et à la mauvaise place.
Imaginer que ces accords puissent être le signe d’une offensive sur le front économique est une faute : l’offensive ne se fait ici que contre le salariat. Le licenciement pour motif personnel dans de tels cas est, pour moi, tout à fait inacceptable, mais je sais que des amendements porteront sur ce point. Quant au maintien de la rémunération, elle fera sans doute débat, de même que les autres avantages acquis qui ne sont pas mentionnés.
C’est une mauvaise manière faite aux salariés que de les considérer comme jetables et corvéables à merci. Il faut donc absolument supprimer cet article dangereux.
Mme Fanélie Carrey-Conte. L’article 11 constitue, en effet, l’une des régressions majeures de ce texte.
On pouvait avoir quelques réserves sur les accords dits « défensifs ». J’en avais notamment sur le fait que le refus de modification du contrat de travail donnait lieu à des licenciements individuels, ce qui permettait à l’entreprise de se soustraire à l’obligation de mettre en place un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE). Ici, c’est beaucoup plus grave ; les effets d’aubaine vont se multiplier.
Il y a une petite hypocrisie dans l’article, qui prétend que la seule contrainte qui s’impose à ces accords est qu’ils ne peuvent avoir pour effet de diminuer la rémunération mensuelle. Or une hausse du temps de travail conduira à une baisse du salaire horaire. Il y aura donc bien des conséquences sur le niveau de rémunération des salariés.
J’ajoute que le licenciement pour motif personnel qui pourra suivre un refus de l’accord constitue une atteinte profonde aux droits des salariés. Cela poursuivra le salarié lorsqu’il recherchera d’autres emplois : il devra se justifier encore et encore de ce licenciement pour motif personnel auprès d’éventuels futurs employeurs.
M. Philippe Noguès. L’objet de l’amendement AS754 est également la suppression de l’article 11. Je ne répète pas tout ce qui vient d’être dit. Si cet article constitue indubitablement une nouvelle protection pour les employeurs, il n’en offre aucune aux actifs. Il est fondamentalement déséquilibré, et va beaucoup plus loin que les accords « défensifs » votés en 2013, sans la justification des difficultés économiques.
Pour les salariés, cet article constitue une véritable régression sociale, puisque le refus de modification du contrat de travail pourra occasionner un licenciement pour motif personnel.
Mme Isabelle Le Callennec. Le groupe Les Républicains est, à l’inverse, favorable aux accords offensifs.
Monsieur le rapporteur, l’alinéa 3 dispose que « l’accord mentionné au premier alinéa ne peut avoir pour effet de diminuer la rémunération mensuelle du salarié », mais l’alinéa 8 qu’un décret « définit la rémunération mensuelle mentionnée au premier alinéa ». N’y a-t-il pas là une contradiction ?
Je redis que nous nous réjouissons, pour notre part, de la mise en place de ce dispositif. Il a beaucoup été question de licenciements, mais les accords offensifs visent, au contraire, à préserver ou à développer l’emploi : c’est ce qui nous intéresse.
M. Francis Vercamer. Le groupe UDI est également favorable à ces accords.
Gérer une entreprise, c’est anticiper les difficultés, essayer de faire face à une concurrence qui pourrait survenir. L’employeur et les représentants du personnel essaient de mettre l’entreprise en ordre de marche pour conquérir de nouveaux marchés. Si l’on attend de rencontrer des problèmes pour agir, les moyens de résister sont très amoindris.
Je ne comprends pas les demandes de suppression de cet article. L’accord est signé par les représentants du personnel : à qui, sinon à eux, peut-on faire confiance pour défendre les intérêts des salariés ? Ce sont des gens responsables et élus par les salariés eux-mêmes. Ils ne signeront pas n’importe quoi.
De plus, la rémunération mensuelle n’étant pas touchée, l’accord n’affectera que des éléments accessoires, des primes de fin d’année, par exemple. La question de Mme Le Callennec me semble néanmoins judicieuse : les alinéas 3 et 8 ne sont-ils pas contradictoires ?
M. Christophe Sirugue, rapporteur. Cet article est important et mérite un débat approfondi.
Les accords de sécurisation de l’emploi, dits accords « défensifs », se déclenchent lorsque l’entreprise est objectivement dans une situation difficile, afin de résoudre les problèmes rencontrés. Avec ces accords « offensifs », l’approche est différente. Il s’agit de prendre en considération ce que sont aujourd’hui le contexte économique et le monde de l’entreprise, à commencer par l’importance primordiale de la compétitivité.
Bien sûr, nous voulons préserver les droits des salariés. Mais nous devons aussi nous donner pour but de maintenir la capacité de nos entreprises à être présentes sur les marchés, à chercher des contrats nouveaux, à s’adapter à des situations nouvelles dont personne ne peut nier l’existence.
La question, s’agissant de l’article 11, est de concilier l’adaptation à la réalité de marchés en évolution perpétuelle et rapide, avec la sécurisation des salariés. J’entends les inquiétudes de mes collègues, et tout au long de l’examen de cet article, je proposerai différents amendements, qui ne visent pas à en modifier l’esprit, que j’assume parfaitement, mais à apporter de nouvelles sécurités aux salariés, notamment sur le point de la qualification du licenciement d’un salarié qui refuserait un tel accord. Le texte doit, à mon sens, être modifié.
Depuis la présentation de ce projet de loi en conseil des ministres, la préservation de son équilibre est l’objet de la plus grande attention. Il ne faut pas fragiliser l’entreprise : sinon, on peut se battre tant qu’on veut pour l’emploi, on peut lancer toutes les revendications que l’on veut, le jour où il n’y a plus d’entreprise, il n’y a plus d’emplois ! Soyons lucides sur la situation de l’entreprise aujourd’hui, mais pas naïfs : c’est pourquoi je vous proposerai des amendements destinés à renforcer l’encadrement de ces accords.
Madame Le Callennec, vous vous interrogez sur ce qui apparaît comme une contradiction entre les alinéas 3 et 8. Le décret définira les modalités de détermination de la rémunération mensuelle garantie, en gommant les éventuelles variations et en précisant le statut d’un éventuel treizième mois.
Il faut entendre les inquiétudes qui ont été exprimées, mais je suis, vous l’avez compris, défavorable aux amendements de suppression.
M. Gérard Cherpion. J’entends avec plaisir les propos du rapporteur : je dépose le même amendement depuis trois ans, et depuis trois ans le même rapporteur le refuse… Je suis heureux de voir aujourd’hui reconnu l’intérêt des accords offensifs.
M. le rapporteur. Votre texte n’est pas le même !
M. Gérard Cherpion. C’est tout à fait la même chose, monsieur le rapporteur.
Dans l’entreprise, il faut savoir prendre des responsabilités au vu de l’évolution des marchés : on ne fragilise pas les personnes, je crois, en préservant l’outil de travail et en faisant avancer des projets.
Nous voterons donc l’article 11.
M. Christophe Cavard. La logique de cet article n’est pas tout à fait nouvelle, puisque les accords de sécurisation de l’emploi existent depuis 2013 : ces dispositions constituent plutôt un élargissement. De plus, le projet de loi promeut les accords majoritaires, c’est-à-dire les discussions avec les salariés, dans des situations particulières, dans le but de préserver et de développer l’emploi.
Je me rappelle très bien la bataille que nous avons menée sur la question de la qualification des licenciements provoqués par les accords défensifs – le rapporteur, d’ailleurs, était à nos côtés. Nous avions obtenu, pour les salariés refusant l’accord, que ces licenciements se fassent pour motif économique. C’est là l’enjeu essentiel. Pour le reste, je le redis, cet article ne fait qu’élargir quelque chose qui figure déjà dans notre droit, et dans une logique d’accords majoritaires.
Nous ne voterons donc pas les amendements de suppression. Nous serons, en revanche, attentifs à la qualification des licenciements que de tels accords pourraient entraîner.
M. Bernard Accoyer. Comme l’a dit Gérard Cherpion, nous soutenons cet article, et plus largement la démarche d’assouplissement du droit du travail. Les entreprises doivent pouvoir s’adapter aux fluctuations du marché. Nous sommes dans une économie de marché, et le marché, ça va et ça vient. C’est tout le problème de la majorité, qui est divisée entre les socio-démocrates, qui ont effectué un virage récent que nous saluons, et d’autres qui continuent d’entretenir une vision collectiviste, ce qui ne peut que porter tort à notre économie et à notre pays.
M. Gérard Sebaoun. J’entends les propos du rapporteur. Mais il faut mesurer le chemin parcouru depuis 2013 et le vote des accords défensifs, destinés à répondre à de graves difficultés économiques conjoncturelles – ce dernier terme a un sens. Ici, on parle d’accords « offensifs », visant à préserver et à développer l’emploi : cette phrase est absolument fourre-tout. Il y a trois ans, ce que nous avons fait était une initiative sérieuse pour préserver les salariés et lutter pour l’efficacité économique ; aujourd’hui, on ouvre une porte qu’on ne refermera pas, et on prend des risques majeurs pour tous ceux qui travaillent.
Mme Isabelle Le Callennec. Je ne comprends pas la logique de ceux qui demandent la suppression de cet article. Ces accords visent à maintenir ou augmenter le nombre de salariés : dès lors, quel salarié refusera un tel accord – majoritaire – au risque, qui plus est, d’un licenciement sui generis ? Son intérêt n’est pas lésé, et l’entreprise embauche. Je rappelle que 6 millions de personnes sont inscrites à Pôle Emploi ! Vraiment, je n’arrive pas à imaginer qui pourrait être contre ces accords. Cela m’échappe. Donnez-nous des exemples !
Mme Fanélie Carrey-Conte. Je commence par souligner à nouveau que les accords de maintien de l’emploi n’ont rien à voir avec les accords inscrits dans ce projet de loi.
Quant aux situations où un salarié refuserait la modification de son contrat de travail, madame Le Callenec, les exemples sont innombrables : une femme qui élève seule ses enfants ne pourra peut-être pas accepter un accord qui modifierait complètement ses horaires de travail, la contraindrait à travailler en soirée ou à des horaires incompatibles avec sa vie personnelle, par exemple. Parfois, vous n’avez tout simplement pas d’autre choix que de refuser ce que l’on vous impose.
M. Michel Liebgott. Nous ne vivons ni sous un régime soviétique ni sous un régime ultra-libéral : nous sommes dans un régime de libre entreprise, qu’il faut réguler. Les intérêts des salariés et des entreprises ne sont pas a priori contradictoires. S’ils l’étaient, nous serions dans une situation dramatique tant du point de vue de l’état du dialogue social que des perspectives de l’emploi dans les années qui viennent.
Supprimer l’article, ce serait refuser le débat parlementaire, continuer de refuser de résoudre des situations difficiles. Nous avons franchi une première étape avec les accords de maintien de l’emploi ; il me paraît légitime d’en franchir une deuxième.
Mais, contrairement à Mme Le Callennec, j’estime qu’il existe effectivement des cas particuliers qu’il faut prendre en considération. Les salariés ne sont pas tous dans la même situation : certains s’adapteront facilement, d’autres pas.
Refuser ce débat me paraît dangereux, car ce serait refuser d’aider des entreprises à se projeter dans l’avenir, à être compétitives : c’est la loi de la société libérale, et nous vivons dans un régime économique où la compétitivité est essentielle. L’individu ne doit pas pour autant devenir une variable d’ajustement, et c’est pourquoi il faut prévoir des protections. Je pense que notre rapporteur en a l’intention.
Mme Jacqueline Fraysse. Je comprends tout à fait le soutien sans réserve que nos collègues de droite apportent à cet article. Par contre, je ne sais pas où ils voient du collectivisme…
Madame Le Callennec, les raisons de refuser une modification du contrat de travail sont nombreuses, comme l’a dit Fanélie Carrey-Conte : au-delà même de l’exemple des femmes, un salarié à qui l’on propose de travailler plus longtemps pour le même salaire – ce qui a été fait chez PSA – peut accepter s’il n’a pas le sentiment de pouvoir faire autrement, même si ce ne sera certainement pas de gaieté de cœur. Il peut aussi considérer qu’il y a des limites à ce que l’on peut lui imposer et refuser cette modification.
Je voudrais faire observer que la première étape, celle de la loi de sécurisation de l’emploi, n’a pas permis de régler le problème du chômage, loin de là ; elle n’a même pas permis de le stabiliser, puisqu’il continue d’augmenter. Je ne vois donc pas d’argument qui plaiderait pour l’élargissement de ces dispositions. Je note, en revanche, que ces accords n’ont pas porté atteinte aux dividendes qui ont été distribués par les entreprises du CAC 40.
Je regrette, monsieur le rapporteur, que vous parliez d’équilibre : je ne vois, dans cet article 11, que déséquilibre. Je regrette de vous entendre tenir des propos qui donnent l’impression que la seule source des difficultés des entreprises, ce sont les salariés : ils sont à l’origine des problèmes, ils portent atteinte à la compétitivité des entreprises, ils servent donc logiquement de variable d’ajustement. Avec ce texte, le salarié devra accepter des sacrifices tant qu’il le peut, et le jour où il les jugera insurmontables, il sera licencié.
Franchement, je suis surprise que mes collègues de gauche cautionnent de telles dispositions, alors même que les premières mesures de cet ordre n’ont pas permis de faire baisser le chômage. Si au moins c’était utile, nous nous ferions sans doute une raison. Ce n’est pas le cas.
M. Jean-Patrick Gille. Le point est, en effet, délicat. Tout le monde ou presque reconnaît qu’il faut des accords qui permettent de s’adapter à une conjoncture soit difficile, soit, avec ce texte, prometteuse.
Certains s’inquiètent de dérives, notamment sur la question des licenciements. Il y a tout de même un accord dans l’entreprise, je le souligne. D’autres redoutent ce qu’il adviendra de ceux qui refusent la modification du contrat de travail. Il y a ici une grande différence entre les accords défensifs et ces accords offensifs : pour les premiers, nous avions fini par obtenir que les éventuels licenciements soient des licenciements économiques, accompagnés de garanties beaucoup plus importantes que les licenciements pour motif personnel – qui semblent, eux, renvoyer à une faute du salarié et qui les privent des possibilités de reclassement.
Je vois une autre difficulté : si une entreprise signe un accord en vue d’obtenir un marché prometteur, mais qu’elle ne l’obtient pas et se trouve de ce fait en difficulté économique, comment se fera le basculement vers un accord défensif, notamment sur les modalités d’éventuels licenciements ?
J’ai moi-même déposé un amendement pour que le licenciement du salarié qui refuse la modification de son contrat de travail soit un licenciement pour motif économique, ou à tout le moins que ce salarié bénéficie de toutes les protections offertes dans un tel cas – reclassement, conversion, accès au contrat de sécurisation professionnelle (CSP) et autres.
M. Gérard Sebaoun. Nous craignons beaucoup, vous l’avez tous compris, pour le sort des salariés : l’accord, même majoritaire, ne suffit pas à nos yeux. Vous semblez envisager la perspective d’un licenciement avec sérénité, madame Le Callennec, mais risquer d’être licencié alors que l’on n’a commis aucune faute a de quoi inquiéter. Et nous nous inquiétons.
M. Arnaud Viala. Dans un monde idéal, nous aurions le plein emploi, aucune menace ne pèserait sur aucune entreprise, et nous nous passerions de tels instruments.
Ce débat pose le problème du périmètre de ce texte. Soit l’on ne s’intéresse qu’aux salariés déjà en poste, l’on veut assurer leur bien-être et même le renforcer – ce que nous souhaiterions tous dans l’absolu ; soit l’on considère que tous les salariés peuvent un jour perdre leur emploi, et l’on s’intéresse aussi à ceux qui n’en ont pas. Le gros défaut de ce texte, c’est finalement de ne pas penser beaucoup aux chômeurs.
Si l’on considère l’entreprise comme un éco-système, où les devenirs de l’employeur et des salariés sont liés, alors on ne peut pas supprimer cet article. Cela reviendrait à jeter le bébé avec l’eau du bain, à attendre que tout le monde soit mort et à se satisfaire d’être tous morts égaux.
M. Michel Issindou. Le sujet est délicat, nous en avons tous conscience. Je récuse les propos de Jacqueline Fraysse, qui est allée trop loin dans ses propos condamnant notre rapporteur : la richesse de l’entreprise, ce sont ses salariés, évidemment. Ils ne gênent pas la compétitivité, ils la produisent ; ils ne doivent pas être une variable d’ajustement. Sur ces points, nous ne pouvons qu’être d’accord.
Mais nous sommes dans une économie de marché, fluctuante, changeante. Qui n’a pas vu, dans son entourage, des chefs d’entreprise passer en quelques mois d’une situation très favorable à une situation très défavorable ou bien retrouver des perspectives et devoir donner un bon coup de collier pour en profiter ? La souplesse est indispensable : il faut laisser l’entreprise s’organiser, et les instances représentatives du personnel (IRP) faire leur travail. Je rappelle que ces accords devront être majoritaires, c’est-à-dire mûris collectivement : ces accords ne seront pas imposés par une décision solitaire du chef d’entreprise.
Combien de conflits très durs, où chacun s’accrochait à ses avantages acquis, avons-nous vus ces dernières années ? Je n’ai rien contre les avantages acquis, qui sont le résultat de luttes bien menées. Mais ne vaut-il pas mieux sauver une entreprise tant qu’il en est encore temps, par des accords internes ? L’Allemagne, ainsi, utilise beaucoup le temps partiel. Nous avons vu tellement d’entreprises finir dans le mur ! Ne peut-on pas essayer de sauver l’entreprise ou de la développer par des accords intelligents, compris, acceptés de tous, quand bien même ils se font parfois au détriment de la vie de famille ?
Il faut accepter l’article 11.
M. Christophe Cavard. Les auteurs de ces amendements de suppression sont sans doute motivés par la crainte que la négociation ne se déroule pas dans les conditions de loyauté et d’égalité recommandées par le rapport Combrexelle, dans la mesure où, dans un rapport de subordination avec leur direction, les salariés abordent les négociations dans une position désavantageuse. Or nous nous efforçons précisément d’apporter des garanties aux salariés par toute une série de mesures, notamment par une formation à la négociation. Il n’y a donc aucune raison de supprimer ces négociations au niveau de l’entreprise, y compris lorsqu’elles concernent des accords « offensifs » qui n’ont pas uniquement vocation à sauver l’entreprise, mais à lui permettre de se développer.
Mme Fanélie Carrey-Conte. Dans l’hypothèse où un accord sur le temps de travail a été signé mais que l’on réalise qu’il permet de préserver ou de développer l’emploi, peut-il être requalifié en accord de préservation et de développement de l’emploi, avec les conséquences que cela entraîne ?
Mme la présidente Catherine Lemorton. En période de crise, on compte beaucoup sur l’emploi public et les emplois aidés. Ils ne peuvent néanmoins constituer l’alpha et l’oméga des politiques de l’emploi, et nous ne devons pas oublier que les entreprises privées créent des emplois. Ces entreprises ne sont pas toutes des caricatures du CAC 40 qui servent de larges dividendes à leurs actionnaires. Il y a aussi de nombreuses PME et TPE, qui doivent souvent anticiper pour répondre à des appels d’offre et survivre – je le vois avec les sous-traitants d’Airbus dans ma circonscription. J’entends ceux qui redoutent que, dans ces conditions, les salariés deviennent la variable d’ajustement, mais nous faisons tout pour parvenir à un équilibre qui ne les lèse pas. Certes, les conditions de travail imposées aux salariés peuvent parfois s’avérer difficilement compatibles avec la vie de famille, au risque de la détruire. Mais je fais confiance aux partenaires sociaux et pense, par ailleurs, que rien plus que le chômage n’est susceptible de détruire la vie de famille.
M. le rapporteur. Je voudrais, en premier lieu, indiquer que c’est en évitant de faire dire aux gens ce qu’ils n’ont pas dit que l’on maintiendra la qualité de nos débats. Je défie Mme Fraysse de retrouver à quel moment j’ai pu signifier par mes propos que les salariés étaient une variable d’ajustement. Ils sont, au contraire, selon moi, la première richesse des entreprises de ce pays. J’ai déposé pas moins de six amendements qui ont tous pour objectif d’améliorer l’accompagnement des salariés et leurs conditions de licenciement, car je considère qu’un salarié est en droit de refuser un accord de préservation ou de développement de l’emploi sans être, pour cela, licencié pour motif personnel.
En second lieu, les accords de maintien de l’emploi n’ont jamais été faits pour créer de l’emploi. Par principe, ils doivent permettre à une entreprise en situation difficile de sauver des emplois. Je peux retourner à Mme Fraysse cette question : qu’en serait-il s’ils n’avaient pas existé ? N’y aurait-il pas eu davantage de fermetures d’entreprise ?
Je pense enfin que nous devons être vigilants sur ces accords, qui reposent sur une appréciation du marché que l’entreprise veut conquérir ou peuvent être inspirés par la volonté de s’adapter aux évolutions de l’environnement économique. C’est la raison pour laquelle je considère qu’un diagnostic partagé est obligatoire, tout comme le partage d’informations sur les objectifs retenus par l’employeur : on ne peut emmener des salariés avec soi sans leur expliquer clairement, en dehors de l’existence de difficultés économiques flagrantes, quel but poursuit la réorganisation de l’entreprise. De grâce ! faisons confiance aux partenaires sociaux pour négocier ces accords, qui sont, de surcroît, majoritaires et s’appliqueront dès le 1er janvier 2017.
Pour répondre à la question de Fanélie Carrey-Conte, l’employeur seul ne pourra en aucun cas requalifier un précédent accord en un accord de préservation de l’emploi. Cette évolution ne pourrait avoir lieu que dans le cadre d’une procédure de révision, qui implique les partenaires sociaux représentatifs.
Des inquiétudes sur les accords « offensifs », j’en ai comme vous, mais on ne peut priver les entreprises de la capacité de s’adapter aux évolutions du marché et de répondre à des appels d’offre.
La Commission rejette les amendements.
Puis elle est saisie de l’amendement AS1005 du rapporteur.
M. le rapporteur. Cet amendement impose, en premier lieu, à l’employeur qui envisage d’engager des négociations relatives à la conclusion d’un accord de préservation ou de développement de l’emploi, de transmettre, en amont de la négociation, toutes les informations nécessaires aux organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise en vue de l’établissement d’un diagnostic partagé sur la situation de l’entreprise.
En second lieu, il précise que l’accord doit impérativement comporter un préambule afin de clarifier, pour les salariés, les principaux objectifs poursuivis par l’accord. À défaut de préambule, l’accord serait sanctionné de nullité.
M. Élie Aboud. La transmission des documents est-elle soumise à des conditions de délai ? Par ailleurs, qu’entendez-vous précisément par « diagnostic partagé » ? Cela renvoie-t-il à un accord total entre l’employeur et les salariés ?
Mme Isabelle Le Callennec. Il me semble que nous avons déjà voté des dispositions précisant que les signataires d’un accord d’entreprise doivent disposer de tous les éléments. Cet amendement n’est-il pas redondant ?
M. Gérard Cherpion. Dans l’hypothèse d’un accord « offensif », il faut agir vite, et les délais de transmission des informations doivent donc être courts. Qu’envisage le rapporteur sur ce point ?
En ce qui concerne le préambule censé indiquer « les objectifs de l’accord en matière de préservation ou de développement de l’emploi », il me semble qu’il s’agit là du sujet même de l’accord. Au-delà, au moment de la signature de l’accord, l’entreprise n’est pas en mesure, à mon sens, de chiffrer objectivement les créations d’emploi que doit permettre l’accord. C’est un point important puisque cette question du préambule peut entraîner la nullité de l’accord. Il ne me paraît donc pas nécessaire dans la mesure où le texte même de l’accord indique quels sont les devoirs de l’entreprise.
M. le rapporteur. Entendons-nous bien sur la différence entre l’accord de maintien de l’emploi et l’accord « offensif » dont nous discutons. L’AME réclame un diagnostic analysé ; l’accord de préservation ou de développement de l’emploi, un diagnostic partagé. La baisse du chiffre d’affaires et la réduction du carnet de commandes sont des éléments tangibles qui peuvent donner lieu à un diagnostic analysé en vue d’un accord de maintien de l’emploi. Mais, par définition, un accord offensif ne peut reposer sur de tels éléments puisqu’il participe d’une démarche prospective : il ne peut donc s’appuyer que sur un diagnostic partagé. Il est essentiel de doter les partenaires sociaux de tous les outils permettant ce diagnostic partagé et, partant, la signature d’un accord.
Quant aux délais, ils correspondent à ceux posés pour les diagnostics généralement établis en vue de la signature d’un accord.
Enfin, je précise à Mme Le Callennec que si j’ai pris soin de préciser dans l’amendement qu’il s’agissait d’une procédure dérogatoire à l’article L. 2222-3-3, c’est que nous sommes dans un cas différent de celui que nous avons évoqué précédemment.
M. Élie Aboud. Le diagnostic doit-il être partagé avec l’ensemble des salariés ?
M. le rapporteur. L’accord est conclu entre l’employeur et les organisations syndicales signataires. C’est donc avec ces dernières que le diagnostic doit être partagé, mais j’ose imaginer qu’elles prendront soin d’informer les salariés. En tout cas, il ne me paraît pas possible d’inscrire dans la loi ce qu’elles doivent faire.
M. Élie Aboud. Nous ne pourrons pas soutenir ces dispositions si les salariés concernés ne sont pas impliqués. Limiter le partage du diagnostic aux organisations syndicales vide la mesure de son sens.
Mme Isabelle Le Callennec. Vous n’avez pas répondu à Gérard Cherpion sur la question du délai.
M. le rapporteur. Je vous ai répondu que les délais étaient les mêmes que pour les autres accords. Nous en avons discuté ce matin ; permettez-moi de ne pas revenir en détail sur toutes nos discussions.
M. Gérard Cherpion. L’accord « offensif » exige un diagnostic partagé entre l’employeur et les organisations syndicales : que se passe-t-il en cas d’absence d’organisations syndicales ?
M. le rapporteur. Cette question fait l’objet d’un amendement à venir.
La Commission adopte l’amendement.
Puis elle examine l’amendement AS725 de M. Olivier Faure.
M. Olivier Faure. La frontière est assez ténue entre un accord « défensif » et un accord « offensif », car les entreprises doivent parfois anticiper leurs difficultés et prendre des mesures qui leur éviteront d’avoir recours à un accord défensif dans un contexte plus tendu.
Cela étant, beaucoup redoutent que les accords offensifs se fassent au détriment des salariés, à qui l’on demandera un effort supplémentaire. Il est donc important de bien encadrer ces accords pour protéger les salariés. C’est la raison pour laquelle cet amendement établit une proportionnalité entre les efforts demandés aux salariés et ceux fournis par les dirigeants, les mandataires sociaux et les actionnaires. Il est logique, en effet, dans le cadre d’un accord « offensif », d’exiger de ceux qui sont à l’initiative de l’accord les mêmes efforts que ceux qui sont exigés des salariés. C’est un gage de cohésion dans l’entreprise.
M. le rapporteur. Si je suis d’accord avec cette exigence, il me semble qu’elle relève de l’accord et que, le cas échéant, les partenaires sociaux peuvent décider d’en faire l’un des éléments de la contractualisation. Avis défavorable.
La Commission rejette l’amendement.
Elle en vient ensuite à l’amendement AS1006 du rapporteur.
M. le rapporteur. Cet amendement prévoit que, dans les entreprises ne disposant pas de délégués syndicaux, les accords de préservation ou de développement peuvent être conclus par des élus mandatés ou, à défaut, par des salariés mandatés. Leur négociation nécessite, en effet, une formation spécifique et l’assistance des organisations syndicales. Il s’agit d’une mesure qui figurait dans la proposition de loi relative à la simplification et au développement du travail, de la formation et de l’emploi, de Gérard Cherpion.
La Commission adopte l’amendement.
Puis elle examine, en discussion commune, les amendements AS753 de Mme Éva Sas et AS248 de Mme Marie-Lou Marcel.
M. Philippe Noguès. Les accords mentionnés à l’article 11 sont signés au nom de l’intérêt économique de l’entreprise, de la préservation de sa compétitivité ou de son anticipation. Cependant, les salariés qui refuseraient les conséquences de l’application de cet accord sur leur contrat de travail se verraient licenciés pour raison personnelle et non pour motif économique. Figureraient donc désormais dans le nouveau code du travail, d’une part, des accords de maintien de l’emploi entraînant des licenciements économiques et, d’autre part, des accords offensifs, signés dans des entreprises qui ne sont pas forcément en difficulté, qui entraîneraient des licenciements secs. Ce déséquilibre est inadmissible, c’est pourquoi nous proposons, avec l’amendement AS753, de requalifier le licenciement en licenciement économique.
Mme Marie-Lou Marcel. Il nous paraît y avoir une contradiction à l’article 11, entre l’alinéa 4, selon lequel le salarié peut refuser la modification de son contrat de travail résultant de l’application d’un accord d’entreprise conclu en vue de la préservation ou du développement de l’emploi, et l’alinéa 5, qui autorise l’employeur à engager, à l’encontre d’un salarié ayant refusé l’application de l’accord à son contrat de travail, une procédure de licenciement dont le motif ne serait pas économique mais reposerait sur une cause réelle et sérieuse. C’est la raison pour laquelle nous proposons la requalification du licenciement en licenciement économique.
Mme Isabelle Le Callennec. Le salarié peut refuser la modification de son contrat de travail résultant de l’application de l’accord, et il est possible à l’employeur d’engager contre lui une procédure de licenciement. Cela signifie donc, a contrario, qu’il peut ne pas le faire ; auquel cas que se passe-t-il ?
M. Jean-Patrick Gille. L’amendement de Philippe Noguès reprend les dispositions figurant au deuxième alinéa de l’article L. 5125-2 du code du travail et qui valent pour l’accord de maintien de l’emploi. L’adopter reviendrait dès lors à supprimer quasiment la distinction entre les AME et les accords de préservation ou de développement de l’emploi.
Quoi qu’il en soit, la vraie question est ce qu’il advient des salariés refusant l’accord. Pour ma part, j’ai déposé un amendement, mais je suis prêt à me rallier à la solution proposée par Philippe Noguès d’un licenciement assorti des protections qui accompagnent le licenciement individuel pour motif économique.
M. le rapporteur. Ce que propose Marie-Lou Marcel, c’est qu’il ne puisse y avoir de licenciement. Doit-on, dans ce cas, envisager la démission du salarié qui n’est pas favorable à l’accord ? Cela me paraît délicat et contraire à l’esprit de ces accords. Je suis donc défavorable à l’amendement AS248.
Quant à l’amendement de Philippe Noguès, il rejoint ma position d’origine, dans la mesure où je considérais que le salarié licencié ne pouvait l’être pour un motif personnel puisque ce n’était pas lui qui avait choisi la mise en œuvre de l’accord. Cependant, il me paraît très complexe de motiver un licenciement économique, alors même que l’entreprise n’est pas dans une situation où il existe des éléments tangibles prouvant ses difficultés économiques.
C’est la raison pour laquelle j’ai proposé un amendement AS1045, que je me propose de défendre ici. J’insiste sur le fait qu’il est incomplet, du fait de l’article 40. C’est la raison pour laquelle, si la Commission l’adopte dans sa forme actuelle, le Gouvernement s’est engagé à le compléter lors de la discussion en séance publique.
Cet amendement écarte la qualification de licenciement pour motif personnel. Il précise que le licenciement est prononcé selon les modalités de la procédure applicable au licenciement individuel pour motif économique. De la sorte, le licenciement n’est pas lié à la personne du salarié mais aux nécessités de bon fonctionnement de l’entreprise ou du service imposées par les besoins économiques, technologiques ou structurels.
Dans un second temps, pour apporter aux salariés licenciés en cas de refus de la modification de leur contrat de travail des garanties légitimes, je souhaite que cet amendement soit enrichi en séance publique par un dispositif spécifique d’accompagnement de ces salariés.
J’émets donc un avis défavorable sur les deux amendements et vous invite à adopter mon amendement inachevé – j’ai eu l’honnêteté de vous en donner les raisons. J’ai reçu l’assurance du Gouvernement que celui-ci le compléterait en séance.
Mme Marie-Lou Marcel. Vous avez mal compris mon amendement. Il dit que le salarié ne peut pas être licencié en cas de refus de la modification de son contrat de travail. Mon second amendement, que nous n’examinerons probablement pas, prévoit que si licenciement il y a, celui-ci doit être considéré comme un licenciement pour motif économique, et non pas pour motif personnel.
Mme Isabelle Le Callennec. Que se passe-t-il si l’employeur n’engage pas de procédure de licenciement à l’encontre du salarié ?
Quelle différence faites-vous entre le licenciement individuel pour motif économique et le licenciement pour motif économique, notamment au regard des conséquences tant pour le salarié que pour le chef d’entreprise ?
M. le rapporteur. Il s’agit d’un licenciement individuel car il n’entre pas dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi.
Le licenciement pour motif économique est conduit par étapes : un entretien préalable, la proposition par l’employeur d’un contrat de sécurisation professionnelle et l’information sur le congé de reclassement, la notification du licenciement, la mention de la priorité de réembauche ainsi que du délai de contestation dans la lettre de licenciement. Par ailleurs, le salarié a évidemment droit aux indemnités liées au licenciement pour motif économique.
Mais les indemnités ne sont pas le seul enjeu. Mon souci est de développer des politiques d’accompagnement très fortes pour les salariés. Je ne peux pas les inscrire dans le projet de loi puisque ce serait créer une charge nouvelle et donc tomber sous le coup de l’article 40. J’insisterai auprès du Gouvernement pour qu’il le fasse en séance.
M. Jean-Patrick Gille. J’ai compris votre raisonnement global mais je m’interroge sur les aspects pratiques.
Il semble que nous soyons tous d’accord pour retenir le motif économique. Je ne comprends pas pourquoi vous ne suivez pas cette logique jusqu’au bout. Vous évoquez la création d’un accompagnement spécifique pour les salariés licenciés dans le cadre de ces accords, alors que les dispositifs sont déjà prévus en cas de licenciement pour motif économique, en particulier celui que nous devons notamment à M. Cherpion, le contrat de sécurisation professionnelle, qui d’ailleurs fonctionne plutôt bien. Je ne comprends pas pourquoi les salariés dont nous parlons ne pourraient pas en bénéficier.
M. le rapporteur. Si je ne veux pas que mon amendement tombe sous le coup de l’article 40, je ne peux pas dire ce que je voudrais dire, à savoir que les salariés bénéficieront du CSP. L’amendement de M. Noguès, si nous l’adoptions, pourrait être déclaré irrecevable au titre de l’article 40. Il ne l’a pas été curieusement, mais il pourrait l’être.
Mme la présidente Catherine Lemorton. Il n’est pas frappé de l’article 40 parce que les effets induits sont très indirects.
M. Jean-Patrick Gille. L’article 40 ne peut pas s’appliquer rétroactivement.
M. Jean-Louis Bricout. Je me réjouis des solutions sécurisantes que nous proposons pour les salariés. Mais je m’étonne que nous soyons amenés à chercher des solutions pour faciliter le licenciement alors que les accords sont censés préserver ou développer l’emploi. Ce n’est pas très cohérent avec l’objectif du texte.
M. Francis Vercamer. Je ne comprends pas bien ce débat. Dès lors que les amendements substituent au motif personnel du licenciement le motif économique et renvoient aux articles du code du travail correspondants, le salarié licencié a droit à tout ce que ledit code prévoit en la matière.
M. le rapporteur. En ouvrant le droit au licenciement pour motif économique dans le cadre des accords offensifs, qui n’existaient pas jusqu’à présent, on ajoute un nouveau public susceptible de bénéficier des dispositions relatives au licenciement économique, on crée donc une charge, ce que je ne suis pas autorisé à faire.
Je suggère une rédaction qui valide le principe du licenciement pour motif économique. Il reviendra au Gouvernement de préciser en séance que le CSP, ainsi que l’ensemble des dispositifs d’accompagnement dont peut bénéficier un salarié à la suite d’un licenciement pour motif économique, s’appliquent dans le cadre des accords de préservation et de développement de l’emploi.
Successivement, la Commission rejette les amendements AS753 et AS248 et adopte l’amendement AS1045.
En conséquence, les amendements AS316 de M. Christophe Cavard, AS673 de M. Jean-Patrick Gille et AS249 rectifié de Mme Marie-Lou Marcel tombent.
La Commission est saisie de l’amendement AS752 de Mme Éva Sas.
M. Philippe Noguès. Cet amendement propose de supprimer l’alinéa 6. Les modalités de consultation des organisations syndicales et des institutions représentatives des salariés doivent être définies par la loi afin d’éviter des négociations déséquilibrées et une contestation de la consultation.
M. le rapporteur. Je vous invite à retirer votre amendement, car il est satisfait par celui que je vais présenter immédiatement.
L’amendement est retiré.
La Commission en vient à l’amendement AS939 du rapporteur.
M. le rapporteur. Cet amendement précise que l’accord doit définir les modalités de prise en compte de la situation des salariés invoquant une situation personnelle et familiale incompatible avec les aménagements de l’organisation du travail et des conditions de travail proposés, le cas échéant, par l’accord.
Il prévoit également que l’accord doit définir les modalités d’information des salariés quant à l’application de l’accord et à ses conditions de suivi. Le suivi de l’accord et l’information des salariés sont indispensables afin de vérifier que l’accord s’inscrit toujours dans le cadre défini dans le diagnostic partagé.
M. Élie Aboud. Je note avec satisfaction que vous faites référence à la situation familiale.
La Commission adopte l’amendement.
Puis elle examine l’amendement AS105 de M. Gérard Cherpion.
M. Gérard Cherpion. Cet amendement supprime la possibilité de mandater un expert-comptable. La proposition de négocier un accord offensif suppose que l’entreprise rencontre des difficultés ou qu’elle envisage un effort pour développer l’emploi. Dans tous les cas, l’entreprise ne peut pas se permettre de consacrer des fonds à l’expertise.
M. le rapporteur. À l’opposé de votre amendement, je propose d’étendre la possibilité de mandater l’expert-comptable.
Je rappelle que, dans le cadre des accords offensifs, l’entreprise ne connaît pas de difficultés, elle souhaite s’adapter pour conquérir de nouveaux marchés. Avis défavorable.
La Commission rejette l’amendement.
Elle passe à l’examen de l’amendement AS1007 du rapporteur.
M. le rapporteur. Afin de garantir l’équilibre de la négociation, cet amendement vise à étendre aux entreprises qui ne disposent pas d’un comité d’entreprise la possibilité de mandater un expert-comptable pour assister les négociateurs. Il rappelle que le coût de l’expertise est pris en charge par l’employeur.
M. Yves Blein, rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques. La commission des affaires économiques avait adopté un amendement AS884 qui s’inscrivait dans la même logique. Je le retire au profit de celui du rapporteur.
Mme Isabelle Le Callennec. Je note une différence entre l’amendement du rapporteur et celui du rapporteur pour avis. Dans le premier, il est écrit « peut être mandaté », et dans le second « est mandaté ». Je préfère la rédaction du rapporteur.
La Commission adopte l’amendement.
Les amendements identiques AS884 de la commission des affaires économiques et AS678 de Mme Audrey Linkenheld sont retirés.
La Commission examine, en discussion commune, les amendements AS922 du rapporteur, AS164 de M. Gérard Cherpion, AS726 de M. Olivier Faure et les amendements identiques AS883 rectifié de la commission des affaires économiques et AS677 de Mme Audrey Linkenheld.
M. le rapporteur. Cet amendement vise à encadrer la durée des accords de préservation et de développement de l’emploi en précisant que ceux-ci ne peuvent être conclus que pour une durée déterminée.
Compte tenu de la diversité des situations pouvant être couvertes par ces accords, il me paraît préférable de laisser les partenaires sociaux en décider de la durée.
À défaut de mention explicite, les accords sont conclus pour une durée de cinq ans. Cette durée est calquée sur celle qui prévaut désormais pour les accords de maintien de l’emploi – la durée initialement fixée à deux ans s’est avérée parfois trop juste pour que l’accord produise ses effets et a donc été portée à cinq ans.
M. Gérard Cherpion. Je retire mon amendement AS164 au bénéfice de celui du rapporteur.
M. Olivier Faure. Je regrette le retrait de l’amendement de M. Cherpion, car il me permettait de présenter mon amendement comme un point d’équilibre.
J’entends qu’il faut laisser aux partenaires sociaux la possibilité de déterminer la durée de l’accord. Mais la durée de cinq ans me paraît trop longue. Les efforts importants qui sont demandés aux salariés dans ces accords supposent que ces derniers soient régulièrement évalués.
La durée de deux ans proposée par M. Cherpion, qui témoigne des craintes que lui inspirent les accords offensifs, me paraît insuffisante. Mon amendement est un compromis entre les deux autres : il propose de fixer la durée à trois ans.
M. le rapporteur pour avis. Je retire mon amendement AS883 rectifié qui est satisfait par celui du rapporteur.
M. Michel Liebgott. Je retire également l’amendement AS677.
M. Gérard Sebaoun. J’entends l’argument consistant à laisser les partenaires sociaux négocier. En revanche, je suis perplexe sur la justification des efforts prolongés qui seraient demandés aux salariés si l’accord devait s’appliquer durant cinq ans – c’est long ! – alors que celui-ci a vocation à développer l’emploi et à favoriser la croissance de l’entreprise.
M. le rapporteur. Mon amendement ne fixe ni plancher, ni plafond. Il prévoit qu’à défaut de stipulation, la durée est de cinq ans.
Bien évidemment, l’intérêt des signataires est de déterminer une durée compatible avec les objectifs de l’accord offensif.
M. Élie Aboud. Prévoir une durée de cinq ans va favoriser le blocage des discussions, ce qui n’est pas approprié dans un contexte offensif.
Mme la présidente Catherine Lemorton. C’est mal connaître l’entreprise, monsieur Aboud.
Les choses évoluent bien plus vite que vous ne le pensez. Je le vois avec Airbus qui doit sans cesse s’adapter face à la concurrence de Boeing. La durée de cinq ans permet de se couvrir. En cinq ans, les entreprises ont le temps de revoir les accords, d’embaucher de nouveaux salariés, de changer de modèle, au gré des nouveaux marchés potentiels. Pour ce que j’en sais, une entreprise peut connaître de telles transformations en cinq ans que les partenaires sociaux seront inévitablement amenés à discuter de nouveau.
L’amendement du rapporteur me paraît en phase avec la réalité des entreprises.
Mme Sylviane Bulteau. S’il n’y a pas d’accord, la durée de cinq ans s’applique. Mais, si au bout de trois ans, les objectifs qui avaient justifié l’accord sont remplis, si le marché est acquis, quelle garantie avons-nous que l’employeur acceptera de réviser l’accord signé pour cinq ans ?
M. Olivier Faure. La durée de cinq ans est supplétive, elle ne s’impose pas aux partenaires sociaux, chacun l’a bien compris.
Pourtant, pendant cette période, l’entreprise va connaître des changements. Les accords offensifs, compte tenu des efforts qu’ils demandent aux salariés, doivent faire l’objet d’une évaluation la plus régulière possible. Une périodicité annuelle serait trop contraignante. Je propose de sous-amender en fixant la durée supplétive à trois ans renouvelables afin de ne pas laisser perdurer des accords qui maintiendraient l’effort des salariés alors que les objectifs sont atteints.
M. Jean-Patrick Gille. Les accords défensifs, parce qu’ils exigent de gros efforts pour faire face aux difficultés de l’entreprise, doivent être bordés dans le temps. A priori, il n’est pas nécessaire de fixer une durée pour les accords offensifs puisqu’ils répondent à un besoin ponctuel de réorganisation de l’entreprise et à des préoccupations plus positives, à moins de concevoir ces accords comme nécessairement porteurs d’une régression.
Cela dit, les amendements que vous proposez sur cet article, monsieur le rapporteur, accentuent le parallélisme entre accords défensifs et offensifs.
Mme Isabelle Le Callennec. En adoptant cet article, nous aurons fait un grand pas. Depuis le temps que notre collègue Gérard Cherpion milite pour les accords offensifs, je suis ravie d’entendre des discours qui parviennent enfin à se rejoindre. Nous avons fait des progrès depuis quatre ans.
Les accords offensifs demanderont des efforts aux salariés, mais ils sont justifiés par la préservation ou le développement de l’emploi. Nous tenons là, je l’espère, un moyen de faire reculer le chômage. Votre Premier ministre vous l’a dit, ce projet de loi a vocation à créer de l’emploi et de la croissance. Le groupe Les Républicains votera l’article 11, malgré quelques amendements problématiques mais qui ne sont rien au regard du pas que nous venons de faire ensemble.
Je ne comprends pas pourquoi l’amendement ne se contente pas de préciser que l’accord est conclu pour une durée déterminée. Certaines entreprises ont une vision à très long terme tandis que les PME sont dans une autre logique. Il faut laisser à chacune la liberté de choisir la durée.
M. Olivier Faure. Les accords offensifs peuvent être très préjudiciables aux salariés. S’il n’est pas possible de diminuer le salaire mensuel, l’augmentation du temps de travail a pour effet de réduire la rémunération de l’heure de travail. L’accord n’est donc pas forcément positif pour le salarié.
On peut comprendre que l’entreprise ait besoin de cet effort pour conquérir de nouveaux marchés, se développer et créer de l’emploi. Mais, si l’entreprise ne réalise pas les objectifs annoncés, aucune sanction n’est prévue. La seule façon d’inciter l’employeur à tenir ses engagements, c’est de procéder à une évaluation régulière.
La durée supplétive que vous prévoyez laisse s’écouler trop de temps avant de pouvoir vérifier que l’employeur a déployé les moyens promis pour créer de l’emploi ou conquérir des marchés.
M. Gérard Sebaoun. Mon inquiétude porte sur un tout autre sujet, mais je ne l’ai pas formalisée dans un amendement. Elle concerne l’alinéa 10 aux termes duquel la consultation annuelle « porte, le cas échéant, sur les conséquences pour les salariés de l’accord conclu ». Je m’étonne de la mention « le cas échéant » s’agissant d’une restructuration.
M. le rapporteur. Les accords de maintien de l’emploi sont conclus pour une durée maximale de cinq ans, ce qui est compréhensible : si l’entreprise ne parvient pas à se redresser en cinq ans, son avenir semble irrémédiablement compromis.
Mon amendement ne propose pas de fixer à cinq ans la durée maximale des accords offensifs. Il prévoit qu’à défaut de durée spécifiée dans l’accord, la durée ne peut excéder cinq ans. Il appartient aux partenaires sociaux d’en décider au cours de la négociation, sachant que cette durée n’est pas plafonnée. Même si je n’imagine pas qu’un accord de cette nature puisse être signé pour sept ans, cela est possible.
Je rassure M. Faure, nous avons adopté précédemment un amendement qui prévoit des clauses de suivi dans l’accord. Il est important de conserver de la souplesse.
M. Olivier Faure. Si le suivi montre que les mesures prises par l’employeur ne sont pas conformes aux engagements, une sanction est-elle prévue permettant d’interrompre l’accord ? Si ce n’est pas le cas, il faut prévoir une durée supplétive la plus courte possible.
M. le rapporteur. Dans le cas que vous évoquez, les partenaires sociaux sont libres de dénoncer l’accord en respectant la procédure habituelle. De ce point de vue, il n’y a aucun changement.
Les amendements AS164, AS883 rectifié et AS677 sont retirés.
La Commission adopte l’amendement AS922.
En conséquence, l’amendement AS726 tombe.
La Commission adopte ensuite l’amendement AS795 de correction du rapporteur.
Puis elle adopte l’article 11 modifié.
*
* *
La Commission examine l’amendement AS187 de Mme Isabelle Bruneau.
M. Jean-Patrick Gille. Cet amendement, pour dire les choses clairement, vise à éviter les licenciements boursiers. Il prévoit que les dirigeants ne pourront bénéficier d’un intéressement aux résultats de l’entreprise si celle-ci a vu diminuer son effectif de salariés à la fin de l’exercice comptable.
M. le rapporteur. Je comprends l’esprit de votre proposition mais cette disposition concernerait un grand nombre d’entreprises puisque vous n’établissez pas de limites quantitatives : elle peut s’appliquer à une diminution d’effectif aussi bien d’un salarié que de plusieurs dizaines. Par ailleurs, elle met sur le même plan tous les types de licenciements et de départs et concernerait donc aussi les licenciements pour faute grave ou les départs pour motif personnel. La rédaction n’est pas adaptée. Avis défavorable.
M. Jean-Patrick Gille. Nous pourrions l’adopter afin que vous affiniez sa rédaction.
M. le rapporteur. Mieux vaut que vous le retiriez pour formuler une nouvelle rédaction en vue de la séance.
M. Jean-Patrick Gille. Comme je ne suis pas premier signataire, je ne m’autorise pas à le retirer.
La Commission rejette l’amendement.
*
* *
Article 12
(Art. L. 2122-4, L. 2232-32 à L. 2232-35, L. 2232-36 à L. 2239 [nouveaux], L. 2253-5 et L. 2253-6 [nouveaux] du code du travail)
Sécurisation des accords de groupe et des accords interentreprises
Cet article vise à clarifier le régime juridique applicable aux accords de groupe et aux accords conclus entre plusieurs entreprises.
Il s’agit en premier lieu de sécuriser juridiquement les accords de groupe. Ces derniers ont été consacrés par la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social, afin de permettre à un groupe d’entreprises de conclure des accords sur des sujets d’intérêt commun aux personnels des entreprises du groupe. Selon l’étude d’impact, quelques 50 000 groupes sont recensés en France, qui emploient environ dix millions de salariés. Il s’agit donc d’un niveau incontournable de négociation collective.
Pourtant, les contours et la portée de l’accord de groupe sont mal définis, ce qui explique sans doute que le nombre d’accords de groupe recensé chaque année reste peu élevé : en 2014, 781 accords et avenants de groupe ont été signés, ce qui représente seulement 2 % de l’ensemble des accords et avenants conventionnels conclus la même année.
Aux termes de l’article L. 2232-31 du code du travail, l’accord de groupe est négocié entre, d’une part, l’employeur de l’entreprise dominante ou un ou plusieurs employeurs des entreprises concernées par le champ de l’accord et, d’autre part, par les organisations syndicales de salariés représentatives dans le groupe ou dans l’ensemble des entreprises concernées par le champ de l’accord.
Pour favoriser le déroulement des négociations dans les meilleures conditions possibles, le a du 2° modifie l’article L. 2232-32 afin de préciser que « les organisations syndicales de salariés représentatives dans chacune des entreprises ou chacun des établissements compris dans le périmètre de l’accord sont informées préalablement à l’ouverture d’une négociation dans ce périmètre ».
Cette disposition suppose de connaître les critères d’appréciation de la représentativité des organisations syndicales au niveau du groupe : le b du 2° dispose ainsi à l’article L. 2232-32 que la représentativité s’apprécie « à l’échelle de l’ensemble des entreprises ou établissements compris dans le périmètre de [l’]accord ».
En conséquence, le 1° complète l’article L. 2122-4 du même code afin de préciser les modalités d’appréciation de cette représentativité en fonction du périmètre concerné. Deux cas de figure sont distingués :
− lorsque le périmètre des entreprises ou établissement compris dans le champ de l’accord est inchangé par rapport à celui d’un accord conclu au cours du cycle électoral précédant l’engagement des négociations, la représentativité des organisations syndicales est appréciée par addition de l’ensemble des suffrages obtenus dans les entreprises ou établissements au cours du cycle électoral précédent, assurant ainsi une certaine stabilité des acteurs de la négociation ;
− en revanche, lorsque le périmètre a évolué, sous l’effet d’une restructuration du groupe par exemple, la représentativité s’apprécie en additionnant l’ensemble des suffrages obtenus lors des dernières élections ayant eu lieu dans les entreprises ou établissements compris dans le périmètre de l’accord, de manière à conforter la légitimité d’un accord intervenant dans un paysage syndical modifié.
b. L’alignement des modalités de validité des accords de groupe sur les modalités applicables aux accords d’entreprise
Par coordination avec les nouvelles modalités de validation des accords d’entreprise prévues à l’article 10 de ce projet de loi, le 4° modifie l’article L. 2232-34 relatif aux conditions de validité d’un accord de groupe afin de préciser que la validité s’apprécie dans les mêmes conditions que pour les accords d’entreprise ou d’établissement :
− à compter de la promulgation de la loi et jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions prévues à l’article 10 (cf. supra), la validité de l’accord de groupe est conditionnée à son approbation par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins 30 % des suffrages aux dernières élections professionnelles et à l’absence d’opposition de la part d’organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins 50 % des suffrages aux mêmes élections ;
− dans un délai d’un an à compter de la remise du rapport de la commission créée à l’article premier du projet de loi, ou au plus tard le 1er septembre 2019, la validité de l’accord sera conditionnée à son approbation par accord majoritaire, ou par un accord recueillant l’approbation de 30 % des organisations syndicales de salariés représentatives et celle d’une majorité de salariés.
Il est précisé que les majorités de 30 et de 50 % sont appréciées à l’échelle de l’ensemble des entreprises ou établissements compris dans le périmètre de cet accord ; en outre, l’opposition majoritaire ou la consultation des salariés sont appréciées également, le cas échéant, dans ce même périmètre.
L’article L. 2232-35 modifié par le 5° dispose que les conditions de forme, de notification, de dépôt et de publicité applicables aux accords de groupe sont celles prévues aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du titre III du livre II de la deuxième partie du travail. Celles-ci précisent notamment que la convention ou l’accord doit être écrit, rédigé en français, et conclu entre une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives et une ou plusieurs organisations professionnelles d’employeurs.
En l’état du droit, l’article L. 2232-30 du code du travail, créé par la loi du 4 mai 2004, ne précise pas l’étendue du champ couvert par un accord de groupe. Depuis, la possibilité de recourir à l’accord de groupe a donc été précisée au cas par cas par plusieurs lois, la dernière en date étant la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi, qui a prévu la possibilité de négocier un accord permettant de procéder à la consultation sur les orientations stratégiques au niveau du groupe.
Selon l’interprétation proposée par une circulaire de la Direction générale du travail en 2004 (27), la négociation de groupe n’avait en effet « pas vocation » à se substituer à l’accord d’entreprise, bien que rien ne l’en empêche expressément. Suivant ce raisonnement, la circulaire précisait que les obligations annuelles ou pluriannuelles de négocier dans l’entreprise relèvent bien du niveau de l’entreprise, « même si un accord de groupe peut valablement être conclu dans ces domaines ». L’incertitude juridique qui pèse sur la portée des accords de groupe nuit donc au développement de la négociation collective à ce niveau.
Pour lever toute ambigüité et renforcer la portée des accords de groupe, le 3° modifie l’article L. 2232-33 afin de permettre à un accord de groupe d’engager l’ensemble des négociations pouvant actuellement être conduites au niveau de l’entreprise, sous réserve des éventuelles adaptations prévues par la section 4 du chapitre II du titre III du livre II de la deuxième partie du travail, relative aux conventions et aux accords de groupe.
Les accords de groupe pourront donc porter également sur les négociations annuelles obligatoires d’entreprise prévues à l’article L. 2242-1 du code du travail, telles que la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise.
2. L’articulation des normes conventionnelles entre les accords de groupe, les accords d’entreprise et les accords d’établissement
Compte tenu du renforcement de la légitimité des accords d’entreprise et des accords de groupe proposé par le projet de loi, se pose la question de l’articulation entre ces accords et les autres niveaux de négociation. Il convient en effet de déterminer la hiérarchie des normes conventionnelles applicable lorsqu’un même sujet est susceptible de faire l’objet de négociations collectives à plusieurs niveaux.
Le 7° insère à cette fin un chapitre III bis intitulé « Rapports entre accords de groupe, accords d’entreprise et accords d’établissement » au sein du titre V du livre II de la deuxième partie du code du travail. Ce nouveau chapitre crée deux articles L. 2253-5 et L. 2253-6.
L’article L. 2253-5 consacre tout d’abord la possibilité de faire primer l’accord de groupe sur les accords d’entreprise ou d’établissement. Lorsqu’une négociation au niveau du groupe aboutit à un accord alors que les entreprises ou éventuels établissements compris dans le périmètre de l’accord de groupe disposaient déjà d’un accord sur le même objet, les stipulations de l’accord de groupe pourront donc prévaloir sur les dispositions des accords d’entreprise ou d’établissement, à condition toutefois que l’accord de groupe le prévoie expressément. Il s’agit là d’un garde-fou essentiel : l’employeur de l’entreprise dominante ne pourra pas décider de faire prévaloir l’accord de groupe par simple décision unilatérale ; les organisations syndicales de salariés devront également valider cette primauté. La primauté de l’accord de groupe pourra s’exercer de manière rétroactive, sur les accords d’entreprise ou d’établissement déjà négociés, ou pour les accords à venir.
Cette primauté de l’accord de groupe vaudra y compris si les stipulations de l’accord de groupe sont moins favorables aux salariés que celles de l’accord d’entreprise.
Dans le même ordre d’idées, l’article L. 2253-6 prévoit qu’un accord d’entreprise peut prévaloir sur les stipulations d’un accord d’établissement portant sur le même objet, que cet accord ait été conclu avant ou après la conclusion de l’accord d’entreprise. Cette primauté suppose toutefois, comme pour l’accord de groupe, que l’accord d’entreprise en dispose expressément.
Par ailleurs, l’accord de groupe pourra également prévaloir sur l’accord de branche, sans que celui-ci ait à le prévoir expressément, dans toutes les matières pour lesquelles l’accord de groupe peut se substituer à l’accord d’entreprise : le 5° supprime en effet les dispositions actuelles de l’article L. 2232-35 du code du travail prévoyant qu’une convention ou qu’un accord de groupe ne peut comporter des dispositions dérogatoires à celles applicables au niveau de la branche.
Le 6° crée ensuite au sein du chapitre II du titre III du livre II de la deuxième partie du code du travail une section 5 consacrée aux accords interentreprises. La nouvelle section comporte quatre articles L. 2232-36 à L. 2232-39.
Il faut rappeler au préalable qu’aucun cadre juridique n’existe actuellement dans le code du travail, seules les notions d’accord de site et d’accord territorial étant reconnues.
L’article L. 2232-36 pose donc le principe de l’accord interentreprises, indiquant que celui-ci peut être négocié « au niveau de plusieurs entreprises », à la fois par les employeurs des entreprises concernées et par les organisations syndicales représentatives de l’ensemble des entreprises concernées.
L’article L. 2232-37 détaille ensuite les modalités d’appréciation de la représentativité des organisations syndicales entrant dans le champ de l’accord : celle-ci est appréciée dans les mêmes conditions que la représentativité syndicale au niveau de l’entreprise et de l’établissement prévue aux articles L. 2122-1 et L. 2122-2, c’est-à-dire que les organisations syndicales doivent avoir recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des élections des titulaires au comité d’entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants. Dans le cadre d’un accord interentreprises, les suffrages obtenus dans chaque entreprise ou établissement dans le champ de l’accord sont additionnés afin d’obtenir la représentativité des organisations syndicales dans le périmètre de l’accord.
Les conditions de validité de l’accord interentreprises prévues à l’article L. 2232-37 sont les mêmes que celles applicables à l’accord de groupe : il s’agit donc dans un premier temps d’une validation par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins 30 % des suffrages aux dernières élections professionnelles et à défaut d’opposition de la part d’une majorité des organisations syndicales représentatives. Dans un délai d’un an à compter de la remise du rapport de la commission de refondation du code ou au plus tard au 1er septembre 2019, l’accord sera valide s’il recueille l’aval d’organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages aux dernières élections, ou, à défaut, l’aval d’organisations syndicales représentatives ayant reçu plus de 30 % des suffrages aux dernières élections et sous réserve de l’approbation de l’accord par une majorité de salariés. Les conditions de majorité de 30 % et de 50 % sont appréciées à l’échelle de l’ensemble des entreprises comprises dans le périmètre de l’accord.
Enfin, à l’instar de l’article L. 2232-35 pour les accords de groupe, l’article L. 2232-39 précise que les conditions de forme, de notification, de dépôt et de publicité applicables aux accords de groupe sont celles prévues aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du titre III du livre II de la deuxième partie du code du travail.
*
Outre deux amendements rédactionnels, la Commission a adopté l’amendement AS 923 du rapporteur précisant qu’à défaut d’accord, le fait d’avoir engagé des négociations au niveau du groupe ne dispense pas les entreprises appartenant à ce groupe des négociations obligatoires prévues au chapitre II du titre IV du livre II de la deuxième partie du code du travail.
La Commission a également adopté l’amendement AS 924 du rapporteur qui prévoit qu’un accord interentreprises conclu entre plusieurs entreprises peut prévoir que ses stipulations priment sur celles des accords d’entreprise ou d’établissement ayant le même objet et compris dans le périmètre de cet accord.
*
La Commission adopte successivement les amendements rédactionnels AS837 et AS796 du rapporteur.
Elle est saisie de l’amendement AS317 de M. Christophe Cavard.
Mme Véronique Massonneau. Nous devons veiller à ne pas dessaisir les organisations de l’entreprise du contenu des négociations dans le cadre de l’articulation entre accord de groupe et accord d’entreprise. C’est pourquoi nous avons déposé deux amendements en ce sens.
L’amendement AS317 supprime la possibilité pour l’employeur de substituer des négociations de groupe à toutes les négociations d’entreprise de manière unilatérale. Il renvoie aux accords de méthode.
L’amendement AS318 propose de soumettre tout accord de groupe engageant les entreprises ou établissements compris dans le périmètre de cet accord à un accord de méthode préalablement défini. En l’état actuel de la rédaction du projet de loi, les dispositions portent en effet atteinte au principe d’autonomie des niveaux de négociation et font du groupe un niveau hiérarchiquement supérieur à celui de l’entreprise. Or le groupe peut être moins pertinent pour l’intérêt des salariés, par exemple quand il s’agit de groupes multisectoriels.
M. le rapporteur. Si je veux être cohérent avec le débat que nous avons eu sur l’article 7, je ne peux me déclarer favorable à une procédure qui imposerait la conclusion d’un accord de méthode. Avis défavorable aux deux amendements.
La Commission rejette l’amendement.
Puis elle examine l’amendement AS923 du rapporteur.
M. le rapporteur. Cet amendement vise à préciser qu’en cas d’échec des négociations engagées au niveau d’un groupe d’entreprises, les entreprises de ce groupe restent tenues d’engager les négociations obligatoires prévues par le code du travail.
La Commission adopte l’amendement.
Elle rejette ensuite l’amendement AS318 de M. Christophe Cavard.
La Commission en vient à l’amendement AS924 du rapporteur.
M. le rapporteur. Cet amendement vise à préciser que les stipulations d’un accord interentreprises conclu entre plusieurs entreprises priment sur celles des accords d’entreprise ou d’établissement ayant le même objet et compris dans le même périmètre.
La Commission adopte l’amendement.
Puis elle adopte l’article 12 modifié.
*
* *
Article 13
(Art. L. 2232-5-1 [nouveau], L. 2232-9 et L. 2261-32 du code du travail)
Missions des branches professionnelles
Le projet de loi encourage la dynamisation du dialogue social à tous les niveaux de négociation collective. Si le dialogue social au sein de l’entreprise a particulièrement été mis en exergue, avec la généralisation des accords majoritaires proposée à l’article 10, le niveau de la branche professionnelle mérite également d’être soutenu. Et ce à double titre : d’abord, parce que la négociation y est relativement dynamique – avec 1 032 accords et avenants conclus en 2014 ; ensuite, parce que son rôle d’appui auprès des entreprises, notamment les plus petites d’entre elles, est primordial.
L’éparpillement du paysage conventionnel nuit pourtant à cet objectif, puisque parmi les 700 branches recensées, nombre d’entre elles se caractérisent par une faible activité conventionnelle. Telle est la raison pour laquelle l’article 14 du projet de loi propose de relancer le chantier de la restructuration des branches. Il apparaît toutefois nécessaire, préalablement à cette réorganisation du paysage conventionnel, de réaffirmer les objectifs des branches professionnelles.
Afin d’asseoir et de renforcer le rôle de ces rouages essentiels à la négociation collective, cet article vise donc à consolider la négociation de branche en définissant les contours de ses missions, et en instituant dans chaque branche une commission permanente en charge de la planification et de la conduite des négociations.
1. La branche, lieu de définition des garanties des salariés et de régulation entre les entreprises d’un même secteur d’activité
Dans son rapport, M. Jean-Denis Combrexelle (28) recense quatre missions accomplies par les branches professionnelles :
− la première finalité d’une branche professionnelle est de définir « l’ordre public conventionnel » applicable et opposable à l’ensemble des entreprises du secteur ;
− sa deuxième finalité est de jouer le rôle de « prestataire de services » vis-à-vis des entreprises, c’est-à-dire d’être en mesure de proposer des instruments − accords-type d’entreprise, exemples de bonnes pratiques, etc. − facilement exploitables par les entreprises du secteur ;
− la troisième ambition prêtée aux branches par le rapport de M. Combrexelle est la définition des stipulations supplétives applicables en l’absence d’accord d’entreprise, dans les domaines définis par le code du travail. Il s’agit ici d’offrir un socle conventionnel solide aux entreprises qui ne sont pas couvertes par des accords d’entreprise, au premier chef les très petites entreprises (TPE) et les petites et moyennes entreprises (PME) ;
− enfin, la dernière finalité est d’animer les négociations en matière de formation et d’emploi dans le secteur d’activité concerné, afin d’organiser une véritable gestion prévisionnelle des effectifs au niveau de la branche.
Un dernier objectif, avancé par M. Patrick Quinqueton (29), est d’ordre économique : la structuration d’un secteur d’activité en convention collective peut permettre de limiter la concurrence par les bas salaires grâce aux négociations de branche.
Sur le fondement de ces objectifs, le paragraphe I crée un article L. 2232-5-1 proposant une définition des objectifs de la négociation de branche. Selon cet article, la négociation de branche vise « à définir des garanties s’appliquant aux salariés employés par les entreprises d’un même secteur, d’un même métier ou d’une même forme d’activité et à réguler la concurrence entre les entreprises de ce champ ».
Cette définition établit donc que la branche est un niveau de négociation propre à assurer la protection des salariés, en définissant leurs « garanties ». Dans son rapport, M. Combrexelle (30) rappelle en effet que la branche « est considérée comme le niveau pertinent de détermination d’un socle minimum de garanties sociales pour les salariés » tels que le salaire minimum, la formation, les qualifications ou encore les mesures relatives à la prévoyance.
Le champ de la branche retenu ici est celui habituellement considéré lors de la constitution ou de la fusion d’une branche, la branche n’ayant d’intérêt que si elle couvre des salariés et des entreprises confrontés aux mêmes contraintes économiques, soit parce qu’elles appartiennent à un même secteur d’activité, soit parce qu’elles se sont regroupées autour d’un même métier ou d’une même forme d’activité.
Enfin, cette définition met en exergue le rôle de régulation de la concurrence entre les entreprises relevant du champ de la branche. Comme le rappelle M. Combrexelle, la plupart des organisations sociales voient en effet dans la négociation conventionnelle « le moyen de limiter les risques d’une concurrence entre les entreprises d’un même secteur qui se ferait par du « dumping social », c’est-à-dire concrètement au détriment des salariés ».
Les branches peuvent aujourd’hui bénéficier de l’appui des commissions paritaires d’interprétation prévues à l’article L. 2232-9 du code du travail. Composées de représentants des employeurs et des salariés, ces commissions, dont les modalités de fonctionnement sont laissées à la libre appréciation des négociateurs, peuvent rendre deux types d’avis : soit des avis dénués de valeur contraignante, qui ont pour seul objet de guider les parties dans l’application de la convention ou de l’accord collectif, soit des avis ayant valeur d’avenant et, à ce titre, incorporés au dispositif de la convention ou de l’accord collectif.
Le II propose de modifier l’article L. 2232-9 pour remplacer les actuelles commissions paritaires d’interprétation par des commissions permanentes de négociation et d’interprétation aux missions élargies, destinées à soutenir et à développer les fonctions de prestation de services, de régulation et d’organisation de la branche.
Selon le 1° du II, ces commissions permanentes seraient ainsi chargées de représenter la branche, « notamment dans l’appui des entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics ». D’après les informations transmises au rapporteur, la multiplicité actuelle des instances au niveau de la branche peut parfois nuire à la visibilité des branches, notamment du point de vue des petites et moyennes entreprises. Ce manque de visibilité se révèle également problématique lorsque les branches sont sollicitées pour négocier sur des sujets transversaux. L’affirmation du rôle de représentation de la branche par la commission paritaire a donc vocation à remédier à ces difficultés.
Mais c’est avant tout un rôle organisationnel que ces commissions paritaires endosseront, en vertu des modifications proposées au 2° du II. Ainsi, la commission paritaire devra se réunir « au moins une fois par an » dans la perspective de la tenue des négociations obligatoires au niveau de la branche prévues au chapitre Ier du titre IV du livre II de la deuxième partie du code du travail, qui recouvrent notamment la négociation annuelle sur les salaires ou la négociation triennale sur la formation professionnelle.
La commission paritaire devra définir son « agenda social », c’est-à-dire le calendrier des négociations, en tenant compte des demandes des organisations syndicales de salariés représentatives portant sur des thèmes de négociation autres que les négociations obligatoires.
La commission paritaire sera également en charge de la rédaction d’un rapport annuel d’activité, dont la Commission nationale de la négociation collective sera destinataire.
Le 2° du II confie enfin aux commissions permanentes un rôle de veille « sur les conditions de travail et l’emploi » au sein de la branche. La branche est en effet un niveau pertinent de négociation sur les conditions de travail : si, au sens strict, les accords relatifs aux conditions de travail ne représentent que 4 % des accords de branche conclus en 2013 et en 2014, en pratique, les négociations sur les conditions de travail comprises au sens large du terme et comprenant notamment le temps de travail ou la rémunération, représentent une grande part des activités des branches.
Il est précisé qu’aux fins de sa mission de veille, la commission peut exercer les missions de l’observatoire paritaire de la négociation collective institué, en application de l’article L. 2232-10 du code du travail, au sein de chaque branche. Introduits par la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social, les observatoires de branche ont vocation à assurer le suivi des négociations d’entreprise au sein de la branche. Contrairement aux commissions paritaires d’interprétation, ils n’ont pas vocation à donner un avis sur les textes mais plutôt à regrouper et diffuser les bonnes pratiques au sein de la branche ; ils sont d’ailleurs destinataires des accords d’entreprise ou d’établissement visant à mettre en œuvre une disposition législative.
Combinée à la restructuration des branches proposée à l’article 14, qui permet de consolider ce niveau de négociation, l’ambition qui préside à la création de ces commissions paritaires permanentes est clairement d’offrir aux branches les moyens de jouer un rôle clé en matière de négociation collective.
Les missions de veille des normes conventionnelles, de diffusion des bonnes pratiques ou encore, de définition d’un calendrier précis de négociation, doivent progressivement permettre aux branches d’inciter les partenaires sociaux à créer les conditions pour que les accords conclus au niveau de la branche soient au moins juridiquement sécurisés, voire sources d’innovation et de compétitivité pour l’ensemble du secteur d’activité couvert par la branche.
Il va sans dire que ce rôle pivot de la branche sera particulièrement déterminant lorsque la branche est composée essentiellement de très petites entreprises ou d’entreprises de taille moyenne, qui n’ont pas toujours les moyens de conduire au sein de l’entreprise des négociations de qualité.
Notons enfin que la coordination proposée au III est incompatible avec la rédaction globale de l’article L. 2261-32 proposée à l’article 14, et doit donc être supprimée.
*
Outre cinq amendements rédactionnels ou de coordination, la Commission a adopté un amendement visant à renforcer la définition des missions des branches professionnelles, en précisant que le rôle de la branche professionnelle est bien de « définir » les garanties s’appliquant aux salariés employés par les entreprises de la branche (AS 929).
*
La Commission est saisie de l’amendement AS925 du rapporteur.
M. le rapporteur. Cet amendement vise à renforcer la définition des missions des branches professionnelles, en précisant que leur rôle est bien de « définir » les garanties s’appliquant aux salariés des entreprises qu’elles regroupent.
La Commission adopte l’amendement.
Puis elle adopte l’amendement rédactionnel AS926 du rapporteur.
Elle en vient à l’amendement AS531 de M. Francis Vercamer.
M. Francis Vercamer. Aujourd’hui, environ 400 000 salariés ne seraient pas couverts par des conventions collectives. Cet amendement vise à préciser dans la loi que « tout salarié est couvert par une convention collective de branche », ce qui permettra d’étendre le bénéfice des dispositions que nous sommes en train de voter.
M. le rapporteur. Avis défavorable. Cette rédaction est trop affirmative : il aurait fallu poser un objectif.
Par ailleurs, mieux vaudrait insérer cette mention dans l’article 14 relatif à la restructuration des branches.
La Commission rejette l’amendement.
Elle examine ensuite l’amendement AS107 de M. Gérard Cherpion.
M. Gérard Cherpion. Le II de l’article 13 prévoit de créer au sein des branches professionnelles des commissions paritaires permanentes de négociation et d’interprétation. Cette création est inutile : le travail de restructuration des branches professionnelles engagé doit permettre à chacune d’entre elles d’organiser ses travaux de négociation de manière autonome.
L’attribution de nouvelles missions à ces commissions est également porteuse d’insécurité. Le texte prévoit qu’elles seront, entre autres, chargées de fixer l’agenda de la négociation, d’établir un rapport annuel d’activité et d’exercer un rôle de veille sur les conditions de travail et d’emploi. Or ces missions ne sont pas directement liées à l’exercice de la négociation collective de branche.
De la même façon, l’articulation de ces missions avec celles dévolues aux commissions paritaires de l’emploi est également incertaine.
Enfin, il n’appartient pas à une instance de concertation telle qu’une commission paritaire de « représenter la branche dans l’appui aux entreprises ou vis-à-vis des pouvoirs publics ». Elle n’en aurait ni les moyens ni la légitimité, notamment auprès des entreprises.
M. le rapporteur. Avis défavorable. Nous ne pouvons pas faire le constat que la situation des branches est insatisfaisante sans nous doter d’outils contribuant à leur réorganisation. En l’occurrence, ces commissions paritaires de négociation et d’interprétation ont pour objectif de regrouper les instances aujourd’hui éparpillées et d’enrichir l’action de celles-ci par des compétences organisationnelles.
En outre, elles présentent l’intérêt non négligeable d’être dotées d’une identité forte et d’être un interlocuteur facilement identifiable par les entreprises de la branche et les pouvoirs publics.
Mme Isabelle Le Callennec. Une convention signée par les partenaires sociaux il y a quelques semaines précise le travail à effectuer dans les mois qui viennent pour atteindre l’objectif de diminution drastique du nombre de branches de sept cents à deux cents. N’est-ce pas redondant de le préciser à nouveau dans la loi ?
M. le rapporteur. Une convention n’a pas la même valeur que la loi.
La Commission rejette l’amendement.
Puis elle adopte successivement les amendements rédactionnels AS927 et AS813 du rapporteur.
Elle est saisie de l’amendement AS322 de M. Christophe Cavard.
Mme Véronique Massonneau. Rappelée dans la résolution 299 des Nations unies, et plusieurs fois dans l’accord issu de la COP21, la nécessité de développer la veille environnementale dans tous les aspects de la société trouve ici une modalité concrète d’application, au plus près des risques potentiels liés à l’activité des entreprises.
M. le rapporteur. En soi, l’objectif est louable mais très sincèrement, je crains que cet ajout ne vienne perturber les missions des commissions qui sont, je le rappelle, la régulation de la concurrence et l’accompagnement des entreprises du secteur concerné. Avis défavorable.
La Commission rejette l’amendement.
Elle adopte successivement l’amendement de coordination AS928 et l’amendement de correction AS929, tous deux du rapporteur.
Puis elle adopte l’article 13 modifié.
*
* *
Article 14
(Art. L. 2261-32, L. 2261-33 et L. 2261-34 [nouveaux] du code du travail)
Restructuration des branches professionnelles
Pour que le dialogue social au niveau des branches professionnelles soit efficace et opérationnel, les branches doivent faire preuve d’une activité conventionnelle dynamique et disposer de moyens d’actions à la hauteur de cette exigence.
Or, en dépit de la réforme de la structuration des branches professionnelles engagée par la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale et poursuivie par la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi, le paysage conventionnel français est encore très disparate : le nombre de branches professionnelles est ainsi estimé à 700, dont une partie se caractérise par des moyens réduits et une activité conventionnelle très limitée, voire inexistante.
Conscient de ce handicap, le Gouvernement s’est donné pour ambition de rationaliser le paysage conventionnel autour de 200 branches d’ici trois ans, et s’est appuyé sur la méthode de travail recommandée par le rapport sur la restructuration des branches remis par M. Patrick Quinqueton à la ministre en charge du travail en décembre dernier (31).
Pour atteindre cet objectif d’un paysage conventionnel resserré, le présent article propose donc d’accélérer le mouvement de restructuration des branches professionnelles en renforçant notamment les compétences du ministre en charge du travail en matière de fusion ou de rapprochement des branches professionnelles.
Les branches professionnelles se sont développées, au XXe siècle, à la suite de la prise de conscience de l’intérêt des conventions collectives dans la régulation des relations entre les salariés et les entreprises (32).
Soucieux de donner davantage de poids à la négociation collective, le législateur a progressivement introduit des dispositions auxquelles il est possible de déroger par voie d’accord, invitant tantôt les branches professionnelles, tantôt les entreprises à négocier sur une thématique donnée.
Si la branche représente de fait un niveau de négociation optimal pour développer le dialogue social dans un secteur économique donné, la taille très réduite de certaines branches s’est en revanche avérée être un frein à l’élaboration de normes conventionnelles de qualité, facilement exploitables par les entreprises de l’ensemble d’un secteur d’activité, faute de moyens à sa disposition.
Dès 2004, M. Michel de Virville (33) préconisait ainsi, dans un rapport au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, de « remédier à la fragmentation parfois excessive de certaines branches » et suggérait « d’appeler les partenaires sociaux à favoriser le regroupement des branches pour aboutir au total à moins d’une centaine de branches » (proposition n° 50).
Ce constat, renouvelé à plusieurs reprises, et notamment par M. Jean-Frédéric Poisson (34), en 2009, n’a débouché que tardivement sur l’élaboration d’une palette d’instruments à la disposition du ministre chargé du travail lui permettant soit d’inciter les partenaires sociaux à opérer à un rapprochement des branches professionnelles soit, à défaut, de procéder d’office à la fusion ou au regroupement de certaines branches.
Aussi, l’objectif d’une centaine de branches fixé par M. de Virville en 2004 est encore loin d’être atteint : dans un bilan datant de décembre 2014 (35), la Direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques (DARES) du ministère du travail indiquait qu’au 31 décembre 2012, 15,3 millions de salariés étaient couverts par 710 conventions collectives – hors branches agricoles –, représentant 494 conventions collectives dites « agrégées », une convention « agrégée » regroupant les échelons nationaux et territoriaux d’un même secteur d’activité.
Parmi ces quelques 500 conventions collectives agrégées, 13 % concentraient 73 % de l’emploi total des branches, tandis que 23 % d’entre elles, représentant un peu plus d’une centaine de conventions collectives agrégées, couvraient un effectif de moins de 1 000 salariés, pour un total inférieur à 0,2 % de l’effectif salarié de l’ensemble des branches.
Partant du constat que le morcellement des branches professionnelles nuit à la vitalité et à l’efficacité du dialogue social, la Grande conférence sociale de juin 2013 a permis la mise en place, sous l’égide de la Commission nationale de la négociation collective (CNNC), d’un comité de suivi de la structuration conventionnelle des branches ayant notamment pour mission d’examiner la situation des branches ne présentant plus d’activité conventionnelle depuis plusieurs années et d’encourager les regroupements de branche.
Le champ d’action du comité s’est toutefois heurté à l’insuffisance des instruments de régulation à sa disposition, l’essentiel de son action reposant sur sa capacité de conviction auprès des partenaires sociaux pour les inciter à entreprendre le chantier du regroupement des branches professionnelles.
Dès lors, la loi du 5 mars 2014 précitée a entrepris d’octroyer à l’administration davantage de moyens de régulation afin d’accélérer le mouvement de restructuration des branches professionnelles.
Les acteurs de la restructuration des branches professionnelles
Traditionnellement, c’est aux organisations syndicales de salariés et aux organisations professionnelles d’employeurs qu’il revient d’assurer la gestion des branches. Cette régulation s’exerce notamment dans le cadre de la Commission nationale de la négociation collective (CNNC).
Depuis 2014, une sous-commission dédiée à la structuration des branches, au sein de la CNNC, poursuit spécifiquement l’objectif de réduction des branches.
Les pouvoirs publics n’interviennent qu’à titre subsidiaire :
− soit en tant que « facilitateur » ou « arbitre ». L’État assure par exemple la présidence des commissions mixtes paritaires mises en place en cas de blocage des négociations ;
− soit pour mettre en place des mesures relevant uniquement de leurs compétences, telles que l’extension d’une convention collective ou son élargissement.
Source : Rapport de M. Patrick Quinqueton (décembre 2015).
Dans les branches où moins de 5 % des entreprises adhèrent à une organisation professionnelle d’employeurs, et qui se caractérisent soit par une faible dynamique de la négociation collective, soit par des moyens limités, l’article 29 de la loi du 5 mars, codifié à l’article L. 2261-32 du code du travail, a ainsi confié au ministre chargé du travail quatre types de compétences en la matière, qu’il peut exercer après avis de la CNNC :
– la possibilité d’élargir une convention de branche étendue à une branche, c’est-à-dire de rendre une convention collective applicable dans un champ autre que celui au sein duquel elle a été négociée ;
− la possibilité de fusionner le champ de la convention collective concernée avec celui d’une autre branche présentant des conditions économiques et sociales analogues ;
− la possibilité de refuser l’extension d’une convention collective − qui aurait pour effet de rendre une convention obligatoire dans un champ professionnel considéré − dans les branches dont la taille limitée, la faiblesse du nombre des entreprises, des effectifs et des ressources nuit au développement d’une activité conventionnelle dynamique ;
− la possibilité de refuser de déclarer représentatifs les partenaires sociaux dans les branches concernées.
La loi du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi a souhaité accélérer cette nouvelle structuration des branches professionnelles et a en conséquence renforcé les moyens du ministre en charge du travail pour y procéder. En particulier, l’article 23 de la loi du 17 août 2015 a admis le caractère alternatif des deux critères communs aux quatre dispositifs, c’est-à-dire la faible activité conventionnelle depuis cinq ans et le faible nombre d’entreprises adhérentes à des organisations professionnelles d’employeurs représentatives. Il a également abaissé à 6 mois le délai de réflexion accordé aux partenaires sociaux pour faire valoir leurs observations avant la décision ministérielle de fusion.
Malgré cette ambition affichée en faveur de la diminution du nombre de branches, force est de constater que l’objectif d’un paysage conventionnel restructuré autour d’une centaine de branches est encore loin d’être atteint.
Dans son rapport remis au Premier ministre en septembre 2015 (36) – qui, logiquement, ne rend pas compte des avancées de la loi du 17 août – M. Jean-Denis Combrexelle constatait que « l’organisation des branches apparaît très en deçà [des] exigences ».
Il rappelait que l’enjeu principal de cette restructuration était de s’assurer que l’organisation des branches professionnelles, « sans même parler du caractère dérisoire au regard des enjeux de certaines micro-branches, soit à la hauteur d’une régulation moderne par la négociation ». Or, selon M. Combrexelle, seule la réduction drastique du nombre de branches leur permettrait de redevenir « des lieux de régulation active », à la hauteur du défi de redynamisation de la négociation collective.
Compte tenu de l’élargissement du champ de la négociation collective qui est le fil rouge du présent projet de loi, il est urgent d’accélérer la réduction du nombre de branches professionnelles afin de renforcer leur effectivité et leurs moyens d’action.
En vertu du principe constitutionnel de liberté contractuelle, la responsabilité de la restructuration du paysage conventionnel relève en théorie des organisations professionnelles et syndicales concernées ; ce n’est qu’à défaut que les pouvoirs publics peuvent intervenir, lorsque l’intérêt général associé à la recomposition des branches l’exige. Cet article propose donc de renforcer les incitations invitant les partenaires sociaux à avancer dans le chantier de la restructuration des branches, tout en donnant à titre subsidiaire davantage de moyens au ministre en charge du travail pour procéder aux restructurations indispensables.
A. LA CONSOLIDATION DES INSTRUMENTS DE RESTRUCTURATION À LA DISPOSITION DU MINISTRE CHARGÉ DU TRAVAIL
En premier lieu, le 1° du I propose la réécriture de l’article L. 2261-32 du code du travail afin de préciser ou de modifier, le cas échéant, les conditions de mise en place des instruments dont dispose d’ores et déjà le ministre chargé du travail pour procéder à la réduction du nombre de branches. Le V de l’article L. 2261-32 modifié précise qu’un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application de cet article.
Le I de l’article L. 2261-32 propose tout d’abord de rendre alternatifs l’ensemble des critères énoncés à l’actuel article L. 2261-32, dans sa rédaction issue de la loi du 5 mars 2014, permettant ainsi plus facilement au ministre chargé du travail d’engager une procédure de fusion d’une convention collective avec celui d’une branche de rattachement. Le ministre pourrait en effet engager cette procédure dès lors que la branche se caractérise soit :
− par la faiblesse de ses effectifs salariés ;
− par la faiblesse de son activité conventionnelle, matérialisée par le nombre d’accords ou d’avenants signés et le nombre des thèmes de négociation couverts par ces accords ;
− par un champ d’application géographique seulement de portée locale ou régionale ;
− par un taux d’adhésion des entreprises composant la branche à une organisation professionnelle représentative des employeurs inférieur à 5 %.
Conformément à la définition de la branche professionnelle proposée à l’article 13 de ce projet de loi, il est précisé que la branche de rattachement doit présenter « des conditions sociales et économiques analogues » à la branche qui a vocation à être fusionnée.
Avant de procéder à la fusion, le ministre chargé du travail doit toutefois respecter plusieurs exigences.
Le ministre doit tout d’abord, par avis publié au Journal officiel, inviter les partenaires sociaux à « faire connaître leurs observations » concernant le projet de fusion, dans un délai déterminé par décret.
Le ministre doit ensuite recueillir l’avis motivé de la commission nationale de la négociation collective avant de procéder à la fusion. En cas de demande écrite et motivée de rattachement à une branche alternative émanant « soit de deux organisations professionnelles d’employeurs soit de deux organisations syndicales de salariés représentées à cette commission », le ministre doit solliciter à nouveau la CNNC avant de prononcer, le cas échéant, la fusion.
Le V précise que dans les trois années suivant la promulgation de la loi, le ministre chargé du travail ne peut procéder à ce type de fusion en cas d’opposition écrite et motivée de la majorité des membres de la CNNC, sauf lorsque la fusion concerne une branche dont le champ d’application géographique est uniquement régional ou local ou une branche n’ayant pas conclu d’accord ou d’avenant au cours des quinze années précédant la publication de la loi.
Le II de l’article L. 2261-32 permet ensuite au ministre chargé du travail de prononcer l’élargissement du champ d’application géographique ou professionnel d’une convention collective, afin qu’il s’applique à un secteur territorial ou professionnel non couvert par une convention collective.
La procédure à suivre est identique à celle développée au I de l’article L. 2261-32, c’est-à-dire que la décision d’élargissement ne pourra intervenir qu’après avis motivé de la CNNC. En outre, les « organisations et personnes intéressées » pourront faire connaître leurs observations dans un délai déterminé par décret, suite à la publication d’un avis publié au Journal officiel de la République française. Dans l’hypothèse où deux organisations demanderaient de façon motivée et écrite le rattachement à un autre champ d’application que celui proposé, le ministre devrait recueillir une nouvelle fois l’avis de la CNNC avant de prononcer, le cas échéant, l’élargissement du champ de la convention collective concernée.
Le III de l’article L. 2261-32 reprend, sans les modifier, les critères permettant au ministre chargé du travail de refuser l’extension d’une convention collective ou de ses avenants ou annexes, « eu égard à l’intérêt général attaché à la restructuration des branches professionnelles ». Il doit également recueillir préalablement l’avis de la CNNC.
d. Le refus d’arrêter la liste des organisations professionnelles d’employeurs et des organisations syndicales de salariés représentatives
De même, le IV de l’article L. 2261-32 modifié reprend sans modification les dispositions de l’actuel article L. 2261-32 permettant au ministre en charge du travail de refuser d’arrêter la liste des organisations professionnelles représentatives mentionnée à l’article L. 2152-6 ainsi que la liste des organisations syndicales reconnues représentatives pour une branche professionnelle au sens de l’article L. 2122-11. Ce refus doit toutefois être précédé de l’avis de la CNNC et du Haut Conseil du dialogue social.
2. Les modalités applicables en cas de fusion ou de regroupement du champ de plusieurs conventions collectives existantes
En cas de fusion ou de regroupement du champ de plusieurs conventions collectives existantes, se pose la question de savoir quelles sont les stipulations applicables : s’agit-il de celles de la convention collective de rattachement, celles de la convention collective rattachée, ou des dispositions tierces, négociées par chacune des branches ?
Le 2° du I du présent article choisit la troisième option, et crée à cette fin l’article L. 2261-33 du code du travail.
• La mise en place de stipulations communes
Le principe énoncé à l’article L. 2261-33 est qu’en cas de fusion de champs de conventions collectives ou de regroupement du champ de plusieurs conventions existantes suite à un accord, de nouvelles dispositions, négociées, se substituent aux stipulations qui étaient jusqu’alors applicables au sein de chaque convention collective, « lorsqu’elles régissent des situations équivalentes ».
L’accord établissant les nouvelles stipulations doit être conclu dans les cinq ans à compter de la date d’effet de la fusion ou du regroupement. À défaut, le troisième et dernier alinéa de l’article L. 2261-33 dispose que les stipulations applicables sont celles de la convention collective de rattachement.
• L’adaptation du principe d’égalité pendant une période transitoire
Dans les cinq ans suivant la date d’effet de la fusion ou du regroupement, à défaut d’accord, il est précisé que la branche issue du regroupement ou de la fusion « peut couvrir plusieurs conventions collectives ».
Compte tenu de la possible incompatibilité des stipulations des conventions collectives entre elles, le deuxième alinéa de l’article L. 2261-32 précise que dans l’intervalle entre la date d’effet de la fusion ou le regroupement et la conclusion de l’accord ou les cinq années suivant cette date, « le principe d’égalité ne peut être invoqué à l’encontre de stipulations conventionnelles différentes régissant des situations différentes ».
Le rapport de M. Combrexelle avait en effet attiré l’attention sur les adaptations nécessaires pendant cette période transitoire, expliquant que « les salariés issus des champs fusionnés ne se trouvent pas nécessairement à égalité pendant une période de transition au regard de certaines dispositions », cette inégalité constituant aujourd’hui un frein au regroupement de certaines conventions collectives.
Cet article fait donc le choix, au nom de l’intérêt général attaché à la restructuration des branches professionnelles, d’écarter momentanément le principe d’égalité pendant la période transitoire entre la fusion ou le regroupement et l’instauration de dispositions communes.
Selon M. Combrexelle, il n’est « pas question de remettre en cause le principe d’égalité de valeur constitutionnelle et de niveau communautaire », mais d’aménager une période transitoire dans la loi, justifiée par une mesure représentant un progrès social qui s’inscrit, à moyen terme, dans le respect du principe d’égalité.
Dans son avis sur le projet de loi, le Conseil d’État a validé cette approche, considérant que « l’intérêt général qui s’attache à la constitution de branches professionnelles d’une taille adaptée aux enjeux actuels de la négociation collective apparaît suffisant pour que puisse être admise provisoirement la persistance de différences de traitement antérieurement existantes entre les salariés ».
• Les acteurs de la négociation
Il convient ensuite de définir quelles organisations sont compétentes pour négocier en cas de fusion de champs conventionnels prononcée par le ministre du travail ou d’accord collectif prévoyant le regroupement de plusieurs conventions préexistantes.
L’article L. 2261-34 créé par le 3° du I précise que, jusqu’à la mesure de la représentativité suivant la fusion ou le regroupement, sont admises à négocier les organisations professionnelles d’employeurs ainsi que les organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’au moins une branche préexistant à la fusion ou au regroupement.
En complément des dispositifs de restructuration existants précisés au I, le II propose de nouveaux outils permettant d’accélérer la restructuration des branches.
Afin de mettre les partenaires sociaux face à leurs responsabilités, le 1° du II invite les organisations professionnelles d’employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel à engager, dans un délai de trois mois suivant la promulgation de la loi, une négociation sur la méthode permettant d’aboutir, dans les trois ans à compter de cette date, à un paysage conventionnel restructuré autour d’environ deux cents branches professionnelles.
En parallèle, le 2° du II dispose que, dans le même laps de temps de trois mois à compter de la promulgation de la loi, les organisations liées par une convention de branche initient des négociations en vue d’opérer les rapprochements permettant d’aboutir à cet objectif.
En complément, le ministre chargé du travail se voit confier de nouvelles attributions lui permettant de procéder d’office à certains regroupements en cas d’inactivité conventionnelle ou d’effectif réduit :
− le III lui permet d’engager, d’ici au 31 décembre 2016, la fusion des branches dont le rayonnement est trop limité compte tenu de leur champ d’application géographique de portée régionale ou locale, ou de leur très faible activité conventionnelle, caractérisée par l’absence de conclusion d’accord ou d’avenant au cours des quinze années précédant la publication de la loi. En pratique, ces deux caractéristiques se recoupent dans de nombreuses situations : l’étude d’impact rappelle en effet que sur les 241 branches n’ayant pas déposé d’accords depuis plus de dix ans, 212 ont une application uniquement régionale ou locale.
− le IV lui permet ensuite d’engager, à l’issue d’un délai de trois ans faisant suite à la promulgation de la loi, la fusion des branches caractérisées par un très faible effectif – moins de cinq mille salariés – et celle des branches n’ayant conclu aucun accord ou avenant au cours des dix années précédant la publication de la loi. Ces branches à très faible effectif se caractérisent en effet, sauf dans quelques cas exceptionnels, par une incapacité à répondre à la fois aux exigences de la négociation collective et à celles des salariés ou des entreprises. Selon l’étude d’impact, 374 branches comptant moins de cinq mille salariés seraient concernées par cette disposition.
Le V précise que la commission nationale de la négociation collective peut continuer de s’opposer à la majorité de ses membres à un projet de fusion du ministre du travail, mais ce pouvoir de véto ne vaudra que pendant trois ans à compter de la promulgation de la loi. En outre, comme il a été dit, ce pouvoir de véto n’est pas applicable lorsqu’il s’agit de fusions de branches territoriales ou locales n’ayant pas conclu d’accord depuis plus de quinze ans comme le permet le III.
*
Lors de son examen du texte, la Commission a adopté quinze amendements rédactionnels présentés par le rapporteur.
*
La Commission adopte successivement l’amendement de correction AS930 et les amendements rédactionnels AS931, AS814, AS932, AS815, AS816, AS817, AS933, AS818, AS819, AS820, tous du rapporteur.
Puis elle est saisie de l’amendement AS534 de M. Arnaud Richard.
M. Francis Vercamer. Nous saluons la volonté du Gouvernement d’accélérer la fusion des branches dont une toute petite partie seulement travaille activement. Hervé Morin a d’ailleurs plusieurs fois déposé des amendements visant à les restructurer à l’occasion de l’examen d’autres textes. Nous estimons toutefois que les réduire à deux cents n’irait pas assez loin et proposons un objectif de cent branches d’ici à trois ans.
M. le rapporteur. Il faut être prudent. Le regroupement des branches doit correspondre aux réalités qu’elles recouvrent. Je considère que l’objectif de deux cents fixé dans le texte sera déjà difficile à atteindre dans le temps imparti. Il ne me paraît pas raisonnable d’inscrire un objectif de cent dans un délai aussi bref. Avis défavorable.
M. Gérard Sebaoun. J’ai cru comprendre que certaines petites branches faisaient preuve d’efficacité et qu’il était difficile de les faire disparaître au prétexte qu’elles concernent peu de salariés. Le nombre importe sans doute moins que la qualité de la négociation qu’elles permettent de porter. L’objectif de deux cents me semble suffisant.
M. Francis Vercamer. Moins il y aura de branches, plus il sera simple de décliner la loi au plus près de l’entreprise et de juger les éventuels litiges.
Sensible aux arguments du rapporteur, je retire toutefois mon amendement. Nous évoquerons cet enjeu dans l’hémicycle et pourrons entendre Mme la ministre préciser ses objectifs en ce domaine.
L’amendement est retiré.
La Commission examine l’amendement AS109 de Gérard Cherpion.
M. Élie Aboud. Cet amendement vise à ajouter les organisations multiprofessionnelles parmi les instances et organisations qui prendront part à la réflexion sur la restructuration des branches.
M. le rapporteur. Je vous demanderai de retirer votre amendement. Les organisations multiprofessionnelles, qui ont vocation à siéger au sein de la commission nationale de la négociation collective en charge de la restructuration des branches, y sont déjà associées pour une part. C’est le cas de la Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles (FNSEA) et de l’Union nationale des professions libérales (UNAPL) et ce sera bientôt le cas de l’Union des employeurs de l’économie sociale et solidaire (UDES) ainsi que le Gouvernement s’y est engagé.
M. Élie Aboud. Je maintiens l’amendement et le redéposerai en séance s’il n’est pas adopté.
La Commission rejette l’amendement.
Puis elle adopte l’amendement rédactionnel AS934 du rapporteur.
Elle examine ensuite l’amendement AS108 de M. Gérard Cherpion.
Mme Isabelle Le Callennec. À ce jour, la production agricole compte cent quarante conventions collectives. En revanche, il n’existe pas de convention collective nationale.
Tout en actant le principe du regroupement des conventions collectives départementales, les partenaires sociaux de l’agriculture souhaiteraient maintenir un dialogue social actif et qualitatif au niveau de chaque territoire. Une dynamique de regroupement des conventions collectives départementales est engagée et une négociation nationale a débuté pour constituer un socle national commun à toute la production agricole. Celui-ci sera conçu comme une convention collective nationale agricole à laquelle rattacher l’ensemble des conventions collectives territoriales.
Il s’agit d’un chantier qui nécessite du temps, car il faut mener à bien, dans un premier temps, la négociation nationale pour créer le socle national et, dans un second temps, les nombreuses négociations collectives locales pour acter leur rattachement.
Dans cet amendement, il est proposé de fixer la date butoir au 31 décembre 2017 au lieu du 31 décembre 2016, ce qui paraît plus réaliste.
M. le rapporteur. La ministre a indiqué que la restructuration n’interviendrait pas à la date butoir du 31 décembre 2016 mais à l’issue de la négociation, ce qui est encore plus favorable que ce que vous suggérez.
Mme Isabelle Le Callennec. Je retire l’amendement. Cela donne, en effet, le temps aux partenaires sociaux de s’organiser.
L’amendement AS108 est retiré.
La Commission adopte ensuite successivement les amendements rédactionnels AS935, AS980 et AS821 du rapporteur.
Puis elle adopte l’article 14 modifié.
*
* *
Chapitre III
Des acteurs du dialogue social renforcés
Article 15
(Art. L. 1311-18 [nouveau] et L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales)
Locaux mis à la disposition des syndicats par les collectivités territoriales
Cet article vise à sécuriser le cadre juridique de mise à disposition de locaux, par les collectivités territoriales, à destination des syndicats.
1. La mise à disposition de locaux syndicaux par les collectivités territoriales : une pratique courante mais insuffisamment sécurisée
La mise à disposition par les collectivités de locaux au profit des syndicats, qui est proposée au titre des missions d’intérêt général accomplies par les syndicats, est un usage répandu dans de nombreuses collectivités territoriales. L’Inspection générale des affaires sociales (IGAS) estime en effet qu’il existe entre 250 et 800 locaux mis à disposition des syndicats dans toute la France, selon des modalités très diverses : il peut s’agir de l’occupation permanente ou ponctuelle de locaux, de la prise en charge par une commune seule ou par l’intermédiaire du financement de plusieurs collectivités, ou encore de prêts à titre gratuit ou à titre onéreux.
En dépit de l’usage courant de cette pratique, le corpus juridique qui l’encadre est très pauvre, et ce à double titre :
− d’une part, la mise à disposition de locaux pour les syndicats qui en font la demande est seulement prévue pour les communes, selon des modalités précisées à l’article L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales (CGCT) ;
− d’autre part, les seules dispositions existantes apportent très peu de garanties aux syndicats, puisqu’une commune peut décider de cesser la mise à disposition, sans préavis ni obligation de proposer un autre local au syndicat qui en bénéficiait jusqu’alors.
Cet article propose donc d’étendre et de renforcer le dispositif de mise à disposition de locaux syndicaux pour l’ensemble des collectivités territoriales, tout en veillant à apporter davantage de garanties aux syndicats.
Le I crée l’article L. 1311-18 au sein de la section 4 du chapitre unique du titre Ier du livre III de la première partie du CGCT, qui permet aux collectivités territoriales et à leurs groupements de mettre des locaux à disposition des syndicats, à condition que ces derniers en fassent expressément la demande. En vertu du principe de libre administration des collectivités territoriales, cette mise à disposition est une simple faculté et non une obligation.
Les conditions de la mise à disposition doivent toutefois être précisées, selon la collectivité considérée, par le maire, le président du conseil départemental, le président du conseil régional, le président d’un établissement public rattaché à une collectivité territoriale ou regroupant ces collectivités, ou le président d’un syndicat mixte. Les conditions fixées doivent notamment tenir compte « des nécessités de l’administration des propriétés de la collectivité, du fonctionnement des services et du maintien de l’ordre public ».
En outre, les assemblées délibérantes des différentes collectivités, à savoir le conseil municipal, le conseil départemental, le conseil régional, le conseil d’administration ou de l’établissement ou du syndicat mixte, peuvent fixer une contribution due à raison de la mise à disposition du local.
Une convention relative aux conditions de la mise à disposition peut également être conclue entre la collectivité et le syndicat bénéficiaire.
Le dernier alinéa de l’article L. 1311-18 sécurise la mise à disposition des locaux en prévoyant que lorsqu’un syndicat a bénéficié pendant une durée au moins égale à cinq années, la collectivité ne peut lui retirer le bénéfice de ce local sans lui proposer un local alternatif lui permettant d’assurer la continuité de ses missions. À défaut et à moins que la convention conclue entre le syndicat et la collectivité n’en dispose autrement, le syndicat a droit à une indemnité spécifique.
Ces dispositions s’appliqueront aux locaux mis à disposition à compter de l’entrée en vigueur de la loi, mais pas seulement : le III précise en effet que ces nouvelles modalités de mise à disposition des locaux ont un effet rétroactif et s’appliquent aussi aux locaux qui étaient déjà mis à la disposition de syndicats par des collectivités avant l’entrée en vigueur de la loi, répondant ainsi à l’impératif de sécurité juridique rappelé en préambule.
Par coordination, le II modifie l’article L. 2144-3 du même code :
− le 1° du II supprime la référence aux syndicats dans la définition des modalités de mise à disposition de locaux par les communes à destination des associations ou des partis politiques qui en font la demande ;
− le 2° du II complète cet article par un alinéa renvoyant les modalités de mise à disposition de locaux communaux pour les syndicats aux conditions nouvellement fixées à l’article L. 1311-8.
*
Lors de son examen du texte, la Commission a adopté huit amendements rédactionnels à cet article.
*
L’amendement AS408 de M. Patrick Hetzel est retiré.
La Commission adopte successivement les amendements rédactionnels AS822, AS823 et AS824 du rapporteur.
L’amendement AS680 de Mme Audrey Linkenheld est retiré.
La Commission adopte l’amendement rédactionnel AS825 du rapporteur.
Puis elle examine l’amendement AS557 de M. Arnaud Richard.
M. Francis Vercamer. Cet amendement vise à supprimer l’alinéa 6 de l’article 15 qui prévoit que lorsque des locaux ont été mis à disposition d’un syndicat pendant une durée d’au moins cinq ans, la décision de la collectivité de lui en retirer le bénéfice sans proposer un autre local lui permettant de continuer à assurer ses missions ouvre le droit à une indemnité spécifique. Ce local librement mis à disposition s’assimile à une subvention et suppose, dans les comptes du syndicat, qu’apparaisse sa valorisation. La jurisprudence en la matière est claire : il ne peut y avoir de mise à disposition de locaux à titre gratuit pour les associations et autres structures.
M. le rapporteur. Avis défavorable. Le texte permet de sécuriser la mise à disposition : un syndicat ne pourra se voir retirer brutalement le bénéfice d’un local. Par ailleurs, il prévoit qu’une indemnité sera versée « sauf stipulation contraire de la convention prévue au quatrième alinéa ». Autrement dit, si la convention le prévoit, ladite indemnité peut être rendue inapplicable.
La Commission rejette l’amendement.
Elle adopte ensuite successivement les amendements rédactionnels AS826 et AS827 du rapporteur.
Elle est saisie de l’amendement AS517 de M. Christophe Cavard.
Mme Véronique Massonneau. Cet amendement vise à assurer que le montant des indemnités spécifiques versées par la collectivité au syndicat en cas de retrait du local soit encadré par voie réglementaire. Il s’agit, dans le même temps, d’empêcher que la convention de mise à disposition puisse prévoir l’absence d’indemnité en cas de retrait du local.
M. le rapporteur. Avis défavorable. Il ne me semble pas opportun de laisser au décret le soin de fixer le montant de l’indemnité : d’une part, en vertu du principe fort de la libre administration des collectivités territoriales ; d’autre part, en raison de la diversité des situations couvertes. L’objectif n’est pas de fixer un loyer, facilement chiffrable, mais bien une indemnité qui peut dépendre de critères comme l’ancienneté de l’occupation du local ou sa superficie.
L’indemnité doit être laissée à la libre appréciation des collectivités territoriales.
La Commission rejette l’amendement.
Elle adopte successivement les amendements rédactionnels AS828 et AS829 du rapporteur.
Puis elle adopte l’article 15 modifié.
*
* *
La Commission est saisie de l’amendement AS57 de M. Patrick Hetzel.
M. Élie Aboud. Cet amendement a pour but de renforcer encore la démocratie participative – un mot qui vous est particulièrement cher, monsieur le rapporteur –, au sein de l’entreprise en permettant à tous les salariés qui le désirent de se présenter de façon indépendante, en dehors de toute organisation syndicale aux élections internes.
M. le rapporteur. J’apprécie le ton badin sur lequel M. Aboud a présenté cet amendement, qui revient ni plus ni moins à mettre fin au monopole syndical de la présentation des candidats au premier tour des élections aux institutions représentatives du personnel. Cette proposition totalement inacceptable aboutirait à affaiblir le rôle des syndicats.
Le monopole syndical permet d’encourager les candidatures de salariés avec des compétences spécifiques utiles pour mener des négociations avec l’employeur.
De plus, ce monopole n’est pas absolu, comme on serait conduit à le penser en lisant l’exposé sommaire de votre amendement. La jurisprudence a reconnu que les candidats choisis par le syndicat ne doivent pas être forcément syndiqués ou adhérents du syndicat qui les choisit, et que les candidatures restent libres au second tour. Avis défavorable.
Mme Isabelle Le Callennec. Cela vous fait peut-être sourire, monsieur le rapporteur. Quant à nous, nous attendons avec impatience les conclusions du rapport d’information sur le paritarisme. Nous continuons à fonctionner sur les mêmes bases qu’après-guerre alors que, depuis plusieurs jours, nous ne cessons de dire que les organisations patronales et salariales doivent se réformer. Nous ne pouvons faire l’économie d’une réflexion sur l’évolution du paritarisme dans notre pays.
Doit-on aller jusqu’à la solution suggérée par M. Aboud ? Je ne sais pas, mais je suis persuadée que nous ne pouvons rester figés. La meilleure preuve en est que certaines organisations patronales et syndicales sont conscientes du nouveau contexte dans lequel nous nous trouvons quand d’autres, fondamentalement conservatrices, veulent que surtout rien ne bouge alors que six millions de personnes sont inscrites à Pôle emploi.
M. le rapporteur. Pour faire vivre le dialogue social, il n’y a rien de mieux que les partenaires sociaux. Et la meilleure solution pour asseoir leur existence, c’est la démocratie représentative.
La Commission rejette l’amendement.
*
* *
Article 16
(Art. L. 2143-13, L. 2143-15 et L. 2143-16 du code du travail)
Augmentation des heures de délégation des délégués syndicaux
La loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi a veillé à valoriser significativement l’expérience et le parcours des délégués syndicaux.
Cette loi a par ailleurs étendu le champ d’intervention des délégués syndicaux au-delà de l’entreprise : aux termes de l’article L. 2143-16-1, chaque délégué syndical peut désormais utiliser des heures de délégation « pour participer, au titre de son organisation, à des négociations ou des concertations » interprofessionnelles ou de branche.
Ces nouvelles attributions représentent un investissement considérable de la part des délégués syndicaux : ainsi, selon une étude mentionnée par l’étude d’impact, dans 39 % des établissements où le représentant du personnel interrogé a au moins un mandat de délégué syndical, celui-ci déclare consacrer plus de temps que le crédit d’heures disponible à la représentation du personnel.
Afin de permettre aux délégués syndicaux de mener à bien leurs nouvelles attributions et de consolider les moyens accordés aux organisations syndicales appelées à négocier un accord, cet article propose d’augmenter de 20 % les heures de délégation à la disposition des délégués syndicaux, des délégués syndicaux centraux et des salariés invités par leur section syndicale à prendre part à la négociation.
L’augmentation des heures de délégation permettra donc aux délégués syndicaux d’intervenir plus fréquemment dans la négociation des accords, à tous les niveaux, ce qui va dans le sens du renforcement de la place de la négociation collective préconisé par ce projet de loi.
• Délégués syndicaux
Actuellement fixées à l’article L. 2143-13 du code du travail, les heures de délégation à la disposition des délégués syndicaux dépendent du nombre de salariés dans l’entreprise. Le 1° modifie donc l’article L. 2143-13, proportionnellement à la taille des entreprises considérées :
− dans les entreprises de 50 à 150 salariés, le a propose d’augmenter le nombre d’heures à la disposition de chaque délégué syndical de 10 à 12 heures par mois ;
− dans les entreprises de 151 à 499 salariés, le b augmente le nombre d’heures de délégation de 15 à 18 heures par mois ;
− dans les entreprises dont l’effectif est supérieur à 500 salariés, le nombre d’heures de délégation passerait de 20 à 24 heures par mois (c).
• Délégué syndical central
Le 2° propose ensuite d’augmenter le nombre d’heures de délégation à la disposition du délégué syndical central de 20 heures à 24 heures par mois, en modifiant l’article L. 2143-15 du code du travail.
Pour mémoire, le délégué syndical central est institué dans les entreprises comportant au moins deux établissements de cinquante salariés, afin de représenter son organisation dans les négociations collectives au niveau de l’entreprise (article L. 2143-5 du même code).
• Sections syndicales
Enfin, le 3° modifie l’article L. 2143-16 du même code afin d’augmenter le crédit global d’heures dont dispose chaque section syndicale au profit de ses délégués syndicaux et des salariés de l’entreprise appelés à négocier une convention ou un accord d’entreprise :
− le a relève ce crédit à 12 heures par an dans les entreprises d’au moins 500 salariés ;
− le b fait passer ce crédit de 15 à 18 heures par an dans les entreprises d’au moins 1 000 salariés.
*
La Commission examine les amendements identiques AS28 de M. Patrick Hetzel et AS165 de M. Gérard Cherpion.
M. Élie Aboud. L’amendement AS28 vise à supprimer l’augmentation de 20 % des heures de délégation que prévoit l’article 16. Outre le fait qu’elle représentera un coût financier important pour les entreprises, elle peut se révéler contre-productive en conduisant le représentant à s’éloigner de son activité professionnelle.
M. le rapporteur. Ce n’est pas par hasard que le projet de loi propose cette augmentation. Le Gouvernement tire les conséquences législatives de l’article 9 de la loi Rebsamen qui a permis un élargissement des attributions des délégués syndicaux. Désormais, ils peuvent utiliser leurs heures de délégation pour participer aux négociations ou aux concertations conduites au niveau de la branche ou au niveau interprofessionnel. Cet article propose simplement de leur donner les moyens de remplir ces nouvelles attributions, qui sont essentielles pour encourager un dialogue social de qualité à tous les niveaux de négociation collective. Avis défavorable.
La Commission rejette les amendements.
Puis elle adopte l’article 16 sans modification.
*
* *
La Commission examine l’amendement AS174 de M. Elie Aboud.
M. Élie Aboud. Les contraintes associées au franchissement des seuils sociaux constituent un mur en période de crise économique. Nous proposons de doubler ces seuils dans les articles du code du travail et du code de la sécurité sociale.
M. le rapporteur. Ma position n’a pas varié depuis que nous avons examiné la loi relative au dialogue social et à l’emploi. Je trouve regrettable de laisser penser que les institutions représentatives du personnel sont à l’origine des maux dont souffrent nos entreprises. Elles constituent un maillon essentiel du dialogue social au niveau de l’entreprise et contribuent à veiller au respect des droits des salariés.
Vous revenez à l’argumentation selon laquelle les entreprises n’embauchent pas pour éviter d’avoir à instaurer des institutions représentatives du personnel. Je vous rappelle que, dans le cadre de la loi Rebsamen, nous avons essayé d’agir directement, notamment par la facilitation des obligations inhérentes aux effets de seuil grâce à la mise en place des délégations uniques de personnel (DUP) et au regroupement des institutions représentatives du personnel. C’est un débat que nous avons eu à plusieurs reprises. Ma position reste la même. Avis défavorable.
Mme Isabelle Le Callennec. Les mesures auxquelles vous faites allusion, monsieur le rapporteur, ne sont manifestement pas suffisantes pour faciliter le passage d’un seuil à un autre : certaines entreprises refusent encore de franchir la barre des cinquante salariés de peur d’être soumises à des contraintes supplémentaires. Faire la politique de l’autruche ne change pas la réalité !
La Commission rejette l’amendement.
Elle est saisie de l’amendement AS189 de M. Patrick Hetzel.
M. Élie Aboud. Cet amendement vise à lever l’un des principaux blocages psychologiques au développement des entreprises et de l’emploi en France, facteur indéniable de la faiblesse de notre économie, en lissant les effets de seuil liés à la forte hausse de leurs obligations en matière sociale lorsqu’elles franchissent les caps de dix, vingt et surtout de cinquante salariés. Durant une période transitoire – j’y insiste – les entreprises franchissant ces seuils seraient libres de mettre en place ou non les institutions représentatives et de consultation du personnel.
M. le rapporteur. Sur ce sujet des seuils, j’ai déjà répondu. Avis défavorable.
La Commission rejette l’amendement.
Puis elle en vient à l’amendement AS193 de M. Patrick Hetzel.
M. Élie Aboud. Répondant à la même logique que le précédent, cet amendement, qui sera bien défendu dans l’hémicycle, fixe la durée de la période transitoire.
Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement ainsi que l’amendement AS191 de M. Patrick Hetzel.
Elle examine ensuite l’amendement AS59 de M. Patrick Hetzel.
M. Élie Aboud. Cet amendement prévoit un doublement du seuil d’effectifs de cinquante à cent salariés. Le franchissement du seuil de cinquante salariés est particulièrement handicapant pour les PME, dans la mesure où il déclenche trente-sept nouvelles obligations, ce qui entrave leur développement et l’embauche des salariés nécessaires.
M. le rapporteur. Faisant preuve de la même cohérence que M. Aboud, j’émets un avis défavorable à cet amendement.
Mme Isabelle Le Callennec. Je me réjouis de voir que des collègues députés socialistes ont déposé le même amendement que nous, même s’ils ne sont pas présents pour le défendre, sur le franchissement du seuil des cinquante salariés, qui est particulièrement handicapant pour les PME. La thèse progresse dans ce domaine-là aussi ! Je continue à regretter que nous ne profitions pas d’un texte qui prétend donner plus de liberté aux entreprises pour relever ces seuils, ce qu’elles nous réclament depuis des années. Quoi qu’il en soit, je réitère mes félicitations aux collègues de la majorité qui ont déposé cet amendement.
Mme la présidente Catherine Lemorton. Nous leur transmettrons puisqu’ils ne sont pas là pour le défendre.
La Commission rejette l’amendement.
Elle passe à l’amendement AS60 de M. Patrick Hetzel.
M. Élie Aboud. Cet amendement double le seuil d’effectifs de dix à vingt salariés. Il s’agit de libérer les contraintes des seuils, particulièrement handicapant pour les PME.
Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement.
Elle rejette de même les amendements AS16 de M. Jean-Charles Taugourdeau et AS195 de M. Patrick Hetzel.
Puis elle en vient à l’amendement AS758 de M. Olivier Faure.
M. Olivier Faure. Il s’agit de faire en sorte que les accidents dont seraient victimes les délégués syndicaux dans l’exercice de leur mandat entrent bien dans le champ des accidents du travail. Peu de gens le savent mais aucune disposition ne protège actuellement un délégué syndical qui se rend sur son lieu de travail syndical en cas d’accident. Dans un texte qui tend à renforcer le dialogue social, il nous paraît opportun de renforcer la protection de ceux qui en assurent l’effectivité. Je suggère que nous adoptions cet amendement pour combler ce vide dans notre droit du travail.
M. le rapporteur. Je partage l’objectif, néanmoins, le champ retenu dans la rédaction actuelle de cet amendement me semble trop large : il couvrirait des activités qui n’ont rien à voir avec l’exercice du mandat de délégué syndical. Je vous propose de le retirer pour que nous le retravaillions ensemble avant l’examen du texte en séance.
L’amendement est retiré.
La Commission discute de l’amendement AS533 de M. Arnaud Richard.
M. Francis Vercamer. Cet amendement, un peu révolutionnaire, vise à faire évoluer le syndicalisme vers un syndicalisme de services. Il s’agit de supprimer l’effet erga omnes des accords pour en réserver le bénéfice uniquement aux salariés adhérents des associations signataires de ces accords.
Dans cette commission ou dans l’hémicycle, on entend souvent dire que les syndiqués ne représentent qu’une minorité de salariés – 5 % dans le privé, 8 % dans la fonction publique – et que, par conséquent, les syndicats ne sont pas représentatifs. Un syndicalisme de services, tel que je le propose, permettra d’améliorer la représentativité puisque les salariés seront poussés à adhérer à un syndicat pour bénéficier des accords signés. Il n’y aura alors plus besoin de faire des référendums dans l’entreprise : étant syndiqués, les salariés feront eux-mêmes le ménage, si j’ose dire, à l’intérieur de leur syndicat. Nul besoin de consulter d’autres salariés puisqu’ils seront tous syndiqués. Voilà pour le principe.
Ce système fonctionne assez bien dans d’autres pays comme l’Allemagne, la Belgique ou l’Espagne. Cette proposition, qui transformerait certes radicalement le syndicalisme, irait dans le sens d’une meilleure adhésion des salariés aux syndicats et d’un plus grand sens des responsabilités lors de la négociation des accords. Les syndicats seraient incités à signer des accords par leurs adhérents désireux d’en bénéficier.
Bien évidemment, il s’agit là d’un amendement d’appel. Monsieur le rapporteur, je me doute bien que vous ne prendrez pas la responsabilité de lui donner un avis favorable aujourd’hui. Je pense néanmoins qu’il faut avoir ce débat, ici ou dans l’hémicycle, comme vous le souhaitez.
M. le rapporteur. En effet, ce pourrait être un vaste débat. J’invite à la prudence en ce qui concerne la déclinaison par principe de modèles étrangers, notamment en ce domaine de l’implantation syndicale : le développement du syndicalisme de services que vous suggérez est lié à un contexte historique. Si nous devions vous suivre, neuf salariés sur dix n’auraient plus de couverture relative aux accords de branche ou d’entreprise, ce qui poserait quelques difficultés. Avis défavorable.
Mme Isabelle Le Callennec. Le débat est large, mais il ne faut pas le refuser. Dans l’enseignement, on peut considérer que certains syndicats s’apparentent aux syndicats de services tels qu’ils viennent d’être définis.
La Commission rejette l’amendement.
*
* *
Article 17
(Art. L. 4614-13, L. 4614-13-1 et L. 2325-41-1 [nouveaux] du code du travail)
Expertise du CHSCT
Cet article vise à tirer les conséquences d’une décision du 27 novembre 2015 du Conseil constitutionnel, qui a déclaré inconstitutionnelles les modalités de prise en charge des frais d’expertise en cas d’annulation par le juge de la délibération du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) décidant le recours à un expert agréé.
Il propose dans un premier temps d’encadrer les délais auquel le juge est soumis pour rendre sa décision, et de suspendre la mise en place de l’expertise pendant cet intervalle.
Il propose ensuite de modifier les modalités de remboursement des frais de l’expertise, qui incombent actuellement à l’employeur, lorsque la décision du CHSCT de recourir à un expert est définitivement annulée par le juge.
Dans les entreprises de cinquante salariés et plus, le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) est l’instance chargée de contribuer à la protection de la santé et de la sécurité des salariés. Il possède la personnalité morale, mais ne dispose pas de budget de fonctionnement propre.
Les attributions du CHSCT (article L. 4612-1 du code du travail)
« Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail a pour mission :
1° De contribuer à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des travailleurs de l’établissement et de ceux mis à sa disposition par une entreprise extérieure ;
2° De contribuer à l’amélioration des conditions de travail, notamment en vue de faciliter l’accès des femmes à tous les emplois et de répondre aux problèmes liés à la maternité ;
3° De veiller à l’observation des prescriptions légales prises en ces matières ».
Le comité est présidé par l’employeur, en application de l’article L. 4614-1 du code du travail ; toutefois, en vertu du dernier alinéa de l’article L. 4614-2 du même code, il ne participe pas au vote lorsqu’il consulte les membres du comité en tant que délégation du personnel. Tel est le cas sur les délibérations du CHSCT relatives à la décision de recourir à un expert. Pour l’assister dans certains de ses travaux, le CHSCT peut en effet décider de faire appel à un expert agréé. Le recours à cette expertise indépendante est envisagé par le code du travail dans trois types de situation :
− lorsqu’un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l’établissement (article L. 4614-12) ;
− en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail dans l’entreprise (article L. 4614-12), en particulier à l’occasion d’un projet de restructuration et de compression des effectifs (article L. 4614-12-1) ;
− en cas de risques technologiques liés à la demande d’exploitation d’une installation classée pour la protection de l’environnement (articles L. 4523-5, R. 4523-2 et R. 4523-3).
Dans une entreprise qui comporte plusieurs établissements disposant chacun d’un CHSCT, l’employeur peut également décider la mise en place d’une instance temporaire de coordination des CHSCT, dont l’unique mission est d’organiser le recours à une expertise unique (article L. 4616-1 du même code).
L’article L. 4614-13 du code du travail dispose que les frais de l’expertise décidée par le CHSCT sont à la charge de l’employeur. Toutefois, ce dernier peut contester la nécessité de l’expertise, la désignation de l’expert, le coût, l’étendue ou le délai de l’expertise devant le juge judiciaire.
En cas de contestation, l’expertise décidée par le CHSCT n’est pas suspendue pendant la procédure juridictionnelle, et peut donc se poursuivre jusqu’à la décision définitive : l’employeur peut, dans ces circonstances, être amené à s’acquitter des frais d’expertise.
La Cour de cassation reconnaît que l’employeur peut être déchargé du coût de l’expertise lorsque la délibération du CHSCT est annulée en raison d’un abus caractérisé de la part du CHSCT, lorsque la décision de recours à l’expertise n’est manifestement pas fondée (37) par exemple.
Or, dans un arrêt du 15 mai 2013 (38), la Cour de cassation a considéré que l’employeur reste tenu au paiement des frais de l’expertise accomplie par l’expert jusqu’au prononcé de la décision de justice, même lorsque l’employeur a obtenu l’annulation en justice de la délibération du CHSCT ayant décidé de recourir à l’expertise. La Cour considérait en effet que l’expert ne disposait pas d’autre possibilité de recouvrer ses honoraires, faute pour le comité qui l’a désigné de disposer d’un budget propre permettant cette prise en charge.
Cette décision a été abondamment commentée par la doctrine, qui a mis en lumière les difficultés nées de l’absence de budget propre au CHSCT : « la solution [retenue par la Cour de cassation dans son arrêt du 15 mai 2013] sera certainement mal comprise d’un employeur qui, bien qu’ayant obtenu gain de cause en justice, supporte pourtant les frais de procédure et, in fine, le coût d’une expertise jugée réalisée à tort. Mais la solution inverse aurait été tout aussi mal comprise, de l’expert cette fois… C’est qu’une telle configuration est inextricable du point de vue juridique : le législateur a créé une institution représentative pourvue de la personnalité morale, mais dépourvue de tous moyens financiers, de sorte que le coût de ses erreurs est nécessairement supporté par d’autres » (39).
Le Conseil constitutionnel a été amené à statuer sur cette problématique à l’occasion d’un litige opposant l’employeur de la société Foot Locker au CHSCT de cette entreprise.
Dans un arrêt du 27 mai 2013, la Cour d’appel avait annulé la délibération du 23 mars 2012 du CHSCT de la société requérante, qui demandait l’intervention d’un expert pour constater l’existence d’un risque grave dans l’entreprise. L’expert ayant déposé son rapport le 13 juin 2013, il a saisi le président du TGI afin d’être remboursé par l’employeur du solde restant dû sur ses honoraires au titre de l’expertise décidée par la délibération du CHSCT finalement annulée. Mais, par une ordonnance du 19 juin 2014, le président du TGI a rejeté la demande de l’expert et l’a condamné à rembourser à l’employeur le montant des provisions versées.
Dans ce contexte, la société requérante a présenté une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) estimant que l’interprétation jurisprudentielle constante des dispositions de l’article L. 4614-13 du code du travail était de nature à porter atteinte à la liberté d’entreprendre, au droit de propriété ainsi qu’au droit au recours de l’employeur, dans la mesure où celui-ci restait tenu au paiement des frais de l’expertise en dépit de l’annulation de la délibération du CHSCT.
Dans sa décision QPC n° 2015-500 du 27 novembre 2015, le Conseil constitutionnel a mis en exergue l’insuffisante sécurité juridique entourant la procédure de contestation de l’expertise du CHSCT : en effet, alors que l’expert peut accomplir sa mission dès que le CHSCT fait appel à lui, les délais de contestation de l’expertise par l’employeur ne sont pas en revanche pas encadrés. De même, le juge judiciaire n’est soumis à aucune obligation lui imposant de statuer dans un délai déterminé.
Le Conseil constitutionnel a en conséquence considéré que l’article L. 4614-13 garantissait effectivement l’exercice d’une voie de recours pour l’employeur, mais qu’en revanche, la combinaison de l’absence d’effet suspensif du recours de l’employeur et de l’absence de délai d’examen de recours par le juge avait pour effet de priver l’employeur de toute protection de son droit de propriété (considérant 10).
L’article 1er de la décision du Conseil constitutionnel a donc déclaré contraires à la Constitution le premier alinéa et la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 4614-13 du code du travail.
Toutefois, considérant que la censure immédiate « aurait pour effet de faire disparaître toute voie de droit permettant de contester une décision de recourir à un expert ainsi que toute règle relative à la prise en charge des frais d’expertise », le Conseil constitutionnel a décidé de reporter l’entrée en vigueur de l’abrogation des dispositions contestées au 1er janvier 2017.
C’est dans ce contexte et afin de remédier à l’inconstitutionnalité du dispositif actuel que cet article entreprend de modifier les modalités et les conséquences de la contestation par l’employeur de la décision du CHSCT de recourir à un expert.
La priorité est de garantir aux employeurs le droit à une contestation effective de l’expertise demandée par le CHSCT, sans pour autant porter atteinte au déroulement de l’expertise demandée par le CHSCT. Pour cela, il est proposé à la fois d’encadrer les délais de contestation de l’expertise par l’employeur et les délais juridictionnels, et de réviser les modalités de prise en charge des frais de l’expertise en cas d’annulation de la décision du CHSCT en dernier ressort par le juge.
Le deuxième alinéa de l’article L. 4614-13 du code du travail distingue actuellement deux types de contestation de l’expertise par l’employeur :
– la contestation relative à l’expertise liée à un projet de restructuration ou de compression des effectifs, d’une part, qui relève de la compétence de l’autorité administrative ;
– la contestation d’une délibération du CHSCT relative à la nécessité, à la désignation de l’expert, au coût, à l’étendue ou au délai de l’expertise, d’autre part, qui relève de la compétence du juge judiciaire.
Le 1° du I maintient et complète cette distinction et définit trois procédures distinctes applicables en cas de contestation par l’employeur du recours à un expert.
Le b du 1° du I consacre en premier lieu la procédure de contestation spécifique applicable en cas de contestation par l’employeur d’une expertise qui se déroule dans le cadre d’une consultation sur un projet de licenciement collectif pour motif économique d’au moins dix salariés dans une période de trente jours.
Cette procédure de consultation du CHSCT est en effet soumise à des délais contraints : le CHSCT est tenu de rendre deux avis, portant respectivement sur l’opération projetée et sur le projet de licenciement collectif en tant que tel, dans des délais qui ne peuvent excéder deux mois lorsque le nombre des licenciements est inférieur à 100, trois mois lorsque le nombre des licenciements est compris entre 100 et 249 et quatre mois lorsque le nombre de licenciements est supérieur ou égal à 250.
Aux termes de l’article L. 4614-12-1 du code du travail, l’expert est tenu de présenter son rapport au plus tard quinze jours avant l’expiration des délais précisés ci-dessus. En outre, l’autorité administrative doit transmettre à l’employeur sa décision de validation du plan de sauvegarde de l’emploi dans les quinze jours suivant sa saisine, et sa décision d’homologation du plan dans les trois semaines suivant celle-ci.
En raison de la spécificité de cette procédure, le projet de loi maintient donc l’existence de délais particuliers de contestation du juge : l’employeur souhaitant contester une décision du CHSCT, quelle que soit la nature de sa contestation, doit saisir l’autorité administrative tant que celle-ci ne s’est pas encore prononcée sur la validité ou l’homologation du plan. L’autorité administrative dispose alors d’un délai de cinq jours pour se prononcer. La décision de l’autorité administrative peut elle-même être contestée auprès du tribunal administratif, en premier ressort, auprès de la cour administrative d’appel ou, en cassation, auprès du Conseil d’État. Le tribunal administratif et la cour administrative d’appel sont tenus de rendre leur décision dans les trois mois suivant leur saisine.
2. Lorsque l’employeur conteste la nécessité de l’expertise, la désignation de l’expert, l’étendue ou le délai de l’expertise
Le c du 1° du I complète ensuite l’article L. 4614-13 par un alinéa traitant de l’ensemble des autres situations de contestation du recours de la décision du CHSCT par l’employeur, à l’exception des situations relatives au coût de l’expertise.
Selon ces nouvelles dispositions, le juge compétent en matière de contestation de l’opportunité ou des modalités de mise en place d’une expertise (désignation de l’expert, étendue ou délai de l’expertise) est le juge judiciaire, ce qui ne change pas de l’état du droit. Toutefois, les conséquences de sa saisine sont modifiées.
En premier lieu, la décision du juge est désormais soumise à des délais précis : le juge devra statuer en premier et dernier ressort dans les dix jours suivant sa saisine, alors qu’il n’était soumis à aucune contrainte de temps jusqu’alors.
Ensuite, compte tenu de ces délais resserrés qui permettront d’obtenir une décision rapide, la saisine du juge aura désormais pour effet de suspendre, jusqu’à l’expiration du délai de pourvoi en cassation, à la fois :
− l’exécution de la décision du CHSCT ou de l’instance de coordination relative à la mise en place de l’expert ;
− les délais dans lesquels le CHSCT et l’instance de coordination sont consultés. Selon l’article L. 4612-8 du code du travail, le CHSCT et l’instance de coordination disposent en effet d’un délai fixé par accord ou, à défaut, par décret en Conseil d’État, pour rendre les avis sur les projets qui leur sont soumis en vertu de leurs attributions consultatives.
Une fois le recours effectué auprès du juge, la décision sera donc délivrée dans un temps réduit, ce qui signifie que l’expertise ne sera interrompue que pour une durée limitée. Le rapporteur s’étonne toutefois que le recours de l’employeur ne soit enserré dans aucun délai contraignant, la contestation pouvant dès lors intervenir très tardivement, y compris après la remise du rapport de l’expert. Dans l’intérêt de l’ensemble des parties, le rapporteur souhaite donc que le délai de saisine du juge judiciaire par l’employeur soit encadré dans le temps.
Le 2° du I crée ensuite un article L. 4614-13-1 visant à définir une procédure spécifique à la contestation du coût de l’expertise, alors que celle-ci relevait jusqu’alors de la même procédure que celle applicable à la contestation de la nécessité de l’expertise.
Selon les informations transmises au rapporteur, cette distinction vise à prendre en compte le fait que le coût final de l’expertise ne peut, dans la plupart des cas, être contesté qu’a posteriori, c’est-à-dire après la remise du rapport par l’expert. Toutefois, au regard de la pratique, il a été indiqué au rapporteur que le texte pourrait être complété en prévoyant la possibilité que la contestation a priori porte sur le coût prévisionnel de l’expertise, telle qu’elle peut ressortir notamment du devis fourni par le cabinet d’expertise.
B. DE NOUVELLES MODALITÉS DE PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE L’EXPERTISE EN CAS D’ANNULATION DE LA DÉCISION DU CHSCT
Le deuxième alinéa ajouté par le c du 1° du I adapte les modalités de prise en charge des frais d’expertise.
La règle selon laquelle « les frais d’expertise sont à la charge de l’employeur » reste applicable en l’absence de contestation de ce dernier.
Néanmoins, en cas d’annulation définitive par le juge de la décision du CHSCT ou de l’instance de coordination, de nouvelles règles sont proposées afin de tenir compte de la censure du Conseil constitutionnel : c’est désormais l’expert qui sera tenu de rembourser à l’employeur les sommes perçues.
Toutefois, afin d’éviter de faire supporter à l’expert une charge excessive et pour pallier la problématique de l’absence de budget propre du CHSCT, il est précisé que le comité d’entreprise (CE) pourra décider « à tout moment » de prendre en charge le remboursement des sommes perçues par l’expert.
La prise en charge des frais d’expertise indus par le comité d’entreprise est précisée à l’article L. 2325-41-1 créé par le II, qui indique que c’est au titre de la subvention de fonctionnement du CE que le comité pourra assumer ces frais. Le montant annuel de cette subvention, prévu à l’article L. 2325-43 du code du travail, s’élève actuellement à 0,2 % de la masse salariale brute.
*
Afin de clarifier les modalités de la procédure applicable à la contestation du coût de l’expertise, la Commission a adopté deux amendements du rapporteur, l’un précisant que l’employeur peut contester le coût prévisionnel d’une expertise dès le début de la procédure, sans attendre la remise du rapport de l’expert et la facture finale (AS 937), l’autre précisant que le recours prévu à l’article L. 4614-13-1 peut être exercé pour contester le coût final de l’expertise, sur le fondement de la facturation effective de l’expertise (AS 938).
En outre, la Commission a adopté deux amendements présentés par le rapporteur visant à encadrer les deux types de saisine dans un délai de quinze jours, qui court :
− à compter de la délibération du CHSCT ou de l’instance de coordination, lorsque la contestation porte sur la nécessité de l’expertise, la désignation de l’expert, le coût prévisionnel, l’étendue ou le délai de l’expertise (AS 936) ;
− à compter de la date à laquelle l’employeur a été informé du coût final, pour la procédure visée à l’article L. 4614-13-1 (AS 938).
*
La Commission est saisie de l’amendement AS937 du rapporteur.
M. le rapporteur. Cet amendement vise à permettre à un employeur de contester le coût prévisionnel d’une expertise si elle lui paraît manifestement excessive.
La Commission adopte l’amendement.
Puis elle examine, en discussion commune, l’amendement AS936 du rapporteur, les amendements identiques AS684 de Mme Audrey Linkenheld et AS755 de Mme Éva Sas, et l’amendement AS331 de M. Christophe Cavard.
M. le rapporteur. L’amendement AS936 vise à encadrer dans un délai de quinze jours la saisine du juge judiciaire par l’employeur, lorsque ce dernier souhaite contester la nécessité de l’expertise, la désignation de l’expert, l’étendue ou le délai de l’expertise.
L’amendement AS684 est retiré.
Mme Éva Sas. Comme les amendements précédents, mon amendement AS755 vise à encadrer le délai de contestation de l’expertise du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) par l’employeur ; il prévoit un délai plus court de dix jours. Il s’agit de faire en sorte que l’expert puisse travailler dans la sérénité sans être trop pénalisé en cas de contestation.
Mme Véronique Massonneau. Notre amendement prévoyait un délai de cinq jours, mais je vais le retirer.
L’amendement AS331 est retiré.
M. le rapporteur. En prévoyant quinze jours, mon souhait était de me caler sur le délai habituel dans le code du travail. Je plaide pour que vous retiriez votre amendement, madame Sas, pour ne pas avoir à émettre un avis défavorable alors que nous sommes d’accord.
Mme Éva Sas. Je vais le retirer dans un esprit de concorde et pour que nous arrivions à un consensus, mais je signale que l’expertise doit être réalisée dans un délai maximum sur lequel les quinze jours vont empiéter de façon importante.
L’amendement AS755 est retiré.
La Commission adopte l’amendement AS936.
Elle adopte l’amendement de correction AS830 du rapporteur.
Puis elle en vient à l’amendement AS938 du rapporteur.
M. le rapporteur. Par coordination avec l’amendement proposant l’ajout de la contestation du coût prévisionnel de l’expertise en début de procédure, cet amendement AS937 vise à préciser que le recours spécifique prévu en fin de procédure concerne le coût final de l’expertise, c’est-à-dire après la remise du rapport et la facturation de l’expertise.
La Commission adopte l’amendement.
Puis elle adopte l’article 17 modifié.
*
* *
La Commission examine l’amendement AS230 de Mme Annie Le Houerou.
Mme Annie Le Houerou. Cet amendement vise à donner explicitement une nouvelle mission au CHSCT en faveur des travailleurs handicapés. Il s’agit de faire entrer les problématiques de maintien en emploi et d’insertion des travailleurs handicapés dans le quotidien de la vie sociale de l’entreprise et non de les traiter à part. Cette proposition fait suite au travail que j’ai mené concernant l’emploi des personnes handicapées en milieu ordinaire.
Dans les entreprises qui sont soumises à l’obligation d’emploi, les problématiques des handicaps ne doivent plus rester l’affaire des seuls spécialistes et des militants qui, jusqu’à maintenant, ont porté à bout de bras les difficultés et les initiatives. De la même façon que l’égalité entre les femmes et les hommes a été inscrite en tant que telle dans les missions des CHSCT, il est temps d’y inscrire le sujet de l’emploi des personnes handicapées.
M. le rapporteur. Je suis un peu perplexe, parce que cela figure déjà dans l’article L. 4612-11 du code du travail : « Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail est consulté sur les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils et des travailleurs handicapés, notamment sur l’aménagement des postes de travail. »
Quant à l’article L. 2323-30, il dispose : « Le comité d’entreprise est consulté, en liaison avec le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, sur les mesures prises en vue de faciliter la mise ou la remise au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre et assimilés, des invalides civils, des travailleurs handicapés, notamment sur celles relatives à l’application de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés. »
À moins que des éléments m’échappent, je pense que votre amendement est satisfait par le code du travail existant et c’est pourquoi je demande son retrait.
Mme Annie Le Houerou. Je pense qu’il n’est pas satisfait. L’idée est d’anticiper la question du handicap dans l’entreprise. Or le premier article auquel vous faites référence indique que, lorsqu’une mesure particulière est prise concernant une personne en situation de handicap, le CHSCT est consulté. L’amendement que je défends vise à intégrer la question du handicap dans tous les actes du CHSCT, notamment ses missions de prévention.
M. le rapporteur. Il me semble que l’article L. 4612-11 du code du travail répond à cette préoccupation.
Mme Annie Le Houerou. Je n’ai pas l’article sous les yeux, mais on s’y réfère à des situations plutôt individuelles alors que nous en sommes à anticiper la question du handicap dans l’entreprise. Par comparaison, l’égalité entre les femmes et les hommes n’y est pas abordée seulement à l’occasion d’une mesure précise qui va être prise en la matière. De nombreuses personnes se retrouvent en situation de handicap à la suite de l’évolution d’une maladie. L’inaptitude est très souvent prononcée, puis le licenciement intervient alors que l’entreprise doit intégrer l’évolution parfois difficile d’un salarié. Il s’agit de prévoir la manière dont l’entreprise va préparer l’intégration de la personne en situation de handicap dans l’entreprise.
M. le rapporteur. J’entends bien, mais je répète que, tel qu’il est rédigé, votre amendement est satisfait par les articles précités du code du travail. Vous voulez peut-être ajouter autre chose mais ce n’est pas ce qui est écrit dans l’amendement.
M. Jean-Patrick Gille. L’amendement est largement satisfait, à une petite différence près. Dans le code, cela relève des consultations obligatoires alors que Mme Le Houerou voudrait que cela fasse partie des missions du CHSCT.
Mme Annie Le Houerou. En fait, l’article de référence est le L. 4612-1 sur les missions du CHSCT, qui sont au nombre de quatre, l’une étant l’égalité entre les femmes et les hommes. Je souhaiterais que l’on y ajoute la prise en compte de l’emploi des personnes en situation de handicap dans l’entreprise. L’article dont vient de parler M. Gille concerne des consultations dans des cas particuliers.
Mme Martine Carrillon-Couvreur. Dans de nombreuses entreprises, il existe des missions handicap qui font un travail extrêmement intéressant. Nous devrions d’ailleurs faire un état des lieux de ces missions tant elles sont diverses. À travers leurs analyses, sachant que nous avons dix ans de recul par rapport à la loi de 2005, elles nous disent qu’il y a besoin d’anticiper davantage dans les entreprises, comme vient de l’expliquer notre collègue Annie Le Houerou. Cette anticipation peut se faire par le biais des missions du CHSCT. Certaines personnes peuvent rester dans l’entreprise et continuer à y travailler même quand elles connaissent des difficultés. Les missions handicap, qui se préoccupent de ces questions, ont le souci d’organiser au mieux cet accompagnement et cette anticipation.
Pour avoir suivi ces questions depuis plusieurs années, je pense qu’il s’agit d’un sujet qui monte et qui est d’ailleurs pris en compte. Chacun essaie de bien faire mais, à la faveur de ce texte, il faut rappeler concrètement cette préoccupation dans le cadre des missions du CHSCT. Peut-être faut-il réécrire l’amendement.
M. Gérard Sebaoun. Pour aller dans le sens de Mme Martine Carrillon-Couvreur, je peux donner l’exemple d’une grande entreprise dotée d’une mission handicap très efficace. Le CHSCT est informé tous les ans du bilan en la matière, mais cela ne fait en aucun cas partie de ses missions. Il n’anticipe pas la notion du handicap dans les travaux.
M. le rapporteur. Je comprends et je pense que Mme Le Houerou a raison. Je suggère que nous puissions nous recaler, car il y a un élément qui m’inquiète. Est-ce bien dans les objectifs du CHSCT de répondre aux problèmes liés à la diversité des handicaps ? Je n’en suis pas complètement convaincu. Revoyons l’amendement ensemble avant qu’il ne soit représenté en séance, si vous le voulez bien.
L’amendement est retiré.
*
* *
Article 18
(Art. L. 1232-12, L. 1442-2, L. 2135-11, L. 2145-1, L. 2145-5 à L. 2145-13 [nouveaux], L. 2212-1 et L. 2212-2 [nouveaux], L. 2325-43, L. 2325-44, L. 3142-7 à L. 3142-15, L. 3341-2, L. 3341-3 du code du travail)
Renforcement de la formation des acteurs de la négociation collective
Le bon fonctionnement de la négociation collective repose sur la formation de ses acteurs. Les salariés, les employeurs ou leurs représentants habilités à conduire des négociations au sein de l’entreprise ou de la branche professionnelle doivent maîtriser à la fois les « codes » de la négociation, mais aussi son contenu. Or la complexité de notre droit du travail, quasi-unanimement dénoncée, ne facilite pas l’acquisition de cette double compétence.
Cet article propose donc d’améliorer la formation des acteurs de la négociation collective, dans l’entreprise d’abord, en permettant au comité d’entreprise de contribuer au financement de la formation des délégués du personnel et des délégués syndicaux présents dans l’entreprise (I).
Si la formation de ses acteurs est une étape indispensable, elle ne suffit pas à garantir un dialogue social dynamique, adaptable, serein voire, pourquoi pas, inventif : la confiance entre les différentes parties prenantes aux négociations collectives est également un facteur clé de la réussite du dialogue social.
Pourtant, dans son rapport (40), M. Jean-Denis Combrexelle note que la confiance fait cruellement défaut dans notre pays et ce, quels que soient les acteurs et les niveaux de négociation collective considérés : en particulier, la confiance réciproque entre les syndicats et les employeurs s’est délitée ; s’agissant de ces derniers, le rapport relève que « le sentiment s’est installé chez beaucoup d’entre eux que la négociation n’est qu’un instrument aux mains des syndicats pour la sauvegarde des seuls droits acquis au détriment de l’intérêt même de l’entreprise, voire de son existence ».
Au regard de ce constat, il paraît nécessaire, voire urgent, de rétablir un niveau de confiance minimal entre les acteurs du dialogue social, à toutes les phases de la négociation. Le développement d’une culture commune du dialogue social entre les représentants des salariés et des employeurs, via la formalisation du dialogue social (cf. supra commentaire de l’article 7) et la diffusion des bonnes pratiques, ne peut en effet que contribuer à restaurer cette confiance qui fait tant défaut à la négociation collective.
C’est dans cette optique que cet article propose la mise en place de formations communes aux représentants des organisations syndicales de salariés et aux organisations professionnelles d’employeurs, auxquelles peuvent être associés à la fois des magistrats et des fonctionnaires désireux de mieux connaître les mécanismes et pratiques de la négociation collective (II).
1. La création d’une contribution du comité d’entreprise au financement de la formation des acteurs du dialogue social dans l’entreprise
a. Un accès limité à la formation dans l’entreprise pour les délégués du personnel et les délégués syndicaux
En l’état du droit, les délégués du personnel et les délégués syndicaux ne disposent pas de droit spécifique à la formation, contrairement à d’autres catégories de représentants du personnel.
Les membres titulaires du comité d’entreprise élus pour la première fois bénéficient par exemple, en vertu de l’article L. 2325-44 du code du travail, d’un stage de formation économique d’une durée maximale de cinq jours, dont le financement est pris en charge par le comité d’entreprise. De même, les membres du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) peuvent suivre une formation financée par l’entreprise afin d’acquérir les compétences nécessaires à l’exercice de leur mandat (article L. 4614-14 du même code).
Pour se former, les délégués du personnel et les délégués syndicaux peuvent avoir recours à plusieurs dispositifs, le principal d’entre eux étant le congé de formation économique, sociale et syndicale prévu à l’article L. 3142-7 du code du travail, d’une durée de douze jours voire de dix-huit jours pour les salariés investis d’une responsabilité syndicale.
Les représentants du personnel, syndiqués ou non, peuvent également mettre à profit leur crédit d’heures de délégation pour suivre des formations à l’extérieur de l’entreprise – ce crédit d’heures est d’ailleurs relevé, pour les délégués syndicaux, par l’article 16 du présent projet de loi. Le cas échéant, ils peuvent également suivre les formations mises en place par le comité d’entreprise, dans le cadre de son budget relatif aux activités sociales et culturelles, à destination de l’ensemble des salariés.
L’offre de formation reste néanmoins très limitée : selon une étude de la Direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques (DARES) de novembre 2014 (41), les représentants du personnel de seulement 38 % des entreprises interrogées ont déclaré avoir bénéficié d’une ou de plusieurs formations au cours de leur mandat, cet accès à la formation étant de surcroît bien moins fréquent pour les représentants du personnel non syndiqués que pour les délégués syndicaux.
Le I propose donc de renforcer la formation dans l’entreprise des délégués du personnel et des délégués syndicaux.
Il complète l’article L. 2325-43 du code du travail par deux alinéas visant à autoriser le comité d’entreprise à dédier une partie de son budget de fonctionnement au financement de la formation des délégués du personnel et des délégués syndicaux présents dans son entreprise.
La subvention de fonctionnement du comité d’entreprise
Prévue à l’article L. 2325-43 du code du travail, la subvention de fonctionnement est versée par l’employeur au comité d’entreprise afin de lui permettre de couvrir les dépenses liées aux tâches administratives.
Égale à 0,2 % de la masse salariale brute, elle permet notamment de prendre en charge les frais de fonctionnement du comité d’entreprise et, le cas échéant, les salaires et charges sociales du personnel recruté directement par le comité d’entreprise.
En vertu de l’article L. 2325-41 du même code, la subvention de fonctionnement peut également être mise à profit pour le financement d’expertises libres sollicitées par le comité d’entreprise, ou pour rembourser le salaire d’un membre du comité d’entreprise affecté temporairement par le comité d’entreprise à une étude relevant des attributions professionnelles et économiques du comité.
La décision d’allouer une partie de la subvention de fonctionnement à la formation des délégués du personnel et des délégués syndicaux doit émaner d’« une délibération » du comité d’entreprise.
En outre, le comité d’entreprise étant tenu à une obligation de transparence financière en application de l’article L. 2313-13 du même code, la somme dédiée au financement de la formation ainsi que ses modalités d’utilisation doivent être retracées à la fois :
− dans les comptes annuels du comité d’entreprise ou, lorsque ses ressources annuelles n’excèdent pas un seuil fixé par décret, dans le livre mentionné à l’article L. 2325-46 du code du travail qui retrace chronologiquement les montants et l’origine des dépenses et des recettes perçues par le comité ;
− et dans le rapport présentant des informations qualitatives sur ses activités et sur sa gestion financière mentionné à l’article L. 2325-50 du même code.
Outre l’indispensable formation des acteurs de la négociation collective rendue nécessaire par la technicité croissante des sujets, M. Combrexelle préconise également d’encourager la formation d’une culture commune de la négociation, afin de restaurer la confiance entre ses acteurs. Il cite notamment l’exemple québécois, où est enseignée « une pédagogie commune aux entreprises et aux syndicats de la négociation » et « où la négociation est enseignée comme une technique et une méthode, chacun restant ensuite bien évidemment libre de ses options syndicales ».
Pour remédier à la fois au manque d’accessibilité du droit du travail et au déficit d’attractivité de la négociation collective qui en résulte, cet article reprend donc la proposition n°12 du rapport de M. Combrexelle préconisant la mise en place de formations communes entre les syndicats et les entreprises.
Le II crée à cette fin un chapitre II au sein du titre Ier du livre II de la deuxième partie du code du travail, intitulé « Formation des acteurs de la négociation collective » et composé de deux articles L. 2212-1 et L. 2212-2. Ces articles laissent une grande liberté de mise en place et de financement de ces formations.
L’article L. 2212-1 pose en premier lieu le principe de ces formations, précisant qu’elles peuvent bénéficier aux salariés, aux employeurs et à leurs représentants, et qu’elles peuvent être dispensées par « les centres, instituts ou organismes de formation ». Afin que la pédagogie commune dispensée lors de ces formations bénéficie à l’ensemble des personnes amenées à s’intéresser aux pratiques de la négociation collective ou à interpréter le contenu des accords, cet article précise que les formations communes peuvent être suivies par des magistrats de l’ordre judiciaire ou administratif, ainsi que par des fonctionnaires.
Il est précisé que l’Institut national du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle peut apporter son concours à la création et à la mise en œuvre de ces formations.
S’agissant du financement, l’article précise que celui-ci peut reposer en tout ou partie sur les crédits du fonds paritaire de financement des organisations syndicales et patronales prévu à l’article L. 2135-9. Par coordination, le III complète à l’article L. 2135-11 la liste des formations éligibles au financement du fonds. Il ne s’agit là que d’une des modalités de financement possibles, l’article laissant toute liberté aux entreprises, aux organisations syndicales de salariés ou aux organisations professionnelles d’employeurs de financer de telles formations.
Les conditions d’application de cet article doivent être précisées par décret en Conseil d’État.
L’article L. 2212-2 permet ensuite à un accord d’entreprise ou de branche de définir :
− d’une part, le contenu des formations communes et leurs conditions de fonctionnement (1°) ;
− d’autre part, les modalités du financement de ces formations afin de couvrir « les frais pédagogiques, les dépenses d’indemnisation et les frais de déplacement et d’hébergement des stagiaires et animateurs » (2°).
Les paragraphes IV à IX proposent de regrouper en un seul chapitre l’ensemble des articles du code du travail relatifs aux congés et à la formation économique, sociale et syndicale.
Le 1° du IV modifie l’intitulé du chapitre V du titre IV du livre I de la deuxième partie du code du travail, désormais intitulé « Congés et formation économique, sociale et syndicale » :
− le 2° du IV crée une section 1 comprenant les articles L. 2145-1 à L. 2145-4 relatifs à la formation économique, sociale et syndicale ;
− les 3° et 4° du IV créent une section 2 relative aux congés de formation économique, sociale et syndicale comprenant les articles L. 3142-7 à L. 3142-15 du code du travail, renumérotés L. 2145-5 à L. 2145-13.
Enfin, les V, VI, VII, VIII et IX effectuent les coordinations résultant de cette renumérotation aux articles L. 1232-12, L. 1442-2, L. 2145-1, L. 2325-44, L. 3341-2 et L. 3341-3 du code du travail.
*
Lors de son examen du texte, la Commission a adopté cinq amendements rédactionnels à cet article.
*
L’amendement AS733 de Mme Éva Sas est retiré.
La Commission examine l’amendement AS110 de M. Gérard Cherpion.
Mme Bérengère Poletti. Actuellement, les sommes du budget de fonctionnement du comité d’entreprise non utilisées au cours d’une année ne peuvent pas être reportées sur la subvention de fonctionnement de l’année suivante. Elles ne peuvent ni être récupérées par l’employeur, ni déduites de la subvention de l’année suivante, ni être transférées sur le budget des activités sociales et culturelles. L’objet de cet amendement est de permettre, par accord collectif, d’autoriser ce transfert.
M. le rapporteur. Il est exact que le budget de fonctionnement du comité d’entreprise ne peut être reporté sur la subvention de fonctionnement de l’année suivante. Cette même préoccupation se traduit, à l’article 18, par la possibilité de dédier une partie de ce budget de fonctionnement au financement de la formation des délégués du personnel et des délégués syndicaux présents dans l’entreprise. Afin de ne pas disperser ce budget et d’encourager la formation des acteurs du dialogue social dans l’entreprise, je vous propose d’en rester à la rédaction actuelle du texte. Avis défavorable.
Mme Isabelle Le Callennec. Cet amendement fait référence à un accord collectif. Alors que nous étudions un projet de loi qui vise à donner plus de libertés aux entreprises et aux actifs, je ne comprends pas le refus du rapporteur. Il s’agit de donner la possibilité d’affecter des sommes non consommées aux activités sociales et culturelles. Vous nous avez parlé des activités syndicales. Je ne vois pas où est le souci si ce n’est que cet amendement est présenté par notre groupe.
Mme Bérengère Poletti. Au contraire, c’est peut-être parce qu’il est proposé par notre groupe qu’il peut être intéressant. C’est un amendement intelligent, plutôt souple, qui permet une avancée tout en respectant la liberté du comité d’entreprise.
M. le rapporteur. Contrairement à ce que dit Mme Le Callennec, dans une appréciation un peu partisane que je regrette, l’amendement a une vraie incidence : en vous suivant, on pourrait en arriver à siphonner complètement les crédits de formation que nous prévoyons à l’alinéa 2 de l’article 18. Il faudrait au moins un taquet. Pour ma part, je ne peux pas prendre le risque de voir disparaître ces crédits pour la formation, après une ventilation à l’intérieur du budget.
M. Yves Censi. Je ne comprends pas les craintes du rapporteur. En fait, l’amendement envisage une fongibilité extrêmement cadrée, qui ne pourrait être imaginée que dans le cadre d’un accord collectif. C’est une forme de liberté et surtout une façon de faire bon usage des fonds, qui fait appel à la responsabilité des responsables du budget de fonctionnement et du budget des activités sociales et culturelles. Cette fongibilité ne représente absolument aucun danger.
La Commission rejette l’amendement.
Puis elle adopte successivement les amendements rédactionnels AS831, AS832, AS833 et AS834 du rapporteur.
Elle en vient à l’amendement AS633 de Mme Catherine Coutelle.
Mme Marie-Noëlle Battistel. Cet amendement tend à renforcer la formation de tous les partenaires sociaux à la négociation sur l’égalité professionnelle alors que de nombreuses disparités persistent entre les femmes et les hommes au sein des entreprises françaises.
M. le rapporteur. Avis défavorable. La philosophie de l’article 18 est de laisser une certaine latitude à l’ensemble des acteurs du dialogue social pour déterminer le contenu de ces formations, notamment par accord d’entreprise ou de branche. Si l’on commence à spécifier que la formation doit porter nécessairement sur la négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, qui est bien sûr une priorité, il faudrait également spécifier que ces formations portent sur la négociation sur les salaires ou sur la négociation sur la gestion prévisionnelle des emplois, qui sont des thématiques tout aussi incontournables. Et je pourrais allonger la liste.
La Commission rejette l’amendement.
Puis elle examine l’amendement AS275 de M. Yves Censi.
M. Yves Censi. Il serait logique de considérer que les formations à la négociation sociale font partie des compétences susceptibles d’être imputées sur les heures figurant dans le compte personnel de formation des salariés.
M. le rapporteur. Le compte personnel de formation a vocation à financer avant tout des formations professionnelles pour les salariés. La formation à l’exercice de la négociation collective doit, quant à elle, rester du ressort des entreprises ou des organisations syndicales. Il serait injuste d’amputer le compte personnel de formation des salariés exerçant un mandat de représentant du personnel pour financer ces formations. Avis défavorable.
La Commission rejette l’amendement.
Elle adopte ensuite l’amendement de correction AS835 du rapporteur.
Puis elle adopte l’article 18 modifié.
*
* *
La Commission est saisie de l’amendement AS20 de M. Jean-Charles Taugourdeau.
M. Élie Aboud. Cet amendement vise à définir de façon claire le rôle et les missions des comités d’entreprise dans la loi. Nous avons tous en tête des cas de comités d’entreprise qui ont une conception extensive de leurs prérogatives.
M. le rapporteur. Préciser que le comité d’entreprise exerce uniquement les missions qui lui sont confiées par la loi, c’est un peu enfoncer des portes ouvertes. Le comité d’entreprise exerce, bien évidemment, les activités qui lui sont conférées par le législateur, dans les conditions définies par le pouvoir réglementaire. S’il exerce des attributions qui ne sont pas prévues par la loi, c’est au juge qu’il revient de le déterminer. Avis défavorable.
M. Élie Aboud. Puisque vous êtes d’accord sur le fond, pourquoi ne pas le préciser ? Pourquoi laisser cela au juge ? Que les choses soient claires d’emblée, dans le cadre de la loi !
La Commission rejette l’amendement.
Elle en vient à l’amendement AS183 de M. Élie Aboud.
M. Élie Aboud. Il s’agit d’obliger le comité d’entreprise à nommer, pour rendre compte de sa gestion, au moins un commissaire aux comptes et un suppléant distincts de ceux de l’entreprise.
M. le rapporteur. Les lourdeurs administratives qui seraient ainsi instaurées ne sont justifiées par aucun élément objectif. Le comité d’entreprise a déjà la possibilité d’avoir recours à un expert-comptable pour l’assister sur tous les éléments d’ordre économique, financier ou social nécessaires à la compréhension des comptes et à l’appréciation de la situation de l’entreprise. C’est une possibilité qu’il n’y a pas lieu de transformer en obligation. Avis défavorable.
M. Élie Aboud. Nous savons tous, monsieur le rapporteur, que nombre de comités d’entreprise ont outrepassé leur rôle. Il ne suffit pas de prévoir qu’ils aient la possibilité de recourir à un commissaire aux comptes. Il faut les y obliger par souci de clarté et de transparence.
La Commission rejette l’amendement.
M. Francis Vercamer. Je veux préciser que je me suis abstenu. Il me semble intéressant d’obliger les comités d’entreprise à avoir un commissaire aux comptes, à condition de réserver la mesure à ceux qui gèrent des sommes importantes. Certains gros comités d’entreprise gèrent plus de fonds que certaines PME, alors qu’ils ne sont pas tenus de faire appel à un commissaire aux comptes. Il faudrait redéposer l’amendement en séance, en prévoyant une taille minimale de comité d’entreprise.
Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement AS21 de M. Jean-Charles Taugourdeau.
L’amendement AS549 de M. Arnaud Richard est retiré.
*
* *
Article 19
(Art. L. 2151-1, L. 2152-1, L. 2152-4 et L. 2261-19 du code du travail)
Mesure de l’audience patronale
Cet article propose de modifier les modalités de mesure de l’audience des organisations professionnelles d’employeurs pour tenir compte du nombre de salariés des entreprises adhérentes.
La loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale a rénové en profondeur les modalités de mesure de la représentativité patronale.
Alors qu’elle reposait jusqu’alors sur un principe de reconnaissance mutuelle, la représentativité des organisations professionnelles d’employeurs est déterminée désormais d’après un ensemble de six critères cumulatifs, définis à l’article L. 2151-1 du code du travail :
− le respect des valeurs républicaines ;
− l’indépendance ;
− la transparence financière ;
− une ancienneté minimale de deux ans dans le champ professionnel et géographique couvrant le niveau de négociation ;
− l’influence, prioritairement caractérisée par l’activité et l’expérience ;
− l’audience.
Les cinq premiers critères sont identiques aux critères servant à mesurer la représentativité des organisations syndicales de salariés, définie par la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail. Ce n’est pas le cas du critère de l’audience qui, contrairement à la mesure de l’audience des syndicats, dépend du nombre d’entreprises que les organisations d’employeurs représentent et non des résultats des élections professionnelles.
Ainsi, au niveau de la branche comme au niveau national et multi-professionnel, une organisation professionnelle d’employeurs est représentative lorsque les entreprises adhérentes représentent au moins 8 % de l’ensemble des entreprises adhérentes à des organisations professionnelles d’employeurs du niveau considéré satisfaisant aux critères communs de représentativité.
Les modalités de calcul du critère de l’audience retenues par la loi du 5 mars 2014 ont, depuis, fait l’objet d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC). Selon les organisations requérantes, l’absence de pondération dans le calcul de l’audience créait une rupture d’égalité entre les organisations patronales, désavantageant celles qui comptent un plus faible nombre d’entreprises adhérentes alors que ces entreprises emploient une part importante des salariés au niveau considéré.
Dans sa décision QPC du 3 février 2016 (42), le Conseil constitutionnel a écarté cette interprétation, considérant qu’ « en prévoyant que l’audience de ces organisations se mesure en fonction du nombre des entreprises adhérentes, le législateur a entendu assurer un égal accès à la représentativité des organisations professionnelles d’employeurs quel que soit le nombre des salariés employés par les entreprises adhérentes ou leur chiffre d’affaires ».
Le commentaire de la décision remarque que « le législateur aurait sans doute pu, sans méconnaître aucune exigence constitutionnelle, pondérer le critère de l’audience en fonction du nombre de salariés des entreprises, mais à l’inverse l’absence de pondération pour apprécier la représentativité n’était pas inconstitutionnelle ».
La première mesure de l’audience selon le cadre juridique nouvellement défini par la loi du 5 mars 2014 doit intervenir en 2017. L’étude d’impact précise qu’en dépit de la constitutionnalité de ce dispositif, l’absence de lien entre le nombre d’entreprises adhérentes et leur nombre de salariés mérite des ajustements, « pour mieux tenir compte des réalités ».
Cet article propose donc de mettre en place le dispositif ayant fait l’objet le 19 janvier 2016 d’une position commune entre deux organisations professionnelles d’employeurs, le Mouvement des entreprises de France (MEDEF) et la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME).
Telle qu’elle est issue de la loi du 5 mars 2014, la mesure de l’audience patronale tient compte du nombre d’entreprises adhérentes à une organisation professionnelle d’employeurs : une entreprise équivaut donc à une voix, quel que soit le nombre de salariés qu’elle emploie ou le niveau de son chiffre d’affaires.
Compte tenu des grandes disparités d’effectifs des entreprises françaises, rappelées dans le tableau ci-après, cette modalité de calcul signifie qu’en pratique, une entreprise de moins de dix salariés a autant de poids qu’une entreprise de plus de trois cents salariés dans la mesure de l’audience patronale.
Selon l’INSEE (43), l’on pouvait recenser en France au 31 décembre 2011 :
− 243 grandes entreprises employant 4,5 millions de salariés, soit une moyenne de 18 518 salariés par entreprise ;
− 4 794 entreprises de taille intermédiaire (ETI) employant 3,3 millions de salariés, soit une moyenne de 688 par entreprise ;
− 137 500 petites et moyennes entreprises (PME) employant près de 7 millions de salariés, soit une moyenne de 50 salariés par entreprise ;
− 3 millions de microentreprises ou très petites entreprises (TPE) employant 3 millions de salariés en équivalent temps plein.
Afin que la mesure de l’audience patronale ne soit pas totalement dénuée de lien avec le nombre de salariés de chaque entreprise, cet article instaure une pondération permettant de réduire le poids du nombre d’entreprises adhérentes et d’instaurer une prise en compte du nombre de salariés.
À cette fin, le 1°, le a et le c du 2° ainsi que le a et le c du 3° proposent de modifier respectivement les articles L. 2151-1, L. 2152-1 et L. 2152-4 du code du travail pour indiquer que l’audience se mesure désormais en fonction du nombre d’entreprises volontairement adhérentes, pondéré par leur nombre de salariés.
Le b du 2° et le b du 3° précisent, aux articles L. 2152-1 et L. 2152-4, les modalités de cette pondération : il serait ainsi tenu compte du nombre d’entreprises adhérentes à hauteur de 20 %, et du nombre de salariés à hauteur de 80 %.
b. L’ajustement du calcul de l’audience au droit d’opposition majoritaire à l’extension d’un accord collectif
L’article 29 de la loi du 5 mars 2014 a par ailleurs modifié l’article L. 2261-19 du code du travail afin de créer un droit d’opposition majoritaire à l’extension d’un accord collectif.
Ainsi, pour pouvoir être étendus, une convention de branche, un accord professionnel ou interprofessionnel, ainsi que leurs avenants ou annexes, ne doivent pas avoir fait l’objet de l’opposition d’une ou de plusieurs organisations d’employeurs reconnues représentatives au niveau considéré « dont les entreprises adhérentes emploient plus de 50 % de l’ensemble des salariés des entreprises adhérant aux organisations professionnelles d’employeurs reconnues représentatives à ce niveau ».
Le 4° tire les conséquences de l’instauration d’une pondération de l’audience en fonction du nombre de salariés :
− le a substitue à la condition d’emploi de plus de 50 % de l’ensemble des salariés des entreprises adhérant aux organisations professionnelles d’employeurs, les nouvelles modalités de mesure de l’audience telles que prévues aux articles L. 2152-1 et L. 2152-4. Toutefois, le niveau de l’audience demandé ne varie pas : l’audience doit être supérieure à 50 % ;
− le b supprime les trois derniers alinéas de l’article L. 2261-19 relatifs au calcul du taux de 50 % prévu par l’actuelle version de cet article.
Enfin, le d du 2° modifie l’article L. 2152-1 afin de préciser que, pour la mesure du seuil de représentativité de 8 %, les entreprises et exploitations adhérentes dans les branches agricoles sont les exploitations ou entreprises mentionnées à l’article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime employant une main d’œuvre salariée, à titre permanent et ce, « quel que soit le nombre d’heures effectuées par les salariés ».
Le rapporteur prend acte de cette proposition de modification de la mesure de l’audience patronale. Il considère néanmoins que les modalités retenues se font au détriment de la représentativité des entreprises françaises comprenant un faible nombre de salariés, qui représentent la majorité des entreprises présentes sur le territoire national.
Considérant que l’absence de pondération initialement retenue par la loi du 5 mars 2014 a été jugée conforme à la Constitution, et que le Conseil d’État a, dans son avis sur le projet de loi, invité le Gouvernement à documenter son choix afin de justifier le respect du principe de participation et du principe d’égalité devant la loi, le rapporteur a demandé au Gouvernement des éléments complémentaires lui permettant d’entériner non seulement le bien-fondé des nouvelles modalités présentées par cet article, mais également leur constitutionnalité au regard des principes de participation et d’égalité devant la loi.
*
Dans l’attente des éléments de réponse de la part du Gouvernement, et afin de permettre aux négociations en cours avec les différentes organisations professionnelles d’employeurs de parvenir à un compromis, la Commission a adopté un amendement de suppression de cet article, tout en indiquant clairement son intention de retravailler cet article d’ici la séance publique.
*
La Commission est saisie des amendements identiques AS584 de la présidente Catherine Lemorton, AS122 de M. Bernard Accoyer, AS463 de M. Alain Tourret, AS539 de M. Arnaud Richard et AS694 de M. Alain Fauré.
Mme la présidente Catherine Lemorton. J’ai déposé un amendement de suppression de cet article, bien que j’aie été interpellée par la CGPME et par le MEDEF, qui me priaient de n’en rien faire.
L’article a pour objet la mesure de la représentativité patronale. Le critère retenu prend en compte le nombre des entreprises adhérentes à hauteur de 20 % et le nombre des salariés de ces entreprises à hauteur de 80 %. Il modifie ainsi les équilibres résultant de la loi du 5 mars 2014, qui prévoit que la représentativité patronale fait l’objet d’une négociation. Le Conseil constitutionnel, saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité, a jugé conforme à la Constitution le régime issu de la loi de 2014.
Le projet de loi arrive alors que seules deux des instances patronales, à savoir la CGPME et le MEDEF, se sont mises d’accord sur la question de la représentativité patronale, tandis que l’Union professionnelle artisanale (UPA), qui regroupe les TPE et certaines PME, n’est pas partie à l’accord signé entre ces deux instances. Ces entreprises, qui comptent certes moins de salariés, risquent en effet de perdre en force et en représentativité s’il entre en vigueur.
Je ne fais pas de la suppression de cet article une affaire en tant que telle. À mes yeux, il s’agit seulement de revenir à l’existant, c’est-à-dire de laisser la chance à toutes les instances patronales de se mettre d’accord. Je ne veux pas qu’on passe en force et qu’on revienne sur le dispositif de 2014 dont la mise en œuvre est en cours. Certes, l’une des instances patronales adhérentes à la CGPME m’a encore écrit tout à l’heure pour me dire qu’ils représentent aussi les PME et qu’ils font donc entendre leur voix, mais j’estime que l’UPA devrait pouvoir les rejoindre.
Monsieur le rapporteur, j’en appelle à vous pour que nous obtenions un dispositif plus équilibré.
Les amendements AS122 et AS463 sont retirés.
M. Francis Vercamer. Certes, une entreprise qui emploie des milliers de salariés a plus d’importance qu’une TPE qui n’en emploie qu’un seul, voire aucun. Mais toutes deux sont soumises au même code du travail ! Les dispositions dont nous débattons, qui amèneront des accords de branche issus de la négociation, ont vocation à s’appliquer ainsi à toutes les entreprises.
Si nous adoptons l’article 19, les grandes entreprises auront la priorité et la prédominance sur les petites, qui devront appliquer les accords négociés par les grandes. Il est normal qu’une entreprise qui compte 200 000 salariés se voie reconnaître plus de poids. Mais la proposition dont nous débattons est complètement disproportionnée. Tout le monde du commerce, de l’artisanat et des TPE sera exclu des négociations collectives, puisque, en ne prenant pas en compte le nombre d’entreprises adhérentes aux instances patronales, nous nous privons de la participation des TPE et de certaines PME.
Prenons en compte le nombre de salariés des entreprises, mais aussi le nombre d’entreprises adhérentes à une organisation patronale. Car je rappelle que les grandes entreprises ne représentent que 1 % des entreprises françaises : nous ne pouvons pas priver 99 % d’entre elles du droit à la parole.
Mme la présidente Catherine Lemorton. Certaines branches professionnelles, telle celle du commerce, risquent de voir disparaître totalement la représentativité des TPE.
M. Jean-Patrick Gille. Il ne s’agit pas d’un sujet nouveau. Nous avions eu l’occasion d’avancer sur le sujet de la représentativité patronale au cours des débats sur ce qui est devenu la loi du 5 mars 2014. Le sujet de la représentativité syndicale, quant à lui, a été traité en 2008. Pour cette dernière, tout est fondé sur l’agrégation, certes complexe, des résultats de vote. Pour la représentativité patronale, c’est un peu plus compliqué.
L’on nous a dit que le plus simple était de fonder cette représentativité sur le nombre d’entreprises adhérentes. Dans ce cas, pourtant, le groupe Renault tout entier ne pèse pas davantage qu’une succursale de quartier. Aussi avons-nous réfléchi beaucoup sur un critère de pondération, notamment au cours de l’examen de la loi Rebsamen du 17 août 2015. Des débats agités est sortie l’idée de laisser aux partenaires sociaux six mois de réflexion. Le MEDEF et la CGPME ont ainsi pu adopter une position commune sur la question.
Le premier a obtenu que le critère du nombre d’entreprises adhérentes à une organisation ne soit pris en compte qu’à hauteur de 20 %. Il est surprenant que la seconde l’ait suivi sur ce point. En tout état de cause, il faudra néanmoins trouver un équilibre. Certes, nous pouvons être tentés de ne pas rentrer dans ces détails. Pourtant, si certains peuvent voir un rééquilibrage dans l’article 19 et d’autres un déséquilibre, l’objectif de cet article n’en demeure pas moins que rien ne bouge et que le rapport de force actuel soit conservé. Les autres organisations patronales ne peuvent qu’être en désaccord. La représentativité promise ne mesure, en effet, plus rien dans ces conditions.
Plusieurs options s’ouvrent à nous. Soit nous en restons au texte de la loi, soit nous trouvons nous-mêmes une solution. Je propose pour ma part, en inversant le rapport proposé, un partage à 70-30 % entre le critère du nombre d’entreprises adhérentes et le critère de leur nombre de salariés. D’autres amendements proposent d’autres répartitions, notamment par moitié entre les deux. Certes, si nous sortons du critère proposé, le MEDEF pourrait bien exprimer du mécontentement, mais cela ne devrait pas être un sujet de préoccupation pour nous.
Pour résumer, soit nous supprimons l’article, mais ne le remplaçons par rien d’autre, ce qui revient à une reculade et à une prorogation du délai de réflexion laissé aux organisations patronales. Soit nous supprimons l’article et nous nous efforçons de trouver par nous-mêmes une solution.
M. Michel Liebgott. Au bas de l’accord sur la représentativité, la signature de l’UPA manque effectivement. Il me semble délicat de valider par la loi un accord où manque la troisième partie prenante, fût-elle la moins importante. Nous devons au moins donner un signal aux TPE et PME, en supprimant l’article, même si ce n’est pas le signal définitif. Le Gouvernement apportera peut-être des éléments en séance publique. Nous serons amenés à examiner les dégâts collatéraux éventuels, tandis que des négociations se déroulent dans d’autres enceintes.
En l’état, il ne me semble cependant pas possible de discuter avec les organisations patronales si nous tranchons définitivement le débat aujourd’hui. Espérons plutôt un accord entre les trois organisations d’ici à la séance publique.
M. Christophe Cavard. Le texte de loi cherche à améliorer le dialogue social. Et après avoir passé de longues heures à discuter sur la représentativité patronale, nous en modifierions les règles au détour d’un article de loi ? Même si elles ont peu de salariés, les TPE, nombreuses et particulièrement dynamiques, sont aussi concernées.
Il ne me paraît pas possible d’accepter la répartition à 20-80 % des deux critères. Je serais donc favorable à la suppression de l’article, pour garder l’existant. La ministre du travail a les moyens de faire calculer, en fonction des diverses propositions, les conséquences sur la représentativité patronale des taux choisis, tant au niveau global qu’au niveau des branches. Nous pourrons ensuite arriver à quelque chose de plus stabilisé.
M. Jean-Frédéric Poisson. Nous avons effectivement déjà eu ce débat en 2008. Aujourd’hui, ce n’est pas une organisation patronale qui manque, mais au moins trois autres : celle de l’économie sociale et solidaire, celle des professions libérales et la fédération des particuliers employeurs, qui emploient quelques centaines de milliers de personnes, ou encore les agriculteurs. L’accord passé entre le MEDEF et la CGPME est donc incomplet.
En 2014, avec mon collègue Gérard Cherpion, nous avions expliqué au ministre du travail que, si la mécanique légale s’emparait du calcul de la pondération, nous ne nous en sortirions plus. À l’époque, j’avais plutôt défendu l’idée qu’un accord soit trouvé branche par branche – ce qui me semblait la voie la plus sûre et la plus adaptée – et que la loi n’impose un seuil de critères qu’à terme.
En l’état, l’article ne me paraît pas pouvoir être adopté. J’espère que le ministère du travail a des outils pour mener des simulations. Mais si la loi définit à la toise, pour toutes les organisations, les mêmes seuils de représentativité, elle ne saura jamais prendre en compte tous les cas de figure. De mon point de vue, la mécanique légale n’est pas la bonne.
Mme Isabelle Le Callennec. Il est nécessaire, en effet, de disposer de calculs et de simulations. Depuis le temps que ce sujet est débattu et depuis l’adoption, l’été dernier, de la loi Rebsamen, n’ont-ils pas déjà été faits ? J’imagine que l’UPA a dû formuler des propositions. Monsieur le rapporteur, vous avez peut-être des informations à nous fournir ? Les éléments sont certainement connus ; il reste à prendre, enfin, une décision.
M. le rapporteur. En l’état actuel, l’article 19 n’est pas satisfaisant ; nous pouvons tous partir de ce postulat. Il fait suite à la décision que nous avions prise de laisser les organisations patronales trouver entre elles un accord, en leur promettant d’intégrer par la suite cet accord dans la loi.
S’agissant de l’accord trouvé aujourd’hui entre le MEDEF et la CGPME, les interprétations peuvent être différentes, mais force est de constater que l’un des interlocuteurs privilégiés n’est plus autour de la table. C’est inacceptable.
Plusieurs options s’ouvrent, dès lors, à nous. Certains collègues déposent des amendements de suppression, mais cette position me semble difficile à expliquer devant l’opinion. D’autres proposent une répartition à 30-70 %, 70-30 % ou 50-50 % : je ne suis pas sûr que cela soit plus probant. Je serais tenté de proposer un amendement de repli en même temps que d’appel dans l’attente du débat en séance publique, car des négociations ont lieu en ce moment. Cela ferait comprendre à certaines organisations qu’elles doivent être plus respectueuses de leurs partenaires. Je suggère donc plutôt le retrait des amendements de suppression, au profit de mon amendement AS1046, tout en émettant un avis défavorable sur les autres amendements.
Mon amendement vise, dans un premier temps, à assurer une stabilité de la représentativité des organisations patronales, en précisant que « dans les quatre ans suivant la première mesure de la représentativité patronale, seront réputées représentatives les organisations qui l’étaient déjà jusqu’à aujourd’hui. Je suis conscient que ce texte n’est pas stabilisé, mais nous laisserions ainsi le temps à la négociation d’être menée.
Ma position personnelle reste que l’article 19 n’est pas acceptable en l’état. Mais je souhaite que nous aboutissions à quelque chose de vraiment négocié plutôt qu’à quelque chose d’imposé.
Mme la présidente Catherine Lemorton. Je vais retirer mon amendement, dans l’espoir que les partenaires se mettent enfin d’accord pour de bon.
L’amendement AS584 est retiré.
M. Francis Vercamer. Quant à moi, je ne retirerai pas l’amendement AS539. Adopter l’article en précisant seulement qu’on suivra la situation pendant quatre ans ne me paraît pas suffisant. Cela revient à dire que la Commission est d’accord avec l’article tel qu’il est.
Nous sommes tous plus ou moins d’accord sur le fond, mais je ne suis pas d’accord avec l’argumentation du rapporteur. Même si mon amendement risque d’être rejeté, je veux au moins qu’on sache mon désaccord avec la disposition de l’article 19.
M. Jean-Frédéric Poisson. Notre rapporteur se livre à un exercice difficile, alors qu’il y a un avis largement majoritaire au sein de la Commission pour ne pas laisser l’article en l’état, même si cela pose des difficultés de principe, d’affichage et de respect du tempo de la négociation en cours.
En adoptant l’amendement du rapporteur, nous nous contenterions de maintenir l’article en le complétant, ce qui est paradoxal si nous voulons majoritairement le supprimer.
Par contre, je me demande si le nouvel alinéa qu’il propose ne pourrait pas remplacer tout l’article 19. Cela permettrait de maintenir la législation actuelle pendant la durée mentionnée, tout en marquant la volonté de la Commission de voir discuter d’autres dispositions. Celles qui seraient issues de la négociation, ainsi que les seuils, pourraient être insérés par la suite.
Mme Isabelle Le Callennec. L’amendement du rapporteur complète l’article 19. En l’adoptant, nous ne remplissons pas son objectif, qui est de se donner du temps et de renvoyer la balle aux partenaires sociaux. L’amendement ne supprimera pas la répartition proposée de 20-80 %.
M. Jean-Patrick Gille. Ma position n’était pas de supprimer l’article. Mais, si nous le supprimons, ce sont les règles d’une représentativité fondée à 100 % sur le nombre d’entreprises adhérentes qui s’appliqueront. Peut-être est-ce la seule manière de faire pression sur les partenaires sociaux, qui ont conclu un accord à l’arraché le 15 novembre. Certes, nous reviendrions ainsi six mois en arrière, mais ne serait-ce pas préférable à ne rien voir bouger, à coup sûr, pendant quatre ans ? Car l’amendement du rapporteur ferait durer la situation actuelle encore quatre années supplémentaires, alors qu’elle dure depuis huit ans déjà. L’idée me paraît contre-productive par rapport à notre objectif.
Par ailleurs, le Conseil constitutionnel avait validé les dispositions de la loi de 2014 à l’occasion d’une question prioritaire de constitutionnalité. La seule question qui demeure est de savoir comment les appliquer. Il me semble donc qu’il vaut mieux finalement supprimer l’article 19 pour maintenir une pression sur les partenaires sociaux. En leur laissant quatre années supplémentaires, nous ne reverrons jamais le dossier ici. Voici pourquoi je reviens sur ma position initiale pour me rallier aux tenants de la suppression de l’article.
M. Yves Censi. Malheureusement, nous subissons les conséquences d’une certaine impréparation de la phase de négociation préalable à la loi. Si l’on entérine l’état actuel des signataires, force est de constater, avec notre collègue Jean-Frédéric Poisson, que beaucoup manquent à l’appel. Ce n’est donc pas véritablement un accord ; cependant, la négociation en cours n’est pas terminée.
Le Gouvernement aurait pu l’impulser bien avant, comme pour la loi de 2008. Nous nous trouvons donc dans une situation instable, sauf à rester sur la loi de 2014, qui n’est pas satisfaisante. Je comprends l’amendement du rapporteur comme une tentative, devant l’insuffisance du Gouvernement, d’inscrire dans la loi la situation actuelle, si instable soit-elle, puisque tout le monde n’est pas d’accord. Mais, avec l’article 19 assorti d’un II nouveau, nous inscrivons dans la loi un accord incomplet et nous interdisons de bouger dans les années qui suivent.
Mieux vaut supprimer l’article et trouver un autre moyen d’organiser des négociations et de les faire aboutir. En tout cas, les discussions sur la pondération des différents critères me semblent nulles et non avenues, car ce n’est pas à la loi de fixer pareille répartition entre les cinq partenaires.
Mme la présidente Catherine Lemorton. Vous savez très bien qu’il ne s’agit pas d’une impréparation du Gouvernement, et ce qu’il y a derrière tout cela.
M. Gérard Cherpion. Théoriquement, nous ne devrions pas avoir de difficulté à valider, par l’adoption de cet article 19, un accord qui a été signé entre les partenaires sociaux et dont les dispositions ont été validées par le Conseil constitutionnel. Cependant, ce n’est pas la meilleure solution, car un déséquilibre s’observe effectivement dans la représentation. D’autres solutions, par paliers, seraient envisageables, du type de celles qui se pratiquent pour les chambres consulaires.
Le rapporteur évoque une négociation en cours. Mais tous les acteurs y sont-ils partie prenante ? Il le faut, car ils sont tous concernés. Tout le monde doit donc participer.
En supprimant l’article 19, nous fixons une date-butoir qui est la date de l’examen du texte en séance publique. Si nous n’avons pas de réponse à ce moment-là, nous prendrons nos responsabilités. Les vacances qui s’annoncent rendent des négociations possibles. À défaut, nous pourrons revenir à l’article 19, qui s’appuie sur un accord existant et a été validé par le Conseil constitutionnel.
Mme Bérengère Poletti. Je rejoins la position de Jean-Patrick Gille. Il convient de faire connaître notre rejet de la situation actuelle. Les partenaires sociaux sont avertis depuis longtemps qu’ils doivent trouver une solution commune et équilibrée. Je suis donc favorable à la suppression de l’article 19, plutôt qu’à l’amendement du rapporteur.
M. Christophe Cavard. Une certaine unanimité me semble se dégager contre l’article 19, même si nous sommes aussi opposés au statu quo. La suppression donnera un signe fort issu des travaux parlementaires. Contrairement à ce qu’a dit Gérard Cherpion, il n’y a pas vraiment d’accord, puisque tous ceux qui sont impactés n’y ont pas été associés. Le travail est donc à reprendre.
Notre objectif final doit être le retrait de l’article pour laisser le temps à la négociation de revenir, d’ici à trois semaines, à une proposition bien mesurée dans laquelle tout le monde se retrouverait.
M. Jean-Frédéric Poisson. À défaut de la substitution que j’évoquais précédemment, ma préférence irait également à la suppression pure et simple de l’article 19. Arriver en séance en ayant adopté l’article 19 et l’amendement du rapporteur en l’état vaudrait, en quelque sorte, accord de principe sur les modalités actuelles de l’article, alors que la Commission y est opposée.
M. le rapporteur. Je comprends d’autant mieux la perplexité de nos collègues que je partage leur analyse. Cela dit, je ne voudrais pas qu’il y ait d’arrière-pensées, c’est-à-dire qu’une fois l’article 19 supprimé en commission, on fasse en sorte que l’on ne touche plus à rien en séance publique. J’affirme donc de manière très claire que si je m’en remets à la sagesse de la Commission sur le vote des amendements de suppression de l’article 19, cela ne vaut pas renonciation de ma part à revenir en séance sur la problématique posée par cet article, que son éventuelle suppression ne réglerait pas : que l’on ne compte pas sur moi pour enterrer le débat ! Avis de sagesse, donc, sur les amendements de suppression.
M. Michel Liebgott. Nous sommes face à une alternative très simple : si nous supprimons l’article 19, nous n’aurons plus de débat ; en revanche, si nous l’adoptons modifié par l’amendement du rapporteur, le débat aura lieu. Je suis plutôt favorable à la deuxième solution, car je crains qu’une fois l’article 19 supprimé, nous n’en parlions plus.
M. Francis Vercamer. En ce qui nous concerne, nous déposerons un amendement par paliers s’inspirant du modèle des chambres consulaires – un délégué pour moins de dix salariés, trois délégués de dix à cinquante salariés, et ainsi de suite – afin d’établir une pondération tenant compte de la taille des entreprises et du nombre de salariés. Bien évidemment, nous ne voyons aucun inconvénient à ce que tous les collègues intéressés par notre amendement le cosignent.
Mme la présidente Catherine Lemorton. Comme M. le rapporteur, j’insiste sur le fait que l’adoption des amendements de suppression ne signifierait absolument pas que nous avons l’intention d’enterrer le débat sur la problématique de l’article 19.
La Commission adopte l’amendement AS539.
En conséquence, l’article 19 est supprimé et les amendements AS693 de M. Alain Fauré, AS682 de M. Jean-Patrick Gille, AS692 de M. Alain Fauré et AS1046 du rapporteur n’ont plus d’objet.
*
* *
Article 20
(Art. L. 2135-12 du code du travail)
Règles d’attribution des crédits du fonds de financement
du dialogue social pour les professions du spectacle
Cet article propose de modifier les modalités de versement des crédits par le fonds paritaire national créé par la loi n° 2014-588 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale, afin de sécuriser les modalités de financement dans le secteur du spectacle.
La loi du 5 mars 2014 a prévu la mise en place d’un fonds paritaire de financement, chargé de financer les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs représentatives au titre de leurs missions d’intérêt général et de participation aux politiques publiques.
Or, les modalités de versement des crédits du fonds ne sont pas adaptées au secteur particulier de la production cinématographique, de l’audiovisuel et du spectacle. En effet, dans ce secteur constitué de neuf branches professionnelles, l’étude d’impact relève que la plupart des organisations professionnelles d’employeurs représentatives se sont regroupées autour d’une fédération, la Fédération des entreprises du spectacle vivant, de la musique, de l’audiovisuel et du cinéma (FESAC). Cette fédération ne peut toutefois accéder à la représentativité, car elle dépasse le champ d’une branche professionnelle, et ne présente pas les conditions pour être représentative au niveau interprofessionnel.
Cette fédération est la principale gestionnaire de l’organisme paritaire collecteur agréé (OPCA) du secteur, le fonds d’assurance formation des activités du spectacle (AFDAS). L’étude d’impact précise qu’avant la loi du 5 mars 2014, la FESAC était mandatée par les organisations professionnelles d’employeurs représentatifs dans les branches du secteur pour percevoir les fonds issus de l’AFDAS. Les modalités de versement du fonds paritaire ont rendu impossible cette pratique, alors même que, selon l’étude d’impact, « l’ensemble des organisations professionnelles représentatives dans les branches du spectacle souhaitent voir perdurer les modalités de financement antérieures à la mise en place du fonds ».
Cet article propose donc de sécuriser les modalités de financement de la FESAC par le fonds paritaire. L’article L. 2135-12 dresse une liste de trois catégories d’actions ouvrant droit, pour les organisations de salariés et d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel, aux crédits du fonds paritaire. Il s’agit de la participation à :
− la conception, à la gestion, à l’animation ou à l’évaluation des politiques publiques menées de manière paritaire (1°) ;
− la mise en œuvre et au suivi des politiques publiques relevant de la compétence de l’État (2°) ;
− la formation économique, sociale et syndicale des salariés appelés à exercer des fonctions syndicales ou des adhérents à une organisation syndicale de salariés amenés à intervenir en faveur des salariés (3°).
S’agissant du 1° de l’article L. 2135-12, les organisations pouvant bénéficier des crédits du fonds paritaire sont, plus précisément, « les organisations de salariés et d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel, leurs organisations territoriales, les organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et multi-professionnel ainsi que celles qui sont représentatives au niveau de la branche ».
Le présent article propose de clarifier cette règle pour les professions du spectacle en tenant compte de la structuration spécifique de ce secteur. Il est ainsi précisé que dans le secteur de la production cinématographique, de l’audiovisuel et du spectacle, peuvent bénéficier des crédits du fonds paritaire au titre de la mission mentionnée au 1° de l’article L. 2135-12, « les organisations professionnelles d’employeurs représentatives de l’ensemble des professions de ce secteur dont les statuts prévoient qu’elles ont vocation à en percevoir les crédits ».
*
La Commission adopte l’amendement rédactionnel AS836 du rapporteur.
Puis elle adopte l’article 20 modifié.
*
* *
TITRE III
SÉCURISER LES PARCOURS ET CONSTRUIRE LES BASES D’UN NOUVEAU MODÈLE SOCIAL À L’ÈRE DU NUMÉRIQUE
Chapitre Ier
Mise en place du compte personnel d’activité
Article 21
(Art. L. 5151-1 à L. 5151-12 [nouveaux], L. 6323-1, L. 6323-2, L. 6323-4, L. 6323-6, L. 6323-7, L. 6323-11-1 [nouveau], L. 6323-24 à L. 6323-31 [nouveaux], L. 6111-6 du code du travail)
Création du compte personnel d’activité
Cet article précise les contours et les modalités de mise en œuvre du compte personnel d’activité (CPA), dont l’entrée en vigueur est prévue au 1er janvier 2017. Il crée également un compte engagement citoyen, intégré dans le CPA. Il rénove, enfin, le compte personnel de formation (CPF) en l’étendant aux travailleurs indépendants et aux professions libérales, en élargissant les actions de formations éligibles et en prévoyant des abondements spécifiques pour les salariés sans qualification.
I. SÉCURISER LES PARCOURS PROFESSIONNELS ET GARANTIR L’ACCÈS AUX DROITS DANS UN COMPTE UNIQUE, PERSONNEL ET UNIVERSEL
La mise en œuvre du compte personnel d’activité traduit, dans le cadre juridique, la modification en profondeur des formes de travail et le caractère de plus en plus discontinu des trajectoires professionnelles. Issu d’une large concertation, le CPA constitue une avancée décisive en matière de sécurisation des parcours professionnels et de préservation des droits acquis. L’article 21 du projet de loi en définit les contours, les objectifs et les modalités d’utilisation.
Le système français de protection sociale s’est construit sur une logique de statut, dans le contexte de la généralisation du salariat et du recul du travail indépendant. Suivant des trajectoires individuelles souvent linéaires, les salariés conservaient leur métier – et donc leurs droits associés, dans une démarche assurantielle – tout au long de leur carrière professionnelle. Une logique solidaire s’est ensuite développée, destinée à assurer une protection sociale à chacun. Les évolutions juridiques n’ont toutefois pas conduit à remettre en cause le caractère indissociable des droits sociaux et du métier. En dépit de son universalisation, notre modèle social continue de lier les droits professionnels au statut.
Pourtant, les formes et le contenu des parcours professionnels se sont modifiés en profondeur en trente ans. Le monde du travail est aujourd’hui marqué par le changement de statut au cours d’une même carrière, un marché du travail dual et le déclin du modèle salarial connu jusqu’alors. Un écart croissant existe dès lors entre le cadre juridique de la protection sociale – rattachée au métier – et la nouvelle réalité des parcours professionnels. La multiplication des contrats courts, la traversée de plus en plus fréquente d’une période de chômage au cours d’une carrière et l’aspiration des actifs à l’autonomie imposent donc de repenser la construction de la protection sociale et son adaptation à la réalité du travail contemporain.
Plusieurs auteurs ont alimenté ces débats relatifs aux nouvelles formes d’emploi. M. Alain Supiot(44), par exemple, proposait dès 1999 l’adaptation du modèle social français – et, plus largement, européen – aux nouvelles réalités du marché du travail. Directement liée à la réforme du code du travail dans une version actualisée (45), cette réflexion souligne la tension entre un droit du travail et un système de protection sociale restés attachés au métier et au statut et des carrières professionnelles et des formes d’emploi peu adaptées à ce cadre juridique.
Face à ce constat, le rattachement de la protection sociale à la personne et la préservation des droits acquis tout au long du parcours professionnel sont devenus de plus en plus nécessaires. La portabilité des droits sociaux et professionnels et leur universalité doivent permettre de sécuriser les parcours professionnels, de corriger certaines inégalités et de faciliter les transitions entre statuts sans perte de droits acquis.
Les fondements d’une réforme des droits sociaux et professionnels ont été posés par plusieurs réformes destinées à sécuriser les parcours professionnels en facilitant la conservation des droits acquis. Consacrée dans l’accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013 (46), cette sécurisation du parcours s’illustre par le principe de portabilité des droits, aujourd’hui applicable dans trois dispositifs :
– la portabilité des garanties de couverture santé et prévoyance, tout d’abord, au niveau des branches professionnelles et des entreprises ;
– le compte personnel de formation (CPF), ensuite, conservé par son titulaire tout au long de son parcours professionnel et devant lui permettre d’acquérir au moins un niveau de qualification durant sa carrière ;
– la création des droits rechargeables à l’assurance chômage, enfin, permettant aux demandeurs d’emploi reprenant un emploi de conserver tout ou partie de leurs droits aux allocations d’indemnisation chômage non utilisés.
Aux côtés de la portabilité, la logique de personnalisation des droits se traduit également par le rattachement de droits à un compte dédié afin de faciliter leur appropriation et leur conservation par leur titulaire. Outre le CPF précité, le compte personnel de prévention de la pénibilité (C3P) répond à cette même logique en permettant d’accumuler des points au titre de l’exposition à la pénibilité. Créé par la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites, le C3P permet de convertir les points acquis au titre de la pénibilité afin de financer des heures de formation, de réduire le temps de travail sans perte de salaire ou de liquider plus tôt ses droits à pension.
La création du compte personnel d’activité a été inscrite dans son principe dans la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi. L’article 38 de cette dernière prévoit ainsi l’entrée en vigueur au 1er janvier 2017 d’un compte personnel d’activité qui rassemble pour chaque personne, « dès son entrée sur le marché du travail et tout au long de sa vie professionnelle, indépendamment de son statut, les droits sociaux personnels utiles pour sécuriser son parcours professionnel ».
Le législateur prévoyait alors l’engagement d’une concertation avec les organisations professionnelles d’employeurs et syndicales de salariés avant le 1er décembre 2015 afin de définir les contours de ce dispositif. Cette négociation, menée à l’échelle nationale et interprofessionnelle, a abouti à un projet de position commune en février 2016. Il est, dans ce cadre, prévu que le CPA, ouvert de l’âge de 16 ans à la retraite, regroupe deux comptes existants : le compte personnel de formation (CPF), d’une part ; le compte personnel de prévention de la pénibilité (C3P), d’autre part. Cette position commune a, à ce jour, été signée par quatre syndicats de salariés représentatifs à l’échelle nationale et interprofessionnelle
– CFDT, FO, CFTC et CFE-CGC.
En parallèle de cette concertation, une réflexion a été animée par France Stratégie à la demande du Premier ministre afin d’examiner les options envisageables pour la mise en place du CPA. Présidée par Mme Selma Mahfouz, la Commission « Compte personnel d’activité » a rendu ses travaux en octobre 2015, identifiant plusieurs scénarios de mise en œuvre du CPA.
« Le compte personnel d’activité, de l’utopie au concret »
Dans son rapport remis en octobre 2015, France Stratégie identifie plusieurs principes clés au cœur du CPA, quel que soit le scénario envisagé. Afin d’être universel, le CPA devrait être ouvert à tous les résidents à partir de 16 ans, être fermé au décès, utiliser le point comme unité de mesure des droits et s’appuyer sur des dotations correctrices pour les personnes éloignées de l’emploi.
Une fois ces principes communs identifiés, France Stratégie définit trois scénarios de mise en œuvre du CPA répondant chacun à une logique distincte :
- « un compte orienté vers la capacité d’évolution professionnelle », visant en premier lieu la sécurisation des trajectoires professionnelles et reposant en conséquence sur les droits à la formation. Les droits accumulés sur d’autres comptes, tels que le compte personnel de prévention de la pénibilité (C3P), le compte épargne-temps ou l’épargne salariale, seraient fongibles pour financer les actions de formation. Les droits à l’assurance chômage pourraient également être partiellement intégrés ;
- « un compte ciblé sur la liberté de l’usage des temps au long de la vie », reposant sur une meilleure articulation entre les temps professionnel, personnel, familial et social et la reconnaissance des activités, qu’elles soient marchandes ou non. Le CPA rassemblerait alors les droits du premier scénario et les droits à congés tels que les jours de réduction du temps de travail (RTT). Certaines activités d’utilité collective, tel que le service civique, pourraient donner lieu à des dotations complémentaires ;
- « un compte ciblé sur l’accès aux droits et la sécurité des transitions », destiné à assurer la continuité des droits sociaux au-delà de l’emploi. Aux côtés des droits contenus dans les scénarios précédents, le CPA constituerait un point d’accès aux droits couvrant les principaux risques sociaux – maladie, accidents du travail, retraite … Assimilé à un « compte-ressources », le CPA permettrait de faciliter l’accès aux droits – aujourd’hui gérés par des organismes différents – ainsi que la mobilité entre statuts.
Le I de l’article 21 du projet de loi définit les objectifs, les contours et les conditions d’utilisation du compte personnel d’activité, dont l’entrée en vigueur est prévue au 1er janvier 2017. Les dispositions régissant ce compte sont rassemblées dans un nouveau titre complétant le livre Ier de la cinquième partie du code du travail.
Les objectifs du CPA sont définis dans un nouvel article L. 5151-1 du code du travail. La mobilisation des droits inscrits sur le compte doit permettre à son titulaire d’atteindre trois catégories d’objectifs :
– renforcer l’autonomie et la liberté d’action du titulaire du compte et sécuriser son parcours professionnel, tout d’abord, en facilitant les mobilités ;
– contribuer au droit à la qualification professionnelle, ensuite, en facilitant l’acquisition par tout actif d’au moins un niveau de qualification au cours de sa carrière professionnelle ;
– favoriser l’engagement citoyen, enfin, dans le cadre de la création du compte engagement citoyen.
L’atteinte de ces objectifs doit être facilitée par l’accompagnement global de tout titulaire d’un CPA. Destiné à assurer une mobilisation effective des droits, cet accompagnement est notamment assuré par le conseil en évolution professionnelle (CEP) créé par la loi du 14 juin 2013 (47) et rénové par la loi du 5 mars 2014 (48).
Le conseil en évolution professionnelle
Le conseil en évolution professionnelle (CEP) constitue un service de conseil gratuit mis en place dans le cadre du service public régional de l’emploi et destiné à favoriser l’évolution et la sécurisation du parcours professionnel. Il remplit deux missions principales :
- d’une part, l’accompagnement dans les projets d’évolution professionnelle, en lien avec les besoins économiques existants et prévisibles des territoires ;
- d’autre part, la simplification de l’accès à la formation, en identifiant les qualifications répondant aux besoins de la personne et la mobilisation des financements disponibles et en facilitant le recours au compte personnel de formation.
Délivré en dehors de l’entreprise, ce conseil est assuré par cinq institutions définies à l’article L. 6111-6 du code du travail, que sont respectivement les organismes de placement spécialisés dans l’insertion professionnelle des personnes handicapées (réseau Cap emploi), Pôle emploi, les missions locales pour l’insertion professionnelle et sociale des jeunes, les organismes paritaires collecteurs agréés au titre du congé individuel de formation (OPACIF), l’Association pour l’emploi des cadres (APEC) et les opérateurs régionaux désignés par la région après concertation au sein du bureau du comité régional de l’emploi, de l’orientation et de la formation professionnelles (CREFOP).
Le CEP a vu son cahier des charges défini par l’arrêté du 16 juillet 2014, qui recense les règles relatives à ses finalités et à ses publics bénéficiaires, à son offre de service, à ses modalités de mise en œuvre et à son suivi.
Le III de l’article 21 du projet de loi complète ce dispositif en prévoyant que le CEP peut être proposé en tout ou partie à distance, dans des conditions définies par le cahier des charges précité. L’accès dématérialisé au CEP reflète le recours croissant aux tutorats et aux formations en ligne, en particulier pour les publics les plus éloignés géographiquement des institutions le dispensant.
Le rapporteur appuie cette pérennisation du rôle du CEP dans la sécurisation des parcours professionnels, aujourd’hui dans le cadre du CPF, demain dans celui du CPA dans son ensemble. Un CEP conforté dans sa mission d’accompagnement de l’ensemble des actifs doit toutefois reposer sur des outils et des financements adéquats. Service encore récent, le CEP ne dispose pas de moyens propres et est mis en œuvre de manière inégale par les cinq institutions devant l’assurer. Afin de garantir la qualité du conseil fourni et d’en faire le principal service d’accompagnement du CPA, le rapporteur souligne la nécessité de renforcer les moyens du CEP et de lui assurer la pleine capacité de remplir sa mission pour 40 millions d’actifs.
Le nouvel article L. 5151-2 du code du travail précise les conditions d’ouverture et de fermeture du compte personnel d’activité.
S’agissant de son ouverture, tout d’abord, le CPA est ouvert pour toute personne âgée d’au moins 16 ans occupant un emploi, ayant un statut de conjoint collaborateur, à la recherche d’un emploi, accompagnée dans un projet d’orientation et d’insertion professionnelles ou accueillie dans un établissement et service d’aide par le travail (ESAT).
Reprenant une dérogation applicable au compte personnel de formation (CPF), le CPA peut être ouvert dès 15 ans pour tout jeune qui signe un contrat d’apprentissage.
S’agissant de sa fermeture, ensuite, le CPA est clos lorsque la personne est admise à faire valoir ses droits à la retraite. Il n’est toutefois pas à exclure qu’un inactif souhaite reprendre une activité et ainsi mobiliser à nouveau les droits accumulés jusqu’alors sur son CPA. Face au silence du projet de loi et de l’étude d’impact sur cette possibilité, le choix d’une fermeture du compte au moment du décès, préconisée par France Stratégie, mérite donc d’être étudié.
Ce régime d’ouverture et de fermeture du compte doit permettre d’accompagner son titulaire tout au long de son activité et ainsi lui permettre de préserver ses droits accumulés quel que soit le stade de son parcours professionnel. Afin de garantir cette préservation des droits, le nouvel article L. 5151-3 du code du travail prévoit que, sauf disposition contraire, les droits inscrits sur le compte demeurent acquis par leur titulaire jusqu’à leur utilisation ou à la fermeture du compte. Cette disposition consacre le principe de portabilité des droits, au cœur du projet de CPA.
Regroupant plusieurs comptes rattachés à l’activité de la personne, le CPA voit son contenu précisé au nouvel article L. 5151-5 du code du travail.
Lors de son ouverture, au 1er janvier 2017, le CPA rassemblera trois comptes distincts :
– le compte personnel de formation (CPF) ;
– le compte personnel de prévention de la pénibilité (C3P) ;
– le compte engagement citoyen.
Le Gouvernement précise que ce périmètre du CPA ne constitue qu’une première étape, le dispositif étant appelé à être complété par d’autres droits par la suite. Le choix d’une construction progressive du CPA, autour d’un noyau dur de trois comptes personnels, devrait faciliter l’entrée en vigueur du dispositif et son appropriation. Il ne s’agit néanmoins que d’une configuration initiale avant la création d’un compte rassemblant tous les droits professionnels.
Le rapporteur soutient cette démarche pragmatique. Plutôt qu’un dispositif constitué de multiples comptes aux paramètres et aux publics hétérogènes, il est préférable d’assurer la pleine effectivité du CPA dès son entrée en vigueur autour d’un noyau dur de trois outils pouvant être mobilisés au titre de la qualification et de la formation professionnelles.
Le compte personnel d’activité repose sur les principes d’autonomie, de responsabilité et d’initiative. Loin d’une démarche prescriptive ou impérative, le compte doit pouvoir être mobilisé par son titulaire dans une démarche personnelle orientée vers le projet professionnel et les attentes en termes de qualification de son choix.
Il est ainsi prévu que le CPA ne peut être mobilisé qu’avec l’accord exprès de son titulaire. Le refus de le mobiliser ne peut dès lors pas constituer une faute.
Une fois le principe général de liberté d’utilisation du compte défini, des conditions spécifiques de mobilisation des droits acquis ont été précisées.
En effet, créé isolément, chaque compte répond à des modalités d’utilisation particulières.
Le CPF, tout d’abord, peut être mobilisé par le salarié sans l’accord de son employeur dès lors que la formation est suivie en dehors du temps de travail. Lorsque cette formation est suivie en tout ou partie pendant le temps de travail, l’accord préalable de l’employeur doit être demandé par le salarié concernant le contenu et le calendrier de la formation, l’absence de réponse valant acceptation. L’accord préalable de l’employeur n’est toutefois pas nécessaire lorsque les heures de formation sont financées au titre des heures créditées sur le CPF pour manquement à l’obligation d’organiser un entretien professionnel ou dans des cas prévus par accord de branche, d’entreprise ou de groupe. Aucun accord préalable de l’employeur n’est également nécessaire en cas de mobilisation du CPF au titre de l’accompagnement à la validation des acquis de l’expérience (VAE) ou de l’acquisition du socle de connaissances et de compétences.
Le C3P, quant à lui, peut être utilisé pour financer une action de formation professionnelle continue via la conversion de points en heures de formation sur le CPF, financer un complément de rémunération en cas de réduction de la durée de travail ou financer une majoration de durée d’assurance vieillesse. Pouvant choisir entre ces trois utilisations, le titulaire du C3P est toutefois tenu d’affecter ses 20 premiers points au financement de la formation pour les assurés nés à partir du 1er janvier 1963 – le seuil étant de 10 points pour ceux nés entre le 1er janvier 1960 et le 31 décembre 1962. Une telle obligation ne s’applique pas pour les assurés nés avant le 1er janvier 1960.
Répondant à une logique de compte unique et personnel, le CPA doit désormais prévoir des mécanismes de fongibilité des droits, comme cela est aujourd’hui déjà prévu dans le cadre de la mobilisation des points acquis sur le C3P au titre du CPF. Il est ainsi prévu que le compte engagement citoyen permette de financer l’inscription d’heures sur le CPF.
L’une des clefs de réussite du CPA réside dans la mise en œuvre d’un système d’information performant, clair et facilement utilisable. La qualité du système d’information conditionne l’appropriation du dispositif par les actifs, et donc sa mobilisation au profit de l’accès aux droits et de la sécurisation des parcours.
Le système d’information du CPA reposera sur deux piliers, définis au nouvel article L. 5151-6 du code du travail :
– un service en ligne gratuit, d’une part, permettant à chaque titulaire de connaître et d’utiliser ses droits. Il sera géré par la Caisse des dépôts et consignations, déjà en charge du système d’information du compte personnel de formation (SI-CPF), sans préjudice de la gestion par la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS) du C3P ;
– une plateforme de services en ligne, d’autre part, ayant trait à l’information sur les droits sociaux et à la sécurisation des parcours professionnels. Cette plateforme donnera également accès au service de conservation des bulletins de paie du titulaire par voie dématérialisée prévu à l’article 24 du projet de loi.
Cette offre de services s’appuiera sur des interfaces de programmation qui permettront à des tiers de développer et de mettre à disposition ces services.
Cet enjeu de mise à disposition des droits dans un système d’information coexiste avec l’exigence de protection des données personnelles. Afin de préserver la confidentialité de ces données, des conditions strictes d’utilisation doivent être définies, s’agissant notamment de l’identification des personnes compétentes pour accéder aux données. La définition de ces conditions d’utilisation des données personnelles relatives au CPF, au C3P ou à la déclaration sociale nominative est renvoyée à un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL).
Le CPF et le C3P sont aujourd’hui régis par leurs propres règles de protection des données personnelles. Cette diversité de régimes de confidentialité dans le CPA pourrait poser des difficultés techniques à mesure que le CPA intégrera d’autres dispositifs voire, à terme, l’ensemble des droits sociaux. Il importe donc de poursuivre la réflexion relative à l’harmonisation des régimes de confidentialité au sein du CPA, seule à même d’assurer la préservation des données personnelles.
Le rapporteur souligne l’avancée fondamentale que constitue la mise en place du compte personnel d’activité pour 40 millions d’actifs. Dispositif clef de sécurisation des parcours professionnels, le CPA permettra de faciliter les transitions entre métiers et entre statuts, de garantir la préservation des droits acquis tout au long d’une carrière et de réduire les inégalités en facilitant l’accès aux droits.
En intégrant le CPF, le C3P et le compte engagement citoyen, le Gouvernement fait le choix d’une démarche pragmatique destinée à assurer une pleine entrée en vigueur du dispositif au 1er janvier 2017. Il importe néanmoins de réfléchir dès à présent à l’extension future du CPA en engageant une réflexion relative aux différents comptes pouvant y être intégrés à l’avenir. Il reviendra à la négociation entre partenaires sociaux, puis au législateur, de définir ce périmètre, en particulier au regard de l’enjeu de gestion des temps personnels et professionnels.
L’objectif premier du CPA est de placer le titulaire au cœur du dispositif. Son succès se mesurera dès lors à son appropriation par les actifs. Pour y parvenir, le rapporteur insiste sur trois principes au fondement du CPA et conditionnant sa réussite.
La liberté, tout d’abord, vise à garantir la possibilité pour chaque titulaire de maîtriser son utilisation des droits acquis et de déterminer son propre parcours professionnel. La plateforme en ligne et les outils numériques associés seront déterminants pour assurer cette libre utilisation. En rendant visible la complexité d’un dispositif ou d’un cadre juridique, les nouvelles technologies rendent incontournable l’enjeu de simplification des procédures d’accès aux droits. Il sera dès lors nécessaire de construire pas à pas le service Internet du CPA et de l’adapter aux remontées des utilisateurs.
L’universalité, ensuite, constitue la condition sine qua non de la sécurisation des trajectoires professionnelles quel que soit le statut. À ce jour, les agents publics ne disposent ni d’un CPF, ni d’un C3P. L’extension du CPF aux travailleurs indépendants sera effective, quant à elle, à partir de 2018. Au 1er janvier 2017, l’universalité du CPA sera donc théorique. Face à ce constat, il importe dès à présent de placer le dispositif dans une logique universelle en engageant une réflexion sur la portabilité des droits avec en premier lieu, l’enjeu d’accumulation et de transférabilité des droits à formation. À terme, l’ensemble des droits sociaux pourraient être concernés par cette universalité et requerraient une adaptation forte de notre système de protection sociale.
La fongibilité, enfin, donne tout son sens à la logique de rassemblement des droits dans un compte unique. Les modalités précises de conversion des droits d’un compte à un autre seront précisées selon les règles propres à chacun de ces dispositifs. Il importe toutefois de veiller dès à présent à cet enjeu de fongibilité des droits, orientée vers la sécurisation et la maîtrise des parcours, en inscrivant ce principe dans le corps de la loi.
Aux côtés du compte personnel de formation et du compte personnel de prévention de la pénibilité, le compte personnel d’activité est complété par un troisième dispositif destiné à valoriser les activités bénévoles ou de volontaires : le « compte engagement citoyen ». L’article 21 du projet de loi en définit le périmètre, les conditions d’utilisation et les modalités de financement. Il s’agit d’une reconnaissance décisive de l’utilité et de l’intérêt pour notre cohésion sociale de ces activités volontaires ou bénévoles.
Le compte engagement citoyen constitue un compte personnel, au même titre que le CPF ou le C3P, recensant pour chaque citoyen les activités bénévoles et volontaires. Cette valorisation des activités citoyennes repose sur l’initiative du titulaire du compte : il demeure libre d’y recenser ou non les activités effectuées.
Intégré dans le CPA, le compte engagement citoyen partage le système d’information du compte personnel de formation (SI-CPF) géré par la Caisse des dépôts et consignations.
Les activités inscrites sur ce compte pourront faire l’objet de deux utilisations distinctes :
– d’une part, elles permettront de financer des heures sur le CPF ;
– d’autre part, elles pourront permettre d’acquérir des jours de congés destinés à l’exercice de ces activités.
Le projet de loi identifie six catégories d’activités permettant d’acquérir des heures de formation. Ces engagements recouvrent :
– le service civique, prenant la forme d’un engagement volontaire d’une durée comprise entre six et douze mois pour toute personne âgée de 16 à 25 ans
– ou, pour les personnes handicapées, de 16 à 30 ans. Il peut également prendre la forme d’un volontariat international en administration (VIA), d’un volontariat international en entreprise (VIE), d’un volontariat de solidarité internationale ou du service volontaire européen ;
– la réserve militaire, composée d’une réserve opérationnelle
– comprenant les volontaires qui ont souscrit un engagement à servir dans la réserve opérationnelle auprès de l’autorité militaire et des anciens militaires soumis à l’obligation de disponibilité – et d’une réserve citoyenne ;
– la réserve communale de sécurité civile, placée sous l’autorité du maire et regroupant, sur la base du bénévolat, des personnes s’engageant à servir dans la réserve pour une durée de un à cinq ans renouvelable ;
– la réserve sanitaire, mise en place par l’établissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires (EPRUS) en vue de répondre aux situations de catastrophe, d’urgence ou de menace sanitaires graves sur le territoire national ;
– l’activité de maître d’apprentissage, dans le cadre de la responsabilité de la formation de l’apprenti ;
– celle de bénévolat associatif, lorsqu’elle comporte la participation à l’organe d’administration ou de direction d’une association inscrite sur une liste par arrêté des ministres chargés de la vie associative et de la formation professionnelle, pris après avis du Haut conseil de la vie associative. Ces activités doivent être comprises dans le champ de celles ouvrant droit à une réduction d’impôt sur le revenu, c’est-à-dire celles étant effectuées dans le cadre d’œuvres ou d’organismes d’intérêt général et ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial ou culturel, ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique. Un décret en Conseil d’État définira les modalités de reconnaissance de ce bénévolat associatif.
Le pouvoir réglementaire devra définir la durée d’exercice d’une de ces activités nécessaire à l’acquisition de 20 heures sur le CPF. Ces heures de formation seront financées par des institutions distinctes selon l’activité concernée. S’agissant du service civique, de la réserve militaire, de l’activité de maître d’apprentissage ou du bénévolat associatif, tout d’abord, le financement sera effectué par l’État. S’agissant de l’engagement dans une réserve communale de sécurité civile, ensuite, la commune prendra en charge ce financement. S’agissant de la mobilisation au titre de la réserve sanitaire, enfin, l’EPRUS sera en charge du financement des heures de formation.
La seconde modalité d’utilisation des droits accumulés sur le compte engagement citoyen correspond à l’acquisition de jours de congés consacrés aux activités de bénévolat ou de volontariat.
Il est ainsi prévu que l’employeur a la faculté d’accorder des jours de congés payés au salarié concerné. L’accord de l’employeur est donc requis pour pouvoir bénéficier de ces jours de congés. Ces derniers sont alors retracés sur le compte engagement citoyen.
S’étant vu attribuer une vocation universelle, le compte personnel de formation est aujourd’hui limité aux salariés et aux demandeurs d’emploi. L’extension du CPF aux non-salariés constitue donc un prérequis à l’universalisation du droit à la formation et à la préservation des droits en cas de changement de statut, plus particulièrement dans le contexte de croissance du travail indépendant et de trajectoires professionnelles de moins en moins linéaires.
Le 7° du II de l’article 21 du projet de loi étend, en conséquence, le CPF aux travailleurs indépendants, aux membres des professions libérales ou des professions non salariées et à leurs conjoints collaborateurs. Premier pas vers l’universalité du CPA, cette extension du CPF constitue une avancée majeure pour favoriser l’acquisition d’un niveau de qualification au cours d’une carrière et empêcher les pertes de droits lors d’un nouveau départ professionnel.
Les principaux paramètres du CPF des travailleurs non-salariés sont identiques à ceux du CPF aujourd’hui en vigueur. Ainsi, le principe d’une alimentation en heures de formation – à hauteur de 24 heures par an jusqu’à l’acquisition de 120 heures, puis de 12 heures par an, dans la limite d’un plafond total de 150 heures – est repris. De manière identique, les périodes d’absence du travailleur pour un congé de maternité, de paternité, et d’accueil de l’enfant, d’adoption, de présence parentale, de proche aidant ou un congé parental d’éducation ou pour une maladie professionnelle ou un accident du travail sont intégralement prises en compte pour le calcul des heures alimentées sur le CPF.
S’agissant des abondements complémentaires, également, le CPF des travailleurs non-salariés peut bénéficier d’heures de formation par deux voies supplémentaires :
– en application de l’accord constitutif du fonds d’assurance formation de non-salariés prévu pour les travailleurs indépendants, les membres des professions libérales et non-salariées et les chefs d’exploitation et d’entreprise agricoles, d’une part ;
– par les chambres de métiers et de l’artisanat de la région et les chambres régionales de métier et de l’artisanat dans le cadre de leurs contributions à la formation professionnelle.
Ces abondements ne sont pas pris en compte dans les modes de calcul des heures créditées chaque année sur le CPF ainsi que de son plafond.
Ces heures sont financées à partir de la contribution prévue à l’article L. 6331-48 du code du travail et versée par les travailleurs indépendants et les membres des professions libérales et non salariées. Elles sont également financées par la contribution prévue à l’article L. 718-2-1 du code rural et de la pêche maritime pour les chefs d’exploitation et d’entreprise agricoles ainsi que pour leurs conjoints et les membres de leur famille.
Lorsque la contribution n’a pas été acquittée dans son ensemble, le nombre d’heures alimenté sur le CPF du travailleur concerné est diminué au prorata de la contribution versée.
La prise en charge des frais de formation, enfin, est confiée au fonds d’assurance formation (FAF) de non-salariés auquel le travailleur non salarié adhère ou à la chambre régionale des métiers et de l’artisanat ou la chambre des métiers et de l’artisanat de la région dont il relève.
Les formations éligibles au titre du CPF des travailleurs indépendants, des professions libérales et non-salariées et de leurs conjoints collaborateurs font coexister des formations éligibles au CPF des salariés et des formations spécifiques.
Le CPF peut, tout d’abord, être mobilisé au titre de formations permettant d’acquérir le socle de connaissances et de compétences et de celles relatives à l’accompagnement à la validation des acquis de l’expérience. Cet article du projet de loi ajoute également dans cette catégorie de formations éligibles par tout titulaire d’un CPF les actions permettant d’évaluer les compétences d’une personne préalablement à l’acquisition du socle précité, celles permettant de bénéficier de prestations de bilan de compétences et celles dispensées aux créateurs ou repreneurs d’entreprises.
Plus spécifiquement, le CPF des travailleurs non-salariés pourra également être mobilisé au titre de formations définies comme éligibles par le fonds d’assurance formation auquel adhère le titulaire du compte. Les chambres régionales des métiers et de l’artisanat et les chambres de métiers et de l’artisanat de région pourront également définir des formations éligibles au CPF des artisans. L’ensemble de ces formations à destination des travailleurs non-salariés devra être adressé à la Caisse des dépôts et consignations dans le cadre de sa gestion du système d’information du CPF.
La mobilisation du compte personnel de formation est conditionnée au suivi d’une formation appartenant à l’une des trois catégories définies à l’article L. 6323-6 du code du travail.
Le CPF peut, tout d’abord, être mobilisé au titre de formations permettant d’acquérir le socle de connaissances et de compétences. Défini par le décret n° 2015-172 du 13 février 2015, ce socle comprend sept modules aujourd’hui délivrés dans le cadre de la certification « CLÉA ».
Le CPF peut, également, être mobilisé au titre de formations sanctionnées par une certification enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP), un certificat de qualification professionnelle (CQP), une certification inscrite à l’inventaire établi par la Commission nationale de la certification professionnelle (CNCP) ou celles concourant à l’accès à la qualification des demandeurs d’emploi. Pour être éligibles, ces formations doivent ensuite être inscrites sur une liste par les partenaires sociaux aux échelles nationale et régionale.
Le CPF peut, enfin, être mobilisé au titre de l’accompagnement à la validation des acquis de l’expérience (VAE). Le 4° du II de l’article 21 du projet de loi étend cette troisième catégorie d’éligibilité à deux actions de formation supplémentaires, dans des conditions précisées par décret : les actions de formation permettant de bénéficier de prestations de bilan de compétences, d’une part ; celles dispensées aux créateurs ou repreneurs d’entreprises, d’autre part.
Il rend par ailleurs éligibles, en cohérence avec l’objectif d’acquisition du socle de connaissances et de compétences, les actions permettant d’évaluer les compétences d’une personne préalablement à cette acquisition.
Constituant une action de formation aux termes de l’article L. 6313-1 du code précité, le bilan de compétences facilite l’évolution professionnelle en permettant d’identifier les aptitudes, les compétences et les attentes du salarié. Il s’inscrit donc au cœur d’une démarche de parcours.
Ce bilan a pour objectif de permettre à un travailleur d’analyser ses compétences et de définir un projet professionnel – et, en cohérence, un projet de formation – en adéquation avec cette analyse. Il ne peut être réalisé qu’avec le consentement du travailleur.
Le bilan de compétences peut être effectué à l’initiative de l’employeur ou du salarié.
Dans le premier cas, le financement est effectué via le plan de formation de l’entreprise.
Dans le second cas, le salarié doit adresser à son employeur une demande de congé pour réaliser un bilan de compétences. Pour ce faire, il doit justifier d’une expérience professionnelle de salarié d’au moins cinq ans en qualité de salarié, qu’elle qu’ait été la nature des contrats de travail successifs, dont douze mois dans l’entreprise. La prise en charge des dépenses afférentes à ce congé est alors effectuée via les ressources consacrées au congé individuel de formation.
L’objectif de l’éligibilité du CPF est donc de permettre aux actifs n’ayant actuellement pas accès au financement du bilan de compétence – tels que les demandeurs d’emploi ou les salariés ne remplissant pas les conditions d’une ancienneté de cinq ans ou d’une ancienneté de douze mois dans l’entreprise – de bénéficier d’une telle prestation.
Les créateurs ou repreneurs d’entreprise doivent être soutenus dans leurs démarches – notamment administratives et juridiques – et pouvoir être accompagnés dans des secteurs parfois éloignés de leur formation. S’il repose par définition sur une approche individuelle et personnelle, le projet entrepreneurial est toutefois indissociable de l’environnement dans lequel il s’inscrit et doit donc reposer sur un appui et un accompagnement. Il s’agit à la fois de faciliter la prise de décision et l’élaboration des dossiers ex ante et de répondre aux principales interrogations découlant des premiers mois d’activité.
Selon l’étude d’impact du projet de loi (49), 43 % de l’ensemble des créateurs d’entreprise ont ainsi estimé avoir manqué d’un appui à leurs débuts. En cohérence avec l’objectif de sécurisation des parcours professionnels, le CPF doit donc pouvoir être mobilisé dans le cadre d’un accompagnement à la création ou à la reprise d’entreprises. Tel est l’objet de l’élargissement de l’éligibilité du CPF à cette prestation.
La loi du 5 mars 2014 précitée a consacré l’objectif d’acquisition du socle de connaissances et de compétences, destiné à faciliter l’insertion et l’évolution professionnelles. Cette acquisition fait l’objet d’une certification sur proposition du comité paritaire interprofessionnel national pour l’emploi et la formation (COPANEF), définie en janvier 2016 dans le cadre du dispositif « CLÉA ».
Progressivement mis en œuvre, le socle de connaissances et de compétences pourrait être acquis plus facilement en identifiant pour chaque personne son niveau et les modules prioritaires.
Tel est l’objectif de l’éligibilité au CPF de l’évaluation préalable du socle de connaissances et de compétences. Il sera toutefois nécessaire de définir par voie réglementaire des critères communs assurant l’homogénéité du dispositif.
Le compte personnel de formation a pour objectif principal de permettre à tout actif d’acquérir au moins un niveau de qualification durant son parcours professionnel. Pour les personnes sans qualification, il s’agit donc de l’outil permettant l’acquisition d’un premier niveau de qualification.
L’article 21 du projet de loi renforce le soutien aux actifs sans qualification en facilitant la mobilisation du CPF via deux dispositifs : le soutien aux jeunes sortis du système scolaire sans qualification, d’une part ; l’alimentation renforcée du compte des salariés sans qualification, d’autre part.
a. Le financement d’une durée complémentaire de formation qualifiante pour les jeunes sans qualification
Le droit pour tout jeune sortant du système éducatif sans diplôme de bénéficier d’une durée complémentaire de formation qualifiante a constitué l’un des principaux axes de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la République. Cette formation complémentaire peut notamment consister en un droit au retour en formation initiale sous statut scolaire, tel que prévu à l’article L. 122-2 du code de l’éducation.
Afin de faciliter le recours à la formation complémentaire, le 5° du II de l’article 21 du projet de loi relie ce dispositif au compte personnel de formation. Il est ainsi prévu que le droit à une durée complémentaire de formation qualifiante se traduit par l’abondement du CPF à hauteur du nombre d’heures nécessaires à sa réalisation, lorsque la formation est dispensée sous le statut de stagiaire de la formation professionnelle.
Le financement de cet abondement en heures de formation est confié à la région dans le cadre du service public régional de la formation professionnelle et de l’objectif d’acquisition d’un premier niveau de qualification auquel elle contribue. Lorsque le CPF de la personne concernée contient déjà des droits, l’abondement effectué par la région constitue un complément des droits déjà inscrits jusqu’à atteindre le nombre d’heures nécessaires à la réalisation de la formation qualifiante. Cet abondement n’est pas pris en compte dans le calcul des heures créditées sur le CPF ni de son plafond. Par dérogation au droit commun, la formation financée dans le cadre du CPF doit toutefois figurer sur le programme régional de formation professionnelle afin d’être éligible.
L’effectivité de l’acquisition d’au moins un niveau de qualification dans une carrière professionnelle passe également par l’aménagement du CPF des salariés sans qualification, en leur prévoyant des modalités spécifiques. Tel est l’objet du 6° du II de l’article 21 du projet de loi, visant à modifier les règles d’alimentation et le plafond du CPF des salariés concernés.
Le droit en vigueur prévoit une alimentation du CPF à hauteur de 24 heures par an jusqu’à 120 heures, puis de 12 heures par an jusqu’au plafond de 150 heures. Prévues pour une année de travail à temps complet, ces dispositions sont adaptées pour les salariés ayant effectué un temps partiel sur tout ou partie de l’année, dans le cadre d’un abondement à due proportion du temps de travail effectué, sous réserve de dispositions plus favorables prévues par accord d’entreprise, de groupe ou de branche qui prévoit un financement spécifique.
Afin de prendre en compte le besoin immédiat de formation des salariés sans qualification, il est prévu d’élever l’alimentation du CPF des salariés n’ayant pas atteint un niveau de formation sanctionné par un diplôme national ou un titre professionnel enregistré et classé au niveau V du répertoire national des certifications professionnelles (RNCP). Le CPF de ces salariés est ainsi alimenté à hauteur de 40 heures par an, le plafond étant quant à lui porté à 400 heures.
Complémentaires et orientés vers l’objectif prioritaire de qualification professionnelle, ces deux dispositifs permettront de diriger une partie des financements de la formation professionnelle vers les publics sans qualification. Le rapporteur estime cet aménagement du CPF central pour garantir l’accès à un premier niveau de qualification prévu par la loi et l’octroi d’un accompagnement renforcé pour les personnes les plus éloignées du marché du travail.
L’article 21 du projet de loi procède, enfin, à plusieurs modifications de conséquence dans le code du travail afin de prendre en compte ces nouveaux paramètres du compte personnel de formation.
Le 1° du II renvoie au nouvel article L. 5151-2 du code du travail définissant les modalités d’ouverture et de fermeture d’un CPA par son titulaire ces mêmes modalités relatives au CPF.
Par ailleurs, le 2° du II intègre les travailleurs indépendants, les membres d’une profession libérale ou d’une profession non salariée ou leur conjoint collaborateur dans la liste des personnes pouvant mobiliser leur CPF, tirant ainsi les conséquences de l’universalisation du dispositif.
Enfin, le 3° du II complète la liste des institutions pouvant financer les abondements en heures complémentaires lorsque la durée de formation est supérieure au nombre d’heures inscrites sur le compte. Les fonds d’assurance formation de non-salariés et les chambres régionales de métiers et de l’artisanat ou les chambres de métiers et de l’artisanat de région – au titre du CPF des non-salariés – et les communes et l’EPRUS – au titre de la mobilisation du compte engagement citoyen – y sont ainsi ajoutés.
*
Outre 18 amendements rédactionnels, la Commission a adopté plusieurs amendements précisant les modalités d’utilisation du compte personnel d’activité et des dispositifs le constituant.
S’agissant des modalités de fermeture du CPA, la Commission a adopté les amendements AS 885 et AS 886 déposés par M. Yves Blein, rapporteur de la commission des affaires économiques. Reprenant une préconisation de France Stratégie, ces amendements prévoient une fermeture du CPA au moment du décès de son titulaire – et non plus lors de la liquidation des droits à retraite – afin notamment de maintenir l’accès à la plateforme d’information sur les droits sociaux au-delà de l’activité.
S’agissant des modalités d’utilisation du compte, la Commission a adopté deux amendements du rapporteur visant à garantir la pleine portabilité des droits acquis et à inscrire le principe de fongibilité des droits dans la loi. Cette conversion des droits sera facilitée par la négociation d’une convention entre la Caisse des dépôts et consignations et la Caisse nationale de l’assurance vieillesse des travailleurs salariés relative aux modalités d’articulation des comptes, cette disposition étant prévue par l’amendement AS 1010 du rapporteur. La Commission a également adopté l’amendement AS 202 de M. Philippe Cordery, rapporteur de la commission des affaires européennes, visant à garantir un accompagnement personnalisé dans le cadre du CPA. Un amendement a, en outre, été adopté à l’initiative du rapporteur afin de clarifier le contenu du service de mise en accessibilité du bulletin de paie via la plateforme de services en ligne du CPA.
S’agissant du compte personnel de formation et de l’éligibilité de nouvelles actions de formation, la Commission a adopté deux amendements du rapporteur destinés à reprendre les termes du code du travail relatifs à la réalisation d’un bilan de compétences et à l’accompagnement, l’information et le conseil dispensés aux créateurs ou repreneurs d’entreprises. Deux amendements supplémentaires du rapporteur clarifient, par ailleurs, le suivi à distance du conseil en évolution professionnelle (CEP) et précisent que les abondements complémentaires effectués au titre du compte d’engagement citoyen ne sont pas pris en compte dans les règles d’alimentation et de plafond du CPF.
Enfin, trois amendements ont été adoptés à l’initiative du rapporteur de la commission des affaires économiques afin de prévoir la mise en place d’outils de simulation des droits sur le CPA, de renommer le compte engagement citoyen « compte d’engagement citoyen » et de renvoyer à la loi du 6 juillet 1901 le champ des activités de bénévolat associatif éligibles à ce même compte.
*
La Commission est saisie de l’amendement AS27 de M. Patrick Hetzel.
M. Élie Aboud. Nous proposons de supprimer les alinéas 1 à 46.
M. Christophe Sirugue, rapporteur. L’article 21 a pour objet de créer un compte personnel d’activité, qui doit constituer une grande avancée pour les salariés. Comme cela a été dit précédemment, il est nécessaire, pour que ce texte soit équilibré, qu’il comporte des éléments de nature à répondre aux inquiétudes de chacun. En proposant de supprimer les alinéas 1 à 46 de l’article 21, vous allez contre cette logique, et c’est pourquoi je suis très défavorable à votre amendement.
La Commission rejette l’amendement.
Elle adopte successivement les amendements rédactionnels AS839 et AS838 du rapporteur.
Puis elle examine l’amendement AS202 de M. Philip Cordery.
M. Philip Cordery. Si l’on peut supposer que les salariés de grandes entreprises trouveront toujours l’aide nécessaire pour se réorienter, il en va tout autrement des salariés de TPE et de PME, ainsi que des entrepreneurs indépendants. L’amendement AS202 a donc pour objet de préciser, à la première phrase de l’alinéa 9 de l’article 21, que l’accompagnement dont bénéficie le titulaire du compte personnel d’activité est personnalisé.
M. le rapporteur. La notion d’accompagnement est importante. Vous proposez que cet accompagnement puisse prendre la forme d’un conseil personnalisé, quelle que soit l’institution le dispensant. J’émets un avis favorable.
La Commission adopte l’amendement.
Elle adopte ensuite successivement les amendements rédactionnels AS841, AS840 et AS842 du rapporteur.
Elle est ensuite saisie de l’amendement AS885 de la commission des affaires économiques.
M. Yves Blein, rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques. L’amendement a pour objet de préciser que le compte personnel d’activité se prolonge au-delà de la période d’activité professionnelle, comme le recommande France Stratégie. Dans la mesure où l’on ouvre la possibilité de capitaliser des heures de formation utiles à l’engagement citoyen, il semble particulièrement justifié d’ouvrir le CPA au-delà de la période d’activité, car c’est bien lorsqu’on est à la retraite que l’on dispose de temps pour un engagement citoyen, et que l’on peut avoir besoin d’acquérir des compétences propres à cet engagement.
M. le rapporteur. Cette proposition s’inscrit dans une vision assez large du compte personnel d’activité, tenant compte de l’apport du compte d’engagement citoyen : il est exact que les retraités peuvent exercer des activités relevant de l’engagement citoyen. Surtout, il me paraît essentiel de ne pas raisonner à court terme : je suis convaincu que le compte personnel d’activité est amené à évoluer, et nous ne pouvons en exclure les retraités, d’autant que certains peuvent reprendre une activité temporaire. J’émets donc un avis favorable à l’amendement.
M. Jean-Patrick Gille. Je suis, pour ma part, un peu plus réservé. Avec le compte personnel d’activité, nous essayons de mettre en place un compte recensant les droits acquis par les personnes en activité, et éventuellement par les bénévoles. Ce compte, qui suivra chaque personne durant toute sa vie professionnelle – c’est pourquoi il s’ouvre à seize ans –, est avant tout destiné à sécuriser les transitions professionnelles. Pour ma part, je ne pense pas que le fait de l’ouvrir aux personnes retraitées constitue une priorité.
L’amendement vise à ce qu’il soit ouvert un compte personnel d’activité pour toute personne ayant fait valoir ses droits à la retraite : ipso facto, dès la promulgation de la loi, on ouvrirait donc un CPA à chaque retraité. Comme cela a déjà été le cas avec le compte personnel de formation (CPF), du jour au lendemain des millions de retraités se retrouveraient avec un CPA et se connecteraient à Internet pour finalement constater que leur compte n’est pas abondé.
Ce qui importe avant tout, c’est de mieux définir le compte personnel d’activité, qui reste encore très flou pour le moment, et je ne pense pas que cette proposition contribue à préciser ses contours. Avec cette proposition, on se fait plaisir, on se donne à bon compte l’impression d’être généreux, mais on n’aide en rien à la construction du CPA.
Mme Isabelle Le Callennec. Effectivement, beaucoup de flou entoure encore le compte personnel d’activité. La première question que l’on peut se poser à son sujet est de savoir à quel moment il sera fermé et, si l’on ouvre des droits à la formation, qui va payer pour cela – a fortiori si des droits sont accordés aux personnes retraitées. Lors de l’annonce de la création du CPA, le ministre du travail de l’époque avait dit que l’on laisserait aux partenaires sociaux le soin de déterminer son contenu. Aujourd’hui, il est question d’y rattacher le compte personnel de formation, le compte personnel de prévention de la pénibilité, le compte d’engagement citoyen, et certains plaident même pour le connecter au compte épargne temps.
L’article 21 est censé préciser les choses, mais de nombreuses inconnues demeurent, ce qui a sans doute donné l’idée à certains de nos collègues de déposer un amendement de suppression. Pour ma part, je pense que la discussion sur cet article est l’occasion pour nous de discuter du contenu du compte personnel d’activité. Quant à l’idée d’ouvrir le CPA aux personnes retraitées, elle me laisse dubitative car, comme son nom l’indique, il s’agit d’un compte d’activité, qui a bien vocation à être fermé à un moment donné.
Mme Monique Iborra. Il n’est jamais simple de préciser le contenu et le périmètre d’un nouveau droit. Cela dit, nous avons bien compris que la création du CPA devait se concevoir comme un premier pas, représentant pour un certain nombre de bénéficiaires une importante ouverture de droits. Je sais que Jean-Patrick Gille, qui fait preuve d’un tropisme marqué pour les jeunes et les missions locales, accorde beaucoup d’importance à la Garantie Jeunes. Si l’on ne saurait lui donner tort, il ne faut pas oublier que les retraités sont d’anciens actifs : comment dénier à une personne ayant travaillé toute sa vie le droit de s’engager en tant que citoyen ? Pour ma part, je suis donc favorable à l’amendement.
M. Gérard Cherpion. La complexité qui préside à la création du compte personnel d’activité est censée se traduire, à terme, par une grande simplicité pour l’utilisateur du compte, qui doit pouvoir prendre connaissance facilement de la totalité des droits qu’il a acquis au cours de sa carrière, via le compte personnel de formation ou le compte d’engagement citoyen. Je suis favorable au compte d’engagement citoyen, qui sera à mon sens très utile pour récompenser les personnes assumant la fonction de tuteur dans le cadre de l’apprentissage, par exemple.
D’autres comptes, tels le compte de prévention de la pénibilité et, éventuellement, le compte épargne-temps, peuvent se trouver rattachés au CPA. En tout état de cause, nous devons veiller à le construire prudemment, car c’est un système nouveau et complexe – on ignore tout, par exemple, des possibilités de fongibilité à l’intérieur de ce compte. Pour ma part, je crois plus raisonnable de ne pas chercher à l’étendre au-delà de ce qui est prévu actuellement, c’est-à-dire au-delà de la carrière professionnelle. À l’heure où les demandeurs d’emploi sont plus nombreux que jamais, mieux vaut utiliser les droits acquis dans le cadre du CPA pour former les actifs à un nouvel emploi.
M. Jean-Patrick Gille. Alors que l’on s’apprête à enrichir le CPA en accordant des droits supplémentaires aux personnes les moins bien formées, en particulier les jeunes, il n’est pas fait mention, dans l’article 21, de financements supplémentaires. Si l’on ouvre le CPA à 16 millions de retraités, ils vont le mettre à profit pour accéder à des formations de bénévoles alimentées par le compte d’engagement citoyen, mais dont le financement sera pris sur la masse globale de crédits affectés au CPA : autant d’argent qui ne sera plus disponible pour les autres publics.
Loin de moi l’idée de vouloir opposer les générations, mais il me semble que nous ne devons pas perdre de vue que ce texte relatif au travail et à l’emploi est censé nous permettre d’adapter le droit du travail et la vie des travailleurs aux nouveaux modes d’organisation du travail, caractérisés par la multiplication des contrats successifs, donc des transitions professionnelles. C’est ainsi que je vois ce compte : comme un moyen de sécuriser les transitions professionnelles, en permettant de capitaliser du temps et éventuellement des financements durant les périodes d’activité, pour les retrouver et les mettre à profit en se formant au cours des périodes de non-activité. En élargissant d’un coup le CPA à 16 millions de personnes supplémentaires sans prévoir les crédits correspondants, nous détournons cet outil de son objectif initial et allons au-devant de sérieuses difficultés.
M. le rapporteur pour avis. J’attire votre attention sur le fait que le compte d’engagement citoyen est défini, aux termes mêmes du texte, par le fait que les activités bénévoles ou de volontariat sont recensées dans le cadre du traitement de données à caractère personnel. L’article 21 fait mention des « activités de bénévolat associatif, lorsqu’elles comportent la participation à l’organe d’administration ou de direction d’une association ». Enfin, cet article précise que la mobilisation des heures mentionnées à l’article L. 5151-10 est financée par l’État, par la commune ou par l’établissement public chargé de la gestion de la réserve sanitaire, en fonction de la nature des activités : le financement est donc bien prévu, en provenance si ce n’est en volume.
Il me paraît difficilement concevable que le CPA soit soldé au moment de partir à la retraite, alors que l’on a cumulé des heures d’engagement citoyen donnant droit à formation et que l’on va justement avoir le temps de suivre des formations – que ce soit à tenir la trésorerie ou à assumer la responsabilité juridique d’une association, toutes choses que l’on n’a pas eu le temps de faire durant sa vie active. À mon sens, il est donc tout à fait cohérent avec l’esprit du texte d’ouvrir le CPA à la période postérieure au départ à la retraite.
M. Arnaud Richard. C’est une très bonne idée, mais il faut se préoccuper de savoir où l’on va. Le dossier médical personnel (DMP), auquel tout le monde à l’époque était très favorable a été un fiasco, et même un scandale d’État, dans lequel ont été englouties d’énormes sommes d’argent public. Essayons de ne pas reproduire la même chose. Chacun, à terme, souhaitera être dans le CPA. Il faut donc procéder par étapes et ne pas sous-estimer les conséquences pour le modèle social français. Je ne suis pas certain qu’il soit pertinent d’inclure dès à présent l’engagement citoyen, même si c’est assez habile en termes de marketing ; il aurait mieux valu commencer par tout ce qui concerne le travail.
M. le rapporteur. Nous créons un noyau dur, qui a vocation à accueillir plus tard d’autres éléments que ceux que nous y mettons aujourd’hui.
Nous posons la question du moment où le compte doit être fermé. Ce compte est conçu pour être une plateforme d’accès aux droits sociaux ; si la fermeture a lieu au moment du départ à la retraite, cela signifie qu’à l’âge de la retraite la personne se verra fermer l’accès à une information sur ses propres droits.
La Commission adopte l’amendement.
Elle examine ensuite l’amendement AS886 de la commission des affaires économiques.
M. le rapporteur pour avis. Cet amendement, corollaire du précédent, prévoit la fermeture du CPA au décès de la personne.
Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement.
Elle examine ensuite l’amendement AS1008 du rapporteur.
M. le rapporteur. Il s’agit de supprimer les mots « sauf disposition contraire ». Notre volonté est en effet de garantir la pleine portabilité des droits acquis sur le CPA. Or la rédaction actuelle laisse penser que certains de ces droits peuvent être annulés par une autre disposition du texte, ce qui n’est pas le cas. C’est pour lever cette ambiguïté que j’ai déposé l’amendement.
La Commission adopte l’amendement.
Puis elle en vient à l’amendement AS887 de la commission des affaires économiques.
M. le rapporteur pour avis. Il s’agit de renommer les différents comptes, et en particulier d’employer l’expression « compte d’engagement citoyen » plutôt que « compte engagement citoyen ».
M. le rapporteur. Favorable, sous réserve d’une rectification supplémentaire. Le nom exact du compte visé au troisième alinéa est « compte personnel de formation ».
M. Christophe Cavard. Je profite de cet amendement pour m’émouvoir de ce que trois de nos amendements, relatifs à l’intégration du compte épargne-temps, ont été déclarés irrecevables au titre de l’article 40 de la Constitution. Sur les trois, deux mentionnaient des dates d’entrée en vigueur, ce qui peut entraîner, je l’admets même si c’est discutable, des conséquences financières, notamment fiscales, mais le troisième se bornait à préconiser une mise en œuvre « au plus tôt ». Je ne comprends pas que de tels amendements ne puissent franchir l’obstacle de l’article 40, alors que 16 millions de retraités viennent de « débarquer » dans le CPA. Je représenterai ces amendements en séance et j’espère que nous en débattrons.
M. Gilles Lurton. Comme M. Cavard, j’ai déposé des amendements qui ont été déclarés irrecevables, et je ne vois pas la différence avec ceux que nous venons d’adopter.
Mme la présidente Catherine Lemorton. Adressez-vous au président Carrez…
Monsieur le rapporteur pour avis, acceptez-vous la rectification proposée par le rapporteur ?
M. le rapporteur pour avis. Oui.
M. Jean-Patrick Gille. Comme Christophe Cavard, j’ai déposé un amendement sur le compte épargne-temps (CET) et je fais miennes ses remarques.
Le CET n’est pas un compte qui viendrait s’ajouter aux autres ; c’est sans doute le plus important de tous, car c’est celui qui est susceptible de donner du sens au CPA. L’enjeu est d’offrir aux actifs la possibilité de gérer leur vie professionnelle. Le monde du travail, le contrat de travail lui-même, sont en train d’évoluer ; il faut permettre aux salariés de retrouver la maîtrise de leur vie professionnelle en s’appuyant sur une gestion différente des temps.
C’est le même mouvement qu’il y a un siècle dans le domaine la santé. Les salariés avaient une mutuelle ou n’en avaient pas, selon l’entreprise où ils travaillaient, puis la sécurité sociale a été créée au lendemain de la Libération : la couverture santé se trouvait ainsi transférée sur un compte externalisé. Il est essentiel de faire la même chose pour le compte épargne-temps. Ce n’est pas difficile, des entreprises ont déjà choisi de l’externaliser, en le faisant gérer par la Caisse des dépôts et consignations.
La Commission adopte l’amendement tel qu’il vient d’être rectifié.
En conséquence, les amendements AS145 de M. Yannick Moreau, AS80 de M. Lionel Tardy, AS91 de M. Patrick Hetzel, AS166 de M. Gérard Cherpion, AS464 de M. Alain Tourret et AS591 de M. Bernard Perrut tombent.
La Commission examine l’amendement AS1009 du rapporteur.
M. le rapporteur. Cet amendement vise à inscrire dans la loi le principe de fongibilité des droits. La capacité du CPA à sécuriser le parcours professionnel et à faciliter les transitions entre métiers ou entre statuts repose sur deux principes clés : la portabilité des droits, inscrite à l’alinéa 16 du présent article, et leur fongibilité, non explicitée par la rédaction actuelle. L’amendement corrige ce silence de la loi en mentionnant la vocation du CPA à permettre la conversion des droits d’un compte à un autre.
M. Jean-Patrick Gille. C’est là, en effet, la seconde dimension du compte, qui ne peut se contenter d’être une juxtaposition des comptes existants. La fongibilité, cependant, ne peut être totale ni dans tous les sens, comme cela semble être le cas dans la rédaction de l’amendement. Elle doit plutôt aller dans le sens de la formation ; c’est ce qui a été fait dans le cadre du compte personnel de prévention de la pénibilité. Je pense que les règles de la fongibilité nécessitent une renégociation par les partenaires sociaux.
M. Gérard Cherpion. Si fongibilité il doit y avoir, elle doit s’organiser selon des règles. Si, demain, le CET est inclus dans le système, nous verrons l’inverse de ce qui est recherché, à savoir des départs en retraite plus précoces, alors que la vocation du CPA est de favoriser l’activité.
M. Bernard Accoyer. La complexité du CPA, tel qu’il se présente, est un problème majeur, qu’aggrave encore l’inclusion du compte personnel de prévention de la pénibilité. Vous mélangez des choses qui n’ont ni le même objectif ni la même logique. Ce sera totalement inapplicable.
Mme Isabelle Le Callennec. J’essaie de comprendre ce que sera le CPA. L’alinéa 8 de l’article dispose que : « Le titulaire du compte personnel d’activité décide de l’utilisation de ses droits dans les conditions définies par le présent chapitre, le chapitre III du titre II du livre III de la sixième partie ainsi que le chapitre II du titre VI du livre Ier de la quatrième partie du présent code. » Pourrait-on, avant même de parler de fongibilité, avoir une définition claire des droits associés à ce compte ? J’ai compris qu’il y avait des droits à la formation ; y en a-t-il d’autres ? Lorsque nous travaillons pour essayer d’améliorer le code du travail, nous avons parfois besoin d’éclaircissements, face à ce genre d’alinéas.
M. le rapporteur. Je pensais que c’était évident. Cela couvre le compte personnel de formation, le compte personnel de prévention de la pénibilité et le compte d’engagement citoyen. L’objet de mon amendement est d’inscrire dans la loi le principe de fongibilité, sans toucher aux modalités prévues par chacun des comptes. M. Gille a raison de dire que les partenaires sociaux devront participer à cette réflexion. Le débat sur la modulation de la fongibilité est important, mais l’amendement ne traite pas cette question.
Mme Le Callennec cherche à donner du texte l’image d’une incroyable complexité, mais ce n’est pas la première fois qu’une loi renvoie à des articles de code et je n’ai jamais vu que cela surprenne un parlementaire.
M. Arnaud Richard. Le CPA est l’expression d’une utopie universaliste plutôt sympathique, mais un feu follet tout de même, à l’image de ce que la gauche peut produire. Son impact, à terme, sera la déconnexion des droits sociaux du contrat de travail. Si le compte de prévention de la pénibilité et le CPF sont solvabilisés, en revanche le compte d’engagement citoyen, pour enthousiasmant qu’il soit, ne donne pas lieu à des financements liés au contrat de travail.
Mme la présidente Catherine Lemorton. Monsieur Richard, je vous rappelle que le DMP dont vous parliez tout à l’heure a été lancé par la droite en 2004, pour un coût approchant le milliard d’euros. Avant que le CPA nous coûte un milliard, nous avons de la marge !
M. le rapporteur pour avis. Le compte d’engagement citoyen est une très belle idée. Une personne qui a été président ou trésorier d’une association pendant dix ans, par exemple, pourra justifier de mille heures d’engagement citoyen. Il faut, comme le propose le rapporteur, une clé de conversion : mettons que cela ouvre droit à 200 heures de formation. L’État finance aujourd’hui les formations de bénévoles : les financements existent déjà, c’est leur allocation qui sera différente. Du fait de la fongibilité, ces 200 heures pourront être consacrées à une formation dans le cadre de l’engagement citoyen – ou, par exemple, à une formation en BTS d’électromécanique si la personne a décidé de changer d’orientation professionnelle.
M. Élie Aboud. Nous ne sommes pas contre le CPA, mais il faut le construire de manière progressive. Le 3 mars, le Conseil d’État a annulé le financement du compte personnel de prévention de la pénibilité. Il faut modérer la cadence et ne pas tout mélanger.
M. Gérard Cherpion. La fongibilité peut être un danger. Une étude du Centre d’observation économique et de recherches pour l’expansion de l’économie et le développement des entreprises (COE-REXECODE) en date du 28 janvier montre plusieurs difficultés inhérentes au compte de prévention de la pénibilité. Celui-ci est financé par un système de double cotisation : à compter du 1er janvier 2017, les entreprises seront redevables d’une cotisation de 0,01 %, celles en mono-exposition de 0,2 %, et celles en poly-exposition de 0,4 %. Ces cotisations fourniraient quelque 270 millions d’euros de recettes annuelles, soit des recettes inférieures aux besoins de financement dès 2025. Si nous en restons à ce système, de deux choses l’une : ou bien l’on augmente les cotisations, qui pourraient, pour couvrir les besoins de financement, aller jusqu’à 6 %, ou bien l’on reste au même niveau, et la fongibilité sera à sens unique et ne servira qu’à remplir ce compte pénibilité. Le risque de la fongibilité est que l’un des comptes absorbe tout.
La Commission adopte l’amendement.
Elle adopte ensuite successivement les amendements rédactionnels AS844 et AS873 du rapporteur.
Puis elle examine l’amendement AS1010 du rapporteur.
M. le rapporteur. Plusieurs dispositifs étant regroupés dans le CPA, il est nécessaire d’assurer la cohérence des différents systèmes d’information. C’est un préalable à la conversion des droits et à l’appropriation du dispositif par les titulaires du compte. Aussi cet amendement vise-t-il à provoquer la négociation d’une convention entre la Caisse des dépôts et consignations (CDC), qui gère le compte personnel de formation (CPF), et la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS), en charge du compte personnel de prévention de la pénibilité.
Mme Isabelle Le Callennec. Nous avons tous en mémoire le régime social des indépendants (RSI), dont la création a donné lieu à une fusion de caisses : comme les systèmes informatiques étaient incompatibles, il s’en est suivi les difficultés que nous connaissons. Les systèmes informatiques de la CDC et de la CNAVTS sont-ils compatibles ?
M. le rapporteur. Ce sera tout l’enjeu de la convention.
Mme Isabelle Le Callennec. Eh bien, bonne chance !
La Commission adopte l’amendement.
Elle examine ensuite l’amendement AS85 de M. Patrick Hetzel.
M. le rapporteur. Avis défavorable. Chaque titulaire d’un CPA aura un identifiant unique, qui lui donnera accès à plusieurs services, dont l’information sur ses droits sociaux. Les modalités d’accès à ces services relèvent de la mise en œuvre opérationnelle du CPA ; elles sont au cœur des actuels travaux de la CDC.
La Commission rejette l’amendement.
Puis elle étudie l’amendement AS199 de M. Philip Cordery.
M. Philip Cordery. La plateforme de services en ligne sera un vecteur d’information pour le salarié, notamment sur ses droits sociaux. Ce dernier concept étant assez vaste, je propose de préciser que ces droits incluent la protection sociale et la retraite.
M. le rapporteur. Ces droits recouvrent par définition l’ensemble des droits ouverts par notre système de protection sociale, y compris ceux relatifs à l’assurance vieillesse. Il me semble donc que votre demande est satisfaite.
L’amendement est retiré.
La Commission examine l’amendement AS888 de la commission des affaires économiques.
M. le rapporteur pour avis. Le texte prévoit que le CPA fournit à son titulaire une information sur ses droits sociaux. Mon amendement vise à ce que le titulaire puisse également les simuler.
M. le rapporteur. Avis favorable. Nous avons vu, à propos de la prime d’activité, qu’un simulateur contribue à une meilleure connaissance du dispositif, ainsi qu’à une simplification de celui-ci.
Mme Isabelle Le Callennec. La simulation sera-t-elle possible à la fois sur les droits ouverts par les trois comptes et – je me réfère à la discussion sur l’amendement précédent – sur ceux relatifs à la protection sociale et aux retraites ?
M. Jean-Patrick Gille. Je ne crois pas du tout au compte qui va gérer tous les comptes. Si, en plus, nous rajoutons la Sécu et la retraite, ça ne marchera jamais. Et quand bien même cela marcherait, je redoute ce monde orwellien !
M. Bernard Accoyer. L’intervention de M. Gille est frappée au coin du bon sens. Cet article relatif au CPA est le fruit de mutations importantes par rapport au texte initial, et l’improvisation conduit à des opérations hasardeuses. Vous mélangez des unités qui n’ont rien à voir entre elles, et dont certaines n’ont même plus d’existence réelle après l’annulation des financements par le Conseil d’État, tandis que d’autres sont contestées de manière frontale par ceux qui doivent les appliquer. Et vous arrivez à présent avec la fée numérique, censée produire une plateforme magique où les salariés pourront voir tous leurs droits. Cela me rappelle fortement le DMP, dont on a rappelé le coût exorbitant et l’échec retentissant.
M. Arnaud Richard. Votre intention, monsieur le rapporteur pour avis, est tout à fait louable. Cependant, le CPA, dispositif complexe, n’est pas encore mis en œuvre, si bien que votre idée ne trouvera à s’appliquer que dans trois à quatre ans. Nous sommes en train de procéder à la disruption du modèle social français qui, somme toute, ne fonctionne pas si mal.
En outre, je partage les inquiétudes de M. Gille sur l’émergence d’un Big Brother contenant toutes les informations relatives à chacun d’entre nous.
M. le rapporteur. Il y a là une vraie confusion : personne n’a jamais dit que tous les droits seraient placés dans le CPA. Il existera une plateforme d’accès aux éléments comme ceux de l’assurance vieillesse, qui sont distincts des droits du CPA, qui rassemble trois comptes. Le texte ne présente aucun risque de création d’un Big Brother.
La Commission adopte l’amendement.
Puis elle examine, en discussion commune, les amendements AS1011 du rapporteur et AS889 de la commission des affaires économiques.
M. le rapporteur. Cet amendement vise à instaurer la consultation du bulletin de paie dématérialisé depuis le CPA. Le terme de consultation s’avère plus adapté à l’objectif du dispositif, qui n’est pas de transférer à l’État la responsabilité de la conservation du bulletin de paie. Les obligations de l’employeur de conserver les bulletins de paie sont maintenues, et le salarié pourra accéder à ses bulletins de paie dématérialisés à partir de la plateforme.
M. le rapporteur pour avis. Je retire mon amendement au profit de celui du rapporteur.
Mme Isabelle Le Callennec. L’alinéa 22 précise que la plateforme de services en ligne donne au titulaire d’un compte « accès à un service de conservation de ses bulletins de paie lorsqu’ils ont été transmis par l’employeur (…) ». Ce dernier ayant l’obligation d’assurer cet accès, a-t-on mesuré l’impact de cette contrainte pour les entreprises dépourvues de direction des ressources humaines ?
M. le rapporteur. La réponse se trouve à l’article 24 du projet de loi.
M. Bernard Accoyer. Portant une grande attention au respect des engagements pris par le président de la République, je m’inquiète de la façon dont vous allez insérer le prélèvement de l’impôt à la source dans votre amendement, monsieur le rapporteur…
M. le rapporteur. Les règles d’établissement du bulletin de paie et des circuits de paiement n’étant pas modifiées, votre question n’a pas d’objet, monsieur Accoyer…
L’amendement AS889 est retiré.
La Commission adopte l’amendement AS1011.
Puis elle étudie l’amendement AS890 de la commission des affaires économiques.
M. le rapporteur pour avis. Cet amendement propose de compléter l’alinéa 22 par la phrase suivante : « Ce service garantit l’intégrité, la disponibilité et la confidentialité de ces documents ».
Mme Isabelle Le Callennec. Monsieur le rapporteur, j’ai lu l’article 24, où il est écrit que « sauf opposition du salarié, l’employeur peut procéder à la remise du bulletin de paie sous forme électronique » ; or vous m’avez dit qu’il ne s’agissait pas d’une possibilité, mais d’une obligation.
M. le rapporteur. Monsieur le rapporteur pour avis, je partage vos objectifs, car l’accès au bulletin de paie dématérialisé sur le CPA est conditionné aux trois garanties d’intégrité, de confidentialité et de disponibilité des données, inscrites à l’article L. 3243-2 du code du travail, mentionné à l’alinéa 22. Votre proposition se trouve déjà satisfaite, et je vous suggère donc de retirer votre amendement.
Madame Le Callennec, l’employeur a l’obligation de rendre accessible le bulletin de salaire dématérialisé.
Mme la présidente Catherine Lemorton. Le salarié peut refuser le transfert dématérialisé mais s’il y a un tel transfert, l’accessibilité est obligatoire.
L’amendement est retiré.
La Commission est saisie de l’amendement AS689 de M. Jean-Patrick Gille.
M. Jean-Patrick Gille. Nous souhaitons proposer aux partenaires sociaux d’engager, d’ici à la fin de l’année, une négociation visant à élargir le CPA à l’assurance chômage. Mes amendements AS699 et AS701 sont semblables, et concernent respectivement le compte épargne-temps (CET) et l’assurance retraite. Il convient cependant de ne pas aller plus loin, et je m’oppose au développement d’un compte englobant toute la protection sociale. Seules les matières relevant de l’activité salariée devraient être intégrées au CPA.
M. le rapporteur. Je partage totalement votre propos, monsieur Gille : le CPA repose sur trois piliers et a vocation, dans un délai à préciser, à accueillir d’autres éléments. Pourraient en effet figurer parmi ceux-ci l’assurance chômage, l’assurance vieillesse, le CET et d’autres composantes. Ne souhaitant pas dresser une liste limitative, j’ai déposé un amendement précisant l’esprit de cet élargissement du CPA. Je vous propose de retirer vos trois amendements au profit du mien.
Mme Isabelle Le Callennec. Cet élargissement diffère de ce que prévoyait la loi du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi, dite loi Rebsamen, et la mise en œuvre de ce que vous proposez ne peut qu’inquiéter. Avons-nous réuni autour d’une table l’ensemble des institutions gérant ces droits sociaux avant d’avancer de telles suggestions ?
On a déjà créé le CPA sans le définir, et je vous entends souvent dire que les partenaires sociaux se saisiront de tel ou tel sujet, si bien qu’ils finissent par être saturés. Ils éprouvent des difficultés à conclure la renégociation de l’assurance chômage, attendue pour le mois de juin. Il faut arrêter de leur charger la barque !
M. Philip Cordery. Je soutiens l’esprit de ces trois amendements et me rallierai à celui de notre rapporteur. J’avais déposé un amendement élargissant le CPA au CET, mais il s’est heurté à l’article 40 de la Constitution.
Le CPA constitue à mes yeux le cœur de la loi, car il organise la sécurisation des parcours professionnels et la flexisécurité, l’objectif étant d’assurer aux salariés un temps utile et bref entre deux emplois. La négociation représente la seule méthode envisageable pour élargir le CPA, comme il en a la vocation.
Mme Monique Iborra. Il reste à définir clairement avec le Gouvernement la nature du CPA, pour le présent et pour l’avenir. M. Gille réserve essentiellement ce compte aux salariés, mais que deviendra, demain, le salariat ? Ce texte s’adresse aux citoyens, si bien que le Gouvernement doit choisir entre une conception proche de celle de M. Gille et une autre, différente, s’attachant à faire de ce compte un projet de société.
Mme Isabelle Le Callennec. Madame Iborra, le titre du projet de loi apporte la réponse à votre question, puisqu’il emploie le terme d’« actifs ». Le CPA s’adresse donc aux actifs.
Mme la présidente Catherine Lemorton. Lors de la présentation du rapport de France Stratégie sur le CPA, il est clairement apparu que le compte s’adressait à tous les citoyens, y compris les indépendants et les auto-entrepreneurs. Tous les actifs sont donc concernés.
M. Arnaud Richard. Je suis heureux que Mme Iborra ait enfin compris la difficulté de l’exercice, pour rester diplomate… Le modèle social français repose sur le travail, et l’on souhaite le bâtir sur l’engagement ou sur l’universalisme. Je doute que cela puisse être durable.
M. Christophe Cavard. Le CPA s’adresse à un public large et, lors de la rencontre à laquelle Mme la présidente a fait allusion, M. François Soulage avait souhaité, comme M. Gille ce soir, qu’il englobe d’autres comptes. Il importe d’élargir le CPA à l’assurance chômage, afin de donner corps à la sécurité sociale professionnelle et de l’adosser à un parcours citoyen. Cette évolution soulève la question de la gestion, aujourd’hui paritaire, d’un tel dispositif. M. le rapporteur a déposé un amendement prévoyant une date d’ouverture des négociations, et il convient d’avancer rapidement pour que le CPA offre de nouveaux droits aux citoyens.
M. Jean-Patrick Gille. Je retire l’amendement ainsi que les suivants, mais j’aurais préféré que celui déposé par le rapporteur après l’article 21 soit plus précis et cite les différents domaines que le CPA pourrait englober.
Les amendements AS689, AS699 et AS701 sont retirés.
La Commission adopte l’amendement rédactionnel AS845 du rapporteur.
Puis elle étudie l’amendement AS891 de la commission des affaires économiques.
M. le rapporteur pour avis. La rédaction actuelle de l’alinéa 39 de l’article 21 s’avère complexe, puisqu’elle propose que les activités bénévoles pouvant créditer le compte d’engagement citoyen se fassent dans le cadre d’associations, dont un arrêté des ministres chargés de la vie associative et de la formation professionnelle, pris après avis du Haut Conseil à la vie associative (HCVA), dressera la liste. Or la grande diversité des associations qui, parmi les quelque 1,8 million d’associations qui existent en France, sont reconnues d’intérêt général au sens de la jurisprudence fiscale, rend très délicate la constitution, puis la tenue actualisée, de cette liste. Je propose donc de conserver le champ défini par l’article 74 de la loi du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire, qui permet de retenir, outre la qualification d’intérêt général, un critère d’ancienneté de l’association, fixé à trois ans minimum.
M. le rapporteur. Je partage votre objectif, mais l’amendement présente l’inconvénient de limiter le dispositif aux seules associations créées depuis au moins trois ans. Je vous suggère donc que nous le réécrivions avec le Gouvernement d’ici à la séance publique.
M. Philip Cordery. On pourrait intégrer les nombreuses associations comptant des éducateurs sportifs, car il ne faudrait pas restreindre le compte d’engagement citoyen aux seuls dirigeants d’association. Les éducateurs sportifs encadrent les jeunes et mériteraient de gagner des points pour leur formation. Je souhaiterais que l’on évoque ce sujet lors de la séance publique, mon amendement s’étant vu opposer l’article 40 de la Constitution.
M. Gilles Lurton. Je m’interroge sur la liste prise par arrêté des ministres chargés de la vie associative et de la formation professionnelle. Comment sera définie cette liste ? Que comprendra-t-elle ? C’est très flou.
M. le rapporteur. L’article 200 du code général des impôts (CGI) dresse la liste des organismes d’intérêt général.
M. le rapporteur pour avis. En effet. Mon amendement intègre les associations bénéficiant de la petite capacité, qui correspond à des capacités fiscales améliorées, et celles jouissant d’une certaine solidité car existant depuis au moins trois ans. Ce dernier critère offre une garantie et évite l’effet d’opportunité. Nous pouvons réécrire cet amendement, monsieur le rapporteur, mais je tiens à le maintenir puisqu’il a déjà passé l’obstacle de l’article 40 de la Constitution.
M. le rapporteur. Il présente d’autres difficultés et devra vraiment être amélioré, mais, étant d’accord avec son objet, j’émets un avis favorable à son adoption.
La Commission adopte l’amendement.
Puis elle étudie l’amendement AS892 de la commission des affaires économiques.
M. le rapporteur pour avis. Je retire cet amendement, puisqu’un vote précédent l’a satisfait, en permettant que les heures inscrites pour le temps citoyen puissent être transcrites dans une unité de compte de formation.
L’amendement est retiré.
Elle examine ensuite l’amendement AS893 de la commission des affaires économiques.
M. le rapporteur pour avis. Cet amendement vise à rappeler que l’on ne peut pas échanger des droits acquis au titre du compte d’engagement citoyen contre des congés possédant les mêmes caractéristiques. Les congés de formation demeurent, indépendamment de ce que l’on peut capitaliser dans le compte d’engagement citoyen.
Mme Isabelle Le Callennec. Je voudrais que l’on me confirme que les droits du compte d’engagement citoyen ne peuvent que s’ajouter à ceux qui existent.
M. le rapporteur pour avis. Mon amendement précise que les droits capitalisés au titre du compte d’engagement citoyen ne peuvent pas se substituer à des droits déjà existants.
M. le rapporteur. Je partage l’esprit de votre amendement, mais il ne vise que ce congé spécifique et peut donner l’impression d’exclure les autres types de congé du dispositif. Je vous demande de retirer votre amendement.
L’amendement est retiré.
La Commission adopte l’amendement rédactionnel AS846 du rapporteur.
Puis elle se penche sur l’amendement AS894 de la commission des affaires économiques.
M. le rapporteur pour avis. Il s’agit de remplacer, à la seconde phrase de l’alinéa 46, le mot « sont » par « peuvent être », afin que le titulaire du compte d’engagement citoyen reste libre de décider des activités qu’il souhaite y recenser.
M. le rapporteur. Cette précision rédactionnelle présente l’avantage de soutenir la liberté d’utilisation du CPA et, par conséquent, du compte d’engagement citoyen. Cependant, l’alinéa 28 prévoit que le compte recense les activités bénévoles et permet d’acquérir des jours de congé accordés par l’employeur pour effectuer ces activités. Ces dernières ont donc vocation à figurer dans le compte d’engagement citoyen ; si tel n’était pas le cas, ces dispositions n’auraient pas leur place dans la section de l’article consacrée à ce compte. Je vous suggère donc, monsieur Blein, de retirer l’amendement.
M. le rapporteur pour avis. L’alinéa 32 de l’article 21 précise bien que le titulaire du compte décide des activités qu’il souhaite y recenser. Il s’agit d’une possibilité et non d’une obligation.
M. Jean-Patrick Gille. Que met-on finalement dans le compte d’engagement citoyen ?
M. le rapporteur. Monsieur Gille, le texte est précis : le titulaire du compte décide des activités qu’il veut voir inscrites dans le compte d’engagement citoyen ; il en a donc la possibilité, et rien n’est automatique.
Le texte dresse la liste des activités bénévoles ou de volontariat permettant d’acquérir des heures pour le compte personnel de formation, à savoir le service civique, la réserve militaire, la réserve communale de sécurité civile, la réserve sanitaire, l’activité de maître d’apprentissage et les activités de bénévolat associatif.
M. le rapporteur pour avis. J’accepte de retirer mon amendement pour le retravailler.
L’amendement est retiré.
La Commission adopte l’amendement rédactionnel AS847 du rapporteur.
Puis elle aborde l’amendement AS895 de la commission des affaires économiques.
M. le rapporteur pour avis. Mon amendement vise à encourager les employeurs à offrir des jours de congés payés pour les activités bénévoles, en leur accordant les mêmes avantages fiscaux que pour les dons et le mécénat d’entreprise ; les employeurs pourront ainsi déduire partiellement le coût financier de ces congés de leur impôt sur les sociétés (IS). Cette mesure renforcera l’attractivité du dispositif.
M. le rapporteur. L’amendement me pose un problème philosophique, car son adoption aurait pour effet de créer une niche fiscale et de faire entrer l’engagement du compte d’engagement citoyen dans une logique marchande.
M. le rapporteur pour avis. Les entreprises font du mécénat, notamment de compétences, et font aussi des dons qu’elles déduisent de leur impôt. Quel employeur aura la générosité d’accorder des jours de congés payés pour des activités bénévoles ? Comme il s’agit d’une charge pour lui, je propose qu’il puisse la déduire de son IS en assimilant cette faculté à un don ou à du mécénat.
Mme la présidente Catherine Lemorton. Certaines entreprises privées possèdent des fondations, et un salarié d’une société pourrait être mis à la disposition d’une de ces structures. J’ai des doutes quant à l’opportunité d’adopter l’amendement.
M. le rapporteur. Qu’une entreprise puisse utiliser le mécénat dans un esprit philanthropique tout en en bénéficiant d’un avantage fiscal, dont acte ! En revanche, je suis opposé à ce que l’on attribue une déduction fiscale en échange de jours de congé.
M. Michel Issindou. L’idée est généreuse, mais me paraît bien difficile à appliquer. Je rappelle que nous avons examiné récemment une proposition de loi de M. Favennec qui visait à valoriser l’engagement associatif en octroyant aux personnes concernées des trimestres complémentaires lors du calcul de leur retraite, et que nous avons rejeté ce texte au motif, notamment, qu’un tel engagement est essentiellement bénévole. Or, il me semble que cet amendement présente le même travers. Je comprends que l’on souhaite compléter le contenu du CPA, qui est une belle idée, mais tenons-nous en, pour l’instant, aux trois piliers prévus dans le texte et évitons d’y inclure des dispositifs trop complexes. Le groupement d’intérêt public (GIP) Info-retraites, qui permettra de calculer l’ensemble des droits acquis par les salariés du privé au cours de leur carrière professionnelle, est si difficile à mettre sur pied qu’il ne pourra pas être opérationnel au 1er janvier 2017, comme le prévoyait la loi. Le numérique ne permet pas tout… Je suis donc assez réservé sur cet amendement – qui, en outre créerait une dépense fiscale supplémentaire –, même si, encore une fois, je comprends l’initiative de M. Blein.
M. Arnaud Richard. Soudain, M. Issindou découvre que le compte d’engagement citoyen ne repose sur rien, ou plutôt sur le seul engagement et non sur le travail, qui fonde notre modèle social. Vous allez donc casser tout ce qui fonctionne bien dans notre pays, même si je comprends que l’idée d’un tel compte soit enthousiasmante.
Par ailleurs, je tiens à préciser à M. Cordery que l’activité des éducateurs sportifs n’entre pas dans le champ du compte d’engagement citoyen tel qu’il a été très précisément décrit par le rapporteur.
Mme Isabelle Le Callennec. Nous nous éloignons de l’objectif du projet de loi qui, comme son titre l’indique, est de créer « de nouvelles libertés et de nouvelles protections pour les entreprises et les actifs ». Je me permets de rappeler que cette catégorie comprend, selon la définition de l’INSEE, les personnes pourvues d’un emploi, salarié ou non salarié, et les chômeurs. Le texte doit viser avant tout à sécuriser le parcours professionnel de ces personnes. Nous sommes tous d’accord pour valoriser le bénévolat et l’engagement citoyen, mais il serait plus pertinent de le faire dans le cadre du futur projet de loi « Égalité et citoyenneté ». Encore une fois, concentrons-nous sur les questions de transition et de mobilité professionnelle. En inscrivant la notion de compte d’engagement citoyen – qui est une bonne idée – dans un texte qui concerne les actifs et la sécurisation des parcours professionnels, nous nous créons des difficultés.
Mme Monique Iborra. Si chacun défend sa propre conception, différente de celle des auteurs du projet de loi, nous ne pourrons pas avancer. M. Gille et M. Cherpion indiquaient récemment – on semble l’avoir oublié – que l’on pouvait se poser la question de savoir si c’est aux partenaires sociaux qu’il appartient de gérer le compte personnel de formation. Il nous faut avancer, désormais : soit nous supprimons le compte d’engagement citoyen, et l’on assure ainsi une certaine cohérence, soit nous le conservons. Mais il nous faut maintenant passer à autre chose, car nous perdons beaucoup de temps.
M. le rapporteur pour avis. Je ferai observer que personne n’a déposé d’amendement visant à supprimer l’alinéa 46 ; j’en déduis qu’il n’est pas contesté. Or, il dispose que « l’employeur a la faculté d’accorder des jours de congés payés dédiés à l’exercice d’activités bénévoles ou de volontariat. » Si l’employeur use de cette faculté, il fait un don qui, comme tout autre don, qu’il prenne la forme de « cash » ou de mécénat de compétences, doit être déductible de l’impôt sur les sociétés de l’entreprise. Mon amendement vise uniquement à donner un contenu concret à cette disposition, car je ne vois pas quelle entreprise pourrait faire don de jours de congés payés sans ce type de contrepartie.
M. le rapporteur. Je n’ai pas du tout la même lecture que vous de l’alinéa 46 qui, selon moi, relève, non pas de la politique fiscale de l’entreprise, mais de sa politique sociale.
La commission rejette l’amendement.
Puis elle examine l’amendement AS896 de la commission des affaires économiques.
M. le rapporteur pour avis. Cet amendement est la conséquence de l’extension du CPA aux personnes retraitées.
M. le rapporteur. Il me semble qu’une telle mesure relève de la négociation entre les partenaires sociaux. Je vous suggère donc de retirer l’amendement. À défaut, j’y serai défavorable.
M. Bernard Accoyer. Il est tout de même assez étonnant que l’on revienne sur l’extension du CPA aux retraités, qui est hors sujet. C’est un cavalier !
L’amendement est retiré.
La Commission examine en discussion commune, les amendements AS1001 du rapporteur, AS113 de M. Gérard Cherpion et AS703 de M. Jean-Patrick Gille.
M. le rapporteur. L’amendement AS1001 est de clarification rédactionnelle.
M. Gérard Cherpion. L’article 21 élargit le champ d’éligibilité au compte personnel de formation (CPF) au bilan de compétences pour les personnes qui n’ont pas droit au congé de bilan de compétences mentionné à l’article L. 6322-42 du code du travail. Pour bénéficier de ce congé, le salarié doit en effet justifier d’une ancienneté en qualité de salarié d’au moins cinq ans, dont douze mois dans l’entreprise. Le dispositif proposé serait complexe à mettre en œuvre. Il est donc proposé, par l’amendement AS113, de rendre le bilan de compétences éligible au CPF pour tout salarié, quelle que soit son ancienneté.
M. Jean-Patrick Gille. Mon amendement a le même objet que celui de M. Cherpion. Je rappelle en effet que le texte limite l’extension de l’éligibilité au CPF du bilan de compétences aux personnes qui ne peuvent réaliser un tel bilan dans le cadre du congé individuel de formation (CIF).
M. le rapporteur. Je partage l’objectif de nos deux collègues. Toutefois, la rédaction de l’amendement AS113 n’étant pas compatible avec mon amendement AS1001, je suggérerais à M. Cherpion de le retirer.
M. Gérard Cherpion. Les deux amendements posent en effet un problème de rédaction. Il serait donc préférable que M. Gille et moi-même les retirions et les redéposions en vue de la discussion en séance publique.
Les amendements AS113 et AS703 sont retirés.
La Commission adopte l’amendement AS1001.
Puis elle examine, en discussion commune, les amendements AS1002 du rapporteur et AS114 de M. Gérard Cherpion.
M. le rapporteur. L’amendement AS1002 est de clarification rédactionnelle.
M. Gérard Cherpion. L’article 21 du projet de loi élargit le champ d’éligibilité au CPF aux formations dispensées aux créateurs ou repreneurs d’entreprises. L’accompagnement des entrepreneurs en vue de la création ou de la reprise d’une entreprise consiste généralement dans des actions de formation, d’accompagnement, d’information et de conseil. Cet amendement vise à prendre en compte ces actions d’ores et déjà reconnues comme actions de formation entrant dans le champ de la formation professionnelle continue aux termes de l’article L. 6313-1 du code du travail.
M. le rapporteur. Il me semble que l’amendement AS114 serait satisfait par l’amendement AS1002.
M. Jean-Patrick Gille. Je pense que cette mesure mérite réflexion. À l’origine, étaient éligibles au CPF les actions qualifiantes, notamment la validation des acquis de l’expérience (VAE) et le socle de compétences. Nous venons d’y intégrer le bilan de compétences. Si nous y ajoutons l’ensemble des actions de conseil et de formation des créateurs d’entreprises, nous risquons de rendre payantes des actions qui jusque-là étaient gratuites. Je pense notamment à celles qui relèvent des chambres consulaires. Peut-être pourrions-nous limiter cette extension aux formations qualifiantes destinées aux créateurs d’entreprises. En tout cas, je ne suis pas certain qu’il faille rendre éligibles au CPF l’ensemble des actions de formation et de conseil.
M. Arnaud Richard. Je partage l’avis de M. Gille : n’intégrons pas dans le CPF tous les dispositifs existants. Ne soyons pas comme Christophe Colomb, qui ne savait pas où il allait, mais y allait tout de même – avec l’argent des autres…
L’amendement AS114 est retiré.
La Commission adopte l’amendement AS1002.
Puis elle examine l’amendement AS897 de la commission des affaires économiques.
M. le rapporteur pour avis. La loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale a permis d’établir que constituent des actions de formation les formations destinées à permettre aux bénévoles associatifs d’acquérir les connaissances nécessaires à l’exercice de leurs responsabilités associatives. Dans le cadre de la création du compte d’engagement citoyen, il semble légitime que les personnes qui assument des responsabilités associatives ou bénévoles puissent utiliser les points qu’elles possèdent au titre de ce compte afin de bénéficier de formations adaptées. Il s’agit donc de prévoir, dans des conditions fixées par décret, que ces formations seront bien accessibles via le CPF.
M. le rapporteur. Vous proposez, par cet amendement, d’étendre l’éligibilité du CPF à l’ensemble de ses titulaires. Ainsi ses financements seraient mobilisés plutôt que ceux dédiés au compte d’engagement citoyen. Cela pose problème, car les financements du CPF doivent être orientés en premier lieu vers la sécurisation des parcours professionnels.
M. Jean-Patrick Gille. Nous avons précisé tout à l’heure que les différents comptes n’étaient pas fongibles. Que se passera-t-il, si nous adoptons cet amendement ? Nous risquons de voir 16 millions de retraités demander que l’on finance leurs formations de bénévoles avec l’argent que nous sommes censés consacrer aux jeunes… Il y a un moment où il faut s’arrêter !
M. le rapporteur pour avis. Je vais illustrer ma proposition par un exemple. Pendant ma vie active, j’ai capitalisé, au titre du compte d’engagement citoyen, des heures de formation que je souhaite utiliser pendant ma retraite pour me former aux activités que j’exerce en tant que bénévole. Je ne vais pas les utiliser pour obtenir une qualification professionnelle, alors que je suis à la retraite.
M. le rapporteur. Je vous rappelle que le CPF est fermé lorsque le titulaire fait valoir ses droits à la retraite. Un retraité ne pourrait donc utiliser ces heures de formation que si nous avions tranché la question de la fongibilité, ce qui n’est pas le cas pour l’instant. En effet, j’ai bien indiqué tout à l’heure que nous reconnaissions le principe de la fongibilité sans modifier les règles de fonctionnement de chacun des comptes, cette fongibilité devant faire l’objet d’une réflexion avec les partenaires sociaux. Du reste, M. Cherpion et M. Gille ont bien précisé, à ce propos, que des clés de répartition devaient être définies.
M. Christophe Cavard. Je comprends l’objectif de la commission des affaires économiques et de son rapporteur pour avis. Nous savons que, dans le secteur de l’économie sociale et solidaire notamment, certains responsables d’associations se retrouvent employeurs de plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines, de salariés. Mieux vaut, en effet, que ces administrateurs bénévoles soient correctement formés. Mais n’oublions pas que le CPF a été créé essentiellement pour financer des formations dans le cadre d’un parcours professionnel. Il me semble donc qu’il serait plus pertinent d’aborder la question des moyens qui doivent être accordés aux bénévoles pour qu’ils puissent se former lors de l’examen du projet de loi « Égalité et citoyenneté ». Je soutiendrai cet amendement s’il est déposé sur cet autre texte.
M. le rapporteur pour avis. Je rappelle que l’alinéa 49 précise que le compte personnel de formation est ouvert et fermé dans les conditions définies à l’article L. 5151-2, c’est-à-dire dans les mêmes conditions que celles applicables au CPA, dont on a dit tout à l’heure qu’il serait fermé lors du décès de l’intéressé. Le CPF restera donc ouvert après la retraite de son titulaire. Certes, la question de la fongibilité se pose. Mais le projet de loi dispose que le compte d’engagement citoyen permet de capitaliser des heures de formation. Il faut bien que son titulaire puisse les consommer, y compris au-delà du temps de vie active, comme le permettent les amendements que nous avons adoptés. Je veux bien admettre que le dispositif mérite d’être simplifié, mais il y a là une vraie question.
M. Gérard Cherpion. Je suis inquiet de la tournure absurde que prend notre discussion. Un journaliste spécialisé dans les ressources humaines, qui suit notre débat, vient de laisser le message suivant sur un réseau social : « Donc, le CPA est fermé à la mort de son détenteur. Les descendants héritent des heures du CPF. » Et c’est un spécialiste qui écrit cela !
M. le rapporteur. Je déplore que nous laissions ce débat sur le compte personnel d’activité partir dans toutes les directions. Revenons-en au texte : le CPA est constitué d’un noyau dur composé de trois comptes. Deux d’entre eux existent déjà ; le troisième, le compte d’engagement citoyen, est nouveau. Que nous réfléchissions à la manière dont celui-ci doit se développer ne me paraît pas scandaleux, dès lors qu’il est créé par ce texte.
Ce qui est certain, c’est que nous voulons que le compte personnel d’activité s’appuie sur deux principes : celui de la portabilité, qui figure dans le texte, et celui de la fongibilité. Or, ce dernier principe pose problème, car, comme l’a indiqué M. Gille, nous ne devons pas, au motif qu’existe désormais le compte d’engagement citoyen, oublier l’objectif initial des deux autres comptes, qui ont vocation à accompagner leurs titulaires dans le cadre d’une formation professionnelle qu’ils suivent, par exemple, en vue d’une reconversion ou d’une réorientation. Nous devons donc veiller à ne pas créer un système de vases communicants sans aucune régulation qui serait préjudiciable aux objectifs que nous nous fixons.
Si j’ai indiqué à M. Blein que nous ne pouvions pas le suivre, c’est parce que les critères de la fongibilité doivent faire l’objet d’une discussion avec les partenaires sociaux. Je souhaiterais donc que l’on arrête de proposer de nouveaux dispositifs. Je proposerai d’ailleurs, dans un amendement que nous examinerons ultérieurement, que les partenaires sociaux se saisissent de nouveau de cette question. Nous ne pouvons pas, en effet, prétendre définir seuls le contenu du compte personnel d’activité, dès lors que certains éléments ont déjà été confiés aux partenaires sociaux par le législateur.
Nous avons tous beaucoup d’idées, mais, de grâce, n’oublions pas les fondamentaux du compte personnel d’activité ! Le compte d’engagement citoyen est une nouveauté et nous lui permettrons de jouer son rôle spécifique, mais nous ne pouvons pas le faire au détriment des autres objectifs.
L’amendement AS897 est retiré.
La Commission adopte l’amendement rédactionnel AS848 du rapporteur.
Puis elle examine l’amendement AS639 de Mme Catherine Coutelle.
Mme Chaynesse Khirouni. Le compte personnel de formation (CPF) est alimenté à hauteur de 24 heures par année de travail à temps complet jusqu’à l’acquisition d’un crédit de 120 heures, puis de 12 heures par année de travail à temps complet, dans la limite d’un plafond total de 150 heures. Pour les salariés à temps partiel, il est alimenté au prorata temporis. Or, outre le fait que les emplois à temps partiel sont occupés en grande majorité par des femmes – de sorte que cette règle crée une inégalité dans l’accès à la formation –, les salariés à temps partiel ont un besoin de formation identique à celui des salariés à temps complet. Nous proposons donc de sécuriser les parcours professionnels et de permettre une accélération du rythme d’acquisition des heures du compte personnel de formation pour les salariés à temps partiel en prévoyant que ces derniers bénéficient, en la matière, des mêmes droits que les salariés à temps complet.
M. le rapporteur. Vous souhaitez que le CPF soit alimenté à la même hauteur pour un salarié à temps plein et un salarié à temps partiel. Or, cela créerait une inégalité entre ces salariés puisqu’ils bénéficieraient du même nombre d’heures de formation, quel que soit leur temps de travail. En outre, cette mesure alourdirait considérablement la charge des entreprises. Je vous suggère donc de retirer votre amendement. À défaut, j’y serais défavorable.
Mme Chaynesse Khirouni. Je maintiens l’amendement, car je le défends au nom de la délégation aux droits des femmes. Il ne s’agit pas d’accorder un privilège aux salariés à temps partiel. Il ne me paraît pas aberrant que ceux-ci puissent bénéficier d’heures de formation supplémentaires pour acquérir des compétences et, éventuellement, accéder ainsi à un emploi à temps complet.
M. Jean-Louis Bricout. Le raisonnement de notre collègue n’est pas faux : deux salariés exerçant le même métier ont des besoins de formation identiques, qu’ils travaillent à temps complet ou à temps partiel. Mais il est certain que cette mesure aurait un coût important pour les entreprises.
M. le rapporteur. Personne ne conteste le besoin de formation des salariés à temps partiel, mais il faut bien mesurer la charge qui pèserait sur les entreprises si elles devaient alimenter à la même hauteur le CPF de leurs salariés à temps partiel et celui de leurs salariés à temps complet. Néanmoins, la question posée par Mme Khirouni est pertinente. On peut en effet s’interroger sur la manière dont les salariés à temps partiel pourraient bénéficier d’un accompagnement spécifique qui leur permette, par exemple, de s’orienter vers une branche professionnelle où ils auront plus de facilité à accéder à un emploi à temps complet. Mais, encore une fois, la mesure proposée créerait une trop grande insécurité.
La Commission rejette l’amendement.
Elle est ensuite saisie de l’amendement AS710 de M. Jean-Patrick Gille.
M. Jean-Patrick Gille. Pour un salarié travaillant à temps plein, le CPF est alimenté à hauteur de vingt-quatre heures par an, soit deux heures par mois. Dans le projet de loi, une avancée est prévue pour les personnes qui n’ont pas atteint le premier niveau de qualification – le niveau V –, c’est-à-dire celles qui ont le plus besoin de formation, car il leur est très difficile de trouver un emploi stable : leur compte sera crédité de quarante heures par an au lieu de vingt-quatre, et elles pourront bénéficier, au total, d’un capital de 400 heures. Je propose de faire passer ce crédit d’heures annuel de quarante à quarante-huit heures, soit quatre heures par mois, c’est-à-dire le double du cas général, ce qui a le mérite de la simplicité. Cela ferait environ une heure par semaine travaillée. Ce serait une petite avancée, toutefois notable, notamment pour les jeunes qui alternent travail et chômage.
M. le rapporteur. Je partage votre objectif. C’est une excellente idée. Cependant, de même que pour l’amendement précédent, l’impact financier de la mesure mérite d’être examiné. À cette fin, je vous invite à retirer votre amendement et à le présenter à nouveau, le cas échéant, en séance publique.
M. Jean-Patrick Gille. Nous avions eu le même débat lors de l’examen de la loi qui a créé le CPF. Or votre argument ne tient pas, monsieur le rapporteur : cette mesure ne crée de dépense supplémentaire ni pour l’État – sinon, l’amendement aurait été déclaré irrecevable au titre de l’article 40 de la Constitution –, ni pour les entreprises. On ne modifie pas les recettes, assises sur la contribution de 0,2 % de la masse salariale ; ce que l’on change, c’est la répartition des heures : on redistribue en faveur de ceux qui n’ont pas atteint le premier niveau de qualification. C’est bien ce que nous cherchons à faire depuis le début. D’autre part, l’amendement ne modifie pas le plafond de 400 heures.
M. Christophe Cavard. Je vous invite, chers collègues, à être attentifs à cette proposition. Nous sommes nombreux, sur tous les bancs, à avoir travaillé sur les questions relatives à la formation, notamment sur celle de son coût. En l’espèce, cette question ne se pose pas, puisqu’il y un plafond à 400 heures. Il s’agit simplement de faire en sorte que, pour ce public donné, le CPF arrive un peu plus vite au plafond.
Lors de la séance de présentation du CPA, un certain nombre de partenaires, notamment M. François Soulage, ancien président du Secours catholique, ont fait valoir la chose suivante : si nous voulons que le CPA soit une plus-value, en particulier pour les personnes non qualifiées, il faut que le droit à la formation soit mesurable tout de suite et accessible rapidement. Sinon, ce droit n’existera que sur le papier. Lesdits partenaires jugent donc intéressant que certains publics puissent accumuler des heures de formation plus vite, ce qui est important pour leur reconversion ou leur évolution professionnelle. Je soutiens la proposition de Jean-Patrick Gille, qui répond à leur préoccupation. En outre, cette mesure est conforme à l’esprit du projet de loi et aux propositions de la ministre du travail.
M. Arnaud Richard. Je pense que Jean-Patrick Gille et Christophe Cavard ont entièrement raison et qu’il faut les entendre. La dimension financière ne compte pas car, sinon, nous n’examinerions pas cet amendement – l’article 40 est suffisamment efficace pour écarter les amendements qui emportent un coût. C’est vraiment conforme à ce que nous voulons : aider les personnes qui ont un niveau de qualification inférieur au niveau V à se former.
Mme Monique Iborra. Si l’on croit qu’il suffit d’augmenter les heures de formation pour les personnes sans qualification, c’est que l’on connaît vraiment mal la question – or, tel n’est pas votre cas, chers collègues. L’expérience montre que, d’une manière générale, les personnes sans qualification ne veulent pas de formation. C’est regrettable, mais c’est une réalité. Que vous leur offriez quarante, quarante-deux ou quarante-huit heures de formation ne changera pas grand-chose. Pour ma part, je souhaiterais plutôt que l’on insiste sur la qualité de la formation et sur les organismes qui la dispense.
M. le rapporteur. Je suis plutôt favorable au dispositif proposé. Cependant, je ne partage pas votre analyse, chers collègues : si l’on arrive plus vite au plafond de 400 heures, le capital d’heures sera renouvelé plus fréquemment. Cela a donc une incidence, même dans le cadre d’une enveloppe fermée. Si j’avais disposé des éléments d’information pertinents, je ne me serais probablement pas opposé à la mesure. Je m’en remets à la sagesse de la commission.
La Commission rejette l’amendement.
Puis elle adopte l’amendement rédactionnel AS849 du rapporteur.
Elle en vient ensuite à l’amendement AS1012 du rapporteur.
M. le rapporteur. Il s’agit de ne pas prendre en compte, dans le plafond du CPF, les abondements complémentaires effectués au titre du compte d’engagement citoyen.
La Commission adopte l’amendement.
Puis elle adopte successivement les amendements rédactionnels AS850, AS851, AS852, AS853, AS854 et AS855 du rapporteur.
Elle examine ensuite l’amendement AS1013 du rapporteur.
M. le rapporteur. Le rôle du conseil en évolution professionnelle (CEP) est conforté dans le cadre de la mise en œuvre du CPA et de sa mission d’accompagnement global. En cohérence avec l’essor des formations à distance, le projet de loi prévoit la possibilité nouvelle de délivrer ce conseil à distance. Il reprend ainsi une préconisation de l’excellent rapport de Gérard Cherpion et de Jean-Patrick Gille relatif à l’application de la loi du 5 mars 2014. Les modules pouvant être délivrés à distance devront être identifiés dans le cahier des charges du CEP, parmi les trois étapes du CEP : l’accueil individualisé, le conseil personnalisé et l’accompagnement dans la mise en œuvre du projet professionnel.
La Commission adopte l’amendement.
Puis elle adopte l’article 21 modifié.
*
* *
La Commission est saisie de l’amendement AS228 de M. Bernard Accoyer.
M. Bernard Accoyer. S’agissant du CPA, la situation, déjà confuse dans la première version du texte, l’est encore plus à l’issue de nos débats ! Cet amendement vise à abroger les chapitres Ier et II du titre VI du livre Ier du code du travail, c’est-à-dire les dispositions relatives au compte personnel de prévention de la pénibilité (C3P), dont le CPA serait ainsi débarrassé. Le C3P est d’une complexité ingérable pour les entreprises. D’ailleurs, son mode de financement a été récemment annulé par le Conseil d’État. Il s’agit donc d’un amendement de grande clarification, aux sens législatif et économique du terme !
M. le rapporteur. Mon avis est évidemment défavorable. Le C3P constitue une avancée significative, qui vise à prendre en compte des différences de situation réelles entre les actifs de ce pays. Des difficultés de mise en œuvre ont été constatées. J’ai été chargé par le Premier ministre d’une mission pour faciliter la mise en place du C3P. Nous avons formulé des préconisations très importantes. Parmi celles-ci figure l’adoption de référentiels de branche. Selon moi, si les branches se saisissent de cet aspect de la question, elles contribueront à la simplification du dispositif. En tout cas, le C3P est un des éléments phares du CPA. Il n’est pas question de le supprimer.
Mme Isabelle Le Callennec. Nous en sommes à la troisième mission d’évaluation du C3P, et des difficultés concrètes de mise en œuvre apparaissent toujours. Vous nous aviez indiqué, monsieur Sebaoun, qu’un certain nombre de branches avaient réussi à s’entendre sur les référentiels, notamment celle du bâtiment. Cela m’avait beaucoup étonnée car, s’agissant du bâtiment, ce n’est manifestement pas le cas : la Fédération française du bâtiment (FFB), la Confédération de l’artisanat et des petites entreprises du bâtiment (CAPEB) et l’Union professionnelle artisanale (UPA) ont demandé très officiellement au Gouvernement de reporter d’un an l’entrée en vigueur du C3P, arguant du fait qu’ils ont encore une vraie difficulté à l’appliquer concrètement. Les ouvriers du bâtiment exercent des tâches multiples, enchaînent des postures, vont d’un chantier à l’autre, ce qui rend les choses très difficiles à mesurer. À défaut de moratoire, si la branche ne réussit pas à s’entendre avant le 1er juillet, il risque d’y avoir un véritable problème.
M. Gérard Sebaoun. Je maintiens ce que j’ai dit : dès 2011, la branche du bâtiment disposait d’un référentiel extrêmement détaillé, qui est à peu près celui que l’on retrouve aujourd’hui dans les travaux sur le C3P. On a utilisé ce référentiel à un moment donné, puis il est resté en l’état, ce qui est dommage, car les professionnels du bâtiment « savent faire ». Les intéressés sont en effet montés au créneau, mais leur problème était beaucoup moins le C3P que leur carnet de commandes.
La Commission rejette l’amendement.
*
* *
Article 21 bis
Ouverture d’une concertation relative
à l’élargissement du compte personnel d’activité
Cet article est issu de l’adoption par la Commission de l’amendement AS1014 du rapporteur. Il vise à ouvrir une concertation relative à l’élargissement du compte personnel d’activité (CPA) à d’autres droits avec les organisations professionnelles d’employeurs et syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel. Ces organisations pourront alors, si elles le souhaitent, ouvrir une négociation.
L’article 21 du projet de loi repose sur une démarche pragmatique visant à assurer l’entrée en vigueur d’un dispositif regroupant trois comptes au 1er janvier 2017. Le CPA a toutefois vocation à dépasser ce périmètre et à rassembler d’autres dispositifs aptes à faciliter les transitions professionnelles. Tel est l’objet de cet amendement destiné à poursuivre cette réflexion relative au contenu du CPA avant de traduire, le cas échéant, cette évolution dans la loi.
*
La Commission examine en discussion commune, l’amendement AS1014 du rapporteur, l’amendement AS200 de M. Philip Cordery et les amendements identiques AS513 de Mme Martine Carrillon-Couvreur et AS712 de M. Jean-Patrick Gille.
M. le rapporteur. L’objet de mon amendement est de préciser notre vision concernant le CPA et de ne pas fermer les évolutions possibles.
Ainsi que je l’ai indiqué, le CPA reposera sur un « noyau dur » de trois comptes : le CPF, le CEC et le C3P. Notre démarche doit être pragmatique : il s’agit de garantir la pleine entrée en vigueur du dispositif tel qu’il est prévu dans le texte le 1er janvier 2017. Néanmoins, la vocation du CPA dépasse ce périmètre : à terme, d’autres comptes pourraient y être intégrés, afin de faciliter les transitions professionnelles.
Selon moi, il est nécessaire de renvoyer dès aujourd’hui à une concertation puis à une négociation des partenaires sociaux la réflexion sur l’intégration d’autres dispositifs une fois que le CPA sera mis en place. Je suis particulièrement attentif à l’enjeu de la gestion des temps et à celui de leur articulation, notamment entre le temps professionnel et le temps personnel.
Plusieurs options pourront être envisagées. Certains, notamment parmi vous, évoquent l’intégration du compte épargne-temps (CET) dans le CPA. D’autres proposent de mettre en place une « banque du temps » permettant à tout salarié de préparer et de mener à terme des projets personnels. Plusieurs d’entre vous ont évoqué cette idée au cours de nos échanges. Elle me semble très intéressante compte tenu de l’évolution des métiers et des parcours professionnels. D’autres amendements, tels celui présenté tout à l’heure par Jean-Patrick Gille, visent à intégrer l’assurance vieillesse ou l’indemnisation chômage dans le périmètre du compte.
Je prends soin de mentionner ainsi les différentes pistes, notamment pour répondre à la remarque de Jean-Patrick Gille, mais j’imagine qu’il peut y en avoir d’autres auxquelles nous ne pensons pas aujourd’hui, et qui pourraient être intéressantes.
Dans leur position commune de février dernier, les partenaires sociaux n’ont pas souhaité élargir le périmètre, tout au moins dans un premier temps. Il faut en tenir compte, mais ce sujet demeure central et reviendra donc nécessairement dans nos débats. C’est pourquoi, selon moi, le CPA doit être conçu dès aujourd’hui de manière à pouvoir intégrer d’autres comptes. Ses paramètres doivent être facilement applicables à un dispositif élargi.
Pour l’ensemble de ces raisons, je plaide pour que la réflexion soit la plus ouverte possible. Mon amendement prévoit qu’une concertation sur les dispositifs pouvant être intégrés dans le CPA sera engagée avant le 1er octobre avec les organisations professionnelles d’employeurs et syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel, qui ouvriront, si elles le souhaitent, une négociation à ce sujet. Comme d’habitude, si les négociations portent leurs fruits, le législateur aura toute latitude pour en transcrire le résultat dans le droit. Si elles n’aboutissent pas, cela ne nous empêchera pas de prendre nos responsabilités. Nous avons besoin de consulter les partenaires sociaux : cela me paraît une étape intermédiaire indispensable. Mais il ne faut pas renvoyer la discussion aux calendes grecques, d’où la date que je vous propose de fixer.
M. Philip Cordery. Je retire mon amendement au profit de celui du rapporteur.
Mme Isabelle Le Callennec. Que se passera-t-il si les organisations d’employeurs et de salariés ne souhaitent pas ouvrir de négociation à ce sujet, ou bien si seulement une partie d’entre elles le souhaitent ? Est-ce de nouveau le Gouvernement et le législateur qui reprendront la main ?
M. le rapporteur. Oui. Je suis tenté de vous répondre que c’est la règle habituelle, que nous avons d’ailleurs suivie pour le CPA. Nous saisissons les partenaires sociaux, et ils décident entre eux s’ils veulent ou non ouvrir une négociation. Première hypothèse : ils ouvrent une négociation. On leur laisse alors le soin de travailler et de produire leurs conclusions. Deuxième hypothèse : ils choisissent de ne pas ouvrir de négociation. Dans ce cas, le législateur peut considérer qu’il doit se saisir lui-même du débat. Les termes de la négociation et les éventuelles conclusions des partenaires sociaux retiendront bien évidemment l’attention du législateur, qui pourra les reprendre ou non à son compte.
Mme Martine Carrillon-Couvreur. Je vous remercie, monsieur le rapporteur, pour la clarté de vos explications, car ce sont des sujets assez compliqués. Vous avez indiqué que les partenaires sociaux n’avaient pas souhaité élargir le périmètre du CPA. Pouvez-vous préciser à quoi ? D’autre part, sait-on aujourd’hui comment les choses vont se passer dans le temps ? On a bien compris qu’il était important de poser d’abord les trois piliers du CPA, puis de travailler pour que les choses se mettent en place progressivement.
Aux termes de mon amendement AS513, le Gouvernement devrait remettre au Parlement un rapport sur la faisabilité de l’élargissement du CPA au CET. Cette question a été souvent évoquée au cours des auditions, en particulier par les syndicats. Pouvez-vous nous donner quelques indications à propos de cette demande ?
M. Jean-Patrick Gille. Mon amendement, ainsi que les amendements AS711 et AS713, sont des amendements de repli sollicitant la remise de rapports. Je les retire et me rallie à celui du rapporteur.
Il faut faire une distinction entre le CET, d’une part, et l’assurance chômage et les retraites, d’autre part.
Pour l’assurance chômage et les retraites, le gros du travail est fait : elles sont financées par les cotisations sociales et leur gestion est externalisée. Dès lors, il appartient aux partenaires sociaux de décider si chacun reste sur son quant à soi et « gère sa caisse » ou si l’on met les choses en commun.
Quant au CET, sa gestion a été externalisée dans certains cas, mais reste totalement dépendante de l’entreprise dans d’autres. Nous pourrions proposer une généralisation de son externalisation, ce qui le rapprocherait des autres types de comptes.
J’ai bien entendu que la ministre n’était pas favorable à l’intégration du CET dans le CPA compte tenu de l’absence d’accord entre les partenaires sociaux. Mais, selon moi, il faudra insister sur ce point en séance publique, car c’est le CET qui crédibilisera le CPA et apportera quelque chose de nouveau.
De plus, nous pourrions, dès le débat en séance publique, poser la question de la généralisation du CET. Il est d’ailleurs curieux que l’on n’ose pas le faire, alors que l’on crée un compte temps universel.
À cet égard, Isabelle Le Callennec et Monique Iborra ont lancé un débat légitime. Jusqu’à présent, le CPF ne concernait que les actifs salariés. Donc, il était logique qu’il soit financé par les cotisations sociales et géré par les partenaires sociaux. À partir du moment où on l’élargit à tous les actifs, voire aux retraités, il devient universel. Dès lors, qui a vocation à le piloter ? D’autant qu’il faudra trouver d’autres financements. Cette question est devant nous.
Ainsi que le rapporteur pour avis a eu l’honnêteté de le rappeler, l’alinéa 49 de l’article 21 tend à élargir le CPF aux retraités. Dès lors, que se passera-t-il pour un actif au moment où il prend sa retraite s’il lui reste des heures sur son CPF ? Cela soulève la question des règles de fongibilité. Il va falloir interroger à nouveau les partenaires sociaux à ce sujet ou bien préciser les choses : nous avons généralisé le CEC, mais peut-être ne faut-il pas le faire pour le CPF ? Nous en avions débattu et n’avions pas choisi cette option jusqu’à présent.
M. le rapporteur. J’entends dire que l’enveloppe qui financera le CPA est exclusivement l’addition des deux enveloppes qui financent actuellement le CPF et le C3P. Ce n’est pas du tout exact : aux alinéas 43, 44, et 45 de l’article 21, le texte prévoit des financements supplémentaires de la part de l’État, des communes et de l’établissement public chargé de la gestion de la réserve sanitaire pour la partie spécifique qu’est le CEC.
Madame Carrillon-Couvreur, les partenaires sociaux ont négocié et sont parvenus à une position commune, qui n’a cependant pas de caractère officiel puisqu’elle n’a été signée, à ce stade, que par quatre syndicats de salariés. Les partenaires sociaux n’ont trouvé d’accord ni sur l’intégration de l’indemnisation chômage au CPA, ni sur celle du CET – que Jean-Patrick Gille et vous-même avez évoquée. En revanche, l’intégration du CPF et celle du C3P ont fait l’objet d’un consensus, sur lequel nous nous appuyons. À ces deux comptes, nous adjoignons le CEC, pour former ce que j’appelle le « noyau dur » du CPA.
Selon moi, il faut que la négociation se poursuive. Tel est l’objectif de mon amendement AS1014, qui consiste à inviter les partenaires sociaux à se saisir à nouveau du débat – encore une fois, nous en avons besoin – et à essayer d’ouvrir le champ du CPA à d’autres éléments que ceux que nous avons inscrits dans le texte de loi.
Je remercie MM. Gille et Cordery d’avoir retiré leurs amendements. Je vous invite à retirer le vôtre, madame Carrillon-Couvreur.
Les amendements AS200, AS513 et AS712 sont retirés.
La Commission adopte l’amendement AS1014.
*
* *
Les amendements AS711 et AS713 de M. Jean-Patrick Gille sont retirés.
*
* *
Article 22
Habilitation à étendre par ordonnance le compte personnel d’activité aux agents publics
Cet article habilite le Gouvernement à légiférer par voie d’ordonnances afin d’étendre aux agents publics le compte personnel d’activité (CPA).
1. Le contenu de l’habilitation
Conformément à sa vocation universelle, le CPA doit être ouvert à tout actif quel que soit son statut. Ainsi, l’article 38 de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi prévoit qu’un CPA rassemble les droits sociaux personnels pour toute personne « indépendamment de son statut ». L’article 21 du projet de loi n’établit pas davantage de distinction entre les salariés, les travailleurs indépendants, les agents publics et les demandeurs d’emploi. L’universalité du dispositif constitue la principale garantie de préservation des droits sociaux accumulés tout au long de son expérience, et donc de sécurisation des parcours professionnels.
Or, en raison du droit régissant l’activité des agents publics, droit dérogatoire au droit commun, le CPA ne peut être d’application immédiate pour les fonctionnaires et doit donc être aménagé.
Tel est l’objet de l’habilitation à légiférer par voie d’ordonnance prévue à l’article 22 du projet de loi, conformément à l’article 38 de la Constitution.
Le I précise tout d’abord le contenu de cette habilitation en lui assignant six objets :
– la création d’un CPA pour chaque agent public. Il s’agit notamment d’informer les agents sur leurs droits à formation et sur leurs droits sociaux liés à la carrière professionnelle et de permettre l’utilisation des droits inscrits ;
– la détermination des conditions d’utilisation et des modalités de gestion du CPA ;
– la définition des règles de portabilité des droits précités, en particulier en cas de changement de statut au sein de la fonction publique ou lors de l’acquisition de la qualité de fonctionnaire ou de contractuel de droit public ;
– le renforcement des garanties applicables aux agents publics concernant leurs droits à formations et les congés liés ;
– l’amélioration des garanties applicables aux agents publics en matière de prévention et d’accompagnement de l’inaptitude physique ainsi que des droits et congés pour raisons de santé et du régime des accidents de service et des maladies professionnelles ;
– l’adaptation aux agents publics de la plateforme de services en ligne associée au CPA et gérée par la Caisse des dépôts et consignations.
Le II encadre les délais de cette habilitation. Prise dans un délai de neuf mois suivant la promulgation de la loi, l’ordonnance devra faire l’objet du dépôt d’un projet de ratification par le Parlement au plus tard six mois après sa publication.
2. La justification de l’habilitation
Le contenu du compte personnel d’activité tel que prévu par le projet de loi n’est pas applicable aux agents publics en l’état :
– le compte personnel de formation (CPF), d’une part, n’est ouvert que pour les salariés, les demandeurs d’emploi et les personnes accompagnées dans un projet d’orientation et d’insertion professionnelles ou accueillies dans un établissement et service d’aide par le travail (ESAT). Si l’article 21 du projet de loi organise son extension aux travailleurs indépendants et aux membres des professions libérales, les agents publics restent donc en dehors du dispositif et répondent à leur propre régime en matière de formation ;
– le compte personnel de prévention de la pénibilité (C3P), d’autre part, est ouvert pour les seuls salariés affiliés au régime général de la Sécurité sociale ou à la Mutualité sociale agricole (MSA).
La complexité et le temps nécessaire pour adapter le CPA aux agents publics justifient l’habilitation du Gouvernement à légiférer par voie d’ordonnance. Afin de poursuivre le rapprochement entre régimes et de faciliter les transitions entre statuts, le rapporteur estime toutefois nécessaire d’accélérer sans tarder la prise en compte de l’inaptitude physique et la personnalisation des droits à formation dans la fonction publique. C’est à cette condition que le CPA pourra répondre à l’objectif d’universalité au fondement de sa création.
L’agenda social de la fonction publique pourra contenir une négociation relative à la définition des règles en matière de formation des agents publics et de prévention de l’inaptitude physique. Les résultats des négociations menées pourront, le cas échéant, être transposés par le législateur.
La prise en compte de ces enjeux de formation et de santé au travail dans la fonction publique constitue un préalable à toute effectivité du CPA pour les agents publics et, a fortiori, à toute portabilité des droits en cas de changement de statut ou lors de l’acquisition de la qualité d’agent public.
*
La Commission a adopté trois amendements rédactionnels à cet article.
*
La Commission adopte successivement les amendements rédactionnels AS856, AS857 et AS1003 du rapporteur.
Puis elle adopte l’article 22 modifié.
*
* *
Article 23
(Art. L. 5131-3 à L. 5131-7 du code du travail)
Renforcement de l’accompagnement des jeunes vers l’emploi et l’autonomie
Cet article rénove les dispositifs d’accompagnement et d’insertion des jeunes en les rassemblant dans un parcours contractualisé d’accompagnement vers l’emploi et l’autonomie et en généralisant la garantie jeunes.
Consacré par le législateur en 2005, le droit à l’accompagnement repose sur plusieurs dispositifs régis par leurs propres objectifs et modes de financement. La création d’un parcours contractualisé d’accompagnement vers l’emploi et l’autonomie vise donc à harmoniser les outils d’accompagnement tout en préservant une démarche personnalisée et adaptée aux besoins de chaque jeune.
L’accompagnement par l’État des jeunes en situation d’exclusion sociale et professionnelle a été rendu indispensable par l’augmentation du nombre de jeunes n’étant ni à l’école, ni en emploi, ni en formation, couramment appelés « NEET » (50). Une étude du Conseil d’analyse d’économique (51) évalue ainsi à 1,9 million le nombre de jeunes de 15 à 29 ans dans cette situation en France, soit 17 % de cette classe d’âge. L’accompagnement de ces jeunes vers l’inclusion et l’emploi est donc devenu l’un des principaux axes de la politique de cohésion sociale, à destination notamment des 900 000 jeunes ayant quitté le système scolaire sans diplôme.
Les pouvoirs publics ont mis en place différents dispositifs visant à corriger cette situation d’exclusion et ainsi donner chair au droit à l’accompagnement, consacré par la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale puis inscrit dans le code du travail en 2007 (52). L’article L. 5131-3 de ce code prévoit ainsi que « tout jeune de seize à vingt-cinq ans révolus en difficulté et confronté à un risque d’exclusion professionnelle a droit à un accompagnement, organisé par l’État, ayant pour but l’accès à la vie professionnelle ».
Ce droit à l’accompagnement a été concrétisé par la création du contrat d’insertion à la vie sociale (CIVIS) conclu avec l’État permettant au jeune de bénéficier d’un suivi individualisé et d’une allocation et d’être affilié au régime général de la Sécurité sociale. Le CIVIS a pour objet d’organiser les actions d’accompagnement au regard à la fois des difficultés rencontrées par son bénéficiaire et de son projet professionnel d’insertion dans un emploi durable.
D’autres dispositifs d’accompagnement ont progressivement été créés aux côtés du CIVIS, destinés à diversifier les modalités d’accompagnement et à répondre aux besoins spécifiques des jeunes. Ont ainsi été mis en place :
– le dispositif « jeunes décrocheurs », issu de l’accord national interprofessionnel du 7 avril 2011 ;
– la délégation du parcours personnalisé d’accès à l’emploi ;
– l’accompagnement dans l’emploi associé aux emplois d’avenir ;
– l’expérimentation de la « garantie jeunes ».
Principalement mis en œuvre par les missions locales, ces outils rassemblent aujourd’hui près de 500 000 jeunes.
Des dispositifs supplémentaires d’accompagnement et d’inclusion sociale peuvent en outre être mentionnés, tels que l’entrée dans une école de la deuxième chance (E2C) ou dans un établissement public d’insertion et de défense (EPIDE).
La création de multiples dispositifs d’accompagnement a permis d’assurer une prise en charge individualisée des besoins de chaque jeune en situation d’exclusion. Toutefois, leur superposition a généré une complexité – tant pour les jeunes voulant y accéder en raison des différences de critères que pour les acteurs les mettant en œuvre – et une cohérence amoindrie dans la mise en œuvre de la politique d’intégration des jeunes en difficulté. Il est donc nécessaire de rationaliser la politique d’accompagnement et de bâtir un dispositif homogène.
L’article 23 du projet de loi procède à la rénovation des dispositifs d’accompagnement et d’inclusion en créant le parcours contractualisé d’accompagnement vers l’emploi et l’autonomie, dont l’entrée en vigueur est prévue au 1er janvier 2017. Il repose sur deux piliers :
– d’une part, un accompagnement du jeune dans le cadre d’un contrat conclu avec l’État et adapté aux besoins du jeune lors d’un diagnostic effectué avec ce dernier, prévu au 4° du I de cet article ;
– d’autre part, une allocation versée par l’État et modulable en fonction de la situation de l’intéressé. Prévue au 5° du I de cet article, cette allocation est incessible et insaisissable ; elle peut être suspendue ou supprimée en cas de non-respect par son bénéficiaire des engagements du contrat.
Le 7° du I de l’article renvoie ensuite au pouvoir réglementaire la détermination des modalités de mise en œuvre du parcours. Un décret en Conseil d’État devra ainsi préciser la nature des engagements des parties au contrat, les critères de durée et de renouvellement du parcours, les conditions d’orientation vers les différentes formes d’accompagnement et les conditions d’attribution, de modulation et de suppression de l’allocation.
Les intitulés du code du travail relatifs au droit à l’accompagnement intègrent ce nouveau dispositif d’accompagnement vers l’emploi et l’autonomie, les modifications de coordination étant déclinées au 1° à 3° du I de l’article.
Le II de l’article aménage, enfin, le régime de transition pour un jeune ayant conclu un CIVIS devant produire ses effets au-delà du 1er janvier 2017. Ce contrat se poursuit alors selon le droit aujourd’hui en vigueur, jusqu’à son terme.
2. La généralisation de la garantie jeunes comme modalité spécifique d’accompagnement et d’insertion
Le parcours contractualisé d’accompagnement vers l’emploi et l’autonomie peut prendre la forme d’une garantie jeunes, généralisée par l’article 23 du projet de loi à tout jeune de 16 à 25 ans répondant à des critères d’exclusion sociale et professionnelle.
Mise en place dans le cadre du Plan pluriannuel de lutte contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale présenté le 21 janvier 2013, la « garantie jeunes » a pour objectif d’amener les jeunes en situation de grande précarité vers l’autonomie, l’emploi et la formation. Mêlant les approches sociale et professionnelle, ce dispositif comporte deux volets :
– l’accompagnement des jeunes par les missions locales, facilitant l’accès à une expérience professionnelle ou à une formation et permettant de construire un projet professionnel. Cet accompagnement comporte une dimension individuelle et des activités collectives ;
– une garantie de ressources, correspondant à une allocation forfaitaire d’un montant équivalent au revenu de solidarité active (RSA) minoré du forfait logement. Cette allocation est cumulable avec les revenus d’activités jusqu’à 300 euros puis est dégressive au-delà jusqu’à 80 % du SMIC brut.
Ce dispositif a été mis en place par voie réglementaire (53) le 1er octobre 2013. Les publics éligibles, les modalités de contractualisation et l’organisation du suivi de l’expérimentation ont alors été définis.
S’agissant des publics éligibles, tout d’abord, le dispositif est ouvert aux jeunes de 18 à 25 ans révolus qui vivent hors du foyer de leurs parents ou au sein de ce foyer sans recevoir de soutien financier de ces derniers, qui ne sont pas étudiants, ne suivent pas une formation, n’occupent pas un emploi et dont le niveau de ressources ne dépasse pas le montant forfaitaire prévu pour le RSA. L’accès à la garantie jeunes est exclu pour les bénéficiaires du RSA. Trois catégories supplémentaires de jeunes sont éligibles, à titre exceptionnel, au dispositif. Il s’agit des jeunes étudiants, suivant une formation, occupant un emploi ou engagé dans le service civique et dont la situation est porteuse d’un risque de rupture, des jeunes âgés de 16 à 18 ans pour lesquels la garantie constitue un appui adapté au parcours vers l’autonomie et de ceux dont le niveau de ressources dépasse le plafond précité lorsque leur situation le justifie.
S’agissant des modalités de contractualisation, également, il est prévu qu’un contrat est signé entre la mission locale et le jeune afin de définir les engagements réciproques en vue de l’insertion sociale de ce dernier. Conclu pour une durée d’un an, le contrat est renouvelable une fois sur décision de la commission d’attribution et de suivi. Son renouvellement est de droit lorsque le jeune a effectué un engagement de service civique durant la durée de son contrat.
S’agissant du suivi de l’expérimentation, enfin, une commission d’attribution et de suivi de la garantie jeunes a été créée dans chaque territoire participant à l’expérimentation. Elle est notamment en charge des décisions d’admission et de renouvellement de la garantie jeunes et de l’animation des partenariats locaux devant permettre le bon déroulement des parcours.
b. L’extension de la garantie jeunes comme modalité intensive du parcours contractualisé d’accompagnement
Le principe d’une généralisation de la garantie jeunes a été posé dès la présentation du dispositif en janvier 2013. Progressivement généralisé dans les départements, le dispositif est appelé à devenir une modalité particulière du parcours contractualisé d’accompagnement prévu à l’article 23 du projet de loi.
Le premier volet de la généralisation de la garantie jeunes a été géographique. Initialement expérimenté dans 10 départements pilotes, le dispositif a ensuite été étendu à 62 départements supplémentaires sur la période 2014-2015. Au terme de cette première extension de la garantie jeunes, au 31 décembre 2015, 46 000 jeunes ont bénéficié du dispositif depuis le début de l’expérimentation. Avec 35 000 jeunes pris en charge à cette date, la montée en charge du dispositif est effective et est appelée à se poursuivre avec l’extension du dispositif à de nouveaux départements.
L’arrêté du 29 février 2016 fixant la liste des territoires concernés par l’expérimentation de la garantie jeunes prolonge ce processus de généralisation du dispositif en ajoutant 19 départements dans la mise en œuvre de cette mesure. Ainsi, 91 départements sont aujourd’hui couverts par le dispositif.
Cette généralisation est appelée à prendre une dimension encore plus significative avec l’inscription du dispositif dans la loi. Inscrite au 6° du I de l’article 23, la garantie jeunes devient un dispositif pérenne ouvert à tout jeune de 16 à 25 ans répondant à certains critères. Elle constitue désormais une modalité spécifique du parcours contractualisé d’accompagnement vers l’emploi et l’autonomie prévu à cet article et correspond ainsi à la forme intensive de ce programme.
Pour en bénéficier, un jeune doit remplir quatre conditions :
– vivre hors du foyer de ses parents ou au sein de celui-ci sans recevoir de soutien financier de leur part ;
– ne pas être étudiant, occuper un emploi ou suivre une formation ;
– avoir un niveau de ressources inférieur à un niveau fixé par décret ;
– s’engager à respecter les engagements réciproques conclus dans le cadre de leur parcours contractualisé d’accompagnement vers l’emploi et l’autonomie.
La garantie jeunes conserve ses deux piliers au cœur d’une démarche d’insertion sociale et professionnelle : d’une part, un accompagnement intensif ; d’autre part, une allocation dégressive en fonction des ressources d’activité du jeune. La définition du montant et des modalités de versement de cette allocation est renvoyée au pouvoir réglementaire.
La généralisation de la garantie jeunes sera effective à partir du 1er janvier 2017, en cohérence avec l’ensemble des dispositions relatives au parcours contractualisé d’accompagnement vers l’emploi et l’autonomie.
Le rapporteur soutient cette généralisation de la garantie jeunes qui permettra à la fois de clarifier l’articulation de ce dispositif avec les autres outils d’accompagnement et d’insertion et d’assurer un égal accès de tout jeune dans la même situation quel que soit son territoire. Cette mesure s’inscrit donc au cœur des politiques d’égalité – et notamment d’égalité des territoires – et de cohésion sociale.
Il souligne néanmoins la nécessité de donner aux structures en charge de ce dispositif les moyens adéquats à l’exercice de cette mission afin de garantir la qualité de l’accompagnement et du suivi. L’efficacité du dispositif repose en sur l’identification des besoins du jeune – notamment au regard de l’alternance entre le suivi individuel et le suivi collectif – et sur la capacité du conseiller référent à assurer un accompagnement personnalisé et sur la durée.
En premier lieu, le rapporteur souligne le rôle central des missions locales dans la montée en charge de la garantie jeunes depuis 2013. Il convient néanmoins d’ouvrir la réflexion sur les structures habilitées à mettre en place ce dispositif. À titre d’exemple, les écoles de la deuxième chance pourraient également être associées à cet accompagnement intensif. L’identification des acteurs compétents relèvera du pouvoir réglementaire.
En second lieu, la généralisation de la garantie jeunes doit s’accompagner d’une augmentation des crédits consacrés, fixés à 255 millions d’euros par la loi de finances initiale pour 2016. À partir d’une hypothèse de 150 000 nouveaux jeunes dans le dispositif en 2017, l’étude d’impact du projet de loi prévoit un coût total pour la mesure d’environ 600 millions d’euros. Si les financements mobilisés dépendront en premier lieu du taux de recours au dispositif, il convient toutefois d’envisager dès à présent la réorientation ou la mobilisation de crédits supplémentaires dans le cadre du programme 102 « Accès et retour à l’emploi » du budget de l’État. Les débats parlementaires dans le cadre du projet de loi de finances pour 2017 devront pleinement intégrer cet enjeu.
*
Outre dix amendements rédactionnels, la Commission a adopté un amendement du rapporteur visant à garantir le caractère incessible et insaisissable de l’allocation versée dans le cadre de la garantie jeunes ainsi que la possibilité d’en suspendre – voire supprimer – le versement en cas de non-respect par son bénéficiaire des engagements du contrat. Cette précision vise à garantir un régime juridique identique à celui prévu pour le parcours contractualisé d’accompagnement vers l’emploi et l’autonomie.
*
La Commission adopte l’amendement rédactionnel AS858 du rapporteur.
Puis elle examine l’amendement AS898 de la commission des affaires économiques.
M. le rapporteur pour avis. L’article 23 crée un parcours contractualisé d’accompagnement vers l’emploi et l’autonomie, qui vient se substituer au contrat d’insertion dans la vie sociale (CIVIS) et généralise la garantie jeunes. Dans un souci de clarté juridique et de cohérence, je propose d’en récrire les alinéas 6 à 14.
Premièrement, il convient de mieux combiner les articles L. 5131-4 et L. 5131-5 du code du travail, pour faire apparaître clairement que la garantie jeunes ne constitue qu’une modalité d’accompagnement des jeunes – certes, la plus intensive – dans le cadre de ce parcours.
Deuxièmement, il est nécessaire de préciser que ce parcours contractualisé engage bien le jeune, la rédaction actuelle étant porteuse d’insécurité juridique.
Troisièmement, il s’agit d’inclure dans l’article L. 5131-5 du code du travail les dispositions encore utiles, mais actuellement mal articulées, de l’article L. 5131-6, lequel serait, par conséquent, abrogé.
Enfin, cet amendement vise à préciser que l’allocation accompagnant la garantie jeunes sera dégressive dans le temps, selon des modalités fixées par décret. Il s’agit d’éviter un effet d’aubaine. Il ne faut pas donner le sentiment que cette allocation est un revenu minimum d’activité : il s’agit d’un forfait qui rémunère un contrat. Dans la rédaction actuelle, le versement de ce forfait s’arrête brutalement, alors que l’on peut très bien envisager qu’il en soit autrement : l’allocation pourrait être fixe pendant une durée de six mois, renouvelable une fois, puis dégressive ensuite.
M. le rapporteur. Cette proposition de réécriture me pose quelques difficultés : vous supprimez l’allocation pouvant être versée dans le cadre du parcours contractualisé d’accompagnement vers l’emploi et l’autonomie ; vous ne mentionnez plus la définition d’engagements qui doivent être respectés par le jeune dans le cadre de la garantie jeunes ; vous introduisez la notion de dégressivité. Ce sont trois éléments relativement lourds, dont je ne comprends pas les fondements. Avis défavorable.
Mme Isabelle Le Callennec. Dans l’exposé sommaire de l’amendement, il est indiqué que l’article 23 généralise la garantie jeunes et supprime le CIVIS. Est-ce bien le cas ? Le CIVIS continuera-t-il d’exister ? On entend souvent sur le terrain, en particulier dans les missions locales, qu’il y a trop de fonds et de dispositifs destinés aux jeunes, qu’on ne s’y retrouve plus et qu’une certaine fongibilité serait nécessaire. Je crois savoir qu’il y a actuellement un débat entre le Gouvernement, les associations de jeunes et les associations étudiantes sur l’insertion professionnelle des jeunes. Ne serait-ce pas le moment de faire un peu de ménage et de rendre les choses plus lisibles ? Je rappelle que le rapport d’information de nos collègues Jean-Frédéric Poisson et Régis Juanico sur l’évaluation des politiques publiques en faveur de la mobilité sociale des jeunes a dressé la liste de tous les dispositifs existants.
M. le rapporteur. Le parcours contractualisé d’accompagnement vers l’emploi et l’autonomie a vocation à rassembler l’ensemble des dispositifs et à remplacer le CIVIS, lequel n’est plus aussi attractif qu’il a pu l’être.
M. Jean-Patrick Gille. L’idée est celle que vous souhaitez, madame Le Callennec : simplifier le dispositif. C’est pourquoi je préfère la version du Gouvernement, qui établit en toute clarté le principe selon lequel tout jeune a droit à un accompagnement global et personnalisé et, le cas échéant, à une allocation interstitielle visant à combler les périodes sans revenus. C’est aux conseillers qu’il revient de doser le niveau de l’accompagnement et, si nécessaire, de l’allocation.
La garantie jeunes constitue le socle de ce dispositif. Elle garantit au jeune concerné, pendant toute la durée de son engagement, un niveau de revenu qui correspond au revenu social d’activité (RSA), soit 461 euros environ, sachant qu’elle ne saurait être dégressive, même si elle est différentielle. Ainsi, un jeune à qui des « petits boulots » rapporteraient 300 euros, par exemple, percevrait au titre de la garantie jeunes un montant complémentaire lui permettant de toucher l’équivalent du RSA.
En clair, cette garantie jeunes, dont la généralisation à l’ensemble du territoire à partir du 1er janvier 2017 permettra à chaque jeune qui estime pouvoir en bénéficier d’en faire la demande, complète un dispositif général d’accompagnement.
M. le rapporteur pour avis. J’accepte de retirer l’amendement s’il crée de la confusion, mais j’en rappelle l’objectif : que la garantie jeunes consiste en un parcours, un contrat, une allocation, et qu’elle remplace les autres dispositifs en vigueur. Or, en l’état, il restera çà et là des bribes de CIVIS et autres contrats qui brouillent la lisibilité du système. Adoptons donc le principe d’une garantie universelle correspondant à un dispositif contractualisé, assorti d’une allocation renouvelable et non dégressive pendant la période d’accompagnement, quoiqu’elle puisse le devenir au terme de celle-ci pour éviter toute interruption brutale de revenu.
Mme Isabelle Le Callennec. Prenez garde aux effets d’affichage : la communication faite autour de cette garantie « universelle » laisse entendre à certains jeunes qu’elle les concernera tous, alors qu’elle ne bénéficiera qu’à ceux qui remplissent les critères. En effet, si cette garantie fonctionne, comme je le constate sur mon territoire, c’est justement parce qu’elle s’adresse à des jeunes éloignés de l’emploi, qui sont pris en charge et accompagnés de manière collective pendant six semaines de telle sorte qu’ils sont encouragés à s’adresser aux entreprises. La notion d’universalité devrait nous inciter à faire preuve de prudence.
M. le rapporteur. La garantie jeunes n’est que l’une des différentes modalités de parcours, monsieur le rapporteur pour avis. Si elle couvrait l’ensemble des parcours, comme vous le suggérez, alors les jeunes qui n’en rempliraient pas les critères ne pourraient bénéficier d’aucune autre modalité de parcours. Autrement dit, elle ne saurait se substituer à l’ensemble des dispositifs et constituer une sorte de droit opposable à l’accompagnement. Elle est certes une pièce importante du dispositif d’accompagnement globalisé, mais d’autres doivent coexister avec elle.
L’amendement est retiré.
La Commission examine l’amendement AS714 de M. Jean-Patrick Gille.
M. Jean-Patrick Gille. Cet amendement vise à ce que le droit à l’accompagnement soit mis en œuvre par les missions locales.
M. le rapporteur. S’il est en effet légitime que les missions locales mettent en œuvre le droit à l’accompagnement, je ne crois pas qu’elles doivent être les seules à le faire.
Mme Monique Iborra. À défaut de devenir universelle à proprement parler, la garantie jeunes sera étendue, ce qui se traduira par une hausse du nombre de demandes. Or, le délégué général de l’Union nationale des missions locales (UNML) que nous avons auditionné nous a clairement indiqué que les missions ne pourraient pas faire face à cette augmentation, non pas par manque de moyens – ils seront augmentés – mais en raison de la charge administrative que représente un tel travail. La liste des documents exigés pour remplir le dossier est abondante, notamment parce que le dispositif repose pour partie sur des financements européens. Dès lors, il serait sage que le législateur permette à d’autres organismes que les seules missions locales de traiter la demande qu’il s’apprête à gonfler.
M. Christophe Cavard. Qu’entendez-vous par « d’autres organismes » ? Faut-il comprendre que des entreprises telles que Manpower ou Vediorbis seraient concernées ? En l’état, rien ne le leur interdit, et elles agissent d’ailleurs déjà dans le cadre d’autres dispositifs réservés à d’autres publics. Qu’est-ce qui les empêchera de capter cette possibilité de mettre en œuvre l’accompagnement des jeunes ? Je voudrais m’assurer qu’elles ne le pourront pas et que la gestion de l’accompagnement demeurera le fait de services publics, en particulier – mais pas exclusivement – les missions locales, qui sont tout à fait adaptées à cette mission.
M. le rapporteur. Ces éléments seront fixés par décret, et le Gouvernement n’a nullement l’intention d’ouvrir le champ de l’accompagnement des jeunes aux entreprises privées. Les écoles de la deuxième chance, en revanche, pourraient avoir un rôle à jouer aux côtés des missions locales, dont nul ne nie la place prépondérante et décisive. Il me semblerait regrettable, toutefois, que d’autres organismes à vocation publique ne puissent pas prétendre exercer cette mission.
Mme Isabelle Le Callennec. Mme Iborra a soulevé à juste titre la question de la complexité des dossiers exigés, en particulier lorsque des fonds européens sont impliqués. La ministre du travail, qui rencontre régulièrement ses homologues européens, ne pourrait-elle pas ouvrir une discussion avec eux sur ce point ? La complexité des dossiers, en effet, pénalise tous les pays, qu’il s’agisse des chantiers d’insertion ou de tout autre domaine relevant du Fonds social européen (FSE). Tous les acteurs se plaignent de la complexité des procédures et des problèmes de trésorerie qui en découlent, les versements du FSE n’étant pas immédiats ; il est temps de s’attaquer aux racines du mal.
L’amendement est retiré.
La Commission passe à l’amendement AS716 de M. Jean-Patrick Gille.
M. Jean-Patrick Gille. Cet amendement vise à ce que la garantie jeunes, à défaut de l’ensemble des parcours d’accompagnement personnalisé, soit mise en œuvre par les missions locales, comme le prévoit déjà le droit existant. Ne pas leur réserver cette compétence risquerait de susciter un débat assez vif. Quant aux propos tenus par le délégué général que vous avez auditionné, il me semble assez bien le connaître pour affirmer que telle n’est pas exactement la position qu’il défend.
Si je comprends – sans être d’accord – les arguments qui poussent à ne pas réserver aux seules missions locales la mise en œuvre du droit à l’accompagnement dans son ensemble, je crois en revanche que les missions locales doivent être chargées de déployer la garantie jeunes – sauf à en modifier le dispositif –, d’autant plus qu’il s’agit d’un mécanisme de financement complexe. Toutes les déclarations publiques sont d’ailleurs allées en ce sens.
M. le rapporteur. Tout d’abord, je confirme les propos de Mme Iborra concernant l’audition des missions locales : il nous a été expliqué en toute clarté – ce que chacun sait déjà – que la garantie jeunes semble donner satisfaction. Néanmoins, ce dispositif visant à introduire les jeunes dans le monde de l’entreprise, il va de soi que la hausse du nombre de demandes risque de présenter des difficultés dans certains territoires. D’autre part, l’objectif et la répartition du coût de 1 600 euros pose problème ; j’ai d’ailleurs fait part à la délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle (DGEFP) de mon étonnement face au caractère extrêmement exigeant des critères requis – y compris celui de 100 % de réussite sur une partie du financement obtenu, ce qui, à ma connaissance, est sans équivalent.
J’ai demandé à la DGEFP si les missions locales étaient seules compétentes pour mettre en œuvre la garantie jeunes. La réponse suivante m’a été faite : les missions locales sont naturellement compétentes, mais elles ne sont pas seules à l’être. C’est par décret que la répartition des tâches sera définie ; en l’état, j’émets un avis défavorable à l’amendement.
La Commission rejette l’amendement.
L’amendement AS899 de la commission des affaires économiques est retiré.
La Commission examine l’amendement AS1015 du rapporteur.
M. le rapporteur. Cet amendement vise à préciser que l’allocation liée à la garantie jeunes est incessible et insaisissable, et qu’elle peut être suspendue ou supprimée en cas de non-respect par son bénéficiaire des engagements du contrat.
La Commission adopte l’amendement.
Puis elle adopte successivement les amendements rédactionnels AS859 et AS1004, l’amendement de coordination AS860 et l’amendement rédactionnel AS861 du rapporteur.
Elle examine ensuite l’amendement AS900 de la commission des affaires économiques.
M. le rapporteur pour avis. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.
M. le rapporteur. Ce n’est pas mon avis ; au demeurant, il est déjà satisfait. L’emploi du terme « respectifs » dans l’alinéa est redondant, car les engagements sont par nature respectifs et les jeunes ne sont pas censés contrôler les engagements pris par l’État. Je vous propose donc de le retirer.
L’amendement est retiré.
La Commission adopte successivement les amendements de conséquence AS862 et AS863 ainsi que les amendements rédactionnels AS866, AS864 et AS865 du rapporteur.
Puis elle adopte l’article 23 modifié.
*
* *
La Commission examine l’amendement AS312 de Mme Jacqueline Fraysse.
Mme Jacqueline Fraysse. Cet amendement vise à revaloriser la gratification des stagiaires. Aujourd’hui, tout employeur accueillant un stagiaire au-delà de deux mois a l’obligation de lui verser une gratification minimale dont le taux horaire est fixé à 3,60 euros depuis septembre 2015. Cette rémunération, très modeste, est près de trois fois moindre que le SMIC horaire ! Nous proposons simplement de faire un geste en direction de ces jeunes qui participent au travail et à la vie de l’entreprise en même temps qu’ils acquièrent des expériences et apprennent leur métier. Je rappelle que près de 1,2 million d’étudiants sont concernés chaque année. La revalorisation que nous proposons aboutit à un taux horaire de 5,20 euros, soit légèrement plus de la moitié du SMIC horaire.
M. le rapporteur. Porter la gratification de 15 % à 22 % du plafond horaire de la sécurité sociale n’est pas neutre financièrement. Mme Chaynesse Khirouni a accompli un travail de grande qualité sur la question des stages : au-delà de la gratification, l’enjeu principal des stages en entreprise réside dans leur capacité à délivrer des compétences professionnelles et à conduire vers un emploi pérenne.
Tel qu’il est formulé, votre amendement a une incidence financière pour les employeurs ; d’autre part, à quoi correspond le taux de 22 % que vous proposez ? Avis défavorable.
Mme Chaynesse Khirouni. La loi du 10 juillet 2014 a profondément remanié plusieurs aspects de l’encadrement des stagiaires, dont les conditions de stage et le statut des stagiaires. Il a été rappelé que le stage est un outil pédagogique en lien avec une formation. Aujourd’hui, en effet, les formations doivent comporter un volume minimum d’heures de face-à-face pédagogique pour éviter les formations « bidon ». Autre aspect important de la loi : la lutte contre le recours abusif aux stages et la requalification de certains stages en contrats salariés.
Vous évoquez le caractère modeste de la « rémunération » des stages, madame Fraysse. Or, nous nous sommes efforcés de rappeler que le stage n’est pas un travail et qu’à ce titre, il ne donne pas lieu à une rémunération, mais à une gratification par indemnisation. J’ajoute que cette indemnité a déjà été augmentée. Quoi qu’il en soit, le fait d’entretenir cette confusion entre rémunération et gratification ne peut que profiter aux entreprises qui tentent d’abuser des stages. De ce point de vue, il n’est pas inutile de plafonner la gratification à un niveau qui permette de distinguer nettement entre l’outil pédagogique qu’est le stage et un véritable emploi.
Mme Jacqueline Fraysse. Je ne confonds nullement rémunération et gratification, comme en atteste l’exposé des motifs de mon amendement. Il va de soi qu’une gratification n’est pas une rémunération – et c’est heureux, vu son caractère très modeste, qui justifierait l’adoption de cet amendement.
Mme la présidente Catherine Lemorton. Mme Khirouni, rapporteure de la proposition de loi tendant au développement, à l’encadrement des stages et à l’amélioration du statut des stagiaires, avait dû trouver un équilibre avec nos collègues sénateurs qui souhaitaient augmenter la gratification, ce qui n’aurait pas manqué de compliquer la recherche de stages dans certains secteurs – ainsi que cela s’est d’ailleurs produit. Je pense en particulier aux stages obligatoires des futurs auxiliaires médicaux, qu’il s’agisse des kinésithérapeutes, des infirmières, des diététiciennes ou encore des ergothérapeutes. Le Gouvernement avait annoncé qu’une enveloppe budgétaire spécifique leur serait consacrée ; pourtant, au-delà de deux mois de stage, ces étudiants ne sont plus rémunérés, ce qui les oblige à enchaîner deux stages dans deux hôpitaux différents, donc dans deux villes différentes. Or, certains stagiaires ne trouvent pas à se loger pour la durée de leur stage et ont les plus grandes peines du monde à trouver un stage qui leur convient, parce que les établissements publics ne disposent pas des fonds nécessaires. Il faudra relancer le Gouvernement sur cette question, car plusieurs dizaines de milliers d’étudiants sont tout de même concernés !
Mme Chaynesse Khirouni. En outre, la loi du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche avait étendu la gratification des stagiaires au secteur public. Or, des problèmes se sont posés dans le secteur du travail social, certaines collectivités arguant du fait qu’elles ne peuvent accepter les candidats stagiaires au motif qu’elles doivent les indemniser au-delà de deux mois. Pour y remédier, des enveloppes de crédits exceptionnels ont été allouées de manière ponctuelle. Compte tenu de ces difficultés, je propose néanmoins de stabiliser le dispositif applicable au secteur privé et au secteur public avant d’envisager une éventuelle hausse de la gratification.
La Commission rejette l’amendement.
*
* *
Article 23 bis
Rapport relatif à l’évaluation des emplois d’avenir
Adopté sur proposition de M. Jean-Louis Bricout, cet amendement prévoit la remise par le Gouvernement d’un rapport sur la mise en œuvre de la loi n° 2012-1189 du 26 octobre 2012 portant création des emplois d’avenir. Destiné à évaluer l’impact de ce dispositif sur la politique de l’emploi, ce rapport devra être remis au Parlement dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi.
*
La Commission examine l’amendement AS668 de M. Jean-Louis Bricout.
M. Jean-Louis Bricout. Cet amendement vise à ce que le Gouvernement remette au Parlement un rapport relatif à la mise en œuvre de la loi de 2012 portant création des emplois d’avenir, afin d’explorer l’opportunité de prolonger ces emplois au-delà du délai de trois ans initialement prévu par la loi.
Au 31 janvier 2016, environ 130 000 contrats étaient en cours, 35 000 autres étant prévus pour l’année 2016, sans doute davantage au premier semestre qu’au second. Le bilan global est positif : chaque jeune concerné bénéficie en moyenne de 2,4 actions de formation, dont 30 % de formations qualifiantes. Certes, 35 000 jeunes sans emploi et sans formation pourront prétendre à bénéficier de ce dispositif en 2016, mais d’autres devront le quitter pour des raisons souvent liées aux contraintes budgétaires auxquelles se heurtent les collectivités et le milieu associatif. Des dispositions existent déjà pour consolider l’emploi dans les structures les plus « porteuses », comme le nouveau dispositif d’aide à l’embauche, qui peut s’appliquer au secteur associatif et au secteur marchand, lequel peut également bénéficier du contrat initiative-emploi (CIE) Starter. Cependant, dans le cas de contrats proposés par les collectivités, la rupture en fin d’engagement peut être brutale, l’aide passant subitement de 75 % à 0 %, ce qui freine la consolidation de ces emplois et oblige parfois les jeunes concernés à repartir de zéro.
Le rapport demandé permettra de conduire une analyse des sorties positives des emplois d’avenir en tenant compte de l’impact que pourrait avoir le prolongement de deux années de l’aide, laquelle passerait à 50 % la quatrième année et à 25 % la cinquième, en vue d’éviter toute rupture financière trop dure et de consolider l’emploi des jeunes.
Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement.
*
* *
Article 24
(Art. L. 3243-2 du code du travail)
Dématérialisation du bulletin de paie
Cet article vise à étendre le recours au bulletin de paie dématérialisé en faisant de la dématérialisation le principe et du format papier l’exception. Dans des conditions garantissant l’intégrité, la disponibilité et la confidentialité des données, le bulletin de paie dématérialisé pourra être hébergé sur les services en ligne du compte personnel d’activité du salarié.
Les modalités de délivrance du bulletin de paie au salarié par l’employeur sont précisées à l’article L. 3243-2 du code du travail. Il constitue une pièce justificative remise par l’employeur au salarié lors du paiement de son salaire.
Auparavant limité au format papier, le bulletin de paie a émergé sous forme dématérialisée au début des années 2000, permettant ainsi de s’appuyer sur les nouvelles technologies pour effectuer des économies et simplifier la transmission du document. Cette pratique a alors été encadrée par le législateur afin de définir un cadre protecteur et de garantir l’assentiment des salariés. La loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d’allégement des procédures en a défini les conditions d’utilisation, en prévoyant deux garanties protectrices :
– d’une part, l’accord du salarié est nécessaire pour procéder à la dématérialisation de son bulletin de paie ;
– d’autre part, la transmission du bulletin sous forme électronique doit s’effectuer dans des conditions de nature à garantir l’intégrité des données.
La dématérialisation du bulletin de paie constitue toutefois l’exception, le format papier demeurant la règle de droit commun. La faculté de recourir à une telle version dématérialisée a, dans les faits, été peu utilisée et demeure résiduelle, en particulier en comparaison avec d’autres pays européens. Ainsi, à peine 15 % des bulletins de paie transmis chaque année en France le sont par voie dématérialisée, contre par exemple 95 % en Allemagne, 73 % en Grande-Bretagne ou 57 % en Italie (54).
L’article 24 du projet de loi inverse la règle d’option en faisant du bulletin de paie dématérialisé la règle générale et du format papier l’exception.
Le I prévoit ainsi que l’employeur peut procéder à la remise du bulletin de paie sous forme électronique sauf opposition du salarié. Outre la nécessité de protéger l’intégrité des données, aujourd’hui en vigueur, des exigences de disponibilité et de confidentialité des données devront également être respectées.
À la demande du salarié, ce bulletin dématérialisé pourra être remis sous la forme d’un hébergement de données par les services en ligne associés au compte personnel d’activité (CPA). Cette disposition permet de simplifier la gestion par le salarié de ses documents administratifs et de bénéficier des garanties de confidentialité et de sécurité offertes par le système d’information du CPA.
Le II de l’article fixe ensuite au 1er janvier 2017 l’application de cette disposition, reprenant ainsi la date d’entrée en vigueur CPA.
Le rapporteur soutient cette démarche au regard des nombreux avantages de la dématérialisation pour l’employeur comme pour le salarié. Elle permet ainsi de :
– réduire le coût d’un bulletin de paie de 42 centimes en moyenne en format papier – après affranchissement – à 10 centimes pour une diffusion dématérialisée, selon les données de l’étude d’impact du projet de loi ;
– protéger le salarié contre la perte ou le vol de ses bulletins de paie, qu’il doit pourtant conserver ;
– favoriser l’accès immédiat aux bulletins de paie et leur transmission aux autorités administratives, par exemple au moment de la liquidation des droits à pension ;
– diminuer les impressions, et donc l’impact des bulletins de paie sur l’environnement.
La dématérialisation s’inscrit en parallèle du processus de simplification du bulletin de paie engagé par le Gouvernement. Ainsi, un bulletin de paie simplifié entrera progressivement en vigueur d’ici le 1er janvier 2018.
Le bulletin de paie simplifié
Préconisée par le rapport de M. Jean-Christophe Sciberras de juillet 2015 intitulé « Pour une clarification du bulletin de paie », la création d’un bulletin de paie simplifié sera effective par étapes d’ici 2018. Deux textes réglementaires ont été publiés en février 2016 afin d’en préciser le contenu :
– le décret n° 2016-190 du 25 février 2016 relatif aux mentions figurant sur le bulletin de paie définit les informations devant permettre au salarié d’identifier le coût total du travail et les allégements de cotisations financés par l’État. Il supprime par ailleurs la référence à l’organisme auquel l’employeur verse les cotisations de sécurité sociale et l’obligation d’établir un récapitulatif annuel des prélèvements sociaux. Ce dispositif entrera progressivement en vigueur, à partir du 1er mars 2016 pour les entreprises volontaires et jusqu’au 1er janvier 2018 selon l’effectif de l’entreprise ;
– l’arrêté du 25 février 2016 fixant les libellés, l’ordre et le regroupement des informations devant figurer sur le nouveau bulletin de paie complète ces dispositions. Le référentiel des intitulés de la paie qu’il prévoit permettra au salarié d’évaluer l’effort financier au titre de chaque risque. Son entrée en vigueur est alignée sur celle du décret précité.
L’hébergement du bulletin de paie dématérialisé sur le service en ligne du CPA, enfin, constitue une garantie centrale pour protéger la confidentialité des données et faciliter leur conservation tout au long du parcours professionnel. Cet hébergement sur le CPA ne pourra toutefois être effectué qu’à la demande du salarié. Afin d’en faciliter la demande, le rapporteur insiste donc sur la nécessité de prévoir dans les textes d’application une procédure simple et accessible pour le salarié afin que ses bulletins de paie puissent être hébergés sur le service en ligne du CPA dès 2017.
*
À l’initiative de son rapporteur, la Commission a adopté l’amendement 1016 visant à clarifier la rédaction des dispositions relatives à la consultation du bulletin de paie dématérialisé via le compte personnel d’activité, en cohérence avec la précision adoptée à l’article 21. La remise du bulletin dématérialisé par l’employeur sera effectuée dans des conditions de nature à garantir son accessibilité par le salarié sur le service en ligne du CPA. Cet amendement renvoie par ailleurs à un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, la définition de la mise en œuvre de cette accessibilité, au regard de l’enjeu de préservation de la confidentialité des données.
*
La Commission examine l’amendement AS1016 du rapporteur.
M. le rapporteur. En cohérence avec un amendement adopté à l’article 21, cet amendement vise à faciliter l’accessibilité du bulletin de paie dématérialisé sur le compte personnel d’activité (CPA). Sauf opposition du salarié, le bulletin de paie pourra être transmis par voie dématérialisée et accessible via le CPA. D’autre part, cet amendement renvoie à un décret en Conseil d’État pris après avis de la CNIL l’encadrement de cette accessibilité, que justifie l’impératif de préservation de la confidentialité et de l’intégrité des données à caractère personnel.
La Commission adopte l’amendement.
En conséquence, les amendements AS473 de Mme Jeanine Dubié, AS901 et AS902 de la commission des affaires économiques tombent.
La Commission examine l’amendement AS903 de la commission des affaires économiques.
M. le rapporteur pour avis. Cet amendement vise à prévoir les modalités selon lesquelles le salarié choisit ou non de disposer de son bulletin de paie sous forme électronique. Ce choix peut par exemple prendre la forme d’une clause optionnelle du contrat de travail, éventuellement réversible par voie d’avenant.
M. le rapporteur. Il aurait pour effet de faire coexister au même article deux procédures contradictoires : l’absence d’opposition du salarié d’une part et, d’autre part, son accord exprès. Il faut choisir entre l’une et l’autre. Je vous propose donc de retirer l’amendement.
L’amendement est retiré.
La Commission examine l’amendement AS538 de M. Arnaud Richard.
M. Arnaud Richard. La dématérialisation du bulletin de paie est une idée intéressante, mais il me semble trop optimiste de prévoir sa mise en œuvre dès le 1er janvier 2017. Plus réalistes, nous proposons de décaler son application d’un an. J’ajoute que cette dématérialisation est liée au CPA, lequel ne sera certainement pas opérationnel à cette date.
Concernant l’amendement précédent, le rapporteur a tout à fait raison. Le projet de loi utilise la formule « sauf opposition du salarié », contrairement à la méthode employée jusqu’ici. Néanmoins, la transmission du bulletin se fait via un système de coffre-fort numérique si le salarié le demande, ce qui pose problème.
M. le rapporteur. La France accuse un énorme retard par rapport à ses voisins européens en ce qui concerne la dématérialisation du bulletin de paie. Or, celle-ci permet de réduire le coût de transmission des bulletins et de faciliter leur préservation. J’ajoute que le salarié peut s’opposer s’il le souhaite à la dématérialisation de son bulletin de paie ou à l’« hébergement » de celui-ci sur son CPA. En repoussant d’un an, comme vous le proposez, l’inversion de la règle d’option inscrite à cet article, on priverait le CPA de l’une de ses fonctionnalités importantes ; avis défavorable.
La Commission rejette l’amendement.
Puis elle adopte l’article 24 modifié.
*
* *
Chapitre II
Adaptation du droit du travail à l’ère du numérique
Article 25
(Art. L. 2248-2 du code du travail)
Modalités d’exercice du droit à la déconnexion
Cet article précise la définition et les modalités d’exercice du droit à la déconnexion. Ce droit devient un nouvel objet de la négociation dans l’entreprise et vise à mieux prendre en compte les contraintes que les nouvelles technologies peuvent exercer sur le quotidien des salariés, en particulier en période de repos.
La négociation annuelle sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail porte actuellement sur six items définis à l’article L. 2242-8 du code du travail :
– l’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;
– les objectifs permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
– les mesures permettant de lutter contre les discriminations en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle ;
– celles relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés ;
– les modalités de définition d’un régime de prévoyance et d’un régime de remboursements complémentaires ;
– l’exercice du droit d’expression directe et collective des salariés.
Le droit à la déconnexion, quant à lui, ne fait l’objet d’aucune disposition propre dans le code du travail. S’il peut être assimilé à l’une des conditions du respect de la vie personnelle, il n’est toutefois pas explicitement inscrit dans les textes.
Certaines entreprises ont d’ores et déjà intégré l’enjeu de la déconnexion dans la négociation des conditions de vie au travail. En référence à l’article 17 de l’accord national interprofessionnel (ANI) du 19 juin 2013 relatif à l’amélioration de la qualité de vie au travail et à l’égalité professionnelle, plusieurs accords d’entreprise ont intégré des dispositions devant permettre de mieux concilier vie personnelle et vie professionnelle. À titre d’exemple, l’accord sur les conditions de vie au travail signé par la Société générale en mars 2015 reconnaît un droit à la déconnexion et prévoit la rédaction d’un guide de bon usage de la messagerie.
D’autres entreprises ont mis en place des dispositifs plus fermes destinés à protéger les salariés contre une utilisation excessive des outils numériques. Ainsi, le groupe Volkswagen a adopté une mesure de mise en veille des serveurs depuis un smartphone entre 18h15 et 7h le lendemain.
La diversité de ces initiatives est notamment soulignée dans le rapport de M. Bruno Mettling consacré à la transformation numérique et à la vie au travail.
Transformation numérique et vie au travail : les préconisations du « rapport Mettling »
Dans le cadre d’une mission confiée par le Gouvernement au printemps 2015, Bruno Mettling, alors directeur des ressources humaines du groupe Orange, a remis un rapport consacré aux effets de la transformation numérique sur la vie au travail. Modifiant à la fois les formes et les relations de travail, l’essor des technologies de l’information et de la communication impose une adaptation du droit du travail à cette nouvelle réalité numérique.
Le rapport s’articule autour de trois axes interrogeant les transformations de la vie au travail dans ce contexte et s’appuie sur 36 propositions.
Les conditions de travail, tout d’abord, sont redéfinies au regard du lieu et du temps de travail, notamment avec l’essor de nouvelles formes de télétravail tels que le nomadisme ou le coworking et le développement du travail connecté à distance. Le droit à la déconnexion s’inscrit dans ce contexte : si les technologies de l’information et de la communication augmentent l’efficacité du travail, elles peuvent également alimenter une surcharge d’informations contre-productive pour le salarié.
La qualité de vie au travail, ensuite, rend indispensable une meilleure régulation des moyens de communications électroniques et une nouvelle approche dans la mesure de la charge de travail. La protection de la santé des travailleurs rend, en outre, nécessaire d’appréhender les outils numériques comme un facteur potentiel de risques psycho-sociaux rendant d’autant plus urgent le droit à la déconnexion.
La fonction managériale, enfin, doit s’adapter à un fonctionnement collaboratif croissant et à l’essor du télétravail – voire du « télémanagement ». La plus grande diversité des ressources et la définition d’une culture d’entreprise orientée vers le numérique impliquent de repenser l’exercice du management d’entreprise et l’articulation entre les notions de contrôle et d’autonomie.
Ces initiatives demeurent toutefois isolées et hétérogènes et ne peuvent s’appuyer sur l’existence d’un cadre juridique dédié définissant le contenu du droit à la déconnexion. Il revient donc au législateur d’en dessiner les contours et sa déclinaison par la négociation d’entreprise afin de garantir l’effectivité du droit au repos et au respect de la vie personnelle.
L’article 25 du projet de loi précise les modalités de définition et d’exercice du droit à la déconnexion pour les salariés.
Le 1° du I intègre les outils numériques disponibles dans l’entreprise comme modalités d’exercice du droit d’expression directe et collective des salariés dans l’entreprise.
Le 2° du I place ensuite le droit à la déconnexion dans le champ de la négociation collective. Une septième matière est ainsi ajoutée au contenu de la négociation annuelle sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail. Cette négociation définit désormais les modalités d’exercice par le salarié de son droit à la déconnexion dans l’utilisation des outils numériques afin de garantir le respect des temps de repos et de congé du salarié.
En l’absence d’accord, les modalités d’exercice du droit à la déconnexion seraient définies directement par l’employeur, qui devrait alors les communiquer aux salariés de l’entreprise.
Une charte prévoit plus spécifiquement la mise en œuvre d’actions de formation et de sensibilisation des salariés à l’usage des outils numériques. Prévue pour les entreprises d’au moins 300 salariés, cette charte est communiquée aux salariés et au personnel d’encadrement et de direction. Elle est élaborée après avis du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
Le II prévoit, enfin, une entrée en vigueur de ces dispositions au 1er janvier 2018.
Le double dispositif de négociation dans l’entreprise et de sensibilisation des salariés s’inscrit dans la lignée des préconisations du « rapport Mettling ». Ce dernier considère ainsi la déconnexion au domicile comme une compétence qui se construit au niveau individuel et qui a besoin d’être soutenue au niveau de l’entreprise.
Le rapporteur estime indispensable de préciser dans la loi les contours de ce droit afin d’en garantir l’effectivité pour les salariés. Les technologies de l’information et de la communication sont un outil ambivalent : elles facilitent le fonctionnement de l’entreprise et la communication entre salariés en même temps qu’elles brouillent les frontières entre le temps de travail et le temps libre. Les entreprises doivent donc anticiper et corriger les contraintes pouvant découler du numérique en intégrant le droit à la déconnexion dans la négociation sur l’amélioration de la qualité de vie au travail.
Ainsi, la définition du droit à la déconnexion dans la négociation collective et la rédaction d’une charte à destination du salarié devraient permettre de diffuser une culture de la déconnexion sur le temps libre et de préserver la vie personnelle. L’enjeu central est d’assurer un meilleur équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle et de préserver la séparation entre le lieu de travail et le domicile. À ce titre, le droit à la déconnexion n’a pas pour seul objectif d’assurer le respect des temps de repos et de congé, comme le prévoit l’article 25. Il vise également à préserver la vie familiale et personnelle, et ainsi clarifier la distinction entre le temps professionnel et le temps libre
Le rapporteur souligne, par ailleurs, la nécessité que le droit à la déconnexion s’accompagne de l’appropriation par chaque acteur de l’entreprise d’une forme de « devoir de déconnexion ». En effet, la rapidité des progrès technologiques rend de fait possible le contournement des mesures de déconnexion mises en œuvre par l’entreprise. Au-delà de sa consécration juridique, la déconnexion doit donc en premier lieu irriguer la culture d’entreprise afin de protéger tant les salariés que les employeurs et de préserver leur temps et leur équilibre personnels. La mise en place de dispositifs de régulation et de sensibilisation à l’usage des outils numériques permettrait ainsi de favoriser la diffusion de cet enjeu de déconnexion.
*
Outre trois amendements rédactionnels, la Commission a adopté deux amendements du rapporteur visant à enrichir le dispositif de droit à la déconnexion. D’une part, ce droit est complété par un « devoir de déconnexion », correspondant à la mise en place par l’entreprise de dispositifs de régulation de l’usage des outils numériques. D’autre part, la préservation de la vie personnelle et familiale est ajoutée comme second objectif du droit à la déconnexion, aux côtés du respect des temps de repos et de congé.
La Commission a également adopté les amendements AS941 de M. Yves Blein, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques, et AS 314 de Mme Corinne Erhel visant à garantir le plein exercice du droit à la déconnexion et la sensibilisation à l’usage raisonnable des outils numériques. Deux amendements identiques des mêmes auteurs ont également été adoptés afin de mettre en place une expérimentation nationale relative à l’usage raisonnable des messageries électroniques, en particulier en dehors du temps de travail.
La Commission a par ailleurs adopté l’amendement AS674 de M. Benoît Hamon étendant aux entreprises d’au moins cinquante salariés l’élaboration d’une charte destinée à la mise en œuvre d’actions de formation et de sensibilisation à l’usage des outils numériques.
Enfin, les amendements identiques AS371 de M. Jean-Patrick Gille et AS717 de M. Christophe Cavard prévoyant l’entrée en vigueur de cet article dès le 1er janvier 2017 ont été adoptés.
*
La Commission adopte l’amendement rédactionnel AS867 du rapporteur.
Puis elle est saisie de l’amendement AS940 de la commission des affaires économiques.
Mme Corinne Erhel. Cet amendement précise que l’affirmation du droit à la déconnexion vise non seulement à assurer le respect des temps de repos et de congé du salarié, mais aussi à préserver l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle de ce dernier. Ce point a déjà été abordé lors de la négociation annuelle sur la qualité de vie au travail mais il est important de réaffirmer ici cet objectif.
Introduisant la notion de « plein exercice du droit à la déconnexion », l’amendement vise également à affirmer le rôle central que doit jouer le salarié en la matière.
M. le rapporteur. Si ces deux objectifs me paraissent importants, l’adoption de cet amendement rendrait sans objet ceux qui suivent. Je vous demanderai donc de le retirer.
M. Gérard Sebaoun. Il convient de trouver un équilibre entre le droit du salarié et les devoirs de son entreprise. Or cet amendement, contrairement à ceux qui suivent, est exclusivement centré sur le salarié.
L’amendement est retiré.
La Commission examine ensuite l’amendement AS314 de Mme Corinne Erhel.
Mme Corinne Erhel. Cet amendement vise uniquement à reprendre la deuxième partie de l’amendement précédent, introduisant la notion de « plein exercice » par le salarié de son droit à la déconnexion.
Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement.
Elle étudie ensuite, en discussion commune, les amendements AS1017 du rapporteur et AS337 de M. Gérard Sebaoun.
M. le rapporteur. Mon amendement vise à compléter l’instauration du droit à la déconnexion par celle de devoir de déconnexion, tel que préconisé par le rapport commandé à M. Bruno Mettling. Pour être effectif, le droit de déconnexion du salarié doit s’accompagner de l’appropriation par les acteurs de l’entreprise d’une régulation volontariste et partagée de l’usage des outils numériques. Il s’agit d’aller au-delà des seuls dispositifs techniques de déconnexion mis en place par l’entreprise qui peuvent toujours être contournés.
M. Gérard Sebaoun. Nous vivons dans une société totalement connectée, et j’ignore si nous pourrions faire autrement. Aujourd’hui, les entreprises ont parfaitement intégré la dimension numérique, ce qui n’est pas sans poser problème. Nous avons besoin non seulement de protéger les salariés, mais aussi d’entendre les acteurs de la société qui demandent la liberté de continuer à user de ces objets connectés pendant leur temps de travail comme pendant leur temps personnel. La difficulté est de savoir quand mettre fin à la connexion, et je ne suis pas certain que les acteurs soient favorables à ce que ce soit la loi qui en décide…
La société dans laquelle travaille M. Bruno Mettling a élaboré une charte. D’après lui, la santé et la sécurité du salarié risquant d’être affectées par l’usage intempestif de l’outil du travail, il convient de négocier un équilibre entre entreprise et salarié sans pour autant empiéter sur la liberté qu’ont certains acteurs d’utiliser de façon acceptable cet outil. On ne peut à la fois les priver d’autonomie et parler, comme on le fait aujourd’hui, de nomadisme et de coworking ! Nous ne résoudrons pas le problème en adoptant des règles trop rigides – comme l’a fait Volkswagen en Allemagne –, car les utilisateurs d’objets connectés savent parfaitement contourner tous les obstacles techniques qu’on peut leur imposer.
L’amendement que je propose tend à assurer un équilibre entre l’exercice du droit à la déconnexion et le devoir de déconnexion et renvoie à la négociation collective le soin de définir les modalités de cet équilibre.
M. le rapporteur. Je partage totalement vos propos, monsieur Sebaoun. Il est tout à fait nécessaire d’envisager le problème tant du côté du salarié que de celui de l’employeur. Simplement, nous n’avons pas encore de définition précise du devoir de déconnexion, expression à laquelle vous faites référence dans votre amendement. Je vous propose donc de le retirer au profit du mien qui évoque la mise en place, par l’entreprise, de dispositifs de régulation – éléments plus faciles à identifier tout en ayant le même objectif que le vôtre.
M. Gérard Sebaoun. Je suis d’accord pour retirer mon amendement. J’ajouterai simplement que le plus important, dans la négociation collective qui doit s’ouvrir entre les acteurs, sera de définir la charge de travail.
L’amendement AS337 est retiré.
La Commission adopte l’amendement AS1017.
Elle adopte ensuite l’amendement rédactionnel AS869 du rapporteur.
Puis elle aborde, en discussion commune, les amendements AS1018 du rapporteur et AS261 de Mme Corinne Erhel.
M. le rapporteur. L’exercice du droit à la déconnexion n’a pas pour unique objectif d’assurer le respect des temps de repos et de congé. Il vise également à garantir la préservation de la vie personnelle et familiale. C’est le sens de mon amendement.
Mme Corinne Erhel. Le mien a pour objet de viser dans le texte la préservation de l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle.
M. le rapporteur. Comme il est rédigé dans le même esprit que le mien, je vous propose de le retirer.
L’amendement AS261 est retiré.
La Commission adopte l’amendement AS1018.
Elle adopte ensuite l’amendement rédactionnel AS868 du rapporteur.
Puis elle en vient à l’amendement AS674 de M. Benoît Hamon.
M. Kader Arif. Aujourd’hui, un cadre moyen doit traiter environ 150 sollicitations par jour, que ce soit par e-mail ou sur son portable. Le traitement et la rapidité de l’accès à l’information sont essentiels au travail des salariés, mais l’omniprésence croissante des flux d’information peut s’avérer contre-productive et dangereuse lorsqu’elle empêche le repos. Le Gouvernement propose donc que les modalités d’exercice du droit à la déconnexion soient discutées lors des négociations annuelles sur la qualité de vie au travail.
Toutefois, pour que la déconnexion soit effective, elle ne doit pas simplement être un droit pour les salariés mais un devoir pour les employeurs. Nous proposons donc de rendre contraignante l’obligation faite à l’employeur de définir et communiquer les modalités d’exercice de son droit par le salarié. Enfin, il est essentiel de permettre l’application de ce droit aux salariés des entreprises comprenant au moins 50 salariés.
M. le rapporteur. Vous proposez que la charte prévue à cet article soit plus largement diffusée, ce qui me semble cohérent avec l’objectif du texte. Je m’interroge néanmoins quant à l’opportunité d’obliger toute entreprise d’au moins cinquante salariés à élaborer une telle charte – qui ne doit pas s’apparenter à une nouvelle contrainte formelle. Cela étant, j’émettrai un avis favorable à cet amendement.
M. Gérard Sebaoun. Je ne suis guère favorable aux chartes : il en existe dans plusieurs grands groupes, mais je ne suis pas certain qu’il soit efficace d’en édicter à des niveaux inférieurs.
La Commission adopte l’amendement.
Elle examine l’amendement AS941 de la commission des affaires économiques.
M. le rapporteur pour avis. Il s’agit d’un amendement de précision rédactionnelle.
M. le rapporteur. J’y suis favorable sous réserve d’une rectification : accepteriez-vous d’en supprimer les mots « de l’entreprise » ?
M. le rapporteur pour avis. Oui.
M. Gérard Sebaoun. La notion d’usage raisonnable n’a pas grand-chose à voir avec le sujet dont nous parlons.
Mme la présidente Catherine Lemorton. Lors de son audition, M. Mettling nous a bien dit que les partenaires sociaux avançaient un peu dans l’inconnu sur la question numérique et qu’ils préféraient observer les choses avant d’agir. Je ne suis pas certaine que nous ayons nous-mêmes une vision bien claire de ce qui se passe. Il n’est pas idéal de faire figurer l’adjectif « raisonnable » dans la loi, mais, à défaut d’autre solution, je propose que nous retenions cette rédaction pour l’instant.
La Commission adopte l’amendement AS941 tel qu’il vient d’être rectifié.
Puis elle en vient à l’amendement AS757 de M. Benoît Hamon.
M. le rapporteur. Avis défavorable. L’instauration d’une sanction me semble poser problème.
L’amendement est retiré.
La Commission aborde les amendements identiques AS942 de la commission des affaires économiques et AS263 de Mme Corinne Erhel.
Mme Corinne Erhel. De nombreuses réflexions ont été engagées de façon non coordonnée sur l’usage des messageries électroniques en dehors des horaires de travail classiques et durant les jours non travaillés. Dans la continuité de ces initiatives dispersées, cet amendement vise à instituer une expérimentation coordonnée par la puissance publique afin d’explorer cette question au sein d’entreprises de tailles, de secteurs et de structures variables, mais aussi au sein d’administrations publiques. Un décret définira le périmètre de cette expérimentation et notamment les structures publiques et privées concernées, la taille de l’échantillon, les populations cibles et les modalités d’évaluation. À l’issue de cette expérimentation, des lignes directrices seront définies à l’usage des entreprises et des administrations publiques sur cette question de plus en plus prégnante à l’heure où le numérique bouleverse l’ensemble des modèles d’organisation.
Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte les amendements.
Elle examine ensuite, en discussion commune, les amendements identiques AS371 de M. Christophe Cavard et AS717 de M. Jean-Patrick Gille, ainsi que les amendements identiques AS943 de la commission des affaires économiques et AS262 de Mme Corinne Erhel.
M. Christophe Cavard. Il n’y a aucun frein technique à la mise en application des mesures que nous venons d’adopter. Nous proposons donc d’en avancer l’entrée en vigueur d’un an, au 1er janvier 2017.
Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte les amendements identiques AS371 et AS717.
En conséquence, les amendements AS943 et AS262 tombent.
La Commission adopte l’article 25 modifié.
*
* *
Article 26
Ouverture d’une concertation relative au travail à distance et à l’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle
Cet article prévoit l’engagement d’une concertation avec les partenaires sociaux relative au développement du travail à distance et à l’impact des outils numériques sur l’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle.
Les technologies de l’information et de la communication facilitent les échanges à distance et l’émergence de nouvelles formes d’organisation du travail. En conséquence, elles favorisent le travail à distance et entraînent une redéfinition de la notion même de lieu de travail.
Le travail à distance a historiquement pris la forme du télétravail, permettant au salarié de partager son temps de travail entre les locaux de l’entreprise et son domicile. Il peut être occasionnel – par exemple dans le cas d’une interruption des transports en commun – ou devenir la forme habituelle d’exécution du contrat de travail.
Le travail à distance ne se limite toutefois pas au télétravail et recouvre au moins deux réalités supplémentaires.
Le nomadisme, tout d’abord, concerne les salariés exerçant une partie de leur activité en déplacement, par exemple au domicile des clients.
Le travail en télé-local, ensuite, consiste à exercer son activité dans un espace distinct du domicile et de l’entreprise, aux côtés d’autres travailleurs relevant le plus souvent d’employeurs distincts. Le « co-working » en constitue l’une des principales modalités.
Une même forme de travail à distance peut s’exercer différemment selon les règles d’organisation propres à chaque entreprise. Ainsi, la mise à disposition d’outils collaboratifs à distance et le nombre de jours travaillés dans l’entreprise et à distance varient selon les entreprises et les missions du salarié.
Le travail à distance est longtemps demeuré moins répandu en France que dans les autres pays européens. Ce retard est parfois expliqué par une forte culture de la présence physique au travail en France, « longtemps considérée comme une condition sine qua non de l’efficacité, du contrôle, mais aussi du travail en équipe » (55).
Cette spécificité française semble toutefois décroître, un nombre croissant d’entreprises françaises pratiquant désormais le travail à distance. Ainsi, la part de salariés ayant recours au télétravail a doublé en six ans, passant de 8 % en 2006 à près de 17 % en 2012 (56).
Le plein essor du travail à distance en France se heurte toutefois à plusieurs freins juridiques, culturels et matériels. Dans son rapport consacré au développement du télétravail, le Centre d’analyse stratégique (57) identifiait quatre séries d’obstacles au développement du télétravail :
– la mauvaise connaissance des responsabilités et les ambiguïtés du cadre juridique, concernant en particulier la présomption d’accident du travail ;
– la dévalorisation sociale et la méconnaissance du télétravail, qui n’est parfois pas accepté comme une forme de travail à part entière ;
– le déficit d’infrastructures et de sécurité des systèmes dans certains territoires, en lien avec l’existence d’une fracture numérique ;
– la crainte d’abus et d’une perte de pouvoir des dirigeants, du fait d’un relâchement du contrôle et de la supervision de l’exécution des tâches.
Le développement du travail à distance est donc conditionné à l’existence d’un cadre juridique définissant clairement les contours des droits et sujétions du salarié l’exerçant ainsi que la responsabilité de l’employeur.
L’encadrement juridique du travail à distance constitue un préalable à son développement afin d’en clarifier les contours – notamment au regard du consentement du salarié – et de prévenir les risques contentieux.
Jusqu’alors dépourvu de dispositions consacrées au travail à distance, le code du travail encadre désormais son exercice et clarifie sa définition.
Reprenant les dispositions de l’accord-cadre européen sur le télétravail conclu le 16 juillet 2002, l’accord national interprofessionnel (ANI) du 19 juillet 2005 sur le télétravail – ensuite étendu par arrêté du 30 mai 2006 – donne une définition au télétravail et précise les obligations du salarié et de l’employeur. Il prévoit notamment la réversibilité du télétravail afin de permettre à tout salarié de revenir dans l’entreprise à un poste correspondant à sa qualification. Ces dispositions ont ensuite été reprises par le législateur. L’article 46 de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l’allégement des démarches administratives a ainsi défini le contenu du télétravail.
L’article L. 1222-9 du code du travail précise, tout d’abord, la définition et l’encadrement par le contrat de travail du télétravail. Ce dernier est défini comme toute forme d’organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l’employeur est effectué par un salarié à l’extérieur. Exercé de manière régulière et volontaire, le télétravail est encadré par le contrat de travail ou un avenant à celui-ci, qui précise notamment les conditions de retour à une exécution du contrat de travail sans télétravail. Les modalités de contrôle du temps de travail sont définies par l’accord collectif ou, à défaut, par le contrat de travail ou son avenant.
L’article L. 1222-10 du code précité identifie, ensuite, cinq obligations de l’employeur à l’égard de son salarié en télétravail, s’ajoutant à ses obligations de droit commun vis-à-vis de ses salariés. L’employeur doit ainsi :
– prendre en charge tous les coûts liés à l’exercice du télétravail, concernant notamment les matériels et les logiciels ;
– informer le salarié de toute restriction à l’usage des équipements et outils informatiques ;
– donner priorité au salarié pour occuper ou reprendre un poste sans télétravail ;
– organiser chaque année un entretien portant notamment sur les conditions d’activité du salarié ;
– fixer les plages horaires durant lesquelles le salarié peut être contacté.
En cas de circonstances exceptionnelles, enfin, le télétravail peut être considéré comme un aménagement du poste de travail devant permettre la continuité de l’activité de l’entreprise et la protection des salariés, par exemple en cas d’épidémie. Prévue à l’article L. 1222-11 du code précité, cette disposition devait être précisée par un décret en Conseil d’État non publié à ce jour.
Désormais inscrit dans le code du travail, le travail à distance demeure moins pratiqué en France que chez la plupart des pays européens. La négociation dans l’entreprise est pourtant centrale pour faciliter sa diffusion et son appréhension comme un travail à part entière. Dix ans après sa signature, l’ANI pourrait donc être adapté afin de tirer les conséquences de l’essor sans précédent du numérique dans les relations de travail. En outre, certains enjeux centraux – tel que le régime d’accident du travail – pourraient être clarifiés.
L’article 26 du projet de loi prévoit ainsi qu’une concertation est engagée avant le 1er octobre 2016 sur le développement du télétravail et du travail à distance avec les organisations professionnelles d’employeurs et syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel. Ces dernières pourront, si elles le souhaitent, ouvrir une négociation à ce sujet.
Le rapporteur soutient cette démarche d’adaptation du cadre juridique à la nouvelle diversité du travail à distance, dépassant le seul télétravail aujourd’hui régi par le code du travail. L’engagement éventuel d’une négociation par les partenaires sociaux permettra d’actualiser les termes de l’ANI de 2005 et d’assurer une meilleure régulation des nouvelles formes de travail à distance. Il conviendra notamment de définir des règles de bonnes pratiques pouvant faciliter l’appropriation du travail à distance. Il pourrait par exemple être prévu que les avenants au contrat de travail définissent une présence minimale dans l’entreprise chaque semaine afin d’éviter l’isolement du télétravailleur et de garantir la qualité de vie au travail en entreprise comme à distance.
La concertation est ensuite élargie à l’enjeu de l’articulation entre le temps professionnel et le temps libre pour les salariés en forfait jours, afin de prolonger la réflexion relative à la prise en compte de la charge de travail et à l’impact des technologies numériques sur le quotidien des salariés.
Susceptibles d’être l’objet d’une négociation entre partenaires sociaux, ces matières pourront par la suite faire l’objet d’un encadrement par voie conventionnelle ou législative. Le rapporteur appuie cette démarche et estime indispensable de prendre en compte dès à présent cette nouvelle réalité numérique qui redéfinit à la fois le temps, le lieu et la charge de travail. Il regrette toutefois que l’étude d’impact du projet de loi ne précise aucun des enjeux ou des dispositifs envisagés en matière de charge de travail ou de fractionnement du repos des salariés en forfait jours et se limite au seul télétravail. L’association des parlementaires à cette réflexion est pourtant indispensable pour ouvrir dès à présent le débat sur la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et garantir une prise en compte des nouveaux besoins des salariés.
L’essor des technologies de l’information et de la communication a un impact direct sur la charge de travail du salarié. Facilitant la diffusion des informations et la gestion des responsabilités en tout lieu et à tout endroit, les outils numériques rendent nécessaire de mesurer différemment la charge de travail au-delà de sa seule dimension physique. L’enjeu sous-jacent est donc celui d’une redéfinition de la notion de « charge de travail » et de sa prise en compte.
Cette redéfinition de la charge de travail est tout particulièrement nécessaire pour les salariés en forfait jours. En cohérence avec les dispositions contenues à l’article 2 du projet de loi, la concertation engagée par le Gouvernement est donc élargie à l’évaluation de la charge de travail de ces salariés.
Les nouvelles formes de travail liées aux technologies de l’information et de la communication peuvent fragiliser la distinction entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Le travail à distance, en particulier, rend plus difficile la vérification du respect des temps de repos par le salarié et la préservation des temps de récupération. Le temps et le lieu de travail sont dès lors plus difficiles à identifier et brouillent la frontière entre le domicile et le lieu de travail. Cette réalité s’applique tout particulièrement aux salariés en forfait jours pour lesquels la préservation du temps libre et de la vie personnelle est parfois délicate.
Le rapporteur appuie cette extension de la concertation – et de la négociation ultérieure – à la prise en compte des pratiques liées aux outils numériques afin notamment de faciliter le bon usage des technologies et, a fortiori, d’éviter la multiplication des risques psychosociaux. La mise en place au sein de l’entreprise d’une politique de régulation de l’usage des outils numériques, préconisée par M. Bruno Mettling dans sa proposition n° 20, constituera l’un des enjeux de cette concertation afin de faciliter une appropriation raisonnée des outils numériques et une sélection simplifiée des informations pertinentes.
L’article 26 du projet de loi inclut, enfin, dans le champ de la concertation ouverte par le Gouvernement la réflexion relative à l’application du principe de fractionnement du temps de repos du salarié en forfait jours. Ce fractionnement pourrait s’appliquer à la fois aux temps de repos quotidien et hebdomadaire.
Le rapporteur soutient le renvoi de cet enjeu à la concertation, qui pourra être l’objet de prochaines négociations entre les syndicats de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs.
*
Outre un amendement rédactionnel, la Commission a adopté l’amendement AS1019 du rapporteur visant à compléter cet article par la demande d’un rapport du Gouvernement au Parlement. Destiné à garantir l’information des parlementaires au terme de la concertation menée, ce rapport permettra de préciser les évolutions juridiques envisagées dans la définition des notions de lieu, de charge et de temps de travail.
*
La Commission examine l’amendement AS86 de M. Patrick Hetzel.
M. Élie Aboud. Nous sommes tous sensibles à ce que peut apporter le télétravail. Mais il faut lutter contre son dévoiement, qui organiserait en réalité une externalisation des activités : le maintien d’un lien entre l’employeur et le télétravailleur est indispensable.
Il faut laisser la liberté aux partenaires sociaux d’engager une concertation sur le télétravail. Le Conseil d’État a en outre, vous le savez, souligné que cet article ne revêtait aucune portée normative.
M. Christophe Sirugue, rapporteur. Avis défavorable. Le développement récent du télétravail, du nomadisme ou du coworking, rend indispensable une évolution de notre cadre juridique, qui n’est plus adapté – je pense notamment au régime d’imputabilité des accidents du travail des travailleurs à distance. C’est pourquoi une concertation doit s’engager entre les partenaires sociaux.
M. Gérard Sebaoun. Je soutiens le rapporteur. Le télétravail mérite d’être développé, et de faire l’objet de négociations dans les entreprises, afin de garantir le mieux-être des salariés demandeurs. Certaines ont longtemps été réticentes quand d’autres s’engageaient. Le développement de nouvelles formes de travail pose des questions considérables : le lien entre le télétravailleur et son entreprise, mais aussi les garanties juridiques, notamment en cas d’accident du travail, ont été cités, mais il faut aussi ajouter la question de l’autonomie de certains salariés dans une conception hiérarchique et managériale de l’entreprise. La place des managers et des réunions d’équipe est remise en question : il est important de pouvoir en parler tranquillement.
M. Élie Aboud. Nous sommes tous d’accord sur le fond. Il faut en tout cas que ce soit clair pour le salarié qui accepte ce statut.
Mme Isabelle Le Callennec. Les partenaires sociaux ont commencé à travailler sur les conséquences de l’uberisation de la société ; je suppose qu’ils ont également commencé à se concerter sur le télétravail.
La Commission rejette l’amendement.
Puis elle se saisit de l’amendement AS944 de la commission des affaires économiques.
M. Yves Blein, rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques. Cet amendement a été proposé à la commission des affaires économiques par Mme Troallic. Il tend à préciser que le télétravail ne peut représenter l’intégralité du temps travaillé par un salarié, et que les droits et avantages légaux et conventionnels dont bénéficie le télétravailleur ne peuvent être inférieurs à ceux des salariés en situation comparable travaillant dans les locaux de l’entreprise. Enfin, les négociations collectives d’entreprise doivent prévoir les conditions d’organisation du télétravail.
J’avais émis un avis favorable, sous réserve, je le précise ici, de la prise en considération du résultat de la concertation des partenaires sociaux.
M. le rapporteur. Avis défavorable. J’approuve absolument l’intention de l’amendement, mais je ne suis pas favorable à l’inscription de ces principes dans la loi : laissons d’abord les partenaires sociaux échanger sur le sujet. Ce dialogue entre les employeurs et les représentants des salariés est d’autant plus indispensable en l’occurrence que les situations sont multiples et très complexes. Je vous suggère donc de retirer l’amendement.
M. Gérard Sebaoun. J’approuve les principes inscrits dans l’amendement. Toutefois, ces questions doivent être envisagées de façon globale. Ainsi, pensons à une entreprise qui veut élargir les horaires de présence de ces salariés ; l’ensemble des salariés seront concernés. Une négociation est donc indispensable.
L’amendement est retiré.
La Commission adopte ensuite l’amendement rédactionnel AS870 du rapporteur.
Puis elle se saisit de l’amendement AS736 de Mme Eva Sas.
Mme Eva Sas. Il s’agit d’un amendement de cohérence avec l’amendement AS739 adopté hier soir, qui supprime la possibilité de déroger au repos quotidien de onze heures consécutives.
Il s’agit d’éviter le fractionnement du repos des salariés qui télétravaillent. En effet, s’il est opportun qu’une concertation s’engage, il faut l’encadrer, en insistant notamment sur la séparation entre vie professionnelle d’un côté, vie personnelle et familiale de l’autre.
M. le rapporteur. Mes arguments seront les mêmes que pour l’amendement précédent : vous faites le choix – que je respecte – d’ôter certains éléments de la concertation. Je ne suis naturellement pas insensible aux questions que vous soulevez, et je n’imagine pas qu’elles ne soient pas au cœur des discussions des partenaires sociaux. Mais l’idée est bien de renvoyer à la concertation, et donc de ne pas cadenasser les échanges. Avis défavorable.
Mme Eva Sas. L’article 26 suggère explicitement, monsieur le rapporteur, que les discussions des partenaires sociaux portent sur « les modalités du fractionnement du repos quotidien ou hebdomadaire de ces salariés ». Nous proposons simplement de ne pas orienter la concertation dans ce sens.
M. Gérard Sebaoun. Ma lecture de cet article n’est pas la même. La négociation est, me semble-t-il, encadrée. Pas plus que moi vous ne défendez le fractionnement du repos, madame Sas, mais cette idée peut être évoquée par les partenaires sociaux – quitte à ce qu’elle soit balayée.
La Commission rejette l’amendement.
Puis elle se saisit de l’amendement AS556 de M. Arnaud Richard.
M. Arnaud Richard. Cet amendement, reprenant l’une des propositions de l’excellent rapport de Bruno Mettling, vise à prévoir, dans les accords d’entreprise, une clarification de la question de l’imputabilité en cas d’accident du travailleur à distance. C’est une carence dans la couverture des accidents du travail : les télétravailleurs à domicile ne sont pas couverts par l’actuelle présomption d’imputabilité de l’accident au travail. Pour établir un climat de confiance propice au développement du télétravail, il nous paraît judicieux que les accords d’entreprise lèvent toute ambiguïté sur ce qu’il advient en cas d’accident pendant les plages horaires travaillées.
M. le rapporteur. C’est là, à nouveau, un sujet extrêmement important, et vous avez entièrement raison de soulever ce problème. Vous l’avez dit, une présomption d’imputabilité de la responsabilité de l’employeur existe dans le cadre classique du travail, mais une ambiguïté persiste si un accident survient pendant les plages horaires télétravaillées. À l’évidence, il va falloir avancer.
Encore une fois, néanmoins, laissons les partenaires sociaux travailler. De toute façon, c’est au législateur qu’il reviendra de décider s’il faut suivre les conclusions des négociations. Cela me paraît conforme à l’esprit de l’article.
M. Gérard Sebaoun. Le télétravail est souvent souhaité le mercredi, pour des raisons que chacun imagine – disons les choses comme elles sont, ce sont malheureusement le plus souvent les femmes qui s’occupent des enfants ce jour-là. Quel est le statut d’un accident survenant sur le trajet entre l’école où l’on va chercher les enfants et la pièce de télétravail ? Ce sont des questions complexes. Le sujet est en tout cas important.
M. Bernard Accoyer. Le projet de loi promet « de nouvelles libertés et de nouvelles protections pour les entreprises et les actifs » et le Gouvernement souhaite à juste titre encourager le télétravail : il existe d’ailleurs un accord-cadre européen sur le sujet. Mais les solutions que vous imaginez vont au contraire freiner son développement : c’est l’éternelle et curieuse démarche du Gouvernement. Nos interminables débats d’hier soir ont montré que, même avec de bonnes intentions, il finit toujours par mettre en place, avec l’aide de sa majorité, des dispositifs lourds, complexes et inefficaces. Tous ces amendements sont intéressants sur le fond, mais ils ne seront pas les moteurs dont notre pays a besoin pour favoriser l’embauche et faire redémarrer la croissance économique. Je ne les voterai donc pas.
M. Arnaud Richard. J’entends les arguments du rapporteur : il faut en effet laisser les partenaires sociaux – auxquels, vous le savez, je suis très attaché – prendre leurs responsabilités. Mais le sujet du télétravail ne date pas d’hier et ils n’ont pourtant jamais voulu le traiter : votre démarche me paraît un peu naïve, monsieur le rapporteur. Pourquoi se prendraient-ils soudainement d’affection pour un sujet qu’ils n’ont jamais voulu aborder ?
Je vous l’accorde, cet amendement n’est pas parfait. Mais quelque 700 000 accidents du travail se produisent chaque année en France, dont peut-être une dizaine concernent des télétravailleurs. Il existe à l’évidence un problème d’accidents du travail qui ne sont pas pris en considération comme tels.
M. le rapporteur. Ce que vous dites est faux, monsieur Richard : l’accord national interprofessionnel (ANI) du 19 juillet 2005 traitait du télétravail. Ne dites donc pas que les partenaires sociaux ne s’en sont jamais préoccupés ! Depuis 2005, le phénomène s’est amplifié, et des problèmes sont apparus : c’est pour cela que nous souhaitons que les partenaires sociaux s’emparent à nouveau de la question, pour faire un point d’étape et se mettre d’accord sur les évolutions nécessaires.
Il y aura une concertation. Faut-il tenir la main des négociateurs et dresser pour eux la liste des sujets qu’ils doivent aborder ? Je ne le crois pas. Faisons-leur confiance. Ils connaissent encore mieux que nous les questions qui sont soulevées dans les entreprises.
Je vous suggère donc de retirer l’amendement.
M. Gérard Sebaoun. Parmi les sujets à traiter, les questions du travail à domicile et du coworking sont un peu différentes.
M. Arnaud Richard. Pour montrer tout l’intérêt que j’accorde au dialogue social, je retire l’amendement.
L’amendement est retiré.
La Commission examine alors l’amendement AS536 de M. Arnaud Richard.
M. Francis Vercamer. Les partenaires sociaux se sont penchés sur la question du télétravail en 2005, c’est vrai. Mais, aujourd’hui, 16 % seulement des salariés sont concernés, contre 40 % au Royaume-Uni : le télétravail a bien du mal à prendre son envol dans notre pays, pour des raisons culturelles peut-être, mais aussi parce que le haut débit n’est pas suffisamment développé. Sur ce dernier point, le Gouvernement a pris des mesures, et je m’en réjouis.
Le télétravail est un gisement d’emplois extraordinaire : il permet, en zone rurale, de travailler sans avoir à se préoccuper de transports, par exemple. Pour donner un coup d’accélérateur, je propose de supprimer complètement, pendant un an, les charges pour toute embauche d’un télétravailleur en CDI. Cela inciterait les entreprises à se pencher sur le sujet. Certes, cela coûterait de l’argent, mais cela créerait du travail et permettrait un meilleur aménagement du territoire, en aidant les zones rurales mal desservies.
En ces temps de mondialisation, cela me paraîtrait une bonne idée. De plus, un tel dispositif fiscal pousserait les partenaires sociaux à engager une concertation. L’article 26 indique en effet qu’ils ouvrent une discussion « [s’ils] le souhaitent ». S’ils ne le souhaitent pas, il ne se passera rien.
M. Gérard Sebaoun. L’idée est sans doute à creuser.
En revanche, aux termes du projet de loi, la concertation doit être engagée – les termes « si elles le souhaitent » portent sur l’ouverture éventuelle d’une négociation.
M. Francis Vercamer. Si elles ne le souhaitent pas, pas de négociation !
Mme la présidente Catherine Lemorton. Elle s’ouvrira, j’en suis sûre : c’est un sujet qui s’imposera aux entreprises !
M. le rapporteur. S’agissant de la formulation de l’article, elle est tout à fait usuelle. Les partenaires sociaux doivent accepter de se saisir d’un sujet pour que s’ouvre une négociation : vous savez cela mieux que moi.
Votre amendement suggère déjà une conclusion des débats. Le législateur devra s’emparer de la question après les partenaires sociaux, peut-être de la manière que vous suggérez. Mais ne mettons pas la charrue avant les bœufs.
Je vous propose de retirer l’amendement ; sinon, j’y serai défavorable – pour des raisons de méthode, puisque, encore une fois, je ne suis pas en désaccord sur le fond.
M. Francis Vercamer. Je retire l’amendement. Je le redéposerai en séance publique pour entendre l’avis du Gouvernement.
L’amendement est retiré.
La Commission se saisit de l’amendement AS1019 du rapporteur.
M. le rapporteur. Le Parlement doit être informé des résultats de la concertation menée. C’est pourquoi cet amendement tend à demander un rapport du Gouvernement sur ce sujet avant le 1er décembre 2017. Nous avons adopté un dispositif similaire pour le compte personnel d’activité.
La Commission adopte l’amendement.
Puis elle adopte l’article 26 modifié.
*
* *
La Commission examine l’amendement AS946 de la commission des affaires économiques.
M. Yves Blein, rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques. Cet amendement a également été proposé à la commission des affaires économiques par Mme Troallic. Il vise notamment à s’assurer que le télétravailleur dispose des moyens matériels et techniques nécessaires, que les plages horaires durant lesquelles il peut habituellement être contacté sont fixées, et que le salarié et sa hiérarchie reçoivent une formation appropriée à l’exercice du télétravail.
Toutefois, ayant entendu les réponses du rapporteur aux précédents amendements, et approuvant l’idée qu’il faut laisser toute sa place au dialogue social, je retire l’amendement.
L’amendement est retiré.
*
* *
Article 27
(Art. L. 2142-6, L. 2324-19 et L. 2314-21 du code du travail)
Adaptation du dialogue social aux pratiques numériques
Cet article adapte le cadre juridique du dialogue social dans l’entreprise aux outils numériques. Il vise à favoriser la communication syndicale en ligne et à encourager le vote électronique lors de l’élection des membres des comités d’entreprise et des délégués du personnel.
Le I de cet article procède à une réécriture de l’article L. 2142-6 du code du travail relatif à la diffusion des communications syndicales.
Deux types de communications syndicales sont à distinguer : la communication sous format papier, d’une part ; la communication dématérialisée, d’autre part. Si le recours aux communications syndicales en ligne se développe progressivement à l’heure de la généralisation de l’intranet d’entreprise, il reste toutefois minoritaire par rapport aux communications traditionnelles sous forme de tracts ou de panneaux d’affichage.
Le droit en vigueur prévoit qu’un accord d’entreprise peut autoriser la mise à disposition des publications syndicales soit sur l’intranet, soit sur la messagerie électronique de l’entreprise. La diffusion sur la messagerie électronique doit alors être compatible avec les exigences de bon fonctionnement du réseau informatique et ne doit pas entraver l’accomplissement du travail. Les modalités de cette diffusion sont définies par l’accord d’entreprise, afin notamment de préserver la liberté de choix des salariés d’accepter ou de refuser un message.
La nouvelle rédaction étend les modalités de communication syndicale en ligne à tous les outils numériques disponibles dans l’entreprise, tout en préservant la définition par l’accord d’entreprise de leurs modalités de diffusion.
Elle aménage, ensuite, la diffusion dématérialisée des communications syndicales dans le cas où aucun accord d’entreprise ne l’aurait encadrée. En l’absence d’accord, toute organisation syndicale peut procéder à une diffusion en ligne de ses communications à condition de respecter trois critères :
– satisfaire aux critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance ;
– être légalement constituée depuis au moins deux ans ;
– avoir un champ professionnel et géographique couvrant celui de l’entreprise ou de l’établissement.
La communication en ligne s’effectue alors, dans ce cas, via un site syndical accessible depuis l’intranet de l’entreprise.
Les conditions de compatibilité avec le bon fonctionnement du réseau informatique de l’entreprise, d’absence d’entrave à l’accomplissement normal du travail et de préservation de la liberté de choix du salarié d’accepter ou de refuser un message sont reprises afin d’assurer un encadrement minimal. Une exigence de compatibilité avec la sécurité du réseau de l’entreprise est, par ailleurs, ajoutée.
Le II de cet article facilite le recours au vote dématérialisé lors des élections professionnelles.
Le droit en vigueur prévoit que ces élections peuvent avoir lieu sous deux formes :
– au scrutin secret sous enveloppe ;
– par vote électronique, à condition qu’un accord d’entreprise ait été conclu, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. L’accord comprend alors un cahier des charges respectant les prescriptions légales minimales.
En l’absence de protocole d’accord préélectoral valide, l’accord collectif prévoyant le recours au vote électronique peut être mis en œuvre unilatéralement par l’employeur, selon la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass, soc, 4 juin 2014).
L’article 27 du projet de loi lève un obstacle à la dématérialisation du vote en autorisant la mise en place du vote électronique en cas d’absence d’accord d’entreprise, dès lors que l’employeur le décide. Si la négociation d’un accord demeure donc le principe, la fixation par l’employeur des modalités du vote électronique en l’absence d’accord devrait permettre de faciliter sa diffusion. Ses modalités de mise en œuvre demeurent précisées par un décret en Conseil d’État.
Le 1° du II intègre ces modifications à l’article L. 2314-21 du code du travail consacré à l’élection des délégués du personnel. Le 2° procède à la même modification à l’article L. 2324-19 relatif à l’élection des membres des comités d’entreprise.
Le rapporteur soutient cette démarche de simplification du recours au vote par voie dématérialisée lors des élections professionnelles. Ce dispositif devrait notamment permettre de renforcer le taux de participation à ces élections, face à l’absence d’institutions représentatives du personnel dans une partie des petites et moyennes entreprises.
*
La Commission a adopté deux amendements rédactionnels à cet article
*
La Commission examine l’amendement AS259 de Mme Jacqueline Fraysse.
M. André Chassaigne. Je parle souvent d’appellation d’origine contrôlée, vous le savez, et aujourd’hui je voudrais – par souci d’œcuménisme – donner plus de sens à l’appellation du projet de loi, qui tend aussi à instaurer de « nouvelles libertés pour les actifs ».
L’article 27 vise à renforcer l’utilisation des outils numériques dans l’exercice du dialogue social. Il est prévu qu’un accord d’entreprise précise notamment les modalités de diffusion numérique des informations syndicales. Ce modeste amendement demande qu’une négociation sur ce sujet puisse être engagée sur simple demande des organisations syndicales. Il s’agirait bien là d’une nouvelle liberté pour les actifs.
M. le rapporteur. Votre intention me paraît satisfaite par le texte, qui prévoit explicitement que l’absence d’accord d’entreprise n’empêchera nullement le recours à la communication syndicale en ligne. Des garanties liées à la sécurité du réseau informatique ou à la liberté de choix du salarié sont toutefois prévues afin d’assurer un encadrement minimal.
La Commission rejette l’amendement.
Puis elle adopte successivement les amendements rédactionnels AS871 et AS872 du rapporteur.
Elle en vient ensuite à l’amendement AS167 de M. Gérard Cherpion.
M. Élie Aboud. L’article 27 vise à faciliter la diffusion de l’information syndicale au sein de l’entreprise en limitant le regard de l’employeur sur les contenus diffusés. Il nous semble donc que, à tout le moins, les messages diffusés ne doivent pas comporter de propos nominatifs, susceptibles de semer le trouble.
M. le rapporteur. Il me semble curieux de vouloir encadrer à ce point l’expression syndicale. Je rappelle que les règles juridiques en vigueur par exemple en matière de diffamation s’appliquent à ce type de documents. Cette restriction pourrait d’ailleurs être facilement contournée en employant non pas le nom de la personne concernée, mais sa fonction au sein de l’entreprise. Avis défavorable.
M. Bernard Accoyer. Cet amendement permettrait d’améliorer le climat qui prévaut, hélas, trop souvent dans les entreprises où certaines personnes sont stigmatisées du fait de leurs responsabilités et des décisions de parti pris qu’on les soupçonne de prendre à l’encontre d’une partie du personnel.
M. Élie Aboud. Nous ne souhaitons pas compliquer la diffusion des messages syndicaux, mais, au contraire, la faciliter, puisque l’accord préalable de l’employeur pour l’utilisation de l’intranet est supprimé.
M. le rapporteur. Vous interdisez les propos nominatifs même en cas d’accord, et je répète que je ne me vois pas inscrire dans la loi qu’un document syndical ne peut mentionner le nom d’une personne. Ce serait inouï !
M. Gérard Sebaoun. Je partage l’avis du rapporteur ; il s’agit d’une proposition quelque peu lunaire.
M. Gérard Cherpion. Il ne faut pas confondre la fonction et la personne. Autant on peut critiquer les positions prises par quelqu’un dans le cadre de ses fonctions, autant il faut respecter la personne.
La Commission rejette l’amendement.
Puis elle adopte l’article 27 modifié.
*
* *
Article 27 bis
(Art. L. 7341-1 à L. 7341-6 [nouveaux] du code du travail)
Définition de la responsabilité sociale des plateformes en ligne
Cet article additionnel visant à définir la responsabilité sociale des plateformes en ligne a été adopté sur proposition de M. Yves Blein, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques, et de Mme Audrey Linkenheld.
Il part du constat que l’essor des plateformes collaboratives met à l’épreuve la distinction entre le salariat et le travail indépendant et brouille la frontière entre les activités professionnelles à but lucratif et celles exercées à titre occasionnel. Par conséquent, il vise à clarifier les obligations sociales des plateformes en ligne et à préciser les droits des travailleurs concernés en matière d’accidents du travail, de formation professionnelle, de validation des acquis de l’expérience et de droit syndical.
*
La Commission examine les amendements identiques AS945 de la commission des affaires économiques et AS264 de Mme Erhel.
Mme Corinne Erhel. Le numérique bouleverse aujourd’hui nos modèles et nos modes d’organisation, mais le taux de conversion ou de transition numérique dans nos entreprises reste très en deçà de ce qu’il est dans les autres pays européens. Nous proposons donc de désigner au sein des instances exécutives des sociétés anonymes un administrateur chargé du numérique. La transformation numérique est en effet un enjeu essentiel pour l’adaptation des compétences ; elle implique de surcroît de développer la collaboration entre les grands groupes, les établissements de taille intermédiaire, les PME et les start-ups. Il s’agit là d’une proposition issue du rapport d’information sur l’économie numérique que Laure de La Raudière et moi-même avons rédigé.
M. le rapporteur. Si je partage votre objectif, votre amendement n’utilise pas le bon véhicule législatif, puisque votre proposition relève du code de commerce et non du code du travail. Je vous appelle donc à le retirer.
M. Francis Vercamer. D’autant que cet amendement ne concerne que les très grosses entreprises. On imagine mal en effet qu’une PME puisse affecter un de ses administrateurs à la seule gestion du numérique. Cette proposition me paraît donc un peu illusoire.
Mme Corinne Erhel. Cela n’a rien d’illusoire puisqu’il s’agit d’une proposition issue d’un travail parlementaire. J’insiste une nouvelle fois sur notre retard en matière de conversion numérique des process. Cela étant, j’accepte de retirer mon amendement.
M. le rapporteur. Je partage votre point de vue, mais vous touchez ici aux missions du conseil d’administration.
Les amendements sont retirés.
La Commission en vient à l’examen, en discussion commune, des amendements identiques AS904 de la commission des affaires économiques et AS686 de Mme Audrey Linkenheld, et de l’amendement AS521 de M. Christophe Caresche.
M. Yves Blein, rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques. L’amendement AS904 propose d’intégrer dans le droit du travail les travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation électronique, de façon à ce qu’on puisse identifier la responsabilité sociale des plateformes qui leur fournissent du travail et que ces travailleurs puissent, par voie de conséquence, bénéficier d’une assurance, du droit à la formation professionnelle, à la validation des acquis de l’expérience, du droit de grève, mais aussi de la capacité à constituer un syndicat.
M. Bernard Accoyer. Cet amendement ajoute rien moins qu’un titre à notre code du travail, le plus complexe et le plus long du monde. Nous ne sommes pas certains que cela contribuera à résorber le chômage.
M. Michel Liebgott. Monsieur Accoyer, le code du travail évolue, car le monde évolue. L’internationalisation du travail, l’émergence des centres d’appel et leur exil vers des pays à bas coût font que nous devons nous interroger sur le sort de ces travailleurs.
M. Christophe Caresche. Mon amendement reprend l’essentiel des éléments des amendements précédents. Il s’agit de mesures qui figuraient dans l’avant-projet du Gouvernement et ont été soumises au Conseil d’État. Pour une raison que je ne m’explique pas, elles ont disparu du projet de loi. Nous ne faisons donc que rétablir des dispositions proposées par le Gouvernement suite à une concertation. Il s’agit de mesures importantes, car les conflits se multiplient entre les travailleurs et les plateformes numériques, avec un risque de contentieux accru. C’est pourquoi nous proposons de sécuriser le contrat de travail entre le travailleur et la plateforme et de donner des droits nouveaux aux travailleurs.
M. le rapporteur. Ces amendements s’inscrivent dans la lignée du rapport de Pascal Terrasse sur l’économie collaborative. Ils sont inspirés par le constat que l’essor des plateformes collaboratives met à l’épreuve la distinction entre salarié et travailleur indépendant et brouille les frontières entre les activités professionnelles qui permettent de vivre et celles qui peuvent être exercées à titre occasionnel.
Vous proposez ainsi de clarifier la responsabilité sociale des plateformes en précisant les conditions de prise en charge des cotisations en matière d’accidents du travail, d’accès à la formation professionnelle, de validation des acquis de l’expérience. Je vous rejoins et suis donc favorable aux amendements identiques AS904 et AS686.
L’amendement défendu par Christophe Caresche inclut également des dispositions concernant la présomption de travail indépendant, la détermination du coût des biens partagés ainsi que la compétence des tribunaux de commerce, domaines qui restent encore à stabiliser. Je suggère donc qu’il retire son amendement.
M. Francis Vercamer. Ces dispositions ne rentrent-elles pas dans le champ du télétravail ? Dans ces conditions, il suffirait d’étendre la négociation entre les partenaires sociaux aux plateformes numériques pour régler le problème.
M. le rapporteur. La différence fondamentale est que, dans le cas du télétravail, l’on a affaire à des salariés, alors que, dans le cas des plateformes, toute la difficulté résulte précisément dans la qualification du travailleur.
Mme Eva Sas. Je pense qu’il serait pertinent d’intégrer le cas de ces travailleurs aux négociations sur le télétravail.
L’amendement AS521 est retiré.
L’amendement AS428 de M. Christophe Caresche est également retiré.
La Commission adopte les amendements AS904 et AS686.
*
* *
Chapitre Ier
Faciliter la vie des TPE et des PME et favoriser l’embauche
La Commission adopte l’amendement rédactionnel AS953 du rapporteur modifiant l’intitulé du présent chapitre.
*
* *
Article 28
(Art. L. 5143-1 [nouveau] du code du travail)
Droit à l’information des employeurs des entreprises de moins de 300 salariés
Cet article vise à inscrire dans le code du travail le droit, pour les employeurs des entreprises de moins de 300 salariés, d’obtenir une information précise, dans un délai raisonnable, sur l’application du droit du travail.
Différents dispositifs visent d’ores et déjà à favoriser une meilleure connaissance et, partant, une meilleure application du droit du travail, en particulier dans les petites et moyennes entreprises.
● Un guide pratique du droit du travail, élaboré par le ministère du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, est mis à jour régulièrement. Ce guide, diffusé par La Documentation française, présente de façon claire et accessible l’état du droit et les différents dispositifs en matière de travail, d’emploi et de formation professionnelle.
● Le site du ministère du travail propose également des fiches pratiques, conçues pour répondre aux besoins des chefs d’entreprise et des salariés. Un portail internet, « Travailler mieux », dédié exclusivement aux questions liées aux conditions de travail, à la santé et à la sécurité, donne accès à des outils simples et concrets à l’intention des employeurs ou des salariés.
Les fiches pratiques les plus consultées en 2013 lors des 24 millions de visites du portail « travail-emploi.gouv.fr » par les usagers :
- rupture conventionnelle du contrat de travail : 1,5 million de visites ;
- indemnité de licenciement : 1 million de visites ;
- droit individuel à la formation : 900 000 visites ;
- contrat à durée déterminée : 650 000 visites ;
- contrat de professionnalisation : 640 000 visites ;
- contrat unique d’insertion ou d’accompagnement : 415 000 visites ;
- période d’essai : 360 000 visites ;
- congés payés : 350 000 visites ;
- droit aux allocations de chômage du salarié démissionnaire : 350 000 visites ;
- congé individuel de formation : 250 000 visites.
Source : Rapport « L’inspection du travail en France en 2013 », Direction générale du travail
● La loi du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi (58)a créé des commissions paritaires régionales interprofessionnelles (CPRI), chargées notamment, dans les entreprises de moins de onze salariés, « de donner aux salariés et aux employeurs toutes informations ou tous conseils utiles sur les dispositions légales ou conventionnelles qui leur sont applicables (article L. 23-113-1 du code du travail). Les CPRI doivent être mises en place à compter du 1er juillet 2017.
● Depuis 2011, des « correspondants PME », au sein des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE), accompagnent les petites et moyennes entreprises dans leurs démarches administratives. L’objectif visé est de développer un guichet unique pour mieux informer les entreprises sur les différents dispositifs publics qui leur sont applicables.
● Les inspecteurs du travail ont par ailleurs un rôle de conseil du public. Cette mission exclut, en principe, les litiges individuels entre salariés et employeurs, qui relèvent des juridictions prud’homales, mais cette limite est imprécise, car les demandes adressées aux inspecteurs du travail peuvent s’étendre à tous les aspects des relations individuelles au travail.
Les services de renseignement des inspections assurent ainsi un accueil des salariés et des employeurs pour toute demande d’information. La réponse à l’usager y est personnalisée et contextualisée en fonction des besoins des entreprises, des secteurs d’activité, des partenaires institutionnels et des liens avec les services de contrôle. Cet ancrage dans le tissu local alimente une analyse des situations réelles qui va donc au-delà d’une simple information sur l’état du droit.
Chaque année, plus de 800 000 demandes sont traitées par ces services de renseignement, dont la grande majorité émane des salariés. En 2015, les demandes formulées par les employeurs représentent seulement 6,6 % du volume total de ces demandes, auxquelles s’ajoutent 2,6 % de demandes issues des particuliers employeurs. Par ailleurs, les demandeurs sont très majoritairement issus de PME. Ainsi, 57,2 % d’entre eux sont issus d’une entreprise de 1 à 10 salariés, 26,2 % d’une entreprise de 11 à 49 salariés, et 16,2 % d’une entreprise de 50 salariés et plus (59).
La revue de ces différents dispositifs visant à faciliter l’accès au droit ne permet pas de masquer la persistance d’une réelle difficulté d’accès à l’information dans les plus petites entreprises. Comme le note un rapport ministériel consacré à l’inspection du travail, « outre leur nombre important (1,6 million), les établissements de moins de cinquante salariés constituent ceux pour lesquels l’accès au droit, et au droit du travail en particulier, est le moins aisé, tant pour les employeurs que pour les salariés » (60).
Le Conseil d’orientation pour l’emploi, dans un rapport consacré à l’emploi dans les très petites entreprises et paru en 2011, préconise ainsi de mieux accompagner les TPE, et d’« apporter une réponse rapide et efficace aux questions concrètes que se pose le chef d’entreprise ». Le Conseil poursuit en précisant que « de nombreux moyens d’information sont à sa disposition, mais ils demeurent trop épars et souffrent d’une coordination parfois insuffisante entre les différents acteurs ».
Dans ce contexte, le présent article entend remédier au relatif hermétisme du droit du travail – issu des dispositions du code du travail comme des stipulations des accords et conventions collectives – applicable aux petites entreprises.
Il prévoit la mise en œuvre d’un « droit » des employeurs à une information précise et rapide, et met en place des services d’information dédiés.
Le présent article crée un nouveau chapitre, intitulé « Appui aux entreprises », au sein du titre IV du livre Ier de la cinquième partie du code du travail. Le titre IV étant consacré à l’aide à la création d’entreprise, le 1° du présent article complète son intitulé pour ajouter l’appui aux entreprises.
Le nouveau chapitre, composé d’un unique article L. 5143-1 figure au 2°. Cet article dispose que tout employeur d’une entreprise de moins de trois cents salariés « a le droit d’obtenir une information précise et délivrée dans un délai raisonnable lorsqu’il sollicite l’administration sur une question relative à l’application d’une disposition du droit du travail ou des accords et conventions collectives qui lui sont applicables ».
Il est précisé que des services d’information dédiés sont mis en place par l’autorité administrative compétente pour assurer la mise en œuvre de ce droit. Celle-ci peut y associer des représentants des collectivités territoriales, des organisations syndicales et professionnelles, ou tout autre acteur qu’elle estime compétent.
D’après l’étude d’impact, ce dispositif s’inscrit dans le cadre de la poursuite de la réforme de l’inspection du travail. Il est prévu de « systématiser les actions collectives d’information sur les droits en lien avec des partenaires extérieurs (branches professionnelles, ordre des experts comptables, chambres consulaires, partenaires sociaux,…) », mais également de mettre en place des conventions, « conclues et déclinées de façon opérationnelle au niveau de chaque région entre le représentant régional des experts comptables et le Direccte ».
Toujours d’après l’étude d’impact, le dispositif prévu doit permettre « d’aller encore plus loin, dans un contexte où le besoin de sécurité juridique des TPE et des PME est majeur pour développer leur activité et favoriser l’emploi ».
La portée normative du dispositif proposé reste néanmoins très faible : le droit à une information précise et délivrée dans un délai raisonnable n’est en effet pas opposable, ce qui ne traduit pas une évolution législative sensible par rapport aux pratiques actuelles des différents services publics concernés.
Par ailleurs, les « services d’information dédiés » devront s’articuler avec les différents dispositifs existants, en particulier les services de renseignement des inspections du travail au sein des Direccte. En toute rigueur, les dispositions prévues par le présent article sont donc déjà appliquées, ce qui réduit encore la portée normative de ce dernier.
Le rôle de ces services d’information devra par ailleurs être précisé par rapport à celui des commissions paritaires régionales interprofessionnelles (CPRI), créées par la loi du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi, et également chargées de donner aux employeurs toutes informations ou tous conseils utiles sur les dispositions légales ou conventionnelles qui leur sont applicables.
À rebours de la philosophie initiale du présent article, la multiplication des dispositifs d’information, organisés dans des structures éparses, accroît le risque de redondances inefficaces, entretient la confusion pour les petites entreprises et contrevient à la logique de guichet unique qui alimente la modernisation de l’action publique depuis plusieurs années.
*
Outre deux amendements rédactionnels, la Commission a adopté deux amendements du rapporteur à cet article.
Le premier, identique à un amendement du rapporteur de la commission des affaires économiques, permet à une entreprise de moins de 300 salariés d’attester de sa bonne foi en cas de contentieux, dès lors qu’elle a suivi les démarches et les procédures prescrites par l’administration pour faire face à une situation donnée (AS 963).
Le deuxième amendement a pour objet de mieux associer les différents acteurs proposant un service d’information et d’accès au droit. Il remplace les « services d’information dédiés » créés par le présent article par un « service public de l’accès au droit ». Sont explicitement associés à ce service les chambres consulaires, les futures commissions paritaires régionales interprofessionnelles, ainsi que les conseils départementaux de l’accès au droit, ces différents acteurs remplissant déjà des missions d’aide et de soutien envers les entreprises (AS 955).
*
La Commission adopte les amendements rédactionnels identiques AS954 du rapporteur et AS947 de la commission des affaires économiques.
Elle examine ensuite, en discussion commune, les amendements AS656 de M. Kader Arif et AS698 de M. Alain Fauré.
M. Kader Arif. Il est prévu à l’article 28 que tout employeur d’une TPE ou d’une PME puisse adresser une question relative à l’application du droit du travail à l’administration, qui dispose d’un délai raisonnable pour lui répondre. Craignant que le temps économique, le temps social et le temps administratif n’aient pas les mêmes horloges, je propose, pour accroître la sécurité juridique, de déterminer un délai précis de deux mois, ce qui correspond au délai de droit commun prévu dans la loi du 12 novembre 2013 habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre l’administration et les citoyens.
Mme Isabelle Le Callennec. L’article 28 me laisse sceptique. Il existe déjà beaucoup trop de structures à disposition des entreprises pour leur fournir des informations. Mieux vaudrait s’atteler à rendre le droit du travail moins complexe, alors que, à l’issue de nos travaux sur ce projet de loi, il le sera davantage. C’est ubuesque.
M. Michel Issindou. Il ne s’agit pas de créer une nouvelle structure, mais de faire obligation à l’administration de répondre dans un certain délai. Je pense, cela étant, qu’un délai raisonnable ne signifie pas grand-chose, et que poser un délai de deux mois est plus pertinent. En effet, les entreprises se plaignent souvent du manque de réactivité des administrations. Il existe d’ailleurs déjà des règles similaires dans l’administration fiscale, où l’absence de réponse dans les deux mois vaut souvent acceptation. Il s’agit donc d’une mesure de bon sens.
Mme la présidente Catherine Lemorton. Un délai de deux mois ne me paraît pas non plus adapté. Selon les demandes – une question touchant au licenciement, par exemple –, l’employeur peut avoir besoin d’une réponse dans un délai de quelques jours. Un délai « raisonnable » a au moins le mérite de la souplesse.
M. Bernard Accoyer. Cet amendement fixe à deux mois le délai de réponse par l’administration, mais, si l’administration ne s’y conforme pas, il ne se passe rien. Je propose donc de le sous-amender avec l’ajout suivant : « En cas de manquement, la responsabilité de l’employeur est dégagée. »
Mme Isabelle Le Callennec. Lorsque les entreprises ont besoin d’informations, elles ont à leur disposition toute une gamme de structures pour y répondre. Lorsqu’elles s’adressent à l’administration, c’est dans l’idée que celle-ci leur fournira une réponse exacte. Or il arrive que certains services soient dans l’incapacité de répondre précisément, tant les textes peuvent être interprétés de diverses manières. Ce que demandent les entreprises, c’est une trace écrite, ce qui n’est pas précisé dans le texte.
Il est par ailleurs indiqué que l’administration peut associer aux services d’information des représentants des collectivités territoriales, des organisations syndicales et professionnelles. Or les entreprises souhaiteraient qu’on leur facilite la vie avec un guichet unique.
M. Francis Vercamer. Je conteste à mon tour la pertinence du délai « raisonnable » et notre amendement AS555 définit avec précision plusieurs délais selon les cas. Si ces précisions relèvent davantage du règlement, peut-être le rapporteur pourrait-il sous-amender l’amendement pour en renvoyer les modalités d’application à un décret.
Nous allons par ailleurs examiner, après l’article 28, un amendement proposant l’établissement d’un rescrit social. Pour un employeur, en effet, le problème n’est pas uniquement d’obtenir une réponse, mais de pouvoir se protéger juridiquement.
M. Gérard Cherpion. C’est en effet le problème du rescrit social qui se pose ici et non celui du délai qui, comme l’a fait remarquer la présidente, peut être très variable selon le type de problème. La mise en place de ce rescrit simplifierait évidemment la vie des entreprises.
Mme Monique Iborra. Cet amendement a le mérite de définir un délai, avec toutes les difficultés que cela comporte et qui ont été évoquées. En revanche, il n’y est pas indiqué que, passé ce délai, la demande est réputée acceptée. Il conviendrait de le préciser.
Mme la présidente Catherine Lemorton. Peut-être M. Accoyer peut-il rédiger un amendement en ce sens pour la séance.
M. le rapporteur. Je suis conscient que la notion de délai raisonnable est une notion floue, mais le qualifier plus précisément ne tiendrait pas compte de la diversité des situations.
En ce qui concerne le rescrit social, je trouve fort de café qu’on puisse demander son instauration quand, pendant des années, on s’est évertué à diminuer les moyens de l’administration !
M. Bernard Accoyer. Ce n’est pas le sujet !
M. le rapporteur. Mais si, monsieur Accoyer, car, en fixant un délai, votre idée est de légitimer les agissements de l’employeur en cas de non-réponse dans les temps. Nous devons faire preuve de réalisme…
Après avoir travaillé de manière approfondie sur le rescrit social, j’ai préféré, dans un souci de pragmatisme, présenter un autre amendement pour améliorer l’information des employeurs, considérant que les moyens actuels ne permettaient pas de mettre en place cette procédure. Je proposerai également un amendement pour remédier à l’éparpillement des intervenants dans ce domaine.
Ceux qui veulent imposer un délai semblent parier sur l’incapacité de l’administration à respecter les délais et sur la validation systématique de la demande de l’employeur qui en résulterait. Je vous concède que la notion de délai raisonnable est floue, mais il ne faut pas l’interpréter comme un encouragement à allonger les délais.
Mme la présidente Catherine Lemorton. Le principe selon lequel le silence de l’administration vaut accord est pertinent sur une question fermée. En revanche, ce principe ne peut pas s’appliquer sur une question ouverte, qui n’appelle pas de réponse par oui ou par non.
Imposer un délai ne correspond pas à la réalité des besoins des entreprises.
M. Kader Arif. La langue française est riche, mais parfois imparfaite. Le mot raisonnable ne répond pas aux attentes des entreprises et des citoyens à l’égard de l’administration. On pourrait compléter mon amendement en précisant que la durée de deux mois est un maximum. Ce serait une erreur que de refuser de fixer un délai. La formulation actuelle n’est pas acceptable.
Mme Bernadette Laclais. L’amendement AS698 procède de la même philosophie que celui de M. Arif, mais il propose un délai plus court. Après le débat qui vient d’avoir lieu, je le retire, sans pour autant être convaincue du bien-fondé du délai raisonnable.
Pour la séance, nous devrions présenter un amendement qui distingue les demandes d’information pour lesquelles un délai de réponse de deux mois maximum serait fixé et les demandes susceptibles de créer du droit, pour lesquelles le principe « le silence vaut accord » s’appliquerait.
C’est faire honneur aux hommes et aux femmes qui travaillent dans l’administration que de penser qu’ils sont capables d’apporter une réponse à la question qui leur est posée dans le délai convenu.
Mme la présidente Catherine Lemorton. Les plateformes interactives des caisses primaires d’assurance maladie (CPAM) ont suscité beaucoup de doutes et d’interrogations. Or il s’avère qu’elles fonctionnent très bien. J’en ai fait l’expérience personnellement. Le site ameli.fr apporte une réponse rapide et personnalisée. L’interaction avec les agents est très efficace. Il n’a pas été nécessaire de fixer un délai pour que ce service donne globalement satisfaction. Des ajustements seront sans doute nécessaires, mais faisons confiance aux agents du service public.
Je regrette que les chambres consulaires n’accomplissent pas le travail d’information des TPE. Il est parfois difficile d’y trouver le bon interlocuteur et d’obtenir des réponses dans un délai satisfaisant.
Mme Isabelle Le Callennec. Les chambres consulaires reprochent au législateur les changements constants de la réglementation.
Je rends hommage à certains services publics. Les directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE), qui sont très sollicitées, ont fait d’énormes efforts pour être accessibles aux entreprises. Les agents ont pris conscience de l’appui qu’ils doivent aux entreprises dans la situation actuelle. Cette disponibilité doit être la marque de fabrique des services publics. Des progrès sérieux ont été accomplis en ce sens.
Mme Monique Iborra. Madame la présidente, la CPAM n’est pas la DIRECCTE. Cette dernière est très sollicitée et ne dispose pas des mêmes moyens que la CPAM.
Fixer un délai, sans sanctionner son non-respect, permet peut-être d’adresser un signal aux entreprises, mais, dans les faits, c’est complètement inutile.
M. Bernard Accoyer. Ce débat est la conséquence des dérapages de la commission dans laquelle nous siégeons.
Le rapporteur a présenté comme rédactionnel un amendement avant l’article 28 qui modifie le titre du chapitre Ier du titre IV en substituant aux mots : « Faciliter la vie », les mots : « Améliorer l’accès au droit ». Tout est dit.
Notre droit du travail est devenu au fil du temps excessivement complexe, avec un code de plus de 3 000 pages. Or que faisons-nous depuis trois jours, si ce n’est en ajouter ? Nous sommes responsables du problème devenu insoluble auquel les fonctionnaires des services publics se trouvent confrontés.
En refusant le rescrit social, vous rejetez sur les TPE et les PME l’impossible mission de trouver leur chemin dans le maquis du droit social. La complexité du code du travail est devenue ingérable pour celles qui n’ont pas de services spécialisés à leur disposition. La faute n’en revient pas aux fonctionnaires, mais au législateur et à l’exécutif.
Il faut adopter ces amendements pour nous obliger à simplifier le code du travail.
L’amendement AS698 est retiré.
La Commission rejette l’amendement AS656.
Puis elle adopte l’amendement rédactionnel AS948 de la commission des affaires économiques.
Elle est ensuite saisie des amendements identiques AS963 du rapporteur et AS950 de la commission des affaires économiques.
M. Yves Blein, rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques. L’amendement AS950 dispose que le droit à l’information de l’employeur « peut porter sur les démarches et procédures légales à suivre face à une situation de fait. Si cette demande est suffisamment précise et complète, le document formalisant la prise de position de l’administration peut être produit par l’entreprise en cas de contentieux pour attester de sa bonne foi. »
Outre la sécurité juridique qu’il apporte aux entreprises, cet amendement vise à inciter le tribunal à se prononcer au fond, puisque la bonne foi de l’employeur dans le respect des procédures est reconnue.
M. Bernard Accoyer. Cet amendement paraît frappé au coin du bon sens. Il s’inscrit dans la logique que nous avons défendue précédemment, peut-être de manière un peu caricaturale. Convenez que, avec 10 000 articles et 3 500 pages, le code du travail est devenu difficile à interpréter. En 1973, le code du travail comptait 600 pages. En Suisse, où le taux de chômage est inférieur à 5 %, il comporte aujourd’hui 54 pages.
Mme Isabelle Le Callennec. L’expression « suffisamment précise et complète » pour qualifier la demande de l’employeur me semble sujette à interprétation.
M. le rapporteur. Mon amendement est identique à celui de la commission des affaires économiques, qui est l’auteur original de cette proposition pragmatique. La reconnaissance de la notion de bonne foi dans la démarche de l’employeur, sans pour autant créer un droit opposable, représente une avancée significative.
La Commission adopte les amendements.
L’amendement AS949 de la commission des affaires économiques est retiré.
La Commission examine l’amendement AS955 du rapporteur.
M. le rapporteur. Pour résoudre le problème de la dispersion des intervenants, évoqué par Mme Le Callennec, cet amendement prévoit la mise en place d’un service public de l’accès au droit pour les employeurs, réunissant l’ensemble des acteurs qui proposent un service d’information aux petites et moyennes entreprises.
Aujourd’hui, les interlocuteurs ne manquent pas : services de renseignement des DIRECCTE, inspection du travail, « correspondants PME », chambres consulaires, conseils départementaux de l’accès au droit, et bientôt commissions paritaires régionales interprofessionnelles. Bref, une clarification s’impose. Avec cet amendement, les services d’information spécialisés créés par l’article 28 seraient rebaptisés service public de l’accès au droit et pourraient fournir une information sur toute question relative au droit du travail, mais également aider les entreprises de moins de 300 salariés dans leurs démarches. Y seraient explicitement associés les chambres consulaires – je considère que l’accompagnement des entreprises, en particulier les PME, fait partie de leurs missions –, les futures commissions paritaires interprofessionnelles ou les conseils départementaux de l’accès au droit. Ces différents acteurs remplissent déjà des missions d’aide et de soutien envers les entreprises. Mais il s’agit de mettre en place une porte d’entrée unique pour simplifier l’accès au droit et garantir l’accompagnement des entreprises.
Mme Isabelle Le Callennec. Comment ce service public de l’accès au droit va-t-il s’organiser sur le terrain alors que ces structures sont parfois en concurrence ? Sera-t-il uniquement virtuel ou accompagné d’une plateforme téléphonique ?
Compte tenu de la multiplication des acteurs, ce dispositif risque de ne pas être simple à mettre en œuvre. Votre intention est louable – tout le monde aspire à la création d’un guichet unique, même virtuel –, mais qui répondra au téléphone ? Y aura-t-il un numéro vert ?
On nous reproche sans cesse de ne pas nous préoccuper de la mise en œuvre sur le terrain des mesures que nous votons. Nous sommes ici pour améliorer la vie des gens, pas pour la leur compliquer. Pardonnez-moi de poser ces questions concrètes.
Mme la présidente Catherine Lemorton. Vous êtes toujours négative alors que nous vous citons des exemples concrets de réussites, la dernière en date étant celle de la prime d’activité pour laquelle un dispositif numérique permettant de connaître ses droits et de faire des simulations a été mis en place.
Mme Isabelle Le Callennec. Et le régime social des indépendants (RSI) ?
Mme la présidente Catherine Lemorton. Nous ne sommes pas responsables des dysfonctionnements du RSI. Nous avons dû les gérer. Nous aurions certainement procédé différemment si nous avions eu à le mettre en place.
M. André Chassaigne. Nous ne pouvons que nous réjouir chaque fois que nous faisons un pas vers un guichet unique.
Je m’interroge sur le périmètre du service public d’accès au droit que vous instaurez. Est-il réservé aux entreprises ? Les salariés et leurs représentants pourront-ils également avoir accès à ces nouvelles protections ?
M. le rapporteur. L’instauration d’un service public d’accès au droit pose inévitablement la question d’une plateforme réunissant l’ensemble des acteurs. Mais d’autres étapes doivent encore être franchies avant d’y parvenir. Dans le même esprit, nous avons débattu hier de l’idée d’une plateforme sur les droits sociaux dans le cadre du compte personnel d’activité.
La prime d’activité est un bon exemple de ce qu’il est possible de faire. Outre le simulateur de la caisse d’allocations familiales, je tiens également à citer le site mes-aides.gouv.fr qui permet de connaître l’ensemble des aides – pas seulement la prime d’activité – auxquelles une personne a droit. Tous ces supports numériques procèdent de la même logique.
Aujourd’hui, les différents intervenants offrent du conseil, souvent gratuit, et des services, qui peuvent être payants. Mais ils restent des acteurs du service public. J’insiste, les chambres consulaires exercent une mission de service public.
Pour répondre à M. Chassaigne, je précise que le service public d’accès au droit est placé dans le chapitre relatif aux TPE-PME. Il est donc focalisé sur les réponses aux demandes des chefs d’entreprise. Mais il me semble que l’idée d’un point d’entrée unique pour les salariés pourrait être très pertinente. Toutefois, je l’avoue, cela ne figure pas dans mon amendement.
La Commission adopte l’amendement.
En conséquence, les amendements AS350 et AS351 de M. Christophe Cavard tombent.
La commission examine, en discussion commune, les amendements AS514 de M. Jean-Louis Costes et AS555 de M. Arnaud Richard.
M. Gilles Lurton. L’amendement AS514 est défendu.
M. Francis Vercamer. L’amendement AS555 s’inspire de la charte Marianne adoptée en 2005 pour l’ensemble des administrations.
Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette successivement les amendements.
La Commission en vient à l’amendement AS554 de M. Arnaud Richard.
M. Francis Vercamer. Il paraît important de s’assurer que les entreprises obtiennent les informations qu’elles sollicitent de l’administration dans un délai raisonnable. À cet effet, le Gouvernement remet un rapport mesurant la satisfaction des entreprises.
M. le rapporteur. Je ne tiens pas à créer un dangereux précédent en acceptant d’inscrire dans la loi les enquêtes de satisfaction. Avis défavorable.
La Commission rejette l’amendement.
Puis elle adopte l’article 28 modifié.
*
* *
La Commission examine, en discussion commune, les amendements AS223 de M. Patrick Hetzel et AS535 de M. Arnaud Richard.
M. Élie Aboud. J’ai cru comprendre que le rapporteur était ouvert à l’idée du rescrit social. L’amendement propose d’expérimenter cette procédure pendant une durée de deux ans.
M. Francis Vercamer. Nous déposons cet amendement sur le rescrit social depuis plusieurs années, dans le dessein de sécuriser les PME.
Les grandes entreprises possèdent tous les outils juridiques pour se défendre contre l’administration et obtenir les informations nécessaires à leur bon fonctionnement. Ce n’est pas le cas des PME qui doivent donc pouvoir être protégées.
Le rescrit social existe dans certains domaines – les exonérations de cotisations sociales par exemple –, mais il ne couvre pas l’ensemble des sujets abordés par le code du travail. Or, compte tenu de sa complexité, les litiges sont de plus en plus importants. Il faut garantir aux PME la sécurité des informations qui leur sont délivrées.
M. le rapporteur. Ces amendements sont en partie satisfaits par l’ordonnance n° 2015-1628 du 10 décembre 2015, que l’article 31 du projet de loi propose de ratifier et qui prévoit un mécanisme de rescrit social sur deux sujets : le respect de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, d’une part, et l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés, d’autre part. Vos amendements vont au-delà : ils visent à étendre le rescrit social à l’ensemble des points relevant du code du travail, ce qui est un objectif souhaitable à terme.
En l’état actuel, il ne peut toutefois être atteint. Dans son rapport, Jean-Denis Combrexelle écarte cette piste qui serait constitutive d’une charge de travail pour les DIRECCTE que leurs moyens actuels ne leur permettent pas de remplir.
Les moyens des administrations de l’État ont été réduits de manière drastique. Il ne leur est tout simplement pas possible de procéder dans des délais satisfaisants à l’étude que suppose le rescrit social, lequel, rappelons-le, n’est pas une simple information, mais consiste en un engagement de l’administration qui vaut droit opposable. Je trouve qu’il y a une forte incohérence de la part de certains à réclamer, à l’approche des élections, une réduction des moyens des administrations et, dans le même temps, à proposer d’instaurer ce type de mesure.
Nous ne pouvons inscrire dans la loi cette disposition en étant conscients qu’il n’est pas matériellement possible de la mettre en œuvre. Elle fait en outre courir le risque d’usages détournés : en l’absence de réponse, les employeurs pourraient considérer qu’il y a accord et s’exonérer de se conformer aux diverses réglementations.
Avis défavorable à ces deux amendements.
Mme Isabelle Le Callennec. Si nous devons tendre vers cet objectif, monsieur le rapporteur, il faut se demander de quelle manière. Vous parlez des annonces concernant la réduction des emplois publics sans évoquer le pendant de ces propositions : l’augmentation du temps de travail, qui pourra être une solution dans le cas qui nous occupe. Le rescrit suppose en effet que les administrations y consacrent du temps. Et je ne crois pas que vous fassiez en sorte qu’elles en disposent – le ministre du budget lui-même se targue de faire des économies de dépenses publiques.
Les services publics doivent être au service du public. Les entreprises ont besoin d’une information rapide et juste. Il nous faut progresser. Sachons donc nous attaquer à la racine du mal : cessons de trop légiférer et mettons en place des dispositifs plus simples et plus lisibles – ce que nous ne sommes pas forcément en train de faire ce matin.
Mme la présidente Catherine Lemorton. Si l’on suit votre logique, pourquoi ne pas proposer une généralisation des plateformes qui permettraient de faire l’économie des services d’avocats spécialistes du droit du travail ?
M. Francis Vercamer. Monsieur le rapporteur, j’aimerais préciser que je n’ai jamais appelé à la contraction des services administratifs et que l’Union des démocrates et indépendants ne prône pas une réduction de l’emploi public.
Le rescrit s’inscrit pour moi dans une logique de prévention et non de répression : il permet aux entreprises de se protéger grâce à une réponse opposable de l’administration. Je préfère que le personnel administratif se consacre à aider les entreprises plutôt qu’à les sanctionner en cas de contrôle révélant des pratiques non conformes.
M. le rapporteur. Je souris, monsieur Vercamer, à l’évocation de votre position sur l’emploi public. Je n’ai pas souvenir que vous vous soyez particulièrement démarqué lors des votes des budgets de la majorité précédente.
Le rescrit social ne joue pas seulement un rôle préventif. En tant que droit opposable, il sert aux entreprises pour des procédures ultérieures. Il engage la responsabilité de l’administration sur le long terme et nécessite donc que la réponse fournie soit parfaitement étayée. Compte tenu des moyens dont disposent actuellement nos administrations, l’extension que vous proposez, et au principe de laquelle j’adhère, est hors de notre portée.
La Commission rejette successivement les amendements.
Puis elle est saisie de l’amendement AS154 de M. Élie Aboud.
M. Élie Aboud. Voici un amendement susceptible de mettre tout le monde d’accord. Nous le savons, les PME et les TPE se heurtent au mépris des banques. Nous entendons ici poser le principe que les établissements de crédit sont tenus d’examiner favorablement les demandes de crédits, sous réserve d’un apport substantiel.
M. le rapporteur. Comme j’aimerais pouvoir répondre favorablement à cet amendement, monsieur Aboud. Malheureusement, plusieurs raisons m’en empêchent.
D’abord, il y a cette formulation : « les établissements de crédit sont tenus d’examiner favorablement les demandes de crédits des personnes morales en situation de fragilité financière qui en font la demande ».
Ensuite, sa portée normative est extrêmement fragile : il ne prévoit ni sanction ni contrôle.
Enfin, ce sujet relève du code monétaire et financier.
M. Michel Issindou. Monsieur Aboud, je dois vous dire ma stupeur : comment avez-vous pu penser insérer une telle disposition dans le code du travail qui régit les relations entre salariés et employeurs ? Ne vous trompez pas de débat !
M. Gérard Cherpion. Je ne suis pas certain que M. Aboud se trompe de débat dans la mesure où nous nous situons dans le chapitre Ier du titre IV qui s’intitule « Faciliter la vie des TPE et des PME et favoriser l’embauche ».
Il s’agit de toute façon d’un amendement d’appel qui vise à souligner les difficultés de financement que rencontrent beaucoup d’entreprises. Très souvent, les banques examinent trop rapidement les dossiers, tardent à donner des réponses ou changent d’avis.
M. Élie Aboud. Je conçois que le terme « favorablement » vous choque et je peux le modifier, mais je ne sais pas si vous avez pris en compte tous les éléments de mon amendement. Cet avis favorable ne peut être exigé que si l’entreprise n’est pas dans le rouge.
Mme la présidente Catherine Lemorton. Monsieur Aboud, je tiens à souligner que, depuis 2008, les gouvernements successifs ont tous veillé à ce que les banques examinent avec la plus grande attention les dossiers des petites entreprises pour les prêts de trésorerie.
La Commission rejette l’amendement.
Puis elle examine, en discussion commune, les amendements AS12 de M. Jean-Charles Taugourdeau et AS119 de M. Élie Aboud.
Mme Isabelle Le Callennec. L’amendement AS12 vise à obliger l’établissement bancaire à recevoir, dans un délai de quarante-huit heures, l’entreprise à laquelle il aurait refusé un prêt afin de lui expliquer les raisons de sa décision.
M. Élie Aboud. Les entreprises, comme je le disais, sont trop souvent en butte au mépris des banques. Elles essuient des refus sans aucune argumentation de fond. Il serait utile d’inscrire cet entretien dans la loi.
M. le rapporteur. Je ne crois pas que cette mesure, qui relève du code monétaire et financier, ait sa place dans une loi sur le travail.
Par ailleurs, pour les petites entreprises, la difficulté principale me semble être moins l’obtention d’un rendez-vous que le refus de prêt. Votre solution ne me paraît pas à la hauteur des problèmes qui se posent à elles.
Mme la présidente Catherine Lemorton. Une telle disposition serait une atteinte à la liberté d’entreprendre et je suis étonnée qu’elle émane de vos rangs, vous qui êtes des défenseurs de l’entreprise privée.
M. Gérard Cherpion. Il n’est pas question de s’immiscer dans l’organisation de la banque. Nous savons tous que les entreprises ont des difficultés pour obtenir des crédits bancaires, même pour se développer. Si le financement participatif a tant de succès, c’est que le crédit bancaire ne répond pas aux besoins. Les plateformes de crowdfunding se substituent en quelque sorte aux banques.
Instaurer une obligation de réponse me paraît nécessaire : les banques doivent expliquer pourquoi elles ont refusé un prêt.
M. André Chassaigne. N’oublions pas le rôle que joue le médiateur du crédit, qui est souvent le représentant de la Banque de France et qui a la possibilité de travailler main dans la main avec la Banque publique d’investissement.
Mme Isabelle Le Callennec. Notre amendement ne concerne pas seulement les entreprises souffrant de difficultés financières. Il couvre aussi celles qui sollicitent les banques pour financer leur développement. Elles aimeraient pouvoir défendre leur projet devant les membres du comité de crédit qui, aujourd’hui, prennent leur décision après l’examen d’un simple dossier.
M. André Chassaigne. Je suis très sensible aux arguments que viennent d’exposer nos collègues de droite : développons donc dans notre pays un pôle public bancaire !
La Commission rejette successivement les amendements.
*
* *
Article 28 bis
(Art. L. 131-4-4 [nouveau] du code de la sécurité sociale)
Exonération de cotisations sociales sur les avantages et cadeaux accordés aux salariés par l’employeur
À l’initiative de M. Alain Fauré et plusieurs de ses collègues, la Commission a adopté un amendement portant article additionnel (AS 691), sous-amendé par le rapporteur, qui exonère de cotisations sociales les avantages et cadeaux accordés aux salariés par l’employeur, sous réserve que leur montant global n’excède pas, au cours d’une année civile, 10 % du plafond mensuel de la sécurité sociale.
Ce montant est porté à 20 % du plafond mensuel de la sécurité sociale lorsque les avantages et cadeaux correspondent à des réductions de tarifs et à des bonifications pour l’achat de biens culturels.
*
Elle en vient à l’amendement AS691 de M. Alain Fauré, qui fait l’objet des sous-amendements AS1051 à AS1053 du rapporteur.
M. Christophe Caresche. L’amendement est défendu.
M. le rapporteur. Je suis favorable à cet amendement, sous réserve de l’adoption de trois sous-amendements.
Sa rédaction actuelle me paraît en effet poser deux difficultés.
Premièrement, il prévoit que l’exonération de cotisations n’excède pas 61 euros par salarié et par an. Je rappelle que ce même plafond est appliqué pour chacun des sept types d’événements mentionnés au III : naissance, adoption ; mariage, pacs ; départ à la retraite ; fête des mères ou des pères ; Sainte-Catherine ou Saint-Nicolas ; Noël ; rentrée scolaire. Si l’on considère que quatre de ces sept événements ont une récurrence annuelle – fête des mères ou des pères, Sainte-Catherine ou Saint-Nicolas, Noël, rentrée scolaire –, on aboutit à une exonération de 804 euros par salarié et par an, soit un montant assez substantiel. En outre, la mention de tous ces événements dans la loi ne me paraît pas opportune.
Deuxièmement, le V pose problème, car il prévoit que l’achat de biens culturels est exonéré de cotisation sans aucune limitation.
Pour répondre à la première difficulté, je propose de simplifier la rédaction en supprimant les alinéas 3 à 14 et de prévoir que l’exonération de cotisation ne peut excéder, au cours d’une année civile, 10 % du plafond mensuel de la sécurité sociale par bénéficiaire, soit 322 euros.
Pour répondre à la deuxième difficulté, le sous-amendement AS1053 prévoit, pour les biens culturels, une exonération allant jusqu’à 20 % du plafond mensuel de la sécurité sociale, soit 644 euros.
Mme Bernadette Laclais. Nous sommes favorables à ces sous-amendements.
M. Arnaud Richard. Cet amendement n’est pas neutre, cela n’aura échappé à personne. Je comprends dans quel esprit ses auteurs l’ont déposé, mais il faut bien voir qu’il concerne une activité économique extrêmement puissante liée aux comités d’entreprise. J’aimerais savoir comment le rapporteur envisage les conséquences de cette évolution de la législation qui va grandement contenter les entreprises de chèques-cadeaux.
M. le rapporteur. Il s’agit d’une pratique déjà tolérée par l’URSSAF : nous nous contentons de l’inscrire dans la loi.
La Commission adopte successivement les sous-amendements AS1051 à AS1053.
Puis elle adopte l’amendement AS691 sous-amendé.
*
* *
La Commission examine l’amendement AS19 de M. Jean-Charles Taugourdeau.
Mme Isabelle Le Callennec. Cet amendement est ainsi rédigé : « Lorsqu’une demande de mise aux normes comporte des risques affectant significativement le niveau de production, l’emploi des salariés ou l’équilibre financier de l’entreprise, l’exécution de celle-ci est suspendue sous réserve d’une atteinte grave aux conditions d’hygiène et de sécurité. La mise en conformité avec les normes fait alors l’objet d’un dialogue entre l’entreprise et les pouvoirs publics permettant d’établir un calendrier prévisionnel qui assure la pérennité de l’activité. »
Les chefs d’entreprise évoquent constamment devant nous le poids des charges et des normes. Par cet amendement, nous souhaitons encourager un dialogue entre les entreprises et les pouvoirs publics pour mettre au point la meilleure application possible des normes.
Mme la présidente Catherine Lemorton. Voici un amendement pour le moins surprenant.
M. le rapporteur. Cet amendement inscrit dans la loi la possibilité pour les entreprises de se soustraire aux mises aux normes lorsqu’elles affectent significativement le niveau de production ou l’emploi, ce qui est pour moi une énormité. Avis très défavorable.
M. Bernard Accoyer. Il s’agit d’un amendement d’appel destiné à souligner que, avec 500 000 normes, notre pays ne s’en sort plus. Celles qui pèsent sur les entreprises rendent leur vie souvent impossible, notamment lorsqu’elles exigent d’elles des travaux hors de leur portée financière. Vous ne pouvez pas balayer d’un revers de main, monsieur le rapporteur, la question extrêmement grave ici soulevée.
M. Gérard Sebaoun. Pour que vous preniez la mesure de l’énormité de votre proposition, madame Le Callennec, citons l’exemple de la loi de 2005 : parce que l’installation d’un ascenseur menacerait l’équilibre financier d’une entreprise, elle pourrait s’exonérer de ses obligations en matière de mise aux normes pour l’accessibilité des personnes handicapées.
Mieux vaudrait que vous retiriez cet amendement.
Mme Isabelle Le Callennec. À mon tour de citer un exemple : des chantiers ont dû être arrêtés dans l’instant parce que des inspecteurs du travail avaient constaté qu’ils ne comportaient pas de toilettes séparées pour les hommes et pour les femmes !
Notre amendement vise à éviter ce genre de situations qui pourrissent la vie des entreprises et créent bêtement des dissensions avec l’inspection du travail. Les inspecteurs du travail exigent une application immédiate des normes ; les entreprises, elles, ont parfois besoin d’un peu de temps. Nous militons pour une application des lois et des normes empreinte de tact et de mesure.
La Commission rejette l’amendement.
*
* *
Article 29
(Art. L. 2232-10-1 [nouveau] du code du travail)
Accords types de branche
Cet article prévoit qu’un accord de branche étendu puisse contenir des stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de cinquante salariés, le cas échéant sous la forme d’un accord type indiquant les différents choix laissés à l’employeur.
En France, les conditions de recours à la négociation collective restent peu adaptées aux petites entreprises.
En effet, seules les organisations syndicales de salariés représentatives, représentées par un délégué syndical, sont en principe habilitées à négocier et à conclure des conventions ou des accords collectifs avec l’employeur.
Or, la présence d’un délégué syndical n’est théoriquement possible que dans les entreprises de plus de cinquante salariés. En deçà de ce seuil, il est toutefois possible de désigner un délégué du personnel comme délégué syndical.
En l’absence de délégué syndical dans l’entreprise – ou d’un délégué du personnel désigné comme délégué syndical dans les entreprises de moins de cinquante salariés –, la conclusion d’une convention ou d’un accord collectif d’entreprise reste néanmoins possible avec les représentants élus des salariés, mandatés ou non, ou avec des salariés non élus mandatés.
Mise en place par la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail (61), cette possibilité de négociation a été élargie par la loi du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi (62).
En l’absence de délégué syndical, l’article L. 2232-21 du code du travail dispose que l’employeur peut négocier et conclure des accords collectifs avec les représentants élus du personnel au comité d’entreprise, à la délégation unique du personnel, ou à « l’instance regroupée » créée par la loi du 17 août 2015 précitée (63) ou, à défaut, avec les délégués du personnel si ces élus sont expressément mandatés à cet effet par un ou plusieurs syndicats de salariés représentatifs dans la branche dont relève l’entreprise, ou, à défaut, par un ou plusieurs syndicats représentatifs au niveau national et interprofessionnel. Les thèmes des négociations ne sont pas limités.
L’article L. 2232-21-1 du même code précise que l’accord ainsi négocié doit être approuvé par les salariés de l’entreprise à la majorité des suffrages exprimés.
En l’absence de représentants élus mandatés, l’article L. 2232-22 du code du travail dispose que les représentants élus titulaires du personnel au comité d’entreprise, à la délégation unique du personnel ou à « l’instance regroupée » précitée ou, à défaut, les délégués du personnel titulaires non expressément mandatés par une organisation syndicale peuvent négocier et conclure des accords collectifs. L’accord ne peut porter que sur des mesures dont la mise en œuvre est subordonnée par la loi à un accord collectif.
Pour être valide, l’accord doit en outre être conclu par des élus titulaires représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles et être approuvé par une commission paritaire de branche, chargée de contrôler que l’accord n’enfreint pas les dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles applicables.
En vertu de l’article L. 2232-24 du code du travail, un accord collectif peut être négocié et conclu par un ou plusieurs salariés expressément mandatés par un ou plusieurs syndicats représentatifs dans la branche ou, à défaut, au niveau national ou interprofessionnel, dans les entreprises où aucun élu n’a manifesté son intention de négocier et lorsqu’un procès-verbal de carence a établi l’absence de représentant du personnel.
La loi du 17 août 2015 précitée a étendu cette possibilité aux entreprises employant moins de onze salariés.
L’accord ainsi négocié ne peut porter que sur des mesures dont la mise en œuvre est subordonnée par la loi à un accord collectif.
L’article L. 2232-27 du même code précise que ce dernier doit être approuvé par les salariés de l’entreprise à la majorité des suffrages exprimés.
Ces dispositions restent néanmoins difficilement applicables, pour des raisons pratiques, dans les très petites entreprises. En outre, le chef d’entreprise et ses salariés n’ont souvent ni le temps, ni la formation juridique pour négocier des accords d’entreprise.
Le présent article créé un nouvel article L. 2232-10-1 au sein de la section 2 du chapitre II du titre III du livre II de la deuxième partie du code du travail, consacrée aux règles applicables à la négociation des conventions de branche et des accords professionnels.
Cet article dispose qu’« un accord de branche étendu peut contenir, le cas échéant sous forme d’accord type indiquant les différents choix laissés à l’employeur, des stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de cinquante salariés ».
Deux situations sont ainsi distinguées :
– soit les stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de cinquante salariés prévues par l’accord de branche étendu s’appliquent directement à ces entreprises ;
– soit ces stipulations peuvent être adaptées par l’employeur. Dans ce cas, elles prennent la forme d’un accord type indiquant les différents choix laissés à l’employeur : il s’agit dans ce cas d’un accord « clés en main » élaboré au niveau de la branche, que l’employeur pourrait adapter, notamment en fonction de la taille et de l’activité de son entreprise. Il est prévu que ce dernier puisse appliquer l’accord type à travers un document unilatéral indiquant les choix qu’il a retenus.
Le seuil retenu, à savoir les entreprises de moins de cinquante salariés, est cohérent avec le fait que la présence d’un délégué syndical n’est théoriquement possible que dans une entreprise de plus de cinquante salariés – même si, en deçà de ce seuil, il est possible de désigner un délégué du personnel comme délégué syndical.
Le champ couvert par les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés est large, puisqu’elles peuvent porter sur l’ensemble des mesures qui peuvent être négociées sur le fondement du code du travail.
Le dispositif proposé s’inscrit dans une nouvelle approche de la négociation collective, privilégiée par M. Jean-Denis Combrexelle dans son rapport : « Plutôt que de s’intéresser en permanence au mode opératoire de la négociation et de la signature au sein des TPE, en cherchant difficilement des processus dérogatoires qui pallient l’absence de représentation syndicale, la question posée est de savoir s’il ne faudrait pas aussi s’attacher au contenu des accords ». Il s’inspire d’une préconisation formulée par M. Combrexelle, relative à l’« édiction d’accords type d’entreprise par les branches dans leur rôle de prestation de services à l’égard des TPE » (proposition n° 28 de son rapport).
Le rapporteur est favorable à ce dispositif qui permet de donner les moyens aux petites entreprises d’accéder aux mesures et aux souplesses qui reposent sur la négociation collective.
*
Outre quatre amendements rédactionnels, la Commission a adopté un amendement du rapporteur permettant aux salariés, ainsi qu’à la commission paritaire régionale de branche ou, à défaut, la commission paritaire régionale interprofessionnelle, d’être informés de l’adoption de l’accord type par l’employeur (AS 964).
*
La Commission examine l’amendement AS657 de M. Kader Arif.
M. Michel Liebgott. L’amendement est défendu.
M. le rapporteur. Cet amendement vise à étendre, par un accord de branche, le bénéfice des comités d’entreprise aux salariés des entreprises employant moins de cinquante salariés. Je rappelle que, dans ces entreprises, les délégués du personnel peuvent déjà exercer les attributions du comité d’entreprise. Par ailleurs, il est déjà possible, par accord collectif, de prévoir pour elles la mise en place d’un comité d’entreprise.
Enfin, il n’est pas techniquement envisageable de prévoir une affiliation par accord de branche des entreprises de cinquante salariés et plus, car il y a une impossibilité de faire participer les salariés des entreprises de moins de cinquante salariés à l’élection des membres du comité d’entreprise. L’employeur de l’entreprise disposant d’un comité d’entreprise ne saurait être tenu de payer pour les salariés d’autres entreprises. En outre, se pose un problème en termes d’attributions économiques des comités d’entreprise, qui concernent par définition une entreprise en particulier.
Argument supplémentaire, s’il en était besoin, cet amendement est en partie satisfait par la création, par la loi du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi, des commissions paritaires régionales interprofessionnelles (CPRI), destinées à représenter les salariés et les employeurs des entreprises de moins de cinquante salariés relevant des branches n’ayant pas mis en place de commission paritaire régionale. Ces CPRI ont en effet des attributions proches, par certains aspects, de celles d’un comité d’entreprise.
Avis défavorable.
L’amendement est retiré.
La Commission examine l’amendement AS696 de M. Alain Fauré.
Mme Bernadette Laclais. Cet amendement vise à renforcer la place des mesures spécifiques aux TPE et PME de moins de cinquante salariés dans les accords types de branche prévus à l’article 29 du projet de loi.
M. le rapporteur. C’est plus qu’un amendement rédactionnel : vous suggérez que, dans tous les accords de branche étendus, figurent des stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de cinquante salariés. Cela me paraît excessif. Avis défavorable.
M. Bernard Accoyer. Cet amendement souligne deux problèmes spécifiques à notre code du travail et qui pèsent lourdement sur l’emploi : les difficultés de s’y retrouver dans les dispositifs, ce qui fait l’objet de l’amendement ; le problème des seuils – celui de cinquante salariés comme les autres – qui sont autant de barrières à l’embauche. Cet amendement rehausserait encore la marche des cinquante salariés, trop rarement franchie par les entreprises.
Mme Bernadette Laclais. Je maintiens mon amendement. Contrairement à ce que dit M. Accoyer, la situation des TPE et PME de moins de cinquante salariés ne serait pas aggravée, bien au contraire, par ces mesures spécifiques les concernant.
Mme la présidente Catherine Lemorton. Je ne suis pas sûre, madame Laclais, que l’Union professionnelle artisanale (UPA) demande une telle disposition : elle n’a pas envie que l’on impose des choses dans chaque entreprise et préfère qu’un accord de branche couvre les TPE. Elle estime trop contraignant pour ses adhérents d’avoir à prendre des dispositions spécifiques. Il faut leur laisser cette liberté.
La Commission rejette l’amendement.
Puis elle adopte successivement les amendements rédactionnels AS956 et AS957 du rapporteur.
Elle examine ensuite, en discussion commune, l’amendement AS951 de la commission des affaires économiques et l’amendement AS370 de M. Christophe Cavard.
M. Yves Blein, rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques. C’est un amendement rédactionnel.
Mme Véronique Massonneau. Le texte n’incite pas suffisamment à la négociation en laissant trop de place au pouvoir unilatéral de l’employeur, puisqu’il est le seul, dans la rédaction initiale, à choisir la disposition qui s’appliquera dans son entreprise lorsque l’accord type prévoit des options. Le texte doit donc favoriser la négociation, y compris avec les salariés mandatés lorsqu’il n’existe pas de délégué du personnel. En outre, pour les TPE, le texte doit favoriser l’accès à l’information des salariés des quelques 800 000 entreprises de moins de onze salariés.
M. le rapporteur. Je demande à mes deux collègues de bien vouloir retirer leur amendement au profit de l’un des miens qui couvre leur demande et va même au-delà. À l’avis des salariés que vous mentionnez, j’ajoute notamment celui des CPRI. Je propose que nous cosignions cet amendement AS964.
Les amendements AS951 et AS370 sont retirés.
La Commission adopte successivement les amendements rédactionnels AS958 et AS959 puis l’amendement AS964 du rapporteur.
Puis elle adopte l’article 29 modifié.
*
* *
Article 29 bis
(Art. 39 du code général des impôts)
Provision pour risque pour les entreprises de moins de cinquante salariés
À l’initiative du rapporteur de la commission des affaires économiques, la Commission a adopté un article additionnel (AS952) qui autorise les entreprises de moins de cinquante salariés à déduire de leurs résultats, et donc de leur base fiscale, une provision pour risque lié à un contentieux prud’homal, quand bien même aucune procédure n’est effectivement engagée.
L’objectif est d’aider les petites entreprises, souvent fragiles, à constituer une réserve de précaution leur permettant de faire face à un contentieux prud’homal dont le résultat serait très pénalisant pour elles.
*
La Commission examine l’amendement AS952 de la commission des affaires économiques.
M. Yves Blein, rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques. Cet amendement concerne les entreprises de moins de cinquante salariés. Le plafonnement des indemnités de licenciement n’a pas été retenu dans le texte ; les montants resteront indicatifs comme prévu dans la loi Macron. Le plafonnement avait été envisagé pour sécuriser les petites entreprises qui peuvent se retrouver en difficulté après avoir été condamnées par les tribunaux prud’homaux à verser de lourdes indemnités à l’issue d’un conflit social.
Cet amendement propose d’autoriser les entreprises de moins de cinquante salariés à constituer des provisions à titre préventif, même si aucune procédure n’est effectivement engagée. Actuellement, la loi permet de provisionner quand un salarié engage une procédure et que le commissaire aux comptes évalue le dol potentiel pour l’entreprise. Avec cet amendement, les entreprises de moins de cinquante salariés pourraient anticiper ce risque en passant une provision d’un montant ne pouvant excéder un mois de masse salariale. Un tel dispositif est rassurant à la fois pour le salarié et pour le chef d’entreprise : le premier est assuré que l’entreprise ne sera pas défaillante ; le second peut profiter d’un moment où son entreprise est en bonne santé pour provisionner cette charge et en déduire le montant de ses bénéfices.
M. Bernard Accoyer. Nous aurions voté des deux mains l’article du projet initial qui prévoyait un plafonnement des indemnités prud’homales. Le Gouvernement a reculé, c’est bien dommage. Cet amendement va dans le bon sens. Il prend acte du fait que la vie des entreprises dépend souvent du niveau des indemnités qu’elles doivent verser. Dans mon département, la Haute-Savoie, plus de 50 % des dépôts de bilan sont liés à l’incapacité des entreprises à payer des indemnités. C’est malheureux pour tout le monde : pour les salariés concernés par le licenciement économique initial et pour tous les autres. Il est dommageable que le Gouvernement ait reculé sur une disposition centrale du texte. Nous voterons pour le présent amendement qui indique la bonne voie.
Mme Martine Carrillon-Couvreur. Je soutiens cet amendement qui propose une mesure très attendue par les chefs d’entreprise : le dispositif leur permettra d’anticiper les difficultés et de traverser les périodes délicates.
Mme Isabelle Le Callennec. La ministre nous a expliqué qu’elle avait supprimé, dans le projet de loi, le plafonnement des indemnités prud’homales au profit d’un dispositif contenu dans la loi Macron, qui permet d’établir un barème indicatif des indemnités par décret. Monsieur le rapporteur, savez-vous si ce décret très attendu va paraître dans les semaines ou les mois à venir ? Entre les deux versions du projet de loi, le sujet des indemnités a provoqué de nombreux débats. Cet amendement est un pis-aller, mais il permet d’aller dans le bon sens.
M. Alain Calmette. Je ne crois pas qu’il faille absolument et systématiquement faire un lien entre le plafonnement abandonné et cet amendement. Néanmoins, je pense aussi que cet amendement va dans le bon sens. Il contribue à l’appui aux PME que visent nombre des mesures que nous examinons ce matin. Petit à petit, nous modifions le texte dans un sens favorable aux PME qui pouvaient – sans doute légitimement – se sentir exclues. Avec cette mesure, nous les mettons vraiment au cœur de nos préoccupations.
M. Gérard Cherpion. Cet amendement répond vraiment au titre du chapitre : il cherche à améliorer l’accès au droit et à faciliter la vie des TPE. Nous n’avons tous que trop d’exemples d’entreprises confrontées à de graves difficultés, et dont la pérennité – avec la totalité des emplois – peut être compromise à cause d’indemnités à verser. Cet amendement va dans le bon sens, en permettant au chef d’entreprise de passer une provision pour accident – car, sans préjuger de la légitimité des raisons invoquées par les uns ou les autres, et tout en respectant l’avis des conseils de prud’hommes, on peut considérer cela comme un accident. L’entreprise pourra ainsi surmonter le problème sans connaître de difficultés bancaires : on le sait, dans de tels cas, les banques n’apportent guère leur soutien.
M. Gérard Sebaoun. Cette idée est intéressante, mais elle pose un problème, étant donné la différence de taille – et donc de masse salariale et de provisions potentielles – des entreprises auxquelles la mesure s’appliquerait. Dans une entreprise de trois salariés, la provision ne couvrira à peu près rien de ce que pourrait obtenir en indemnités un salarié licencié pour cause réelle et sérieuse ; dans une entreprise de quarante-neuf salariés, le risque sera très largement couvert.
Mme la présidente Catherine Lemorton. J’approuve cet amendement, mais voudrais apporter une précision. Pour une entreprise, un licenciement se traduit le mois suivant par un effet bénéfique sur la trésorerie : en attendant l’avis des prud’hommes, il peut s’écouler douze ou quinze mois durant lesquels l’entreprise n’a plus les salaires et les cotisations afférentes à payer. Une entreprise, qui licencie trois ou quatre salariés pour raison économique, va utiliser cette trésorerie supplémentaire pour pallier ses difficultés. Dans le cadre d’un licenciement pour une raison autre qu’économique, l’entreprise provisionne en attendant la décision des prud’hommes. N’oublions pas que c’est ce qui se passe en cas de licenciement donnant lieu à des indemnités pour préjudice.
M. le rapporteur. Je voulais remercier Yves Blein et la commission des affaires économiques pour cet amendement, qui nous permet de sortir de la logique actuelle du provisionnement pour contentieux avéré, afin d’autoriser le passage de provisions pour contentieux potentiel. Gérard Sebaoun a raison d’émettre une réserve à propos de la différence de taille des entreprises concernées. Cela étant, j’espère qu’une entreprise n’est pas confrontée à de nouvelles procédures tous les ans. Même une entreprise de trois salariés peut accumuler un montant de provisions qui lui permette de répondre au versement d’indemnités. S’agissant des entreprises de quarante-neuf salariés, peut-être devrons-nous revoir la mesure pour éviter qu’elles n’accumulent des provisions excessives. Cela étant, il ne faut pas amoindrir l’intérêt d’un dispositif qui répond à un réel souci des PME. Au passage, je précise que cette question de provisions n’a rien à voir avec le plafonnement des indemnités. Avis favorable.
Mme la présidente Catherine Lemorton. Je vais compléter mon propos pour être en phase avec le code du travail existant – il a beau être complexe, nous le connaissons quand même. Quand il n’y a pas de raison économique au licenciement, l’employeur doit remplacer le salarié licencié dès le lendemain de son départ. Le code du travail l’impose. Les employeurs ne le savent pas assez et perdent souvent aux prud’hommes pour une question de forme, parce qu’ils ont attendu deux ou trois jours avant d’embaucher. Dans ce cas, mon argument sur la trésorerie tombe un peu à l’eau, je vous l’accorde, monsieur Cherpion, puisqu’un nouveau salarié entre dans l’entreprise.
M. Gérard Cherpion. Je partage votre analyse sur la manière dont les choses peuvent se dérouler et aboutir à un allégement des charges quand il n’y a plus de salaire à verser. Cependant, l’amendement va au-delà de cette provision de gestion que vous décrivez : il s’agit d’une provision fiscale, déductible des bénéfices.
M. Gilles Lurton. Je suis tout à fait d’accord avec cet amendement, mais je voudrais revenir sur vos propos, madame la présidente. Quand un employeur licencie pour des raisons économiques, c’est souvent parce qu’il est en phase de baisse d’activité et donc de ressources. Il ne trouve pas forcément de nouvelles ressources au lendemain du licenciement.
Mme Kheira Bouziane-Laroussi. J’approuve cet amendement. Lors des auditions, j’avais interrogé les représentants patronaux sur ce risque qui induirait une peur de l’embauche. Pour moi, la notion de risque renvoie à celle d’assurance. Le représentant de la CGPME avait d’ailleurs indiqué que son organisation étudiait le problème sous cet angle. Le sujet mérite d’être approfondi afin que nous trouvions la bonne solution pour l’entreprise, mais aussi pour les salariés.
M. Michel Issindou. Si elle est sécurisante pour l’entreprise et les salariés, cette mesure est essentiellement fiscale. Nous l’examinons d’ailleurs après l’article 29, ce qui tend à indiquer que nous sommes à la frontière du code du travail et du code des impôts. Combien cette mesure gagée va-t-elle coûter ? Chaque entreprise de moins de cinquante salariés aura, de manière évidente, intérêt à provisionner systématiquement pour réduire son montant d’impôts. Quel est le niveau du manque à gagner pour l’État, qui sera compensé selon les règles prévues à l’article 575 du code général des impôts ? L’étude d’impact donne-t-elle une idée de ce coût qui peut d’ailleurs être considéré comme une politique utile en faveur des PME ?
Mme la présidente Catherine Lemorton. La mesure étant proposée par voie d’amendement, elle ne fait pas l’objet d’une étude d’impact.
M. le rapporteur. Je rappelle que les provisions ne peuvent excéder un mois de la masse salariale de l’entreprise. Nous avons arrêté ce dispositif avec l’accord du Gouvernement et après discussion avec Bercy. Je ne connais pas le coût précis de la mesure. Il vous sera possible d’interroger la ministre sur ce point lors de l’examen du texte dans l’hémicycle.
M. Yves Blein, rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques. Nous pouvons faire un calcul de probabilité en retenant des données moyennes. Pour une entreprise de vingt-cinq salariés, l’indemnité équivaut à deux ans de salaire pour un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. La fourchette de provisions est acceptable. La défiscalisation de cette provision ne dure d’ailleurs qu’un temps : le jour où elle est reprise, elle figure au compte de résultat de l’entreprise.
Mme Chaynesse Khirouni. Je voulais compléter l’intervention de ma collègue Kheira Bouziane-Laroussi en proposant d’élargir le débat à l’assurance et à la création d’un fonds de garantie. Aux PME et TPE, il faut d’ailleurs ajouter les associations qui peuvent aussi être confrontées à de vraies difficultés en raison de coûts liés à des licenciements. Notre réflexion d’aujourd’hui est une première étape, mais, lors d’auditions avec des représentants d’employeurs, j’avais évoqué les possibilités d’assurance et la création d’un fonds de garantie. Un tel fonds pourrait être mobilisé à n’importe quel moment, ce qui permettait d’échapper à la difficulté soulevée par Gérard Sebaoun. Ce pourrait aussi être un moyen pour l’employeur de sécuriser la procédure puisque, dans le cadre de la mise en œuvre d’un fonds de garantie, on ne fait pas n’importe quoi.
M. le rapporteur. Cette piste avait été envisagée lors de l’audition de l’Union nationale des professions libérales (UNAPL) et de l’Union des employeurs de l’économie sociale et solidaire (UDES). Ces organisations suggéraient la mise en place d’un tel fonds obéissant au principe de la mutualisation du risque. C’est une très bonne idée, mais nous craignons que sa mise en pratique ne prenne trop de temps. Il faut garder cet objectif, qui est le bon, ce qui n’empêche pas d’adopter le dispositif proposé par l’amendement.
Mme la présidente Catherine Lemorton. L’UNAPL et l’UDES se sont montrées clairement favorables à la mutualisation puisque embaucher ou être embauché est un risque, même si la formule est un peu violente.
La Commission adopte l’amendement.
*
* *
La Commission examine l’amendement AS405 de M. Denys Robiliard.
M. Gérard Sebaoun. Le premier signataire de cet amendement est Denys Robiliard, à qui, en votre nom à tous, j’adresse un signe d’amitié.
La France est présentée comme le leader européen de la franchise, secteur qui compte 350 000 salariés, 70 000 points de vente, 2 800 réseaux différents, et qui réalise 53 milliards d’euros de chiffre d’affaires. Or les salariés de ce réseau ne sont pas représentés.
Cet amendement vise à la création d’une instance de représentation du personnel, commune à l’ensemble du réseau de franchisés, qui permettrait l’instauration d’un dialogue entre représentants des entreprises et des salariés. Il est prévu que les salariés puissent accéder à des activités sociales et culturelles. Un recensement des offres d’emploi disponibles au sein du réseau permettrait aussi de leur offrir une perspective d’évolution ou de mobilité professionnelle. Enfin, la possibilité de négocier au niveau du réseau permettrait la conclusion d’accords et d’ouvrir ainsi la voie à des avantages pour l’ensemble des salariés des entreprises franchisées.
M. le rapporteur. Cet amendement propose une réforme extrêmement lourde, représentant une réelle avancée pour les salariés des réseaux de franchisés, qui en ont bien besoin. Néanmoins, en l’état actuel des éléments dont je dispose, il soulève plusieurs questions, notamment juridiques. L’une d’elles tient au choix de l’instance suggérée. Pourquoi ne pas avoir plutôt opté pour la reconnaissance d’une unité économique et sociale (UES) ? Pourquoi avoir choisi une instance de droit commun et non pas une négociation conventionnelle au sein du réseau des franchisés ? Certains éléments techniques nécessiteraient sans doute une concertation avec les entreprises concernées.
Sans nier les qualités de Gérard Sebaoun, je sais que Denys Robiliard est le fin connaisseur de ce dossier. Je plaide pour que l’amendement soit retiré afin que nous l’examinions en séance. Quoi qu’il en soit, c’est un sujet très important.
M. Gérard Sebaoun. Ce texte était considéré comme un amendement d’appel, destiné à susciter un débat que nous aurons certainement en séance.
L’amendement est retiré.
*
* *
Article 30
(Art. L. 1233-3, L. 1233-3-1 [nouveau] et L. 1233-3-2 [nouveau] du code du travail)
Motif économique de licenciement
Cet article opère une modification en profondeur de la définition du motif économique de licenciement, qui figure à l’article L. 1233-3 du code du travail.
En premier lieu, c’est la définition même du motif économique qui fait l’objet d’une refonte, avec l’introduction d’une série d’indicateurs issus de la jurisprudence qui précisent la notion de difficultés économiques, mais également l’inscription dans la loi des deux autres critères jurisprudentiels qui fondent la légitimité du motif économique.
Par ailleurs, comme pour les dispositions relatives à la durée du travail, aux repos et aux congés, la nouvelle architecture des normes proposée par le rapport de M. Jean-Denis Combrexelle sur « la négociation collective, le travail et l’emploi » est appliquée à cette définition. Le renvoi à la négociation collective pour la définition de certains indicateurs permettant de caractériser la notion de difficultés économiques est toutefois limité au niveau de la branche : autrement dit, aucun accord d’entreprise ne pourra venir déterminer sa propre norme en la matière.
Enfin, le texte revoit le périmètre d’appréciation du motif économique par le juge, en le limitant, pour les entreprises constituées en groupe, au secteur d’activité commun des entreprises situées sur le seul territoire national. Cette modification est assortie d’une disposition spécifique qui a pour but de maintenir le contrôle du juge au-delà du périmètre national en cas de création artificielle de difficultés économiques.
Rappelons toutefois que les licenciements économiques représentent une proportion relativement faible des ruptures de contrat de travail : en 2013, ils représentaient 5,3 % des sorties d’emploi en CDI et 0,6 % du stock d’emploi des entreprises. Par comparaison, les autres types de licenciements représentaient 15,8 % des sorties d’emploi et les ruptures conventionnelles 12,3 %.
Les entrées à Pôle emploi à la suite d’un licenciement économique représentent chaque année environ 155 000 personnes, soit 2,6 % des inscriptions annuelles à Pôle emploi.
Sur le plan du contentieux, en 2013, sur un peu plus de 160 000 litiges introduits auprès des conseil prud’homaux portant sur la contestation du motif du licenciement, seuls un peu moins de 3 500 d’entre eux portaient sur la contestation du motif économique – contre plus de 157 000 sur la contestation du motif personnel. Par ailleurs, le taux de recours contentieux est estimé à 30 % en cas de licenciement pour motif personnel, il est de moins de 3 % en cas de licenciement pour motif économique.
La loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi a organisé la refonte de la procédure de licenciement collectif dans les entreprises de plus de 50 salariés, en prévoyant que le plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) doit être négocié entre employeur et syndicats ou établi unilatéralement par l’employeur après consultation des représentants du personnel. Elle a également transféré à l’administration – en l’occurrence aux Direccte – la compétence en matière de contrôle sur le PSE et la procédure consultative, le contentieux sur ces deux points étant corrélativement confié au juge administratif. Toutefois, la loi de 2013 a maintenu la compétence du juge judiciaire sur le contentieux du motif économique du licenciement, défini à l’article L. 1233-3 du code du travail.
Tout licenciement économique doit être justifié par une cause réelle et sérieuse (article L. 1233-2). Aux termes de l’article L. 1233-3, le motif économique est non inhérent à la personne du salarié – sinon, il s’agit d’un licenciement pour motif personnel –, et résulte « d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ».
Cette définition du motif économique du licenciement a fait l’objet d’une abondante jurisprudence, qui a d’une part précisé la notion de « difficultés économiques » et dans une moindre mesure, celle de « mutations technologiques », et qui a, d’autre part, – sur le fondement de l’adverbe « notamment » – développé deux motifs supplémentaires de licenciement :
– la réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise ;
– et la cessation d’activité de l’entreprise.
Si les conditions sont remplies, la cause réelle et sérieuse est fondée : le juge n’a en effet pas à contrôler le choix effectué par l’employeur entre les différentes solutions possibles pour assurer par exemple la sauvegarde de la compétitivité de son entreprise (Cass. ass. plén., 8 décembre 2000 ; Cass. soc., 8 juillet 2009). La validité du licenciement économique est également subordonnée à l’impossibilité de reclasser l’intéressé.
Par ailleurs, les difficultés économiques invoquées ne doivent pas résulter d’une attitude intentionnelle ou frauduleuse de l’employeur (Cass. soc., 10 juillet 2002 et 22 juin 2011). L’employeur ne doit pas avoir fait preuve de légèreté en embauchant un salarié alors qu’il connaissait la mauvaise situation de l’entreprise (Cass., soc., 26 février 1992 et 26 mars 2003). Néanmoins, comme le juge n’a pas à contrôler les choix de gestion de l’employeur, la faute de ce dernier doit être particulièrement caractérisée (Cass. soc., 23 novembre 2011).
Dans les faits, les deux motifs les plus souvent invoqués pour justifier un licenciement d’ordre économique sont les difficultés économiques et la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise. L’étude d’impact note ainsi que les difficultés économiques ont été invoquées dans 49 % des PSE homologués ou validés depuis l’entrée en vigueur de la loi de sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013.
Les difficultés financières rencontrées par l’entreprise doivent être réelles et sérieuses, même s’il n’est pas exigé que la situation de l’entreprise soit catastrophique (Cass. soc., 9 juillet 1997). Ainsi, ne justifient pas à eux seuls le licenciement :
– la perte d’un marché (Cass. soc., 29 janvier 2014), sauf s’il s’agit de l’unique marché de l’entreprise ou encore de l’unique marché public d’une entreprise qui représentait 30 % de son chiffre d’affaires ;
– le souci de rentabilité de l’entreprise (Cass. soc., 5 mars 2014) ;
– des difficultés économiques résultant d’un manquement de l’employeur.
De la même manière, la baisse du chiffre d’affaires et du bénéfice de l’entreprise ne suffit pas caractériser l’existence de difficultés économiques (Cass. soc., 16 avril 2015) si elle ne s’accompagne pas d’autres indicateurs négatifs. Ainsi, si s’y ajoute une baisse constatée des ventes mais passagère, celle-ci traduit une diminution de la rentabilité et non des difficultés économiques. Elles sont en revanche établies si la baisse du chiffre d’affaires et du bénéfice se conjugue par exemple avec l’effondrement d’un marché.
L’existence de résultats déficitaires permet de fonder le motif économique, a fortiori s’il s’agit d’une dégradation spectaculaire des résultats (Cass. soc., 19 mars 2014), et qu’ils se traduisent par un résultat d’exploitation négatif et la perte de clients, ou encore par une chute du chiffre d’affaires liée à la crise affectant le secteur d’activité de l’entreprise. En revanche, le motif économique n’est pas fondé si ces résultats déficitaires sont néanmoins en amélioration par rapport aux exercices précédents, que le chiffre d’affaires est en augmentation et que l’entreprise améliore ses parts de marché.
On voit que la jurisprudence a tendance à exiger que deux ou plusieurs critères soient remplis pour « fonder » la légitimité d’un licenciement pour motif économique.
Comme l’indique l’étude d’impact, au rang des motifs valides de licenciement économique, ont été jugés tels, soit par la Cour de cassation, soit par le Conseil d’État – qui était, rappelons-le, le juge de dernier ressort compétent en matière de licenciement économique entre 1975 et 1986 – :
– la suppression de poste consécutive aux difficultés d’une entreprise qui avait été mise en règlement judiciaire (Cass., soc., 25 avril 1994) ;
– une baisse brutale et durable du volume d’activité de l’établissement et une tension à la baisse des prix de vente ayant conduit à une diminution des bénéfices (Cass., soc., 19 juin 2007) ;
– un surendettement bancaire de quatre millions de francs et une baisse du chiffre d’affaires (Cass., soc., 30 septembre 1997) ;
– un recours au chômage partiel pendant trois mois (CE, 20 mars 1996, s’agissant d’une société placée sous le contrôle technique du ministère des travaux publics, des transports ou du tourisme) ;
– une « crise conjoncturelle persistante » touchant le secteur d’activité de l’entreprise et entraînant une diminution importante des commandes (CE, 10 octobre 1986) ;
– une baisse de production et une importante perte d’exploitation (CE, 18 février 1983) ;
– des charges financières compromettant durablement les résultats de l’entreprise (Cass. soc., 26 janvier 2005) ;
– l’inadaptation du secteur d’activité d’une entreprise à l’évolution du marché, ayant entraîné des pertes d’exploitation ainsi qu’une dégradation des performances financières du secteur et une perte de compétitivité (Cass. soc., 29 janvier 2008) ;
– une baisse significative de la production et une contraction importante du marché intérieur, se traduisant par une baisse sensible du chiffre d’affaires (Cass. soc., 29 janvier 2008).
L’introduction d’une nouvelle technologie ayant une incidence sur l’emploi constitue une cause économique de licenciement, et cela, même si la compétitivité de l’entreprise n’est pas menacée (Cass. soc., 9 octobre 2002 et 15 mars 2012).
Le motif économique est également fondé dans le cas d’une entreprise procédant à l’acquisition de nouvelles machines permettant une automatisation des tâches (Cass. soc., 14 mai 1998) ou encore par la mise en œuvre d’un nouveau logiciel informatique entraînant la suppression d’une grande partie des attributions d’un salarié (Cass. soc., 17 mai 2006).
A contrario, le changement de logiciel d’une entreprise déjà habituée à la technologie informatique ne constitue pas une évolution pouvant être qualifiée d’innovation technologique (Cass. soc., 13 mai 2003).
Hors difficultés économiques ou mutations technologiques, une réorganisation d’entreprise peut constituer un motif valide de licenciement si elle est effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l’entreprise (Cass. soc., 5 avril 1995 et 31 mai 2011) ou du secteur d’activité du groupe auquel cette entreprise appartient (Cass. soc., 10 décembre 2003 et 9 juillet 2015).
Les difficultés économiques rencontrées par l’entreprise, qui la conduisent à mettre en œuvre une réorganisation, doivent mettre en cause sa pérennité (Cass. soc., 28 janvier 2014).
Correspondent à une réorganisation destinée à sauvegarder la compétitivité de l’entreprise celle décidée pour prévenir des difficultés à venir liées à :
– des évolutions technologiques et leurs conséquences sur l’emploi (Cass. soc., 11 janvier 2006 et 27 mars 2012) ;
– l’apparition de nouveaux acteurs sur le marché menaçant la compétitivité de l’entreprise (Cass. soc., 2 février 2011).
En revanche, ne correspondent pas à une réorganisation destinée à sauvegarder la compétitivité d’une entreprise :
– celle qui vise à réaliser des profits supplémentaires (Cass. soc., 30 novembre 2011 et 29 mai 2001) ou à améliorer sa rentabilité (Cass. soc., 17 décembre 2014) ;
– celle qui vise à améliorer les marges (Cass. soc., 13 septembre 2006) ;
– celle visant à réduire les charges sociales (Cass. soc., 12 novembre 1997) ;
– une réorganisation mise en œuvre alors que l’entreprise est prospère (Cass. soc., 29 janvier 2003).
Est également considérée comme injustifiée la décision de transférer la production de France vers l’étranger en raison d’incitations financières et fiscales attractives (Cass. soc., 18 septembre 2007), de même qu’une réorganisation liée aux prescriptions d’une autorité de tutelle à moins que cette réorganisation ne soit une condition à l’obtention de subventions nécessaires à la survie de la structure (Cass. soc., 2 avril 2008).
Dans une définition récente, la Cour d’appel de Paris a estimé que le motif de la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise supposait de rapporter « la preuve d’une menace pesant sur la compétitivité de l’entreprise devant entraîner une dégradation de sa position sur le marché, susceptible d’engendrer de difficultés économiques à venir et de compromettre les emplois s’il n’y est pas porté remède par des mesures d’anticipation » (CA Paris, pôle 6, ch. 10, 19 mai 2015).
Pour constituer en elle-même une cause réelle et sérieuse de licenciement économique, la cessation d’activité de l’entreprise doit être totale, définitive et ne pas résulter d’une faute ou d’une légèreté blâmable de l’employeur.
Ainsi, un employeur qui néglige de faire les travaux nécessaires ou de payer ses loyers fait preuve d’une légèreté blâmable qui, si elle conduit à la cessation d’activité de l’entreprise, ne constituera pas une cause réelle et sérieuse de licenciement. Pas plus que le motif de licenciement ne sera fondé face à des agissements fautifs de l’employeur (Cass. soc., 10 juillet 2002).
La cessation totale d’une entreprise appartenant à un groupe ne constitue pas une cause économique de licenciement si ce dernier exerce une telle influence sur sa filiale qu’il devient le coemployeur de son personnel (Cass. soc., 18 janvier 2011).
Une cessation partielle de l’activité de l’entreprise (Cass. soc., 10 octobre 2006) ou la fermeture d’un seul établissement (Cass. soc., 14 décembre 2005) ne justifie un licenciement économique qu’en cas de difficultés économiques, de mutation technologique ou de réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité.
Il en va de même pour une cessation temporaire, qui ne peut constituer un motif économique de licenciement que si elle est justifiée par une autre cause : difficultés économiques, nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise ou mutations technologiques (Cass. soc., 20 mai 2015).
Enfin, le juge contrôle que la cessation définitive de l’activité est réelle : est ainsi considéré comme dénué de cause réelle et sérieuse un licenciement économique effectué par une entreprise qui suspend son activité en la mettant en sommeil au niveau du registre de commerce pour ouvrir quelques mois plus tard un nouvel établissement (CA Toulouse, 4ème ch., sect. 2, 10 mai 2013).
Si l’entreprise n’appartient pas à un groupe, les difficultés économiques s’apprécient au niveau de l’entreprise dans son ensemble et non dans le cadre du secteur d’activité (Cass. soc., 6 mars 2007 et 26 juin 2012), pas plus que dans le cadre d’un établissement (Cass. soc., 26 février 2013 et 14 octobre 2015).
En revanche, dans les groupes de sociétés, ces difficultés doivent être appréciées au niveau du groupe ou du secteur d’activité du groupe auquel appartient l’entreprise concernée, si le groupe est composé de plusieurs secteurs d’activité (Cass. soc., 5 avril 1995, arrêt « Vidéocolor », et 14 octobre 2015). L’employeur doit alors fournir des éléments précis et détaillés sur la situation du secteur d’activité (Cass. soc., 9 juillet 2015).
Si l’entreprise fait partie d’une unité économique et sociale, l’appréciation du motif économique doit a priori s’opérer à cette échelle (CA Metz, 14 janvier 2013).
S’il s’agit d’un groupe international, doivent également être prises en compte les sociétés du secteur d’activité situées à l’étranger (Cass. soc., 12 juin 2001 et 4 mars 2009).
Concrètement, a été considéré comme dénué de cause réelle et sérieuse le licenciement justifié par la seule baisse d’activité et le résultat déficitaire d’un atelier alors qu’aucune difficulté économique au niveau du secteur d’activité du groupe auquel appartient l’entreprise n’a été relevée (Cass. soc., 26 octobre 1999). De même, la spécialisation d’une entreprise dans le groupe ou son implantation dans un pays différent de ceux où sont situées les autres sociétés du groupe ne suffit pas à exclure son rattachement à un même secteur d’activité au sein duquel doivent être appréciées les difficultés économiques (Cass. soc., 23 juin 2009).
Dans un arrêt du 31 mai 2006 dit « Catimini », la chambre sociale de la Cour de cassation a considéré comme dénué de cause réelle et sérieuse le licenciement économique lié à la réorganisation de l’entreprise d’un groupe dans le seul but d’améliorer les marges de ce dernier, en l’absence de toute menace pesant sur la compétitivité du secteur d’activité du groupe en question.
De la même manière, le seul souci de rentabilité ne permet pas de justifier un licenciement économique (Cass. soc., 14 décembre 2011, arrêt « Generali ») : en l’espèce, la charge de la preuve de la situation menacée du secteur d’activité dans un groupe d’envergure mondial revient à l’employeur qui doit produire les comptes consolidés du groupe mondial.
Cet article répond à un double objectif :
– d’une part, sécuriser les entreprises aujourd’hui confrontées à l’incertitude sur le caractère justifié ou non des difficultés économiques à l’origine d’un licenciement ;
– et d’autre part contribuer au renforcement de l’attractivité du territoire national pour les grands groupes détenant des filiales en France.
Sur le plan de l’architecture des normes, il reprend le triptyque préconisé par le rapport de M. Jean-Denis Combrexelle, qui consiste à articuler les normes autour de règles d’ordre public, de celles relevant de la négociation collective, et enfin, des normes supplétives, applicables à défaut d’accord. Cette nouvelle architecture appliquée aux critères de licenciement économique permet de donner plus de souplesse aux partenaires sociaux pour fixer, au niveau de la branche, les critères adéquats pour les entreprises d’un même secteur d’activité. Comme précédemment indiqué le texte ne retient toutefois pas le principe d’une primauté de l’accord d’entreprise. En effet, en la matière, la branche apparaît comme le niveau le plus adapté, de par son rôle naturel en matière de régulation économique et sociale.
La définition des critères qui fondent la nature économique du licenciement, tout comme les précisions relatives au périmètre d’appréciation de ces critères, relèvent du chapitre consacré aux règles d’ordre public (1° de l’article).
Cet article propose de préciser la définition du motif économique du licenciement. Le a) du 2° propose de substituer aux deux critères actuellement cités – les difficultés économiques et les mutations technologiques, dont on rappellera qu’ils ne sont pas exhaustifs, puisqu’ils sont précédés de l’adverbe « notamment » – le seul mot « notamment ».
Dès lors que le b) du 2° du présent article s’attache à énumérer de manière plus précise les différents critères permettant de fonder un licenciement économique, on peut s’interroger sur la pertinence du maintien de ce renvoi explicite à la non-exhaustivité, à travers le mot « notamment ».
En réalité, la fixation d’une liste limitative de motifs économiques de licenciement – qui correspond par exemple à l’option adoptée par les Pays-Bas en juillet 2015 – ne saurait être introduite dans le droit français. En effet, dans sa décision n° 2001-455 DC du 12 janvier 2002 sur la loi de modernisation sociale, le Conseil constitutionnel a jugé qu’une telle liste exhaustive de critères, qui prétend épuiser les raisons légitimes pouvant conduire à un licenciement économique, représentait une atteinte à la liberté d’entreprendre « manifestement excessive au regard de l’objectif poursuivi du maintien de l’emploi ». Autrement dit, le souhait de sécuriser la procédure du licenciement économique en précisant les critères qui le fondent se heurte à cet obstacle constitutionnel et contraint à maintenir une forme d’ouverture et d’indétermination irréductibles.
C’est pourquoi la liste plus exhaustive qui est proposée par le projet de loi au b) du 2° du présent article ne saurait en tout état de cause être pleinement exhaustive. On peut de ce point de vue s’interroger sur l’effet utile d’une énumération plus longue des différents critères « économiques », dès lors que ces critères demeurent inéluctablement non exhaustifs.
L’énumération des différents « motifs » économiques de licenciement débute par la notion déjà connue et centrale de « difficultés économiques », dont on a vu à quel point elle a pu donner lieu à une jurisprudence abondante et complexe. Cette cristallisation et cette stratification des critères retenus par le juge pour retenir ou ne pas retenir la cause réelle et sérieuse d’un licenciement économique posent, d’après l’étude d’impact, un véritable problème de visibilité aux entreprises, qui, dès lors qu’elles sont confrontées à un contexte difficile, ne sont pas en capacité d’anticiper ou de sécuriser leur situation au regard d’un éventuel licenciement.
Le projet d’article propose de répondre à cette incertitude chronique en fixant une série de critères qui caractérisent les difficultés économiques, autrement dit :
– soit une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires pendant plusieurs trimestres consécutifs en comparaison avec la même période de l’année précédente ;
– soit par des pertes d’exploitation pendant plusieurs mois ;
– soit par une importante dégradation de la trésorerie ;
– soit par tout élément de nature à justifier de ces difficultés.
Le texte retient une série de critères alternatifs, qui ont tous été dégagés par voie jurisprudentielle, et dont on ne saurait contester la légitimité.
Toutefois, la voie retenue suscite quelques interrogations :
– en premier lieu, on l’a vu, la jurisprudence retient très rarement un critère unique pour juger du caractère fondé du motif économique, sauf le plus souvent, si ce critère est massif, par exemple une perte d’exploitation très importante d’un groupe (Cass., soc., 29 janvier 2008). Or, dans l’option retenue par le texte, l’existence d’un seul critère suffirait à valider le motif économique, par exemple une importante dégradation de la trésorerie ;
– ensuite, on peut s’interroger sur la nature des critères retenus. Comme on l’a dit, si personne ne peut mettre en cause le fait qu’il s’agit de critères adéquats pour juger de la santé financière d’une entreprise (baisse des commandes, baisse du chiffre d’affaires, pertes d’exploitation, dégradation de la trésorerie), ces critères sont toutefois loin d’être les seuls qui puissent être pris en compte pour considérer qu’une entreprise est en difficulté économique. Ainsi, on l’a vu, le recours au chômage partiel a pu être retenu par le juge comme un critère suffisant pour considérer que les difficultés économiques étaient avérées. De même, plusieurs autres critères auraient pu être pris en compte comme la baisse de la production, le positionnement défavorable de l’entreprise par rapport à la concurrence, la concurrence des sociétés pratiquant des prix de vente inférieurs et dont la productivité est supérieure, etc., tous critères qui ont également été dégagés par voie jurisprudentielles
– en outre, la fixation des critères n’est pas harmonisée. Ainsi, le texte prévoit que la baisse des commandes ou du chiffre d’affaires pendant une certaine durée doit être mise en comparaison avec la même période de l’année passée, alors que les pertes d’exploitation et la dégradation de la trésorerie sont évaluées de manière brute à partir d’un instant « t ».
– la question peut aussi se poser de savoir pourquoi n’a été retenu qu’un critère de durée pour évaluer les deux premiers indicateurs supposés des difficultés économiques d’une entreprise, sans prise en compte aucune de l’ampleur enregistrée de la baisse des commandes ou des pertes d’exploitation, par exemple.
On rétorquera que le juge judiciaire pourra toujours estimer que le volume de la diminution du chiffre d’affaires ou de la dégradation de la trésorerie n’est pas suffisant pour caractériser les difficultés économiques. La rédaction choisie laisse néanmoins à penser que l’objectif recherché est de permettre à une entreprise de disposer d’un indicateur suffisamment précis pour savoir si elle se situe dans un contexte de difficultés économiques justifiant qu’elle procède à un ou des licenciements économiques. Autrement dit, une entreprise enregistrant des baisses de commandes pendant un an doit pouvoir considérer que ses difficultés économiques sont avérées et que les licenciements qu’elle engagerait sur ce fondement n’encourent pas l’invalidation en cas de contentieux. Or, peut-on réellement considérer qu’une très légère baisse des commandes, quand bien même serait-elle enregistrée pendant un an, suffit à caractériser des difficultés économiques ? Plusieurs interlocuteurs entendus par le rapporteur ont ainsi pu faire part de leurs doutes sur cet unique critère de durée, qui conduit en réalité à dessaisir le juge de sa capacité d’appréciation du caractère « sérieux » du licenciement, en ne lui concédant qu’un pouvoir d’appréciation sur son caractère « réel » (une baisse des commandes pendant x trimestres).
On sait en effet que les difficultés économique doivent être suffisamment importantes aujourd’hui pour justifier une suppression d’emplois, ce qui n’est pas le cas par exemple de difficultés passagères (Cass. soc., 27 janvier 2009) ou encore d’une situation déficitaire depuis des années en l’absence d’aggravation (Cass. soc., 23 mai 2000).
– enfin, la liste des critères est complétée par la formule « soit par tout élément de nature à justifier de ces difficultés ». Si cette formule permet précisément de couvrir les multiples autres critères dont la prise en compte est importante pour juger de la réalité des difficultés économiques d’une entreprise, elle présente également le double inconvénient, et le paradoxe, d’une part, de ne pas permettre une sécurisation pleine et entière pour les entreprises, qui restent exposées à une définition qui demeure floue, et d’autre part, de paraître plus large que la définition actuelle, puisqu’elle donne l’impression que n’importe quel indicateur négatif peut permettre à une entreprise de se décréter en difficulté économique.
Le texte reprend ensuite la notion de « mutations technologiques », déjà existante dans la rédaction actuelle, comme motif économique légitime de licenciement.
Deux autres critères se voient gravés dans le marbre de la loi : il s’agit des deux critères dégagés par le juge et pour lesquels la constance de la jurisprudence plaide pour une telle inscription. Il s’agit du critère de la « réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité » d’une part, et d’autre part, de « la cessation d’activité de l’entreprise ».
Le 3° complète la sous-section 2 consacrée à la définition du motif économique avec deux sous-paragraphes respectivement relatifs au champ de la négociation collective et aux dispositions supplétives, qui font l’objet des nouveaux articles L. 1233-3-1 et L. 1233-3-2.
Le nouvel article L. 1233-3-1 prévoit qu’une convention ou un accord collectif de branche fixe deux types d’indicateurs :
– en premier lieu, la durée de la baisse des commandes ou du chiffre d’affaires caractérisant les difficultés économiques, cette durée ne pouvant être inférieure à deux trimestres consécutifs ;
– en second lieu, la durée des pertes d’exploitation caractérisant les pertes économiques, cette durée ne pouvant être inférieure à un trimestre.
Le nouvel article L. 1233-3-2 dispose qu’à défaut de convention ou d’accord collectif de branche définissant ces indicateurs :
– la durée de la baisse des commandes ou du chiffre d’affaires caractérisant les difficultés économiques est de quatre trimestres consécutifs ;
– la durée des pertes d’exploitation caractérisant les difficultés économiques est d’un semestre.
L’application de la nouvelle articulation des normes au champ de la définition du motif économique inspire plusieurs réflexions.
Tout d’abord, le niveau de négociation retenu – celui de la branche – apparaît effectivement comme le plus approprié, puisqu’il correspond la plupart du temps au niveau d’un secteur d’activité et présente l’avantage de ne pas donner lieu à un foisonnement d’accords fixant des critères différents, ce qui occasionnerait une hétérogénéité des situations aux conséquences extrêmement préjudiciables. A contrario, fixer la capacité de négocier les critères des difficultés économiques au niveau de la branche présente l’inconvénient de ne pas permettre une prise en compte des spécificités des entreprises couvertes. Ainsi, au sein d’une branche, coexistent souvent des grandes et des petites entreprises : une branche qui fixerait le « seuil » de difficultés économiques à trois trimestres de baisse des commandes ou du chiffre d’affaires pourrait mettre en danger les petites entreprises de son secteur. En effet, trois trimestres de recul du chiffre d’affaires ou des commandes n’ont pas les mêmes conséquences pour une petite entreprise que pour une entreprise plus grande ; un tel recul n’a en outre pas le même sens s’il s’agit d’une entreprise confrontée à une concurrence importante ou d’une entreprise plutôt préservée. Enfin, une petite entreprise peut être en réelle difficulté économique au bout d’un unique trimestre de recul de son chiffre d’affaires ou de ses ventes. Dès lors, la fixation des critères de durée par la branche peut s’avérer à la fois drastique pour les petites entreprises qui en relèvent et souple pour les plus grandes entreprises du secteur.
Deuxièmement, et cette difficulté rejoint la première, suffit-il, comme on l’a déjà évoqué, de fixer un critère de durée pour considérer que des difficultés économiques sont fondées ? Peut-on sérieusement estimer qu’une entreprise qui enregistre une baisse de 0,1 % de ses commandes pendant six mois est en difficulté économique telle qu’un plan de licenciement économique serait justifié ? Qu’aucune prise en compte de l’ampleur des difficultés rencontrées ne soit requise paraît plus qu’étonnant. Toutefois, une telle définition de l’ampleur des difficultés pourrait difficilement relever de la négociation collective, en raison de la trop grande diversité des situations. C’est précisément aujourd’hui le pouvoir d’appréciation du juge qui permet, à travers une forme de casuistique, d’évaluer, en fonction du profil de l’entreprise, de sa taille, de son secteur d’activité, de son positionnement par rapport à la concurrence, etc., si les indicateurs invoqués permettent réellement de fonder l’existence de difficultés économiques.
Troisième interrogation : le texte ne prévoit pas de confier à la négociation collective la tâche de fixer un critère relatif à la dégradation de la trésorerie. On comprend aisément pourquoi, puisque s’agissant de cet indicateur – plus encore que des deux autres – le critère de durée ne paraît pas pertinent : il est, autrement dit, beaucoup plus difficile de fixer un critère pertinent de dégradation de la trésorerie qui soit synonyme de difficultés économiques. Il peut toutefois sembler incohérent que les branches puissent négocier pour fixer deux critères de licenciement économique, mais pas le troisième.
Quatrième réflexion : dès lors qu’une branche aurait fixé d’une part la durée de la baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, d’autre part, la durée des pertes d’exploitation caractérisant les difficultés économiques, la rédaction retenue par le projet conduit à soumettre le juge à ces indicateurs.
Dès lors qu’il aurait à connaître d’un contentieux concernant un licenciement économique dans une entreprise couverte par un accord de branche, et que l’un ou l’autre des critères de durée fixés par l’accord serait rempli, le juge serait tenu de valider le licenciement en question en l’estimant fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors même qu’il n’aura jamais pu évaluer le caractère « sérieux » de ce licenciement.
Si l’entreprise connaît bien une baisse de commandes depuis un semestre, et même si elle n’enregistre pas de perte d’exploitation et si sa trésorerie demeure excédentaire, le juge serait en effet « tenu » par les indicateurs fixés par accord, puisque, rappelons-le, ceux-ci sont posés comme étant alternatifs (et cela, alors même que la jurisprudence a tendance à considérer que plusieurs critères doivent être remplis pour justifier l’existence de difficultés économiques).
En outre, la fixation d’un critère de durée d’ordre « mécanique » ne permet pas de tenir compte des particularités liées au contexte économique de l’entreprise et, par exemple, d’un ralentissement de l’activité qui serait en réalité cyclique.
Enfin, s’agissant des dispositions supplétives, on peut soulever les mêmes interrogations que celles relatives aux critères retenus pour déterminer les indicateurs caractérisant les difficultés économiques.
Plus encore, le renvoi à la négociation collective étant entièrement nouveau, lors de la publication de la loi, aucune entreprise ne sera encore couverte par un accord de branche fixant des durées à prendre en compte pour apprécier les critères des difficultés économiques. Cela signifie que les dispositions supplétives s’imposeront par défaut : dès lors, le juge devra considérer que pour tout contentieux dont il sera saisi en matière de licenciement économique, en l’absence d’accord de branche, une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires sur un an par rapport aux douze mois de l’année précédente, ou encore des pertes d’exploitation enregistrées pendant un semestre, suffisent à caractériser les difficultés économiques. Dès lors qu’un seul de ces critères serait rempli, le licenciement économique devrait être considéré comme reposant sur une cause réelle et sérieuse.
Au total, la nouvelle articulation des normes proposée par le présent article, en permettant de poser par voie conventionnelle, au niveau de la branche, les critères de durée fondant légitimement les difficultés économiques d’une entreprise, conduit au résultat suivant : si un critère est rempli, il est suffisant (les critères étant alternatifs) ; en revanche, si les durées prévues par l’accord, ou, à défaut, celles qui s’appliquent de manière supplétive, ne sont pas remplies, opérant un retour aux règles d’ordre public, le juge devra aller rechercher si l’un ou l’autre des autres critères n’est pas rempli (dégradation de la trésorerie ou tout autre élément de nature à justifier des difficultés économiques).
Après l’énumération des différents motifs pouvant justifier une procédure de licenciement économique, le b) du 2° complète l’article L. 1233-3 relatif à la définition du motif économique, en précisant le périmètre d’appréciation de ce motif.
Le texte précise ainsi que « la matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise ». Il ajoute que « l’appréciation des difficultés économiques, des mutations technologiques ou de la nécessité d’assurer la sauvegarde de sa compétitivité s’effectue au niveau de l’entreprise si cette dernière n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun aux entreprises implantées sur le territoire national du groupe auquel elle appartient ».
Le niveau d’appréciation du motif économique est précisé pour trois des quatre motifs prévus par le texte : en effet, s’agissant de la cessation d’activité d’une entreprise, la question du niveau d’appréciation ne se pose pas.
S’agissant des trois autres motifs, le projet de loi propose de modifier ce qui fait aujourd’hui l’objet d’une jurisprudence constante, à savoir la prise en compte du groupe, ou du moins du secteur d’activité du groupe auquel appartient l’entreprise, pour les entreprises relevant d’un groupe. Le texte propose que, pour les entreprises appartenant à un groupe, l’appréciation des difficultés économiques, des mutations technologiques ou de la sauvegarde nécessaire de la compétitivité se fasse au niveau du secteur d’activité commun aux entreprises du territoire national du groupe auquel appartient l’entreprise ayant procédé au licenciement. Au lieu de tenir compte, comme aujourd’hui, de la situation économique d’ensemble du groupe auquel appartient l’entreprise, et le cas échéant, de la santé économique d’une ou plusieurs filiales du groupe installées dans d’autres pays européens ou du reste du monde, le juge verra sa capacité d’appréciation limitée aux seules filiales éventuellement installées en France et, qui plus est, de leur secteur d’activité commun. Le juge ne pourra donc plus tenir compte ni de la situation financière des filiales étrangères, ni de celle de la société mère si celle-ci n’est pas installée en France, ni des entreprises situées en France mais qui auraient une activité relevant d’un secteur différent de celui de l’entreprise concernée par le licenciement économique.
Dans un contexte de mondialisation, la fixation d’un périmètre strictement national peut sembler aller véritablement à contre-courant.
Le b) du 2° du présent article complète l’article L. 1233-1 pour préciser que « ne peuvent constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement pour motif économique les difficultés économiques créées artificiellement à la seule fin de procéder à des suppressions d’emplois ».
Cette précision se veut une contrepartie à la modification du périmètre d’appréciation des critères d’un licenciement économique. En effet, en fixant au juge un strict périmètre national pour évaluer les difficultés économiques d’une entreprise appartenant à un groupe, la question se pose de savoir si on ne court pas le risque à l’avenir de valider des licenciements économiques dans une entreprise en difficulté, et cela même, alors que le groupe auquel appartient l’entreprise aurait organisé les conditions de sa déroute, au profit d’une réorganisation destinée uniquement à des gains de compétitivité ou à une augmentation de ses profits.
De deux choses l’une : soit une telle pratique implique des transferts financiers frauduleux, auquel cas il s’agit d’un abus de droit, et il n’est alors nullement nécessaire de prévoir que dans ce cas, le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse, puisqu’en cas de fraude, le juge prononce en tout état de cause la nullité du licenciement, qui d’ailleurs ouvre au salarié le droit à être réintégré dans l’entreprise et au versement des salaires perdus entre son licenciement et sa réintégration (Cass., soc., 25 janvier 2006). Ainsi, dans un arrêt Lafarge Ciments du 27 novembre 2012 la Cour d’appel de Versailles a clairement indiqué que la fraude est susceptible d’annuler un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) dès lors que « le motif économique mis en avant ne correspond à aucune réalité et [n’est] mis en œuvre que pour dissimuler une situation de fait totalement différente de l’apparence donnée ».
En tout état de cause, la réserve de fraude existe toujours : il n’est jamais nécessaire de la prévoir explicitement dans la loi.
Soit il s’agit d’une pratique d’optimisation, qui conduit un groupe, en toute légalité, à mettre en difficulté une filiale pour des raisons de compétitivité ou de profits, et dans ce cas, encore faut-il s’assurer que ces raisons ne conduisent pas aujourd’hui déjà un juge à estimer le licenciement sans cause réelle et sérieuse, ce qui semble être le cas. En effet, d’après les éléments transmis au rapporteur, le juge peut d’ores et déjà censurer des opérations visant à créer des difficultés économiques artificielles, comme ce serait le cas par exemple d’une société mère réaffectant toute sa production de boulons dans une filiale lorraine rentable, alors qu’aucun marché n’existe, ou encore d’une société mère en situation de co-emploi qui organiserait des difficultés au sein d’une filiale dans le but de la mettre en liquidation judiciaire.
De telles opérations peuvent aujourd’hui déjà être annulées au titre de la fraude ou d’une légèreté blâmable.
En tout état de cause, cette « clause de sauvegarde » destinée à permettre au juge de garder un pouvoir de contrôle au-delà du territoire national en présence d’un montage qui conduirait un groupe à mettre en difficulté une filiale française pour des raisons artificielles, gagnerait à être élargie au motif de la réorganisation de l’entreprise destinée à sauvegarder sa compétitivité et non au seul motif des difficultés économiques, comme le prévoit le texte proposé.
Il convient également de s’interroger sur la possibilité pour le juge, à l’avenir, de mettre en évidence la création artificielle de difficultés économiques à la seule fin de procéder à des suppressions d’emplois, dès lors que son pouvoir d’appréciation restera limité au territoire national, et qu’il n’aura plus a priori la possibilité d’examiner la situation économique de l’ensemble du groupe et de ses filiales.
L’étude d’impact associée au projet de loi donne trois exemples de création artificielle de difficultés économiques pour justifier des licenciements économiques : celui « du transfert de la trésorerie d’une filiale française au profit d’une autre filiale, d’allocations de charges communes excessives ou de choix stratégiques qui, manifestement, cherchent à organiser l’insolvabilité d’un site français ». Dans chacun de ces cas, comment le juge pourra-t-il désormais avoir connaissance de tels transferts ou choix stratégiques si on le prive des moyens d’apprécier la situation économique du groupe dans sa globalité ?
Autant il peut sembler problématique de pré-valider un licenciement en l’estimant fondé sur une cause réelle et sérieuse préconstituée, autant il peut paraître « redondant » de préciser que la création artificielle de conditions économiques pour justifier un plan de licenciement ne constitue pas une cause réelle et sérieuse de licenciement.
*
Lors de son examen du texte, la Commission a adopté trois amendements AS1049, AS1050 et AS1048 à l’initiative du rapporteur, qui proposent une refonte assez large de l’article 30.
Ces amendements ont tout d’abord consisté à supprimer l’application à la définition du motif économique de licenciement de la nouvelle architecture des normes, en supprimant l’ensemble des dispositions renvoyées à la négociation collective, et par conséquent, les règles supplétives applicables en l’absence d’accord. En effet, il est apparu qu’il n’était guère pertinent de renvoyer au dialogue social pour la définition des critères de durée pouvant être retenus pour caractériser les difficultés économiques. La définition de ces critères doit relever de l’ordre public.
Ensuite, la Commission a, en adoptant ces amendements, modifié la définition même des difficultés économiques :
– par l’ajout d’un indicateur dans la liste de ceux déjà énumérés, celui de la dégradation de l’excédent brut d’exploitation ;
– par le maintien du caractère alternatif des indicateurs pouvant être retenus pour qualifier les difficultés économiques, et surtout par le principe réitéré qu’au moins un critère soit rempli pour caractériser ces difficultés ;
– par la prise en compte de l’ampleur des difficultés économiques, par le biais de l’ajout de la notion d’ « évolution significative » ;
– par le maintien du caractère « mécanique » d’un seul des indicateurs mentionnés, au lieu de deux dans la rédaction du projet de loi initial. En effet, le principe d’une durée permettant de caractériser des difficultés économiques n’a été retenu que pour la baisse des commandes ou du chiffre d’affaires ; elle a été supprimée s’agissant des pertes d’exploitation, qui seront donc renvoyées, pour l’examen de leur ampleur, à l’appréciation du juge.
La durée de la baisse des commandes ou du chiffre d’affaires permettant de caractériser les difficultés économiques a également été revue par rapport au projet de loi : alors que la rédaction initiale fixait, en l’absence d’accord collectif, la durée requise à au moins quatre trimestres, la Commission a souhaité introduire une différenciation de cette durée en fonction de la taille de l’entreprise. Ainsi, les difficultés économiques seront considérées comme constituées dès lors que, par rapport à la même période de l’année précédente, la baisse des commandes ou du chiffre d’affaires enregistrée par une entreprise aura été :
– d’au moins un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
– d’au moins deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
– d’au moins trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
– et d’au moins quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus.
*
Mme Monique Iborra. Avant que nous n’abordions la discussion sur l’article 30 relatif au motif économique de licenciement, je voudrais apporter quelques éléments de contexte. Nombre de nos concitoyens qui sont aujourd’hui dans la rue prétendent que le projet de loi va faciliter les licenciements économiques. Il n’en est rien, tout au contraire. On dit aussi que les grandes multinationales seront favorisées, alors que, pour licencier, elles invoquent l’absence de compétitivité plutôt que le motif économique.
L’article est en fait conçu à l’intention des TPE et PME. Le rapporteur va encore rééquilibrer le texte. Mais, en tout état de cause, la communication qui a été faite au sujet de ce dernier jusqu’à ce jour était souvent erronée.
M. Bernard Accoyer. Nous sommes ici au cœur d’un texte qui représente un rendez-vous manqué. L’article précise les causes du licenciement économique. Mais, à la moindre protestation, le Gouvernement rétropédale et fait machine arrière. Nous dénonçons ce manque de courage. Alors que les pouvoirs publics avaient enfin compris que le code du travail provoque des difficultés qui créent du chômage et inspirent la peur d’embaucher, ils sont pris en flagrant délit de renoncement. C’est inquiétant pour l’avenir du pays et désolant pour les salariés qui paieront de leur emploi cette reculade.
La Commission examine les amendements identiques AS338 de M. Gérard Sebaoun et AS746 Mme Eva Sas.
M. Gérard Sebaoun. Certains pensent que l’article 30 constitue la base nécessaire pour régler la question de la compétitivité et créer de l’emploi. À mes yeux, il marque seulement un recul de la protection des salariés.
La flexibilité existe depuis bien longtemps dans notre pays, avec l’intérim, le contrat à durée déterminée, utilisé à 90 % pour les jeunes qui entrent sur le marché du travail, des contrats de plus en plus courts, des ruptures conventionnelles, des dérogations aux 35 heures, des accords d’entreprise, des forfaits jours… Le recours aux juges serait la terreur des chefs d’entreprise en cas de licenciement économique : pourtant, moins de 2 % des litiges sont portés devant les prud’hommes, et les licenciements économiques ne représentent que 2,6 % des inscriptions à Pôle emploi. On cite l’Allemagne en exemple, mais les pouvoirs publics reviennent sur les mesures prises en matière de droit du travail, car la pauvreté y a explosé. En Espagne et en Italie, les emplois précaires sont nombreux ; la reprise y est moins due aux réformes sur le marché du travail qu’à une reprise de la conjoncture, à laquelle ces pays sont particulièrement sensibles en raison de l’élévation des taux d’intérêt sur la dette publique qu’ils avaient connue. La France suit une tendance différente.
La supposée rigidité du marché du travail n’est donc pas l’objet essentiel qui doit nous occuper. Nous faisons un mauvais diagnostic, sur la base duquel nous donnons un mauvais traitement : ce n’est pas comme cela que nous soignerons le malade.
Mme Eva Sas. L’amendement AS746 est défendu.
M. le rapporteur. L’important article 30 a donné lieu à de nombreux commentaires. En ma qualité de rapporteur, j’ai estimé que des évolutions étaient nécessaires, car il ne serait pas satisfaisant de s’en tenir à la législation actuelle. Aussi ai-je déposé des amendements à cet article. Mais le statu quo, tel qu’il subsisterait après l’adoption d’amendements de suppression, ne saurait lui non plus répondre aux difficultés que nous rencontrons. Dans la loi actuelle, en effet, le motif économique résulte « notamment de difficultés économiques ou de mutations technologiques ». Or la jurisprudence a dégagé au moins deux critères supplémentaires : la cessation d’activité et la réorganisation de l’entreprise destinée à sauvegarder sa compétitivité. Elle a aussi interprété de manière large la notion de difficultés économiques. Nous avons donc préféré récapituler les indicateurs fixés par le juge, en cherchant à savoir comment caractériser la situation économique d’une entreprise.
Il importe aussi de savoir comment tenir compte des différences de taille entre les entreprises, car la situation d’un artisan ne s’analyse pas de la même manière que celle d’une entreprise de 1 000 salariés. La notion de trimestre ne correspond pas à la même réalité pour l’un ou pour l’autre.
La démarche engagée par le projet de loi me semble de bon aloi. Le législateur doit travailler sur l’évolution de la jurisprudence. Je ne suis pas favorable au statu quo : j’émets donc un avis défavorable aux amendements de suppression de l’article 30.
Mme Isabelle Le Callennec. Il s’agit en effet d’un article très important, car il est effectivement nécessaire de préciser ce que sont les difficultés économiques ouvrant droit à licenciement. Les entreprises nous le demandent. Quand le contentieux est porté devant les prud’hommes, en effet, la notion n’est pas interprétée partout de la même manière.
En revanche, il faut remettre les choses en perspective. Comme l’a dit Gérard Sebaoun, les licenciements économiques concernent moins de 2 % des litiges portés devant les prud’hommes, tandis qu’ils ne représentent que 2,6 % des inscriptions à Pôle emploi. Il faut donc relativiser l’importance du débat. À mes yeux, il s’agit avant tout de sécuriser la situation des PME vis-à-vis des prud’hommes.
M. Jean-Frédéric Poisson. Je ne partage pas l’avis du rapporteur, selon lequel les juges ne pourraient apprécier toute forme de difficultés économiques, parce que la formulation actuelle le leur interdirait, alors que le recours à l’adverbe « notamment » dans l’énumération des causes possibles signifie nettement l’absence d’exclusive dans le code du travail actuel.
En outre, le rapporteur entend faire de ces motifs d’appréciation du juge des dispositions d’ordre public. Mais les motifs économiques du licenciement entrent-ils vraiment au nombre des dispositions qui garantissent la sécurité générale de notre droit ? Doit-on vraiment aller aussi loin ?
Certes, j’entends bien que toute forme artificielle de montage comptable ne saurait être reconnue comme susceptible d’établir l’existence de vraies difficultés économiques. Mais je ne crois pas que les juges tombent jamais dans un tel panneau.
En revanche, je ne suis pas sûr qu’on atteigne le but de sécuriser le droit en imposant aux procédures un cadre législatif. Retenir comme critère de difficultés économiques la simple baisse de chiffre d’affaires sur plusieurs trimestres me semble ouvrir un spectre très large qui rompt l’équilibre entre les droits du salarié et les intérêts de l’entreprise.
Bref, il y a à la fois trop de flou et trop de rigidité dans cet article. Bien que, n’étant pas membre de cette commission, je ne puisse pas participer au vote, je suis favorable à sa suppression.
M. Gérard Cherpion. Monsieur le rapporteur, je déplore quant à moi un problème de méthode. Nous trouvons dans la liasse trois de vos amendements, qui ont fait l’objet d’un dépôt tardif. Les deux premiers éclairent d’un jour particulier le sens de vos propos précédents.
Sur le fond, je suis effectivement opposé à la suppression de l’article. Mais vous en modifiez complètement la substance par un amendement dont l’adoption ferait habilement tomber tous les autres amendements déposés sur cet article. Vous proposez en effet de faire remonter au niveau des dispositions d’ordre public des normes qui n’en faisaient pas partie. Je ne conteste pas les critères que vous proposez, notamment dans la mesure où ils témoignent d’une attention particulière à la taille des entreprises. Mais la présentation est néanmoins étonnante. Vous vous substituez à la ministre du travail pour réécrire l’article sur le licenciement économique. Nous arrivons à une nouvelle modification de ce texte qui ne constitue pas, pour une fois, une reculade, mais conduit néanmoins à quelque chose de totalement différent. Il y a là un problème de méthode.
Vous caractérisez les difficultés économiques en fonction de la taille des entreprises : baisse des commandes ou du chiffre d’affaires d’un trimestre pour une entreprise de moins de 11 salariés, de deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins 11 salariés et de moins de 50 salariés, de trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins 50 salariés et de moins de 300 salariés, de quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de 300 salariés et plus.
Il me semble qu’il serait plus pertinent de différencier en fonction de la situation économique de l’entreprise. Votre amendement finirait presque par me faire croire que l’amendement de suppression se justifie.
Mme la présidente Catherine Lemorton. Le rapporteur jouit du privilège de déposer des amendements quand il le souhaite, n’étant pas soumis au délai de dépôt. Monsieur Cherpion, je me rends compte, vu votre argumentation, que vous avez pu en l’occurrence étudier ceux de notre rapporteur.
En tout état de cause, il ne sera pas dit que j’ai empêché la discussion sur les points chauds du texte. Je laisserai de même la parole aux auteurs des amendements qui tomberaient du fait de l’éventuelle adoption des amendements du rapporteur.
M. Gérard Sebaoun. Je rejoins notre collègue Jean-Frédéric Poisson. Outre tous les éléments de définition expressément cités, je suis étonné de voir que peut être invoqué « tout élément de nature à justifier » un licenciement économique. Cela ne saurait guère que compliquer l’accomplissement de la mission du juge.
M. Michel Liebgott. Le licenciement économique constitue l’un des traumatismes les plus violents que puisse vivre un salarié. Il est sans conteste une cause majeure de malaise. Il paraît important que nous ne nous référions pas seulement aux exemples étrangers, et le rapporteur a rappelé que sa réflexion portait sur une amélioration des critères, en tenant compte de la jurisprudence. Il ne s’agit pas d’empêcher le juge de juger : nous voulons au contraire l’aider.
Prenons l’exemple des inégalités entre les entreprises de différentes tailles. Les grandes entreprises n’ont pas de problème pour licencier : leurs politiques des ressources humaines leur permettent d’organiser le reclassement de 600 salariés sur d’autres sites. Dans ma commune, j’ai vu un établissement supprimé pour mieux en voir renaître un autre. Une grande entreprise avait pu supporter plusieurs centaines de milliers d’euros de déficit sur un site pendant des années, car elle ne voulait pas quitter la ville pour y préserver sa marque.
À Florange, on a pu rattraper des entreprises sous-traitantes, les pressions politiques ayant permis d’assimiler leurs salariés à ceux de la sidérurgie. Si on ne l’avait pas fait, ils auraient été victimes d’un jugement qui n’était pas porté par le juge intuitu personæ, mais qui était malheureusement l’une des conséquences du fait que ces entreprises étaient petites, car leurs salariés sont souvent les moins bien protégés.
Le licenciement économique dans les TPE et PME doit être notre première préoccupation. Ne pas traiter cette question serait une grave erreur. Devant la multiplication des dépôts de bilan, nous ne pouvons rester spectateurs. La réforme doit nous permettre d’en finir avec des licenciements économiques qui peuvent être abusifs, faute de définition législative pertinente.
M. le rapporteur. Nos travaux sur cet article sont marqués par la volonté de stabiliser la jurisprudence. Elle ne me semble pas incompatible avec notre fonction de législateur. Lorsqu’on constate les inégalités marquantes qui existent entre les tribunaux, il n’est pas choquant d’imaginer que le législateur veuille améliorer la compréhension du droit.
Monsieur Cherpion, vous êtes bien le seul à être surpris. Je me suis exprimé sur la question de l’article 30. J’assume en cela non seulement ma fonction de député, mais de rapporteur, car je tiens compte des discussions conduites avec tous les partenaires sociaux. Sur certains points, que je vous exposerai, je dépose des amendements ; sur d’autres, je réfléchis encore. Et vous me reprochez de remplacer la ministre ? Mais depuis quand le Gouvernement vote-t-il la loi ?
M. Gérard Cherpion. Il s’agit tout de même d’un projet de loi, non d’une proposition de loi.
M. le rapporteur. Vous avez en tout cas pu prendre connaissance des amendements que j’ai déposés et qui portent sur la distinction entre les entreprises selon la taille, sur les différents critères applicables à la notion de difficultés économiques et sur la suppression des alinéas qui renvoient à la négociation et au droit supplétif, pour en réserver le contenu aux dispositions d’ordre public.
En tout état de cause, je considère que la suppression de l’article 30 ne serait pas à la hauteur de notre fonction de législateur.
La Commission rejette les amendements.
Puis elle examine l’amendement AS1049 du rapporteur.
M. le rapporteur. Il s’agit seulement de supprimer le chapeau.
La Commission adopte l’amendement.
Puis elle examine, en discussion commune, les amendements AS1050 du rapporteur, AS966 de la commission des affaires économiques et AS690 de Mme Audrey Linkenheld.
M. le rapporteur. L’amendement AS1050 énonce, au niveau des dispositions d’ordre public, les critères et indicateurs pouvant être retenus pour caractériser les difficultés économiques. La définition des difficultés économiques me paraît en effet devoir être d’ordre public, sans possibilité d’y déroger par voie d’accord.
Pour ce qui est des critères, je propose d’y intégrer la dégradation de l’excédent brut d’exploitation, qui me paraît constituer un bon indicateur de la situation économique de l’entreprise. L’amendement maintient le caractère alternatif des critères caractérisant les difficultés économiques afin de répondre à une exigence constitutionnelle : une liste fermée serait considérée comme portant atteinte à la liberté d’entreprendre.
L’amendement prévoit qu’un critère au moins doit être rempli pour que les difficultés économiques soient considérées comme matérialisées, étant précisé que je souhaite introduire la notion d’ampleur des difficultés, qui me semble extrêmement importante. En effet, enregistrer de légères pertes d’exploitation pendant un semestre, par exemple, n’est pas forcément le signe d’une situation justifiant un licenciement économique. En tout état de cause, il me paraît essentiel que le juge puisse continuer à apprécier l’ampleur des difficultés rencontrées, sans s’arrêter à de simples critères de durée : c’est pourquoi l’amendement précise que l’évolution des indicateurs doit être significative.
Par ailleurs, en ce qui concerne les critères de durée, l’amendement propose de ne maintenir que ceux relatifs à la baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, seul cet indicateur conservant un caractère mécanique. L’amendement exclut en effet les critères mécaniques de durée pour les pertes d’exploitation. Dès lors que l’on conserve un caractère mécanique à la durée de la baisse des commandes ou du chiffre d’affaires pour apprécier les difficultés économiques, il me paraît nécessaire de tenir également compte des spécificités des entreprises en fonction de leur taille, ce que le projet de loi ne prévoit pas. Il s’agit pourtant là d’une nécessité, comme l’ont mis en évidence les travaux de la commission des affaires économiques : par l’amendement AS966, celle-ci prévoit ainsi une distinction en fonction des seuils d’effectifs.
L’amendement que je vous propose intègre la baisse des commandes ou du chiffre d’affaires en comparaison avec la même période de l’année précédente. Cette période est d’au moins un trimestre pour les entreprises de moins de 11 salariés, d’au moins deux trimestres consécutifs pour celles de 11 à 49 salariés, d’au moins trois trimestres pour celles de 50 à 299 salariés, et d’au moins quatre trimestres pour celles de plus de 300 salariés – cette dernière durée correspondant au plancher fixé par le projet de loi dans le cadre des dispositions supplétives.
Cette construction répond à une préoccupation exprimée par nombre de nos collègues, selon laquelle il paraissait insuffisant de se référer uniquement à des trimestres, mais aussi de ne pas tenir compte de la taille de l’entreprise ou de ne pas permettre de qualifier la situation économique. Ma proposition a pour objet de répondre à toutes ces interrogations légitimes. Il m’a semblé excessif d’exiger, comme le prévoyait le projet de loi, une année entière de diminution des commandes ou du chiffre d’affaires pour une TPE ou une PME, compte tenu de la fragilité particulière des petites entreprises, qui ne disposent pas de la même trésorerie ni du même accompagnement bancaire que les entreprises de plus grande taille.
Contrairement à ce qu’affirme M. Cherpion, je ne pense pas que cet amendement ait pour effet de vider l’article 30 de tout son sens.
M. Gérard Cherpion. Ce n’est pas ce que j’ai dit !
M. le rapporteur. J’estime au contraire qu’il donne du sens à l’article 30, en permettant de flécher de manière beaucoup plus précise les enjeux auxquels nous sommes confrontés.
M. Yves Blein, rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques. La question que nous abordons a longuement retenu l’attention de la commission des affaires économiques, qui y a répondu en déposant l’amendement AS966, très proche de celui que vient de présenter M. le rapporteur – auquel nous sommes tout disposés à nous rallier en retirant le nôtre.
Définir précisément le licenciement économique procure une plus grande visibilité aux salariés, en leur permettant de mieux comprendre l’environnement économique dans lequel évolue leur entreprise, mais aussi au chef d’entreprise – de la même manière, en autorisant tout à l’heure, grâce à l’amendement CE145, les entreprises de moins de cinquante salariés à constituer une provision pour risques sociaux, nous avons fourni aux TPE et aux PME un moyen supplémentaire de se sécuriser.
La commission des affaires économiques a également souhaité enrichir les critères, en particulier y en ajoutant celui de la dégradation de l’excédent brut d’exploitation. La seule baisse du chiffre d’affaires n’est pas forcément significative, dans la mesure où elle peut être voulue afin d’améliorer la rentabilité de l’entreprise.
Enfin, nous avons souhaité fixer des seuils, car, dès lors que l’on est en présence d’un signal d’alerte, il est justifié de réagir beaucoup plus vite pour une entreprise de dix salariés que pour une grande entreprise. De ce point de vue, la durée d’un trimestre pour les entreprises de moins de onze salariés me paraît tout à fait adaptée. À l’inverse, plus la surface économique d’une entreprise est étendue, en chiffre d’affaires comme en diversité de la clientèle, plus grande est sa capacité à gérer par anticipation une évolution de son activité, ce qui justifie que l’on prenne en compte un plus grand nombre de trimestres pour apprécier l’existence de difficultés économiques, et la nécessité éventuelle de procéder à un licenciement économique.
Je vous remercie, monsieur le rapporteur, d’avoir été à l’écoute de nos propositions. Nous sommes tout à fait d’accord avec le contenu de votre amendement, à une réserve près : la comparaison du chiffre d’affaires avec celui de l’année précédente ne nous semble pas forcément significative, car une entreprise peut diminuer son chiffre d’affaires tout en augmentant sa rentabilité, donc sa compétitivité.
M. Gérard Sebaoun. L’amendement AS1050 définit les difficultés économiques « soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation, une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés ». En raison de cette dernière partie de la phrase, il me semble que, en dépit de la grande vigilance dont a fait preuve le rapporteur, la rédaction de son amendement ne modifie pas substantiellement le texte.
Mme Isabelle Le Callennec. L’objectif de l’article 30 est de sécuriser juridiquement le licenciement économique, qui ouvre des droits aux salariés concernés, et de l’harmoniser sur l’ensemble du territoire. À la notion de baisse des commandes et du chiffre d’affaires, vous en avez ajouté d’autres telles que la dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, et « tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés ». Pouvez-vous nous préciser de quoi il s’agit ?
Par ailleurs, lorsque vous introduisez la notion de taille de l’entreprise, je ne comprends pas que vous le fassiez uniquement par association aux critères constitués par une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires, en excluant de fait la dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation.
Enfin, vous savez notre aversion pour les seuils et comprendrez donc notre effarement en découvrant qu’on appliquera le critère de comparaison sur deux trimestres consécutifs pour une entreprise de quarante-neuf salariés, et sur trois trimestres pour une entreprise de cinquante salariés. Alors que, pour ce qui est des indemnités prud’homales pour licenciement jugé sans cause réelle et sérieuse, on devra se référer à un barème indicatif, vous imposez un barème impératif pour la définition du licenciement économique. Je vous avoue avoir un peu de mal à suivre votre logique.
M. Jean-Frédéric Poisson. Monsieur le rapporteur, vous nous avez expliqué avoir l’ambition de stabiliser la jurisprudence. Est-ce à dire que vous pensez être en mesure d’homogénéiser les décisions de la chambre sociale de la Cour de cassation ? Si vous y parvenez, vous aurez bien mérité qu’on pose une plaque à votre nom dans cette salle, la chambre sociale de la Cour de cassation étant connue pour rendre des décisions diamétralement opposées sur tous les sujets !
Nous ne devons pas perdre de vue que, l’amendement AS1049 ayant été adopté, les dispositions que vous nous proposez sont désormais fixées dans un cadre situé hors du champ de la négociation collective, et ne peuvent relever de dispositions supplétives : elles sont d’ordre public. Si l’amendement AS1050 est adopté, les seuls critères de caractérisation des difficultés économiques seront les seuils et les durées énoncés, sans que les entreprises aient la possibilité de prendre d’autres dispositions par la voie conventionnelle. Or le texte du Gouvernement prévoyait que des dispositions conventionnelles puissent adapter ou moduler les règles de droit commun figurant dans la première partie de l’article 30. Votre amendement a pour effet de rigidifier le dispositif et je ne suis pas certain que les partenaires sociaux soient d’accord avec cette évolution.
Un trimestre représente une très longue durée dans la vie d’une entreprise : il est des entreprises de 300 salariés qui ne supporteraient pas plus de la moitié d’un trimestre de dégradation de certains de leurs indicateurs. Quant à l’idée d’établir une corrélation entre la taille des entreprises et les difficultés auxquelles elles sont confrontées – en ajoutant de nouveaux seuils à un monde économique qui en compte déjà beaucoup trop –, elle ne me paraît pas pertinente : une très grosse entreprise peut connaître des difficultés qui la mettront à genoux en quelques semaines, et il ne sera pas nécessaire d’attendre trois trimestres pour exiger que soient prises des dispositions importantes en matière de réorganisation et éventuellement d’ajustement des effectifs.
Pour l’ensemble de ces raisons, votre amendement ne me paraît pas constituer une solution satisfaisante.
M. Bernard Accoyer. Une période de référence d’une année constitue à la fois une exigence et une faiblesse. En effet, il peut arriver qu’une situation se dégrade progressivement sur plusieurs années, ce qui oblige à prendre des décisions à un moment donné.
Par ailleurs, les cinq derniers paragraphes de votre amendement multiplient les seuils, donc les rigidités, alors qu’il suffirait, pour stabiliser la jurisprudence comme vous le souhaitez, de retenir la durée d’un trimestre : si, comme vous le reconnaissez, la baisse d’un certain nombre d’indicateurs au cours d’un trimestre menace une entreprise de onze salariés, elle peut tout autant menacer une entreprise de 5 000 salariés.
Mme Monique Iborra. S’il est difficile de prévoir toutes les raisons pouvant constituer le signe de difficultés économiques et justifier éventuellement de procéder à des licenciements, pour les PME et les TPE, le législateur que nous sommes doit-il renoncer à apporter une meilleure définition que celle du code du travail ? Je ne le pense pas.
Pour ce qui est de la jurisprudence, les magistrats que nous avons auditionnés nous ont expliqué envisager de mettre en place des formations qui leur seraient destinées, afin de leur permettre de rendre des jugements éclairés. Il ne faut donc pas penser non plus que le fait de s’en remettre au juge règle tous les problèmes.
Donner plus de visibilité aux PME et TPE, ce n’est pas seulement leur permettre de détecter les dangers, c’est aussi leur ouvrir des perspectives en leur montrant qu’elles peuvent embaucher et prendre de l’ampleur. Nous pouvons et devons le faire, même si cette démarche ne résoudra pas tous les problèmes.
Mme Chaynesse Khirouni. Monsieur le rapporteur, avec tout le respect et l’amitié que j’ai pour vous, je dois vous dire que votre amendement confirme la difficulté d’intégrer dans la loi des critères clarifiant les difficultés économiques de l’entreprise, de nature à justifier un éventuel licenciement économique. Pour ma part, je considère que, pour les TPE et PME, le dispositif que vous proposez accroît l’insécurité juridique pour les employeurs et pour les salariés. Je m’interroge notamment sur les périodes retenues pour l’évaluation des difficultés économiques, notamment la durée d’un trimestre pour les entreprises de moins de onze salariés – sur ce point, M. Poisson a exposé des arguments tout à fait convaincants.
Je m’interroge également sur le fait d’associer le chiffre d’affaires au nombre de salariés. Une entreprise de cinq salariés – une start-up, par exemple – peut réaliser un chiffre d’affaires bien plus important qu’une entreprise de quinze salariés : tout dépend de l’activité économique. Je ne vois pas comment le fait de redéfinir les critères de difficultés économiques pourrait aider les juges à prendre une décision éclairée au sujet d’une procédure de licenciement : comme l’a dit Mme Iborra, des formations leur seraient sans doute bien plus utiles. Les licenciements pour motif économique représenteraient 2 % des licenciements. Si cela peut sembler peu, les employeurs y voient cependant une importante source d’insécurité juridique, à laquelle ni le projet de loi ni votre amendement ne me semblent apporter de réponse.
Par ailleurs, les associations sont aussi des entreprises et se trouvent, à ce titre, soumises au code du travail : tout un pan de l’économie sociale et solidaire se trouve donc concerné par les dispositions relatives aux licenciements pour motif économique. Or les critères énumérés par l’article 30 et votre amendement ne répondent pas à la situation particulière des associations, le seul critère de la dégradation de la trésorerie n’étant pas suffisant.
Pour les employeurs, la vraie difficulté réside dans la justification du licenciement pour insuffisance professionnelle : cela implique une procédure, un suivi, des comptes rendus, des entretiens, un accompagnement, toutes choses qu’un petit chef d’entreprise a du mal à assumer. À mon avis, cela constitue au quotidien un problème bien plus important que celui du licenciement économique. Environ 27 000 ruptures conventionnelles sont actuellement conclues chaque mois. C’est le signe d’un assouplissement de notre droit, qui permet aux entreprises et aux salariés en désaccord de rompre le contrat qui les unissait.
M. Gérard Bapt. Le réquisitoire de Mme Le Callennec et M. Poisson contre les seuils m’a paru un peu paradoxal, car les seuils, qui sont présents partout dans notre législation, posent toujours des difficultés, que ce soit en matière sociale ou dans le domaine budgétaire.
L’amendement de notre rapporteur répond à une préoccupation importante pour nos territoires et les entreprises qui les font vivre : je pense notamment aux petites entreprises du secteur du bâtiment et des travaux publics qui, lorsqu’elles perdent un marché, doivent pouvoir compenser en bénéficiant l’année suivante d’une autre commande, émanant souvent d’une collectivité locale, si elles veulent assurer leur pérennité.
Pour ce qui est des problèmes suscités par le licenciement pour insuffisance professionnelle, Mme Khirouni est libre de faire des propositions, mais c’est un autre problème que celui qui nous occupe.
Mme Chaynesse Khirouni. J’ai simplement voulu évoquer tous les sujets relatifs au licenciement !
M. Gérard Bapt. En tout état de cause, cela n’a rien à voir avec l’amendement du rapporteur, qui répond à une importante préoccupation des petites entreprises qui font vivre les zones rurales.
M. Michel Issindou. Le travail effectué par le rapporteur et qui consiste à établir des critères et des seuils sera utile au juge. Il me paraît justifié d’introduire de la souplesse dans le dispositif en ajoutant la mention de « tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés », car il ne faut jamais perdre de vue que l’on ne peut prévoir toutes les situations.
Les acteurs de terrain nous disent souvent qu’ils éprouvent la nécessité de s’adapter en temps réel à l’activité économique, dans le dessein de sauver des emplois, et non l’inverse : je ne connais pas de PME qui se soit donnée pour objectif de se débarrasser de ses salariés. Cela dit, les entrepreneurs n’ont plus confiance dans le système actuel et n’embauchent quasiment plus pour une durée indéterminée : 85 ou 90 % des contrats proposés sont des CDD ou de l’intérim, avec toutes les dérives que cela entraîne. Je connais même de grandes sociétés qui n’embauchent plus d’ingénieurs en direct : elles font appel pour cela à des sociétés d’intérim spécialisées.
C’est un fait : la difficulté à qualifier les licenciements pour motif économique aboutit à une situation aux antipodes de la situation idéale, celle où tous les salariés seraient embauchés pour une durée indéterminée. Parmi les solutions « bricolées » pour contourner les difficultés entourant le contrat de travail, la rupture conventionnelle a connu le plus grand succès, mais je ne suis pas certain qu’elle soit de nature à réduire le climat d’insécurité où se trouvent les personnes entrant actuellement dans l’emploi.
Dans certaines situations, il peut être préférable de se séparer d’une partie des salariés plutôt que de vouloir garder tout le monde et de laisser l’entreprise s’enfoncer dans les difficultés, ce qui finira par entraîner encore plus de personnes vers le chômage. Avec son amendement, le rapporteur poursuit avant tout l’objectif de lutter contre le chômage, ce que nous ne devons pas perdre de vue, même si cela peut donner aux salariés le sentiment d’une certaine insécurité. Le compte personnel d’activité (CPA) que nous avons voté hier peut avoir vocation à permettre aux salariés de passer plus facilement d’un emploi à un autre. Certes, cela relève encore d’une vision idéale, pour ne pas dire utopique, du monde du travail, mais la flexisécurité est bien l’objectif vers lequel nous devons tendre. Nous devons pour cela faire confiance aux entrepreneurs, qui sont les seuls à créer vraiment de l’emploi, sans désespérer les salariés. C’est tout l’enjeu de ce texte et, en l’occurrence, de cet amendement.
M. Alain Calmette. Le vote de l’amendement AS1049 a eu pour conséquence importante de remonter au niveau de l’ordre public les critères définis par l’amendement AS1050. Compte tenu de l’objectif que nous nous sommes fixé et qui consiste à stabiliser la jurisprudence et à uniformiser les caractéristiques du licenciement économique, nous devons être le plus précis possible, car, faute de pouvoir renvoyer certains aspects du dispositif à la négociation collective, il nous faut quasiment tout prévoir. Dans ce contexte, je m’interroge sur la fin du premier paragraphe de l’amendement, à savoir « tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés » : peut-il y avoir un « élément de nature à justifier de ces difficultés » qui n’entraîne pas obligatoirement une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, une perte d’exploitation, une dégradation de trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation ? Si cela existe, il faut le prendre en compte ; sinon, il me semble que cette dernière proposition ne va avoir pour effet que de susciter des incertitudes allant à l’encontre de la logique que nous cherchons à mettre en œuvre.
Mme Eva Sas. Après avoir, à mon tour, salué, sincèrement, la qualité du rapporteur, permettez-moi de m’étonner qu’il nous présente un tel amendement.
D’abord, aucune solution n’est n’apportée au problème du périmètre, qui reste national et non européen.
Mme la présidente Catherine Lemorton. Ce n’est pas l’objet de l’amendement !
Mme Eva Sas. Ensuite, en introduisant de nouveaux seuils selon la taille de l’entreprise, cet amendement rend la situation plus complexe alors que le projet de loi prétend simplifier le code du travail. De plus, comme mon collègue Jean-Frédéric Poisson, je considère qu’il n’existe pas de corrélation entre la taille d’une entreprise et sa capacité à résister à des difficultés économiques – le niveau de trésorerie de l’entreprise est en revanche véritablement déterminant. Avec ces seuils, l’amendement introduit une inéquité forte en défaveur des salariés des petites entreprises qui pourront être licenciés plus facilement.
Par ailleurs, Chaynesse Khirouni a raison de considérer que cet amendement n’éclaire pas du tout le juge : il introduit au contraire des éléments qui vont perturber son appréciation sans permettre l’analyse de la réalité de la situation économique d’une entreprise, car les choses sont bien plus complexes que ce qu’il laisse entendre. En effet, le chiffre d’affaires constitue parfois un critère inopérant : une entreprise dont le chiffre d’affaires baisse peut parfaitement enregistrer une progression de son bénéfice.
Enfin, les critères introduits par l’amendement sont beaucoup trop larges. Les difficultés économiques sont en particulier caractérisées par « l’évolution d’au moins un des indicateurs économiques » énumérés. D’une part, qu’en est-il si les critères évoluent de façons totalement divergentes ? D’autre part, l’évolution négative d’un seul indicateur suffit pour licencier. Quant à la mention de « tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés », elle est extrêmement large et, à notre sens, beaucoup trop vague pour que nous puissions adopter un texte qui ouvrirait la porte à des licenciements économiques sans qu’une entreprise ait à justifier de réelles difficultés économiques.
M. Gérard Cherpion. L’article 30 nous avait donné de grands espoirs sur l’évolution possible et raisonnable du licenciement économique, mais le fait que les dispositions présentées par l’amendement revêtent un caractère d’ordre public conduit à supprimer toute une partie du dialogue social initialement prévu. Il est étonnant que ceux-là mêmes qui prônent le dialogue social en permanence parviennent à en supprimer une phase entière au niveau de l’entreprise.
Cet amendement met en place des critères limitatifs contestables : les interventions que nous venons d’entendre, exprimées depuis tous les bancs de la Commission, en témoignent. La réintroduction de seuils rend la situation plus complexe. Nous ne gagnons rien en lisibilité et la vie des PME n’est pas facilitée, contrairement à ce qui a été annoncé.
En espérant que cet article, qui allait initialement dans le bon sens, évoluera positivement d’ici à la séance publique, nous nous abstiendrons sur cet amendement.
M. le rapporteur. Je remercie les collègues qui ont eu des mots sympathiques à mon égard. Je suis bien convaincu de leur sincérité.
Certains me font cependant un procès en « rigidité ». Ils oublient que je propose de modifier la rédaction du projet de loi présenté par le Gouvernement. Si nous n’introduisons pas de distinctions entre les entreprises selon leur taille, la durée requise de baisse significative du chiffre d’affaires ou des commandes s’établirait indifféremment à quatre trimestres, en application des dispositions supplétives prévues par le texte. Je ne propose donc pas d’introduire une rigidité, mais, bien au contraire, d’adopter des dispositions d’ordre public qui permettent d’établir une distinction entre les entreprises sur le fondement de seuils dont j’ai bien constaté l’existence durant les auditions. Nous verrons d’ailleurs que ceux qui me critiquent à ce sujet ont eux-mêmes présenté des amendements visant à établir des seuils.
Personne ne prétend qu’il n’y aurait pas de différence entre un artisan et une entreprise de 400 salariés. Pour autant, fallait-il qu’il y ait autant de seuils ? J’avoue que, dans un premier temps, je n’avais défini que trois catégories, avec des seuils à 10 et à 50 salariés. Divers échanges m’ont amené à prendre en considération la profonde différence qui sépare une entreprise de 55 salariés d’une autre qui en compte 1 000. J’ai donc ajouté un seuil à 300 salariés. Il me semble erroné de parler de rigidité, s’agissant d’un élément d’adaptation à la réalité économique !
Quant aux critères choisis, comme la commission des affaires économiques, nous avons retenu ceux qui reviennent le plus souvent dans la jurisprudence. La mention de « tout élément de nature à justifier ces difficultés » soulève des interrogations. Nous sommes pourtant dans l’obligation de l’inclure en raison de la jurisprudence du Conseil constitutionnel qui considérerait que, si elle ne figurait pas dans le texte, nous porterions atteinte à la liberté d’entreprise.
Au-delà de cette obligation constitutionnelle, cette mention permet de laisser au juge une capacité d’appréciation. La jurisprudence montre qu’il prend position en tenant compte, par exemple, de la concurrence, d’une crise conjoncturelle ou d’un problème de productivité. Certes, les critères stricts de baisse du chiffre d’affaires ou de tels indicateurs ne peuvent pas suffire à caractériser des difficultés économiques. Mais, madame Khirouni, cette rédaction permet d’inclure les problématiques spécifiques aux associations. Nous n’ouvrons pas un fourre-tout qui permettrait de justifier des licenciements économiques par n’importe quel argument : au contraire, nous permettons au juge de développer une argumentation et d’apprécier la situation.
Après les nombreuses auditions que nous avons menées, à l’occasion desquelles les acteurs de terrain nous ont fait passer des messages, le renvoi à la négociation collective de la définition des critères du licenciement économique me paraît être quelque chose de fou. Cette disposition était dans le projet de loi, mais, parce que je ne partage pas ce choix, je présente un amendement qui introduit des critères qui sont strictement d’ordre public pour définir le licenciement économique : ils ne relèvent donc ni de la négociation ni de dispositions supplétives, et ils s’imposent partout. Certes, ces éléments, proposés en accord avec Yves Blein, rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques, apportent aux chefs d’entreprise des précisions sur les conditions d’un licenciement économique, mais ils fournissent aussi des éléments au juge pour qu’il s’oppose à ce que l’on en vienne à faire n’importe quoi.
Ainsi, nous parvenons à un certain équilibre. Il s’agit de s’adapter à une réalité caractérisée par une disparité des situations qui tient à la fois à la géographie, à la diversité de la jurisprudence, à la taille des entreprises, aux difficultés des divers marchés, à la crise économique. Le législateur ne peut pas ne pas en tenir compte et ne pas donner d’orientations nouvelles.
L’amendement AS966 est retiré.
La Commission adopte l’amendement AS1050.
En conséquence, l’amendement AS690 tombe, de même que les amendements AS309 de M. Daniel Goldberg, AS419 de Mme Jacqueline Fraysse, AS372 de M. Christophe Cavard, AS477 de Mme Jeanine Dubié, AS339 et AS406 de M. Gérard Sebaoun et AS252 de Mme Marie-Lou Marcel.
M. Gérard Sebaoun. Nous avons déjà évoqué les difficultés des plus petites entreprises à trouver un financement auprès des banques. J’ai retrouvé à ce sujet les chiffres d’une enquête régulièrement effectuée par un syndicat représentant environ 30 000 petites entreprises – je rappelle que les TPE constituent 97 % des entreprises : 62 % d’entre elles annoncent des dégradations de leur trésorerie. Je pense que nous devons conserver cette donnée à l’esprit.
La Commission examine, en discussion commune, les amendements AS700 de Mme Audrey Linkenheld, AS374 de M. Christophe Cavard, AS747 de Mme Eva Sas et AS654 de M. Kader Arif.
L’amendement AS700 est retiré.
Mme Véronique Massonneau. L’amendement AS374 vise à substituer aux mots « sur le territoire national » les mots « dans l’espace économique européen ». Les difficultés économiques d’une entreprise appartenant à un groupe doivent être estimées en relation avec la situation économique des autres entreprises appartenant au groupe et se trouvant dans l’Union européenne et en Suisse. La seule situation nationale ne peut servir à rendre compte de la situation d’entreprises européennes et multinationales dont la capacité à jouer des transferts d’écritures est avérée par ailleurs.
Mme Eva Sas. L’amendement AS747 va dans le même sens. Il vise à élargir au périmètre européen l’examen des difficultés économiques d’une entreprise susceptible de recourir à des licenciements pour motifs économiques. Il est en effet malheureusement trop courant que des entreprises ou des groupes transfèrent artificiellement des pertes sur une entreprise nationale pour justifier des licenciements économiques auxquels ils veulent procéder dans un cadre légal. L’appréciation du « motif économique » au niveau européen permettra d’éviter que les présentations artificielles des comptes ou les orientations des commandes européennes vers des entreprises ou établissements qui se trouvent dans des pays étrangers ne masquent la situation économique réelle d’un groupe.
L’amendement AS654 est retiré.
M. Gérard Sebaoun. Ces amendements tentent de proposer un périmètre européen pour l’appréciation du licenciement économique. Pour ma part, je suis partisan d’un maintien du statu quo : lorsqu’il y a des licenciements, il faut que l’on puisse appeler à la rescousse une grande entreprise qui a des filiales dans le monde entier et qui produit son cash flow à l’autre bout de la planète.
M. Jean-Frédéric Poisson. Cette question constitue l’un des motifs de mes réserves à l’égard de l’article 30 : la séparation des niveaux de responsabilité est à mon sens contraire à l’esprit même de la responsabilité d’un investisseur et d’un chef d’entreprise. C’est pourquoi il faut qu’une seule référence demeure : celle du groupe. Les groupes bénéficient de législations qui intègrent vers le haut à peu près tous les éléments nécessaires ; je ne comprends pas que, sur ce point particulier relatif à la santé économique, nous distinguions entre le groupe et ses établissements. Au nom de la liberté d’entreprendre et de la responsabilité qui est liée à cette dernière, je ne comprends pas cette logique.
J’en profite, madame la présidente, pour répondre aux arguments avancés par le rapporteur en défense de son amendement AS1050. Je ne lui fais pas de procès en « rigidité », mais j’insiste sur le fait que les seuils que nous avons adoptés s’apprécient a contrario : le vote de la Commission signifie très clairement qu’une entreprise de onze salariés qui se trouve dans l’impossibilité de démontrer qu’elle a subi deux trimestres consécutifs de dégradation de son chiffre d’affaires ou de ses commandes ne peut pas recourir au licenciement économique. Pourtant, une telle entreprise qui subit une sévère dégradation durant cinq mois a largement de quoi fermer plusieurs fois. La rédaction retenue met les entreprises en danger.
Mme la présidente Catherine Lemorton. Monsieur Poisson, notre commission respecte une règle : je demande que l’on ne profite pas de la discussion sur un sujet pour revenir sur un autre précédemment réglé.
M. Jean-Frédéric Poisson. Madame la présidente, j’ignorais que cette règle était aussi formelle, sans quoi je l’eusse respectée. Je n’abuse pas du temps de parole que vous voulez bien m’accorder.
Mme la présidente Catherine Lemorton. Je vous laisse tout le temps de parole que vous souhaitez avoir. Vous aviez l’amendement sous les yeux lors du débat qui lui était consacré ; vous pouviez présenter tous vos arguments à ce moment. Je ne coupe pas la parole.
M. Jean-Frédéric Poisson. Une fois que le rapporteur a répondu, il ne me semble pas anormal de demander à réagir à ses propos.
M. le rapporteur. Je suis défavorable à une extension au niveau européen du périmètre à prendre en compte pour apprécier les difficultés économiques d’une entreprise. La question n’est pas de savoir si ce périmètre doit être communautaire ou comprendre la Suisse, mais à faire en sorte que les groupes ne s’exonèrent pas de leur responsabilité – sur ce point, je rejoins M. Poisson.
Je n’ai pas déposé d’amendement sur cet aspect du texte qui, pourtant, je l’ai dit, ne me convient pas. En l’état, il ne répond pas à mes inquiétudes et à mes interrogations sur la responsabilité des groupes. Je négocie actuellement avec le Gouvernement sur ce sujet et présenterai des amendements en séance publique.
La Commission rejette successivement les amendements AS374 et AS747.
Puis elle est saisie de l’amendement AS375 de M. Christophe Cavard.
Mme Véronique Massonneau. Il s’agit de proposer une nouvelle rédaction de l’alinéa 12 visant à prévenir les abus rendus possibles par un texte initial trop imprécis. Il faut que la situation donnant lieu à une modification du contrat de travail ou de l’emploi résulte d’une cause réelle et sérieuse dont la justification doit pouvoir être demandée par voie judiciaire.
M. le rapporteur. Je demande le retrait de l’amendement. Madame Massonneau, je ne suis pas certain que votre rédaction soit beaucoup plus claire que celle du projet de loi. Est-il vraiment préférable d’évoquer une « situation économique artificielle » plutôt que des « difficultés économiques créées artificiellement à la seule fin de procéder à des suppressions d’emplois » ?
Par ailleurs, je m’interroge aussi sur le « doute raisonnable ». Le juge peut examiner la situation du secteur d’activité commun aux entreprises d’un groupe, ce qui lui permet d’avoir des doutes. S’il ne disposait plus d’informations sur l’ensemble du groupe, comment parviendrait-il à formuler un avis sur la réalité des difficultés économiques alléguées ? Sur cette question, je réfléchis également avec le Gouvernement à la façon de mieux couvrir les situations que vise l’alinéa 12, sans parvenir, dans sa rédaction actuelle, à les traiter vraiment.
L’amendement est retiré.
La Commission examine l’amendement AS1048 du rapporteur.
M. le rapporteur. Puisque nous avons introduit des règles d’ordre public en matière de licenciement économique, l’amendement vise à supprimer le renvoi à la négociation collective et, par voie de conséquence, à des dispositions supplétives applicables en l’absence d’accord collectif.
La Commission adopte l’amendement.
En conséquence, les amendements AS970 de la commission des affaires économiques, AS172 de M. Lionel Tardy, AS283 de M. Yves Censi, AS431 de M. Christophe Caresche, AS553 de M. Arnaud Richard, AS168 de M. Gérard Cherpion, AS388 de M. Arnaud Viala, AS169 de M. Gérard Cherpion, AS389 de M. Arnaud Viala et AS432 de M. Christophe Caresche tombent.
La Commission adopte l’article 30 modifié.
*
* *
Mme Isabelle Le Callennec. S’agissant de l’article 30, monsieur le rapporteur, ne peut-on craindre que le dispositif que nous avons adopté ne soit censuré par le Conseil constitutionnel, qui avait estimé contraire à la Constitution le plafonnement des indemnités prud’homales en raison précisément de l’inégalité de traitement entre les salariés d’entreprises de tailles différentes ?
Ce qu’a dit Mme Iborra en ce qui concerne la formation des juges eux-mêmes est très important : si la loi Macron a réformé les conseils de prud’hommes, c’est en raison d’un manque de formation des conseillers prud’homaux ; de la même façon, on ne s’attaque ici qu’aux conséquences d’un problème, mais il faut continuer à travailler sur les causes.
La Commission se saisit de l’amendement AS545 de M. Arnaud Richard.
M. Arnaud Richard. La loi du 14 juin 2013 dispose que toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
C’est une avancée que nous ne pouvons que saluer, car les TPE et PME sont particulièrement sensibles à la durée des procédures en droit du travail. Les partenaires sociaux ont fait le choix il y a quelques années de réduire drastiquement le délai de prescription : c’est une souplesse intéressante.
Cet amendement propose d’aller encore plus loin en réduisant le délai à six mois. Cela constituerait un signe encourageant pour les petites entreprises, leur apporterait plus de visibilité et de sécurité.
M. Christophe Sirugue, rapporteur. Avis défavorable. Le délai de deux ans a été négocié dans le cadre de l’accord national interprofessionnel (ANI) par les partenaires sociaux, et nous n’avions fait que transcrire cet accord. Il constituait en outre déjà, vous l’avez dit, une réduction substantielle par rapport au délai initial.
La Commission rejette l’amendement.
Puis elle se saisit de l’amendement AS529 de M. Arnaud Richard.
M. Arnaud Richard. Cet amendement propose de créer des conciliateurs du travail.
L’inspection du travail fait aujourd’hui face à une forte demande sociale. Les agents font état d’un nombre élevé de sollicitations individuelles ; cela montre l’inexistence d’autres formes de recours. Il convient donc à notre sens de chercher à décharger les agents d’une partie de ces requêtes, mais aussi à mieux relayer leur message au sein des entreprises.
Cet amendement propose donc que les agents de contrôle se voient adjoindre des collaborateurs bénévoles, susceptibles de jouer un rôle de conciliateur du travail, à l’instar des conciliateurs de justice. En liaison avec l’inspection du travail, ces conciliateurs joueraient à la fois un rôle de filtre des demandes adressées aux agents de contrôle et un rôle de médiateur entre salariés et employeurs, tout particulièrement dans les TPE.
Les salariés disposeraient ainsi de référents bien identifiés sur les questions de droit du travail les plus simples, qui n’ont pas besoin d’être traitées par les agents de contrôle. Ceux-ci pourraient se concentrer sur d’autres tâches.
Les actuels « conseillers des salariés » semblent les mieux placés pour remplir ces nouvelles fonctions. Leur expérience et leur connaissance du monde de l’entreprise, mais aussi leur coût assez minime pour les finances publiques, plaident pour un élargissement de leurs missions au service des salariés dans les TPE.
M. le rapporteur. La conciliation constitue déjà, je le rappelle, un préliminaire obligatoire. Pour les conflits individuels, il existe le Bureau d’orientation et de conciliation ; en matière collective, la loi prévoit déjà une possibilité de recours soit à la médiation judiciaire, soit à la conciliation, soit à la médiation, soit encore à l’arbitrage.
Les outils sont donc déjà nombreux. Avis défavorable.
M. Arnaud Richard. Ces outils, récents, fonctionnent-ils ? En 2013, l’étape obligatoire de la conciliation prud’homale n’a permis de résoudre que 5,5 % des affaires. C’est déjà ça, me direz-vous, mais il me semble en tout cas que tous les outils cités par le rapporteur ne fonctionnent pas comme ils le pourraient.
La Commission rejette l’amendement
Puis elle examine l’amendement AS170 de M. Gérard Cherpion.
Mme Isabelle Le Callennec. Il s’agit de rétablir le barème d’indemnités prud’homales contraignant qui figurait dans la version initiale du projet de loi, transmise au Conseil d’État.
Le Conseil constitutionnel a censuré la disposition de la loi Macron qui établissait un barème. Mme la ministre a refusé de remettre ce sujet sur la table mais nous a affirmé qu’elle prenait toutes les dispositions nécessaires. Pouvez-vous nous rassurer sur l’évolution de ce dossier ?
M. le rapporteur. C’est un sujet qui a fait l’objet de discussions nourries. Le rétablissement du plafonnement des indemnités prud’homales ne nous semble pas devoir être retenu.
Je n’aborde pas ici les questions de principes. Mais, s’agissant du niveau élevé des indemnités versées par l’employeur, il nous a été rappelé au cours des auditions que les indemnités au titre de l’absence de cause réelle et sérieuse ne constituent qu’une part du coût global de la rupture ; ce coût est l’addition de toutes les indemnités, légales, conventionnelles et autres, dues par l’employeur. En ce qui concerne les écarts d’un tribunal à l’autre, les données chiffrées montrent que les écarts tendent plutôt à se resserrer autour d’une valeur centrale de dix mois de salaire en moyenne. Le plafonnement tel que vous le proposez serait donc une harmonisation vers le bas.
Ce que vous proposez reviendrait à faire coexister trois barèmes différents, un barème au stade de la conciliation, un référentiel indicatif au stade du jugement et enfin un plafonnement – c’est d’ailleurs pourquoi j’ai trouvé assez cocasse votre développement sur les barèmes complexes que nous proposons...
Mme Isabelle Le Callennec. Ce n’est pas la même chose !
M. le rapporteur. Mais si.
Cet amendement ne correspond pas aux objectifs que nous nous fixons. Avis défavorable.
M. Bernard Accoyer. Je suis étonné des propos du rapporteur. Notre amendement ne distingue pas selon la taille des entreprises ! Il établit des distinctions suivant la durée de présence dans l’entreprise. Nous sommes contrariés, monsieur le rapporteur, que vous n’ayez pas pris connaissance sérieusement de la version initiale du projet de loi, qui avait recueilli notre approbation – vous lui tournez même carrément le dos, en faisant comme si elle n’avait jamais existé.
Pour une fois que l’exécutif avait compris l’une des causes de notre chômage endémique, c’est-à-dire notre jurisprudence du travail, pour une fois qu’il faisait le bon choix, il renonce ! C’est tout le problème de ce projet de loi, modifié d’abord par le Gouvernement lui-même, puis par la majorité.
Vous teniez là l’occasion d’élargir la majorité jusqu’à la droite qui, sur ce point, vous aurait rejoints.
Mme Isabelle Le Callennec. Le rapporteur – dont j’entends les arguments sans qu’ils me convainquent – n’a pas répondu à ma question : l’article L. 1235-1 dispose que « le juge peut prendre en compte un référentiel indicatif établi, après avis du Conseil supérieur de la prud’homie, selon les modalités prévues par décret en Conseil d’État. » La ministre, pour rassurer les entrepreneurs qui souhaitaient la création d’un plafonnement des indemnités prud’homales, nous a assurés que ce décret ne tarderait pas : a-t-il été rédigé ? Quand sera-t-il signé ? Vous avez peut-être une idée !
M. le rapporteur. Eh bien, je vous engage à poser la question à Mme la ministre dans l’hémicycle.
La Commission rejette l’amendement.
Puis elle se saisit de l’amendement AS430 de M. Christophe Caresche.
M. Christophe Caresche. Je serai bref sur ce sujet devenu très sensible. Le Gouvernement a renoncé à établir un barème contraignant : c’est donc le dispositif prévu dans la loi Macron qui s’appliquera. Je note au passage qu’on pourrait se demander si la place d’un barème indicatif est bien dans la loi.
Je propose ici un dispositif dont je me doute qu’il n’aura pas les faveurs du rapporteur : le juge serait tenu de suivre le barème, mais pourrait y déroger dès lors qu’il motive spécialement sa décision. Quelque chose de similaire existe en matière pénale - naguère pour les peines planchers, par exemple. C’est une solution qui me paraît plus élégante.
M. le rapporteur. Vous êtes perspicace : j’émettrai en effet – à moins que vous ne retiriez votre amendement – un avis défavorable. Ce n’est pas l’esprit du projet de loi, puisque cela reviendrait à rendre le barème à peu près obligatoire.
L’amendement est retiré.
*
* *
Article 31
Ratification de l’ordonnance relative aux garanties consistant en une prise de position formelle, opposable à l’administration, sur l’application d’une norme à la situation de fait ou au projet du demandeur
Cet article vise à ratifier l’ordonnance n° 2015-1628 du 10 décembre 2015 relative aux garanties consistant en une prise de position formelle, opposable à l’administration, sur l’application d’une norme à la situation de fait ou au projet du demandeur.
Prise sur le fondement de l’article 9 de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives, cette ordonnance a pour objet, comme l’indique le rapport au Président de la République, de « renforcer les garanties applicables aux porteurs de projet et de leur assurer un environnement plus sécurisé du point de vue des normes applicables ».
Elle modifie cinq codes : le code de la consommation (article 1er), le code général de la propriété des personnes publiques (article 2), le code rural et de la pêche maritime (article 3), le code de la sécurité sociale (article 4) et le code du travail (article 5).
En matière de droit du travail, l’article 5 de l’ordonnance créé deux mécanismes de garantie contre des sanctions prévues par le code du travail, concernant le respect de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes d’une part et l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés d’autre part :
– L’article L. 2242-9-1 du code du travail instaure une procédure de rescrit permettant à une entreprise de demander à l’administration du travail une prise de position formelle quant à la conformité de son accord ou, à défaut d’accord, de son plan d’action relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. La loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, modifiée par la loi n° 2012-1189 du 26 octobre 2012 portant création des emplois d’avenir, a en effet instauré une pénalité pouvant aller jusqu’à 1 % de la masse salariale lorsqu’une entreprise de plus de cinquante salariés manque à ses obligations en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. La délivrance d’un rescrit doit permettre à l’entreprise d’éviter une éventuelle sanction en l’assurant qu’elle remplit bien les conditions posées par les textes.
– Par ailleurs, l’article L. 5212-5-1 du code du travail dispose que l’association de gestion du fonds pour l’insertion des personnes handicapées (AGEFIPH) se prononce de manière explicite sur toute demande d’un employeur concernant l’application à sa situation de la législation relative à l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés. Créé dans un souci de contrôle préventif, cet article permet à l’entreprise de s’assurer du respect de ses obligations et de se prémunir contre les pénalités financières prévues à l’article L. 5212-12 du même code.
La Commission adopte l’article 31 sans modification.
*
* *
Chapitre II
Renforcer la formation professionnelle et l’apprentissage
Article 32
(Art L. 6241-5, L. 6241-9, L. 6242-6 et L. 6332-16 du code du travail)
Apprentissage
Cet article répond à divers objectifs visant à renforcer la politique d’apprentissage :
– simplifier l’organisation et la collecte de la taxe d’apprentissage ;
– élargir la liste des établissements d’enseignement éligibles au barème de la taxe d’apprentissage et à la prise en charge par les organismes collecteurs agréés ;
– préciser les conditions de versement libératoire des établissements ;
– renforcer l’employabilité des apprentis à l’issue de leur formation.
Le deuxième alinéa (1°) de l’article 32 propose de supprimer l’article L. 6242-6 du code du travail.
Celui-ci prévoit qu’une convention triennale d’objectifs et de moyens conclue entre l’État et les organismes collecteurs habilités – c’est-à-dire les organismes paritaires collecteurs agréés (OPCA) et les organismes interconsulaires régionaux – définit les modalités de financement et de mise en œuvre des missions de l’organisme collecteur habilité.
Deux facteurs plaident pour la suppression de cette convention. Tout d’abord, les OPCA n’ont aucune marge de manœuvre justifiant la mise en place d’une telle convention. Ils collectent les contributions – taxe d’apprentissage et cotisation supplémentaire (CSA) – et les reversent, affectées par les employeurs, aux CFA et aux établissements bénéficiaires. Pour les fonds non affectés par les entreprises relatifs au quota et aux barèmes, l’OPCA les répartit dans le cadre d’une instance interne et, enfin, s’agissant des fonds libres du quota – taxe d’apprentissage et CSA – il est tenu de demander l’avis de la région avant de les répartir.
Par ailleurs, l’objectif de ces conventions est satisfait par d’autres voies. S’agissant des organismes collecteurs de la taxe d’apprentissage (OCTA) habilités au niveau national, le dernier alinéa de l’article L. 6242-6 prévoit que les modalités de financement et de mise en œuvre des missions de l’OCTA sont intégrées dans les conventions auxquelles sont astreints les OPCA en vertu du dernier alinéa de l’article L. 6332-1-1. S’agissant des OCTA œuvrant au niveau régional, le dialogue instauré avec les régions par la loi du 5 mars 2014, en outre formalisé par le rapport d’activité prévu par l’article R. 6242-13, rend inutile le maintien en sus d’une relation contractuelle directe avec l’État.
2. L’élargissement de la liste des établissements habilités à percevoir une part de la taxe d’apprentissage
Instituée en 1925 et modifiée à plusieurs reprises depuis, notamment en 1971 avec la création des organismes collecteurs de la taxe d’apprentissage (OCTA), la taxe d’apprentissage a pour objet de faire participer les employeurs au financement des formations premières à caractère technologique et professionnel, dont l’apprentissage.
L’article L. 6241-9 définit les établissements habilités à recevoir une part de taxe d’apprentissage correspondant à leurs dépenses de formation technologique et professionnelle, hors du cadre de l’apprentissage.
La loi du 5 mars 2014 a restreint le nombre d’établissements éligibles en fixant une liste limitative de catégories d’établissements pouvant y prétendre.
S’agissant du barème de la taxe d’apprentissage, il s’agissait de concentrer une part plus grande de la taxe d’apprentissage en direction d’un plus petit nombre d’établissements, dans un but de plus grande efficacité. De fait, si une part plus importante de la taxe a été régionalisée – les moyens pour les régions passant de 1 529 millions d’euros en 2012 à 1 653 millions d’euros en 2015 –, la part de la taxe dite « barème » a été réduite d’environ 50 millions d’euros. La typologie des formations, établissements et organismes pouvant percevoir la taxe a été précisée afin d’éviter le « saupoudrage ». Ont en particulier été écartés du bénéfice du barème les établissements à but lucratif et, pour ceux qui délivrent des diplômes, les établissements secondaires privés agissant hors contrat d’association avec l’État.
Cette modification avait pour objectif de réorienter le produit de la taxe, grâce à l’élaboration par les préfets de nouvelles listes régionales, vers les établissements publics et privés faisant l’objet d’un contrôle pédagogique de la part de l’État et délivrant des titres et diplômes inscrits au répertoire national des certifications professionnelles.
Le 2° de l’article entend élargir le type d’établissements « privés d’enseignement du second degré gérés par des organismes à but non lucratif » éligibles. Il ne s’agira plus seulement des établissements sous contrat d’association avec l’État au sens de l’article L. 442-5 du code de l’éducation ou de l’article L. 813-1 du code rural et de la pêche maritime mais aussi :
– des établissements habilités à recevoir des boursiers nationaux autres que les établissements publics et privés sous contrat, à savoir les établissements régionaux d’enseignement adapté et les établissements d’enseignement et de formation agricole mentionnés au livre VIII du code rural et de la pêche maritime ;
– les écoles techniques privées légalement ouvertes et reconnues par l’État aux termes de l’article L. 443-2 du code de l’éducation.
Dans un souci de coordination, les deux derniers alinéas (4°) de l’article prévoient que les organismes collecteurs paritaires agréés qui pouvaient jusqu’à présent prendre en charge les dépenses de fonctionnement des CFA conventionnés par l’État ou les régions aux termes de l’article L. 6332-16 pourront dorénavant prendre en charge dans les mêmes conditions les organismes de formation professionnelle initiale ou continue à but non lucratif figurant sur une liste arrêtée par le ministre en charge de la formation professionnelle et du ministère de l’éducation nationale et concourant par leurs enseignements technologiques et professionnels à l’insertion des jeunes sans qualification. Les critères d’éligibilité seront précisés par décret.
Le projet de loi ne revient donc pas sur la condition de la gestion à but non lucratif mais étend la liste à des établissements remplissant en très grande partie les obligations des établissements sous association et se caractérisant par leurs résultats, en particulier en terme d’insertion professionnelle.
Lorsqu’il emploie un apprenti, l’employeur apporte un concours financier au centre de formation où est inscrit cet apprenti. Ce concours est exonéré de la taxe d’apprentissage et s’impute sur la fraction « quota » de celle-ci. L’article L. 6241-5 prévoit que le concours apporté aux écoles d’apprentissage technologique et professionnel qui ont bénéficié d’une dérogation ouvre le même droit à imputation.
Le présent article précise que l’employeur ne peut imputer son concours de la fraction quota que si l’établissement bénéficiaire ne bénéficie pas déjà des dépenses prévues au 1° de l’article L. 6241-8, à savoir les dépenses exposées afin de favoriser des formations technologiques et professionnelles dispensées hors du cadre de l’apprentissage qui ouvrent également droit à une exonération totale ou partielle de la taxe d’apprentissage. Il rend prioritaire le versement libératoire en vertu de l’article L. 6241-8 sur celui prévu par l’article L. 6241-5, tendant ainsi à préserver la fraction quota en dépit de l’élargissement de la liste des établissements et répondant surtout à la nouvelle philosophie de la formation professionnelle née de la loi du 5 mars 2014 privilégiant l’obligation de former et non plus celle de payer.
a. Un objectif déjà pris en compte par la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale
L’article L. 6231-1 du code du travail indique que les centres de formations d’apprentis (CFA) ont pour mission première de dispenser aux jeunes travailleurs titulaires d’un contrat d’apprentissage une formation générale associée à une formation technologique et pratique complète reçue en entreprise. Pour ce faire, les CFA articulent leur formation avec l’entreprise en question.
Les ruptures des contrats d’apprentissage sont cependant assez élevées, entre 10 et 35 % selon le rapport du comité d’évaluation et de contrôle des politiques publiques. Les causes en sont multiples ; elles touchent principalement à la qualité du travail jugée insuffisante par les employeurs et au manque de lien ressenti entre leur formation en CFA et l’activité dans l’entreprise.
La loi du 5 mars 2014 a donc enrichi l’article L. 6231-1 en octroyant aux centres de formation des apprentis (CFA) quatre nouvelles missions destinées à lutter contre ces ruptures prématurées :
– assurer la cohérence entre la formation dispensée au sein du CFA et celle dispensée au sein de l’entreprise, en particulier en organisant la coopération entre les formateurs et les maîtres d’apprentissage ;
– développer l’aptitude des apprentis à poursuivre des études par les voies de l’apprentissage, de l’enseignement professionnel ou technologique ou par toute autre voie ;
– assister les postulants à l’apprentissage dans leur recherche d’un employeur et les apprentis en rupture de contrat dans la recherche d’un nouvel employeur ;
– apporter en lien avec le service public de l’emploi, en particulier les missions locales, un accompagnement aux apprentis pour les aider à résoudre les difficultés d’ordre social ou matériel susceptibles de mettre en péril le déroulement du contrat d’apprentissage.
Le 4° de l’article 32 du projet de loi vise à rapprocher encore l’Éducation nationale et les centres de formation des apprentis dans l’objectif de renforcer l’employabilité des apprentis à l’issue de leur formation.
Il est proposé d’ajouter à l’article L. 6231-1 un alinéa qui prévoit que les CFA « délivrent à tout apprenti une attestation mentionnant notamment la durée de la formation et les compétences travaillées, conformément au modèle établi par un arrêté conjoint du ministre chargé de la formation professionnelle et du ministre de l’éducation nationale ».
En effet, jusqu’à aujourd’hui, un même diplôme ou titre en dépit d’un même intitulé pouvait sanctionner deux formations porteuses de contenus et de savoir-faire très différents. Une attestation élaborée selon un modèle conjoint garantira l’homogénéité des formations, l’acquisition à la fois d’un savoir-être et de compétences professionnelle par les apprentis, quelle que soit la voie suivie.
*
* *
La Commission examine l’amendement AS525 de M. Christophe Cavard.
M. le rapporteur. Avis défavorable. Cet amendement vise à réserver, pour les établissements privés, l’allocation de la taxe d’apprentissage aux publics les plus en difficultés. Une telle procédure me paraît difficile à mettre en œuvre. Comment cibler la part de financement sur un certain type de public ?
La Commission rejette l’amendement.
Puis elle adopte successivement les amendements rédactionnels AS342 et AS343 du rapporteur.
Elle adopte alors l’article 32 modifié.
*
* *
La Commission se saisit de l’amendement AS116 de M. Gérard Cherpion.
Mme Isabelle Le Callennec. L’objet du présent amendement est de permettre aux organismes paritaires collecteurs agréés (OPCA) qui le souhaitent, ainsi qu’au Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels (FPSPP), d’accompagner les salariés licenciés pour motif économique lorsque la formation est mise en œuvre dans le cadre d’un congé de reclassement ou d’un congé de mobilité.
Nous sommes là vraiment dans l’esprit du projet de loi, c’est-à-dire d’une sécurisation des parcours professionnels.
M. le rapporteur. Avis défavorable. Vous proposez de mutualiser le financement de la formation au niveau des OPCA et du FPSPP. Mais je crois sincèrement que les entreprises de plus de 1 000 salariés qui procèdent à un licenciement économique doivent financer seules les formations, sans les faire peser sur les autres entreprises et notamment les plus petites.
La Commission rejette l’amendement.
Puis elle examine l’amendement AS112 de M. Gérard Cherpion.
M. Gérard Cherpion. La loi du 5 mars 2014 organise un financement du dialogue social pour l’ensemble des organisations syndicales et patronales représentatives.
Il s’agit de remplacer le « préciput formation » et le Fongefor en établissant une cotisation sur la masse salariale de 0,016 %. Cette cotisation est gérée par l’Association de gestion du fonds paritaire national (AGFPN).
Néanmoins, l’agriculture ne disposait ni du préciput, ni du Fongefor. Il s’agit donc d’une cotisation supplémentaire et non d’une substitution, alors qu’il existe depuis 1992 un financement du dialogue social au niveau de la branche agricole.
Par ailleurs, l’AGFPN ne redistribue pas aux organisations professionnelles agricoles leur quote-part car elle ne sait pas identifier les secteurs professionnels concernés.
Par conséquent, le financement du dialogue social en agriculture, qui passe par la MSA, devrait être affecté à un organisme paritaire constitué par les organisations professionnelles et syndicales de salariés de l’agriculture, sans passer par une redistribution au niveau de l’interprofession. Nous recherchons un juste retour de la cotisation agricole et une autonomie par rapport à l’interprofession.
J’ajoute qu’il faut rectifier l’amendement en replaçant le mot « gérée » par le mot « recouvrée ».
M. le rapporteur. Vous proposez un financement autonome du dialogue social pour le secteur agricole. De façon cohérente, l’amendement suivant, AS111, vise à exclure le secteur agricole du fonds de financement du dialogue social.
Mais il existe des financements pour les organisations représentatives au niveau national multi-professionnelles, dont la FNSEA. Avis défavorable.
M. Gérard Cherpion. Il s’avère que beaucoup ne touchent rien ; la FNSEA touche 10 %. Cela ne correspond pas du tout à la réalité : il faudrait un recouvrement par la MSA, ce n’est pas contesté, mais ensuite une répartition gérée par la profession. Il n’y aurait pas d’incidence financière globale, mais ce serait plus légitime. Les entreprises des territoires, de débardage forestier par exemple, doivent bénéficier d’un juste retour de leurs cotisations.
M. Arnaud Richard. La réforme du dialogue social est très récente, et elle constitue une énorme amélioration. Mais le problème que soulève M. Cherpion est bien réel. Je comprends bien que tous les partenaires sociaux ne soient pas d’accord… Mais j’invite le rapporteur à se pencher sur ce sujet, car ces préoccupations sont légitimes.
La Commission rejette l’amendement.
Suivant l’avis défavorable du rapporteur, elle rejette ensuite l’amendement AS111.
Elle se saisit ensuite, en discussion commune, des amendements AS551 de M. Arnaud Richard, AS162 de M. Gérard Cherpion et AS595 de M. Gilles Lurton.
M. Arnaud Richard. Dans un avant-projet de loi dont je ne suis pas sûr que vous ayez pu prendre connaissance figurait un article 6 disposant qu’un apprenti pouvait travailler plus de huit heures par jour, sans dépasser les dix heures.
Vous serez peut-être contre cette disposition, monsieur le rapporteur, mais je souligne qu’il s’agissait de l’une des cinquante-deux mesures de simplification de la vie des entreprises présentées en juin 2015. Inutile donc de nous accuser de vouloir abuser des apprentis !
M. le rapporteur. C’est un débat important.
Je commence par rappeler qu’il est déjà possible aujourd’hui, pour des apprentis mineurs de travailler jusqu’à quarante heures par semaine, avec une autorisation. Ce dispositif n’est donc pas nouveau ; le secteur de l’hôtellerie et de la restauration entre autres utilise cette dérogation de façon quasi-systématique.
Cet amendement prévoit une généralisation de ce qui est aujourd’hui soumis à autorisation.
Sur le principe, on peut en effet raisonner en se disant qu’un jeune apprenti doit suivre l’organisation de l’entreprise dans laquelle il effectue son apprentissage : c’est un argument que nous avons souvent entendu au cours de nos auditions. Pour autant, dans la mesure où les textes ouvrent déjà cette possibilité, et parce que j’ai entendu le débat qui a eu lieu sur cette question et les incompréhensions qu’il a provoquées, il ne me semble donc pas judicieux de modifier notre code du travail sur ce point.
Avis défavorable.
M. Bernard Accoyer. La version initiale du projet de loi prévoyait de passer d’un régime de dérogation à un régime de déclaration concernant la possibilité pour un apprenti de travailler au-delà de trente-cinq heures par semaines et jusqu’à quarante heures maximum.
Vous venez d’avancer des arguments qui ne nous ont pas convaincus. Le souhait de voir l’apprentissage se développer et rencontrer moins de freins dans notre pays nous rassemble. C’est une mesure utile.
Nous essayons donc de revenir sur les reculs du Gouvernement, en proposant qu’il soit possible d’aligner, à titre exceptionnel ou lorsque des raisons objectives le justifient, le temps de travail de l’apprenti sur celui de son tuteur, dans la limite de seize semaines maximum et après avis conforme du médecin du travail.
M. le rapporteur. Avis défavorable.
Mme Isabelle Le Callennec. Il est dommage de passer à côté de cette mesure. Les entreprises se heurtent à des difficultés simplement matérielles. Pensons à une entreprise du bâtiment qui travaille sur un chantier, qui y emmène le jeune : si celui-ci a terminé ses horaires de travail et que le chantier est loin des locaux de l’entreprise, que se passera-t-il ? Le maître de stage ne peut pas ramener l’apprenti et revenir ensuite sur le chantier. Ces problèmes sont très concrets.
De plus, cet amendement encadre strictement la mesure : caractère exceptionnel ou raisons objectives, avis conforme du médecin du travail, information de la DIRECCTE…
C’est une liberté supplémentaire pour les entreprises, et le jeune n’est pas pénalisé. L’idée de caler les heures de travail d’un apprenti sur celles de son tuteur n’est pas saugrenue.
Mme la présidente Catherine Lemorton. Et justement, ce que vous proposez existe déjà dans la loi…
Mme Isabelle Le Callennec. L’amendement AS595 est à peu près identique ; il propose en outre qu’un décret en Conseil d’État détermine les secteurs dans lesquels cette disposition s’applique.
Actuellement, madame la présidente, il faut une autorisation ; ce n’est pas la même chose qu’une information.
La Commission rejette successivement les amendements AS551, AS162 et AS595.
La Commission examine l’amendement AS115 de M. Gérard Cherpion.
M. Gérard Cherpion. L’article 17 de la loi du 5 mars 2014 affirme le principe de la liberté pour l’entreprise de choisir son collecteur de taxe d’apprentissage. Or, dans un décret publié le 29 août 2014, le Gouvernement a remis ce principe en cause en instaurant une « collecte captive » au profit des branches professionnelles : à partir de 2018, les entreprises devront reverser leur taxe d’apprentissage à leur collecteur de branche ou, « à défaut », à un collecteur interprofessionnel.
Cette réforme ne correspond pas à la réalité du terrain ou à une attente des entreprises. En effet, plus d’un tiers d’entre elles ont choisi l’année dernière de verser leur taxe d’apprentissage à un collecteur interprofessionnel plutôt qu’à un collecteur de branche, notamment pour les raisons suivantes : choix stratégique de financer des formations sur des métiers transversaux et non sur leur cœur de métier, volonté des grands groupes multisectoriels de mettre en place une stratégie d’apprentissage globale en finançant des formations sur la pluralité de leurs métiers, capacité pour ces grands groupes implantés dans plusieurs régions de suivre la mise en œuvre de leur stratégie sur l’ensemble du territoire.
En reléguant les collecteurs interprofessionnels au second plan, la « collecte captive » est donc contreproductive : la liberté des entreprises de choisir leur collecteur est ce qui garantit le développement de formations en apprentissage adaptées à leurs besoins, qu’il s’agisse de formations de branche ou transversales. C’est ce qui permet in fine aux jeunes de trouver un emploi. C’est pourquoi l’amendement vise à revenir au texte de 2014 en réaffirmant la liberté de l’entreprise de verser sa taxe d’apprentissage à un organisme de son choix.
M. le rapporteur. L’amendement conteste le décret et non la loi. J’invite M. Cherpion à contester le décret comme n’étant pas conforme à la loi, sans chercher à corriger une loi dont il reconnaît lui-même qu’elle est claire. Avis défavorable.
Mme Isabelle Le Callennec. Il est essentiel de maintenir la liberté de l’entreprise dans le versement de sa taxe d’apprentissage.
M. le rapporteur. Cette liberté n’est pas remise en cause.
M. Gérard Cherpion. Pour revenir sur le décret, il conviendrait que vous donniez un avis en tant que rapporteur.
Mme la présidente Catherine Lemorton. L’échange devra avoir lieu dans l’hémicycle ; ce n’est pas de notre prérogative.
La Commission rejette l’amendement.
Elle examine ensuite l’amendement AS522 de Mme Anne-Yvonne Le Dain.
Mme Anne-Yvonne Le Dain. Merci de m’accueillir dans votre Commission.
Les conseils régionaux sont en charge de la formation des jeunes et des chômeurs. Il me semblerait intéressant d’indiquer explicitement que ceux qui le souhaitent, notamment parmi les organismes paritaires collecteurs agréés (OPCA), peuvent finaliser des plans de formation conjoints avec les conseils régionaux et les gérer éventuellement avec eux.
M. Gérard Cherpion. Cela fonctionne déjà comme cela et ce qui me gêne dans cet amendement, c’est qu’il parle de plans de formation « gérés » en commun. La gestion du plan de formation est la compétence de la région et non de l’OPCA.
Mme Monique Iborra. C’est vrai que rien n’empêche aujourd’hui les régions de contractualiser avec les OPCA. Cela présente un intérêt évident, par exemple dans la préparation opérationnelle à l’emploi (POE). Nous devrions encourager ces dispositions qui restent encore marginales. Je soutiens donc cet amendement, non parce qu’il crée un droit nouveau, mais parce qu’il appelle l’attention sur le fait que peu de régions pratiquent cette contractualisation, alors que son intérêt est réel.
Mme Anne-Yvonne Le Dain. Ne pas écrire quelque chose, c’est parfois, et même souvent, le rendre impossible. Cette loi crée une nouvelle dynamique ; il faut la créer sur tous les points. Les conseils régionaux ont désormais la charge de la formation des jeunes et des chômeurs ; il ne convient pas de maintenir deux zones séparées, régions et OPCA. Le dialogue entre les deux gagnerait à pouvoir s’appuyer sur la loi.
M. le rapporteur. Je suis résolument hostile à cet amendement. Nous ne pouvons mettre les régions et les OPCA sur un pied d’égalité en écrivant que les deux peuvent gérer des programmes en commun. La loi du 5 mars 2014 a attribué à la région un bloc de compétences entier en matière de formation professionnelle. Aux régions d’assumer cette compétence, de prévoir les coordinations nécessaires, d’organiser des rencontres.
La Commission rejette l’amendement.
*
* *
Article 33
Adaptation expérimentale du contrat de professionnalisation
pour les demandeurs d’emploi
Cet article vise à permettre aux demandeurs d’emploi de conclure, à titre expérimental, un contrat de professionnalisation.
Le contrat de professionnalisation fait l’objet du chapitre V du titre II du livre III de la sixième partie du code du travail.
Mis en place en 2004 (64), il est fondé sur l’alternance entre périodes en entreprise et périodes en formation et peut être conclu à durée déterminée ou indéterminée. Aux termes de l’article L. 6325-11, l’action de professionnalisation à durée déterminée ou qui se situe au début d’un CDI est d’une durée minimale comprise en 6 et 12 mois et peut-être portée jusqu’à 24 mois notamment pour les personnes qui n’ont pas validé un second cycle de l’enseignement secondaire.
Ce contrat de professionnalisation a pour objectif de permettre l’acquisition d’une qualification professionnelle prévue à l’article L. 6314-1, à savoir une qualification :
– soit enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles :
– soit reconnue dans les classifications d’une convention collective de branche ;
– soit ouvrant droit à un certificat de qualification professionnelle de branche ou interbranche.
Enfin, l’article L. 6325-1 ouvre la possibilité de conclure un contrat de professionnalisation :
– aux personnes âgées de 16 à 25 ans révolus afin de compléter leur formation initiale ;
– aux demandeurs d’emploi âgés de 26 ans et plus ;
– aux bénéficiaires d’un minimum social.
L’étude d’impact accompagnant le projet de loi fait état de 176 300 contrats de professionnalisation signés en 2014 – soit une hausse de 2 % par rapport à 2013.
Une étude de la direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques (DARES) de décembre 2012 montrait que la qualification préparée, validée dans 69 % des cas, était plus élevée chez les bénéficiaires de plus de 25 ans. Par ailleurs, à l’issue du contrat les deux tiers des bénéficiaires restent en emploi, chez le même employeur dans trois quarts des cas. Il s’agit donc d’un outil d’insertion professionnelle efficace.
Toutefois, 75 % de ces contrats sont signés par des jeunes de moins de 26 ans et seulement moins de 10 000 bénéficient aux demandeurs d’emploi de longue durée. Le contrat fonctionne plus comme un complément à la formation initiale que comme un outil permettant le retour dans l’emploi des publics qui en sont les plus éloignés.
Afin de permettre aux demandeurs d’emploi, notamment les plus éloignés du marché du travail de bénéficier plus largement de ce type de contrat, le projet de loi propose d’élargir, à titre expérimental, le type de qualification professionnelle pouvant être acquise, de sorte que ces publics puissent acquérir les compétences professionnelles identifiées par le salarié et l’employeur sans que celles-ci correspondent nécessairement aux qualifications professionnelles du contrat de professionnalisation.
Cette expérimentation, qui faciliterait le développement du recours aux contrats de professionnalisation en permettant de l’adapter davantage aux besoins des entreprises et des bénéficiaires, prendrait fin le 31 décembre 2017.
*
La Commission adopte l’article 33 sans modification.
*
* *
Article 34
(Art. L. 335-5, L. 613-3, L. 613-4 du code de l’éducation
et art. L. 6315-1 et L. 6422-2 du code du travail)
Assouplissement de la validation des acquis de l’expérience (VAE)
Cet article vise à assouplir les conditions de la validation des acquis de l’expérience instituée en 2002 (65), afin d’en faire un outil plus largement utilisé notamment pour les personnes les moins qualifiées.
1. La validation des acquis de l’expérience : un outil efficace de valorisation de l’expérience professionnelle
Toute personne, peut, par la validation des acquis de son expérience (VAE) professionnelle, obtenir un titre à finalité professionnelle ou un diplôme de l’enseignement supérieur. À côté de la formation initiale et de la formation continue, la VAE constitue donc la troisième voie d’accès aux diplômes et aux titres professionnels.
Les ministères ont aménagé progressivement leurs certifications afin de les rendre accessibles par la VAE. Dès 2002 et 2003, les ministères en charge de l’emploi, des affaires sociales, de l’éducation nationale, de l’agriculture et de la jeunesse et des sports ont agi en ce sens. À partir de 2005, l’offre s’est élargie aux diplômes et titres des ministères en charge de la défense, de la culture et des affaires maritimes
Toute personne justifiant, sur une période d’au moins trois ans, d’une activité salariée ou non, d’une activité bénévole ou de volontariat, inscrite sur la liste des sportifs de haut niveau ou ayant exercé des responsabilités syndicales ou un mandat électoral local peut obtenir une VAE. L’expérience doit toutefois être en rapport avec la certification visée.
L’accès à la VAE est une démarche individuelle. Néanmoins, l’employeur peut décider d’inscrire une VAE pour un salarié dans un plan de formation.
En 2012, environ 64 000 dossiers de candidatures à un titre professionnel délivré par le certificateur public ont été jugés recevables à la VAE. 28 700 d’entre eux ont obtenu une validation totale. Ces chiffres marquent une baisse par rapport aux années antérieures alors que la VAE représente un des moyens de s’adapter à un marché du travail caractérisé par une nécessaire mobilité professionnelle.
Pour pallier cette baisse, les partenaires sociaux ont préconisé une simplification des modalités de constitution des dossiers, l’amélioration de la qualité de l’accompagnement du candidat et une augmentation de l’offre de sessions. Dans cet esprit, l’article 6 de la loi du 5 mars 2014 a, à l’initiative de la commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale, simplifié et assoupli la VAE en admettant le caractère discontinu de la période d’activité de trois ans et en facilitant l’accès à la VAE des moins qualifiés. Pour les personnes n’ayant pas atteint le niveau de formation V, les périodes de formation initiale ou continue en milieu professionnel sont désormais prises en compte dans la durée minimum d’activité.
L’encouragement à la reconnaissance de son activité repose également sur l’instauration d’un accompagnement à la VAE, ouvert à toute personne dont la candidature a été déclarée recevable. Cet accompagnement vise à faciliter la préparation du dossier et de l’entretien avec le jury. Le décret n° 2014-1354 du 12 novembre 2014 portant diverses mesures relatives à la validation des acquis de l’expérience a précisé le périmètre et le contenu des actions de préparation à la VAE.
Ces avancées renforcent l’approche par parcours et valorisent l’acquisition de compétences, en particulier dans le cadre du bénévolat ou de l’engagement syndical ou politique. La mobilisation du compte personnel de formation au titre de l’accompagnement à la VAE devrait favoriser le recours à celle-ci.
Il est cependant nécessaire d’aller plus loin. En effet, les dispositions législatives actuelles manquent encore de cohérence et de clarté pour les bénéficiaires potentiels, tant dans la nature des expériences à prendre en compte que dans le contenu des étapes du processus et sa mise en œuvre.
L’article L. 335-5 du code de l’éducation dispose que « la durée minimale d’activité requise pour que la demande de validation soit recevable est de trois ans, que l’activité ait été exercée de façon continue ou non ». Le troisième alinéa du I du présent article propose de réduire cette durée à un an. Il propose par ailleurs de prendre en compte également dans cette période le temps de « formation initiale ou continue en milieu professionnel suivie de façon continue ou non » pour l’ensemble des demandeurs et non plus seulement pour les personnes les moins qualifiées. Par cohérence, le quatrième alinéa du II de l’article L. 335-5 qui prévoyait cette dérogation pour les personnes n’ayant pas atteint le niveau V est supprimé. L’appréciation de cette durée continue à être confiée à l’autorité ou l’organisme mentionné à l’article L. 6412-2 du code du travail.
Par coordination, les septième à neuvième alinéas du I de l’article du projet modifient l’article L. 613-3 du code de l’éducation en prévoyant que l’autorité ou organisme qui se prononce sur la recevabilité de la demande fonde son examen au regard des nouvelles conditions de durée minimum requises et supprime les dispositions plus favorables en vigueur pour les personnes les plus éloignées de l’emploi, dispositions constituant désormais le droit commun.
Enfin, la suppression du deuxième alinéa de l’article L. 6422-2 du code du travail, qui prévoyait (par la rédaction des deux derniers alinéas de cet article introduite par le 2° du II du présent article) que « l’ouverture de ce droit [à la VAE] est subordonnée à des conditions minimales d’ancienneté déterminées par décret en Conseil d’État » et qu’une « convention ou un accord collectif peut fixer une durée inférieure », met fin à toute condition d’ancienneté au sein de l’entreprise pour prétendre à une VAE.
L’article L. 335-5 dans sa rédaction actuelle dispose que : « le jury peut attribuer la totalité du diplôme ou du titre » mais, à défaut, il peut n’accorder qu’une « validation partielle ». La rédaction ne va cependant pas jusqu’à mentionner la possibilité de conserver sans limitation de durée le bénéfice de cette validation partielle. L’article R. 335-9 du code de l’éducation a de fait fixé à cinq ans la limite du bénéfice de cette validation partielle.
Le septième alinéa du I de l’article prévoit explicitement que les parties de certifications acquises le sont définitivement et permettent des dispenses d’épreuves pour la suite du processus d’acquisition du diplôme ou du titre.
Cette modularisation permettra de faire valider les acquis de son expérience en plusieurs temps et devrait ainsi conduire un plus grand nombre de personnes à entamer le processus sans attendre d’avoir acquis toutes les compétences requises.
Par coordination, les trois derniers alinéas du I de l’article introduisent dans l’article L. 613-4 la possibilité d’une validation partielle dans les mêmes conditions pour les diplômes et titres à finalités professionnelles délivrés au nom de l’État.
L’article L. 6315-1 du code du travail prévoit qu’au moment de son embauche, le salarié est informé « qu’il bénéficie tous les deux ans d’un entretien professionnel avec son employeur consacré à ses perspectives d’évolution professionnelle, notamment en termes de qualification et d’emploi ».
Les deuxième et troisième alinéas du II de l’article prévoient qu’au cours de cet entretien, le salarié recevra « des informations relatives à la validation des acquis de l’expérience ». Cette systématisation de l’information permettra plus facilement au salarié de s’inscrire dans une démarche de valorisation de son expérience.
d. Des conditions de rémunération des salariés en CDD durant la formation, alignées sur le droit commun
Le droit en vigueur dispose que le bénéficiaire reçoit une rémunération versée par l’organisme collecteur paritaire agréé (OPCA) dont le montant est égal à un pourcentage du salaire moyen perçu aux cours des quatre derniers mois sous contrats de travail à durée déterminée. Le pourcentage est déterminé par accord ou convention collective ou à défaut par décret.
Les deux derniers alinéas de l’article renvoient désormais aux dispositions de droit commun de l’article L. 6422-8 selon lesquelles : « le salarié (…) a droit à une rémunération égale à celle qu’il aurait reçue s’il était resté à son poste de travail dans la limite par action de validation d’une durée déterminée par décret pour chaque action (…) ». Par ailleurs, le salarié reçoit sa rémunération de son employeur qui est remboursé par l’OPCA et non plus directement de celui-ci.
L’action de validation des acquis de l’expérience devient financièrement neutre pour le salarié et devrait contribuer à lever ce frein à son utilisation.
*
La Commission examine l’amendement AS590 de Mme Françoise Dumas.
Mme Annie Le Houerou. Dans le rapport Les Associations dans la crise : la réinvention d’un modèle de notre collègue Françoise Dumas, la difficulté d’accéder au dispositif de validation des acquis de l’expérience (VAE) pour des expériences associatives bénévoles a été mise en évidence. La procédure longue et complexe peut décourager certains publics, particulièrement les bénévoles, « qui, en raison du caractère désintéressé de leur activité, sont a priori très éloignés d’une démarche utilitariste de prise en compte de leur expérience ».
Selon le Haut conseil à la vie associative (HCVA), les représentants du monde associatif ne sont pas suffisamment associés aux jurys qui examinent les demandes de VAE, souvent formés d’universitaires très éloignés de l’expérience vécue par les candidats. Ils valorisent essentiellement les connaissances, au détriment des savoir-faire acquis dans le bénévolat, qui sont des qualités essentielles dans la vie professionnelle. Une disposition introduite dans la loi relative à l’économie sociale et solidaire permet au conseil d’administration ou à l’assemblée générale de donner son avis au jury sur l’implication du bénévole dans la vie de l’association. Renforcer le caractère normatif de cette disposition permettrait de faciliter la VAE pour les bénévoles. Cet amendement vise à ce que l’avis rendu par le conseil d’administration ou l’assemblée générale de l’association soit bien pris en considération.
M. le rapporteur. Il y a un problème avec le positionnement de l’amendement, qui, s’agissant de la phrase « le jury tient compte de cet avis », ne permet pas de savoir de quel avis il s’agit. Je propose donc à Mme Laclais de retravailler son amendement et de le déposer de nouveau au titre de l’article 88.
L’amendement est retiré.
La Commission examine l’amendement AS658 de M. Arnaud Richard.
M. Arnaud Richard. Le projet de loi prévoit de réduire la période de validation des acquis de trois à un an. Or la durée normale des formations d’apprentissage varie entre deux et quatre ans. Aussi nous semble-t-il plus raisonnable d’imposer l’exercice d’une année supplémentaire dans un métier concerné par la voie de la formation classique, afin que la VAE ne soit pas un moyen de court-circuiter cette voie normale d’apprentissage.
M. le rapporteur. Défavorable. L’amendement vise à fixer une seconde condition : l’exercice d’une année supplémentaire dans le métier concerné. Son adoption défavoriserait les demandeurs d’emploi, qui ne pourront pas obtenir leur qualification ou ne le pourront que s’ils trouvent un emploi. C’est un peu kafkaïen.
La Commission rejette l’amendement.
Elle adopte ensuite successivement les amendements rédactionnels AS344, AS345, AS346, l’amendement de conséquence AS789 et l’amendement rédactionnel AS347 du rapporteur.
L’amendement AS526 de M. Christophe Cavard est retiré.
La Commission adopte l’article 34 modifié.
*
* *
Article 35
(Art. L. 6323-16 du code du travail)
Sécurisation des listes des formations éligibles au compte personnel de formation (CPF)
Cet article vise à mieux déterminer les critères qui président à l’inscription de telle ou telle formation dans les listes éligibles au compte personnel de formation (CPF).
La loi du 5 mars 2014 retient le principe de sélection des formations parmi des listes destinées à garantir l’amélioration des qualifications et à répondre aux besoins du marché du travail. Visant à assurer la qualité et la pertinence des formations, le choix d’une formation dans une liste élaborée en dehors de l’entreprise conditionne l’utilisation des heures inscrites sur le CPF.
L’article L. 6323-6 du code du travail identifie trois grandes catégories de formations éligibles au CPF :
– les formations permettant d’acquérir le socle de connaissances et de compétences défini par le décret n° 2015-172 du 13 février 2015. Ce socle de connaissances fait l’objet d’une certification sur proposition du Comité paritaire interprofessionnel national pour l’emploi et la formation (COPANEF). Sept modules constituant le socle de connaissances et de compétences professionnelles ont été définis, parmi lesquels figurent la communication en français et la capacité d’apprendre tout au long de la vie. Les modalités de délivrance de cette certification ont été définies en janvier 2016, avec la création du certificat « CLÉA ». De portée nationale, cette certification est accessible par tous les dispositifs de formation professionnelle et est reconnue dans tous les secteurs ;
– les formations conduisant à une qualification ou à une certification et inscrites sur une liste par les partenaires sociaux aux échelles nationale et régionale. Les formations effectivement éligibles doivent être placées sur des listes dans des conditions définies aux articles L. 6323-16 et L. 6323-21 du code du travail, s’agissant respectivement des salariés et des demandeurs d’emploi.
Concernant les salariés, d’une part, les formations doivent figurer sur la liste nationale interprofessionnelle établie par le COPANEF après consultation du conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles (CNEFOP), sur la liste de la branche professionnelle concernée dans le cadre des listes nationales établies par les commissions paritaires nationales pour l’emploi (CPNE) ou sur la liste régionale pour les salariés établie par le comité paritaire interprofessionnel national pour l’emploi et la formation (COPAREF) du lieu de travail après consultation des commissions paritaires régionales de branche lorsqu’elles existent et concertation au sein du bureau du comité régional de l’emploi, de l’orientation et de la formation professionnelles (CREFOP).
Concernant les demandeurs d’emploi, d’autre part, les formations doivent figurer sur la liste nationale interprofessionnelle établie par le COPANEF ou sur la liste régionale pour les demandeurs d’emploi établie par le COPAREF du lieu de domicile, après diagnostic et concertation au sein du bureau du CREFOP et consultation des commissions paritaires régionales de branche lorsqu’elles existent. Cette seconde liste est alors élaborée à partir du programme régional de formation professionnelle pour les personnes à la recherche d’un emploi financé par la région, Pôle Emploi et l’Association de gestion du fonds pour l’insertion des personnes handicapées (AGEFIPH).
– l’accompagnement à la validation des acquis de l’expérience dans les conditions prévues par le décret n° 2014-1354 du 12 novembre 2014 portant diverses mesures relatives à la validation des acquis de l’expérience.
Le rapport d’application de la loi du 5 mars 2014 de nos collègues Jean-Patrick Gille et Gérard Cherpion retrace dans le schéma ci-dessous la complexité du système des listes (66) :
LES TROIS CATÉGORIES DE FORMATIONS ÉLIGIBLES AU CPF
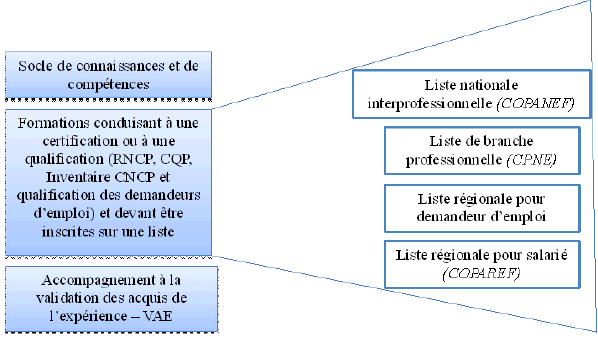
Afin d’assurer l’adéquation des listes de formations éligibles aux besoins des salariés, des demandeurs d’emploi et des entreprises, l’actualisation régulière des listes, la transmission des listes au CNEFOP et à la Caisse des dépôts et consignations ou la mention dans les listes des formations facilitant l’évolution professionnelle des salariés exposés à des facteurs de risques professionnels sont prévues.
De nombreuses incertitudes pèsent aujourd’hui sur la pertinence des listes de formations disponibles et sur leur adéquation avec les objectifs fixés par le législateur en 2014. Les listes ont effectivement été élaborées en peu de temps
– entre septembre 2014 et janvier 2015 – et ont permis de recenser plus de 12 000 formations dès leur publication. De nombreuses formations ne sont aujourd’hui pas éligibles. Le rapport précité fait état de seulement 130 formations sur les 450 proposées par le Conservatoire national des arts et métiers qui a indiqué que moins d’un tiers de ses formations sont éligibles au titre du compte personnel de formation.
Le II de l’article L. 6323-16 du code du travail dispose que : « les listes [mentionnées ci-dessus] sont actualisées de façon régulière ». Cette disposition est vague et n’a qu’une faible portée opérationnelle.
Le présent article propose de la compléter par la détermination des critères selon lesquels les formations sont inscrites et la publication de ces critères. La détermination et la publication des critères par les instances compétentes permettent une meilleure transparence mais donnent également une plus grande portée à l’actualisation : celle-ci se fait au regard de critères objectivés qui peuvent perdre de leur pertinence au bout d’un certain temps et conduire à l’élaboration de nouvelles listes. L’insertion de telle ou telle formation dans une liste devrait ainsi être mieux justifiée.
Les différences d’éligibilité à une formation selon les régions ou les branches rendent le système de liste difficilement lisible. Deux titulaires d’un CPF n’ont ainsi pas accès aux mêmes formations s’ils relèvent de deux régions ou branches distinctes.
Cette rigidité du dispositif, associée à une complexité et à une incertitude quant au caractère éligible d’une formation, affaiblit l’esprit de responsabilisation et de liberté qui a inspiré le CPF. Ceci freine la mobilisation du CPF pour chaque actif et la montée en charge du dispositif.
La simplification doit aller plus loin que la seule explicitation des critères d’élaboration des listes d’éligibilité des formations. L’objectif doit être que chaque bénéficiaire puisse mobiliser son CPF pour une formation qualifiante quelles que soient sa région de résidence et la branche dans laquelle il exerce son activité.
NOMBRE DE LISTES DES FORMATIONS ÉLIGIBLES AU CPF
Nombre de listes |
Nombre de formations, certifications et actions de formation | |
Listes des COPAREF |
46 |
7 602 |
Listes des CPNE de branches |
144 |
7 947 |
Liste nationale interprofessionnelle COPANEF |
1 |
2 678 |
Liste générique (socle & accompagnement VAE) |
1 |
2 |
Total |
192 |
12 276 (sans doublon) |
Source : Caisse des dépôts et consignations.
*
La Commission examine l’amendement AS92 de Mme Marianne Dubois.
Mme Isabelle Le Callennec. C’est Marianne Dubois, très sensible à la question de la langue des signes, qui est à l’initiative de cet amendement.
À l’heure actuelle, nombre de salariés souhaitant se former dans le cadre du compte personnel de formation (CPF) ne peuvent choisir la langue des signes car elle ne figure plus dans la liste des formations. Parallèlement, les organismes de formation en langue des signes se trouvent de fait dans une situation économique particulièrement fragile, alors que les besoins ne cessent de croître. L’amendement vise donc à ce que la langue des signes soit inscrite dans la liste des formations proposées aux salariés dans le cadre du CPF.
M. le rapporteur. Défavorable. Ma réponse ne porte pas sur la langue des signes en tant que telle, que nous avons intérêt à soutenir. Il se trouve simplement que la liste n’est pas fixée par la loi mais par le Comité interprofessionnel pour l’emploi et la formation (COPANEF) s’agissant de la liste nationale interprofessionnelle et par le Comité paritaire interprofessionnel régional pour l’emploi et la formation professionnelle (COPAREF) au niveau régional.
Mme Martine Carrillon-Couvreur. La langue des signes est inscrite dans la loi de 2005 et reconnue comme une langue à part entière. La conférence nationale du handicap de 2014 a rappelé la feuille de route. Tout le monde est d’accord, il faut maintenant que les choses bougent.
Mme Isabelle Le Callennec. Je ne comprends pas que la langue des signes ne soit toujours pas inscrite sur la liste du COPANEF.
M. Gérard Cherpion. Ce n’est pas du domaine législatif ; cela dépend du COPANEF et je peux, si vous le souhaitez, relayer la demande auprès de ce dernier.
Ce n’est pas la seule matière absente des listes, ce qui est d’ailleurs quelque peu contraire à l’esprit de la loi de 2014 : celle-ci a établi la liberté du salarié ou du demandeur d’emploi de choisir la formation qu’il souhaite, or ce qui n’est pas dans la liste est de fait interdit.
La Commission rejette l’amendement.
Elle adopte ensuite l’amendement de précision AS352 du rapporteur.
Puis elle adopte l’article 35 modifié.
*
* *
Article 36
(Art. L. 6111-7, L. 6111-8 [nouveau] et L. 6353-10 [nouveau] du code du travail)
Information et évaluation des formations
Cet article vise à améliorer la lisibilité des résultats d’insertion liés aux formations vis-à-vis des acteurs institutionnels et des bénéficiaires afin de faciliter le pilotage de la carte régionale des formations initiales par les régions, les rectorats et les partenaires sociaux.
L’article L. 6111-7 du code du travail dispose que : « les informations relatives à l’offre de formation professionnelle sur l’ensemble du territoire national et aux perspectives du marché de l’emploi correspondant à ces formations sont intégrées à un système d’information national, dont les conditions de la mise en œuvre sont déterminées par décret en Conseil d’État ».
Cet article issu de la loi du 5 mars 2014 permet la mise en place d’un système unique d’information national portant sur l’offre de formation professionnelle.
Le décret n° 2015-742 du 24 juin 2015 relatif au système d’information sur l’offre de formation professionnelle a introduit l’article R. 6111-1 qui dispose que : « le système d’information national… utilise un langage de référence commun dénommé : Langage harmonisé d’échanges d’informations sur l’offre de formation – LHÉO ». Il s’agit d’exprimer de façon cohérente une action de formation qui peut ensuite être lue, diffusée, classée, décrite par le plus grand nombre. Ce langage commun concerne tous les acteurs chargés d’informer sur la formation, les opérateurs ainsi que les financeurs qui définissent les modalités de publication de leur catalogue d’offres de formation ainsi que celles de leur diffusion.
S’il est à ce stade trop tôt pour évaluer pleinement l’efficacité de cet outil, le deuxième alinéa du présent article propose de compléter l’article L. 6111-7 pour prévoir que le décret devra préciser les conditions de publicité de ce nouvel outil afin de le porter à la connaissance du plus grand nombre.
2. Une enquête nationale qualitative relative au taux d’insertion des formations dispensées à destination des jeunes et des familles
Si l’article L. 6111-7 prévoit un système d’information complet sur la carte des formations, il n’existe que des enquêtes partielles sur les différents taux d’insertion professionnelle à l’issue des différentes filières de formation et ces enquêtes ne sont pas rendues publiques.
L’enquête IVA « Insertion des lycéens dans la Vie active » apporte aux régions et aux académies des informations sur les débouchés par filière professionnelle à la suite des formations dispensées dans le cadre de l’éducation nationale.
L’enquête IPA « Insertion professionnelle des apprentis » mesure quant à elle l’insertion professionnelle des apprentis avec des résultats de taux d’emploi par secteur d’activité. Elle cible donc les jeunes sortants de classe terminale d’un CFA ou d’une section d’apprentissage.
Ces deux enquêtes sont réalisées annuellement par la Direction de l’évaluation, de la prospective et de la performance du ministère de l’éducation nationale.
Le 2° du présent article propose de rendre publics les résultats d’une enquête nationale quantitative « relative aux taux d’insertion des formations dispensées » non seulement dans les CFA mais aussi dans les sections d’apprentissage et les lycées professionnels.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la formation professionnelle et du ministre chargé de l’éducation nationale déterminera les modalités de diffusion de ces résultats. Un plus large accès à l’information et, notamment, au taux d’insertion dans l’emploi des formations envisagées, constitue un outil essentiel pour la construction d’un parcours de formation efficace à la fois pour les jeunes mieux à même d’apprécier les propositions professionnelles offertes par les diverses formations, et pour les acteurs institutionnels qui peuvent en tirer des conséquences sur l’évolution de l’offre.
La gestion des entrées et des sorties dans la formation obéit à des procédures différentes selon les financeurs. Il n’existe à ce stade aucun outil commun de gestion de ces flux. Cette absence de rationalisation a notamment pour conséquence la multiplication des tâches, tant du côté des organismes de formation que des financeurs, et nuit au suivi de la qualité des formations ainsi qu’à la cohérence des procédures.
Or, la mise en oeuvre du CPF et sa montée en charge ont rendu encore plus nécessaire la mise en place d’un outil unique. En effet, le compte implique de nombreux acteurs privés et publics et la prise en charge financière suppose un suivi précis des entrées, des sorties, des ruptures de formation et des validations totales ou partielles.
Le 3° du présent article propose donc de compléter le chapitre III « Réalisation des actions des formations » du titre cinquième « Organismes de formation » du livre III « Formation professionnelle continue » de la sixième partie « La formation professionnelle tout au long de la vie » du code du travail par une section 4 intitulée « Obligations vis-à-vis des financeurs ».
L’article unique de la section ainsi créée prévoit que « les organismes de formation informent le financeur de la formation, dans des conditions définies par décret, de l’entrée, des interruptions, des sorties effectives pour chacun de leurs stagiaires et les [sic] données relatives à l’emploi et au parcours de formation [de ces stagiaires] ».
Il crée ainsi le cadre juridique indispensable, compte tenu de la centralisation des informations et données personnelles, permettant la mise en place d’un « guichet unique », une plateforme commune de saisie des entrées et sorties temporaires ou définitives des stagiaires de la formation professionnelle. Cette plateforme contiendra également les données relatives au parcours et à l’emploi des stagiaires.
Outre qu’elle simplifiera la tâche administrative des auteurs puisqu’elle reposera sur le principe de la saisie unique d’une même donnée partagée, elle permettra donc de mettre en place un véritable suivi de la qualité des parcours de formation, répondant ainsi à l’exigence fixée par l’article 8 de la loi du 5 mars 2014. Celui-ci a prévu que les organismes collecteurs paritaires agréés (OPCA), les organismes paritaires agréés au titre du congé individuel de formation (OPACIF), l’État, les régions, Pôle Emploi et l’association de gestion du fonds pour l’insertion des personnes handicapées (AGEFIPH), s’assurent de la capacité du prestataire à dispenser une formation de qualité sur la base de critères définis par décret en Conseil d’État.
Le décret n° 2015-790 du 30 juin 2015 relatif à la qualité des actions de la formation professionnelle continue identifie ainsi six critères devant être respectés en contrepartie des financements versés au prestataire : l’identification précise des objectifs de la formation et son adaptation au public formé ; l’adaptation des dispositifs d’accueil, de suivi pédagogique et d’évaluation aux publics de stagiaires ; l’adéquation des moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement à l’offre de formation ; la qualification professionnelle et la formation continue des personnels chargés des formations ; les conditions d’information du public sur l’offre de formation, ses délais d’accès et les résultats obtenus et la prise en compte des appréciations rendues par les stagiaires.
La plateforme créée par le présent article constituera un outil précieux pour le processus de vérification de ces exigences.
À l’initiative du rapporteur, la Commission a voté l’amendement AS877 permettant à Pôle emploi de disposer également des données sur les entrées et sorties de formation afin d’avoir une vue complète, précise et actualisée sur le sujet et d’éviter le double paiement avec la région.
*
La Commission adopte successivement les amendements rédactionnels AS353, AS395, AS354, AS355 et AS403 du rapporteur.
Elle examine ensuite l’amendement AS877 du rapporteur.
M. le rapporteur. Le présent amendement a pour objet de permettre à Pôle emploi de disposer de données sur les entrées et sorties de formation. Dans le cadre de la mobilisation gouvernementale pour l’emploi, il est en effet nécessaire d’avoir une vue complète de ces entrées et sorties. Il s’agit par ailleurs d’éviter un double paiement quand la région, d’une part, et Pôle emploi, d’autre part, peuvent être amenés à verser une rémunération à la personne en formation. C’est pourquoi l’amendement propose que les organismes de formation, dont la loi prévoit déjà qu’ils doivent transmettre à Pôle emploi des informations sur les entrées en formation, transmettent également les informations relatives aux interruptions et sorties.
M. Gérard Cherpion. Ces informations et leur croisement sont en effet nécessaires. Un « entrepôt » de l’ensemble des données devrait être rapidement mis en place ; la Délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle (DGEFP) y travaille. Une réunion de lancement de l’entrepôt a lieu la semaine prochaine.
La Commission adopte cet amendement.
Elle adopte ensuite l’article 36 modifié.
*
* *
Article 37
(Art. L. 6111-7, L. 6111-8 [nouveau] et L. 6353-10 [nouveau] du code du travail)
Recrutement d’agents contractuels par les groupements d’établissements (GRETA) et les établissements d’enseignement supérieur
Cet article vise à permettre aux groupements d’établissements et aux établissements d’enseignement supérieur de recruter des agents contractuels en contrat à durée indéterminée et à ouvrir à leurs agents contractuels un accès à la fonction publique de l’État.
1. Des agents contractuels des GRETA et des établissements d’enseignement supérieur en situation précaire
L’article L. 423-1 du code de l’éducation dispose que : « pour la mise en œuvre de leur mission de formation continue ainsi que de formation et d’insertion professionnelles, les établissements scolaires publics s’associent en groupement d’établissement dans des conditions définies par décret ». Les groupements ainsi constitués (GRETA) n’ont pas de personnalité juridique distincte et dépendent pour l’ensemble de leurs activités et de leur gestion administrative, financière et comptable, de l’établissement support. Dès lors, leurs personnels comme ceux des établissements d’enseignement supérieur sont soumis aux dispositions statutaires de la fonction publique relatives à l’emploi de contractuels.
Par dérogation au principe selon lequel les emplois permanents de l’État, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics doivent être occupés par des fonctionnaires, des magistrats ou des militaires, les GRETA et les établissements d’enseignement supérieur peuvent recruter des agents contractuels en vertu des dispositions de :
– l’article 4 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, c’est-à-dire en cas d’absence de corps de fonctionnaires susceptibles d’assurer les fonctions correspondantes ou, pour les emplois de catégorie A, lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient ;
– l’article 6 de la même loi dès lors que : « Les fonctions qui, correspondant à un besoin permanent, impliquent un service à temps incomplet d’une durée n’excédant pas 70 % d’un service à temps complet ».
Il en résulte qu’il existe un nombre important d’agents contractuels dans les GRETA ou les établissements d’enseignement supérieur soit en CDD, soit en CDI, exerçant leur activité à temps partiel ou à temps plein.
L’étude d’impact accompagnant le projet de loi fait apparaître qu’en 2014 :
– environ 60 % des agents contractuels des GRETA ne travaillaient pas à temps complet, soit près de 1 400 agents ;
– 2 052 personnels contractuels de catégorie A – formateurs intervenants devant les stagiaires – étaient en CDD ;
– les personnels administratifs, techniques et de services représentaient quant à eux 1 558 agents en CDD.
S’agissant des établissements d’enseignement supérieur, les taux de contractuels sont très variables et représentent, selon l’étude d’impact, entre 10 % et 85 % des personnels.
Le premier dispositif est celui prévu par l’article 6 de la loi du 11 janvier 1984 précitée. En vertu de cet article, les agents contractuels peuvent être recrutés par un contrat à durée déterminée ou à durée indéterminée dès lors que le service est à temps incomplet et que la quotité de ce service ne dépasse pas 70 % d’un temps complet. Toutefois, il ne s’agit pas d’un droit à CDI et la quotité de travail constitue en tout état de cause un élément de précarité.
Le second dispositif est celui de l’article 6 bis de la même loi tel que modifié par la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, et à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique.
Il prévoit le principe du recrutement et du renouvellement du contrat initial en CDD, dans la limite d’une durée maximale de six ans. Au terme des six ans, le renouvellement du contrat arrivé à terme prend la forme d’un CDI et les contrats en cours sont réputés en CDI. Toutefois, le dernier alinéa de l’article 6 bis exclut les contrats conclus pour la mise en œuvre d’un programme de formation, d’insertion, de reconversion professionnelle ou de formation professionnelle d’apprentissage de l’application des deuxième à septième alinéas de l’article.
Le Conseil d’État a d’ailleurs confirmé, dans un arrêt du 16 novembre 2015 (n° 389989), la lecture stricte du dernier alinéa de l’article 6 bis, excluant du droit à la CDisation les agents contractuels des GRETA et des établissements d’enseignement supérieur.
Il a ainsi rejeté la demande du requérant formulée en référé visant à imposer le maintien provisoire de relations contractuelles au-delà de la date d’échéance du contrat en attendant le jugement au fond, arguant que la durée d’emploi de l’intéressé supérieure à six ans n’a « pas eu pour effet de [le] rendre titulaire d’un contrat à durée indéterminée ».
3. L’extension proposée des droits des agents contractuels des GRETA et des établissements d’enseignement supérieur
Dans les deux périmètres – GRETA et établissements d’enseignement supérieur – la « CDisation » favorise le climat social, la stabilité des équipes et la continuité du service public.
L’article 37 vise deux catégories d’agents :
– le I vise les agents contractuels recrutés par les GRETA mentionnés à l’article L. 432-1 du code de l’éducation ;
– le II vise les agents contractuels recrutés par les établissements d’enseignement supérieur dont les missions sont mentionnées aux articles L. 123-3 et L. 123-4 du code de l’éducation.
Pour l’ensemble de ces agents, il prévoit qu’ils peuvent « être employés à temps complet ou incomplet en fonction des besoins du service ». Les dispositions de l’article 6 de la loi du 11 janvier 1984 ne sont plus opposables à une augmentation de leur quotité de travail aujourd’hui plafonnée à 70 % d’un temps plein.
Par ailleurs, pour l’ensemble de ces agents, il prévoit qu’ils bénéficient du droit à la « CDisation » au bout de 6 ans de services tel que prévu par l’article 6 bis de la loi du 11 janvier 1984.
Enfin, ces agents se voient étendre le bénéfice des dispositions du décret pris pour l’application de l’article 7 de la loi du 11 janvier 1984 (décret 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’État) qui comprend les dispositions régissant les relations du travail (recrutement, discipline, rémunération, évaluation, congés, etc.) et les règles de protection sociale équivalentes à celles dont bénéficient les fonctionnaires, sauf en ce qui concerne les régimes d’assurance maladie et d’assurance vieillesse.
b. L’ouverture de l’accès à la fonction publique de l’État aux agents contractuels des GRETA et des établissements d’enseignement supérieur
La loi du 12 mars 2012 a prévu que, par dérogation à la loi du 11 janvier 1984, l’accès aux corps de fonctionnaires de l’État, dont les statuts particuliers prévoient un recrutement par la voie externe, peut être ouvert par la voie de modes de recrutement réservés valorisant les acquis professionnels des postulants. Le III du présent article étend le bénéfice de cette disposition aux agents contractuels visés au I et II.
Le temps de service accompli antérieurement à leur « CDisation » sera pris en compte pour l’accès à la qualité de fonctionnaire.
*
La Commission adopte les amendements rédactionnels AS524 et AS772 du rapporteur.
Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette ensuite l’amendement AS527 de M. Christophe Cavard.
Enfin,, elle adopte l’article 37 modifié.
*
* *
Chapitre III
Préserver l’emploi
Article 38
(Art. L. 1254-9, L. 1255-11, L.1255-14 à L. 1255-16, L. 1255-17 et L. 1255-18 [nouveaux] et L. 5132-14 du code du travail, art. L. 5542-51 du code des transports, ordonnance n° 2015-380 du 2 avril 2015 relative au portage salarial)
Portage salarial
Cet article vise à ratifier l’ordonnance du 2 avril 2015 relative au portage salarial. Il complète le dispositif mis en place par des sanctions pénales pour les entreprises de portage salarial et les entreprises clientes du salarié porté qui ne respecteraient pas les règles définies dans l’ordonnance. Cet article corrige en outre diverses erreurs matérielles.
Le portage salarial a été consacré pour la première fois au niveau législatif par la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail, dont l’article 8 a introduit un article L. 1251-64 dans le code du travail définissant le portage salarial comme « un ensemble de relations contractuelles organisées entre une entreprise de portage, une personne portée et des entreprises clientes comportant pour la personne portée le régime du salariat et la rémunération de sa prestation chez le client par l’entreprise de portage ».
Cet article 8 prévoyait également qu’un accord national interprofessionnel (ANI) étendu puisse confier à une branche professionnelle la mission d’organiser le portage salarial. Ainsi, sur la base de l’ANI du 11 janvier 2008, les partenaires sociaux de la branche de l’intérim ont conclu un accord relatif au portage salarial le 24 juin 2010.
Cependant, par une décision du 11 avril 2014 (67), le Conseil constitutionnel a déclaré les dispositions de l’article 8 de la loi du 25 juin 2008 précitée inconstitutionnelles, au motif que l’organisation des relations contractuelles en matière de portage salarial relevait de la compétence du législateur. Le Conseil constitutionnel a reporté l’effet de cette déclaration d’inconstitutionnalité au 1er janvier 2015.
Afin de tirer les conséquences de cette décision, l’article 4 de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives a autorisé le Gouvernement à prendre par ordonnance « toute mesure législative visant à déterminer les conditions essentielles de l’exercice du portage salarial […] et les principes applicables à la personne portée, à l’entreprise de portage et à l’entreprise cliente. Ces conditions essentielles comprennent la définition des conditions d’exercice de l’activité d’entreprise de portage salarial et des conditions de recours au portage salarial, incluant les différents types de contrats de travail, leurs caractéristiques, les conditions d’emploi et de travail des salariés portés et l’indication des garanties qui leur sont applicables ».
Le I du présent article vise à ratifier l’ordonnance n° 2015-380 du 2 avril 2015 relative au portage salarial, prise sur ce fondement.
● Le titre Ier de l’ordonnance précitée créé un chapitre IV, consacré au portage salarial, au sein du titre V du livre II de la première partie du code du travail, relatif au contrat de travail temporaire et aux autres contrats de mise à disposition.
– La section 1 définit le portage salarial et les conditions dans lesquelles il est possible pour une personne de se faire « porter ».
Le portage salarial constitue ainsi une forme particulière de mise à disposition de main d’œuvre constituée par :
« – d’une part, la relation entre une entreprise dénommée « entreprise de portage salarial » effectuant une prestation au profit d’une entreprise cliente, qui donne lieu à la conclusion d’un contrat commercial de prestation de portage salarial ;
– d’autre part, le contrat de travail conclu entre l’entreprise de portage salarial et un salarié désigné comme étant le « salarié porté », lequel est rémunéré par cette entreprise » (article L. 1254-1 du code du travail).
Le salarié porté doit justifier « d’une expertise, d’une qualification et d’une autonomie lui permettant de rechercher lui-même ses clients et de convenir avec eux des conditions d’exécution de sa prestation et de son prix » (article L. 1254-2 du même code). Il bénéficie par ailleurs d’une rémunération minimale fixée par accord de branche étendu et dont le montant s’élève, à défaut d’accord, à 75 % du plafond de la sécurité sociale.
Le portage salarial s’apparente donc à une relation triangulaire de travail impliquant une personne portée, une entreprise de portage salarial et une entreprise cliente. Le salarié porté est lié par un contrat de travail avec l’entreprise de portage salarial, qui assure sa rémunération, mais c’est à lui de démarcher une entreprise cliente qu’il met en relation avec l’entreprise de portage salarial. Le portage salarial constitue ainsi un montage lui permettant d’exercer une activité de nature indépendante, sans avoir à créer sa propre structure juridique et tout en bénéficiant du statut de salarié. Pour l’entreprise cliente, l’intérêt du portage salarial est notamment de pouvoir externaliser des missions ou des projets ponctuels et spécifiques vers des spécialistes.
Comme l’indique le rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance, « le champ d’application ainsi défini du portage salarial répond à un motif d’intérêt général en rapport avec l’objet de la présente ordonnance. Elle vise à sécuriser les entreprises de portage salarial en les assurant que leurs salariés portés sont bien à même de rechercher eux-mêmes leurs prestations. Cette définition offre également un cadre protecteur pour les personnes portées. En effet, seules celles qui disposent d’une autonomie suffisante seront éligibles au dispositif. Pour les autres, les règles du salariat définies par le code du travail doivent rester la voie privilégiée de la relation de travail ».
– La section 2 précise les conditions et les interdictions du recours au portage salarial par une entreprise cliente : celle-ci ne peut faire appel à un salarié porté que pour l’exécution d’une tâche occasionnelle ne relevant pas de son activité normale et permanente ou pour une prestation ponctuelle nécessitant une expertise dont elle ne dispose pas (article L. 1254-3). Une prestation chez une entreprise cliente ne peut excéder trente-six mois (article L. 1254-4). Par ailleurs, les activités de service à la personne sont exclues du dispositif (article L. 1254-5).
– La section 3 définit la nature et les spécificités du contrat de travail liant l’entreprise de portage et le salarié porté, qui peut être à durée déterminée ou indéterminée (articles L. 1254-7 à L. 1254-21).
– La section 4 précise la nature et les spécificités du contrat commercial conclu entre l’entreprise de portage et l’entreprise cliente (articles L. 1254-22 et L. 1254-23).
– La section 5 spécifie les conditions d’activité des entreprises de portage salarial. Celles-ci exercent leur activité à titre exclusif. Elles doivent par ailleurs mettre en place pour chaque salarié porté un compte d’activité permettant de détailler les sommes qu’elles reçoivent de l’entreprise cliente et celles qu’elles versent au salarié porté ou aux organismes en charge du recouvrement des contributions sociales et fiscales. Sont également précisées leurs obligations au regard de la médecine du travail et les modalités de décompte de leurs effectifs (articles L. 1254-24 à L. 1254-31).
● Le titre II de l’ordonnance définit les conditions particulières de prise en compte des salariés portés en matière d’éligibilité et d’électorat des délégués du personnel et des membres du comité d’entreprise.
● Le titre III détermine les conditions d’effectifs et d’ancienneté spécifiques aux salariés des entreprises de portage salarial pour l’application des dispositifs de participation et d’épargne salariale.
● Le titre IV prévoit la possibilité pour le comité d’entreprise de l’entreprise ayant recours au portage salarial de saisir l’inspection du travail en cas de recours abusif à ce type de prestations, selon une procédure similaire à celle relative au recours abusif aux contrats de travail à durée déterminée et au travail temporaire. Ce dispositif, prévu à l’article L. 2323-17 par l’ordonnance, a été déplacé à l’article L. 2323-59 par la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi, sans que son contenu soit modifié.
● Enfin, le titre V comporte un article de coordination supprimant la possibilité pour les entreprises de portage salarial de déroger à l’interdiction de prêt illicite de main-d’œuvre, ainsi qu’un article autorisant un accord de branche étendu à prévoir l’adaptation du niveau et de la répartition de la contribution des employeurs au titre de leur participation au financement de la formation professionnelle continue.
Le III met en place un dispositif de sanctions pénales afin de garantir l’application effective des règles définies par l’ordonnance du 2 avril 2015. Il complète le chapitre V, consacré aux « sanctions pénales », du titre V du livre II de la première partie du code du travail, relatif au contrat de travail temporaire, aux autres contrats de mise à disposition et au portage salarial, par une nouvelle section intitulée « portage salarial » et composée de cinq articles.
Le dispositif proposé est directement inspiré des sanctions existant en cas de non-respect des dispositions relatives au contrat à durée déterminée (articles L. 1248-1 et suivants du code du travail) et de celles relatives au travail temporaire (articles L. 1255-1 et suivants du même code).
● L’article L. 1255-14 nouveau sanctionne d’une amende de 3 750 euros les entreprises de portage salarial qui ne respecteraient pas les règles prévues aux articles L. 1254-5 et suivants du code du travail. Il s’agit plus précisément du non-respect :
– de l’interdiction de conclure un contrat de portage salarial pour les activités de services à la personne (1°, article L. 1254-5) ;
– du fait que le contrat doit préciser s’il est conclu pour une durée déterminée ou indéterminée (2° et 5°, articles L. 1254-7, L. 1254-14 et L. 1254-20) ;
– pour les contrats à durée déterminée, de l’obligation de mentionner un terme précis ou une durée minimale (3°, article L. 1254-11) ;
– des durées maximales s’appliquant aux contrats à durée déterminée (4°, articles L. 1254-12, L. 1254-13 et L. 1254-17) ;
– de l’obligation de faire figurer dans le contrat de travail différentes clauses et mentions relatives à la relation entre l’entreprise de portage et le salarié porté ainsi que, pour les contrats à durée déterminée, celles relatives à la réalisation de la prestation de service de portage salarial (6°, articles L. 1254-15 et L. 1254-21) ;
– de l’obligation de transmettre le contrat de travail au salarié dans un délai de deux jours ouvrables suivant sa conclusion (7°, article L. 1254-16) ;
– du délai maximum de deux jours ouvrables suivant le début de la prestation pour conclure le contrat commercial avec l’entreprise cliente de la personne portée et pour en transmettre une copie à celle-ci (8°, article L. 1254-22) ;
– de l’obligation de faire figurer dans le contrat commercial différentes clauses et mentions reprenant les éléments essentiels de la négociation de la prestation entre le salarié et l’entreprise cliente (9°, article L. 1254-23) ;
– du caractère exclusif de l’activité de portage salarial (10°, article L. 1254-24) ;
– de l’obligation de mettre en place, pour chaque salarié porté, un compte d’activité (11°, article L. 1254-25) ;
– de l’obligation de souscrire à une garantie financière (12°, article L. 1254-26) ;
– de l’obligation d’effectuer une déclaration préalable à l’autorité administrative avant d’exercer l’activité de portage salarial (13°, article L. 1254-27) ;
– des obligations relatives à la médecine du travail (14°, article L. 1254-28).
En cas de récidive, l’article L. 1255-14 nouveau prévoit une peine de six mois d’emprisonnement et une amende de 7 500 euros.
La juridiction peut en outre prononcer une interdiction d’exercer l’activité d’entreprise de portage salarial pour une durée de deux à dix ans.
● L’article L. 1255-15 nouveau prévoit de sanctionner d’une amende de 3 750 euros le fait pour une entreprise, autre que celle mentionnée à l’article L. 1255-14 nouveau, de conclure un contrat de portage salarial sans respecter les conditions requises pour exercer cette activité, prévues aux articles L. 1254-24 à L. 1254-27 du code du travail (voir les points 10° à 13° ci-dessus).
● L’article L. 1255-17 nouveau complète ce dispositif de sanctions par une peine délictuelle de six mois d’emprisonnement et une amende de 6 000 euros lorsqu’est méconnue l’interdiction d’exercer l’activité de portage salarial prononcée par la juridiction.
L’article L. 1255-16 nouveau tend à sanctionner d’une amende de 3 750 euros les entreprises clientes qui ne respecteraient pas les dispositions prévues par l’ordonnance du 2 avril 2015, en particulier :
– le fait de ne recourir à un salarié porté que pour l’exécution d’une tâche occasionnelle ne relevant pas de son activité normale et permanente ou pour une prestation ponctuelle nécessitant une expertise dont elle ne dispose pas (1°, article L. 1254-3) ;
– l’interdiction de recourir à un salarié porté pour remplacer un salarié dont le contrat de travail est suspendu à la suite d’un conflit collectif de travail, de lui faire effectuer des travaux dangereux, de lui faire réaliser une prestation dont la durée est supérieure à trente-six mois, ou celle de recourir à un salarié porté pour une activité de service à la personne (2°, articles L. 1254-4 et L. 1254-5) ;
– l’obligation de conclure avec l’entreprise de portage salarial le contrat commercial au plus tard deux jours ouvrables suivant le début de la prestation et celle d’y faire figurer différentes clauses et mentions reprenant les éléments essentiels de la négociation de la prestation entre le salarié porté et l’entreprise cliente (3° et 4°, articles L. 1254-22 et L. 1254-23) ;
Comme pour l’entreprise de portage salarial dont les sanctions sont prévues à l’article L. 1255-14 nouveau, l’article L. 1255-16 nouveau prévoit une peine de six mois d’emprisonnement et une amende de 7 500 euros pour l’entreprise cliente en cas de récidive.
L’article L. 1254-18 nouveau crée une peine complémentaire aux sanctions prévues ci-dessus : le juge pourra ainsi ordonner l’affichage ou la diffusion de tout ou partie du jugement, aux frais de l’entrepreneur de portage salarial ou de l’entreprise cliente condamnés, ainsi que son insertion dans les journaux qu’il désigne.
● Le II vise à corriger une erreur matérielle figurant à l’article L. 1254-9 du code du travail, qui précise les conditions de fixation de l’indemnité d’apport d’affaire. Cette indemnité doit être définie par accord de branche étendu. À défaut, son montant est fixé à 5 % de la rémunération due au salarié. Or, la version actuelle de l’article L. 1254-9 précité dispose que le montant de l’indemnité « est fixé à 5 % de la rémunération due au salarié porté et de l’indemnité ». Il est donc proposé de supprimer les mots « et de l’indemnité », qui ne renvoient à aucun contenu spécifique.
● Le IV tend à corriger plusieurs erreurs de références d’articles dans le code du travail et le code des transports.
*
La commission a adopté six amendements rédactionnels à cet article.
*
La Commission adopte successivement les amendements rédactionnels AS773, AS774, AS775, AS776, AS777 et AS778 du rapporteur.
Puis elle adopte l’article 38 modifié.
*
* *
Article 39
(Art. L. 1242-2, L. 1242-7, L. 1244-1, L. 1244-2, L. 1244-4, L. 1251-6, L. 1251-11, L. 1251-37, L. 1251-60, L. 2412-2 à L. 2412-4, L. 2412-7 à L. 2412-9, L. 2412-13, L. 2421-8-1, L. 5135-7 et L. 6321-13 du code du travail)
Emploi saisonnier
Cet article vise à introduire dans le code du travail la définition du caractère saisonnier des emplois. Par ailleurs, il invite les branches professionnelles concernées à engager des négociations sur les modalités de reconduction de ce contrat et de prise en compte de l’ancienneté du salarié. À l’issue d’un délai de six mois après la promulgation de la loi, le Gouvernement serait habilité à prendre par ordonnance des dispositions supplétives.
En l’état du droit, il n’existe pas de définition de l’emploi à caractère saisonnier au niveau législatif : l’article L. 1242-2 du code du travail, qui dresse la liste des cas où un contrat à durée déterminée peut être conclu, mentionne notamment les « emplois à caractère saisonnier », sans toutefois en proposer de définition.
La définition du travail saisonnier repose principalement sur une circulaire du ministère du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle du 30 octobre 1990 relative au contrat de travail à durée déterminée et au travail temporaire. Sont considérés comme ayant un caractère saisonnier les « travaux qui sont normalement appelés à se répéter chaque année, à date à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs, et qui sont effectués pour le compte d’une entreprise dont l’activité obéit aux mêmes variations » (68).
Cette définition a été reprise par la Cour de cassation (69) qui y a apporté un certain nombre de précisions. Ainsi, si les travaux saisonniers se rencontrent le plus souvent dans les domaines agricole, agroalimentaire ou touristique, il n’existe pas de liste limitative de secteurs d’activité dans lesquels peuvent exister de tels travaux (70). Pour pouvoir être qualifiées de saisonnières, les variations d’activité doivent être régulières, prévisibles et cycliques, tout en étant indépendantes de la volonté des employeurs et des salariés. Il ne doit pas s’agir d’un simple accroissement périodique de production au sein d’une entreprise travaillant à l’année (71).
Au niveau européen, un règlement du 14 juin 1971 (72) a défini le travail à caractère saisonnier comme « un travail qui dépend du rythme des saisons et se répète automatiquement chaque année ».
Le I vise à introduire dans le code du travail la définition du caractère saisonnier des emplois. L’article L. 1242-2, qui ne fait que mentionner les emplois à caractère saisonnier, serait complété afin de préciser qu’il s’agit des emplois « dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ».
La définition, au niveau législatif, de l’emploi saisonnier, permet à la France de se conformer à la directive du 26 février 2014 relative aux conditions d’entrée et de séjour des travailleurs saisonniers ressortissants de pays tiers (73).
La définition proposée reprend celle retenue par la Cour de cassation.
Le II procède à des modifications rédactionnelles de conséquence.
2. Modalités de reconduction du contrat de travail à caractère saisonnier et prise en compte de l’ancienneté du salarié
Comme le prévoit l’article L. 1244-1 du code du travail, la faculté pour un employeur de conclure des contrats saisonniers successifs avec le même salarié afin de pourvoir un emploi saisonnier n’est assortie d’aucune limite au-delà de laquelle la relation de travail serait requalifiée en contrat à durée indéterminée. L’employeur peut donc employer le même salarié durant plusieurs saisons successives sous contrat à durée déterminée, dès lors que l’activité est bien saisonnière (74).
La situation est néanmoins différente lorsque le contrat de travail comporte une clause de reconduction pour la saison suivante. L’article L. 1244-2 du code du travail dispose ainsi qu’ « une convention ou un accord collectif de travail peut prévoir que tout employeur ayant occupé un salarié dans un emploi à caractère saisonnier lui propose, sauf motif réel et sérieux, un emploi de même nature, pour la même saison de l’année suivante. La convention ou l’accord en définit les conditions, notamment la période d’essai, et prévoit en particulier dans quel délai cette proposition est faite au salarié avant le début de la saison ainsi que le montant minimum de l’indemnité perçue par le salarié s’il n’a pas reçu de proposition de réemploi ».
L’article L. 1244-2 précise enfin que pour calculer l’ancienneté du salarié, les durées des contrats de travail à caractère saisonnier successifs dans une même entreprise sont cumulées.
La pratique de la reconduction des contrats paraît néanmoins limitée. Ainsi, d’après les chiffres fournis par l’étude d’impact annexée au présent projet de loi, en 2015, parmi les vingt-six accords et conventions collectives, recensés par la direction générale du travail, faisant mention de la possibilité de recourir à des emplois saisonniers, seuls cinq prévoient la possibilité d’introduire une clause de reconduction dans le contrat de travail.
Le travail saisonnier comporte par définition une part irréductible d’instabilité, puisqu’il ne s’inscrit pas dans un cadre annualisé et à durée indéterminée. De nombreux saisonniers effectuent plusieurs saisons de suite chez le même employeur, sans avoir la certitude de voir ce contrat reconduit. Le code du travail prévoit certes qu’une clause de reconduction peut être introduite, mais celle-ci n’est pas obligatoire. Cette situation est facteur d’insécurité pour les salariés.
Il convient donc d’apporter à ces emplois des garanties plus importantes, qui profiteraient certes aux salariés, mais aussi aux employeurs dont la main-d’œuvre, stabilisée, serait plus professionnalisée et donc plus compétitive.
C’est pourquoi le III invite les branches professionnelles dans lesquelles l’emploi saisonnier est particulièrement développé à engager « des négociations relatives au contrat de travail à caractère saisonnier afin de définir les modalités de reconduction de ce contrat et de prise en compte de l’ancienneté du salarié », lorsqu’elles n’ont pas déjà prévu de telles clauses dans leurs accords collectifs.
La définition des modalités de reconduction des contrats de travail ou de la prise en compte de l’ancienneté serait ainsi laissée aux partenaires sociaux, dans le cadre d’accords ou de conventions collectives de branche. Il est prévu que les négociations soient engagées dans les six mois suivant la promulgation de la loi.
Cette disposition permet à la fois d’améliorer la sécurisation des parcours professionnels et l’acquisition de compétences des salariés tout en renforçant le dialogue social.
Cependant, afin que ce dispositif puisse voir le jour dans des délais raisonnables, en particulier dans les secteurs d’activité où le dialogue social est encore peu développé, le III prévoit d’habiliter le Gouvernement, à l’issue du délai de six mois après la promulgation de la loi, à prendre par ordonnance « toute mesure législative s’appliquant, à défaut d’accord de branche, dans les branches qu’elle détermine, à la reconduction du contrat de travail à caractère saisonnier […] et à la prise en compte de l’ancienneté du salarié ».
Cette disposition traduit une préconisation formulée dès 1999 par M. Anicet Le Pors, dans un rapport relatif à l’amélioration de la situation sociale et professionnelle des travailleurs saisonniers du tourisme. Plus récemment, le rapport présenté par Mmes Annie Genevard et Bernadette Laclais, intitulé « Un acte II de la loi Montagne » et paru en juillet 2015 proposait d’ « étudier la possibilité de généraliser la reconduction automatique des contrats saisonniers d’une saison sur l’autre » (proposition n° 7.b).
*
La Commission a adopté trois amendements rédactionnels à cet article.
*
La Commission adopte successivement les amendements rédactionnels AS779, AS784 et AS780 du rapporteur.
Puis elle adopte l’article 39 modifié.
*
* *
La Commission examine l’amendement AS291 de Mme Bernadette Laclais.
Mme Bernadette Laclais. J’appelle l’attention de notre Commission sur les événements qui se sont produits ce week-end dans une station renommée de sports d’hiver. La station n’est pas en cause, mais nous sommes confrontés au problème récurrent du logement des saisonniers.
L’objectif de cet amendement est de favoriser la construction et la rénovation par les employeurs de logements destinés aux salariés saisonniers. J’ai rencontré beaucoup d’employeurs ; ils ne sont pas fermés à l’idée. Nous pourrions leur donner un coup de pouce en leur permettant notamment de bénéficier d’avantages fiscaux. C’est en tout premier lieu dans l’intérêt des employés, ainsi que des communes, qui ont consenti de gros efforts.
M. Bernard Accoyer. Je soutiens cet amendement. La question du logement des saisonniers, en particulier dans les stations de sports d’hiver, est un problème grave, humainement et socialement, et angoissant, pour les saisonniers mais également pour l’avenir économique de ces stations. L’économie touristique est devenue, en raison de la désindustrialisation de notre pays, un pôle d’emplois et de création de richesses très important, qui ne peut fonctionner qu’avec des saisonniers. Il convient de réfléchir aux moyens de favoriser et d’amplifier la construction de logements pour ces derniers, qui constituent une population fragile s’accommodant parfois de logements particulièrement précaires, faute de trouver autre chose ou de chercher beaucoup, et souvent victimes d’accidents dramatiques.
M. le rapporteur. Je suis très embarrassé car je partage pleinement la préoccupation de Bernadette Laclais, mais je suis amené à émettre un avis défavorable. Outre le fait que les dispositions fiscales ont vocation à être discutées dans le cadre de l’examen des lois de finances, cette mesure n’est pas compatible avec les règles communautaires régissant la TVA. L’un des principes fondateurs de la directive relative au système commun de TVA de 1977 est que les entreprises déduisent la TVA qui grève leurs achats de biens et de services dans la mesure où ces dépenses sont utilisées pour les besoins de leurs opérations taxées. Or la mise à disposition gratuite d’un logement par une commune au profit des personnels saisonniers ne constitue pas une telle opération. Enfin, accorder le bénéfice d’une telle mesure aux communes touristiques pourrait entraîner des revendications émanant d’autres acteurs de la vie économique.
Mme Bernadette Laclais. J’ai déposé l’amendement pour que nous prenions bien conscience du problème. Il faut vraiment que nous engagions une réflexion.
L’amendement est retiré.
*
* *
Article 40
(Art. L. 1253-24 du code du travail)
Groupement d’employeurs
Cet article vise à permettre aux groupements d’employeurs de bénéficier des aides à l’emploi dont auraient bénéficié leurs entreprises adhérentes si elles avaient embauché directement les personnes mises à leur disposition.
1. Le groupement d’employeurs, un outil original de développement et de sécurisation de l’emploi, en particulier dans les petites entreprises
La loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre social a autorisé la constitution de groupements d’employeurs, chargés de recruter des salariés pour les mettre ensuite à la disposition de leurs adhérents. Dispositif créé à l’origine pour répondre aux besoins des plus petites entreprises afin de leur permettre de recruter du personnel dans des conditions sécurisées, les groupements d’employeurs ont connu, en près de trente ans, de nombreuses évolutions. En particulier, la loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011 pour le développement de l’alternance et la sécurisation des parcours professionnels a assoupli la législation relative aux groupements d’employeurs, notamment en supprimant la condition d’effectifs pour les entreprises adhérentes et en améliorant le statut des salariés du groupement.
Défini aux articles L. 1253-1 et suivants du code du travail, un groupement d’employeurs est un groupe constitué par plusieurs entreprises, dont l’objet est de mettre à la disposition de ses membres le personnel qu’il recrute. Il peut être constitué soit sous la forme d’une association régie par la loi du 1er juillet 1901, soit sous la forme d’une société coopérative. Les salariés concernés sont liés par un contrat de travail avec le groupement d’employeurs, qui est leur employeur.
Les entreprises membres du groupement doivent en principe relever de la même convention collective. Si ce n’est pas le cas, la constitution du groupement d’employeurs reste cependant possible, sous réserve de déterminer la convention collective qui sera applicable au groupement et d’effectuer une déclaration auprès de la Direccte.
Ce dispositif permet de répondre à plusieurs situations. Les entreprises membres du groupement peuvent ainsi :
– partager à temps partiel un salarié qualifié (comptable, cadre ayant des compétences spécifiques, etc.), le salarié bénéficiant d’un contrat de travail à temps plein ;
– utiliser successivement, suivant les périodes de l’année, un ou plusieurs salariés pour effectuer des travaux saisonniers se situant à des époques différentes (par exemple : taille d’arbres fruitiers, récolte de légumes, travaux d’été, récolte de fruits à l’automne, etc.) ;
– bénéficier occasionnellement d’appoints de main-d’œuvre pour renforcer l’effectif de salariés existants et permettre ainsi de faire face à des besoins échelonnés avec un travailleur qui bénéficie du statut de salarié permanent du groupement ;
– maintenir la permanence de l’emploi d’un salarié sur plusieurs entreprises alors que ce dernier était menacé de licenciement ou risquait de voir son statut devenir précaire ;
– transformer des emplois précaires en emplois permanents en mettant à la disposition des adhérents les services d’un salarié expérimenté.
Chaque entreprise membre supporte les frais salariaux en proportion de l’utilisation de la main-d’œuvre, avec des frais de gestion réduits et tout en étant déchargée des tâches administratives qu’occasionne normalement l’emploi d’un salarié. Le groupement d’employeurs peut également apporter à ses membres une aide ou des conseils en matière d’emploi ou de gestion des ressources humaines.
Il constitue donc une solution pragmatique répondant à certains besoins des entreprises – en particulier les petites et moyennes entreprises – s’agissant notamment de la variation de la charge de travail, des questions d’organisation du travail ou du développement de compétences spécialisées.
Le groupement d’employeurs apporte par ailleurs aux salariés une plus grande stabilité et une plus grande sécurité d’emploi. Ces derniers n’ont en effet, pour l’aspect juridique et financier de la relation de travail, qu’un seul interlocuteur, le groupement, avec lequel ils peuvent espérer un contrat à durée indéterminée et à temps plein, au lieu d’avoir à multiplier les contrats temporaires, les temps partiels, voire les prestations sous statut de travailleur indépendant avec une multiplicité d’employeurs. Par ailleurs, l’exécution du contrat de travail au sein de deux ou trois entreprises peut être de nature à enrichir les compétences des salariés par la diversité des expériences et des tâches accomplies.
En outre, les groupements mettent en place des dispositifs relativement fins de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. La plupart des entreprises qui adhèrent aux groupements étant le plus souvent de taille moyenne ou petite, elles ne seraient pas en mesure de mettre en place elles-mêmes de tels systèmes de gestion de la formation et de l’emploi.
Le présent article créé une section 4, intitulée « Dispositions applicables à l’ensemble des groupements d’employeurs » et composée d’un article unique, au sein du chapitre III du titre V du livre II de la première partie du code du travail, consacré aux contrats conclus avec un groupement d’employeurs.
L’article L. 1253-24 nouveau permet aux groupements d’employeurs de bénéficier des « aides à l’emploi dont auraient bénéficié ses entreprises adhérentes si elles avaient embauché directement les personnes mises à leur disposition ».
L’étude d’impact annexée au présent projet de loi précise que les dispositifs d’aide à l’emploi devront être adaptés « en prévoyant, par exemple, des règles de proratisation de l’aide en fonction du temps de présence du salarié dans l’entreprise utilisatrice ».
Seraient éligibles à ces aides l’ensemble des groupements d’employeurs, qu’ils entrent ou non dans le champ d’application d’une même convention collective, ainsi que les groupements composés d’adhérents de droit privé et de collectivités territoriales.
*
La Commission adopte l’article 40 sans modification.
*
* *
La Commission examine l’amendement AS278 de Mme Bernadette Laclais.
Mme Bernadette Laclais. Il s’agit de faciliter le recrutement et le fonctionnement des groupements d’employeurs, en clarifiant les questions relatives à leur fiscalité.
M. le rapporteur. Défavorable. L’interprétation française de la directive TVA, dont l’article 261 du code général des impôts constitue la transposition, a été récemment remise en cause par la Commission européenne, et notamment la tolérance qui permettrait, sur le fondement de cet article, d’exonérer de TVA les mises à disposition de personnel facturées à prix coûtant et effectuées auprès de personnes morales de droit public ou d’organismes sans but lucratif.
La Commission rejette l’amendement.
Elle examine ensuite l’amendement AS289 de Mme Bernadette Laclais.
Mme Bernadette Laclais. C’est le même sujet. Ce n’est sans doute pas dans les clous de la directive européenne.
M. le rapporteur. Sur ce point, ce n’est pas la directive européenne que j’invoquerai, mais vous proposez de supprimer toute référence à une convention collective et je ne crois pas que l’on puisse laisser le choix à l’employeur de ne relever d’aucune convention collective car cela favoriserait le dumping social. Avis défavorable.
Mme Bernadette Laclais. Je comprends votre argument, monsieur le rapporteur, et suis disposée à trouver une autre solution d’ici à la séance publique, mais imposer ne fonctionne pas. Ne pourrait-on pas essayer de trouver une formulation médiane, monsieur le rapporteur ? Dans ce cas, je retirerais mon amendement, mon objectif étant de stimuler les groupements d’employeurs, qui représentent une solution pour les pluriactifs et les saisonniers.
M. Gérard Cherpion. Le groupement d’employeurs constitué peut choisir sa convention collective. Les personnes travaillant dans l’entreprise bénéficient des avantages de la convention collective des autres salariés, tout en restant rattachées à la convention de base, qui est celle du groupement d’employeurs.
Mme Bernadette Laclais. La rédaction de mon amendement élimine peut-être l’option négociée, mais il faut trouver un moyen de doper les groupements d’employeurs. Or le choix d’une convention collective bloque le dispositif et réduit son attractivité.
M. le rapporteur. Nous retravaillerons ensemble cet amendement.
L’amendement est retiré.
*
* *
Article 40 bis
(Art. L. 1253-19 du code du travail)
Constitution des groupements d’employeurs « mixtes » sous la forme de sociétés coopératives
À l’initiative de Mme Bernadette Laclais, la Commission a adopté un amendement portant article additionnel (AS 268), sous-amendé par le rapporteur, permettant d’ouvrir les groupements d’employeurs composés de personnes de droit privé et de collectivités territoriales ou de leurs établissements publics à la forme coopérative.
En effet, alors que les groupements d’employeurs peuvent être constitués sous la forme associative ou coopérative, les groupements d’employeurs « mixtes » ne peuvent actuellement l’être que sous la forme associative.
En mettant ainsi en cohérence les différentes dispositions en matière de groupements d’employeurs, cet article devrait favoriser le recours à ce dispositif.
*
* *
La Commission examine l’amendement AS268 de Mme Bernadette Laclais, qui fait l’objet d’un sous-amendement AS1054 du rapporteur.
Mme Bernadette Laclais. Cet amendement propose de mettre en cohérence les articles L. 253-2 et L. 1253-18 du code du travail, les groupements d’employeurs mixtes pouvant être constitués sous trois formes juridiques. La nouvelle rédaction simplifie le code en supprimant les exceptions. L’adoption de cet amendement favoriserait le développement des groupements d’employeurs. Monsieur le rapporteur, votre sous-amendement ne semble pas amoindrir la portée de ma proposition.
M. le rapporteur. Le sous-amendement a pour objectif d’autoriser la création de groupements d’employeurs mixtes sous toutes les formes, associatives comme coopératives, qui sont mentionnées à l’article L. 1253-2 du code du travail. Sous réserve de l’adoption du sous-amendement, j’émets un avis favorable à l’adoption de l’amendement.
M. Gérard Cherpion. On conserve donc le droit local.
La Commission adopte le sous-amendement.
Puis elle adopte l’amendement sous-amendé.
*
* *
Article 41
(Art. L. 1233-24-2, L. 1233-57-19, L. 1233-61 et L. 1233-62 du code du travail)
Transfert d’entités économiques
Cet article introduit, pour les entreprises de plus de 1 000 salariés, une dérogation au principe du maintien des contrats de travail en cas de transfert d’entités économiques lorsque le plan de sauvegarde de l’emploi prévoit un tel transfert. Il vise ainsi à faciliter les licenciements économiques lorsqu’un projet de réduction des effectifs se combine avec la cession d’un ou de plusieurs établissements distincts.
1. Le droit existant : l’interdiction des licenciements économiques motivés par un transfert d’entreprises
Aux termes de l’article L. 1224-1 du code du travail, « lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise ».
Cet article pose le principe du maintien des contrats de travail lorsqu’une entreprise est transférée, c’est-à-dire lorsque sa propriété passe d’une personne juridique à une autre. Les contrats de travail doivent être obligatoirement transférés dans le chef de la nouvelle entité juridique, malgré le changement d’employeur.
Cette disposition est ancienne puisque l’article L. 1224-1 précité est issu de la loi du 19 juillet 1928, sa rédaction n’ayant pas été modifiée depuis. Dès cette époque, le souci du législateur était de faire en sorte que les contrats de travail ne soient pas affectés par les changements d’employeurs dus à toutes sortes d’opérations de vente, fusion, mise en société, etc. Les contrats de travail sont donc juridiquement regardés comme partie intégrante de l’entreprise cédée, considérée comme une entité économique plus que comme une simple personne juridique. Le transfert de l’entreprise inclut donc tant la propriété des actifs physiques et immatériels (ce qui constitue le « facteur capital » de l’entreprise) que les emplois (son « facteur travail »).
Toutefois, au-delà de cette logique juridique, ce principe se traduit par une meilleure protection des droits des salariés, reprise au niveau européen par la directive du 12 mars 2001 relative au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d’entreprises, d’établissements ou de parties d’entreprises ou d’établissements (75). Son article 4 dispose que ce transfert « ne constitue pas en lui-même un motif de licenciement pour le cédant ou le cessionnaire ».
Si le transfert ne peut constituer en lui-même un motif de licenciement, l’article 4 de la directive du 12 mars précitée précise néanmoins que « cette disposition ne fait pas obstacle à des licenciements pouvant intervenir pour des raisons économiques, techniques ou d’organisation impliquant des changements sur le plan de l’emploi ».
En d’autres termes, les licenciements prononcés avant le transfert de l’entreprise cédante ne peuvent être autorisés qu’à la condition qu’ils ne soient pas exclusivement motivés par le transfert lui-même.
Il existe trois exceptions au principe du maintien des contrats de travail en cas de transfert d’entreprise :
– l’article L. 1224-1 précité ne s’applique pas lorsque l’entreprise est reprise par le personnel licencié. Les salariés qui investissent leurs indemnités de rupture dans la reprise de l’entreprise ne sont ainsi pas tenus de les restituer au motif que leur licenciement serait jugé privé d’effet dès lors qu’ils travaillent pour l’entreprise repreneuse ;
– son application est également écartée lorsque le transfert ne concerne que les titres composant le capital de l’entreprise et que la prise de contrôle ou la prise de participation de l’entreprise par le repreneur ne s’accompagne pas du transfert de l’entité économique. Ici, la distinction entre détention du capital social et détention de l’entreprise prend toute sa portée ;
– enfin, il peut être dérogé à l’article L. 1224-1 lorsque l’entreprise transférée fait l’objet d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire.
Le risque d’un contournement des dispositions garantissant le maintien des contrats de travail, par recherche d’optimisation du coût du transfert pour le cessionnaire, a conduit la jurisprudence à une approche restrictive des modalités d’application du régime du transfert des contrats de travail. Pour la Cour de justice de l’Union européenne comme pour la Cour de cassation, les licenciements économiques prononcés avant le transfert de l’entreprise sont ainsi jugés dépourvus d’effets.
Ainsi, la Cour de justice considère, dans une décision du 15 juin 1988, que le licenciement prononcé par l’employeur sortant, en méconnaissance de l’article 4 de la directive du 12 mars 2001 précitée, est sans influence sur les salariés qui doivent « être considérés comme étant toujours employés de l’entreprise à la date du transfert » (76). Elle précise également, que le contrat de travail doit être « considéré comme existant par le cessionnaire même si le travailleur licencié n’a pas été repris » (77).
La Cour de cassation avait quant à elle d’abord admis que des licenciements pour motif économique soient prononcés à l’occasion d’un transfert, y compris lorsqu’ils sont effectués par le cédant en vue d’une réorganisation décidée par le cessionnaire (78). Cependant, compte tenu du risque de voir priver d’effet, pour des raisons tenant aux seules exigences du repreneur, des dispositions légales dont la finalité est de garantir la poursuite des contrats en cours, cette position a été progressivement abandonnée. S’inspirant de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, la Cour de cassation a d’abord retenu que des licenciements fondés sur les seules exigences du repreneur étaient privés d’effet (79), puis de façon plus rigoureuse, que des licenciements économiques prononcés à l’occasion d’un transfert ne pouvaient produire d’effet (80).
Selon l’exposé des motifs du présent article, cette jurisprudence peut décourager les repreneurs potentiels d’entreprises en difficulté, notamment lorsque leur offre de reprise porte sur une entité économique autonome mais dont il ne leur est pas possible de conserver la totalité des emplois. Les licenciements étant à la charge du repreneur, la recherche de ce dernier, pourtant obligatoire dans les entreprises de plus de 1 000 salariés envisageant la fermeture d’un établissement ayant pour conséquence un projet de licenciement collectif (81), rend plus délicates les négociations de reprise.
De ce fait, l’étude d’impact annexée au présent projet de loi souligne qu’« alors même que l’article L. 1224-1 du code du travail a comme objectif la préservation des salariés, la mise en œuvre systématique et généralisée de ses dispositions joue parfois contre la possibilité de préserver une partie des emplois ». En effet, en l’absence d’offre de reprise – qui ne peut donc pas porter sur une partie seulement du personnel –, l’employeur qui ne parvient pas à céder son entreprise doit mettre fin à la totalité des contrats de travail.
Le présent article entend revenir sur la position du juge afin que, sous certaines conditions (notamment la mise en place d’un PSE), des réductions d’effectifs pour motif économique puissent avoir lieu avant un transfert d’entités économiques, sans que le repreneur ait à en assumer la charge.
● Le 1° du I introduit ainsi une exception au principe, figurant à l’article L. 1224-1 du code du travail, selon lequel le transfert d’une entité économique autonome entraîne le maintien des contrats de travail.
Cette exception est insérée à l’article L. 1233-61 du code du travail relatif au plan de sauvegarde de l’emploi.
Cet article dispose que « dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, l’employeur établit et met en œuvre un plan de sauvegarde de l’emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre ». Il précise également que le PSE comprend un plan de reclassement visant à faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité.
Le 1° complète l’article L. 1233-61 par un nouvel alinéa prévoyant que lorsque ce plan comporte, en vue d’éviter la fermeture d’un ou plusieurs établissements, le transfert d’une ou plusieurs entités économiques nécessaire à la sauvegarde d’une partie des emplois, le principe du maintien des contrats de travail ne s’applique que pour les emplois n’ayant pas déjà été supprimés, à la suite des licenciements, à la date d’effet du transfert.
Ce régime nouveau ne concerne ainsi que les entreprises tenues d’établir ou de négocier un plan de sauvegarde de l’emploi : les licenciements économiques qui ne relèvent pas du champ d’application de l’article L. 1233-61 ne sont pas concernés et restent donc soumis à l’interprétation actuelle de l’article L. 1224-1. Il faut en outre que ce plan comporte le transfert d’une ou de plusieurs entités économiques, et que ce transfert permette d’éviter la fermeture d’un ou de plusieurs établissements.
Par ailleurs, cette nouvelle disposition ne concerne que « les entreprises mentionnées à l’article L. 1233-71 du code du travail », c’est-à-dire celles soumises à l’obligation de proposer un congé de reclassement, à savoir les entreprises et les établissements d’au moins 1 000 salariés, les entreprises appartenant à des groupes d’au moins 1 000 salariés ou les entreprises ou groupes d’entreprises de dimension communautaire d’au moins 1 000 salariés. Il s’agit précisément des entreprises concernées par l’obligation de rechercher un repreneur en cas de projet de fermeture d’un établissement, mentionnée à l’article L. 1233-57-9 du code du travail.
Afin de s’assurer que le transfert ait effectivement bien pour objet de préserver les emplois qui demeurent dans l’entreprise, il pourrait être précisé que seules pourront déroger au principe du maintien des contrats de travail en cas de transfert d’entités économiques, les entreprises faisant l’objet d’une offre de reprise qu’elles envisagent d’accepter, notamment au regard de la capacité de l’auteur de l’offre à garantir la pérennité de l’activité et de l’emploi de l’établissement.
● Le 2° du I complète l’article L. 1233-24-2 du code du travail relatif à l’accord collectif pouvant être conclu afin de déterminer le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi.
Il précise que les modalités d’information et de consultation du comité d’entreprise, prévues par l’accord collectif, peuvent être aménagées en cas de projet de transfert d’une ou plusieurs entités économiques, dont il rappelle qu’il doit être destiné à limiter le nombre des suppressions d’emplois.
En effet, le projet de transfert rend nécessaire la consultation du comité d’entreprise, conformément à l’article L. 2323-33 du code du travail.
● De manière complémentaire, le 3° du I complète l’article L. 1233-57-9 du code du travail relatif à la consultation du comité d’entreprise sur toute offre de reprise à laquelle l’employeur souhaite donner suite. Il prévoit que l’accord collectif prévoyant un aménagement des modalités d’information et de consultation du comité d’entreprise en cas de projet de transfert fixe le délai dans lequel l’employeur consulte le comité d’entreprise sur l’offre de reprise.
● Le 4° du I complète la liste de l’article L. 1233-62 relative au contenu du plan de sauvegarde de l’emploi en ajoutant « des actions favorisant la reprise de tout ou partie des activités en vue d’éviter la fermeture d’un ou de plusieurs établissements ». Il rappelle ainsi que les transferts d’un ou plusieurs établissements peuvent constituer l’un des moyens mis en œuvre afin d’éviter les licenciements ou d’en limiter le nombre.
Enfin, le II précise que les dispositions du présent article s’appliquent aux licenciements économiques engagés postérieurement à la date de promulgation de la loi.
*
Outre trois amendements rédactionnels, la Commission a adopté un amendement du rapporteur (AS 965) afin de préciser que seules pourront déroger au principe du maintien des contrats de travail en cas de transfert d’entités économiques, les entreprises qui font l’objet d’une offre de reprise qu’elles envisagent d’accepter, notamment au regard de la capacité de l’auteur de l’offre à garantir la pérennité de l’activité et de l’emploi.
*
La Commission examine l’amendement AS392 de M. Christophe Cavard.
Mme Véronique Massonneau. L’article 41 du projet de loi modifie à titre principal l’article L. 1233-61 du code du travail, qui oblige l’employeur à établir un plan de sauvegarde de l’emploi pour les grands licenciements pour motif économique.
Il s’agit d’envisager la situation dans laquelle le plan de sauvegarde de l’emploi prévoit la cession d’un ou de plusieurs établissements, afin de remplir l’obligation de recherche d’un repreneur posée par la loi du 29 mars 2014 visant à reconquérir l’économie réelle, dite loi Florange. Pour favoriser l’émergence d’offres de reprise, il est fait une entorse au principe de maintien des contrats de travail en cas de transfert d’une entité économique autonome, en permettant à l’employeur de supprimer certains emplois avant la reprise.
Toutefois, dans sa formulation actuelle, ce texte, qui ne vise que l’article L. 1233-71 du code du travail, paraît peu compatible avec la directive européenne du 12 mars 2001 car il permet à toute entreprise d’au moins 1 000 salariés – ou appartenant à un groupe de cette dimension – engagée dans une procédure de licenciements pour motif économique, de procéder au licenciement d’une partie des salariés qui auraient dû être transférés. Cela, en outre, sans faire référence à une quelconque offre effective de reprise à laquelle l’employeur envisagerait de donner une réponse positive, conformément à la procédure décrite à l’article L. 1233-57-19 du code du travail.
Par ailleurs, la rédaction du texte semble exclure les salariés qui auraient dû être transférés du bénéfice des mesures de reclassement prévues au plan de sauvegarde de l’emploi, créant ainsi entre les salariés visés par les suppressions d’emploi une inégalité de traitement difficilement justifiable.
M. le rapporteur. J’approuve le premier élément de votre amendement, qui rejoint d’ailleurs mon amendement AS965 à l’article 41. Il importe en effet de garantir que les licenciements effectués avant le transfert permettent bien d’éviter un plus grand nombre de suppressions d’emploi.
En revanche, je ne suis pas favorable au deuxième point de votre amendement, qui vise à ce que la priorité de réembauche s’applique au cédant – ce que le droit en vigueur affirme déjà –, mais également au repreneur. Cela créerait une contrainte pour le repreneur, qui ne possède aucun lien juridique avec les salariés licenciés. Soit vous retirez votre amendement, sachant que sa première partie est couverte par le mien, soit vous le maintenez, et j’émettrai un avis défavorable à son adoption.
M. Gérard Cherpion. Dans un certain nombre de cas, l’article L. 1224-1 peut s’appliquer et obliger le repreneur à conserver les contrats de travail. Il est donc possible qu’un lien existe.
Mme Véronique Massonneau. Je retire mon amendement.
L’amendement est retiré.
La Commission est saisie de l’amendement AS965 du rapporteur.
M. le rapporteur. Je viens d’évoquer cet amendement, qui vise à garantir que le transfert d’entités économiques ait effectivement pour objet de permettre de sauvegarder une partie des emplois.
Il prévoit ainsi que seules pourront déroger au principe du maintien des contrats de travail en cas de transfert d’entités économiques, les entreprises de plus de 1 000 salariés qui font l’objet d’une offre de reprise qu’elles envisagent d’accepter, notamment au regard de la capacité de l’auteur de l’offre à garantir la pérennité de l’activité et de l’emploi de l’établissement.
Cette précision permet en outre de s’assurer de la conformité de l’article 41 du projet de loi avec la directive du 12 mars 2001 relative au transfert.
La Commission adopte l’amendement.
Puis elle adopte successivement les amendements rédactionnels AS781, AS782 et AS783 du rapporteur.
La Commission aborde l’amendement AS393 de M. Christophe Cavard.
Mme Véronique Massonneau. Défendu.
M. le rapporteur. Avis défavorable.
La Commission rejette l’amendement.
Puis elle adopte l’article 41 modifié.
*
* *
La Commission examine l’amendement AS659 rectifié de M. Frédéric Barbier.
Mme Annie Le Houerou. Afin de relancer l’emploi et la reprise économique, il est important de sécuriser le parcours professionnel du salarié.
Ainsi, des ajustements peuvent s’opérer en transférant du personnel lorsque les services et les salariés ne sont pas liés ou ne dépendent pas directement de l’activité principale de la société et de son cœur de métiers, ou quand les difficultés structurelles ou financières provoquent des dysfonctionnements dans l’organisation du travail ou mettent en cause la pérennité de l’entreprise.
L’article L. 1224-1 du code du travail ne doit pas être généralisé et ne doit s’appliquer que lorsque des conditions précises l’encadrent.
M. le rapporteur. Cet amendement s’avère imprécis ; par exemple, comment peut-on évaluer que le repreneur possède ou non l’expérience requise ? Comment juge-t-on la crédibilité du repreneur ? Nous devons nous montrer vigilants face à des sources de contentieux futurs. Par ailleurs, le dernier critère me paraît contestable, car une entreprise financièrement saine peut choisir de transférer une partie de ses activités sans que cela soit préjudiciable aux salariés transférés. Enfin, prévoir que le comité d’établissement émet un avis conforme revient à lui conférer un droit de véto sur toute opération d’externalisation, et je ne suis pas certain de la constitutionnalité d’une telle mesure.
Madame Le Houerou, j’émets pour toutes ces raisons un avis défavorable à l’adoption de votre amendement, même si je comprends l’inquiétude qu’il traduit.
Mme Annie Le Houerou. Je retire mon amendement.
L’amendement est retiré.
Puis elle étudie l’amendement AS663 rectifié de M. Frédéric Barbier.
Mme Annie Le Houerou. Nous constatons que des services entiers de grands groupes industriels sont de plus en plus externalisés. Ainsi, les salariés sont transférés vers un partenaire extérieur de l’entreprise, subissant alors des changements qu’ils vivent douloureusement. Ils perdent non seulement leur statut, mais aussi leur appartenance à un groupe auquel ils sont attachés pour certains depuis des dizaines d’années.
Lors de ces opérations, les contrats de travail en cours sont transférés automatiquement à l’entreprise d’accueil. Les salariés qui n’acceptent pas leur transfert sont considérés comme démissionnaires, n’ayant ainsi pas d’autre choix que de quitter l’entreprise.
Pourtant, la jurisprudence européenne a consacré le droit d’opposition du salarié au transfert de son contrat de travail, au nom des droits fondamentaux du travailleur. Elle donne de fait au salarié la possibilité du choix de l’entreprise et établit le droit au refus.
En Allemagne, lorsqu’une partie de l’entreprise est transférée, par acte juridique, à un autre propriétaire, l’opposition d’un travailleur employé dans cette partie de l’entreprise fait obstacle au transfert de son contrat de travail au cessionnaire, et la relation de travail avec le cédant persiste.
Le présent amendement suit les recommandations de la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) en prévoyant que le salarié soit d’accord pour être externalisé.
M. le rapporteur. Madame Le Houerou, je comprends là encore vos intentions, mais je doute que votre amendement aboutisse à ce que vous souhaitez ; en effet, il revient sur le principe de l’article L. 1224-1 du code du travail, très protecteur des droits des salariés, qui prévoit le maintien des contrats de travail en cas de modification de la situation juridique de l’employeur. Je vous demande de retirer votre amendement ; à défaut, j’émettrais un avis défavorable à son adoption.
Mme Annie Le Houerou. Je le retire.
L’amendement est retiré.
*
* *
Article 41 bis
(Art. L. 1233-71 du code du travail)
Rectification d’une erreur matérielle
La commission a adopté un amendement AS 962 portant article additionnel afin de corriger une erreur matérielle, intervenue lors de la codification de 2008.
La rectification porte sur l’article L. 1233-71 du code du travail relatif à la définition des entreprises soumises à l’obligation de proposer un congé de reclassement à chaque salarié dont elle envisage de prononcer le licenciement pour motif économique.
Sont notamment concernées par cette obligation les entreprises ou les groupes d’entreprises de dimension communautaire, dès lors qu’elles emploient au total au moins mille salariés.
La rectification apportée par le présent article permet de viser les articles définissant ces entreprises ou groupes d’entreprises.
Ainsi, on entend par entreprise de dimension communautaire « l’entreprise ou l’organisme qui emploie au moins mille salariés dans les États membres de la Communauté européenne ou de l’Espace économique européen et qui comporte au moins un établissement employant au moins cent cinquante salariés dans au moins deux de ces États » (article L. 2341-1 du code du travail).
Les groupes d’entreprises de dimension communautaire sont quant à eux définis comme les groupes « satisfaisant aux conditions d’effectifs et d’activité mentionnées à l’article L. 2341-1 et comportant au moins une entreprise employant au moins cent cinquante salariés dans au moins deux des États mentionnés à ce même article » (article L. 2341-2 du même code).
La Commission adopte l’amendement rédactionnel AS962 du rapporteur.
*
* *
Article 42
(Art. L. 1233-85 et L. 1233-90-1 [nouveau] du code du travail)
Revitalisation des bassins d’emplois
Cet article vise à faciliter la mise en œuvre de l’obligation de revitalisation des bassins d’emploi. Le délai pour conclure une convention entre l’entreprise concernée et l’autorité administrative serait allongé de six à huit mois. Par ailleurs, la possibilité de conclure une convention-cadre nationale lorsque les licenciements concernent au moins trois départements serait reconnue par la loi.
L’obligation pour les entreprises qui procèdent à une fermeture totale ou partielle d’activités de contribuer à l’effort de revitalisation des sites est apparue avec la loi n° 2002-73 de modernisation sociale du 17 janvier 2002.
La loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale a précisé le champ et les modalités d’application de l’obligation de revitalisation, codifiée à l’article L. 1233-84 du code du travail.
Ainsi, lorsqu’elles procèdent à un licenciement collectif affectant, par son ampleur, l’équilibre du ou des bassins d’emploi dans lesquels elles sont implantées, les entreprises d’au moins 1 000 salariés – et, plus généralement, les entreprises soumises à l’obligation de proposer un congé de reclassement aux salariés licenciés – sont tenues, sauf lorsqu’elles font l’objet d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, de contribuer financièrement à la création d’activités et au développement des emplois et d’atténuer les effets du licenciement envisagé sur les autres entreprises dans le ou les bassins d’emploi.
En vertu de l’article D. 1233-38 du même code, c’est au représentant de l’État dans le département qu’il appartient de déterminer, dans un délai d’un mois à compter de la date de validation ou d’homologation du plan de sauvegarde de l’emploi, si le licenciement envisagé affectera l’équilibre du bassin d’emploi. Pour ce faire, il prend notamment en compte le nombre et les caractéristiques des emplois supprimés, le taux de chômage dans le bassin d’emploi, ses caractéristiques socio-économiques et l’impact potentiel du licenciement sur les autres entreprises. Le licenciement d’un même nombre de salariés ne sera donc pas considéré de la même manière suivant le bassin d’emploi dans lequel il intervient. Si le représentant de l’État considère que le licenciement affecte le bassin d’emploi, l’entreprise peut conclure une convention avec l’État ou procéder à la réactivation du bassin d’emploi par un accord collectif.
Prévue à l’article L. 1233-85 du même code, la convention de revitalisation doit être conclue dans un délai de six mois à compter de la notification du projet de licenciement pour motif économique d’au moins dix salariés à l’autorité administrative. Elle détermine la nature ainsi que les modalités de financement et de mise en œuvre des actions destinées à contribuer à la création d’activités et au développement des emplois et à atténuer les effets du licenciement envisagé sur les autres entreprises du bassin d’emploi. Il peut s’agir par exemple, en cas de fermeture du site, d’actions en faveur de la reprise par d’autres entreprises, d’actions de formation, etc.
Les mesures envisagées dans la convention doivent tenir compte des actions de même nature éventuellement prévues dans le cadre d’un accord de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ou dans le cadre du plan de sauvegarde de l’emploi établi par l’entreprise.
Le montant de la contribution de l’entreprise au financement de ces actions ne peut être inférieur à deux fois la valeur mensuelle du SMIC par emploi supprimé. Le préfet peut toutefois fixer un montant inférieur lorsque l’entreprise est dans l’incapacité d’en assurer la charge financière. En l’absence de convention, les entreprises concernées doivent verser au Trésor public une contribution égale à quatre fois le SMIC mensuel par emploi supprimé (article L. 1233-86 du même code).
La Cour des comptes, dans un rapport consacré au bilan des conventions de revitalisation paru en décembre 2015, note que « l’analyse des délais de négociation des conventions […] met en évidence la difficulté des parties intéressées à parvenir à la conclusion de conventions dans les six mois suivants la notification du PSE à l’autorité administrative, ainsi que le prévoit le code du travail » (82). Ainsi, seule une entreprise, sur les treize retenues par l’enquête de la Cour, a pu conclure la convention en moins de six mois, la durée moyenne de négociation d’une convention atteignant près de 15 mois.
Des divergences de points de vue entre l’État et l’entreprise peuvent être à l’origine de ces retards. La Cour des comptes évoque en particulier des difficultés à définir le taux d’effort de l’entreprise, les types d’actions à engager et les secteurs d’activité éligibles, mais également l’existence de désaccords quant à la délimitation de la zone d’intervention. Par ailleurs, certains éléments déterminants pour finaliser la convention sont connus tardivement, notamment la détermination du nombre de salariés à prendre en compte pour le calcul de la contribution financière, par exemple lorsqu’un plan de départs volontaires s’étale dans le temps.
Afin de laisser davantage de temps à la négociation, le a) du 1° modifie l’article L. 1233-85 du code du travail en allongeant de six à huit mois le délai de conclusion de la convention de revitalisation entre l’entreprise et l’autorité administrative. Comme c’est le cas dans le droit en vigueur, ce délai continuerait de courir à compter de la notification à l’autorité administrative du projet de licenciement collectif d’au moins dix salariés dans une même période de trente jours, prévue à l’article L. 1233-46 du même code.
Le a) du 1° ajoute une référence à l’article L. 1233-19, relatif à la notification du projet de licenciement de moins de dix salariés dans une même période de trente jours. Cette référence ne semble pas opportune : en effet, seules les entreprises procédant à un licenciement collectif affectant, par son ampleur, l’équilibre du ou des bassins d’emploi dans lesquels elles sont implantées, doivent conclure une convention de revitalisation. Un licenciement de moins de dix salariés ne correspond pas a priori à cette situation.
b. Mieux valoriser les démarches volontaires de l’entreprise en faveur de la revitalisation du bassin d’emplois
L’article L. 1233-85 du code du travail dispose que la convention tient compte des actions contribuant à la création d’activités et au développement des emplois déjà engagées par l’entreprise dans le cadre d’un accord collectif relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences d’une part, et dans le cadre de son plan de sauvegarde de l’emploi d’autre part.
Le b) du 1° propose de compléter l’article L. 1233-85 afin de prendre également en compte les actions en faveur de l’emploi engagées par l’entreprise dans le cadre d’une démarche volontaire, avant la signature de la convention. Il peut s’agir par exemple d’actions menées au titre de la responsabilité sociale et territoriale de l’entreprise, qui peuvent contribuer à la création d’emplois sur le territoire.
La démarche volontaire devra faire l’objet d’un document-cadre conclu entre l’État et l’entreprise, dont les modalités seront définies par décret.
Une circulaire du 12 juillet 2012 relative à la mise en œuvre de l’obligation de revitalisation (83) précise qu’une convention-cadre nationale peut, le cas échéant, être signée entre le représentant de l’entreprise et le délégué général à l’emploi et à la formation professionnelle.
La convention de revitalisation peut, en effet, être négociée au niveau national lorsque les licenciements économiques affectent un nombre importants de territoires, de sorte que la mise en œuvre de l’obligation de revitalisation de l’entreprise conduirait à la négociation d’une multitude de conventions locales de revitalisation.
La circulaire précise que la convention-cadre fixe l’économie globale de la revitalisation par l’entreprise. Elle définit en particulier le nombre d’emplois supprimés retenus au titre de la revitalisation de l’entreprise, ainsi que l’objectif de création d’emploi. Elle détermine également les territoires d’intervention – sans toutefois en fixer le périmètre précis –, le niveau de l’engagement financier de l’entreprise et les grandes lignes du plan d’actions proposé par celle-ci.
Le 2° créé un article L. 1233-90-1 dans le code du travail reconnaissant l’existence de la convention-cadre nationale de revitalisation. Cet article est composé de quatre alinéas :
– Le premier alinéa prévoit qu’une convention-cadre nationale de revitalisation peut être conclue entre le ministre chargé de l’emploi et l’entreprise, à l’initiative de l’une ou l’autre des parties, lorsque les suppressions d’emplois concernent au moins trois départements.
– Le deuxième alinéa précise que la contribution financière versée par l’entreprise est déterminée en tenant compte du nombre total des emplois supprimés.
– Dans un souci de cohérence avec l’allongement du délai de conclusion des conventions prévu au a) du 1° du présent article, le troisième alinéa prévoit que la convention-cadre nationale est signée dans un délai de huit mois à compter de la notification du projet de licenciement pour motif économique d’au moins dix salariés à l’autorité administrative.
– Le quatrième alinéa prévoit que la convention nationale donne lieu, dans les quatre mois suivant sa signature, à une ou plusieurs conventions locales conclues entre le représentant de l’État et l’entreprise. Ce délai de quatre mois correspond à celui indiqué dans la circulaire précitée. Il est en outre précisé que les conventions locales doivent s’inscrire en cohérence avec le contenu de la convention-cadre nationale.
*
La Commission a adopté un amendement AS 394, présenté par M. Christophe Cavard, supprimant l’extension du délai de six à huit mois laissé à l’entreprise et à l’autorité administrative pour conclure la convention de revitalisation.
Elle a par ailleurs adopté un amendement AS 960 du rapporteur supprimant la référence, ajoutée par l’article 42, aux entreprises procédant au licenciement de moins de dix salariés. Cette mention était inutile dans la mesure où l’obligation de conclure une convention de revitalisation ne concerne que les entreprises qui « procèdent à un licenciement collectif affectant, par son ampleur, l’équilibre du ou des bassins d’emplois dans lesquels elles sont implantées » (article L. 1233-84 du code du travail). La Commission a également adopté deux amendements rédactionnels.
*
La Commission est saisie de l’amendement AS394 de M. Christophe Cavard.
Mme Véronique Massonneau. Cet amendement a pour objet de revenir à l’état initial de la loi en matière d’actions de revitalisation de bassins d’emploi. Les entreprises de plus 1 000 salariés procédant à des licenciements peuvent ainsi conduire des actions pour atténuer les effets de ces licenciements sur les autres entreprises dans le ou les bassins d’emploi. La loi actuelle prévoit un délai de six mois pour déterminer les modalités de financement et de mise en œuvre des actions. L’article 42 du projet de loi propose d’étendre ce délai à huit mois mais nous préférons en rester à la durée de six mois.
M. le rapporteur. Avis favorable.
La Commission adopte l’amendement.
Puis elle en vient à l’amendement AS960 du rapporteur.
M. le rapporteur. Cet amendement a pour objet de supprimer la référence aux licenciements de moins de dix salariés. L’obligation de conclure une convention de revitalisation ne concerne que les entreprises procédant à un licenciement collectif affectant par son ampleur l’équilibre du ou des bassins d’emploi dans lesquels elles sont implantées. Les entreprises licenciant moins de dix salariés ne déséquilibrent pas un ou des bassins d’emploi.
La Commission adopte l’amendement.
Puis elle adopte l’amendement rédactionnel AS1044 du rapporteur.
La Commission aborde l’amendement AS400 de M. Christophe Cavard.
Mme Véronique Massonneau. Lorsque les suppressions d’emploi couvrent au moins trois départements, la convention nationale de revitalisation doit être obligatoire et ne doit pas dépendre du souhait des parties. Si nous n’adoptions pas cette proposition, nous accepterions de vider les conventions de revitalisation de leur sens.
M. le rapporteur. Avis défavorable.
La Commission rejette l’amendement.
Puis elle adopte l’amendement rédactionnel AS961 du rapporteur.
La Commission adopte l’article 42 modifié.
*
* *
Article 43
(Art. 28 de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion)
Accès aux formations du CNFTP pour les salariés en contrat d’accompagnement dans l’emploi dans les collectivités territoriales
Cet article tend à créer une cotisation obligatoire assise sur les rémunérations versées aux bénéficiaires de contrats d’accompagnement dans l’emploi employés dans les collectivités territoriales ou leurs établissements publics, afin de leur permettre d’accéder aux formations délivrées par le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT).
Les règles relatives à la formation des personnels dans la fonction publique territoriale sont fixées par la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale. L’article 8 de cette loi dispose que les formations des agents des collectivités territoriales sont assurées par le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT).
Le financement de ces formations est prévu par l’article 12-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant diverses dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Les ressources du CNFPT sont notamment constituées par une cotisation obligatoire, versée par les collectivités territoriales et leurs établissements publics. Cette cotisation s’élevait au maximum à 1 % de la masse des rémunérations versées aux agents des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. Le taux de la cotisation a été abaissé par la loi de finances pour 2016 (84). Il ne peut désormais excéder 0,9 %.
À moins qu’une disposition législative ne le prévoie expressément, les différents emplois aidés, qui sont des contrats de droit privé, ne sont pas soumis à la cotisation obligatoire au CNFPT. La question du financement de la formation des personnes en contrat aidé est donc posée à chaque nouveau type de contrat.
a. Le financement insuffisant des formations des salariés en contrat aidé dans les collectivités territoriales
Afin de faciliter le financement des formations destinées aux salariés bénéficiant d’un contrat d’accompagnement dans l’emploi ou d’un contrat d’avenir au sein des collectivités territoriales et de leurs groupements, l’article 28 de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion prévoyait que les actions de formation destinées à ces salariés pouvaient être financées au moyen de la cotisation obligatoire prévue à l’article 12-2 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, assise sur la masse des rémunérations versées aux agents des collectivités territoriales et leurs établissements publics.
L’article 28 de la loi du 1er décembre 2008 précitée devait ainsi permettre le financement des formations des salariés en contrats aidés recrutés par des collectivités territoriales grâce à une cotisation réservée jusqu’alors au financement des formations des agents titulaires et des agents contractuels de droit public.
Toutefois, en dépit de cette disposition nouvelle, les formations du CNFPT destinées aux agents des collectivités territoriales sont restées très peu ouvertes aux salariés en contrat aidé dans ces mêmes collectivités, au motif – selon l’étude d’impact annexée au présent projet de loi – que ces emplois n’entraient pas dans l’assiette de la cotisation versée au CNFPT.
Les collectivités territoriales et leurs établissements publics employant des salariés en contrat aidé ont pourtant, en contrepartie de l’aide financière reçue pour ces embauches, l’obligation de faire bénéficier ces salariés d’actions de formation. Ainsi, aux termes de l’article L. 5134-114 du code du travail, « l’aide relative à l’emploi d’avenir est attribuée au vu des engagements de l’employeur […]. Ces engagements portent obligatoirement sur les actions de formation ». Concernant les contrats d’accompagnement dans l’emploi, l’article L. 5134-22 du même code dispose que « la demande d’aide à l’insertion professionnelle indique les modalités d’orientation et d’accompagnement professionnel de la personne sans emploi et prévoit des actions de formation professionnelle et de validation des acquis de l’expérience nécessaires à la réalisation de son projet professionnel ».
Aussi, compte tenu de ces obligations de formation, il est justifié d’assujettir les rémunérations versées aux bénéficiaires d’emplois aidés à une cotisation destinée à financer leur formation. Cette cotisation a été mise en place pour les contrats d’avenir en 2012.
L’article 2 de la loi n° 2012-1189 du 26 octobre 2012 portant création des emplois d’avenir a complété l’article 28 de la loi du 1er décembre 2008 précitée afin de rendre effectif l’accès des jeunes bénéficiaires d’emploi d’avenir employés par les collectivités territoriales ou leurs établissements publics aux formations délivrées par le CNFPT.
Cet article précise tout d’abord que le financement d’actions de formation destinées aux bénéficiaires de contrats d’avenir repose, totalement ou en partie, sur la cotisation assise sur la masse des rémunérations versées aux agents des collectivités territoriales et leurs établissements publics et destinée à financer les formations assurées par le CNFPT. Il ne s’agissait jusqu’alors que d’une simple possibilité.
L’article 2 de la loi du 26 octobre 2012 précitée a par ailleurs créé une ressource complémentaire destinée à financer la formation des bénéficiaires d’emplois d’avenir, sous la forme d’une cotisation obligatoire assise sur les rémunérations de ces bénéficiaires, cotisation dont le taux a été fixé par décret à 0,5 %.
En outre, au vu de l’importance de l’enjeu qu’il représente et des adaptations rendues nécessaires par la montée en puissance du dispositif, cet article a également prévu que la mise en œuvre de l’accès à la formation des jeunes en emplois d’avenir fasse l’objet d’une convention d’objectifs et de moyens annuelle conclue entre l’État et le CNFPT.
Ce dispositif a contribué à développer la formation des jeunes bénéficiant d’un contrat d’avenir au sein des collectivités territoriales et de leurs établissements.
Toutefois, un vide juridique demeure pour les salariés embauchés en contrat d’accompagnement dans l’emploi, qui ne bénéficient pas d’un dispositif similaire. Un rapport de l’Inspection générale de l’administration de juillet 2014 sur la formation des agents territoriaux souligne à cet égard « l’incohérence avec l’absence de financement prévu pour les contrats uniques d’insertion » (85).
Afin de développer la formation des bénéficiaires de contrats d’accompagnement dans l’emploi dans les collectivités territoriales ou leurs établissements publics, le présent article propose d’introduire une cotisation assise sur les rémunérations versées aux bénéficiaires de ces contrats d’accompagnement dans l’emploi, identique à celle mise en place par la loi du 26 octobre 2012 pour les contrats d’avenir.
Le présent article complète ainsi le V de l’article 28 de la loi du 1er décembre 2008 précitée en étendant aux contrats d’accompagnement dans l’emploi le dispositif de financement de la formation des jeunes bénéficiant d’un emploi d’avenir :
– Il précise tout d’abord que le financement d’actions de formation destinées aux bénéficiaires de contrats d’accompagnement dans l’emploi dans les collectivités territoriales ou leurs établissements publics, repose, totalement ou en partie, sur la cotisation assise sur la masse des rémunérations versées aux agents des collectivités territoriales et leurs établissements publics.
– Il crée une ressource complémentaire destinée à financer la formation des bénéficiaires de contrats d’accompagnement dans l’emploi dans les collectivités territoriales ou leurs établissements publics. Cette ressource est constituée par une cotisation obligatoire assise sur les rémunérations de ces bénéficiaires. Le taux de cette contribution doit être fixé par décret.
– Enfin, il est prévu que la convention annuelle d’objectifs et de moyens, conclue entre l’État et le CNFPT afin de définir les modalités de mise en œuvre des actions de formation engagées en faveur des bénéficiaires de contrats d’avenir, définisse également les modalités de mise en œuvre des actions de formation engagées en faveur des bénéficiaires de contrats d’accompagnement dans l’emploi.
Ces dispositions s’appliquent à compter de la promulgation de la présente loi.
En permettant d’améliorer l’accès à la formation des salariés bénéficiant d’un contrat d’accompagnement dans l’emploi au sein des collectivités territoriales et de leurs établissements, ce dispositif contribuera à une insertion durable de ces salariés dans l’emploi à l’issue de leur contrat.
La commission a adopté cet article sans modification.
La Commission adopte l’article 43 sans modification.
*
* *
La Commission examine l’amendement AS672 de M. Jean-Patrick Gille.
Mme Annie Le Houerou. Cet amendement propose de confier le financement de l’allocation d’assurance à un fonds alimenté par une somme forfaitaire versée par les employeurs à la clôture de tout contrat de travail.
M. le rapporteur. Vous souhaitez lutter contre la multiplication des contrats à durée déterminée (CDD), mais vous prévoyez que l’on se fonde sur la « clôture de tout contrat de travail ». En outre, il convient de renvoyer cette question à la négociation collective. Madame Le Houerou, je vous demande donc de retirer votre amendement.
Mme Annie Le Houerou. Je le retire.
L’amendement est retiré.
*
* *
TITRE V
MODERNISER LA MÉDECINE DU TRAVAIL
Article 44
(Art. L. 1225-11, L. 1225-15, L. 1226-2, L. 1226-2-1 [nouveau], L. 1226-8, L. 1226-10, L. 1226-12, L. 1226-15, L. 1226-20, L. 1226-21, L. 3122-45, L. 4622-3, L. 4624-1 à L. 4624-10, L. , L. 4625-1-1 [nouveau] du code du travail et article L. 717-2 du code rural et de la pêche maritime)
Réforme de la médecine du travail
Cet article vise à poursuivre la réforme de la santé au travail initiée par la loi du 17 août 2015 (86).
Il entend modifier le suivi individuel de l’état de santé des salariés en recentrant la mission du médecin du travail sur les salariés exposés à des risques particuliers. Il remplace à cet effet la visite médicale d’aptitude systématique à l’embauche par une visite d’information et d’orientation réalisée après l’embauche. Il apporte en outre des précisions sur le dialogue entre le salarié et le médecin du travail et modifie les voies de recours contre les décisions du médecin du travail.
Le texte rapproche les régimes juridiques de l’inaptitude, qu’elle soit d’origine professionnelle ou non, et précise, notamment, les conditions dans lesquelles la rupture du travail peut être prononcée.
Enfin, il s’attache à rénover les dispositifs propres à certaines catégories de salariés, qu’il s’agisse des femmes en état de grossesse ou ayant accouché, des travailleurs intérimaires ou des salariés en contrat à durée déterminée.
Le I vise à modifier le titre II du livre II de la première partie du code du travail.
Le 1° emporte des modifications sur le régime applicable aux salariées en état de grossesse médicalement constaté ou ayant accouché et qui travaillent de nuit.
La salariée enceinte ou ayant accouché qui travaille de nuit doit être affectée à un poste de jour sur sa demande ou à l’initiative du médecin du travail. Faite sur la demande de la salariée, la mutation sur un poste de jour est limitée à la durée de la grossesse et du congé légal postnatal.
Lorsque le médecin du travail en est à l’initiative, cette affectation vaut pour la durée de la grossesse et peut être prolongée d’un mois maximum en cas d’incompatibilité du poste de nuit avec l’état de la salariée. Ce changement d’affectation ne doit entraîner aucune diminution de rémunération et, s’il a lieu dans un autre établissement, l’accord de l’intéressée est indispensable.
Si l’employeur ne peut proposer un autre emploi, il doit faire connaître, par écrit, à la salariée, ou au médecin du travail, les motifs qui s’opposent au reclassement. Le contrat de travail de l’intéressée est alors suspendu jusqu’à la date du début du congé légal de maternité avec une garantie de rémunération.
L’article L. 1225-11 dispose que ce régime ne fait pas obstacle à l’application des dispositions relatives à la protection contre la rupture du contrat de travail d’une salariée en état de grossesse médicalement constaté (article L. 1225-4), au congé de maternité (art. L. 1225-17), à l’interdiction d’emploi postnatal et prénatal (art. L. 1225-29), à l’inaptitude consécutive à une maladie ou un accident non professionnel constatée par le médecin du travail (art. L. 1226-2) et aux mesures individuelles pouvant être proposées par le médecin du travail (art. L 4624-1).
Le a) du 1° tend à compléter la liste des dispositifs applicables aux salariées concernées et précise que le régime ne fait plus obstacle à l’application de l’article L. 1226-10 relatif à l’inaptitude consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, dont la portée est sensiblement modifiée par le 7° du I.
L’article du projet de loi porte plusieurs ambitions, particulièrement celle visant à rapprocher les régimes juridiques de l’inaptitude, d’origine professionnelle ou non. Cette modification s’inscrit dans ce cadre.
Le b) du 1° opère une coordination nécessaire avec la modificaiton introduite au 6° du II.
Le 2° conduit à modifier le régime applicable aux salariées en état de grossesse médicalement constaté ou ayant accouché et qui sont exposées à un risque particulier à raison de leur poste de travail. L’employeur est ainsi tenu, en collaboration avec le médecin du travail, de proposer un aménagement de poste ou, dans les cas où le risque est le plus sérieux, une mutation provisoire de poste. Il procède aux mêmes ajustements que le 1°, maintenant le régime de protection applicable et précisant que le régime ne fait plus obstacle à l’application de l’article L. 1226-10 relatif à l’inaptitude consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle.
II. VERS UNE HARMONISATION DES RÈGLES RELATIVES À L’INAPTITUDE QU’ELLE SOIT D’ORIGINE PROFESSIONNELLE OU NON
Aujourd’hui, coexistent deux régimes d’inaptitude selon que l’accident ou la maladie ont une origine professionnelle ou non. Les articles L. 1226-2 à L. 1226-5 définissent les règles afférentes à l’inaptitude ayant une origine non professionnelle. Les règles relatives à l’inaptitude d’origine professionnelle sont fixées par les articles L. 1226-6 à L. 1226-22. Le projet vise également à harmoniser les modalités de rupture du contrat de travail ainsi que les règles relatives à l’obligation de reclassement. Selon l’étude d’impact, cette harmonisation permet « de sécuriser juridiquement tant l’employeur que le salarié et de limiter le risque contentieux ».
1. L’harmonisation des règles relatives à l’inaptitude consécutive à une maladie ou un accident non professionnel avec le régime de l’inaptitude d’origine professionnelle.
Le 3° vise à modifier l’article L. 1226-2 qui fixe le régime de l’inaptitude consécutive à une maladie ou un accident non professionnel. Il tend à harmoniser les règles avec celles qui s’appliquent aux salariés déclarés inaptes suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle.
L’article L. 1226-2 pose une obligation de reclassement du salarié. Les conclusions du médecin du travail tendant à constater l’inaptitude à reprendre un emploi constituent aujourd’hui un préalable nécessaire. C’est sur son avis d’inaptitude que l’employeur va s’appuyer pour examiner les possibilités de reclassement du salarié. Les propositions qui y figurent sont donc essentielles. L’article dispose ainsi que la proposition de l’employeur « prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise ».
L’emploi proposé doit être « aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé ». Il est enfin indiqué que, pour y parvenir, la proposition peut comporter des mesures telles que « mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ».
Il convient enfin de préciser que pour reclasser le salarié inapte à son poste, il ne suffit pas de prendre en compte les conclusions du médecin du travail, il faut aussi que l’emploi proposé soit approprié aux capacités du salarié.
Le 3° tend à accorder aux salariés déclarés inaptes à la suite d’un accident ou d’une maladie non professionnelle les mêmes droits que ceux dont disposent les salariés déclarés inaptes à la suite d’un accident du travail ou une maladie professionnelle.
Le a) apporte trois modifications en ce sens.
Aujourd’hui, l’employeur est tenu à une obligation de reclassement à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel. Si cette obligation de reclassement n’est pas respectée, le licenciement pour inaptitude qui est prononcé peut être requalifié par les juges en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il est désormais prévu que l’obligation de reclassement soit proposée dès lors qu’il est constaté que le salarié est « victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel ». Les dispositions actuelles de l’article L. 1216-2 précisent que les propositions de reclassement ne peuvent intervenir que dans le cadre d’une visite de reprise. Mais l’inaptitude peut aussi être reconnue à l’issue d’autres visites médicales. La nouvelle rédaction élargit les obligations de reclassement de l’employeur à toutes les situations.
Le a) remplace ensuite le terme « emploi » par celui de « poste ».
Un emploi correspond généralement à plusieurs postes de travail possibles dans une organisation. Un emploi regroupe des postes très proches au regard des activités réalisées ou des compétences mises en œuvre. Le poste constitue une unité plus précise au sein d’une organisation et correspond à une situation de travail réelle, concrète à un moment donné et à un endroit donné.
Le projet de loi opère cette substitution à plusieurs articles du code du travail avec l’intention de davantage préciser les termes employés. Toutefois, la méticulosité des locutions, aussi précieuse soit-elle, tend à en restreindre la portée, s’agissant plus particulièrement des dispositions relatives au reclassement. Le rapporteur estime qu’il conviendrait de s’en tenir aux dispositions en vigueur.
Enfin, il transpose au sein de l’article des modifications apportées par le 6° du II sur la constatation de l’inaptitude.
Le b) a pour objet d’étendre l’obligation pour l’employeur de consulter les délégués du personnel sur les possibilités de reclassement du salarié en cas d’inaptitude ayant pour cause une maladie ou un accident non professionnel, à l’instar de l’avis des délégués du personnel requis en cas d’inaptitude d’origine professionnelle (cf. article L. 1226-10). Même si le code du travail leur réserve une compétence particulière, y compris lorsqu’existe un comité d’entreprise, les délégués du personnel semblent ne jouer aujourd’hui qu’un rôle supplétif ; il est traditionnellement fait référence à la consultation des délégués du personnel en l’absence de comité d’entreprise.
Les règles de consultation obéissent à un formalisme qui a été précisé par la jurisprudence.
Ainsi, l’employeur ne peut passer outre son obligation de consultation et, ce, même s’il n’est pas en mesure de proposer un poste de reclassement au salarié (87). La consultation des délégués du personnel a lieu après que l’inaptitude a été définitivement constatée mais avant que soit faite au salarié la proposition de reclassement (88). En pratique, l’employeur devant soumettre les propositions de reclassement doit avoir au préalable procédé à ses recherches de reclassement et sollicité le médecin du travail. La consultation suppose aussi que l’employeur fournisse toutes les informations nécessaires sur le reclassement du salarié comme l’a rappelé la Cour de Cassation dans un de ses arrêts (89). Les délégués doivent avoir accès au constat d’inaptitude et aux conclusions du médecin du travail (90). Ces éléments sont transmis avec la convocation (91). Enfin, l’avis des délégués du personnel ne lie pas l’employeur et ne le libère pas de son obligation de reclassement, même si l’avis peut conclure à l’absence d’une telle possibilité. Il ne le dispense pas de rechercher l’existence d’une telle possibilité dans l’entreprise (92).
On peut supposer que les règles dégagées par le juge trouveront à s’appliquer, l’objectif étant de parvenir à une unification du droit.
Le b) substitue le terme « aptitude » à celui de « capacité ». Le médecin du travail formulera ainsi des indications sur la capacité du salarié à exercer une des tâches existantes dans l’entreprise.
La vérification systématique de l’aptitude, dans le cadre de visites d’embauche et des visites périodiques, a montré ses limites. Cette modification terminologique tire les conséquences de l’instauration du mauvais suivi de l’état de santé du salarié (cf. II du présent article)
Le c) prévoit en outre que, dans les entreprises d’au moins 50 salariés, le médecin du travail formule des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d’une formation destinée à lui proposer un poste adapté.
Cet ajout permet d’offrir des garanties nouvelles aux salariés déclarés inaptes à la suite d’un accident ou d’une maladie non professionnelle.
Le d) procède à deux types de modification, remplaçant, par cohérence avec le a), le terme d’« emploi » par celui de « poste » et modifiant surtout la portée des possibilités de reclassement du salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel.
Le reclassement envisage aujourd’hui trois possibilités : mutation, transformation de poste, aménagement de travail.
La rédaction proposée, bien que plus fournie, semble pourtant plus restrictive.
Tout d’abord, la liste des possibilités de reclassement est fermée quand la rédaction actuelle laisse la possibilité à l’employeur de proposer d’autres mesures de reclassement.
Par ailleurs, la nouvelle rédaction ne tient plus compte du reclassement par voie de mutation. Telle qu’envisagée, la rédaction limiterait les possibilités de reclassement du salarié et ne permettrait pas un reclassement au sein des établissements d’une même entreprise ou dans le groupe auquel appartient l’entreprise considérée. La jurisprudence a précisé la portée du reclassement par voie de mutation. Dans ce dernier cas, la recherche doit être faite dans l’ensemble des établissements de l’entreprise ou dans le groupe auquel celle-ci appartient (93), « parmi les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation permettent d’effectuer la mutation de tout ou partie du personnel » (94). Sont également visées, les entreprises avec lesquelles l’employeur entretient des relations de partenariat offrant des possibilités de permutation du personnel.
Force est de constater, qu’en ne retenant pas la notion de mutation, la rédaction proposée restreint sensiblement la portée du reclassement. Surtout, elle écornerait sérieusement les droits des salariés les plus faibles en leur accordant une protection plus faible.
La nouvelle rédaction n’évoque finalement que l’aménagement, l’adaptation ou la transformation de postes existants ainsi que l’aménagement du temps de travail.
Selon les informations transmises au rapporteur, la notion d’aménagement de poste vise un ensemble de mesures portant sur des éléments physiques (installation d’un siège ergonomique). L’adaptation y ajoute des mesures organisationnelles de nature à favoriser le maintien dans l’emploi. La transformation de poste implique un changement dans la nature ou l’organisation des tâches. Enfin, l’aménagement du temps de travail permettra au salarié de travailler à temps partiel lorsque son état de santé le justifie.
2. Le licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle : entre clarification et assouplissement
Le 4° insère un nouvel article L. 1226-2-1 dispensant l’employeur de son obligation de recherche de reclassement en cas d’inaptitude d’origine non professionnelle. Le nouveau régime s’inspire en cela de l’article L. 1226-12 applicable au licenciement en cas d’inaptitude d’origine professionnelle. La rédaction tient compte des assouplissements opérés par la loi relative au dialogue social et à l’emploi (95) sur le régime de l’inaptitude d’origine non professionnelle. Elle harmonise également les dispositions relatives aux motifs de rupture de contrat de travail et à la portée de l’obligation de reclassement de l’employeur.
À l’heure actuelle, le licenciement en cas d’inaptitude d’origine non professionnelle n’est pas expressément prévu par le code du travail. Il procède de la lecture combinée des articles L 1226-4 et L. 1226-4-1 qui incitent fortement l’employeur, confronté à une impossibilité de reclassement, à tirer au plus vite les conséquences de la situation. Le régime relève également de la jurisprudence (96). En effet, lorsqu’il n’a pas pu reclasser un salarié ou si le salarié refuse le reclassement, l’employeur peut procéder à son licenciement. À défaut, il est tenu, au terme d’un délai d’un mois suivant la déclaration d’inaptitude, de reprendre le versement du salaire.
En cas d’inaptitude d’origine professionnelle, l’article L. 1226-12 du code du travail dispose que le salarié déclaré inapte peut être licencié lorsque le reclassement est impossible ou lorsque le salarié a refusé les propositions de reclassement. La jurisprudence a appliqué cette solution à l’inaptitude d’origine non professionnelle.
L’article L. 1226-2-1 nouveau clarifie la situation et dispose que « lorsque l’employeur est dans l’impossibilité de proposer un autre poste au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent au reclassement ».
L’employeur est fondé à rompre le contrat de travail dans trois situations distinctes :
– s’il justifie de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2 (cf 3° du I) ;
– en cas de refus par le salarié de l’emploi proposé dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2. La rédaction reprend ici une solution déjà consacrée par la jurisprudence ;
– si l’avis du médecin du travail mentionne expressément que tout maintien du salarié dans l’entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement. Par cette disposition, le projet de loi étend à l’inaptitude non professionnelle l’assouplissement des conditions de licenciement pour inaptitude professionnelle opérée par la loi relative au dialogue social et à l’emploi (97) et par le 8° du I du présent article. L’ajout de ces deux derniers motifs de rupture assouplit ainsi les conditions du licenciement pour inaptitude. Il permet de répondre aux effets de la jurisprudence de la Cour de cassation obligeant l’employeur à rechercher un poste de reclassement alors même que le salarié est déclaré inapte à tout poste, y compris lorsque le médecin mentionne que son maintien est préjudiciable à sa santé. Il s’agit en particulier de situations de risques graves pour la santé mentale du salarié.
L’article L. 1226-2-1 nouveau reprend, en outre, une recommandation formulée par le rapport du groupe de travail « Aptitude et médecine du travail » (98). La jurisprudence prévoit aujourd’hui que la preuve de l’impossibilité du reclassement incombe à l’employeur (99) que l’inaptitude soit d’origine professionnelle ou non. Au terme du nouveau dispositif, l’employeur est désormais présumé avoir satisfait à son obligation de reclassement s’il prend en compte « les avis et les indications du médecin du travail » et s’il respecte les conditions prévues par l’article L. 1226-2.
Cette rédaction semble toutefois incomplète pour le rapporteur. Elle laisse entendre qu’il suffit à l’employeur de ne proposer qu’un seul poste au salarié déclaré inapte pour satisfaire à l’obligation de reclassement. Elle amoindrit sensiblement la responsabilité de l’employeur dans la recherche d’une solution et apparaît en contradiction avec l’esprit des modifications apportées par cet article. Il convient en effet d’encourager autant que possible les échanges entre médecin du travail, salarié et employeur pour dégager une solution de reclassement, le licenciement n’intervenant qu’en cas d’impossibilité. Il semblerait dès lors plus approprié de préciser que la présomption de satisfaction de l’obligation de reclassement est conditionnée à la proposition par l’employeur d’un ou plusieurs postes. La notion d’emploi répond parfaitement à cette exigence.
Enfin, le dispositif prévoit qu’il est fait application de la procédure applicable au licenciement pour motif personnel, à l’instar de la rédaction actuelle prévue par le dernier alinéa de l’article L. 1226-12. L’employeur doit ainsi convoquer son salarié à un entretien préalable, tenir cet entretien et notifier dans les règles dictées par le code du travail le licenciement au salarié inapte.
Le 5° procède à une mesure de coordination et modifie à cet effet le champ d’application de l’article L. 1226-4-1.
Cet article prévoit qu’en cas de licenciement prononcé dans le cas visé à l’article L. 1226-4, c’est-à-dire lorsque l’employeur a satisfait à son obligation de reclassement, les indemnités dues au salarié au titre de la rupture sont prises en charge soit directement par l’employeur, soit au titre des garanties qu’il a souscrites à un fonds de mutualisation.
Dans le droit actuel, le licenciement ouvre ainsi droit, pour le salarié, à l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement. Le salarié ne peut, en principe, prétendre au paiement d’une indemnité pour un préavis étant dans l’impossibilité physique de l’exécuter en raison d’une inaptitude à son emploi. Toutefois, le préavis est pris en compte pour le calcul de l’indemnité légale de licenciement.
1. L’assouplissement du régime de l’inaptitude consécutive à une maladie ou un accident professionnel.
Le 6° tend à simplifier la rédaction du premier alinéa de l’article L. 1226-8 relatif au retour du salarié, victime d’une maladie ou d’un accident professionnel, dans son emploi ou dans un emploi similaire.
À l’issue des périodes de suspension, le salarié déclaré par le médecin du travail apte à reprendre son travail, retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente. La jurisprudence considère comme étant similaire un emploi comportant le même niveau de rémunération, la même qualification, et les mêmes perspectives de carrière que l’emploi initial (100).
La rédaction du projet de loi aura pour effet d’autoriser le salarié à reprendre son travail à l’issue des périodes de suspension, sauf s’il est déclaré inapte dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10 (cf. 7° du I).
Les modifications apportées à l’article L. 1226-8 résultent des remarques du groupe de travail précité concluant au caractère peu adapté de la pertinence médicale de l’aptitude.
La déclaration d’aptitude au travail est ainsi supprimée au profit d’un constat d’inaptitude. Le groupe de travail avait en effet relevé deux biais. En premier lieu, le médecin du travail ne dispose pas de l’ensemble des éléments pour apprécier l’état de santé du salarié. Surtout, la déclaration d’aptitude peut pousser l’employeur à ne fournir aucun effort pour protéger le travailleur des risques que pourrait entraîner l’exécution des tâches dans le cadre de son poste de travail. La pratique de l’aptitude ferait ainsi obstacle à la prévention au sein de l’entreprise.
Depuis la loi du 17 août 2015 précitée, le rôle du médecin du travail est par ailleurs recentré sur la vérification d’aptitude des salariés affectés à des postes exposés. Cette modification, cohérente avec l’assouplissement de la surveillance médicale des salariés prévue par le II du présent article, consacre l’abandon de la vérification systématique par le médecin, du travail de l’aptitude du salarié. Trop souvent organisé pour répondre à des impératifs légaux ou réglementaires, le contrôle de l’aptitude a pu contribuer à éloigner le médecin du travail de la prévention des risques. Le contrôle du médecin aura désormais pour objet de déceler une inaptitude, d’inciter, au travers d’un dialogue, à rechercher des solutions de reclassement et de réduire les risques de contentieux.
b. La constatation de l’inaptitude d’origine professionnelle : des règles similaires au régime de l’inaptitude d’origine non professionnelle
Le 7° modifie l’article L. 1226-10 qui fixe le régime de constatation de l’inaptitude consécutive à une maladie ou un accident professionnel.
Ÿ Le dispositif actuel
L’article L. 1226-10 formule une obligation de reclassement du salarié.
Comme pour l’inaptitude d’origine non professionnelle, les conclusions du médecin du travail tendant à constater l’inaptitude à reprendre un emploi constituent aujourd’hui un préalable nécessaire sur lequel l’employeur va s’appuyer pour examiner les possibilités de reclassement du salarié pouvant passer par diverses mesures.
Dans les deux cas d’inaptitude, il ne suffit pas de prendre en compte les conclusions du médecin du travail, il faut que l’emploi proposé soit « approprié à ses capacités ».
L’emploi proposé doit être « aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé ».
On rappellera que, à la différence du régime actuel de l’inaptitude d’origine non professionnelle, l’employeur est tenu par la nécessité de consulter les délégués du personnel, différence appelée à s’estomper (cf. 3° du I).
Ÿ Les modifications proposées
Comme pour l’article L. 1226-2, il est prévu, par la modification de l’article 1226-10, que l’obligation de reclassement soit proposée dès qu’il est constaté que le salarié est « victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle » et non plus à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail.
Il est aussi précisé que la déclaration d’inaptitude est établie en application des dispositions relatives à la constatation de l’inaptitude du salarié réécrites par le 6° du II du présent article.
Tout d’abord, les a) et b) remplacent donc le terme « emploi » par celui de « poste ».
Ensuite le b) remplace, par coordination, le terme « aptitude » par celui de « capacité ». Le médecin du travail formulera ainsi des indications sur la capacité du salarié à exercer une des tâches existantes dans l’entreprise.
Il est par ailleurs proposé de modifier la seconde phrase du deuxième alinéa en vertu de laquelle, dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation destinée à lui proposer un poste adapté. La modification substitue aux mots « destinée à lui proposer » les mots « le préparant à occuper ». Cette rectification est cohérente avec la réforme d’ensemble du régime de l’inaptitude. Il s’agit de davantage accompagner le salarié dans une démarche de reconversion et d’adaptation professionnelle lorsqu’est décelée une inaptitude. La formation n’a pas d’autre objet que de lui permettre de continuer à travailler au travers d’un dialogue que l’on espère fructueux entre le salarié, l’employeur et le médecin.
Le c) modifie la portée des possibilités de reclassement du salarié victime d’une maladie ou d’un accident professionnel. Comme pour le régime de l’inaptitude d’origine non professionnelle, le reclassement envisage aujourd’hui trois possibilités : mutation, transformation de poste, aménagement de travail. À l’instar des modifications apportées à l’article L. 1226-2, la rédaction proposée ne tient plus compte de la mutation. Elle évoque l’aménagement, l’adaptation ou la transformation de postes existants ainsi que l’aménagement du temps de travail.
Par cohérence avec les remarques formulées sur l’écriture de l’article L. 1226-2, il serait opportun de ne pas réduire la portée des obligations de reclassement en maintenant la rédaction en vigueur.
En modifiant l’article L. 1226-12, le 8° tend à assouplir les conditions du licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle.
Le b) constitue le cœur du dispositif et complète les motifs de rupture du contrat de travail.
Initialement, l’employeur ne pouvait rompre le contrat de travail que s’il justifiait soit de son impossibilité de proposer un emploi, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions. La loi du 17 août 2015 (101) a facilité le licenciement pour inaptitude professionnelle en permettant à l’employeur de rompre le contrat, sans devoir rechercher de reclassement, dès lors que l’avis du médecin du travail mentionne expressément que tout maintien du salarié dans l’entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé.
Le présent texte complète ce dispositif. Comme pour l’article L. 1226-2, il prévoit qu’il en serait de même si l’avis du médecin du travail mentionne expressément que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’entreprise.
Le c) renforce enfin la présomption de satisfaction de l’obligation de reclassement au bénéfice de l’employeur alors que la jurisprudence prévoit aujourd’hui que la preuve de l’impossibilité du reclassement lui incombe. Cette modification fait suite à la recommandation formulée par le rapport du groupe de travail « Aptitude et médecine du travail ». Au terme du nouveau dispositif, l’employeur est désormais présumé avoir satisfait à son obligation de reclassement s’il prend en compte « avis et indications du médecin du travail » et s’il respecte les conditions prévues par l’article L. 1226-10.
Ces dispositions sont cohérentes avec celles prévues pour le licenciement en raison de l’inaptitude d’origine non professionnelle. Elles appellent également les mêmes remarques s’agissant de l’obligation de proposer emploi plutôt qu’un poste.
Le 9° procède à des modifications de pure coordination au sein de l’article L. 1226-15 relatif aux sanctions applicables à l’employeur en cas de non-respect des obligations de reclassement.
Le 10° poursuit l’unification du droit en étendant aux salariés en contrat durée déterminée les mesures d’assouplissement pour inaptitude d’origine professionnelle.
Il modifie à cet effet l’article L. 1226-20 qui précise les dispositions applicables à ces salariés en précisant notamment les conditions dans lesquelles la rupture peut être possible. Si l’employeur justifie de son impossibilité de proposer un emploi ou si le salarié refuse un emploi offert dans ces conditions, l’employeur est fondé à procéder à la rupture du contrat.
Son dernier alinéa qui prévoit une indemnité en cas de rupture de contrat dont le montant ne peut être inférieur au double de celui de l’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 1234-9 pour les salariés en contrat à durée indéterminée n’est pas modifié.
En revanche, le b) étend au salarié en CDD les dispositions susceptibles de faire obstacle à la possibilité d’un reclassement prévues pour les salariés en CDI.
Enfin, le 11° propose, par cohérence avec la suppression de la vérification systématique, de lier l’indemnité prévue au premier alinéa de l’article L. 1226-21 à la méconnaissance de la vérification d’inaptitude.
Le II rénove le régime de la surveillance médicale des salariés en reprenant les principales préconisations du groupe de travail « Aptitude et médecine du travail ».
Le 1° modifie la rédaction de l’article L. 4622-3 qui définit les missions du service de santé au travail, particulièrement celle du médecin.
L’article L. 4622-3 dispose que le « rôle du médecin du travail est exclusivement préventif ». La mission du médecin consiste à éviter :
– toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail, notamment en surveillant leurs conditions d’hygiène au travail, les risques de contagion et leur état de santé ;
– ainsi que toute atteinte à la sécurité des tiers.
À la faveur d’une initiative parlementaire, la loi du 17 août 2015 précitée avait étendu les missions du médecin du travail. Le législateur avait ainsi décidé que le médecin devait également assurer la surveillance de l’état de santé des travailleurs en fonction des risques concernant la sécurité des tiers.
L’objectif recherché consistait à recentrer la mission des médecins du travail sur une catégorie tout à fait particulière de salariés, pour lesquels l’aptitude doit être systématiquement vérifiée. Selon les termes de notre collègue Michel Issindou, à l’initiative de cette évolution, « il s’agit des salariés occupant des postes dits de sécurité et susceptibles de compromettre, du fait de leur maladie, non seulement leur propre sécurité, mais également celle des tiers ». M. Issindou ajoutait également que les postes dits de sécurité devaient être distingués des postes à risque. Notre collègue citait notamment les « conducteurs de grue [transportant] des plaques au-dessus d’une école » pour illustrer son propos (102).
En réponse à une interrogation formulée lors de l’examen du texte par l’Assemblée, le rapporteur avait tenu à préciser la portée de la modification introduite en soulignant que son objet visait à protéger les tiers que les salariés pouvaient être amenés à côtoyer pendant leur travail.
Cela étant, la rédaction adoptée reste empreinte d’incertitude.
Elle n’est pas circonscrite et présente le risque d’une extension peu souhaitable des missions du médecin du travail. La nouvelle rédaction proposée précise dorénavant que le rôle du médecin de travail consiste notamment à éviter « tout risque manifeste d’atteinte à la sécurité des tiers évoluant dans l’environnement immédiat de travail ».
La rédaction adoptée en août 2015 tendait à rendre moins lisibles les missions du médecin du travail. Elle pouvait laisser penser qu’elle intimait au médecin du travail de poursuivre une nouvelle mission – prévenir toute atteinte à la sécurité des tiers – détachable des objectifs du service de santé au travail définis par l’article L. 4622-2. Elle pouvait aussi laisser penser que la mission du médecin relevait plus d’une médecine de contrôle que d’une médecine de prévention.
En recentrant la rédaction sur les risques d’atteinte à la sécurité des tiers et en la limitant à l’environnement immédiat de travail, la rédaction du projet de loi semble avoir pris en compte les nombreuses craintes et réticences exprimées à l’occasion de l’examen de la loi Rebsamen. Du point de vue législatif, cette rédaction empêche toute confusion entre médecine de contrôle et médecine de prévention. Il convient toutefois d’être particulièrement vigilant sur les précisions qui pourraient être apportées dans le cadre réglementaire.
Les 2° à 7° du III procède à la réforme du suivi de l’état de santé des salariés en prévoyant une nouvelle architecture.
Réaffirmant le principe du suivi individuel de tout travailleur, le texte instaure une visite d’information et de prévention réalisée après l’embauche qui permettra d’identifier les salariés pour lesquels un suivi particulier pourra être préconisé en raison de l’état de santé du travailleur ou des risques professionnels auxquels il est exposé.
Le projet institue par ailleurs un suivi renforcé pour les travailleurs affectés à un poste présentant des risques particuliers pour leur santé ou celle des tiers.
Le projet maintient la possibilité pour le médecin de proposer des mesures individuelles d’aménagement de poste et pose les bases d’un véritable échange entre le médecin du travail, les salariés et les employeurs pour la mise en œuvre des propositions du médecin. Dans cette architecture, la déclaration d’inaptitude apparaît comme l’ultime solution après que toutes les voies ont été explorées.
Il réforme enfin les modalités de contestation des décisions du médecin du travail considérant que le caractère médical des avis appelle une procédure adaptée.
Les 2° à 4° procèdent à diverses mesures de coordination.
Le 2° procède à la nouvelle numérotation de l’article L. 4624-2 relatif au dossier médical en santé au travail. Un nouvel article L. 4624-8 précisera désormais le régime de cet outil de suivi de l’état de santé du travailleur, à la main du médecin du travail.
Le 3° procède à une nouvelle numérotation l’article L. 4624-3 qui devient l’article L. 4624-9.
Le 4° procède à l’abrogation de l’article L. 4624-4 qui précise notamment le régime de surveillance des salariés affectés à des postes présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, celles de leurs collègues ou de tiers. Ces dispositions sont toutefois réintroduites par le 6° du présent II, au sein d’un article L. 4624-2, moyennant quelques modifications.
Le 6° procède à une nouvelle numérotation de l’article L. 4624-5 qui devient l’article L. 4624-10. La rédaction est par ailleurs enrichie par des précisions complémentaires. Les décrets en conseil d’État préciseront « notamment les modalités du suivi individuel prévu à l’article L. 4624-1, les modalités d’identification des travailleurs mentionnés à l’article L. 4624-2 et les modalités du suivi individuel renforcé dont ils bénéficient ».
Le 5° réforme le régime de surveillance médicale des salariés au travers des articles L. 4624-1 à L. 4624-7. Les modifications tiennent compte des préconisations contenues dans le rapport du groupe de travail « Aptitude et médecine du travail ».
À l’exception de certaines catégories de travailleurs dont les modalités de suivi l’état de santé relèvent du niveau législatif, le régime de surveillance des salariés découle de dispositions règlementaires.
Le suivi individuel de l’état de santé du salarié est ainsi fixé par les articles R. 4624-10 à R. 4624-36 du code du travail. Cette surveillance médicale des salariés au travers de plusieurs examens médicaux : à l’embauche, de façon périodique (103), lors de la reprise du travail sous la forme d’un examen de pré reprise et d’un examen de reprise. Ils peuvent aussi être réalisés à la demande du salarié ou de l’employeur. S’y ajoutent des examens complémentaires qui peuvent être décidés par le médecin du travail.
S’agissant des travailleurs temporaires, l’article L. 4624-1 prévoit l’organisation de la surveillance médicale par décret.
Le code du travail impose par ailleurs une surveillance médicale renforcée pour différentes catégories de salariés, en raison de leurs activités professionnelles ou du fait de leur état de santé particulier. Ces salariés bénéficient, au minimum d’une visite médicale tous les 24 mois mais le médecin du travail peut décider de la fréquence des examens en tenant compte de recommandations de bonne pratique (104).
Depuis la loi du 17 août 2015, les salariés affectés à des postes présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, celles de leurs collègues ou de tiers et les salariés dont la situation personnelle le justifie, bénéficient d’une surveillance médicale spécifique. L’article L. 4624-4 dispose que les modalités d’identification de ces salariés et les modalités de la surveillance médicale spécifique sont déterminées par un décret en Conseil d’État.
Les salariés faisant l’objet d’une surveillance médicale renforcée
Article R. 4624-18 du code du travail
« Bénéficient d’une surveillance médicale renforcée :
1° Les travailleurs âgés de moins de dix-huit ans ;
2° Les femmes enceintes ;
3° Les salariés exposés :
a) A l’amiante ;
b) Aux rayonnements ionisants ;
c) Au plomb dans les conditions prévues à l’article R. 4412-160 ;
d) Au risque hyperbare ;
e) Au bruit dans les conditions prévues au 2° de l’article R. 4434-7 ;
f) Aux vibrations dans les conditions prévues à l’article R. 4443-2 ;
g) Aux agents biologiques des groupes 3 et 4 ;
h) Aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction mentionnés à l’article R. 4412-60 ;
4° Les travailleurs handicapés. »
Le texte fait le choix de prévoir les examens médicaux par la loi plutôt que par le règlement et en simplifie le cadre.
Ÿ Le nouveau cadre du suivi des travailleurs
L’article L. 4624-1 garantit à chaque travailleur, quel que soit son statut, un suivi individuel de son état de santé. Ce suivi est assuré par le médecin du travail. Dans le cas d’un service de santé au travail interentreprises, le suivi peut être effectué sous l’autorité du médecin du travail par un membre de l’équipe pluridisciplinaire qui ne peut être qu’un professionnel de santé.
Le deuxième alinéa dispose que ce suivi peut être réalisé par le biais d’une une visite d’information et de prévention effectuée après l’embauche du travailleur dans un délai fixé par décret en conseil d’État. Cette visite remplacerait l’actuel examen médical d’embauche. Elle serait assurée soit par le médecin du travail soit, sous son autorité, par un professionnel de santé membre de l’équipe pluridisciplinaire. Le texte mentionne notamment le collaborateur médecin et l’infirmier.
Le deuxième alinéa de l’article L. 4624-1 dispose que le suivi individuel de l’état de santé du travailleur peut être réalisé par le biais d’une visite d’information et de prévention effectuée après l’embauche du travailleur dans un délai fixé par décret en Conseil d’État. Cette visite serait, quant à elle, assurée soit par le médecin du travail soit par un membre de l’équipe pluridisciplinaire.
Ces dispositions reprennent les propositions 5 et 6 du groupe de travail « Aptitude et médecine du travail » qui proposait l’instauration d’une visite obligatoire d’information et de prévention en substitution de la visite d’embauche, au rythme d’une visite dans les 3 mois suivant l’embauche pour les salariés occupant un poste à risque et dans les 6 mois pour les autres.
Le dernier alinéa dispose que « les modalités et la périodicité de ce suivi prennent en compte les conditions de travail, l’état de santé et l’âge du travailleur, ainsi que les risques professionnels auxquels il est exposé. ». Cette disposition permet de conclure à un espacement des visites plus ou moins important selon les catégories de travailleurs.
Le projet de loi distingue deux régimes : celui des travailleurs affectés à des postes à risque (examen d’aptitude) faisant l’objet d’un suivi renforcé et celui d’autres travailleurs pour lesquels un suivi particulier sera proposé en fonction de l’âge et de l’état de santé (grossesse, handicap…).
Ÿ Les travailleurs présentant des risques particuliers
L’article L. 4624-2 précise le cadre juridique des travailleurs affectés à des postes présentant des risques particuliers.
La loi du 17 juillet 2015 avait institué une surveillance médicale spécifique (article L. 4624-4), pour les salariés affectés à des postes présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, celles de leurs collègues ou celles de tiers et pour les salariés dont « la situation personnelle le justifie ». Un décret en Conseil d’État devait préciser les modalités de cette surveillance médicale spécifique ainsi que les salariés concernés.
Au terme du I du nouvel article, la dénomination choisie est « suivi individuel renforcé ». En outre, par cohérence avec la modification apportée à l’article L. 4622-3 (cf. 1° du présent II), la nouvelle rédaction circonscrit le champ des risques particuliers pour la sécurité des tiers. Il est ainsi précisé qu’il s’agit des tiers « évoluant dans l’environnement immédiat de travail ». Les travailleurs concernés bénéficieraient d’un examen médical d’aptitude qui se substituerait à la visite d’information et de prévention réalisée avant l’embauche. Par ailleurs, la nouvelle rédaction ne prévoit plus le cas « des salariés dont la situation personnelle le justifie », dans la mesure où le troisième alinéa du nouvel article L. 4624-1 a vocation à couvrir les mêmes hypothèses.
Le II dispose que cet examen permettrait de s’assurer de la compatibilité de l’état de santé du travailleur avec le poste auquel il est affecté et serait réalisé, sauf dispositions spécifiques, par le médecin du travail.
Cette proposition reprend partiellement la recommandation n° 4 du groupe de travail. Celle-ci préconisait un contrôle de l’aptitude des salariés devant occuper un poste de sécurité avant l’embauche. Mais elle proposait aussi d’en confier la responsabilité à un médecin différent du médecin du travail. La mission jugeait en effet « essentiel de ne pas faire basculer la médecine de prévention qu’est la médecine du travail en une médecine de contrôle ». Il n’a pas été retenu de confier cette visite à un autre médecin que le médecin du travail, l’organisation pouvant être source de complexité.
S’agissant des dispositions spécifiques, il est fait référence à d’autres régimes relevant d’autres codes, tel que celui des transports.
Ÿ Les modalités des échanges entre médecin, salarié et employeur
Les articles L. 4624-3 à L. 4624-6 précisent le rôle du médecin du travail et déterminent le cadre des échanges du médecin du travail avec les salariés et les employeurs. La déclaration d’inaptitude, qui n’intervient qu’en dernière extrémité, s’insère dans ce cadre.
Ø L’article L. 4624-3 autorise le médecin du travail à proposer des mesures individuelles d’aménagement de poste, possibilité déjà prévue par le droit actuel (article L. 4624-1). Au terme de la nouvelle rédaction, le médecin peut ainsi proposer des mesures individuelles d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail ou d’aménagement du temps de travail. Ces propositions prennent appui sur des critères qui ne sont pas limitativement énumérés. Le texte fait notamment référence à l’âge et à la santé physique ou mentale du travailleur.
S’agissant de propositions entraînant une restriction des tâches concernées, le dispositif prévoit l’organisation d’un échange avec le salarié et l’employeur. Cet échange prend la forme d’un entretien avec le salarié dans les conditions prévues par l’article L. 4624-5. S’agissant de l’employeur, le texte ne définit pas précisément la forme que prendraient les échanges.
Ø L’article L. 4624-4 complète le dispositif de la constatation de l’inaptitude dont les dispositions sont aujourd’hui prévues par les articles R. 4624-31 à R. 4624-33.
À l’heure actuelle, le médecin du travail ne peut constater l’inaptitude médicale du salarié à son poste de travail que s’il a notamment réalisé deux examens médicaux espacés de deux semaines, accompagnés, le cas échéant, d’examens complémentaires.
Au terme du projet de loi, le médecin du travail qui constate qu’aucune mesure d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail n’est possible et que l’état de santé du travailleur justifie un changement de poste, déclarerait le travailleur inapte à son poste de travail.
La déclaration d’inaptitude, qui prend la forme d’un avis, n’intervient qu’en dernière extrémité. À cet effet, le médecin doit avoir au préalable :
– procédé, ou fait procéder par un membre de l’équipe pluridisciplinaire, à une étude de poste ;
– échangé avec le travailleur et l’employeur.
Le médecin devrait recevoir le travailleur dans les conditions prévues par l’article L. 4624-5. Ce rendez-vous constituerait le cadre de l’échange avec le travailleur. Enfin, le texte dispose que l’avis d’inaptitude, délivré par le médecin du travail, est éclairé par des conclusions écrites, assorties d’indications relatives au reclassement du travailleur.
Ø L’article L. 4624-5 fixe le cadre de l’échange entre le médecin du travail et le salarié en ce qui concerne tant les mesures individuelles de restriction des tâches (article L. 4624-3) que la constatation de l’inaptitude (article L. 4624-4). Un entretien est ainsi obligatoirement prévu afin d’échanger sur l’avis et les indications, ou les propositions adressées à l’employeur. Le deuxième alinéa dispose que le médecin du travail peut proposer à l’employeur un appui pour mettre en œuvre son avis et les indications ou ses propositions. Cet appui peut être fourni par l’équipe pluridisciplinaire ou par un organisme compétent en matière de maintien dans l’emploi. Le projet de loi formalise une pratique déjà existante dans certains services de santé au travail. Cet appui peut prendre plusieurs formes (action en milieu de travail, appui technique au travail d’expertise, … Il peut s’agir par exemple d’aide fournie par les caisses régionales de l’assurance retraite et santé au travail (CARSAT) ou de services d’appui au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés (SAMETH).
La rédaction vise, d’une part, l’avis d’inaptitude assortie des indications de reclassement mentionnés à l’article L. 4624-4, d’autre part, les propositions émises par le médecin dans le cadre des mesures individuelles relatives au poste prévues par l’article L. 4624-3.
Ø L’article L. 4624-6 précise la portée des avis et indications, ou des propositions du médecin du travail émis en application des articles L. 4624-2 à L. 4624-4. L’employeur est ainsi tenu par les avis d’aptitude, d’inaptitude, indications et propositions émanant du médecin du travail. Le cas échéant, il doit faire connaître par écrit les motifs au travailleur et au médecin du travail qui s’opposent à ce qu’il y donne suite.
Ÿ Les modalités de contestation des avis du médecin
L’article L. 4624-7 précise le cadre juridique de la contestation des positions prises par le médecin du travail.
Le cadre actuel du recours est fixé par les articles L. 4624-1 et R. 4624-35 à R. 4624-36.
L’article L. 4624-1 dispose aujourd’hui qu’en cas de difficulté ou de désaccord portant sur les mesures individuelles, l’employeur ou le salarié peut exercer un recours devant l’inspecteur du travail. Ce dernier prend sa décision après avis d’un médecin inspecteur du travail. La décision de l’inspecteur du travail peut ensuite être contestée dans un délai de deux mois devant le ministre chargé du travail.
L’article L. 4624-7 s’écarte du droit actuel mais aussi des préconisations du groupe de travail en instituant un recours auprès du juge du contrat de travail, soit le conseil des prud’hommes.
Précisons que le groupe de travail recommandait de confier l’examen des litiges à une commission médicale régionale composée de médecins du travail, à l’exclusion des inspecteurs du travail. Elle justifiait son choix en précisant que l’inspecteur du travail n’avait compétence ni pour se prononcer sur une décision médicale ni pour apprécier les propositions de reclassement, ces dernières relevant du juge judiciaire. L’étude d’impact précise que cette solution n’a pas été retenue car ne tenant pas compte des procédures contentieuses, ni des coûts afférents à la contribution des médecins du travail intervenant dans la commission.
Le projet de loi retient une autre solution qui fait intervenir le juge du contrat de travail et le médecin.
Le champ du recours, formulé par l’employeur ou le salarié, concernerait les articles L. 4624-2 à L. 4624-4, soit l’examen médical d’aptitude pour les salariés faisant l’objet d’un suivi renforcé, les propositions individuelles tenant à la modification des tâches ou la constatation de l’inaptitude.
Le texte prévoit la saisine du conseil des prud’hommes d’une demande de désignation d’un médecin-expert inscrit sur une liste des experts près la cour d’appel. Son avis se substituerait à celui du médecin du travail. À cet effet, le texte prévoit que le médecin-expert peut demander la communication du dossier médical en santé au travail.
Cette solution est cohérente avec la préconisation du groupe de travail visant à réserver à un médecin l’examen d’une décision d’ordre médical. Elle présente aussi l’intérêt de ménager la compétence du juge prud’homal s’agissant d’une contestation susceptible de modifier sensiblement le contrat de travail. Elle permet enfin d’unifier le contentieux sur cette matière, les conseils de prud’hommes ayant d’ores et déjà à connaître du contentieux lié à la rupture du contrat de travail et au reclassement.
Le texte prévoit en outre que le conseil des prud’hommes statue en la forme des référés.
Le 6° insère un nouvel article L. 4625-1-1 complétant le chapitre V du titre II du livre VI de la quatrième partie du code de travail, relatif à la surveillance médicale de catégories particulières de travailleurs.
Ce nouvel article prévoit des mesures d’adaptation des règles relatives au suivi de l’état de santé des travailleurs (visite d’information et d’orientation et périodicité du suivi) et au suivi individuel renforcé. Ces adaptations feraient l’objet d’un décret en Conseil d’État pour les salariés temporaires et les salariés en contrat à durée déterminée.
Le deuxième alinéa dispose pour ces derniers que ces adaptations leur garantissent un suivi médical individuel d’une périodicité équivalente à celle du suivi des salariés en contrat à durée indéterminée.
Enfin, le décret devrait prévoir « les modalités d’information de l’employeur sur la situation de son salarié au regard de ce suivi ». Il est notamment prévu la mise en place d’un système d’information commun permettant de partager le suivi des salariés entre service de santé au travail et d’assurer l’information de l’employeur.
Le 7° tend à modifier le dernier alinéa de l’article L. 717-2 du code rural et de la pêche maritime qui prévoit les modalités d’application des mesures de santé au travail pour les salariés agricoles.
Le a) remplace la référence à l’article L. 4624-1 par les articles L. 4624-1 à L. 4624-9 institués par le présent article. Il applique ainsi aux salariés agricoles les dispositions du code du travail relatives au suivi de l’état de santé des travailleurs, y compris le suivi renforcé, à l’adaptation du poste de travail à l’état de santé du travailleur, au régime de l’inaptitude, aux échanges entre médecin du travail, employeur et salarié et à la résolution des litiges.
Sur le modèle du 6° du présent II, le b) prévoit des mesures d’adaptation pour les salariés temporaires et en contrat à durée déterminée. Ces mesures concernent le suivi de l’état de santé des travailleurs (visite d’information et d’orientation et périodicité du suivi), le suivi individuel renforcé ainsi que « les modalités d’information de l’employeur sur la situation de son salarié au regard de ce suivi ». Ces adaptations feraient l’objet d’un décret en Conseil d’État.
Enfin, le III prévoit une entrée en vigueur de l’article à compter de la publication des décrets pris pour son application et au plus tard le 1er janvier 2017.
*
Sur proposition du rapporteur, la Commission a adopté une série d’amendements tendant à maintenir la notion d’emploi pour l’appréciation du reclassement des salariés déclarés inaptes et à revenir au droit en vigueur s’agissant des possibilités de reclassement.
*
La Commission examine, en discussion commune, les amendements AS1020 du rapporteur et AS500 de M. Gérard Sebaoun.
M. le rapporteur. La rédaction du projet de loi laisse entendre qu’il suffit à l’employeur de ne proposer qu’un seul poste au salarié déclaré inapte pour satisfaire à l’obligation de reclassement. Elle amoindrit sensiblement la responsabilité de l’employeur dans la recherche d’une solution et apparaît en contradiction avec l’esprit des modifications portées par le présent article. Il convient en effet d’encourager autant que possible les échanges entre les médecins du travail, les salariés et les employeurs pour dégager une piste de reclassement, le licenciement n’intervenant qu’en dernière extrémité. Il semblerait dès lors plus approprié de préciser que l’obligation de reclassement est conditionnée à la proposition d’un emploi par l’employeur. Le fait de proposer un « emploi » sous-entend l’idée de proposer plusieurs postes. Mon amendement satisfait celui déposé par M. Gérard Sebaoun.
M. Gérard Sebaoun. Comme vient de le rappeler M. le rapporteur, le remplacement du terme « emploi » par le mot « poste » dans le code du travail avait suscité un débat. Le rétablissement du terme « emploi » maintient le droit en l’état. J’avais trouvé une autre solution, mais je me rallie à celle proposée par M. le rapporteur. Je retire donc mon amendement.
Mme Isabelle Le Callennec. Monsieur le rapporteur, de combien de temps dispose l’entreprise pour proposer plusieurs postes ? Ne faudrait-il pas allonger le délai, aujourd’hui fixé à un mois me semble-t-il, pour laisser à l’employeur le temps de plusieurs postes corrects ?
M. Gérard Sebaoun. On en reste au droit actuel : aux termes de la loi, l’employeur doit rechercher tout emploi pouvant être proposé au salarié compte tenu de sa santé. Je ne suis pas sûr qu’un délai soit prévu.
M. le rapporteur. Cette question relève du domaine réglementaire.
L’amendement AS500 est retiré.
La Commission adopte l’amendement AS1020 et l’amendement de précision AS1021 du rapporteur.
Puis elle est saisie de l’amendement AS1022 du rapporteur.
M. le rapporteur. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.
Mme Martine Carrillon-Couvreur. Dans un reclassement, il importe de proposer des postes et non un seul.
M. le rapporteur. Mon amendement satisfait votre préoccupation, madame Carrillon-Couvreur.
La Commission adopte l’amendement.
Puis elle en vient à l’amendement AS396 de M. Christophe Cavard.
Mme Véronique Massonneau. L’obligation pour le médecin du travail d’élaborer des indications sur la possibilité pour le salarié de bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté dans le cadre d’une mesure de reclassement, serait réservée aux entreprises d’au moins 50 salariés. Cet amendement propose d’étendre cette mesure à l’ensemble des reclassements en cas d’inaptitude professionnelle et non professionnelle, quelle que soit la taille des entreprises. Cela ne représenterait aucune surcharge d’activité pour les médecins du travail et permettrait de mettre l’ensemble des salariés sur un pied d’égalité.
M. le rapporteur. Vous souhaitez supprimer le seuil de 50 salariés, ce qui ne simplifierait pas la vie des petites entreprises. J’émets un avis défavorable à l’adoption de cet amendement.
La Commission rejette l’amendement.
Puis elle aborde l’amendement AS1023 du rapporteur.
M. le rapporteur. La rédaction du projet de loi se révèle restrictive pour les droits des salariés.
Tout d’abord, la liste des possibilités de reclassement est fermée quand la rédaction actuelle laisse la possibilité à l’employeur de proposer d’autres mesures de reclassement. Je propose le maintien du droit en vigueur.
Par ailleurs, la nouvelle rédaction ne tient plus compte du reclassement par voie de mutation. Telle qu’envisagée, la rédaction limiterait les possibilités de reclassement du salarié et ne permettrait pas un reclassement au sein des établissements d’une même entreprise ou dans le groupe auquel appartient l’entreprise considérée.
La jurisprudence a précisé la portée du reclassement par voie de mutation. Dans ce dernier cas, la recherche doit être faite dans l’ensemble des établissements de l’entreprise ou dans le groupe auquel celle-ci appartient, et « parmi les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation permettent d’effectuer la mutation de tout ou partie du personnel ». Sont également visées les entreprises avec lesquelles l’employeur entretient des relations de partenariat offrant des possibilités de permutation du personnel.
En ne retenant pas la notion de mutation, le projet de loi restreint sensiblement la portée du reclassement. Il écorne les droits des salariés les plus faibles en leur accordant une protection plus limitée que dans le cas d’un licenciement économique. On voit mal pour quelles raisons l’obligation de reclassement au sein d’entreprises du même groupe se justifierait dans un cas et pas dans l’autre.
M. Gérard Sebaoun. Monsieur le rapporteur, votre amendement accroît la protection des salariés. Dans une première version, la notion d’aménagement du travail avait disparu et la voilà réintégrée, contrairement à celle de mutation, qui s’avère très ambiguë. Une mutation peut bénéficier aux salariés, par exemple dans un établissement proche, mais elle peut également s’avérer délétère si elle est utilisée pour proposer n’importe quoi n’importe où. La disparition de la mutation ne me gêne pas. Je voterai donc l’amendement de M. le rapporteur.
M. le rapporteur. J’ai voulu m’appuyer sur la jurisprudence, qui, jusqu’à présent, n’a jamais été défavorable aux salariés sur ces questions.
M. Michel Issindou. L’intérêt de la médecine du travail est de maintenir les gens dans l’emploi. Le terme de poste recouvre un périmètre plus restreint que celui d’emploi. Procédons donc à un élargissement !
Comme M. Gérard Sebaoun, je souhaite que l’on fasse attention : pour caricaturer, on ne doit pas accepter d’envoyer en Roumanie un salarié de Renault sous prétexte qu’un poste existe là-bas pour lui. Le juge appréciera, mais il convient, comme l’a fait M. le rapporteur, de ne pas faire apparaître la notion de mutation.
La Commission adopte l’amendement.
En conséquence, l’amendement AS 397 de M. Christophe Cavard tombe.
La Commission examine l’amendement AS501 de M. Gérard Sebaoun.
M. Gérard Sebaoun. Cet amendement traite du sujet important du droit à l’inaptitude. L’article 44 traite de la santé au travail et vise notamment à harmoniser deux régimes existants, selon que le salarié a été déclaré inapte suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle, ou suite à une maladie ou un accident non professionnel. Le droit de l’inaptitude est un droit protecteur, voulu par le législateur. La jurisprudence de la Cour de cassation a imposé avec constance à l’employeur une obligation de reclassement, qu’il remplit dans la limite de ses moyens. Il ne peut procéder à un licenciement que s’il fait la démonstration de l’impossibilité du reclassement du salarié déclaré inapte. Selon l’étude d’impact du projet de loi, environ 95 % des inaptitudes débouchent sur un licenciement. Selon Pôle emploi, près de 64 000 salariés ont été licenciés pour inaptitude physique en 2013 et sont entrés à l’assurance chômage. Le projet de loi donne à l’employeur deux nouveaux motifs de rupture du contrat de travail : l’inaptitude du salarié à tous les postes dans l’entreprise et le fait que son maintien dans la structure porte préjudice à sa santé ; l’obligation de reclassement se trouve réputée satisfaite lorsque l’employeur propose un poste – et un seul – tenant compte des recommandations du médecin du travail.
Cet amendement vise à supprimer le nouvel article L. 1226-1 inséré dans le projet de loi, qui introduit ces deux nouveaux motifs. Il propose de ne pas modifier le droit actuel, l’employeur devant rechercher et proposer tout autre poste potentiel, et pas seulement un poste, pour que l’on considère qu’il a rempli son obligation de reclassement.
Mme Annie Le Houérou. J’avais déposé un amendement visant à favoriser l’accompagnement humain dans l’emploi, mais il a été retoqué au titre de l’article 40. Quoi qu’il en soit, il nous faudra trouver, en lien avec la médecine du travail, le moyen d’obliger l’employeur à étudier toutes les possibilités d’aménagement de poste, notamment pour les personnes souffrant d’un handicap psychique. Je défendrai un amendement en ce sens en séance publique.
M. Gilles Lurton. Que se passe-t-il lorsqu’il n’existe aucune possibilité de reclasser le salarié au sein de l’entreprise ?
M. Le rapporteur. Il doit être licencié.
M. Bernard Accoyer. Tout d’abord, j’observe que, dans le titre V, le médecin du travail est traité comme un intermédiaire dont on ne fait pas grand cas. Du reste, les médecins du travail, qui se trouvent dans une situation très difficile parce qu’ils sont de moins en moins nombreux et que leurs missions sont complexes, qu’il s’agisse des demandes sanitaires ou des examens d’aptitude, ne sont pas mentionnés. J’ajoute que la précédente réforme de la médecine du travail n’est pas encore totalement mise en œuvre, alors qu’elle prenait en compte la raréfaction des médecins du travail en favorisant le déploiement d’équipes sanitaires. Il est dommage que nous passions sur cette réforme comme si de rien n’était. Mais cela est dû au manque de concertation préalable avec les médecins du travail.
Par ailleurs, M. Sebaoun estime que l’obligation de reclassement ne peut pas être satisfaite lorsque l’employeur ne propose qu’un seul autre poste. Nous savons pourtant combien il est difficile, dans de nombreuses entreprises, d’aménager ou de trouver des postes pour les salariés devenus inaptes à leur poste précédent. Cet amendement va donc un peu loin.
M. le rapporteur. Tout d’abord, l’amendement AS501 doit être en partie satisfait par l’adoption de l’amendement AS1020, qui a réintroduit la notion d’emploi. Néanmoins, il vise à supprimer les deux nouveaux motifs de rupture du contrat de travail créés par le projet de loi, c’est-à-dire le cas où le maintien du salarié serait gravement préjudiciable à sa santé et le cas où l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’entreprise. Or, ces dispositions permettent notamment de répondre aux effets de la jurisprudence de la Cour de cassation, qui oblige l’employeur à rechercher un poste de reclassement alors même que le salarié est déclaré inapte à tout poste dans l’entreprise ou que le médecin du travail a mentionné que son maintien dans l’entreprise serait gravement préjudiciable à son état de santé. Il s’agit en particulier de situations de risque grave pour la santé mentale du salarié.
Sur le fond, cet amendement a également pour effet de supprimer des éléments qui me semblent essentiels pour le salarié : la motivation en cas d’impossibilité de licenciement, la procédure de licenciement et les conditions limitativement énumérées de rupture du contrat de travail. Ces garde-fous doivent être précisés dans la loi. Avis défavorable.
M. Gérard Sebaoun. J’entends les arguments du rapporteur. En ce qui concerne la réintroduction de la notion d’emploi, je crois qu’il a raison. Toutefois, si l’on peut comprendre que l’inaptitude du salarié à tous les postes constitue un motif de rupture du contrat de travail, le fait qu’on puisse licencier une personne après lui avoir fait une seule proposition de reclassement pose un véritable problème. Il est vrai que les deux sujets sont un peu différents ; ma proposition de suppression est donc peut-être un peu abrupte. Mais l’amendement du rapporteur visant à rétablir la notion d’emploi a les mêmes motifs que le mien sur ce point. Il s’agit, du reste, d’une jurisprudence constante de la Cour de cassation, qui cherche à éviter ainsi que la proposition de reclassement ne soit partielle ou un peu trop rapide. Je vais cependant retirer mon amendement, et nous en rediscuterons en séance publique.
L’amendement est retiré.
La Commission adopte l’amendement rédactionnel AS1024 du rapporteur.
Puis elle examine l’amendement AS1025 du rapporteur.
M. le rapporteur. L’article L. 1226-2-1 définit les conditions de rupture du contrat de travail en cas d’impossibilité de reclassement du salarié déclaré inapte lorsque cette inaptitude est d’origine non professionnelle. Il serait ainsi possible de rompre le contrat si le maintien du salarié dans l’entreprise est gravement préjudiciable à sa santé ou si son état de santé fait obstacle à tout reclassement dans l’entreprise. Le dispositif circonscrit toutefois l’obligation de reclassement à la seule entreprise et limite les possibilités de reclassement au sein du groupe auquel appartient éventuellement l’entreprise. Elle est donc moins protectrice des droits du salarié déclaré inapte. Ces nouveaux motifs de rupture du contrat remettent par ailleurs en question la jurisprudence dégagée par la Cour de cassation sur la notion de « groupe de reclassement », applicable au licenciement économique comme au licenciement pour inaptitude. Je propose donc de revenir sur ces éléments.
La Commission adopte l’amendement.
Puis elle examine les amendements identiques AS398 de M. Christophe Cavard et AS609 de M. Denys Robiliard.
Mme Véronique Massonneau. L’obligation de reclassement qui incombe à l’employeur est, en l’état actuel du texte, réputée satisfaite dès lors qu’il a proposé au salarié un poste en prenant en compte l’avis et les indications du médecin. Par l’amendement AS398, nous proposons que cette présomption de respect de l’obligation de reclassement soit réputée inexistante dès lors que l’employeur n’aura proposé au salarié qu’un seul poste de reclassement.
M. Gérard Sebaoun. Il s’agit, ici, de supprimer la possibilité pour l’employeur de ne proposer au salarié qu’un seul poste de reclassement.
M. le rapporteur. Je n’ai pas tout à fait la même lecture de l’alinéa 22 que les auteurs des amendements. Celui-ci dispose en effet que, pour que l’obligation soit satisfaite, l’employeur doit tenir compte d’une procédure de reclassement définie et encadrée. Je ne suis donc pas certain que l’obligation de reclassement soit remise en cause. Il est toujours possible pour le salarié de contester la non-application du dispositif. Or, je ne pense pas qu’un employeur oserait prendre le risque d’un contentieux en n’accomplissant pas les diligences nécessaires. La présomption n’efface pas l’obligation, même si elle aboutit à un renversement de la charge de la preuve. J’ajoute que nous avons assoupli le dispositif en adoptant l’amendement proposant le retour à la notion d’emploi. Je suggérerai donc à Mme Massonneau et à M. Sebaoun de retirer leurs amendements.
Les amendements sont retirés.
L’amendement AS509 de Mme Martine Carrillon-Couvreur n’a plus d’objet.
La Commission adopte ensuite l’amendement rédactionnel AS1026 du rapporteur.
Puis elle examine, en discussion commune, les amendements AS1027 du rapporteur et AS502 de M. Gérard Sebaoun.
M. le rapporteur. Il s’agit, là encore de substituer, le mot : « emploi » au mot : « poste » à propos, cette fois, de l’inaptitude professionnelle.
M. Gérard Sebaoun. L’amendement AS502 est défendu.
La Commission adopte l’amendement AS1027.
En conséquence l’amendement AS502 tombe.
La Commission adopte l’amendement rédactionnel AS1028 du rapporteur.
Puis elle examine l’amendement AS1029 du rapporteur.
M. le rapporteur. Il s’agit d’une déclinaison de l’amendement AS1023, applicable à l’inaptitude professionnelle.
La Commission adopte l’amendement.
En conséquence, l’amendement AS499 tombe.
Puis elle examine l’amendement AS1030 du rapporteur.
M. le rapporteur. Il s’agit, là encore, de remplacer les mots « l’entreprise » par les mots : « un emploi ».
La Commission adopte l’amendement.
Puis elle examine l’amendement AS503 de M. Gérard Sebaoun.
M. Gérard Sebaoun. Cet amendement s’inscrit dans la même logique que l’amendement AS501. Je le retire.
L’amendement est retiré.
L’amendement AS511 de Martine Carrillon-Couvreur n’a plus d’objet du fait de l’adoption de l’amendement AS1020 du rapporteur.
La Commission adopte l’amendement rédactionnel AS1031 du rapporteur.
Puis elle examine l’amendement AS508 de M. Gérard Sebaoun.
M. Gérard Sebaoun. Cet amendement a trait aux postes à risque. La notion de tiers, que nous avons introduite dans la loi de 2015 relative au dialogue social et à l’emploi est, selon les syndicats de médecins du travail notamment, vaste et difficile à définir. Le présent projet de loi la conserve néanmoins, tout en la restreignant à « l’environnement immédiat de travail ».
Actuellement, les postes de sécurité sont soumis à des mesures de surveillance strictes puisqu’ils nécessitent une visite de la médecine du travail, d’une part, et un certificat délivré par des médecins experts, d’autre part. C’est le cas notamment pour les pilotes de ligne ou les conducteurs de train.
Par ailleurs, on crée la notion de poste présentant un risque pour le salarié, pour ses collègues et pour les tiers. Ce faisant, on bascule, me semble-t-il, vers une médecine qui n’est plus préventive. Je prendrai trois exemples pour illustrer mon propos. Lors de son examen d’embauche, on découvre qu’un salarié est amblyope, c’est-à-dire qu’il a une faiblesse visuelle très importante. Doit-on lui interdire de travailler dans le bâtiment, où les postes sont à risque ? Par ailleurs, que se passera-t-il si un salarié épileptique parfaitement stabilisé cache son affection au moment de son embauche ou si un salarié diabétique souffre de crises d’hypoglycémie, ce qui présente un risque pour lui-même, pour ses collègues et éventuellement pour des tiers ?
La notion de poste à risque et, par conséquent, celle de postes qui ne sont pas à risque sont donc extrêmement difficiles à déterminer par décret. Le médecin du travail est pris en tenaille, car il doit délivrer un certificat d’aptitude qui n’a pas grand intérêt dans la mesure où il ne dispose pas toujours de tous les éléments. On entre ainsi dans un autre système, écarté par Hervé Gosselin dans son rapport de 2007, qui rapproche la médecine préventive telle qu’elle a été construite depuis 1946 de la médecine dite « de sécurité » qui est en vigueur dans d’autres pays. Nous pourrions basculer véritablement vers cet autre système, et pourquoi pas ? De fait, puisqu’on manque de ressources, il faudra bien que le rôle des médecins évolue. Mais la question n’est pas tranchée ; nous naviguons entre deux eaux. Quoi qu’il en soit, je ne suis pas certain que ce soit au médecin d’assumer la responsabilité de la sécurité des tiers lorsqu’il sélectionne le salarié au moment de l’embauche.
M. Bernard Accoyer. Il y a dans le fait que ce texte, dont ce n’est pas l’objet principal, traite de la médecine du travail une ambiguïté qui peut expliquer certaines anomalies. En tout cas, le projet de loi pâtit à l’évidence d’une préparation insuffisante puisque aucune concertation n’a été organisée avec les médecins du travail, et les équipes qui les entourent car la vérification de l’aptitude d’un salarié ne relève pas forcément de médecins diplômés en médecine du travail, lesquels sont de moins en moins nombreux. Par ailleurs, le recours à un médecin expert, qui est un objet médical non identifié, est incompatible avec le code de l’éthique médicale. Du reste, le Conseil national de l’ordre des médecins n’a pas été consulté lors de la préparation du présent projet de loi.
Une telle improvisation est très dommageable, car la question est grave, que ce soit du point de vue des salariés eux-mêmes, qui sont forcément dans une situation difficile, ou du point de vue de la définition des postes dits à risque ou exigeant une aptitude particulière, l’établissement de l’aptitude n’étant pas défini de façon suffisamment précise. L’amendement de notre collègue Sebaoun n’apporte pas toutes les réponses, mais il soulève les bonnes questions.
M. Michel Issindou. M. Accoyer peut lire mon récent rapport sur le sujet, dont l’article 44 est un peu la traduction. Je conçois que ces dispositions ne le satisfassent pas, mais il ne peut pas dire qu’aucune concertation n’a été organisée : nous avons procédé à 78 auditions et rencontré de très nombreux salariés et médecins du travail notamment. M. Sebaoun et moi avons une approche différente du problème. Dans le cadre de ce rapport, nous sommes partis d’un constat très simple, celui de la pénurie de médecins du travail. Celle-ci est si importante qu’actuellement, les obligations légales ne sont pas respectées. Je rappelle en effet que chaque salarié doit, tous les deux ans, passer une visite chez un médecin du travail. Or, actuellement, nous sommes très loin du compte. L’administration accorde même des dérogations qui portent à quatre, cinq ou six ans, voire beaucoup plus, le délai séparant deux visites.
La position d’Hervé Gosselin, qui a participé avec moi à la mission de 2014, a évolué depuis le rapport qu’il a remis en 2007. Nous avons défini grosso modo trois catégories de postes. La première catégorie regroupe les postes dits de sécurité – celui de pilote de ligne, par exemple – qui doivent être soumis aux contrôles les plus stricts, même si ceux-ci ne sont pas infaillibles, comme en témoigne l’affaire de la Germanwings. La deuxième catégorie est celle des postes dits à risque dont le nombre doit demeurer raisonnable. Je reconnais que nous avons encore quelques difficultés à les définir très clairement, mais ils sont déjà connus, puisqu’ils sont décrits dans le rapport. Les salariés qui occupent ces postes doivent voir, avant leur embauche puis de manière régulière, le médecin du travail, car, pour diverses raisons, leur travail met en jeu leur santé – il existe, du reste, de nombreuses similitudes entre ces postes à risque et les cas de pénibilité. Ces postes exigent, non pas des visites de contrôle, mais une prévention régulière destinée à s’assurer que ces personnes sont en bonne santé.
La troisième catégorie regroupe l’ensemble des autres postes. Nous devons faire face à la pénurie : les effectifs de médecins du travail sont de 5 000 équivalents temps plein et ils ne seront plus que de 2 500 dans quinze ans. La situation est dramatique ! Aujourd’hui, seulement 3 millions des 20 millions de visites d’embauche – leur nombre a augmenté en raison de la multiplication des CDD et des contrats d’intérim – qui devraient être organisées sont effectuées. Beaucoup de salariés commencent à travailler, et parfois même quittent l’entreprise, avant d’avoir passé la visite médicale. On peut déplorer cette pénurie et réclamer que l’on revalorise cette belle médecine à laquelle je crois, mais le fait est qu’elle est en train de se casser la figure. Nous avons donc estimé – et c’est pourquoi je ne soutiens pas cet amendement – qu’il fallait cibler les salariés les plus exposés et définir des priorités. Ainsi ceux qui présentent apparemment le moins de risques doivent être vus à intervalles plus longs, de quatre à cinq ans au maximum. C’est une mesure de bons sens, et c’est dans cet esprit que le texte a été bâti.
La visite d’embauche peut être décalée à l’après-embauche ; il s’agirait d’une visite de prévention qui consisterait en un entretien avec le salarié. Les visites seraient donc rapprochées pour ceux qui en ont besoin et plus espacées pour les autres. C’est, de fait, ce qui se passe aujourd’hui. Or, il faut mettre la loi en accord avec les pratiques. On ne peut pas continuer à faire semblant d’ignorer le problème. C’est pourquoi l’article 44, qui me satisfait pleinement, va dans le bon sens : il correspond à ce qu’est la réalité de la médecine du travail.
Mme la présidente Catherine Lemorton. J’ajouterai que l’on peut se demander ce qu’il en serait si tous les employeurs qui ne sollicitent pas du tout la médecine du travail se réveillaient subitement…
M. Gérard Sebaoun. Je veux dire deux choses. Premièrement, la loi n’est pas là pour gérer la pénurie. Deuxièmement, mon amendement a trait aux postes à risque, car la notion de tiers y est inhérente. Or, c’est une notion extrêmement large. Certes, il y a eu l’accident de Germanwings, mais on ne sait pas, aujourd’hui, comment on aurait pu empêcher ce pauvre pilote de provoquer ce crash, sauf en violant le secret médical – mais c’est un autre débat. La notion de sécurité des tiers, même si elle est limitée à l’environnement immédiat du salarié, a été créée suite à certains événements. Or, je ne suis pas certain qu’elle corresponde à la réalité décrite par Michel Issindou. Je m’en tiens donc à mon amendement.
Mme Isabelle Le Callennec. Cet article a toute sa place dans un projet de loi qui a pour objet de protéger les entreprises et les actifs. C’est pourquoi je m’inquiète que, selon M. Issindou, l’article 44 ne fasse que traduire « un petit peu » les recommandations que contient son rapport, qui m’a paru très intéressant. Sur le terrain, on continue à se heurter à des difficultés, malgré les nombreuses réformes de la médecine du travail qui sont intervenues. Aussi, je me demande quelles améliorations apportera l’article 44 : sera-t-on allé suffisamment loin ? L’intitulé du titre V, « Moderniser la médecine », du travail est ambitieux, surtout lorsque l’on sait que ce titre ne comporte qu’un article et que l’on a entendu les réserves qui viennent d’être formulées.
Je crois néanmoins que le principe de réalité nous impose de cibler les moyens disponibles. De fait, les entreprises ne respectent plus leurs obligations légales, mais comment le pourraient-elles dès lors que l’on manque de médecins du travail ? Au demeurant, de nombreux salariés se portent bien. En voulant être parfait, on manque l’objectif. Mais l’article 44 ne permettra pas de résoudre tous les problèmes de la médecine du travail, alors que si l’on veut continuer à attirer les salariés, notamment les jeunes, dans l’industrie, il faut être attentif à la santé au travail.
M. le rapporteur. M. Sebaoun s’interroge sur la notion d’atteinte à la sécurité des tiers et sur celle de poste à risque. La première peut laisser penser qu’on impose au médecin du travail une nouvelle mission, détachable des objectifs du service de santé au travail, et que la mission du médecin relève plus d’une médecine de contrôle que d’une médecine de prévention. Mais, en recentrant la rédaction sur les risques d’atteinte à la sécurité des tiers et en la limitant à l’environnement immédiat de travail, on limite ce risque. Quant à la notion de poste à risque, qu’il est en effet difficile de définir, elle consiste à cibler les postes les plus exposés et dangereux pour le salarié et dont les conséquences peuvent également concerner des tiers évoluant dans l’environnement immédiat de travail. Il n’en demeure pas moins qu’il nous faudra être particulièrement vigilants quant aux précisions qui pourraient être apportées dans le cadre réglementaire. J’entends donc les inquiétudes de M. Sebaoun, mais il me semble que le texte contient quelques éléments de nature à les apaiser, même si, il faut avoir le courage de le dire, il s’agit bien d’un basculement. Avis défavorable.
La Commission rejette l’amendement.
La Commission est saisie de l’amendement AS227 de Mme Isabelle Le Callennec.
Mme Isabelle Le Callennec. Cet amendement vise à circonscrire la responsabilité de l’employeur lorsqu’il a accompli toutes les diligences pour que soient organisées les visites en matière de médecine du travail. Nul ne peut être tenu par des obligations qu’il n’est pas en son pouvoir d’accomplir. Or il n’est pas dans le pouvoir de l’entreprise d’organiser, à la place de l’État, la formation des médecins du travail, leur numerus clausus, la carte médicale ou encore leur temps de travail.
L’entreprise n’a pas, qui plus est, le droit de recourir à une autre ressource médicale, le code du travail instaurant le monopole de la médecine du travail. Elles sont, de ce fait, très nombreuses à se trouver en difficulté : elles voudraient respecter leurs obligations légales, mais ne le peuvent tout simplement pas, car elles ne trouvent pas de médecins disponibles. Il n’est pas question qu’elles soient pénalisées pour cela. De plus, elles cotisent, elles paient et elles n’obtiennent pas le service !
M. le rapporteur. Il y a une petite différence avec le débat que nous avons eu tout à l’heure : en l’espèce, c’est la santé des salariés qui est en jeu. Vous proposez, ni plus ni moins, d’exonérer l’employeur de sa responsabilité en cas d’impossibilité de réaliser les visites médicales. Plutôt que d’introduire une telle disposition dans la loi, je préfère trouver les moyens de rendre la médecine du travail effective, en en changeant certaines modalités. C’est ce qui est proposé à travers ce projet de loi, et c’est tout l’enjeu du débat. En préconisant, à brûle-pourpoint, d’exonérer l’employeur de ses obligations, vous faites un raccourci qui me semble un peu rapide. Avis défavorable.
Mme Isabelle Le Callennec. Pensez-vous que nous allons résoudre le problème de la médecine du travail avec cet article 44 ? Pour ma part, j’en doute.
M. le rapporteur. Notre ambition, avec cet article, c’est de modifier l’organisation de la médecine du travail afin qu’elle puisse assumer les missions qui lui sont confiées. Cette organisation différente fait, j’en conviens, l’objet de désaccords.
La Commission rejette l’amendement.
Puis elle examine l’amendement AS505 de M. Gérard Sebaoun.
M. Gérard Sebaoun. La fin de l’alinéa 60 est redondante. Je propose de la supprimer.
M. le rapporteur. La précision apportée par le texte m’apparaît utile, s’agissant notamment du collaborateur médecin qui peut intervenir dans le cadre du service de santé au travail. Je vous invite à retirer votre amendement.
M. Gérard Sebaoun. La liste des professionnels de santé concernés est déjà indiquée dans la loi de 2011 relative à l’organisation de la médecine du travail.
M. Bernard Accoyer. Elle est d’ailleurs restrictive !
L’amendement est retiré.
La Commission en vient à l’amendement AS507 de M. Gérard Sebaoun.
M. Gérard Sebaoun. Je suis d’accord avec l’idée de confier les visites les plus simples, notamment celle qui est effectuée à l’embauche, à une infirmière dûment formée, conformément aux recommandations des rapports de Michel Issindou et d’Hervé Gosselin. La loi de 2011 le permet déjà dans certains cas. Cependant, les petites entreprises sont très inquiètes de la disparition du certificat d’aptitude. Je propose que l’infirmière puisse délivrer une attestation à l’issue de la visite. Cela rassurerait beaucoup les petites entreprises que nous avons rencontrées. Je précise que ce document n’aurait aucune valeur du point de vue de la responsabilité de l’employeur.
M. Bernard Accoyer. Il y a plusieurs questions. Premièrement, les visites médicales d’aptitude posent, nous le savons, un problème gravissime en raison du manque de médecins du travail. Deuxièmement, les infirmières ne sont pas habilitées à délivrer un certificat médical d’aptitude, même si elles ont suivi une formation préalable. Quelle serait la valeur d’un tel document devant une juridiction en cas de contentieux ? Ce point n’est pas résolu. On voit bien que le titre V du projet de loi ne répond pas aux problèmes très graves qui se posent en matière de médecine du travail.
Mme Isabelle Le Callennec. J’ai entendu dire que les infirmières n’avaient pas accès au dossier médical du patient. Est-ce le cas ? En leur donnant cette possibilité, nous franchirions une étape supplémentaire, mais j’ai cru comprendre qu’il y avait des résistances.
M. Gérard Sebaoun. En droit, vous avez raison : une infirmière ne peut pas consulter un dossier médical ; seul un médecin peut le faire. Cependant, si vous lisez bien le projet de loi, nous ne sommes pas dans ce cadre-là : l’infirmière aura la responsabilité, sous la coordination du médecin et en respectant un cahier des charges très strict, d’accueillir le salarié et de lui donner des informations sur son poste et sur le suivi médical dont il bénéficiera. Cela ne va pas plus loin.
Quant à l’attestation, elle indiquerait simplement que le salarié a été vu par un professionnel de santé de l’équipe pluridisciplinaire de santé au travail. Encore une fois, les syndicalistes et les responsables de petites entreprises m’ont dit que la suppression du certificat d’aptitude les inquiétait, même si je leur ai bien précisé qu’il ne les exonérait de rien.
M. Michel Issindou. J’ai bien entendu l’argumentation de Gérard Sebaoun, mais veillons à ne pas rétablir la visite d’aptitude par le biais de cette attestation. La terminologie employée est un peu ambiguë. Il s’agit d’une visite de prévention et d’information.
Les employeurs m’ont dit la même chose qu’à Gérard Sebaoun, mais il faut qu’ils sortent de l’illusion que le certificat d’aptitude les protégeait contre tout problème qui pouvait survenir ultérieurement dans l’entreprise : il ne les protégeait en rien – lorsque l’on approfondit la question avec eux, on s’aperçoit d’ailleurs qu’ils en sont conscients. La jurisprudence est constante : ils ont une obligation de résultat en ce qui concerne la sécurité de leurs salariés.
Il ne faut pas leur donner le sentiment que, tout en supprimant la visite d’aptitude, nous recréons un document qui se rapproche du certificat d’aptitude. La trace du passage du salarié au service de santé au travail à telle date sera inscrite dans les fichiers. L’employeur pourra obtenir cette information. Une attestation de ce passage n’aurait qu’une valeur symbolique et me paraît inutile. Du reste, je ne suis pas sûr que cela irait dans le sens de la simplification.
M. le rapporteur. Revenons à ce qui est écrit dans l’amendement : il n’y est pas question de certificat médical validant quoi que ce soit. Gérard Sebaoun a expliqué que, compte tenu des habitudes, une forme d’inquiétude se manifestait, et que l’attestation n’aurait aucune valeur juridique particulière, puisqu’elle indiquerait simplement que le salarié est passé au service de santé au travail. La délivrance d’une telle attestation est d’ailleurs ce que vous suggérez dans la recommandation numéro 5 de votre rapport, monsieur Issindou.
M. Michel Issindou. Alors, c’est une excellente mesure !
M. le rapporteur. Je m’abrite donc derrière votre rapport et donne un avis favorable à l’amendement de M. Sebaoun.
La Commission adopte l’amendement.
Puis elle est saisie de l’amendement AS583 de Mme Véronique Massonneau.
Mme Véronique Massonneau. L’alinéa 62 de l’article 44 tend à conditionner les modalités et la périodicité des visites d’information et de prévention effectuées après l’embauche aux conditions de travail, à l’état de santé du travailleur, à son âge, ainsi qu’aux risques professionnels auxquels il est exposé. Cet alinéa soulève deux problèmes majeurs.
D’abord, celui de la gestion des risques rencontrés par le salarié au cours de sa carrière. Aujourd’hui, tout salarié est exposé à des risques directs d’un raccourcissement de l’espérance de vie ou de troubles psychosociaux, tels que l’épuisement professionnel – burnout. Établir une liste exhaustive de ces risques est inenvisageable, d’autant que cela pourrait exclure des salariés de ces visites pourtant nécessaires.
Ensuite, celui du rapport entre le médecin et le patient, qui sera différent selon que le salarié est exposé ou non à des risques professionnels.
Plus généralement, cette disposition modifie en profondeur la philosophie originelle de la médecine du travail : avec ce texte, on tente d’adapter l’homme au travail en s’assurant qu’il est en mesure de supporter les risques, alors que la mission première de la médecine du travail est d’essayer de supprimer ces mêmes risques.
M. Gérard Sebaoun. Je suis opposé à cet amendement. La catégorie des salariés exposés à des risques est, on l’a dit, difficile à définir. Tous les autres salariés passeront une visite d’information et de prévention, au cours de laquelle on leur donnera non seulement des informations sur leur poste de travail et sur les risques, mais aussi la ligne à suivre pour assurer leur propre surveillance. En outre, tout salarié et tout employeur peut faire appel à tout moment au médecin du travail s’il y a un risque particulier.
L’alinéa 62 me paraît utile : il permet de prendre en compte les conditions de travail, l’état de santé, l’âge du travailleur et les risques professionnels.
Mme Véronique Massonneau. On crée tout de même deux catégories de salariés !
M. Bernard Accoyer. Je partage l’avis de M. Sebaoun. L’alinéa 62 est particulièrement important. Il fonde même l’intérêt de tout un pan de la médecine du travail. Je voterai évidemment contre cet amendement.
M. le rapporteur. Je partage également l’analyse de M. Sebaoun. La distinction entre les salariés exposés à des risques et les autres salariés existe déjà. En outre, en supprimant l’alinéa 62, vous remettez en cause le suivi particulier dont bénéficient plusieurs catégories de salariés : les travailleurs âgés de moins de dix-huit ans, les femmes enceintes, les travailleurs handicapés et les salariés exposés à l’amiante, aux rayonnements ionisants, au plomb, au risque hyperbare, au bruit, aux vibrations, aux agents biologiques ou aux agents cancérigènes. Avis défavorable.
La Commission rejette l’amendement.
Puis elle rejette l’amendement AS506 de M. Gérard Sebaoun.
Elle en vient à l’amendement AS399 de M. Christophe Cavard.
Mme Véronique Massonneau. Cet amendement vise à préciser que tout salarié a la possibilité de solliciter une visite médicale lorsqu’il anticipe un risque d’inaptitude. Il s’agirait d’une démarche bénéfique à tous, qui permettrait au salarié d’alerter sur son état de santé. Elle serait sécurisante pour le salarié, mais aussi pour l’entreprise, qui gagnerait en visibilité sur les salariés et leurs éventuels problèmes de santé.
M. le rapporteur. La possibilité de solliciter une visite médicale n’est pas remise en cause. Selon moi, l’amendement n’a pas d’objet. Avis défavorable.
L’amendement est retiré.
La Commission adopte successivement les amendements rédactionnels AS1033 et AS1032 du rapporteur.
Puis elle examine l’amendement AS336 de M. Gérard Sebaoun.
M. Gérard Sebaoun. Le projet de loi prévoit qu’un employeur ou un salarié contestant l’avis d’inaptitude puisse saisir le conseil de prud’hommes en référé d’une demande de désignation d’un médecin expert inscrit sur la liste des experts près la cour d’appel.
Depuis la loi Rebsamen, le droit en vigueur est le suivant : l’employeur ou le salarié s’adresse, en informant l’autre partie, à l’inspecteur du travail, qui s’adresse à son tour au médecin contrôleur régional. L’inspecteur du travail n’a, certes, aucune compétence médicale, mais il connaît l’entreprise, ce qui n’est pas neutre. Quant aux médecins contrôleurs régionaux, ils sont peu nombreux – une quarantaine –, mais ils ont une vraie compétence en matière de santé au travail.
Il me paraît contre-productif d’attribuer le contentieux de l’inaptitude aux conseils de prud’hommes, certains d’entre eux étant très encombrés. En outre, il y a encore très peu d’experts en santé au travail – je n’en ai trouvé aucun près la cour d’appel de Paris, ni près celle de Versailles. Je propose donc d’en rester au système actuel.
M. le rapporteur. Il y a un principe, un constat et des interrogations.
Le principe, c’est, d’une part, que l’appréciation et la remise en question d’une décision d’ordre médical ne peuvent être faites que par un médecin et, d’autre part, que l’appréciation des propositions de reclassement revient au juge du travail.
Le constat, c’est que le système actuel ne fonctionne pas, car le contentieux est un processus long. Gardons à l’esprit que, pour le salarié, la protection des droits doit être garantie. Telle est l’exigence qui doit nous animer.
Quant à mes interrogations, elles portent sur le réseau des médecins experts – vous vous êtes posé la même question, monsieur Sebaoun – et sur le coût du recours à l’expertise. J’ai demandé des éléments d’information complémentaires. J’espère que je les obtiendrai d’ici à la séance publique et qu’ils permettront de lever nos interrogations. En attendant, je vous invite à retirer votre amendement.
M. Gérard Sebaoun. Il n’y a que 1 500 recours par an environ contre les avis du médecin du travail, mais c’est une question importante. Je reconnais que les procédures sont longues dans le système actuel.
L’amendement est retiré.
La Commission adopte l’amendement rédactionnel AS1035 du rapporteur.
Les amendements AS608 et AS607 de M. Denys Robiliard sont retirés.
La Commission en vient à l’amendement AS570 de M. Gérard Sebaoun.
M. Gérard Sebaoun. Le rapport Gosselin de 2007 a évoqué la création d’une sorte de droit d’alerte auprès de l’employeur pour le médecin du travail, lorsque celui-ci constate que plusieurs salariés d’un même collectif de travail – entreprise, atelier, grande direction – font état des mêmes difficultés. L’employeur aurait l’obligation de répondre et le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) ou, à défaut, les délégués du personnel, serait informé de la nature des difficultés – sans que lui soit communiqué le nom des personnes concernées. J’ai trouvé cette idée intéressante. Il s’agit d’un amendement d’appel.
M. le rapporteur. Une partie de votre amendement est satisfaite par l’article L. 4624-3 du code du travail, qui deviendra l’article L. 4624-9 si le projet de loi est adopté. Cet article prévoit une procédure d’alerte médicale qui prend une forme écrite. S’ensuit un échange avec l’employeur, ainsi qu’une information du CHSCT ou, à défaut, des délégués du personnel, ainsi que de l’inspection du travail. Dans votre amendement, vous n’envisagez pas le cas d’un refus opposé par l’employeur aux mesures proposées par le médecin du travail. Vous ne reprenez donc pas l’obligation incombant à l’employeur de motiver ce refus. Or ce point me semble important.
Toutefois, vous proposez deux innovations intéressantes : le fait que la réponse de l’employeur doit être rapide et l’inscription de la question à l’ordre du jour du CHSCT. Ces deux dispositions complémentaires pourraient être introduites dans le futur article L. 4624-9. Je vous invite à déposer un nouvel amendement à cette fin.
L’amendement est retiré.
La Commission adopte successivement les amendements rédactionnels ou de coordination AS1036, AS1037, AS1038 et AS1039 du rapporteur.
M. Bernard Accoyer. Je souhaite exprimer la déception du groupe Les Républicains. La médecine du travail est extrêmement importante, humainement, socialement et économiquement. Or le présent titre V a manifestement été écrit dans l’improvisation et sans véritable concertation, au premier chef avec les professionnels concernés. Ceux-ci attendaient une poursuite de la réforme précédente, qui était fondée sur le travail en commun, au sein d’équipes pluridisciplinaires et polyvalentes. Il n’en a pas été question. Des pans entiers de la médecine du travail, qui en forment pourtant le cœur, ont été ignorés. En outre, il y a un certain nombre de problèmes plus spécifiques : les règles en matière d’aptitude restent confuses, ce qui est très préoccupant ; le recours à des experts extérieurs pose question au regard du secret médical, car seul le médecin du travail ou le médecin de l’entreprise y est tenu. En somme, ce n’est pas un travail sérieux. Nous le regrettons et nous voterons contre l’article 44.
La Commission adopte l’article 44 modifié.
*
* *
La Commission examine l’amendement AS335 de M. Gérard Sebaoun.
M. Gérard Sebaoun. Il existe un petit nombre de services interentreprises de santé au travail. Ce sont des services autonomes auxquels les entreprises ont l’obligation d’adhérer. La loi de 2011 les a dotés d’un conseil d’administration paritaire, mais dont le président est toujours un employeur, et le trésorier, toujours un salarié. Cet amendement vise à rétablir un véritable paritarisme. Je suis sûr qu’il trouvera un écho favorable auprès du rapporteur, de Michel Issindou et d’autres collègues socialistes présents dans cette salle, qui avaient cosigné un amendement analogue défendu par Alain Vidalies au cours de la législature précédente.
M. le rapporteur. Merci pour ces précisions, cher collègue ! Je continue à partager ce point de vue, mais je pense que la question relève, en toute objectivité, de la négociation entre les partenaires sociaux. Je suis favorable au paritarisme, mais il me paraît difficile de l’imposer de cette manière dans la loi. Je vous invite à retirer votre amendement.
M. Gérard Sebaoun. Il s’agit d’un débat ancien : cette demande est formulée depuis longtemps par des organisations syndicales, mais elle se heurte à une réticence très forte de la part du Centre interservices de santé et de médecine du travail en entreprise (CISME). Nous avons créé une mission d’information relative au paritarisme, qui mène actuellement ses travaux. Or, dans les conseils d’administration de ces services, le paritarisme est mis en défaut. On me répond que c’est l’employeur qui paie. Certes, mais tel est le cas dans tous les régimes paritaires : c’est toujours l’employeur qui verse les cotisations, pour ses salariés ou pour d’autres. À la différence du rapporteur, je pense que cette proposition a bien sa place dans notre débat, de même qu’elle l’avait en 2011. Je suis étonné de sa réponse. Je ne retire pas mon amendement. Si vous votez contre, chers collègues, vous assumerez votre position.
M. Michel Issindou. J’ignore si je faisais partie des cosignataires en 2011, mais on ne peut pas imposer ce changement par un amendement, aussi intelligent soit-il. Au cours des auditions que j’ai menées ces derniers temps, cette demande n’est jamais venue dans la bouche des organisations syndicales les plus représentatives. Je sais bien qu’elle est exprimée par un syndicat en particulier, que vous connaissez mieux que moi, monsieur Sebaoun. Mais, pour les autres, ce n’est pas le sujet du jour.
Nous n’avons pas intérêt à rouvrir un débat sur la gouvernance, alors que nous avons déjà des difficultés à imposer une modernisation de la médecine du travail. J’ai d’ailleurs toujours dit que la réforme de 2011, qui a introduit la pluridisciplinarité, allait dans le bon sens, monsieur Accoyer, même si nous nous sommes parfois opposés sur d’autres points. Si nous adoptons cet amendement, nous allons déclencher une révolution au Conseil d’orientation des conditions de travail (COCT) et ailleurs. Cette question doit être discutée entre les partenaires sociaux. Il ne nous appartient certainement pas de la trancher. Nous sommes pour le dialogue et le partenariat.
M. le rapporteur. J’assume ma position. Je plaide pour que cette question soit traitée dans le cadre de la négociation. L’amendement étant maintenu, je lui donne un avis défavorable.
M. Gérard Sebaoun. Nous poursuivrons la discussion en séance publique.
La Commission rejette l’amendement.
L’amendement AS498 de M. Gérard Sebaoun est retiré.
La Commission examine l’amendement AS341 de M. Gérard Sebaoun.
M. Gérard Sebaoun. Cet amendement vise à sécuriser la situation des intervenants de l’équipe pluridisciplinaire de santé au travail, en particulier les infirmières et les collaborateurs médecins, qui ne bénéficient pas des mêmes protections juridiques que le médecin du travail. Or, dans la mesure où ils sont chargés de rencontrer les salariés lors de la visite d’embauche puis de les suivre, ils doivent être protégés de la même manière que la personne chargée de coordonner l’équipe.
M. le rapporteur. Je ne partage pas cette analyse. D’une part, le texte précise que les membres de l’équipe pluridisciplinaire sont placés sous l’autorité du médecin du travail et travaillent dans le cadre d’un protocole établi avec ce dernier sous sa responsabilité. D’autre part, ils n’exercent pas tout à fait les mêmes responsabilités que le médecin du travail, puisque ce dernier assume la fonction de surveillance préventive et est dépositaire du secret médical. La protection dont il bénéficie lui permet d’éviter toute forme de pression tendant à altérer sa mission. Avis défavorable.
M. Gérard Sebaoun. Les membres de l’équipe pluridisciplinaire ont tout de même des responsabilités importantes. La tendance actuelle est d’ailleurs au renforcement, par des heures de formation, des compétences des infirmières, peu nombreuses, qui exercent en santé au travail. Ces salariés devraient être mieux protégés.
La Commission rejette l’amendement.
*
* *
TITRE VI
RENFORCER LA LUTTE CONTRE LE DÉTACHEMENT ILLÉGAL
Article 45
(Art. L. 1262-4-1, L. 1262-4-4 [nouveau], L. 1264-1 et L. 1264-2 du code de travail)
Renforcement des obligations des maîtres d’ouvrage et des donneurs d’ordre lorsque ceux-ci ont recours à des prestataires établis à l’étranger
Faisant le constat que les maîtres d’ouvrage et les donneurs d’ordre doivent prendre leurs responsabilités dans l’identification particulièrement difficile du détachement illégal, cet article vise à compléter les dispositifs issus des lois du 10 juillet 2014 (105) et du 6 août 2015 (106) en vue de renforcer la vigilance des entreprises qui recourent aux travailleurs détachés, y compris dans le cadre du recours à des sous-traitants. Il leur confie ainsi de nouvelles obligations assorties de sanctions administratives.
a. Certains maîtres d’ouvrage et donneurs d’ordre ont bénéficié du travail détaché sans prendre pleinement leur part dans la lutte contre sa dimension frauduleuse
• Le cadre juridique du détachement
Le détachement de travailleurs permet à un employeur de faire travailler un de ses salariés temporairement dans un autre État que celui dans lequel il exerce son emploi habituellement. On parle alors d’une prestation de service internationale qui pose deux questions juridiques : celle du droit du travail applicable à ce travailleur présent temporairement dans un autre État que celui dans lequel il a conclu son contrat de travail et celle du droit de la sécurité sociale qui doit déterminer auprès de quel État il doit payer ses cotisations.
Les réponses apportées par le droit international s’étant rapidement révélées insuffisantes dans un marché aussi intégré que celui de l’Union européenne, celle-ci a rapidement développé une législation spécifique.
En matière de droit du travail, le détachement a d’abord été régi par la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles qui stipulait que les parties étaient libres de choisir les règles qui leur étaient applicables. À défaut, le contrat était régi par les règles du pays avec lequel le salarié avait le plus de liens.
Cette solution, inspirée par le droit international des contrats, est devenue insatisfaisante à la suite de l’intégration d’États comme la Grèce, le Portugal ou l’Espagne avec lesquels les écarts de rémunération étaient très importants, faisant craindre une concurrence déloyale aux États dont les salaires et les normes sociales étaient élevées. La nécessité de mieux encadrer ces asymétries sociales s’est faite encore plus impérieuse à la suite des accords de Schengen favorables à la circulation des personnes au sein de l’Union et a trouvé une première traduction dans la directive du 16 décembre 1996 (107). Ce texte encore en vigueur prévoit un « noyau dur » de dispositions en matière de droit du travail du pays d’accueil qui s’appliquent au travailleur détaché. Ce « noyau dur », prévu à l’article 3 paragraphe 1 de la directive, comprend :
– les périodes maximales de travail et les périodes minimales de repos ;
– la durée minimale des congés annuels payés ;
– le taux de salaire minimal (y compris la majoration pour heures supplémentaires) ;
– les conditions de mise à disposition des travailleurs (notamment pour les sociétés d’intérim ou les agences de placement qui mettent à disposition un travailleur pour une entreprise d’un autre État-membre) ;
– la sécurité, la santé et l’hygiène au travail ;
– les mesures de protection spécifiques aux conditions de travail des femmes enceintes, des femmes venant d’accoucher, des enfants et des jeunes ;
– l’égalité de traitement entre hommes et femmes ainsi que les autres dispositions en matière de discrimination.
L’objectif de ce « noyau » est d’éviter que le détachement ne devienne un instrument de contournement généralisé dans les États dont les standards sociaux sont élevés par le recours à des travailleurs venant d’États moins protecteurs. L’application insuffisante de cet encadrement a conduit à compléter l’arsenal juridique européen par l’adoption d’une directive d’exécution en 2014 (108) qui donne plus de latitude aux États-membres pour contrôler le recours au détachement.
En matière de droit de la sécurité sociale, le règlement CE 883/2004 (109) sur la coordination des systèmes de sécurité sociale prévoit à son article 12 que les travailleurs détachés continuent pendant une période maximale de 24 mois d’être affiliés au système de sécurité sociale de l’État dans lequel ils ont leur activité habituelle. Ils n’ont donc pas à verser de contributions à verser au système de sécurité sociale de leur pays d’accueil, ce qui explique les stratégies parfaitement licites d’optimisation sociale qu’engendre le recours massif au détachement.
Le droit français est dès lors pour l’essentiel un droit d’application, très encadré par les normes européennes et leur interprétation par la Cour de Justice. La définition en droit interne du détachement, prévue dès la loi quinquennale du 20 décembre 1993 à l’article L. 341-5 du code du travail, fait désormais l’objet des dispositions de l’article L. 1261-3 du même code : un travailleur détaché est un salarié d’un employeur régulièrement établi et exerçant son activité hors de France et qui, travaillant habituellement pour le compte de celui-ci, exécute son travail à la demande de cet employeur pour une durée limitée sur le territoire national.
Les articles L. 1262-1 et L. 1262-2 du code du travail définissent les conditions du détachement, à savoir :
– Les formes que peuvent prendre le détachement : par un employeur (pour réaliser un contrat avec un destinataire, pour un transfert interne ou intra-groupe ou sans contrat avec le destinataire) ou par une entreprise de travail temporaire ;
– Une condition d’établissement : l’employeur ou l’entreprise de travail temporaire doivent être établis à l’étranger ;
– Une condition tenant au lien juridique entre le salarié et l’entité qui procède au détachement : les relations contractuelles doivent perdurer pendant la période de détachement puisque le détachement est par définition temporaire.
Le détachement se résume ainsi comme une mission ponctuelle et temporaire, progressivement encadrée par le droit européen et national en raison des abus qu’il peut engendrer.
• Des enjeux importants
Le recours au travail détaché a connu depuis l’intégration en 2004 de nouveaux États-membres dans l’Union européenne un changement à la fois quantitatif puisque le nombre de travailleurs détachés en France a été multiplié par dix en quelques années et qualitatif puisque cette croissance considérable s’est accompagnée de la mise en place d’une optimisation sociale généralisée et systématique assortie parfois de fraudes au regard des règles nationales et européennes
Selon l’étude d’impact du présent projet de loi, les déclarations de prestations de services réalisées par entreprises étrangères sont au nombre de 73 593 et impliquent 228 649 travailleurs détachés correspondant à 42 000 emplois équivalents temps plein. En 2005, le détachement ne représentait que 6 455 déclarations pour 26 466 salariés détachés. La Pologne était le premier pays d’origine de la main d’œuvre détachée, devant le Portugal et la Roumanie.
Les secteurs de la construction et du bâtiment occupent une place particulière dans l’économie du travail détaché comme l’illustre le chiffre de 43 % des travailleurs déclarés en 2013 dans le secteur du BTP d’après les données de la Direction générale du travail (110). Le recours à ces travailleurs étrangers par certaines entreprises, souvent importantes, apportent des avantages significatifs en termes de coût grâce aux moindres cotisations sociales. Cette optimisation est licite puisque la règlementation européenne applicable permet à l’entreprise d’utiliser sur les chantiers des travailleurs qui payent les cotisations de leurs pays d’origine conformément au règlement européen de 2004. Il est également parfaitement licite au regard de la directive de 1996 de rémunérer tous les travailleurs détachés au salaire minimum là où les salariés français bénéficient de salaires plus élevés en raison de leur ancienneté par exemple. En revanche, le détachement devient illégal lorsqu’il conduit à du travail dissimulé ou à des conditions de travail qui méconnaissent le droit du pays d’accueil.
Dans ce cadre, la France a fait le choix de privilégier un système de déclaration préalable qui devrait en principe lui permettre de mieux connaître le phénomène. L’obligation de déclaration qui pèse sur ces entreprises est cependant une formalité légère conformément à la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne (111) qui fait obstacle à toute forme de restriction déguisée au principe de libre prestation. Il s’agit également d’une obligation qui fait l’objet d’un contournement généralisé puisqu’on estime que les déclarations comptabilisées ne représentent que la moitié des travailleurs effectivement présents sur le territoire français (112). La pratique en matière de déclarations ne permet donc pas à l’heure actuelle de lutter efficacement contre la fraude.
Dans ce cadre, le maître d’ouvrage, c’est-à-dire la personne publique ou privée qui a commandé l’ouvrage à l’entrepreneur qui s’engage à le lui fournir, et le donneur d’ordre, entendu comme celui qui fait appel au sous-traitant, ont chacun un rôle à jouer dans une meilleure identification du détachement. L’enjeu d’une meilleure connaissance des situations de détachement à travers le respect des obligations déclaratives est de mieux localiser les travailleurs et les prestations, de mieux identifier la nature de ces dernières et d’assurer un suivi statistique fiable pour lutter avec efficacité contre le détachement illégal. Or, faire appliquer aux maîtres d’ouvrage et donneurs d’ordre situés de manière pérenne sur le territoire français des obligations qui les incitent à leur tour, financièrement et par effet de réputation, à faire respecter le droit par leurs sous-traitants étrangers semble l’une des manières les plus efficaces de résoudre le problème de la fraude massive.
b. Des améliorations récentes ont créé une véritable obligation de vigilance de l’entreprise bénéficiaire du travail détaché et méritent d’être complétées
L’efficacité de la lutte contre le détachement illégal est très largement dépendante de l’étendue des obligations qui s’imposent aux maîtres d’ouvrages et donneurs d’ordre ainsi que des sanctions dont elles sont assorties.
Les articles L. 8222-1 à L. 8222-7 du code du travail issus de l’ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail avaient constitué une première étape en présentant les obligations et les conditions de la solidarité financière entre donneurs d’ordre ou maîtres d’ouvrage et leur co-contractant recourant au travail illégal en général.
Anticipant les nouvelles possibilités offertes par la directive du 15 mai 2014 (113) en matière de contrôle par les États-membres du détachement, la loi précitée du 10 juillet 2014 a créé plusieurs dispositifs de portée générale ou spécifiques au détachement :
– l’obligation pour l’employeur qui détache un salarié de déposer une déclaration préalable de détachement adressée à l’inspection du travail, assortie de sanctions ;
– la mise en place d’une obligation de vigilance pour les donneurs d’ordre ou maîtres d’ouvrage les conduisant à vérifier que leur cocontractant prestataire étranger a effectivement déposé une déclaration préalable de détachement ;
– de nouvelles sanctions administratives applicables à l’employeur, au donneur d’ordre ou au maître d’ouvrage en cas de manquement à l’obligation de dépôt d’une déclaration de détachement ;
– le renforcement des obligations du donneur d’ordre ou du maître d’ouvrage en cas de non-respect par l’employeur sous-traitant des règles du droit du travail ou en cas d’hébergement dans des conditions indignes ;
– la possibilité pour les officiers de police judiciaire de recourir à des mises sur écoute ou à des captations d’image en cas d’affaires graves de travail illégal.
Pour sa part, la loi du 6 août 2015 a renforcé cet encadrement par de nouvelles dispositions :
– le donneur d’ordre ou le maître d’ouvrage qui ne s’est pas vu remettre la copie de la déclaration de détachement, doit adresser lui-même une déclaration à l’inspection du travail sous quarante-huit heures. Rédigée en français, elle doit comprendre une présentation des activités ainsi que les coordonnées du maître d’ouvrage ou du donneur d’ordre, une présentation des activités ainsi que les coordonnées de l’établissement employant habituellement le travailleur détaché, les adresses et les dates auxquels la prestation a été effectuée ainsi que des éléments permettant d’identifier (nom, prénom, date et lieu de naissance) et de localiser ce travailleur dans son pays d’origine et en France (adresse, coordonnées téléphoniques, électroniques et postales) ;
– le maître d’ouvrage ou le donneur d’ordre qui a connaissance par un agent de contrôle du non-paiement total ou partiel du salaire au niveau minimum légal d’un travailleur détaché effectuant une prestation dont il est le destinataire doit enjoindre par écrit son co-contractant ou sous-traitant direct ou indirect de faire cesser la situation. À défaut, il est tenu solidairement du paiement des sommes dues au travailleur ;
– une nouvelle sanction de suspension de la prestation de service est désormais possible. La décision motivée est prononcée par l’autorité administrative compétente sur rapport d’un agent de contrôle constatant un manquement grave aux règles relatives au salaire minimum, au repos quotidien ou hebdomadaire ou à la durée maximale du travail. Le non-respect de cette sanction est lui-même passible d’une amende administrative ;
– le montant maximal fixé pour le total de l’amende administrative qui peut être prononcée en cas de manquement aux obligations de déclaration préalable ou de présentation à l’inspection du travail de documents traduits a été relevé de 10 000 euros à 500 000 euros.
a. Renforcer les obligations pesant sur les maîtres d’ouvrage et donneurs d’ordre en matière de déclaration du détachement
Le 1° complète les dispositions de l’article L. 1262-4-1 qui prévoient en l’état actuel du droit la vérification par le donneur d’ordre et le maître d’ouvrage que le prestataire de services co-contractant respecte les conditions du détachement de salariés ou de travailleur temporaire et l’obligation de transmission d’une déclaration à l’inspection du travail en cas de défaut de remise d’une copie de la déclaration préalable au détachement par l’entreprise prestataire.
Le a) du 1° ajoute un « I » à l’article L. 1262-4-1 en raison de la création d’un « II » portant sur l’obligation de vérification par le maître d’ouvrage que les sous-traitants respectent leurs obligations.
Le b) du 1° étend aux maîtres d’ouvrage et aux donneurs d’ordre, dont les cocontractants n’ont pas effectué la déclaration de détachement de leurs propres salariés, l’obligation de procéder à leur déclaration de détachement de manière dématérialisée. Le dispositif renvoie les conditions de la transmission par voie dématérialisée à un décret pris en Conseil d’État après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Une disposition similaire avait été adoptée dans la loi du 6 août 2015 mais ne concernait que les seuls employeurs (article L. 1262-2-2).
Il crée également un « II » qui fait obligation au maître d’ouvrage de procéder à la vérification avant le début du détachement, auprès de l’ensemble des sous-traitants directs ou indirects qui y ont recours, du respect des obligations prévues au I de l’article L. 1262-2-1, à savoir celle de transmission d’une déclaration préalable au détachement. Le champ de la vérification qui doit être opérée par le maître d’ouvrage comprend donc les sous-traitants directs de ses co-contractants, c’est-à-dire ceux qui exécutent tout ou partie du contrat d’entreprise ou d’une partie du marché public, mais aussi les sous-traitants indirects, c’est-à-dire les sous-traitants des sous-traitants. Conformément à l’article 3 de la loi du 31 décembre 1975, le sous-traitant de l’entreprise co-contractante doit être accepté par le maître d’ouvrage qui agrée les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance si bien que ce dernier connaît nécessairement l’ensemble des sous-traitants.
Cette obligation qui concerne l’ensemble de la chaîne de sous-traitance permettra de mettre un terme aux montages juridiques consistant à insérer une entreprise écran entre le prestataire et le maître d’ouvrage afin d’échapper aux règles de vigilance qui pèse sur ce dernier. Elle sert également de fondement à une sanction prévue par le 4° de cet article. Le 2° crée un nouvel article L. 1262-4-4 qui prévoit qu’une déclaration doit être obligatoirement envoyée à l’inspection du travail lorsqu’un salarié détaché est victime d’un accident du travail.
Aujourd’hui, ces règles sont prévues par l’article R. 1262-2 mais elles ne s’appliquent qu’aux salariés détachés non affiliés à un régime français de sécurité sociale. En cas d’accident, une déclaration est aujourd’hui envoyée à l’inspection du travail du lieu de survenance de cet accident, dans les quarante-huit heures. Pour les salariés affiliés à la sécurité sociale française, la déclaration d’accident du travail est adressée à la caisse primaire d’assurance maladie qui doit en informer l’inspection du travail de la survenance d’un accident du travail (article L. 441-3 du code de la sécurité sociale).
Lorsque le salarié est détaché par l’employeur pour son propre compte, cette déclaration est envoyée par l’employeur ou l’un de ses représentants.
S’il est détaché dans la cadre d’une prestation de service ou d’une mobilité intra-groupe, l’entreprise utilisatrice ou le donneur d’ordre accomplit la déclaration.
La consécration de cette obligation au niveau législatif emporte deux effets.
La rédaction met tout d’abord fin à la distinction entre salariés affiliées et non affiliés à la sécurité sociale française. Désormais, il revient à l’inspection du travail d’être préalablement informée de cet accident. Il s’agit notamment de mieux impliquer les maîtres d’ouvrage publics et privés dans le respect de la législation relative au droit du travail.
Le relèvement de ces dispositions au niveau législatif sert également de fondement juridique à l’application d’une sanction administrative en cas de manquement, prévue au 4°.
Le délai dans lequel la déclaration est effectuée et ses modalités sont renvoyés à un décret en Conseil d’État.
S’agissant de la personne à qui il revient d’effectuer cette déclaration, le texte reprend en l’adaptant les dispositions actuelles. Deux cas de figure sont prévus :
– dans le cadre d’un détachement pour compte propre, il revient à l’employeur de faire la déclaration (3° de l’article L. 1262-1) ;
– dans le cadre d’une prestation de service ou d’une mobilité intra-groupe, il appartient au donneur d’ordre ou au maître d’ouvrage co-contractant de faire la déclaration (1° et 2° de l’article L. 1262-1). Cette disposition s’appliquera également aux salariés détachés par une entreprise de travail temporaire établie hors du territoire national (article L. 1262-2).
Le 3° vise à modifier l’article L. 1264-1 créée par la loi du 6 août 2015.
Pour renforcer l’effectivité des obligations dont doit s’acquitter l’employeur en cas de détachement, le législateur les avait assorties d’une amende administrative. Le régime de l’amende ressortit à l’article L. 1264-3. Proportionnée, son montant est fixé par l’autorité administrative après constatation par un agent de contrôle de l’inspection du travail. Son montant maximal s’élève à 2 000 euros par salarié détaché. Il peut être relevé à un montant de 4 000 euros en cas de réitération dans un délai d’un an après la notification de la première amende. Un plafond de 500 000 euros est enfin fixé. Le délai de prescription d’une telle amende est de deux ans.
Le 3° vise à assortir d’une amende administrative les manquements de l’employeur aux dispositions du nouvel article L. 1264-4-4 relatives à la déclaration obligatoire d’un accident du travail d’un salarié détaché auprès de l’inspection du travail.
Le 4° procède à une rédaction globale de l’article L. 1264-2 relatif à la sanction du maître d’ouvrage ou du donneur d’ordre en cas de manquement à ses obligations de vigilance.
Institué par la loi du 6 mai 2015, cet article avait pour ambition de renforcer l’obligation de vigilance du maître d’ouvrage ou du donneur d’ordre formulée à l’article L. 1262-4-1. Pour en assurer l’effectivité, le législateur avait institué une amende administrative dont le régime relevait également de l’article L. 1264-3.
La nouvelle rédaction tient compte des modifications opérées par le présent article et prend ainsi acte de la réécriture de l’article L. 1262-4-1 et de la création de l’article L. 1262-4-4.
Son I prévoit la possibilité de prononcer une amende administrative à l’encontre du maître d’ouvrage ou du donneur d’ordre, dans les conditions prévues par l’article L. 1264-3 :
– en cas de méconnaissance des obligations de vigilances mentionnées au I de l’article L. 1262-2-1 comme le droit actuel le prévoit ;
– en cas de méconnaissance de l’obligation de déclaration d’un accident du travail d’un salarié détaché auprès de l’inspection du travail formulée par le nouvel article L. 1264-4-4.
Son II assortit enfin de la même peine les manquements du maître d’ouvrage aux nouvelles dispositions du II de l’article L. 1262-4-1 relatives à la vérification du respect des obligations de déclaration préalable de détachement par les sous-traitants directs ou indirects.
*
La Commission adopte les amendements rédactionnels AS981 et AS982 du rapporteur.
Puis elle adopte l’article 45 modifié.
*
* *
La Commission examine l’amendement AS332 de M. Gérard Cherpion.
Mme Isabelle Le Callennec. Nous sommes tout à fait favorables à l’article 45, que nous avons examiné très rapidement, puisqu’il renforce la lutte contre le détachement illégal.
L’amendement AS332 vise à exclure des dispositions destinées à lutter contre le dumping social, cette mobilité internationale, qui correspond à un détachement au sein d’un même groupe. C’est une possibilité importante qui, en l’état, est traitée comme un détachement externe.
M. le rapporteur. Cet amendement vise à modifier le I de l’article L. 1262-2-1 du code du travail de telle sorte que les entreprises qui procèdent à un détachement intra-groupe ne soient pas soumises à l’obligation de déclaration à l’inspection du travail, au motif que « ce type de mobilité ne porte pas atteinte aux intérêts des entreprises françaises et ne constitue pas une concurrence déloyale ».
J’estime, au contraire, que comme les autres formes de détachement, la mise à disposition d’employés entre entreprises appartenant à un même groupe ou entre établissements d’une société internationale donne lieu à de réels abus. C’est, par exemple, le cas des établissements dits « coquilles vides », bien connus des services de l’inspection du travail : ces entreprises qui n’exercent aucune véritable activité hors de France détachent néanmoins de manière continue des salariés provenant d’États où les conditions sociales sont moins avantageuses afin de remporter des marchés grâce au faible coût de main d’œuvre. Ces salariés, qui restent systématiquement moins de deux ans en France afin de continuer de relever de la sécurité sociale de leur pays d’origine, constituent une véritable concurrence déloyale pour les entreprises françaises. Les services de l’inspection du travail peinent à détecter ces situations. Or, si cet amendement était adopté, ces salariés deviendraient invisibles.
Quant à la déclaration de détachement, sa dématérialisation devrait faciliter les démarches de tous les entrepreneurs qui ont recours à ce mécanisme.
Il ne faut assouplir aucune des mesures de lutte contre le détachement illégal. Avis défavorable.
Mme Isabelle Le Callennec. J’entends vos arguments, monsieur le rapporteur, mais s’il existe des travailleurs détachés qui viennent en France, certaines entreprises françaises détachent aussi des salariés à l’étranger, une situation que vous balayez un peu vite en vous appuyant sur quelques exemples d’entreprises qui ne sont pas vertueuses.
Mme Catherine Coutelle. Elles sont nombreuses !
Mme Isabelle Le Callennec. Les entreprises visées sont, pour l’essentiel, des TPE et des PME.
La Commission rejette l’amendement.
*
* *
Article 46
(Art. L. 1262-4-5 [nouveau] du code du travail)
Création d’une contribution visant à compenser les coûts administratifs liés à la création d’un système de déclaration dématérialisé
L’efficacité des contrôles en matière de détachement illégal est fortement dépendante de l’information dont dispose l’administration du travail. La France, en retard en matière de dématérialisation des procédures de déclaration de détachement, doit mettre en place une base de données pour faciliter l’identification des fraudes sans disperser les moyens financiers déjà limités à la disposition des services de contrôle. Cet article vise à créer une contribution, dont les employeurs établis hors de France devront s’acquitter. Elle doit compenser les coûts liés à la création d’un système de télétransmission des déclarations préalables au détachement transmises par les employeurs et au traitement des données qui en sont issues.
1. Une gestion administrative efficace des déclarations de détachement nécessite un système dématérialisé qui doit être financé
L’étude d’impact du projet de loi rappelle que 74 000 déclarations ont été présentées en 2014 à l’inspection du travail. Ce chiffre résulte directement de l’augmentation très importante du détachement depuis le milieu des années 2000 et pourrait être beaucoup plus important si l’ensemble des prestataires de service respectaient leur obligation de transmission de déclaration.
Les déclarations transmises sont la principale source d’information nationale sur le détachement. Elles sont effectuées à l’aide de formulaires cerfa n°13816*02 comprenant trois modèles selon le type de détachement (pour compte propre, dans le cadre d’une mobilité intragroupe, ou par le biais d’une entreprise de travail temporaire établie hors de France). Ces formulaires proposent huit rubriques à renseigner :
– la raison sociale, l’adresse, les coordonnées téléphoniques et électroniques, la forme juridique, l’immatriculation dans le pays d’établissement et l’activité principale de l’entreprise étrangère employeur ;
– l’identité du dirigeant de cette entreprise ;
– le représentant en France de l’entreprise étrangère (nom, adresse, téléphone, courriel) ;
– le donneur d’ordre/contractant/client (nom et adresse) ;
– les éléments liés à la prestation : nature de l’activité principale, lieux de prestation en France, date du début de la prestation en France, durée prévisible de la prestation, recours à un matériel ou à un procédé dangereux, le cas échéant ;
– les horaires de début et de fin de travail ainsi que le nombre de jours de repos par semaine ;
– l’adresse de l’hébergement collectif.
Il est possible d’effectuer depuis juin 2014 cette démarche sur internet, via le déploiement de l’application « système d’information - prestations de services internationales » (Sipsi). L’article 283 de la loi du 6 août 2015 (114) a par ailleurs prévu que la transmission par voie dématérialisée, gage de rapidité et de facilité, était désormais obligatoire comme cela se fait en Belgique. La constitution d’une base de données doit rendre plus facile et plus systématique la détection de fraude grâce à un meilleur ciblage des risques. Ainsi, elle permet de suivre les salariés qui ont fait plusieurs déclarations de détachement dans plusieurs zones géographiques et de caractériser la fraude (par exemple, sur la durée du détachement). Des bases régionales doivent être développées dans le cadre des nouvelles unités spécialisées de l’inspection du travail que sont les URACTI (unités régionales d’appui et de contrôle en matière de travail illégal).
Le développement d’un tel outil présente un coût significatif lié au développement d’un projet par la direction générale du Travail pendant plusieurs années.
Il n’est pas rare que soit prélevé un impôt exigé à raison des contrôles exercés par l’administration afin de poursuivre un objectif d’intérêt général (115). La mobilité du travail détaché, dans la mesure où elle nécessite la mise en place d’outils spécifiques de contrôle est de nature à justifier la mise en place d’une contribution prélevée sur les entreprises établies hors de France qui détachent des salariés sur le territoire.
Cette contribution serait aussi tout à fait compatible avec le droit européen dès lors que l’article 9.2 de la directive d’exécution du 15 mai 2014 (116) prévoit que les États-membres peuvent « imposer d’autres exigences et mesures de contrôle » que celles qui sont expressément autorisées à la double condition :
– que celles-ci viennent compenser des règles qui s’avèrent insuffisantes ou inefficaces ;
– qu’elles soient « justifiées et proportionnées ».
Or, une telle contribution répond bien à la première exigence puisqu’elle a bien pour objet de rendre les contrôles efficaces, en effet :
– elle vient financer un système d’information nécessaire au bon fonctionnement des contrôles ;
– financer le système d’information par une contribution dédiée permet d’éviter d’avoir à disperser les moyens déjà insuffisants de l’administration du travail en matière de contrôle.
Elle est également justifiée par la mise en place de la base de données et proportionnée pour autant que son montant est directement lié au coût de financement de celle-ci ainsi que du traitement des données.
Il est créé un nouvel article L. 1262-4-5 créant une contribution visant à compenser les coûts de mise en place d’une base de données des déclarations de détachement et de traitement de ces données.
Son premier alinéa dispose que tout employeur ayant recours au détachement est assujetti à une contribution destinée à compenser les coûts engendrés par :
– la mise en place du fonctionnement du système de déclaration dématérialisée prévu par l’article L. 1262-2-2 du même code. La loi du 6 août 2015 précitée avait en effet prévu que la déclaration préalable au détachement transmise à l’inspection du travail ainsi que l’attestation fournie par une entreprise de transport qui détache du personnel roulant ou navigant soient toutes deux obligatoirement transmises par voie dématérialisée ;
– le coût de traitement des données obtenues grâce à ces déclarations. Celles-ci doivent en effet permettre, d’une part, une meilleure connaissance par les services de l’inspection du travail, destinataires de ces déclarations ou attestations, de la localisation et du nombre de détachements effectués et, d’autre part, une meilleure identification des fraudes.
Cette contribution a pour fait générateur le détachement d’un salarié. Elle a donc vocation à être proportionnelle au nombre de salariés qui sont détachés par l’employeur. Le détachement d’un salarié s’accompagnant légalement toujours d’une déclaration, il constitue un critère objectif et rationnel sur lequel fonder les modalités d’imposition.
Le deuxième alinéa prévoit que le montant est forfaitaire et sera fixé par un décret en Conseil d’État dans la limite de 50 euros par travailleur. Le plafond est destiné à garantir que les recettes de la contribution restent liées au coût du dispositif qu’elles financent et ne constituent pas une restriction à la libre circulation des travailleurs protégée par les traités.
Le dernier alinéa de l’article prévoit que la contribution sera recouvrée comme toutes les recettes autres que les impositions de toute nature et les amendes.
L’étude d’impact jointe au projet de loi indique qu’à raison d’un montant de 30 euros par salarié, les recettes de la contribution devraient être d’environ 6,8 millions d’euros.
*
La Commission est saisie de l’amendement AS333 de M. Gérard Cherpion.
Mme Isabelle Le Callennec. Cet amendement va dans le même sens que le précédent.
Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement.
Puis elle adopte les amendements rédactionnels AS979, AS983 et AS984 du rapporteur.
Elle adopte ensuite l’article 46 modifié.
*
* *
Article 47
(Art. L. 1263-3, 1263-4-1 [nouveau], L. 1263-5 et L. 1263-6 du code du travail)
Application de la mesure administrative de suspension temporaire d’activité d’un prestataire étranger en cas d’absence de déclaration de détachement
L’absence de déclaration préalable de détachement par l’employeur en dépit de ses obligations constitue un véritable obstacle à l’effectivité des contrôles. L’article vise à ce qu’en cas de non-respect de l’obligation de déclaration préalable, une suspension temporaire de la prestation puisse être prononcée comme elle peut l’être en cas de manquement grave aux règles essentielles du droit du travail.
1. Les sanctions pécuniaires ne suffisent pas à faire respecter l’obligation de déclaration du détachement
Le non-respect de l’obligation de déclaration préalable par l’employeur issue de la loi du 10 juillet 2014 (117) est passible d’une amende administrative prononcée par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) pouvant aller jusque 2 000 euros par salarié détaché, 4 000 en cas de récidive.
Le montant total d’une telle amende ne pouvait initialement dépasser le plafond de 10 000 euros. Ce niveau était insuffisamment dissuasif pour les fraudes de grande ampleur. Il s’appliquait en cas de non-déclaration de 5 salariés aussi bien que d’une centaine. La loi du 6 août 2015 l’a donc relevé à 500 000 euros (118).
Les sanctions pécuniaires, même significativement augmentées, se révèlent pourtant insuffisantes en cas de manquements particulièrement graves au droit du travail qui nécessitent une réponse plus immédiate. L’étude d’impact précise notamment que « le risque d’une amende ne dissuade néanmoins pas toujours certaines entreprises, qui dans la mesure où elles sont établies hors de France, ne peuvent faire l’objet d’un recouvrement forcé ».
Les autres sanctions existantes ne sont pas toujours applicables et rarement efficaces. Ainsi, la fermeture administrative temporaire ne s’applique que dans le cas trop restrictif d’une infraction de travail illégal et serait inopérante dans la mesure où elle serait dirigée contre des entreprises étrangères qui n’ont pas d’établissements sur le territoire français. De même, l’élément d’extranéité tenant à ce que l’entreprise fautive est toujours établie à l’étranger combiné au caractère par nature très fugace de l’infraction fait obstacle à des poursuites concluantes sur le terrain pénal.
Pour pallier ce manque, la peine de suspension de la prestation de service internationale a été créée par la loi du 6 août 2015 précitée afin de compléter l’arsenal juridique existant. L’article L. 1264-4 autorise à cet effet la DIRECCTE à faire cesser immédiatement l’activité d’un prestataire de service en cas d’infraction grave aux règles protectrices des travailleurs (salaire minimum, durée maximale du travail, hébergement collectif indigne).
Cet article vise à étendre la peine de suspension de prestation de services, en cas de non-déclaration de détachement. Le respect de l’obligation de déclaration est en effet la condition même de toute démarche de contrôle qui doit pouvoir s’appuyer en amont sur des informations permettant d’apprécier la situation. La mesure, dont le principal intérêt demeure son caractère dissuasif, pourrait permettre de garantir l’effectivité de cette obligation.
Le 1° crée un nouvel article L. 1263-4-1 qui prévoit un nouveau cas dans lequel peut être appliquée la mesure administrative de suspension temporaire d’activité d’un prestataire étranger en cas d’absence de déclaration de détachement.
L’article L. 1263-4 prévoit en effet déjà l’application de cette mesure administrative dans certaines situations :
– lorsque l’employeur ne met pas fin à un manquement grave aux règles relatives au salaire minimum, au repos quotidien ou hebdomadaire, à la durée quotidienne ou hebdomadaire maximale du travail ;
– lorsque l’employeur méconnaît l’obligation de présentation de documents traduits en langue française ;
– lorsque l’employeur est responsable de conditions de travail ou d’hébergement indignes.
Ces manquements doivent être constatés par un agent de contrôle de l’inspection du travail qui, le cas échéant, enjoint l’employeur de faire cesser cette situation. Il informe le maître d’ouvrage ou le donneur d’ordre dans les plus brefs délais.
Si l’employeur ne fait pas cesser les manquements dans un délai, fixé par voie règlementaire à trois jours, l’autorité administrative compétente peut suspendre la prestation pour une durée maximale d’un mois. Cette décision motivée est prise sur la base du rapport de l’agent de contrôle. Elle doit alors tenir compte notamment de la répétition ou de la gravité des faits. Il est mis fin à la mesure dès qu’il est mis fin au manquement.
Le nouvel article L. 1263-4-1 reprend un dispositif similaire. L’étude d’impact précise que le dispositif vise à autoriser la suspension d’une prestation de services internationale pendant une durée maximale d’un mois « à défaut d’accomplissement de la déclaration de détachement par l’employeur, le maître d’ouvrage ou le donneur d’ordre ».
Il convient toutefois d’être plus précis. Le droit actuel dispose qu’une déclaration préalable doit être effectuée par l’employeur avant le détachement. Le code du travail prévoit une obligation de vigilance du donneur d’ordre ou du maître d’ouvrage : ils doivent en effet s’assurer que le prestataire de services s’est acquitté de ses obligations. En cas de manquement, il leur revient d’effectuer une déclaration dans les 48 heures suivant le début du détachement. Le nouveau dispositif vise explicitement ce cas de figure. La sanction ne s’appliquera qu’à défaut d’accomplissement de la déclaration transmise par le donneur d’ordre du maître d’ouvrage.
L’autorité administrative compétente, saisie par un rapport motivé des services de l’inspection du travail ou par un fonctionnaire de contrôle assimilé, peut par une décision motivée suspendre la réalisation de la prestation pour un mois au plus.
Elle doit mettre fin à la mesure dès que la situation est régularisée par le donneur d’ordre, le maître d’ouvrage ou l’employeur.
Cette sanction est cumulable avec les amendes administratives prévues aux articles L. 1264-1 à L. 1264-2. Définie par l’article L. 1264-3, cette amende peut aller jusque 2 000 euros par salarié détaché, 4 000 en cas de manquement réitéré aux obligations durant l’année qui suit la première amende.
Les modalités de mise en œuvre de cette sanction doivent être précisées par voie règlementaire.
Le 2° modifie par coordination l’article L. 1263-5.
L’article L. 1263-5 issu de la loi du 6 août 2015 précitée prévoit que la décision de suspension de la prestation de services prononcée par l’autorité administrative n’entraîne ni rupture, ni suspension du contrat de travail, ni aucun préjudice pécuniaire pour les salariés détachés. L’objet de la mesure n’est en effet pas de sanctionner le salarié en le privant de tout lien avec son employeur mais d’empêcher le commencement ou la poursuite d’une activité illégale. Les mêmes considérations imposent que cette précision s’applique à la mesure de suspension qui peut être décidée en cas de non-transmission de la déclaration de détachement par le maître d’ouvrage et le donneur d’ordre.
L’article, qui ne faisait référence qu’à la « la décision de suspension de la prestation prononcée par l’autorité administrative », est modifié afin de préciser qu’il s’applique tant à la mesure de suspension applicable aux manquements prévus par l’article L. 1263-4 qu’à celle applicable aux manquements prévus par le nouvel article L. 1263-4-1.
Le 3° modifie également par coordination l’article L. 1263-6 relatif à la sanction applicable en cas de non-respect de la décision administrative de suspension.
Cet article prévoit qu’une amende administrative peut être prononcée par l’autorité administrative sur le rapport motivé d’un agent de contrôle de l’inspection du travail. Pour mémoire, son montant peut s’élever jusqu’à 10 000 euros par salarié détaché en cas de non-respect de la décision de suspension prévue à l’article L. 1263-4.
Le a) précise que cette mesure est également applicable à la décision de suspension créée par le nouvel article L. 1263-4-1.
En l’état du droit, le constat par un rapport motivé du non-respect de la décision de suspension peut être fait par des membres du corps des inspecteurs du travail ou par des membres du corps des contrôleurs du travail.
Le b) précise que le constat de la méconnaissance de la décision de suspension par l’employeur peut également être fait par tout fonctionnaire assimilé aux agents de contrôle de l’inspection du travail (sous réserve de l’adoption de l’article 51 du projet de loi ; dans le cas contraire, l’assimilation serait faite aux seuls inspecteurs du travail).
Le 4° modifie l’article L. 1263-3 relatif au constat d’un manquement grave commis par un employeur en matière de salaire minimum, au repos quotidien et hebdomadaire, à la durée hebdomadaire ou quotidienne maximale du travail, d’un manquement à l’obligation de présenter des documents traduits en français ou que les conditions de travail ou d’hébergement sont indignes.
Il précise que ce constat peut également être fait par les fonctionnaires de contrôle assimilés à des agents de contrôle de l’inspection du travail tel que prévu par l’article L. 8112-3.
Il s’agit notamment :
– des fonctionnaires habilités par la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) dans les mines, carrières et leurs dépendances ;
– des ingénieurs ou techniciens habilités par la DREAL dans les industries électriques et gazières ;
– des agents civils et militaires qui assurent ses fonctions dans les établissements de la défense.
*
La Commission adopte les amendements rédactionnels AS985, AS986, AS987 et AS988 du rapporteur.
Puis elle adopte l’article 47 modifié.
*
* *
Article 48
(Art. L. 1263-4 nouveau du code du travail)
Transposition de l’article 15 de la directive 2014/67/UE relative au recouvrement des sanctions prononcées par les autres États-membres à l’encontre d’entreprises françaises
Cet article a pour objet de transposer l’article 15 de la directive 2014/67/UE (119) en garantissant une reconnaissance sans formalité et une exécution des sanctions prononcées par un autre État à l’encontre d’entreprises françaises. Le caractère mobile du travail détaché favorise l’impunité des employeurs qui sont établis dans un autre État. Cette reconnaissance mutuelle dans l’ensemble des États de l’Union est de nature à améliorer significativement la capacité à sanctionner effectivement les fraudes liées au travail détaché.
1. La directive d’exécution 2014/67/UE a fait l’objet d’une transposition quasiment complète en droit français
• Les dispositions de la directive
La directive d’exécution de 2014 a été conçue, à l’initiative d’un groupe de 11 États-membres dont la France, par la Commission européenne comme une réponse aux insuffisances devenues manifestes de la directive de 1996. L’entrée de nouveaux États-membres en 2004 puis en 2007 s’est en effet traduite par un changement très profond de l’environnement dans lequel la législation européenne devait s’appliquer, le détachement devenant un phénomène massif et sujet à de nombreuses fraudes. Ces difficultés, susceptibles de distordre considérablement la concurrence dans des secteurs économiques aussi importants que la construction ou l’agriculture, ont rendu nécessaire un renforcement des capacités de contrôle des États-membres.
Issue d’un compromis avec les États plus favorables au maintien d’un système libéral de détachement, la directive d’exécution a été adoptée par le Parlement européen en avril 2014.
Elle propose six avancées majeures en termes de contrôle du détachement illégal :
– elle détermine à l’article 4 deux faisceaux d’indices : l’un permettant de s’assurer qu’une entreprise exerce une activité réelle dans l’État où elle est établie, l’autre permettant de s’assurer du caractère temporaire du détachement ;
– elle impose à son article 6 des délais maxima pour répondre aux demandes de transmission d’information venant d’un autre État-membre ;
– elle établit à son article 9 une liste d’exigences administratives et de mesures de contrôle compatibles avec le droit européen. Cette liste n’est pas limitative, conformément aux souhaits des États favorables à un plus grand encadrement, et elle n’exclut pas d’autres mesures « justifiées et proportionnées » dès lors que la Commission européenne en est informée ;
– elle incite à son article 11.3 à ce que les syndicats puissent, pour le compte ou à l’appui du travailleur détaché, engager une procédure judiciaire ou administrative en vue de l’application des directives précitées de 1996 et de 2014 ;
– elle crée à son article 12 une responsabilité solidaire entre sous-traitant de premier rang et donneur d’ordre du secteur du bâtiment en cas de non-paiement du salaire minimum ou de cotisations sociales indûment retenues ou en cas de non respect des droits des travailleurs. Ces mesures peuvent être renforcées à condition d’être « non discriminatoires, proportionnées » et que la Commission en soit informée ;
– elle prévoit à son article 15 une obligation d’assistance et de reconnaissance mutuelles des sanctions ou amende administratives.
• La transposition en droit français
La France a fait le choix dès l’été 2014 de devancer la transposition de cette directive en soutenant avant même la fin des négociations, l’initiative législative de notre collègue Pierre Savary. La loi n° 2014-790 du 10 juillet 2014 visant à lutter contre la concurrence sociale déloyale contient plusieurs dispositions.
– Elle instaure notamment un dispositif de responsabilité solidaire entre le donneur d’ordre et l’un de ses sous-traitants s’il ne respecte pas, ou pas intégralement, l’obligation de verser aux salariés – notamment détachés – une rémunération au moins égale au salaire minimum légal ou conventionnel.
– Elle ouvre la possibilité pour les organisations syndicales représentatives d’engager une action judiciaire, y compris sans le consentement du travailleur concerné, en cas de manquement à l’ensemble des obligations définies par le titre VI du code du travail du livre II de la première partie portant sur le travail détaché.
– Elle précise les sanctions applicables en cas de travail illégal, qui peut souvent être constaté dans les cas de fraude au régime du détachement.
Plusieurs exigences nouvelles relèvent également du pouvoir règlementaire.
Ainsi, le décret n° 2015-364 du 30 mars 2015 a précisé :
– les obligations des employeurs établis hors de France détachant des salariés en France en matière de déclaration préalable de ce détachement, de désignation d’un représentant en France et de conservation des documents à présenter en cas de contrôle ;
– les conditions de mise en œuvre de la responsabilité du cocontractant en cas de manquement à l’obligation de déclaration préalable ou de désignation d’un représentant et les sanctions encourues dans cette hypothèse ;
– les modalités de la peine complémentaire de diffusion de la décision pénale des personnes ayant recouru au travail illégal sur le site internet du ministère du travail ;
– les modalités de mise en œuvre de l’obligation de vigilance et de la responsabilité des maîtres d’ouvrage et des donneurs d’ordre vis-à-vis de leurs sous-traitants et cocontractants ;
– les modalités selon lesquelles les organisations syndicales représentatives de travailleurs informent les salariés des actions en justice formées en leur nom.
La loi du 6 août 2015 a également renforcé les mesures de contrôle ainsi que les sanctions en conformité avec la directive :
– elle a augmenté le montant maximal de la sanction administrative prévue par le code du travail de 10 000 à 500 000 euros ;
– elle a créé une nouvelle mesure administrative de suspension temporaire d’activité en cas d’infraction grave à des règles fondamentales du droit du travail dont les modalités ont été précisées par le décret n° 2015-1579 du 3 décembre 2015 (120) ;
– elle a rendu obligatoire la carte d’identité professionnelle pour les travailleurs détachés dans le bâtiment ;
– elle a rendu obligatoire pour les parties d’un contrat de transport de marchandises par voie fluviale de le conclure par écrit ;
– elle a rendu obligatoire la transmission par voie dématérialisée de la déclaration préalable au détachement.
Aussi, la directive est aujourd’hui presque entièrement transposée.
b. Une dernière mesure législative de transposition : le recouvrement des sanctions prononcées dans un autre État-membre
L’exécution transfrontalière des sanctions est souvent très complexe et d’autant plus si celles-ci n’ont pas été prononcées par une autorité judiciaire comme c’est souvent le cas en matière de détachement. Elle n’en est pas moins essentielle dans ce domaine où les travailleurs n’exercent leur activité que temporairement sur un autre territoire avant de repartir dans leur pays d’origine. Faciliter l’application des différentes sanctions administratives, notamment pécuniaires, prévues par les États-membres est de nature à mettre fin à une cette impunité systématique.
La décision cadre 2005/214/JAI du Conseil (121) avait posé les bases de l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux sanctions pécuniaires. Toutefois, son application au travail détaché était demeurée problématique comme le constatait la commission elle-même en 2007 qui rappelait que « les procédures aboutissant à une décision exécutoire sont jugées trop longues pour couvrir la majorité des situations transfrontalières, compte tenu également de la nature temporaire du détachement et de sa durée, souvent courte » (122) et que le droit de certains États interdit de lancer des procédures administratives contre des entreprises établies dans un autre État.
L’article 15 de la directive 2014/67/UE a constitué une véritable avancée dans ce principe de reconnaissance en prévoyant :
– que l’autorité requise doit procéder à l’exécution d’une sanction ou amende administrative prononcée par une autorité de l’État requérant ou à la notification de la décision à l’entreprise concernée si cela lui est demandé. Il faut que cette sanction/amende soit conforme au droit de l’État requérant et notamment qu’elle ne soit plus contestée sur le plan juridique ;
– que l’autorité requise d’exécuter la sanction/amende doit reconnaître cette décision sans formalité et prendre sans délai toutes les mesures nécessaires à son exécution. Pour assurer cette exécution, l’autorité requise doit respecter le droit de son État-membre.
– que la notification faite par l’autorité requise produit les mêmes effets juridiques que si elle émanait de l’autorité requérante.
La directive devant être transposée avant le 18 juin 2016, il convient d’assurer l’effectivité de ce principe de reconnaissance mutuel dans le code du travail. Une telle mesure ne devrait pas concerner un grand nombre d’entreprises françaises car le recours à des travailleurs détachés français est rarement motivé par des considérations purement financières et donc moins susceptible de donner lieu à une infraction dans un autre État-membre.
Il est créé un nouvel article L. 1264-4 au sein du chapitre IV du titre VI du livre II de la première partie du code du travail, relatif aux amendes administratives.
Le premier alinéa prévoit que les sanctions ou amendes administratives qui ont été notifiées par les autorités compétentes d’un autre État-membre à l’encontre d’un prestataire de services établi en France à l’occasion d’un détachement de salariés sont constatées par l’État.
Il s’agit donc d’une reconnaissance qui rend la sanction ou l’amende administrative exécutoire en France et qui oblige l’administration à recouvrer les montants dus comme s’il s’agissait d’une sanction ou d’une amende administrative prononcée par une autorité française.
Le deuxième alinéa renvoie les modalités de recouvrement aux articles 112 à 124 du décret du 7 novembre 2012 applicables aux recettes autres que les impositions de toute nature et que les amendes ou condamnations pécuniaires. La directive d’exécution précitée prévoit à son article 19.1 que l’autorité requise recouvre les montants dus conformément à sa règlementation applicable à des plaintes similaires.
Le troisième alinéa prévoit que les titres de perception sont émis par le ministère du travail. L’article L. 252 A du livre des procédures fiscales indique qu’un titre de perception délivré par l’État constitue un titre exécutoire de plein droit. L’autorité en charge de délivrer ce titre n’a donc aucune incidence sur son effet juridique. Le choix du ministre du travail résulte des attributions qui sont les siennes à savoir les « règles relatives aux conditions de travail » et de la tutelle administrative qu’il exerce sur la direction générale du travail et sur la délégation nationale à la lutte contre la fraude (123).
Le quatrième alinéa fixe le délai de prescription de l’action en recouvrement par le comptable public à cinq ans à compter de l’émission du titre de perception, ce qui correspond au délai de droit commun en matière de prescription des créances depuis la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile.
Le cinquième alinéa prévoit que le produit de ces sanctions ou amendes est versé au budget général de l’État. Il s’agit de l’application du principe posé à l’article 19.1 de la directive d’exécution précitée qui prévoit que les montants recouvrés au titre des sanctions et/ou amendes prononcées par un autre État-membre « sont acquis à l’autorité requise ».
*
La Commission adopte les amendements rédactionnels AS989, AS990 et AS991 du rapporteur.
Puis elle adopte l’article 48 modifié.
*
* *
Article 49
(Art. L. 1263-1 et L. 8271-3 du code du travail)
Élargissement de l’accès aux données issues des déclarations de détachement et aux établissements inspectés pour les interprètes assermentés
L’amélioration des dispositifs de contrôle reste l’un des principaux outils à développer pour atteindre les objectifs fixés par le plan national de lutte contre le travail illégal adopté par la commission nationale de lutte contre le travail illégal le 27 novembre 2012. Cet article s’inscrit dans cette démarche en facilitant l’accès aux informations sur le détachement à l’ensemble des agents de contrôle et en permettant aux inspecteurs du travail de se faire accompagner d’interprètes assermentés dans l’exercice de leur droit d’entrée.
1. Les agents de contrôle en matière de lutte contre le travail illégal doivent avoir un meilleur accès aux données concernant le détachement
Certaines situations de détachement sont constitutives de travail illégal au sens de l’article L. 8211-1 du code du travail :
– il s’agit principalement de travail dissimulé par dissimulation d’activité (c’est le cas lorsque l’activité du travailleur détaché n’est pas déclarée) ou par dissimulation d’emploi salarié (par exemple, lorsque le travailleur détaché est un « faux indépendant ») ;
– il peut également s’agir de prêt illicite de main-d’œuvre lorsqu’une entreprise de travail intérimaire ou une agence de placement établie à l’étranger ne respecte pas les conditions de mise à disposition du salarié.
Les agents compétents pour rechercher et constater les infractions constitutives de travail illégal sont conformément à l’article L. 8271-1-2 du code du travail :
– les inspecteurs et les contrôleurs du travail ;
– les officiers et agents de police judiciaire ;
– les agents des impôts et des douanes ;
– les agents des organismes de sécurité sociale et des caisses de mutualité sociale agricole agréés à cet effet et assermentés ;
– les administrateurs des affaires maritimes, les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes et les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l’autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer ;
– les fonctionnaires des corps techniques de l’aviation civile commissionnés à cet effet et assermentés ;
– les fonctionnaires ou agents de l’État chargés du contrôle des transports terrestres ;
– les agents de Pôle Emploi chargés de la prévention des fraudes, agréés et assermentés à cet effet.
Leurs compétences respectives sont rappelées dans le tableau ci-dessous.
LES COMPÉTENCES DES AGENTS EN MATIÈRE DE LUTTE CONTRE LE TRAVAIL ILLÉGAL
Travail dissimulé (Art. L. 8271-7) |
Marchandage (Art. L. 8271-14) |
Prêt illégal de main d’œuvre (Art. L. 8271-16) |
Emploi d’étranger non autorisé (Art. L. 8271-17) |
Fraude au revenu de remplacement (Art. L. 812-1) |
Cumul irrégulier d’emploi (Art. D. 8261-1 et D. 8271-1) | |
Officiers de police judiciaire |
Compétence |
Compétence |
Compétence |
Compétence |
Compétence |
Compétence |
Inspecteur et contrôleur du travail |
Compétence |
Compétence |
Compétence |
Compétence |
Compétence |
Compétence |
Agents de recouvrement sociaux |
Compétence |
|||||
Agents de Pôle Emploi |
Compétence |
|||||
Agents de recouvrement fiscaux (impôts |
Compétence |
Compétence |
Douanes seulement |
|||
Contrôleur des transports terrestres |
Compétence |
|||||
Aviation civile |
Compétence |
|||||
Affaires maritimes |
Compétence |
Source : Direction Générale du Travail.
Les informations dont bénéficie l’inspection du travail sur la situation des travailleurs détachés relèvent de deux sources distinctes :
– le I de l’article L. 1262-2-1 issu de la loi du 10 juillet 2014 (124) qui prévoit que l’employeur établi hors de France doit transmettre une déclaration préalable au détachement à l’inspection du travail du lieu où débute sa prestation. Ces déclarations obligatoirement transmises par voie dématérialisée permettront de constituer la future base de données comprenant les déclarations de détachement transmises par voie dématérialisée dite « SIPSI » prévue pour avril 2016. Elle doit permettre de mieux déceler les fraudes à l’avenir ;
– le deuxième alinéa de l’article L. 1262-4-1 qui prévoit qu’en l’absence de transmission par l’employeur établi hors de France de la déclaration préalable au détachement, il revient au maître d’ouvrage ou au donneur d’ordre, qui ne s’est pas vu remettre la copie de cette déclaration par son co-contractant, de fournir dans les quarante-huit heures suivant le début du détachement une déclaration à l’inspection du travail du lieu où débute la prestation. Il n’est pas encore prévu que sa transmission soit obligatoirement dématérialisée.
2. Les inspecteurs du travail doivent pouvoir être compris et se faire comprendre dans les établissements qu’ils visitent
L’inspecteur et le contrôleur du travail ont le droit de pénétrer dans les établissements pour l’exercice de leur mission conformément à l’article L. 8113-1 du code du travail et aux articles 12 de la convention n° 81 (125) et 16 de la convention n° 129 de l’Organisation internationale du travail (126). La jurisprudence a établi qu’il n’était pas conditionné par une présomption d’infraction et peut être exercé à tout moment (127) y compris la nuit (128) et sans avertissement préalable afin d’assurer l’efficacité des contrôles. Si l’employeur refuse le droit d’entrée, il se rend coupable du délit d’obstacle prévu à l’article L. 8114-1 du code du travail.
En revanche, ce n’est que dans le cadre de leur droit d’audition que les agents de contrôle de l’inspection du travail peuvent recourir à des interprètes assermentées pour le contrôle de la règlementation sur la main d’œuvre étrangère et le détachement national des travailleurs prévu à l’article L. 8271-3 du même code. Le droit d’audition se distingue très nettement, en droit, du droit de visite en ce qu’il est consenti par l’employeur, le délit d’obstacle n’existant pas dans cette perspective.
Aussi, en l’état actuel du droit, un inspecteur se présentant dans un établissement accompagné d’un interprète est réputé exercer son droit d’audition et non son droit d’entrée. L’employeur peut s’opposer à son entrée dans l’établissement car le droit d’entrée est l’attribut personnel de l’inspecteur du travail et ne saurait être étendu à un interprète dans le silence des textes, d’autant que ce droit est intrinsèquement lié à la mission de contrôle. Il revient au législateur de préciser s’il souhaite que l’interprète puisse accompagner l’inspecteur dans le cadre de son droit d’entrée.
a. Un nouveau droit d’accès aux données issues de la base des déclarations de détachement pour l’ensemble des agents de contrôle
L’article L. 1263-1 prévoit, en son premier alinéa, que les agents de contrôle et les autorités chargées de la coordination de leurs actions peuvent se communiquer les renseignements et documents nécessaires pour assurer les contrôles liés au travail détaché.
Le second alinéa leur autorise à transmettre les renseignements et documents dont ils disposent aux autorités analogues dans les États étrangers.
Le I complète cet article, relatif à l’échange de renseignements entre agents et autorités de contrôle, en créant un nouvel alinéa qui vise à permettre que les agents chargés de la lutte contre le travail illégal, autres que les inspecteurs et contrôleurs du travail, aient accès aux données issues des déclarations de détachement transmises à l’inspection du travail, qu’elles viennent des employeurs au titre de l’obligation issue de l’article L. 1262-2-1 du code du travail ou bien des donneurs d’ordres et maîtres d’ouvrage au titre de l’obligation issue de l’article L. 1262-4-1. Les agents concernés relèvent de la police, de la gendarmerie, de l’administration fiscale et douanière ou du recouvrement des cotisations sociales (cf. b. du 1.).
L’article L. 8271-3 relatif à la sollicitation des interprètes assermentés. prévoit que les agents de contrôle qui n’appartiennent ni à la police ni à la gendarmerie peuvent solliciter des interprètes assermentés pour assurer leur mission de contrôle de la règlementation sur la main-d’œuvre étrangère et le détachement transnational de travailleurs.
Le II complète cet article par un nouvel alinéa qui précise que les agents de contrôle pourront être accompagnés de ces interprètes lors de leur droit d’entrée dans les établissements.
Dans le cadre du travail détaché, l’assistance d’interprètes est particulièrement importante pour que la conduite du contrôle par les inspecteurs soit réellement efficace. La barrière de langue conduit souvent à des difficultés pour identifier les situations potentiellement dangereuses pour ces travailleurs ou bien pour faire appliquer certaines décisions, notamment celles relatives à la suspension des travaux. Suivant une recommandation du Conseil économique, social et environnemental dans son dernier avis (129), le législateur doit donc expressément préciser que ceux-ci peuvent être accompagnés par un interprète afin que ce dernier puisse avoir accès au lieu de travail.
*
La Commission adopte l’amendement rédactionnel AS992 du rapporteur.
Puis elle adopte l’article 49 modifié.
*
* *
Article 50
(Art. L. 1263-3 et L. 4231-1 du code du travail)
Application de la suspension de la prestation de service internationale aux activités régies par le code rural et de la pêche maritime
Cet article vise à assurer l’application des dispositions relatives à la suspension de la prestation de service aux travailleurs détachés du secteur agricole. La spécificité de certaines règles applicables à ces activités régies par le code rural et de la pêche maritime nécessite de compléter certaines dispositions du code du travail afin que les manquements à ces règles dérogatoires puissent être sanctionnés par cette mesure efficace et dissuasive dans les mêmes conditions que les manquements aux règles de droit commun.
Malgré l’objectif de parité sociale posé par l’article 1er de la loi n° 60-808 du 5 août 1960 (130) repris par les lois d’orientation agricole n° 80-502 du 4 juillet 1980 (131) et n° 99-574 du 9 juillet 1999 (132), le droit du travail applicable aux activités agricoles a longtemps fait l’objet de mesures dérogatoires, en raison des traditions mais aussi des conditions économiques propres à ce secteur d’activité. Aujourd’hui, il reste quelques dispositions spéciales justifiées par les conditions objectives du travail agricole qui imposent, en raison des contraintes naturelles et climatiques, des règles particulières quant à la durée du travail, tant dans l’amplitude des journées que dans la périodicité des périodes d’activité, quant à la fixation du repos hebdomadaire ou quant aux conditions d’hébergement collectif.
L’articulation entre les dispositions sociales spéciales et les règles de droit commun sont réglées par l’article L. 711-1du code rural et de la pêche maritime. Celui-ci prévoit que la réglementation du travail salarié dans les établissements ou activités agricoles défini par le code s’applique sans préjudice des dispositions du livre II du code du travail qui sont applicables à ces établissements ou activités. Il s’applique également aux apprentis.
L’agriculture est un secteur dans lequel le recours au détachement se développe, représentant aujourd’hui 5 % des demandes préalables (133). D’après l’étude d’impact, le nombre de salariés détachés serait de 30 000 pour un total de 1 165 000 salariés employés dans l’agriculture en 2014.
Le I complète l’article L. 1263-3 du code du travail par un nouvel alinéa.
Cet article, créé par la loi du 6 juin 2015 (134), prévoit aujourd’hui la possibilité pour l’autorité administrative compétente de prononcer une décision de suspension de la prestation internationale en cas de manquement grave commis par l’employeur notamment aux règles relatives au temps de travail et au temps de repos prévues par les articles L. 3131-1, L. 3132-2, L. 3121-34 et L. 3121-35 du code du travail.
Les articles L. 3131-1, L. 3121-34 et L. 3121-35 imposent des obligations similaires à celles qui sont prévues aux articles L. 714-5, L. 713-2 et L. 713-13 du code rural et de la pêche maritime et peuvent s’appliquer aux travailleurs du secteur agricole conformément à la règle selon laquelle ces dispositions spécifiques s’appliquent sans préjudice de celles du code du travail. En revanche, l’article L. 3132-2 qui prévoit que le repos hebdomadaire est d’une durée minimale de 24 heures consécutives à ajouter aux heures consécutives de repos quotidien n’est pas applicable aux salariés exerçant des activités relevant du code rural et de la pêche maritime qui a ses propres dispositions fixées à l’article L. 714-1 du code rural.
Ces dernières diffèrent des dispositions générales :
– en fixant le principe du dimanche comme jour de repos hebdomadaire, des exceptions étant prévues lorsque le travail du dimanche est indispensable au fonctionnement de l’entreprise suivant certaines modalités déterminées ;
– en prévoyant qu’une convention ou un accord collectif peut déroger au principe du dimanche comme jour de repos hebdomadaire suivant certaines modalités déterminées ;
– en prévoyant une dérogation en cas de circonstances exceptionnelles qui permet de suspendre le repos hebdomadaire pour une durée limitée.
Le nouvel alinéa précise qu’un manquement grave à ces dispositions spécifiques peut fonder une mesure de suspension de la prestation de service au même titre que pour les dispositions du code du travail en matière de temps de repos hebdomadaire. Cette mesure justifiée par le souci de trouver une réponse rapide et proportionnée à certaines pratiques frauduleuses doit pouvoir être appliquée dans le secteur agricole en tenant compte de ses spécificités.
Le II modifie l’article L. 4231-1 du code du travail.
Cet article créé par la loi du 10 juillet 2014 (135) prévoit les conditions dans lesquelles le maître d’ouvrage et le donneur d’ordre doivent s’assurer que les salariés de ses co-contractants ou des sous-traitants directs et indirects bénéficient de conditions d’hébergement dignes.
Son premier alinéa prévoit qu’une fois informé par écrit par un agent de contrôle d’une situation dans laquelle les salariés de son co-contractant ou de l’entreprise sous-traitante sont logés collectivement dans des conditions indignes, il a l’obligation d’enjoindre l’employeur de faire cesser cette situation sans délai.
Son deuxième alinéa prévoit qu’à défaut de régularisation, le maître d’ouvrage ou le donneur d’ordre doit prendre à sa charge l’hébergement des salariés dans des conditions déterminées par l’article L. 4111-6 du code du travail, lesquelles ont été précisées par voie réglementaire.
Le présent article vise à préciser les conditions dans lesquelles le maître d’ouvrage ou le donneur d’ordre est tenu d’assurer un hébergement collectif aux salariés employés à des travaux agricoles. Des dispositions spécifiques sont en effet prévues par le code rural et de la pêche maritime. Son article L. 716-1 précise ainsi que l’hébergement doit satisfaire à des « conditions, notamment d’hygiène et de confort fixées par décret » et doivent tenir compte des conditions locales. La modification vise à prendre en considération la configuration des locaux utilisés par les employeurs agricoles qui ne permet pas toujours de satisfaire aux exigences de l’article L. 4111-6 du code du travail et à ses mesures d’application.
*
La Commission adopte l’amendement rédactionnel AS993 du rapporteur.
Puis elle adopte l’article 50 modifié.
*
* *
Article 50 bis
(Art. L. 1262-2 du code du travail)
Égalité de traitement entre travailleurs intérimaires détachés
et travailleurs intérimaires locaux
La Commission a adopté, à l’initiative du groupe Socialiste, Républicain et Citoyen, un amendement visant à inscrire à l’article L. 1262-2 relatif aux entreprises de travail temporaire le principe selon lequel les travailleurs intérimaires détachés se voient appliquer les mêmes conditions d’emploi et de travail que les travailleurs intérimaires locaux.
Cet amendement transpose par anticipation les dispositions prévues à l’alinéa c du paragraphe 2 de l’article 1er de la proposition de directive du Parlement européen et du conseil qui a été faite par la Commissaire européenne à l’emploi, aux affaires sociales, aux compétences et à la mobilité des travailleurs. Il s’agit ainsi de clarifier le principe d’égalité, inspiré par le principe « à travail égal, rémunération égale » qui guide les travaux de la Commission européenne et de montrer, dans le cadre des négociations qui vont s’ouvrir, l’attachement de la France à ce principe, notamment dans le domaine du travail intérimaire.
*
La Commission examine l’amendement AS581 de M. Gilles Savary.
Mme Monique Iborra. Le groupe SRC a repris à son compte cet amendement de M. Savary qui vise à transposer par anticipation une directive européenne relative au détachement de travailleurs dans le cadre d’une prestation de services. Il est ainsi proposé qu’un travailleur étranger relevant d’une agence d’intérim soit employé aux mêmes conditions que celles qui s’appliquent en France. L’objectif est de mettre fin au « détachement d’intérim » tel qu’il est prévu depuis 1996, et d’inscrire cette nouvelle disposition dans le code du travail.
M. le rapporteur. Avis favorable : c’est un sujet très important.
La Commission adopte l’amendement.
*
* *
TITRE VII
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 51
(Art. L. 1233-30, L. 1253-6, L. 1263-3, L. 1263-6, L. 2143-7, L. 2313-11, L. 2314-10, L. 2315-12, L. 2323-18, L. 2323-24, L. 2324-8, L. 2324-12, L. 2325-19, L. 2326-5, L. 2392-2, L. 3121-7, L. 3121-36, L. 3122-23, L. 3123-2, L. 3171-3, L. 3172-1, L. 3221-9, L. 4132-3, L. 4154-2, L. 4311-6, L. 4526-1, L. 4612-7, L. 4613-1, L. 4614-11, L. 4614-8, L. 4616-2, L. 4624-3, L. 4711-3, L. 4721-1, L. 4721-2, L. 4721-4, L. 4721-5, L. 4744-7, L. 5213-5, L. 5424-16, L. 6225-4, L. 6361-5, L. 6363-1, L. 7122-18, L. 7232-9, L. 7413-3, L. 7421-2, L. 7424-3, L. 8112-3, L. 8113-1 à L. 8113-5, L. 8113-8, L. 8114-2, L. 8123-1, L. 8123-6, L. 8223-1-1, L. 8271-1-2, L. 8271-14, L. 8271-19 et L. 8291-2 du code du travail ; articles L. 1324-10, L. 5243-2-3, L. 5544-18, L. 5544-31, L. 5548-1 à L. 5548-4 et L. 5641-1 du code des transports)
Prolongation du plan de transformation des emplois de contrôleurs du travail en inspecteurs du travail
Cet article vise à prolonger une voie d’accès au corps d’inspecteur du travail réservée aux agents relevant du corps des contrôleurs du travail. Il s’inscrit dans le cadre du plan de transformation des emplois lancé en septembre 2013 qui vise à la requalification progressive en postes d’inspecteurs, par voie d’examen professionnel, de tous les postes de contrôleurs du travail. Cet article porte également les mesures d’adaptation législative du code du travail et du code des transports, rendues nécessaires par la réforme.
a. L’inspection du travail a longtemps reposé sur deux corps distincts : les inspecteurs du travail et les contrôleurs du travail
Conformément à l’article 6 de la convention OIT n° 81, les missions d’inspection du travail doivent être assurées par « des fonctionnaires publics dont le statut et les conditions de service leur assurent la stabilité dans leur emploi et les rendent indépendants de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indue ».
La France a développé deux corps distincts pour assurer ces missions (136) :
– Le corps de l’inspection du travail correspond à un statut de fonctionnaire de catégorie A. L’inspecteur a la responsabilité d’une section dont il organise l’activité. Il a compétence pour intervenir dans l’ensemble des établissements et chantiers. Le déroulement de la carrière permet d’accéder au grade de directeur adjoint du travail, puis de directeur du travail.
– Le corps des contrôleurs du travail comprend des fonctionnaires de catégorie B. Conformément à l’article L. 8112-5 du code du travail, ils exercent leurs missions d’inspection sous l’autorité de l’inspecteur du travail responsable de la section. Ils assurent généralement le contrôle des établissements de moins de cinquante salariés. Les contrôleurs peuvent accéder par inscription au choix sur le tableau d’avancement, au grade de contrôleur du travail de classe supérieur puis de contrôleur du travail de classe exceptionnelle.
Inspecteurs et contrôleurs disposent des mêmes prérogatives lorsqu’ils effectuent des contrôles et des investigations à l’exception des décisions administratives prévues par le code du travail qui relèvent de la seule compétence de l’inspecteur du travail.
Il y avait en 2013 781 inspecteurs du travail et 1320 contrôleurs du travail (137).
b. Les grandes orientations de la réforme de l’inspection du travail prévue par le décret du 20 mars 2014 remettent en cause cette distinction
L’indépendance de l’inspection du travail relève d’un principe général au sens de l’article 34 de la Constitution mais sa mise en œuvre est d’ordre règlementaire (138).
C’est le décret n° 2014-359 du 20 mars 2014 (139) qui a engagé la réforme du système de l’inspection du travail, initialement liée au projet de loi relatif à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale (140). Il prévoit :
– une organisation interne rénovée autour des unités de contrôle au niveau infra-départemental, départemental ou régional, placées sous l’autorité d’un inspecteur du travail ;
– un groupe national de veille, d’appui et de contrôle pour les affaires complexes qui nécessitent une expertise ou des moyens de contrôles spécifiques ;
– un maillage autour de sections qui correspond au territoire dans lequel chaque inspecteur ou contrôleur du travail exerce ses missions ;
– des mesures transitoires pour que des inspecteurs du travail puissent exercer la compétence qui leur est réservée en matière de décision administrative dans les sections où il n’y a que des contrôleurs du travail.
c. Le plan de transformation d’emplois qui permet la montée en compétence des agents doit être poursuivi
Les mesures prévues par le décret du 20 mars 2014 précité ont été accompagnées d’un plan de transformation des emplois en vue de la fusion des deux corps d’inspection. La dualité des corps d’inspection est en effet une spécificité française qui ne correspondait plus à une nécessité opérationnelle. Issu d’un amendement gouvernemental à l’Assemblée nationale, l’article 6 de la loi du 1er mars 2013 (141) avait prévu un examen professionnel exceptionnel destiné à permettre aux contrôleurs du travail d’accéder aux emplois d’inspecteurs du travail, pendant une durée de trois ans échue depuis le 1er mars 2016. Cet examen a permis à 540 contrôleurs depuis 2013 de devenir inspecteurs du travail après une formation complémentaire de six mois. Cette démarche a vocation à être poursuivie pour permettre à l’ensemble des contrôleurs de rejoindre à terme le corps des inspecteurs du travail.
Poursuivant cette orientation, le dernier alinéa de l’article 261 de la loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques (142) habilite le Gouvernement à prendre par ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi afin d’organiser l’accès au corps de l’inspection du travail par la voie d’un concours réservé aux seuls agents relevant du corps des contrôleurs du travail et remplissant des conditions d’ancienneté. Le texte prévoit un délai de 9 mois à compter de la promulgation de la loi pour prendre ces mesures, soit jusqu’au 6 mai 2016.
Le champ de l’habilitation couvrait les dispositions d’une proposition de loi relative aux pouvoirs de l’inspection du travail qui avait été adoptée par la commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale (143). Malgré son inscription à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale en mai 2014, cette proposition de loi n’avait finalement pas été examinée en séance publique.
Elle comportait, dans son article 1er, une série de mesures relatives aux missions et garanties accordées aux agents de contrôle de l’inspection du travail. Outre l’affirmation du principe d’indépendance de ces agents, cet article tirait aussi les conséquences de la mise en extinction du corps des contrôleurs du travail, en procédant à l’ensemble des modifications nécessaires pour unifier les compétences et les pouvoirs de contrôle des agents de l’inspection du travail. Son article 5 tirait quant à lui les conséquences rédactionnelles de cette unification dans l’ensemble des codes où il est fait référence à l’inspection du travail. Les modifications couvraient ainsi le code du travail, le code rural et de la pêche maritime ainsi que le code des transports.
Le I vise à prolonger le concours d’accès ouvert aux contrôleurs du travail pour accéder au corps de l’inspection du travail.
Cette voie d’accès vient s’ajouter :
– au concours ouvert aux fonctionnaires et agents publics justifiant de quatre années de service public ;
– à la nomination au choix parmi les contrôleurs du travail justifiant de quinze ans de services effectifs dont dix en catégorie B ;
– à l’accès après examen professionnel dans la limite du cinquième des postes ouverts au concours.
L’article 6 de la loi du 1er mars 2013 précitée avait ouvert une voie d’accès par un examen professionnel spécifique. Prévues pour une durée de trois ans après la promulgation de la loi, ces dispositions ne sont plus applicables depuis le 1er mars 2016. Le présent article reprend cette possibilité en perspective de la création d’un corps unique. Quatre ans devraient permettre aux 1 000 membres du corps (144) des contrôleurs d’accéder au corps des inspecteurs.
Les modalités d’application de cet article sont renvoyées à un décret en Conseil d’État.
Cette disposition doit être mise au regard de l’habilitation de l’article 261 de la loi du 6 août 2015 précitée visant à prévoir par ordonnance l’accès des contrôleurs du travail au corps de l’inspection du travail par concours. Cette ordonnance, actuellement examinée par le Conseil d’État, est conçue comme complémentaire des dispositions de cet article. L’ordonnance doit en effet doit modifier l’article 8112-1 du code du travail pour y intégrer les inspecteurs et les contrôleurs du travail tandis que les dispositions de ce projet de loi procèdent à une harmonisation des références aux inspecteurs et contrôleurs du travail.
Le II procède ainsi à des modifications rédactionnelles dans le code du travail afin d’harmoniser les références aux fonctions d’inspecteur du travail en renvoyant à l’article L. 8112-1 du code du travail qui définit les missions de l’inspecteur du travail. Il est en effet fait référence aux fonctions d’inspecteur et/ou de contrôleur du travail, appelées à fusionner, dans des termes différents en fonction des articles concernés.
Les modifications proposées reprennent les mesures de coordination prévues par l’article 5 de la proposition de loi précitée, moyennant quelques ajustements visant à tenir compte des modifications législatives opérées depuis mai 2014.
Le III procède à des modifications rédactionnelles dans le code des transports.
Les 1 à 4° harmonisent certaines mentions de l’inspecteur ou du contrôleur du travail au profit d’un renvoi à l’article L. 8112-1 du code du travail.
Le 5° modifie l’article L. 5641-1 relatif à l’inspection du travail dans les navires pour en simplifier la rédaction et pour tenir compte de la fusion des services d’inspection du travail issue de l’arrêté du 30 décembre 2008 (145) . Les services de l’inspection du travail maritime créés en 2002 ont en effet été fusionnés avec les services de l’inspection du travail en 2008.
Le a) supprime le premier alinéa qui confie à l’inspection du travail maritime l’inspection du travail sur les navires.
Le b) et le c) introduisent respectivement au deuxième et troisième alinéas la référence aux agents de contrôle de l’inspection du travail dans sa rédaction harmonisée.
*
La Commission adopte les amendements rédactionnels AS994, AS995, AS996, AS997, AS998, AS999 et AS1000 du rapporteur.
Puis elle adopte l’article 51 modifié.
*
* *
Article 52
(Art. L. 5426-1-1, L. 5426-8-1 et L. 5426-8-2 du code du travail)
Renforcement des sanctions en cas de versement indu
de prestations d’assurance-chômage
Cet article tire les conséquences de l’annulation par le Conseil d’État de dispositions conventionnelles du régime d’assurance-chômage qui tendaient à renforcer les prérogatives de Pôle Emploi en cas de versement d’une prestation indue ou de non-déclaration d’une période d’activité professionnelle. Il renforce notamment les moyens de recouvrement auquel il peut être recouru et les sanctions auxquelles s’expose le demandeur d’emploi lorsqu’il ne déclare pas la reprise d’une activité professionnelle.
1. Le versement d’indus en matière de prestation d’assurance chômage représente des montants significatifs et difficiles à recouvrer
La loi du 13 février 2008 (146) a mis fin à la séparation fonctionnelle entre l’Agence nationale pour l’emploi (ANPE), établissement public mettant en contact les employeurs et les chômeurs, et l’Union nationale interprofessionnelle pour l’emploi dans l’industrie et le commerce (UNEDIC), qui assurait à travers le réseau des Association pour l’emploi dans l’industrie et le commerce (Assedic) le recouvrement des cotisations et le paiement des indemnités, dans la perspective de créer un organisme unique chargé à la fois d’indemniser les chômeurs et de faciliter la recherche d’emploi.
Cette logique de « guichet unique » au bénéfice des demandeurs d’emploi a conduit à la création de Pôle Emploi, « institution publique dotée de la personnalité morale et de l’autorité financière » (147) le 19 décembre 2008 qui assure leur accompagnement dans la recherche d’emploi, le versement des allocations chômage, l’aide aux entreprises dans les recrutements. Le recouvrement des cotisations a, quant à lui, été confié aux URSSAF. La détermination et l’interprétation des règles de l’indemnisation ainsi que la gestion financière du régime demeurent les prérogatives de la gouvernance paritaire de l’UNEDIC.
Ainsi, l’URSSAF verse plusieurs prestations pour son compte et pour celui de différents acteurs :
Pour son propre compte :
– l’aide individuelle à la formation ;
– l’aide à la mobilité.
Pour le compte de l’État :
– les allocations spécifiques d’indemnisation des intermittents du spectacle ;
– l’allocation temporaire d’attente ;
– l’allocation de préretraite de licenciement ;
– l’allocation transitoire de solidarité.
Pour le compte du Fonds de solidarité :
– l’aide prévue à l’article 136 de la loi de finances pour 1997 (148) ;
– l’allocation de solidarité spécifique ;
– l’allocation équivalent retraite ;
– la prime forfaitaire en cas de reprise d’activité professionnelle.
Pour le compte de l’UNEDIC :
– les allocations de retour à l’emploi du régime d’assurance-chômage.
La répétition de l’indu est qualifiée par la jurisprudence de quasi-contrat (149). L’indu crée en effet une obligation de remboursement de la valeur dont une partie s’est injustement enrichie. Les particuliers disposent d’une procédure spécifique appelée « action en répétition de l’indu » devant le juge judiciaire pour obtenir la restitution de ce dont ils se sont appauvris. En vue d’obtenir le recouvrement des sommes indûment versées, les administrations fiscale et sociales peuvent, lorsque la loi le prévoit, utiliser une contrainte, c’est-à-dire un titre exécutoire emportant tous les effets d’un jugement en l’absence d’opposition de la part de celui auquel la somme est réclamée. Dans la mesure où ces organismes sont conduits à verser des prestations, ils peuvent également, lorsque la loi le permet, procéder à des retenues sur les futures échéances.
Le versement d’une allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) indue peut être le fait d’une erreur de Pôle Emploi mais aussi du bénéficiaire de la prestation. Constitue ainsi un indu le fait d’obtenir le bénéfice ou la continuation du service des allocations alors que les conditions ne sont pas remplies, par exemple si le bénéficiaire a exercé une activité professionnelle sans la déclarer au terme du mois échu comme l’y oblige le règlement de l’Unedic du 6 mai 2011 (150).
L’étude d’impact annexée au projet de loi indique que sur 800 millions d’euros d’indus versés chaque année par Pôle Emploi, 300 millions d’euros ne sont pas effectivement recouvrés soit 37 % du montant total. En l’état du droit, il n’est pas possible à Pôle Emploi de procéder à une retenue ou de délivrer une contrainte pour recouvrer les allocations d’assurance chômage contrairement aux autres prestations versées pour son compte, pour le compte de l’État ou du Fonds de solidarité. En cas de refus du débiteur, Pôle Emploi doit donc obtenir le remboursement devant le juge judiciaire dans les conditions de droit commun déterminées par le code civil et le code de la procédure civile (151). Or, cette procédure est particulièrement longue et coûteuse en frais de justice et d’avocat en comparaison d’une contrainte ou d’une retenue.
Cette situation s’écarte des dispositions prévues pour les organismes de sécurité sociale ou plus récemment des modifications apportées pour la gestion des allocations de solidarité. La loi de finances pour 2012 (152), précisée par le décret n° 2012-1066 du 18 septembre 2012 (153), a ainsi transféré à Pôle emploi la gestion des indus sur l’ensemble des allocations de solidarité. Deux articles L. 5426-8-1 et L. 5426-8-2 ont ainsi été créés visant d’une part à permettre à Pôle emploi d’obtenir le remboursement de toute somme indûment versée par retenues sur les échéances à venir, d’autre part à habiliter la même institution à recourir à la contrainte pour le recouvrement des sommes indûment versées.
Pour pallier ce manque, le règlement général de l’UNEDIC annexé à la convention du 14 mai 2014 (154) avait ouvert la possibilité de procéder à « la retenue d’une fraction des allocations à payer, sans que cette retenue ne puisse excéder la partie saisissable des allocations ». Un recours non suspensif était prévu pour l’allocataire dans un délai de 30 jours. Ces dispositions ont cependant été annulées par un arrêt du Conseil d’État du 5 octobre 2015 (155) en raison de l’incompétence des partenaires sociaux pour décider des modalités de récupération des trop perçus.
Il n’en reste pas moins nécessaire, pour ne pas aggraver la situation financière du régime d’assurance chômage, de donner à Pôle Emploi les moyens de procéder à un recouvrement efficace des prestations d’allocation chômage.
2. Les omissions de période d’activité constituent un manquement aux obligations des demandeurs d’emploi et un coût pour le régime d’assurance chômage
Les demandeurs d’emplois doivent porter à la connaissance de Pôle emploi « les changements affectant leur situation susceptibles d’avoir une incidence sur leur inscription comme demandeurs d’emploi » (156) dans un délai de 72 heures (157).
L’étude d’impact du projet de loi rappelle cependant que 205 000 demandeurs d’emploi ont déposé des demandes d’ARE dans lesquelles la période de référence comprenant des omissions en termes de déclaration. Le coût de celles-ci est évalué à 95 millions d’euros.
Le paragraphe 4 de l’accord d’application n° 9 annexé à la convention du 14 mai 2014 précitée prévoyait que :
– ces périodes d’activité non déclarées lorsqu’elles étaient supérieures à trois mois ne seraient plus prises en compte pour l’ouverture ou le rechargement des droits à l’assurance chômage ;
– les rémunérations correspondant à ces périodes non déclarées ne seraient plus prises en compte dans le calcul du salaire de référence ;
– Pôle Emploi pouvait tenir compte de ces périodes sur décision favorable de l’instance paritaire régionale lorsque celles-ci permettaient d’atteindre la durée d’affiliation requise pour le rechargement des droits.
Cependant, l’arrêté du 25 juin 2014 (158) agréant ces dispositions a été annulé par la décision du Conseil d’État du 5 octobre 2015 précitée car elle n’entrait pas dans le champ de l’article L. 5422-20 du code du travail qui renvoie à des accords entre organisations syndicales et patronales les mesures d’application relatives au régime d’assurance chômage. Comme pour la récupération des indus, le Conseil d’État a jugé qu’une telle compétence ne relevait pas des partenaires sociaux.
Aussi, en l’état du droit, les périodes d’activité professionnelle non déclarées sont prises en compte et il n’existe aucune sanction spécifique hormis la répétition des sommes versées à tort, ce qui constitue une véritable singularité dans le champ de la protection sociale. À titre de comparaison, pour les régimes de base de la sécurité sociale toute fraude aux prestations sociales ou fausse déclaration auprès des caisses entraîne des conséquences importantes pour l’allocataire : inscription sur une base nationale, plusieurs niveaux de sanctions allant du remboursement des allocations avec avertissement jusqu’au remboursement avec dépôt de plainte par la caisse locale (159). La sanction normale prévue en ce domaine est la pénalité administrative proportionnelle à la gravité de la faute prévue par l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale.
Si toutes les non-déclarations ne sont pas intentionnelles en matière d’allocation chômage, il convient de mieux faire respecter l’obligation de déclaration en prévoyant des sanctions adaptées
a. La possibilité pour Pôle Emploi de recourir à la retenue et à la contrainte pour obtenir le remboursement des allocations d’assurance-chômage indûment versées
Le I modifie la section 4 du chapitre VI du titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail. Cette section est consacrée à la répétition des prestations indues en matière d’indemnisation des travailleurs involontairement privés d’emploi.
Le 1° modifie les articles L. 5426-8-1 et L. 5426-8-2 du code du travail.
L’article L. 5426-8-1 prévoit les conditions dans lesquelles Pôle Emploi peut recourir à des retenues sur les échéances à venir pour obtenir le remboursement de prestations indûment versées. L’article L. 5426-8-2 prévoit quant à lui les conditions dans lesquelles Pôle emploi peut délivrer une contrainte pour obtenir le remboursement de prestations indûment versées.
Une des conditions, commune aux deux articles, tient à la personne morale pour laquelle Pôle Emploi a versé cette prestation. En l’état du droit, il doit s’agir :
– de l’institution Pôle Emploi elle-même ;
– de l’État ;
– du fonds de solidarité ;
– des employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1 du code du travail à savoir : outre l’État, les établissements publics administratifs, les collectivités territoriales, les entreprises inscrites au répertoire national des entreprises contrôlées majoritairement par l’État, les établissements publics à caractère industriel et commercial des collectivités territoriales, les sociétés d’économie mixte ayant une participation majoritaire d’une collectivité, les services à caractère industriel et commercial gérés par les chambres de commerce et d’industrie territoriales, des chambres d’agriculture, des salariés des établissements et services d’utilité agricoles des chambres d’agriculture, d’Orange ou d’une de ses filiales ou des entreprises de la branche professionnelle des industries électriques et gazières.
Cet article y ajoute l’Union nationale interprofessionnelle pour l’emploi dans l’industrie et le commerce (Unedic), organisme de droit privé désigné par la convention du 31 décembre 1958 pour gérer le régime d’assurance-chômage. C’est en effet Pôle Emploi qui assure le service de l’allocation d’assurance conformément à l’alinéa 2 de l’article L. 5427-1 du code du travail. Ainsi, il lui serait possible de procéder à une retenue ou de délivrer une contrainte pour obtenir le remboursement de l’allocation d’assurance chômage comme c’est déjà le cas pour l’ensemble des autres prestations. La possibilité de délivrer une contrainte n’était pas prévue par l’article 27 de la convention du 14 mai 2014 précitée mais elle constitue une demande des partenaires sociaux. Ces moyens efficaces de recouvrement doivent pouvoir être rapidement mis à disposition de Pôle Emploi au regard des montants de prestations indûment versées et qui doivent être remboursés y compris lorsque le bénéficiaire est de mauvaise volonté.
La rédaction des deux articles L. 5426-8-1 et L. 5426-8-2 emporte deux conséquences.
Tout d’abord, Pôle Emploi est autorisé à effectuer un recouvrement, non plus seulement sur la prestation sur laquelle a été constaté l’indu, mais également sur d’autres prestations qu’il peut avoir à verser au bénéficiaire concerné pour son compte ou pour le compte de l’État, du Fonds de solidarité, des employeurs publics et désormais de l’UNEDIC.
La nouvelle rédaction unifie en quelque sorte le régime de récupération des indus entre les prestations d’aide sociale et les allocations d’assurance chômage alors que ces allocations ne sont pas du même ordre. Les secondes répondent à une logique d’assurance et ont la nature de rémunérations quand les premières relèvent d’un mécanisme de solidarité.
Par ailleurs, les retenues ne peuvent dépasser un plafond, garantissant au bénéficiaire un minimum de prestations sociales mensuelles, à moins que ce dernier opte pour un remboursement intégral en un seul versement. Le montant de ce plafond, fixé par voie règlementaire, devra le cas échéant être adapté. En tout état de cause, la compétence donnée à Pôle Emploi par le présent article ne saurait porter atteinte aux conditions minimales d’existence des bénéficiaires de sommes indues.
Le 2° procède à une modification rédactionnelle des articles L. 5426-8-1 et L. 5426-8-2, en faisant directement référence à « Pôle Emploi ».
b. La non-prise en compte des périodes d’activités non déclarées dans l’ouverture ou le rechargement des droits à l’allocation d’assurance
Le II crée une nouvelle section 1 bis relative aux périodes d’activités non déclarées dans le chapitre VI du titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail comprenant un article unique L. 5426-1-1 qui prévoit une mesure de sanction en cas d’absence de déclaration d’activités en son I et un recours pour le demandeur d’emploi contre cette sanction en son II.
Ainsi, lorsque des périodes d’activité professionnelle d’une durée supérieure à trois jours cumulés au cours d’un mois civil ne sont pas déclarées par le demandeur d’emploi à Pôle Emploi au terme de ce mois, elles ne sont pas prises en compte pour l’ouverture ou le rechargement des droits à l’allocation d’assurance.
L’ouverture d’affiliation des droits est de 122 jours ou 610 heures de travail au cours des 28 mois précédant la fin du contrat de travail (160). Elle sera donc plus difficile à obtenir dès lors que plus de trois jours par mois civil n’auront pas été déclarés.
Le droit rechargeable, qui offre la possibilité d’allonger la durée d’indemnisation d’un demandeur d’emploi pour toute période travaillée avant l’épuisement de ses allocations, est ouvert depuis le 1er octobre 2014 à tout allocataire de l’ARE qui a travaillé au moins 150 heures sur l’ensemble de sa période d’indemnisation. Au terme du dispositif proposé par le I, les heures non déclarées ne seront pas prises en compte au titre du droit rechargeable, réduisant d’autant la durée d’indemnisation.
Le dispositif prévoit en outre que les rémunérations correspondant aux activités non déclarées ne sont pas incluses dans le salaire de référence qui permet de calculer le montant de l’ARE (161). Compte tenu des règles de calcul, cela ne sera préjudiciable à l’allocataire que dans la mesure où le salaire de cette activité non déclarée était supérieur au salaire moyen perçu pour la période déclarée.
Il s’agit d’une mesure plus large que celle qui était prévue par l’accord d’application n° 9 annexé à la convention précitée.
Le II prévoit que lorsque l’application de ces règles conduit à empêcher l’ouverture ou au rechargement des droits à l’allocation d’assurance-chômage, le demandeur d’emploi peut exercer un recours devant l’instance paritaire régionale de Pôle Emploi qui aura à déterminer si les conditions de la non déclaration sont de nature à faire obstacle non seulement au rechargement des droits mais aussi à leur ouverture.
*
La Commission a adopté, lors de l’examen de l’article, deux amendements du rapporteur.
Le premier amendement tend à cloisonner les possibilités de retenue en cas de trop-perçu entre, d’une part, les allocations d’assurance chômage, et d’autre part, les autres prestations, notamment de solidarité, versées par Pôle Emploi. Il est ainsi impossible d’utiliser les autres prestations versées par Pôle Emploi pour rembourser des allocations d’assurance chômage indûment versées.
Le second amendement précise que les périodes d’activité professionnelle non-déclarées sont prises en compte lorsque la non-déclaration est le fait de l’employeur ou d’une erreur de Pôle Emploi.
*
La Commission examine l’amendement AS1041 du rapporteur.
M. le rapporteur. Dans sa rédaction actuelle, l’article 52 permet à Pôle Emploi, si le demandeur ne conteste pas le caractère indu des indemnités de chômage qu’il a touchées, d’obtenir leur remboursement en procédant à des retenues sur les échéances à venir dues à quelque titre que ce soit, comme Pôle Emploi en a déjà la possibilité concernant toutes les autres prestations qu’elle verse.
Bien entendu, le principe de la retenue ne pose pas de problème. En revanche, il n’est pas souhaitable que Pôle Emploi puisse puiser, pour se rembourser des trop-perçus en matière d’allocation de chômage, dans les allocations de solidarité comme l’allocation de solidarité spécifique et l’allocation temporaire d’attente, qui sont versées par l’État. Ces deux catégories de prestations ont des finalités, des modalités et des montants bien différents, ce qui explique que la contrainte et la retenue n’ont longtemps pas été utilisables pour les prestations d’assurance-chômage.
Sans mettre en cause ou diminuer les retenues, l’amendement vise à en cloisonner les possibilités, de telle sorte que seules les allocations chômage servent à rembourser les versements indus passés. Rien ne change concernant les montants de trop-perçu et les retenues ; nous fléchons simplement les capacités provenant de ces différentes ressources.
M. Bernard Accoyer. En fléchant, vous tuez ! S’en prendre ainsi à des entreprises françaises qui connaissent des difficultés, puisqu’elles sont en délicatesse avec Pôle Emploi, peut créer des problèmes. Cet amendement présenté en dernière minute, au terme de notre discussion, mérite naturellement un examen beaucoup plus attentif, plutôt que d’être ainsi défendu à la va-vite.
M. le rapporteur. Avant d’intervenir à la va-vite, cher collègue, lisez donc l’amendement en question : il n’y est nullement question des entreprises, mais de Pôle Emploi.
La Commission adopte l’amendement.
Puis elle examine l’amendement AS1042 du rapporteur.
M. le rapporteur. L’article 52 prévoit une nouvelle sanction en cas de manquement à l’obligation de déclaration qui pèse sur les demandeurs d’emploi lorsqu’ils reprennent une activité professionnelle. Les périodes de plus de trois jours au cours d’un mois qui n’auront pas été déclarées au terme dudit mois ne compteront plus dans l’ouverture et dans le rechargement des droits à l’allocation chômage. Les partenaires sociaux sont très attachés à ce principe de sanction en cas de non-déclaration, et le Gouvernement a repris l’hypothèse la plus raisonnable et proportionnée par rapport à la gravité du manquement.
Cet amendement vise toutefois à offrir des garanties aux demandeurs d’emplois qui n’auraient pas pu, de bonne foi, effectuer la déclaration dans les délais impartis par le texte. Une sanction n’ayant de sens que si elle punit les véritables responsables d’un manquement, je propose d’inscrire dans la loi l’hypothèse dans laquelle un demandeur d’emploi n’est pas en mesure d’effectuer sa déclaration à cause de son employeur ou de Pôle Emploi. Cette précaution évitera les effets indésirables de cette mesure, qui n’en est pas moins nécessaire dans le contexte financier dans lequel se trouvent les comptes de l’UNEDIC.
La Commission adopte l’amendement.
Elle passe à l’amendement AS404 de M. Christophe Cavard.
Mme Véronique Massonneau. Dès lors que le demandeur d’emploi souhaite déposer un recours au sujet des jours pris en compte ou non pour l’ouverture et le rechargement de ses droits à l’assurance-chômage, ce recours devient suspensif de la procédure à son encontre, y compris du recouvrement des indus, le cas échéant. L’amendement vise à éviter de prendre le risque de placer des personnes en situation de recherche d’emploi en difficulté avant même qu’elles aient eu la possibilité de faire valoir le motif de l’éventuelle non-déclaration.
M. le rapporteur. Avis défavorable. Tout d’abord, ce type de recours est généralement non suspensif. Surtout, une telle mesure augmenterait les indus, ce qui fragilisera davantage les personnes tenues de les rembourser. Depuis de nombreuses années, je me bats chaque jour pour éviter ces mesures dont on pense qu’elles protègent les demandeurs d’emploi alors qu’en réalité, elles ne font qu’accumuler la dette qui, à terme, devra être remboursée.
La Commission rejette l’amendement.
Puis elle adopte l’article 52 modifié.
*
* *
Article 53 (nouveau)
(Art. L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1235-4 et L. 1235-5 du code du travail)
Obligation pour l’entreprise de rembourser à Pôle emploi les indemnités chômage versées en cas de licenciement lié à un traitement discriminatoire ou à un harcèlement moral ou sexuel
La Commission a adopté cet article additionnel, à l’initiative de Mme Catherine Coutelle, qui vise à généraliser à tous les licenciements fautifs résultant de discrimination ou de harcèlement, l’obligation qui est faite par le juge à l’employeur de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage perçues par le salarié injustement licencié, dans la limite de six mois d’indemnités.
Il existe de nombreux cas de licenciements fautifs qui s’avèrent être des actes purement discriminatoires, ainsi que les prud’hommes le reconnaissent après avoir été saisis. Il s’agit donc de faire payer à l’employeur le coût social de ce licenciement, sans préjudice des indemnités qui peuvent être versées à la victime.
*
La Commission est saisie de l’amendement AS640 de Mme Catherine Coutelle.
Mme Catherine Coutelle. Cet amendement, déjà adopté dans la loi de 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes, a été censuré par le Conseil constitutionnel non pas sur le fond, mais en raison de l’effet d’entonnoir – il avait été présenté en deuxième lecture. Je précise d’emblée que deux ministres se sont engagés à ce qu’il soit de nouveau intégré dans un prochain projet de loi.
Il vise à ce qu’un employeur ayant procédé à un licenciement indu faisant suite à une discrimination sexuelle ou à des agissements sexuels rembourse les indemnités versées à Pôle Emploi. Cette mesure s’applique d’ores et déjà, mais seulement dans le cadre d’une liste limitative, comprenant, par exemple, les licenciements collectifs ou les cas de représailles. Nous demandons que le champ en soit précisé
Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement.
*
* *
Article 54 (nouveau)
(Art. L. 1235-3-1[nouveau] du code du travail)
Versement d’une indemnité qui ne peut être inférieure à six mois
en cas de licenciement lié à un traitement discriminatoire
ou en raison de faits de harcèlement sexuel
Cet amendement, adopté par la Commission à l’initiative de Mme Catherine Coutelle et sous-amendé par le rapporteur, vise à étendre aux licenciements jugés discriminatoires, liés à des faits de harcèlement sexuel ou à la maternité, la possibilité pour le juge d’ordonner la poursuite du contrat de travail ou d’octroyer au salarié une indemnité minimale équivalente à six mois de salaire.
Cette mesure doit participer à mettre fin à des pratiques aussi courantes qu’inacceptables en indemnisant la victime de façon dissuasive pour l’employeur et suffisante pour elle.
*
La Commission examine l’amendement AS641 rectifié de Mme Catherine Coutelle, qui fait l’objet du sous-amendement AS1047 du rapporteur.
Mme Catherine Coutelle. Cet amendement, rectifié pour corriger une erreur de codification et lui aussi adopté dans la loi de 2014, vise à fixer une indemnité plancher en cas de licenciement pour motif discriminatoire. Comme nous l’ont fait remarquer des associations et des organisations syndicales, le projet de loi supprime les plafonds d’indemnités de licenciement sans rétablir de plancher, ce que nous proposons. Ainsi, toute personne licenciée pour des motifs discriminatoires liés au sexe, à la grossesse, à la situation familiale ou à un harcèlement, doit bénéficier de douze mois d’indemnité au moins. J’ajoute que le Défenseur des droits s’est prononcé en faveur du rétablissement de ce droit.
M. le rapporteur. J’y suis, moi aussi, très favorable. Mon sous-amendement vise simplement à ramener à six mois d’indemnités le plancher prévu, afin de l’aligner, par cohérence et par souci d’égalité, sur l’ensemble des autres dispositifs du code du travail.
Mme Catherine Coutelle. Soit, mais je déposerai de nouveau un amendement visant à fixer un plancher de douze mois en séance publique.
La Commission adopte le sous-amendement AS1047.
Puis elle adopte l’amendement AS641 rectifié ainsi sous-amendé.
*
* *
La Commission examine l’amendement AS65 de Mme Véronique Louwagie.
M. Gilles Lurton. Cet amendement concerne la situation des experts-comptables salariés. L’article L. 8221-6 du code du travail prévoit une présomption simple de non-salariat au profit des personnes physiques inscrites au registre du commerce ou au répertoire des métiers ainsi qu’aux dirigeants de sociétés effectuant des prestations de services pour le compte d’un donneur d’ordre. Cette présomption peut être renversée dès lors que l’intéressé se place dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard du donneur d’ordre.
Ainsi, le statut social de l’expert-comptable est sujet à interprétation par les organismes de protection sociale. L’UNEDIC, par exemple, estime que « le professionnel inscrit actionnaire ou associé porteur d’un nombre important de parts mais minoritaire, titulaire ou non d’un mandat social de gérant ou d’administrateur, n’exerce pas a priori son activité sous un lien de subordination, dans la mesure où il bénéficie d’une indépendance à la fois fonctionnelle et hiérarchique vis-à-vis de l’entreprise ». Cependant, d’autres interprètent les choses différemment : l’URSSAF de Basse-Normandie, par exemple, requalifie en contrat de travail des conventions de prestations de services signées entre un cabinet d’expertise comptable et des sociétés holding d’exercice constituées par d’anciens salariés, estimant que les gérants de ces sociétés exécutent ces prestations à titre exclusif dans le cadre d’un service organisé par le cabinet – qui disposait par ailleurs d’un pouvoir de sanction à leur égard.
Ces positions contradictoires sont préjudiciables pour les experts-comptables salariés, d’une part, qui peuvent ainsi être privés d’une couverture par l’assurance chômage, et pour les cabinets d’experts-comptables, d’autre part, dont les relations contractuelles avec des sociétés d’exercice sous-traitantes peuvent être requalifiées en contrat de travail, avec comme conséquence le redressement des sommes versées au titre de la convention litigieuse. C’est pour y remédier que nous vous proposons d’adopter cet amendement.
M. le rapporteur. Les auteurs de l’amendement reconnaissent eux-mêmes qu’il s’agit d’un problème peu courant, sinon d’un cas particulier. On ne saurait modifier un article relatif à la dissimulation d’emploi salarié en raison d’un cas isolé qui, au demeurant, semble avoir mérité une requalification juridique compte tenu des faits que vous exposez. En matière de requalification, la plus grande prudence s’impose. C’est au problème inverse que nous sommes le plus souvent confrontés : celui de la dissimulation d’un travail salarié derrière des contrats passés entre donneurs d’ordre et prestataires. La pertinence de la subordination juridique comme critère du salariat mérite un débat plus vaste et approfondi que celui que suscite cet amendement de circonstance. Avis défavorable.
La Commission rejette l’amendement.
*
* *
La Commission examine l’amendement AS611 de Mme Catherine Coutelle.
Mme Catherine Coutelle. Vous savez, madame la présidente, combien je tiens à ce que la moitié de l’humanité soit représentée autant que l’autre. Les femmes représentent 48 % des salariés. Nous proposons donc de modifier le titre du projet de loi en ajoutant « les actives » après « les entreprises ». À ceux qui m’opposeront la règle selon laquelle le masculin peut avoir valeur de neutre, je répondrai que la délégation aux droits des femmes se bat assez pour que les droits de l’homme cèdent le pas aux droits humains, et qu’elle demande la féminisation du titre de ce texte.
M. le rapporteur. De telles évolutions me laissent dubitatif, même si je ne m’y oppose pas. L’ordre alphabétique imposerait néanmoins de placer le terme « actives » après « actifs », de même que les « femmes » viennent avant les « hommes » lorsqu’il est question d’égalité professionnelle.
Mme la présidente Catherine Lemorton. Si je suis favorable à la philosophie de cet amendement, je constate que l’ajout proposé supprimerait le vis-à-vis entre les deux groupes que sont les entreprises et les actifs, pour y ajouter un troisième élément, en l’occurrence les actives.
Mme Catherine Coutelle. Suivant les recommandations du Haut conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes concernant la féminisation des titres, des noms et des textes, dont je souhaite qu’elles soient rapidement adoptées par l’Assemblée nationale, je vous propose de modifier le titre en remplaçant « les actifs » par « les actif-ve-s ».
La Commission adopte l’amendement ainsi rectifié.
M. Gérard Cherpion. Avant que nous ne nous prononcions sur l’ensemble du texte, je voudrais, madame la présidente, vous remercier d’avoir animé nos travaux, ainsi que M. le rapporteur pour son travail et la passion qu’il a mise à défendre ce texte.
Nous regrettons de n’avoir pu faire adopter davantage de nos amendements dans plusieurs domaines : l’élargissement du CPA dans le temps et sa fongibilité, qui poseront des problèmes en matière de financement du compte pénibilité, mais aussi la question des licenciements économiques, celle de la médecine du travail qui, en dépit de l’excellent travail de M. Issindou, subit des modifications qui ne nous conviennent pas, ou encore le problème de la représentation patronale, que nous n’avons pu résoudre.
De façon générale, les mesures prises dans ce texte, qui étaient initialement destinées à favoriser l’emploi et le développement des PME, lesquelles détiennent le plus fort potentiel de recrutement, leur seront finalement défavorables. Dans ces conditions, nous voterons contre ce projet de loi.
Mme Monique Iborra. Je vous remercie au nom du groupe SRC, madame la présidente, d’avoir insisté pour que notre commission soit saisie de ce texte au fond. Je remercie également l’ensemble des députés qui ont participé à nos débats, ceux de l’opposition mais surtout ceux de la majorité, car ils ont beaucoup travaillé en amont, aux côtés du rapporteur, avec lequel nous avons constamment débattu de la position de notre groupe.
Contrairement à ce qu’a prétendu l’orateur précédent, j’estime que ce texte, tel qu’il a été amendé, donne corps à une réforme nécessaire – ce dont peut convenir l’opposition, elle qui n’y est jamais parvenue – tout en respectant un juste équilibre entre les intérêts des entreprises et ceux des salariés. Je suis tout à fait défavorable à toute dichotomie entre les uns et les autres : tous ont besoin de travailler ensemble. L’intérêt du texte réside précisément dans sa capacité à tenir compte de l’évolution du marché du travail tout en favorisant la transformation d’une culture de la confrontation en culture de la négociation, non pas en faveur de tel ou tel groupe, mais dans l’intérêt de tous.
Je regrette l’attitude et les postures de l’opposition, qui avait là l’occasion d’approuver ce qu’elle aurait pu considérer comme un premier pas, même imparfait. Vous vous seriez honorés en mettant en relief ceux des éléments du texte qui vous conviennent. Au contraire, vous prétendez que ce texte dessert les intérêts des TPE et des PME ; c’est une contre-vérité que nous ne pouvons accepter.
Mme la présidente Catherine Lemorton. Je remercie tout particulièrement notre rapporteur qui, sur un texte pourtant compliqué, tant pour l’opposition que pour la majorité, a travaillé en amont avec le Gouvernement et multiplié les auditions pour accomplir un remarquable travail.
La Commission adopte l’ensemble du projet de loi modifié.
*
* *
En conséquence, la Commission des affaires sociales demande à l’Assemblée nationale d’adopter le présent projet de loi dans le texte figurant dans le document annexé au présent rapport.
Ø Mouvement des entreprises de France (MEDEF) (*) – M. Pierre Gattaz, président, M. Pierre Brajeux, président du MEDEF Hauts-de-Seine et président de Torann-France, M. Michel Guilbaud, directeur général, et M. Olivier Gainon, directeur de Cabinet.
Ø Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) – M. François Asselin, président, M. Jean-Michel Pottier, vice-président des affaires sociales, M. Georges Tissié, directeur des affaires sociales, et M. Jean-Eudes du Mesnil du Buisson, secrétaire général
Ø Caisse des dépôts et consignations (CDC) – Mme Anne-Sophie Grave, directrice des retraites et de la solidarité, Mme Marie-Hélène Martinez, directrice du projet CPA, et Mme Brigitte Laurent, directrice des relations institutionnelles
Ø Fédération française du bâtiment (FFB) (*) – M. Jacques Chanut, président, Mme Laetitia Assali, directrice des affaires sociales, et M. Benoît Vanstavel, directeur des relations institutionnelles
Ø M. Pascal Terrasse, député de l’Ardèche, auteur du rapport au Premier ministre sur l’économie collaborative (février 2016)
Ø Confédération française démocratique du travail (CFDT) (*) – Mme Véronique Descacq, secrétaire générale adjointe, Mme Lucie Lourdelle et Mme Caroline Werkoff, secrétaires confédérales
Ø Confédération française de l’encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) – M. Franck Mikula, secrétaire national Emploi et formation, et M. Fabrice Richard, juriste en droit social
Ø Union nationale des syndicats autonomes (UNSA) – M. Luc Bérille, secrétaire général, Mme Florence Dodin, secrétaire générale adjointe, et Mme Vanessa Jereb, secrétaire nationale
Ø Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) – M. Bernard Sagez, secrétaire général, M. Richard Bonne, directeur de cabinet, et Mme Élise Guillaume, responsable du service politique sociale
Ø Force ouvrière (FO) – M. Jean-Claude Mailly, secrétaire général, M. Didier Porte, secrétaire confédéral, et Mme Cristelle Gillard, directrice de cabinet
Ø Table ronde réunissant des professeurs d’université :
– M. Emmanuel Dockès, professeur agrégé de droit français spécialiste de droit du travail, à l’Université Paris-Ouest-Nanterre-La-Défense
– M. Pascal Lokiec, agrégé des facultés de droit, professeur à l’Université Paris Ouest-Nanterre-La Défense
– Me Hélène Masse-Dessen, avocate au Conseil d’État et à la Cour de cassation
– M. Jean-François Cesaro, agrégé des universités, professeur de droit à l’Université Panthéon Assas
Ø Table ronde réunissant des avocats spécialisés :
– Me Franck Morel, avocat associé au cabinet Barthélémy avocats Paris
– Me Emmanuelle Barbara, avocate spécialiste en droit du travail de la sécurité sociale et de la protection sociale, Managing Partner au cabinet August & Debouzy
– Me Michel Henry, avocat au cabinet SCP Michel Henry, et Me Matthieu Jantet-Hidalgo, avocat collaborateur
– Me Nicolas de Sevin, président d’AvoSial, avocat associé, au cabinet CMS Bureau Francis Lefebvre, et Me Marie Hélène Bensadoun, avocat associée au groupe social August & Debouzy
Ø Syndicat des avocats de France (SAF) – Me Judith Krivine et Me David Van Der Vlist
Ø Confédération de l’artisanat et des petites entreprises du bâtiment (CAPEB) (*) – M. Patrick Liebus, président, Mme Cécile Sauveur, directrice du pôle juridique et social, Mme Valérie Guillotin, chargée de mission, et M. Dominique Proux, directeur des relations institutionnelles et parlementaires
Ø Union professionnelle artisanale (UPA) – M. Jean-Pierre Crouzet, président, et M. Pierre Burban, secrétaire général
Ø M. Robert Badinter, ancien ministre, ancien président du Conseil constitutionnel, ancien sénateur des Hauts-de-Seine, et M. Antoine Lyon-Caen, professeur agrégé de droit du travail, avocat associé au cabinet Lyon-Caen & Thiriez, auteurs du livre Le travail et la loi (juin 2015)
Ø Ministère du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social – Direction générale du travail (DGT) – M. Yves Struillou, directeur général du travail, M. Jean-Henri Pyronnet, sous-directeur des relations individuelles et collectives du travail, et Mme Claire Scotton, adjointe au sous-directeur des relations individuelles et collectives du travail
Ø M. Jean-Denis Combrexelle, président de la section sociale au Conseil d’État
Ø Union des employeurs de l’économie sociale et solidaire (UDES) – M. David Cluzeau, vice-président chargé des affaires sociales, M. Sébastien Darrigrand, délégué général, et Mme Violaine Trosseille, responsable du pôle relations sociales
Ø Union nationale des professions libérales (UNAPL) – M. Michel Chassang, président, Mme Marie-Françoise Gondard-Argenti, présidente de la commission des affaires sociales, et Mme Chirine Mercier, déléguée générale
Ø Association française des entreprises privées (AFEP) (*) – M. François Soulmagnon, directeur général, Mme Stéphanie Robert, directrice, et Mme France Henry-Labordère, directrice des affaires sociales
Ø Union nationale des missions locales (UNML) – M. Serge Kroichvili, délégué général
Ø M. Bruno Mettling, président-directeur général d’Orange Middle East and Africa, auteur du rapport à la Ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue Social Transformation numérique et vie au travail (septembre 2015), et M. François-Xavier Rey, Program Office Director
Ø Ministère du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social – Délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle (DGEFP) – Mme Carine Chevrier, déléguée générale à l’emploi et à la formation professionnelle, Mme Myriam Mesclond-Ravaud, sous-directrice Parcours d’accès à l’emploi, M. Michel Ferreira-Maia, chef de mission Politiques de formation et de qualification, M. Hervé Leost, sous-directeur Mutations économiques et sécurisation de l’emploi, et M. Cédric Puydebois, sous-directeur Politiques de formation et du contrôle
Ø Mme Selma Mahfouz, présidente de la commission Compte personnel d’activité (CPA), directrice de l’animation de la recherche, des études et des statistiques (DARES) du ministère du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, et Mme Hélène Garner, chef de projet à France Stratégie, rapporteure sur le CPA
Ø Cour de Cassation – M. Jean-Yves Frouin, président de la chambre sociale et M. Alain Chollet, conseiller doyen
Ø CGT – M. Fabrice Angei, membre du bureau confédéral, en charge du dossier Projet de loi travail et M. Alain Alphon-Layre, membre de la direction confédérale, en charge du dossier Santé au travail
(*) Ces représentants d’intérêts ont procédé à leur inscription sur le registre de l’Assemblée nationale, s’engageant ainsi dans une démarche de transparence et de respect du code de conduite établi par le Bureau de l’Assemblée nationale.
Ø Centre interservices de santé et de médecine du travail en entreprise (CISME)
Ø Cercle des DRH
Ø Conseil économique, social et environnemental (CESE)
Ø Conseil national de l’ordre des médecins (CNOM)
Ø Conseil d’orientation des conditions de travail (COCT)
Ø CroissancePlus
Ø Fédération des entreprises de portage salarial (FEPS) (*)
Ø Fédération des particuliers employeurs de France (FEPEM)
Ø Groupe Fnac
Ø Union des employeurs de l’économie sociale et solidaire (UDES)
Ø Union française de l’électricité (UFE)
(*) Ces représentants d’intérêts ont procédé à leur inscription sur le registre de l’Assemblée nationale, s’engageant ainsi dans une démarche de transparence et de respect du code de conduite établi par le Bureau de l’Assemblée nationale.
1 () Cet élément fait l’objet de plus amples développements dans le cadre du commentaire de l’article 5 du présent projet de loi.
2 () DARES Analyses n° 054, juillet 2011.
3 () Cette directive est issue de l’accord européen négocié et signé entre les partenaires sociaux du secteur de la navigation intérieure, en l’occurrence l’Union européenne de la navigation fluviale (UENF), l’Organisation européenne des bateliers (OEB) et la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF).
4 () Jean-Denis Combrexelle, « La négociation collective, le travail et l’emploi », rapport au Premier ministre, septembre 2015.
5 () La chambre sociale de la Cour de cassation a par exemple considéré que, dès lors qu’il n’était pas stipulé dans l’accord lui-même qu’à défaut de renégociation, l’accord à durée déterminée cesserait de produire ses effets, l’absence de renégociation ne mettait pas fin à cet accord (Cass. soc., 28 septembre 2010, n° 09-13.708).
6 () Articles R. 2262-1 à R. 2262-5 du code du travail.
8 () Jean-François Cesaro, Rapport sur la dynamisation de la négociation collective, « Propositions pour le droit du renouvellement et de l’extinction des conventions et accords collectifs de travail », remis à la ministre du Travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social en janvier 2016.
9 () À défaut, la jurisprudence considère que « le consentement unanime des signataires est nécessaire pour engager la procédure de révision » (Cass. soc., 13 nov. 2008, n° 07-42.481, Bull. civ. V, n° 224).
10 () Les modalités de mesure de la représentativité des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d’employeurs sont présentées respectivement aux commentaires des articles 10 et 19 du présent rapport.
11 () Cass. soc., 12 octobre 2005, n° 04-43355.
12 () Cass. soc., 13 octobre 2010, n° 09-13.109.
13 () Cass. soc., 28 octobre 2015, n° 14-16-043.
14 () Op. cit.
15 () Cass. soc.13 mars 2001, n° 99-45.651.
16 () Cass. soc., 24 octobre 2000, n° 98-42.273.
17 () Cass. soc., 23 septembre 2009, n° 08-40.830.
18 () Cass. soc., 17 avril 2008, n° 07-41.465.
19 () Jean-Denis Combrexelle, « La négociation collective, le travail et l’emploi », rapport au Premier ministre, septembre 2015, p. 60.
20 () Cass. soc., 5 novembre 2014, n° 13-14.077.
21 () En cas de procès-verbal attestant l’absence de représentants élus du personnel, un salarié mandaté par une organisation syndicale de salariés représentative peut également conduire la négociation.
22 () Seuls les délégués du personnel sont exclus de ce dispositif, car ils ne tiennent pas de réunion au sens strict du terme, mais sont reçus par l’employeur.
23 () Ainsi, au niveau de l’entreprise ou de l’établissement, la représentativité d’une organisation syndicale est appréciée au regard du respect des critères de l’article L. 2121-1 et à la condition qu’elle ait recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des élections des titulaires au comité d’entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants.
24 () Loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi.
25 () M. Jean-Denis Combrexelle, « La négociation collective, le travail et l’emploi », rapport au Premier ministre remis en septembre 2015.
26 () Décision n° 2012-649 DC du 15 mars 2012 et décision n° 2015-715 DC du 5 août 2015 (considérant 142).
27 () Circulaire DRT n° 09 du 22 septembre 2004.
28 () M. Jean-Denis Combrexelle, « La négociation collective, le travail et l’emploi », rapport au Premier ministre remis en septembre 2015.
29 () Patrick Quinqueton, Rapport sur la restructuration des branches, 17 janvier 2015.
30 () M. Jean-Denis Combrexelle, op. cit.
31 () Patrick Quinqueton, Rapport sur la restructuration des branches, 17 janvier 2015.
32 () Pour un panorama de l’histoire des conventions collectives, consulter le rapport précité de M. Patrick Quinqueton (cf. supra).
33 () M. Michel de Virville, « Pour un code du travail plus efficace », rapport au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, janvier 2004.
34 () « Rapport sur la négociation collective et les branches professionnelles », mission confiée par le Premier ministre à M. Jean-Frédéric Poisson, remis le 28 avril 2009.
35 () DARES Analyses, « Portait statistique des principales conventions collectives de branche en 2012 », décembre 2014, n°097.
36 () M. Jean-Denis Combrexelle, « La négociation collective, le travail et l’emploi », rapport au Premier ministre remis en septembre 2015.
37 () Cass, soc., 2 décembre 2009, n° 08-18.409.
38 () Cass. Soc. 15 mai 2013, n° 11-24.218.
39 () Revue de jurisprudence sociale, 7/2013, n° 546, p. 497.
40 () M. Jean-Denis Combrexelle, « La négociation collective, le travail et l’emploi », rapport au Premier ministre remis en septembre 2015.
41 () DARES, « Les représentants du personnel : quelles ressources pour quelles actions ? », Dares Analyses, novembre 2014, n° 084.
42 () Décision n° 2015-519 QPC du 3 février 2016, MEDEF.
43 () INSEE, "Les entreprises en France", 2014.
44 () Alain Supiot, Au-delà de l’emploi. Transformations du travail et devenir du droit du travail en Europe, 1999.
45 () Alain Supiot, Au-delà de l’emploi, les voies d’une vraie réforme du droit du travail, 2016.
46 () Accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013 pour un nouveau modèle économique et social au service de la compétitivité des entreprises et de la sécurisation de l’emploi et des parcours professionnels des salariés.
47 () Loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 de sécurisation de l’emploi.
48 () Loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale.
49 () Étude d’impact du projet de loi, p. 209.
50 () « Not in Education, Employment or Training ».
51 () Conseil d’analyse économique, P. Cahuc, S. Carcillo, Klaus F. Zimmermann, « L’emploi des jeunes peu qualifiés en France », 2013.
52 () Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007.
53 () Décret n° 2013-880 du 1er octobre 2013 relatif à l’expérimentation de la « garantie jeunes ».
54 () Rapport de M. Jean-Christophe Sciberras, « Pour une clarification du bulletin de paie », 27 juillet 2015
55 () « Transformation numérique et vie au travail », rapport de M. Bruno Mettling à Mme Myriam El Khomri, ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, septembre 2015, p. 13.
56 () LBMG Worklabs, Le télétravail en France, 2012.
57 () Centre d’analyse stratégique, « Le développement du télétravail dans la société numérique de demain », novembre 2009.
58 () Loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi
59 () Source : Direction générale du travail et étude d’impact annexée au présent projet de loi
60 () Rapport « L’inspection du travail en France en 2013 », Direction générale du travail
61 () Loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail.
62 () Loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi.
63 () La loi du 17 août 2015 prévoit la possibilité, dans les entreprises d’au moins 300 salariés, de regrouper les délégué du personnel, le comité d’entreprise et le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ou deux de ces institutions seulement, au sein d’une instance commune.
64 () Loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social.
65 () Loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale.
66 () Rapport d’information n° 3558 de MM. Gérard Cherpion et Jean-Patrick Gille sur la mise en application de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale.
67 () Décision QPC n° 2014-388 du 11 avril 2014.
68 () Circulaire du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle DRT no 90/18 du 30 octobre 1990.
69 () Cass. soc., 12 oct. 1999, n° 97-40.915 ; Cass. soc., 9 mars 2005, no 02-46.154.
70 () Cass. soc., 5 janv. 1999, n° 96-42.931.
71 () Cass. soc., 5 déc. 2007, n° 06-41.313.
72 () Règlement CEE, n° 1408/71 du Conseil, 14 juin 1971.
73 () Directive n° 2014/36/UE du 26 février 2014 relative aux conditions d’entrée et de séjour des travailleurs saisonniers ressortissants de pays tiers.
74 () Cass. soc., 15 oct. 2002, n° 00-41.759 ; Cass. soc., 16 nov. 2004, n° 02-46.777.
75 () Directive 2001/23 du 21 mars 2001
76 () CJCE, 15 juin 1988, Boîte Internationale, aff. C/101.87, Rec. p. 3057.
77 () CJCE, 12 mars 1998, Dethier Equipement, aff. C/319.94, Rec. I., p. 1079.
78 () Cass. soc., 18 mars 1982, Bull. civ. V, n° 184 ; 21 mars 1990, Bull. civ. V, n° 132.
79 () Cass. soc., 17 juill. 1990, Bull. civ. V, n° 372 ;17 juin 1995, Bull. civ. V, n° 217 ; 31 mars 1998, Bull. civ. V, n° 182.
80 () Cass. soc., 22 janv. 2002, Bull. civ. V, n° 25 ; Rapport annuel, p. 354.
81 () La loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi a imposé une obligation de rechercher un repreneur aux entreprises d’au moins 1 000 salariés envisageant la fermeture d’un établissement qui aurait pour conséquence un projet de licenciement collectif. Cette obligation a été renforcée par la loi n° 2014-384 du 29 mars 2014 visant à reconquérir l’économie réelle, dite « loi Florange ».
82 () Cour des comptes, Bilan des conventions de revitalisation, Communication à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire de l’Assemblée nationale, décembre 2015.
83 () Circulaire DGEFP/DGCIS/DATAR n° 2012-14 du 12 juillet 2012 relative à la mise en œuvre de l’obligation de revitalisation instituée à l’article L. 1233-84 du code du travail.
84 () Loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016.
85 () Inspection générale de l’administration, rapport n° 014-056/14-012/02, juillet 2014. Le contrat unique d’insertion prend la forme du contrat d’accompagnement dans l’emploi dans le secteur non marchand.
86 () Loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi.
87 () Cour de cassation, chambre sociale, 22 juin 1994, pourvoi n 91-41.610.
88 () Cour de cassation, chambre sociale, 8 avril 2009, pourvoi n° 07-44.307 et Cour de cassation, chambre sociale, 26 septembre 2012, pourvoi n° 11-17.908.
89 () Cour de cassation, chambre sociale, formation de section, prud’hommes, 13 juillet 2004, pourvoi n° 02-41.046, arrêt n° 1623.
90 () Cour de cassation, chambre sociale, 26 janvier 2011, pourvoi n 09-72.284.
91 () Cour de cassation, chambre sociale, 29 février. 2012, pourvoi n° 10-28.848.
92 () Cour de cassation, chambre sociale, 10 novembre 1993, pourvoi n° 89-41.898, arrêt n° 3428.
93 () Cour de cassation, chambre sociale, 28 mars 2007, pourvoi n° 06-41068.
94 () Cour de cassation, chambre sociale, 30 septembre 2003, pourvoi n° 01-46667.
95 () Loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi.
96 () En cas d’inaptitude d’origine professionnelle, l’article L. 1226-12, dans sa rédaction actuelle, dispose que le salarié déclaré inapte peut être licencié lorsque le reclassement est impossible ou lorsque le salarié a refusé les propositions de reclassement. La jurisprudence a appliqué cette solution à l’inaptitude d’origine non professionnelle.
97 () Loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi.
98 () Rapport du groupe de travail « Aptitude et médecine du travail », établi par M. Michel Issindou, M. Christian Ploton et Mme Sophie Quinton-Fantoni,, avec l’appui de l’inspection générale des affaires sociales, mai 2015.
99 () Cour de cassation, chambre sociale 6 janvier 2010, pourvoi n° 08-44177.
100 () Cour de cassation, chambre sociale, 24 mars 2010, pourvoi n° 09-40339.
101 () Loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi.
102 () Première lecture du projet de loi relatif au dialogue social et à l’emploi, compte rendu intégral de la deuxième séance du jeudi 28 mai 2015, Assemblée nationale, Journal officiel de la République française, XIVe législature, session ordinaire de 2014-2015, 243e séance.
103 () Au moins tous les 24 mois, au terme de l’article R. 4624-16 du code du travail.
104 () Article R. 4624-18 du code du travail.
105 () Loi n° 2014-790 du 10 juillet 2014 visant à lutter contre la concurrence sociale déloyale.
106 () Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques.
107 () Directive 96/71/CE du Parlement européen et du conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services.
108 () Directive 2014/67/UE du Parlement Européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à l'exécution de la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services et modifiant le règlement (UE) n° 1024/2012 concernant la coopération administrative par l'intermédiaire du système d'information du marché intérieur ( « règlement IMI » ).
109 () Règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale.
110 () Direction générale du travail, Analyse des déclarations de détachement des entreprises prestataires de services en France en 2013, novembre 2014.
111 () Par exemple : CJUE, 19 décembre 2012, Commission c/Belgique. La Cour estime que les formalités exigées par la base de données belge Limosa sont une entrave à la prestation de service.
112 () M. Jean Grosset, rapporteur appuyé par M. Bernard Cieutat, « Les travailleurs détachés ». Avis du Conseil économique social et environnemental, septembre 2015.
113 () Directive 2014/67/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à l'exécution de la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services et modifiant le règlement (UE) n° 1024/2012 concernant la coopération administrative par l'intermédiaire du système d'information du marché intérieur ( « règlement IMI » ).
114 () Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques.
115 () Il existe de nombreux exemples : la contribution pour frais de contrôle prévue à l’article L. 612-20 du code monétaire et financier dont les personnes soumises au contrôle de l’Autorité de Contrôle Prudentiel s’acquittent auprès de la Banque de France chaque année, la contribution sur les activités privées de sécurité qui finance le Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) prévue à l’article 1609 quintricies du code général des impôts.
116 () Directive 2014/67/UE du Parlement Européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à l'exécution de la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services.
117 () Loi n° 2014-790 du 10 juillet 2014 visant à lutter contre la concurrence sociale déloyale.
118 () Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques.
119 () Directive 2014/67/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à l'exécution de la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services et modifiant le règlement (UE) n° 1024/2012 concernant la coopération administrative par l'intermédiaire du système d'information du marché intérieur (« règlement IMI »).
120 () Décret n° 2015-1579 du 3 décembre 2015 relatif à la suspension temporaire de la réalisation de prestations de services internationales illégales et à la compétence des agents de contrôle de l'inspection du travail des services déconcentrés.
121 () Décision-cadre 2005/214/JAI du Conseil du 24 février 2005 concernant l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux sanctions pécuniaires.
122 () Communication de la commission au Parlement européen, au conseil, au comité économique et social européen et au comité des régions, Détachement de travailleurs dans le cadre de la prestation de services : en tirer les avantages et les potentialités maximum tout en garantissant la protection des travailleurs, 13 juin 2007.
123 () Décret n° 2014-406 du 16 avril 2014 relatif aux attributions du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.
124 () Loi n° 2014-790 du 10 juillet 2014 visant à lutter contre la concurrence sociale déloyale.
125 () Organisation internationale du travail, convention n° 81 sur l'inspection du travail, 1947.
126 () Organisation internationale du travail, convention n° 129 sur l'inspection du travail (agriculture), 1969.
127 () Cour de cassation, chambre criminelle, 22 juillet 1981, no 81-90.167.
128 () Cour de cassation, chambre criminelle, 14 décembre 1912, S. 1914. 1. 420.
129 () M. Jean Grosset, rapporteur appuyé par M. Bernard Cieutat, « Les travailleurs détachés ». Avis du Conseil économique social et environnemental, septembre 2015, p. 90.
130 () Loi n° 60-808 du 5 août 1960 d’orientation agricole.
131 () Loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 d’orientation agricole.
132 () Loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d’orientation agricole.
133 () M. Jean Grosset, rapporteur appuyé par M. Bernard Cieutat, « Les travailleurs détachés ». Avis du Conseil économique social et environnemental, septembre 2015, p. 15.
134 () Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques.
135 () Loi n° 2014-790 du 10 juillet 2014 visant à lutter contre la concurrence sociale déloyale.
136 () Sous réserve des compétences de certains agents de contrôle assimilés au corps de l’inspection du travail dans le domaine des mines et carrières, des industries électriques et gazières et des établissements de défense.
137 () Ces chiffres correspondent à des équivalents temps plein (ETP). Direction générale du travail-Département de l’animation de la politique du travail et du contrôle, L’inspection du travail en France en 2013, novembre 2014.
138 () Décision n° 2007-561 DC du 17 janvier 2008, Loi ratifiant l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative).
139 () Décret n° 2014-359 du 20 mars 2014 relatif à l'organisation du système d'inspection du travail.
140 () Initialement prévue à l’article 20 de ce projet de loi, cette disposition a été supprimée par le Sénat et ne figure donc pas dans la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale.
141 () Loi n° 2013-185 du 1er mars 2013 portant création du contrat de génération.
142 () Loi n° 2015-990 du 6 août 2015.
143 () Voir le rapport n° 1942, du 14 mai 2014, de M. Denys Robiliard, au nom de la Commission des affaires sociales, sur la proposition de loi relative aux pouvoirs de l’inspection du travail.
144 () Ce chiffre provient de l’étude d’impact annexée au projet de loi.
145 () Arrêté du 30 décembre 2008 relatif aux prescriptions techniques de sécurité applicables aux bateaux de marchandises, aux bateaux à passagers et aux engins flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures.
146 () Loi n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi.
147 () Article L. 5312-1 du code du travail.
148 () Loi n° 96-1181 du 30 décembre 1996 de finances pour 1997.
149 () Cour de cassation. 1ère chambre civile, 1er mars 2005, n° 03-11.496.
150 () Règlement général de l’UNEDIC annexé à la Convention d'assurance chômage, 6 mai 2011, article 26.
151 () UNEDIC, Circulaire n° 2016-10 du 29 février 2016, « Conséquences de la décision du Conseil d’État du 5 octobre 2015 sur la convention du 14 mai 2014 relative à l’indemnisation du chômage et ses textes associés », p. 8.
152 () Article 61 de la loi de finances n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 pour 2012.
153 () Décret n° 2012-1066 du 18 septembre 2012 relatif à la répétition des prestations indues versées par Pôle emploi.
154 () Règlement général annexé à la convention UNEDIC du 14 mai 2014 relative à l’indemnisation du chômage.
155 () CE, 5 octobre 2015, Association des amis des intermittents et précaires et autres, n° 383956.
156 () Article L. 5411-2 du code du travail.
157 () Article R. 5411-7 du code du travail.
158 () Arrêté du 25 juin 2014 portant agrément de la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage et des textes qui lui sont associés.
159 () La fraude aux allocations constitue en effet une infraction prévue par les articles 313-1 et 441-7 du code pénal.
160 () 36 mois pour les plus de 50 ans.
161 () Le salaire de référence est calculé sur les 12 derniers mois précédant le dernier jour de travail payé. Le montant journalier de l’ARE est égal au montant le plus élevé entre 40,4 % du salaire journalier de référence augmenté de 11,76 euros et 57 % du salaire journalier de référence.