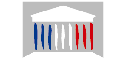
N° 3784
______
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 25 mai 2016.
RAPPORT
FAIT
en application de l’article 145-5 du Règlement
AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION
ET DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE,
sur le contrôle parlementaire de l’état d’urgence
(auditions effectuées par la Commission en application de l'article 5 ter de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires)
PAR MM. Dominique Raimbourg et Jean-Frédéric Poisson,
Députés
——
___
Pages
INTRODUCTION 5
EXAMEN EN COMMISSION 11
LISTE DES PERSONNES ENTENDUES 13
COMPTES RENDUS DES AUDITIONS 15
Quelques heures après les attentats meurtriers qui ont frappé notre pays le 13 novembre 2015, le Président de la République a réuni le Conseil des ministres et décrété (1) l’état d’urgence pour une durée de douze jours, ainsi que le permet la loi du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence.
Très vite, la nécessité de proroger ce régime d’exception au-delà de cette durée initiale s’est imposée, conduisant à l’adoption d’une loi de prorogation, ainsi que le prévoit l’article 2 de la loi du 3 avril 1955 précitée. Votée en un temps record, cette loi de prorogation (2) a été l’occasion d’actualiser des dispositions législatives datées et d’instituer, sur l’initiative de M. Jean-Jacques Urvoas, alors président de la commission des Lois, un contrôle parlementaire de l’état d’urgence.
Le nouvel article 4-1 de la loi de 1955 prévoit ainsi : « L’Assemblée nationale et le Sénat sont informés sans délai des mesures prises par le Gouvernement pendant l’état d’urgence. Ils peuvent requérir toute information complémentaire dans le cadre du contrôle et de l’évaluation de ces mesures ».
Il restait ensuite à donner corps à ce nouveau contrôle.
L’Assemblée nationale et le Sénat et plus particulièrement, en leur sein, les commissions des Lois auxquelles avait été confié l’examen de la loi de prorogation de l’état d’urgence, s’y sont attelés avec diligence : le 27 novembre 2015, la commission des Lois du Sénat créait un comité de suivi de l’état d’urgence dont le rapporteur spécial est M. Michel Mercier ; le 2 décembre 2015, la commission des Lois de l’Assemblée nationale définissait, sous l’impulsion de son président Jean-Jacques Urvoas, les grandes orientations du contrôle parlementaire de l’état d’urgence et le confiait au rapporteur et au co-rapporteur d’application du projet de loi de prorogation (3).
À procédure d’exception, contrôle exceptionnel. La nécessité d’un contrôle parlementaire innovant s’est très vite imposée à notre commission. Ce choix se justifiait à plus d’un titre. Dès le 14 novembre, l’état d’urgence avait été déployé et mis en œuvre à grande échelle (4) : il n’était pas question d’attendre mais au contraire de contrôler dans le temps même de l’action et le contrôle parlementaire s’est vite imposé comme un élément de la légitimité de cette période d’exception. Il s’agissait aussi de mettre à la disposition de chacun des données complètes qui permettent de saisir l’état d’urgence et de substituer une évaluation aussi complète que possible aux angoisses et aux fantasmes.
Élaborés au moment où l’état d’urgence était dans sa période maximale d’utilisation et très fortement médiatisé (5), les outils témoignent de la volonté d’instaurer un contrôle approfondi, autant que possible « en temps réel » et fondé sur une démultiplication des sources d’information.
La première initiative, lancée dès le 27 novembre 2015 et poursuivie avec intensité pendant plusieurs semaines, a consisté à saisir le ministre de l’Intérieur afin d’obtenir des précisions sur certaines mesures individuelles ou générales (perquisitions, assignations à résidence, interdictions de manifester, couvre-feu,…) sur lesquelles l’attention des rapporteurs avait été appelée. Il s’est souvent agi de cas dont la presse, légitimement vigilante sur le périmètre et les modalités d’action des services de police, s’était fait l’écho. Soixante-six courriers auxquels le ministre a tous répondu ont ainsi été envoyés. Signe de la vigilance du Parlement, cette démarche – qui a été reprise récemment – a contribué à structurer le contrôle en permettant de mieux saisir l’usage par le Gouvernement des pouvoirs qui lui ont été conférés et d’ouvrir des pistes de travail aux rapporteurs.
Nécessairement partiels, ces cas individuels n’étaient toutefois pas suffisants pour parvenir à des conclusions et obtenir une connaissance fine et détaillée de l’application de l’état d’urgence. Aussi la Commission s’est-elle attachée à disposer de données statistiques exhaustives auprès du Gouvernement.
Ces données sont de deux ordres :
– les données chiffrées dites de « synthèse » qui récapitulent le nombre de mesures prises en application de la loi du 3 avril 1955 et les suites judiciaires auxquelles elles donnent lieu ;
– les informations détaillées sur chacune des mesures administratives mises en œuvre depuis le 14 novembre dernier. Ces données détaillées n’étaient initialement pas disponibles au cabinet du ministre mais ont été fournies intégralement pour les perquisitions et les assignations à résidence décidées depuis le 14 novembre. Elles nous ont permis de diffuser, dès le 13 janvier dernier, un aperçu objectif de la mise en œuvre des perquisitions et des assignations à résidence dans le temps et l’espace (6).
Ces données étant essentielles à la qualité du contrôle parlementaire de l’état d’urgence, vos rapporteurs ont souligné le 17 mai dernier la nécessité de disposer de données complètes sur les perquisitions conduites depuis le 26 février 2016 – ce qui n’est pas le cas à ce jour – et sur les mesures de limitation de la circulation et de réunions pour lesquelles les remontées d’information ne sont aujourd’hui pas consolidées.
Plusieurs instances ont également été sollicitées, afin de croiser les sources d’information. Outre le Gouvernement, partenaire évident puisque chargé de l’application de l’état d’urgence et qui a toujours fait montre d’une disponibilité qu’il convient ici de saluer, des échanges d’information ont été organisés avec le Conseil d’État, afin de disposer de données exhaustives sur le contentieux administratif lié à la mise en œuvre de l’état d’urgence. Le Défenseur des droits, qui a mis en alerte ses 397 délégués territoriaux, nous a signalé plusieurs cas puis est venu le 22 mars dernier présenter ses propres conclusions sur l’état d’urgence (7). La Commission nationale consultative des droits de l’homme a également été sollicitée le 9 décembre puis est venue présenter ses observations le 16 mars devant la commission des Lois (8). Enfin, des avocats, des collectifs et des associations nous ont également saisis de différents cas ainsi que des députés, auxquels nous avions adressé un courrier le 8 décembre afin de les informer de la démarche de contrôle entreprise par la Commission et leur indiquer notre disponibilité pour recevoir tous les éléments d’information qu’ils jugeraient pertinent de nous transmettre.
Soucieux de voir comment était concrètement appliqué l’état d’urgence, nous avons procédé à des déplacements dans plusieurs départements pour y rencontrer, sous l’autorité du préfet, les acteurs de la mise en œuvre de l’état d’urgence sur le terrain (9). Ces échanges nous ont permis de tirer des enseignements précieux sur les méthodes de travail et l’organisation déployée à l’échelon préfectoral (10).
Enfin, la Commission, dans son entier, a conduit plusieurs auditions – dont les comptes rendus sont rassemblés dans le présent rapport – et qui ont été faites dans le format spécifique des auditions des commissions d’enquête, c’est-à-dire sous serment.
En effet, pour mettre en œuvre son contrôle, la Commission des Lois a souhaité mobiliser tous les pouvoirs mis à la disposition des parlementaires, tant ceux très larges que leur attribue le nouvel article 4-1 de la loi du 3 avril 1955 qui offre au Parlement un droit de regard constant sur les mesures mises en œuvre durant l’état d’urgence, que ceux – plus généraux – prévus par les textes relatifs aux assemblées parlementaires.
Le 2 décembre 2015, la Commission a ainsi demandé à être dotée des prérogatives spécifiques d’investigation dévolues aux commissions d’enquête, ainsi que l’article 5 ter de l’ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires lui en offrait la possibilité. Introduite en 1996 mais jamais utilisée jusqu’alors par l’Assemblée nationale, cette disposition autorise les commissions permanentes à « demander à l’assemblée à laquelle elles appartiennent, pour une mission déterminée et une durée n’excédant pas six mois, de leur conférer, dans les conditions et limites prévues par cet article, les prérogatives attribuées aux commissions d’enquête ». Par ce biais, la Commission a ainsi pu procéder à des auditions sous serment, et ses rapporteurs faire des contrôles sur pièces et sur place et demander à disposer de tous documents de service.
Au terme de la procédure prévue par les articles 145-1 à 145-3 du Règlement de notre assemblée, la commission des Lois a donc été dotée à partir du 4 décembre 2015 et pour une durée de trois mois (11) des prérogatives attribuées aux commissions d’enquête pour assurer sa mission de suivi, de contrôle et d’évaluation des mesures prises pendant l’état d’urgence. L’état d’urgence ayant été prorogé pour trois mois supplémentaires en février (12), la Commission, lors de sa réunion du 11 février dernier, a demandé à être dotée de ces prérogatives spécifiques pour une nouvelle période de trois mois, à compter du 4 mars dernier.
Ces prérogatives vont donc arriver à échéance le 3 juin prochain. Pour se conformer aux dispositions sur les commissions d’enquête, qui prévoient que les documents en leur possession ne peuvent donner lieu ni à publication ni à débat si la commission n’a pas déposé son rapport dans un délai de six mois suivant sa constitution, vos rapporteurs ont donc proposé à la Commission d’autoriser la publication des comptes rendus des auditions faites à huis clos, en application de l’article 5 ter de l’ordonnance du 17 novembre 1958.
Organisées à huis clos en raison de la sensibilité des sujets abordés, les auditions conduites en janvier dernier ont été l’occasion d’entendre les acteurs principaux de l’état d’urgence alors que l’essentiel des mesures venait d’être pris (13) et que s’esquissait progressivement l’environnement jurisprudentiel de l’état d’urgence. Ont ainsi été entendus : les responsables des services de renseignement et de la sécurité (le directeur général de la sécurité intérieure, le chef du service du renseignement territorial, des responsables locaux de la sécurité publique et de la gendarmerie ; les instances coordinatrices du ministère de l’Intérieur en matière de lutte contre le terrorisme et contre la radicalisation), le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques du ministère de l’Intérieur ; le vice-président du Conseil d’État et le président de la section du contentieux du Conseil d’État ainsi que des représentants syndicaux des magistrats administratifs ; la directrice centrale de la police judiciaire au ministère de l’Intérieur ; le directeur des affaires criminelles et des grâces du ministère de la Justice. Chacun y fait le récit de la façon dont l’état d’urgence – objet juridique pour l’essentiel inconnu – a été « acclimaté » dans les circonstances dramatiques que traversait notre pays.
En outre, le présent rapport inclut les comptes rendus des auditions, conduites en mars, des représentants de la Commission nationale consultative des droits de l’homme, de la Ligue des droits de l’homme puis du Défenseur des droits. Ces instances y livrent leurs observations et leurs conclusions sur la mise en œuvre des mesures de police administrative prises en application de la loi du 3 avril 1955.
Tout au long de ces derniers mois, nous nous sommes efforcés de rendre compte de nos travaux et de nos conclusions, acquis à l’idée qu’un contrôle rigoureux et en temps réel de l’état d’urgence n’avait de sens que s’il faisait l’objet d’une restitution publique régulière.
Les données recueillies grâce à cette « veille parlementaire » et aux outils de contrôle déployés ont ainsi alimenté les différentes communications d’étape présentées à la commission des Lois depuis le 2 décembre dernier (14). Parallèlement, les données de synthèse recueillies auprès du ministère de l’Intérieur et du ministère de la Justice sont mises en ligne chaque semaine sur la page que notre Commission a dédiée au suivi de l’état d’urgence sur le site internet de l’Assemblée nationale.
Alors que vient d’être publiée la loi prorogeant l’état d’urgence jusqu’au 25 juillet prochain (15), vos rapporteurs tiennent à souligner ici la vigilance dont ils continueront de faire preuve et leur souhait d’adapter leur contrôle aux différentes formes que peut prendre l’état d’urgence. L’article 4-1 de la loi du 3 avril 1955 leur donne toute faculté pour assurer leur mission de contrôle. Ils continueront donc de publier les données chiffrées dont ils disposent, de faire des communications d’étape afin de tenir la Commission informée de l’application de l’état d’urgence, avant de présenter, dans un prochain rapport, l’ensemble de leurs analyses sur cette période d’exception.
*
* *
Au cours de sa réunion du mercredi 25 mai 2016, la commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République examine le présent rapport.
M. le président Dominique Raimbourg. Mes chers collègues, ainsi que Jean-Frédéric Poisson et moi vous l’avons indiqué le 17 mai dernier, lors de notre communication d’étape sur le contrôle parlementaire de l’état d’urgence, les prérogatives d’enquête reconnues à notre Commission en application de l’article 5 ter de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 arrivent à expiration. En effet, octroyés une première fois le 4 décembre dernier pour une durée de trois mois, reconduits ensuite pour trois mois supplémentaires le 4 mars dernier, ces pouvoirs spécifiques ne peuvent être attribués que pour une durée totale de six mois.
Par conséquent, nous vous proposons d’autoriser aujourd’hui la publication des différentes auditions faites à huis clos par notre Commission à l’occasion de son contrôle de l’application de l’état d’urgence, sur le fondement de l’article 5 ter de l’ordonnance précitée.
La Commission autorise la publication du présent rapport.
M. le président Dominique Raimbourg. Conformément à l’alinéa 3 de l’article 144-2 du Règlement de notre Assemblée, le rapport rassemblant ces comptes rendus sera diffusé à l’issue d’un délai de cinq jours francs suivant la publication de son dépôt au Journal officiel, soit le 1er juin prochain.
• Jeudi 7 janvier 2016
— M. Jean-Marc Sauvé, vice-président du Conseil d’État et M. Bernard Stirn, président de la section du contentieux
— M. Serge Gouès, président du Syndicat de la juridiction administrative (SJA) et Mme Hélène Bronnenkant, secrétaire générale du SJA
• Vendredi 8 janvier 2016
— M. Loïc Garnier, chef de l’Unité de coordination de la lutte anti-terroriste (UCLAT) au ministère de l’Intérieur
— M. Patrick Calvar, directeur général de la sécurité intérieure (DGSI) au ministère de l’Intérieur, M. Jean-Yves Guillard, sous-directeur de la sécurité intérieure, et Mme Marie Deniau, chef de cabinet
— M. Jérôme Léonnet, directeur central adjoint du Service central du renseignement territorial au ministère de l’Intérieur
— Mme Mireille Ballestrazzi, directrice centrale de la police judiciaire au ministère de l’Intérieur
— M. Olivier de Mazières, préfet, chargé de l’état-major opérationnel de la prévention du terrorisme (EMOPT) au ministère de l’Intérieur
— M. Robert Gelli, directeur des affaires criminelles et des grâces au ministère de la Justice
• Lundi 11 janvier 2016
Table ronde réunissant des responsables opérationnels de la gendarmerie nationale
— Colonel Marc Boget, commandant le groupement de gendarmerie départementale de l'Oise
— Colonel Frédéric Boudier, commandant le groupement de gendarmerie départementale des Bouches-du-Rhône
— Colonel Marc Payrar, commandant le groupement de gendarmerie départementale de la Vendée
— Général Michel Pidoux, commandant la région de gendarmerie du Centre – Val de Loire et le groupement de gendarmerie départementale du Loiret
— Colonel David Rey, commandant le groupement de gendarmerie départementale de Saône-et-Loire
— Colonel Charles-Antoine Thomas, commandant le groupement de gendarmerie départementale du Val d'Oise
Table ronde réunissant des responsables opérationnels de la police nationale
— Le commissaire divisionnaire M. Paul Agostini, directeur départemental de la sécurité publique de la Haute-Vienne
— Le commissaire divisionnaire M. Pascal Belin, directeur départemental de la sécurité publique du Loiret
— L’inspecteur général M. Pierre-Marie Bourniquel, directeur départemental de la sécurité publique des Bouches-du-Rhône
— Le commissaire divisionnaire M. Jean-François Illy, directeur départemental de la sécurité publique du Bas-Rhin
— Le contrôleur général M. Patrick Mairesse, directeur départemental de la sécurité publique de l’Isère
— Mme Sophie Tissot, présidente de l’Union syndicale des magistrats administratifs (USMA), et M. Olivier Di Candia, secrétaire général de l'USMA
• Mardi 19 janvier 2016
— M. Thomas Andrieu, directeur des libertés publiques et des affaires juridiques au ministère de l’Intérieur
• Mardi 15 mars 2016
— Mme Christine Lazerges, présidente de la Commission nationale consultative des droits de l'homme (CNCDH), Mme Gwénaëlle Calvès, membre de la CNCDH, et M. Hervé Henrion-Stoffel, conseiller juridique
— M. Michel Tubiana, président d’honneur de la Ligue des droits de l’homme
• Mardi 22 mars 2016
— M. Jacques Toubon, Défenseur des droits.
COMPTES RENDUS DES AUDITIONS (16)
Audition, non ouverte à la presse, de M. Jean-Marc Sauvé, vice-président du Conseil d'État, et de M. Bernard Stirn, président de la section du contentieux 16
Audition, non ouverte à la presse, de M. Serge Gouès, président du syndicat de la juridiction administrative, et de Mme Hélène Bronnenkant, secrétaire générale 32
Audition, non ouverte à la presse, de M. Loïc Garnier, chef de l’Unité de coordination de la lutte anti-terroriste (UCLAT) au ministère de l’Intérieur 44
Audition, non ouverte à la presse, de M. Patrick Calvar, directeur général de la sécurité intérieure au ministère de l’Intérieur, accompagné de M. Jean-Yves Guillard, sous-directeur de la sécurité intérieure, et de Mme Marie Deniau, chef de cabinet 53
Audition, non ouverte à la presse, de M. Jérôme Léonnet, directeur central adjoint chargé du renseignement, chef du Service central du renseignement territorial 64
Audition, non ouverte à la presse, de Mme Mireille Ballestrazzi, directrice centrale de la police judiciaire au ministère de l’Intérieur 74
Audition, non ouverte à la presse, de M. Olivier de Mazières, préfet, chargé de l’état-major opérationnel de la prévention du terrorisme (EMOPT) au ministère de l’Intérieur 84
Audition, non ouverte à la presse, de M. Robert Gelli, directeur des affaires criminelles et des grâces au ministère de la Justice 94
Table ronde, non ouverte à la presse, réunissant des responsables opérationnels de la gendarmerie nationale 102
Table ronde, non ouverte à la presse, réunissant des responsables opérationnels de la police nationale 114
Audition, non ouverte à la presse, de Mme Sophie Tissot, présidente de l’Union syndicale des magistrats administratifs, et de M. Olivier Di Candia, secrétaire général 130
Audition, non ouverte à la presse, de M. Thomas Andrieu, directeur des libertés publiques et des affaires juridiques au ministère de l’Intérieur 139
Audition de Mme Christine Lazerges, présidente de la Commission nationale consultative des droits de l'homme (CNCDH), de Mme Gwénaëlle Calvès, membre de la CNCDH et de M. Hervé Henrion-Stoffel, conseiller juridique 161
Audition de M. Michel Tubiana, président de la Ligue des droits de l’homme 173
Audition de M. Jacques Toubon, Défenseur des droits (17) 180
AUDITION DE M. JEAN-MARC SAUVÉ, VICE-PRÉSIDENT DU CONSEIL D'ÉTAT, ET DE M. BERNARD STIRN, PRÉSIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
Compte rendu de l’audition, non ouverte à la presse, du jeudi 7 janvier 2016
M. le président Jean-Jacques Urvoas. Messieurs les présidents, merci beaucoup de votre disponibilité.
La commission des Lois s’est lancée, vous le savez, dans un exercice nouveau : le contrôle en temps réel de l’application des mesures que le Gouvernement est amené à prendre dans le cadre de l’état d’urgence. À ce titre, Jean-Frédéric Poisson, rapporteur, et moi-même avons effectué des déplacements dans plusieurs départements – la Haute-Garonne, l’Hérault, l’Ille-et-Vilaine, le Val-de-Marne, l’Yonne, le Nord, le Rhône –, au cours desquels il a notamment été question du contrôle exercé sur ces mesures par les juridictions administratives. Celles-ci, saisies en référé, ont rendu un grand nombre de décisions. Il nous a donc paru utile de recueillir votre analyse au terme de ces premières semaines d’application de l’état d’urgence.
Pour exercer cette mission de contrôle de l’état d’urgence, notre commission est dotée des pouvoirs que l’article 5 ter de l’ordonnance du 17 novembre 1958 confère aux commissions d’enquête. Compte tenu de la sensibilité des questions qui touchent aux mesures prises pendant l’état d’urgence et du programme des auditions à venir – notamment celles, demain, de différents services ainsi que de représentants des juridictions administratives qui pourraient évoquer des contentieux en cours –, j’ai décidé que nos réunions, ouvertes aux membres de la commission, se dérouleraient à huis clos, hors de la présence des journalistes, et ne seraient pas retransmises sur le site internet de l’Assemblée nationale. Elles donneront en revanche lieu à un compte rendu écrit qui sera publié, en tout ou partie, à l’issue de nos travaux. Jusqu’à cette publication, je demande à mes collègues de bien vouloir respecter la confidentialité de nos échanges.
Conformément aux dispositions de l’article 6 de l’ordonnance du 17 novembre 1958 précitée et à l’usage qui prévaut pour les commissions d’enquête, je vais vous demander de prêter le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en levant la main droite et en disant : « Je le jure ».
(M. Jean-Marc Sauvé et M. Bernard Stirn prêtent successivement serment.)
Avant de vous laisser la parole pour un exposé liminaire, je vous prie par avance de bien vouloir m’excuser de devoir quitter la réunion avant son terme afin d’assister aux vœux du Président de la République aux forces de sécurité.
M. Jean-Marc Sauvé, vice-président du Conseil d’État. Je me propose de préciser d’abord le cadre juridique de l’état d’urgence, après quoi le président Stirn dressera un bilan quantitatif et qualitatif – jurisprudentiel – du contrôlé opéré par le Conseil d’État au mois de décembre et depuis le début du mois de janvier.
Le cadre constitutionnel de l’état d’urgence a été précisé par deux décisions du Conseil constitutionnel. La première, celle du 25 janvier 1985, a répondu à une question essentielle en indiquant que l’entrée en vigueur de la Constitution du 4 octobre 1958 n’avait pas eu pour effet d’abroger implicitement la loi du 3 avril 1955. Cette question a été à nouveau traitée en 2005, à l’occasion du déclenchement de l’état d’urgence à la suite des violences urbaines en Île-de-France. Sur le fondement d’une autre analyse, le Conseil d’État a alors confirmé que la loi de 1955 était toujours en vigueur.
La seconde décision est celle du 22 décembre 2015, dans le cadre cette fois de l’application de l’état d’urgence décrété le 14 novembre 2015. Le Conseil constitutionnel a déclaré l’article 6 de la loi du 3 avril 1955, dans sa rédaction issue de la loi du 20 novembre 2015, conforme à la Constitution.
Cet article est tout d’abord conforme à l’article 66 de la Constitution : en d’autres termes, l’assignation à résidence n’est pas une privation de liberté, y compris la mesure complémentaire d’astreinte à résider à son domicile pendant une plage horaire limitée à douze heures par tranche de vingt-quatre heures.
Quant à la conformité aux articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, qui concernent la liberté d’aller et de venir, le Conseil constitutionnel a fait les constatations suivantes. Les mesures d’assignation à résidence ne peuvent évidemment être prononcées que lorsque l’état d’urgence a été déclaré. Ensuite, elles ne peuvent être édictées qu’à l’égard de personnes pour lesquelles il existe – c’est la nouveauté de la rédaction issue de la loi du 20 novembre – « des raisons sérieuses de penser que [leur] comportement constitue une menace pour la sécurité et l’ordre publics ». Enfin, ces mesures doivent être édictées et appliquées dans le respect du principe de proportionnalité : leur durée ne peut excéder la période de l’état d’urgence et, en cas de prorogation – c’est un point très important sur lequel nous aurons l’occasion de revenir –, elles doivent faire l’objet d’un réexamen.
Ainsi que le Conseil constitutionnel l’a indiqué, le juge administratif doit contrôler le caractère adapté, nécessaire et proportionné de ces mesures. Le commentaire publié aux Cahiers, relatif à la décision, souligne à cet égard une double évolution de la jurisprudence administrative. D’abord, le basculement de la haute police dans le champ du plein contrôle, en fait amorcé après l’état d’urgence de 2005 ; ensuite, l’appropriation des standards internationaux de contrôle, avec le triple contrôle de proportionnalité, qu’en réalité le Conseil d’État met en œuvre sous cette forme depuis l’arrêt d’Assemblée Association pour la promotion de l’image du 26 octobre 2011.
S’agissant enfin de la conformité à l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen – le droit au recours –, les mesures d’assignation à résidence peuvent être contestées devant le juge administratif, y compris par la voie du référé.
Le régime contentieux des actes administratifs pris dans le cadre de l’état d’urgence a été précisé par le Conseil d’État en deux temps.
D’abord, en 2006, une série de décisions du juge des référés a apporté un éclairage significatif sur le cadre juridique et sur le contrôle contentieux ; le point d’orgue en a été l’arrêt d’Assemblée Rolin et Boisvert du 24 mars 2006. Nous savons depuis lors que la déclaration de l’état d’urgence n’est pas un acte de Gouvernement et peut, par conséquent, être contestée devant le juge administratif jusqu’à son éventuelle prorogation par le législateur, laquelle revient en réalité à une ratification implicite – ce qui a d’ailleurs conduit à un non- lieu en 2006, lorsqu’a été contesté le décret initial.
Quant aux mesures générales d’application, au-delà du décret qui institue l’état d’urgence et, le cas échéant, autorise le recours aux perquisitions – c’est le I de l’article 11 de la loi de 1955 –, le Conseil d’État a jugé dès 2006 qu’il exerce un entier contrôle sur leur choix, donc sur le choix de recourir à l’assignation à résidence. L’arrêt du 24 mars 2006 pose en effet le principe d’un entier contrôle du juge administratif sur les catégories de mesures pouvant être prises dans le cadre de l’état d’urgence, marquant un premier revirement par rapport à la jurisprudence Dagostini du 25 juillet 1985 : jusqu’alors, les mesures adoptées n’étaient soumises qu’à un contrôle restreint, limité à l’erreur manifeste d’appréciation.
Par ailleurs, et c’est essentiel dans le contexte actuel, toujours par l’arrêt du 24 mars 2006, la loi du 3 avril 1955, dans sa rédaction alors en vigueur – dont la rédaction actuelle se distingue en ce qu’elle accorde plus de pouvoirs, mais apporte aussi plus de garanties -, a été jugée compatible avec les stipulations de la Convention européenne des droits de l’homme.
Le Conseil d’État ne s’est pas encore prononcé sur son degré de contrôle du décret déclarant l’état d’urgence, mais a semblé pencher pour un contrôle restreint. Ce débat présente toutefois un caractère quelque peu théorique, compte tenu de ce que j’ai indiqué sur la validation de la déclaration initiale par la loi de prorogation.
Il est clair, en revanche, que le juge administratif exerce un contrôle restreint sur la décision du Président de la République de maintenir l’état d’urgence ou de ne pas y mettre un terme – je fais ici référence à l’article 3 de la loi du 20 novembre dernier, qui rappelle que le délai de trois mois est un délai maximal. De ce point de vue, l’ordonnance de référé Allouache, rendue le 9 décembre 2005, est tout à fait explicite. Le Conseil d’État procède à un contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation s’agissant de la décision du chef de l’État de ne pas mettre un terme à l’état d’urgence à l’intérieur du délai de prorogation fixé par le législateur. En 2006, en raison de ce contrôle juridictionnel, le Président de la République a décidé, par le décret n° 2006-2 du 3 janvier 2006, de mettre fin de manière anticipée, à compter du 4 janvier, à l’état d’urgence qui avait été décrété le 8 novembre 2005 et prorogé pour trois mois à compter du 21 novembre.
Voilà pour les acquis de 2005.
En 2015 – le président Stirn y reviendra –, le Conseil d’État a été conduit à préciser sa jurisprudence dans la décision Cédric D. du 11 décembre, sur trois points majeurs.
D’abord, l’office du juge des référés. Il appartient à celui-ci de s’assurer, en l’état de l’instruction, que l’autorité administrative, opérant la conciliation nécessaire entre la sauvegarde de l’ordre public et le respect des libertés, n’a pas porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, que ce soit dans l’appréciation de la menace que représente le comportement de l’intéressé, compte tenu de la situation ayant conduit à la déclaration de l’état d’urgence, ou dans la détermination des modalités de l’assignation à résidence. Pas plus tard qu’hier, nous le verrons, le Conseil d’Etat a exercé un contrôle spécifique de ces modalités.
Ensuite, l’office du juge de l’excès de pouvoir. Il lui appartient d’exercer un entier contrôle sur les motifs justifiant le prononcé de la mesure individuelle d’assignation à résidence : c’est l’abandon définitif de la jurisprudence Dagostini, s’agissant non seulement des mesures générales, mais aussi des mesures individuelles.
Enfin, l’articulation entre la procédure de la question prioritaire de constitutionnalité et la procédure de référé : l’arrêt précise la portée du caractère prioritaire d’une QPC soulevée dans le cadre d’une requête en référé.
Je laisse maintenant la parole au président Stirn. Je pourrai ensuite répondre à d’autres questions, y compris sur les avis rendus par le Conseil d’État, notamment le 11 décembre, date à laquelle il est prononcé à la fois au contentieux, sous la présidence de Bernard Stirn, et en formation consultative, sous ma présidence, sur le projet de loi constitutionnelle.
M. Bernard Stirn, président de la section du contentieux du Conseil d’État. Je compléterai le propos du vice-président par trois types d’indications concernant d’abord des éléments quantitatifs, ensuite le cadre juridique général tel qu’il a été fixé par la décision de section du 11 décembre, et enfin, dans ce cadre, un premier bilan des décisions rendues depuis lors, en application des principes fixés par la section du contentieux.
Sur le premier point, nous suivons depuis le début, jour par jour, les entrées devant les tribunaux administratifs et, bien sûr, devant le Conseil d’État. Un tableau régulièrement communiqué à la commission des Lois indique l’état de l’ensemble des requêtes. On peut dire aujourd’hui que le nombre de contentieux est significatif, tout en restant relativement limité – d’ailleurs, il n’a pas été enregistré de nouvelles requêtes au cours des derniers jours : nous avons l’impression que l’essentiel du contentieux est déjà passé.
Hier soir, nous avions enregistré au total 62 affaires devant les tribunaux administratifs, dont 53 concernaient des assignations à résidence – à rapporter aux quelques 390 mesures d’assignation à résidence qui ont été prononcées. Du côté des tribunaux administratifs, on relève que, dans six cas, des mesures de suspension ont été décidées et que, dans trois d’entre eux, le ministre de l’intérieur a fait appel devant le Conseil d’État. Les délais de recours – qui sont de quinze jours en matière de référé, comme vous le savez – n’étant pas nécessairement expirés, je ne peux garantir que l’on en restera à ce chiffre, mais l’hypothèse est assez vraisemblable dans la mesure où, quand le ministre a décidé de faire appel, il l’a fait assez rapidement.
Le Conseil d’État a été saisi d’un peu moins de 20 affaires au total. Il a rendu à ce jour 15 décisions. Sept d’entre elles sont celles qui ont été rendues en section le 11 décembre et qui concernaient des assignations en résidence dans le cadre de la COP21 : ce sont les premières, celles qui ont permis au Conseil d’État de fixer les principes. Il est à noter que, dans trois cas – une proportion qui n’est pas négligeable – , le juge des référés du Conseil d’État a prononcé un non-lieu, car le ministre de l’intérieur a abrogé la mesure d’assignation à résidence alors que l’affaire était pendante devant le Conseil. Un quatrième non-lieu va intervenir, à l’occasion cette fois d’un pourvoi en cassation qui a été formé contre une ordonnance dite de tri, tenue sans audience, avant les décisions du 11 décembre, par un tribunal administratif. Trois jugements de non-lieu sont donc acquis et un quatrième est tout à fait certain.
Parmi les cas de référés sur lesquels le Conseil d’État a eu à se prononcer, deux affaires ou séries d’affaires sont à part, car elles relèvent d’autres législations même si les mesures visées ont été prises à l’occasion de l’état d’urgence. Il s’agissait, dans trois cas, d’interdictions faites à des supporteurs de se déplacer lors de matchs de football et, dans un cas, de l’interdiction de vente d’articles pyrotechniques à Strasbourg au moment des fêtes de fin d’année. Ce sont bien là des mesures de police prises dans le cadre de l’état d’urgence, mais en application respectivement du code du sport et du code de la défense.
Trois référés sont en revanche très significatifs : l’un, assez largement médiatisé, portait sur l’assignation à résidence à Bobigny d’un gérant de restaurant ; les deux autres affaires, jugées hier soir, concernent respectivement un restaurant à Cannes et une personne résidant à Brétigny-sur-Orge.
Il ne reste plus aujourd’hui aucune affaire de référé pendante devant le Conseil d’État. Je remettrai au secrétariat de la commission un dossier réunissant l’intégralité des décisions rendues par le Conseil et les décisions les plus significatives des tribunaux administratifs, ainsi qu’une note de synthèse reprenant les principaux chiffres que je vous ai donnés.
Il n’y avait plus hier soir devant le Conseil d’État que deux affaires au fond. Il s’agit de recours pour excès de pouvoir relevant en premier ressort du Conseil d’État, introduits par la Ligue des droits de l’homme et quelques autres associations contre l’un des décrets relatifs à l’état d’urgence et une circulaire d’application de la loi du 20 novembre. Ces recours ont été l’occasion, sinon le prétexte, de nouvelles QPC : trois QPC sont formulées contre d’autres dispositions de la loi du 20 novembre que celles qui ont déjà donné lieu à la décision du Conseil constitutionnel en date du 22 décembre. Ces affaires seront examinées par les sous- sections réunies mercredi 13 janvier et le Conseil d’État décidera alors, sans doute dans les jours qui suivront, de transmettre ou non au Conseil constitutionnel des QPC portant sur d’autres articles de la loi prorogeant l’état d’urgence.
Voilà ce qu’il en est du point de vue quantitatif.
En matière jurisprudentielle, je dirai quelques mots du cadre général tracé par les décisions de section du 11 décembre. Celles-ci sont en effet essentielles en ce qu’elles ont fourni au Conseil d’État l’occasion d’indiquer, au début de l’application de l’état d’urgence, le cadre contentieux dans lequel les tribunaux administratifs et lui-même allaient ensuite examiner les affaires. Il s’agissait en l’espèce de référés-liberté dont le Conseil d’État était saisi en appel lorsqu’une audience avait eu lieu, et en cassation lorsqu’il n’y en avait pas eu. Les requêtes ont été enregistrées les 3 et 4 décembre devant le Conseil d’État et complétées par une QPC enregistrée le 7 décembre. La section du contentieux a statué sur la totalité des affaires le 11, soit un délai particulièrement bref pour un examen devant une formation supérieure qui a beaucoup mobilisé le rapporteur public et la sous-section chargée de l’instruction.
Ces décisions du 11 décembre sont importantes tant du point de vue procédural qu’au fond. Du point de vue procédural, le Conseil d’État a jugé, comme le vice-président l’a rappelé, qu’en matière d’assignation à résidence il existait une présomption d’urgence, de sorte que le juge des référés devait s’attacher principalement aux moyens de fond, donc tenir une audience. Nous observons depuis lors que la totalité des affaires d’assignation à résidence, devant le tribunal administratif comme devant le Conseil d’État lorsque celui-ci a été saisi en appel, ont fait l’objet d’audiences.
Quant au fond du droit, il convient de rappeler trois points.
Premièrement, le Conseil d’État a jugé que la loi sur l’état d’urgence permettait de prendre des mesures de police, notamment d’assignation à résidence, pour d’autres motifs que ceux ayant justifié l’application de l’état d’urgence. Cette lecture a été confirmée par la décision du Conseil constitutionnel du 22 décembre. C’est d’autant plus significatif qu’il s’agissait alors d’assignations à résidence liées à la tenue de la COP21, et non au terrorisme.
Deuxièmement, comme le vice-président l’a également rappelé, le Conseil d’État a décidé que le juge administratif exercerait désormais un entier contrôle sur les mesures individuelles prises au titre de l’état d’urgence. C’est, là encore, en parfaite cohérence avec cette décision que le Conseil constitutionnel a indiqué le 22 décembre qu’il revenait au juge administratif de vérifier que les mesures étaient adaptées, nécessaires et proportionnées.
Troisièmement, le Conseil d’État a renvoyé une QPC sur l’article 6 de la loi, relatif aux assignations à résidence, au Conseil constitutionnel, qui a lui-même statué très rapidement, rendant sa décision sur ce point dès le 22 décembre. Parallèlement, la section du contentieux a précisé au juge des référés que le renvoi d’une QPC n’impliquait pas nécessairement la suspension des mesures concernées.
J’en viens en dernier lieu aux principales observations que peut susciter la jurisprudence.
Du point de vue procédural, d’abord, on constate depuis un mois l’importance du débat contradictoire devant le juge des référés. Dans ces affaires, comme votre commission le sait bien, il n’est pas toujours facile de savoir où est la vérité. Les griefs de l’administration qui ont conduit aux mesures contestées sont généralement formulés dans des « notes blanches » des services de renseignement. Or, depuis bien longtemps, la jurisprudence du Conseil d’État admet que de telles notes puissent constituer un fondement acceptable dès lors qu’elles sont soumises à un débat contradictoire et que le juge peut se faire une idée à partir de la note blanche et des observations de la personne concernée.
Cette jurisprudence générale est particulièrement significative dans les procédures de référé, puisqu’elle se double alors de l’oralité : la discussion contradictoire prend la forme d’un débat oral qui met face à face un représentant du ministère de l’intérieur et la personne concernée, sous l’arbitrage du juge. Plusieurs affaires soumises au Conseil d’État, notamment les trois les plus significatives, ont donné lieu non seulement, de manière systématique, à une audience, mais également à des demandes de complément d’instruction. Dans l’affaire de Bobigny, il y a même eu deux audiences, ce qui est tout à fait exceptionnel : le complément d’instruction ordonné à l’issue de la première audience a donné lieu, des deux côtés, à des productions qui ont conduit le juge des référés à décider une seconde audience pour approfondir les questions posées aux parties.
M. Jean-Marc Sauvé. Précisons que le juge était le président Stirn.
M. Bernard Stirn. J’avais en effet pris moi-même cette affaire, la première qui se présentait devant le Conseil d’État. J’ai ainsi pu mesurer personnellement cette importance des débats oraux, des questions posées par le juge, des réactions des parties, qui permettent sinon de faire toute la lumière, ce qui est toujours difficile, du moins de procéder à des vérifications très approfondies, pleinement contradictoires, et de rassembler un grand nombre d’éléments.
Seconde observation : devant le juge des référés du Conseil d’État, le ministère de l’intérieur a pris lui-même l’initiative soit d’abroger des arrêtés d’assignation à résidence, soit de modifier les conditions de l’assignation à résidence. J’y ai fait référence, dans quatre cas, les arrêtés ont été abrogés avant que le Conseil d’État ne puisse statuer ; dans un cas – l’une des affaires jugées hier après-midi –, ce sont les modalités de l’assignation à résidence qui ont été modifiées par le ministre de l’intérieur avant même que le juge des référés ne se prononce. Cela montre que lorsqu’un débat a lieu, notamment devant le juge des référés du Conseil d’État, l’administration réexamine très sérieusement les mesures et que, si elle nourrit des doutes sur leur principe même ou sur ses modalités de mise en œuvre, elle en tire les conséquences avant que le juge ne l’ordonne – quatre affaires, sur un total de quinze, c’est une proportion très significative.
À ce jour, le juge des référés du Conseil d’État a été amené à censurer la position de l’administration ou à prononcer des injonctions complémentaires dans deux cas.
Trois affaires retiennent plus particulièrement l’attention. Dans la première, celle de Bobigny, seule l’assignation à résidence du restaurateur était en cause, le restaurant n’ayant pas été fermé. Le recours a été rejeté au terme de la seconde audience, car il est apparu – c’est tout l’intérêt des débats contradictoires – que les déclarations de l’intéressé, souvent empreintes de contradiction, étaient démenties sur certains aspects par les productions complémentaires de l’administration.
En revanche, dans les deux autres affaires, jugées hier après-midi, le Conseil d’État a, pour la première fois, en partie censuré les mesures prises par l’administration.
La première affaire, touchant un restaurant de Cannes, était assez comparable à celle de Bobigny – le lieu était considéré comme un endroit où pouvaient se rencontrer des personnes aux activités dangereuses –, à ceci près que l’administration avait non seulement assigné le restaurateur à résidence, mais également fermé le restaurant. Le juge des référés du tribunal administratif de Nice avait suspendu la mesure d’assignation et celle de fermeture. Le juge des référés du Conseil d’État a confirmé le sentiment des premiers juges s’agissant de la fermeture, mais a pris une position différente à propos de l’assignation à résidence.
Dans le cas de la fermeture, on voit toute la portée de l’entier contrôle, qui s’applique au caractère adapté, nécessaire et proportionné des mesures. Les débats devant le Conseil d’État ont débouché sur la conviction qu’il n’était pas nécessaire de fermer le restaurant, notamment parce que la cellule islamique qui s’y était réunie par le passé avait été complètement dissoute depuis. L’assignation à résidence a semblé en revanche justifiée, car des notes blanches complémentaires produites devant le Conseil d’État ont conduit à penser que le restaurateur pouvait sans excès être regardé comme entretenant des relations suspectes et dangereuses.
J’en terminerai par la décision rendue hier en toute fin d’après-midi et tendant à l’aménagement des pointages effectués dans le cadre d’une assignation à résidence. L’intéressée est une mère de famille d’origine tchétchène résidant à Brétigny-sur-Orge, dans l’Essonne, et dont le comportement a alerté à juste titre les services de renseignement : elle n’a pas expliqué de manière satisfaisante ses voyages très fréquents en Turquie, notamment au cours de l’audience où elle s’est montrée confuse, voire contradictoire. Son compagnon – qui a quitté la France – a quant à lui un comportement incontestablement dangereux ; on a d’ailleurs pu avoir l’impression qu’elle était sous son emprise et qu’il lui faisait accomplir des missions pour le compte de réseaux terroristes, de sorte que, d’une certaine manière, l’assignation à résidence la protège des pressions de cet homme, dont elle est aujourd’hui séparée.
S’agissant des mesures elles-mêmes, l’instruction a été très intéressante. Cette dame est mère de trois jeunes enfants respectivement âgés d’un an, de quatre ans et de sept ans. Le cadet reste avec elle et les deux autres sont scolarisés l’un le matin, l’autre toute la journée. Or l’arrêté initial d’assignation à résidence exigeait trois pointages par jour – soit le nombre maximal – qui, de manière quelque peu surprenante, devaient avoir lieu au commissariat d’Arpajon, distant de Brétigny de dix kilomètres, alors même qu’il existe à Brétigny un poste de police ouvert, du moins en semaine. Dès lors, la dame était dans une situation préoccupante : elle devait se rendre trois fois par jour à Arpajon en bus puis en train – elle n’a pas de voiture – avec son plus jeune enfant et avait de grandes difficultés pour récupérer les deux autres à l’école. Après d’abondantes discussions au cours de l’audience de référé, cette situation a conduit le ministère de l’intérieur à modifier in extremis, hier après-midi, les modalités d’assignation à résidence en ramenant à deux le nombre de pointages quotidiens et en décidant qu’ils auraient lieu à Brétigny en semaine – mais toujours à Arpajon le week-end.
L’ordonnance rendue par le juge des référés prend acte de ces modifications – que le juge aurait sans doute ordonnées si le ministère de l’intérieur n’en avait pas pris l’initiative –, mais enjoint de trouver d’autres modalités pour le week-end. En effet, les deux pointages prévus à Arpajon le samedi et le dimanche font peser sur l’intéressée des contraintes excessives, d’autant qu’il n’y a pas de bus le week-end, ce qui l’oblige à marcher pendant trois quarts d’heure avec son bébé d’un an. Il est certainement possible de faire en sorte qu’un fonctionnaire de police passe dans la journée à Brétigny pour assurer le pointage.
M. Jean-Marc Sauvé. J’aimerais insister ici sur trois aspects.
Premièrement, les mesures d’instruction. Dans l’une des affaires présentées, il y a eu en décembre deux audiences d’instruction ; dans les autres cas, le Conseil d’État a ordonné, après la première audience, des mesures d’instruction complémentaires. Cela atteste d’un travail juridictionnel actif et approfondi : le juge ne se borne pas à enregistrer les productions, les dénégations et les affirmations des parties.
Deuxièmement, l’oralité : dès lors qu’une affirmation est formulée devant l’autre partie, un débat s’engage, sous l’arbitrage du juge.
Troisièmement, l’interactivité entre les parties sous le contrôle du juge, qui est à la fois impressionnante et presque embarrassante. D’un côté, elle a permis quatre abrogations sur quinze affaires, limitant très probablement le nombre des suspensions prononcées par le juge administratif. En fait, le juge, à partir de l’important travail accompli à l’audience et des mesures d’instruction prescrites, se trouve de facto inciter l’administration à adapter préventivement son comportement. De sorte que l’administration anticipe la décision juridictionnelle susceptible d’intervenir – et ce jusqu’à la dernière minute : après l’expiration de la dernière mesure d’instruction, au moment où le juge des référés rédigeait son ordonnance, quelques dizaines de minutes avant que celle-ci ne soit rendue publique, les conditions du pointage ont été modifiées par le ministre dans l’affaire de Brétigny, ce qui a obligé le juge à réécrire son ordonnance. On atteint alors les limites des bienfaits de l’interactivité : il y a le temps de l’action administrative et il y a le temps du juge qui doivent demeurer distincts.
M. le président Jean-Jacques Urvoas. Merci beaucoup pour ces propos liminaires. Je répète que nos échanges sont soumis au régime du huis clos et qu’ils ne feront l’objet, en tout ou partie, que d’un compte rendu écrit diffusé après publication de nos travaux de contrôle. Ils ne doivent donc susciter aucun commentaire à l’extérieur de cette salle. Je le dis notamment à l’intention des collaborateurs parlementaires. Si je devais être informé de l’existence d’une trace, écrite ou orale, des propos tenus au cours des auditions à huis clos, la mesure dérogatoire autorisant la présence de collaborateurs dans la salle serait immédiatement suspendue.
J’aimerais d’abord vous interroger, messieurs, sur la compétence du juge administratif s’agissant des mesures prises dans le cadre de l’état d’urgence, à la lumière des observations que nous avons pu faire lors de nos différents déplacements.
Compte tenu de ses compétences contentieuses, la juridiction administrative était-elle préparée pour connaître de ce contentieux, notamment en matière d’assignation à résidence ?
Le Conseil d’État a-t-il aidé les tribunaux administratifs à se préparer à accueillir le contentieux spécifique des mesures prises en application de l’état d’urgence ? A-t-il été sollicité pour cela ? En ce qui concerne particulièrement les référés contre les assignations à résidence, a-t-il adressé une documentation aux tribunaux ?
Enfin, vous avez rappelé l’importance du débat contradictoire. Or nous avons constaté qu’il est arrivé que le juge des référés confirme l’assignation à résidence au motif que celle-ci ne constituait pas une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’aller et de venir, sans asseoir sa décision sur aucune autre pièce d’instruction en défense que l’arrêté lui- même, et sans aucun débat contradictoire. Comprenez-vous que de telles situations nourrissent des critiques ou des réserves quant à l’indépendance du juge administratif ?
M. Bernard Stirn. Le jour même de la déclaration de l’état d’urgence, la section du contentieux du Conseil d’État s’est préoccupée de réunir une documentation et de la diffuser aux tribunaux administratifs par l’intermédiaire de l’outil interne Juradinfo, commun à l’ensemble de la juridiction administrative. Dès le lundi suivant, nous avons mis sur Juradinfo toutes les décisions déjà rendues en matière d’état d’urgence, notamment en 2005 et 2006, avec une petite note de commentaire. Nous nous servons de cet outil pour mutualiser la totalité de l’information. Nous avons ainsi demandé aux tribunaux administratifs de signaler à la cellule qui le gère toutes les décisions à mesure qu’elles sont rendues, et nous les mettons sur Juradinfo lorsqu’elles présentent un intérêt – ce qui n’est pas le cas, par exemple, d’une décision concluant à l’incompétence territoriale d’un tribunal administratif. Le tri est opéré par le Centre de recherches et de diffusion juridiques du Conseil d’État, sous mon contrôle. Les décisions sont immédiatement mises sur Juradinfo – accessible par voie dématérialisée à tous les magistrats –, y compris, naturellement, celles du Conseil d’État, dès qu’elles sont rendues.
Grâce à ces instruments, nous avons pu informer rapidement les tribunaux administratifs, et nous continuons de le faire en temps réel. Il est essentiel, en effet, que l’ensemble des juridictions soient éclairées par les jugements du Conseil d’État, mais aussi des autres tribunaux administratifs.
J’en viens au débat contradictoire. C’est là toute la portée des décisions du 11 décembre. Cette préoccupation est apparue immédiatement : nous avons eu la mauvaise surprise de constater, au cours des premiers jours de l’état d’urgence, que, dans certains tribunaux administratifs, les premières affaires avaient été jugées sans audience. Aujourd’hui, toutes les juridictions ont bien compris que ces affaires, du fait de la présomption d’urgence, devaient donner lieu à audience – et c’est ce qui se passe : je ne crois pas qu’il y ait eu depuis le 11 décembre des affaires jugées sans audience.
Or, si le dossier écrit peut être assez mince – un arrêté d’assignation à résidence, généralement assorti d’une note blanche –, l’audience, elle, est normalement le moment du débat contradictoire. L’administration se fait représenter à l’audience.
M. le président Jean-Jacques Urvoas. Nous avons appris, lors d’un de nos déplacements, qu’un recours contre un arrêté d’assignation avait été rejeté en référé sans que le préfet n’ait eu à présenter aucune des pièces qu’il avait lui-même préparées pour justifier l’arrêté, et qu’il n’a donc pas communiquées au juge. Il avait également pressenti un collaborateur pour prendre part au débat. Il a donc été très surpris que le juge confirme la décision d’assignation à résidence sur le seul fondement de l’arrêté préfectoral, lequel est pour le moins elliptique.
M. Bernard Stirn. Sans audience ?
M. le président Jean-Jacques Urvoas. Je l’ignore.
M. Bernard Stirn. S’il n’y a pas eu d’audience, c’est regrettable, mais s’il y a une audience, toutes les parties doivent y être convoquées.
M. Bernard Stirn. Devant le juge des référés du Conseil d’État, le ministère de l’intérieur est convoqué et systématiquement représenté à un niveau élevé – même quand nous le convoquons dans de très brefs délais.
M. Jean-Marc Sauvé. Que les choses soient parfaitement claires : s’agissant des mesures prises dans le cadre de l’état d’urgence, il doit y avoir des audiences. Le 11 décembre, s’appuyant sur les conclusions du rapporteur public qui étaient particulièrement claires, le Conseil d’État a énoncé le principe de la présomption d’urgence en cas d’assignation à résidence. Par conséquent, il devient en principe impossible de rejeter un référé-liberté sans audience. Or, dès lors qu’une audience a lieu, les parties sont convoquées et elles sont par conséquent mises en situation de produire une défense ou des pièces supplémentaires.
La juridiction administrative était-elle préparée à traiter du contentieux relatif aux mesures prises en application de l’état d’urgence ? Nous avons tout fait pour que les juges des référés soient en mesure de se prononcer. Dès le 14 novembre, nous avons appelé l’attention des tribunaux administratifs d’Île-de-France et des grandes métropoles sur la nécessité d’une montée en puissance à la fois quantitative et qualitative de leurs permanences. Nous nous attendions en effet à une vague de requêtes, et il nous semblait souhaitable qu’elles soient examinées par des juges expérimentés et en nombre suffisant.
Nous avons toutefois été confrontés à des difficultés que nous n’avions pas anticipées. Si, depuis l’entrée de vigueur de la loi du 10 janvier 1990 modifiant l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, qui ouvre une voie de recours à caractère suspensif contre les arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière, la juridiction administrative a acquis une véritable culture de l’urgence, si nous savons désormais nous prononcer en première instance comme en appel dans des délais extrêmement brefs, nous n’avions pas l’expérience de l’état d’urgence qui peut conduire à prendre des mesures de caractère tout à fait exceptionnel, comme en 2015 de nombreuses mesures d’assignation à résidence.
M. le président Jean-Jacques Urvoas. Si tel n’avait pas été le cas, vous feriez figure d’exception. Aucun des acteurs que nous avons rencontrés n’a jamais été confronté à l’état d’urgence. Services préfectoraux, direction des libertés publiques et des affaires juridiques, policiers, gendarmes, avocats : tout le monde a vraiment tâtonné.
Tous les recours formés contre des assignations à résidence ont été rejetés par la justice administrative. Hormis une mesure comportant des vices de forme ou des erreurs de droit, que pourrait être, selon vous, une assignation à résidence prise en vertu de l'état d'urgence qui porterait une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ?
M. Bernard Stirn. Ce serait, par exemple, une assignation à résidence prise à l’encontre d’un individu qui n’apparaîtrait pas comme porteur d’une menace grave pour la sécurité et l’ordre publics. La loi du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence, modifiée par la loi du 20 novembre 2015, précise les conditions de mise en œuvre de la mesure. Il appartient au juge des référés de vérifier qu’elles sont réunies.
Dans l’affaire de Bobigny, la personne concernée donnait des gages d’une bonne intégration dans la société française, d’une vie professionnelle et familiale stable, produisant plusieurs témoignages favorables de sources très variées : monde associatif, secteur sportif, élus. La première note blanche qui m’avait été soumise montrait que la personne concernée entretenait des rapports avec un individu engagé dans des activités inquiétantes. L’audience m’a permis de poser la question de la nature de ces liens et de m’entendre répondre qu’il ne s’agissait que d’un « client » du restaurant. Le supplément d’instruction demandé à ce sujet a toutefois permis d’infirmer cette affirmation et d’établir que les deux personnes concernées avaient voyagé ensemble. Cet élément m’a amené à convoquer une deuxième audience révélant des contradictions dans les déclarations du requérant, les débats de cette seconde audience ne permettant pas au juge d’affirmer qu’en prenant une mesure d’assignation à résidence, on avait ciblé une personne au sujet de laquelle il n’existait aucune raison sérieuse de penser que son comportement constituait une menace pour la sécurité et l'ordre publics. J’ajoute qu’il était un peu troublant de constater que la personne en question effectuait de très nombreux voyages : on a, bien sûr, le droit de voyager, mais les explications données en réponse à mes questions n’étaient pas très claires, et l’on peut comprendre que la fréquence de ces déplacements ait alerté les services de renseignement.
M. le président Jean-Jacques Urvoas. Le Conseil d'État a estimé qu'une fois l'état d'urgence déclaré, les motifs justifiant telle ou telle mesure de police peuvent différer de ceux ayant conduit à cette déclaration. Lors de nos premiers débats, il était pourtant implicite que seul le terrorisme justifiait la mise en œuvre de l’état d’urgence et des mesures qui l’accompagnent. Selon vous, quelle rédaction de l'article 6 de la loi du 3 avril 1955 aurait-il fallu retenir pour qu’il en soit ainsi ?
M. Bernard Stirn. La loi peut parfaitement disposer que des assignations à résidence peuvent être prononcées à l’encontre de personnes à l'égard desquelles il existe des raisons sérieuses de penser qu’elles ont un lien avec des activités terroristes, mais ce n’est pas ainsi qu’elle est rédigée aujourd’hui.
M. Jean-Marc Sauvé. S’il est tout à fait possible de rédiger la loi afin de donner au ministre de l’Intérieur et aux préfets la possibilité de prononcer des assignations à résidence pour les seuls motifs ayant conduit à la proclamation de l’état d’urgence, en l’absence de restrictions en ce sens, l’article 6 de la loi de 1955 tel que modifié par la loi du 20 novembre dernier s’applique : il prévoit que toute personne dont le « comportement constitue une menace pour la sécurité et l'ordre publics » peut être assignée à résidence, quelle que soit la nature de cette menace.
M. Bernard Stirn. L’article 6 commence par ces mots : « Le ministre de l'intérieur peut prononcer l'assignation à résidence, dans le lieu qu'il fixe, de toute personne résidant dans la zone fixée par le décret mentionné à l'article 2 et à l'égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace pour la sécurité et l'ordre publics dans les circonscriptions territoriales mentionnées au même article 2».
L’un des arguments du ministère de l’intérieur consiste à expliquer que tout se tient : la mobilisation des forces de sécurité en période d’état d’urgence et de menaces terroristes rend difficile l’affectation d’un trop grand nombre de personnels à la surveillance des stades de football ou de la COP21.
M. le président Jean-Jacques Urvoas. Le juge administratif a-t-il tenu compte de la possibilité de mettre en œuvre d’autres mesures de police administrative, de droit commun ou exceptionnelles, comme l'interdiction de se rendre en Île-de-France, pour évaluer le caractère nécessaire et proportionnée des assignations à résidence liées à la tenue de la COP21 qu’il a eu à examiner ? Pourquoi assigner à résidence en province un individu susceptible de troubler la COP21, auquel la préfecture de police interdit déjà le séjour en région parisienne dans le cadre de l’état d’urgence ?
M. Jean-Marc Sauvé. Le triple contrôle de proportionnalité exercé par le juge sur le caractère adapté, nécessaire et proportionné d’une mesure de police administrative lui permet d’être extrêmement exigeant et intrusif à l’égard de l’administration, mais je ne pense pas qu’il confère au juge la possibilité de censurer une mesure au motif qu’un autre des dispositifs applicables dans le cadre de l’état d’urgence serait à son sens plus approprié ou plus pertinent. Je crois que nous atteignons là l’une des limites du pouvoir du juge. Mutatis mutandis, lors du contrôle de la déclaration d’utilité publique d’un grand équipement, par exemple d’une autoroute, le juge se prononce sur la proposition qui lui est soumise et non sur une éventuelle version alternative plus pertinente.
Aujourd’hui le contrôle de proportionnalité permet d’aller très loin dans la recherche de l’équilibre et de la conciliation entre la nécessité de prévenir les infractions et de sauvegarder l’ordre public et l’exigence de garantir le respect des libertés fondamentales. La mesure prise doit bien être proportionnée aux raisons – agissement, comportements – qui la justifient et aux finalités de l’état d’urgence.
Les « notes blanches » n’établissent pas la commission d’infractions pénales et n’en rapportent pas les preuves : si tel était le cas, le traitement des actes en question relèverait de la police judiciaire et de la répression pénale. Ces notes fournissent des informations sur des relations, des agissements et des comportements et, par conséquent, elles peuvent présenter un faisceau de présomptions et d’indices sur l’existence d’une menace à l’ordre et la sécurité publics, qu’un débat contradictoire écrit et oral ou une mesure d’instruction peut confirmer ou contredire. J’ai la conviction que le débat contradictoire sur les pièces versées par l’administration et le triple contrôle de proportionnalité nous conduisent à disposer de tous les éléments permettant d’exercer un contrôle juridictionnel approfondi et de mettre un terme à des mesures restrictives de liberté qui porteraient une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Je n’ai aucun doute sur ce point. Le contrôle de proportionnalité d’une mesure administrative restrictive de liberté, tel que nous le pratiquons depuis l’arrêt Benjamin du 19 mai 1933, permet d’aller si loin que certains de nos collègues des juridictions supérieures britanniques ont pu estimer qu’il pouvait porter atteinte à la séparation des pouvoirs.
M. Jean-Frédéric Poisson, président. Comment appréciez-vous le passage, dans la loi, de la notion d’« activité » à celle de « comportement » ? Cette évolution, qui n’est pas uniquement sémantique, est-elle pertinente ? Constitue-t-elle une source de difficultés particulières pour le juge ?
M. Jean-Marc Sauvé. En choisissant ces termes, l’intention du Gouvernement puis du législateur, qui a adopté la loi du 20 novembre 2015 consacrant cette évolution, était bien d’élargir le champ du prononcé de la mesure d’assignation à résidence. L’exigence qui pèse sur l’administration est moins forte dès lors que des éléments comportementaux suffisent pour prendre cette mesure. La notion de comportement est plus large et plus souple – je m’abstiens volontairement d’employer le mot « flou » qui serait péjoratif – que celle d’activité qui implique de recenser des actes précis. Toute activité a une dimension comportementale, alors que tous les comportements ne constituent pas, stricto sensu, une activité.
Le juge n’a pas à se prononcer sur le bien-fondé ou le mal-fondé de la loi. Il la prend telle qu’elle est, et il l’applique, le cas échéant en l’interprétant conformément à la Constitution. S’il a un doute sur sa conformité à la Constitution, il peut poser une question prioritaire de constitutionnalité. En l’espèce, cela a été fait, et le Conseil constitutionnel a tranché la question qui lui était posée. L’évolution de la rédaction de la loi que vous évoquez a sans doute incité la section du contentieux à admettre, dans sa décision du 11 décembre, le caractère sérieux de la question qui lui était posée.
En tant que conseil du Gouvernement, le Conseil d’État s’était prononcé sur cette disposition du projet loi en estimant qu’il s’agissait d’une mesure de rigueur qui paraissait nécessaire. Il a opéré une sorte de contrôle préalable de constitutionnalité : s’il avait estimé que la modification de l’article 6 de la loi du 3 avril 1955 soulevait une difficulté au regard de l’article 66 de la Constitution ou des articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, il aurait naturellement émis des réserves et son avis aurait été défavorable. Dans son avis du 17 novembre 2015, le Conseil d’État précise qu’il « s’est notamment assuré de ce que les contraintes nouvelles assortissant l’assignation à résidence seraient […] réservées aux personnes à l’égard desquelles il existe des raisons sérieuses de penser que leur comportement constitue une menace », et qu’il a « vérifié que les modifications apportées par le projet à la loi de 1955 ne relevaient pas d’une rigueur non nécessaire quand elles renforçaient les pouvoirs de police administrative ».
M. Bernard Stirn. Si l’on regarde les choses cas par cas, l’évolution évoquée est particulièrement adaptée à la lutte contre le terrorisme. Les personnes suspectes d’aider les réseaux peuvent plus souvent être confondues sur la base d’éléments comportementaux que sur celle d’activités pour lesquelles elles seraient de toute façon passibles de sanctions pénales.
M. Jean-Frédéric Poisson, président. Existait-il des raisons sérieuses de penser que les assignés à résidence en raison de la tenue de la COP21 qui se sont pourvus en cassation devant le Conseil d’État avaient eu des comportements susceptibles de porter atteinte à l’ordre public ?
M. Bernard Stirn. Ces affaires ont été les premières à nous être soumises. Elles ont été traitées dans des délais très brefs et, afin de fixer très rapidement un cadre juridique global, elles ont été immédiatement renvoyées en audience collégiale sans que se tiennent d’audiences de référé permettant le débat oral.
Les dossiers en question comportaient des éléments extrêmement sérieux. Les personnes visées avaient eu des activités dangereuses et menaçantes pour l’ordre public, et l’on pouvait raisonnablement craindre qu’elles les réitèrent lors de la COP21. De plus, quelques jours après les attentats, le ministère de l’intérieur insistait beaucoup sur le fait que les forces de police, mobilisées par ailleurs, n’avaient pas les moyens de suivre de près chacun des individus concernés. Je rappelle également que ces mesures n’étaient prises que pour la durée de la COP21. Au final, il n’a pas paru possible au Conseil d’État de considérer qu’elles étaient disproportionnées.
M. Jean-Marc Sauvé. Sans avoir étudié, comme le président de la section du contentieux, la totalité des dossiers, j’ai été frappé néanmoins par les antécédents de plusieurs de ces personnes.
M. Jean-Frédéric Poisson, président. Pour les situations que nous avons eu à connaître, nous n’avions pas affaire à des militants écologistes, mais à des délinquants.
Quelle valeur le juge accorde-t-il à la contestation par un requérant du contenu des notes blanches ? Que serait une « contestation sérieuse » de leur contenu devant le Conseil d’État ?
M. Bernard Stirn. Nous partons du principe que les services de renseignement travaillent de façon honnête, et qu’ils n’affabulent pas dans les notes blanches. Le débat contradictoire, renforcé par l’oralité du référé, permet ensuite de voir si le contenu de ces notes est contesté de manière crédible sur le fondement d’éléments établis par l’intéressé. Dans les quatre cas qui ont donné lieu à l’abrogation d’arrêtés d’assignation à résidence avant même que le juge ne se prononce, le ministère de l’intérieur a probablement eu des doutes sur les informations dont il disposait – ce procédé a certainement empêché jusqu’à maintenant que le juge ait l’occasion de suspendre ou d’annuler un tel arrêté. Dans les affaires de Bobigny, de Cannes et de Brétigny-sur-Orge, que j’ai évoquées, les audiences et les compléments d’instruction ont permis que les éléments figurant dans la note blanche fassent l’objet de discussions très complètes. Je crois que le juge a disposé des éléments permettant de vérifier si les informations fournies par les services de renseignement étaient suffisantes pour que la mesure prise soit considérée à la fois comme nécessaire, adaptée et proportionnée.
M. Jean-Marc Sauvé. Si la note blanche contient des allégations inexactes ou erronées, le débat contradictoire permet de fournir des éléments contraires pertinents et, par conséquent, de les contredire utilement. La matérialité des faits reprochés peut donc être contestée.
Si les allégations sont floues, imprécises ou inconsistantes, elles risquent de n’être pas de nature, au titre du contrôle de proportionnalité, à justifier la mesure prise par l’autorité administrative. Une telle mesure ne tiendrait pas.
M. Jean-Frédéric Poisson, président. Le Conseil d'État a estimé que son contrôle reposait sur « l’appréciation de la menace que constitue le comportement de l'intéressé, compte tenu du péril imminent ou de la calamité publique avant conduit à la déclaration de l'état d'urgence ». De plus, il a tenu compte, comme vous l’indiquiez, de la très forte mobilisation des forces de l'ordre, sollicitées pour plusieurs missions en parallèle. Les éléments fournis par le ministère de l'intérieur pour permettre au juge administratif de mesurer pleinement l'ampleur des désordres publics attendus ou la mobilisation des forces concernées sont-ils suffisants, et permettent-ils d'apprécier la proportionnalité des mesures de police ?
M. Bernard Stirn. Notre réponse est plutôt positive. Une information nous est donnée dans les mémoires écrits déposés par le ministère de l’intérieur. Pour les affaires relatives aux supporters d’équipes de football, il nous a par exemple été très précisément indiqué les moyens humains nécessaires pour organiser la sécurité d’un match. Dans le contexte actuel, il n’est peut-être pas tout à fait raisonnable de mobiliser trois escadrons de gendarmerie pour une seule rencontre. Dans le cas du référé, l’audience permet au juge d’interroger l’administration que l’avocat de la personne mise en cause n’hésite généralement pas à pousser dans ses retranchements.
Pour ma part, je n’ai jamais eu le sentiment que le ministère de l’intérieur retenait la moindre information : il participe à l’instruction écrite et aux audiences, et il répond aux questions et aux demandes de complément d’instruction.
M. Jean-Frédéric Poisson, président. Estimez-vous que le juge des référés dispose, durant le délai très court de son office, d’une documentation et d’informations suffisantes et pertinentes pour se prononcer sur des mesures restrictives de liberté ?
M. Bernard Stirn. C’est indéniablement le cas pour ce qui concerne l’information juridique. Sur le fond des affaires, l’audience et l’oralité permettent aussi de disposer de l’information nécessaire.
Si, par nature, depuis l’entrée en vigueur de la loi du 30 juin 2000, le juge des référés statue seul dans un délai bref, les juges des référés du Conseil d’État se parlent. Les affaires délicates donnent lieu à de nombreux échanges entre les trois présidents adjoints de la section du contentieux, les conseillers d’État chargés des fonctions de juge des référés, et moi-même. Une sorte de collégialité de fait existe, qui ne retire rien au rôle du collègue qui signe seul l’ordonnance. Au demeurant, le projet de loi portant application des mesures relatives à la justice du XXIe siècle, actuellement examiné par le Parlement, tend à créer une collégialité de droit permettant de siéger en référé à trois juges. Cela me semble tout à fait souhaitable, notamment dans les affaires très sensibles.
Mme Françoise Descamps-Crosnier. Certains tribunaux administratifs viennent d’enjoindre au ministère de l’intérieur de préciser la durée de l’assignation à résidence lorsque les arrêtés pris ne comportent pas de date de fin d’application de la mesure. La plupart des arrêtés rédigés sur le même modèle sont concernés. Les tribunaux ont laissé à l’administration des délais, variant entre une et deux semaines, pour apporter la précision demandée : est-il nécessaire de procéder à une harmonisation de ce délai ?
M. Bernard Stirn. Le ministère de l’intérieur n’ayant pas fait appel des décisions que vous évoquez, le Conseil d’État n’en est pas saisi à ce jour.
Le droit est toutefois assez clair. Dans le treizième considérant de sa décision du 22 décembre 2015, le Conseil constitutionnel indique qu’« en vertu de l'article 14 de la loi du 3 avril 1955, la mesure d'assignation à résidence prise en application de cette loi cesse au plus tard en même temps que prend fin l'état d'urgence ». La durée pendant laquelle la mesure est en vigueur est donc déjà précisée, et le ministre de l’intérieur n’est tenu de la spécifier de façon particulière que s’il entend qu’elle prenne fin avant le terme de l’état d’urgence – ce qui s’est produit pour les arrêtés pris dans le cadre de la COP21 puisque les assignations à résidence prenaient fin le dernier jour de la conférence internationale. Par définition, les mesures prises dans le cadre de la lutte contre le terrorisme s’appliquent pendant la durée de l’état d’urgence. L’idée d’une obligation de fixer un délai ne me semble pas vraiment pertinente alors que nous nous trouvons dans un cadre juridique parfaitement tracé.
M. Jean-Marc Sauvé. Les tribunaux administratifs de Pau et de Dijon ont rendu en référé des décisions dont la presse s’est fait l’écho. Le considérant que vient de citer le président Stirn indique clairement que l’assignation à résidence est bornée dans le temps – au plus tard à la fin de l’état d’urgence - et que cette borne est conforme à la Constitution. Il appartient à l’autorité administrative de fixer éventuellement un délai plus court, ce qui peut constituer un élément d’appréciation de la légalité de la mesure. Nous pouvons penser que si les militants écologistes que nous avons évoqués avaient continué de faire l’objet d’une assignation à résidence au-delà de la fin de la COP21, c’est-à-dire le 12 décembre, jusqu’au terme du délai de trois mois, cette durée aurait constitué un élément de la discussion sur l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale qu’une telle mesure aurait représentée.
M. Jean-Frédéric Poisson, président. Monsieur le vice-président du Conseil d’État, monsieur le président de la section du contentieux, nous vous remercions pour votre disponibilité et pour la précision de vos réponses.
——fpfp——
AUDITION DE M. SERGE GOUÈS, PRÉSIDENT DU SYNDICAT DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE, ET DE MME HÉLÈNE BRONNENKANT, SECRÉTAIRE GÉNÉRALE
Compte rendu de l’audition, non ouverte à la presse, du jeudi 7 janvier 2016
M. le président Jean-Jacques Urvoas. Je remercie M. Serge Gouès et Mme Hélène Bronnekant, président et secrétaire générale du Syndicat de la juridiction administrative, d’avoir répondu à l’invitation de la commission des Lois, dans le cadre du contrôle des mesures que le Parlement a autorisé le Gouvernement à prendre pendant l’état d’urgence.
Les juridictions administratives sont particulièrement concernées puisque, saisies en référé, elles ont déjà rendu un grand nombre de décisions. Il nous sera donc utile de disposer de votre analyse de ce dont vous avez eu à connaître pendant ces premières semaines.
Afin d’assurer le contrôle en temps réel de l’état d’urgence, notre commission a désigné deux rapporteurs – Jean-Frédéric Poisson, qui vous prie de l’excuser de son absence, et moi-même. Nous nous sommes par ailleurs dotés, en vertu de l’article 5 ter de l’ordonnance de 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, de pouvoirs identiques à ceux d’une commission d’enquête, pour une durée de trois mois.
Compte tenu de la sensibilité des questions abordées, nos auditions se déroulent à huis clos. Leurs comptes rendus seront publiés en tout ou partie à l’issue de notre mission de contrôle.
Conformément à l’article 6 de l’ordonnance du 17 novembre 1958, je vais vous demander de prêter serment de dire toute la vérité, rien que la vérité. Veuillez lever la main droite et dire : « Je le jure ».
(M. Serge Gouès et Mme Hélène Bronnenkant prêtent serment.)
M. Serge Gouès, président du Syndicat de la juridiction administrative. Le juge administratif a, depuis la promulgation de la loi du 20 novembre, pris de nombreuses décisions. Au 4 janvier 2016, soixante-deux ordonnances ont été rendues par les tribunaux administratifs, pour l’essentiel dans le cadre de la procédure de référé liberté ; vingt-six d’entre elles ont été rendues postérieurement à la lecture des décisions du Conseil d’État du 11 décembre 2015 ; douze sont postérieures à la décision du Conseil constitutionnel statuant sur la QPC relative aux assignations à résidence ; sept ordonnances en référé ont enfin donné lieu à une suspension des mesures prononcées. Par ailleurs, le juge des référés du tribunal administratif de Pau, par ordonnance du 30 décembre 2015, a décidé d’enjoindre le ministre de l’Intérieur de préciser le terme de la mesure d’assignation prononcée à l’encontre du requérant.
J’aimerais rappeler dans un premier temps que, contrairement a ce qu’on a pu lire ici ou là, le juge administratif est compétent pour contrôler la légalité des actes pris dans le cadre de l’état d’urgence. Nous sommes heureux que, dans sa décision du 22 décembre 2015, le Conseil constitutionnel ait jugé bon de rappeler que « le juge administratif est chargé de s’assurer que [la] mesure [examinée] est adaptée, nécessaire et proportionnée à la finalité qu’elle poursuit ». C’est d’autant plus important que certains articles parus dans la presse voudraient sans doute laisser croire le contraire. Ainsi, la parution dans Le Monde du 1er janvier d’un article titré : « État d’urgence : le réveil des tribunaux administratifs » n’a pas du tout été du goût des juges administratifs, qui n’ont pas attendu ce début d’année pour traiter de ces questions. Dès décembre, les premières ordonnances étaient rendues, parfois dans la précipitation et un peu d’impréparation, mais avec pertinence si l’on en croit le Conseil d’État.
Nos confrères de l’ordre judiciaire ont, de leur côté, élevé quelques protestations, arguant du fait qu’il revenait au juge des libertés de statuer. Même si notre petit millier de juges administratifs ne peut certes se prévaloir de l’audience dont jouit la cohorte des juges judiciaires, nous tenons à réaffirmer ici que nous avons fait notre travail.
Ce travail, nous l’avons fait avec vigilance, sauf pour ce qui concerne les perquisitions administratives sur lesquelles nous n’avons aucun pouvoir de contrôle. Il me semble pourtant que l’on pourrait envisager un contrôle a priori de ces perquisitions décidées par le préfet, et que le président du tribunal compétent pourrait les examiner et statuer en urgence, ce qui permettrait sans doute d’éviter quelques méprises regrettables comme on a pu en déplorer ici ou là. Il ne s’agit évidemment pas de créer une sorte de parquet au sein de la juridiction administrative, qui a déjà par ailleurs à connaître de ce type de questions dans le cadre des procédures d’exécution ou de règlement des expertises.
Mme Hélène Bronnenkant, secrétaire générale du Syndicat de la juridiction administrative. Votre rapport sur le projet de loi prorogeant la loi sur l’état d’urgence insiste sur le fait que le procureur doit être informé de toute perquisition administrative et que celle-ci doit se dérouler en présence d’un officier de police judiciaire. Mais il persiste un flou sur le contrôle a posteriori et sur le juge compétent dans le cas où sont contestés les fondements mêmes de la perquisition. La position du juge administratif en matière de contrôle a priori comme a posteriori est donc fragile ; sans doute conviendrait-il de la renforcer, comme cela a été le cas en matière de perquisitions fiscales, sous l’impulsion notamment de la Cour européenne des droits de l’homme.
M. Serge Gouès. Un autre point contestable à nos yeux est la disjonction entre le motif qui a conduit à la proclamation de l’état d’urgence et les motifs qui fondent les mesures de police prises dans ce cadre – et je pense ici à la confusion induite par la coïncidence entre les attentats du 13 novembre et la tenue de la COP21.
Sans balayer la soixantaine de cas concrets dont nous avons eu à traiter, je voudrais m’arrêter sur deux décisions particulières qui illustrent la manière dont le juge administratif exerce sa vigilance.
Le 17 décembre 2015, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a suspendu la mesure d’assignation à résidence prise à l’encontre d’un plaignant soupçonné d’entretenir des liens avec des individus impliqués dans un trafic d’armes. Le juge des référés a en effet considéré, d’une part, que la note blanche était par trop imprécise et, d’autre part, que, les prétendus trafiquants n’ayant eux-mêmes fait l’objet d’aucune assignation à résidence, la mesure prise à l’encontre du plaignant n’avait pas lieu d’être.
Le 18 décembre 2015, le tribunal administratif de Nice a annulé la fermeture administrative d’un établissement de restauration cannois soupçonné d’être fréquenté par les membres d’une cellule terroriste. Celle-ci ayant été dissoute et ses membres ayant disparu de la circulation, le juge des référés a jugé illégale la mesure de fermeture, décision confirmée par le Conseil d’État, le 6 janvier.
Pour ce qui est de la vigilance du juge administratif, je vous renvoie enfin à la tribune publiée sur le site de Mediapart, le 29 décembre 2015, par une dizaine de juges administratifs, sous couvert de l’anonymat. Les auteurs insistent sur le fait que la tâche du juge administratif « devrait être […] de veiller à la proportionnalité de ces mesures [prises dans le cadre de l’état d’urgence], à l’équilibre entre ordre public et libertés publiques. Mais ce rôle ne doit pas faire naître de trop grandes attentes : le juge administratif n’est, avec le juge judiciaire, le garant de l’État de droit que pour autant que les lois l’y autorisent. » Formulant quelques remarques critiques sur les décisions rendues par le Conseil d’État, ils s’interrogent sur le fait que, « imperceptiblement, l’équilibre entre ordre public et libertés publiques se déplace. Et nous nous retrouvons, juges administratifs, dotés d’une responsabilité accrue sans avoir véritablement les moyens de l’assumer. » Nous ignorons l’identité des signataires de cette tribune, mais notre syndicat partage leur analyse.
Mme Hélène Bronnenkant. Alors que le contrôle réel du juge porte sur les faits, il nous incombe, dans le cadre de l’état d’urgence, de nous prononcer en quelque sorte sur l’animus d’une personne. Cela implique d’établir la plausibilité d’une décision, ce pourquoi nous manquons souvent de matière car les dossiers ne comportent pas grand-chose. Sans soumettre tous les éléments au contradictoire, il serait donc souhaitable d’obtenir des services du préfet ou de renseignement ceux qui nous sont nécessaires pour exercer un contrôle sur les faits qui ont conduit aux assignations à résidence, contrôle sans lequel il ne saurait y avoir d’État de droit. C’est dans cette perspective que le tribunal administratif de Pau a, par exemple, demandé que soit précisée la durée des assignations à résidence.
M. Serge Gouès. La question des notes blanches est en effet essentielle. Il est très délicat pour nous de statuer quand le dossier ne comporte qu’une note blanche de trois lignes – cas auquel j’ai été confronté dans une affaire d’expulsion d’imam. Par ailleurs, il n’existe pas chez les juges administratifs cette culture du dialogue avec la police qui existe chez les magistrats de l’ordre judiciaire. On pourrait certes demander, par des mesures d’instruction, que nous soient fournies davantage d’informations, mais c’est toujours délicat, et nous ne sommes pas préparés à cela.
Au chapitre des moyens limités dont nous disposons, je voudrais également aborder la question de la sécurité : les tribunaux administratifs semblent être les derniers lieux publics sur le territoire où l’on puisse entrer sans fouille préalable, ce qui est à l’origine d’un certain nombre d’incidents. Sur ce sujet, le Conseil d’État renvoie la balle aux chefs de juridictions, dont le budget est très limité.
Mme Hélène Bronnenkant. Chaque chef de juridiction agit sur ce point comme il l’entend, malgré un risque terroriste élevé.
M. Serge Gouès. Au moment où l’on s’apprête à modifier la Constitution, il conviendrait de se souvenir que le juge administratif n’y est pas mentionné, ce qui est paradoxal. Ne serait-ce dès lors pas le bon moment pour le constitutionnaliser, à l’instar du juge judiciaire, comme nous le demandons depuis des années ?
M. le président Jean-Jacques Urvoas. Au regard de ce que sont les compétences contentieuses des juridictions administratives, estimez-vous qu’elles étaient préparées à faire face au contentieux qu’elles ont aujourd’hui à traiter par la voie du référé ?
Mme Hélène Bronnenkant. Lorsque nous est soumis un nouveau type de contentieux, nous demandons au Conseil d’État un vade-mecum définissant le cadre juridique à l’aide de fiches thématiques, vade-mecum qui, en l’occurrence, ne nous a pas été fourni.
Instruction a été certes été donnée aux chefs de juridiction de ne pas envoyer au front les magistrats les plus jeunes, mais tardivement. En revanche – et c’est à mettre au rang des points positifs –, on nous envoie quotidiennement les dernières décisions tombées et le dernier état de la jurisprudence.
M. le président Jean-Jacques Urvoas. Après le 13 novembre, le Conseil d’État n’a donc pas fourni aux juridictions administratives de bases documentaires ?
Mme Hélène Bronnenkant. Nous ne disposons que de la base juridique Juradinfo, où sont recensées les dernières décisions concernant les assignations à résidence, mais sans aucune mise en perspective. Les juges sont donc très demandeurs de consignes techniques, ne serait-ce que pour s’éviter par la suite les remarques désagréables du Conseil d’État sur leur travail…
M. le président Jean-Jacques Urvoas. Je m’étonne de ce que vous dites car le Conseil d’État nous dit l’inverse… M. Sauvé et M. Stirn nous ont affirmé ce matin qu’une documentation était transmise aux chefs de juridiction.
Mme Hélène Bronnenkant. Il se peut qu’il y ait un problème de circulation de l’information.
M. le président Jean-Jacques Urvoas. Jean-Marc Sauvé a par ailleurs rappelé que toutes les décisions prises en 2005 et 2006 dans le cadre de la précédente application de l’état d’urgence avaient été immédiatement envoyées aux juridictions administratives.
M. Serge Gouès. Nous nous fondons certes sur la décision du 11 décembre qui fait jurisprudence mais ne couvre pas l’ensemble des problématiques – ainsi la question de la durée, soulevée dans la décision du tribunal administratif de Pau. Les magistrats confrontés à des situations inédites se trouvent donc démunis.
M. le président Jean-Jacques Urvoas. En ce qui concerne le dossier dont dispose la juridiction administrative pour confirmer ou infirmer les assignations à résidence, il semblerait qu’un juge se soit prononcé sur la seule base de l’arrêté d’assignation, sans que soit réclamé au préfet et, à sa grande surprise, aucun autre élément. Pouvez-vous nous préciser comment s’exerce le contradictoire ?
M. Serge Gouès. Dans le cadre général du droit des étrangers, le contradictoire est fragile, à l’exception de quelques tribunaux administratifs, comme celui de Paris, où le préfet est représenté à l’audience. Quant aux éléments sur la base desquels la juridiction s’est prononcée, il est en effet étonnant qu’ils n’aient pas inclus la note blanche.
Mme Hélène Bronnenkant. La justice administrative est par culture une justice du contradictoire, ce qui explique que la procédure ne revête aucun caractère inquisitorial. Il est rare que le juge demande des pièces supplémentaires ; le plus souvent, il se contente de la lecture du dossier.
M. le président Jean-Jacques Urvoas. Quoi qu’il en soit, cette manière de procéder me paraît de nature à nourrir les soupçons sur l’indépendance du juge administratif. Se contenter de l’arrêté préfectoral, c’est un plaidoyer pro domo : la situation est justifiée, circulez, il n’y a rien à voir…
Mme Hélène Bronnenkant. Ma juridiction a eu à connaître à Strasbourg d’une décision préfectorale interdisant la vente de feux d’artifice au déballage en application de l’état d’urgence. Le magistrat, vice-président du tribunal, ayant décidé de suspendre la décision, il a dû subir de la part du préfet un rappel à l’ordre s’apparentant à une forme de pression pour le moins désagréable.
M. le président Jean-Jacques Urvoas. Nous nous interrogeons sur les assignations à résidence prononcées à l’occasion de la COP21 dans le cadre de l’état d’urgence, le Gouvernement faisant valoir que les forces de police devaient rester disponibles pour lutter contre le terrorisme et ne pouvaient donc être mobilisées par les manifestations violentes susceptibles de se produire durant cet événement international. C’est en appliquant le même raisonnement que le préfet a interdit la consommation d’alcool dans les rues de Lille, afin de limiter les troubles à l’ordre publics causés par les cas d’ivresse nocturne et pour ne pas mobiliser les forces de sécurité publique sur d’autres missions que celles directement liées à l’état d’urgence… Pourtant, une décision de ce genre relève de son pouvoir de police ; il n’avait nul besoin d’invoquer l’état d’urgence. Quelle est, en la matière, la position du juge administratif ?
Mme Hélène Bronnenkant. Au regard du droit conventionnel, la légalité des mesures d’assignation à résidence est fragile dans la mesure où l’on peut estimer qu’elles contreviennent aux libertés fondamentales. Je rappelle en effet que, dans le cadre de l’état d’urgence, ne sont autorisées que les mesures dérogatoires dont le but est celui-là même qui a justifié l’instauration de l’état d’urgence, à savoir la préservation de la sécurité et la lutte contre le terrorisme.
La tribune publiée dans Mediapart par nos collègues témoigne des interrogations de bon nombre d’entre nous sur le fait de savoir si la jurisprudence du Conseil d’État est parfaitement compatible avec notre cœur de métier, qui est de faire respecter l’État de droit. S’il s’agit de permettre à l’administration d’agir comme elle ne pourrait le faire dans d’autres circonstances, tout en étant moins contrôlée, nous considérons que la porte est alors ouverte à tous les arbitraires. Nous estimons donc que sur les mesures d’assignation à résidence prises à l’encontre de personnes ne constituant pas une menace terroriste, notre contrôle devrait être beaucoup plus strict.
M. le président Jean-Jacques Urvoas. Est-ce à dire que vous considérez que l’office du juge saisi en référé liberté ne doit pas porter uniquement sur le contrôle de l’erreur manifeste, mais qu’il doit aussi s’intéresser à la proportionnalité de la mesure, voire anticiper un contrôle du fond ?
Mme Hélène Bronnenkant. C’est en effet l’idée…
M. le président Jean-Jacques Urvoas. Que pourrait bien être, selon vous, une assignation à résidence, prise en vertu de l’état d’urgence, qui porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ? Tous les recours formés contre les assignations ont été rejetés par la juridiction administrative.
M. Serge Gouès. La réponse nous est donnée par l’ordonnance rendue hier par le juge des référés du Conseil d’État à propos d’une épouse de djihadiste assignée à résidence. Celle-ci a démontré devant le juge que, mère de trois enfants, elle ne pouvait matériellement pas se rendre trois fois par jour au commissariat situé à dix kilomètres de son domicile.
Je vous lis le communiqué du Conseil d’État : « Le juge des référés a ensuite examiné les modalités de l’assignation au regard du droit au respect de la vie familiale et de l’intérêt supérieur des trois jeunes enfants de l’intéressée, dont deux sont scolarisés et le dernier gardé à domicile. En vertu de la mesure de la mesure d’assignation dont elle avait fait l’objet, la requérante devait en effet se rendre en transports en commun à 9 heures, 14 heures et 19 heures à un commissariat de police situé à dix kilomètres de son domicile, alors qu’il existe un poste de poste de police dans la commune où elle réside. Le juge des référés a estimé que ces modalités faisaient peser des contraintes excessivement lourdes sur l’intéressée, qui doit assurer les trajets à l’école, assurer la garde de ses enfants par une voisine ou les amener avec elle au commissariat dont elle ne revient jamais avant 19 h 45.
« À la suite des échanges au cours de l’audience et du supplément d’instruction, ordonné par le juge des référés, le ministre de l’intérieur a toutefois modifié les conditions de l’assignation à résidence en réduisant les obligations de présentation de trois fois à deux fois par jour et en permettant à l’intéressée de se présenter au poste de police de sa commune de résidence du lundi au vendredi […].
« Le juge des référés du Conseil d’État a tenu compte de cette modification intervenue en cours d’instance. Toutefois au vu des atteintes portées aux libertés fondamentales qu’il a relevées, il a ordonné au ministre, pour préserver la vie familiale et l’intérêt des enfants, de prendre toutes mesures de nature à permettre à l’intéressée de s’acquitter de son obligation dans tous les cas et tous les jours au poste de police de sa commune de résidence, et non seulement les jours ouvrés. »
Mme Hélène Bronnenkant. Nous savons faire la balance entre la menace à l’ordre public et l’atteinte aux libertés fondamentales – nous le faisons déjà en matière de droit des étrangers. Imaginons que quelqu’un se trouve contraint d’arrêter de travailler, nous examinerions sa situation – est-il en contrat à durée déterminée ou indéterminée ? –, la gravité éventuelle de l’atteinte et la réalité de la menace à l’ordre public. Moins la menace est importante, plus l’enjeu des libertés est important. Nous en débattons entre collègues, lorsque des doutes existent, et le contrôle est effectué de manière très rapprochée.
M. le président Jean-Jacques Urvoas. La tribune publiée par Mediapart a-t-elle été beaucoup discutée dans les juridictions ? C’est une initiative inédite…
M. Serge Gouès. C’est très rare : habituellement, l’expression collective passe plutôt par les syndicats.
M. le président Jean-Jacques Urvoas. La démarche ou le contenu ont-ils suscité l’approbation de vos collègues ?
Mme Hélène Bronnenkant. Nous nous exposons rarement dans les médias. D’une part, nous considérons que c’est trop risqué. D’autre part, nous ne voulons pas nous politiser, sous peine de nuire à la valeur fondamentale que nous devons défendre : la justice. Nous sommes donc extrêmement réservés sur ces prises de position dans la presse, qui peuvent toujours être lues comme une critique de mesures prises par le Gouvernement en place.
En l’occurrence, la démarche me semble avoir reçu un accueil plutôt favorable. L’idée de montrer publiquement que nous ne sommes pas en permanence d’accord avec le Conseil d’État sourd depuis un moment.
M. le président Jean-Jacques Urvoas. Si les auteurs avaient lancé une pétition, ils auraient donc été plus de dix à signer ?
M. Serge Gouès. Sûrement, mais sans doute aurait-il fallu que les syndicats s’impliquent : il n’est pas évident de faire signer des pétitions.
M. le président Jean-Jacques Urvoas. Lorsque nous avons prorogé l’état d’urgence, nous avons adapté la loi de 1955 – elle avait d’ailleurs déjà été largement retouchée par une ordonnance de 1960. Nous avons notamment débattu de la substitution de la notion de « comportement » à celle d’ « activité ». Comment comprenez-vous ce changement ? Quel sens lui donnez-vous ? A-t-il eu des conséquences pour le juge administratif, ou faut-il considérer que le terme de « comportement », volontairement plus imprécis, en vaut un autre, sans que cela affecte les jugements que vous portez sur la qualification des faits qui vous sont soumis ?
M. Serge Gouès. C’est une question très difficile, sur laquelle je ne dispose pas d’éléments, faute de recul et d’éléments fournis par mes collègues. Le juge administratif est très souple, il a l’habitude des modifications de textes et s’adapte très vite.
M. le président Jean-Jacques Urvoas. Dans nos débats législatifs, était évoqué le fait que nous étions aux frontières de la justice prédictive, un comportement étant quand même beaucoup plus difficile à établir qu’une activité…
Mme Hélène Bronnenkant. Le terme de « comportement », a priori, a quelque chose de plus subjectif que celui d’« activité ».
M. le président Jean-Jacques Urvoas. Et pourtant vos collègues n’ont pas été fragilisés… Est-ce parce que vous avez l’habitude d’interpréter ?
Mme Hélène Bronnenkant. Nous n’avons pas eu de retour sur cette question, même si la difficulté de juger ces cas est réelle. Comme nous vous l’avons dit, le problème réside dans le fait qu’il ne reste de l’activité ou du comportement que trois lignes dans les dossiers, et, vous l’avez souligné, peut-être faudrait-il que nous soyons plus proactifs, surtout si les préfectures attendent, apparemment, que nous leur demandions des éléments pour nous les fournir.
M. le président Jean-Jacques Urvoas. Si cela ne vous est pas remonté, tant mieux. Cela veut dire que nos collègues étaient inutilement inquiets et que le terrain est déjà largement balisé ; cette modification ne constitue pas un changement fondamental.
La question des notes blanches fait-elle l’objet, au niveau syndical, d’une réflexion, qui concernerait le pouvoir administratif, ou bien exprimez-vous simplement un regret ?
M. Serge Gouès. C’est un regret. Cette question précise n’a pas été abordée il y a un mois, lors de notre congrès, dont les actes font pourtant une centaine de pages. Nous en parlons entre nous.
M. le président Jean-Jacques Urvoas. Je suppose que l’idée que des éléments supplémentaires soient versés au contradictoire recueille l’assentiment de tout le monde, d’autant que la question soulève toutefois des difficultés au regard de la Convention européenne des droits de l’homme, mais quelle forme cela pourrait-il prendre ? Faudrait-il faire un dossier distinct ou donner une forme d’habilitation à quelques magistrats qui pourraient accéder aux éléments dont disposent les services de renseignement ? Concrètement, comment imaginez-vous cela ?
Mme Hélène Bronnenkant. La loi sur le renseignement peut fournir un précédent. En matière d’état d’urgence, dès lors qu’on lui démontre que la mesure prise est efficace et nécessaire à la préservation de la sécurité publique, dès lors que les motifs exposés sont réels et qu’il n’y a pas d’atteinte au droit à la vie, de torture, etc., la Cour européenne des droits de l’homme est moins regardante sur des principes dits « conditionnels », comme la publicité de l’audience et le contradictoire.
M. le président Jean-Jacques Urvoas. Les délais laissés aux juridictions pour se prononcer constituent-ils une difficulté ?
M. Serge Gouès. Cette question se pose en droit des étrangers.
En l’occurrence, les juridictions sont très chargées. Notre enquête sur les conditions de travail a montré que plus de 70 % de nos collègues souffraient de leurs conditions de travail. Une charge supplémentaire n’est donc jamais bienvenue, mais nous faisons notre métier et nous n’avons vraiment entendu personne râler. Les magistrats font ce qu’ils doivent faire pour le service public de la justice.
M. le président Jean-Jacques Urvoas. Selon vous, depuis un mois et demi, les juridictions ont-elles évolué dans leur appréciation de la situation ?
Mme Hélène Bronnenkant. Je crois qu’il y a eu une prise de conscience, après un moment de flottement. Des décisions avaient été rendues par ordonnance alors que cela n’aurait pas dû être le cas – des audiences auraient dû se tenir –, mais nous avons pu nous faire une petite expérience, nous collectons des données, nous discutons entre nous.
Il y a quand même cette recherche de « comportement »… Nous savons faire la balance des atteintes aux libertés et des menaces à l’ordre public, mais rechercher ce qui anime une personne, c’est un nouveau métier pour nous. Il faut donc un temps d’adaptation, mais je crois que cela se fait.
M. le président Jean-Jacques Urvoas. J’ai été très surpris qu’une personne puisse tout à la fois faire l’objet d’une assignation à résidence en province et d’une interdiction de se rendre en Île-de-France, édictée par le préfet de police de Paris. Cela aurait-il pu être porté à la connaissance du juge administratif et celui-ci aurait-il pu intégrer ces deux paramètres pour mesurer si les mesures prises étaient proportionnées ? Tout de même, il y a peu de chances qu’un assigné à résidence se rende en Île-de-France s’il est assigné loin de la capitale !
Mme Hélène Bronnenkant. En principe, la connexité est un outil juridique à notre disposition pour regrouper et faire masse des dossiers.
M. le président Jean-Jacques Urvoas. Le juge aurait donc pu tenir compte du fait que la personne était soumise à d’autres mesures ?
Mme Hélène Bronnenkant. Oui, cela nous arrive dans d’autres situations. Je pense à quelqu’un à qui le statut d’apatride est refusé au motif qu’il est d’une nationalité précise, mais dont on refuse aussi d’examiner sa demande de titre de séjour en tant qu’étranger malade au motif qu’il est apatride… Il faut résoudre la contradiction, dans un sens ou dans un autre, et nous sommes capables de le faire.
Mme Sandrine Mazetier. Si ce n’est pas le cas en matière d’état d’urgence, existe-t-il des vade-mecum pour d’autres contentieux ? Des suppléments d’instruction sont-ils ordonnés en d’autres matières ou est-ce une innovation ?
Par ailleurs, les pétitions de juges administratifs existent, notamment lorsque de nouvelles dispositions entraînent une charge supplémentaire et un conflit d’agendas, tous les contentieux devant être réglés dans les mêmes délais d’urgence. La réforme de l’asile avait ainsi donné lieu à des pétitions relativement nourries.
Le Conseil d’État l’indiquait ce matin : s’il est dans la culture des tribunaux administratifs de se prononcer rapidement en matière de contentieux du droit des étrangers, ce n’est pour le moment pas le cas en matière d’état d’urgence. Il me semble pourtant que pratiquement tous les tribunaux administratifs de France ont déjà eu à statuer sur des référés-liberté. Je ne comprends donc pas pour quelles raisons un juge administratif peut être amené à douter de l’urgence qu’il y a à statuer sur une assignation à résidence.
M. Serge Gouès. Il existe de très nombreux vade-mecum disponibles sur l’intranet du Conseil d’État, relatifs au droit des étrangers, au droit de l’urbanisme, aux questions fiscales.
Mme Hélène Bronnenkant. À un bémol près : nous n’en avons pas sur les lois qui entrent en vigueur et qui concernent des sujets complexes, par exemple sur l’immigration, alors qu’il nous serait utile de disposer d’une présentation des principales modifications apportées au droit en vigueur. En revanche, nous disposons de toute la documentation de notre centre de formation.
M. Serge Gouès. Les suppléments d’instruction se pratiquent effectivement en matière d’urbanisme, de fiscalité ainsi que dans d’autres contentieux. Il ne s’agit toutefois pas d’une pratique courante. La décision est alors souvent prise de manière collégiale lorsque, pendant l’examen des dossiers, nous constatons qu’un élément fait défaut.
Mme Hélène Bronnenkant. Pour ce qui est de l’asile en effet, il y a eu une pétition. Nous avons vraiment réussi à rassembler les magistrats sur la question des audiences délocalisées. En fait, cela arrive dès que l’on touche aux symboles, aux principes. Nous ne voulions pas nous rendre dans les centres de rétention pour juger du droit des étrangers : cela aurait porté atteinte aux symboles de la justice. Celle-ci doit être rendue dans un lieu neutre, et non chez l’une des parties. C’est sur ce point que nous avions réussi à mobiliser.
Mme Sandrine Mazetier. Pas seulement.
Mme Hélène Bronnenkant. Il me semble en tout cas que c’est le dernier cas en date pour notre syndicat.
Mme Sandrine Mazetier. Les soixante-deux décisions que vous avez évoquées ont-elles été rendues par un juge unique ?
Mme Hélène Bronnenkant. Toutes.
Mme Sandrine Mazetier. Toutes ?
M. Serge Gouès. Eh oui ! C’est d’ailleurs l’un de nos combats. Nous n’allons pas faire ici une tribune syndicale mais, alors que la marque de fabrique de la juridiction administrative était la collégialité, aujourd’hui, une décision sur deux n’est plus collégiale, et la proportion des décisions rendues par un juge unique augmente de plus en plus. Ajoutez à cela la disparition du rapporteur public, notamment dans les affaires touchant au droit des étrangers… Cela fait beaucoup.
M. le président Jean-Jacques Urvoas. Vos collègues magistrats judiciaires estiment qu’il pourrait, à l’issue d’un délai de cinq jours, être envisagé de demander au juge judiciaire d’intervenir dans le contrôle des assignations à résidence, comme c’est déjà le cas en matière de contentieux des étrangers. Comment réagissez-vous à cette proposition syndicale ?
Mme Hélène Bronnenkant. Alors que nous sommes juges de l’assignation à résidence, nous devrions, au bout de cinq jours, passer la main aux magistrats judiciaires ? Cette manière de nous percevoir est assez violente ! De même, quand il est dit qu’il n’y a aucun juge administratif qui contrôle… Nous nous sentons vraiment niés dans notre existence et notre légitimité.
Il n’est pas bon de se monter les uns contre les autres, mais nous nous sentons tout à fait compétents pour juger de ces assignations à résidence. Nous ne sommes pas là que pour justifier l’action de l’administration – puisque tel est le procès d’intention qui nous est fait. Notre jurisprudence le prouve, notamment nos décisions les plus récentes.
M. le président Jean-Jacques Urvoas. Nous débattons de plus en plus régulièrement, à l’Assemblée nationale, de la légitimité du juge administratif, notamment au regard de l’article 66 de la Constitution. Nous en débattrons à nouveau lorsque le chantier du projet de loi portant réforme de la procédure pénale s’ouvrira.
Mme Sandrine Mazetier. La tribune anonyme publiée dans Mediapart indique que la loi permet de déroger à nos principes, aux engagements internationaux, en particulier la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, mais le Conseil d’État indique que la loi de 1955 est conforme à la Convention européenne de sauvegarde des libertés.
M. Serge Gouès. À quel passage de cette tribune faites-vous référence ?
Mme Sandrine Mazetier. C’est au cinquième paragraphe : « Lorsque la loi, comme c’est le cas de celle portant application de l’état d’urgence, instaure un état d’exception dont la nature est d’éclipser des pans entiers de l’ordre constitutionnel normal et permet de déroger à nos principaux engagements internationaux, en particulier la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le pouvoir du juge est limité ». Si des nuances sont ensuite formulées, dans cette tribune, sur la jurisprudence du Conseil d’État, l’avis qu’il a rendu sur la conformité de la loi de 1955 avec la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est clair : le juge, écrivent les auteurs de la tribune, « doit seulement vérifier si les mesures exceptionnelles autorisées par l’état d’urgence pouvaient être prises à l’encontre des personnes concernées ».
Mme Hélène Bronnenkant. C’est par un arrêt d’Assemblée, Rolin et Boisvert, du 24 mars 2006 que le Conseil d’État a déclaré la loi de 1955 elle-même conforme à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. L’article 15 de la Convention prévoit que les États parties peuvent déclarer l’état d’urgence à condition d’en informer la Cour. Cela s’est produit huit fois avant 2015 et deux fois en 2015, en Ukraine et en France. Cela étant, quand bien même elle validerait l’état d’urgence dans son principe, la Cour européenne des droits de l’homme peut tout à fait être amenée à relever des violations de la Convention à l’occasion de l’examen des mesures individuelles qui ont été prises. Ainsi, un arrêt rendu en 2010 à l’encontre du Royaume-Uni, qui a recouru plusieurs fois à l’état d’urgence en raison de la situation en Irlande du Nord, a condamné une violation de l’article 8 de la Convention – des pouvoirs exorbitants, insuffisamment circonscrits et sans contrôle, étaient confiés aux policiers – tout en considérant l’état d’urgence en lui-même parfaitement légal.
M. le président Jean-Jacques Urvoas. Vous évoquiez l’idée que le président de la juridiction puisse a priori être saisi des perquisitions administratives pour éviter les méprises, mais en quoi cette saisine permettrait-elle de les éviter ?
M. Serge Gouès. Je n’ai pas d’exemples précis à l’esprit, mais certaines perquisitions récentes se sont mal passées. Si le préfet précise dans quel cadre il va agir, à quel endroit et pour quelle raison, le président du tribunal administratif est tout à fait compétent pour vérifier la régularité de la mesure…
M. le président Jean-Jacques Urvoas. Les méprises que nous avons, pour notre part, observées, sont de deux ordres. Premier type de méprise : la personne visée avait déménagé depuis quelque temps et, en raison d’une mauvaise documentation des services de renseignement, la perquisition n’a pas eu lieu à la bonne adresse. Dans le cadre d’une saisine a priori, c’est cette adresse erronée qui aurait été donnée au président du tribunal, mais il ne dispose pas de pouvoirs d’investigation qui lui auraient permis d’y aller sonner pour demander à l’occupant des lieux s’il est bien celui chez qui il compte perquisitionner le lendemain ! Deuxième type de méprise : la procédure se déroule mal. Un citoyen voit sa porte exploser, alors qu’il suffisait de sonner pour qu’il ouvre, ou bien il se retrouve menotté alors que, ses enfants dans la chambre d’à côté, il n’avait nulle intention d’agresser les agents du RAID protégés par leurs boucliers. Le justiciable considère qu’il s’agit là d’une agression, qu’il conteste. Je ne vois pas quelle garantie apporterait une saisine a priori du tribunal, et je ne vois pas d’autres méprises possibles. En tout cas, les seuls cas que nous avons rencontrés sont des perquisitions qui se sont mal passées.
Mme Hélène Bronnenkant. Et le motif ? Perquisitionne-t-on parce que la personne visée appartient à la mouvance écologiste radicale ou parce que c’est un islamiste radical ?
M. le président Jean-Jacques Urvoas. De quel document disposeriez-vous pour contester le motif ? En l’absence d’éléments contradictoires, je ne vois pas en quoi une saisine a priori serait protectrice. Je ne dis pas que j’y suis hostile, je suis très soucieux de renforcer les droits mais je ne vois pas, matériellement, quelle plus-value elle apporterait.
Mme Hélène Bronnenkant. Ce qui nous semble contradictoire, c’est que le procureur de la République est informé, alors que l’article 14-1 de la loi du 3 avril 1955 dispose que « les mesures prises […] sont soumises au contrôle du juge administratif ». Une institution est informée, mais c’est l’autre qui sera responsable pour contrôler a posteriori ! Je songe aussi à la disproportion des moyens employés. Des recours indemnitaires seront sans doute formés à la suite de perquisitions qui se sont mal passées.
M. le président Jean-Jacques Urvoas. J’entends votre remarque, mais l’information du procureur n’est qu’une information. Il n’a ni d’avis d’opportunité à émettre ni même de jugement à porter sur ce qui se fait. Certes on pourrait imaginer que le président de la juridiction administrative le soit également, mais ce ne serait pas pour autant une saisine a priori. D’ailleurs, des procureurs peuvent vouloir saisir l’occasion de ces perquisitions administratives pour lever le doute sur un dossier qu’ils n’arrivent pas à judiciariser.
Mme Hélène Bronnenkant. La loi prévoit le contrôle des perquisitions administratives par le juge administratif. Mais quel est ce contrôle ? Qu’il n’y ait pas de contrôle a priori, soit, mais pas de contrôle a posteriori… La nullité de la perquisition administrative pourra-t-elle être soulevée dans le cadre d’un procès pénal ? Comment va-t-on faire ? Tant que ce point n’est pas précisé, cela reste assez fragile au regard de la Convention européenne des droits de l’homme.
M. le président Jean-Jacques Urvoas. De fait, le contentieux porte essentiellement sur les assignations à résidence qui sont au nombre de 400. Les 3 000 perquisitions n’ont donné lieu qu’à deux recours contentieux. Ces chiffres augmentent tous les jours, mais de moins en moins, car, dans les deux cas, l’effet de surprise s’est réduit.
Nous vous remercions, madame, monsieur, de votre disponibilité et de la qualité de vos réponses.
——fpfp——
AUDITION DE M. LOÏC GARNIER, CHEF DE L’UNITÉ DE COORDINATION DE LA LUTTE ANTI-TERRORISTE (UCLAT) AU MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
Compte rendu de l’audition, non ouverte à la presse, du vendredi 8 janvier 2016
M. le président Jean-Jacques Urvoas. La mission confiée à notre Commission d’effectuer, avec des attributions similaires à celles d’une commission d’enquête, le contrôle parlementaire des mesures prises par le Gouvernement dans le cadre de l’état d’urgence, nous conduit à procéder ce matin à l’audition de M. Loïc Garnier, chef de l’Unité de coordination de la lutte anti-terroriste (UCLAT), de M. Patrick Calvar, directeur général de la sécurité intérieure, et de M. Jérôme Léonnet, directeur central adjoint chargé du renseignement, chef du service central du renseignement territorial (SCRT).
Conformément aux dispositions de l’article 6 de l’ordonnance du 17 novembre 1958, je vais maintenant vous demander, monsieur Garnier, de prêter le serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité.
(M. Loïc Garnier prête serment.)
Cette audition est effectuée à huis clos, ce qui signifie qu’elle ne sera pas retransmise sur le site de l’Assemblée nationale. Un compte rendu sera publié, mais seulement à l’issue des travaux de contrôle et pas nécessairement in extenso.
Jean-Frédéric Poisson et moi-même avons effectué plusieurs déplacements dans différents départements, où nous avons rencontré les préfets et directeurs départementaux de la sécurité publique, mais aussi les responsables des services locaux de renseignement, qu’il s’agisse du renseignement territorial (RT), de la direction générale de la sécurité intérieure (DGSI) ou même de la police aux frontières (PAF), toujours en présence des procureurs de la République – y compris des procureurs généraux dans certaines villes – territorialement compétents. Nous avons beaucoup parlé de l’UCLAT, ainsi que du fichier des signalés pour la prévention et la radicalisation à caractère terroriste (FSPRT).
Vous avez la parole pour un exposé liminaire, avant que les membres de notre Commission ne vous posent quelques questions.
M. Loïc Garnier, chef de l’Unité de coordination de la lutte anti-terroriste (UCLAT). Je commencerai par dire quelques mots sur la menace terroriste, en évoquant les appels au djihad qui sont apparus récemment sur les réseaux sociaux. S’il s’agit de signaux « faibles », leur accumulation est interprétée par certains, notamment par moi, comme un signal fort. Parmi les messages les plus virulents que nous ayons relevés, je peux vous citer ceux-ci : « La démocratie en Europe est un système de mécréance qui débouche sur des parlements formés de mécréants et d’homos » ; « Aux armes, mes frères ! Ceinturez-vous d’explosifs et décapitez pour Noël les mécréants dans les monuments et les grands magasins » ; « Les attentats à Paris ne sont pas finis, dans quelques jours toutes les villes de Seine-Saint-Denis et du Val-d’Oise seront touchées » ; « On va attaquer toutes les épiceries kasher de Paris » ; « Après le Bataclan et les bars-restaurants, les attentats à Paris ne sont pas finis ». Tous ces messages nous inquiètent, et ce serait mentir que de dire que 2016 sera une année tranquille. Pour ma part, et sans vouloir faire de catastrophisme, je pense que nous n’avons encore rien vu : malheureusement, le pire reste à venir.
Nous avions déjà assisté à des opérations sans retour avec les attaques menées par les frères Kouachi ou par Amedy Coulibaly, mais ces trois individus, tués par les forces de l’ordre, étaient morts « en soldats ». Avec le Bataclan et les fusillades des terrasses, on a eu affaire à une opération kamikaze, ce qui représente une démarche psychologique très différente et un danger beaucoup plus grand ; par ailleurs, alors que nous n’avions eu jusqu’alors que des attaques ciblées – sur la rédaction de Charlie Hebdo, sur la communauté juive –, c’est une tuerie de masse qui a été perpétrée le 13 novembre, même si l’on peut y voir certains signes symboliques d’une portée limitée.
Je pense que tous les modes opératoires de l’État islamique ont vocation à être importés sur le territoire français et que, dès lors, le risque d’une attaque chimique ne saurait être écarté, comme le Premier ministre a déjà eu l’occasion de vous le dire. En effet, il ne serait sans doute pas très compliqué d’importer trois ou quatre obus chimiques en provenance de Syrie ou d’Irak, et de les faire exploser à l’aide d’un pain de plastic : l’effet d’un tel dispositif serait assez limité, mais suffirait à déclencher une panique importante.
L’ensemble de ces considérations justifie, à mon sens, la mise en œuvre de l’état d’urgence, qui constitue un signe rassurant à l’égard de la population française. Pour ce qui est de l’UCLAT, je tiens tout d’abord à préciser que nous ne sommes pas en charge de la problématique des perquisitions administratives. Notre rôle consiste essentiellement à mettre en œuvre les autres mesures administratives, notamment le FSPRT, dont la création n’a pas été facile mais qui constitue aujourd’hui un outil opérationnel utile. Ce fichier a été constitué suite à la décision du ministre de l’Intérieur de mettre en place un Numéro vert, initialement conçu comme une simple plate-forme téléphonique à l’usage des familles. Fonctionnant au départ avec le concours de quatre personnes seulement, il en emploie aujourd’hui treize, sur les vingt-cinq personnes constituant le département de lutte contre la radicalisation. Ce dispositif est rapidement apparu nécessaire, et le fichier de sécurité nationale dont il est assorti a été agréé deux fois par la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) et le Conseil d’État, qui ont obtenu certaines modifications. D’autres adaptations seront sans doute nécessaires, afin que l’ensemble des acteurs concernés se l’approprie : si le fichier n’est pas complexe, il est complet.
La structure du fichier comporte deux modes d’acquisition des données : du haut vers le bas d’une part, du bas vers le haut d’autre part. Pour ce qui est du haut vers le bas, l’UCLAT traite l’ensemble des appels téléphoniques qui lui parviennent de la part des familles ou d’autres proches des personnes signalées, ou encore des acteurs institutionnels. En toute transparence, les signalements font l’objet d’un triple envoi. Ils sont d’abord adressés aux directeurs de cabinet des préfectures des personnes effectuant les signalements – car nous avons constaté que ces personnes se sentent souvent très isolées. Un filtre sécuritaire est appliqué à chaque appel, afin d’évaluer les signalements et de distinguer ceux devant être pris au sérieux des autres – il peut s’agir, par exemple, d’un règlement de comptes dans le cadre d’un divorce. Le dossier est adressé à la DGSI et au Service Central du Renseignement Territorial pour évaluation. Sous le contrôle de la Commission Nationale de Contrôle des Techniques de Renseignement, des mesures techniques de surveillance peuvent être mises en place, à l’issue desquelles il est décidé, soit d’une prise en compte sécuritaire, soit d’une prise en compte dans un cadre social, par les collectivités territoriales, l’éducation nationale, ou tout autre service que le préfet du département jugera opportun d’actionner.
Du haut vers le bas, nous traitons également l’ensemble des signalements que nous recevons via internet. Dès le 29 avril 2014, nous avons créé une rubrique spéciale sur le site du ministère de l’Intérieur, permettant aux personnes de signaler certains comportements en remplissant des champs autorisant une expression assez libre, et de laisser leurs coordonnées si elles le souhaitent. Enfin, nous avons mené une action assez large à destination des commissariats et brigades de gendarmerie, afin de leur permettre de disposer d’un canevas de questions à poser – ce qui leur faisait défaut jusqu’alors – et d’être en mesure de recueillir et de transmettre plus facilement les premiers éléments au SCRT local pour évaluation. Tous ces signalements nous sont directement envoyés.
Du bas vers le haut, j’évoquerai la réactivation des états-majors de sécurité au niveau des préfectures, à une fréquence très variable : il est évident que l’état-major de la Creuse a vocation à être activé beaucoup moins souvent que celui des Bouches-du-Rhône. Ce dispositif constitue l’occasion, pour les différents acteurs de la vie locale, de transmettre certains signalements de façon plus ou moins confidentielle – il peut éventuellement s’agir d’une communication ne concernant que le directeur de cabinet. Ces signalements remontent ensuite jusqu’à nous.
Pour en revenir au FSPRT, j’insiste sur le fait que ce fichier a été initialement conçu pour collationner l’ensemble des données. Au départ, nous travaillions sur un fichier Excel, qui s’est révélé instable techniquement et ne disposait pas d’une base juridique suffisante, bien que nous ayons engagé très rapidement devant la CNIL et le Conseil d’État les procédures de nature à nous mettre en conformité avec le droit. Aujourd’hui, ce fichier est alimenté par les services locaux avec différents niveaux de visibilité, étant précisé qu’un nombre très restreint de personnes à l’UCLAT – dont moi-même – disposent d’une visibilité totale. Il s’agit d’un fichier de sécurité nationale, intrusif dans la mesure où il comporte un certain nombre de données à caractère extrêmement personnel – la religion, la conversion, les signes extérieurs de radicalisation –, et je veille à assurer la plus grande confidentialité dans son utilisation. Ainsi, au niveau local, les différents acteurs n’ont accès qu’aux fiches qu’ils ont eux-mêmes créées.
Le FSPRT compte aujourd’hui environ 12 000 entrées, ce qui constitue un chiffre important. C’est une source d’information au niveau local, qui permet de traiter les comportements de radicalisation et de déstabilisation. C’est aussi un outil opérationnel pour les services, qui permet de déclencher un certain nombre de procédures et de mener des actions en matière de renseignement. Les 12 000 entrées recouvrent des situations diverses. Il peut s’agir de signaux de radicalisation forts ou faibles, par exemple des signalements de conversion dont l’importance doit être évaluée au cas par cas : une conversion à l’islam radical est beaucoup plus significative quand elle se produit au sein d’une famille catholique, par exemple ; la volonté exprimée de partir en Syrie est évidemment un signal fort.
Il peut s’agir de situations de long terme, mais parfois aussi de situations d’urgence. Dans le premier cas, on peut assister à un processus progressif de conversion et d’observance très stricte de la religion, qui n’implique pas forcément la volonté de recourir à la violence : il ne s’agit alors que d’une conviction religieuse intime, relevant de la sphère purement privée. Pour ce qui est de l’urgence, le fichier a permis, dans un certain nombre de cas, de sauver des vies. Ainsi, nous avons reçu des signalements relatifs à des jeunes filles, parfois mineures – parmi les mineurs signalés comme étant radicalisés, il y a plus de jeunes filles que de jeunes hommes –, que nous avons parfois pu rattraper in extremis : je me souviens que, suite au signalement d’une jeune fille qui venait de recevoir un SMS de son amie, l’informant qu’elle s’apprêtait à partir pour la Syrie en passant par Istanbul, nous avons pu alerter la police aux frontières, qui a intercepté la personne concernée dans la salle d’embarquement avant de la remettre à ses parents. Comme vous le voyez, le FSPRT n’est pas seulement un outil sécuritaire, mais aussi parfois un outil social nécessitant une grande réactivité de la part de l’ensemble des acteurs.
Le dispositif présente encore des imperfections, à la fois techniques et humaines. Techniques, en raison du fait qu’un autre service, à savoir l’état-major opérationnel de prévention du terrorisme (EMOPT) y a entré des données qui dans un certain nombre de cas, ont nécessité et nécessitent encore une mise aux normes, ce qui a rendu nécessaire un important travail de nettoyage des fiches – une personne est employée à cette tâche à plein-temps. Un fichier de cette importance doit être géré avec beaucoup de rigueur et de transparence, ce qui, en pratique, n’a rien de facile.
Sur le plan humain, le dispositif est imparfait en raison de la difficulté des services locaux, notamment les préfectures, de s’approprier l’outil : cela se fait en remplissant un certain nombre de rubriques, ce qui n’est effectivement pas simple et s’est trouvé encore compliqué par des problèmes de connexion auxquels nous avons été confrontés, mais qui sont en voie de résolution définitive. Nous avons recours au réseau du système de Circulation hiérarchisée des enregistrements opérationnels de la police sécurisés (CHEOPS), un système informatique regroupant une grande partie des fichiers de la police nationale. Tous les problèmes sont en passe d’être réglés, et je pense que nous parviendrons à une situation totalement stabilisée d’ici quatre ou cinq mois. Ce délai me paraît tout à fait normal si l’on considère que le FSPRT a été activé pour l’ensemble des acteurs le 5 octobre 2015, ce qui implique la connexion de cent une préfectures et environ 5 000 accédants – le plus souvent à un degré de visibilité très faible, je le répète. Nous avons récemment diffusé une nouvelle doctrine d’emploi du FSPRT à l’ensemble des acteurs concernés, tenant compte des dernières modifications du fichier, et nous sommes toujours prêts à perfectionner cet outil d’analyse, comme nous l’avons fait récemment en ajoutant la possibilité d’effectuer certaines requêtes.
À la date du 7 janvier 2016, nous avions 8 808 signalements directs, provenant pour une moitié d’internet, des appels téléphoniques, des brigades et des commissariats, pour l’autre moitié des états-majors de sécurité locaux – un chiffre qui, à mon sens, témoigne de l’efficacité du dispositif. Pour ce qui est des personnes signalées, il s’agit à 80 % de majeurs. Les 20 % de mineurs sont des personnes de plus en plus jeunes, et comprennent plus de jeunes filles que de jeunes hommes. Ces personnes se radicalisent dans des circonstances de plus en plus baroques, et parfois dramatiques – on a assisté, dans certains cas, à des mariages sur Skype –, s’inscrivant dans une espèce de fantasmagorie du djihad. Analysant ce phénomène avec l’aide de psychologues, de psychiatres et de psychanalystes, nous pensons avoir affaire la plupart du temps à des jeunes désœuvrés et déstabilisés.
Les conversions représentent environ 40 % des personnes signalées. La notion de conversion est à relativiser : si elle ne fait pas de doute quand une personne passe de la religion catholique ou juive à l’islam, on peut également considérer que le fait, pour une personne d’origine maghrébine et « de culture musulmane », mais n’ayant jamais pratiqué, d’adopter un comportement religieux très strict, représente également une forme de conversion qui n’est pas sans faire penser aux mouvements chrétiens américains de la mouvance reborn, c’est-à-dire à une redécouverte de la religion – alors même que la religion dont ces personnes deviennent adeptes n’est pas du tout celle pratiquée par leurs parents et grands-parents.
Suite à la mise en œuvre de l’état d’urgence, l’UCLAT a reçu 462 dossiers d’assignation à résidence. Nous recevons en général une note provenant du renseignement territorial ou de la DGSI, que nous transformons en note dite blanche, parfaitement acceptée par la jurisprudence administrative. Nous devons en effet faire en sorte de supprimer du document initial tout ce qui serait de nature à mettre en péril ses sources – sans toutefois le vider de sa substance, afin d’éviter des contentieux ultérieurs devant le tribunal administratif. Sur ces 462 dossiers, 366 ont été signés, les autres ayant été rejetés par la direction des libertés publiques et des affaires juridiques (DLPAJ), qui a estimé que l’argumentation n’était pas suffisante pour prononcer une mesure d’assignation à résidence ; en évitant du contentieux, ce filtre épargne aussi à l’État de « perdre la face » devant le juge administratif, ce qui aurait des effets extrêmement néfastes.
Dans le cadre de la COP21 et de l’état d’urgence, nous avions reçu soixante-cinq dossiers, sur lesquels vingt-sept ont été signés, et dix notifiés – la différence entre ces deux derniers chiffres s’expliquant par le fait que la plupart des personnes concernées logeaient dans des squats et étaient de ce fait difficiles à localiser. Fort heureusement, la COP21 s’est très bien passée, en partie grâce à ces mesures administratives qui symboliquement ont marqué un coup d’arrêt, et grâce au travail mené avec nos partenaires étrangers et au rétablissement du contrôle aux frontières, qui a permis d’arrêter énormément de perturbateurs venant de l’étranger, notamment des Pays-Bas, de la Belgique, d’Allemagne et d’Italie. Alors qu’il y a six ou huit mois, nous étions plutôt pessimistes quant à la tenue de la COP21 – je l’étais moi-même –, la vigilance dont nous avons fait preuve, jointe aux mesures prises dans le cadre de l’état d’urgence, a permis que ce événement se déroule sereinement, contrairement à ce que nous craignions.
Il est à noter que 50 % des dossiers d’assignation à résidence concernant les islamistes radicaux font l’objet d’aménagements, rendus nécessaires par le fait que les personnes concernées peuvent déménager, ou avoir des horaires de travail incompatibles avec les mesures qui leur sont appliquées, notamment l’obligation de pointage.
M. le président Jean-Jacques Urvoas. Ce chiffre me surprend, car il ne correspond pas à ce qui nous a été dit lors de nos déplacements dans les préfectures.
Mme Sandrine Mazetier. Les assignations à résidence dont vous faites état correspondent-elles uniquement à celles prononcées dans le cadre de l’état d’urgence ?
M. Loïc Garnier. Oui, uniquement à celles prononcées dans le cadre de l’état d’urgence. Au demeurant, le fait d’apporter des aménagements aux assignations à résidence ne constitue pas un problème : il s’agit simplement de rédiger des arrêtés, ce que nous nous efforçons de faire de la manière la plus juste et la plus lucide possible.
Pour ce qui est du contentieux, cinquante-trois dossiers d’assignation à résidence ont été contestés devant le tribunal administratif, soit 14 % de l’ensemble des dossiers, ce qui impose une révision, une demande de renseignements complémentaires aux services et une présence au tribunal administratif, afin de défendre notre position.
J’en viens aux réactions suscitées dans les autres pays par la déclaration de l’état d’urgence en France. Cette mesure a eu un écho très favorable dans la presse italienne : « La défense du droit de manifester valait-elle la peine de braver les interdictions ? » s’est interrogé le Corriere della Sera, avant de répondre que non. Les mesures d’assignation à résidence prises dans le cadre de la COP21, en application de la loi de 1955, ont conduit La Libre Belgique à s’émouvoir du fait que, selon elle, on utilisait l’état d’urgence au prétexte d’attentats islamistes pour limiter la liberté de circulation de certaines personnes. Aux États-Unis, certains ont accusé la France de vouloir étouffer la contestation de la COP21 en recourant aux moyens de l’état d’urgence – ce dont la Russie s’est émue, elle aussi. Enfin, les Britanniques ont été assez neutres, se bornant à relever que la communauté musulmane était désormais sous la surveillance de la police et des médias, et produisant des témoignages vidéo de jeunes musulmans se disant « victimes » des mesures prises. Globalement, donc, les critiques sont restées prudentes et limitées.
Pour ce qui est de l’impact en France de l’état d’urgence, il y a eu des réactions extrêmement défavorables. Je pense notamment à l’ONG islamique Baraka City, ou à la fraternité musulmane Sanabil, qui ont médiatisé au maximum l’ensemble des mesures prises dans le cadre de l’état d’urgence, se posant en victimes et même en boucs émissaires des attentats dans le cadre d’une politique de communication très agressive. Ont ainsi été produits des témoignages de personnes critiquant la police, accusée de procéder aux perquisitions d’une manière excessivement violente. Il s’agit de mon point de vue d’allégations purement mensongères : à ma connaissance, toutes les interventions se sont faites au contraire avec beaucoup de tact et de mesure et, en tout état de cause, je n’ai jamais entendu parler de portes enfoncées en hurlant et les armes à la main – et je suis catégorique sur le fait que ce n’est pas ainsi que l’on travaille.
M. Sébastien Pietrasanta. Pour ce qui est de la popularisation du Numéro vert, estimez-vous que les campagnes de communication ont porté leurs fruits ? Lors d’une précédente audition, vous aviez avancé le chiffre de 3 000 signalements, et nous en sommes aujourd’hui à 8 800. Cette nette accentuation est-elle liée aux attentats de novembre 2015 ? Par ailleurs, parvient-on à élargir la base des personnes qui appellent ? Le chiffre de 40 % de convertis parmi les personnes signalées ne correspond pas à celui cité par la DGSI. La surreprésentation des convertis parmi les personnes signalées, que nous avions constatée naguère, est-elle toujours d’actualité ?
Pouvez-vous nous renseigner sur la possibilité éventuelle pour certaines personnes de sortir du fichier, et le cas échéant à quelles conditions ? Quand vous constatez qu’une personne a été fichée indûment, supprimez-vous son nom du fichier, la transférez-vous dans un autre fichier, ou lui attribuez-vous un code particulier ?
Enfin, en ce qui concerne l’état-major opérationnel, je n’ai pas très bien compris quelles étaient les interactions entre les différents fichiers. J’imagine qu’il existe un fichier central, mais comment est-il alimenté et quels sont ses liens avec les autres fichiers afin de faire circuler les informations de la manière la plus rapide et la plus fiable qui soit ? Existe-t-il deux fichiers consolidés, l’un géré par l’UCLAT, l’autre par l’état-major opérationnel ?
M. Loïc Garnier. On a effectivement observé une forte augmentation du nombre d’appels au Numéro vert, due à plusieurs facteurs. Il s’agit tout d’abord des campagnes de communication menées, notamment sous la forme d’affichettes apposées dans les locaux des services sociaux, les commissariats et les brigades de gendarmerie, mais aussi avec le site internet Stop-Djihadisme.gouv.fr créé par le SIG et les différents spots diffusés à la télévision. Le Numéro vert est aujourd’hui très connu et bien référencé par les moteurs de recherche – il apparaît même en tête de liste, ce qui n’est pas négligeable.
On constate d’importantes variations du nombre d’appels, qui constituent un excellent thermomètre de l’inquiétude de nos concitoyens. Ainsi, le 13 novembre 2015, nous avons eu cinquante et un appel ; le 14 novembre, 155 appels ; le 15 novembre, 122 appels ; et le 16 novembre, 638 appels. Comme on le voit, après une certaine augmentation du nombre d’appels durant le week-end qui a suivi les attentats – dont le caractère limité peut sans doute être attribué à une certaine sidération –, ce nombre a explosé le lundi suivant. Pour autant, ces appels n’ont abouti qu’à vingt-six signalements, en raison d’un grand nombre d’appels motivés uniquement par l’inquiétude ou la malveillance. Nous avons également noté des pics d’appels survenant en fonction de certains événements sociaux, notamment de manifestations plus ou moins populaires.
Lorsque nous avons été en présence d’un afflux massif d’appels, notamment à la suite des attentats, nous avons ouvert la plate-forme téléphonique vingt-quatre heures sur vingt-quatre, y compris le week-end. Nous n’avons cependant pas maintenu l’ouverture la nuit, ayant constaté que nous recevions très peu d’appels la nuit, les gens s’étant adaptés au format d’horaires que nous avions annoncé : il serait donc inutilement coûteux de maintenir une ouverture vingt-quatre heures sur vingt-quatre et sept jours sur sept.
En ce qui concerne la sortie des fichiers, nous avions pris des engagements de clarté et de transparence totale. Ainsi, la personne qui appelle peut rester anonyme ; elle n’est jamais enregistrée ; enfin, lorsqu’un signalement n’est pas confirmé, nous supprimons la fiche correspondante. Seules quelques personnes à l’UCLAT ont le pouvoir de supprimer les données. De même, seule l’UCLAT peut valider une fiche, et toutes les informations versées au fichier nous sont suggérées pour validation.
M. le président Jean-Jacques Urvoas. Est-ce également vous qui modifiez les fiches ? Les services nous ont indiqué que les rectifications, par exemple pour corriger une erreur matérielle, peuvent prendre jusqu’à quatre mois car seule l’UCLAT peut y procéder.
M. Loïc Garnier. Les services peuvent modifier les fiches eux-mêmes.
M. le président Jean-Jacques Urvoas. Peuvent-ils modifier l’orthographe des noms ?
M. Loïc Garnier. Oui.
M. le président Jean-Jacques Urvoas. Ils nous ont pourtant indiqué le contraire.
M. Loïc Garnier. On est dans le processus d’appropriation du fichier. Les choses se sont faites rapidement et tout le monde réfléchit en marchant… Avec les nouvelles doctrines que nous avons diffusées, tout rentre désormais dans l’ordre.
Quoi qu’il en soit, la sortie du fichier correspond à un engagement que nous avions pris devant la CNIL et le Conseil d’État. Nous en avons d’ailleurs complètement sorti une série de jeunes gens, sans garder aucune mémoire de leurs dossiers. Lorsqu’on a affaire à des personnes à la marge, dont il serait délicat, dans un premier temps, de supprimer la fiche, on peut mettre le dossier en sommeil. En effet, lorsqu’elle sait qu’elle a été signalée au Numéro vert, la personne peut adopter une stratégie de dissimulation et changer radicalement de comportement : se raser la barbe et reprendre une attitude normale. Deux ou trois mois après, on peut demander une nouvelle évaluation pour supprimer le dossier du fichier. Nous ne sommes pas là pour faire de la compilation, ni mettre la population française en fiches.
M. le président Jean-Jacques Urvoas. Ce fichier sert-il aux assignations à résidence et aux perquisitions ?
M. Loïc Garnier. Non, il sert simplement au traitement des personnes radicalisées.
M. le président Jean-Jacques Urvoas. Logiquement, toutes les personnes perquisitionnées devraient y figurer ?
M. Loïc Garnier. Pas forcément. Les consignes que nous avons reçues nous conduisent à essayer de découvrir des indices de terrorisme via des infractions de droit commun. Ont donc été perquisitionnés des gens supposés être des trafiquants d’armes, qui n’étaient pas pour autant radicalisés.
M. le président Jean-Jacques Urvoas. En revanche, les personnes assignées à résidence y figurent toutes ?
M. Loïc Garnier. Oui.
Mme Élisabeth Pochon. Quel est le rapport entre ce fichier et les fiches S ? L’un précédant l’autre, comment ces deux fichiers cohabitent-ils ?
Recevez-vous beaucoup d’appels de la part d’institutions telles que l’Éducation nationale ? Les jeunes – notamment les jeunes filles – appellent-ils eux-mêmes ? Peut-on dresser une cartographie des appels ?
Des institutions telles que la police aux frontières ont-elles accès à ce fichier et peuvent-elles le consulter à titre préventif ?
Mme Sandrine Mazetier. Êtes-vous prescripteur des modalités d’assignation à résidence ?
M. le président Jean-Jacques Urvoas. Par exemple, est-ce vous qui décidez du nombre de pointages au commissariat de police ?
M. Loïc Garnier. Ces décisions se prennent en liaison avec la DLPAJ et les services locaux, en fonction du cas, afin de ne pas handicaper la personne dans sa vie quotidienne.
Mme Sandrine Mazetier. Vous avez dit que 50 % des assignations à résidence ordonnées dans le cadre de l’état d’urgence avaient vu leurs modalités évoluer ; or il y a très peu de contentieux. Quelqu’un fait donc évoluer les modalités de contrôle hors contentieux ?
M. Loïc Garnier. Il s’agit tout simplement de recours gracieux.
Mme Sandrine Mazetier. Vous n’intervenez donc pas dans cette procédure ?
M. Loïc Garnier. Si : à la suite d’un recours gracieux, la DLPAJ sollicite notre avis sur les possibilités d’aménagement des modalités.
Il faut bien distinguer les fiches S et le FSPRT. Celui-ci liste les personnes signalées ; fichier déclaratif, il ne saurait faire foi d’une radicalisation avérée. Lorsqu’un individu est inscrit au FSPRT, les services de renseignement évaluent sa radicalisation grâce aux moyens qui leur sont conférés par la loi. S’il est considéré comme radicalisé, voire en lien avec une mouvance violente, il fait l’objet d’une fiche S.
Nous recevons en effet de plus en plus d’appels en provenance d’institutions, notamment de l’Éducation nationale. Cela est dû en particulier à notre action de formation. Deux fois par semaine, nous nous déplaçons, partout en France, dans les préfectures pour animer des séances de formation sur une demi-journée ou une journée entière, qui réunissent différents corps de l’État, collectivités territoriales et acteurs associatifs divers. Nous essayons de sensibiliser chacun à ce problème. Ainsi, lors d’une conférence que j’ai donnée dans l’Orne, à Alençon, je m’étais adressé aux représentants de l’Éducation nationale pour leur dire : « Nous avons longtemps été ennemis, mais nous devons travailler ensemble à ce problème. Vous êtes les observateurs privilégiés du comportement des jeunes ; prenez conscience du fait que vous pouvez peut-être leur sauver la vie. » Plus surprenant, nous recevons également des appels de la part de médecins ou d’avocats qui nous indiquent – en violation parfois du secret professionnel – qu’un client mériterait d’être surveillé.
M. le président Jean-Jacques Urvoas. Vous avez indiqué que 366 assignations à résidence ont été prononcées. Y incluez-vous les assignés à résidence de la COP21 ?
M. Loïc Garnier. Non, ce chiffre ne concerne que l’islam radical. Les assignés à résidence dans le cadre de l’arrêté relatif à la COP21 représentent vingt-sept personnes de plus.
M. le président Jean-Jacques Urvoas. Le cabinet du ministre nous a parlé de 381 dossiers en tout.
M. Loïc Garnier. Ces chiffres changent tous les jours, parfois vite, ce qui rend le décompte délicat.
M. le président Jean-Jacques Urvoas. Le chiffre des 381 assignations date du 21 décembre et ne semble pas avoir bougé depuis. Selon le cabinet du ministre, entre le 21 décembre et aujourd’hui, aucune assignation à résidence n’a été prononcée.
M. Loïc Garnier. Cela mérite d’être précisé.
Mme Marie-Anne Chapdelaine. Les sorties des fichiers correspondent-elles à un écrasement physique des données relatives à une personne ou à la mise à l’écart de la fiche vouée à être un jour effacée ?
M. Loïc Garnier. Les données sont écrasées et disparaissent.
M. le président Jean-Jacques Urvoas. Monsieur Garnier, nous vous remercions.
——fpfp——
AUDITION DE M. PATRICK CALVAR, DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE AU MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR, M. JEAN-YVES GUILLARD, SOUS-DIRECTEUR DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE, ET MME MARIE DENIAU, CHEF DE CABINET
Compte rendu de l’audition, non ouverte à la presse, du vendredi 8 janvier 2016
M. le président Jean-Jacques Urvoas. Monsieur le directeur général, je vous remercie pour votre présence. Cette audition se déroulera à huis-clos ; le compte rendu, non nécessairement intégral, ne sera publié qu’à l’issue des travaux portant sur l’état d’urgence. Nous avons également les pouvoirs d’une commission d’enquête, que nous nous sommes donnés en vertu de l’article 5 ter de l’ordonnance de 1958 régissant le fonctionnement des assemblées parlementaires.
Avant de vous passer la parole, je dois vous demander, conformément aux dispositions de l’article 6 de l’ordonnance du 17 novembre 1958, de prêter le serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité.
(MM. Patrick Calvar et Jean-Yves Guillard, et Mme Marie Deniau prêtent serment.)
Monsieur le directeur général, je vous prie de bien vouloir concentrer vos propos sur ce qui, dans votre activité, relève de l’état d’urgence.
M. Patrick Calvar, directeur général de la sécurité intérieure (DGSI). L’état d’urgence nous a permis de prendre une série de mesures dans le cadre de la loi. Notre philosophie a d’emblée consisté à rechercher une action ciblée, privilégiant le qualitatif plutôt que le quantitatif.
Nous avons visé des individus que nous ne pouvions pas, sur la base des informations dont nous disposions, intégrer dans le cadre des procédures judiciaires. Il s’agit par exemple des personnes rentrées de la zone syro-irakienne sans que nous ayons la preuve qu’elles avaient pénétré en Syrie et rejoint des groupes terroristes ; en l’absence de cette preuve, elles ne pouvaient pas faire l’objet de ces procédures. Nous savions avec exactitude qu’elles s’étaient rendues en Turquie, mais il nous manquait les informations sur leur itinéraire ultérieur. Nous avions également rangé parmi les cibles des individus sur lesquels nous possédions des informations indiquant un possible engagement djihadiste, mais sans actes matériels qui nous auraient permis d’entrer dans une phase judiciaire. De façon générale, la DGSI mène une action préventive de démantèlement des réseaux pour empêcher la commission d’actes ; c’est dans cette perspective que nous avons opéré, cherchant – notamment au travers des perquisitions administratives – des éléments susceptibles de déboucher sur des actions de neutralisation judiciaire.
Nous étions avant tout intéressés par l’informatique et la téléphonie. Les matériels ont été en majorité copiés et font encore l’objet d’exploitation. Certaines opérations ont donné lieu à des actions judiciaires, en coopération avec le renseignement territorial et la police judiciaire. Ce n’était pas nous qui agissions, mais des officiers de mon service étaient présents dans chaque opération que nous avions proposée, afin d’orienter les recherches.
Les mesures autorisées dans le cadre de l’état d’urgence nous ont essentiellement servi à cibler les islamistes. Ainsi, s’agissant des groupes d’ultra-gauche, nous nous étions orientés non vers des perquisitions ou des assignations à résidence, mais vers des interdictions de séjour, notamment au moment de la COP21.
Pour ce qui nous concerne, nous avons ciblé 536 objectifs, dont 139 individus que nous soupçonnions de vouloir partir dans la zone syro-irakienne et 63 que nous soupçonnions en revenir ; 134 assignations à résidence ont été prononcées, et 503 perquisitions administratives, effectuées. Nous avons copié des supports informatiques dans le cadre de 246 opérations, et saisi des armes et des munitions pour 43 d’entre elles. Certaines de ces armes – notamment des fusils de chasse – étaient détenues légalement, mais nous pouvions néanmoins les récupérer le temps de l’état d’urgence. Nous avons également saisi des matériels divers tels que des vidéos, des drapeaux ou d’autres signes permettant de faire un lien entre la personne et son idéologie. Vingt-huit gardes à vue ont été prononcées à la suite des opérations menées sur notre demande : deux pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste, une pour apologie de crimes d’atteinte à la vie et recel de vidéos, et deux pour apologie du terrorisme. Enfin, dans une affaire, en perquisitionnant le domicile de l’individu, nous avons découvert qu’il s’intéressait aux forces de sécurité et avait manifestement des intentions délinquantes. Mon service l’a placé en garde à vue pour association de malfaiteurs ; depuis, il est incarcéré. Il préparait vraisemblablement un acte isolé, du type de celui qui s’est produit hier – sous réserve des conclusions de l’enquête.
M. le président Jean-Jacques Urvoas. Lors de nos déplacements, nous avons été frappés de constater que votre service était très peu demandeur de perquisitions, au regard de l’ensemble des perquisitions prononcées dans chaque département. Comme vous dites, vous avez privilégié le qualitatif plutôt que le quantitatif.
Quelle était la marge d’autonomie de vos services locaux en matière de désignation des cibles ? S’agit-il de propositions de vos responsables territoriaux ou de commandes de la centrale ? Vous, Monsieur le directeur général, validez-vous personnellement l’ensemble des objectifs traités sur indication de la DGSI ? Votre personnel était-il systématiquement présent aux perquisitions dont vous souhaitiez l’organisation ? Au final, l’état d’urgence n’a-t-il pas représenté pour vous un problème ? Il a pu vous amener, en effet, à dévoiler la surveillance d’objectifs que vous auriez souhaité traiter plus longtemps, pour déboucher plus sûrement sur des procédures judiciaires.
M. Sébastien Pietrasanta. Avez-vous renoncé à perquisitionner ou à assigner à résidence certains individus parce que vous étiez en train de les surveiller ? Dans le contexte de l’état d’urgence, avez-vous fait face à des choix cornéliens entre l’action – afin de ne prendre aucun risque – et la poursuite de la surveillance discrète ?
M. Patrick Calvar. Aujourd’hui, deux cents dossiers judiciaires couvrent plus de mille individus. C’est pourquoi nous privilégions le qualitatif : ces mille objectifs individuels, qui n’entrent pas dans le cadre de l’état d’urgence, représentent déjà un portefeuille lourd à suivre.
Le choix des cibles se faisait par les responsables locaux, mais toujours en concertation avec la centrale. En effet, nous souhaitons avoir une vision globale et maîtriser notre action. Les locaux proposaient une cible ; une discussion s’engageait ; puis les demandes étaient faites officiellement auprès de l’autorité préfectorale ou de l’UCLAT.
M. le président Jean-Jacques Urvoas. Donc – simple hypothèse – je ne peux pas avoir rencontré de commissaire me disant qu’on lui a imposé d’assigner une personne à résidence, alors que si on lui avait demandé son avis, il aurait dit non…
M. Patrick Calvar. Le local connaît le dossier, mais nous pouvons, à Paris, disposer d’informations complémentaires. En effet, nos sources d’information sont multiples : nos propres enquêtes, les données issues de la coopération avec nos partenaires nationaux et internationaux… Paris peut donc donner une impulsion alors que la province, n’ayant pas encore tous les éléments en main, n’est pas en situation d’agir. C’est pourquoi nous souhaitons avoir une vision globale centralisée. Ce n’est pas moi qui donne le feu vert, mais le responsable de la sous-direction antiterroriste où est centralisé l’ensemble de l’information. Si problème il y a, le directeur du renseignement et des opérations intervient ; en cas de difficulté à trancher, j’interviens personnellement. Je n’ai eu à intervenir dans aucun des cas traités.
Lors de ces perquisitions, même si ce n’était pas nous qui opérions, un représentant de notre service était toujours présent. En effet, puisque nous étions demandeurs, nous devions pouvoir orienter les équipes sur le terrain.
Ces procédures pouvaient-elles nous nuire et nous empêcher de parvenir à nos objectifs ? Nous avons ciblé les dossiers pour lesquels les perquisitions représentaient un moyen idéal d’avancer, alors que nous nous trouvions bloqués. En effet, dans la plupart des enquêtes que nous menons, nous avons besoin de disposer des moyens de communication et de les étudier pour établir les arborescences relationnelles qui constituent autant d’indices permettant de déceler une éventuelle dangerosité. Aujourd’hui, la plupart des gens sur lesquels nous travaillons utilisent des moyens de communication variés et souvent cryptés, donc impossibles à intercepter et à déchiffrer. Seule la perquisition administrative permet d’aller au cœur du problème. La perquisition est suivie d’un énorme travail puisque tout ce qui a été pris – des gigaoctets de données – doit ensuite être analysé. Quelque précis que soit le renseignement, la technique devient aujourd’hui un problème. Dans les affaires récentes, parmi les plus graves, le chiffrement des moyens de communication utilisés représente pour nous un handicap majeur ; nous travaillons donc beaucoup plus sur la métadonnée et l’arborescence, auxquelles seule la perquisition permet d’avoir accès. Pour ne pas attirer l’attention, nous n’avons pas perquisitionné les personnes en cours de surveillance ; nous n’avons agi que lorsqu’il s’agissait de lever le doute, et l’état d’urgence représentait pour nous un outil extraordinaire nous permettant de le faire en temps réel.
Mme Cécile Untermaier. Comment s’organise l’articulation entre votre service et les préfets ? Votre coopération vous paraît-elle satisfaisante ? Y a-t-il des marges de progression en matière de synergies et de mise à niveau de l’information ?
La centralisation des assignations à résidence ne nuit-elle pas à l’efficacité ? Ne serait-il pas au préfet de fixer les modalités de la mesure ? J’ai ainsi constaté sur le terrain des difficultés au pointage : par exemple, en zone rurale, les brigades devaient ouvrir le samedi et le dimanche uniquement pour que la personne vienne pointer. La centralisation me paraît donc poser question.
Enfin, dès lors que les perquisitions sont admises comme un risque par les personnes recherchées, ont-elles encore un sens ? N’en avez-vous pas diminué le nombre pour cette raison précisément ?
M. Patrick Calvar. La synergie avec les préfets est aujourd’hui totale. S’il existe plusieurs niveaux de coordination, notamment avec les services qui luttent contre le terrorisme – le renseignement territorial, la police judiciaire, la gendarmerie nationale –, la DGSI mène un dialogue particulier avec les préfets. Notre coopération fonctionne très bien.
En matière de lutte antiterroriste, la centralisation me paraît inévitable. En effet, s’agissant de mesures graves, il importe d’avoir une vision globale, et les règles du jeu doivent être les mêmes sur l’ensemble du territoire, sans varier d’un département à l’autre. En revanche, les modalités de leur mise en œuvre doivent s’adapter aux réalités locales, en fonction du lieu et des capacités de la gendarmerie ou de la police d’appliquer les mesures prescrites. Je fais donc une différence entre l’application de l’assignation à résidence au niveau national et son exécution matérielle sur le terrain.
Aujourd’hui, ceux qui ont quelque chose à se reprocher savent clairement qu’ils peuvent faire l’objet de perquisitions. Mais ils le savaient déjà avant l’instauration de l’état d’urgence car les perquisitions peuvent intervenir dans un cadre judiciaire. La précaution est donc naturelle pour eux. Néanmoins, ils conservent systématiquement des moyens de communication, donc nous rendre chez eux représente toujours un plus pour nous. Une fois que nous avons réalisé des opérations sur une série de cibles, nous pouvons croiser les informations. Des éléments trouvés chez un individu peuvent nous permettre de rebondir pour analyser ceux trouvés chez un autre. L’état d’urgence et les perquisitions administratives qu’il autorise permettent également de repérer des infractions de droit commun commises par des individus qu’on ne peut pas neutraliser dans le cadre de la lutte antiterroriste. Comme nombre d’individus investis dans les activités terroristes le sont également dans des faits de petite et moyenne délinquance, il s’agit d’ouvertures intéressantes. La téléphonie et les autres matériels saisis permettent ainsi de rebondir sur un autre niveau d’infraction.
M. le président Jean-Jacques Urvoas. La surveillance vous a-t-elle permis de détecter des comportements de surprotection ? Observant que l’état d’urgence est massivement utilisé pour conduire des perquisitions, certains individus pourraient considérer que le risque que vous pénétriez chez eux est désormais plus fort que par le passé, et prendre dès lors encore plus de précautions, glissant vers la clandestinité.
M. Patrick Calvar. J’ai en tête un cas de ce type ; mais bien que l’intéressé ait considéré – à raison – qu’il ferait l’objet d’une perquisition, il a néanmoins conservé quelques moyens de communication. De plus, les perquisitions les déstabilisent et les soumettent à une pression qu’ils ne ressentaient pas nécessairement avant. C’est également un élément important qui justifie l’état d’urgence et les mesures appliquées depuis son instauration.
M. René Dosière. Sur quoi débouchent les vingt-huit gardes à vue que vous avez évoquées ?
M. Patrick Calvar. Ce n’est pas nous qui avons pris en compte ces vingt-huit gardes à vues. Une affaire de terrorisme sur laquelle nous avons rebondi a abouti à l’incarcération du suspect. Je n’ai pas de chiffres sur les autres cas car, à partir du moment où l’enquête quittait le cœur de la lutte antiterroriste pour s’engager sur le terrain du droit commun, nous n’avons pas suivi les dossiers. Ainsi, je ne sais pas ce qu’il est advenu de l’individu impliqué dans une affaire de détention d’images pédophiles. Les officiers de police judiciaire qui opéraient appartenaient soit à la police nationale – la plupart du temps à la direction centrale de la sécurité publique – soit à la gendarmerie nationale. Pour les clients qui continuent à nous intéresser, nous avons maintenu des mesures de surveillance. Je ne peux donc pas vous répondre.
Mme Sandrine Mazetier. Des mesures de surveillance ont-elles été compromises du fait de l’état d’urgence ? Y a-t-il des cas où des perquisitions ordonnées par un autre service auraient échappé à la coordination ? Ou bien les avantages – la désorganisation des filières du fait de la pression liée à l’état d’urgence et de la potentialité des perquisitions – s’avèrent-ils supérieurs aux inconvénients éventuels, comme celui de compromettre la surveillance ?
M. Patrick Calvar. Nous n’avons pas été confrontés à cette situation, précisément grâce à la coordination par l’autorité préfectorale. Nous étions en permanence en contact avec les services, notamment ceux du renseignement territorial ; les cibles indiquées par ce dernier comme par notre service faisaient l’objet d’entretiens. Il n’y a donc pas eu d’opération handicapée ou entravée parce qu’on aurait déclenché une perquisition. Aujourd’hui, la coopération avec le renseignement territorial s’organise à différents échelons : au niveau local, nous coordonnons l’action dans les régions ; nous coopérons au niveau zonal ; enfin, au sein de la DGSI, une structure regroupe tous les services engagés dans la lutte antiterroriste : sécurité intérieure, renseignement territorial et direction du renseignement de la préfecture de police. En cas de nécessité, on désamorce les conflits pour rester fidèle au principe général de fonctionnement du renseignement : la complémentarité et la coordination entre les services.
M. Dominique Raimbourg. Au moment du déclenchement de l’état d’urgence, vous aviez en stock un certain nombre de cibles sur lesquelles vous aviez des renseignements sans disposer d’indices susceptibles de déboucher sur une procédure judiciaire. Aujourd’hui, près de deux mois après, vous reste-t-il encore beaucoup de cibles potentielles à exploiter ? Ou bien n’est-ce pas en ces termes qu’il convient de poser la question ?
M. Patrick Calvar. Il nous reste toujours des cibles à traiter, mais j’insiste sur le fait que parmi les individus que nous surveillons, plus de mille sont intégrés dans des procédures judiciaires. Cette situation peut certes produire des télescopages. J’ai ainsi en tête une affaire où les responsables locaux nous poussaient à organiser une perquisition administrative à l’encontre d’un individu qui faisait l’objet d’une procédure judiciaire. L’autorité judiciaire s’est formellement opposée à cette mesure, considérant que l’affaire serait traitée dans le cadre judiciaire selon le rythme qui lui est propre.
M. le président Jean-Jacques Urvoas. Y a-t-il eu des erreurs de perquisition ?
M. Patrick Calvar. À ce jour, à ma connaissance, non.
M. le président Jean-Jacques Urvoas. Donc les portes que vous avez cassées…
M. Patrick Calvar. Nous n’avons pas cassé de portes puisque nous n’étions pas opérateurs.
M. le président Jean-Jacques Urvoas. Ceux qui devaient vous permettre d’atteindre les objectifs que vous souhaitiez traiter n’ont-ils jamais cassé des portes par erreur ?
M. Patrick Calvar. Pour l’instant, nous n’avons pas reçu de plaintes de la part des personnes que nous avions ciblées.
M. le président Jean-Jacques Urvoas. Plutôt que des personnes que vous aviez ciblées, je parlais de celles qui auraient été victimes d’une erreur.
M. Patrick Calvar. Nous n’avons pas eu à ce jour de plaintes.
M. le président Jean-Jacques Urvoas. Vous dites avoir demandé 503 perquisitions. Ont-elles toutes eu lieu dans des domiciles qui étaient bien ceux des cibles identifiées ? N’y-a-t-il eu aucune erreur ?
M. Patrick Calvar. Pas à ma connaissance.
M. Jean-Yves Guillard, sous-directeur de la sécurité intérieure. Des perquisitions peuvent être menées contre des objectifs dont la radicalisation est avérée. En fonction des éléments collectés, la perquisition est également un moyen de déterminer le degré de radicalisation.
M. le président Jean-Jacques Urvoas. Je reformule ma question : n’avez-vous jamais perquisitionné de domiciles en vous trompant d’adresse ?
M. Jean-Yves Guillard. Pas à ma connaissance.
M. Patrick Calvar. Pas à notre connaissance. En tout cas, pour l’instant, personne ne s’est plaint. Des pétitions ont été montées sur les réseaux sociaux, suggérant qu’il s’agissait d’agressions islamophobes, mais rien ne nous a été reproché concernant telle ou telle personne en particulier. Connaissez-vous un cas qui contredit ce que j’avance ?
M. le président Jean-Jacques Urvoas. Pas du tout, c’est une simple hypothèse.
Pour quelles raisons demandez-vous une assignation à résidence, lorsque vous optez pour cette mesure ?
M. Patrick Calvar. L’assignation permet d’entraver les activités des individus, leurs possibilités de déplacement et leur capacité de contacts. Beaucoup d’entre eux ne travaillent pas régulièrement, se déplacent facilement et entrent en contact avec d’autres ; l’assignation à résidence permet de les fixer. Deuxièmement, nous cherchons à déstabiliser la mouvance. Enfin, assigner à résidence les individus faisant partie d’un groupe les empêche de tenir les réunions conspiratives.
M. le président Jean-Jacques Urvoas. Le faites-vous parce qu’ils sont dangereux ?
M. Patrick Calvar. Non, si l’on a la certitude qu’ils sont dangereux, on entre dans la phase judiciaire, et notre objectif est de les faire incarcérer.
Mme Marie-Anne Chapdelaine. Vous avez évoqué le matériel informatique et les arborescences. En dehors de l’état d’urgence, disposez-vous des moyens juridiques pour perquisitionner ces matériels ? Maîtrisez-vous les techniques utilisées par ces individus ? Avez-vous le niveau de connaissance nécessaire pour aller chercher et décrypter l’information cachée ?
M. Patrick Calvar. Dans le cadre de l’état d’urgence, si la personne s’oppose à la perquisition, nous n’avons pas de pouvoir de coercition.
M. le président Jean-Jacques Urvoas. Sauf erreur de ma part, vous n’avez pas non plus la capacité juridique de contrôler l’identité de la personne. Normalement, vous la connaissez puisque vous l’avez surveillée, mais la loi ne permet pas au policier de demander à la personne perquisitionnée de prouver son identité. De la même manière, nous avons constaté que les perquisitions relatives à une même cible pouvaient se dérouler sur plusieurs lieux ; mais si l’individu refuse de se déplacer, vous n’avez pas la capacité de coercition pour l’y amener. Certes, il suffit de disposer de deux témoins pour que la perquisition soit légale, mais la personne ne peut pas être amenée sur les lieux de force.
M. Patrick Calvar. La loi sur le renseignement nous autorise à recourir à une série de techniques permettant d’attaquer un système informatique pour en extraire le contenu : flux entrant et sortant, mémoire… Mais le problème est de déterminer l’existence de ce moyen de communication ; si on le savait, les techniques de renseignement nous permettraient d’attaquer de façon discrète.
Quant au chiffrement, il représente la question majeure d’aujourd’hui et de demain. Avec les techniques actuelles, l’on peut émettre d’un endroit non localisable ; l’utilisateur n’est pas identifiable ; le contenu échangé n’est parfois pas déchiffrable. En tout état de cause, il nous faut l’aide des opérateurs. Les modes de chiffrement deviennent de plus en plus complexes ; ce débat concerne l’ensemble de la communauté internationale, y compris les très grands services – en particulier américains –, qui sont tous confrontés au même problème. Laissant de côté le contenu, on s’intéresse aujourd’hui aux métadonnées – dont vous avez débattu lors de l’examen de la loi sur le renseignement –, pour comprendre qui connaît qui et tenter de localiser les utilisateurs.
M. le président Jean-Jacques Urvoas. La loi ne permet pas de saisir le matériel informatique mais seulement de copier les données. Nous avons été alertés sur les conséquences peu satisfaisantes de ce dispositif : la copie des données allonge la durée de la perquisition ; elle permet de constater l’effacement de données mais ne permet pas de remonter au-delà alors que l’analyse du disque dur le permettrait. Ces critiques vous paraissent-elles fondées ?
M. Patrick Calvar. La première difficulté tient à la disponibilité des techniciens en mesure d’effectuer la copie. Tous nos sites ne possèdent pas des techniciens capables de faire ce travail. Il nous a donc fallu définir des priorités. Dans certains endroits, nous n’avons pas pu procéder à la copie.
Ensuite, avec l’extraction de données, une partie des informations nous échappe alors que l’étude de l’ordinateur pourrait nous les livrer. Mais, en matière administrative, ce n’est pas possible, y compris dans les techniques de renseignement. On peut examiner la mémoire, les flux entrants et sortants mais l’idéal est de pouvoir mettre la main sur l’appareil lui-même.
M. le président Jean-Jacques Urvoas. Quel est le statut juridique des données informatiques copiées ?
M. Patrick Calvar. Ces données existent le temps de leur exploitation, ensuite nous devons les détruire. Nous sommes engagés dans une course de vitesse au cours de laquelle nous devons, à partir de ces données, réussir à déceler si une infraction est constituée.
M. le président Jean-Jacques Urvoas. Une fois que vous l’avez exploitée, la donnée est détruite, n’est-ce pas ?
M. Patrick Calvar. Oui, sauf si elle est transmise à l’autorité judiciaire, considérant qu’une infraction est commise.
M. le président Jean-Jacques Urvoas. Vraiment ?
M. Patrick Calvar. Oui, bien sûr.
M. le président Jean-Jacques Urvoas. L’exploitation des données a-t-elle commencé ?
M. Patrick Calvar. Bien sûr, mais nous parlons de gigaoctets.
Mon service a interpellé plus de 300 personnes depuis que nous luttons contre les filières irako-syriennes. Les deux tiers sont mis en examen et la moitié est incarcérée. Nous récupérons à chaque fois des masses énormes de données. Les outils qui permettent d’analyser ces données coûtent cher. En outre, nous devons disposer des techniciens capables de lire les données et de les rendre intelligibles pour les enquêteurs. Nous devons donc surmonter deux problèmes : l’acquisition de matériel, d’une part, et la formation et la professionnalisation de nos effectifs, d’autre part.
Notre souci est d’établir une hiérarchie dans le choix des opérations, des perquisitions et des individus. Le renseignement en amont permet de préciser le profil des personnes qui sont dans notre collimateur.
M. le président Jean-Jacques Urvoas. En écho à la question de Mme Chapdelaine, il me semblait que le chiffrement s’appliquait principalement aux interceptions ?
M. Patrick Calvar. Vous chiffrez ce que vous voulez.
Les techniques sont très simples et connues : vous ouvrez un compte, vous le rendez anonyme, vous ne le localisez pas – certains logiciels permettent de s’en abstraire –, vous rédigez dans la partie « brouillons » un message que vous chiffrez, grâce à des logiciels en libre accès ; les complices non localisés – grâce à des systèmes simples comme Tor – entrent dans l’appareil, lisent le message et le suppriment. Si d’aventure on s’intéresse à ce compte, on ne saura pas où il se trouve mais on s’apercevra qu’il a été consulté, tout en ignorant par qui.
M. Sébastien Pietrasanta. Vous avez évoqué 536 objectifs ciblés. S’agissant de la chronologie des opérations, je suppose que la plupart de ces cibles ont été traitées dans les quarante-huit premières heures.
Tous les objectifs ont-ils été atteints ou une partie des personnes visées sont-elles entrées dans la clandestinité à la faveur de la médiatisation des opérations ?
M. Patrick Calvar. Nous avons traité 536 objectifs. Ce sont ceux qui ont fait l’objet de mesures.
M. Sébastien Pietrasanta. Par rapport à vos ambitions, existe-t-il un delta correspondant à ceux que vous n’avez pas réussi à attraper ?
M. Jean-Yves Guillard. Ce sont bien 536 objectifs qui ont fait l’objet de mesures.
M. Sébastien Pietrasanta. Je me suis sans doute mal exprimé. 536 objectifs ont été traités. Vos prévisions étaient-elles supérieures ? L’état d’urgence et le risque de perquisitions ont-ils fait fuir certaines personnes ?
M. Patrick Calvar. Nous n’avons pas raté de cible. Nous n’avons pas eu ce problème. L’état d’urgence nous permet d’aller voir directement au lieu de déployer des moyens de surveillance. Certaines personnes, qui étaient des clients lourds, savaient qu’elles allaient être traitées et nous attendaient. Pour ceux-là, nous n’avons peut-être pas eu le jackpot.
M. Sébastien Pietrasanta. Si je reformule, l’état d’urgence a été utile car il vous a permis d’économiser du temps, de l’énergie et des hommes en allant directement au fait. Mais, pour certains clients lourds, des éléments ont sans doute disparu.
M. Patrick Calvar. Pour nous, l’état d’urgence est un moyen direct de se faire une idée. Ensuite, chez certaines personnes, nous n’avons pas trouvé ce que nous aurions pu espérer car ils s’attendaient à notre venue. Enfin, – c’est un élément fort et un résultat –, certains ont compris qu’ils étaient toujours dans le collimateur. Comme ils sont un peu paranoïaques, ils sont persuadés, certains à juste raison, que c’était un avertissement et que nous continuons à être derrière eux.
M. Patrick Mennucci. Quelle appréciation portez-vous sur l’utilité des actions que vous avez menées dans les lieux de culte ?
M. Patrick Calvar. À ma connaissance, nous n’avons pas engagé d’actions dans les lieux de culte. Nous avons fait du ciblage individuel.
Mme Cécile Untermaier. Qui dit état d’urgence, dit rapidité et efficacité. Considérez-vous que le dispositif administratif que vous avez mis en place permet de répondre à ces exigences ? On m’a rapporté que les documents à remplir étaient chronophages pour le personnel qui préférerait être dans l’action plutôt que dans la charge administrative.
M. le président Jean-Jacques Urvoas. Nous portons notre part de ce surcroît d’activité administrative…
M. Patrick Calvar. Cela ne nous avait pas échappé. Point important, le dialogue qui a été instauré depuis un certain temps au niveau local, permet de donner très rapidement aux préfets les éléments pour prendre des décisions. Aujourd’hui, la charge administrative qui pèse sur les services peut être lourde, mais pas seulement en matière de renseignement – la procédure judiciaire très complexe alourdit singulièrement le travail des enquêteurs.
Parce que notre cœur de cible était relativement limité, qu’il s’agissait de personnes sur lesquelles nous avions déjà des éléments – nous pouvions faire des extractions immédiates de dossiers –, et dont nous avions déjà parlé avec les autorités préfectorales, la charge a été plus légère.
Nos structures départementales sont parfois très légères. Pour elles, il s’agit d’une charge supplémentaire. La centralisation contribue également à alourdir le travail administratif. Mais cette bureaucratie interne permet un contrôle de nos actions. J’ai donné des instructions afin que les fonctionnaires ne s’engagent pas de façon isolée dans des opérations que nous ne pourrions pas contrôler au plan central.
Mme Sandrine Mazetier. Quel est votre avis sur la durée nécessaire de l’état d’urgence ? Pendant combien de temps vous est-il utile ? Manifestement, ce temps est assez court.
Y a-t-il des choses que l’état d’urgence permet et qu’il conviendrait de généraliser hors de l’état d’urgence ?
M. le président Jean-Jacques Urvoas. Pour compléter sur la chronologie des perquisitions, vous en avez effectué beaucoup au début et moins aujourd’hui ?
M. Patrick Calvar. Pour être honnête, nous avons démarré assez lentement. Nous sommes montés en puissance au fur et à mesure. Dès lors que nous avons traité une grande partie de nos objectifs, nous sommes plutôt aujourd’hui sur une pente descendante.
Pour répondre à votre autre question, je n’entrerai pas dans la dimension politique. Je suis convaincu, d’après les informations dont je dispose, que la question qui se pose avec la menace terroriste n’est pas de savoir si mais quand et où. La décision a été prise par l’organisation de frapper. La menace reste aujourd’hui immédiate. Il existe également d’autres menaces d’autres natures, sans oublier ce qui s’est passé hier.
L’état d’urgence, et surtout les mesures qui vont être prises, vont nous permettre un certain nombre de choses. Il faut être très proactif – cela a été le cas avec l’état d’urgence. Il faut se dire que c’est un combat de longue haleine. Je pense que les armes que nous avons aujourd’hui sont bonnes.
M. Patrick Mennucci. Les jeunes participant à de telles opérations ont, semble-t-il, connu une dérive dans leur vie personnelle et trouvé en Daech un moyen d’exister. Parmi les équipes repérées, figurent également des trafiquants de drogue. Pouvez-vous préciser le profil de ces personnes afin de nous aider à comprendre qui elles sont ?
M. Patrick Calvar. Ceux qui ont agi ne l’ont pas fait sous l’emprise de la drogue, quel qu’ait été leur passé. Nous faisons face à des gens qui sont devenus des vrais soldats – Daech est une vraie armée – ils ont combattu, ils sont aguerris, ils font preuve d’une violence inouïe. Ils sont passés à l’action de manière très méthodique, avec beaucoup de sang-froid. On a parlé du captagon, de cocaïne mais eux n’étaient pas drogués. Ils mènent leurs actions en sachant qu’ils vont mourir. Ils n’ont pas peur de mourir. Cela fait leur grande dangerosité. Cette ampleur du phénomène et ce niveau de professionnalisme, morbide, nous ne les avons jamais connus.
D’où viennent-ils ? Pourquoi ont-ils franchi le pas ? Pourquoi sont-ils allés en Syrie ? Ce sont d’autres questions. Une me taraude : pourquoi une gamine de quinze ans bousille sa vie pour aller en Syrie ? Comment en est-on arrivé là ?
M. Patrick Mennucci. Pouvez-vous nous préciser ce qui s’est passé au Stade de France ?
M. Patrick Calvar. Je suis tenu par le secret de l’instruction. Mais, plusieurs choses n’ont pas fonctionné dans le scénario idéal. Il suffit de lire le communiqué – ce document est toujours préparé avant l’action – : il mentionne huit morts et le dix-huitième arrondissement. Le huitième mort, on peut penser qu’il s’agit de Salah Abedslam ; dans le dix-huitième, que s’est-il passé ? Il n’a pas voulu se faire exploser ? L’engin n’a pas marché ? Si un jour il est arrêté, il pourra donner des explications.
Ce sont des opérations militaires qui sont minutées et coordonnées. L’objectif était-il de pénétrer et de se faire exploser dans le stade ? C’est vraisemblable. Pourquoi n’ont-ils pas pu le faire ? Sont-ils arrivés en retard, un contrôle les en a-t-il empêchés ? Je retiens qu’ils n’ont pas hésité à se faire sauter. Comme dans toute opération, une partie a fonctionné, l’autre pas. Ce sont des questions auxquelles nous ne pourrons peut-être jamais apporter de réponse. Il faudrait arrêter les responsables et qu’ils parlent.
M. le président Jean-Jacques Urvoas. Monsieur le directeur général, je vous remercie pour votre précision et pour l’ensemble des éléments que vous avez pu nous communiquer.
——fpfp——
AUDITION DE M. JÉRÔME LÉONNET, DIRECTEUR CENTRAL ADJOINT CHARGÉ DU RENSEIGNEMENT, CHEF DU SERVICE CENTRAL DU RENSEIGNEMENT TERRITORIAL AU MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
Compte rendu de l’audition, non ouverte à la presse, du vendredi 8 janvier 2016
M. le président Jean-Jacques Urvoas. Monsieur le directeur général, je vous remercie d’avoir accepté de venir devant la commission des Lois dans une configuration particulière puisque celle-ci a décidé de travailler sous le régime du huis clos lors de ses auditions – il n’y aura pas de vidéo et le compte rendu publié à l’issue de nos travaux ne sera pas nécessairement exhaustif – et qu’elle s’est dotée des pouvoirs d’une commission d’enquête.
C’est la raison pour laquelle vous devez prêter serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité.
(M. Jérôme Léonnet prête serment.)
Lors des déplacements que nous avons effectués, au cours desquels nous avons rencontré vos collaborateurs, des préfets et la DGSI, nous avons été impressionnés par l'engagement des personnels mobilisés dans l’état d’urgence au point de noter une fatigue certaine, qui fait craindre un burn-out sur la durée, tant les exigences en termes de présence et d’investigation sont fortes. Si vous en avez l’occasion, faites-leur part de la gratitude de la Commission, et remerciez les pour leur grande disponibilité et la fiabilité des informations qu’ils nous ont transmises.
Votre service est probablement celui qui travaille le plus dans le cadre de l’état d’urgence, tant sur le plan qualitatif que quantitatif, sans pour autant être celui qui dispose des moyens les plus conséquents. C’est en effet vous qui devez suivre le plus grand nombre d’individus.
M. Jérôme Léonnet, directeur central adjoint chargé du renseignement, chef du service central du renseignement territorial (SCRT). Vos propos me vont droit au cœur. J’ai eu l’occasion de dire ma reconnaissance aux responsables locaux du renseignement territorial, qui, dans 60 % des cas, sont des officiers. Nous avons toujours pu échanger à toute heure du jour et de la nuit, y compris le week-end. Ils ont fait preuve d’une motivation totale. Le travail au niveau central n’en a été que facilité. Je vous remercie et je ne manquerai pas de leur transmettre votre coup de chapeau.
Le service central du renseignement territorial (SCRT) présente la particularité d’être à la fois un service central et un service territorial : 150 fonctionnaires travaillent à Paris à l’analyse et à la synthèse des informations remontant des territoires. Mais l’essentiel des forces – 2 250 – sont réparties dans les territoires.
Ce service entretient un lien organique très fort avec la sécurité publique. Les effectifs du renseignement territorial sont en effet placés sous la responsabilité directe des directeurs départementaux de la sécurité publique (DDSP). En tant que chef du SCRT, je ne suis qu’un animateur, un pilote. Mon positionnement en tant que directeur-adjoint de la sécurité publique en charge du renseignement rend facile ce travail de pilotage au quotidien.
L’objectif poursuivi depuis la création du SCRT est de doter la sécurité publique d’une filière de renseignement, ce qui a constitué un atout évident pour les mesures de l’état d’urgence. La proximité entre le renseignement territorial et la sécurité publique, mais aussi son autre tuteur sur le terrain, la gendarmerie nationale – le SCRT compte en son sein 200 gendarmes –, a été un élément important.
Je reviens sur la chronologie de nos instructions.
J’ai abordé d’emblée les mesures de l’état d’urgence avec le directeur central de la sécurité publique. Dès le 15 novembre, avec Pascal Lalle, nous avons organisé une visioconférence avec les coordinateurs zonaux de sécurité publique, accompagnés des responsables locaux du renseignement territorial. Nous avons précisé les méthodes de travail et développé l’idée selon laquelle les objectifs de ces mesures liées à l’état d’urgence devaient s’appuyer sur notre travail dans le domaine de la prévention de la radicalisation ainsi que dans le domaine de la lutte contre l’économie souterraine et la criminalité organisée.
Le travail sur la prévention de la radicalisation est devenu une réalité très importante au quotidien pour le renseignement territorial : lors de ma prise de fonctions en septembre 2014, le renseignement territorial, toutes composantes confondues, suivait une petite centaine d’individus radicalisés. À l’heure où je vous parle, 2 371 individus sont suivis selon des modalités diverses, mais le renseignement territorial en demeure le chef de file. Environ 350 d’entre eux méritent un suivi plus attentif.
La première instruction que j’ai donnée aux responsables zonaux, à charge pour eux de transmettre aux responsables départementaux, était de cibler, pour les perquisitions ou les assignations à résidence dans le cadre de l’état d’urgence, les individus les plus signalés parmi les radicalisés. Ces individus sont distingués eu égard à leurs antécédents psychiatriques, leur passage en prison, leur passé délinquant, leurs liens avec la délinquance, ou des manifestations d’agressivité dans leur milieu familial ou professionnel. La consigne a été donnée de commencer par ces 350 individus particulièrement signalés. Cette évidence a été régulièrement rappelée.
Au-delà des individus signalés, les mesures de l’état d’urgence, en particulier les perquisitions administratives, devaient également nous permettre d’aller plus loin dans le suivi de certains dossiers pour lesquels notre connaissance était insuffisante pour demander des mesures judiciaires. C’est la particularité à laquelle un service de renseignement dépourvu de compétence judiciaire est confronté. Pour les 2 371 cas, nous devons déterminer s’il importe de creuser, s’il est possible de trouver des éléments pouvant conduire à un débouché judiciaire. Les mesures de l’état d’urgence nous ont permis, pour un certain nombre de cas, de répondre à ces questions que nous nous posons au quotidien.
Une deuxième visioconférence a été organisée le 20 novembre, avec le directeur central et l’ensemble des responsables zonaux.
Le 16 novembre, j’ai adressé à mes interlocuteurs zonaux l’instruction de commandement de la sécurité publique sur le déroulement des perquisitions administratives.
L’état d’urgence a donné la possibilité au renseignement territorial de s’intéresser à des individus qui nous préoccupaient dans la perspective de la COP21. Nous disposions d’éléments précis montrant une volonté de manifestation, y compris violente, de la part de certains individus. Or la gestion de ces manifestations et des troubles auxquels elles pourraient donner lieu risquait d’être pénalisante pour les services de police déjà confrontés à la prise en compte de la menace terroriste.
Nous avons donc posé la question suivante au service juridique : est-il possible d’utiliser les mesures de l’état d’urgence pour certains cas, particulièrement évidents pour nous, d’individus potentiellement dangereux et violents ? Il nous a été répondu positivement. Le chef de la division compétente a écrit à deux reprises aux responsables départementaux pour leur demander de faire remonter les profils individuels paraissant les plus dangereux. Plusieurs dizaines de notices individuelles ont été passées au tamis. Au terme de cet examen, le renseignement territorial a proposé une trentaine de mesures d’assignation à résidence. Vingt-quatre mesures ont été retenues, huit ont été notifiées. Pourquoi ce delta entre les mesures signées et les notifications ? Parce que, dans bien des cas, les individus visés vivant dans des squats, leur localisation n’a été rendue possible in fine, faute d’éléments d’adresse fiables. Dans le cadre de la COP21, les arrêtés d’assignation à résidence ont été limités à ces huit cas notifiés. Parmi eux, quatre personnes ont fait l’objet de perquisitions administratives.
Les instructions sur la COP21 ont été données par le chef de la division compétente. Le 17 novembre, il était précisé : « Dans le cadre de la mise en place par le SCRT du dispositif dédié à la COP21, il vous est demandé, chacun en ce qui vous concerne, de faire remonter les informations relatives aux profils individuels de militants de la mouvance d’ultragauche susceptibles de perpétrer des actions violentes sur la voie publique. Il conviendra pour chacune des personnes citées de fournir des éléments d’identité précis et de domiciliation, ainsi que les éléments objectifs de vos services pouvant motiver une prise en compte de ces individus dans le cadre des mesures de l’état d’urgence ». Le lendemain, le 18 novembre, nous écrivions : « en complément du courriel qui vous a été envoyé hier dans le cadre de la mise en œuvre de possibles mesures administratives de type assignation à résidence, il convient dans les meilleurs délais pour chacun des individus d’apporter des précisions – éléments d’état civil et antécédents ».
L’utilisation des mesures de l’état d’urgence dans le cadre de la COP21 n’est pas une évidence. Cette question, que vous vous posez également je le sais, s’est posée d’emblée à nous. Notre réponse a consisté à limiter au maximum les mesures. Je le redis, vingt-quatre dossiers ont été retenus et huit mesures notifiées.
M. le président Jean-Jacques Urvoas. Loïc Garnier, chef de l’Unité de coordination de la lutte anti-terroriste (UCLAT), nous a indiqué le chiffre de vingt-sept assignations signées et dix notifiées.
M. Jérôme Léonnet. Ces chiffres sont probablement plus à jour que les miens.
Le 19 novembre, j’ai adressé un message aux responsables locaux du renseignement territorial et à tous les DDSP pour attirer leur attention sur la présence lors des perquisitions de fonctionnaires du renseignement territorial, qui ont très souvent été à l’origine de ces mesures. Dans un souci de protection de l’identité des personnels, j’ai demandé que ces derniers soient laissés en dehors des manœuvres de perquisition, sauf volonté contraire de leur part. Sur le terrain, l’application de cette instruction a été laissée à l’appréciation souveraine au cas par cas du responsable du renseignement territorial. Il s’avère que des fonctionnaires ont participé aux perquisitions, mais de nombreux autres ne l’ont pas fait. Je tenais, en tant que chef de service, à ce que la notion de protection soit rappelée à chacun.
Ensuite, le 26 novembre, j’ai transmis à tous les chefs des renseignements territoriaux deux notes de la direction des libertés publiques et des affaires juridiques (DLPAJ) qui sont des foires aux questions sur les perquisitions et les mesures d’assignation à résidence, afin de clarifier les choses.
Enfin, le 8 décembre, j’ai envoyé à mes interlocuteurs sur le terrain une instruction qui a fuité dans la presse – dans un article de Libération, si mes souvenirs sont bons – et qui a été datée à tort du 30 novembre par les journalistes. J’y explique qu’au 8 décembre, les objectifs RT s’amenuisent, forcément. Je demande donc à mes interlocuteurs d’être aussi rigoureux et précis que possible dans le ciblage de leurs propositions. Je rappelle dans cette instruction qu’on n’attend pas de leur part que chaque perquisition administrative donne lieu à la découverte d’armes ou de stupéfiants mais que le ciblage d’une perquisition se fonde sur des éléments objectifs. Les coordonnateurs zonaux de sécurité publique figurant parmi les destinataires du message, j’en ai profité pour leur rappeler la rigueur et la déontologie dont on ne doit pas se départir au moment où l’on procède à une perquisition administrative. Ce n’est pas là un aspect « RT » en tant que tel : je l’ai indiqué sous ma casquette de directeur central adjoint après en avoir parlé avec Pascal Lalle qui avait lui-même donné des instructions en ce sens à plusieurs reprises.
Voilà la chronologie des instructions données. Je vais à présent en dresser un bilan. Encore une fois, vous me pardonnerez si jamais les chiffres que je m’apprête à citer, qui sont ceux que j’ai collationnés, ne sont pas parfaitement en phase avec ceux de l’UCLAT.
Au total, le renseignement territorial a été à l’origine de 1 149 perquisitions administratives réalisées sur des individus et de quarante et une perquisitions effectuées dans des lieux de culte ou salles de prière – cela, dans le domaine de la prévention de la radicalisation. Ce chiffre de 1 149 est à rapprocher du nombre total des perquisitions auxquelles la sécurité publique a pu procéder dans son domaine de compétence, y compris dans les quatre départements de grande couronne, qui est de 1 680.
Quant au résultat de ces perquisitions, je ne prétends pas être exhaustif dans la mesure où les suites judiciaires peuvent parfois nous échapper mais dans l’immédiat, on recense trente-neuf placements en garde à vue, vingt-trois kilogrammes de stupéfiants découverts ainsi que des armes, et plusieurs centaines de milliers d’euros. Encore une fois, les perquisitions administratives, dans le domaine de compétence du renseignement territorial, n’avaient pas, selon nous, pour effet attendu la découverte d’armes, d’explosifs, de stupéfiants ou de numéraires en liquide. Il faut garder à l’esprit le fait que le renseignement territorial s’occupe des individus dits « bas-moyen spectre ». Certains des individus dont j’ai parlé répondent à des critères de radicalisation légers : eux n’ont pas fait l’objet de mesures. Nous avons ciblé les 1 149 perquisitions parmi les 2 371 individus qui nous ont paru les plus intéressants. Mais nous n’avons bien évidemment pas trouvé, lors de ces perquisitions, d’éléments comparables à ceux que l’on aurait pu trouver chez des radicalisés d’un autre calibre. Pour autant, nous avons parfois retrouvé des armes, des stupéfiants et du numéraire.
Au titre des mesures de l’état d’urgence, toujours dans le domaine de la radicalisation, nous avons transmis 124 demandes d’assignation à résidence. Selon les informations qui m’ont été fournies, quatre-vingt-douze arrêtés ont été signés et soixante-huit, notifiés. Là encore, la différence s’explique essentiellement par des difficultés de domiciliation.
Voilà les éléments de bilan que je pouvais vous livrer. Je suis à votre disposition pour répondre aux questions plus précises que vous voudrez me poser.
M. le président Jean-Jacques Urvoas. Je vous remercie, monsieur l’inspecteur général. Pourriez-vous nous transmettre les différentes notes que vous avez évoquées ? Nous ne les avons pas toutes en notre possession, notamment celle qui a été mentionnée dans Libération le 22 décembre et dont nous apprenons qu’elle est datée du 8 décembre et non pas du 30 novembre, comme l’a indiqué ce quotidien .
M. Jérôme Léonnet. Elle date du 8 décembre à 8h28.
M. le président Jean-Jacques Urvoas. Je commencerai paradoxalement par aborder un sujet que vous n’avez pas encore évoqué et dont on n’a pas parlé depuis le début de la matinée : les interdictions de manifestation. Je rappelle que cette mesure peut être prise dans le cadre de l’état d’urgence mais que c’est aussi une mesure de police dont les préfets peuvent parfaitement user en dehors de ce cadre. Le préfet du département du Rhône a pris un arrêté interdisant une manifestation de soutien aux migrants qui était prévue le 21 novembre. Lorsque nous nous sommes rendus à Lyon, il nous a été dit que la manifestation avait été interdite sur le fondement d’informations transmises par le RT, car elle était susceptible d’être perturbée par une contre-manifestation, et donc de mobiliser une énergie supplémentaire à celle qui était habituellement requise dans ce cas-là. Or cette manifestation était la quatrième du genre au cours du trimestre. Pourriez-vous nous dire – maintenant ou ultérieurement, car peut-être n’avez-vous pas les éléments factuels qui vous permettront d’éclairer la réponse – pourquoi cette manifestation-là présentait une difficulté au point d’être interdite, alors que les trois précédentes s’étaient tenues exactement dans les mêmes conditions, avaient été appelées par le même collectif d’organisations et s’étaient déroulées sans aucune interpellation ni aucune mobilisation des forces de sécurité publique ? Le préfet n’a pas été capable de me répondre quoi que ce soit, si ce n’est qu’une note que vous lui avez transmise a fondé sa décision.
M. Jérôme Léonnet. Une note du RT lyonnais ?
M. le président Jean-Jacques Urvoas. Oui.
M. Jérôme Léonnet. Je n’ai pas d’élément précis me permettant de répondre à cette question. Mais il est vrai qu’il y a régulièrement à Lyon, lors des manifestations sur ce thème, des incidents, parfois graves. J’ai en mémoire des manifestations ayant eu lieu à la fin de l’année 2014 sur la thématique « post-Sivens » au cours desquelles un officier du RT s’était fait casser la figure en marge du cortège. Il y a à Lyon à la fois des militants de l’ultra-gauche, capables de mailler le cortège d’une manifestation en faveur des migrants, et une mouvance d’ultra-droite importante, particulièrement décomplexée et qui n’hésitera pas ou pourrait ne pas hésiter à faire le coup de poing. C’est le seul élément d’explication générale que je puisse vous donner. Je vous propose de vous transmettre la note en question.
M. le président Jean-Jacques Urvoas. Volontiers car les éléments que vous nous donnez ont effectivement été évoqués mais ils valent également pour les trois précédentes manifestations.
Venons-en aux assignations à résidence qui ont été décidées dans le cadre de la COP21. Vous avez très logiquement exprimé vos interrogations à cet égard : nous avons les mêmes. Le législateur a en effet voté la prolongation de l’état d’urgence convaincu de donner ainsi aux forces de sécurité les moyens exorbitants du droit commun pour lutter contre le terrorisme mais des assignations à résidence ont été décidées en raison de la tenue de la COP21. Or cette dernière n’a pas été décidée courant novembre : elle a été largement préparée et anticipée. L’État avait nécessairement prévu d’organiser la mobilisation des forces de police – notamment des unités de forces mobiles. Néanmoins, il a utilisé ce pouvoir particulier conféré par l’état d’urgence pour assigner à résidence. Vous avez présenté votre réflexion et le Conseil d’État a eu l’occasion d’exprimer la sienne dans un arrêt rendu en assemblée plénière. J’aimerais que vous nous disiez si les désordres que vous aviez anticipés étaient particuliers, par leur nature ou par leur ampleur, par exemple au regard de ce que l’on peut déjà prévoir pour l’Euro, en juin 2016. On sait en effet que certains spectateurs de matchs de football peuvent être à l’origine de débordements. Le contexte était-il particulier ? En quoi était-il modifié pendant l’état d’urgence ? Sachant que vous auriez de toute façon mobilisé des forces mobiles, pourquoi avoir également pris des arrêtés d’assignation ?
M. Jérôme Léonnet. L’analyse qu’a faite le RT de la COP21 s’est nourrie d’une expérience nationale : celle de la montée en puissance de la mouvance ultra-gauche sur le thème des zones à défendre (ZAD) depuis la fin de l’année 2014 mais également de celle d’une mouvance ultra-gauche européenne lors de l’exposition universelle de Milan et de l’inauguration du siège de la Banque centrale européenne à Francfort. Lors de ces deux événements, on a vu toute une mouvance ultra-gauche de type Black Bloc commettre des violences caractérisées sur la voie publique, sur un mode qui a surpris les polices italienne et allemande. La photo, à la une de Libération montrait, à Milan, une rangée de militants Black Bloc en combinaison noire avec un bâton dans la main, qui donnait terriblement l’impression d’avoir affaire à une rangée de forces mobiles à la manœuvre.
À la suite des échanges que nous avons pu avoir avec nos homologues italiens et allemands, nous avions prévu que la COP21 serait pour ces militants l’occasion de venir sur le territoire et de participer au moins aux deux manifestations les plus importantes qui étaient prévues, à l’ouverture et à la fermeture de la conférence. Nous avons obtenu des éléments, y compris chiffrés. Pour ne rien vous cacher, dans le cadre de l’état d’urgence, la première des mesures que j’ai proposée et qui a été actée, consistait en l’établissement de fiches d’interdiction du territoire pour 480 militants étrangers susceptibles de venir commettre des violences en France. Si nous avons pu déterminer leur identité, c’est que nos partenaires allemands, italiens, belges et anglais nous les avaient communiquées. Nous avons constaté que quand des militants européens se trouvent sur un territoire qui n’est pas le leur, ils sont encore plus décomplexés. À Milan, quelques dizaines de Français ont ainsi commis des violences au-delà de celles qu’ils auraient commises sur notre territoire parce qu’ils pensaient être totalement dans l’anonymat. Or ils ont été interpellés.
C’est pourquoi, au-delà des mesures d’interdiction du territoire qui ont pu être demandées pendant le temps de la COP21 et auxquelles il a été mis fin depuis, il nous a également paru nécessaire d’appliquer des dispositions de l’état d’urgence à ceux des militants qui nous paraissaient susceptibles de commettre des violences, sachant qu’il nous avait été indiqué que cela était juridiquement possible. Si tel n’avait été le cas, nous n’aurions pas pu le faire. S’agissant des ressortissants étrangers, les mesures d’interdiction du territoire peuvent être prises à droit constant. Mais pour les militants français, nous aurions été contraints de surveiller chacun d’entre eux – notamment à Rennes. Cette surveillance n’aurait pas été du même ordre que celle que l’on peut instituer dans des domaines tels que la prévention de la radicalisation. Cela a aussi permis au RT de préserver sa capacité à prendre en compte le problème de la radicalisation. Si je le souligne, c’est qu’aujourd’hui, la moitié de notre potentiel d’interceptions de sécurité et plus de la moitié de nos ressources humaines sont entièrement consacrées à la prévention de la radicalisation : alors qu’en septembre 2014, la radicalisation occupait 5 à 10 % de notre potentiel, le pourcentage est désormais de l’ordre de 40 %. C’est dire si nous avions intérêt à préserver ce potentiel.
M. le président Jean-Jacques Urvoas. Les 1 149 perquisitions administratives que vous avez mentionnées ne concernent-elles que la radicalisation ?
M. Jérôme Léonnet. Oui.
M. le président Jean-Jacques Urvoas. Avez-vous procédé à d’autres perquisitions administratives pour lutter contre l’économie souterraine dans le cadre de l’état d’urgence ?
M. Jérôme Léonnet. Oui. Dans les orientations que nous avons pu donner à la sécurité publique avec Pascal Lalle, il était clairement et nettement précisé que le RT était chef de file s’agissant de la radicalisation, tandis que c’était la sûreté départementale pour tout ce qui concernait l’économie souterraine – même lorsque le repérage initial revenait au RT, ce qui est souvent le cas.
M. le président Jean-Jacques Urvoas. Les chiffres que vous nous avez fournis en matière d’assignation à résidence ne concernent-ils donc eux aussi que la radicalisation ?
M. Jérôme Léonnet. Tout à fait.
M. le président Jean-Jacques Urvoas. Par conséquent, si d’autres assignations à résidence sont demandées par la police nationale, la sécurité publique ou la police aux frontières (PAF), elles viennent s’ajouter à ces chiffres.
M. Jérôme Léonnet. Oui.
Mme Sandrine Mazetier. Vous avez rapidement donné des instructions liées à la COP21 concernant l’ultra-gauche : en avez-vous fait autant concernant l’ultra-droite ? Je pense par exemple à l’agression d’un de nos concitoyens en marge d’une manifestation identitaire à Pontivy en Bretagne. On pouvait prévoir des réactions de violence sachant qu’à Lyon, un jeune homme venant rendre hommage aux victimes s’est fait agresser. Le service central du renseignement territorial (SCRT) a-t-il procédé à des demandes de surveillance d’éventuels appels aux agressions en provenance des mouvements identitaires – notamment sur les réseaux sociaux ?
M. Jérôme Léonnet. La surveillance de l’ultra-droite est pour nous une donne quotidienne. La division du SCRT qui a piloté la mission sur la COP21 est aussi celle qui travaille sur l’ultra-droite Il se trouve que géographiquement, les personnels travaillant sur l’ultra-droite se trouvent dans le bureau attenant à celui des personnels se consacrant à l’ultra-gauche et que nous avons travaillé ensemble au quotidien.
Les incidents ayant eu lieu à Pontivy et ailleurs n’ont pas donné lieu, à mon niveau, à des instructions écrites du chef de la division mais j’ai le souvenir précis d’avoir téléphoné à plusieurs chefs RT – aux services zonaux en Bretagne, aux deux chefs de service départemental de renseignement territorial (SDRT) concernés et à Lyon – non seulement pour essayer de faire remonter un maximum d’informations mais aussi pour leur demander d’être très attentifs. Lyon est typiquement la ville dans laquelle le risque de frictions entre identitaires et ultra-gauche est évident. Et les identitaires ont, depuis plusieurs années maintenant, un comportement totalement décomplexé. Ce qui s’est passé à Pontivy était scandaleux, j’ai donc demandé au chef du renseignement territorial de me fournir un maximum d’informations et de les transmettre également aux services saisis de l’enquête. Cela ne faisait pas partie en tant que tel de l’instruction générique mais du travail de pilotage que l’on fait quotidiennement et qui conduit votre serviteur et ses adjoints à passer une grande partie de leurs journées à échanger avec les départements, à la fois pour assurer un suivi des dossiers en cours et pour donner des instructions au fil de l’eau.
Mme Sandrine Mazetier. Êtes-vous à l’origine d’une demande d’interdiction de manifestation s’agissant de l’ultra-droite ?
M. Jérôme Léonnet. Non. Le RT – même dans le cas exposé par le président Urvoas – apporte des éléments de contexte mais ne demande pas l’interdiction d’une manifestation. Depuis trente ans que je fais ce métier, il m’est arrivé, dans le ressort parisien, d’alerter sur le fait que nous n’aurions pas les moyens d’assurer l’ordre public – charge au préfet de police d’en déduire qu’il fallait interdire certaines manifestations, ce qu’il n’a fait que dans des cas rarissimes. En revanche, je n’ai pas le souvenir d’avoir jamais pris ma plume pour demander une interdiction. Cette notion répond à un raisonnement juridique qui prend en compte non seulement le risque de trouble à l’ordre public mais surtout l’incapacité à le gérer – ce qui ne relève pas du RT.
M. le président Jean-Jacques Urvoas. Concernant les assignations à résidence, vous nous avez indiqué avoir dans votre spectre 2 371 individus dont 350 qui nécessitaient un suivi particulièrement attentif : ces 350 sont-ils ce que le service du renseignement territorial appelle les « INSA », individus nécessitant un suivi attentif – équivalent des détenus particulièrement surveillés dans l’administration pénitentiaire ?
M. Jérôme Léonnet. Oui.
M. le président Jean-Jacques Urvoas. Ces 350 INSA ont-ils tous fait l’objet d’une perquisition administrative ?
M. Jérôme Léonnet. Je ne puis vous le certifier. C’est ce que nous avons demandé mais, pour être franc, le service central est en train de recenser toutes les actions qui ont été menées. Je dispose pour cela d’une liste d’actions qu’il nous faut croiser avec celle des INSA qui – difficulté supplémentaire – évolue toutes les semaines : certains dossiers d’INSA redeviennent des dossiers normaux, tandis que d’autres passent à la direction générale de la sécurité intérieure (DGSI).
M. le président Jean-Jacques Urvoas. Qu’en est-il des individus qualifiés de « VIPS » (vigilance individus particulièrement signalés) ?
M. Jérôme Léonnet. Cette catégorie, que nous avons laissée aux oubliettes au cours de l’année 2015, regroupait, depuis septembre 2014, des individus que la DGSI nous demandait de prendre en compte, considérant qu’ils ne présentaient plus une dangerosité telle qu’il lui faille continuer d’en assurer le suivi. C’est la naissance de notre travail sur la radicalisation. Aujourd’hui, la catégorie n’a plus lieu d’être car nous avons beaucoup plus de profils. Pour répondre à votre question, je pense que l’ensemble des INSA que nous suivions au début de l’état d’urgence ont fait l’objet de perquisitions administratives mais je ne puis vous le garantir car je n’ai pas de statistiques. La première instruction que nous ayons donnée aux services zonaux du renseignement territorial le 15 novembre fut que la priorité des priorités était les INSA.
M. le président Jean-Jacques Urvoas. Les assignés à résidence ont-ils tous fait l’objet d’une perquisition administrative ?
M. Jérôme Léonnet. C’est ce que nous avons demandé. Et, a priori, oui.
M. le président Jean-Jacques Urvoas. Est-ce la DLPAJ qui vous a indiqué qu’il était juridiquement possible d’assigner certains individus à résidence dans le cadre de la COP21 sur le fondement de l’état d’urgence ?
M. Jérôme Léonnet. Oui, tout à fait. L’échange avec ce service a été quotidien. C’est à lui que nous adressions nos questions et c’est lui qui nous a transmis les deux fameuses notes de foire aux questions que j’ai tout de suite fait suivre parce qu’elles apportaient des éléments intéressants.
M. le président Jean-Jacques Urvoas. Nous avons prévu de convoquer Thomas Andrieu qui est directeur des libertés publiques au ministère de l’intérieur.
Toujours s’agissant des assignations à résidence, nous avons pris connaissance de cas de personnes assignées à résidence à l’initiative de votre service et qui ont vu leur assignation levée sans décision judiciaire : avez-vous une idée du nombre de personnes concernées ?
M. Jérôme Léonnet. Dans le domaine de la radicalisation, sur les soixante-huit arrêtés notifiés, cinquante-huit sont encore en vigueur au moment où je vous parle.
M. le président Jean-Jacques Urvoas. Pour être précis, il semblerait que, dans un cas dans l’Hérault, l’assignation ait été levée, à la surprise de votre service local.
M. Jérôme Léonnet. Et à ma propre surprise.
M. le président Jean-Jacques Urvoas. Vous n’étiez donc pas à l’origine de la demande.
M. Jérôme Léonnet. Non. Le tribunal administratif avait donné raison à l’administration. Et pour nous, il continuait d’être indispensable d’assigner cette personne à résidence. Nous avons appris que la mesure avait été levée, sans être à l’origine de cette décision. Mais je préférerais que vous posiez la question à la DLPAJ, qui a peut être craint que le Conseil d’État, qui était saisi, ne fasse droit au recours de l’imam.
M. le président Jean-Jacques Urvoas. Inversement, dans un autre département, nous avons découvert que la centrale – c’est-à-dire vous – avait demandé l’assignation à résidence d’un homme dans un objectif qui ne semblait pas pertinent au renseignement local. Et l’assignation a été levée deux ou trois semaines plus tard.
M. Jérôme Léonnet. C’est un cas que j’ai suivi en direct. Je présenterai les choses autrement. La centrale n’a pris aucune décision d’initiative. La division compétente a demandé à tous les départements de faire remonter leurs propositions d’assignation à résidence. Et dans le lot de ces propositions, sur lesquelles il y a eu un échange entre la division et Toulouse, figurait cette personne, qui a été suivie jusqu’à l’été 2015 par la direction générale de la sécurité intérieure (DGSI) parce qu’un élément de téléphonie chez lui ramenait au réseau terroriste Forsane Alizza. Le RT de Toulouse, ayant récupéré ce dossier en septembre ou en octobre, en a tout de suite conclu qu’il n’y avait pas motif à radicalisation. Pourtant, ce monsieur a fait l’objet d’une assignation à résidence. J’ai le souvenir d’avoir dit, après avoir eu cet élément d’information, qu’il fallait lever immédiatement cette mesure parce qu’elle n’était pas justifiée.
M. le président Jean-Jacques Urvoas. Qui a décidé de cette assignation ?
M. Jérôme Léonnet. Concrètement, la proposition a été formulée par le service central du RT sur la foi d’éléments transmis par le terrain. C’est clairement une erreur. Nous nous sommes fondés sur un dossier qui pouvait être lourd mais qui ne nous semblait pas relever de la radicalisation. Pourtant, nous avons formulé cette proposition injustifiée. Et encore une fois, ma réaction immédiate a été de dire qu’il fallait mettre fin immédiatement à cette mesure.
M. le président Jean-Jacques Urvoas. Sur les 1 149 perquisitions organisées, des erreurs de domicile ou d’appréciation de renseignements ont-elles été commises ? Si un certain nombre de notifications d’assignation à résidence n’ont pu être prononcées en raison d’une difficulté à localiser certains individus, vous êtes-vous a contrario trompé d’adresse à certains endroits ?
M. Jérôme Léonnet. Nous avons, dans certains cas, eu beaucoup de mal à récupérer des éléments d’adresse. Quant à savoir si le RT a pu se tromper d’adresse, je n’ai pas d’éléments sur ce point.
M. le président Jean-Jacques Urvoas. Nous avons souvent constaté que vos responsables locaux s’appuyaient sur les moyens techniques de la police judiciaire pour l’exploitation des données informatiques. Est-ce parce que le RT n’est pas suffisamment équipé en ce domaine ?
M. Jérôme Léonnet. Tout à fait. En matière de veille sur internet, le RT dispose de moyens dits du milieu ouvert : avec notre ligne ADSL, nous faisons un travail de surveillance sur les réseaux sociaux et les profils Facebook ou Twitter ouverts. Nous ne disposons pas de moyens nous permettant de faire une extraction informatique digne de ce nom. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle, dans le cadre des mesures que le législateur nous a accordées au titre du deuxième cercle dans le cadre de la loi sur le renseignement, nous allons mutualiser des moyens avec la police judiciaire pour mener certaines opérations.
M. le président Jean-Jacques Urvoas. En matière d’exploitation des données, des responsables de la police judiciaire nous ont indiqué avoir affecté leurs officiers Ntech.
M. Jérôme Léonnet. Il s’agit d’officiers brevetés IC, qui sont en général des policiers de sûreté départementale.
M. le président Jean-Jacques Urvoas. Ce sont eux qui exploitent les données copiées ou celles-ci remontent-elles à un plus haut niveau ?
M. Jérôme Léonnet. Il est possible que la division nationale de recherche et d’appui ou les sections zonales de recherche et d’appui aient parfois donné un coup de main. Mais aucun des éléments d’exploitation ne remonte à la centrale : tout est fait localement.
M. le président Jean-Jacques Urvoas. Monsieur l’inspecteur général, nous vous remercions pour votre disponibilité et la précision de vos réponses. N’oubliez pas de nous adresser les documents que vous avez évoqués – notes et éléments de contexte sur Lyon.
M. Jérôme Léonnet. Tout à fait. Je vous remercie encore une fois pour vos propos à l’égard des personnels du RT et pour votre écoute.
——fpfp——
AUDITION DE MME MIREILLE BALLESTRAZZI, DIRECTRICE CENTRALE DE LA POLICE JUDICIAIRE AU MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
Compte rendu de l’audition, non ouverte à la presse, du vendredi 8 janvier 2016
M. le président Jean-Jacques Urvoas. Madame la directrice centrale de la police judiciaire, notre réunion se déroule à huis clos, n’est pas retransmise en direct et le compte rendu à laquelle votre audition donne lieu sera publié, en tout ou partie, à la fin de nos travaux. Notre commission s’étant dotée, pour contrôler les mesures prises par le Gouvernement dans le cadre de l’état d’urgence, des pouvoirs d’une commission d’enquête, je dois vous demander de prêter le serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité.
(Mme Mireille Ballestrazzi prête serment.)
Nous souhaitons aller au cœur de l’état d’urgence. C’est donc sur ce sujet que nous vous interrogerons, après avoir écouté votre exposé préalable.
Mme Mireille Ballestrazzi, directrice centrale de la police judiciaire au ministère de l’Intérieur. La Direction centrale de la police judiciaire (DCPJ) est engagée dans la lutte contre toutes les formes de terrorisme, que celui-ci trouve son inspiration dans une idéologie séparatiste, une foi religieuse dévoyée ou des convictions politiques extrêmes. Chaque fois qu’un attentat est commis, les femmes et les hommes qui composent la DCPJ sont donc en première ligne pour enquêter, sous la direction des magistrats spécialisés du tribunal de grande instance de Paris — depuis un an, la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI) est systématiquement co-saisie, sauf lorsque nous travaillons sur notre initiative. Tel a été le cas lors des attaques perpétrées dans les locaux de Charlie Hebdo et de l’Hyper Casher, il y a un an, après le projet avorté du Thalys, en août 2015, et, bien entendu, après les attentats du 13 novembre dernier.
Néanmoins, l’action de la DCPJ contre le terrorisme ne se résume pas au travail d’enquête colossal mené après la commission d’attentats. Elle s’inscrit également dans une démarche proactive, qui vise à identifier et à neutraliser des individus susceptibles de passer à l’acte ou d’être complices de projets terroristes dans le cadre d’enquêtes portant sur les milieux radicaux ou par le recueil et l’exploitation de renseignements. C’est en coordination étroite avec les services de renseignement et avec les autorités judiciaires que la DCPJ participe à la prévention des actes de terrorisme, soit dans un cadre judiciaire, notamment pour association de malfaiteurs en lien avec un acte de terrorisme, soit dans un cadre préjudiciaire, en utilisant les techniques de renseignement, lesquelles nous sont précieuses.
Il était naturel que la DCPJ participe aux opérations déclenchées dans le cadre de l’état d’urgence. Je commencerai donc par dresser rapidement un bilan quantitatif et qualitatif de cette participation.
La DCPJ n’a pas conduit d’opérations en propre dans ce cadre, le pilotage étant confié, pour la police nationale, à la Direction centrale de la sécurité publique (DCSP) et, plus particulièrement, au Service central du renseignement territorial (SCRT). En revanche, nous nous sommes fortement impliqués aux côtés de nos collègues de la DCSP, tout d’abord en leur offrant un appui procédural, ensuite en mettant à leur disposition aussi souvent que nécessaire nos brigades de recherche et d’intervention (BRI), enfin en proposant des objectifs à l’autorité préfectorale, après concertation avec les services partenaires, dont précisément, le SCRT.
Au plan quantitatif, depuis le début de l’état d’urgence, 1 680 perquisitions administratives ont été effectuées en zone de police, hors région Île-de-France, par les services de la sécurité publique. À ce jour, la DCPJ a participé à 540 de ces opérations, lesquelles ont mobilisé environ 1 180 enquêteurs et techniciens de la police technique et scientifique de notre direction centrale. En outre, 509 policiers des BRI ont été sollicités pour intervenir dans le cadre d’une soixantaine d’opérations visant des individus susceptibles d’être dangereux et armés. La DCPJ a donc mobilisé, jusqu’à présent, environ 1 690 personnels dans le cadre de l’état d’urgence, ce qui représente un effort important au regard de l’activité que nous déployons par ailleurs en matière antiterroriste et du nombre de nos fonctionnaires actifs, qui est de 3 340.
À la suite de ces opérations, les services territoriaux de la DCPJ ont été saisis d’une quarantaine d’enquêtes pénales qui les ont conduits à prononcer des mesures de garde à vue à l’encontre de 31 personnes. À l’issue de ces investigations, neuf d’entre elles ont été écrouées, huit ont été placées sous contrôle judiciaire, deux ont comparu, après reconnaissance préalable de culpabilité, pour des infractions de moindre gravité, et trois se sont vu notifier des convocations par officier de police judiciaire en vue d’un jugement ultérieur.
Au plan qualitatif, il est indéniable que l’état d’urgence a permis de réaliser des affaires d’envergure et de « fixer » des individus à la dangerosité avérée, comme en témoignent les exemples suivants. La perquisition administrative effectuée le 16 novembre, sur renseignement de la police judiciaire, dans la commune de Feyzin, dans la banlieue sud de Lyon, a permis la découverte de nombreuses armes de guerre, au nombre desquelles figuraient notamment une Kalachnikov, trois pistolets semi-automatiques, un fusil à pompe, deux gilets pare-balles et un lance-roquettes. La perquisition administrative effectuée en novembre par les fonctionnaires du commissariat de police du Creusot, en Saône-et-Loire, accompagnés de ceux de la Direction interrégionale de la police judiciaire (DIPJ) de Dijon, au domicile d’un individu converti à l’islam radical a permis de trouver deux fusils à pompe, un pistolet 7.62, un gilet pare-balles et vingt kilos de cannabis ; l’individu a été écroué. La perquisition administrative effectuée le 16 novembre à Hem, dans la banlieue de Roubaix, par nos collègues de la Sécurité publique du Nord leur a permis de découvrir des produits explosifs, notamment un pain de pentrite, quatre bâtons de dynamite et du matériel pyrotechnique, ainsi que des stupéfiants. La PJ de Lille, saisie de l’enquête, a interpellé plusieurs mis en cause intermédiaires avant d’arrêter le propriétaire, un Français résidant en Belgique ; il y a eu quatre écrous dans cette affaire.
Ainsi que je l’ai indiqué, les BRI de la DCPJ sont intervenues à soixante reprises pour sécuriser les opérations de perquisition administrative visant des individus à la dangerosité avérée. Leurs compétences spécifiques en matière d’intervention ont été mises à la disposition des unités engagées sur ces points sensibles. Nous gardons tous en mémoire l’opération antiterroriste menée conjointement par la DCPJ et la DGSI à Strasbourg le 6 octobre 2012, au cours de laquelle un délinquant radicalisé avait ouvert le feu sur les policiers intervenant avant d’être abattu. Il appartenait à un groupe terroriste qui préparait des attentats en France après avoir commis une tentative d’attentat contre un commerce à Sarcelles. Je pense également à l’opération antiterroriste menée le 16 janvier 2015 à Verviers, en Belgique, lors de laquelle les policiers belges avaient été pris dans une fusillade nourrie, avant de neutraliser deux individus et d’en interpeller un troisième.
Je tiens à souligner que les règles qui ont présidé, dans certains cas, à l’utilisation de moyens mécaniques pour pénétrer dans les domiciles visés étaient identiques à celles qui prévalent en temps normal : nécessité et proportionnalité. À ce jour, à ma connaissance, aucune de ces opérations n’a donné lieu à des incidents graves ou à un quelconque contentieux ; j’y vois la marque du professionnalisme des BRI.
Par ailleurs, un grand nombre des objectifs proposés par les services territoriaux de la DCPJ ont été retenus par les préfets, au terme de processus de décision placés sous le signe de la clarté, de la concertation et de la transparence entre services. Au total, 140 opérations ont été déclenchées sur la base d’éléments fournis par la police judiciaire. Cela montre que les efforts de coordination consentis tant au niveau central — je pense au rôle de l’Unité de coordination de la lutte antiterroriste (UCLAT) et de l’État-major opérationnel de prévention du terrorisme (EMOPT) — qu’au niveau local s’avèrent efficaces. Une culture de l’information partagée s’affirme. Je tiens, en outre, à souligner l’effort de rapprochement consenti par le service du renseignement territorial de la Direction centrale de la sécurité publique et les services de la DCPJ pour améliorer la circulation de l’information sur la radicalisation, permettre une meilleure évaluation de la dangerosité des individus détectés et cibler un peu mieux les individus les plus dangereux.
Je veux saluer la mobilisation et la motivation extraordinaires dont les effectifs de la DCPJ ont fait preuve depuis les attentats du 13 novembre et leur volonté, jamais prise en défaut, de participer pleinement aux actions menées dans le cadre de l’état d’urgence. Pour tout vous dire, il avait été décidé, en accord avec la DCSP et le directeur général de la police nationale, que des officiers de police judiciaire de la DCPJ seraient d’astreinte, prêts à intervenir jour et nuit, pour prendre le relais d’une affaire si le parquet décidait de saisir la police judiciaire. Le soir même, j’étais débordée par les demandes qui me parvenaient : l’ensemble des personnels de la PJ voulaient participer aux perquisitions, aux réflexions et à la définition des cibles, ce qui témoigne de la motivation et de la mobilisation générale de la police nationale.
Par ailleurs, je souhaiterais vous livrer quelques réflexions sur la contribution de l’état d’urgence à la lutte antiterroriste et sur les solutions qui pourraient être apportées aux difficultés liées à la fin du dispositif, dont la presse se fait parfois l’écho.
L’état d’urgence est, pour nous, un cadre approprié en période de crise. Depuis les meurtres à caractère terroriste commis par Mohammed Merah en 2012, les forces de sécurité intérieure sont confrontées à une menace terroriste de plus en plus diffuse, massive et protéiforme. Pour y faire face, elles doivent assurer une circulation optimale de l’information entre leurs différents services spécialisés et les différentes autorités, judiciaires et préfectorales notamment. Elles doivent également parvenir à concilier, ce qui est parfois délicat, le rythme de l’enquête judiciaire et celui du renseignement, le temps lent de l’identification et de la localisation des terroristes potentiels et l’urgence, parfois pressante, d’agir pour prévenir le pire. En permettant aux préfets de déclencher des opérations visant des individus contre lesquels une action judiciaire coercitive n’aurait pas pu être envisagée faute d’éléments suffisants, l’état d’urgence résout en partie ces difficultés. Il permet de mieux articuler l’action des services de renseignement et celle des services judiciaires ; il réduit la marge d’incertitude au sujet d’un certain nombre d’individus jugés dangereux et permet de concentrer l’action des services sur les cibles les plus pertinentes. Il ne prive pas pour autant l’autorité judiciaire de son rôle, puisque la constatation d’infractions conduit de manière systématique à l’établissement de procédures judiciaires sous contrôle.
Par ailleurs, nous constatons une judiciarisation croissante du renseignement. Or la fin de l’état d’urgence pourrait accentuer cette tendance. De manière générale, nous avons fait le constat, en effet, que les événements tragiques qui ont endeuillé notre pays et la période d’état d’urgence qui s’en est suivie ont encore renforcé le dialogue entre les partenaires de la lutte antiterroriste. Ce dialogue est en effet l’unique moyen pour ces derniers de positionner correctement le curseur entre enquête judiciaire et suivi administratif d’objectifs à moindre dangerosité. Mais l’accentuation de la menace terroriste conduit déjà, fort logiquement, à une judiciarisation croissante du renseignement. De fait, les services font plus rapidement qu’auparavant le choix de porter à la connaissance du parquet local tout élément susceptible de prévenir une éventuelle menace, et les magistrats du parquet concernés choisissent beaucoup plus fréquemment qu’avant d’en saisir la DCPJ, afin d’en vérifier la pertinence et d’agir en fonction des vérifications effectuées. Ainsi, pendant les quinze jours des fêtes de fin d’année, plusieurs services territoriaux et centraux de la DCPJ ont dû déployer de très importants moyens — téléphonie, mobilisation de plusieurs BRI, surveillance sur le terrain — pour vérifier et, finalement, en l’espèce, invalider plusieurs renseignements.
Cette tendance devrait, selon nous, s’accentuer encore avec la fin de l’état d’urgence, puisque seuls les pouvoirs de police judiciaire permettront d’exercer la coercition nécessaire pour vérifier un renseignement brut sans prendre le risque d’un imprévisible passage à l’acte. Pour la DCPJ, sur laquelle la situation actuelle a déjà un impact très fort, la sortie de l’état d’urgence pourrait donc entraîner un accroissement de sa charge de travail.
En résumé, je dirai que l’état d’urgence est un outil très approprié en période de crise terroriste, dans la mesure où il permet de mieux traiter une menace diffuse et proliférante. Mais, à la fin, prochaine, de cette période, nous devrons être collectivement attentifs au maintien d’un juste équilibre entre le travail de renseignement et le travail judiciaire. Les techniques de renseignement offertes par la loi de juillet 2015 aux services dits du « premier cercle » comme aux services dits « du deuxième cercle », dont fait partie la DCPJ, seront sans doute adaptées pour agir efficacement en amont du cadre judiciaire et permettront ainsi de le préserver. J’ajoute que la menace terroriste, qui est forte depuis un an, s’est encore aggravée depuis les attentats du vendredi 13 novembre, puisque nous savons que nous avons désormais affaire à des combattants aguerris, entraînés et formés, en provenance de Syrie, assistés par des artificiers et des organisateurs qui ont suivi un véritable entraînement au commandement et à la planification de ce type d’actions. Offrir aux services de sécurité les moyens d’être efficaces est donc vital.
M. le président Jean-Jacques Urvoas. Vous avez évoqué la masse de travail que l’état d’urgence a produite pour les services de police judiciaire. Compte tenu de ses effectifs — 3 340 personnes — et du nombre des perquisitions pour lesquelles elle a été sollicitée, la DCPJ a-t-elle été contrainte de délaisser une partie de ses autres activités en raison des mesures prises dans le cadre de l’état d’urgence ?
Mme Mireille Ballestrazzi. Cela ne se traduit pas dans les résultats. Nos policiers travaillent énormément — on me reproche souvent, du reste, l’augmentation du stock d’heures supplémentaires. De fait, si nous voulons conserver nos résultats en matière de lutte contre la criminalité organisée et la délinquance spécialisée, qui est au cœur de notre mission, tout en nous engageant totalement sur le front de la lutte antiterroriste, il nous faut travailler plus. Je crois cependant que nous atteignons actuellement la limite. J’ai beaucoup d’admiration pour le travail des personnes que je dirige, car elles ont peu de week-ends et de nuits pour se reposer. Les fonctionnaires de la sous-direction antiterroriste (SDAT) sont en effet contraints, en période de flagrance, de passer plusieurs nuits à travailler sur les attentats — certains d’entre eux dorment une heure par terre, avant de se remettre au travail. Beaucoup d’informations doivent être gérées, beaucoup d’actions doivent être menées, la procédure doit être établie : cela ne se fait pas sans sacrifier son temps de sommeil et sa vie familiale.
Ainsi, le bilan de l’année 2015 en matière de lutte contre le trafic de stupéfiants demeure très encourageant, puisque nous maintenons nos résultats au même niveau. Mais, outre la gestion des attentats, dans laquelle de nombreux services ont été engagés — la DGSI, la DCPJ et nos collègues territoriaux, que nous sollicitons chaque fois qu’une vérification est nécessaire —, il y a tous les dossiers périphériques : depuis les attentats de janvier 2015, 200 saisines restent en service territorial ou en co-saisine avec la sous-direction antiterroriste pour des faits d’apologie du terrorisme, des menaces, des suspicions de départ ou des départs en Syrie, saisines qui nécessitent un investissement immédiat et total, car nous ne pouvons pas nous permettre la moindre faille.
Bien entendu, la police judiciaire profite et continuera à profiter du plan de lutte antiterroriste interministériel et bénéficiera d’un renfort dans le cadre du pacte de sécurité annoncé par le Président de la République. Je crois néanmoins que, à l’avenir, si la menace terroriste perdure et que nous devons travailler sur des filières ou des individus, nos autres activités s’en ressentiront peut-être ; mais tel n’est pas le cas aujourd’hui.
M. le président Jean-Jacques Urvoas. Vos personnels, qui font déjà beaucoup et à qui l’on demande de faire encore plus pendant la période d’état d’urgence, ne sont donc pas au bord de la rupture ?
Mme Mireille Ballestrazzi. J’y suis attentive. Si certains groupes peuvent être au bord de la rupture, nous avons la possibilité de solliciter une aide extérieure. Lors des attentats du 13 novembre, par exemple, nous avons sollicité le soutien opérationnel des services territoriaux aux côtés de la DRPJ de Paris, car les différentes scènes de crime devaient être traitées simultanément et devaient l’être par des spécialistes des constatations en matière de crimes de sang. Ainsi, la Criminelle de Versailles s’est occupée de la scène de crime de Charonne et celle de Lille d’une autre scène de crime. Nous avons également sollicité les BRI de Strasbourg, de Rouen, d’Orléans, de Lyon. Nous avons donc la capacité de faire appel, en cas de besoin, à l’ensemble des services. Les BRI ont en effet une compétence nationale. Quant aux autres officiers de police judiciaire, il est possible de solliciter des parquets généraux une habilitation ponctuelle sur la zone concernée, sauf quand la DCPJ est saisie.
M. le président Jean-Jacques Urvoas. Les mesures administratives liées à l’état d’urgence ont-elles joué un rôle dans le déroulement immédiat de l’enquête sur l’attentat du Bataclan ou de l’intervention du RAID à Saint-Denis ?
Mme Mireille Ballestrazzi. Non, monsieur le président.
M. le président Jean-Jacques Urvoas. Les cibles des perquisitions administratives sont-elles définies par la direction centrale ou localement ?
Mme Mireille Ballestrazzi. Si beaucoup de choses se décident au niveau de la direction centrale, ce n’est pas le cas pour ce type d’actions opérationnelles, qui sont définies par les fonctionnaires ayant la connaissance du terrain. Ceux-ci reçoivent de nombreux renseignements. Dans la phase préjudiciaire, de petits éléments peuvent indiquer que la cible est potentiellement dangereuse, mais des semaines, voire des mois, de surveillance technique et physique sont parfois nécessaires pour « habiller » cette cible en procédure judiciaire. L’état d’urgence présente un avantage à cet égard, puisqu’il permet de réaliser une perquisition administrative — dont la décision est toujours prise après une discussion collective — et de raccourcir ainsi le processus en facilitant la recherche d’éléments. Il s’agit presque d’une mesure prudentielle face à la menace et au risque.
M. le président Jean-Jacques Urvoas. Au plan local, vos services ont donc proposé au préfet d’effectuer des perquisitions concernant des objectifs qu’ils ne parvenaient pas à judiciariser, afin de lever les doutes et, le cas échéant, d’avoir confirmation de leur suspicion. Est-ce bien cela ?
Mme Mireille Ballestrazzi. C’est un peu cela, sachant que, dans la plupart des cas — je ne sais pas ce qu’il en est pour l’ensemble du territoire —, les procureurs de la République ont été mis dans la boucle.
M. le président Jean-Jacques Urvoas. Pour ce que l’on en sait, en effet, les procureurs ont toujours été informés, en amont, des perquisitions. Il nous est même arrivé de croiser des procureurs qui avaient, eux aussi, fourni des cibles, car ils ne parvenaient pas à aboutir par la voie judiciaire. Mais, comme pour les poissons volants, ce n’est pas la majorité de l’espèce !
Mme Mireille Ballestrazzi. Certains préfets ont même convié le procureur à la réunion consacrée au choix des cibles.
M. Sébastien Pietrasanta. Les trois belles affaires que vous avez mentionnées ont toutes trois été réalisées au cours des premiers jours de l’état d’urgence. D’autres affaires de ce type l’ont-elles été par la suite ?
Mme Mireille Ballestrazzi. Oui. Celles que j’ai citées sont emblématiques, mais il y en a d’autres. La semaine dernière, par exemple, nous avons eu deux saisines de la police judiciaire à la suite de perquisitions administratives qui avaient permis de découvrir des armes de guerre.
M. Sébastien Pietrasanta. Je m’étonne que vous découvriez encore aujourd’hui des armes de guerre. Faut-il être stupide, dans le contexte actuel, pour continuer à cacher de telles armes à son domicile !
Mme Mireille Ballestrazzi. Nous avons en effet perçu, à un moment, que les perquisitions étaient moins efficaces. Je précise cependant que, dans l’une des deux affaires, ces armes de guerre ont été découvertes dans des buissons, où elles avaient été abandonnées.
M. le président Jean-Jacques Urvoas. Avez-vous encore besoin, aujourd’hui, de l’état d’urgence ou tous les objectifs qu’il était opportun de traiter en administratif l’ont-ils été ?
Mme Mireille Ballestrazzi. Des objectifs, nous en avons toujours, et je pense que les services de renseignement en ont également. Le ministre nous a demandé à plusieurs reprises, au cours des six derniers mois, de judiciariser le plus possible les renseignements que nous recueillions sur les individus radicalisés et potentiellement dangereux. Nous avons donc donné des instructions pour que, au niveau local, renseignement territorial, police judiciaire et sûreté départementale se réunissent et examinent la possibilité de judiciariser sur la base de faits pénaux, puisqu’une grande partie de ces individus radicalisés sont connus pour des actes de délinquance antérieurs. Or on s’aperçoit que ce n’est pas si simple. Je ne peux pas parler pour mes collègues du renseignement, mais je suppose qu’il existe encore un certain nombre d’objectifs.
M. le président Jean-Jacques Urvoas. Est-il arrivé que des mesures administratives interfèrent dans des enquêtes menées par la PJ ?
Mme Mireille Ballestrazzi. Pas du tout, monsieur le président. On pourrait en effet imaginer qu’une perquisition administrative menée à Marseille puisse avoir un impact sur une enquête menée à Lille. Mais tel n’a pas été le cas. Au niveau zonal, c’est-à-dire sur un territoire assez vaste, la concertation a été suffisante pour éviter précisément qu’un objectif proposé par un service n’interfère dans une procédure judiciaire en cours.
M. le président Jean-Jacques Urvoas. Nous avons constaté que l’un des éléments indispensables de la collaboration de la DCPJ avec les services du renseignement notamment consistait dans l’aide que vous pouvez leur apporter en matière de traitement ou de captation de données numériques, car ils ne disposent pas forcément des équipements nécessaires dans ce domaine — je pense notamment au renseignement territorial. Aviez-vous anticipé cette situation ?
Mme Mireille Ballestrazzi. Dès que nous avons commencé à former, il y a plus de vingt ans de cela, des enquêteurs spécialisés en culture informatique, il a été annoncé — je le dis avec modestie — que ceux-ci seraient au service de l’ensemble de la police nationale. Nous avons mis ainsi beaucoup d’outils à sa disposition, voire à la disposition de la gendarmerie. La DCPJ a en effet pour habitude de travailler dans la transversalité. Depuis la création de l’Office de lutte contre la cybercriminalité, nous avons accéléré le processus de formation et formé plus de 400 enquêteurs spécialisés pour la Sécurité publique. Aujourd’hui, le renseignement territorial doit avoir ses propres personnels spécialisés et disposer des outils nécessaires ; tout cela va se faire. Mais, en attendant, il est naturel que nous prêtions main-forte à nos collègues.
M. le président Jean-Jacques Urvoas. Alimentez-vous d’une manière quelconque le fichier de l’UCLAT, le fichier de traitement des signalés pour la prévention et la radicalisation à caractère terroriste (FSPRT) ?
Mme Mireille Ballestrazzi. La sous-direction antiterroriste, qui centralise l’ensemble des informations de la police judiciaire dans ce domaine, informe systématiquement l’UCLAT et la DGSI. Nous donnons tout.
M. le président Jean-Jacques Urvoas. Ce fichier présente-t-il un intérêt dans le cadre de votre activité de police judiciaire ?
Mme Mireille Ballestrazzi. Oui, car il est important de connaître l’environnement d’un objectif. J’aurais souhaité, du reste, que l’ensemble des services puissent avoir y accès, mais cela est compliqué, car c’est un fichier très protégé. Toujours est-il que la sous-direction antiterroriste y a accès, et c’est vital. En effet, les noms qui figurent dans ce fichier ne se trouvent pas forcément dans d’autres fichiers. Or il est important de savoir si l’individu sur lequel on travaille est connu comme radicalisé et par quel service il a été signalé.
M. le président Jean-Jacques Urvoas. Ceux de vos personnels qui travaillent dans les directions interrégionales ont-ils accès à ce fichier ?
Mme Mireille Ballestrazzi. Non, mais ils passent par la sous-direction antiterroriste, ce qui permet à celle-ci de filtrer et d’avoir un regard global.
M. le président Jean-Jacques Urvoas. Pourriez-vous nous expliquer l’articulation entre l’UCLAT et l’EMOPT ?
Mme Mireille Ballestrazzi. Cette articulation existe, mais je préfère laisser à M. de Mazières le soin de vous l’expliquer.
Mme Françoise Descamps-Crosnier. En janvier 2015, devant la commission d’enquête sur la surveillance des filières et des individus djihadistes, le ministre de l’Intérieur avait indiqué que votre direction recevrait le renfort de 106 agents, notamment pour permettre à la sous-direction de la lutte contre la cybercriminalité de renforcer l’efficacité des patrouilles opérées sur internet par le biais de la plateforme d’harmonisation, d’analyse, de recoupement et d’orientation des signalements (PHAROS). Pouvez-vous nous indiquer ce qu’il en est de ces recrutements ?
Par ailleurs, l’Office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l’information et de la communication (OCLCTIC), qui dépend de votre direction, peut réclamer aux hébergeurs de sites sensibles le retrait de contenus illicites sans avoir à demander l’autorisation du juge. Ce pouvoir de blocage administratif est-il particulièrement sollicité depuis les attentats, notamment ceux du mois de novembre dernier ? Les signalements sur PHAROS ont-ils augmenté ? La disposition de la loi du 20 novembre 2015 sur la réforme de l’état d’urgence prévoyant que le ministre de l’Intérieur peut prendre toutes mesures pour assurer l’interruption de tout service de communication au public en ligne provoquant à la commission d’actes de terrorisme ou en faisant l’apologie a-t-elle apporté une quelconque valeur ajoutée à vos possibilités d’intervention ?
Mme Mireille Ballestrazzi. Les renforts dont devait bénéficier l’Office « cyber », comme on l’appelle couramment, sont bien arrivés, et ce pour deux raisons. D’une part, le ministre, lorsqu’il a visité les locaux de PHAROS, début février, s’est aperçu de son utilité — c’est un outil majeur — ainsi que de la passion et de l’expertise des fonctionnaires qui y travaillent. D’autre part, la plateforme a été beaucoup sollicitée et a joué un rôle très important après les attentats de janvier dernier. Par ailleurs, compte tenu de l’importance des réseaux sociaux dans les revendications ou l’apologie du terrorisme, le ministre s’est rendu dans la Silicon Valley pour rencontrer les grands opérateurs internationaux et leur délivrer un message à ce sujet. Depuis, la sous-direction de la lutte contre la cybercriminalité a reçu des renforts à la fois au titre du plan de lutte antiterroriste et dans le cadre de sa montée en puissance, car c’est une sous-direction jeune, qui a été créée en 2014. Les autres renforts ont été affectés à la sous-direction antiterroriste et, dans une moindre mesure, au groupe de lutte contre le financement du terrorisme.
Quant à l’augmentation des signalements, elle a été très importante en 2015, surtout après l’attentat contre Charlie Hebdo et ceux du 13 novembre. Il faut saluer, à cet égard, l’efficacité des agents de PHAROS, qui font de la veille, peuvent détecter et être informés. Si l’apologie du terrorisme est évidente, ils s’adressent immédiatement à l’opérateur pour bloquer le site, le déréférencer ou faire retirer les contenus incriminés. Ensuite, une enquête est menée et il est décidé, en lien avec le procureur de la République, de confier à un service la poursuite de cette enquête. Depuis la visite du ministre de l’Intérieur dans la Silicon Valley, de nombreuses réunions ont été organisées avec les opérateurs au niveau ministériel — mais l’Office avait déjà des contacts privilégiés avec ces derniers. Un groupe de travail a été mis sur pied afin qu’ils acceptent plus rapidement de déréférencer un site, de le bloquer ou de retirer un contenu qui constituerait une apologie du terrorisme, une revendication, ou qui serait de nature pédopornographique. Je précise cependant que les opérateurs américains ne sont pas soumis aux mêmes obligations qu’en France, en raison de la législation américaine sur la liberté d’expression.
Un énorme travail a été effectué. L’Office central a été désigné, pour des raisons de commodité, comme le point d’entrée unique pour l’ensemble des enquêteurs de la police nationale. Un formulaire type de réquisition a ainsi été établi pour chaque opérateur — Twitter, Facebook, Google… — et intégré au logiciel de rédaction de procédure utilisé par les enquêteurs. Cette réquisition est transmise à l’Office « cyber », puis elle est adressée à l’opérateur. En cas d’urgence, un appel suffit. Ce dispositif fonctionne bien. Je dois dire que le choc provoqué par les attentats du 13 novembre a été tel que nombre d’opérateurs n’ont pas attendu qu’on les sollicite et ont retiré d’eux-mêmes certaines images.
M. le président Jean-Jacques Urvoas. La prérogative confiée au ministre par la loi du 20 novembre 2015 n’a donc pas été utilisée ?
Mme Mireille Ballestrazzi. Non. Les mesures ont été prises dans le cadre de la procédure du 13 novembre 2015.
Mme Sandrine Mazetier. Si j’ai bien compris, les perquisitions administratives rendues possibles dans le cadre de l’état d’urgence permettent à la PJ d’économiser les mois de surveillance nécessaires à la judiciarisation d’une affaire. En quoi la fin de l’état d’urgence entraînerait-elle une augmentation de la judiciarisation du renseignement ? Par ailleurs, s’il n’était plus nécessaire de recourir à l’état d’urgence pour prendre ce type de mesures – perquisitions administratives, assignations à résidence –, la situation serait-elle tenable pour vos personnels, aussi passionnés et dévoués soient-ils ?
Ma deuxième question porte sur les rumeurs malveillantes ; je pense aux chaînes de textos qui sont apparues rapidement après le 13 novembre et qui peuvent provoquer de véritables paniques. Des recherches sont-elles menées, dans un cadre préjudiciaire, sur les sources de ces rumeurs malveillantes qui contribuent à alimenter la terreur — et qui, à ce titre, devraient peut-être, selon moi, être qualifiées, de complicité de terrorisme — ou les affaires directement liées à des actes ou à des comportements terroristes sont-elles trop nombreuses pour permettre ces enquêtes ?
Enfin, avez-vous un avis sur ce que devrait être la durée de l’état d’urgence ?
Mme Mireille Ballestrazzi. S’agissant de la judiciarisation du renseignement, nous sommes aujourd’hui face à un risque majeur : nous craignons, et pas uniquement en France, une nouvelle tuerie de masse ou des attentats multiples. Il faut donc — c’est en tout cas la tendance que l’on observe — judiciariser le plus tôt possible le renseignement. Les services de renseignement, qui ont parfois tendance à prendre du temps pour « environner » un suspect, le suivre, identifier l’ensemble de ses contacts, vont nous transmettre leurs informations, que nous soumettons ensuite au parquet. Or les procureurs, qui, auparavant, auraient souhaité disposer de davantage d’éléments pour ouvrir une enquête préliminaire, acceptent aujourd’hui de judiciariser immédiatement. Par exemple, le 22 décembre, une femme demeurant à Strasbourg nous a indiqué qu’elle avait entendu telle personne dire qu’un certain Omar était revenu de Syrie pour commettre un attentat sur le marché de Noël. Nous savons qui est ledit Omar, de quelle équipe il fait partie, et nous connaissons sa très grande dangerosité. C’est donc le branle-bas de combat : trois BRI se rendent à Strasbourg pour vérifier qu’Omar est bien revenu de Syrie, identifier ses contacts, réaliser des écoutes téléphoniques… Au bout de quatre jours, n’ayant rien obtenu, nous avons décidé de vérifier ; nous avons donc « cassé » : il se trouve que cette femme voulait se venger de son ex-conjoint. Toujours est-il que le parquet a immédiatement accepté que l’on judiciarise l’affaire.
M. le président Jean-Jacques Urvoas. Quelle est, selon vous, la plus-value des mesures administratives pour la SDAT ?
Mme Mireille Ballestrazzi. La plus-value de la mesure administrative ne bénéficie pas à la SDAT, mais à l’intérêt général. Au plan judiciaire, nous sommes obligés d’« habiller » un renseignement en procédure, ce qui peut prendre du temps. La procédure administrative permet d’agir et, éventuellement, de trouver immédiatement les éléments qui permettent de passer à la phase judiciaire. Comme au poker — mais l’exemple est mal choisi —, on peut miser très longtemps sans pouvoir voir le jeu de l’adversaire ; la mesure administrative permet de savoir immédiatement si ses cartes sont gagnantes ou perdantes.
M. le président Jean-Jacques Urvoas. Avez-vous le sentiment que l’état d’urgence a facilité le travail de vos fonctionnaires ?
Mme Mireille Ballestrazzi. Non. Les perquisitions administratives ne facilitent pas la tâche de la police judiciaire ; elles permettent de vérifier plus facilement qu’un objectif est dangereux ou non et, éventuellement, de réunir les éléments nécessaires à la détermination de sa dangerosité. Elles ne diminuent pas notre charge de travail. Elles contribuent peut-être à économiser du temps de travail, comme l’a dit Mme Mazetier, mais elles permettent aussi de mener des actions. En effet, il ne nous est pas possible d’exploiter intégralement la multitude de renseignements que nous recueillons ; nous sommes obligés de choisir les objectifs sur lesquels nous allons travailler, et nous n’avons pas forcément les moyens ni le temps nécessaires pour étudier un objectif qui nous paraît moins prioritaire. La perquisition administrative peut alors nous permettre d’empêcher que, dans ce cas, rien ne soit fait — je parle ici de l’investigation judiciaire, et non du renseignement.
Quant aux rumeurs malveillantes, PHAROS procède, le cas échéant, à des vérifications. Mais le travail de la police judiciaire a une finalité exclusivement judiciaire. Dès lors, si une rumeur malveillante ne présente aucun des caractères constitutifs d’une infraction pénale, ce n’est pas à nous, mais aux services de renseignement, de traiter l’affaire.
Enfin, j’estime ne pas avoir à émettre un avis sur la durée de l’état d’urgence, car celle-ci relève d’une décision politique.
M. le président Jean-Jacques Urvoas. Madame la directrice, je vous remercie pour votre disponibilité. Transmettez aux personnels que nous avons rencontrés lors de nos différents déplacements notre gratitude pour leur disponibilité, leur motivation et leur rigueur. Le contrôle parlementaire visant également à vérifier l’efficacité des mesures prises dans le cadre de l’état d’urgence, il est rassurant de constater que les personnels ont une éthique, car celle-ci n’apparaît pas toujours dans les récits que les journaux font des perquisitions.
——fpfp——
AUDITION DE M. OLIVIER DE MAZIÈRES, PRÉFET, CHARGÉ DE L’ÉTAT-MAJOR OPÉRATIONNEL DE LA PRÉVENTION DU TERRORISME (EMOPT) AU MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
Compte rendu de l’audition, non ouverte à la presse, du vendredi 8 janvier 2016
M. le président Jean-Jacques Urvoas. Monsieur le préfet, dans le cadre du contrôle parlementaire de l’état d’urgence, la commission des lois est investie des pouvoirs d’enquête en application de l’article 5 ter de l’ordonnance de 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires. Je vous précise que nous travaillons à huis clos. Aussi les propos que vous tiendrez ne seront-ils publiés qu’à l’issue de notre travail de contrôle. En effet, nous avons estimé, eu égard au sujet que nous traitons, que la confidentialité était de bon aloi, tout en garantissant que nous puissions faire état ultérieurement de ce qui aura été dit.
Je vous demande donc de prêter le serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité.
(M. Olivier de Mazières prête serment.)
M. Olivier de Mazières, préfet, chargé de l’état-major opérationnel de la prévention du terrorisme au ministère de l’Intérieur. L’état-major opérationnel de la prévention du terrorisme (EMOPT) est entré en action le 30 juin dernier et j’ai eu l’honneur d’en prendre la direction à la mi-juillet. Sa création a été décidée par le ministre de l’Intérieur après le drame de Saint-Quentin-Fallavier dans l’Isère, qu’il convient d’appeler un échec opérationnel. Le ministre voulait être certain que toutes les personnes signalées sur le territoire national au titre de la radicalisation étaient prises en charge, suivies par un service de police ou de renseignement. Les investigations menées dans le cadre de cette affaire avaient mis en évidence des lacunes, notamment à l’occasion d’un déplacement de l’auteur des faits.
De manière générale, lorsque l’on examine les attaques terroristes dont nous avons été l’objet depuis l’affaire Merah au mois de mars 2012, on s’aperçoit que tous les individus qui sont passés à l’action avaient été repérés, signalés à un moment ou à un autre — ce qui est plutôt rassurant —, mais qu’ils avaient pu sortir des écrans radars. Il s’agissait de tout faire pour éviter que cela ne se reproduise. Aussi a-t-on mis en place un dispositif qui comporte trois étages.
Le plus important est constitué des préfets de département, auxquels il a été demandé d’assurer la conduite opérationnelle, minutieuse, attentive du travail de suivi des individus radicalisés dans les départements ou territoires dont ils ont la charge, ce qui n’était pas le cas auparavant. Une partie des individus radicalisés était connue des préfets et des services locaux, parce qu’ils avaient été détectés au niveau local dans le cadre des états-majors de sécurité que président les préfets, ou parce que leur signalement avait été transmis par le Centre national d’assistance et de prévention de la radicalisation (CNAPR), cette plateforme nationale que gère l’Unité de coordination de la lutte antiterroriste (UCLAT). En revanche, une partie des personnes radicalisées, notamment les objectifs directement pris en charge par les services de renseignement, n’était pas toujours connue des préfets. Il a donc d’abord fallu partager l’état des personnes radicalisées sur le territoire.
Le deuxième étage comprend les préfets de zone de défense, qui jouent un rôle de supervision, de « contrôle qualité ». Ils disposent du pouvoir d’évocation de certains dossiers, ont la possibilité de mobiliser des moyens zonaux supplémentaires et d’orienter certaines thématiques de travail en fonction des spécificités de la zone de défense sur laquelle ils exercent leur compétence.
Enfin, le premier étage de la fusée, qui est constitué de l’état-major installé au niveau national, se veut le lieu de rencontres et d’échanges entre tous les services intéressés par ces questions : la DGSI, le Service central du renseignement territorial (SCRT), la Direction du renseignement de la préfecture de police de Paris (DRPP) et la Direction centrale de la police judiciaire (DCPJ).
Le travail que nous avons réalisé dans les trois premiers mois d’existence de l’état-major a été essentiellement quantitatif. Il a fallu compiler les renseignements émanant des états-majors de sécurité, du CNAPR, de la DGSI et du SCRT. Il a fallu s’assurer de la fiabilité des données dont on disposait sur ces individus, supprimer des doublons, parfois même des triplons, harmoniser les données avant d’intégrer ce socle dans un fichier partagé, le fichier des signalés pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste (FSPRT), qui est entré en vigueur le 5 octobre dernier.
Depuis cette date, nous avons poursuivi un important travail sur le FSPRT et avons également mené un travail plus qualitatif sous plusieurs angles. D’abord, nous avons croisé les données en nous efforçant de dégager un certain nombre de risques prioritaires dont il nous paraissait nécessaire que les préfets et les services locaux puissent se saisir. C’est ainsi que nous avons beaucoup travaillé sur ce que l’on appelle le « risque métier » : il s’agit d’individus radicalisés qui, par leurs fonctions ou leurs activités, ont accès à des lieux sensibles ou à des professions pouvant d’une manière ou d’une autre accroître leur dangerosité — personnes travaillant dans des centrales nucléaires, dans des entreprises classées Seveso et, d’une manière générale, dans des points d’importance vitale, dans des entreprises de transport, dans des zones aéroportuaires.
Nous exerçons également une vigilance particulière à l’égard des personnes radicalisées qui travaillent dans différents services publics, notamment celles qui exercent ou ont exercé la profession de militaire, les policiers, les gendarmes, les personnels de l’administration pénitentiaire. Nous menons aussi, en lien étroit avec le Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) un travail assez exemplaire afin de repérer les agents privés de sécurité radicalisés. De par leur profession, les vigiles peuvent en effet avoir accès à des sites particulièrement sensibles.
Enfin, plus récemment, nous nous sommes penchés sérieusement sur les personnes radicalisées exerçant des fonctions d’enseignement ou ayant accès à des établissements d’enseignement, qu’il s’agisse de l’enseignement public ou privé. Nous avons fait le même exercice en ce qui concerne les activités sportives, notamment sur les personnes pratiquant le tir, des sports de combat ou des activités de type paramilitaire, et nous avons commencé à le faire, même si l’accès à l’information est parfois plus difficile, sur des personnes ayant des antécédents psychologiques.
Un travail qualitatif de cartographie des risques a donc été établi. Bien évidemment, cette cartographie a été partagée avec les préfets de zone et les préfets de département.
Dans le même temps, nous avons essayé de prendre appui sur les préfets pour assurer le meilleur suivi et le meilleur pilotage de la lutte contre la radicalisation. Certains préfets avaient déjà mis en place des dispositifs en partie performants. Par exemple, nous nous sommes assez fortement inspirés de l’organisation mise en place par le préfet de la zone de défense Ouest. Ailleurs, des incertitudes subsistaient quant aux personnes à mettre autour de la table pour échanger sur les signalements, sur les leviers à utiliser pour tenter d’entraver les personnes signalées. Nous avons joué un rôle de diffusion des bonnes pratiques, considérant que le préfet ou son directeur de cabinet devait présider, à un rythme de préférence hebdomadaire, des groupes d’évaluation départementaux (GED) associant tous les services représentés au sein de l’état-major, c’est-à-dire la sécurité intérieure, le renseignement territorial, la gendarmerie départementale et, bien entendu, la police judiciaire.
La question s’est posée de savoir s’il fallait associer systématiquement ou épisodiquement le parquet, et de quelle manière. Là aussi, nous avons fait part des bonnes pratiques que nous avions pu constater sur le territoire : le parquet n’est pas systématiquement associé à ce type de réunion, mais fréquemment.
Il a aussi fallu conseiller les départements sur les actions concrètes d’entrave des personnes radicalisées. De ce point de vue, le souhait du ministre était très clair : il s’agissait de ne pas se limiter aux incriminations de caractère purement terroriste, mais d’utiliser tous les leviers possibles qu’autorise le droit commun. C’est ainsi que nous avons préconisé l’utilisation des comités opérationnels départementaux antifraude (CODAF) — mais, là encore, certains préfets ne nous avaient pas attendus pour le faire. Ces outils peuvent être pertinents en ce qu’ils permettent de jouer sur des leviers comme la fraude aux prestations sociales ou au travail dissimulé. Autre exemple : on sait qu’il est extrêmement difficile aujourd’hui de caractériser des fautes qui pourraient justifier la dissolution d’une association cultuelle. En revanche, on peut a minima s’assurer que les lieux de prière utilisés par les personnes radicalisées sont conformes à la réglementation en matière de sécurité incendie, de droit locatif, etc.
Nous ne nous concentrons pas seulement sur ce travail de tête de réseau des préfectures, d’appui territorial et d’exploitation maximale du FSPRT. Nous nous sommes aperçus qu’un certain nombre d’acteurs nationaux pouvaient jouer un rôle important en la matière. En effet, certaines activités réglementées permettent d’entraver des personnes radicalisées en leur retirant un agrément, une habilitation ou une carte professionnelle, à condition que les éléments recueillis par les services de renseignement le justifient. C’est le cas du CNAPS qui peut retirer des cartes professionnelles et du préfet délégué chargé de la plate-forme aéroportuaire de Roissy et du Bourget avec lesquels nous sommes en liaison permanente sur ces questions. La sécurité à la RATP et à la SNCF est assurée par un certain nombre de professions réglementées qui exercent au sein de la Surveillance générale (SUGE) ou du groupe de protection de la sécurisation des réseaux (GPSR).
Nous avons aussi des échanges de travail avec le secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale (SGDSN), sur le réseau des opérateurs d’importance vitale, ainsi qu’avec le ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, qui est vigilant en ce qui concerne les établissements classés Seveso. Enfin, certaines grandes entreprises sont désormais plus sensibles à leur sécurité — c’est un effet des drames qui ont frappé notre pays ces derniers mois.
M. le président Jean-Jacques Urvoas. Pouvez-vous revenir sur la composition de l’EMOPT ?
M. Olivier de Mazières. Cinq services sont représentés, chacun par deux personnes. La Direction générale de la sécurité intérieure est représentée par deux commissaires de police, le Service central du renseignement territorial par un commissaire de police et un commandant à l’échelon fonctionnel, la Direction du renseignement de la préfecture de police par deux commissaires, la Direction centrale de la police judiciaire par un commissaire et un capitaine qui vient d’être nommé commandant, enfin la Direction générale de la gendarmerie, qui, récemment encore, était représentée par deux colonels, l’est désormais par un colonel et un lieutenant-colonel. Enfin, l’EMOPT est composé d’une secrétaire issue de la préfecture de police et de votre serviteur.
M. le président Jean-Jacques Urvoas. L’administration pénitentiaire n’est pas représentée.
M. Olivier de Mazières. Ni l’administration pénitentiaire, ni la Direction de la protection et de la sécurité de la défense (DPSD), ni le renseignement militaire ne sont représentés.
M. le président Jean-Jacques Urvoas. Y a-t-il une explication rationnelle à cela autre que le fait que ces services ne dépendent pas du ministère de l’Intérieur ?
M. Olivier de Mazières. Disons que le travail de décloisonnement doit déjà être accompli entre les services qui appartiennent au ministère de l’Intérieur avant qu’on envisage de l’étendre. Cela dit, ce n’est pas parce que ces services ne sont pas intégrés à l’EMOPT que nous ne travaillons pas avec eux.
Dans l’armée existe une proportion significative de personnels radicalisés. Nous travaillons sur ce sujet avec la DPSD. Nous avons préconisé de faire entrer ce service et l’administration pénitentiaire dans les GED, au moins dans les départements concernés par des implantations militaires ou des grands centres de détention.
M. le président Jean-Jacques Urvoas. Le ministre de l’Intérieur a indiqué exercer une tutelle directe sur l’EMOPT. Comment cela se traduit-il ?
M. Olivier de Mazières. Cela se traduit par des réunions hebdomadaires. Ces réunions se sont quelque peu espacées depuis les événements du 13 novembre. Mais, jusqu’à cette date, le ministre tenait un comité de pilotage de manière hebdomadaire ou au moins tous les dix jours.
Le comité de pilotage réunit l’intégralité des personnels de l’état-major auxquels il a adjoint le chef de l’UCLAT et les principaux responsables de départements de l’UCLAT, le directeur général de la police nationale, le directeur général de la gendarmerie nationale, le directeur général de la sécurité intérieure, la Direction des libertés publiques et des affaires juridiques (DLPAJ), ainsi bien évidemment que les principaux collaborateurs de son cabinet. J’ai l’honneur de comparaître devant cet aréopage pour rendre compte du travail accompli et de la mise en œuvre des directives du ministre, mais il ne nous est pas interdit de prendre des initiatives.
M. le président Jean-Jacques Urvoas. Après six mois de fonctionnement, êtes-vous confronté à des blocages administratifs, voire institutionnels ?
M. Olivier de Mazières. Si vous entendez par blocage administratif ou institutionnel le refus délibéré ou la mauvaise volonté manifeste de collaborer, je répondrai non. Mais, si vous entendez par là le fait que le décloisonnement pourrait être perfectionné et que la lisibilité du dispositif mis en place pourrait être améliorée, je répondrai par l’affirmative.
M. le président Jean-Jacques Urvoas. Votre outil de travail est le FSPRT.
M. Olivier de Mazières. C’est notre principal outil de travail.
M. le président Jean-Jacques Urvoas. Ce matin, M. Loïc Garnier, chef de l’UCLAT, nous a dit qu’il gérait le FSPRT.
M. Olivier de Mazières. C’est exact.
M. le président Jean-Jacques Urvoas. Cela veut dire que vous êtes deux à gérer le FSPRT et à le nourrir.
M. Olivier de Mazières. À le nourrir, certainement ; à le gérer, non. Je vous confirme que l’UCLAT est le seul organisme qui gère le FSPRT.
M. le président Jean-Jacques Urvoas. Vous n’avez pas votre propre fichier ?
M. Olivier de Mazières. Non. Loïc Garnier a dû vous expliquer que le FSPRT a été créé avant l’EMOPT dans une logique différente. À l’origine, c’est un fichier qui recense les signalants au CNAPR. Lors de la création de l’EMOPT, il a été décidé d’adapter le fichier aux besoins des préfets, donc de l’EMOPT, en considérant qu’il pouvait être pertinent d’avoir, dans un fichier, des informations relatives aux personnes signalées, et que cela pouvait être au moins aussi intéressant que des informations sur les personnes signalantes.
L’outil a évolué en ce sens, ce qui a justifié un nouveau décret pris au début du mois d’octobre après un nouvel examen de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) et du Conseil d’État, sachant que la version première du FSPRT dont l’usage était réservé à l’UCLAT avait déjà fait l’objet d’un décret, non publié, au mois de mars. On a fait en quelque sorte évoluer le contenu, mais le contenant et la responsabilité du contenant n’ont pas changé. En clair, l’UCLAT est le seul administrateur du FSPRT et le maître d’œuvre technique est le service des technologies et des systèmes d’information de la sécurité intérieure, le ST(SI)2.
Nous avons travaillé étroitement avec l’UCLAT et le ST(SI)2 pour faire évoluer certaines rubriques du FSPRT dans le cadre de la mise à jour qui a été lancée au mois d’octobre. Mais, pour donner un exemple concret, je n’ai pas la faculté de créer ni de supprimer une fiche du FSPRT.
M. le président Jean-Jacques Urvoas. Qui peut créer une fiche ?
M. Olivier de Mazières. L’UCLAT.
M. Sébastien Pietrasanta. Vous pouvez l’alimenter ?
M. Olivier de Mazières. Oui, je peux la faire vivre.
Mme Françoise Descamps-Crosnier. Pouvez-vous susciter la création d’une fiche ?
M. Olivier de Mazières. Bien sûr ! Je peux demander sa création comme sa suppression, comme tout utilisateur local du FSPRT. Mais cela doit être validé par l’UCLAT, ce qui ne me choque pas.
M. Sébastien Pietrasanta. J’ai du mal à comprendre quel est l’apport supplémentaire de l’EMOPT par rapport au rôle de l’UCLAT. L’UCLAT est censée coordonner. Mais vous avez aussi un rôle de coordonnateur. Quelle est la différence ? S’agit-il d’une différence méthodologique, opérationnelle ? Comment les choses coexistent-elles en la matière ?
M. Olivier de Mazières. Le travail accompli n’est pas le même. Toute l’activité que j’ai décrite dans mon propos liminaire n’était faite auparavant ni par l’UCLAT ni par quiconque. La compilation et l’harmonisation des signalements afin de constituer le stock qui est devenu le socle du FSPRT ont été réalisées par l’EMOPT. Cela nous a d’ailleurs été reproché par certains qui considéraient qu’il était excessif d’affecter dix commissaires de police ou l’équivalent dans des bureaux pour ajouter des lignes Excel au fichier. On peut comprendre leur réaction, mais personne ne s’est précipité pour accomplir ce travail à notre place. Avec le recul, je me dis que, si le travail était ingrat, il avait le mérite de permettre à chacun d’être au cœur du dispositif, et donc d’être directement opérationnel pour la suite.
Tout le travail qualitatif que j’ai également décrit tout à l’heure, c’est-à-dire le contrôle qualité du travail effectué par les préfets, l’appui qui leur est donné en matière d’organisation, l’attention qui est appelée et le suivi qui est réalisé sur les risques métier n’avait jamais été fait auparavant. Nous suivons aujourd’hui plusieurs dizaines de personnes qui sont identifiées comme ayant accès à des sites particulièrement sensibles ou exerçant des fonctions qui font qu’elles constituent un danger supplémentaire.
De même, le travail d’échanges fréquents, pour ne pas dire permanents, avec le CNAPS, la DPSD, la RATP, la SNCF, le SGDSN n’avait jamais été réalisé auparavant. Bref, le travail accompli par l’EMOPT depuis sa création n’avait jamais été fait jusqu’à présent.
L’objectif de l’EMOPT est de veiller à la fiabilité et à la méticulosité du suivi. Il s’assure auprès des préfets que chaque individu est effectivement pris en compte par un chef de file, qu’il n’y a pas d’orphelin, qu’un individu qui change de département ou de zone de défense est bien pris en compte par un autre service. Ce travail n’est pas accompli par l’UCLAT, mais on ne peut le lui reprocher : ce n’est pas sa mission.
M. Sébastien Pietrasanta. J’ai du mal à comprendre. Prenons le cas d’un appel au numéro vert. C’est l’UCLAT qui reçoit l’appel, qui crée une fiche et qui la transmet au cabinet du préfet pour être évaluée. Si j’ai bien compris, cette fiche vous est transmise également. Et c’est à vous qu’il revient d’en faire le suivi. Est-ce bien cela ?
M. Olivier de Mazières. Lorsque l’UCLAT enregistre un signalement au titre du CNAPR, le signalement est transmis au préfet qui décide, en GED, d’en confier l’évaluation à un service, presque systématiquement au service du renseignement territorial. À l’issue de cette évaluation, on décide de laisser l’individu dans le FSPRT ou de l’en sortir. Mais, je le répète, il ne s’agit que d’une partie du dispositif. Il y a aussi des objectifs qui sont directement repérés localement et qui, grâce à un travail de proximité des services, sont intégrés dans le FSPRT. Certains objectifs sont enfin directement pris en charge, notamment par la DGSI, qui intègrent eux aussi le « pot commun ». C’est là qu’intervient l’EMOPT : d’abord, il s’assure que chaque individu fait bien l’objet d’un suivi par un service chef de file, ensuite que l’individu n’est pas abandonné, c’est-à-dire que les investigations menées sur son compte sont réelles. Je précise que l’EMOPT n’est pas un service opérationnel de police. Je n’essaie jamais de savoir quelle est la nature des investigations dont un individu fait l’objet. En revanche, je veux être sûr que cet individu fait l’objet d’investigations, quelles qu’elles soient.
Le FSPRT comporte de nombreuses rubriques, qu’il est possible de croiser pour repérer soit des activités à risque, soit les lieux de convergence d’un certain nombre d’individus. Lorsque vous vous apercevez que plusieurs individus exercent des activités associatives au même endroit ou fréquentent la même salle de sport, ces adresses méritent une attention particulière. Aussi demandons-nous aux services de mener des investigations. Ce sont des actions qui ne sont pas faites par l’UCLAT.
Par ailleurs, lorsque des individus signalés ne peuvent pas localement faire l’objet d’une entrave par les services de police, c’est-à-dire qu’ils sont suivis, surveillés, mais que l’on ignore, par exemple, comment les empêcher de fréquenter tel site sensible, nous avons la possibilité d’intervenir grâce aux contacts et aux échanges permanents que nous avons avec divers opérateurs nationaux. Plusieurs agents privés de sécurité ont ainsi fait l’objet d’un retrait de carte professionnelle. Nous avons la possibilité d’alerter le CNAPS sur le fait que, dans tel département ou sur tel territoire, tout porte à croire que telle personne affectée sur tel site peut poser des problèmes de sécurité. Nous nous assurons aussi auprès des préfets et des services locaux que le travail est effectivement accompli, nous leur donnons des priorités d’action, car notre vision nationale nous permet de distinguer des éléments qu’ils n’aperçoivent pas forcément au niveau départemental. En échange, ils sont en mesure de nous alerter sur tel problème, telle difficulté, et de nous demander d’appuyer leur démarche lorsqu’un interlocuteur ne leur répond pas.
Nous effectuons donc un travail de pilotage fin, de suivi attentif et individuel, qui ne fait pas partie des missions de l’UCLAT.
M. le président Jean-Jacques Urvoas. Dans le cadre de l’état d’urgence, avez-vous été associé d’une manière ou d’une autre à la définition des cibles qui ont fait l’objet de perquisitions administratives ?
M. Olivier de Mazières. Oui. Les mesures qui ont immédiatement suivi la mise en œuvre de l’état d’urgence ont été lancées assez massivement. Et, au bout de quelques jours, un recentrage important a été fait sur la radicalisation. La mise en œuvre de ces mesures a été facilitée grâce aux habitudes de travail en commun qui avaient été prises dès le mois de juillet. Et le fichier permettait déjà de flécher un certain nombre de personnes et de « cibles » potentielles de perquisition ou d’assignation à résidence.
Aujourd’hui, plus de 70 % des personnes assignées à résidence, hors le cas particulier des personnes qui l’ont été au titre de la COP21, sont inscrites dans le FSPRT, de même que plus de 60 % des personnes perquisitionnées administrativement, à la fois en zone de police et de gendarmerie. La proportion est plus faible dans la zone de la préfecture de police. À la suite des attentats, nous avons croisé un certain nombre de données qui nous permettaient d’isoler des facteurs de risque prioritaires. Nous avons croisé trois types de données : les fratries — c’est d’ailleurs un phénomène que nous avions déjà vu apparaître lors de la constitution du FSPRT —, les infractions à la législation sur les armes et les déplacements fréquents à l’étranger, mais pas nécessairement sur les terrains de guerre. Cela nous a permis d’isoler plusieurs centaines de personnes qui ont été proposées comme « cibles » potentielles de perquisitions administratives, voire d’assignation à résidence.
M. le président Jean-Jacques Urvoas. Ce chiffre correspond-il aux premiers temps de l’état d’urgence ou à l’ensemble de la période ?
M. Olivier de Mazières. Nous avons effectué ces signalements au cours de la première semaine suivant les attentats. Nos priorités ont ensuite évolué et nous nous sommes concentrés sur le risque métier. Nous ne voulions pas exclure a priori d’autres modes opératoires que ceux du 13 novembre.
Tous les matins, mon équipe passe en outre en revue les nouveaux signalements enregistrés par le CNAPR et appelle l’attention des préfets dans la journée sur telle ou telle situation qui doit être traitée en urgence — par exemple en cas de soupçon de départ à l’étranger de mineurs.
M. le président Jean-Jacques Urvoas. Le ministre de l’Intérieur nous a indiqué qu’une grille évaluant le basculement dans le fanatisme et la radicalisation violente avait été adressée aux services déconcentrés de l’État dans l’ensemble du pays. Avez-vous élaboré ces indicateurs ?
M. Olivier de Mazières. L’UCLAT et le comité interministériel pour la prévention de la délinquance (CIPD) ont accompli ensemble ce travail intéressant et indispensable, qui nous donne un substrat idéologique pour comprendre le phénomène de la radicalisation.
M. le président Jean-Jacques Urvoas. Depuis l’entrée en vigueur de l’état d’urgence, êtes-vous informé des mesures administratives prises dans l’ensemble du territoire ?
M. Olivier de Mazières. Oui, via les préfets de zone. Il est facile d’avoir connaissance du bilan quantitatif, mais nous n’avons eu accès aux données qualitatives — comment se déroulaient les perquisitions ? constatait-on un phénomène d’assèchement ? Comment le compenser dans les perquisitions administratives ? Comment les élus, les médias et la population percevaient-ils l’état d’urgence ? — qu’après un certain temps et par le biais du cabinet du ministre. Le développement des indicateurs demandés par la commission des Lois nous a également permis d’avoir accès à des informations fiables et complètes.
M. le président Jean-Jacques Urvoas. Le fichier a vocation à fournir une information exhaustive des personnes entrées dans un processus de radicalisation. S’il était parfait, suffirait-il pour cerner les cibles ?
M. Olivier de Mazières. Oui et non. Dans l’absolu, vous avez raison, car il est conçu pour être largement utilisé ; le ministre a insisté à plusieurs reprises sur son souhait de ne pas privilégier d’axe prioritaire dans l’analyse d’une personne fichée au FSPRT, car il a constaté à raison que le passage d’un signal faible, voire très faible, à l’action pouvait être extrêmement rapide et que les signaux les plus forts étaient déjà les mieux pris en compte. Les perquisitions administratives n’ont d’ailleurs pas tellement concerné le haut du spectre — sur lequel la DGSI enquête — et pas du tout les objectifs déjà judiciarisés, mais ont souvent été utilisées pour lever des doutes.
M. le président Jean-Jacques Urvoas. Quel bilan qualitatif dressez-vous de l’état d’urgence ?
M. Olivier de Mazières. Les suites judiciaires aux actions de la police reposent sur des bases de droit commun ; on a relevé peu d’infractions terroristes et celles-ci concernaient surtout des cas d’apologie et d’appel au terrorisme.
Il convient de ne pas mesurer l’efficacité du dispositif de l’état d’urgence à l’aune du nombre d’incriminations pour terrorisme et de procédures judiciaires engagées. Nous avons en effet porté de rudes coups à des réseaux de trafiquants d’armes et de stupéfiants, qui alimentent les personnes radicalisées en moyens logistiques. Un mois après les attentats, nous avions en outre saisi 1 million d’euros en liquide. Cela a permis aux groupes d’interventions régionaux (GIR) et au service du traitement du renseignement et de l’action contre les circuits financiers clandestins (Tracfin) de lancer des enquêtes. Nous continuons, par ailleurs, d’exploiter les matériels informatiques saisis. Cette action de déstabilisation de la criminalité et de ses liens avec la radicalisation se révèle fort utile. En outre, le millier d’opérations effectuées la première semaine suivant les attentats a permis à l’État d’envoyer un message de fermeté pour rassurer la population et de jeter les fondements de l’action de demain contre le terrorisme. Les mesures prises au titre de l’état d’urgence nous apportent une connaissance beaucoup plus fine de la réalité de la radicalisation ; nous avons ainsi réévalué la dangerosité de certaines personnes et relativisé la menace présentée par d’autres.
Mme Sandrine Mazetier. L’EMOPT entretient-il des relations avec la direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI) ?
Aucune personne auditionnée n’a évoqué l’action de la Direction générale de la sécurité extérieure (DGSE), alors que l’on parle de terroristes issus de services de Saddam Hussein.
Qu’est-ce que le CNAPR ?
Quel est votre degré de connaissance du FSPRT, vous qui pouvez consulter l’ensemble des fiches ? Quel est celui de l’EMOPT ?
Où se trouve la trace de votre intervention pour qu’un nouveau service suive une personne fichée ayant décidé de déménager ?
Pourquoi peu des gens faisant l’objet de mesures dans le cadre de l’état d’urgence dans le périmètre de la préfecture de police (PP) étaient-ils fichés ?
M. Olivier de Mazières. Le Centre national d’assistance et de prévention de la radicalisation (CNAPR), géré par l’UCLAT, est le numéro vert destiné à aider les familles et à prévenir la radicalisation violente.
L’EMOPT et l’UCLAT disposent d’une vision complète des données sur l’ensemble du territoire, mais ma structure ne peut ni créer ni supprimer de fiche. Nous suivons le déplacement des personnes fichées, le signalement de ces mouvements incombant au service chef de file. Ce dernier peut envoyer une alerte à n’importe quel autre service dans le pays ayant accès au FSPRT pour l’informer de l’arrivée d’une personne dans son périmètre. L’EMOPT s’assure que le service destinataire de cette notification la prend effectivement en compte.
Je suis particulièrement sensible à la coopération avec les Douanes : dans mon précédent poste, j’étais chargé de la sécurité en Corse et je veillais à décloisonner l’activité des services ; j’ai ainsi éprouvé la qualité exceptionnelle des moyens et des compétences des Douanes. À l’EMOPT, j’ai repris cet objectif de décloisonnement et, après ma nomination, j’ai tout de suite rencontré le directeur national des enquêtes douanières. Nous avons échangé nos informations sur quelques dossiers. Comme la direction centrale de la police aux frontières (DCPAF), les Douanes évoluent principalement, mais non exclusivement, aux frontières. Pour qu’un préfet et l’EMOPT suivent un individu, celui-ci doit être ancré dans le territoire national. Les personnes ayant commis les attentats du 13 novembre dernier résidaient à l’étranger et n’avaient pas vocation à être suivies par l’EMOPT. C’est à la DGSI de se mettre en relation avec la DGSE pour surveiller de tels individus, si bien que l’EMOPT ne travaille pas avec la DGSE.
Il me semble que deux facteurs peuvent expliquer l’écart entre le chiffre des individus ciblés par la PP qui étaient fichés et celui constaté dans le reste du pays : la PP s’est, dans un premier temps, concentrée sur des objectifs de droit commun, mis en avant par sa direction de la sécurité de proximité de l’agglomération parisienne (DSPAP), et n’a traité que dans un second moment des cas transmis par sa direction du renseignement (DRPP) ; elle a massivement utilisé l’état d’urgence pour lever les doutes entretenus au sujet de personnes qui n’étaient pas forcément inscrites encore au FSPRT.
M. le président Jean-Jacques Urvoas. Nous vous remercions, monsieur le préfet, de votre disponibilité et des réponses que vous avez apportées à nos questions.
——fpfp——
AUDITION DE M. ROBERT GELLI, DIRECTEUR DES AFFAIRES CRIMINELLES ET DES GRÂCES AU MINISTÈRE DE LA JUSTICE
Compte rendu de l’audition, non ouverte à la presse, du vendredi 8 janvier 2016
M. le président Jean-Jacques Urvoas. Conformément aux dispositions de l’article 6 de l’ordonnance du 17 novembre 1958, je dois vous demander, monsieur le directeur des affaires générales et des grâces, de prêter le serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité.
(M. Robert Gelli prête serment.)
M. Robert Gelli, directeur des affaires générales et des grâces au ministère de la Justice. Je dirai dans un premier temps ce qu’a fait la direction des affaires criminelles et des grâces (DACG) depuis le 13 novembre 2015. Notre premier souci a été d’informer les parquets et de les mobiliser sur les problématiques posées et les nouveaux dispositifs mis en place. Depuis le 13 novembre et jusqu’à la pause de Noël, nous leur avons ainsi adressé deux circulaires et sept dépêches, ce qui est beaucoup en un peu plus d’un mois.
La première circulaire a été celle signée par la Garde des sceaux et le ministre de l’Intérieur dans la nuit du 13 au 14 novembre et adressée aux parquets dès dix heures le samedi matin. Nous avons adressé une dépêche aux parquets le même jour, dans l’après-midi, afin de mettre en place un dispositif de remontée d’information. Nous avons ensuite envoyé différentes dépêches pour préciser le cadre juridique de la loi prorogeant l’état d’urgence et mettant en place de nouvelles modalités de police administrative.
Nos deux dernières circulaires datent du 11 et du 18 décembre. La première était destinée à assurer l’articulation entre les décisions judiciaires et les assignations à résidence prononcées par les préfets. La seconde, pas vraiment liée à l’état d’urgence, est tout de même importante, car elle porte sur la lutte contre le terrorisme, et notamment sur l’articulation entre le parquet de Paris et les parquets locaux dans les hypothèses d’attentats multiples : anticipant sur des situations qui peuvent malheureusement se produire, elle définit de manière précise le rôle des parquets locaux dans l’attente de l’arrivée du parquet de Paris, ainsi que leurs missions dans la prise en charge des victimes.
Parallèlement, nous avons mis en place, dans notre « foire aux questions », une rubrique spéciale sur l’état d’urgence, et nous avons élaboré deux « focus DACG » — ce sont des fiches à destination des parquets que nous mettons en ligne sur notre site et qui leur sont également distribuées — sur l’état d’urgence : l’un dressant un bilan avant l’entrée en vigueur du nouveau régime, c’est-à-dire avant prolongation de la première phase, sous le régime de la loi de 1955, et l’autre présentant le régime applicable à compter du 21 novembre 2015, aussi bien sur la question des perquisitions administratives que sur celle de la violation des mesures d’interdiction.
Enfin, nous avons établi les références de tous les codes NATINF (nature d’infraction) pour engager les poursuites en cas de violation d’une mesure prise dans le cadre de l’état d’urgence, et produit des tableaux comparatifs entre les différents régimes, afin que les parquets disposent de tous les outils possibles. Ces mesures vous donnent une idée de la mobilisation importante de la DACG, mais aussi des parquets et parquets généraux.
Comme je viens de l’indiquer, nous avons mis en place dès le premier jour un dispositif de remontée d’informations qui nous a permis de recueillir des données statistiques. Les remontées sont de deux sortes. Le premier dispositif est celui que nous avons mis en place à la suite des attentats de janvier 2015 : il porte sur les événements qu’on pourrait qualifier de « post-attentat », à savoir les apologies de terrorisme et autres infractions, atteintes aux personnes ou dégradations, par exemple à caractère raciste, liées aux attentats. Au 5 janvier 2016, 662 affaires ont été signalées à la DACG en lien avec les événements du 13 novembre 2015.
Concernant plus particulièrement votre mission, nous avons également mis en place dès le premier jour un tableau de bord de remontée d’informations sur les perquisitions administratives, de façon à suivre le devenir de ces perquisitions au plan judiciaire. Les éléments vous ont été transmis. Nous ne prétendons pas à l’exhaustivité, car il s’agit de dispositifs manuels : chaque jour les parquets alimentent un tableau, qui passe par le parquet général, lequel l’adresse à son tour à la DACG. Il peut donc exister, à l’unité ou à la dizaine près, des décalages. Nous constatons d’ailleurs déjà des décalages avec le ministère de l’Intérieur sur le nombre de perquisitions administratives. En revanche, je pense que nos chiffres sur les suites judiciaires sont bons, car ce sont là des chiffres par définition maîtrisés par la justice. Au 5 janvier 2016, 530 perquisitions ont abouti à une procédure judiciaire.
Ce suivi est très exigeant, car les données judiciaires sont des données évolutives et non figées ; vous savez comme moi qu’une suite judiciaire n’est pas toujours immédiate, il peut s’écouler un certain temps avant qu’une décision soit prise. Ces contraintes sont inhérentes au fonctionnement même de l’institution judiciaire. C’est une exigence très forte à l’égard des parquets, et, s’agissant du premier dispositif de remontée d’informations, il risque d’être difficile de leur demander de s’inscrire dans la longue durée.
Dans un premier temps, nous avons demandé aux parquets de nous faire des remontées quotidiennes, puis nous sommes passés à une remontée deux fois par semaine : le mardi, pour que l’information soit à jour le mercredi, jour du Conseil des ministres, et le vendredi.
Les infractions se répartissent en trois grands blocs : un bloc « armes » — 199 procédures —, un bloc « stupéfiants » — 183 procédures — et un bloc « autres », qui peut concerner des faux, des séjours irréguliers, des outrages ou rébellions, ainsi que toutes autres situations, pas forcément significatives.
Une vingtaine d’infractions susceptibles de se rattacher au terrorisme ont été recensées. Deux d’entre elles ont donné lieu à une saisine du parquet de Paris et à des enquêtes. La première concerne un individu susceptible de se rendre en Syrie, la seconde un individu catégorisé comme radical, salafiste, chez lequel ont été retrouvés des armes et différents documents laissant penser qu’il pourrait être en contact avec l’État islamique ; ce dernier individu a été mis en examen du chef d’association de malfaiteurs et placé sous mandat de dépôt le 18 décembre.
Il y a ensuite des faits en lien avec le terrorisme, mais dont le parquet de Paris ne s’est pas saisi, en tout cas pas tout de suite, relatifs à la découverte d’éléments qualifiés d’apologie du terrorisme, tels que des vidéos de propagande. Ces faits sont pour l’instant traités localement, par des poursuites ou des enquêtes. Au total, une vingtaine d’affaires peuvent être directement liées au terrorisme. Cela ne signifie pas que les autres ne le soient pas, mais les éléments recueillis ne permettent pas pour le moment d’affirmer qu’elles le sont.
J’en viens aux interrogations exprimées par les parquets. Nous avons très rapidement reçu des questions sur la notion de domicile. La loi de novembre a supprimé toute ambiguïté à cet égard.
Nous avons en outre reçu des questions sur la possibilité de procéder, dans le cadre de la procédure administrative, à la saisie de documents ou de matériel informatique. Ces questions ont été réglées par nos circulaires, dépêches et fiches focus, ainsi que par la loi de novembre.
Nous avons reçu des questions sur la problématique du placement en garde à vue. Notre position a été que le placement en garde à vue n’avait pas vocation à remonter au début de la perquisition administrative, qui n’est pas stricto sensu une mesure coercitive et n’est pas du tout une mesure judiciaire, et que, de ce fait, le placement en garde à vue ne démarrait qu’à compter de la constatation d’une infraction.
Nous avons toujours souligné, y compris devant le Conseil d’État, qu’une séparation très claire devait être établie entre la procédure administrative et la procédure judiciaire. Si le procureur de la République doit être informé de la réalisation d’une perquisition administrative, cela ne veut pas dire qu’il doit en recevoir la maîtrise ni donner des instructions aux préfets. La loi de 1955, au départ, ne prévoyait absolument pas cette articulation entre action administrative et action judiciaire. Le procureur est informé pour qu’il puisse savoir, en tant que garant des libertés, qu’il se passe quelque chose dans son ressort. Cette information lui permet également de vérifier qu’une procédure judiciaire que la perquisition administrative pourrait gêner n’est pas déjà en cours, non pas pour dire au préfet de ne pas procéder à la perquisition, mais seulement pour l’informer, par exemple, qu’une perquisition est déjà prévue dans le cadre de cette autre procédure judiciaire.
Des questions ont également été posées sur le basculement vers un régime judiciaire. Elles ont été rapidement réglées. Dès lors qu’une infraction est constatée, le régime bascule dans du judiciaire. La présence de l’officier de police judiciaire (OPJ) a justement été prévue pour faciliter cette bascule. Cela n’a pas suscité de difficulté opérationnelle sur le terrain. Certains procureurs se sont rendus sur les lieux des perquisitions administratives : quand je l’ai appris, j’ai aussitôt indiqué que ce n’était pas la place du procureur. Les procureurs ne se déplacent pas en règle générale : il n’y a donc pas de raison qu’ils le fassent dans le cadre d’une perquisition administrative.
Certaines questions juridiques sont un peu plus complexes et commencent à poser problème devant des juridictions. Ainsi, devant une juridiction de l’ordre judiciaire a été invoquée l’insuffisante motivation d’un ordre de perquisition. Le tribunal saisi de ce motif de nullité par la défense a estimé devoir faire un supplément d’information pour demander en quoi le comportement de la personne concernée représentait une menace pour la sécurité ou l’ordre public de nature à justifier la perquisition à son domicile. Le jugement a été renvoyé au 22 janvier. Nous attendons avec impatience la décision du tribunal.
Par ailleurs, il a été reproché à un ordre de perquisition d’être trop général en ce sens qu’était visée une adresse correspondant à un immeuble, sans précision ni du numéro d’appartement ni de la personne. L’ordre était d’autant plus vague et imprécis qu’il ne présentait qu’une motivation « bateau » : « Vu l’état d’urgence, nous décidons… » Ce sera jugé le 13 janvier 2016. Je vous communiquerai ces décisions.
Certaines autres interrogations n’ont pas donné lieu à des demandes de nullité, mais il n’est pas impossible qu’elles reviennent par la suite. Cela concerne notamment des suspicions de détournement de la finalité des perquisitions administratives.
D’autres difficultés concernent le cadre opérationnel. Dans une affaire, les services de police, se trompant d’appartement, ont enfoncé la porte, et un enfant de six ans a été blessé par des éclats de bois. Une plainte a été déposée à Nice, et l’inspection générale de la police nationale (IGPN) saisie.
M. Sébastien Pietrasanta. D’abord une remarque : sur les 530 perquisitions qui ont engendré des poursuites judiciaires, vingt ont un lien avec le terrorisme, dont deux ont nécessité la saisine du parquet antiterroriste ; le pourcentage me paraît faible.
Ma première question, qui porte sur l’articulation entre le parquet antiterroriste de Paris et les parquets locaux, m’a été inspirée par les faits qui se sont déroulés à Valence, où une voiture a foncé sur des militaires en faction devant la mosquée. Quand j’ai entendu le procureur de Valence prétendre que cette affaire ne présentait pas de caractéristiques terroristes, j’ai eu l’impression qu’il n’était pas au fait de la loi antiterroriste du 13 novembre 2014 qui a créé l’incrimination « d’entreprise terroriste individuelle ». Une voiture lancée sur une personne ou un groupe est une arme par destination. Comment doit-on interpréter la non-saisine du parquet antiterroriste dans cette affaire ? Est-ce la manifestation d’une volonté de le décharger ? Le procureur de la République de Valence a-t-il vraiment considéré qu’il n’y avait pas d’éléments justifiant une telle saisine, ce qui me laisse un peu perplexe ?
Ce matin, François Molins, procureur de la République de Paris, a indiqué que, après avoir été récemment renforcé, le parquet antiterroriste compte onze magistrats. Si ceux-ci ne sont pas débordés pour l’instant, ce ne sera pas le cas dans les mois à venir, a-t-il expliqué. Qu’en pensez-vous ? Même s’il n’y a eu que deux saisines supplémentaires, les événements du 13 novembre et l’instauration de l’état d’urgence n’ont-ils pas changé la donne ?
En ce qui concerne l’apologie du terrorisme, pourriez-vous nous donner des informations sur les dossiers de ce type qui ont été traités depuis les attentats des 7, 8 et 9 janvier 2015 ?
M. Robert Gelli. Depuis le 13 novembre dernier, nous avons recensé 279 dossiers d’apologie du terrorisme sur un total de 662 affaires signalées hors perquisitions administratives, c’est-à-dire concernant notamment des faits commis sur la voie publique. Lors des perquisitions administratives, qui donnent lieu à un comptage différent, nous avons une vingtaine de cas où les documents et objets trouvés laissent penser que la personne est liée au terrorisme.
S’agissant de l’articulation entre le parquet de Paris et les parquets locaux, elle est immédiate dès qu’une affaire présente une connotation terroriste. Le parquet de Paris décide de s’en saisir si ce caractère terroriste s’affirme au vu de certains critères : la personne est-elle déjà connue des services spécialisés ? Est-elle reliée à un réseau ou à une organisation ? D’ailleurs, même dans le cas où le parquet de Paris renonce à s’en saisir au départ, il peut récupérer le dossier à tout moment, par exemple si la police judiciaire découvre des liens entre la personne en cause et d’éventuels commanditaires à l’étranger. Si de telles connexions apparaissaient dans l’affaire de Valence, le parquet de Paris reprendrait la main. L’appréciation se fait au cas par cas.
Quant aux effectifs du parquet antiterroriste, François Molins les estime suffisants tout en anticipant les besoins futurs si la situation se prolonge — et nous pouvons légitimement craindre que cela soit le cas. En outre, il faut envisager toute la durée du processus judiciaire d’un dossier : la période d’intense mobilisation pour le parquet que constitue le moment du flagrant délit ; la phase de règlement du dossier ; l’audience. Nous redoutons le moment où tous ces dossiers arriveront à l’audience, car l’afflux sera problématique tant pour le parquet que pour le siège. Quand il faudra juger toutes ces affaires, dont certaines en cour d’assises, nous rencontrerons de vraies difficultés.
M. le président Jean-Jacques Urvoas, rapporteur. Dans la loi que nous avons adoptée en novembre, nous avons précisé que les comptes rendus des perquisitions devaient être communiqués sans délai aux procureurs. Savez-vous comment cela se passe ? Quelle forme cela prend-il ?
M. Robert Gelli. Quand une découverte est faite lors de la perquisition, l’officier de police judiciaire (OPJ) appelle immédiatement la permanence pénale du parquet et le processus judiciaire est enclenché. La présence de l’OPJ permet cette information simple et rapide. Si la perquisition ne donne rien, le procureur en sera informé par un compte rendu écrit très succinct, du genre « résultat : néant ».
M. le président Jean-Jacques Urvoas. Nous avons procédé à plusieurs déplacements et, chaque fois, les préfets ont invité les procureurs, voire les procureurs généraux. Nous avons constaté que les interprétations différaient concernant le moment où débute la garde à vue : invoquant un principe de précaution, certains procureurs font démarrer la garde à vue dès le début de la perquisition, même si la direction des affaires criminelles et des grâces leur demande de la faire coïncider avec la constatation de l’infraction. Est-il normal qu’un procureur décide de faire comme il veut en la matière ?
M. Robert Gelli. La direction des affaires criminelles et des grâces écrit toujours sous réserve de l’appréciation souveraine des juridictions du fond. En l’occurrence, la différence d’appréciation n’est pas dramatique.
De notre point de vue, on ne peut pas faire démarrer une garde à vue à un moment où la personne n’est pas retenue. Dans une affaire ordinaire, le gardien de la paix interpelle sur la voie publique une personne qui est en train de commettre une infraction, il la conduit au commissariat où un OPJ notifie une garde à vue commençant au moment de l’interpellation, c’est-à-dire à l’instant où la personne a été privée de liberté. Lors d’une perquisition administrative, la personne n’est privée de liberté qu’au moment où des découvertes impliquent le déclenchement d’une procédure judiciaire. Le principe de précaution conduit parfois à une paralysie du système et à des difficultés pratiques. Comment justifier juridiquement que la garde à vue d’une personne débute à un moment où celle-ci était libre ? Pour ma part, je ne sais pas le faire.
M. le président Jean-Jacques Urvoas. Avez-vous suggéré que les préfets associent les parquets à la définition des cibles ? Avez-vous au contraire émis des réserves à ce sujet ?
M. Robert Gelli. Nous avons émis des réserves, car nous estimons que les perquisitions administratives et judiciaires sont complètement différentes. Les motivations des perquisitions administratives liées à la situation d’état d’urgence relèvent du préfet et du ministère de l’Intérieur. Les procureurs de la République n’ont pas à définir des cibles. Ils ont été associés à ces décisions au début de l’état d’urgence pour une raison simple : aussi bien les préfets que les OPJ ou les services de police et de gendarmerie se sont tournés spontanément vers eux. Le préfet n’est pas un spécialiste des perquisitions, ce n’est pas son métier ; et les OPJ ont l’habitude d’être en relation avec le procureur de la République. Finalement, le procureur de la République s’est retrouvé…
M. le président Jean-Jacques Urvoas. …conseiller technique du préfet ! (Sourires.)
M. Robert Gelli. Un peu… C’est même allé beaucoup plus loin, car, dès les premières heures, il a fallu mettre en place les états-majors de sécurité. Une certaine émulation a suivi : comment fait-on ? A-t-on des objectifs précis ? Mais le ministère de la justice considère que les procureurs de la République n’ont pas à fixer de cibles, d’objectifs. Normalement, ce sont des renseignements qui ne sont pas à disposition de l’autorité judiciaire.
M. Dominique Raimbourg. J’aimerais revenir sur la garde à vue. Vous avez raison d’un point de vue juridique, mais, au moment de la perquisition, une espèce de coercition s’exerce tout de même sur le perquisitionné. Dans un souci de protection des libertés, ne serait-il pas souhaitable de considérer que la garde à vue commence au début de la perquisition ?
D’autre part, en ce qui concerne l’appréciation de la validité de la perquisition, quelle sera la position de la direction des affaires criminelles et des grâces si, dans les décisions qui sont attendues, les tribunaux exigent du préfet qu’il motive ses perquisitions à la manière d’un juge d’instruction ou d’un juge des libertés et de la détention (JLD) ? Par définition, la perquisition administrative n’a pas à être aussi motivée qu’une perquisition judiciaire : elle peut être décidée sur la foi d’un simple renseignement et non pas d’indices.
Ma dernière question concerne cette affaire où, par erreur, une porte a été cassée et un enfant blessé. Y a-t-il eu un versement de provisions ou la mise en place d’une procédure d’indemnisation rapide afin d’éviter l’amertume des gens victimes de cette erreur ?
M. Robert Gelli. Quitte à me répéter, je maintiens qu’on ne peut pas faire remonter le placement en garde à vue à un moment où la personne concernée était libre. On nous dit d’ailleurs que cette perquisition administrative s’exerce sous le contrôle du juge administratif. On se pose la question quand il y a une garde à vue. Et si, au bout de quatre heures, la perquisition administrative ne donne lieu à aucune procédure judiciaire ? Quel sera le régime de ces quatre heures ? Jusqu’à présent, on a toujours considéré que la perquisition administrative était une mesure de police administrative relevant du seul juge administratif, parce que n’obéissant pas à un régime de contrainte. Je reste sur ma position, car je ne veux pas que l’on mélange les registres et que, d’une certaine manière, l’on justifie judiciairement quelque chose qui n’est pas contrôlé par le judiciaire. C’est trop facile.
M. le président Jean-Jacques Urvoas. Seriez-vous favorable à l’idée que le juge judiciaire soit chargé de contrôler les assignations à résidence qui dépassent une certaine durée ? En matière de droit des étrangers, c’est le cas.
M. Robert Gelli. C’est le cas parce qu’il y a aussi une rétention administrative. L’assignation à résidence de l’étranger est soumise au contrôle du juge administratif et non du juge judiciaire. C’est la rétention qui est soumise au juge judiciaire.
M. Dominique Raimbourg. Sauf erreur de ma part, le projet de loi qui va nous être soumis prochainement prévoit la possibilité de retenir le perquisitionné pendant la perquisition, ce qui va changer un peu la donne : on aura affaire à une personne faisant l’objet d’une coercition.
M. Robert Gelli. C’est le débat permanent. D’un côté, on dit qu’il s’agit d’une disposition de police administrative qui ne permet pas de mesure de contrainte, sauf à ce que celle-ci soit contrôlée par le juge judiciaire ou donne lieu à un recours devant ce dernier. D’un autre côté, on affirme que c’est le juge administratif qui est compétent puisqu’il s’agit d’une mesure de police administrative. À ce stade, la question n’est pas réglée. On a une possibilité de retenir la personne pour éviter les difficultés liées au fait qu’il n’y a pas de rétention, mais sans prévoir l’intervention du juge judiciaire. Dans le cas d’une perquisition administrative, je ne vois pas quand et comment le juge judiciaire va intervenir. Ce n’est pas réglé.
S’agissant de la validité de la perquisition, le juge judiciaire est tout à fait compétent pour apprécier la légalité — mais pas l’opportunité — d’une mesure qui fait grief à la personne et qui sert de fondement à la poursuite. Il est tout à fait dans son rôle de vérifier la légalité et donc la régularité de la mesure. Cela ne veut pas dire qu’il va devoir apprécier la motivation, suivant l’argumentation de la défense que je vous ai citée. En revanche, s’il n’y a absolument aucune motivation ou si la perquisition se déroule dans un autre endroit que celui qui était indiqué, le juge judiciaire aura matière à apprécier.
Votre question sur la procédure d’indemnisation rapide, relève de la compétence du ministère de l’Intérieur. Nous avons suffisamment à faire avec les erreurs commises dans le cadre de procédures judiciaires pour ne pas nous occuper de celles qui sont commises dans le cadre des procédures administratives…
M. le président Jean-Jacques Urvoas. Selon vous, monsieur le directeur, la jonction entre les procédures administratives et judiciaires s’opère-t-elle aisément ? Pensez-vous au contraire qu’il existe un risque de nullité de certaines procédures judiciaires engagées après les procédures administratives liées aux perquisitions ?
M. Robert Gelli. Pour l’instant, nous n’avons pas eu de problèmes, hormis les cas que j’ai évoqués et qui posent la question de la légalité de l’ordre de perquisition. Globalement, la bascule s’est faite sans difficulté, notamment grâce à la présence d’OPJ.
M. le président Jean-Jacques Urvoas. Sur un plan général, si on le compare au régime des perquisitions judiciaires, diriez-vous que le régime des perquisitions administratives souffre de quelques lacunes ?
M. Robert Gelli. On ne peut pas comparer ces deux types de perquisitions. Les perquisitions administratives sont et doivent rester exceptionnelles ; elles ne se pratiquent que dans le cadre de l’état d’urgence. Leur but est de rechercher des informations, des renseignements qui peuvent déboucher sur des poursuites judiciaires, mais non de rechercher des infractions. Quant aux perquisitions judiciaires, elles ont lieu au cours d’enquêtes qui ont permis d’étayer les soupçons par divers moyens, tels que les écoutes téléphoniques. Dans ce cadre-là, on ne perquisitionne pas chez une personne sans avoir de la matière, ou alors c’est qu’elle a été interpellée dans la rue en train de vendre de la drogue et qu’on veut savoir s’il n’y en a pas plus chez elle.
M. le président Jean-Jacques Urvoas. Avez-vous suggéré aux parquets qui risquent d’avoir une activité débordante de s’organiser d’une manière particulière ? Nous avons pu observer que certains avaient organisé des permanences dédiées à l’état d’urgence. Étaient-ce des initiatives locales ou une suggestion du ministère ?
M. Robert Gelli. Il n’y a pas eu d’écrits, mais de nombreuses réunions ont été organisées. Pour ma part, j’ai réuni à deux reprises tous les procureurs généraux pour évoquer les questions d’organisation liées à l’état d’urgence. Les initiatives sont prises ensuite sur le plan local, en particulier dans les juridictions importantes.
M. le président Jean-Jacques Urvoas. Tous les procureurs nous ont vanté l’extraordinaire mobilisation de tous les magistrats, y compris ceux du siège.
M. Robert Gelli. Absolument ! Dans le cadre de la dernière circulaire de décembre 2015, nous évoquons la question des attentats, voire des multi-attentats, qui peuvent se produire en province à tout moment du jour et de la nuit. Il a été demandé expressément aux parquets généraux de veiller à ce qu’une organisation préétablie permette de rapatrier du monde et de mettre en place une cellule de crise en cas d’attentat. Nous l’avons prévu non pas pour la gestion de l’état d’urgence classique, mais pour faire face à d’éventuels attentats.
M. le président Jean-Jacques Urvoas. Nous vous remercions, monsieur le directeur, pour votre disponibilité et vos réponses.
——fpfp——
TABLE RONDE RÉUNISSANT DES RESPONSABLES OPÉRATIONNELS DE LA GENDARMERIE NATIONALE
Compte-rendu de la table ronde, non ouverte à la presse, du lundi 11 janvier 2016, réunissant des responsables opérationnels de la gendarmerie nationale : Colonel Marc Boget, commandant le groupement de gendarmerie départementale de l’Oise ; Colonel Frédéric Boudier, commandant le groupement de gendarmerie départementale des Bouches-du-Rhône ; Colonel Marc Payrar, commandant le groupement de gendarmerie départementale de la Vendée ; Général Michel Pidoux, commandant la région de gendarmerie du Centre-Val de Loire et le groupement de gendarmerie départementale du Loiret ; Colonel David Rey, commandant le groupement de gendarmerie départementale de Saône-et-Loire ; Colonel Charles-Antoine Thomas, commandant le groupement de gendarmerie départementale du Val-d’Oise.
M. le président Jean-Jacques Urvoas. Dans le cadre du contrôle de la mise en œuvre de l’état d’urgence, la commission des Lois a procédé à plusieurs déplacements à travers le territoire national. Nous avons demandé au général Favier, directeur de la gendarmerie nationale, s’il serait possible d’organiser une rencontre avec des responsables opérationnels de la gendarmerie nationale des départements que nous n’avons pas eu l’occasion de visiter et nous vous remercions très sincèrement, messieurs, d’avoir accepté notre proposition de participer à cette table ronde qui se déroule à huis clos.
Comme nous sommes dotés de pouvoirs identiques à ceux d’une commission d’enquête, je vais demander à chacun d’entre vous de prêter le serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité.
Le général Michel Pidoux, les colonels Charles-Antoine Thomas, Marc Boget, Marc Payrar, David Rey et Frédéric Boudier prêtent serment.
Vous pourriez, dans un premier temps, présenter les unités que vous commandez et préciser les conditions dans lesquelles vous avez été amenés à appliquer les dispositions prises pendant l’état d’urgence.
Général Michel Pidoux, commandant la région de gendarmerie du Centre-Val de Loire et du groupement de gendarmerie départementale du Loiret. Je commande depuis 2013 la région de gendarmerie du Centre, devenue Centre-Val de Loire après la réforme de l’organisation territoriale, et j’ai pris, à l’été 2014, le commandement du groupement départemental du Loiret, dans le cadre de la réorganisation territoriale de la gendarmerie.
Le département du Loiret traite la moitié des signalements liés à la radicalisation de la région Centre-Val de Loire, laquelle regroupe la moitié des signalements de ce type dans la zone Ouest.
Le groupement a procédé à vingt-cinq perquisitions administratives, qui se sont déroulées sans difficulté particulière. Je bénéficie du renfort du peloton spécialisé de protection de la gendarmerie (PSPG) attaché à la centrale nucléaire de Dampierre-en-Burly, apport de qualité dans la sécurisation des interventions.
Hors état-major, le groupement – compagnies, escadron départemental de sécurité routière (EDSR) et PSPG de Dampierre – a un effectif de 650 militaires. L’état-major, qui a été fusionné aux niveaux départemental et régional, compte 155 militaires.
M. le président Jean-Jacques Urvoas. À combien de perquisitions a participé le PSPG ?
Général Michel Pidoux. Il a pris part à plus de vingt perquisitions sur vingt-cinq. Il est mobilisable pour ces interventions, qui rentrent dans le cœur de ses missions, ce qui nous permet de renforcer la sécurité des opérations.
Colonel Charles-Antoine Thomas, commandant le groupement de gendarmerie départementale du Val-d’Oise. Le groupement départemental du Val-d’Oise, dont j’ai le commandement, est une unité forte de 676 militaires qui ont pour mission de protéger 250 000 habitants répartis sur 138 communes couvrant 75 % du territoire du département. Ce groupement se situe au premier rang en Île-de-France en matière de taux de crimes et délits par gendarme et pour mille habitants et au dixième rang national parmi les groupements départementaux en termes de violences à l’encontre des militaires. Vous le voyez, il s’agit d’un département assez tonique.
À cela s’ajoute une problématique spécifique liée à la radicalisation. Pour la zone de gendarmerie, tous services confondus – direction départementale de la sécurité intérieure (DDSI), service départemental du renseignement territorial (SDRT) –, 107 personnes sont suivies pour radicalisation, 28 sont inscrites au fichier de signalement pour la prévention et la radicalisation à caractère terroriste (FSPRT), dont 18 sont considérées comme étant des cibles à haute valeur ajoutée faisant l’objet d’un suivi de la DDSI.
Nous avons conduit quarante-deux perquisitions administratives, dont 75 % se sont concentrées dans les dix jours suivant la déclaration de l’état d’urgence, car nous avons fait le choix avec le préfet d’agir rapidement. J’ajoute que 40 % d’entre elles ont abouti à des résultats probants.
Colonel Marc Boget, commandant le groupement de gendarmerie départementale de l’Oise. Le groupement de gendarmerie départementale de l’Oise, que je dirige depuis l’été 2012, compte 1 150 militaires qui ont pour mission d’assurer la sécurité de 80 % de la population du département.
Depuis le début de l’état d’urgence, nous avons procédé à quarante et une perquisitions administratives, qui se sont déroulées sans aucune difficulté. Elles ont été exclusivement ciblées sur l’islam radical.
Colonel Marc Payrar, commandant le groupement de gendarmerie départementale de la Vendée. Le groupement de gendarmerie de la Vendée, que je commande depuis septembre 2012, compte 663 militaires. Il a en charge la sécurité des 660 000 habitants de 278 des 282 communes que compte le département.
Nous avons mené onze perquisitions administratives, qui ont conduit à quatre judiciarisations pour une quinzaine de cibles initiales.
Colonel David Rey, commandant le groupement de gendarmerie départementale de Saône-et-Loire. Le groupement de gendarmerie de Saône-et-Loire, que je commande depuis août 2014, regroupe 720 militaires, effectif appelé à augmenter d’ici à l’été 2016.
Mon groupement a procédé à vingt-huit perquisitions administratives : quatre ont été menées avec l’antenne départementale des renseignements intérieurs, une avec le concours du peloton d’intervention interrégional de gendarmerie (PI2G) de Dijon, les autres ayant été effectuées en mobilisant nos propres ressources, à savoir les pelotons de surveillance et d’intervention. Elles ont abouti à la saisie de diverses armes, de quelques stupéfiants et ont permis d’améliorer grandement la connaissance que nous avons du milieu des personnes radicalisées, qui est assez actif dans la partie ouest du département.
Colonel Frédéric Boudier, commandant le groupement de gendarmerie départementale des Bouches-du-Rhône. Je commande le groupement de gendarmerie des Bouches-du-Rhône depuis l’été 2014, après avoir commandé celui de la Loire-Atlantique. Notre unité, forte de 1 100 militaires, couvre un quart de la population du département, soit 500 000 habitants.
Depuis le 16 novembre dernier, nous avons effectué quarante-quatre perquisitions administratives, qui ont donné lieu à quatorze interpellations et une mise sous écrou. Ces opérations ont été en très grande majorité menées avec les moyens organiques dont je dispose : brigades territoriales et pelotons de surveillance et d’intervention. Pour une seule, j’ai eu recours, pour accroître le niveau de sûreté, au PI2G d’Orange en raison de la dangerosité présumée de l’individu ciblé, réputé posséder des armes de guerre et se livrer à un trafic.
M. le président Jean-Jacques Urvoas. Un tel renfort était-il justifié a posteriori ?
Colonel Frédéric Boudier. Non, car cet individu, originaire du Kosovo, ne détenait aucune arme et notre opération ne nous a pas permis de recueillir des éléments tangibles liés à une activité terroriste. Nous avons toutefois procédé à des investigations supplémentaires pour non-déclaration de revenus et dissimulation d’activités.
M. le président Jean-Jacques Urvoas. Dans quelles conditions les perquisitions ont-elles été décidées ? Avez-vous été associés à la définition des cibles ? Maîtrisiez-vous les horaires d’intervention ? Les opérations ont-elles fait l’objet d’un suivi particulier ?
Colonel Frédéric Boudier. Notre mission était claire : chercher des cibles liées de près ou de loin à l’activité terroriste. Toutefois, une problématique particulière se posait à nous. Selon la gradation établie, les cibles suivies par la gendarmerie appartiennent davantage au bas du spectre, la DGSI se consacrant à celles du haut du spectre et le renseignement territorial à l’échelon intermédiaire. Dans ce cadre, nous avons sélectionné celles qui pouvaient être les plus intéressantes dans un délai rapide, car notre volonté première a été d’agir tous azimuts pour ébranler les réseaux existants et éviter les dissimulations. Nous avons été force de proposition : c’est dans notre périmètre de cibles potentielles que nous avons procédé à des choix en priorité.
S’agissant de l’encadrement, chaque perquisition a été conduite en présence soit de mon adjoint soit de moi-même au cours des quinze premiers jours. Une fois les objectifs les plus sensibles atteints, j’ai délégué ce suivi aux commandants de compagnie territorialement compétents.
M. le président Jean-Jacques Urvoas. Qu’en a-t-il été des horaires d’intervention ?
Colonel Frédéric Boudier. Ils ont été libres, mis à part le premier jour où nous avons aligné nos interventions sur la police nationale qui, s’agissant d’opérations se déroulant dans des quartiers sensibles, a préféré intervenir à un horaire un peu atypique – une heure du matin – pour des raisons d’ordre public. Par la suite, nous avons repris notre autonomie, menant des opérations de jour quand elles ne se justifiaient pas de nuit.
M. le président Jean-Jacques Urvoas. Quels critères justifient une intervention de nuit ?
Colonel Marc Boget. L’intervention de nuit a généralement lieu lorsque l’environnement est défavorable. Je vous donnerai l’exemple du quartier de La Nacre à Méru : une intervention des gendarmes accroîtrait les risques de troubles à l’ordre public si elle avait lieu en plein jour. Dans ces cas, nous préférons intervenir en fin de soirée, vers vingt-trois heures. Sinon, nous nous adaptons aux spécificités de la cible : petit matin, vers six heures, pour être sûrs de trouver l’intéressé à son domicile ; heures de l’après-midi en cas d’activité commerciale.
M. le président Jean-Jacques Urvoas. Le besoin de protection des effectifs entre-t-il en ligne de compte ?
Colonel Marc Boget. Pour reprendre l’exemple du quartier de La Nacre, une perquisition administrative se déroulera dans des conditions d’exécution beaucoup plus sereines si elle a lieu à vingt-trois heures plutôt qu’en plein de milieu de l’après-midi, où une cinquantaine de personnes sont susceptibles de se regrouper pour venir titiller les forces de l’ordre.
Colonel Frédéric Boudier. L’activité professionnelle de la cible peut aussi décider de l’horaire. J’ai en tête le cas d’un videur de boîte de nuit qui a exigé une intervention à un horaire atypique. Pendant les quelques jours qui précèdent l’intervention, les unités recueillent divers renseignements ayant trait aux habitudes de vie et aux cycles de travail des cibles pour nous aider à choisir l’horaire.
M. Sébastien Pietrasanta. La présence d’enfants vous conduit-elle à éviter les perquisitions de nuit ? Comment mettez-vous cette variable en balance avec d’autres éléments comme le risque des troubles à l’ordre public le jour ?
Colonel Charles-Antoine Thomas. La question s’est posée pour mon groupement. Les perquisitions administratives visent un lieu : dans un même logement, peuvent vivre plusieurs familles ou des familles recomposées dont les membres ne sont absolument pas concernés par la radicalisation. L’une de nos préoccupations est d’éviter que nos interventions soient perçues comme étant illégitimes par l’opinion publique. Il nous a fallu agir avec des précautions particulières. Dès lors qu’il y avait des enfants, notamment des enfants en bas âge, nous avons pris soin de déclencher les opérations à des heures admissibles, entre dix-neuf heures et vingt et une heures, mais en aucun cas à deux heures du matin, horaire auquel, pour un enfant, voir apparaître une dizaine de personnes casquées et armées est particulièrement traumatisant.
M. le président Jean-Jacques Urvoas. Comment vos opérations ont-elles été encadrées ?
Colonel Charles-Antoine Thomas. Nos opérations, qui ont débuté le dimanche 15 novembre au matin, ont été conduites sous le contrôle d’un officier supérieur de l’état-major du groupement.
Mme Marie-Françoise Bechtel. Y a-t-il eu des incidents qui vous auraient été rapportés par témoignages directs ou par la presse ? Si oui, comment les avez-vous traités ?
Colonel Charles-Antoine Thomas. Deux perquisitions menées par mon groupement ont fait l’objet d’articles dans la presse : l’une dans Le Parisien, l’autre dans un billet de blog du Monde.
La première concernait une cible que la gendarmerie des transports aériens nous a demandé de traiter, qui était un chef de piste de l’aéroport de Roissy. Au moment où nous sommes intervenus, nous nous sommes rendu compte qu’aucun élément matériel ne justifiait l’assignation à résidence déjà délivrée. Dès le lendemain, j’ai fait remonter les informations au préfet. Il faut savoir que, dans le Val-d’Oise, dès les premiers jours de l’état d’urgence, nous avons instauré un système visant à passer au crible chaque soir toutes les opérations afin de s’assurer que tous les critères étaient respectés pour les assignations à résidence. Le calme est ensuite revenu dans la presse.
La deuxième affaire, beaucoup plus complexe, concerne un homme détenant armes et munitions et lié à des personnes radicalisées. Nous sommes intervenus chez lui pour saisir toutes les munitions et armes susceptibles de servir à des personnes moins bien intentionnées. Il a ensuite été contacté, nous ne savons par qui, et il y a eu un article. Nous avons fourni tous les éléments nécessaires et nous n’avons plus entendu parler de cette perquisition.
Le seul cas atypique que je peux citer est lié à une intervention dans une cité plutôt hostile vers neuf heures du matin : de façon tout à fait inattendue, les mères de famille musulmanes nous ont applaudis !
Général Michel Pidoux. Les opérations que nous effectuons dans le cadre de l’état d’urgence réclament un travail préparatoire très important qui affecte les autres missions de la gendarmerie – sécurité routière, lutte contre les atteintes aux biens, notamment. Elles exigent de réunir plusieurs critères : usage minimal de la force, choix du bon moment compte tenu de la présence des enfants, des horaires liés à telle ou telle activité professionnelle de la cible, à la date de signature de l’ordre qui appelle une action rapide afin d’éviter toute tentative de fuite ou de dissimulation.
Ces opérations, de nature complexe, mobilisent plusieurs officiers supérieurs du groupement : l’officier adjoint de police judiciaire, l’officier adjoint de renseignement, avec la présence systématique de l’un ou l’autre afin de sécuriser l’opération. À cela s’ajoute un point interactif quotidien afin d’adapter et d’affiner en permanence le déroulement des perquisitions.
J’insiste sur l’impact que celles-ci ont sur nos autres missions : les réunions en préfecture, l’implication personnelle des commandants de groupement dans le choix des cibles en coordination avec le préfet, tout cela est particulièrement chronophage.
M. le président Jean-Jacques Urvoas. Qui décide des horaires : le préfet ou bien vous ?
Général Michel Pidoux. Le préfet statue globalement et l’évaluation de l’environnement permet ensuite de cibler au mieux l’heure la plus favorable pour intervenir. Ces horaires peuvent varier considérablement. Je citerai le cas d’un infirmier-ambulancier astreint à des permanences de nuit dont il a fallu guetter le retour, ce qui n’a pas été simple. Les forces mobilisées peuvent attendre l’arme au pied et, sur la durée, cette mobilisation est très consommatrice d’énergie.
Colonel David Rey. Nous avons l’initiative des horaires, sachant que l’ordre de perquisition prévoit une exécution sans délai. Nous nous mettons d’accord avec le préfet pour qu’il délivre l’ordre soit la veille au soir soit dans la matinée pour une exécution dans la nuit, période la plus calme, notamment dans les cités. Les interventions nocturnes augmentent les chances de trouver la ou les personnes à leur domicile. Elles permettent, dans le cadre des reconnaissances, de déceler des signes simples de présence comme l’éclairage électrique. Quant à la présence d’enfants, fréquente, elle n’a jamais présenté de difficultés particulières. Nous évitons de les réveiller et, en cas de nécessité, la personne qui en a la charge s’occupe d’eux.
Une de nos perquisitions, qui visait une salle de prière, a fait l’objet d’un article dans la presse. La perquisition au domicile d’un imam salafiste autoproclamé, soupçonné de détenir des armes, n’ayant rien donné, le préfet, après quelques hésitations compte tenu du caractère sensible du lieu, a décidé de perquisitionner la salle de prière où cette personne exerçait régulièrement. Nous avons pris soin de ne pas l’effectuer un vendredi ni d’avoir recours à un chien. L’opération s’est déroulée en douceur, sans casse : nous avons simplement demandé les clefs du local. L’article de presse s’est félicité des conditions dans lesquelles elle a été menée et de l’absence d’éléments à charge.
M. le président Jean-Jacques Urvoas. Quelle proportion des objectifs que vous avez traités a été désignée par la sécurité intérieure ?
Colonel Marc Payrar. En Vendée, sur onze perquisitions, une a été faite sous pilotage de la DRSI, qui nous a demandé notre concours s’agissant d’un individu qu’elle suivait. Nous avons effectué la perquisition administrative, et les agents de la DRSI étaient présents en tant qu’observateurs. Tous les actes ont été effectués avec le spécialiste en nouvelles technologies.
M. le président Jean-Jacques Urvoas. Cela s’est déroulé dans les premières semaines de l’état d’urgence ou plus récemment ?
Colonel Marc Payrar. C’était au tout début. Nous avons également travaillé sur un autre dossier avec la DRSI auquel nous avons jugé utile d’associer la direction de la protection et de sécurité de la défense (DPSD). Cette perquisition a dû être annulée au dernier moment, et la cible a pu être traitée plus tard par la DRSI, dans un autre département.
Colonel Marc Boget. Dans l’Oise, une grosse opération commune entre la gendarmerie et la sécurité intérieure a été menée le 26 novembre. Un certain nombre d’objectifs étaient suivis à la fois par les gendarmes et la sécurité intérieure.
M. le président Jean-Jacques Urvoas. Et sur les quarante-deux perquisitions, combien en attribueriez-vous à la sécurité intérieure ?
Colonel Marc Boget. Dans l’Oise, le suivi était quotidien au début : nous revoyions tous les objectifs tous les jours. Aujourd’hui, nous le faisons une fois par semaine. Mais il existe un échange permanent entre la sécurité intérieure et le renseignement territorial, j’ai donc tendance à vous répondre qu’il n’y a pas d’objectifs spécifiques à la gendarmerie ou à la sécurité intérieure, chacun enrichit l’autre des connaissances dont il dispose sur une personne.
Colonel Charles-Antoine Thomas. Dans le Val-d’Oise, sur quarante-deux perquisitions, trente-trois ont été faites à la demande de la gendarmerie, deux à la demande de la gendarmerie des transports aériens, cinq de la DDSI et deux du service départemental du renseignement territorial (SDRT).
Néanmoins, j’ai demandé à disposer d’officiers de liaison de la DDSI et de la SDRT lors de l’ensemble des perquisitions afin de participer à toutes les opérations de gendarmerie. En effet, il faut savoir ce que nous recherchons lorsque nous travaillons sur des sources numériques ou des documents que nous trouvons.
Nous avons donc travaillé en permanence avec des gens dont le renseignement est le métier, et nous continuons à le faire. Pour les prochaines perquisitions administratives prévues, soit la DDSI nous demande de travailler pour elle et, dans ce cas, notre cellule de renseignement sera présente, soit c’est nous qui proposons des cibles, et alors la DDSI et le SDRT seront présents. C’est la meilleure façon de mettre les résultats en commun.
M. le président Jean-Jacques Urvoas. Quelle est la durée moyenne d’une perquisition ?
Colonel Charles-Antoine Thomas. Elle dépend de la quantité de données numériques qui sont découvertes sur place ; c’est ce qui nous prend le plus de temps. Pour nous, la véritable richesse est le numérique, car si l’on peut parfois trouver quelques signes de réseaux logistiques, personne ne dort avec sa kalachnikov !
En revanche, sur les sources numériques, avec nos enquêteurs N’Tech spécialisés dans les technologies numériques, nous pouvons rester jusqu’à quatre ou cinq heures sur place. C’est le temps nécessaire pour tout récupérer lorsque nous ne pouvons pas nous appuyer sur une infraction connexe pour saisir le matériel de communication : téléphones, ordinateurs, mais aussi manettes de jeux vidéo, car certaines permettent d’échanger des messages. Si l’on peut s’appuyer sur une infraction connexe, alors les choses sont beaucoup plus simples : nous saisissons le matériel et nous allons ensuite le traiter au sein du laboratoire.
Colonel Marc Boget. Pour nous aussi, la durée moyenne est de trois heures à trois heures et demie.
Colonel Marc Payrar. La perquisition menée avec la DRSI a duré plus de onze heures. Il s’agissait d’un spécialiste informatique soupçonné de faire de la propagande. Nous avons fait le choix de traiter les informations sur place, en sa présence et sans saisie administrative, car nous étions aux premiers jours de l’état d’urgence. L’intéressé était libre de partir à tout moment. Nous avons procédé en présence d’un spécialiste des nouvelles technologies venant d’un département voisin car nous n’en disposions pas au moment des faits. À cela s’ajoutait la nécessité de disposer d’un traducteur. Tout a donc été traité sur place, et les éléments trouvés ont permis de judiciariser le dossier par la suite.
Mme Élisabeth Pochon. Vous parlez des perquisitions passées : il semble que l’effet de surprise ait joué aux premiers moments de l’état d’urgence. Est-ce à dire qu’il y en a de moins en moins aujourd’hui, voire plus du tout ?
Ces perquisitions ont-elles eu un apport important sur les dossiers que vous étiez en train de suivre ? A contrario, la focalisation actuelle peut-elle gêner des enquêtes plus longues ou le suivi de questions de façon plus distanciée ?
Colonel Frédéric Boudier. Il est important de ne pas interférer avec d’autres enquêtes, notamment en interservices. C’est pourquoi, dans les Bouches-du-Rhône, lorsque nous avions ciblé certaines personnes, nous en informions systématiquement la sécurité intérieure, le renseignement territorial et la direction départementale de la sécurité publique, en plus du préfet, afin d’éviter toute interférence. Nous avions également convenu avec le préfet d’informer assez tôt le procureur de la République du TGI compétent, afin de vérifier que l’individu ne faisait pas l’objet d’un suivi sur commission rogatoire ou autre, de manière à ne pas interférer avec une procédure judiciaire.
Comme l’a dit le général Pidoux, nous nous sommes focalisés sur le terrorisme, et cela s’est fait fatalement au détriment d’autres segments de la délinquance. Bien sûr, les nécessités du moment l’exigeaient, et nous avons pu rétablir un certain équilibre. Nous avons fait très fort au début pour répondre aux nécessités de l’urgence et pour bousculer très vite d’éventuels réseaux. Maintenant, les choses se sont tassées, car la plupart des cibles ont été vues. Néanmoins, nous avons fait une perquisition il y a trois jours, à la demande de la sécurité intérieure, sur trois objectifs. Il s’agissait de volontaires au départ vers la Syrie, vraiment radicalisés, qui étaient sur le point de prendre le bus pour partir via un réseau. Ces perquisitions ont été suivies de l’assignation à résidence de l’un d’entre eux.
Maintenant que nous avons pu nous rééquilibrer sur nos activités traditionnelles, nous constatons que cette focalisation a aussi eu des avantages. Lorsque nous travaillons en groupes d’évaluation départementaux (GED) sur des cibles, nous nous appuyons sur les renseignements dont nous disposons à un moment précis. Les personnes entrent dans le collimateur du GED suite à des témoignages, des observations, des comportements inquiétants. L’avantage des perquisitions est qu’elles ont été menées à charge et à décharge : dans un certain nombre de cas, nous avons constaté qu’il n’y avait pas lieu de prolonger la surveillance. Je me souviens ainsi d’une perquisition au cours de laquelle nous avons trouvé dans le téléphone personnel du suspect un message désapprouvant les récents attentats.
C’est précieux pour nous, car cela permet, sur l’ensemble des cibles potentielles, de nous recentrer sur les objectifs les plus pertinents. Grâce à ce coup de collier que nous avons donné pour répondre à la nécessité du moment, nous nous y retrouverons sur la durée, car cela nous a permis de mettre fin à un certain nombre de surveillances.
M. Sébastien Pietrasanta. L’état d’urgence a donc été un accélérateur sur les signaux faibles que vous examiniez, sans entraver le reste de votre action ?
Colonel Frédéric Boudier. Sur le volet terrorisme, oui, mais cela a été consommateur de temps et de ressources dans d’autres domaines.
En revanche, j’appelle votre attention sur le fait que nous avons rencontré d’autres difficultés. Notre collègue a évoqué le temps passé pour perquisitionner les supports informatiques. Très clairement, pour nous, c’est une complication. La loi est ainsi faite et nous l’avons appliquée, mais il aurait été beaucoup plus confortable et moins consommateur d’effectifs de pouvoir saisir le matériel informatique chez quelqu’un, puis de le lui rendre après l’avoir étudié à tête reposée.
M. le président Jean-Jacques Urvoas. Le statut de la donnée ne serait pas le même.
Colonel Frédéric Boudier. C’est vrai, mais pour les personnes qui n’avaient pas grand-chose à se reprocher, il aurait été moins traumatisant et plus discret de procéder ainsi, plutôt que d’avoir des gendarmes circulant toute la journée dans la maison, au vu et au su du voisinage. Certains auraient été satisfaits que nous prenions leur ordinateur pour leur rendre ensuite. Et pour nous, que de présence en moins ! Cela fait partie des éléments qui nous ont compliqués la tâche.
Mme Marie-Françoise Bechtel. Le temps passé à analyser les données numériques vous semble-t-il proportionné à l’intérêt de ce que vous avez été amené à découvrir ? Aux deux tiers de la durée fixée pour l’état d’urgence, estimez-vous, au vu des données recueillies et des analyses faites, que les perquisitions administratives vous ont offert une meilleure approche, véritablement utile, notamment du point de vue informatique ?
M. le président Jean-Jacques Urvoas. J’imagine que vous n’avez pas totalement exploité toutes les copies que vous avez faites ?
Colonel Marc Payrar. En ce qui concerne la perquisition qui a duré presque douze heures, 90 % des données ont été traitées, ce qui nous a permis de révéler des infractions à la loi et de passer dans le cadre judiciaire. Nous avons saisi les ordinateurs, qui sont en cours d’exploitation dans un autre cadre.
Les perquisitions administratives, notamment informatiques, ont permis de lever le doute dans bon nombre de cas sur des personnes suivies parce qu’elles avaient un comportement qui appelait l’attention. Certaines ont été sorties de nos fichiers de suivi et la perquisition nous a permis de passer à autre chose. Nous avons effectivement travaillé à charge et à décharge.
La perquisition numérique est très utile, car nous constatons que l’outil informatique est employé pour la propagande et la diffusion de nombreuses informations.
M. le président Jean-Jacques Urvoas. Au final, le seul intérêt de la perquisition administrative ne se résume-t-il pas au matériel informatique ?
Colonel Charles-Antoine Thomas. Pas uniquement, bien que ce soit déjà beaucoup. Pour vous donner une idée, nous avons récupéré dix-huit téraoctets de données. Il nous faut du temps pour les exploiter, mais surtout des analystes. Nous avons donc transféré ces données aux services spécialisés, dont c’est le métier. Chacun doit s’en tenir à ce qu’il sait faire.
Mais au-delà, il était intéressant pour nous de mettre au jour des réseaux réels que nous ne connaissions pas. Je pense au cas particulier d’un chef d’entreprise dans le Vexin, un Français, catholique de naissance, radicalisé et islamisé. Lors de la perquisition, nous avons découvert qu’il faisait travailler de manière dissimulée une personne venant de Syrie, et nous avons trouvé des faux passeports sur lesquels figurait le nom d’une autre personne habitant à Persan, ville du nord du département qui constitue aussi un bassin de radicalisation. Nous n’avions pas du tout fait le lien entre l’activité économique, le recueil de personne en situation irrégulière issue de l’immigration clandestine en provenance de Syrie, et les faux papiers. Nous découvrons petit à petit le panorama de personnes françaises, de familles catholiques, qui se sont radicalisées. Nous avons mis à découvert tout un réseau que nous ne connaissions pas.
C’est aussi, pour nous, le résultat des perquisitions administratives. Il n’y a pas de délit, pas d’infraction, mais une précision sur la constitution de ces milieux que nous n’avions pas. Car pour appeler l’attention des services, il faut être visible. Voilà un exemple de cas dans lequel les perquisitions administratives ont permis de mettre au jour une base logistique potentielle. Lorsque l’on sait ce que représente le Val-d’Oise par rapport à la Seine-Saint-Denis, ce n’est pas neutre.
L’état d’urgence, ce n’est pas uniquement les perquisitions administratives et les assignations à résidence. Cela nous a aussi permis de nous déployer à deux reprises pour bloquer les sorties de Paris, lors des attentats et de l’attaque de Saint-Denis, et de contrôler les flux avec une meilleure efficacité. L’état d’urgence est aussi un moyen de gêner la mobilité de notre adversaire. L’effet majeur des perquisitions administratives et du contrôle de zone que nous a demandé notre directeur général est de limiter la mobilité de l’adversaire et de le déstabiliser. Il y a aussi une approche tactique à mettre en avant.
M. le président Jean-Jacques Urvoas. Vous avez raison de le rappeler.
Général Michel Pidoux. Dans la région Centre-Val de Loire, la tenue 24 heures sur 24 d’une barrière de péage de pleine voie permet bien des révélations. C’est une activité très chronophage, mais l’unité qui la tient découvre toute la vie de cette autoroute et des éléments intéressants tels que le passage de « fiches S » ou des étrangers circulant à des heures précises de la nuit. Si la capacité en matière de sécurité routière s’en trouve obérée – car pour tenir sans renfort de gendarmerie mobile, il faut prendre sur sa propre ressource, ce qui est épuisant –, les résultats obtenus sont suffisamment motivants pour entretenir la volonté de poursuivre et de tirer tous les enseignements possibles en cette période sensible.
M. Sébastien Pietrasanta. À propos de vos effectifs, dans quel état d’esprit se trouvent-ils ? Aux deux tiers de la période d’état d’urgence, sont-ils fatigués ? Y a-t-il eu beaucoup de formations ou de congés repoussés ? Si l’état d’urgence venait à être prolongé, comment les gendarmes le prendraient-ils ?
Général Michel Pidoux. La gendarmerie a, bien sûr, été impactée. Les attentats s’étant concentrés sur Paris, nous avons été sollicités autour de la région parisienne en première réaction, en tant que dispositif d’interception. Dans le Loiret et l’Eure-et-Loir, qui bouclent toute la partie du sud et sud-ouest de la région parisienne, il y a eu un effort immédiat à faire.
Les personnels sont des militaires : ils vivent en caserne, ils sont disponibles et ils ne se posent pas de questions. Dans une telle période, en voyant ce qui se passe, ils viennent spontanément se mettre à la disposition de leurs chefs, même s’ils sont en vacances ou en repos. Nous gérons dans la durée, comme nous l’avons déjà fait en 2005, pendant ce mois terrible qui a suivi la mort de deux enfants – j’étais alors commandant du groupement de l’Oise.
M. Sébastien Pietrasanta. Mais cela n’avait pas duré aussi longtemps, et la situation n’avait pas été précédée par des événements tels que ceux qui se sont produits depuis le mois de janvier. J’imagine que vous avez des effectifs pour surveiller les brigades de gendarmerie ?
Général Michel Pidoux. Non, la surveillance d’une brigade de gendarmerie est assurée par son propre personnel et aussi par les familles qui y vivent.
M. Sébastien Pietrasanta. Chez vos collègues de la police nationale, des sentinelles fixes sont placées devant l’entrée de certains commissariats. Ce n’est pas le cas des gendarmeries ?
Général Michel Pidoux. Dans la région Centre-Val de Loire, nous n’avons pas de gardes statiques devant les casernes. À Orléans, 1 013 militaires et leurs familles vivent dans la grande caserne qui abrite un escadron de gendarmerie mobile. Ces familles font partie de la problématique de la sécurité de la caserne, qui est située à 400 mètres du quartier difficile de l’Argonne. Il y a donc une sensibilisation, et ces familles ont des interrogations légitimes, notamment à la suite de la communication du ministre quelques jours avant Noël concernant Orléans. Nous avons élevé le niveau de protection de la caserne, mais les enceintes de ces casernes n’ont pas été construites pour répondre aux menaces que nous connaissons aujourd’hui.
Puisque cette problématique va manifestement s’inscrire dans la durée, le commandant de caserne que je suis ne peut pas faire l’économie d’une réflexion sur la protection et la hauteur des clôtures. Mais alors, quelle image allons-nous renvoyer à une population que nous sommes censés protéger ? Une brigade de gendarmerie doit être ouverte au public, qu’il s’agisse des grosses casernes comme Orléans ou des brigades de six gendarmes installées dans la profondeur du territoire. Pour qui voudrait s’en prendre aux familles ou perpétrer une action, ce serait relativement facile. Nous ne pouvons pas nous consommer dans notre propre autodéfense, notamment s’agissant des brigades à petits effectifs. Les familles sont associées, tout le monde est vigilant : l’épouse qui va sortir attend que le portail soit refermé pour que personne n’en profite pour s’engouffrer, ceux qui sortent de nuit font de même. Tout le monde est concerné et se montre très attentif, mais sans stress.
M. le président Jean-Jacques Urvoas. Colonel Thomas, vous disiez que les téraoctets de données que vous avez copiés ont été transmis aux services capables de les analyser. Quels sont les services en question ?
Colonel Charles-Antoine Thomas. En ce qui nous concerne, il s’agit essentiellement de la DDSI. Nous observons un protocole en recherchant des mots-clés qui nous ont été fournis, à partir desquels nous travaillons avec notre N’Tech. Nous avons la chance de bénéficier du soutien du pôle judiciaire de la gendarmerie nationale (PJGN). Toutes les données qui répondent à ces critères leur sont transmises en urgence, les autres sont conservées dans des disques durs, que nous traitons comme des scellés judiciaires bien qu’ils n’en soient pas à proprement parler.
M. le président Jean-Jacques Urvoas. Les personnes qui traitent ces données sont des officiers de police judiciaire ?
Colonel Charles-Antoine Thomas. Je pense que c’est le cas au niveau de la DDSI ; chez nous, le personnel habilité est OPJ, bien sûr.
M. le président Jean-Jacques Urvoas. De combien d’accès au FSPRT disposez-vous par groupement ?
Colonel Marc Boget. Nous en avons deux par groupement.
M. le président Jean-Jacques Urvoas. Est-ce vous qui récupérez les signalements issus du Centre national d’assistance et de prévention de la radicalisation (CNAPR) ?
Colonel Frédéric Boudier. Normalement, c’est le Renseignement territorial qui fait le criblage. On peut ensuite se voir attribuer un objectif, s’il s’avère pertinent.
M. le président Jean-Jacques Urvoas. De votre point de vue, y a-t-il beaucoup de « pollution » dans les signalements en question ?
Colonel Frédéric Boudier. En zone gendarmerie, dans les Bouches-du-Rhône, je n’en ai pas vu beaucoup.
M. le président Jean-Jacques Urvoas. On nous dit qu’il y a beaucoup de délations, par exemple pour cause de difficultés familiales.
Colonel Frédéric Boudier. C’est vrai, nous avons vu de tout. Il peut y avoir des dénonciations sur fond de problèmes de garde d’enfants, de divorces qui se passent mal, mais nous faisons assez vite la part des choses.
Je reviens sur les contrôles routiers, qui sont un élément majeur de l’état d’urgence. Sans doute parce que c’est la procédure la plus attentatoire aux libertés publiques, l’attention se concentre beaucoup sur les perquisitions administratives, mais les contrôles de flux sur les barrières de péage sont extrêmement pertinents. Sur les cinq barrières de péage de pleine voie dans les Bouches-du-Rhône, dont la deuxième plus grosse du pays, Lançon-Provence, nous voyons passer énormément de choses. Ainsi, entre le 17 novembre et le 19 novembre, hors la masse d’infractions relevant de la police judiciaire et liées aux stupéfiants, nous avons vu passer huit personnes fichées « S », deux faisant l’objet de mandats de recherche, trois sous le coup d’une obligation de quitter le territoire français, deux fichées au titre du non-respect du contrôle judiciaire, et même un déserteur ! On draine donc énormément de choses par les voies routières, et c’est intéressant.
J’ai regretté, à titre personnel, que le toilettage de la loi de 1955 ne nous autorise pas à ouvrir les coffres de voiture. Nous avons le droit d’aller chez les gens, dans leur maison, mais pas d’ouvrir leur véhicule alors que nous sommes en état d’urgence et que la douane peut le faire toute l’année. Je trouve cela un peu restrictif. Je ne sais pas si nous aurions utilisé cette possibilité systématiquement, mais elle aurait été utile dans un certain nombre de cas. Bien sûr, nous nous rapprochons du magistrat sur le fondement de l’article 78-2-2 du code de procédure pénale, mais il peut décider de ne pas nous délivrer cette réquisition pour des raisons qui lui appartiennent. Quand on estime nécessaire de mettre en place un dispositif lourd, avec du personnel, ne pas disposer de cette réquisition est pénalisant. Je pensais donc que cette possibilité serait ouverte dans le cadre de la révision de la loi de 1955 sur l’état d’urgence.
M. le président Jean-Jacques Urvoas. Cela n’a pas été prévu dans le texte du Gouvernement, ni d’ailleurs dans les amendements déposés par la suite. Il y a eu des amendements portent sur la saisie informatique, mais pas sur ce sujet.
Merci, messieurs, pour votre disponibilité et la précision de vos réponses.
——fpfp——
TABLE RONDE RÉUNISSANT DES RESPONSABLES OPÉRATIONNELS DE LA POLICE NATIONALE
Compte-rendu de la table ronde, non ouverte à la presse, du 11 janvier 2016 réunissant des responsables opérationnels de la police nationale : le commissaire divisionnaire M. Paul Agostini, directeur départemental de la sécurité publique de la Haute-Vienne ; le commissaire divisionnaire M. Pascal Belin, directeur départemental de la sécurité publique du Loiret ; l’inspecteur général M. Pierre-Marie Bourniquel, directeur départemental de la sécurité publique des Bouches-du-Rhône ; le commissaire divisionnaire M. Jean-François Illy, directeur départemental de la sécurité publique du Bas-Rhin ; le contrôleur général M. Patrick Mairesse, directeur départemental de la sécurité publique de l’Isère.
M. le président Jean-Jacques Urvoas. La commission des Lois a décidé de procéder à un contrôle parlementaire de l’état d’urgence, que nous inventons en même temps que vous en inventez la pratique, car bien peu d’entre nous avaient en mémoire la mise en œuvre de ce dispositif en 2005, et encore moins des précédentes.
Nous avons souhaité vous rencontrer afin de compléter l’information que nous avons pu recueillir dans les différents départements que M. Jean-Frédéric Poisson et avons visités au cours des trois dernières semaines.
Il nous a semblé que nul autre que vous n’étiez aussi bien placés pour évoquer la réalité opérationnelle des diverses missions accomplies pendant l’état d’urgence, particulièrement les perquisitions administratives.
Pour mener à bien ce travail, la Commission s’est dotée des prérogatives d’une commission d’enquête ; je vais donc vous demander de prêter serment de dire toute la vérité, rien que la vérité.
(M.M Pierre-Marie Bourniquel, Jean-François Illy, Paul Agostini, Pascal Belin et Patrick Mairesse prêtent serment).
Peut-être pourriez-vous nous fournir quelques données statistiques relatives aux opérations que vous avez été conduits à mener ainsi que sur la dimension des directions dont vous avez la responsabilité.
M. l’inspecteur général Pierre-Marie Bourniquel, directeur départemental de la sécurité publique des Bouches-du-Rhône. Je suis inspecteur général, directeur départemental de la sécurité publique des Bouches-du-Rhône et coordonnateur de la zone sud.
À Marseille, je dirige 3 500 policiers, 4 500 sur le département des Bouches-du-Rhône et, indirectement, 14 000 sur la nouvelle zone sud qui incorpore depuis le 1er janvier la région toulousaine et s’étend désormais de Tarbes à Menton et à la Corse.
Cent cinquante-trois perquisitions ont été effectuées dans le département des Bouches-du-Rhône, dont quarante-quatre par la gendarmerie et quatre-vingt-dix-sept par les services de sécurité publique et douze par la direction générale de la sécurité intérieure (DGSI), auxquelles la sécurité publique a largement prêté son concours.
Pour la zone sud, d’après les chiffres qui m’ont été communiqués, le nombre des perquisitions administratives s’élève à 332 et celui des assignations à résidence à 30. Pour le département des Bouches-du-Rhône, dix-sept arrêtés ont été pris par le ministère de l’intérieur et treize ont été notifiés.
M. le commissaire divisionnaire Jean-François Illy, directeur départemental de la sécurité publique du Bas-Rhin. La sécurité publique du Bas-Rhin représente environ 1 300 personnes auxquelles s’ajoutent au quotidien une demi-compagnie républicaine de sécurité (CRS) au titre du renfort pour le plan Vigipirate et une autre demi-CRS lors des sessions du Parlement européen ou du Conseil de l’Europe.
Dans le cadre de l’état d’urgence, notre dispositif de sécurité a été fortement impacté par l’augmentation des contrôles effectués en raison de la proximité de la frontière allemande, pour y surveiller les entrées et les sorties du territoire national. Les effectifs du renseignement territorial (RT) représentent trente-six personnes, dont sept sont spécialisées dans la radicalisation ; ce service fait face à une augmentation montante du nombre de signalements en matière de radicalisation qui s’élève aujourd’hui à 528 dont 224 dépendent du RT. Une quarantaine d’individus sont identifiés comme nécessitant un suivi attentif (INSA), ce qui mobilise un fonctionnaire pour trente personnes signalées. Nous gérons enfin cinq assignations à résidence, dont quatre tenues de procéder à trois pointages quotidiens.
Nous avons réalisé trente-huit perquisitions, quarante-trois en incluant les opérations faites par la Direction interrégionale de la police judiciaire (DIPJ). Ces perquisitions administratives – qui, en tout cas au début, étaient liées à l’économie souterraine, au trafic de stupéfiants ou d’armes – ont donné des résultats intéressants : quatre personnes ont été écrouées.
Les villes de Haguenau, au Nord, et Sélestat, plus proche de Colmar, sont également placées sous ma responsabilité.
M. le président Jean-Jacques Urvoas. D’après les chiffres dont je dispose, quarante-neuf perquisitions auraient été réalisées dans le Bas-Rhin : cela signifie-t-il que la gendarmerie n’aurait effectué que cinq perquisitions ?
M. Jean-François Illy. Ce sont bien les chiffres dont je dispose.
M. le commissaire divisionnaire Paul Agostini, directeur départemental de la sécurité publique de la Haute-Vienne. La situation dans le Limousin est beaucoup plus calme… la direction départementale de la sécurité publique (DDSP) couvre la seule ville de Limoges, soit 85 000 habitants, et compte 400 policiers, le service du renseignement territorial occupant dix fonctionnaires.
Nous avons réalisé sept perquisitions administratives, dont les cibles ont été désignées par le RT ou par la sécurité intérieure. Sur les sept, deux individus ont été assignés à résidence, qui faisaient d’ailleurs l’objet d’une surveillance de la sécurité intérieure. À ma connaissance, de leur côté, les gendarmes ont effectué cinq perquisitions.
M. le commissaire divisionnaire Pascal Belin, directeur départemental de la sécurité publique du Loiret. Dans le Loiret, deux agglomérations sont principalement concernées : Orléans, avec 250 000 habitants environ et Montargis, 50 000 environ. La sécurité publique compte 615 agents, dont vingt-trois affectés au renseignement territorial.
Nous avons effectué trente-neuf perquisitions, dont onze cibles désignées par la DGSI et non judiciarisées ; trente-deux opérations ont eu lieu au domicile de personnes physiques, les sept autres dans des commerces. Huit de ces perquisitions ont eu des suites judiciaires, notamment pour détention d’armes à Montargis, ou détention d’une forte somme en numéraire dans un commerce orléanais, tout cela en lien avec la radicalisation. Nous avons signifié quatorze assignations à résidence ; treize sont effectives et le quatorzième intéressé s’est présenté spontanément au centre de détention ce matin, car il avait une peine à purger…
M. le contrôleur général Patrick Mairesse, directeur départemental de la sécurité publique de l’Isère. La sécurité publique de l’Isère compte huit cents fonctionnaires, répartis dans quatre circonscriptions : Grenoble, Bourgoin, Vienne et Voiron. La sécurité publique a réalisé cinquante-deux perquisitions administratives, dont cinq pour le compte de la police judiciaire (PJ), une dizaine sur la base d’informations du renseignement territorial et une au titre de la sécurité intérieure. Selon les informations dont je dispose, la gendarmerie aurait effectué vingt-six perquisitions ; à ce jour, neuf assignations à résidence ont été prononcées, dont trois en zone police.
Le RT dispose de trente agents : cinq à Bourgoin, trois à Vienne et vingt-trois à Grenoble. Depuis un an et demi, chaque fois qu’il y a des renforts, Grenoble est pourvu.
M. le président Jean-Jacques Urvoas. Pouvez-vous préciser comment sont définies les cibles ? Sont-elles désignées par le biais des groupes d’évaluation départementaux de la radicalisation (GED), par les états-majors de sécurité, les procureurs sont-ils présents ou associés, voire actifs, au sens où ils auraient pu suggérer des cibles ? Est-ce le préfet qui détermine les modalités d’intervention – horaire, type d’unité mobilisée – ou ce soin est-il laissé aux directeurs départementaux de la sécurité ?
M. Pierre-Marie Bourniquel. Les magistrats ont été associés, en tout cas prévenus, à la fois par moi — dans les trois parquets des Bouches-du-Rhône, soit Tarascon, Aix et Marseille —, ainsi que par le préfet de police mais ils n’ont pas été associés à la partie administrative.
M. le président Jean-Jacques Urvoas. Ils ne vous ont pas suggéré des cibles qu’ils ne parvenaient pas à judiciariser ?
M. Pierre-Marie Bourniquel. C’eût été une faute au regard du principe de la séparation des pouvoirs.
Les objectifs ont été déterminés à la fois par les chefs de service de la sécurité intérieure, du renseignement territorial, quelquefois du service départemental, dans la mesure où cela pouvait être l’occasion de se rapprocher de certains milieux. Tout cela a été fait sous l’autorité et le contrôle du préfet de police, auxquels ces objectifs étaient soumis, et chacun d’entre nous en avisait sa direction centrale respective qui prenait contact avec l’unité de coordination de la lutte antiterroriste (UCLAT), afin d’éviter tout risque de gêne sur le plan national. Au terme de ces consultations, les décisions redescendaient vers nos directions respectives et le préfet ; l’action intervenait alors très rapidement.
M. le président Jean-Jacques Urvoas. Ces procédures ont-elles été appliquées dès le début ? Ou, le premier week-end, des opérations ont-elles été organisées par l’état-major opérationnel de prévention du terrorisme (EMOPT) ?
M. Pierre-Marie Bourniquel. À ma connaissance, non, mais je ne l’exclurais pas formellement et cela ne m’aurait pas choqué, l’EMOPT disposant d’une vision globale de la situation sur l’ensemble du territoire national. La sécurité publique a poursuivi ses propres objectifs et a fourni l’essentiel des effectifs opérationnels aux autres services : police judiciaire ou brigades de recherche et d’intervention (BRI).
La première nuit, celle du dimanche, nous avons effectué treize perquisitions avec la BRI ; nous ne savions pas vraiment comment les choses allaient se passer, et étions encore sous le choc des attentats de Paris. Sur certains des objectifs qui nous avaient été signalés, nous avons pris beaucoup de précautions. Les choses se sont bien passées et, au cours des deux premières semaines, nous avons pratiqué treize à quatorze perquisitions par jour, puis une dizaine pendant quelques semaines, à un rythme très soutenu. Le nombre a ensuite décru, du fait de la réduction du nombre des objectifs, mais aussi parce qu’une perquisition prend beaucoup de temps : il faut l’organiser, analyser ensuite son déroulement, organiser des auditions, etc. Les services de la sûreté départementale se sont totalement consacrés à cette activité, en parfaite coordination avec les autres services.
M. le président Jean-Jacques Urvoas. Avez-vous, au sein de la direction départementale de la sécurité publique, désigné un responsable particulier ?
M. Pierre-Marie Bourniquel. Tout était centralisé et coordonné par le chef d’état-major qui était en liaison constante avec les autres directions.
M. Patrick Mairesse. En Isère, nous sommes entrés en action dès le dimanche soir. Nous n’avons pas reçu d’instruction de Paris et avons agi sur la base d’une liste établie dans la journée du dimanche par la DDSP après un énorme travail de vérification des adresses. Des réunions de travail quotidiennes ont eu lieu, auxquelles participaient notamment pour la sécurité publique, des responsables de la brigade anti-criminalité (BAC), la brigade des stupéfiants, qui connaissent bien les quartiers sensibles et, bien évidemment, du renseignement territorial autour du directeur et de son adjoint. Les divers services croisaient leurs listes afin de ne pas perdre de temps et d’éviter des cibles que certains services ne souhaitaient pas voir perquisitionnées à ce moment.
Nous avons ensuite eu deux réunions par semaine avec la préfecture pour faire valider les listes d’opérations retenues, en lien avec les responsables de la gendarmerie, de la DGSI et de la PJ. Il nous a fallu établir un calendrier, avec toutes les difficultés que pouvait poser la disponibilité des fonctionnaires spécialisés en informatique, ou des chiens attachés à la détection de stupéfiants ou d’armes ; au terme d’une ou deux semaines, c’est la disponibilité des spécialistes qui a cadencé le rythme des interventions.
M. le président Jean-Jacques Urvoas. Le fichier de traitement des signalés pour la prévention et la radicalisation à caractère terroriste (FSPRT) vous est-il utile pour cibler les mesures ?
M. Patrick Mairesse. Certains individus étaient fichés au FSPRT mais la plupart n’y figuraient pas. Durant les premières semaines, nous avons souhaité associer perquisitions administratives et constitution des dossiers pour assignation à résidence. La durée d’établissement de ces dossiers nous a conduits à différer quelques perquisitions de cibles intéressantes suivies par le renseignement territorial, afin de pouvoir procéder simultanément à la perquisition et à la notification de l’assignation.
M. le président Jean-Jacques Urvoas. Toutes les personnes assignées à résidence ont-elles été perquisitionnées dès le début ? Quand bien même les assignations étaient décidées par la direction les libertés publiques et des affaires juridiques ?
M. Patrick Mairesse. Oui. Au début, par exemple, nous avons très vite procédé à une perquisition au domicile d’un couple, auquel nous avions retiré les cartes d’identité et passeports – nous avons été l’un des premiers départements à procéder à de tels retraits. C’était là l’intérêt de ce dispositif de pouvoir entrer dans leur domicile.
M. Pascal Belin. Dans le Loiret, le choix des cibles s’est essentiellement fait à partir du FSPRT. Les cibles ont été identifiées soit par la direction régionale de la sécurité intérieure – le choix s’est alors porté sur des cibles non judiciarisées –, soit par le renseignement territorial pour aller rapidement vérifier les soupçons que nous pouvions avoir sur l’activité de certaines personnes.
J’ai organisé des réunions quotidiennes, pilotées par moi-même ou le directeur adjoint, rassemblant les chefs du service du renseignement territorial, de la sûreté départementale, du service de sécurité de proximité (SSP), ce dernier étant chargé de la mise en œuvre des opérations, afin d’établir un tableau de cibles.
Une liste de cibles nous a été demandée par la direction centrale et nous avons débuté les perquisitions dès le lundi 16 novembre au soir, sur la base d’un document établi le jour même. Pour des raisons techniques, nous n’avons procédé qu’à deux ou trois perquisitions par jour, sachant que chaque opération nécessitait un personnel nombreux et prenait une heure à une heure et quart. Au départ, les demandes étaient adressées au préfet les unes après les autres, puis nous avons alimenté un tableau, sollicitant en retour des ordres de perquisition.
Sur trente-neuf perquisitions, treize ont été effectuées la première semaine, seize la deuxième, cinq durant les troisième et quatrième semaines. La dernière opération a eu lieu deux jours avant Noël.
M. Jean-François Illy. L’organisation dans le Bas-Rhin a été un peu différente. Nous nous sommes appuyés sur le volet « sûreté départementale » de la DDSP. Dès le dimanche soir, en urgence, une réunion s’est tenue, avec la police judiciaire, la sécurité intérieure, le renseignement territorial, la sûreté départementale et la direction de la DDSP, c’est-à-dire moi-même et mon adjoint, pour définir des objectifs sur lesquels une intervention dès le dimanche était possible.
Nous avons pris soin de ne pas empiéter sur les enquêtes judiciaires en cours et nous nous sommes concentrés sur des cibles qui étaient en phase préjudiciaire, par exemple. Nous avons aussi essayé de tenir compte des sources d’approvisionnement des individus radicalisés – stupéfiants, argent, armes, etc.
Nous avons donc défini quatorze objectifs pour la première soirée. Ensuite, le préfet ayant souhaité que le procureur de la République soit associé, mon adjoint et moi-même avons défini les objectifs à notre niveau puis nous les avons faits remonter lors des réunions avec l’état-major de sécurité – restreint, ou élargi au procureur. La consultation du procureur permet tout à la fois de vérifier s’il détient des informations supplémentaires, par exemple en consultant les casiers judiciaires, et de préparer la phase judiciaire qui peut éventuellement s’ensuivre. Le préfet valide donc les objectifs que nous lui proposons ; nous informons le procureur de la République ; le commandement de la zone – nous dépendons de Metz – et Paris valident aussi nos objectifs. En particulier, il faut vérifier avec la police judiciaire s’il y a des informations importantes que nous ne détiendrions pas. En général, ce n’est pas le cas, grâce notamment au fichier des personnes radicalisées, puisque nous tenons une réunion hebdomadaire du bureau de liaison avec toutes les parties prenantes, y compris les gendarmes : chacun sait qui il peut joindre pour obtenir les renseignements nécessaires.
Ce dispositif nous a permis de lever rapidement les doutes que nous entretenions sur certains individus, de « fermer des portes ». Ainsi, un bailleur social suspectait un individu de vendre des livres par internet depuis des logements sociaux : une perquisition administrative, en fin d’après-midi, nous a permis de comprendre que cette personne servait simplement de lien avec d’autres individus, qui utilisaient sa liaison internet.
Le dispositif a ensuite été réduit : comme le disait mon collègue, nous avons beaucoup sollicité notre personnel, puisque toutes les perquisitions ont été conduites par la sûreté départementale, un officier de police judiciaire (OPJ) étant systématiquement présent. Cela nous a obligés à réfléchir à notre gestion des ressources humaines, la fatigue s’accumulant rapidement. Nous avons également dû tenir compte de la disponibilité des unités mobiles appelées en renfort : il est en effet nécessaire de bien assurer la sécurité des interventions, notamment lors des perquisitions de nuit, qui sont les plus dangereuses car il est toujours possible que nous soyons attendus par des individus armés.
Ces perquisitions nécessitent des vérifications plus approfondies – nous ne sommes plus dans l’urgence : nous travaillons désormais sur le fond –, pour valider les adresses, et nous assurer que les perquisitions apporteront quelque chose aux enquêtes. L’activité de la police judiciaire alimente aussi nos recherches dans le domaine de la radicalisation. Ainsi, il y a deux jours, une affaire a commencé de façon banale : Police Secours a été appelée dans un quartier de Strasbourg, pour un différend familial. Un individu frappait sa compagne, âgée de dix-sept ans, mariée religieusement avec lui. Or nous avons découvert là un kilo de résine de cannabis, qui lui sert à financer certaines activités et figure déjà dans une commission rogatoire d’un juge d’instruction. Nous explorons donc peu à peu les liens entre différents individus qui profitent de l’économie souterraine pour alimenter les réseaux terroristes.
Au niveau de la DDSP, nous avons souvent rencontré des difficultés pour lier un nom et un domicile et effectuer toutes les vérifications nécessaires : hors du temps judiciaire, c’est très compliqué. Dans certains quartiers, nous sommes très rapidement repérés.
M. le président Jean-Jacques Urvoas. Avez-vous commis des erreurs d’adresse ?
M. Jean-François Illy. Non, nous avons préféré reporter des interventions, le temps de nous assurer que l’adresse était exacte.
Certaines affaires sont simples, et n’apporteront pas grand-chose en matière judiciaire. Mais notre compréhension du phénomène de la radicalisation a vraiment progressé : je pense par exemple à un individu que le RT pensait plutôt banal, et que nous avons trouvé en train de prêcher à quatre jeunes, et dont nous avons découvert qu’il détenait les numéros de téléphone belges mais aussi syriens… Ces renseignements ont alimenté ensuite les recherches de la SI.
M. Paul Agostini. En Haute-Vienne, les cibles ont été choisies principalement à partir des informations du RT et de la SI. Des réunions ont rassemblé, à la DDSP, l’ensemble des services : RT, SI, PJ, DDSP, notamment la sûreté départementale et le service de sécurité de proximité. Il s’agissait de confronter nos opinions sur les individus radicalisés susceptibles de détenir des objets ou des produits intéressants. Une première liste a été dressée sur la base des informations du RT. Pour la SI, la question de l’opportunité des perquisitions se posait : ce service travaille notamment à partir d’écoutes, et nous risquions de signaler à certaines personnes qu’elles étaient surveillées. Nous avons néanmoins choisi quelques cibles à partir des données de la SI. Nous avons aussi essayé de faire coïncider perquisition administrative et assignation, ce qui explique que les cibles SI aient été traitées après celles identifiées par le RT.
S’agissant des cibles désignées par le renseignement territorial, nous avons visé soit des individus suspectés d’être radicalisés, soit des délinquants qui commençaient à tenir des propos de soutien à Daech. Les perquisitions n’ont pas donné grand-chose.
Nous avons mené une perquisition au centre d’accueil de demandeurs d’asile (CADA), dans un appartement qui se trouve dans une cité sensible de Limoges, afin de nous assurer que ce foyer ne servait pas de planque aux délinquants locaux. Nous avons pu lever ce doute.
Nous avons deux personnes assignées à résidence, dont un individu, installé à Limoges depuis deux jours, arrivant de Bordeaux, et qui a séjourné en Syrie.
M. le président Jean-Jacques Urvoas. Je suis assez surpris par la faiblesse des chiffres de perquisitions administratives de la SI. La moitié des perquisitions sont faites directement par la sécurité publique. L’État a pris des mesures pour lutter contre le terrorisme, et l’on pourrait penser que ce sont le RT et la SI qui ont les effectifs nécessaires… Que cherchiez-vous dans toutes les perquisitions qui ne sont demandées ni par le renseignement territorial, ni par la sécurité intérieure ?
M. Pierre-Marie Bourniquel. La force de la DCSP, c’est de rassembler police judiciaire et renseignement, l’un alimentant l’autre. Ce qui permet d’avoir du renseignement tous azimuts.
Par ailleurs, je ne fais pas partie de la SI, mais on peut comprendre la volonté de ne pas éveiller l’attention d’un individu radicalisé ou en voie de radicalisation, et donc intéressant pour les services de police, mais également intéressant pour le service de renseignement. La SI peut souhaiter, pour cette raison, continuer à le surveiller en évitant les perquisitions administratives.
M. le président Jean-Jacques Urvoas. Cela n’explique pas le volume de perquisitions administratives venues de la sécurité publique.
M. Pierre-Marie Bourniquel. La sécurité publique, et c’est ce qui fait sa force, dispose, avec ses antennes du renseignement territorial, d’un très bon maillage territorial, en zone de police comme en zone de gendarmerie – où nous avons d’ailleurs mené également des perquisitions.
J’ai été le premier étonné, le premier déçu, par les résultats des perquisitions, même si nous avons tout de même récupéré 150 000 euros, un kilo d’héroïne, un kilo de cocaïne, du cannabis, quelques armes… Si nous n’avons pas trouvé plus de choses, c’est qu’il y a eu des fuites dès le dimanche : les cibles les plus intéressantes, les plus « professionnelles », ont vite su que des perquisitions administratives allaient être menées et ont pris les mesures nécessaires.
Nous avons commencé les perquisitions administratives dans la nuit du dimanche au lundi. Au bout de deux jours, les plus crétins avaient compris qu’ils devaient mettre à l’abri l’essentiel. C’est comme cela que nous avons trouvé des explosifs dans une cité de Marseille et une kalachnikov dans le port de l’Estaque : les délinquants s’en étaient débarrassés…
À mon sens, il fallait faire ces perquisitions administratives ; si nous ne les avions pas menées, nous le regretterions aujourd’hui. Elles nous permettent de mieux connaître des individus, de lever des doutes et de mieux comprendre le phénomène de la radicalisation. Les services de renseignement y gagnent beaucoup de temps. C’est peut-être là leur principal intérêt.
M. le président Jean-Jacques Urvoas. Selon vous, le principal bénéficiaire de l’état d’urgence, c’est le renseignement ?
M. Pascal Belin. Je confirme que l’intérêt des perquisitions administratives s’est amenuisé très rapidement. Ainsi, au sein d’un groupe de Tchétchènes, la première assignation à résidence et la première perquisition ont concerné le trésorier du groupe ; la consultation de ses ordinateurs – avec des documents en cyrillique… – était donc très intéressante. Mais le reste du groupe a très vite pris la poudre d’escampette. Les perquisitions n’avaient alors plus aucun intérêt : nous avons trouvé des téléphones entièrement vides, sans la moindre conversation téléphonique, sans le moindre SMS, sans le moindre contact… tout comme les ordinateurs, totalement vidés également. Or il était impossible de mener toutes les perquisitions en même temps.
M. le président Jean-Jacques Urvoas. Et que cherchiez-vous dans les perquisitions proposées par la sécurité publique ?
M. Pascal Belin. Tout dépendait des cibles. La moitié des personnes que nous avons perquisitionnées avaient des antécédents judiciaires. Nous avons par exemple trouvé beaucoup d’armes, un lance-roquettes, des masques à gaz, des gilets pare-balles… chez un soi-disant collectionneur qui faisait notamment venir d’Allemagne des armes en principe démilitarisées, mais de façon très légère et très faciles à remilitariser. On peut se procurer sur internet une kalachnikov pour 150 euros, je l’ai vérifié moi-même.
M. le président Jean-Jacques Urvoas. Une kalachnikov démilitarisée…
M. Pascal Belin. Bien sûr, mais il n’est pas difficile de faire en sorte qu’elle fonctionne à nouveau.
Nous avons également trouvé de l’argent, puisque les perquisitions visaient notamment à vérifier si certains avaient des activités illicites liées au terrorisme. Nous avons ainsi trouvé dans un commerce 237 000 euros en petites coupures, cachées un peu partout. En revanche, nous avons trouvé peu de stupéfiants : les trafiquants conservent rarement la marchandise chez eux…
Dans les trois quarts des cas, les perquisitions nous ont permis de faire des vérifications, lorsqu’on nous avait signalé un changement inquiétant de comportement ou des propos de soutien à Daech : nous avons pu voir, chez les personnes elles-mêmes, si ces signes n’étaient liés qu’à un mal-être ou s’il y avait quelque chose de plus grave.
Mme Marie-Françoise Bechtel. Merci d’être venus aujourd’hui, messieurs.
C’est la première fois que nous mettons en œuvre l’ensemble des procédures administratives de l’état d’urgence. Cette question est peut-être prématurée, mais à ce jour, que diriez-vous de la façon dont le renseignement dans son ensemble a alimenté ces actions ? Notre renseignement a fait l’objet de nombreuses réformes : quel est votre regard sur ce qu’il vous apporte, en quantité comme en qualité ? Ou ma question est-elle prématurée ?
M. Pierre-Marie Bourniquel. Elle est tout à fait pertinente, madame la Députée… Le renseignement, c’est notre mémoire. Ce que nous apprenons aujourd’hui, nous savons sans doute l’exploiter, mais pas totalement : nous l’exploiterons mieux quand nous pourrons recouper ces informations avec d’autres. Sauf dans des cas très particuliers, il est donc prématuré d’essayer d’évaluer précisément l’intérêt des perquisitions administratives. Mais je suis un vieux flic, et je suis intimement persuadé qu’elles seront très intéressantes.
Je regrette en revanche que nous n’ayons pas pu tirer des perquisitions tout ce que nous aurions pu : nous ne pouvons par exemple pas saisir le matériel informatique, mais seulement en copier le contenu sur place. Or nous ne disposons pas de policiers formés en nombre suffisant. Et si certains de nos fonctionnaires parlent arabe, les trois quarts ne le lisent pas. Nous avons essayé de copier tout ce que nous pouvions copier, mais nous avons parfois manqué de personnel, surtout dans les premières nuits où nous menions jusqu’à treize perquisitions simultanées. Une masse d’informations nous a donc échappé. Il y a là certainement des leçons à tirer.
Il est également toujours intéressant, après une perquisition, de savoir ce que disent les gens au téléphone une fois que nous avons refermé la porte. Mener des écoutes administratives permettrait d’apprendre beaucoup de choses.
Je le redis, du point de vue strictement judiciaire, j’ai été un peu déçu par le volume des découvertes. Mais du point de vue du renseignement, les perquisitions étaient une très bonne chose. On s’en apercevra dans quelque temps. Mais nous sommes aussi passés à côté de certains renseignements, par manque de moyens ou impossibilité matérielle.
M. Sébastien Pietrasanta. L’efficacité des perquisitions a diminué rapidement, car très vite, les cibles potentielles s’attendaient à vous voir arriver, dites-vous. Était-ce un phénomène général ?
J’aimerais, comme le président Urvoas, des précisions sur le choix des cibles, lorsqu’il n’émanait pas des services de renseignement.
S’agissant enfin des perquisitions de nuit, j’aimerais en savoir plus sur la façon dont vous procédez, notamment lorsqu’il y avait une famille, des enfants notamment. Avez-vous évité les perquisitions de nuit dans ces cas-là ? Comment avez-vous géré ces situations ?
M. Pierre-Marie Bourniquel. Les perquisitions se font en général à six heures du matin, heure à laquelle les enfants dorment. Les policiers sont souvent des pères ou des mères de famille : ils savent agir avec une certaine pudeur.
Il est vrai que ces opérations menées en pleine nuit ont parfois suscité des réactions un peu différentes des perquisitions habituelles. Certains ne s’y attendaient pas, surtout au début. Nous avons donc rencontré des réactions parfois un peu violentes d’incompréhension ; mais nous sommes là pour expliquer les choses.
Il y a beaucoup été question des portes enfoncées. Nous avons essayé, en règle générale, de faire intervenir un serrurier : mais comment faire avec treize perquisitions simultanées – surtout lorsque les serruriers ne sont pas très bien payés par l’État ?
M. le président Jean-Jacques Urvoas. Voulez-vous dire que vous avez cassé les portes parce que vous manquiez de serruriers ?
M. Pierre-Marie Bourniquel. Nous n’en avons presque pas cassé, monsieur le président.
M. le président Jean-Jacques Urvoas. Dans un département, le préfet a imposé dans son arrêté la réquisition d’un serrurier ; aucune porte n’a été cassée.
M. Pierre-Marie Bourniquel. Tout dépend des départements.
M. le président Jean-Jacques Urvoas. Vous disiez que le mode opératoire était déterminé par les policiers, et pas par le préfet.
M. Pierre-Marie Bourniquel. En cas de perquisition administrative, le paiement des serruriers ne relève pas de la police, puisqu’il n’y a pas de réquisition.
M. le président Jean-Jacques Urvoas. Les signalements faits à la plateforme nationale de signalement (CNAPR) vous prennent-ils beaucoup de temps ?
M. Patrick Mairesse. Oui, il y a une montée phénoménale des signalements, surtout après des campagnes télévisées ou des interventions de spécialistes réels ou autoproclamés. De plus, des administrations auprès desquelles nous prêchions jusque-là sans grand succès ont maintenant compris toute l’importance de ce sujet – je pense notamment à l’éducation nationale, aux municipalités et aux élus locaux qui ont été sensibilisés à ces questions.
La rançon de ces actions, c’est une montée impressionnante du nombre des signalements, souvent faits par les familles. Nous ne pouvons en négliger aucun. Beaucoup ont entraîné la création de fiches dans le FSPRT, ou des demandes d’assignation et des perquisitions.
M. le président Jean-Jacques Urvoas. Est-il arrivé que des signalements résultent de dénonciations malveillantes ?
M. Patrick Mairesse. Cela se peut. Auparavant, nous recevions des lettres des bailleurs sociaux expliquant que des jeunes gens se réunissaient dans les halls d’immeubles pour vendre des stupéfiants ; à présent, on nous écrit pour nous dire qu’un voisin est radicalisé… Nous devons donc examiner ces signalements avec discernement pour ne stigmatiser personne à tort.
Nous avons décidé, dans l’Isère, de ne pas remettre aux intéressés – dont beaucoup ont des antécédents d’infractions au droit commun – l’ordre de perquisition administrative qui les visait, pour nous éviter de les retrouver affichés le lendemain sur la page Facebook des intéressés. En effet, dès le deuxième jour suivant l’instauration de l’état d’urgence, il est arrivé que nous soyons accueillis d’un : « Enfin ! Je vous attendais »… C’est pour certains une question de standing ! Nous avons d’ailleurs trouvé chez un individu radicalisé un ordinateur dont l’entier contenu avait été vidé… à l’exception, dans l’historique, d’une recherche sur l’état d’urgence ! Et ce dès le dimanche soir !
M. le président Jean-Jacques Urvoas. Lorsque vous examinez, au cours de la perquisition, l’ordinateur de la personne concernée, pouvez-vous par copie récupérer les données effacées ?
M. Pascal Belin. Non, cela ne peut se faire qu’en laboratoire. Il faudrait donc pouvoir saisir l’appareil.
M. le président Jean-Jacques Urvoas. Par ailleurs, êtes-vous suffisamment équipés pour traiter la totalité des tétraoctets que vous collectez et que vous pourriez collecter en laboratoire ?
M. Jean-François Illy. Oui. Le problème, c’est le temps que le technicien doit y consacrer. Si l’on doit vérifier sur place le contenu des ordinateurs, la perquisition s’éternise.
M. le président Jean-Jacques Urvoas. Quelle est la durée moyenne d’une perquisition ?
M. Jean-François Illy. Si l’on ne procède pas à cette vérification-là, il faut entre une heure et 75 minutes, mais s’il faut expertiser tous les fichiers informatiques, on ne s’en sort plus. De plus, au début, nous n’avions pas tout le matériel nécessaire ; nous nous sommes structurés et nous commençons à disposer de cet équipement, mais l’opération demeure lente et compliquée. Il nous faudrait pouvoir procéder à l’appréhension administrative du bien, quitte à le remettre ensuite ; ainsi permettrions-nous aux services spécialisés de récupérer l’ensemble des données durant une plage de travail normale. Les personnes auxquelles nous avons affaire n’ignorent pas nos contraintes : elles savent que, pendant la durée d’une perquisition, nous avons du mal à exploiter le contenu de leurs téléphones et à analyser leurs murs d’images sur Facebook.
Pendant la période des fêtes, qui est aussi celle où les voitures brûlent, la présence des policiers était massive au centre-ville de Strasbourg comme dans les quartiers. Nous avons constaté qu’aux pétards, dont l’utilisation était interdite, ont été substitués en certains lieux des bouteilles incendiaires ou des cocktails Molotov destinés à « accueillir » les forces de l’ordre pendant la nuit du 31 décembre…
M. le président Jean-Jacques Urvoas. Autrement dit, ils ont compensé l’interdiction des pétards en revenant au cocktail Molotov…
M. Jean-François Illy. Exactement. Les gens auxquels nous faisons face s’adaptent.
Je considère pour ma part qu’il faut s’intéresser aux quartiers qui ne bougent pas et aux associations cultuelles qui organisent des temps de prière. On retire de cette observation des indications profitables, mais elle prend du temps. Ainsi, quand on constate que des convertis fréquentent certaines mosquées mais pas d’autres, ou que des repas sont préparés pour un certain nombre d’individus dans des foyers, il est opportun de s’interroger, et d’observer. Si certains quartiers n’ont pas bougé le 31 décembre, c’est parce qu’on ne voulait pas que nous y venions… Dans le même temps, les contrôles systématiques à la frontière franco-allemande nous ont permis de détecter le passage d’individus recherchés par certains services. Il ne fallait pas attirer leur attention, mais ces contrôles nous ont permis de tracer leurs mouvements, de repérer leurs lieux de rendez-vous.
Mme Marie-Françoise Bechtel. Avez-vous reçu des signalements concernant des écoles coraniques ?
M. Jean-François Illy. L’Éducation nationale, partenaire dont on parle très peu alors qu’elle est capable de nous donner des indications de suivi et d’orientation, est à l’origine de quarante-quatre signalements. Les analyses se font aussi à partir des remontées d’observations brutes des brigades spécialisées de terrain et des bureaux de police.
M. le président Jean-Jacques Urvoas. Le FSPRT est-il un outil fiable ? Vous est-il utile ?
M. Pascal Belin. Parce qu’il est récent, il est fiable pour ce que j’en vois, mais pour l’instant peu utile : les personnes fichées sont à la fois peu nombreuses et bien connues de nos hommes et des services de renseignement ; ils n’ont pas encore besoin de le consulter systématiquement.
M. le président Jean-Jacques Urvoas. Des perquisitions administratives ont donc eu lieu chez des gens qui n’étaient pas inscrits au FSPRT ?
M. Pascal Belin. Certainement.
M. le président Jean-Jacques Urvoas. Et les domiciles de tous ceux qui y sont inscrits ont-ils été perquisitionnés ?
M. Pascal Belin. Non.
M. le président Jean-Jacques Urvoas. Cela ne vous paraît-il pas étonnant ?
M. Pierre-Marie Bourniquel. Non. Si les signes de radicalisation décelés sont légers, une perquisition administrative n’est pas forcément nécessaire.
M. le président Jean-Jacques Urvoas. J’insiste. Le ministre annonce la constitution d’un fichier des personnes signalées pour radicalisation. On lance des procédures administratives qui doivent permettre de lever les doutes à propos de beaucoup de ces gens ; les perquisitions ne sont-elles pas une occasion de le faire ?
M. Pierre-Marie Bourniquel. Les signes de radicalisation sont plus ou moins forts. Nous savions que les cibles les plus intéressantes cacheraient les armes et les documents compromettants s’il y en avait ; nous avons perquisitionné leurs domiciles en premier lieu. Ceux des individus qui donnent des signes faibles de radicalisation viennent dans un second temps.
M. Jean-François Illy. Dans le Bas-Rhin, vingt des vingt et un perquisitionnés sur proposition du SRT étaient fichés au FSPRT.
Mme Élisabeth Pochon. Vous est-il arrivé de perquisitionner deux fois le domicile d’une même personne ?
M. Jean-François Illy. Nous nous sommes posé la question pour des personnes dont nous nous sommes rendu compte qu’elles avaient deux adresses : l’une pour percevoir certaines allocations ou financer diverses activités, et une autre correspondant à leur résidence réelle. En de tels cas, il convient de faire connaître au préfet l’adresse de résidence effective alors même que la perquisition est en cours dans l’autre lieu, de sorte que nous puissions aller perquisitionner là-bas dans la foulée.
M. le président Jean-Jacques Urvoas. Que se passe-t-il si la personne visée refuse de vous accompagner ?
M. Pascal Belin. Cela ne nous a pas été dit tout de suite, mais on ne peut pas la retenir. Les perquisitions judiciaires accompagnent assez souvent une garde à vue, soit lorsqu’on interpelle la personne, soit lorsque nous l’amenons chez elle après l’avoir interpellée ailleurs. En de tels cas, nous nous assurons des personnes – et des enfants : un fonctionnaire est désigné pour s’occuper d’eux, il les accompagne dans une pièce à part et les surveille pour leur éviter une scène bouleversante. Habituellement, les personnes interpellées suivent la perquisition judiciaire et en attestent en signant le procès-verbal. Lors des perquisitions administratives, c’est une adresse qui est ciblée, non une personne ; les occupants ont le droit d’assister à la perquisition, mais ils n’y sont pas contraints.
M. le président Jean-Jacques Urvoas. Y a-t-il une gradation d’efficacité entre une perquisition administrative et une perquisition judiciaire ?
M. Pascal Belin. Nécessairement. Dans des affaires de trafic de stupéfiants ou d’armes par exemple, la perquisition judiciaire est un élément d’investigation qui fait suite à la collecte de renseignements en amont qui révèlent l’infraction. Le schéma d’une perquisition administrative est inverse : on cherche, par ce moyen, à révéler quelque chose. On ne travaille donc pas de la même manière. Les trafiquants de stupéfiants sont rarement assez stupides pour garder la drogue et l’argent chez eux ; ils se servent de nourrices, de boxes, de parties communes d’immeubles et autres lieux de stockage qui appartiennent à tout le monde et à personne. Le travail de renseignement sert à déterminer les adresses des lieux de stockage, pour permettre de perquisitionner au bon endroit ; en général, on trouve et on vérifie alors si une infraction est constituée. Le résultat obtenu est donc obligatoirement beaucoup plus efficace que lors d’une perquisition administrative, qui est un moyen d’investigation parmi d’autres.
M. le président Jean-Jacques Urvoas. Mais alors, comment évaluer la plus-value de l’état d’urgence par rapport au droit commun ?…
Votre silence en dit long !
M. Patrick Mairesse. Nous avons fait œuvre de pédagogie, notamment auprès des autorités préfectorales, qui ont découvert ce que savent les procureurs : dans une perquisition, parfois on trouve, parfois on ne trouve pas… Les préfets ont dû admettre que nous avons une obligation de moyens et pas forcément de résultat. Au demeurant, si nous avions trouvé des dizaines de Kalachnikov au cours d’une perquisition administrative, il eût sans doute été préférable, plutôt que de nous féliciter, de nous demander pourquoi nous n’avions pas procédé plus tôt à une perquisition judiciaire…
M. le président Jean-Jacques Urvoas. Soit, mais avec 500 armes découvertes au terme de 3 000 perquisitions administratives, le ratio est plutôt faible – d’autant que sont comptabilisées dans ce nombre de simples crosses de fusils.
M. Pierre-Marie Bourniquel. Je le redis, c’est en matière de renseignement que les résultats les plus intéressants sont obtenus, mais ils sont difficilement quantifiables, alors que les chiffres de la répression le sont.
M. le président Jean-Jacques Urvoas. Sans doute. Mais n’est-ce pas une échappatoire astucieuse de définir comme plus-value de l’état d’urgence un élément non quantifiable ?
M. Pierre-Marie Bourniquel. On pourrait dire la même chose de la prévention – or qui peut en nier l’impact ? Que certains éléments ne soient pas quantifiables ne les rend pas moins nécessaires, et même essentiels.
M. Pascal Belin. Permettez-moi d’évoquer un autre aspect. Il est arrivé que des perquisitions administratives nous permettent de faire rapidement sortir de nos tableaux des gens soupçonnés de radicalisation à la suite d’une dénonciation aux motivations malveillantes d’une ex-épouse ou d’un employeur, mais pour lesquels nous n’avions pas d’autre moyen de vérification que l’observation extérieure. À l’inverse, nous avons aussi pu constater rapidement par ce biais que certains des individus signalés l’avaient été pour de bonnes raisons. On peut quantifier le nombre de personnes signalées qui ont été sorties de nos tableaux et celles que l’on a tout intérêt à maintenir inscrites dans nos fichiers. Mais, sur le fond, une perquisition administrative n’a pas le même impact qu’une garde à vue – et encore les gardes à vue ne donnent-elles pas toutes des résultats d’égale importance. Et il est vrai que, dans certains lieux, on a trouvé des stocks d’armes et dans d’autres, une crosse de fusil mais que tout est comptabilisé de la même façon.
M. le président Jean-Jacques Urvoas. Si je vous entends bien, l’avantage de l’état d’urgence était d’abord la surprise, puis le renseignement ; en d’autres termes, l’état d’urgence est terminé ?
M. Patrick Mairesse. Pas exactement. Ainsi, je me pose effectivement la question de retourner au domicile de gens chez qui nous sommes allés perquisitionner pendant les tout premiers jours de l’état d’urgence, alors qu’ils avaient « nettoyé » leurs ordinateurs et que nous ne disposions peut-être pas de tous les moyens informatiques qui nous auraient été nécessaires. Peut-être les individus ciblés, se considérant désormais tranquilles, ont-ils repris leurs activités comme avant.
M. Paul Agostini. Je reviens un instant sur le fait que tous les domiciles de toutes les personnes inscrites au FSPRT n’ont pas été l’objet d’une perquisition administrative. Si l’on perquisitionne, c’est que l’on cherche quelque chose. Or, au nombre des inscrits, il y a des aliénés, qui sont plus souvent à l’hôpital que chez eux, et aussi des jeunes filles qui se radicalisent dans le seul but d’embêter leurs parents. Il est bon de maintenir ces gens inscrits au fichier pour pouvoir les suivre, mais il n’y a pas nécessairement matière à perquisitionner leur domicile.
Quant à l’état d’urgence, il ne se limite pas aux perquisitions administratives. Il permet aussi la sécurisation des gares, des aéroports et des écoles, et, plus généralement, un niveau de vigilance élevé.
M. le président Jean-Jacques Urvoas. Les quelque 400 personnes assignées à résidence sont-elles dangereuses ?
M. Paul Agostini. Pour certaines, oui.
M. le président Jean-Jacques Urvoas. Et les autres ?
M. Paul Agostini. Dans la Haute-Vienne, les assignés étaient suivis par les services de la sécurité intérieure et la perquisition a permis de prendre connaissance du contenu de leur ordinateur. L’un d’eux est soupçonné de séjours en Syrie et fait des séjours réguliers en Tchétchénie. Un autre, qu’il me semble très intéressant de suivre, a séjourné en Syrie.
M. Jean-François Illy. Nous avons cinq assignés à résidence dans le Bas-Rhin. J’observe incidemment que, puisqu’ils sont tous tenus de venir pointer trois fois par jour au commissariat à la même heure : si d’aventure ils ne se connaissaient pas précédemment, ils se connaissent maintenant… Autrement dit, nous facilitons la constitution d’éventuels réseaux !
M. le président Jean-Jacques Urvoas. C’est comme le regroupement en prison…
M. Jean-François Illy. Au nombre des assignés à résidence, figure une jeune fille qui a été perquisitionnée, ce qui a permis de déterminer ses liens avec la sœur de l’un des terroristes morts au Bataclan.
Il est exact que certaines personnes sont signalées pour avoir fait des déclarations délirantes. Mais les perquisitions administratives ont aussi permis d’établir ou de confirmer le lien entre des individus suivis par la sous-direction antiterroriste et par la DGSI, à la frange d’enquêtes judiciaires. Je pense notamment à un individu interpellé la semaine dernière en possession d’un pistolet-mitrailleur Scorpio, de munitions et de deux gilets pare-balles ; il avait été contrôlé peu avant dans un hall d’immeuble alors qu’il était en compagnie d’un ami lui-même suivi par les services de renseignement. En d’autres termes, les perquisitions administratives nous permettent de garder l’avantage sur le terrain, ce qui n’est pas négligeable, et nous donnent la possibilité d’intervenir de manière cohérente et rapide dans certains quartiers difficiles pour voir ce qui s’y passe. Telle est, selon moi, la plus-value de l’état d’urgence.
Mme Élisabeth Pochon. Est-il arrivé que des personnes assignées à résidence se soient soustraites à leurs obligations ? Si cela a été le cas, comment cela a-t-il été traité ?
M. Jean-François Illy. À Strasbourg, où nous avons systématiquement couplé notification de l’assignation à résidence et perquisition administrative, il n’y a rien eu de tel.
M. Pascal Belin. Dans le Loiret, la première semaine, les assignés étaient tenus de pointer au commissariat quatre fois par jour ; parce que cela signifiait, pour certains, des trajets d’une heure et demie à répétition, nous sommes passés à des obligations plus soutenables. Sur les quatorze personnes assignées à résidence, deux procédures seulement ont été lancées pour manquements aux obligations ; c’est très peu.
M. Pierre-Marie Bourniquel. Sur dix assignations à résidence dans les Bouches-du-Rhône, un seul manquement aux obligations a été constaté. La personne concernée a été interpellée, placée en garde à vue et a fait l’objet d’une procédure en comparution immédiate.
Peut-être tous les assignés à résidence sont-ils dangereux, mais beaucoup d’individus qui ne sont pas assignés à résidence sont, eux, extrêmement dangereux. Ainsi de cet adolescent de seize ans qui ce matin, dans les rues de Marseille, a agressé à coups de machette un homme coiffé d’une kippa ; le jeune homme portait également un couteau qu’il était décidé à utiliser contre les policiers qui l’approcheraient pour l’interpeller, et il aurait déclaré envisager de tuer des membres des forces de l’ordre avec une arme à feu. J’ai appris que la section antiterroriste du parquet de Paris s’est saisie de l’enquête. En réalité, un certain nombre d’individus atteints de troubles psychiques ont trouvé, si j’ose dire, bien que le mot soit particulièrement mal choisi, une nouvelle croisade. Le danger est aussi là.
M. le président Jean-Jacques Urvoas. Vos personnels ont-ils peur ?
M. Pierre-Marie Bourniquel. Non. Ils font un peu plus attention et mettent leur gilet pare-balles. Beaucoup ont demandé à porter leurs armes en dehors du service. Mais il n’y a aucun fléchissement de l’activité policière. Je sens au contraire une nouvelle forme de solidarité et, même à Marseille, une plus grande prise de conscience, plus de soutien et d’empathie de la part de la population à l’égard des policiers. C’est important.
M. Pascal Belin. Après qu’un attentat contre mon service a été déjoué par la DGSI, il y a une peur rétrospective et, par la suite, des rumeurs résurgentes de nouvel attentat se sont d’autant plus rapidement répandues au sein du personnel.
M. Patrick Mairesse. Une des personnes assignées à résidence en Isère a été le sujet d’articles dans Le Monde et un journal local. La perquisition administrative de son domicile a suscité un vif intérêt de la part de tous les services qui souhaitaient pouvoir exploiter les données contenues dans son ordinateur. L’homme est tenu de se présenter trois fois par jour au commissariat de police. À chaque fois, le détecteur de métaux sonne, car il prend soin d’avoir en poche un morceau de ferraille, un tournevis, un autre outil… Depuis trois jours, il ne signe plus de son nom mais écrit la mention : « Je ne suis pas un terroriste ». Ce n’est pas une infraction, mais alors qu’un officier devait le recevoir pour lui signifier qu’il importait d’en finir avec ces provocations permanentes, il s’est, comme par hasard, présenté au commissariat accompagné d’un journaliste du Monde...
M. le président Jean-Jacques Urvoas. Messieurs, je vous remercie.
——fpfp——
AUDITION DE MME SOPHIE TISSOT, PRÉSIDENTE DE L’UNION SYNDICALE DES MAGISTRATS ADMINISTRATIFS, ET DE M. OLIVIER DI CANDIA, SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
Compte rendu de l’audition, non ouverte à la presse, du lundi 11 janvier 2016
M. le président Jean-Jacques Urvoas. Je remercie Mme Sophie Tissot et M. Olivier Di Candia, présidente et secrétaire général de l’Union syndicale des magistrats administratifs, d’avoir répondu à l’invitation de la commission des Lois, dans le cadre du contrôle des mesures que le Parlement a autorisé le Gouvernement à prendre pendant l’état d’urgence.
Nous souhaitions vous entendre, après avoir auditionné le vice-président et le président de la section du contentieux du Conseil d’État, puisque, dans le cadre de l’application de l’état d’urgence, les juridictions administratives ont eu, ont et auront une responsabilité particulière. Nous aimerions savoir comment cela a été vécu « de l’autre côté du miroir ». Les juridictions administratives étaient-elles préparées à un tel contentieux ? Quelle relation avez-vous entretenue avec le Conseil d’État ? Comment avez-vous appréhendé la compétence qui vous était dévolue ?
Compte tenu de la sensibilité des questions abordées, nos auditions se déroulent à huis clos. Leurs comptes rendus, qui ne seront pas nécessairement exhaustifs, seront publiés à l’issue de notre mission de contrôle.
Conformément à l’article 6 de l’ordonnance du 17 novembre 1958, je vais vous demander de prêter serment de dire toute la vérité, rien que la vérité.
(Mme Sophie Tissot et M. Olivier Di Candia prêtent serment.)
Mme Sophie Tissot, présidente de l’Union syndicale des magistrats administratifs. L’état d’urgence a été déclaré par décret du 14 novembre 2015 et prorogé, pour une durée de trois mois, à compter du 26 novembre, par la loi du 20 novembre 2015 prorogeant l’application de la loi du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence et renforçant l’efficacité de ses dispositions.
Par son article 4, qui modifie l’article 6 de la loi de 1955, la loi permet désormais au ministre de l’intérieur de prononcer une assignation à résidence « […] dans le lieu qu’il fixe, de toute personne […] à l’égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace pour la sécurité et l’ordre public ». Aux termes de ce même article 4, est créé un article 4-1 qui dispose notamment que : « À l’exception des peines prévues à l’article 13, les mesures prises sur le fondement de la présente loi sont soumises au contrôle du juge administratif dans les conditions fixées par le code de justice administrative, notamment son Livre V ».
Enfin, le nouvel article 4-1 de la loi du 20 novembre prévoit que « l’Assemblée nationale et le Sénat sont informés sans délai des mesures prises par le Gouvernement pendant l’état d’urgence. Ils peuvent requérir toute information complémentaire dans le cadre du contrôle et de l’évaluation de ces mesures ».
C’est donc parce que le juge administratif est juge de certaines mesures essentielles de la loi prorogeant l’état d’urgence, et parce que la commission des Lois a souhaité mettre en place un suivi et une veille continue de l’ensemble de ces mesures afin d’en assurer un contrôle effectif, que l’Union syndicale des magistrats administratifs (USMA) est aujourd’hui auditionnée, et nous tenions à vous en remercier.
Notre positionnement est toutefois délicat, et il nous incombe d’en faire état.
L’USMA est un syndicat représentant les magistrats administratifs ; nous méconnaîtrions et outrepasserions notre rôle si nous nous permettions aujourd’hui de nous prononcer au-delà de ce qu’il nous appartient de dire : en d’autres termes, ce sont des questions de droit et de justice, mais également des conditions dans lesquelles nous rendons cette justice que nous allons évoquer devant vous. Le reste ne nous appartient que comme citoyens, non comme magistrats.
Aussi, en premier lieu, allons-nous nous pencher sur ce qui résulte à ce jour de la jurisprudence du Conseil d’État ; les décisions qui ont pu être rendues par les juges de première instance sont, de fait, dépassées. En second lieu, nous nous permettrons de tirer des enseignements de ces décisions, non plus juridiquement mais humainement, afin de nous interroger sur les répercussions que pourraient avoir, sur les juridictions administratives de premier ressort, les décisions prises tant par le Conseil d’État que par le Conseil constitutionnel.
À notre sens, la compétence du juge administratif était, pour ces mesures de police administrative, incontournable et justifiée. Comme l’a dit le rapporteur public, M. Domino, dans ses conclusions sous les décisions du Conseil d’État du 11 décembre : « Pour ces mesures, le référé, et particulièrement le référé liberté, est une voie de droit qui est, pour tout dire, irremplaçable. Les assignations à résidence prononcées pour de courtes durées ne peuvent même pas être contrôlées autrement ».
Les juges des référés de plus d’une dizaine de tribunaux administratifs ont procédé au contrôle des mesures prises en raison de l’état d’urgence, à partir d’un cadre juridique vierge de tout précédent – aucun référé n’avait jamais porté sur une mesure prise dans ce cadre. L’immense majorité des affaires, soit plus de 80 %, concernait des mesures d’assignation à résidence, le reste concernant d’autres mesures – interdiction de manifestations, interdiction de fréquenter tout lieu de culte, perquisition, fermeture administrative provisoire d’un restaurant.
Aujourd’hui, l’office du juge des référés sur les mesures prises dans le cadre de l’état d’urgence est précisé par sept décisions rendues par le Conseil d’État, le 11 décembre 2015, par les conclusions du rapporteur public sur ces décisions, par une ordonnance rendue le 23 décembre dernier par le Conseil d’État, par deux ordonnances du 6 janvier 2016 et enfin par la décision du Conseil constitutionnel du 22 décembre 2015.
À l’examen des mesures portant assignation à résidence, quel qu’ait été le type d’assignation à résidence qui lui était soumis, le juge des référés – qu’il s’agisse du référé liberté ou du référé suspension – doit retrouver classiquement son rôle, c’est-à-dire celui de juge de l’urgence. Il lui appartient de s’interroger sur l’existence de cette dernière.
Il n’y a plus de doute désormais : les mesures d’assignation à résidence sont restrictives de la liberté d’aller et venir : dès lors, par leur nature même, elles créent une situation d’urgence. En la matière, celle-ci doit être présumée, ce qui n’est pas le cas, rappelons-le, des assignations à résidence prises à l’encontre des étrangers en situation irrégulière. C’est en conséquence à l’administration qu’il appartiendra de faire valoir des circonstances particulières de nature à renverser cette présomption : la charge de la preuve contraire lui incombe.
Cela entraîne une première conséquence pour le juge administratif : aucune requête tendant à la suspension d’une décision portant assignation à résidence ne pourra plus, pour ce motif, être rejetée par voie d’ordonnance, sans instruction contradictoire et sans audience.
Juge de l’urgence, le juge des référés ne saurait davantage abandonner son office au profit d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) – la décision C. Domenjoud, rendue le 11 décembre 2015 par le Conseil d’État, a précisé cette obligation. Il lui appartient, en l’état de l’instruction, de s’assurer que l’autorité administrative n’a pas porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale en exerçant son office de manière autonome, laissant d’ailleurs de côté cette QPC qui sera jugée postérieurement.
Précisons au surplus que, par sa décision du 22 décembre 2015, le Conseil constitutionnel a précisé que les dispositions contestées de l’article 6 de la loi du 3 avril 1955 n’apportaient pas une atteinte disproportionnée à la liberté d’aller et venir. Il a notamment souligné que la mesure d’assignation à résidence, sa durée, ses conditions d’application, les obligations complémentaires dont elle peut être assortie, doivent être justifiées et proportionnées aux raisons ayant motivé la mesure, dans les circonstances particulières ayant conduit à la déclaration de l’état d’urgence… sous le contrôle du juge administratif qui se doit en l’espèce d’en vérifier le caractère adapté, nécessaire et proportionné à la finalité poursuivie.
L’office du juge des référés se trouve là aussi précisé : notre contrôle ne pourra être, d’évidence, qu’un contrôle de proportionnalité, parce que l’étendue du contrôle du juge est en relation directe avec celle, toujours première, des devoirs et des pouvoirs de l’administration. C’est seulement ainsi que le juge des référés entrera pleinement dans son champ de compétences tel que défini plus haut par le rapporteur public : exercer son office, pratiquer ce contrôle, qui ne saurait être « au rabais », l’État de droit ne pouvant céder devant l’état d’urgence.
Comme le disait le même rapporteur public, le juge administratif doit « s’assurer, en l’état de l’instruction devant lui, que l’autorité administrative n’a pas porté d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, que ce soit dans son appréciation de la menace que constitue le comportement de l’intéressé compte tenu de la situation ayant conduit à la déclaration de l’état d’urgence, ou dans les modalités de l’assignation à résidence ».
Rien de nouveau pourtant dans les modalités de ce contrôle.
Il convient en effet de rappeler que nous sommes ici en matière de police – certes de haute police, mais de police tout de même. Le contrôle pratiqué en la matière par le juge administratif depuis maintenant fort longtemps – l’arrêt Benjamin date de 1933 – est bien de ce type : un contrôle de proportionnalité.
Il n’existe aucune raison juridique pour que les mesures d’assignation à résidence constituent une exception.
Dans l’exercice des pouvoirs qu’il détient en application de la loi de 1955, le pouvoir exécutif est soumis au respect du principe de proportionnalité. « […] l’éminence de la police exercée dans ce cadre ne saurait se traduire par une évanescence des principes auxquels elle est normalement soumise. » – pour citer encore une fois le rapporteur public, M. Domino.
Deuxième conséquence pour le juge administratif : vérifiant la proportionnalité de la mesure, le juge pourra suspendre les mesures contestées devant lui, non seulement en tout, mais aussi en partie, pour ne permettre que ce qui est proportionné à la menace identifiée. Pour ce seul motif, le contrôle pratiqué par le juge administratif échappe, selon nous, à toute critique : tout peut être contesté devant le juge, le principe de la mesure comme son étendue. Ainsi, le juge peut modifier les modalités de l’assignation à résidence, leur nombre, mais également le lieu de la convocation au regard du respect de la vie familiale de l’intéressé ou de l’intérêt supérieur de ses enfants. L’ordonnance du 6 janvier dernier l’a précisé.
Enfin, si les décisions du 11 décembre l’ébauchaient, l’ordonnance rendue le 23 décembre le confirme : pour caractériser l’existence d’un comportement constitutif d’une menace pour l’ordre et la sécurité publique, l’administration pourra produire des « notes blanches ».
Ces notes, régulièrement contestées, voire proscrites par une circulaire de 2004, constituent toutefois un moyen de preuve, le seul d’ailleurs à étayer l’argumentation de l’administration et à permettre de protéger le secret des sources et des méthodes des services des ministères de l’intérieur ou de la défense.
Il nous semble, à nouveau, nécessaire de laisser de côté les idées reçues. Les notes blanches sont un moyen de preuve, et « aucune disposition législative ni aucun principe ne s’oppose à ce que les faits relatés dans les "notes blanches" produites par le ministre et qui bien évidemment doivent être versées aux débats et soumises aux échanges contradictoires, soient susceptibles d’être prises en considération par le juge administratif » – a jugé le Conseil d’État dans son ordonnance du 23 décembre dernier.
Ces notes permettent à l’administration d’apporter des éléments de faits au soutien de la mesure prise et contestée devant le juge. Toutefois et comme dans tout litige, le juge administratif est maître de l’instruction et peut, s’il l’estime souhaitable, afin de s’assurer que l’autorité administrative n’a pas porté d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, ordonner un supplément d’instruction : suspendre l’audience, la renvoyer, afin de permettre une discussion contradictoire sur les éléments soumis au débat, notamment sur ces notes blanches.
Dès lors que le débat contradictoire est possible, dès lors que ces notes blanches demeurent un moyen de preuve loin d’être irréfragable, rien dans les principes du procès administratif ne saurait les interdire.
C’est le dernier enseignement : maître de son procès, dans le respect de ses règles, le juge des référés peut, sans méconnaître son office, s’appuyer, s’interroger, permettre la contradiction sur ces notes blanches comme sur tout autre élément produit au dossier. Preuve à l’instar de toute autre preuve, la note blanche est contestable, non dans l’utilisation qui en est faite, mais dans son contenu.
Le juge se doit, dans l’examen des faits qu’il pratique, entendre et permettre la contradiction sur ces notes blanches comme sur tout autre élément du dossier. Mais il peut également recourir à un complément d’instruction, pour compléter ou préciser les éléments figurant dans ces notes, à charge pour le ministre de produire de nouveaux éléments sous forme de notes blanches, qui seront alors soumises à nouveau au principe du contradictoire.
En substituant à un recours devant une commission une procédure de référé devant le juge administratif, la loi du 20 novembre 2015 a privilégié une procédure plus protectrice des libertés et, par là même, accordé un rôle essentiel au juge administratif.
Cet enjeu, auquel nous ne saurions nous dérober, impose au juge administratif de statuer en toute indépendance, mais également en toute sécurité : sécurité pour lui, mais également pour les agents administratifs travaillant à ses côtés, et pour le public présent aux audiences. En effet, il ne saurait être contesté que la justice doit être rendue en toute indépendance et en toute sécurité : que le juge soit administratif ou judiciaire n’y change rien.
En conséquence, d’évidence, le dispositif mis en place en novembre 2015 doit imposer à la justice administrative de se « sécuriser ». Les juridictions administratives ne sont aujourd’hui pas équipées de dispositifs spécifiques comme le sont les juridictions judiciaires. Elles devront l’être. Si, dans un contexte budgétaire plus que contraint, il est délicat de solliciter l’octroi de moyens supplémentaires, en l’espèce, ils nous paraissent nécessaires et même indispensables à une justice sereine et de qualité.
La sûreté est un élément primordial de revendication de notre syndicat. Les attentats de janvier nous avaient poussés à être encore plus revendicatifs. Ceux du 13 novembre devront conduire à doter les juridictions administratives des moyens nécessaires à garantir leur pleine sécurité.
Enfin, parce que rendre la justice ne peut se faire qu’en toute indépendance, la juridiction administrative doit afficher les signes de son indépendance, aujourd’hui fortement contestée.
Malheureusement, les événements qu’a subis la France en 2015 ne peuvent que nous pousser à solliciter les attributs que sont les signes de cette garantie de toute activité juridictionnelle : la robe, avant tout ; la prestation de serment, également ; et moins apparente mais fondamentale, la consécration constitutionnelle du statut de magistrat.
Les juges administratifs ont été désignés par la loi du 20 novembre 2015 pour garantir la protection des libertés et des droits fondamentaux. Il est dès lors indispensable de les doter de tous les attributs qui symbolisent leur indépendance, lesquels viendraient conforter la réalité : nous sommes des juges indépendants, et nous avons su montrer depuis ces dernières années que nous étions les garants, aux côtés du juge judiciaire, et tout autant que lui, des libertés fondamentales.
M. le président Jean-Jacques Urvoas. L’autre jour m’est revenue cette phrase de Mauriac : « J’aime tellement l’Allemagne que je préfère qu’il y en ait deux ». Il en va à mes yeux de même de la protection des libertés : je l’aime tellement que je préfère qu’il y ait deux juges pour s’en occuper : le juge judiciaire et le juge administratif.
Vous avez souligné à bon droit que le législateur avait choisi de se passer des commissions départementales, pour confier au juge administratif cette responsabilité. Et c’est précisément sur l’exercice de cette responsabilité que je vous interrogerai d’abord.
J’ai bien entendu tout ce que vous avez dit : il y a un avant et un après les décisions du Conseil d’État. Pour autant, je m’intéresse à l’avant. En effet, alors que le législateur fait confiance au juge administratif pour assurer la protection des libertés, les conditions dans lesquelles certaines décisions ont pu être rendues ont de quoi surprendre : pas d’audience, pas de contradictoire, simplement des ordonnances de tri…
J’ai effectué huit déplacements dans les départements pour me rendre compte concrètement de l’application qui est faite de l’ensemble des mesures prévues par la loi du 3 avril 1955. Dans un cas, le préfet avait préparé toute une base documentaire – notes blanches, mais aussi d’autres éléments – pour étayer sa décision, persuadé que le juge administratif allait le lui demander. Or ce dernier s’est contenté de l’arrêté préfectoral sans même le convoquer, sans même une audience, et donc sans contradictoire. Devant de tels cas, on peut comprendre que certains aient pu critiquer la juridiction administrative. Quel est donc votre point de vue, en tant que syndicalistes attentifs au fonctionnement de votre institution ?
Mme Sophie Tissot. Il est exact que quelques décisions ont été rendues sans audience préalable, donc sans contradictoire parce que, au vu de l’arrêté et des moyens qui étaient développés, il était apparu au juge que le contradictoire n’était pas nécessaire.
C’est aussi pour cette raison que je vous ai dit en préambule que les décisions du Conseil d’État étaient les bienvenues, dans la mesure où elles ont permis d’éviter de revoir de telles décisions. Je crois qu’il y a eu sept – six plus une – ordonnances dans lesquelles le juge des référés de première instance avait pris ce parti. Mais à partir du 11 décembre, il n’y en a plus eu.
M. Olivier Di Candia, secrétaire général de l’Union syndicale des magistrats administratifs. Il faut aussi avoir à l’esprit l’état de la jurisprudence avant les décisions du Conseil d’État. En matière de référé liberté, selon nos bases de jurisprudence, deux conditions sont à prendre en compte : d’une part, l’existence d’une situation d’urgence et, d’autre part, l’existence d’une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il est donc dans les possibilités du juge administratif de régler des affaires sans audience, et donc sans contradictoire, lorsque la démonstration de l’urgence n’est pas apportée par le requérant.
Sans qu’il soit question de lui faire le moindre procès d’intention, le réflexe du collègue a été de se pencher sur l’existence de la jurisprudence la plus proche, celle des assignations à résidence des étrangers en situation irrégulière, en exigeant des éléments apportant la démonstration de la situation d’urgence. Et c’est en cela que les décisions du Conseil d’État fortifient la position du juge administratif, puisqu’en la matière, l’urgence sera désormais présumée, ce qu’elle n’était pas nécessairement dans l’état antérieur de la jurisprudence.
M. le président Jean-Jacques Urvoas. Vous avez rappelé que vous n’aviez pas d’expertise particulière sur ces sujets, d’ailleurs comme aucun des acteurs de l’état d’urgence, qu’il s’agisse du législateur qui essaie d’assurer un contrôle en temps réel, à charge pour lui de l’inventer chaque jour, des préfets ou des policiers que nous avons auditionnés. Avez-vous bénéficié d’un soutien documentaire de la part du Conseil d’État sur l’état d’urgence de 2005 ?
Mme Sophie Tissot. Nous bénéficions en permanence d’une base de données pour tout contentieux, dénommée Ariane. Nous y avons accès aux décisions de première instance.
M. le président Jean-Jacques Urvoas. Le Conseil d’État avait donc intégré dans cette base de données les décisions de 2005. Une note d’information était-elle jointe ? Je vous pose cette question car les conclusions du rapporteur public ont créé un vade-mecum de l’état d’urgence. Du reste, j’ai trouvé les vingt-trois pages rédigées par le rapporteur public absolument remarquables. Elles sont d’une grande limpidité et témoignent de grandes qualités pédagogiques.
Mme Sophie Tissot. Le Conseil d’État est attaché au respect de l’indépendance des magistrats, y compris en première instance. Nous bénéficions des conclusions des décisions du Conseil d’État. Il appartient ensuite à chaque juge, en première instance, de faire sa jurisprudence.
On se rend compte que le juge administratif a été très réactif : entre le moment où ces ordonnances ont été prises et le recours devant le Conseil d’État, il s’est écoulé moins d’un mois… Le délai a été très bref pour faire admettre que l’atteinte à la liberté d’aller et venir était telle qu’elle créait une situation d’urgence impliquant une audience et un contradictoire sur ces décisions administratives.
M. le président Jean-Jacques Urvoas. Le Conseil constitutionnel a jugé sa QPC en onze jours. Et pour notre part nous avons voté une loi en trois jours ! On ne peut guère faire mieux.
Que pensez-vous de cette tribune publiée sur le site de Mediapart, le 29 décembre, par des juges administratifs, sous couvert de l’anonymat ?
M. Olivier Di Candia. À titre personnel, je suis diamétralement opposé à ce qui a été rédigé. Au vu du contexte, on peut admettre que ces premières affaires sans audience aient pu constituer une erreur. Mais en tout cas aujourd’hui, à travers les décisions rendues par le Conseil d’État, le contrôle du juge est entier. Prétendre que nous n’avons pas les moyens d’exercer le contrôle revient désormais à dire que nous ne serions pas des juges protecteurs des libertés fondamentales. C’est une forme d’autocritique dont nous voulons nous défaire.
M. le président Jean-Jacques Urvoas. Je l’ai vécue comme telle. C’est pourquoi je n’ai pas bien compris quelle était la vocation de ce texte.
Mme Sophie Tissot. Cela rejoint l’une des revendications que j’ai évoquée tout à l’heure : nous sommes, du fait de la jurisprudence de ces dernières décennies, devenus des juges protecteurs des libertés fondamentales. En revanche, les critiques que nous entendons, et qui émanent non seulement de cette tribune mais aussi du président de la Cour de cassation et des magistrats judiciaires, sont d’autant plus faciles que nous ne disposons pas de ce statut constitutionnel reconnaissant notre qualité de juge administratif. Cela dit, des progrès ont été accomplis en la matière depuis le milieu des années 2000 puisque le législateur a reconnu cette compétence de juge administratif. Mais il doit aller plus loin pour éviter toute critique, comme celles qui sont faites actuellement.
M. le président Jean-Jacques Urvoas. Pensez-vous que cette tribune est partagée par vos collègues, ou bien est-ce une initiative minoritaire ?
Mme Sophie Tissot. Je pense qu’elle est minoritaire.
M. Olivier Di Candia. Pour en avoir parlé au sein de nos juridictions, nous avons eu le sentiment que cette tribune était loin d’être partagée.
Mme Sophie Tissot. Un mouvement sans conteste majoritaire et opposé à cette tribune vise à dire que nous avons été capables d’assumer ces décisions dans le cadre de l’état d’urgence. Soixante-cinq à soixante-dix décisions ont été rendues par le juge administratif des référés de première instance. Nous avons respecté les délais de quarante-huit heures. Nous avons su nous organiser, absorber cette charge de travail supplémentaire et, sur le fond, nous montrer protecteurs des libertés fondamentales.
M. le président Jean-Jacques Urvoas. L’affaire Domenjoud porte sur une mesure d’assignation à résidence qui n’est pas directement liée au terrorisme mais à des menaces sur l’ordre public en raison de la tenue de la COP21. Lorsque nous avons voté la prorogation de l’état d’urgence pour trois mois, il s’agissait avant tout de donner les moyens à l’exécutif de lutter contre le terrorisme, d’autant que l’opération de Saint-Denis stricto sensu n’était pas terminée. Puis nous avons découvert les mesures d’assignation à résidence prononcées à l’occasion de la conférence sur le climat. Pour certains d’entre eux avait également été décidée une interdiction de se rendre en Île-de-France. Pensez-vous qu’il aurait été possible pour le juge administratif de tenir compte de l’existence d’autres mesures de police administrative, de droit commun ou exceptionnelles, pour fonder sa décision ? Ce qui me surprend, c’est la "double peine"… D’autant qu’un individu assigné à résidence en province aura du mal à se rendre en Île-de-France ! Face à une telle situation, quel est votre raisonnement ?
Mme Sophie Tissot. On applique le contrôle de proportionnalité. Le juge administratif n’a pas à juger de l’opportunité de la décision. S’il y a deux mesures ayant le même objet, le juge annulera une des mesures de police. Mais dans le cas que vous évoquez, apparemment le juge a estimé que ces deux mesures étaient compatibles ?
M. le président Jean-Jacques Urvoas. Mais je ne sais s’il avait eu connaissance des deux mesures.
M. Olivier Di Candia. Effectivement, je n’en suis pas certain. Le juge contrôle la mesure d’assignation à résidence et ne raisonne pas en termes de peine, de sanction, puisque c’est une mesure de police. Il s’agit pour lui de déterminer si l’assignation à résidence est le moyen d’éviter l’existence d’une situation de trouble à l’ordre public.
M. le président Jean-Jacques Urvoas. Si l’on écarte les vices de forme ou les erreurs de droit, que serait une assignation prononcée en vertu de l’état d’urgence qui porterait une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ?
M. Olivier Di Candia. L’ordonnance rendue le 6 janvier par le juge des référés du Conseil d’État en est une bonne illustration. Il a estimé en effet que les modalités de l’assignation à résidence décidées sur une personne, modalités qui l’obligeaient à pointer trois fois par jour dans une commune distante de dix kilomètres de son lieu d’habitation, portaient une atteinte manifestement grave et illégale parce qu’elle rendait l’organisation de sa vie privée impossible.
Mme Sophie Tissot. Une telle mesure aboutit finalement à un confinement. Il ne s’agit plus d’une mesure restrictive mais d’une privation de liberté.
M. le président Jean-Jacques Urvoas. Un collectif d’universitaires qualifie assez violemment les assignations à résidence. Il va plus loin que le Conseil d’État.
Je vous ai entendu dire que les notes blanches étaient proscrites par une circulaire de 2004.
Mme Sophie Tissot. Selon cette circulaire, les notes blanches ne devaient plus être utilisées et, donc, pas être soumises au juge ni au débat contradictoire.
M. le président Jean-Jacques Urvoas. Selon vous, qu’est-ce qu’une contestation sérieuse de ces notes blanches ?
Mme Sophie Tissot. Ce serait un faisceau d’indices qui réussirait à combattre ce qui y est écrit.
L’enseignement que peut apporter la personne assignée à résidence ou l’usage qu’elle fait de certains sites ou réseaux sociaux sont parfois mis en avant par une note blanche. Il est permis de penser que si le requérant développait davantage des moyens de preuve en produisant par exemple des attestations nombreuses et concordantes, circonstanciées, il pourrait faire basculer l’intime conviction du juge.
M. le président Jean-Jacques Urvoas. Un long débat a eu lieu en commission sur la substitution, proposée par l’exécutif, de la notion de comportement dangereux à celle d’activité dangereuse Le comportement est plus difficile à interpréter que l’activité qui est matérielle. Ce changement sémantique a-t-il eu des conséquences pour le juge administratif, ou aviez-vous l’habitude, avec le droit des étrangers, de faire face à ce genre d’interprétation ?
Mme Sophie Tissot. On arrive à déterminer le comportement sans pour autant tomber dans le délit d’opinion, ce qui peut être l’écueil.
M. le président Jean-Jacques Urvoas. Autrement dit, vous aviez déjà l’habitude d’appréhender la notion de comportement.
Mme Sophie Tissot. Oui.
M. Olivier Di Candia. Cette notion était même centrale dans le contrôle des mesures de police.
M. le président Jean-Jacques Urvoas. Ce terme a fait l’objet ici d’un long débat. On avait l’impression d’entrer dans une justice un peu prédictive.
Mme Sophie Tissot. De manière générale, lorsque le juge administratif contrôle une attitude par rapport à l’ordre public, il a déjà l’habitude d’appréhender le comportement.
M. le président Jean-Jacques Urvoas. Nous vous remercions, madame, monsieur, de votre disponibilité.
——fpfp——
AUDITION DE M. THOMAS ANDRIEU, DIRECTEUR DES LIBERTÉS PUBLIQUES ET DES AFFAIRES JURIDIQUES AU MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
Compte rendu de l’audition, non ouverte à la presse, du mardi 19 janvier 2016
M. le président Jean-Jacques Urvoas. Monsieur le Directeur, nous avons souhaité, Jean-Frédéric Poisson et moi-même, évoquer avec vous l’application des mesures dont le Parlement a confié la mise en œuvre au Gouvernement dans le cadre de l’état d’urgence, et vous remercions d’avoir répondu à notre invitation.
Je rappelle que cette audition se déroule à huis clos, mais fera l’objet d’un compte rendu écrit qui sera publié à l’issue de nos travaux.
Conformément aux règles propres aux commissions d’enquête qui sont applicables aux travaux de notre commission sur le contrôle de l’état d’urgence, je vous demande de prêter serment de dire toute la vérité et rien que la vérité.
(M. Thomas Andrieu prête serment.)
Je vous laisse la parole pour un exposé liminaire, qui sera suivi de nos questions.
M. Thomas Andrieu, directeur des libertés publiques et des affaires juridiques (DLPAJ) au ministère de l’Intérieur. Merci, monsieur le président.
Un mot, d’abord, pour dire qu’il ne saurait, à mes yeux, n’être fait qu’un point d’étape de l’état d’urgence. Il est trop tôt, en effet, pour en dresser un bilan, même si le Parlement va devoir très vite se poser deux questions : faut-il constitutionnaliser l’état d’urgence ? Et faut-il le proroger ?
Je formulerai une première observation sur le prononcé de l’état d’urgence au cours des heures qui ont suivi les attentats. Alors même que la conflictualité est extrême au contentieux sur ce sujet – j’y reviendrai –, personne n’a contesté juridiquement le bien-fondé du déclenchement de l’état d’urgence, ce qui aurait pourtant été possible. Ce n’est notamment pas le cas dans les trois questions prioritaires de constitutionnalité (QPC) qui ont été portées devant le Conseil constitutionnel.
Je ne reviens pas sur la présentation du régime juridique de l’état d’urgence, dont l’architecture globale est bien connue de votre commission.
Une remarque historique seulement : c’est la première fois depuis la période qui a duré de 1961 à 1963 que l’état d’urgence est véritablement mis en œuvre en métropole. En 2005, il n’y avait eu qu’une seule perquisition administrative et aucune assignation à résidence. Or, à ce jour, plus de 330 personnes sont effectivement assignées à résidence et, ce matin, nous en sommes à 3 143 perquisitions administratives. Cette situation est sans précédent dans l’histoire de la Ve République depuis 1961.
Permettez-moi d’ouvrir une très brève parenthèse concernant le double rôle que joue ma direction pendant l’état d’urgence. À son rôle traditionnel de direction juridique fournissant un conseil juridique et contentieux – celui d’un avocat internalisé pour le reste du ministère – s’ajoute en effet celui d’une direction métier : nous sommes, par délégation du ministre, producteurs des mesures de police administrative que sont les assignations à résidence. Ainsi, nous en avons ainsi prononcé 104 le premier dimanche, en préparant en parallèle le projet de loi que vous avez adopté la semaine suivante. J’ai dans ma direction un « atelier de production » d’assignations à résidence, ce qui m’a d’ailleurs conduit à mettre en berne certaines de nos autres fonctions.
Vous êtes déjà entrés dans le détail des grandes mesures de l’état d’urgence. Je ne reviens donc pas sur la QPC du 22 décembre 2015, sinon pour dire qu’outre la constitutionnalité des assignations à résidence elles-mêmes, la décision tranche la question de la constitutionnalité de l’existence d’un état d’urgence. Appréciant l’équilibre entre prévention des atteintes à l’ordre public et respect des libertés protégées, elle estime que le critère de péril imminent ou de prévention d’une calamité est pertinent pour justifier des mesures réglementaires et individuelles plus fortes qu’en droit commun, à condition toutefois de respecter strictement les principes de nécessité et de proportionnalité.
Au nombre des apports juridiques de cette décision, on compte également la validité de la notion de « raisons sérieuses » permettant de penser que la personne représente une menace pour l’ordre public. Ce point avait fait débat, y compris devant votre commission. La notion est ancienne en droit public, pratiquée en matière d’interdiction de sortie du territoire ou pour justifier une exclusion de l’application de la convention de Genève, la protection apportée par cette dernière ne s’appliquant pas aux personnes dont on a des « raisons sérieuses » de penser qu’elles sont elles-mêmes persécutrices ou criminelles.
En outre, la décision de section du Conseil d’État du 11 décembre 2015 a confirmé un raisonnement tout à fait traditionnel en matière d’ordre public, même s’il a été abondamment débattu dans la presse, à savoir qu’il est possible, sur le fondement de la loi relative à l’état d’urgence, de prévenir tout trouble à l’ordre public, et non pas seulement les troubles qui l’ont justifiée. Autrement dit, on peut assigner à résidence toute personne qui menace l’ordre public, quand bien même elle n’aurait aucun lien avec le terrorisme.
Voici maintenant quelques précisions d’ordre quantitatif.
En ce qui concerne les assignations à résidence, nous avons été saisis par l’Unité de coordination de la lutte antiterroriste (UCLAT), chargée de coordonner les positions des services de renseignement, de 447 dossiers. Nous n’avons prononcé que 379 assignations, les autres dossiers ne nous paraissant pas fondés. Nous avons spontanément abrogé 23 assignations qui nous ont finalement paru insuffisamment étayées une fois que nous avons reçu les contestations des personnes concernées ; nous les avons abrogées soit de notre seule initiative, soit après que des contentieux ont été engagés. Si l’on soustrait du total les 27 assignations à résidence « COP21 », arrivées à échéance le 12 décembre, 323 personnes demeurent à ce jour assignées à résidence.
169 contentieux sont engagés, ce qui représente un taux de conflictualité assez élevé. Toutefois, sur ce total, on compte 101 référés ; sachant que les personnes concernées par des contentieux de fond ont, pour la plupart, formé un référé, il serait plus exact de considérer que le contentieux concerne une centaine de personnes. Le juge administratif a suspendu cinq arrêtés d’assignation, en a annulé un, et a prononcé une injonction de réaménagement dans quatre cas – je reviendrai sur cette question délicate. Parmi les points débattus figurent, d’une part l’usage des « notes blanches » devant le juge administratif et l’effet des assignations à résidence sur la vie professionnelle et familiale des intéressés, d’autre part : c’est le principal sujet contentieux du moment, à propos duquel la vigilance extrême du juge administratif nous oblige – mais c’est normal – à nous réajuster en permanence.
S’y ajoute enfin un contentieux des perquisitions qui débute, mais dont le juge des référés ne peut pas s’emparer puisque, dès lors que la perquisition a eu lieu, on ne saurait soutenir qu’il y a urgence ; en la matière, les tribunaux administratifs veulent juger vite, mais tout de même pas aussi vite qu’en référé. À ce jour, une vingtaine de recours indemnitaires ont été recensés par mes services.
S’agissant des perquisitions, s’il fallait faire un seul point de droit, ce serait pour souligner la grande confusion qui règne dans le débat médiatique. Les perquisitions soulèvent en effet deux questions juridiques distinctes. Premièrement, la légalité de la mesure elle-même : s’agissant d’une mesure de police administrative, préventive, la question est de savoir s’il existe des raisons sérieuses de penser que la personne représente une menace pour l’ordre public. Le débat sur la légalité de la mesure a donc lieu avant même que l’on n’approche de l’appartement. De sorte que la mesure peut être parfaitement légale ab initio, et que l’éventualité que l’on ne trouve rien ne prouve absolument pas son illégalité. Deuxièmement, l’exécution de la perquisition : une perquisition parfaitement légale peut avoir été exécutée dans des conditions de nature à engager la responsabilité de l’État.
Dans les cas qui ont été cités par la presse, et qu’évidemment nous regardons, il me semble que, s’il y a eu des fautes – l’État n’en a pas reconnu juridiquement à ce jour, mais il sera sans doute amené à le faire –, c’est au stade de l’exécution. Il me semble que les perquisitions étaient justifiées ; en tout cas, je n’ai pas vu au contentieux d’éléments qui me permettent de penser le contraire. Mais cela pourrait arriver.
Que faire le jour où l’état d’urgence s’arrêtera ? Du point de vue de la DLPAJ, il faudra : judiciariser le plus grand nombre possible d’affaires – le processus est en cours – ; prendre des mesures pérennes de police administrative – de nombreuses personnes concernées par les mesures de l’état d’urgence sont susceptibles de faire l’objet d’une interdiction de sortie du territoire français, voire de mesures d’expulsion – ; apporter enfin une réponse législative. Celle-ci se composera des trois volets annoncés : la loi constitutionnelle ; une loi pénale qui comporte des mesures traitant spécifiquement de la menace terroriste – actuellement devant le Conseil d’État, elle passera en Conseil des ministres début février ; se posera enfin la question de la modification de la loi du 3 avril 1955 une fois la réforme constitutionnelle adoptée.
Enfin, par rapport à l’ensemble des périodes d’état d’urgence – heureusement peu nombreuses – qu’a connues notre histoire, je suis frappé par le contrôle qu’exerce aujourd’hui le juge. En 1962, le Gouvernement a fait fermer des journaux OAS en métropole. Saisi d’un recours contre cette décision, le Conseil d’État a jugé que, fin 1962, l’état d’urgence n’existait déjà plus, en raison de la dissolution de l’Assemblée nationale survenue en octobre 1962 – c’est l’un des cas où l’état d’urgence prend fin automatiquement –, et a annulé les mesures de fermeture ; mais il l’a fait en 1969, c’est-à-dire sans aucun effet. La vraie différence réside ici : actuellement, le contrôle du juge est total. La QPC permet de remonter toute la chaîne et surtout, le juge des référés se prononce en quarante-huit heures. Un dernier exemple : j’ai été saisi dimanche dernier à quatorze heures par un tribunal administratif de trois requêtes qui ont été audiencées vingt-quatre heures après. Dans l’intervalle, nous avons fait notre travail de rédaction des mémoires, de saisine des services de renseignement pour obtenir des compléments, etc. En tout état de cause, l’univers juridique actuel est totalement différent de celui dans lequel on vivait à l’époque. Quand on débat de l’état d’urgence, quand on le critique, il faut tenir compte de ce contexte, dans lequel la lettre de la loi est strictement respectée.
M. le président Jean-Jacques Urvoas. Merci, monsieur le directeur. Nous avons beaucoup de questions à vous poser.
Commençons par le premier week-end. À compter du moment où le Président de la République prend le décret déclarant l’état d’urgence, la production du ministère de l’Intérieur, donc de votre service, est abondante : outre le texte du décret, les premières circulaires sont rapidement diffusées. Cela signifie-t-il que vous aviez anticipé l’état d’urgence, que vous aviez travaillé sur cette hypothèse avant qu’elle ne devienne réalité ?
M. Thomas Andrieu. Nous avions, de notre propre initiative, préparé un décret déclarant l’état d’urgence le 9 janvier 2015, au moment de l’attaque de l’Hyper Cacher, faisant alors le travail juridique nécessaire.
M. le président Jean-Jacques Urvoas. Vous avez dit que 104 assignations à résidence avaient été prononcées dès le premier dimanche. Comment le lien s’est-il alors noué avec les préfets et l’UCLAT ou l’état-major opérationnel de prévention du terrorisme (EMOPT) ? Sur quels fondements et à partir de quels renseignements ces premières assignations ont-elles été décidées ?
M. Thomas Andrieu. Ces assignations ont été décidées conformément aux modalités définies par le ministre lui-même, l’UCLAT étant l’unique interface de la DLPAJ avec les services de renseignement.
Ce mode de fonctionnement est tout à fait traditionnel au ministère de l’Intérieur. La DLPAJ est habituée à travailler avec l’UCLAT, notamment sur les mesures d’expulsion depuis trente ou quarante ans, et, depuis la loi du 13 novembre 2014, sur les interdictions de sortie du territoire, les interdictions d’entrée sur le territoire et les gels d’avoirs. Toutes ces mesures sont prises à la DLPAJ sur proposition des services de renseignement : traditionnellement, les services établissent une note blanche sur telle ou telle personne, après quoi nous leur demandons des précisions pour étayer la décision, satisfaire à un standard de preuve suffisamment élevé, etc.
Nous avons été saisis d’une centaine de notes pendant le week-end, dont les premières nous sont parvenues à minuit dans la nuit du samedi au dimanche.
M. le président Jean-Jacques Urvoas. Sur ces 104 assignations à résidence, vous souvenez-vous du nombre de dossiers dont l’UCLAT vous avait saisi ?
M. Thomas Andrieu. Je peux sans doute retrouver cette information. En tout cas, nous en avons rejeté car, je l’ai dit, tel est toujours le cas.
M. le président Jean-Jacques Urvoas. Mais l’on pourrait imaginer que, au cours du premier week-end, vous ayez eu moins de recul qu’au bout de deux ou trois semaines ?
M. Thomas Andrieu. Au cours du premier week-end, les notes étaient plus courtes, la pression extrême. Les faits expliqués n’en étaient pas moins graves, mais ils étaient moins étayés. Nous avons donc pris les mesures demandées, puis, au fil du temps, nous avons demandé des compléments et réexaminé les mesures sur le fondement des notes complémentaires rédigées par les services de renseignement, notamment lorsque des personnes se plaignaient et saisissaient le ministre ou un préfet ou lorsque des recours étaient formés. C’est ce qui nous a conduits à abroger 23 assignations.
M. le président Jean-Jacques Urvoas. Toujours au cours de ce premier week-end, c’est l’UCLAT qui vous fait des propositions : est-ce à dire qu’aucun questionnement, même minimal, ne s’adresse aux départements concernés ?
M. Thomas Andrieu. Normalement, selon le schéma qui a été adopté, ce sont les préfets qui ont l’initiative des propositions – cela leur a été dit dès le départ –, mais celles-ci leur remontent par les canaux des services : elles partent du service de renseignement local qui les adresse au préfet, puis elles remontent après avoir été validées par celui-ci.
M. le président Jean-Jacques Urvoas. Mais où remontent-elles ?
M. Thomas Andrieu. Elles remontent par la voie hiérarchique – soit la direction générale de la police nationale (DGPN), soit la direction générale de la gendarmerie nationale (DGGN), soit la direction générale de la sécurité intérieure (DGSI) –, après quoi il est indispensable que le nom de la personne soit mis au « pot commun » pour vérifier que tous les services sont d’accord pour l’assigner. D’où le rôle de l’UCLAT. Lorsqu’une personne est suivie par un service, elle ne l’est normalement plus par un autre, et un effort de coordination du travail des services de renseignement a été fait cette année ; il faut toutefois s’assurer que la personne n’est pas une source pour un autre service, que les services étrangers n’expriment pas d’opposition, etc. C’est alors une procédure de silence qui s’applique : pour qu’une mesure de police administrative soit validée, il faut que les autres services ne s’y opposent pas. C’est à ce stade que s’opère la coordination.
M. le président Jean-Jacques Urvoas. Si je comprends bien, même au cours du premier week-end, l’indication est donnée aux préfets de département de suggérer des assignations à résidence très rapidement ; le préfet de département s’informe auprès du service local du renseignement territorial et, s’il en a, de ses services de sécurité intérieure ; une réunion minimaliste est organisée au niveau du département, puis le préfet fait remonter au ministère, par son canal hiérarchique, des propositions d’assignation qui sont triées par l’UCLAT et qui vous parviennent ensuite.
M. Thomas Andrieu. Tel est bien le schéma qui a été arbitré. Il convient toutefois de préciser deux points. D’une part, au niveau local, certains dossiers étaient connus des préfets, avec leur état-major de sécurité, ce qui leur a permis d’aller très vite. D’autre part, il n’est pas exclu que certaines propositions soient venues des services centraux, auquel cas il est possible qu’elles ne soient pas passées par les préfets.
M. le président Jean-Jacques Urvoas. Les premières assignations que vous avez prononcées prévoyaient quatre pointages par jour dans les commissariats ou les brigades. Pour quelle raison ?
M. Thomas Andrieu. Le régime de l’assignation à résidence n’avait pas été mis en œuvre depuis 1962 en métropole. Or la loi du 3 avril 1955 dans sa rédaction antérieure au 20 novembre en fixait le principe sans en déterminer les modalités. Nous nous sommes donc inspirés du seul régime d’assignation à résidence administrative existant, celui des étrangers terroristes en voie d’éloignement, qui figure dans le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et prévoit quatre pointages.
M. le président Jean-Jacques Urvoas. Et ensuite la loi du 20 novembre a limité à trois pointages.
M. Thomas Andrieu. En effet.
M. le président Jean-Jacques Urvoas. Dans chacun de nos déplacements – nous en avons effectué neuf –, j’ai été surpris de constater que les modalités étaient les mêmes pour toutes les personnes assignées, au point de donner l’impression d’une sorte de « prêt-à-porter » juridique, sans prise en compte de paramètres personnels.
M. Thomas Andrieu. Pour être tout à fait clair, nous avons travaillé dans des conditions très particulières dans les dix premiers jours. De ce fait, les modalités étaient assez standardisées. C’est précisément cet aspect que le juge administratif nous a demandé de corriger sans délai. Nous avions d’ailleurs commencé à le faire spontanément lorsque des cas étaient parvenus jusqu’à nous. En effet, une mesure peut être parfaitement légale, parce que la personne visée représente une menace, sans que les modalités de pointage ou d’assignation dans tel ou tel lieu le soient, parce qu’elles porteraient une atteinte excessive à sa vie privée et familiale.
En ce moment, nous nous attachons moins à prendre de nouvelles mesures d’assignation qu’à ajuster les modalités de pointage, les lieux de pointage et, le cas échéant, le lieu de résidence nocturne de la personne pour mieux tenir compte de sa situation privée et familiale. Je vous renvoie aux décisions du Conseil d’État, notamment à une ordonnance du 6 janvier dernier qui donne les grandes lignes du travail effectué sur cette question. Depuis début janvier, c’est surtout ce travail qui, outre la gestion des contentieux, nous occupe.
M. le président Jean-Jacques Urvoas. Avez-vous des inquiétudes concernant l’appréciation par la Cour européenne des droits de l’homme de ce qui a été fait jusqu’à présent ?
M. Thomas Andrieu. Non.
La décision a été prise d’adresser à la Cour européenne des droits de l’homme une notification de dérogation à certains droits prévus à la Convention, au titre de son article 15. La Cour étudiera donc la question de savoir si le recours à cette disposition est justifié. Compte tenu des événements qui se sont produits, nous sommes assez sereins à cet égard. Il peut toujours y avoir une situation où les choses se sont mal passées ; j’espère que ce n’est pas le cas. Je ne vois en tout cas aucun problème de principe concernant une mesure en particulier.
M. le président Jean-Jacques Urvoas. Vous nous avez dit, comme tous les acteurs de l’état d’urgence, que vous ne pouviez vous appuyer sur aucune référence, sinon très ancienne et d’ampleur incomparable avec ce que nous vivons aujourd’hui. L’exercice du contentieux en référé sur les assignations n’était guère pratiqué. Pourquoi le ministère a-t-il systématiquement plaidé pour que le juge restreigne son contrôle à l’erreur manifeste d’appréciation ?
M. Thomas Andrieu. Nous avons défendu le maintien de la jurisprudence existante sur cette question, qui date de 1985. C’est une stratégie de défense traditionnelle. Puis le Conseil d’État a pris ses responsabilités, ce qui était tout à fait normal et sans surprise.
M. le président Jean-Jacques Urvoas. Indépendamment de la fonction que vous exercez, qu’avez-vous pensé du choix fait par certains tribunaux administratifs de rejeter des recours en procédant par ordonnance de tri ?
M. Thomas Andrieu. Nous n’avions rien demandé de tel aux tribunaux, ils ne nous en avaient même pas parlé : il s’agit de requêtes que nous n’avons pas vues et dont nous avons découvert qu’elles étaient rejetées par ordonnance de tri. On peut comprendre l’interprétation de la jurisprudence qui fonde ces décisions : traditionnellement, lorsque l’urgence est invoquée devant le juge administratif, il faut argumenter, montrer que la situation personnelle de la personne est en jeu – qu’elle doit se rendre à son travail, accompagner ses enfants à l’école, s’occuper de ses parents malades, etc. –, sans quoi, normalement, la requête est rejetée. Mais sur certains dossiers, les magistrats y sont allés très fort. Je le répète, nous n’étions même pas devant le juge : nous n’avons rien plaidé et n’avons pas très bien compris certaines décisions.
Le Conseil d’État, par sa décision du 11 décembre, a envoyé un message clair aux tribunaux administratifs – qui, désormais, se posent systématiquement la question de savoir si la mesure était justifiée compte tenu de son effet sur la situation personnelle de l’intéressé, et, sur ce point, nous demandent de répondre en vingt-quatre heures.
M. le président Jean-Jacques Urvoas. La DLPAJ a-t-elle accès d’une manière ou d’une autre au FSPRT (fichier de traitement des signalés pour la prévention et la radicalisation à caractère terroriste) ?
M. Thomas Andrieu. Non, et nous avons pris soin de ne rien demander de tel. La DLPAJ connaît seulement le FSPRT pour l’avoir porté devant la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) et devant le Conseil d’État.
M. le président Jean-Jacques Urvoas. Vous n’avez donc pas d’avis sur la manière dont les assignations ou les perquisitions ont été ciblées ?
M. Thomas Andrieu. Traditionnellement, ce n’est pas à la DLPAJ qu’il revient de décider de l’opportunité de l’emploi de tel ou tel outil à l’endroit d’une personne, mais à la DGSI, à la police et la gendarmerie nationales, de suivre quelqu’un en pur renseignement, sans attirer son attention, de judiciariser certaines affaires ou encore de prendre une mesure de police administrative. Dans ce dernier cas, la DLPAJ est saisie et si je ne conteste pas l’opportunité de la mesure, j’en étudie la légalité pour indiquer aux services si, de ce point de vue, elle peut « passer » ou s’il faut me donner plus d’éléments. Ce mode de fonctionnement n’est d’ailleurs pas propre à l’état d’urgence.
M. le président Jean-Jacques Urvoas. Vous arrivez à vous repérer entre l’UCLAT et l’EMOPT ?
M. Thomas Andrieu. Oui. (Sourires.) Dans le cadre de mes fonctions de production de décisions individuelles, c’est très clairement et sans conteste l’UCLAT qui assure l’interface avec les services de renseignement et qui nous transmet les notes blanches. Cela ne nous empêche pas de prendre part à des réunions de travail, en présence de l’UCLAT, avec les services concernés. Quant à l’EMOPT, le ministre organise une réunion quasi-hebdomadaire sur le sujet, à laquelle assistent toutes les personnes concernées.
M. le président Jean-Jacques Urvoas. C’était le cas avant le 13 novembre ?
M. Thomas Andrieu. Et la réunion a toujours lieu aujourd’hui.
M. le président Jean-Jacques Urvoas. Toujours avec le ministre ?
M. Thomas Andrieu. Oui. L’EMOPT a d’abord été chargé d’une mission, essentielle, de coordination. Il faut veiller à ce que toutes les personnes radicalisées figurent au FSPRT– c’est désormais le cas, je pense, mais il a fallu du temps en 2015, et le travail n’a été complété qu’après l’attaque de Saint–Quentin-Fallavier –, puis soient prises en charge par un service, de telle manière que personne ne sorte plus des radars. Cette mission, extrêmement lourde, l’EMOPT continue de l’exercer. Ensuite, il faut s’assurer que le fichier est nettoyé lorsqu’un signalement s’avère erroné. L’EMOPT y contribue, sur proposition des services. Enfin, l’EMOPT effectue un travail qualitatif à partir des informations qui remontent des services de renseignement, qu’il recoupe et dont il réalise des synthèses transversales – par exemple s’agissant des professions sensibles ou de l’accès aux lieux sensibles.
M. le président Jean-Jacques Urvoas. Les documents que vous transmet l’UCLAT pour appuyer, par exemple, une demande d’assignation à résidence peuvent-ils contenir la moindre référence au fait que l’individu est fiché au FSPRT ?
M. Thomas Andrieu. Surtout pas ! Les mesures administratives doivent n’être fondées que sur des éléments qui puissent ensuite être produits devant un juge. Il ne faut donc pas faire état d’informations confidentielles, relevant des techniques de renseignement, ou révélant quoi que ce soit du fonctionnement interne de ces services et du ministère de l’Intérieur en général. Pour la production des mesures individuelles, nous n’avons pas à savoir ce genre de choses.
Mme Sandrine Mazetier. Vous aviez, dites-vous, anticipé l’état d’urgence dès le 10 janvier 2015. Aviez-vous aussi anticipé la COP21 ? Comment ont été rédigées les assignations à résidence liées à cet événement ?
Nous sommes par ailleurs très étonnés de ne pouvoir obtenir d’informations sur le nombre d’interdictions de manifester. Ces mesures-là vous sont-elles soumises ? Si elles ne le sont pas, qu’est-ce qui le justifie ? Si elles le sont, vous seriez aimable de nous transmettre les éléments demandés.
M. Thomas Andrieu. En ce qui concerne les assignations à résidence « COP21 », voici comment elles sont parvenues à ma direction.
À supposer que la question du maintien de la conférence ait été posée, elle a été tranchée dans la nuit du 13 au 14 novembre. Il s’agissait de décider si l’on faisait venir 160 chefs d’État sur le sol français dans la situation que traversait le pays. Une réponse politique très ferme et très claire a été apportée cette nuit-là : le Président de la République a déclaré que la COP21 était maintenue et serait un succès. C’était un cap. Mais la COP21 est alors devenue, dans les heures qui ont suivi les attentats, la préoccupation numéro un. Je me place ici du point de vue de l’ordre public, abstraction faite du volet judiciaire. La préfecture de police et les services de renseignement étaient très inquiets.
À cet égard, les deux questions que vous me posez sont liées.
Nous avons prononcé une interdiction de manifester dans toute l’Île-de-France les deux premières semaines en appliquant un raisonnement juridique classique en police administrative : les deux conditions de l’interdiction, à savoir le risque de trouble à l’ordre public et le fait de ne pas avoir les moyens policiers de gérer ce trouble, étaient réunies. En l’occurrence, on savait que les forces de l’ordre allaient se consacrer exclusivement au terrorisme au cours des semaines suivantes, ce qui empêchait de gérer des manifestations qui n’auraient soulevé aucune difficulté en temps normal. C’est cette logique qui a conduit à une situation assez exceptionnelle en France : l’interdiction de manifester sur tout le territoire métropolitain les 28, 29 et 30 novembre 2015, au moment où les chefs d’État arrivaient sur le sol français et où ils y étaient le plus nombreux.
S’agissant des assignations, le raisonnement est le même. Il s’agissait d’individus connus, dont la violence, quel que soit leur engagement politique par ailleurs, était attestée – je me permets de le dire, car la presse parle toujours de « militants écologistes » ; mais des militants écologistes, il y en a 4 000 qui ont pu défiler dans les rues de Paris le dimanche précédant la COP, et tout s’est très bien passé !
Nous avons été saisis, essentiellement par le service central du renseignement territorial (SCRT), de demandes d’interdiction d’entrée sur le territoire pour des étrangers vivant hors de France et d’assignations à résidence. On m’a ainsi demandé de produire une centaine d’assignations à résidence de personnes susceptibles d’être violentes dans le cadre de la COP21. Nous avons écarté tous les dossiers qui ne satisfaisaient pas aux critères requis. Nous en avons conservé un quart, ce qui représente un taux de chute beaucoup plus élevé que pour les assignations à résidence « terrorisme », et nous avons donc assigné à résidence 27 personnes.
Tout cela s’est effectivement fait dans les jours qui ont suivi les attentats et précédé la COP21. Avant les attentats, il était de toute façon juridiquement impossible d’assigner qui que ce soit à résidence et, en temps normal, ces situations, ces risques et ces personnes auraient été gérés en recourant aux méthodes habituelles de maintien de l’ordre public. Vous aurez noté que les assignations ne duraient que jusqu’au 12 décembre inclus, c’est-à-dire jusqu’au lendemain de la COP21, jour de la dernière manifestation prévue.
Certains cas qui ont fait l’objet de nombreux recours devant les tribunaux administratifs ont donné lieu à des ordonnances de tri à Rennes, et nous savions que le Conseil d’État allait probablement les annuler et se prononcer au fond. Quelques requêtes avaient aussi été déposées devant le tribunal administratif de Paris, dont celle qui a donné lieu à la décision de section du Conseil d’État, le 11 décembre : le Conseil d’État s’est dépêché de statuer pour que sa décision ait un effet juridique, puisque les assignations arrivaient à échéance le 12. C’est à cette occasion que le Conseil d’État a jugé possible d’assigner pour un motif différent de celui qui avait conduit à déclencher l’état d’urgence, mais que la mesure devait évidemment être strictement proportionnée et la menace de trouble à l’ordre public établie.
Les interdictions de manifester ne sont pas systématiquement soumises à la DLPAJ, la loi du 3 avril 1955 confiant au ministre le soin de prononcer les assignations à résidence, les autres mesures incombant au préfet – moyennant quelques nuances concernant notamment les réquisitions d’armes. Le préfet est donc chargé de prononcer les interdictions de manifester avec ou sans état d’urgence ; il le fait quotidiennement, c’est son métier. Dès lors, certains préfets ont interdit des manifestations de leur propre initiative, sans nous solliciter. Nous n’avons été consultés que pour les interdictions les plus sensibles, notamment celles qui concernaient l’Île-de-France sur lesquelles nous avons alors fait notre travail de conseil et de proposition.
Ces mesures n’ont pas suscité un contentieux important : de mémoire, il y a eu quatre décisions de tribunaux administratifs, qui ont validé les interdictions, notamment en Île-de-France et, dans un cas, à Nancy.
M. le président Jean-Jacques Urvoas. Je reviens à la COP21, qui est un objet en lui-même parmi les assignations à résidence. La décision du Conseil d’État du 11 décembre 2015 valide une interprétation qu’à titre personnel je juge extensive ; quoi qu’il en soit, ainsi en a décidé le Conseil d’État. Mais pourquoi 27 personnes seulement ont-elles été assignées ? Est-ce à dire que la possibilité d’émeutes ne dépendait que de 27 personnes ?
M. Thomas Andrieu. Il faudrait poser la question aux services de renseignement.
M. le président Jean-Jacques Urvoas. Combien vous ont-ils proposé d’assignations liées à la COP21 ?
M. Thomas Andrieu. Une centaine. Nous avons alors fait notre travail en vérifiant que les faits étaient suffisamment étayés et suffisamment graves pour survivre à un éventuel contentieux.
M. le président Jean-Jacques Urvoas. Vous avez donc signé 27 assignations à résidence. Combien en avez-vous notifié ?
M. Thomas Andrieu. À ma connaissance, nous avons notifié les 27.
M. le président Jean-Jacques Urvoas. Vous en avez notifié 10.
M. Thomas Andrieu. Non.
M. le président Jean-Jacques Urvoas. Si. La majorité des personnes assignées vivaient dans des squats dont les adresses n’étaient pas connues. Bref, vous avez signifié l’assignation à 10 des 27 fauteurs de trouble qui auraient menacé Paris d’émeutes : si la COP21 s’est bien passée, c’est parce que 10 émeutiers ont été assignés.
M. Thomas Andrieu. Je vérifierai, monsieur le président. Car nous avons pour chaque assignation le procès-verbal de notification de la mesure.
M. le président Jean-Jacques Urvoas. En ce qui concerne les assignations « COP21 », je pense avoir le bon chiffre. Mais, plus généralement, le contrôleur général Loïc Garnier nous a indiqué que 30 % des assignations à résidence n’étaient pas notifiées.
M. Thomas Andrieu. Ce taux me paraît élevé. Évidemment, cela peut arriver, puisqu’il s’agit précisément de personnes dont on ne sait pas tout. Je vais me rapprocher de Loïc Garnier à ce sujet.
M. le président Jean-Jacques Urvoas. Si je vous pose la question, c’est parce que ce taux nous a étonnés, nous aussi. De deux choses l’une : soit les services de renseignement sont mal renseignés, soit leur paupérisation est telle qu’ils n’ont plus les moyens d’aller jusqu’au domicile des individus visés. Mais 30 %, c’est énorme.
M. Thomas Andrieu. Je vais regarder. Je peux difficilement vous dire autre chose à ce stade (18).
Mme Sandrine Mazetier. Vous n’avez pas vraiment répondu à ma première question. Vous aviez préparé dès le 10 janvier 2015 le décret déclarant l’état d’urgence. Or la COP21 n’était une surprise pour personne. Les cibles des assignations « COP21 » étaient-elles prêtes bien avant le décret déclarant l’état d’urgence ? Ou avez-vous dû improviser les assignations de ces zadistes dans la nuit du samedi 14 au dimanche 15 novembre ?
M. Thomas Andrieu. Je me suis mal exprimé. Le 9 janvier 2015, je me suis penché sur le régime juridique de l’état d’urgence, au cas où. Ce travail préparatoire, qui se retrouve dans la loi du 20 novembre, a permis de s’interroger sur l’assignation, la perquisition, la constitutionnalité de ces dispositions, etc. Quant à la COP21, j’ai été saisi, effectivement dans les jours qui ont suivi les attentats, de l’idée qu’il fallait assigner à résidence certaines personnes susceptibles de commettre lors de cet événement des troubles que les services estimaient graves. Je suis évidemment certain qu’il s’agit de personnes que les services – le renseignement territorial plus que la DGSI, sans doute – suivent depuis longtemps. Mais l’usage de l’état d’urgence à partir du 13 novembre nous a fait entrer dans un univers totalement nouveau : nous avons découvert ensemble, inventé ensemble. J’espère que nous ne nous sommes pas trompés.
M. le président Jean-Jacques Urvoas. Combien reste-t-il d’assignations à résidence en cours?
M. Thomas Andrieu. Les 27 assignations « COP21 » sont arrivées à échéance. J’ai abrogé 23 arrêtés ; il y a eu 5 suspensions, et une annulation par le Conseil d’État. Il y a donc, sauf erreur, 323 personnes qui pointent aujourd’hui.
M. le président Jean-Jacques Urvoas. Le Conseil d’État a relevé qu’une part notable des assignations avait été abrogée avant que lui-même ne statue. Pourquoi avez-vous proposé ces abrogations ? Je pense notamment à un cas qui a été porté à notre connaissance lors d’un de nos déplacements.
M. Thomas Andrieu. Nous avons abrogé les assignations lorsque nous nous sommes aperçus que nous nous étions trompés.
D’abord, après le vote de la loi du 20 novembre, nous avons repris tous les dossiers – il n’y a normalement aujourd’hui plus aucune assignation à résidence dont la date soit antérieure au 21 novembre – pour les mettre en conformité avec la loi, eu égard au nombre de pointages mais aussi au critère de fond. À cette occasion, nous avons pu trouver des erreurs.
Ensuite, même si, devant le juge, on se bat, il faut parfois reconnaître que l’on s’est trompé. J’assume totalement la politique qui consiste, dans ce cas, à retirer la mesure aussitôt, sans attendre de se faire taper sur les doigts. On se bat quand on pense que l’on a raison et que la décision ira dans notre sens. Il nous arrive donc d’abroger une décision alors même que le contentieux est pendant devant le Conseil d’État. Mais je pense – ce serait au Conseil d’État de le dire – que cela donne davantage de crédibilité aux mesures que nous continuons à défendre.
L’abrogation peut être justifiée par le fait que, même si la personne n’est vraiment pas recommandable, tient des propos inadmissibles ou fraude massivement, on ne peut pas, pour autant, établir qu’elle est liée au terrorisme, et donc qu’elle représente une menace grave pour l’ordre public. Dans un tel cas, la mesure a été retirée.
M. le président Jean-Jacques Urvoas. Quels sont les éléments que vous avez découverts et qui vous ont conduit à prendre cette décision ? Est-ce tel ou tel service, est-ce le préfet qui vous a conseillé de retirer la mesure ?
M. Thomas Andrieu. Ce sont rarement les services qui nous demandent de retirer une assignation. Quant aux préfets, forts de leur vision globale du terrain, ils sont plutôt enclins à faire usage de leurs pouvoirs de police administrative lorsqu’une personne pose d’importants problèmes. Dans le dossier que vous évoquez, c’est moi qui ai estimé qu’il allait falloir « débrancher ». La préfecture était plutôt disposée à continuer.
Je ne sais plus si nous l’avons fait dans ce cas, mais, s’agissant de certains dossiers médiatisés, nous signalons le retrait de la mesure au cabinet, sachant que la question va lui être posée.
M. le président Jean-Jacques Urvoas. C’est vous qui avez décidé d’abroger l’assignation ?
M. Thomas Andrieu. Oui, c’est moi qui dit dans ces cas au cabinet que, sauf observation contraire de sa part, j’abrogerais la mesure dans les vingt-quatre heures parce qu’elle ne « passerait pas la barre ».
M. le président Jean-Jacques Urvoas. Avez-vous assigné des mineurs ?
M. Thomas Andrieu. Il ne faut pas l’exclure – la loi ne l’interdit pas –, et nous l’avons fait. Mais je n’ai pas leur nombre en tête. Nous assignons des gens extrêmement dangereux, dont certains sont mineurs. Ce qui s’est passé récemment à Marseille nous rappelle que l’on peut, à quinze ans, commettre un acte qui va être qualifié de terroriste. J’ai souvenir que nous avons dû procéder à des ajustements, afin de concilier la fréquentation du lycée avec l’assignation.
M. le président Jean-Jacques Urvoas. Quoi qu’il en soit, il n’existe pas de régime particulier pour les mineurs.
M. Thomas Andrieu. La loi n’en prévoit pas. Mais nous notifions évidemment l’assignation aux parents. En outre, s’agissant d’un mineur, l’effet de la mesure sur sa vie privée et familiale, voire professionnelle dans certains cas, fait naturellement l’objet d’une attention toute particulière.
M. le président Jean-Jacques Urvoas. Avez-vous assigné des personnes qui étaient soumises à un contrôle judiciaire ?
M. Thomas Andrieu. Je n’exclus pas que nous l’ayons fait. Nous avons rédigé une circulaire croisée – associant la Chancellerie et l’Intérieur – sur l’interaction entre mesures administratives et mesures judiciaires.
M. le président Jean-Jacques Urvoas. Quelle plus-value une mesure administrative apporte-t-elle lorsqu’une mesure judiciaire est déjà applicable ?
M. Thomas Andrieu. L’objectif n’est pas le même et, surtout, les modalités peuvent être différentes : elles sont beaucoup plus strictes dans le cas de l’assignation à résidence administrative. En outre, l’autorité judiciaire n’a pas nécessairement toutes les informations dont disposent les services de renseignement. Elle est d’ailleurs très intéressée par nos arrêtés, que nous transmettons systématiquement à la direction des affaires criminelles, de même que les décisions des juges administratifs.
M. le président Jean-Jacques Urvoas. Auriez-vous pu assigner des détenus ?
M. Thomas Andrieu. Rien de tel n’est remonté jusqu’à moi. Juridiquement, cela ne me paraît pas possible : on peut soutenir que la personne représente une menace pour l’ordre public, mais, puisqu’elle est enfermée, il n’y a pas lieu de l’assigner. Ce serait par ailleurs impraticable.
M. le président Jean-Jacques Urvoas. Lors de notre visite à la préfecture de police de Paris, j’ai été surpris d’apprendre que des personnes assignées à résidence en province avaient fait l’objet à la fois d’une assignation à résidence et d’une interdiction de se rendre en Île-de-France. Quelle est la cohérence de cette accumulation de mesures administratives ?
M. Thomas Andrieu. Les assignations sont prononcées par le ministre et les autres mesures sont prononcées par le préfet. Effectivement, dans le cas que vous citez, il était juridiquement inutile d’associer les deux.
Mme Cécile Untermaier. À propos des assignations à résidence, Jean-Jacques Urvoas a parlé d’un « prêt-à-porter juridique ». De fait, les horaires de pointage sont parfois inadaptés ; en milieu rural, notamment, les gendarmeries peuvent être fermées le week-end. De plus, le lieu de pointage tend à devenir le lieu de rendez-vous des assignés, ravis de s’y retrouver ! Enfin, vous l’avez dit, le risque existe d’une atteinte à la vie privée et familiale, qui peut être sanctionnée par le juge. Dans ce contexte, que préconisez-vous pour améliorer le dispositif, du point de vue de la méthode comme du fond ?
J’aimerais ensuite vous interroger sur les difficultés que pose le suivi des assignations à résidence par les services de police ou de gendarmerie en région. Ces services vous ont-ils fait part de leurs interrogations, voire de leur exaspération ou de leur fatigue ? Ce n’est qu’une question, mais on peut imaginer que la mise en œuvre de ces mesures pose des problèmes de moyens.
Je terminerai par l’essoufflement des mesures prévues par l’état d’urgence. À quelle date, selon vous, ont-elles perdu de leur intérêt ?
M. Thomas Andrieu. S’agissant des pointages, le cadre de notre réflexion est fourni par la jurisprudence du Conseil d’État, qui rappelle très clairement la nécessité de concilier maintien de l’ordre public et respect de la vie professionnelle et familiale des intéressés. Ce qui ne signifie pas qu’il faille se régler entièrement sur celle-ci. Ainsi, il est hors de question d’autoriser une personne particulièrement dangereuse à se rendre à Paris alors même qu’elle y travaille, dès lors qu’elle peut y rencontrer certaines personnes. Dans un cas de ce type, le tribunal administratif a validé la mesure. Bref, le juge pondère les différents intérêts en cause.
Aujourd’hui, je l’ai dit, notre travail consiste essentiellement, non à produire de nouvelles assignations, mais à ajuster, en fonction des demandes des personnes et des contentieux, les modalités de pointage, qui peuvent effectivement être très astreignantes.
Le juge a sanctionné les modalités de pointage appliquées à une mère de famille, qui devait se présenter à dix kilomètres de son domicile au motif que la gendarmerie était fermée le week-end. Nous avons modifié le lieu de pointage en semaine au profit d’un poste plus proche. Pour le week-end, il nous a été demandé d’ouvrir le poste ; désormais, une patrouille vient devant le commissariat au moment du pointage.
Nous sommes extrêmement vigilants sur ces points.
Le suivi des assignations à résidence n’est normalement pas difficile : c’est la personne qui se déplace, pour venir pointer dans un commissariat ou dans une brigade. Il s’agit donc, si je puis m’exprimer ainsi, d’une tâche très reposante pour les services de renseignement. Si le commissariat ou la brigade fait son travail, le premier défaut de pointage est signalé au service et transmis au parquet : l’article 40 du code de procédure pénale s’applique et une procédure judiciaire est engagée. Mais, en ce moment, les services subissent une tension et une charge de travail phénoménales. Ce serait à eux plus qu’à moi de vous le dire.
Quant à l’effet des mesures, il est très clair – vous l’avez déjà constaté, à en croire votre rapport d’étape publié la semaine dernière – que l’efficacité marginale des perquisitions est désormais faible. Ne sont utiles que des perquisitions extrêmement ciblées et fondées sur des renseignements « frais ». Voilà pourquoi le nombre de perquisitions est tombé en deçà d’une dizaine chaque nuit.
Le cas des assignations est plus délicat. Certes, l’effet de surprise a disparu. Mais nous avons affaire à des personnes dont la dangerosité est attestée, souvent devant le juge, et qu’il n’est pas sans intérêt d’immobiliser. Toutefois, cette mesure n’est que temporaire. L’idéal serait de pouvoir judiciariser les dossiers – mais nous n’avons pas toujours assez d’éléments – ou, à défaut, d’envisager des mesures de police administrative pérennes, ce que nous sommes en train de faire. Sur les quelque 300 personnes concernées, il y en a une centaine qui, à un moment ou à un autre, ont dit vouloir partir pour la Syrie ; la possibilité de prononcer à leur endroit une interdiction de sortie du territoire est donc actuellement à l’étude.
M. Jean-Frédéric Poisson, président. Comment les modalités des assignations à résidence ont-elles été choisies ?
Avez-vous utilisé le bracelet électronique ? Et, si vous ne l’avez pas fait, pour quelles raisons ?
Enfin, le terme d’« activité » dangereuse, figurant dans la loi de 1955, a été remplacé par celui de « comportement » dangereux, ce qui a suscité un long débat entre nous – en Commission davantage que dans l’hémicycle, d’ailleurs. Cette évolution sémantique a-t-elle influencé votre appréciation des situations ? Surtout, a-t-elle entraîné des difficultés juridiques ?
M. Thomas Andrieu. En ce qui concerne le choix des modalités, il convient de distinguer deux périodes. Au cours des premières heures et des premiers jours, comme la loi dans son ancienne rédaction était muette sur ce point, nous nous sommes inspirés, je l’ai dit, du régime applicable aux terroristes en voie d’éloignement, prévu dans le CESEDA. Sur ce fondement, nous avons prévu quasi systématiquement quatre pointages ainsi qu’une astreinte à domicile la nuit, laquelle ne figurait pas dans la lettre du texte avant la réforme du 20 novembre.
Après le 20 novembre, nous nous sommes réglés sur la lettre de la loi, notamment en réduisant le nombre de pointages. Puis, à mesure que nous recevions des demandes de rectification des services ou des plaintes des intéressés, nous avons ajusté les modalités pour tenir compte de la vie privée et familiale des assignés. C’est en ce moment, je le répète, l’essentiel du travail de la cellule dédiée à l’assignation à résidence au sein de ma direction. Et c’est un travail permanent, car les situations individuelles évoluent.
M. Jean-Frédéric Poisson, président. Vous avez cité l’exemple d’une personne assignée loin de son travail. Comment cela se passe-t-il avec son employeur ?
M. Thomas Andrieu. Pour l’instant, pour autant que je le sache, son contrat est suspendu. La personne n’a pas été licenciée.
Dans la plupart des cas, lorsque l’assigné à résidence travaille, nous parvenons à concilier l’assignation et les nécessités professionnelles. J’ai cité cet exemple, très rare, pour montrer que la seule circonstance qu’une personne travaille dans telle commune ne justifie pas que l’on revienne sur les modalités de l’assignation, si cette personne est très dangereuse et que tous ses « copains » se trouvent dans cette commune.
Le bracelet électronique n’a pas été utilisé à ce stade, car nous ne disposons pas des outils techniques nécessaires. Nous allons donc devoir nous mettre en ordre de bataille pour y parvenir rapidement. La mesure a ceci de vertueux qu’elle requiert l’accord de l’intéressé ; or certains assignés pourraient préférer se signaler plutôt que devoir limiter leurs déplacements. En ce sens, il faut y voir une souplesse offerte aux personnes concernées.
J’en viens au passage du terme d’« activité » à celui de « comportement ». Je me souviens en effet qu’il avait suscité ici des interrogations. La notion de comportement a inquiété, à mon avis à tort. Elle existe déjà dans notre droit en matière de police administrative, précisément s’agissant des étrangers que l’on expulse pour des motifs liés au terrorisme : l’article L. 521-3 du CESEDA parle de « comportements […] liés à des activités à caractère terroriste ». Elle est donc maniée tous les jours devant le juge administratif, notamment devant le tribunal administratif de Paris, qui juge de ces mesures, et devant le Conseil d’État.
J’y insiste, toutes les mesures de police administrative sont prises sur le fondement d’éléments qui sont soumis au contradictoire : on discute de faits voués à être connus de la personne à qui on les oppose. Par exemple : « Vous fréquentez Untel ». Le juge nous objecte que le mot « fréquenter » n’est pas très précis. « Vous l’avez vu huit fois au cours du mois qui vient de s’écouler, vous échangez avec lui sur Facebook, vous échangez des photos de décapitations sur Facebook » – voilà qui devient plus précis. Tel est le type de dialogue qui s’engage devant le juge.
M. Jean-Frédéric Poisson, président. J’en viens aux perquisitions.
Avez-vous établi une typologie des lieux perquisitionnés ? Selon vous, du point de vue administratif, est-ce une personne ou un endroit que l’on perquisitionne ? La réponse à cette question n’est évidemment pas sans conséquences.
Aux termes de la loi, les procureurs sont informés « sans délai » de la décision de perquisition. Cela signifie-t-il qu’ils doivent être informés avant la perquisition, ou qu’il suffit de les informer pendant, ou encore juste après ? La validité de la perquisition en est-elle affectée ?
À l’aéroport d’Orly, dans le Val-de-Marne, des vérifications ont eu lieu dans les vestiaires des employés de plusieurs sous-traitants d’Aéroports de Paris. C’était peu après la mise en œuvre de l’état d’urgence, puisque notre déplacement à Orly était le premier. Des modalités spécifiques ont-elles été mises en œuvre pour fonder juridiquement ces perquisitions dans des vestiaires, qui sont des endroits à part sur le lieu de travail ?
Nous parlions tout à l’heure des vérifications d’adresse à propos des assignations à résidence : dans certains cas, l’adresse était erronée ou impossible à trouver. La vérification de l’identité des personnes perquisitionnées pose-t-elle des problèmes, et, si oui, faut-il y remédier par une modification législative ?
Enfin, les services concernés nous ont expliqué à plusieurs reprises que la copie des systèmes informatiques pendant une perquisition présente deux inconvénients : d’une part, elle ne permet pas de retrouver la trace de toutes les informations pouvant être obtenues sur les supports eux-mêmes ; d’autre part, elle demande beaucoup de temps alors qu’il peut être problématique de faire durer l’intervention des forces de l’ordre, surtout dans les quartiers « compliqués ». Dès lors, peut-on légaliser la saisie des équipements ?
M. Thomas Andrieu. Je ne dispose pas d’une typologie des lieux perquisitionnés, dont je n’ai pas de recensement exhaustif – je rappelle que les perquisitions sont prononcées par les préfets. Sans doute l’UCLAT pourrait-elle établir une telle classification.
Perquisitionne-t-on un lieu ou une personne ? Sans nul doute possible, un lieu – le premier alinéa de l’article 11 de la loi de 1955 est très clair sur ce point, qui a été étudié avec la plus grande attention par le Conseil d’État –, mais un lieu dont on a des raisons sérieuses de penser qu’il est fréquenté par une personne qui représente une menace : le lieu lui-même ne saurait être une menace. La notion de fréquentation implique la régularité : il ne peut s’agir d’un endroit où la personne a pris un café une fois dans sa vie.
Par ailleurs, on perquisitionne en informant le procureur. Aux termes de la loi, le procureur est informé sans délai de la décision du préfet de perquisitionner. Or la décision est un arrêté de police administrative. Le procureur doit donc être informé dès la signature de l’arrêté, c’est-à-dire avant même que la police ne soit au pied de l’immeuble. En outre, il sera évidemment informé à la seconde de l’ouverture éventuelle d’une procédure judiciaire, permise par la présence de l’officier de police judiciaire (OPJ) ; mais, puisqu’il s’agit d’une procédure judiciaire, la loi de 1955 n’en dit rien. Enfin, la perquisition donne lieu à l’établissement d’un compte rendu communiqué sans délai au procureur de la République.
Ces modalités, nous les avons rédigées pour l’essentiel dans la nuit du 13 au 14 novembre, le directeur des affaires criminelles et moi-même. Nous les avons incluses dans la circulaire aux préfets qui a été envoyée cette nuit-là et dont la lettre de la loi ne diffère pas. Normalement, donc, le procureur est parfaitement informé. Les préfets nous disent que leur collaboration avec les procureurs est excellente, qu’elle n’a jamais été aussi satisfaisante qu’en ce moment. Chacun a ses outils spécifiques, mais la vision du risque est partagée.
La vérification de vestiaires ne fait pas l’objet d’un dispositif législatif spécifique. C’est la lettre de la loi qui a été appliquée : « lieu fréquenté par une personne dont le comportement constitue une menace pour la sécurité et l’ordre publics ». Faut-il créer une protection spéciale pour ce type de lieux ? Je n’en suis pas certain. La loi protège les lieux affectés à l’exercice de certaines fonctions ou mandats – de magistrat, de parlementaire, d’avocat, notamment. Je doute qu’il faille aller plus loin.
En ce qui concerne les vérifications d’identité et l’analyse des systèmes informatiques pendant une perquisition, faut-il modifier la loi de 1955 pour disposer d’outils plus performants ? Les services répondraient probablement par l’affirmative. Aujourd’hui, en droit, une personne présente dans le lieu perquisitionné peut sans doute prendre son manteau et quitter la pièce. La loi n’en dit rien et si aucune mesure privative de liberté ne s’applique, rien ne s’y oppose – ou alors il faudrait que la loi le dise. Je ne vois pas ce qui empêche de le faire, à moins que la volonté de partir brutalement ne paraisse révéler une infraction ou quelque chose de suspect, et justifie dès lors une garde à vue.
M. Jean-Frédéric Poisson, président. Immédiate, dans ce cas ?
M. Thomas Andrieu. Oui.
Faut-il prévoir lors d’une perquisition une forme de retenue, avant même la vérification d’identité ? Nous nous posons la question dans le cadre d’une éventuelle modification de la loi de 1955 en application de la réforme constitutionnelle sur l’état d’urgence. L’idée de retenir les personnes le temps de la perquisition, peut-être au maximum quatre heures – une durée traditionnelle en matière de retenue des personnes –, doit être étudiée ; elle permettrait de s’assurer de leur présence dans un cadre juridiquement sécurisé. C’est dans ce contexte que se pose la question de la vérification de leur identité. Spontanément, je répondrais donc plutôt par l’affirmative, mais il n’y a pas eu d’arbitrage sur ce point.
Si on devait le faire, la référence à la vérification d’identité me paraît la bonne, car cette procédure s’accompagne de garanties : le parquet est automatiquement informé dans le cas d’un mineur ; s’agissant d’un majeur, il est prévenu de la possibilité d’aviser le parquet ou sa famille ; un compte rendu est transmis au parquet, etc. Il faudrait reproduire ou transposer cet ensemble de garanties.
J’en viens aux saisies. Le mécanisme de copie fonctionne déjà, et il apporte beaucoup. Dans le débat sur l’efficacité des perquisitions, ce qui est spontanément explicable, c’est le volet judiciaire : on obtient des résultats que l’on peut quantifier – le nombre d’armes que l’on a trouvées, de procédures judiciaires que l’on a ouvertes, etc. Mais il s’y ajoute tout un volet ayant trait au renseignement, moins facile à expliquer, et pourtant extraordinaire, qui porte ses fruits et continuera de le faire pendant de longs mois, de longues années. Ce que l’on voit en renseignement au cours de ces perquisitions est très difficilement mesurable, mais très riche. Les services en sont très heureux. Dans ce contexte, la copie du système informatique est absolument essentielle.
Toutefois, il arrive en effet que l’on ne parvienne pas à « cracker » le système ; il faudrait alors pouvoir emporter l’appareil. Pourquoi ne pas créer un système de saisie ? Le Conseil d’État nous y avait d’ailleurs invités dans son avis – rendu public – sur le projet de loi voté le 20 novembre, et l’exposé des motifs du projet de loi constitutionnelle évoque cette possibilité au nombre des pistes de réforme de la loi de 1955. Avis favorable, donc – à condition de pouvoir résoudre cette difficulté : comment concevoir un système de saisie qui préserve l’intégrité des données et prémunisse contre tout « bidouillage » ? Tel est l’enjeu juridique, voire politique de la mesure : parvenir à une traçabilité comparable à celle des saisies judiciaires. C’est cet aspect qu’il faudrait creuser si l’on s’engage dans cette voie.
M. Jean-Frédéric Poisson, président. La transition entre certaines procédures déclenchées sous régime administratif et leur éventuelle poursuite sous régime judiciaire va poser un problème lors de l’arrêt de l’état d’urgence, qui est en question. Je l’ai dit la semaine dernière à la Garde des sceaux dans l’hémicycle, lors du débat sur l’état d’urgence. Comment envisagez-vous cette transition ? Que va-t-il se passer à la date de péremption, si j’ose dire ? Le 27 février au matin, qu’advient-il des décisions qui ont été prises jusqu’au 26 dans le cadre de l’état d’urgence ? De plein droit, elles deviennent en principe sans effet ; mais comment sécuriser leur prolongement en droit commun ?
M. Thomas Andrieu. Vous l’avez dit : l’idéal est la judiciarisation. Si l’on a suffisamment d’éléments, il faut passer le relais à la justice et la laisser faire son travail. Cela reste le premier objectif des services.
Que faire lorsque ce n’est pas possible ? Il existe tout un système de suivi en renseignement, notamment sur le fondement des nouvelles techniques de renseignement, qui doit être mis en œuvre. Mais il ne relève pas de ma direction. Par ailleurs, il existe des mesures de police administrative pérennes, indépendantes de l’état d’urgence, qui doivent elles aussi être appliquées. Nous nous employons déjà, en lien avec les services de renseignement, à repasser au crible la liste des assignés afin de voir qui pourrait faire l’objet d’une procédure d’expulsion, pour les étrangers, d’une interdiction de sortie du territoire, pour ceux qui ont manifesté la volonté de partir en Syrie – ils sont plusieurs dizaines –, ou encore d’une procédure de gel d’avoirs, commune avec Bercy et qui permet de bloquer les comptes bancaires.
M. Jean-Frédéric Poisson, président. La direction des affaires criminelles et des grâces (DACG) a publié au tout début de l’état d’urgence une note invitant à faire débuter les gardes à vue au moment où l’on constate une infraction au cours d’une perquisition, et non à partir du début de la perquisition. Quelle formule vous paraît la plus adaptée à cette situation ?
M. Thomas Andrieu. Il me semble qu’il faut aller au bout de la logique de la police administrative. Tant que l’on n’a pas constaté d’infraction, le cadre est celui d’une procédure strictement administrative : il n’y a pas de garde à vue, le procureur a simplement été informé en début de perquisition. Si l’on constate une infraction, notamment si l’on découvre une arme, l’OPJ procède à une saisie et ouvre une procédure judiciaire de son fait. Mais la perquisition administrative se poursuit en parallèle. La Chancellerie et nous sommes parfaitement d’accord sur cette interprétation. Chacun joue son rôle de manière indépendante.
M. Jean-Frédéric Poisson, président. Vous répondez donc en insistant sur la séparation des compétences et des procédures autant que de besoin, et sur la répartition des champs d’intervention.
M. Thomas Andrieu. Oui. Nous avons dû l’écrire dans des circulaires, ou dans une foire aux questions que nous avons envoyée aux préfets.
M. Jean-Frédéric Poisson, président. Merci de nous communiquer ces documents.
Qu’en est-il de l’indemnisation, par exemple des personnes dont on a fracturé la porte ? Avez-vous une idée de la répartition entre gestes gracieux et remboursements après procédure contentieuse ?
M. Thomas Andrieu. Nous n’en sommes qu’au début. Une vingtaine de contentieux m’ont été signalés. Ils s’adressent aux préfets puisque ce sont ces derniers qui décident des perquisitions, mais nous leur avons demandé de nous en saisir systématiquement, et je crois que la plupart le font. Je ne peux pas encore établir de bilan. Il y aura assurément des indemnisations : je ne doute pas que des problèmes d’exécution se soient posés lors de certaines perquisitions. Simplement, je l’ai dit, il faudra veiller à bien distinguer deux questions : d’une part, la légalité de la perquisition, qui est indépendante de son déroulement et de ce qu’elle permet ou non de trouver ; d’autre part, l’exécution de la mesure, qui peut « déraper » même si celle-ci est légale.
Peut-on casser la porte ? Oui, si personne n’est là pour ouvrir, ou si l’on estime qu’un effet de surprise est nécessaire compte tenu de la dangerosité des personnes concernées. Que se passe-t-il ensuite dans l’appartement ? Là encore, c’est une affaire de fait, touchant l’usage le plus strictement proportionné de moyens coercitifs. Nous avons rappelé ces points dans une circulaire du 25 novembre, signée par le ministre.
M. Jean-Frédéric Poisson, président. J’en viens aux autres mesures de l’état d’urgence, dont on parle moins et qui sont, de fait, moins utilisées.
Parmi les arrêtés dont nous avons eu connaissance, l’un interdisait la vente d’alcool dans le Nord, un autre instaurait un couvre-feu dans le quartier des Champs Plaisants, à Sens, dans l’Yonne. Votre service a-t-il été consulté au préalable ?
M. Thomas Andrieu. Juridiquement, les deux sujets sont différents. Le couvre-feu est expressément prévu par la loi de 1955, même s’il n’est pas interdit en temps ordinaire. Nous n’avons pas été consultés au sujet de l’arrêté qui l’a instauré.
En revanche, l’interdiction de la vente d’alcool n’est pas mentionnée dans la loi de 1955. Il s’agit d’une mesure assez traditionnelle en police administrative : elle est appliquée aux alentours des stades avant les matchs, par exemple. Ici, elle l’a été dans un autre contexte. J’ignore si la mesure a fait l’objet d’un contentieux.
M. Jean-Frédéric Poisson, président. Comment les remises d’armes sont-elles gérées ? En particulier, comment ce dispositif est-il utilisé ? Une distinction est-elle bien opérée entre saisie administrative et saisie pénale ?
M. Thomas Andrieu. Je ne savais pas que les dispositions relatives à la saisie administrative des armes légalement détenues avaient été appliquées : je l’ai découvert en lisant le rapport que vous avez publié la semaine dernière. Je suis très heureux que cet article ait pu être utile, d’autant qu’à ce stade, je pensais qu’il ne serait pas mis en œuvre. Vous l’aurez noté, nous avions pris la précaution de le réécrire intégralement pour l’adapter au droit des armes actuellement en vigueur.
Cela dit, le vrai problème, aujourd’hui, en France, ne vient sans doute pas des détenteurs légaux d’armes, à quelques exceptions près.
M. Jean-Frédéric Poisson, président. Comment expliquer que le blocage des sites, permis par la loi de 1955, ne soit pas souvent utilisé ? Y a-t-il dans le texte un problème de formulation qui en compliquerait l’usage ?
M. Thomas Andrieu. Non. Mais les moyens techniques dont nous disposons pour bloquer un site sont ceux que prévoit la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique et qui consistent à enjoindre à un opérateur de procéder au blocage. L’application de la loi de 2004 ne posant pas de problème, je ne suis pas certain qu’un besoin supplémentaire se soit fait sentir : on peut déjà bloquer des sites qui font l’apologie du terrorisme.
M. Jean-Frédéric Poisson, président. En dehors de l’état d’urgence.
M. Thomas Andrieu. Oui, indépendamment de la loi sur l’état d’urgence, en vertu de dispositions pérennes de la loi de 2004 modifiée par la loi du 13 novembre 2014 sur le terrorisme. À ce jour, 43 décisions de blocage de sites faisant l’apologie du terrorisme ont été prises, 210 décisions de déréférencement d’adresses et 526 demandes de retrait de contenus illicites ont été formulées. Peut-être la disposition de la loi de 1955 relative au blocage des sites mériterait-elle une réflexion complémentaire.
M. Jean-Frédéric Poisson, président. En ce qui concerne les dissolutions d’associations prononcées après les perquisitions de Lagny, le décret renvoie à l’article L. 212-1 du code de sécurité intérieure, et non aux dispositions de la loi sur l’état d’urgence. Y a-t-il une raison particulière à ce choix ?
M. Thomas Andrieu. Qui peut le plus peut le moins. Or le standard du code de sécurité intérieure est plus élevé, plus exigeant. Nous l’avons retenu parce que nous pensions consolider ainsi le décret ; c’est une sécurité.
M. Jean-Frédéric Poisson, président. Considérez-vous donc que, sur ce point précis, le code de la sécurité intérieure est plus solide que la loi de 1955 ?
M. Thomas Andrieu. Non. Je considère que le code de la sécurité intérieure est plus exigeant : en satisfaisant au standard du code de la sécurité intérieure, on peut montrer devant le Conseil d’État que la mesure est étayée. Si nécessaire, il est toujours possible de procéder devant le Conseil d’État à une substitution de base légale : en cas de doute, comme la procédure est la même, nous pouvions fonder la mesure sur la loi de 1955. Mais nous avons estimé que nous n’en avions pas besoin sur ce dossier, qui concerne une filière d’acheminement de terroristes vers la Syrie, active depuis plusieurs années. Nous sommes donc assez sereins à cet égard.
M. Jean-Frédéric Poisson, président. Comment décririez-vous l’organisation que vous avez instaurée au sein de votre direction pour échanger avec les préfectures et les services préfectoraux et pour suivre l’application des mesures de l’état d’urgence ? En interne, avez-vous renforcé votre service ou modifié son organisation pour faire face aux besoins spécifiques de la période ?
M. Thomas Andrieu. J’ai créé une cellule dédiée à l’état d’urgence qui m’est directement rattachée. Réunie dans un même lieu, elle dispose d’une boîte fonctionnelle et est en lien quotidien, y compris le week-end – même si les choses se sont tassées depuis Noël –, avec les services de renseignement, notamment l’UCLAT, qui sert d’interface, et avec les préfectures.
J’ai diverti des ressources de ma direction vers cette mission, qui est évidemment la priorité numéro un pour le ministre. Cela a quelque peu dégradé la qualité de notre prestation dans d’autres domaines.
Dans le cadre du plan de lutte antiterrorisme annoncé en janvier, j’ai obtenu cinq créations d’emplois ; au titre du plan qui vient d’être annoncé, nous en avons eu trois. Naturellement, ils seront intégralement consacrés aux questions de terrorisme et de renseignement.
M. Jean-Frédéric Poisson, président. Quels sont vos effectifs et quelle en est la proportion affectée à l’état d’urgence ? Outre les huit postes que vous venez d’évoquer, y en a-t-il d’autres ?
M. Thomas Andrieu. Il y a 175 effectifs physiques à la DLPAJ. La cellule « état d’urgence » proprement dite ne compte que quatre personnes. Mais une très grande partie des cadres de ma direction travaille sur l’état d’urgence stricto sensu ou sur l’état d’urgence et le terrorisme.
Nous avons un bureau des expulsions ; 95 % des personnes qu’il suit sont des terroristes et les mesures législatives qui y sont débattues sont toujours liées au terrorisme. Nous avons un bureau des titres d’identité et de voyage, qui contient désormais une cellule « interdiction de sortie du territoire français » – un sujet qui concerne exclusivement le terrorisme. Nous avons un bureau de la liberté individuelle qui s’occupe des dissolutions – rares, mais lourdes à gérer – et des gels d’avoirs financiers.
Plus généralement, ce qui me frappe eu égard aux priorités du ministre – j’exerce mes fonctions depuis avril 2014 –, c’est que les questions de terrorisme et de renseignement ont envahi le travail du ministère comme jamais auparavant. C’est légitime, et je suis en train de réorienter ma direction en ce sens. La DLPAJ s’est toujours occupée d’ordre public et de ces questions. Mais à titre personnel, depuis Charlie, je consacre 80 % de mon temps de travail au terrorisme, au renseignement et à l’islam – je suis par ailleurs chargé de la relation avec les cultes, indépendamment de mes fonctions juridiques – et, depuis les attentats du 13 novembre, je m’occupe à 95 % de terrorisme, de renseignement, d’islam et d’état d’urgence.
Au-delà de tel ou tel attentat, l’allocation des ressources ministérielles et les préoccupations du ministre se déplacent ainsi de plus en plus vers le haut du spectre. Cette préoccupation ministérielle est d’ordre politique, mais aussi administratif : comment s’organiser ? D’où les débats sur l’EMOPT et l’UCLAT. À mon avis, nous n’avons pas fini d’accompagner cette transition.
Je le constate à mon niveau : le bureau qui traite de la vie privée au sein de ma direction s’est occupé de la loi renseignement et, désormais, toutes les questions de fichiers de police intéressantes concernent ce « haut du spectre » – FSPRT, terrorisme, etc. Notre bureau des questions pénales s’occupe lui aussi de terrorisme. Bref, c’est toute ma direction qui est en train de monter ainsi en gamme. C’est passionnant, mais cela représente beaucoup de travail.
M. Jean-Frédéric Poisson, président. La situation que vous décrivez semble devoir nécessiter, en tout cas si elle se prolonge, une adaptation des niveaux moyens de compétence. Certes on n’en a jamais fini de se préparer, mais quel temps cela demanderait-il, selon vous ?
Par ailleurs, il y a 95 préfectures en métropole, 100 en France : quatre personnes en lien avec les préfectures en période d’état d’urgence, est-ce suffisant ?
M. Thomas Andrieu. Qu’il n’y ait pas de malentendu : je ne suis pas le seul à suivre l’état d’urgence en administration centrale dans ce ministère, loin de là !
Ma cellule « état d’urgence » a d’abord vocation à traiter les assignations – prononcées par la DLPAJ par délégation du ministre –, en lien avec les préfectures et les services de renseignement. Puis vient la fonction de conseil juridique, traditionnelle et traitée ailleurs au sein de ma direction, sur des mesures dont nous n’avons pas l’initiative mais dont on nous saisit. Le flot de saisines, extraordinairement nourri au cours des premières semaines, s’est apaisé depuis le début du mois de janvier, redevenant plus habituel.
Quant aux chantiers de fond, qui ne sont pas directement liés à l’état d’urgence, j’ai entrepris de reprofiler ma direction, parce que je considère que toute direction juridique au sein de l’État devrait être composée un peu à la manière d’un cabinet d’avocats : certes hiérarchique, avec des personnes jeunes et d’autres plus âgées, mais telle que celui qui se trouve tout en bas de la chaîne puisse un jour atteindre le plus haut niveau, grâce au socle de compétences, juridiques et d’autre nature, dont il dispose. Ce qui implique une sociologie différente de celle qui caractérise les administrations en France. Je précise que je m’exprime sur ce point à titre personnel. Ce reprofilage est en cours : à chaque changement, nous nous efforçons de relever le niveau.
M. Jean-Frédéric Poisson, président. Nous vous remercions d’avance de bien vouloir nous faire parvenir les documents que vous avez proposé de nous communiquer.
Merci de cette audition, et de la mission que vous accomplissez pour nous tous.
——fpfp——
AUDITION DE MME CHRISTINE LAZERGES, PRÉSIDENTE DE LA COMMISSION NATIONALE CONSULTATIVE DES DROITS DE L’HOMME (CNCDH), DE MME GWÉNAËLLE CALVÈS, MEMBRE DE LA CNCDH ET DE M. HERVÉ HENRION-STOFFEL, CONSEILLER JURIDIQUE
Compte rendu de l’audition, ouverte à la presse, du mardi 15 mars 2016
M. le président Dominique Raimbourg. Madame la présidente de la Commission nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH), nous vous recevons aujourd’hui, avec Mme Gwénaëlle Calvès, membre de la CNCDH, et M. Hervé Henrion-Stoffel, conseiller juridique, dans le cadre de nos travaux de contrôle de l’état d’urgence, décrété le 14 novembre 2015 et prolongé à deux reprises, le 20 novembre et le 19 février dernier. Nous avons souhaité vous entendre au regard de la place qui est la vôtre dans le domaine de la défense des droits et des libertés ; vous avez par ailleurs publié un avis sur le suivi de l’état d’urgence.
Dans la mesure où notre mission est constituée comme une commission d’enquête, conformément aux dispositions de l’article 6 de l’ordonnance du 17 novembre 1958, je vous demande de prêter le serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité.
(Mme Christine Lazerges, Mme Gwénaëlle Calvès et M. Hervé Henrion-Stoffel prêtent successivement serment.)
Je vais maintenant vous donner la parole, puis mes collègues vous poseront des questions.
Mme Christine Lazerges, présidente de la Commission nationale consultative des droits de l’homme. Au nom de la CNCDH, je me félicite de cette initiative de votre Commission. Votre prédécesseur, Jean-Jacques Urvoas, nous a saisis pour assurer le suivi de l’application de l’état d’urgence ; c’est sur la base de cette saisine que nous avons conduit nos travaux. Les chiffres que je serai amenée à donner proviennent du ministère de l’intérieur. N’étant pas des professionnels des questions de sécurité, nous nous garderons de formuler des appréciations globales sur l’efficacité des mesures prises dans le cadre de l’état d’urgence pour mieux lutter contre le terrorisme. Nous avons cependant des constats à établir au regard des droits et libertés fondamentaux ; j’en évoquerai quelques-uns puis Mme Calvès, universitaire comme moi, traitera des divers contrôles exercés sur les opérations administratives.
L’avis que nous présentons aujourd’hui a été rédigé par l’un des quatre pôles de la CNCDH, le pôle « État de droit et libertés » ; Mme Calvès en a été la rapporteure, l’avis a été adopté à l’unanimité moins la voix de la Croix-Rouge, qui, me semble-t-il, reste toujours neutre.
Dans le cadre de l’état d’urgence, trois types de mesures administratives ont principalement été ordonnés : perquisitions, assignations à résidence, fermetures de lieux de culte.
S’agissant des perquisitions, 3 284 avaient été ordonnées au 3 février ; au 11 mars, ce chiffre s’élève à 3 449, ce qui montre que l’état d’urgence s’essouffle dans les mesures qu’il autorise puisque, en un mois, une centaine de perquisitions supplémentaires seulement ont été effectuées. Cette évolution permet de s’interroger sur la pertinence de la reconduction de l’état d’urgence.
Le même phénomène s’observe pour les assignations à résidence : 392 prononcées au 3 février, 470 au 11 mars.
Quant aux lieux de culte, dix avaient fait l’objet d’une mesure de fermeture au 3 février.
Par ailleurs, un peu moins d’une dizaine d’interdictions de manifester ont été prononcées ; nous regrettons que ces interdictions ne fassent pas l’objet d’un recensement de la part du ministère de l’intérieur, et nos chiffres ne sont peut-être pas tout à fait exacts.
La CNCDH n’a pas considéré que le Président de la République ait commis une erreur en décrétant l’état d’urgence, ni le Parlement en le prorogeant après les douze jours prévus par la loi. En revanche, nous nous interrogeons sur le second renouvellement de trois mois, car nous estimons que l’état d’urgence constitue un état d’exception, qui, dans un État de droit, ne saurait être permanent. Ce serait une grande victoire pour les terroristes de se dire qu’ils peuvent nous contraindre à vivre en permanence sous le régime de l’état d’urgence.
Les perquisitions administratives ont fait l’objet de très nombreux signalements de dysfonctionnements : la mobilisation des forces de police et de gendarmerie a souvent paru démesurée ; à titre d’exemple, la perquisition d’une mosquée à Brest, le 20 novembre 2015 à trois heures du matin par une centaine de membres des forces de l’ordre, n’a abouti à aucune interpellation. Il nous semble par ailleurs que les autorités ont parfois manqué de discernement dans le choix des cibles, puisqu’une ferme biologique située dans le Périgord a fait l’objet d’une perquisition.
La CNCDH n’est pas composée que de personnalités qualifiées, elle l’est aussi de représentants d’organisations non gouvernementales (ONG) et d’associations, à raison de trente représentants par collège. Ainsi, la Ligue de droits de l’homme (LDH), qui a été très active, l’Action des chrétiens pour l’abolition de la torture (ACAT), qui a rendu un rapport sur les violences policières, et la CIMADE, service œcuménique d’entraide, notamment, sont représentées à la CNCDH. Ces organismes, dont les missions sont de veiller aux excès des forces de l’ordre, nous ont fournis, ainsi que d’autres personnes que nous avons entendues, la plupart des informations que je vais vous présenter, particulièrement en ce qui concerne les perquisitions administratives.
Au cours de ces opérations, la présence de personnes vulnérables – mineurs, femmes enceintes, personnes âgées ou handicapées – a très peu été prise en compte, ce qui, aux yeux de la CNCDH, constitue une grave erreur. Vous êtes au fait de ces exemples de perquisitions ratées au regard du respect des droits fondamentaux : une perquisition nocturne, effectuée devant des enfants mineurs, par des personnes cagoulées entrant violemment en masse dans l’appartement, cause un choc grave et entraîne de lourdes séquelles psychologiques. De nombreuses violences physiques nous ont été rapportées : plaquages au sol, coups, immobilisations physiques accompagnées d’une mise en joue avec arme, violences psychologiques, usage des menottes bien au-delà de ce qu’autorise l’article 803 du code de procédure pénale, dégradations volontaires ou involontaires d’emblèmes religieux ou d’objets cultuels, dégâts matériels quasi systématiques… Monsieur le président de la commission des Lois, j’insiste auprès de vous pour que la réparation de ces dégâts matériels soit faite dans de meilleures conditions qu’aujourd’hui. En effet, la majorité des personnes dont le domicile a été perquisitionné sont peu au fait des procédures et ne saisissent pas le tribunal administratif ou ne sollicitent pas un avocat ; certaines préfectures les indemnisent, d’autres non, et beaucoup parmi les intéressés ne sont toujours pas indemnisés. Un suivi de la commission des Lois dans ce domaine serait le bienvenu, bien des gens chez qui ces opérations ont été menées ne disposant que de faibles moyens. Un certain nombre d’appartements ont été mis à sac, ce qui est douloureux psychologiquement comme matériellement.
J’insiste aussi sur les propos déplacés, vexatoires, voire injurieux, tenus par certains policiers ou gendarmes : « Lisez ça si vous savez lire », « On est en état d’urgence alors on fait ce qu’on veut », « Il reste encore quelques places à Guantanamo » ou, de façon plutôt discriminatoire, « Vous pratiquez plus qu’il ne faut ». Nous avons même eu l’exemple d’un représentant des forces de l’ordre apercevant la représentation d’un personnage barbu dans un appartement et demandant : « Qui est ce barbu ? », ce à quoi il a été répondu qu’il s’agissait de Victor Hugo !
Le plus important réside dans l’absence de remise de l’ordre de perquisition, ainsi que de récépissé, à l’occasion des opérations. C’est sans doute ce qui explique la quasi-absence de recours, les personnes perquisitionnées ne disposant d’aucun élément tangible à produire. Nous nous sommes néanmoins félicités de constater que, dès le 25 novembre 2015, le ministre de l’intérieur, a, par voie de circulaire, rappelé aux forces de l’ordre le strict respect des règles des codes de déontologie de la police et de la gendarmerie.
Il nous est par ailleurs revenu que l’assignation à résidence s’est parfois transformée en mesure restrictive de la liberté d’aller et venir, et, dans certains cas, en une privation de liberté qui aurait dû relever de l’article 66 de la Constitution. Cela a été le cas lorsque des personnes ont été contraintes à se présenter quatre fois par jour au commissariat de police, ce que même la loi du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence n’autorise pas. Nous avons eu connaissance de cas assez dramatiques, tel celui d’une mère de famille vivant seule avec trois jeunes enfants, obligée d’aller se présenter à quatre kilomètres de son domicile, en l’absence de moyens de transport.
En tout état de cause, l’assignation à résidence, par la fréquence des pointages, entrave l’activité professionnelle, constitue une obstruction à la poursuite d’études et bouleverse l’organisation de la vie privée, comme l’illustre notre avis. Certaines juridictions pourront vous le dire : puisque l’état d’urgence perdure, les mesures d’assignation à résidence devraient être beaucoup plus individualisées qu’elles ne l’ont été jusqu’à présent.
Certaines pratiques ont constitué un détournement de l’état d’urgence et nous avons pu constater que les principes de nécessité et de proportionnalité ne présidaient pas à toutes les décisions d’opérations administratives. Cela a été le cas à l’occasion de la COP 21, puisque des militants écologistes ont fait l’objet de cette mesure et qu’une grève dans une entreprise multimédias ainsi qu’une manifestation d’un syndicat de retraités ont été interdites.
L’état d’urgence a encore été utilisé à Calais dans le but d’entraver la liberté d’aller et venir des migrants – qui vivent dans des conditions que la CNCDH considère comme infra-humaines – en instituant, au titre de l’article 5 de la loi du 3 avril 1955, une « zone de protection » sur l’emprise de la route nationale 216, dite rocade portuaire de Calais. Concrètement, cela a conduit à interdire aux migrants vivant dans la « jungle » l’accès et la circulation sur les voies routières, ce qui nous a semblé fort peu en relation avec la lutte contre le terrorisme.
D’après des sources ministérielles, nombre des poursuites engagées dans le cadre de l’état d’urgence étaient sans rapport avec la lutte contre le terrorisme, mais relevaient d’infractions à la législation sur les stupéfiants ou les armes. À la date du 3 février dernier, vingt-huit infractions avaient été constatées ; la section antiterroriste du parquet de Paris a été saisie de cinq d’entre elles, les vingt-trois autres relevant du délit d’apologie ou de provocation à des actes de terrorisme.
Enfin, les personnes visées étant pour la plupart de confession musulmane, il y a là une sorte de discrimination à l’égard d’une religion, ainsi qu’un sentiment de rejet éprouvé par les intéressés. Nous fondant sur le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) adopté en 1966 par l’Assemblée générale des Nations unies, nous considérons qu’en aucun cas l’état d’urgence ne doit aboutir à des discriminations fondées sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion ou l’origine sociale. À nos yeux, l’état d’urgence porte atteinte à la cohésion nationale ; dans ces conditions, il ne saurait perdurer que s’il s’avère strictement indispensable. Nous souhaitons que la loi de procédure pénale – au sujet de laquelle le Sénat nous a entendus aujourd’hui – ne serve pas seulement à permettre la levée de l’état d’urgence une fois introduits dans ce code un certain nombre de dispositifs, telles les perquisitions de nuit, qu’aujourd’hui seul ledit état d’urgence autorise.
Mme Gwénaëlle Calvès, membre de la CHCDH. Mon propos portera sur les divers contrôles de l’état d’urgence qui ont été réalisés, et qui sont de trois ordres : institutionnel, juridictionnel et « citoyen » – j’entends par là : émanant de la société civile.
La Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) et le Défenseur des droits sont à l’origine du contrôle institutionnel. Toutefois, la partie de notre avis concernant la CNIL est caduque, car elle porte sur l’article 11 de la loi du 3 avril 1955, qui prévoit la saisie et la conservation de données informatiques à l’occasion d’une perquisition administrative. Or, dans sa réponse à la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) nº 536 du 19février dernier, soit le lendemain de l’adoption de notre avis, le Conseil constitutionnel a censuré cette disposition législative. Dans la mesure où il s’agit d’une abrogation à effet immédiat, nos propositions tendant à améliorer le contrôle de la CNIL sur la conservation de ces données sont tombées.
En revanche, nos préconisations relatives à l’importance des avis et recommandations du Défenseur des droits conservent toutes leur pertinence. Au titre de sa mission de contrôle de l’activité des forces de police, le Défenseur des droits a appelé l’attention sur le déroulement des perquisitions administratives à de nombreuses reprises. Ses délégués territoriaux conduisent un travail d’analyse très précieux, fondé sur les réclamations des administrés, complémentaire du nôtre, et qui nous a menés à faire des rappels à la déontologie policière, souvent malmenée comme l’a montré Christine Lazerges.
Le contrôle juridictionnel des mesures prises dans le cadre de l’état d’urgence, exercé par le juge administratif, tient une place cruciale dans la défense des droits individuels et collectifs au sujet de laquelle nous avons formulé sept recommandations. Nous avons en outre mentionné les contentieux que nous considérons comme « latéraux », concernant par exemple des retraits d’habilitation d’accès à des zones aéroportuaires ou des contrôles d’identité, indûment exercés au titre de l’état d’urgence et annulés par le juge des libertés et de la détention (JLD). De fait, les risques d’abus, l’effet « pente glissante » ou « doigt dans l’engrenage », auxquels un régime tel que celui de l’état d’urgence peut donner lieu, ne doivent pas être sous-estimés. Le Défenseur des droits a d’ailleurs fait de même en prenant en compte toutes les réclamations reçues, relatives à des mesures directement justifiées ou non par l’état d’urgence.
Très générale, notre première proposition porte sur la mauvaise connaissance des voies d’accès à la justice administrative – réalité qui excède largement notre sujet –, comme le montre le taux quasi nul de recours contentieux exercés à l’encontre des perquisitions. Il est d’un sur quatre pour les assignations à résidence, et plus difficile à évaluer pour les autres mesures, car les données fournies par le ministère de l’intérieur sont assez incomplètes, singulièrement dans le domaine des restrictions à la liberté de culte. En tout état de cause, la justice administrative est sous-investie par le public.
La deuxième proposition à trait aux contestations contentieuses des perquisitions administratives : on en comptait une seule à la date de l’adoption de l’avis, contre trois aujourd’hui, alors même que ces opérations constituent le premier motif de saisine du Défenseur des droits. La question de l’accès au juge est bel et bien posée, puisque les intéressés se plaignent auprès du Défenseur des droits au lieu de saisir le juge, démarche pourtant normale lorsque quelqu’un a subi un préjudice dû à une illégalité.
Nous avons fortement insisté sur la nécessité de mettre les personnes perquisitionnées en mesure d’exercer leur droit au recours contentieux en rendant systématique la remise d’un récépissé récapitulant le déroulement de l’opération et indiquant les voies de recours ouvertes au justiciable. Je rappelle qu’un très grand nombre d’actes administratifs bien plus bénins, lorsqu’ils sont exécutés, mentionnent les voies et délais de recours.
Nous proposons encore de rendre obligatoire le contrôle a priori de l’autorité judiciaire de la décision même de perquisitionner un domicile. Le Conseil constitutionnel a considéré qu’un tel contrôle n’était pas exigé par la Constitution ; il nous semble pourtant qu’il serait de nature à conforter l’état de droit, et il nous paraît praticable. Le mécanisme d’information sans délai des procureurs compétents fonctionne bien, aux dires mêmes de ces derniers. Il n’y aurait donc pas d’obstacle technique à ce que cette obligation d’information soit transformée en demande d’autorisation. Dans la décision rendue le lendemain de l’adoption de notre avis sur les deux QPC qui lui ont été adressées, le Conseil constitutionnel a semblé désireux de favoriser l’exercice des voies de recours après le déroulement d’une perquisition, en invitant le juge administratif à vérifier la légalité de la mesure à l’occasion d’un recours indemnitaire formé devant lui – ce qui ne va pas de soi. Il a particulièrement insisté sur le contrôle à opérer sur les perquisitions de nuit – la moitié de ces opérations étant nocturnes – et a invité le juge administratif à s’assurer que celles-ci sont justifiées par l’urgence ou l’impossibilité de les effectuer le jour.
Nous nous félicitons du contrôle exercé par les juridictions administratives dans le cadre du contentieux le plus volumineux, celui de l’assignation à résidence, et nous proposons même de l’inscrire dans la loi. Nous suggérons une procédure de référé spécifique à l’état d’urgence – car, actuellement, c’est au référé-suspension et au référé-liberté qu’il est le plus souvent recouru –, et ce en précisant le mode de contrôle applicable, ce qui éviterait le flottement constaté au début de l’entrée en vigueur de l’état d’urgence. En effet, comme l’a reconnu la semaine dernière la doctrine autorisée dans l’AJDA (Actualité juridique, Droit administratif), le juge administratif partage certaines émotions avec l’opinion et peut être tenté, par exemple, de considérer qu’il n’y a pas de condition d’urgence, comme l’avaient fait les tribunaux administratifs au début de ce contentieux. Si la loi déterminait le type de contrôle applicable, de telles tentations seraient évitées.
Concernant l’effectivité du contrôle, le recours aux « notes blanches » des services de renseignement a suscité de nombreuses interrogations à l’occasion des auditions auxquelles nous avons procédé. La question est apparue déterminante quant à l’exercice effectif des droits de la défense ; le juge exige désormais que ces notes soient circonstanciées et précises afin d’acquérir la qualité d’élément probant. Cela met par ailleurs l’avocat du plaignant en mesure de réfuter les arguments avancés par l’administration. Au cours de la période récente, un assez grand nombre d’assignations à résidence jugées en référé ont été considérées comme manifestement illégales, faute pour l’administration de pouvoir étayer son action sur des éléments concrets.
De manière générale, le juge administratif vérifie aujourd’hui, comme le Conseil constitutionnel l’y a invité, que les motifs retenus pour décider d’une assignation à résidence, d’une perquisition ou de la fermeture d’un lieu de culte soient étroitement proportionnés au péril imminent ayant conduit à la déclaration de l’état d’urgence. Nous proposons que l’administration s’approprie ce mode de contrôle, et, de façon explicite et systématique, établisse ce lien entre la restriction de liberté qu’elle décide et les raisons qui ont motivé l’état d’urgence. En clair, cela éviterait l’assignation à résidence de militants écologistes et permettrait également d’individualiser les conditions de l’assignation, car, comme le rappelait Christine Lazerges, les obligations de pointage, selon leur fréquence et le lieu où elles doivent être effectuées, peuvent être très lourdes pour les intéressés.
Enfin, dans le cadre du contrôle « citoyen », nous présentons de façon non exhaustive l’action des associations, de la presse et des syndicats pour souligner le rôle fondamental de vigie tenu par la société civile. Cette mobilisation ne doit toutefois pas faire oublier que des phénomènes plus inquiétants ont été observés : des dénonciations malveillantes par exemple, des mises à l’index par le voisinage de personnes ayant été perquisitionnées. La LDH, dont Christine Lazerges a souligné l’éminence de la participation à nos travaux, a indiqué que son action d’assistance aux personnes était entravée par les intéressés eux-mêmes, la peur du regard de leurs voisins leur interdisant de dire qu’ils ont fait l’objet d’une perquisition ou d’une assignation et leur imposant, dans les faits, de faire le silence sur leur situation.
En conclusion, l’état d’urgence crée une ambiance générale susceptible de corroder le lien social, alors même que notre pays a plus que jamais besoin d’unité face à la menace terroriste. Nous appelons par conséquent à une sortie de l’état d’urgence et à un retour rapide à la normalité.
Mme Christine Lazerges. Nous avons pu mesurer à quel point une perquisition ou une assignation à résidence constitue une humiliation. Comme Gwénaëlle Calvès l’a fort bien dit, dans ce contexte, la famille est rejetée par son voisinage, les enfants sont montrés du doigt à l’école, ce qui pousse certains des intéressés à vouloir déménager. Nous avons constaté que les retombées des mesures administratives qu’autorise l’état d’urgence sont bien le détricotage du lien social et la crise de la cohésion sociale. Notre société n’a pas besoin d’une telle atmosphère, et il nous paraît urgent de sortir de l’état d’urgence.
M. Lionel Tardy. L’état d’urgence est aujourd’hui prolongé jusqu’au 26 mai. Nous savons que l’Euro 2016 de football viendra ensuite, ce qui se traduira par une prolongation de trois mois, c’est-à-dire jusqu’à la fin du mois d’août, soit neuf mois d’état d’urgence au bas mot. Même si, comme nous l’espérons, rien de notable ne se produit d’ici le 26 mai, ne pensez-vous pas que le Gouvernement cherchera à prolonger l’état d’urgence jusqu’à l’Euro, car si un attentat devait survenir au cours de cette manifestation sportive alors que la mesure aurait été levée, cela lui serait reproché ?
Mme Christine Lazerges. Je vous rappelle que vous êtes le Parlement, non le Gouvernement, et que le Parlement peut prendre ses responsabilités, quoi que lui demande le Gouvernement. Je comprends que cela n’est pas aisé, nous l’avons écrit dans un autre avis : il est très facile d’entrer dans l’état d’urgence, mais extrêmement difficile d’en sortir. Personne n’ayant jamais prouvé l’utilité de l’état d’urgence, nous nous gardons bien d’émettre une opinion à ce sujet : nous ignorons s’il est utile ou non.
Un attentat terroriste pourrait se produire en France pendant la période de l’état d’urgence ; nous ne savons rien – ni les uns, ni les autres – de l’état d’urgence en tant que mode de prévention du terrorisme. Il n’est que d’entendre ce que l’on dit de la France à l’étranger. Il serait grave de dire que, puisqu’il est difficile de sortir de l’état d’urgence, nous n’en sortirons pas ; après l’Euro, il y aura autre chose, il suffit de regarder ce qui se passe en Turquie, ou hier en Côte-d’Ivoire. État d’urgence ou pas, le risque de terrorisme est lourd ; le prix à payer est-il l’état d’urgence ? À la CNCDH, nous n’en sommes pas convaincus, et nous pensons qu’entrer dans l’ère du soupçon est ce qui pourrait arriver de pire à la France pour les années à venir.
M. Sergio Coronado. Je tiens à vous remercier pour la qualité de votre travail comme pour celle de vos interventions. Vous mettez en lumière les dégâts, à certains égards peu visibles, de l’état d’urgence ; lors de nos discussions avec le ministre de l’intérieur, Bernard Cazeneuve, l’argument régulièrement avancé a été que très peu de plaintes sont déposées pour dénoncer les perquisitions ou les assignations à résidence abusives.
Vous exposez très clairement comment l’accès à la justice ne va pas de soi pour les intéressés, comment ces perquisitions et assignations à résidence constituent des marqueurs d’infamie aux yeux de leur entourage et de leur voisinage, comment ces mesures administratives peuvent compromettre la vie familiale, professionnelle, estudiantine ou militante.
Je partage votre analyse sur le détournement de l’état d’urgence. Toutefois, le Conseil constitutionnel n’a pas épousé ce point de vue, puisqu’il a considéré que, si le législateur avait voulu que l’état d’urgence ne serve qu’à lutter contre le terrorisme, il l’aurait clairement exprimé dans la loi. De son point de vue, le recours à l’état d’urgence à des fins de maintien de l’ordre public ne constitue pas un détournement. Pourtant, l’assignation à résidence de vingt et un militants écologistes par les forces de police et de gendarmerie est totalement infondée dans le contexte de la lutte contre le terrorisme : la question du détournement est dès lors posée.
Je souhaite vivement avoir votre opinion au sujet des conceptions du Conseil constitutionnel sur la lutte contre le terrorisme, l’état d’urgence et le maintien de l’ordre public.
Mme Gwénaëlle Calvès. Il ne me semble pas que le Conseil constitutionnel ait donné un blanc-seing aux forces de l’ordre pour recourir à l’état d’urgence à des fins autres que celles liées au péril imminent…
M. Sergio Coronado. J’ai simplement dit que le Conseil semble accepter volontiers que l’état d’urgence ne serve pas exclusivement à la lutte contre le terrorisme.
Mme Gwénaëlle Calvès. Le Conseil constitutionnel a, au contraire, incité le juge administratif à veiller à ce que la mesure administrative prise dans le cadre de l’état d’urgence soit adaptée, nécessaire et proportionnée à la finalité poursuivie, laquelle ne peut être que la cessation de l’état de crise ayant précipité la décision de mettre en œuvre l’état d’urgence.
La décision du Conseil et les instructions assez fermes qu’il donne au juge administratif ne me semblent pas pouvoir être interprétées comme autorisant un usage de ces mesures de police autre que destiné à lutter contre le péril imminent.
Mme Christine Lazerges. Mon interprétation est légèrement divergente, il me semble que le Conseil constitutionnel a été astucieux dans la formulation de sa décision et qu’il laisse la porte ouverte à des détournements.
Nous avons entendu les syndicats de magistrats des tribunaux administratifs, qui nous ont fait part d’un état de sidération des juges au moment du jugement des premières affaires, avant qu’une décision du Conseil d’État vienne mettre un terme aux hésitations d’un certain nombre de tribunaux administratifs. Toutefois, le fait qu’un tribunal administratif ait pu considérer qu’il n’était pas urgent de statuer sur une assignation à résidence est assez hallucinant ; cela a été justifié par l’un des syndicats auditionnés par l’état psychologique régnant alors, et qui était le même que celui de tous les Français !
Mme Marie-Anne Chapdelaine. Nous savons que, malheureusement, le terrorisme ne va pas disparaître. Dans la mesure où vous pensez que l’état d’urgence ne se justifie plus puisqu’il ne donne pratiquement plus lieu à aucune interpellation, une sortie « sèche » du dispositif vous semble-t-elle envisageable, ou faut-il prévoir des mesures transitoires ? Plutôt que de reconduire l’état d’urgence pour trois mois, aurait-il fallu aménager une sortie ?
Toujours en conservant à l’esprit que le terrorisme ne disparaîtra pas, quelle appréciation portez-vous sur la législation actuelle relative au respect des droits au sein de cette société qui, hélas, a appris à vivre avec le terrorisme ?
Mme Christine Lazerges. On est en état d’urgence ou on ne l’est pas. Le Conseil d’État l’a dit, il n’existe pas de sortie graduée – idée qu’il avait été envisagé d’inscrire dans la loi. Nous avons vécu pendant des années sans état d’urgence alors qu’il y avait des actions terroristes : les attentats de l’année 2015 n’ont pas été les premiers commis en France.
Au pays de la Déclaration des droits de l’homme – pour autant qu’on ose encore les évoquer –, nous devons être capables, même dans le contexte actuel de cette crainte justifiée du terrorisme, de vivre autrement qu’en état d’urgence. Je le répète, ce sont toujours les mêmes qui sont entravés dans leur existence, et ce sont précisément ceux que l’on a le plus de mal à intégrer dans notre société et à doter de chances égales à celles des autres.
L’état d’urgence, les perquisitions, les assignations à résidence sont des machines à discrimination. Au lieu de continuer à les faire tourner, revivons avec des forces de l’ordre fonctionnant normalement. Je le répète, rien ne prouve que l’état d’urgence soit utile, rien non plus ne prouve qu’il soit inutile ; il peut durer jusqu’à la fin des temps si le courage politique de revenir aux fondamentaux fait défaut.
Je réponds maintenant à votre seconde question. Comme tout texte de procédure pénale, un texte qui touche aux droits fondamentaux doit être mûrement pensé. Mon maître en droit, le doyen Carbonnier, citant Montesquieu, enseignait à ses élèves que le Parlement ne devait légiférer que « d’une main tremblante ». En l’occurrence, nos mains tremblent parce que nous avons peur, mais nous ne nous donnons absolument pas les moyens de réfléchir. La preuve en est qu’on a même imaginé de maintenir des mineurs – et des majeurs – en rétention pendant quatre heures, sans aucune garantie. Comment peut-on, aujourd’hui, en France, imaginer qu’il serait possible de retenir quelqu’un pendant quatre heures pour faire du renseignement, et que cela constituerait un moyen de lutte contre le terrorisme ?
Mme Cécile Untermaier. Merci pour vos travaux ainsi que pour vos interventions, qui nous sont utiles dans notre recherche d’un équilibre entre sécurité et liberté. Comme vous, je considère qu’il faut sortir de l’état d’urgence et que les moyens de la sécurité sont à rechercher dans le droit commun.
Il me semble toutefois qu’au fil du temps le dispositif a été amélioré ; l’approche, brouillonne au départ, est devenue, peut-être du fait de la réduction du nombre des opérations, plus précise par la suite, avec des initiatives mieux ciblées, mieux proportionnées et circonstanciées. Partagez-vous cette impression ?
J’ai interrogé le préfet de mon département, la Saône-et-Loire, qui ne m’a fait part d’aucun débordement et m’a, au contraire, affirmé que toutes les opérations s’étaient déroulées dans le respect des droits et des libertés. Il me semble que les députés doivent jouer leur rôle sur le terrain, être aux côtés des préfets et faire circuler l’information, au même titre qu’un délégué du Défenseur des droits.
L’idée du récépissé est très intéressante. Puisque nous sommes sous un régime d’état d’urgence, nous pourrions adopter cette mesure de façon exceptionnelle. Par ailleurs, l’accès à la justice me paraît extrêmement difficile, singulièrement pour des gens modestes ; cette question trouvera peut-être sa solution dans le projet de loi « Justice du XXIe siècle », mais elle demeure une réalité aujourd’hui.
Comme vous, je déplore que des dénonciations malveillantes aient été enregistrées, car les dommages psychologiques qui en résultent ne sont pas rattrapables ; en revanche, en tant qu’élus nous pouvons agir auprès des préfets pour faciliter la réparation matérielle.
Enfin, s’il advenait qu’un jour nous soyons à nouveau en état d’urgence, nous risquerions de rencontrer les mêmes difficultés. Que pouvons-nous faire pour que, le cas échéant, le dispositif soit immédiatement mis en place de façon satisfaisante ?
Mme Christine Lazerges. Il faudrait en premier lieu que la police et la gendarmerie fassent preuve du plus grand respect pour la déontologie. Ainsi, quantité de perquisitions auraient pu ne pas avoir lieu de nuit, et la mise à sac des appartements n’est pas justifiée. Certes, on n’entre pas en sonnant à la porte, mais le seul dégât matériel constaté devrait concerner la porte d’entrée.
L’idéal à atteindre est celui de forces de l’ordre convenablement formées ; or, l’état d’urgence a révélé des dysfonctionnements dans ce domaine. Par ailleurs, en se fondant sur le nombre de recours formés contre ces opérations, le ministre de l’intérieur ne retient pas un critère sérieux, puisqu’il est notoire que l’accès à la justice est difficile : quelles sont les personnes – elles aussi sous le coup de la sidération – qui iront s’assurer les services d’un avocat ? De fait, des avocats spécialistes du droit des étrangers sont intervenus, en nombre croissant au fil du temps. En tout état de cause, l’état d’urgence aura révélé cette grande difficulté d’accès à la justice.
Mme Gwénaëlle Calvès. Les personnes qui s’estiment lésées doivent obligatoirement, avant tout contentieux, adresser une demande de réparation. Les préfets son donc là bien dans leur rôle. Malheureusement, nous ne disposons pas de statistiques sur le sujet.
M. le président Dominique Raimbourg. Je me suis déplacé dans trois préfectures, et il semble que la doctrine qui se met en place soit la suivante : si la perquisition est infructueuse, le bris de porte est indemnisé ; si, au contraire, des objets ont été saisis, les intéressés font l’objet de poursuites diverses et il n’y a pas d’indemnisation spontanée du bris de porte ; dans ce cas, un contentieux est nécessaire. Faute de lignes budgétaires clairement identifiées, l’appréciation de cette doctrine peut varier d’une préfecture à l’autre. Une administration ne peut d’ailleurs pas décider spontanément l’indemnisation d’un particulier sans avoir été condamnée par un tribunal.
Mme Christine Lazerges. Un procès devant le tribunal administratif dure plusieurs années…
Mme Gwénaëlle Calvès. Il est inexact de dire que l’accès à la justice administrative soit difficile ; le référé-suspension et le référé liberté sont gratuits, rapides et efficaces, et beaucoup d’associations sont prêtes à aider les intéressés. L’obstacle est psychologique, il ne résulte pas des procédures : ceux qui ont fait l’objet de ces mesures administratives se sont sentis montrés du doigt, notamment par leur voisinage et n’ont pas osé saisir le juge. À l’occasion de la déclaration de l’état d’urgence, un discours est apparu, tendant à considérer que le juge judiciaire était plus protecteur que le juge administratif, mal distingué de l’administration elle-même. Nous l’avons constaté avec stupéfaction, à l’occasion d’auditions au cours desquelles certains de nos interlocuteurs identifiaient la justice administrative à l’administration. Il s’agit donc bien d’un problème de méconnaissance, et certainement pas de procédure ni de coût : nous manquons d’une bonne pédagogie du droit.
Lionel Tardy. À ce stade, la question n’est plus que politique. Nous consultons les préfets de nos circonscriptions : jusqu’à la fin du mois de décembre le dispositif a progressé vers sa maturité. Un nombre considérable de perquisitions ont été effectuées, certaines ont été infructueuses, mais beaucoup de choses ont pu être faites, les préfets nous l’ont dit avec franchise : les forces de l’ordre ont pu investir beaucoup de lieux où elles ne pouvaient pas aller auparavant. Ainsi, sous couvert de l’état d’urgence, des affaires de banditisme ou de drogue ont pu être éclaircies, et certains délinquants qui se croyaient ignorés des services de police ont reçu de leur part un sérieux avertissement.
Aujourd’hui, force est de constater que cette courbe des perquisitions tangente toujours plus vers le zéro, car tous les dossiers en souffrance ont été traités. La vraie question est de savoir si un gouvernement sera capable de décider de la fin de l’état d’urgence, car si un attentat survient par la suite, il lui sera reproché. Le Gouvernement actuel peut-il prendre le risque, les forces de l’ordre ayant achevé de vérifier ce qu’il y avait à vérifier, de sortir de l’état d’urgence ? Si un attentat devait subvenir après coup, le Président de la République serait en difficulté.
Mme Christine Lazerges. Des attentats pourraient tout à fait avoir lieu actuellement, sous l’état d’urgence. L’argument de l’Euro 2016 de football ne tient pas, il y aura toujours quelque chose après…
M. Joaquim Pueyo. Je vous sais gré de nous avoir rappelé que les parlementaires ont un rôle et le Gouvernement un autre. Selon vous, le contrôle exercé est-il suffisant ? Comment pourrait-il être renforcé ?
S’il est vrai que les personnes qui font l’objet d’une perquisition, même classique, sont stigmatisées, cela l’est encore plus dans le cadre de la procédure d’urgence, je l’ai constaté dans mon département : les voisins pensent que les intéressés sont des terroristes. Comment réparer un tel préjudice ? La brutalité de la perquisition dépend du contenu de l’information dont disposent les forces de l’ordre : si elles pensent trouver des armes lourdes, elles adapteront leur comportement à cette situation. Par ailleurs, à l’issue de la perquisition, explique-t-on leurs droits aux intéressés ?
Mme Christine Lazerges. On ne leur explique rien du tout, pas plus que l’on ne leur délivre de récépissé.
M. Joaquim Pueyo. Il faudrait le faire, car la notion de juridiction administrative est très vague pour la population. Le juge administratif a beau être indépendant, les confusions sont nombreuses dans les esprits, ainsi que vous l’avez rappelé.
Je souhaite que le Gouvernement produise une évaluation objective des perquisitions administratives. Environ 10 % des personnes perquisitionnées ont fait l’objet de poursuites judiciaires, pas toujours liées au terrorisme : il peut s’agir de trafic de drogue, etc. Nous aurions besoin de cette évaluation avant de nous prononcer sur une éventuelle prolongation de l’état d’urgence. Il faudra pourtant bien en sortir rapidement, car il va y avoir l’Euro 2016, mais aussi le 14 juillet, les festivals estivaux dont certains rassemblent beaucoup de jeunes, et nous ne pourrons vivre éternellement dans l’état d’urgence.
Mme Christine Lazerges. Je rappelle que, dans la procédure judiciaire, la « note blanche » est sans valeur, ce qui pose le problème du fondement des perquisitions, dont certaines sont déclenchées sur la foi de simples rumeurs. Une « note blanche » ne porte ni date ni signature. On va rarement devant le juge administratif, plus rarement encore devant le Conseil d’État. Sur 3 449 perquisitions effectuées, trois ont été déférées devant le juge administratif. Le contrôle est donc inexistant. S’agissant des assignations à résidence, une sur quatre a fait l’objet d’un contrôle. Ce sont 3 449 familles et leurs proches qui sont concernés : à quoi tout cela a-t-il servi ? Les perquisitions devraient procéder d’un document signé par un service, le ministre de l’intérieur nous a indiqué que cela était le cas. La « note blanche » n’est qu’un ramassis de on-dit, dont l’accumulation finit par prendre des allures de preuve.
Mme Gwénaëlle Calvès. Je pensais que la question portait sur deux plans : celui du contrôle portant sur le cas d’espèce, certes, mais surtout celui du contrôle portant sur l’ensemble de la mise en œuvre de l’état d’urgence afin d’en dresser le bilan : à quoi a-t-il servi, quels types d’atteintes aux libertés a-t-il pu y avoir ? C’est cela qui serait nécessaire pour mettre un terme à l’ère du soupçon et de la stigmatisation. Le véhicule pourrait être la notification au Conseil de l’Europe des différentes mesures prises dans ce cadre, puisque l’article 15 de la Convention européenne des droits de l’homme fait obligation à la France de notifier sa décision de recourir à l’état d’urgence et, ensuite, de détailler les décisions prises sur ce fondement.
Un contrôle européen surviendra probablement dans des années, et portera sur des cas particuliers. Ce serait, en revanche, l’occasion pour le Parlement et pour l’opinion de dresser un bilan. Cela faciliterait aussi la sortie de ce dispositif, ce que tout le monde souhaite.
M. le président Dominique Raimbourg. Combien d’incidents vous a-t-on signalés ? Et, s’agissant du contrôle juridictionnel, la procédure devant le tribunal administratif, avec la distinction entre le référé-liberté et l’assignation au fond, n’est-elle pas trop complexe pour le justiciable ?
Mme Christine Lazerges. Nous ne disposons pas d’une comptabilité des « bavures » ou des incidents. Nos informations proviennent de sources diverses, comme le blog de Laurent Borredon, journaliste au Monde, mais aussi des associations. J’imagine que vous allez entendre des associations qui agissent sur le terrain, la LDH étant la plus impliquée.
Mme Gwénaëlle Calvès. En ce qui concerne la procédure de référé et la procédure au fond, ce n’est pas le justiciable qui a à choisir, c’est le plus souvent son conseil. Dans la mesure où ce qui est demandé au juge est de faire usage de son pouvoir d’injonction afin de suspendre ou d’aménager l’assignation, ce sont les procédures d’urgence qui constituent la voie la plus naturelle, et d’ailleurs la plus usitée.
M. le président Dominique Raimbourg. Merci beaucoup pour ce travail et pour vos propos.
——fpfp——
AUDITION DE M. MICHEL TUBIANA, PRÉSIDENT D’HONNEUR DE LA LIGUE DES DROITS DE L’HOMME
Compte rendu de l’audition, ouverte à la presse, du mardi 15 mars 2016
M. le président Dominique Raimbourg. Nous recevons maintenant M. Michel Tubiana, président d’honneur de la Ligue des droits de l’homme (LDH). Nous avons tenu à recevoir cette association particulièrement active dans la recherche d’abus qui auraient pu être commis dans le cadre de l’état d’urgence. La LDH a un avis critique – je ne pense pas trahir votre pensée en disant cela, monsieur le président – sur l’état d’urgence.
Cette audition est publique et filmée.
Comme vous le savez, monsieur le président, la Commission des lois a mis en place un processus de contrôle de l’état d’urgence, considérant qu’il s’agit là d’un état qui sort de l’ordinaire, et elle s’est constituée en commission d’enquête, ce qui a une conséquence formelle : conformément aux dispositions de l’article 6 de l’ordonnance du 17 novembre 1958, je dois vous demander de prêter le serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité.
(M. Michel Tubiana prête serment.)
Je vous laisse la parole pour un exposé introductif.
M. Michel Tubiana, président d’honneur de la Ligue des droits de l’homme (LDH). La LDH n’a pas contesté l’opportunité de la mise en œuvre de l’état d’urgence pendant la période initiale de douze jours, mais elle critique son renouvellement. Je doute de pouvoir vous apporter plus d’informations que vous n’en avez déjà, dans la mesure où nous publions toutes celles que nous détenons lorsque les gens nous autorisent à le faire. Mon intervention va donc porter essentiellement sur les conséquences de ce régime d’exception et les interrogations qu’il suscite.
Par rapport à la première période, nous constatons une certaine amélioration, notamment en ce qui concerne les manifestations et les perquisitions : nous n’avons pas eu connaissance de nouvelles interdictions de manifestation prises en application de l’état d’urgence ; nous n’avons plus de remontées en matière de perquisitions. En revanche, nous enregistrons de très nombreux cas de traumatismes liés aux perquisitions et nous allons faire une espèce de livre noir avec ces témoignages de violences inutiles, d’attitudes totalement dénuées de professionnalisme et de déontologie de la part des intervenants. Dans nombre de cas, ce qui est peut-être le plus grave pour l’avenir, les gens nous décrivent des situations où ils ont été victimes d’un racisme avéré en raison de leur religion – parce que musulmans, comme on peut s’en douter – ou de leur origine.
Nous encourageons bien évidemment ces personnes à déposer des recours en indemnisation. Mais elles se trouvent confrontées à deux difficultés : il n’y a en général aucune trace de réquisition ; elles ont d’autant plus peur d’engager une procédure qu’il est très difficile d’établir le fait au sens juridique du terme. Sur le premier point, on peut dire que dans 90 % des cas, les forces de l’ordre ne laissent trace d’aucune réquisition et qu’il est extraordinairement difficile de les obtenir de la part de la préfecture, sans parler des commissariats qui opposent un silence quasi-permanent.
Depuis l’entrée en vigueur de l’état d’urgence, ce silence est d’ailleurs la marque de fabrique du ministère de l’intérieur, c’est-à-dire place Beauvau et partout ailleurs. La coupure du dialogue avec la société civile est totale et absolue. Nous avons même cessé d’essayer de les joindre parce que nous n’avons plus personne au téléphone. On ne nous rappelle plus. C’est désobligeant, peu démocratique et surtout très contre-productif : des échanges auraient sans doute permis d’éviter beaucoup de problèmes. Je n’en fais pas une crise de dépit – c’est le problème du ministère de l’intérieur – et je dois reconnaître que ce n’est pas la première fois que cela m’arrive. Cela étant, c’est la première fois que cela m’arrive avec cette majorité philosophique, politique. Daniel Mayer a dû vivre ce genre de choses en 1955 et 1956 dans ses activités pour la LDH.
Venons-en au deuxième point. Les gens ont très peur d’engager des procédures car les pratiques violentes qu’ils ont subies agissent comme une intimidation. En outre, les procédures ne pourraient guère être que des recours en annulation de ces perquisitions, dont je ne vois pas trop l’efficacité si ce n’est pour obtenir une indemnisation. Et on se heurte alors aux ressources et aux privilèges de l’État en matière de droit administratif : il faut présenter une demande d’indemnisation préalable et, à ce jour, nous avons au moins trois exemples de rejet par les préfectures.
À l’appui de leur recours en indemnisation, les gens peuvent parfois apporter des preuves visuelles, grâce à des photos prises pendant les perquisitions, ou mêmes auditives quand des smartphones ont été déclenchés. À l’avenir, nous allons voir comment les juridictions judiciaires vont pouvoir être saisies sur le plan pénal pour des faits visant des forces de l’ordre responsables de tels agissements et propos.
Quant aux assignations à résidence, elles suscitent plusieurs interrogations. À ma connaissance, dans au moins trente cas, le ministère de l’intérieur a levé l’assignation à résidence avant que l’affaire ne soit jugée, provoquant ainsi une impossibilité à statuer et reconnaissant ainsi explicitement la situation. La LDH appuie la démarche pénale de cinq personnes qui ont saisi la Cour de justice de la République contre le ministre de l’intérieur lui-même et contre son délégataire devant le doyen des juges d’instruction, c’est-à-dire le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques du ministère devenu depuis directeur de cabinet du garde des sceaux.
Les procédures pénales sont engagées sur le fondement de l’atteinte aux libertés – rien n’a été entrepris pour la prévenir et la faire cesser – mais aussi parce qu’il apparaît au grand jour que la décision a été prise avant tout sur la base de la pratique religieuse de ces personnes. Nous ne soupçonnons pas M. Bernard Cazeneuve ou M. Thomas Andrieu d’un quelconque racisme mais, de fait, après le retrait des arrêtés d’assignation à résidence, le seul point commun à toutes ces personnes est leur religion musulmane.
Le Conseil d’État a exercé une censure que je qualifierais de bienveillante. Sans entamer un débat sur la nature du Conseil d’État, on peut rappeler que 30 % des conseillers et 25 % des maîtres de requêtes sont nommés par décret en conseil des ministres ou par décret du Président de la République, c’est-à-dire par les gouvernements de diverses couleurs. Ce n’est pas le débat à l’ordre du jour de la commission des Lois, mais il faudra un jour s’en préoccuper. Disons que le Conseil d’État et les juridictions administratives de première instance ont pris très peu de décisions négatives, ce qui, selon nous, démontre qu’il n’y a pas de recours réel et effectif contre les décisions du ministre de l’intérieur en matière d’assignation à résidence.
Permettez-moi d’outrepasser mon rôle et de vous interroger sur le nombre d’assignations à résidence maintenues à la suite de la prorogation. Est-ce que vous avez un chiffre ?
M. le président Dominique Raimbourg. Soixante-dix.
M. Michel Tubiana. Je crois qu’il y en avait un peu moins de 400. Qu’est-ce qui justifie que l’on soit passé d’un peu moins de 400 à 70 en trois mois ? Est-ce que la dangerosité de ces personnes se serait évaporée dans l’intervalle ? Est-ce le temps qu’il a fallu au ministère de l’intérieur pour se rendre compte que ses fichiers étaient faux ou pas à jour ? Je ne peux que m’interroger sur un « rapport qualité-prix », si j’ose dire, des mesures prises en vertu de l’état d’urgence. Elles ont un effet d’intimidation mais à combien de procédures antiterroristes importantes ont-elles abouti ? À moins de compter très malhonnêtement les dossiers d’apologie du terrorisme, aucune procédure majeure, réellement importante ou même mineure n’est, à ma connaissance, issue des perquisitions ou des assignations à résidence liées à l’état d’urgence.
Que ces mesures aient aidé les services de police en matière de petits délits de droit commun, de trafics de stupéfiants, voire de détention d’armes, je n’en doute pas. Mais ce n’est pas l’objet initial de l’état d’urgence. J’observe, à cet égard, que cela a été rendu possible et encouragé par le Conseil constitutionnel et le Conseil d’État qui ont, l’un et l’autre, considéré que les dispositions de l’état d’urgence pouvaient s’appliquer même en l’absence de lien entre les faits et les raisons qui ont motivé l’état d’urgence, ce qui a contribué à ouvrir encore davantage les vannes.
Nous paierons collectivement cher les conséquences de cette situation. Comment le dire pour rester mesuré dans le propos ? Nous avons perçu beaucoup de ressentiment de la part d’une partie de la population. Ce sont des gens qui ont souvent fait l’objet de très larges discriminations et qui, maintenant, se sentent collectivement suspects en raison de leur origine ou de leur pratique religieuse. Certains peuvent être poussés dans des dérives, non pas des dérives djihadiste mais de rejet du monde blanc. Ils en viennent à penser que la République est injuste à l’égard de citoyens français considérés comme suspects parce que d’une certaine origine et pratiquant une certaine religion.
La LDH accompagne bon nombre de plaignants dans des procédures qui sont toutes rejetées à l’exception d’un epsilon qui n’est pas négligeable malgré tout. Ce n’est pas suffisant. On aurait pu attendre des autorités politiques qu’elles accompagnent ces situations de discours nets, d’engagements nets, de propos fermes sur l’absence de discriminations, etc. Le silence abyssal du Premier ministre et du ministre de l’intérieur – pour ne pas revenir sur les propos pyromanes tenus par le Premier ministre lors du dîner du Conseil représentatif des institutions juives de France (CRIF) – pèse très lourd dans le mauvais plateau de la balance.
M. le président Dominique Raimbourg. Nous en venons aux questions.
M. Paul Molac. J’aimerais avoir une précision concernant les assignations à résidence. Combien de personnes font-elles l’objet d’une assignation à résidence depuis le début de l’état d’urgence ?
M. le président Dominique Raimbourg. C’est une question de flux et de stock, si j’ose dire, sans vouloir employer des termes qui seraient dépréciatifs s’agissant de personnes. Si j’ai bien compris, soixante-dix personnes précédemment assignées à résidence le sont encore actuellement.
M. Paul Molac. Il n’y en a plus que 70 sur 400, c’est cela ?
M. Michel Tubiana. Le nombre de 400 avait déjà baissé soit sur recours soit d’office.
M. le président Dominique Raimbourg. En effet, ce chiffre correspond à un « flux » ; il n’y a pas eu 400 personnes qui sont restées assignées à résidence jusqu’à la nouvelle prolongation de l’état d’urgence le 26 février dernier.
M. Michel Tubiana. Ce chiffre correspond à un étiage maximum. À ma connaissance, une soixantaine d’assignations avait été levée avant la nouvelle prorogation et il en restait donc quelque 340. Une question reste entière : qu’est-ce qui justifie que 270 aient désormais disparu ?
M. Paul Molac. Je n’ai pas d’autre question mais je me suis interrogé sur la prorogation de l’état d’urgence et, si je me souviens bien, je ne l’ai pas votée.
M. Michel Tubiana. Sauf la première fois.
M. Paul Molac. Je parlais de la prorogation.
M. Michel Tubiana. Le 19 novembre aussi, il s’agissait d’une prorogation.
M. Paul Molac. C’est vrai, après les douze premiers jours. Je n’ai pas voté pour la deuxième prorogation en tout cas, et je m’interroge toujours sur ces mesures dérogatoires. L’effet des perquisitions administratives a pu être bénéfique à un moment donné, au moins pour l’ordre public, mais ce n’est plus le cas. Je peux vous avouer mon trouble face à ces procédures dérogatoires qui durent dans le temps. Pour avoir été professeur d’histoire, je pense qu’il faut quand même s’en méfier. La référence à la justice d’exception mise en place pendant la guerre d’Algérie n’est pas forcément à notre honneur. Nous devons donc faire attention. Je n’ai pas de solution mais je suis un peu troublé par tout cela.
Mme Marie-Anne Chapdelaine. Vous refusez la prolongation de l’état d’urgence, je l’ai bien noté, mais j’aimerais avoir votre avis sur certaines préconisations qui nous ont été faites par des personnes que nous avons auditionnées avant vous. Pour améliorer la procédure concernant les perquisitions, certains suggèrent l’établissement d’un récépissé récapitulant le mode opératoire des policiers, document qui pourrait servir de base à d’éventuelles contestations. On nous a aussi parlé de référés spécifiques pendant l’état d’urgence. Qu’en pensez-vous ?
M. Michel Tubiana. Je peux approuver ces préconisations mais la question qui se pose est celle du maintien, de la justification de l’état d’urgence. Avec ces préconisations, nous sommes dans les modalités d’application. Avez-vous eu connaissance de l’avis rendu, il y a deux jours, par la Commission de Venise ?
M. le président Dominique Raimbourg. J’ai rencontré les experts mais je n’ai pas eu connaissance de l’avis.
M. Michel Tubiana. Le début de cet avis vous fera sans doute plaisir : il y est écrit que la déchéance de nationalité n’est pas, per se, contraire au droit, et qu’il faut constitutionnaliser l’état d’urgence. La suite sera moins plaisante aux yeux du Gouvernement : la Commission de Venise souhaite que l’état d’urgence soit limité dans le temps, précis, encadré par des modalités définies et non pas laissées à l’appréciation du législateur.
Nous sommes dans le cadre de ces garanties. Évidemment, je suis tout à fait preneur de ces garanties, ne serait-ce que pour permettre aux gens d’entamer le minimum des recours, c’est-à-dire le recours en indemnisation. Je ne crois pas trop à l’efficacité du recours en annulation, dans la mesure où les gens vont être confrontés aux inévitables notes blanches du ministère de l’intérieur, auxquelles les juridictions administratives accordent une crédibilité a priori.
Quitte à vous paraître excessif, je vais vous faire part d’une réflexion qui me vient de mon expérience de militant des droits de l’homme très tourné vers la région euroméditerranéenne. À ma connaissance, le seul pays dont les structures sont reconnues comme démocratiques et qui pratique des interventions de cette nature, sans laisser de traces et sans que l’on puisse savoir qui a fait quoi, c’est Israël dans les territoires palestiniens. Considère-t-on que les gens qui sont perquisitionnés en vertu de l’état d’urgence sont des Palestiniens ou qu’ils leur ressemblent ? En tout état de cause, c’est la réalité. Dans un état de droit, il est invraisemblable que quelqu’un ne soit pas en mesure de prouver que des policiers sont venus chez lui.
Tout en étant preneur de ces préconisations, je persiste à penser que la vraie question est celle du maintien de l’état d’urgence, à moins que l’on estime, comme le Premier ministre, que ce régime d’exception doit durer jusqu’à l’éradication de Daech, ce qui nous promet de beaux jours.
M. le président Dominique Raimbourg. La perquisition est nécessairement perçue comme une intrusion brutale dans un domicile qui normalement est protégé. En dehors de cet aspect, avez-vous établi des données sur les violences inutiles ?
M. Michel Tubiana. Nous faisons un recensement par le biais de divers observatoires que nous avons créés, mais nos données n’auront jamais de valeur statistique puisque nous n’avons connaissance que des cas dont les gens veulent bien nous parler. Je crains aussi que nous ne divergions énormément sur la notion de violence inutile. Parlons des perquisitions de nuit, par exemple. Sur ce point, ce n’est même pas la peine de faire des statistiques car toutes les sources d’information convergent, que ce soient les nôtres ou celles de la presse : 98 % ou 99 % des perquisitions ont eu lieu au plein milieu de la nuit. Cela a été la règle, comme si ce qui fait l’objet de recherches ne pouvait être découvert qu’au milieu de la nuit. Rappelons que dans 99 % des cas, on n’a rien trouvé qui ait un lien avec le terrorisme.
Au passage, je signale que le ministère de l’intérieur a diffusé une circulaire visant à rappeler les forces de l’ordre à un minimum de déontologie. Vous n’ignorez pas l’existence de cette circulaire qui, en elle-même, est révélatrice de comportements. Je ne comprends pas l’utilité de systématiquement défoncer une porte, le comble ayant été atteint lors de la perquisition d’un restaurant dont vous avez probablement vu la vidéo. Le propriétaire a beau dire que la porte est ouverte, le bélier l’enfonce quand même ! On finit par en rire, mais le restaurateur ne devait pas trouver cela très drôle.
Il faut partir du principe que la vie des policiers était en danger à chaque perquisition pour considérer que toutes les violences de ce type-là étaient légitimes. En tout cas, il est une violence totalement illégitime, dont nous avons recensé une bonne vingtaine de cas : les injures racistes. Ces affaires aboutissent difficilement quand il n’y a que la parole des uns contre celle des autres.
M. le président Dominique Raimbourg. Nous avons des données divergentes pour les perquisitions de nuit, puisque nous sommes grosso modo à 50 %, c’est-à-dire à une perquisition sur deux.
M. Michel Tubiana. Ce n’est pas ce qui nous est remonté.
M. le président Dominique Raimbourg. Quand nous interrogeons les préfectures sur ce point, elles nous expliquent qu’il faut intervenir tard dans la soirée ou tôt le matin, de façon à trouver des gens au domicile. Mais ce pourcentage est élevé.
Vous nous avez dit que vous ne contestiez pas la décision d’instaurer l’état d’urgence. Selon vous, à quel moment a-t-il cessé d’être utile ? Est-ce que la première prolongation vous a semblé opportune ? Considérez-vous, au contraire, que les douze premiers jours étaient suffisants ?
M. Michel Tubiana. Nous avons considéré que la première prorogation était injustifiée et qu’elle allait entraîner ce qui s’est produit. Ce point-là peut être discuté, je le concède. En revanche, beaucoup de choses sont indiscutables.
Lorsque les mesures ont été mises en œuvre, on a enlevé un arbre – les dispositions sur la presse qui figuraient initialement dans la loi de 1955 – mais on a laissé le reste de la forêt, c’est-à-dire l’élimination de l’intervention judiciaire. Souvenez-vous des premières décisions des tribunaux administratifs. Le jour où l’on en fera une anthologie, ce ne sera pas à l’honneur de la juridiction administrative ! Nous avons ainsi eu droit à : « il n’y a pas d’urgence », « vous ne justifiez pas de l’urgence » et « si vous ne pouvez plus aller faire vos courses pendant trois mois, ce n’est pas vraiment gênant. » Avec l’aval du Conseil d’État, ces mesures ont été appliquées à des militants qui n’avaient rien à voir avec les motifs de l’état d’urgence.
Tout cela nous a démontré que le système ne permettait pas un contrôle. Si nous avons pris position contre la prorogation de l’état d’urgence, ce n’est pas par principe ; nous l’avons fait parce que nous estimions qu’il n’y avait pas de contrôle pour tout ce qui touchait aux libertés individuelles, qu’il n’y avait pas de contre-pouvoir suffisant sur ce terrain-là.
Quant à la deuxième prorogation… Permettez-moi de regretter que l’Assemblée nationale se soit laissée aller à renouveler une deuxième fois un état d’urgence qui n’a plus la moindre justification si ce n’est le confort politique du Gouvernement pour faire adopter le projet de loi de réforme de la procédure pénale. J’espère d’ailleurs que, cette fois-ci, vous nous auditionnerez sur ce projet de loi, ce qui n’a pas été le cas la première fois.
M. le président Dominique Raimbourg. Pour des raisons d’urgence.
M. Michel Tubiana. Ah ça, je ne doute pas que l’urgence soit le maître mot de toute cette affaire !
M. le président Dominique Raimbourg. Disons pour des raisons de calendrier, si vous préférez.
Je peux aussi vous apporter une précision puisque j’ai le pourcentage exact des perquisitions nocturnes : 50,4 %.
M. Michel Tubiana. Qu’est-ce qu’ils entendent par nocturne ?
M. le président Dominique Raimbourg. Ce sont les perquisitions qui ont lieu entre vingt et une heures et six heures du matin.
M. Michel Tubiana. Beaucoup de gens dorment à six heures cinq du matin.
M. le président Dominique Raimbourg. C’est vrai, mais l’horaire retenu correspond à la définition légale de la nuit.
Revenons un instant à la discussion sur la protection offerte par le juge administratif ou le juge judiciaire. Ne touche-t-on pas là au problème de la note blanche et du contrôle a posteriori par un juge administratif, là où le juge judiciaire exigerait un contrôle a priori. Mais le contrôle a priori n’est-il pas trop lent dans certaines circonstances ?
M. Michel Tubiana. Quand on veut assassiner son chien, on dit qu’il a la rage : il suffit de ne pas donner les pouvoirs et les moyens nécessaires à la justice française pour pouvoir lui reprocher sa lenteur. J’ai soixante-quatre ans et je suis avocat depuis 1974, c’est-à-dire depuis plus de quarante ans, et je dois même pouvoir faire valoir mes droits à la retraite. Depuis que je suis dans la profession, j’ai entendu chaque garde des Sceaux, l’un après l’autre, dire qu’il allait remédier aux problèmes matériels de la justice. Tous l’ont dit, quelle qu’ait été leur couleur politique.
Je suis d’accord avec vous : cela aurait probablement été un problème, mais un problème matériel et non pas juridique. S’il y avait eu une volonté politique de faire fonctionner l’institution judiciaire, la question ne se serait pas posée, y compris en cas de débat réellement contradictoire. Dans le projet de loi que vous avez adopté, vous avez encore utilisé ce malheureux juge des libertés et de la détention (JLD) comme éternel alibi. Dans les grandes juridictions, le JLD joue un rôle tout à fait intéressant en ce qui concerne les questions de détention. Pour le reste, nous sommes dans une farce : le parquet va voir un homme ou une femme qui n’a connaissance d’aucun dossier, qui est censé en prendre connaissance dans les cinq minutes, et qui, sur requête du parquet, doit, en son for intérieur, être à la fois juge et avocat, et, par conséquent, décider des mesures d’exception qui sont prévues.
On pourrait imaginer qu’il y ait, comme cela existe dans un certain nombre de juridictions américaines, un avocat commis d’office par le bâtonnier et n’ayant pas de droit de suite sur les affaires, qui joue le rôle du contradicteur du parquet. Cela peut très bien s’organiser, à condition de le vouloir et d’avoir une vision claire de ce qu’est la défense des libertés. C’est une question de volonté politique.
Chacun des ordres juridictionnels a des cadavres dans son placard. Pour faire vite, rappelons qu’un seul magistrat de l’ordre judiciaire, Paul Didier, n’avait pas prêté serment au maréchal Pétain sous l’Occupation. Quant au Conseil d’État, il a rendu un certain nombre d’arrêts, qu’on lui rappelle douloureusement, sur la meilleure manière d’appliquer le statut des Juifs et sur qui était juif, sans se poser deux minutes la question de la légitimité du texte.
Dans les recueils de jurisprudence, il n’y a qu’un seul arrêt du Conseil d’État concernant vraiment les libertés : l’arrêt Canal. C’est d’ailleurs un arrêt important, mais c’est le seul. Quitte à me répéter, j’insiste sur la composition du Conseil d’État où 30 % des conseillers et 25 % des maîtres des requêtes sont nommés par le pouvoir politique. Un jour ou l’autre, la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH), je vous le promets bien, aura à se prononcer sur la question de l’indépendance et de l’impartialité de cette juridiction. Qu’on le veuille ou non, cette juridiction n’a pas une culture de protection de libertés. Regardez les décisions des tribunaux administratifs ! Elle a une culture de protection de l’État. Vous savez comme moi que, jusque dans les années 1920, le Conseil d’État a mis en œuvre la théorie des actes de gouvernement qui consiste à dire : on applique et on ne dit rien.
Dans ce contexte, le degré de protection offert par le Conseil d’État ne me paraît ni réellement crédible ni réellement suffisant. Je ne mets pas en cause l’honnêteté intellectuelle des hommes ou des femmes qui le composent ; ce n’est pas une question d’intérêt. Mais la pratique démontre que cette protection ne suffit pas. Pour contredire mon propre propos, je vous invite à lire l’avis de la Commission de Venise où il est écrit que le contrôle du Conseil d’État est suffisant.
M. le président Dominique Raimbourg. Merci de votre objectivité. S’il n’y a pas d’autres questions, il me reste à vous remercier d’avoir participé à cette audition.
——fpfp——
AUDITION DE M. JACQUES TOUBON, DÉFENSEUR DES DROITS
Compte-rendu de l’audition, ouverte à la presse, du mardi 22 mars 2016
M. le président Dominique Raimbourg. Nous avons le plaisir d’accueillir M. Jacques Toubon, Défenseur des droits, venu avec deux de ses adjoints, Mme Claudine Angeli-Troccaz, chargée de la déontologie de la sécurité, et M. Patrick Gohet, chargé de la lutte contre les discriminations et de la promotion de l’égalité. Sont également présents M. Bernard Dreyfus, délégué général à la médiation avec les services publics, et M. Richard Senghor, secrétaire général.
Nous entendons normalement le Défenseur des droits à l’occasion de la parution de son rapport annuel d’activité. L’année 2015 a été, monsieur Toubon, votre première année d’activité complète puisque vous avez succédé à M. Baudis en juillet 2014.
Les relations entre nos deux institutions sont intenses : l’an dernier, vous avez été entendu pas moins de 29 fois par le Parlement. C’est dire que votre expression n’est pas entravée ; au contraire, elle suscite toujours ici même un grand intérêt.
Les questions que nous vous poserons porteront naturellement sur votre bilan, sur l’ensemble des sujets que vous abordez dans le rapport, mais également sur l’état d’urgence. Notre commission, instituée en commission d’enquête pour procéder au contrôle parlementaire de l’état d’urgence, a en effet examiné les réclamations dont vous avez été saisi à ce propos et qui sont pour nous un matériau essentiel à l’heure où nous préparons notre rapport.
M. Jacques Toubon, Défenseur des droits. Merci de me donner une nouvelle occasion de m’exprimer devant votre commission tout entière. Depuis le début de cette année, j’ai par ailleurs été consulté une dizaine de fois par les deux chambres, principalement par les commissions des lois et leurs rapporteurs, à propos de textes en discussion. La présentation annuelle de mon rapport d’activité fait désormais partie de nos usages. Il a en effet été convenu avec votre prédécesseur, M. Jean-Jacques Urvoas, puis avec vous-même, monsieur le président, que nous ferions le point sur l’activité du Défenseur des droits deux fois par an au total, dont une fois, en début d’année, à propos du rapport d’activité pour l’année précédente.
J’ai bien conscience du fait qu’une telle audition peut sembler décalée dans un contexte dominé par la violence, la peur et la volonté de sécurité. Mais la mission du Défenseur des droits contribue au maintien de la cohésion sociale et au renforcement de l’appartenance à la République, avec les droits et libertés que celle-ci confère à tous ; or ce sont là les seules réponses de fond et durables à la double menace que représentent la terreur imposée de l’extérieur et la division interne dans laquelle on voudrait nous entraîner.
C’est ce que j’ai dit dès les attentats de janvier 2015 aux agents du Défenseur des droits rassemblés pour une minute de recueillement : notre responsabilité allait être plus lourde, plus difficile, plus pressante. J’ai essayé de l’exercer en prenant le risque de m’exposer sur des sujets et dans des débats qui étaient tout sauf consensuels. Car, pour moi, le droit n’est pas une théorie : c’est une action. Et c’est, pour une nation comme la France, un principe absolu, une structure essentielle de la société.
Dans les petites choses comme dans les grandes, notamment celles qui relèvent de la décision du pouvoir politique, nous avons été entendus, écoutés quelquefois, suivis ou critiqués. Les mesures sécuritaires, les enfants à Calais, le droit d’asile, la déontologie des forces de sécurité, les discriminations : sur ces différents sujets, j’ai fait entendre notre voix, j’ai pris des décisions et formulé des recommandations, en toute indépendance, et j’en ai rendu compte, comme je vous en rends compte aujourd’hui. À vous de décider de me soutenir si je suis mis en cause. Quand, il y a un an et demi, vous avez largement ratifié ma nomination par le Président de la République, je vous ai dit que je serais indépendant – c’est mon statut –, impartial – c’est notre méthode –, libre – c’est mon tempérament. J’ai tenu parole.
Voici ce qu’a été le Défenseur des droits en 2015. D’abord, 240 à 250 agents au siège national, essentiellement des experts juristes ; à la date de la semaine dernière, 417 délégués territoriaux – nous avons commencé à en accroître le nombre, puisqu’ils étaient 372 il y a un an et demi, et j’espère qu’ils seront 500 début 2017. Notre institution est jeune : elle a commencé à fonctionner en juin 2011. Nous avons reçu au cours de l’année 120 000 demandes dont vous trouverez le classement détaillé dans les tableaux intégrés au rapport et qui, en gros, se répartissent en trois catégories. Le premier tiers correspond à des demandes de renseignement que nous réorientons. Le deuxième, à des demandes que nous accueillons, traitons et réorientons en travaillant sur l’accès aux droits. Sur le tiers restant, 50 000 dossiers environ relèvent de la médiation avec les services publics : c’est le lot quotidien du Défenseur des droits. En particulier, les questions de protection sociale et de mise en œuvre des droits sociaux représentent 40 % de toute l’activité de médiation avec les services publics.
Nous allons connaître cette année une mutation importante : alors que nous avions jusqu’à présent deux implantations, rue Saint-Florentin et rue Saint-Georges, nos locaux doivent être réunis à l’automne place de Fontenoy, dans des bureaux actuellement en cours de rénovation par les services du Premier ministre. Dans la partie des bâtiments qui donne place de Fontenoy seront installés dès la fin 2016 la CNIL, d’une part, et le Défenseur des droits, de l’autre. Un an plus tard, en 2017, l’immeuble Ségur accueillera toute une série d’autorités indépendantes qui dépendent du point de vue administratif et budgétaire des services du Premier ministre.
À cette occasion, nous procéderons à des mutualisations de services communs et de fonctions support. Voilà pourquoi nous avons dès à présent simplifié notre structure. Depuis 2011, nous avions un secrétaire général, responsable des fonctions métier, et un directeur général, responsable des fonctions support. Celles-ci étant appelées à se réduire considérablement, nous avons supprimé il y a quelques jours le poste de directeur général des services – l’intéressé, conseiller maître à la Cour des comptes, vient d’être nommé secrétaire général du Conseil économique, social et environnemental – et nous sommes en train, dans des conditions que j’aurai certainement l’occasion de vous exposer avant la fin de l’année, de réorganiser et de rationaliser la structure des fonctions métier, notamment en réduisant le nombre de directions concernées.
Le travail du Défenseur des droits consiste naturellement à prendre en considération toute la demande sociale lorsqu’il s’agit de mettre en œuvre des droits et libertés qui ne sont pas suffisamment effectifs. Au-delà des chiffres que vous trouverez dans le rapport, ce travail est donc difficile à résumer. J’ai mentionné l’importance des droits sociaux, mission prenante et prioritaire de notre maison. Vous avez tous entendu parler dans les médias de l’action que nous avons menée pour accélérer la liquidation des droits des retraités et le versement de leur pension, retardés par l’embolie de certaines caisses régionales d’assurance vieillesse du régime général. Vous avez également discuté du blocage du régime social des indépendants (RSI), qui a fait l’objet d’une mission parlementaire. En la matière, nous avons non seulement traité les cas qui nous étaient soumis, mais formulé des propositions et des recommandations de réformes, non sans résultat : Mme Marisol Touraine, ministre des affaires sociales, a fait publier fin août 2015 un décret prévoyant un dispositif de liquidation provisoire. Pour l’instant, ce dispositif ne bénéficie qu’aux assujettis à l’assurance vieillesse du régime général, mais il sera étendu aux autres régimes en 2017.
En 2015, j’ai beaucoup mis l’accent sur ce qu’il est convenu d’appeler la « fracture numérique ». L’utilisation des nouvelles technologies, qui se développe dans les services de l’État comme dans les collectivités territoriales, est souhaitable, notamment parce qu’elle permet de réaliser des économies dans les administrations et établissements publics, mais elle n’est pas également accessible à tous. On considère généralement que, pour 20 à 25 % des personnes qui vivent en France, il est difficile, voire impossible, de recourir aux procédures numérisées. Nous avons donc demandé – et nous nous battons pour obtenir satisfaction auprès du Sénat, devant lequel se trouve le projet de loi pour une République numérique – que soit inscrit dans la loi ce principe : lorsque l’on passe à des procédures numérisées, on continue d’offrir une alternative papier ; et si, pour telle ou telle raison, ce n’est pas possible, un service d’accompagnement et de médiation est obligatoirement mis à la disposition des usagers. Le ministère des finances semble désireux de le faire s’agissant de la déclaration des revenus en ligne. Mais on nous dit, certaines associations notamment, que ces procédures numérisées présentent des difficultés. Nous devons parvenir à les résoudre. Je le dis devant la commission des Lois, car les droits – vous le savez mieux que moi, monsieur le président –, c’est d’abord l’accès aux droits et la possibilité de s’en prévaloir.
L’année dernière, nous avons aussi fortement agi pour lutter contre les discriminations et promouvoir l’égalité. Nous remportons des succès, dont certains sont spectaculaires, comme dans le cas de ce cadre d’une grande banque qui, au bout de dix ans de procédure, a obtenu plus de 400 000 euros de dommages et intérêts car il avait été maltraité en raison de son état de santé et de son handicap. Dans des affaires plus courantes aussi, nous parvenons à démontrer des discriminations, soit par nous-mêmes, soit en présentant des observations devant les juridictions au titre de l’article 33 de la loi organique relative au Défenseur des droits.
Ainsi, le projet de loi égalité et citoyenneté, un texte important que le Gouvernement a transmis au Conseil d’État et qui sera présenté dans quelques semaines en Conseil des ministres, puis au Parlement, comporte dans son titre III des mesures qui tendent à améliorer la loi de 2008 sur les discriminations et qui résultent de propositions que nous avons formulées afin de rééquilibrer le dispositif. Jusqu’à présent, en effet, en matière d’accès aux biens et aux services, on ne pouvait alléguer les critères de discrimination par la voie civile : seule était ouverte la voie pénale, qui est très ardue car la preuve est particulièrement difficile à établir et les procureurs sont très réticents à s’engager dans ces affaires. Je vous signale ces dispositions car elles seront, selon toute vraisemblance, défendues ici par le ministre de la justice – à l’instar, dans le cadre de la réforme dite « J21 » que vous aurez bientôt à examiner et sur laquelle je vous donnerai prochainement mon avis, de l’action collective contre les discriminations, mesure essentielle.
En ce qui concerne les discriminations, nous ne sommes pas suffisamment saisis. Les situations de discrimination sont beaucoup plus nombreuses et plus graves que ne le laisse croire le nombre de recours – environ 5 000 – que nous recevons chaque année. Voilà pourquoi, dans le cadre de notre action de promotion de l’égalité, nous avons décidé de réaliser cette année une grande enquête en population générale – 5 000 personnes seront interrogées – pour tenter de déterminer l’origine du non-recours, dans toutes nos compétences mais spécialement en matière de discrimination. Ce qui est en jeu, c’est le sentiment qu’éprouvent certaines personnes ou populations vulnérables ou démunies que la République et les droits qu’elle octroie sont pour les autres. C’est terrible dans un pays comme le nôtre. Nous devons redonner confiance dans la République, dans les institutions, dans les administrations et, pour cela, traiter la question du non-recours.
Ces difficultés touchent particulièrement les étrangers qui viennent en France ou qui y vivent, en situation régulière ou irrégulière. J’ai présenté le 6 octobre dernier un rapport complet sur Calais qui a été diversement apprécié. Il montrait l’écart entre les droits fondamentaux de toute personne, y compris les migrants, spécialement les enfants et parmi eux les mineurs non accompagnés, et la situation réelle. Je continuerai sur cette voie, et je présenterai en avril ou en mai un rapport général sur le respect des droits des étrangers dans notre pays. C’est évidemment une question d’actualité, l’une des principales qui se posent aujourd’hui à l’Europe. C’est aussi, en particulier eu égard au tout récent accord entre l’Europe et la Turquie, une question de droit.
Nous avons également accordé une grande attention à la situation des handicapés. Le 11 février 2015, nous avons célébré le dixième anniversaire de la loi de 2005 et dressé le bilan de son application. Il y a incontestablement des avancées, en particulier la scolarisation des enfants handicapés dans les écoles élémentaires, les collèges et les lycées de droit commun plutôt qu’au sein d’établissements d’enseignement spécialisé. Mais il existe encore bien des difficultés et – je le dis à l’intention des nombreux élus départementaux ici présents – trop de différences de fonctionnement entre les maisons départementales des personnes handicapées (MDPH), innovation de la loi de 2005. J’en parlerai avec le bureau élargi de l’Assemblée des départements de France que je rencontrerai la semaine prochaine, répondant à l’invitation du président Bussereau. La décentralisation est un acquis au sein de nos institutions et le pouvoir des élus locaux s’exerce aujourd’hui dans des domaines déterminants, mais nous devons prendre garde de ne pas favoriser les inégalités entre les personnes, surtout entre les enfants, selon l’endroit où ils vivent sur notre territoire. Le problème se pose aussi particulièrement outre-mer.
Nous avons abordé cette question d’une autre façon, qui est passée inaperçue, car c’était malheureusement une semaine après les attentats du 13 novembre. Lors de la journée internationale des enfants, le 20 novembre – date anniversaire de la signature de la Convention internationale des droits de l’enfant –, nous avons présenté un rapport sur les enfants handicapés pris en charge par l’Aide sociale à l’enfance (ASE), et qui sont à ce double titre concernés par les décisions des présidents des conseils départementaux. Ces enfants – 70 000 selon les estimations – subissent une forme de double peine ; leur prise en charge est très mal assurée. Nous avons formulé plusieurs recommandations à ce sujet, dont j’espère que Mme Neuville et Mme Rossignol les prendront en considération.
J’en terminerai par un domaine très sensible dans le contexte actuel : la déontologie de la sécurité, en particulier lors des contrôles d’identité. Vous le savez, la cour d’appel de Paris a rendu à ce sujet en juin 2015 des décisions qui introduisent un élément très novateur dans ce contentieux : pour cinq des plaignants, elle a estimé que les contrôles dont ils avaient fait l’objet étaient discriminatoires, portaient atteinte à leurs droits fondamentaux, et jugé qu’ils devaient être indemnisés par l’État. L’été dernier, le procureur général de Paris a présenté un pourvoi devant la Cour de cassation ; celle-ci va donc créer une jurisprudence dans ce domaine. Quoi qu’il en soit, dans cette affaire, nous avions présenté des observations devant la cour d’appel et nous avons été d’une certaine façon suivis. Nous l’avons dit au sujet de la proposition de loi Savary sur la sécurité dans les transports comme du projet de loi renforçant la lutte contre le crime organisé : pour garantir les droits fondamentaux des intéressés, il nous paraît nécessaire d’assurer la traçabilité des contrôles d’identité et la possibilité d’un recours.
Tout cela, nous l’avons fait en étroite concertation avec les organes parlementaires, au Sénat comme à l’Assemblée nationale. Nous avons donné de nombreux avis, le plus souvent sollicités, mais pas toujours. Nous avons souvent remarqué que les parlementaires défendaient, avec plus ou moins de succès, des amendements inspirés de nos propositions. Nous nous efforçons d’introduire dans les débats parlementaires des éléments de technique juridique, en particulier les jurisprudences ou les prescriptions des conventions internationales : la Convention de Strasbourg, la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les grandes conventions de l’ONU sur les enfants, les personnes handicapées, les droits des femmes ou la traite des êtres humains.
Nous avons également beaucoup travaillé avec les juridictions. L’an passé, nous avons ainsi présenté, au titre de l’article 33 de la loi organique, une centaine d’observations devant elles, à tous les niveaux, du plus modeste tribunal des affaires de sécurité sociale ou conseil des prudhommes jusqu’à la Cour européenne des droits de l’homme.
Nous nous sommes aussi très fréquemment appuyés sur des partenariats avec la société civile. Dans notre action, rien n’est fait en chambre, en théorie, encore moins par idéologie. Nous travaillons avec les associations, les administrations, les membres de nos collèges – dont une partie a été nommée par le président de l’Assemblée nationale, celui du Sénat, celui de la Cour de cassation ou par le vice-président du Conseil d’État, et que nous consultons tous les mois et demi environ à propos de nos décisions – et les membres des comités d’entente ou de liaison, au nombre de huit à dix, que nous réunissons deux fois par an et qui nous informent des besoins de la société.
Ces partenariats existent aussi à l’échelle européenne et internationale. Ainsi, le Défenseur des droits est très actif au sein de l’Association des ombudsmans et médiateurs de la francophonie, laquelle joue un rôle très utile, en particulier pour faire progresser les droits fondamentaux sur le continent africain. Nous avons aussi une Association des ombudsmans méditerranéens qui prend toute sa valeur avec la crise des migrants. S’y ajoutent, au niveau européen, le réseau des organismes de promotion de l’égalité et de lutte contre les discriminations (EQUINET), le réseau des défenseurs des enfants (ENOC) et l’association des médiateurs, dont le médiateur de l’Union européenne lui-même, placé auprès de la Commission. À ce propos, veuillez excuser l’absence de Geneviève Avenard, Défenseure des enfants, qui s’est notamment occupée de la question des enfants à Calais.
Il y a quelques jours a été publié un rapport du CRÉDOC (Centre de recherche pour l’étude et l’observation des conditions de vie), organisme parfaitement crédible, selon lequel « un Français sur deux se dit confronté personnellement à des difficultés importantes invisibles des pouvoirs publics ou des médias ». Cette observation rejoint ce que je vous disais du non-recours : il existe un écart entre les situations réelles, marquées par les inégalités et les injustices, et les recours. Les personnes dont parle ce rapport sont invisibles ou se rendent invisibles car elles ne veulent pas se signaler. Tout cela constitue un ferment extrêmement dangereux pour notre pays. Car celui-ci se caractérise par une religion de l’égalité, une volonté de justice, et si une partie importante de notre population a l’impression que la République ne tient pas ses promesses, qu’elle ne lui rendra pas la justice, ne lui garantira pas l’effectivité des droits qu’elle attend, cela menace notre cohésion sociale.
En ce qui concerne l’état d’urgence, mon action a été double. En collaboration avec les commissions des Lois de l’Assemblée nationale et du Sénat, et ici même à l’instigation de votre ancien président Jean-Jacques Urvoas, j’ai accepté, en toute indépendance, de porter à votre connaissance, pour contribuer au contrôle parlementaire institué par la loi du 20 novembre 2015, toutes les informations dont nous disposons depuis que, le 23 novembre, j’ai décidé d’ouvrir la porte de nos délégués, et du Défenseur des droits en général, aux réclamations des victimes des mesures de l’état d’urgence ou de personnes qui se jugent telles. Nous avions reçu à la date d’hier 79 réclamations, que nous sommes en train d’instruire et dont j’ai eu l’occasion de dresser un bilan le 26 février dernier, c’est-à-dire à la date d’échéance de la première prorogation de l’état d’urgence. Je ne reviens pas sur ce rapport au Parlement qui contient tous les éléments quantitatifs et d’appréciation qualitative.
Voici les principales observations que l’on peut en tirer. Premièrement, les mesures qui ont été prises – perquisitions, assignations à résidence, etc. – peuvent créer un climat de suspicion, de délation ou une atmosphère délétère, au détriment des personnes qui en ont fait l’objet, dans la plupart des cas à tort, ou qui en ont subi des dommages tels que la perte de leur emploi. Aujourd’hui, au bout de quatre mois, le Gouvernement, en particulier le ministère de l’intérieur, et le Parlement qui le contrôle sont peut-être plus à même qu’au début de tirer les leçons de l’expérience et de fixer quelques prescriptions ou orientations pour la mise en œuvre de ces mesures.
Deuxièmement, nous avons constaté un déficit particulier de prise en considération de la situation des enfants, pourtant essentielle du point de vue du Défenseur des droits. Hélas, dans les textes adoptés depuis lors, notamment pour procéder à la deuxième prorogation – j’espère que ce sera la dernière – de l’état d’urgence, mes propositions sur la manière de traiter les enfants, en particulier au cours des perquisitions de nuit, n’ont pas été retenues. Les amendements en ce sens au projet de loi renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale ont en effet été rejetés pour des raisons dites « opérationnelles » ; je le regrette.
Troisièmement, il est très difficile à une personne qui a fait l’objet d’une telle mesure de réclamer une indemnisation. Selon la circulaire publiée par le ministre de l’intérieur en novembre, cela suppose en effet de se référer à la jurisprudence administrative de la faute lourde du service public ; il n’existe pas de disposition spécifique et plus expédiente destinée à l’indemnisation. En particulier, toute perquisition ne se solde pas par la remise d’un procès-verbal qui pourrait servir de base à la réclamation. Je pense pour ma part que remédier à cette situation ne nuirait en rien à l’efficacité des mesures et que ce serait justice vis-à-vis de ceux qui ont subi des dommages matériels considérables – vous connaissez les cas spectaculaires qui ont été médiatisés.
Quant au fond des mesures, permettez-moi de citer ici les propos de votre ancien président lorsqu’il a présenté au nom de votre Commission son second rapport sur la mise en œuvre de l’état d’urgence : le droit d’exception, disait-il en substance, ne devrait pas devenir le droit ordinaire ; pour reprendre son expression imagée, les lois « gloutonnes » de l’état d’exception ne doivent pas dévorer le droit commun. Or aujourd’hui, deux mois plus tard, il est clair que nous y sommes. Ainsi, dans le projet de loi constitutionnelle de protection de la Nation tel qu’il a été adopté par l’Assemblée nationale, comme dans le projet de loi renforçant la lutte contre le crime organisé, des dispositions extrêmement restrictives de libertés qui pouvaient, de notre point de vue de défenseur des libertés, se concevoir dans une période limitée et au titre d’un droit d’exception, deviennent le droit commun. Je songe aux mesures que vous avez votées et qui vont être examinées par le Sénat à la fin du mois concernant la retenue administrative, le contrôle administratif des voyageurs ou les dispositions relatives à l’usage des armes par les forces de sécurité.
À propos de ces textes, nous avons dit ce que le Défenseur des droits peut légitimement déclarer en application des principes de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme ou du Conseil constitutionnel : ces mesures sont susceptibles d’affaiblir l’État de droit et les libertés que nous connaissions jusqu’à présent. J’ai livré notre analyse de ces dispositions, expliqué en quoi, de notre point de vue, elles restreignent les libertés et pourquoi nous pensons que le Parlement et l’ensemble des décideurs politiques devraient se demander s’ils veulent vraiment, dans l’équilibre délicat entre les exigences légitimes de sécurité et la garantie du respect des libertés, déplacer le curseur du côté de la sécurité.
Telle est notre position. Je l’ai dit ici comme au Sénat et à sa commission des Lois. Nous sommes à la croisée des chemins. Nous tous, et surtout les députés et sénateurs membres de la commission des Lois de chaque assemblée, nous devons nous demander quelle philosophie juridique et des libertés nous voulons préserver. Les circonstances nous conduisent-elles légitimement à faire évoluer cette philosophie, ou est-ce en défendant la liberté et les droits humains fondamentaux que nous devons nous battre contre ceux qui nous assassinent et qui veulent assassiner nos libertés ?
J’ai dit que la déchéance de nationalité telle qu’elle était proposée ne me paraissait pas correspondre aux principes républicains. Si elle ne concerne que les binationaux, comme dans la version du Sénat, elle est contraire à l’article 1er de la Constitution selon lequel notre citoyenneté et notre nationalité sont indivisibles, de même que la République. Si elle concerne tous les Français, y compris ceux qui sont nés français, elle se heurte à l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 qui garantit les droits fondamentaux à tout homme et à toute femme du jour de sa naissance, sans quoi notre société n’aurait point de Constitution, comme on disait à l’époque ; l’on ne saurait y revenir.
De toute façon, en vertu de la non-rétroactivité des mesures de procédure pénale plus dures, ces textes ne s’appliqueraient pas à ceux des terroristes que nous voudrions juger pour les assassinats des 7, 8 et 9 janvier 2015 ou du 13 novembre dernier.
M. Patrick Lebreton. Merci de me permettre de m’exprimer dans cette commission dont je ne suis pas membre.
Monsieur le Défenseur des droits, depuis plusieurs années, votre institution se développe dans les outre-mer et accorde une attention particulière aux discriminations spécifiques dont les Français qui en sont originaires peuvent être victimes. Je n’ai toutefois pas trouvé trace dans le présent rapport du problème du cautionnement pour la location de logements dans l’Hexagone, qui était présenté comme un combat pour les droits des ultramarins dans le rapport annuel 2012. Il est malheureusement très courant que les gestionnaires de biens et propriétaires privés hexagonaux refusent un logement à un candidat au motif que la personne qui se porte caution se trouve outre-mer. Cette discrimination frappe avant tout nos étudiants et nos jeunes travailleurs qui font le pari de venir dans l’Hexagone pour se former ou pour entreprendre leur insertion professionnelle. Le Défenseur des droits indiquait dans son rapport avoir adressé des recommandations au ministère du logement pour mettre fin à cette discrimination. Cette action a-t-elle été suivie d’effets ? Si oui, lesquels ?
M. Patrick Mennucci. Monsieur le Défenseur des droits, vous venez de nous faire part de votre position sur l’état d’urgence à peu près dans les mêmes termes que le 26 février, lors de votre conférence de presse. Vous aviez alors alerté au sujet d’un « régime de police administrative qui limite l’intervention du juge […], restreint les libertés et réduit les garanties, pour des périodes reconductibles pouvant s’inscrire dans le long terme ». Je dois vous dire que je n’ai pas beaucoup apprécié cette phrase – il est vrai que vous n’êtes pas là pour faire plaisir –, qui ne me paraît pas refléter l’action menée par le Parlement et le Gouvernement ni nos efforts à tous pour lutter contre le terrorisme. À cette occasion, vous avez même critiqué, comme vous venez de le faire à nouveau, le deuxième texte antiterroriste que le Premier ministre a cité cet après-midi lors des questions au Gouvernement. Je suis un peu surpris. J’ai beaucoup de respect pour vous ; j’étais là lorsque notre Commission vous a auditionné en vue de votre nomination et j’ai fait totalement confiance au Président de la République qui proposait de vous nommer. (Rires.)
M. Jacques Toubon. Merci !
M. Patrick Mennucci. Je vous en prie. Cela m’autorise sans doute, avec tout le respect que je vous dois, à vous parler comme je le fais. Il me semblait que vous étiez chargé du contrôle, et de la critique lorsque les droits existants ne sont pas garantis. En quoi les mesures résultant de l’état d’urgence, ou le texte sur la criminalité organisée que l’Assemblée vient de voter et qui est en cours de navette – à ce propos, il faudrait prévenir Mme Kosciusko-Morizet, qui semblait l’ignorer tout à l’heure lors des questions au Gouvernement, que nous avons, dans ce cadre, porté la période de sûreté de vingt-deux à trente ans pour les crimes terroristes –, bref les lois et règles qui ont été adoptées, en totale conformité avec la Constitution et avec les pratiques républicaines, vous posent-ils un problème ?
Je ne mets nullement en cause votre rapport sur l’état d’urgence, qui est factuel et se borne à reprendre des déclarations. Encore faut-il préciser que celles-ci ne sont pas toujours vérifiées : il n’y a pas eu d’enquête pour confirmer les propos prêtés à des gendarmes et, que je sache, la police des polices n’a pas été saisie du cas où des policiers sont censés avoir justifié la perquisition par le fait que l’intéressé était vêtu de noir ou portait une barbe ! Il est un peu surprenant que ces propos allégués soient retranscrits de manière aussi abrupte dans votre rapport.
Quoi qu’il en soit, il est tout à fait légitime que le Défenseur des droits alerte sur des cas où le déroulement des perquisitions ne garantirait pas le respect de la personne humaine ou ne tiendrait pas compte de la présence d’enfants. Le problème n’est donc pas le contenu du rapport, mais la philosophie générale de votre action. Considérez-vous que ce qui a été fait n’est pas conforme au droit ?
M. Joaquim Pueyo. Dans votre bilan de l’état d’urgence, un point a particulièrement retenu mon attention : la saisine « relative à la mise en isolement d’un détenu en raison de ses pratiques religieuses (confiscation de son tapis et de ses livres de prière) ». Nous ouvrons actuellement dans les établissements pénitentiaires des quartiers dédiés aux individus au profil ou au discours radical à tendance prosélyte, afin de les éloigner des autres détenus qu’ils risqueraient d’influencer. Qu’en pensez-vous ? Comptez-vous formuler des recommandations concernant cette décision du ministère de la Justice ?
En 2011, lors de la création du Défenseur des droits, on avait envisagé de rattacher à cette instance le contrôleur général des prisons, ce qui n’a finalement pas été fait. Le Défenseur des droits a repris les compétences de la Commission nationale de déontologie de la sécurité, qui jouait un rôle important dans le contrôle des établissements pénitentiaires. Mais que pensez-vous de cette coexistence du Défenseur des droits et d’un organisme indépendant chargé de contrôler les lieux de privation de liberté ? Êtes-vous en relation ?
Le fondamentalisme remet en question la démocratie, la laïcité et jusqu’à la liberté individuelle. Avez-vous été saisi par des associations ou des citoyens sur ce fondement ?
M. Jacques Bompard. J’ai lu avec intérêt votre rapport annuel d’activité : vous ne chômez pas ; bravo !
Toutefois, on est en droit de s’interroger sur les cas concrets qui y sont évoqués. Ainsi, un livreur qui refuse de se rendre dans un quartier sensible ne propage pas des stéréotypes : il exerce un droit inaliénable, celui d’assurer sa propre sécurité. Un professeur qui ne veut pas exercer dans un quartier dangereux n’est pas raciste : il souligne l’aveuglement d’un État coupable de ne pas garantir la sécurité de ses citoyens. Nous le savons bien en Provence-Alpes-Côte d’Azur, à Marseille, à Avignon ou à Carpentras.
Ce que l’on ressent à la lecture de ce rapport, c’est une présomption de racisme à l’encontre des Français, qu’il s’agisse des contrôles d’identité, des institutions, des cantines. Or la France souffre d’un profond questionnement identitaire et la culpabilisation des masses ne fonctionnera plus. On a vu l’accueil que les réseaux sociaux ont réservé à la campagne caricaturale du Gouvernement « Tous unis contre la haine ». Mais quelle haine ? C’est la haine de soi qui constitue, je crois, la matrice du délitement de notre société. Rien sur les habitants de Calais, rien sur les exilés de la France périphérique, rien sur le racisme anti-Blanc, rien sur les masses populaires qui souffrent au quotidien d’une crise identitaire qui n’est traitée que par l’idéologie institutionnelle soumise au prêt-à-penser, incapable, hélas, de résoudre les problèmes auxquels notre pays est confronté.
Monsieur le Défenseur des droits, intégrerez-vous à vos travaux de l’année prochaine la lutte contre la haine de soi au sens large du terme, premier facteur à mes yeux de tension dans notre pays ?
M. Jacques Toubon. Monsieur Lebreton, en ce qui concerne la caution pour la location d’un logement, j’ai présenté en 2014 un avis que j’ai soumis au ministre de l’outre-mer. Cette démarche n’a pas encore abouti, car on m’a opposé l’incidence financière d’une telle mesure. Mais je ne désespère pas ; au contraire, je continue à me battre.
De manière générale, le Défenseur des droits a beaucoup œuvré pour que les banques et les compagnies d’assurances ne traitent pas de manière inégalitaire les personnes originaires des départements d’outre-mer, par exemple lorsqu’il s’agit d’ouvrir un compte bancaire. Nous avons fait beaucoup de progrès dans ce domaine. Il est clair à mes yeux que ma mission s’étend à la totalité du territoire de la République, dont les départements d’outre-mer. Le Défenseur des droits en est d’ailleurs à sa troisième mission et à son troisième rapport sur la situation de Mayotte.
Merci, en tout cas, de me rappeler cette question : je vais poursuivre mes démarches.
M. Patrick Lebreton. C’est un dossier important.
M. Jacques Toubon. Monsieur Mennucci, je sais bien que ce que je dis ou écris ne plaît pas à tout le monde et suscite des discussions. Je vous rappelle que je ne suis pas un juge : si je puis manier la balance pour tenter de rétablir l’équilibre des droits, je ne possède pas le glaive. On peut donc toujours, naturellement, discuter mes points de vue. Mais vous pourriez utilement vous rapporter à mon avis sur le projet de loi renforçant la lutte contre le crime organisé, qui a été publié – comme tout ce que je dis ou écris et que l’on peut retrouver soit dans des documents que je fais parvenir aux rapporteurs ou aux présidents des commissions des Lois, soit sur notre site, en temps réel. Au Sénat, j’ai eu l’occasion d’exprimer mon avis, dans les mêmes termes, à M. Michel Mercier, rapporteur, et d’en parler à M. Philippe Bas, président de la commission des Lois, qui en a d’ailleurs fait état, je crois, dans le débat de la semaine dernière, en invoquant l’article 66 de la Constitution sur l’autorité judiciaire.
Voici ce que j’ai écrit : « Le présent projet de loi doi[t] contenir les garanties nécessaires en vue d’assurer un juste équilibre entre la protection des droits et des libertés et l’impératif de sécurité publique et de prévention et de répression des infractions pénales. L’une de ces garanties, essentielle en matière de procédure pénale, est assurément le contrôle du juge judiciaire, gardien des libertés individuelles en vertu de l’article 66 de la Constitution, lorsque les mesures ordonnées dans le cadre de l’enquête sont susceptibles de porter atteinte aux droits fondamentaux, telles que perquisitions, saisies et interceptions de données personnelles. »
Le Conseil constitutionnel n’a pas dit autre chose le 19 février, dans sa décision sur la question prioritaire de constitutionnalité concernant les saisies de données informatiques. Ce n’est qu’à condition de modifier la Constitution que l’on pourrait procéder régulièrement et légalement à ces saisies. Ce que je dis ici n’équivaut donc pas à des propos tenus par le Premier président de la Cour de cassation, par le vice-président du Conseil d’État ou par tel ou tel commentateur : c’est l’expression de la loi, telle qu’elle se présente dans notre édifice normatif.
Vous avez parlé, monsieur Mennucci, de police administrative. Voici ce que j’écrivais encore dans mon avis : « En renforçant les moyens de l’autorité administrative, ce projet de loi crée un déséquilibre entre le préfet et le procureur de la République : il déplace ainsi l’initiative du déclenchement de mesures portant atteinte aux libertés individuelles au bénéfice du préfet, sans que celui-ci soit soumis au respect de garanties procédurales telles qu’un contrôle a priori. » La caractéristique de toutes les mesures prises dans le cadre de l’état d’urgence, qui est admissible à titre temporaire et exceptionnel mais deviendra permanente si ces lois sont votées, c’est que le contrôle a priori d’un juge est remplacé par le contrôle a posteriori. On juge de la régularité de la mesure une fois qu’elle a été appliquée, on ne la soumet pas à une autorisation préalable. En matière de libertés, la différence est considérable, monsieur le député !
Comme je l’ai déjà dit, notamment à la presse, ce sont aujourd’hui les propos, les comportements, les attitudes qui pourront être mis en cause à travers la police administrative et les mesures à caractère administratif, et non les infractions commises, contrairement au principe même de notre procédure pénale. J’ai donc écrit très clairement : « Eu égard à l’objet de sa mission, le Défenseur des droits émet les observations et recommandations suivantes sur les dispositions relatives aux mesures d’investigation portant atteinte au droit au respect de la vie privée et du domicile, au renforcement des pouvoirs de l’autorité administrative dans le cadre de la prévention du terrorisme ainsi que sur d’autres dispositions relatives au nouveau régime d’irresponsabilité pénale en matière d’usage des armes à feu. »
Je ne suis pas le seul à m’exprimer ainsi, comme en témoigne le très important compte rendu des débats en séance publique à l’Assemblée : l’article 18 relatif à la retenue administrative ne semblait pas aller de soi pour tous les députés, contrairement à ce que vous avez suggéré, et certains d’entre eux ne jugeaient pas le point de vue du Défenseur des droits aussi excessif que vous.
Je ne m’attarde pas sur les raisons pour lesquelles tout cela remet en cause l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme et sa jurisprudence.
Monsieur Pueyo, en matière pénitentiaire, votre expérience vous rend plus compétent que moi. Lorsque j’ai été auditionné ici même en juillet 2014 en vue de ma nomination, j’ai indiqué que, à la suite de l’adoption de la loi du 23 mai 2014 qui avait donné un nouveau statut au Contrôleur général des lieux de privation de liberté, je considérais que le débat ouvert en 2011 sur l’éventualité qu’il rejoigne le Défenseur des droits était clos. À mes yeux, ce n’était pas une priorité et je n’allais pas me battre pour cela. En outre, nous entretenons avec Adeline Hazan, qui occupe actuellement le poste, de bonnes relations de travail. Elle est chargée de tout ce qui concerne la condition pénitentiaire tandis que nous nous occupons des droits des détenus. En année moyenne, nous avons d’ailleurs traité à peu près le même nombre de cas – 4 000 environ –, quoique de manière différente. Je ne méconnais pas le fait que cette situation puisse intriguer les avocats ou les détenus ; souvent, d’ailleurs, ils saisissent les deux instances, pour obtenir une double garantie.
Quant à votre question sur la radicalisation, qui concerne plutôt Adeline Hazan puisqu’elle a trait à l’organisation de la détention, je n’ai personnellement pas de point de vue sur le sujet, mais je dirai, comme je l’ai fait à propos de l’article 20 du projet de loi renforçant la lutte contre le crime organisé, relatif au contrôle administratif, qu’il faut prendre garde de passer de mesures restrictives de liberté à des mesures privatives de liberté et qui porteraient atteinte aux droits des personnes libres comme des détenus. Vous êtes mieux placé que moi pour savoir qu’un détenu, en effet, n’est pas moins une personne que celles qui sont de l’autre côté des barreaux.
Monsieur Bompard, le Défenseur des droits ne formule nullement une présomption de racisme, bien au contraire ; sa méthode consiste à procéder au cas par cas. Prenons le livreur que vous avez évoqué : aux termes de ma décision, son refus de livrer dans un quartier réputé difficile ou dangereux ne constitue pas, dans les circonstances de l’espèce, une discrimination. Vous voyez que mon point de vue est loin d’être systématique. En particulier, j’ai pris en considération cette donnée du dossier : quinze jours ou trois semaines auparavant, une autre personne avait été attaquée sur place.
Vous avez employé une expression que je reprends à mon compte bien que, sur de nombreux sujets, je ne sois pas d’accord avec vous : les « exilés de la France périphérique ». Mais ces exilés, monsieur Bompard, forment une grande partie de ceux qui s’adressent au Défenseur des droits ; ce sont eux qui, je l’ai dit, ne s’adressent pas assez à lui ou aux autres instances de recours ; ce sont ces populations vulnérables, ces personnes oubliées ou qui se croient oubliées, abandonnées, qui subissent le pire dans une société républicaine de progrès comme la nôtre : l’aquoibonisme. « À quoi bon irais-je demander quelque chose ? De toute façon, je ne l’obtiendrai pas. La loi, le droit, la République, c’est pour les autres. » Quand je rétablis des droits sociaux, quand j’essaie de prendre par la main une personne qui n’arrive pas à avancer dans le labyrinthe administratif, c’est de ces exilés de la France périphérique qu’il s’agit ! Je partage tout à fait le point de vue de ceux qui ont parlé de ségrégation à propos de notre société.
Voilà pourquoi le projet de loi « Égalité et citoyenneté » est particulièrement important. J’en connais une partie, qui me concerne, celle qui touche à la lutte contre les discriminations : elle est très positive. Mais il faut aller plus loin. J’ai parlé de l’enquête que nous allons réaliser. J’ai aussi adressé hier un appel à témoignages aux jeunes qui ont du mal à trouver un emploi du fait de leur origine. Vous avez voté ici même il y a deux ans un nouveau critère de discrimination : le lieu de résidence. Nous en faisons usage, en particulier s’agissant de l’inégalité de traitement en matière de services publics – de l’éducation ou de la santé.
Croyez-moi, monsieur Bompard : notre présomption, c’est une présomption d’égalité ! Or aujourd’hui, dans notre pays, elle est rarement confirmée. Il faut la rétablir.
M. Éric Ciotti. Monsieur le Défenseur des droits, vous avez accompli un travail considérable au cours de cette première année complète d’exercice.
À vous écouter, peut-être plus encore qu’à vous lire, on ressent un grand pessimisme quant à la situation de notre pays en matière de protection des libertés. Je ne partage pas cette analyse. Nous, législateur, qui avons l’honneur de représenter la nation au Parlement, nous devons d’abord dire que la France est un pays de liberté, de droit, une grande démocratie. Bien sûr, des difficultés existent et, naturellement, vous en êtes saisi ; peut-être leur donnez-vous de ce fait plus d’importance qu’elles n’en ont en réalité. Mais ce qui nous menace, ce n’est pas l’absence de libertés, mais ceux qui attaquent les libertés. Je crains que vous ne l’ayez un peu oublié dans votre propos.
En ce qui concerne l’état d’urgence, vous avez parlé de « climat de suspicion » ou « délétère » au sujet de ceux qui ont subi les mesures prévues par la loi, par notre Constitution, bref des mesures de droit. Qu’est-ce qui vous fait dire cela ? Ces mesures sont susceptibles d’être contrôlées par le juge administratif, qui est un juge de plein droit. Il y a d’ailleurs eu très peu de contentieux et, surtout, très peu qui ont donné lieu à une sanction par le juge administratif, garant de nos libertés. Cette analyse me paraît donc traduire une dérive que je déplore.
Vous avez évoqué la nécessité de combattre le terrorisme par la philosophie des libertés. Bien entendu ; mais je ne suis pas sûr que ceux qui nous livrent cette guerre, rappelée tout à l’heure encore par le Premier ministre, soient animés des mêmes sentiments. Les bons sentiments peuvent nuire à l’efficacité. Vous avez raison de dire que rien ne nous rattache ni ne doit nous rattacher à ces personnes. Ne faisons pas preuve d’une coupable naïveté. C’est l’éternel débat sur l’équilibre entre sécurité et liberté. Pour moi, la sécurité est la première des libertés. Quand on ne peut pas, en toute sécurité, aller dans une salle de spectacle, assister à une rencontre sportive, s’installer à une terrasse de café, on n’est plus complètement libre. Cela justifie les mesures prises par le Gouvernement dans le cadre de notre État de droit et qui ont été adoptées à une immense majorité par la représentation nationale.
J’aimerais également en revenir à un sujet d’actualité, même si, en tant que tel, il ne concerne pas votre rapport d’activité pour 2015. Il s’agit d’une campagne d’affichage que vous avez lancée, qui stigmatise inutilement les policiers et qui caricature leur action. Sur l’affiche, qui montre des policiers en train de procéder à un contrôle, on peut lire ce slogan : « Être défendu est un droit pour moi aussi ! » Elle suggère un contrôle au faciès et, surtout, l’idée que les policiers manqueraient de manière générale à leurs obligations déontologiques et de neutralité.
Nous avons débattu de ces questions dans l’hémicycle lors de l’examen du projet de loi de réforme pénale défendu par le garde des Sceaux et le ministre de l’intérieur. Le débat, assez vif, opposait le Gouvernement, soutenu par le groupe Les Républicains, aux écologistes, qui s’exprimaient notamment par la voix de M. Mamère. Votre campagne rejoint en tous points les propos que celui-ci a alors tenus.
Les policiers l’ont très mal vécue ; ils vous l’ont écrit, vous l’ont dit, notamment la secrétaire générale du Syndicat des commissaires de la police nationale, connu pour sa modération. Je vous rappelle qu’en 2015, 15 000 policiers ont été blessés en service, que 11 sont morts, que nous vivons sous une menace terroriste maximale et que les policiers sont seuls en première ligne dans ce combat ! Ils sont des cibles parce qu’ils portent l’uniforme de la République pour défendre les libertés ! Ce sont d’abord des défenseurs des libertés, et eux aussi ont droit au respect. Laisser entendre qu’ils procéderaient à des contrôles au faciès, qu’ils ne respecteraient pas leurs obligations, me choque tout autant qu’eux. Je regrette donc très profondément que vous ayez balayé d’un revers de main la demande que les syndicats vous ont adressée de renoncer à cette campagne, et que je réitère devant vous. Dans le contexte actuel, ce n’est pas aux policiers qu’il faut s’attaquer. C’est une injustice, une erreur et une faute.
M. Jacques Valax. Je ne voudrais pas entonner le même hymne que mon collègue, mais je dois malheureusement reconnaître avec lui que, dans le contexte de violence, de peur et d’insécurité que vous avez rappelé, et alors que, comme vous l’avez dit, la terreur nous est imposée de l’extérieur, les lois de la République, auxquelles je suis profondément attaché, sont mises en danger par certains individus. Dès lors, comment concilier les impératifs de liberté individuelle – motivation première de votre action –, de cohésion nationale et de solidarité ? Selon les principes démocratiques, c’est possible ; mais que faire face aux velléités croissantes qui s’opposent à ces principes ? C’est ce problème que sous-entendait la dernière question de mon collègue Pueyo.
À la lecture de votre rapport, je me demande si vous n’auriez pas tendance à « laver plus blanc que blanc ». Vous citez, page 80 du document qui nous a été distribué, le cas de cette manifestante qui arborait un fanion le 14 juillet – comme par hasard, elle faisait partie de « La Manif pour tous » – et concluez qu’au nom de la liberté d’expression, il faudrait supprimer toutes les interdictions de manifester ce jour-là. C’est très bien en théorie, mais auriez-vous défendu de la même manière la liberté d’un syndicaliste de la CGT ?
Sans aller aussi loin qu’Éric Ciotti, je crois qu’il n’a pas tout à fait tort. Le rapport cite l’exemple d’une intervention des forces de gendarmerie dans une situation un peu crispée, et le Défenseur des droits, dans la quiétude et la tiédeur de son bureau, « regrett[e] que l’éventualité d’un problème cardiaque, comme celle de la consommation de médicaments psychotropes et d’un état physique et psychique particulier de la victime le jour des faits […] n'aient pas été […] pris en considération » ! N’allez-vous pas un peu trop loin ? Vous n’auriez peut-être pas dû reprendre cet exemple. Considérer de manière intellectuelle qu’il indique le sens de votre action, je le comprends ; mais de là à en faire un exemple de votre action quotidienne ! Vous nous donnez des leçons de démocratie qui n’ont pas lieu d’être. Je le prends très mal et je tenais à vous le dire.
M. Jacques Toubon. Vous le prenez très mal, mais c’est vous qui avez voté l’article du code de la sécurité intérieure qui prévoit que je contrôle les personnes exerçant des activités de sécurité ! C’est ce texte qui traite du comportement professionnel des gendarmes, auquel vous venez de faire allusion.
M. Jacques Valax. C’est la théorie !
M. Jacques Toubon. Mais si je ne l’appliquais pas, là, oui, ce serait une faute ! C’est l’honneur et la difficulté de la mission du Défenseur des droits que d’appliquer les textes que vous votez.
M. Jacques Valax. De là à chercher le poil à gratter ! Ce n’est plus appliquer la loi, c’est l’interpréter !
M. Sergio Coronado. C’est plus calmement que je saluerai la qualité du travail accompli par le Défenseur des droits en 2015 et synthétisé dans ce beau rapport.
En écoutant mes collègues, j’ai cru n’avoir pas bien compris quelles étaient les attributions du Défenseur des droits. Toutefois, vérification faite, dans l’article 4 de la loi organique du 29 mars 2011 consacré à ses missions, je n’ai rien trouvé qui concerne la lutte contre le terrorisme ni le maintien de l’ordre public, mais seulement la défense des droits et libertés dans le cadre des relations avec les administrations de l’État, la défense et la promotion de l’intérêt supérieur et des droits de l’enfant, la lutte contre les discriminations et le contrôle du respect de la déontologie par les personnes exerçant des activités de sécurité sur le territoire de la République.
Rien de tout cela ne fonde les reproches qui vous sont adressés aujourd’hui, monsieur le Défenseur des droits. Je conçois qu’étant donné les conditions de votre nomination, vous soyez aux yeux de certains de mes collègues un Défenseur des droits très surprenant – je le dis au bon sens du terme. Vous assumez pleinement les missions qui vous sont conférées par la loi organique. Voilà pourquoi je salue la voix forte que vous faites entendre dans le débat nécessaire sur la défense des libertés, à l’heure où celles-ci sont parfois fragilisées sous prétexte de lutter contre le terrorisme.
J’aimerais vous poser trois questions d’actualité.
Premièrement, que pensez-vous de l’accord sur la crise migratoire conclu vendredi dernier par la Turquie et l’Union européenne ? Ne fragilise-t-il pas pour le moins les engagements de la France et les conventions internationales ? Nul besoin de rappeler les déclarations à ce sujet du haut commissaire des Nations unies pour les réfugiés, ni la manière dont la Grèce a été contrainte par les pays de l’Union de déclarer la Turquie « pays sûr », ni encore le fait que la guerre d’Erdoğan contre le terrorisme ne connaît aucune exception – journalistes, avocats, organisations de défense des droits de l’homme, parlementaires pro-kurdes : tous sont visés par la forte répression menée par le pouvoir en place. Au demeurant, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ne semble heureusement pas prêt à respecter l’accord.
S’agissant en deuxième lieu des perquisitions dans le cadre de l’état d’urgence, j’aimerais rappeler à ceux de mes collègues qui semblent trouver que vos déclarations sont un peu vives et outrepassent vos attributions que, la semaine dernière, la Commission nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH) a été par la bouche de sa présidente, Mme Lazerges, ancienne députée socialiste, tout aussi claire sur les perquisitions, pointant les mêmes abus que vous. Vous évoquez « cris, insultes, propos déplacés sur la pratique religieuse des perquisitionnés, manque d’attention à l’égard des enfants présents […] braquages inappropriés et menottages, dégradations volontaires ». Il me paraît essentiel que, dans le cadre de vos attributions, particulièrement en matière de respect de la déontologie, vous adressiez des recommandations, notamment au ministre de l’intérieur, afin qu’il publie une circulaire donnant des consignes aux forces de l’ordre.
La CNCDH suggère en filigrane la remise en fin de perquisition d’un document rappelant leurs droits aux personnes perquisitionnées, notamment lorsqu’une perquisition n’a rien donné. Je serai très attentif à votre point de vue sur le sujet.
Le ministre de l’intérieur a-t-il donné suite à certaines recommandations que vous avez rendues publiques le 26 février dernier ?
Enfin, je ne reviens pas au fameux débat sur la remise d’un récépissé lors d’un contrôle d’identité, car on connaît la position du Gouvernement à ce sujet, malgré les engagements pris pendant la campagne. Mais le ministre de l’intérieur, répondant non seulement à M. Mamère mais à de nombreux parlementaires de la majorité qui l’interpellaient, a eu à ce sujet une phrase définitive, ce qui arrive assez souvent à ce poste : il n’y aurait pas dans notre pays de contrôles au faciès. De sorte que toute remise en cause, tout rappel des difficultés que rencontre une partie de la population lorsqu’elle est en contact avec les forces de l’ordre, est considéré comme une basse attaque contre ces dernières, soumises à une forte pression pour assurer notre sécurité. Les témoignages que vous recevez confortent-ils ce type de propos ? N’y aurait-il plus aucun problème dans les relations entre les forces de l’ordre et une partie de la population lors des contrôles d’identité ?
M. Erwann Binet. Vous avez rappelé à plusieurs reprises, notamment dans un avis publié en juillet dernier, votre souhait que l’encadrement législatif de l’assistance médicale à la procréation (AMP) évolue pour permettre à toutes les femmes d’y accéder, y compris aux couples de femmes et aux femmes seules. En revanche, je trouve votre réflexion timide ou, du moins, discrète s’agissant des questions d’accès à l’origine. Or nous, parlementaires, sommes saisis par les intéressés d’un problème dont le débat public se fait régulièrement l’écho : des enfants nés d’un don de gamètes, désormais adultes – les plus âgés atteignent aujourd’hui la trentaine –, parfois nés avant les lois de bioéthique de 1994, se voient opposer le secret absolu dont le législateur a entouré ce don.
Cela peut conduire à s’interroger. Sans aller jusqu’à lever l’anonymat du don, on pourrait imaginer de recourir à des solutions existant dans d’autres pays, comme la délivrance d’informations ne permettant pas l’identification. Et pourquoi ne pas autoriser l’enfant, une fois parvenu à l’âge adulte, à connaître l’identité du donneur ?
Êtes-vous saisi de ces questions ? Si tel est le cas, quelle serait votre position sur ce point dans le cadre d’une évolution des lois de bioéthique à laquelle vous nous appelez par ailleurs ?
Je tiens ensuite à vous remercier des efforts que vous déployez pour susciter les témoignages de victimes de discriminations. La page d’accueil du site internet du Défenseur des droits présente ainsi un appel à témoignages concernant les discriminations à l’embauche. C’est une très bonne chose, c’est très bien fait et je partage votre souci à ce sujet. Mais comment ces efforts sont-ils relayés par vos délégués sur le terrain ? Ils accueillent parfaitement les réclamations ; les engagez-vous aussi à les devancer, par exemple en se rendant dans les collèges, les lycées, les agences Pôle Emploi pour y faire œuvre de sensibilisation – bref, à être proactifs plutôt que de rester enfermés dans un bureau de sous-préfecture en attendant que les victimes frappent à leur porte ?
M. Jacques Toubon. Monsieur Ciotti, en ce qui concerne l’affiche, je ne vois pas en quoi la photographie elle-même montre autre chose que le quotidien du métier des policiers en tenue. Elle n’a rien d’une dénonciation ni d’une stigmatisation.
Comme je l’ai écrit à Mme Berthon, secrétaire générale du Syndicat des commissaires de la police nationale, il ne s’agit pas d’une campagne de communication. En juin dernier, nous avons mis en circulation sept affiches portant sur les quatre missions du Défenseur des droits, dont la défense des enfants, la lutte contre les discriminations et la médiation avec les services publics. L’une de ces affiches portait sur les droits des femmes. Il s’agissait, d’une manière générale, d’appeler l’attention sur la possibilité offerte aux personnes qui se trouvent dans ce type de situations de nous saisir pour faire valoir leurs droits. Une seconde série d’affiches a été envoyée plus récemment. Les mairies ou les institutions qui les reçoivent choisissent de les exposer ou non. Je n’ai pas lancé une campagne de publicité en utilisant des affiches de quatre mètres par trois ou des spots radiodiffusés. C’est une campagne d’information, visant à développer le recours au Défenseur des droits.
L’affiche en question, je le répète, n’a pas la portée que vous dénoncez. Elle se contente de décrire l’un de nos domaines de compétence, la déontologie de la sécurité.
J’observe qu’en cette matière le nombre de requêtes présentées au Défenseur des droits a augmenté de 250 % depuis 2010, peut-être pour des raisons de fond, mais d’abord parce que, dans l’ancien système, la CNDS ne pouvait être saisie que par l’intermédiaire d’un parlementaire, alors que le Défenseur des droits l’est directement. Surtout, sur les 550 dossiers que j’ai eu à traiter l’an passé, et qui concernent des policiers nationaux – dans la moitié des cas –, des gendarmes, des gardiens de prison, des policiers municipaux ou des vigiles, un peu plus de 10 % a fait l’objet de notre part d’une décision de manquement et, puisque c’est ainsi que nous procédons, d’une demande de sanction à l’autorité disciplinaire – le ministère de l’intérieur, de la défense ou de la justice. En d’autres termes, dans 90 % des cas, nous avons estimé que le policier, le gendarme, l’agent de sécurité s’était conduit conformément au code de déontologie. Cela confirme qu’il n’y a pas ici la moindre vindicte contre les forces de sécurité, bien au contraire.
En effet, comme vous l’avez très justement rappelé, s’il est possible d’appliquer les lois dans notre pays, et de les faire appliquer par ceux qui voudraient s’y soustraire, c’est grâce aux forces de sécurité, dépositaires du monopole de la violence légitime. En d’autres termes, les premiers serviteurs de la loi, en même temps que ses premiers bénéficiaires, ce sont les forces de sécurité. Pour le dire clairement, en tant que Défenseur des droits, je suis du même côté que les forces de sécurité. Dans les circonstances actuelles, en particulier, je suis le premier à leur rendre hommage.
C’est si vrai que, dans son récent rapport, l’ACAT (Action des chrétiens pour l’abolition de la torture) juge que le Défenseur des droits est beaucoup trop gentil avec la police, complètement impuissant face à ses exactions et à ses violences supposées, et conclut qu’il faudrait désigner quelqu’un d’autre pour s’en occuper !
Ma position se situe probablement à mi-chemin entre la vôtre, monsieur Ciotti, et celle de l’ACAT ; et c’est sans doute la bonne position.
En ce qui concerne l’application des mesures de l’état d’urgence, ce dont j’ai fait état, notamment dans mon rapport du 26 février remis au Parlement, c’est ce que disent les personnes qui m’ont saisi. Pour l’instant, à l’exception de quatre ou cinq règlements à l’amiable – le cas le plus simple étant celui du lycéen empêché de se rendre au lycée par son assignation à résidence et pour lequel nous avons obtenu que soient modifiés les horaires de pointage –, tous les cas sont à l’instruction et je n’ai pris aucune position vis-à-vis de ces déclarations. En parlant du climat, je faisais référence à ce qui ressort des propos ou des écrits des personnes soumises à ces mesures. Je vais maintenant mener une instruction contradictoire dont je tirerai les conclusions. Ce ne seront pas celles du contentieux administratif, qui porte sur le bien-fondé juridique des mesures prises en application de la loi d’avril 1955 ou de la loi du 20 novembre – et peut-être, demain, des nouvelles dispositions constitutionnelles et des textes subséquents. Ce que je vérifierai, c’est si le comportement des policiers ou des gendarmes qui ont par exemple procédé aux perquisitions a été conforme à la déontologie de la sécurité.
Monsieur Valax, il y a une grande différence, du point de vue de l’État de droit, entre les textes qui s’appliquent de manière exceptionnelle et temporaire, comme la loi relative à l’état d’urgence, et ceux qui sont destinés à entrer dans notre droit commun – donc, lorsqu’ils restreignent nos libertés, à les restreindre en permanence. C’est sur ce point que j’interroge la représentation nationale.
L’enjeu, que M. Ciotti et vous-même, après M. Mennucci, avez très bien formulé, est le suivant : la meilleure réponse à ceux qui menacent nos libertés consiste-t-elle à réduire ces libertés au profit de mesures de sécurité ? En janvier, lorsque j’ai pour la première fois fait état devant la commission sénatoriale de suivi de l’état d’urgence des réclamations que j’avais reçues, j’ai posé cette question : si l’on avait fait face aux événements en recourant à l’arsenal législatif que vous, députés élus en 2012, avez vous-mêmes voté en 2012, en 2013, en 2014 ou en 2015, la situation serait-elle si différente aujourd’hui ? C’est une manière pratique ou triviale de s’interroger sur la philosophie que nous devons choisir : celle des mesures d’exception qui peuvent devenir lois ordinaires ou celle de la préservation d’un certain état de nos libertés.
Vous avez fait référence à mes décisions concernant « La Manif pour tous ». Il en ressort que les instructions générales données par l’autorité administrative, en l’occurrence le préfet de police, m’ont paru porter atteinte à la liberté d’expression et de manifestation. Contrairement à ce que vous dites, ce point de vue n’est pas réservé à « La Manif pour tous » : j’ai dénoncé exactement de la même manière la mesure d’« encagement » par la police de parents d’élèves et de syndicats d’enseignants venus manifester devant la mairie d’Asnières, et je le ferai dans tout cas similaire. J’ai en effet formulé une recommandation générale sur l’« encagement », une mesure à mes yeux totalement contraire aux principes mêmes du maintien de l’ordre républicain, comme je l’ai dit à la commission d’enquête qui a été créée l’année dernière après l’affaire du barrage de Sivens. Ce n’est pas une mesure de sécurité, c’est une interdiction de manifester ! Elle porte donc clairement atteinte à la liberté de manifestation et d’expression, de même que l’instruction du préfet de police tendant à faire enlever tous les t-shirts ou fanions au passage du Président de la République sur les Champs-Élysées.
J’avais annoncé en juillet 2014 – certains ne l’avaient pas cru, qui peut-être le croient aujourd’hui, et se mordent les doigts de s’être trompés – que je n’agirais selon aucun a priori. C’est ce qui s’est passé dans le cas que vous citez. En particulier dans ces affaires de liberté d’expression, de manifestation, de liberté religieuse, si difficiles au moins depuis Charlie Hebdo, ma position est guidée par le droit et d’abord par l’impératif de cohésion sociale et nationale.
Pour prendre un exemple récent, si on m’interrogeait sur la fameuse disposition du projet de loi défendu par la ministre du travail Mme El Khomri relative à la liberté religieuse dans les entreprises, je répondrais que l’article à propos duquel on a poussé des hauts cris ne fait que reprendre des dispositions existantes, au mot près ! Par définition, l’entreprise, qui relève du secteur privé, n’est pas couverte par les lois adoptées pour le secteur public. D’un autre côté, il existe des difficultés qui engagent le fonctionnement des entreprises, des problèmes de discrimination, de libertés : il faut les traiter au cas par cas. Quoi qu’il en soit, la loi que vous allez examiner n’apporte aucune novation ; je le dis, car cette question risque de se poser et de faire l’objet d’un débat peut-être difficile.
Monsieur Coronado, en ce qui concerne les contrôles d’identité dits subjectifs, c’est-à-dire discriminatoires, l’affaire a été portée devant la Cour de cassation, à laquelle je présenterai des observations dans lesquelles je ferai valoir mon point de vue.
À mes yeux, l’accord entre la Turquie et l’Union européenne – plus exactement, entre le gouvernement turc et les chefs d’État et de gouvernement, tant qu’il n’a pas été transformé en un accord juridiquement contraignant – n’est pas juridiquement correct, pour deux raisons.
Premièrement, il ne pourrait être mis en œuvre que si, en application des textes sur le droit d’asile, la Turquie était considérée comme un pays sûr. Or elle ne l’est pas, en particulier parce que, aux termes de la directive de 2013, cela supposerait qu’elle ait ratifié la convention de Genève sans aucune limitation géographique, ce qu’elle n’a pas fait. La Commission européenne a d’ailleurs elle-même estimé que « l’application de [l’accord] requiert la modification préalable des législations nationales tant grecque que turque – la législation grecque doit prévoir le statut de pays tiers sûr pour la Turquie et la législation turque doit garantir l’accès effectif à des procédures d’asile pour toute personne ayant besoin d’une protection internationale ».
Je note qu’un autre pays concerné, la Hongrie, qui n’est pas considérée comme « faible » sur les questions migratoires, juge irrecevable les demandes d’asile des personnes ayant transité par des pays sûrs, au nombre desquels les États candidats à l’adhésion à l’Union européenne, à l’exception de la Turquie. De nombreuses personnes signalent donc ce problème.
Deuxièmement, après le renvoi en Turquie, les migrants pourraient être renvoyés depuis ce pays vers d’autres qui, eux, tomberaient sous le coup de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme sur la torture et les traitements inhumains ou dégradants. Or la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme interdit aux États contractants d’éloigner une personne vers un pays lorsqu’il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’elle y courra un risque réel d’être soumise à un traitement contraire à l’article 3. Elle interdit même de renvoyer une personne dans un pays, fût-il considéré comme sûr, si celui-ci risque de la renvoyer à son tour dans un autre pays non sûr, celui de sa nationalité ou de sa résidence. Cela pourrait tout à fait concerner les Syriens.
Il y a donc lieu de mettre en question la légalité internationale et européenne de cet accord. En disant cela, je ne tranche ni dans un sens ni dans l’autre : simplement, je ne crois pas que l’on puisse appliquer ces dispositions sans s’interroger sérieusement sur ces points. Je me tiens naturellement à la disposition de tous pour aller plus loin sur ces sujets. Le Défenseur des droits est en effet l’une des rares instances de notre pays, à l’exception, naturellement, des tribunaux judiciaires, à se préoccuper tous les jours, voire toutes les nuits, des personnes qui, comme les enfants ou les familles retenus en centre de rétention administrative, sont dans une situation violemment contraire aux règles internationales ou nationales.
Monsieur Binet, j’ai justement donné aux délégués instruction d’étendre et d’intensifier leurs activités dans le domaine de la promotion de l’égalité et de la lutte contre les discriminations. Aujourd’hui, il est vrai que certains d’entre eux ont, par tradition, tendance à privilégier les questions de médiation avec les services publics. Mais je vais essayer, en particulier grâce aux recrutements et remplacements, d’accentuer cette dimension de leur action. En outre, je prépare actuellement un projet éducatif, pour l’éducation au droit, que j’aimerais développer avec l’éducation nationale afin de faire mieux comprendre aux collégiens et lycéens le rôle fondamental des règles de droit dans une République comme la nôtre.
En ce qui concerne la procréation médicalement assistée, je maintiens ce que j’ai dit devant la mission sénatoriale conduite par Mme Catherine Tasca. Toutefois, par rapport à la position publique prise par 130 médecins la semaine dernière, qui repose encore essentiellement sur des principes d’éthique biomédicale et surtout sur l’idée de traiter l’infertilité de tous les couples, la mienne est d’une certaine manière plus large et plus fondamentale : elle s’appuie sur le principe d’égalité. Je ne suis pas sûr que d’éventuelles futures discussions à ce sujet aboutiraient si l’on partait de l’idée d’étendre les lois de bioéthique ou de supprimer les obstacles qui y figurent : mieux vaudrait à mon avis – mais vous êtes plus compétent que moi sur ces questions – partir des textes du type de celui sur le mariage pour tous, c’est-à-dire de l’égalité. Juridiquement, philosophiquement, politiquement, cette démarche serait probablement sinon plus facile, du moins plus cohérente.
L’amélioration de nos dispositions sur l’accès à l’origine ont fait l’objet en 2012 et 2013 de discussions auxquelles le Défenseur des droits de l’époque a participé. Puis, après qu’elles ont débouché en 2013 et 2014 sur des textes et des propositions, dont le rapport Théry, on n’en a plus parlé. Si vous me saisissez, je peux réfléchir à ce problème très intéressant, qui se posera dès lors que l’on aura entériné toute la récente jurisprudence de la Cour de cassation sur la gestation pour autrui, et traité les questions de filiation qui font partie des suites du mariage pour tous. Il ne s’agit pas ici d’idéologie mais d’application pratique du droit.
Prenons l’exemple du livret de famille. Il soulève des questions très concrètes du type de celles que vous, parlementaires, devriez vous poser. Qu’y écrit-on ? Que peut-il dire d’un enfant, de ses parents ? En s’appuyant sur quels documents ? Quel doit être son degré de publicité ? Nous devrions mettre ces questions sur la table, ce qui n’a pas encore été fait, et les regarder froidement au lieu de les laisser aux groupes d’intérêt et de pression.
Mme Maina Sage. Merci de vos travaux. Votre rapport montre bien la montée en puissance des activités de médiation, de suivi et de défense d’intérêts qui sont souvent ceux des minorités discriminées. Vous jugez très faible le chiffre de 5 000 saisines pour discrimination en 2015. À combien estimez-vous leur nombre potentiel et quels moyens mettre en œuvre pour les traiter ?
Ma deuxième question porte sur les territoires d’outre-mer, à propos desquels je m’associe aux remarques précédemment formulées : nos jeunes subissent encore trop de discriminations, qu’il s’agisse d’accéder au logement ou à des services de base. Mes collègues doivent en être conscients, certains ultramarins attendent des années pour obtenir une simple couverture sociale et sanitaire : en 2016, c’est intolérable ! Des procédures à rallonge et une administration qui ne comprend pas les exceptions ultramarines exposent nos étudiants à de graves difficultés, lourdes de conséquences pour certains. Pourriez-vous faire le point sur l’avancée de vos travaux à ce sujet, du moins s’agissant de la sécurité sociale ?
J’étais venue vous voir l’année dernière pour vous parler de la représentation de la médiature au sein de nos territoires d’outre-mer. Vous avez des délégués en Polynésie française que j’ai rencontrés. Je tiens à signaler que, pour la plupart d’entre eux, ils ne sont qu’indemnisés. Les moyens restent faibles. Vous avez hérité d’une extension de vos missions, mais les délégués ne sont pas toujours armés pour répondre à l’ensemble des demandes qui en découlent. C’est le cas en Polynésie où le représentant du Défenseur des droits, qui, auparavant, représentait avant tout le Défenseur des enfants, s’est senti démuni face à ces nouvelles missions, faute de moyens. Il faudrait donc renforcer les formations et les moyens dans ces territoires isolés.
La fracture numérique est l’un des problèmes qui ont été soulevés. Or si, comme vous l’avez dit, elle fait partie de vos priorités, elle devrait aussi l’être pour l’outre-mer. Nos délégués ont eu du mal à gérer le nouveau logiciel, à remplir les formulaires de demande, à assurer un suivi. Souvent retraités, ils n’ont pas la pratique de l’outil numérique. Je tenais à vous signaler ce problème très concret.
Enfin, êtes-vous en contact régulier avec les différentes associations d’aide aux victimes, jusque dans nos territoires les plus éloignés ?
Mme Anne-Yvonne Le Dain. Dans votre rapport, la carte de la répartition géographique des délégués du Défenseur des droits montre de grandes disparités, avec un rapport de 1 à 7 entre certains départements. Il serait intéressant de disposer également d’une carte permettant de comparer ce chiffre au nombre des affaires dont vous êtes saisis et à la population. Car ce sont sans doute aussi ces données, et non pas seulement la pénurie naturelle de l’État, qui expliquent que les délégués soient si peu nombreux ici ou là. Prise isolément, la carte peut faire croire à des injustices qui n’en sont peut-être pas.
En matière de terrorisme, vous semblez très attaché à l’instruction individuelle des affaires, un principe inhérent à nos démocraties qui proscrivent, du point de vue juridique et philosophique, l’idée de responsabilité et de culpabilité collectives. Mais après les attentats de Toulouse, de Montauban, de Paris et bien d’autres, nous avons entendu, dans le cadre de notre commission d’enquête sur le terrorisme, des victimes et leurs avocats s’étonner de ce que chaque affaire soit traitée séparément, sans possibilité de centralisation des informations, alors que celles-ci concernent des personnes qui ne peuvent être inculpées, qui sont tout au plus des témoins, mais dont on découvrira plus tard qu’ils sont eux aussi des terroristes. Comment, dans cette situation, éviter les instructions collectives ? C’est une question de droit et de déontologie. Est-ce au procureur de la République, est-ce à la police de garder en mémoire tous ceux qui ont été impliqués ou suspectés à un moment ou à un autre et dont on s’aperçoit, plusieurs années après, que l’on aurait mieux fait de les suivre à la trace ?
Notre collègue Erwann Binet est allé jusqu’à évoquer la suppression de l’anonymat du don de gamètes. Nous touchons là à une question essentielle : le principe même du don biologique dans notre tradition nationale – je n’ose dire de notre droit puisque, n’étant pas juriste, je ne le connais pas. L’anonymat est en France un trait fondamental du don, qui va de pair avec la gratuité ; certes cela nous distingue d’autres pays, mais n’est-ce pas le cas de bien d’autres choses dont nous nous glorifions, un peu trop peut-être ? Je ne vous demande pas nécessairement de réponse sur ce sujet délicat, monsieur Toubon.
M. Jacques Toubon. Je vais vous en faire une.
Mme Anne-Yvonne Le Dain. J’irai plus loin. La levée de l’anonymat toucherait en définitive, du point de vue du droit, à la distinction, essentielle en droit français, entre le droit du sol et le droit du sang. S’il n’y a plus d’anonymat, c’est le droit du sang qui prime. On donne aux gamètes, aux gènes, la force de la loi. Cette question n’a rien d’anodin, elle est fondamentale. Cela concerne aussi la gestation pour autrui : l’accouchement sous X protège les femmes. En levant l’anonymat du don de gamètes, du don d’organes, du don du sang, on rend les femmes coupables à vie de l’enfant dont elles auront accouché et dont elles ne sont ni la mère génétique ni la mère en droit. Dans bien des pays, en Inde, en Russie, aux États-Unis, un homme peut être le père d’un enfant qui aura eu trois mères : celle qui aura donné les gamètes, celle qui aura porté l’enfant et celle qui l’aura « réceptionné ». Je ne sais pas si j’ai très envie d’aller vers ce monde-là.
Je ne vous pose pas de question à ce sujet, car j’ai bien l’impression que vous avez envie d’être interrogé quant au fond sur ce point et que mon collègue Erwann Binet se fera un plaisir de s’en occuper. Mais j’y reviendrai, car je suis testarde !
M. Patrice Verchère. Je vous félicite et vous remercie, monsieur le Défenseur des droits, ainsi que l’ensemble de vos délégués territoriaux, pour tout le travail accompli ainsi que pour les échanges que nous avons eus avec vous, et qui sont importants même s’ils donnent lieu à des contestations.
Dans votre rapport, vous consacrez page 58 un paragraphe au « sens du silence » : le 12 novembre 2015 est entré en vigueur, dans le cadre du « choc de simplification », le principe selon lequel le silence de l’administration vaut désormais acceptation. Vous en dites assez peu, car il est trop tôt pour en dresser un bilan, mais vous évoquez l’inventaire à la Prévert des exceptions à ce principe : il en ressort que l’on a rendu quelque chose de simple très compliqué. L’inquiétude se fait jour chez les fonctionnaires, notamment territoriaux, et chez les citoyens : comment appliquer le principe, à moins d’aller systématiquement consulter les listes sur la page du site Légifrance dont vous donnez le lien dans le rapport ? Vous semblez vous préoccuper du travail supplémentaire que va engendrer cette réforme, qui risque de susciter beaucoup de contestations et de contentieux. Est-ce bien le cas ?
M. le président Dominique Raimbourg. J’aimerais à mon tour vous remercier, monsieur le Défenseur des droits. La vivacité de nos débats témoigne de l’intérêt que nous accordons à vos travaux.
Quelques questions très pragmatiques sur l’état d’urgence. Vous avez formulé plusieurs recommandations au sujet des perquisitions. Premièrement, mettre les enfants à l’écart et les faire encadrer par du personnel non cagoulé. Avez-vous reçu des réponses à ce sujet ? La pratique a-t-elle changé ? Deuxièmement, en cas de dommages matériels, notamment de bris de porte, la situation a-t-elle évolué concernant l’indemnisation lorsque la perquisition n’est pas fructueuse ? Y a-t-il désormais des indemnisations spontanées ? Troisièmement, vous-même et la CNCDH avez préconisé la remise d’un procès-verbal de perquisition. Avez-vous été suivis ?
M. Jacques Toubon. À tout seigneur tout honneur, monsieur le président ; je commencerai donc par vos questions, d’autant plus facilement que je peux vous répondre trois fois « non » ! Je n’ai pas de réponse concernant les enfants, je n’ai pas de réponse concernant l’indemnisation, je n’ai pas de réponse concernant le procès-verbal. Mais vous avez eu le privilège d’en obtenir à l’occasion du récent débat législatif, lors de la discussion des amendements ; dans ce cadre, le ministre a refusé les dispositions relatives aux enfants. Pour ma part, je n’ai pas eu la faveur d’une réponse.
Monsieur Verchère, la question que vous soulevez est en effet une source de vive préoccupation, non seulement à cause de la complication induite, mais aussi et surtout parce que bien des fonctionnaires, dans le doute, refusent ! En d’autres termes, une mesure censée faciliter l’accès du citoyen à l’administration finit, pour des raisons que l’on peut comprendre, par créer un nouvel obstacle. Bernard Dreyfus, mon délégué général à la médiation, grand spécialiste de ces questions, qui participe aux réflexions sur la simplification, pourra vous donner tous les éléments. Honnêtement, je crois que, dans cette affaire, on a agi de manière un peu improvisée.
Madame Sage, je n’ai aucune idée de ce que représente le potentiel de saisines pour discrimination. Mais il est possible de s’appuyer sur la fameuse enquête « Trajectoires et origines » de l’Institut national d’études démographiques (INED), réalisée sur dix ans et publiée il y a deux mois dans son intégralité : elle distingue discriminations réelles, substantielles et rapportées. Cela donne quelques indications, sans permettre de déterminer combien de réclamations je devrais recevoir ; je sais en tout cas qu’avec 5 000, nous sommes loin du compte.
Je suis d’autant plus attentif aux territoires d’outre-mer que j’ai débuté ma carrière administrative rue Oudinot, au cabinet du secrétaire d’État chargé de l’outre-mer, et que je n’ai jamais cessé de m’en préoccuper, ni au cabinet du Premier ministre, ni au Parlement, ni au Gouvernement. Je parlerai avec mon directeur du réseau territorial de la situation des délégués de Polynésie. Je l’ai dit, je suis en train d’accroître le nombre de délégués et d’intensifier leur travail, et je ne m’arrêterai évidemment pas à l’Hexagone.
Il est exact que le statut des délégués est difficile : il s’agit de bénévoles, légèrement indemnisés. Mais je ne vois pas comment je pourrais ne pas traiter ceux de l’outre-mer comme ceux du reste du territoire de la République.
Quant aux associations de victimes, je suis spécifiquement en relation avec celles qui défendent les victimes de la délinquance, du terrorisme, et avec le fonds de garantie.
Madame Le Dain, le rapport court qui vous a été distribué doit être complété par le rapport complet disponible en ligne et dans lequel vous trouverez la réponse à votre question sur la répartition territoriale des saisines, rapportée à la population. Elle est à peu près stable.
S’agissant de votre question sur la justice, je rappellerai l’une des critiques que j’ai formulées à propos du projet de loi relatif au renseignement lorsque vous l’examiniez : il n’y avait pas d’interface entre la partie administrative – recueil de renseignements, etc. –, qui peut concerner un groupe, comme vous l’avez dit, et le dossier judiciaire. Ce vrai problème est peut-être résolu par les textes dont vous débattez actuellement, mais je n’en suis pas tout à fait sûr.
Enfin, en matière d’anonymat du don de gamètes, les choses me semblent très claires. Si l’on se place dans la perspective des textes de bioéthique, je suis partisan du maintien de l’anonymat. Mais, eu égard à la filiation et à l’égalité, la réponse pourrait être autre. Sur ce sujet, je vous répondrai donc comme à M. Erwann Binet : le point de vue n’est pas le même selon que l’on part de l’extension de la loi de 1994 ou des libertés et de l’égalité. Et c’est ce dernier point de vue que je vous encourage à adopter même si, vous l’avez fort bien souligné, cette question pourrait faire partie de celles pour lesquelles il n’y a aucune raison de supprimer l’exception française.
M. le président Dominique Raimbourg. Merci, monsieur le Défenseur des droits.
——fpfp——
© Assemblée nationale