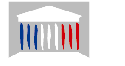______
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 5 octobre 2016.
RAPPORT
FAIT
AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE, SUR LA PROPOSITION DE LOI (n° 3997)
renforçant la lutte contre le terrorisme
PAR M. Éric CIOTTI,
Député
——
SOMMAIRE
___
PAGES
INTRODUCTION 7
I. FACE À L’INTENSITÉ DE LA MENACE DU TERRORISME ISLAMISTE, NOTRE PAYS N’A PAS PRIS TOUTES LES MESURES QUI S’IMPOSAIENT 9
A. NOTRE PAYS, DUREMENT TOUCHÉ PAR LES ATTENTATS, DEMEURE EXPOSÉ, À UN NIVEAU ÉLEVÉ, À LA MENACE DU TERRORISME ISLAMISTE 9
1. Des attentats d’une ampleur et d’une gravité inédites 9
2. Un risque toujours renforcé de nouvelles attaques 10
B. LES MESURES PRISES JUSQU’À AUJOURD’HUI S’AVÈRENT INSUFFISANTES POUR GARANTIR LA SÉCURITÉ DE NOS CONCITOYENS 11
1. Depuis 2012, quatre lois prorogeant l’état d’urgence et cinq lois renforçant la lutte contre le terrorisme… 11
2. … mais de nombreuses propositions de l’opposition à l’Assemblée nationale et de la majorité sénatoriale repoussées 14
II. UNE PROPOSITION DE LOI POUR COMBLER LES LACUNES DE NOTRE LÉGISLATION CONTRE LE TERRORISME 15
A. MIEUX SUIVRE ET CONTRÔLER LES INDIVIDUS RADICALISÉS REPRÉSENTANT UNE MENACE GRAVE POUR LA SÛRETÉ DE L’ÉTAT (articles 1er et 2) 16
B. ÉLOIGNER DU TERRITOIRE LES ÉTRANGERS MENAÇANT L’ORDRE PUBLIC (articles 3 à 5) 17
1. L’interdiction du territoire français, une peine complémentaire efficace qu’il convient de renforcer (article 3) 17
2. Faciliter l’expulsion des étrangers menaçant l’ordre public (articles 4 et 5) 18
C. RENFORCER L’ARSENAL PÉNAL ET PÉNITENTIAIRE EN MATIÈRE DE LUTTE CONTRE LE TERRORISME (articles 6 à 11) 19
1. Compléter notre législation anti-terroriste par un nouveau délit de séjour intentionnel sur un théâtre d’opérations terroristes (article 7) 19
2. Durcir la prise en charge et le suivi des détenus terroristes ou islamistes (articles 8 à 11) 20
a. La suppression des réductions de peine supplémentaires pour les personnes condamnées pour terrorisme (article 8) 20
b. L’assouplissement des modalités de fouilles des détenus terroristes ou prosélytes (article 9) 21
c. Le renforcement du régime de détention au sein des unités dédiées à la prise en charge des détenus islamistes (article 10) 22
d. L’« isolement électronique » de l’ensemble des détenus (article 11) 23
3. Placer en rétention ou sous surveillance de sûreté les criminels terroristes particulièrement dangereux à leur sortie de prison (article 6) 23
D. AMÉLIORER LE CADRE JURIDIQUE DE LA LÉGITIME DÉFENSE DES POLICIERS (article 12) 25
DISCUSSION GÉNÉRALE 27
EXAMEN DES ARTICLES 41
Chapitre Ier – Dispositions relatives au suivi et au contrôle des individus radicalisés constituant une menace à la sûreté de l’État 41
Article 1er : Contrôle des individus constituant une menace grave pour la sécurité et l’ordre public 41
Article 2 : Création, à titre expérimental, d’un fichier des personnes radicalisées constituant une menace à la sécurité publique ou à la sûreté de l’État 50
Chapitre II – Dispositions applicables aux étrangers menaçant l’ordre public ou coupables de délits et crimes passibles de cinq ans de prison 57
Article 3 (art. L. 131–30 du code pénal) : Peine complémentaire d’interdiction du territoire français à l’encontre des étrangers déclarés coupable d’un crime ou d’un délit puni d’une peine d’au moins cinq ans d’emprisonnement 57
Article 4 (art. L. 521–1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) : Expulsion des étrangers faisant l’objet d’une fiche « S » ou inscrits au fichier des personnes radicalisées constituant une menace à la sécurité publique ou à la sûreté de l’État 63
Article 5 (art. L. 521–1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) : Extension des possibilités d’expulsion au cas des étrangers coupables de tout délit ou crime passible d’au moins cinq ans d’emprisonnement 65
Après l’article 5 66
Chapitre III – Dispositions relatives à la création d’une rétention de sûreté pour les personnes condamnées pour crime terroriste, et d’un délit de séjour à l’étranger sur un théâtre d’opérations de groupements terroristes 67
Article 6 (art. 362, 706-25-15 à 706-25-24 [nouveaux], 723-37-1 [nouveau] et 723-38 du code de procédure pénale) : Rétention et surveillance de sûreté pour les personnes condamnées pour un crime terroriste 67
Article 7 (art. 421-2-7 [nouveau] et 421-5 du code pénal) : Délit de séjour intentionnel sur un théâtre d’opérations de groupements terroristes 79
Après l’article 7 83
Chapitre IV – Dispositions relatives aux droits et obligations des personnes détenues 84
Avant l’article 8 84
Article 8 (art. 721-1-1 du code de procédure pénale) : Suppression des crédits de réduction de peine supplémentaire pour les personnes condamnées pour terrorisme 85
Après l’article 8 88
Article 9 (art. 57 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire) : Assouplissement des modalités de fouilles des détenus terroristes ou prosélytes 88
Article 10 (art. 726-2 du code de procédure pénale) : Renforcement du régime de détention des détenus radicalisés ou prosélytes 91
Article 11 (art. 39 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire) : Interdiction en prison des équipements permettant de passer des communications électroniques 95
Chapitre V – Dispositions relatives à la légitime défense des policiers 98
Article 12 (art. L. 315–3 du code de la sécurité intérieure) : Doctrine d’emploi de l’usage de la force armée par les fonctionnaires de la police nationale 98
Mesdames, Messieurs,
« La France est en guerre. (…) Face aux actes de guerre qui ont été commis sur notre sol (…) au nom de cette (…) idéologie djihadiste, nous devons être impitoyables. (…) Nous devons (…) nous défendre, à la fois dans l’urgence et dans la durée. Il y va de la protection de nos concitoyens et de notre capacité à vivre ensemble ». C’est en ces termes que s’exprimait, le 16 novembre 2015, devant le Parlement réuni en Congrès à Versailles, M. François Hollande, Président de la République.
Près d’un an après les terribles attaques du 13 novembre 2015 et quelques mois après l’attentat qui a causé la mort de 86 personnes, le jour de la fête nationale, à Nice, dont votre rapporteur est l’un des députés, ces mots résonnent douloureusement.
Personne, à commencer par votre rapporteur, ne saurait s’ériger en donneur de leçon sur un sujet aussi sensible et complexe, et alors que la menace pesant sur notre pays est grande, diffuse, protéiforme et difficile à évaluer. Mais comment ne pas s’interroger sur le temps perdu et les étapes manquées dans la construction d’une législation antiterroriste à la hauteur des dangers auxquels est aujourd’hui exposé notre pays ?
Une partie de cet échec procède de choix faits, ces trente dernières années, au détriment de la sécurité de notre pays. La diminution constante de la part de la richesse nationale consacrée aux dépenses de défense, de sécurité et de justice entre 1980 et aujourd’hui a conduit à fragiliser la réponse de l’État face aux menaces qui pèsent sur la France, en particulier le terrorisme.
Alors que l’Assemblée nationale commence à débattre du projet de loi de finances pour 2017, il apparaît plus que jamais nécessaire de redonner à ces trois secteurs stratégiques les moyens humains et financiers dont ils ont besoin pour accomplir leurs missions, comme l’ont également appelé de leurs vœux l’ensemble des personnes auditionnées par votre rapporteur, qu’ils s’agissent de policiers, de magistrats ou de personnels de l’administration pénitentiaire.
Une autre part de cet échec trouve sa source dans la résistance de l’actuelle majorité à réarmer juridiquement nos services de renseignement, nos forces de police et de gendarmerie, nos magistrats et nos personnels pénitentiaires face à la menace djihadiste.
Certes, sous la XIVe législature, le Parlement a examiné de nombreux textes ayant pour objet, directement ou indirectement, la lutte contre le terrorisme (1).
Mais lors de l’examen de chacun de ces textes, dont la plupart a été adoptée avec le soutien de l’opposition, la majorité a repoussé nombre des propositions formulées par le groupe Les Républicains et destinées à mieux prévenir et réprimer le terrorisme, tant sur un plan administratif que judiciaire. Votre rapporteur observe d’ailleurs que, à plusieurs reprises, la majorité a rejeté certaines de ces propositions dans un premier temps avant de les accepter ultérieurement, selon une stratégie des « petits pas » préjudiciable à l’efficacité de notre système de lutte contre le terrorisme.
C’est la raison pour laquelle, alors que notre pays demeure exposé comme jamais à la menace du terrorisme islamiste, le groupe Les Républicains de l’Assemblée nationale, convaincu que toutes les mesures qu’exigent les circonstances actuelles n’ont pas été prises (I), a décidé d’inscrire à l’ordre du jour de sa journée réservée du jeudi 13 octobre 2016 un texte comportant les dispositions qu’il estime indispensable d’adopter pour combler les lacunes de notre législation antiterroriste (II).
I. FACE À L’INTENSITÉ DE LA MENACE DU TERRORISME ISLAMISTE, NOTRE PAYS N’A PAS PRIS TOUTES LES MESURES QUI S’IMPOSAIENT
La France fait aujourd’hui face à une menace de grande ampleur de la part de groupements et d’individus islamistes, récemment rappelée par les représentants des autorités chargées de l’antiterrorisme dans notre pays (A). Or, malgré l’adoption de plusieurs lois destinées à renforcer les moyens administratifs et judiciaires de la lutte contre le terrorisme, toutes les mesures susceptibles de garantir la sécurité des Français n’ont pas été prises à ce jour (B).
A. NOTRE PAYS, DUREMENT TOUCHÉ PAR LES ATTENTATS, DEMEURE EXPOSÉ, À UN NIVEAU ÉLEVÉ, À LA MENACE DU TERRORISME ISLAMISTE
Durement touchée par plusieurs attentats d’une ampleur et d’une gravité inédites (1), la France demeure une cible privilégiée du terrorisme islamiste (2).
Moins de trois ans après les actes meurtriers perpétrés par Mohammed Merah à l’encontre de militaires à Toulouse et Montauban puis contre l’école juive Ozar Hatorah en février et mars 2012, qui ont fait 7 morts, la France a connu, en début d’année 2015, l’attaque contre Charlie Hebdo par les frères Kouachi le 7 janvier, le meurtre d’une policière municipale à Montrouge le lendemain et la prise d’otage de l’Hypercacher de Vincennes par Amedy Coulibaly le surlendemain. Les attaques survenues entre le 7 et le 9 janvier 2015 ont fait au total 18 morts et 20 blessés.
Le 19 avril 2015, Aurélie Châtelain était assassinée. Le 26 juin de la même année, Yassin Salhi décapitait Hervé Cornara, chef d’entreprise, à Saint-Quentin-Fallavier, dans l’Isère. Le 21 août, plusieurs passagers d’un train Thalys reliant Amsterdam à Paris déjouaient un attentat.
Le 13 novembre 2015, la France était une nouvelle fois frappée, cette fois-ci par des attentats terroristes multi-sites d’une ampleur inédite commis par trois commandos à Paris et au stade de France à Saint-Denis. Ces tueries causaient la mort de 130 personnes et en blessaient 493 autres.
Le 13 juin 2016, notre pays était frappé par le double meurtre de Magnanville, commis par Larossi Abballa contre Jean-Baptiste Salvaing, commandant de police, et sa compagne, Jessica Schneider, fonctionnaire du ministère de l’intérieur. Le 14 juillet, à Nice, Mohamed Lahouaiej-Bouhlel fonçait avec son camion dans la foule réunie pour célébrer la fête nationale, tuant 86 personnes et en blessant 434 autres.
Dernière attaque en date, le 22 juillet 2016, deux islamistes munis d’armes blanches, Adel Kermiche et Abdel Malik Nabil-Petitjean, prenaient en otage plusieurs personnes dans l’église de Saint-Étienne-du-Rouvray, près de Rouen, égorgeaient le père Jacques Hamel et blessaient un paroissien.
Ce lugubre rappel, qui porte à 237 le nombre de victimes décédées des suites d’un attentat islamiste dans notre pays depuis janvier 2015, ne doit pas non plus faire oublier les nombreuses tentatives déjouées ou avortées, comme le projet récent d’un commando féminin dévoilé après la découverte de bouteilles de gaz dans une voiture à proximité de Notre-Dame-de-Paris.
Ainsi qu’il l’avait indiqué au journal Le Monde en septembre, le procureur de la République près le tribunal de grande instance (TGI) de Paris, M. François Molins, a rappelé à votre rapporteur que « l’affaiblissement de l’État islamique en zone irako-syrienne constitue un facteur qui renforce le risque d’attentat ».
En juillet 2016, 2 147 ressortissants français, ou étrangers résidant en France, étaient connus des services de renseignement pour leur implication dans les filières syro-irakiennes. Parmi eux, 898 avaient manifesté des velléités de départ et plus de 1 000 avaient séjourné dans la zone ; 680 adultes y étaient toujours présents, dont un tiers de femmes ; 187 étaient morts au cours de combats. Il y aurait par ailleurs – chiffre effrayant – 420 mineurs, dont 18 combattants. Enfin, 179 individus étaient en transit dans un pays tiers pour rejoindre la zone ou en revenir et 203 étaient revenus sur le territoire français. Cette question du retour des individus depuis les zones de combat, et plus encore avec le recul de Daech sur zone, constitue et constituera un défi considérable, pour la France et pour l’Europe (2).
Entendu, en mai 2016, par la commission de la Défense nationale et des forces armées, M. Patrick Calvar, directeur général de la sécurité intérieure, soulignait que la France « est aujourd’hui, clairement, le pays le plus menacé ». Il rappelait « qu’un des numéros de la revue francophone de Daech, Dar al Islam, titrait en une : " Qu’Allah maudisse la France " », qu’« Al-Qaïda au Maghreb islamique (AQMI), en tant qu’organisation héritière du Groupe islamique armé (GIA) des années 1990, considère toujours la France comme l’ennemi numéro un et [qu’]Al-Qaïda dans la péninsule arabique (AQPA) nous stigmatise de la même façon ». Il concluait ainsi son propos : « la question relative à la menace n’est pas de savoir "si", mais "quand" et "où" » (3).
Entendus par votre rapporteur, M. François Molins et Mme Camille Hennetier, vice-procureure, cheffe de la section antiterroriste au TGI de Paris, ont aussi souligné les dangers constamment élevés auxquels notre pays demeure exposé, en provenance en particulier de trois types d’individus :
– d’abord, des nombreux islamistes détenus dans un établissement pénitentiaire qui n’ont peur de rien et rien à perdre, comme en témoigne l’agression à l’arme blanche, le 3 septembre dernier, de deux surveillants au sein de l’unité de prévention de la radicalisation de la maison d’arrêt d’Osny ;
– ensuite des mineurs, qui se radicalisent rapidement sous l’influence de « maîtres à penser » situés à l’étranger et grâce aux réseaux sociaux ;
– enfin, des individus « isolés » qui s’engagent dans l’islamisme radical et le terrorisme à bas bruit, à la marge des mécanismes de surveillance de nos services de renseignement.
Ce bilan dramatique et ce contexte préoccupant justifient, aux yeux de votre rapporteur, un changement de paradigme dans la lutte contre le terrorisme.
B. LES MESURES PRISES JUSQU’À AUJOURD’HUI S’AVÈRENT INSUFFISANTES POUR GARANTIR LA SÉCURITÉ DE NOS CONCITOYENS
Malgré de nombreux textes discutés ces derniers mois, tous votés par le groupe Les Républicains de l’Assemblée nationale dans une démarche de responsabilité (1), notre législation demeure incomplète et insuffisante pour lutter efficacement contre le terrorisme, faute d’avoir notamment adopté plusieurs mesures administratives et judiciaires fortes proposées par l’opposition (2).
1. Depuis 2012, quatre lois prorogeant l’état d’urgence et cinq lois renforçant la lutte contre le terrorisme…
Notre pays a enrichi, ces trente dernières années, l’arsenal juridique à la disposition des services d’enquête et des magistrats pour mieux détecter et réprimer les menaces terroristes pesant sur notre pays : création d’une compétence concurrente nationale des juridictions pénales parisiennes en matière de terrorisme et application à ce domaine de règles procédurales dérogatoires (4) ; répression de l’association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste (5) ; extension des règles procédurales dérogatoires, comme la garde à vue prolongée à 6 jours (6) ou l’intervention de l’avocat différée à la 72e heure (7) …
–– La loi n° 2012-1432 du 21 décembre 2012 relative à la sécurité et à la lutte contre le terrorisme a en particulier permis d’appliquer la loi pénale française aux crimes et délits qualifiés d'actes de terrorisme commis à l'étranger par un Français ou par une personne résidant habituellement sur le territoire français.
–– La loi n° 2014-1353 du 13 novembre 2014 renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme a complété cette législation. Il s’agit, sur le plan administratif, de la création d’un dispositif d’interdiction de sortie du territoire et du renforcement des mesures d’assignation à résidence et, sur le plan judiciaire, de la création d’un délit d’entreprise terroriste individuelle, de la facilitation des perquisitions de données informatiques, de l’extension de l’enquête sous pseudonyme à l’ensemble de la criminalité et de la délinquance organisées ou de la possibilité de capter des données informatiques reçues ou émises par des périphériques audiovisuels de type Skype.
–– La loi n° 2015-912 du 24 juillet 2015 relative au renseignement a doté notre pays d’un cadre juridique de surveillance administrative des activités susceptibles de porter atteinte à certains intérêts protégés, par la mise en place d’un régime d’autorisation des techniques de recueil de renseignements sous un double contrôle administratif et juridictionnel, sans toutefois adopter, à ce moment-là, les dispositions nécessaires à la création d’un véritable service du renseignement pénitentiaire.
–– La loi n° 2015-1556 du 30 novembre 2015 relative aux mesures de surveillance des communications électroniques internationales a permis d’autoriser, aux seules fins de défense et de promotion des intérêts fondamentaux de la Nation, la surveillance des communications qui sont émises ou reçues à l'étranger.
–– La loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale a accru les moyens mis à la disposition des juges d’instruction et des procureurs. Ils peuvent désormais utiliser des dispositifs techniques spéciaux d’investigation, dont certains étaient jusque-là réservés aux services de renseignement ou à l’instruction. Les perquisitions domiciliaires nocturnes, en enquête comme à l’instruction, ont été facilitées. Des dispositions ont amélioré la protection des témoins menacés.
Cette loi a également créé de nouvelles infractions terroristes en incriminant la consultation habituelle de sites faisant l’apologie du terrorisme ou provocant à la commission d’actes de terrorisme, infraction qui a déjà donné lieu à de nombreuses et sévères condamnations, ainsi que l’entrave au blocage de tels sites.
Elle a enfin donné la possibilité au Gouvernement d’intégrer le renseignement pénitentiaire dans la communauté du renseignement, mesure réclamée par votre rapporteur depuis longtemps.
La même loi a accru l’efficacité des contrôles d’identité, décidés par le procureur de la République et sous son contrôle, en autorisant l’inspection visuelle et la fouille des bagages. Les personnes dont le comportement paraîtrait lié à des activités terroristes peuvent désormais être retenues, afin d’examiner leur situation, pendant une durée maximum de quatre heures, à laquelle le procureur de la République peut mettre fin à tout moment. Les personnes qui se sont rendues ou ont manifesté l’intention de se rendre sur des théâtres d’opérations terroristes peuvent également faire l’objet d’un contrôle administratif à leur retour.
–– La loi n° 2016-987 du 21 juillet 2016 prorogeant l’application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence et portant mesures de renforcement de la lutte antiterroriste a durci les modalités d’aménagement de peine des personnes condamnées pour terrorisme (8), allongé les délais de détention provisoire pour les mineurs – de plus en plus nombreux – mis en cause dans des procédures terroristes, aggravé les peines encourues en matière d’association de malfaiteurs en vue d’une entreprise terroriste (9) et rendu systématique le prononcé de la peine complémentaire d’interdiction du territoire français pour les condamnés terroristes étrangers.
Elle a également prolongé, à la demande du groupe Les Républicains, la durée du contrôle administratif pouvant être prononcé à l’encontre des personnes revenant de théâtre d’opérations de groupements terroristes.
La même loi a renforcé la sécurité de la détention des prévenus terroristes arrêtés vivants afin de permettre leur jugement et leur condamnation et ainsi d’éviter leur suicide en détention provisoire, comme ce fut le cas, à la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis, de Yassin Salhi, auteur de l’attaque de Saint-Quentin-Fallavier. À cette fin, elle a sécurisé juridiquement la vidéosurveillance permanente dont peuvent faire l’objet ces détenus, dont « l’évasion ou le suicide pourraient avoir un impact important sur l’ordre public eu égard aux circonstances particulières à l’origine de leur incarcération et à l’impact de celles-ci sur l’opinion publique » (10).
–– À cette législation ordinaire s’est ajoutée, depuis le mois de novembre 2015, la législation de l’état d’urgence.
Le soir des attentats du 13 novembre, le Président de la République a décrété l’état d’urgence sur l’ensemble du territoire national. Par une loi du 20 novembre 2015 (11), le Parlement a autorisé, une première fois, sa prolongation pour trois mois et également renforcé le cadre juridique de l’état d’urgence. Cette légalité d’exception a été, ensuite, prorogée pour trois mois supplémentaires par la loi du 19 février 2016 (12), puis pour deux mois par la loi du 20 mai 2016 (13) et enfin pour six mois par la loi du 21 juillet 2016 (14), qui a notamment introduit – enfin ! – la possibilité pour le représentant de l’État dans le département d’autoriser les contrôles d’identités, la fouille des bagages ainsi que la visite des véhicules.
Cette législation d’urgence a par ailleurs permis de moderniser et de renforcer notre cadre juridique en période de péril imminent en créant un régime de saisie administrative des systèmes informatiques ainsi qu’une retenue administrative lors de la perquisition.
2. … mais de nombreuses propositions de l’opposition à l’Assemblée nationale et de la majorité sénatoriale repoussées
Malgré ces améliorations de notre législation, dont de nombreuses ont été adoptées à l’initiative du groupe Les Républicains à l’Assemblée nationale et de la majorité sénatoriale, certaines propositions formulées par l’opposition ont été repoussées tant par le Gouvernement que par sa majorité. Tel a notamment été le cas lors de la discussion du projet de loi renforçant la lutte contre le crime organisé et des projets de loi prorogeant l’état d’urgence.
Votre rapporteur observe à cet égard le caractère incomplet ou partiel des dispositions votées dans les textes soumis à l’examen du Parlement au cours des derniers mois, s’agissant notamment des modalités d’exécution des peines prononcées pour terrorisme ou des mesures administratives susceptibles de mieux contrôler les personnes radicalisées ou de prévenir la commission d’actes de terrorisme.
En matière d’exécution des peines prononcées pour terrorisme, la loi du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé et la dernière loi prorogeant l’état d’urgence sont restées au milieu du gué. Si, à l’initiative du groupe Les Républicains, elle a rendu la « perpétuité réelle » possible pour les criminels terroristes (15) et exclu les condamnés terroristes du bénéfice de certains aménagements de peine (crédits « automatiques » de réduction de peine, suspension et fractionnement de peine, semi-liberté et placement à l’extérieur), elle n’a pas réglé le sort des criminels terroristes condamnés à une peine à temps ou ceux soumis à une période de sûreté « incompressible » qui, dans les conditions prévues à l’article 720-5 du code de procédure pénale, pourraient bénéficier d’un relèvement de cette période.
D’une part, ces personnes peuvent continuer de présenter, à leur sortie de prison, une particulière dangerosité. D’autre part, elles peuvent, selon le cas, bénéficier de plein droit de certains aménagements de peine (réductions de peine supplémentaires, libération sous contrainte, permissions de sortir, placement sous surveillance électronique…) ou demander à en bénéficier si leur période de sûreté est levée. Cela est d’autant plus préoccupant que nombre de ces personnes, qui pratiquent la technique de la dissimulation, présentent d’apparents gages de réinsertion sociale et sont éligibles à un aménagement de peine.
Votre rapporteur déplore qu’aient été rejetés, sans qu’ils soient réellement examinés au fond, des amendements instituant un droit général, pour l’ensemble des gendarmes et des fonctionnaires de police, à procéder à des contrôles d’identité, à des visites de véhicules et à des fouilles de bagages. Un tel renforcement apparaît pourtant indispensable, non seulement dans le contexte actuel de lutte contre le terrorisme, mais aussi en raison de l’évolution des formes de délinquance et de criminalité.
Dans ce contexte, il est urgent de doter nos services de sécurité de moyens juridiques leur permettant de remplir correctement leur mission face à une menace terroriste protéiforme et d’un niveau inégalé. Aussi la proposition de loi vise-t-elle à mieux surveiller, sur le plan administratif, les individus radicalisés représentant une menace grave pour la sûreté de l’État (A), à faciliter l’éloignement du territoire français des étrangers qui menacent l’ordre public (B), à consolider notre législation pénale et pénitentiaire de lutte contre le terrorisme (C) et à améliorer l’usage par les policiers d’une arme contre un individu dangereux (D).
Ainsi que l’avait souligné le Conseil d’État dans son avis sur le deuxième projet de loi visant à proroger l’état d’urgence, « lorsque, comme cela semble être le cas, le "péril imminent" ayant motivé la déclaration de l’état d’urgence trouve sa cause dans une menace permanente, c’est à des instruments pérennes qu’il convient de recourir ».
A. MIEUX SUIVRE ET CONTRÔLER LES INDIVIDUS RADICALISÉS REPRÉSENTANT UNE MENACE GRAVE POUR LA SÛRETÉ DE L’ÉTAT (articles 1er et 2)
On estime aujourd'hui à près de 9 300 le nombre de personnes signalées pour radicalisation violente, dont 4 600 via la plateforme de signalement et 4 900 via les états–majors de sécurité départementaux. 7 % des signalements ont trait à des départs effectifs, 30 % à des femmes et 20 % à des mineurs (16).
L’article 1ercrée un contrôle administratif à l’encontre des individus qui constituent, par leur comportement, une menace grave pour la sécurité et l’ordre public, mais pour lesquels il n’existe pas suffisamment d’éléments pour ouvrir une enquête judiciaire. Dans ce cas, il prévoit que le ministre de l’intérieur pourra prononcer les mesures suivantes :
– l’assignation à résidence avec obligation de présentation périodique aux services de police et de gendarmerie ;
– le placement sous surveillance électronique mobile ;
– le placement en centre de rétention spécialisé.
Sur le modèle du dispositif organisé par l’article L. 552–1 du code du séjour et de l’entrée des étrangers et du droit d’asile, quand un délai de quinze jours s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention, le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention, qui ne peut toutefois pas excéder soixante jours – soit soixante–quinze jours maximum. Au terme de ces soixante–quinze jours, le ministre pourra prendre une nouvelle décision d’assignation dans un centre de rétention ou de placement sous surveillance électronique.
De nombreux rapports parlementaires ont déploré l’absence d’un fichier consolidé, notamment entre les services de police et de gendarmerie des personnes radicalisées. L’article 2 autorise en conséquence le ministre de l’intérieur à mettre en œuvre, à titre expérimental et pour une durée de trois ans, un fichier des personnes radicalisées constituant une menace à la sécurité publique ou à la sûreté de l’État. Il faut noter que lors de son audition par votre rapporteur, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris, M. François Molins, a indiqué qu’un tel fichier serait utile pour les services de police et de gendarmerie.
La réponse pénale n’apparaît aujourd’hui plus adaptée à la part prise par les étrangers dans la délinquance. Il importe donc de renforcer significativement les mesures permettant l’éloignement des étrangers menaçant l’ordre public, soit par leur interdiction du territoire français (1°) soit par leur expulsion (2°).
1. L’interdiction du territoire français, une peine complémentaire efficace qu’il convient de renforcer (article 3)
L’interdiction du territoire français (ITF), prévue à l’article 131-30 du code pénal, est une peine qui peut être infligée de manière facultative par la juridiction répressive soit à titre de peine complémentaire à une peine d’emprisonnement ou d’amende, soit à titre de peine principale. Le principal objectif poursuivi par cette peine est de prévenir les atteintes à l’ordre public, en éloignant du territoire national les étrangers s’étant rendus coupables d’un crime ou d’un délit.
Le cadre juridique régissant la peine d’ITF a profondément évolué au cours de ces vingt dernières années. On a ainsi pu assister, d’une part, à un élargissement progressif de son champ d’application et, d’autre part, à la reconnaissance de la notion d’« étranger protégé », laquelle a pu, dans certains cas, rendre moins aisé le prononcé de cette peine.
Introduite par la loi n° 70-1320 du 31 décembre 1970 relative aux mesures sanitaires de lutte contre la toxicomanie et à la répression du trafic et de l’usage illicite de substances vénéneuses, l’ITF concernait, à l’origine, les seuls étrangers condamnés du chef d’infraction à la législation sur les stupéfiants. Elle a, par la suite, été progressivement étendue à de nouvelles infractions parmi les plus graves.
La loi n° 91-1383 du 31 décembre 1991 renforçant la lutte contre le travail clandestin et la lutte contre l’organisation de l’entrée et du séjour irréguliers d’étrangers en France a marqué la première étape importante dans l’évolution de la peine d’ITF. En effet, ce texte a élargi le champ d’application de la peine d’ITF aux crimes contre l’humanité, au proxénétisme, aux infractions liées au travail clandestin et à l’emploi irrégulier de travailleurs étrangers, aux infractions liées à l’aide à l’entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d’un étranger ainsi qu’à la soustraction à l’exécution d’un arrêté d’expulsion.
C’est également dans ce texte qu’est apparue, pour la première fois, la notion d’« étranger protégé » pour désigner les catégories d’étrangers qui, en raison de leurs liens avec la France, ne peuvent être condamnés à une peine d’ITF. Ces protections concernaient, à l’origine, les étrangers père ou mère d’un enfant français résidant en France et les étrangers mariés avec un conjoint de nationalité française.
Afin de renforcer la lutte contre les étrangers en situation irrégulière et contre ceux qui présentent une menace à l’ordre public en commettant certaines infractions, la loi n° 93-1027 du 24 août 1993 relative à la maîtrise de l’immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité a, dans le prolongement de la loi précitée du 31 décembre 1991, étendu la peine d’ITF à de nouvelles infractions – torture, actes de barbarie, violences ayant entraîné la mort, agressions sexuelles et autres types d’atteinte à l’intégrité physique ou psychique de la personne, etc.
La loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l’immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité a constitué une étape supplémentaire dans la protection de certaines catégories d’étrangers. Elle a introduit, dans le code pénal, deux nouveaux articles 131-30-1 et 131-30-2, lesquels précisent, d’une part, les cas dans lesquels l’interdiction de territoire doit être spécialement motivée et, d’autre part, les cas dans lesquels elle ne peut pas être prononcée.
Afin de rétablir un juste équilibre entre la protection de l’ordre public et le respect du droit à une vie familiale normale, la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l’immigration et à l’intégration a limité le champ des protections absolues et relatives dont bénéficient, aux termes des articles 131-30-1 et 131-30-2 précités du code pénal, certaines catégories d’étrangers. Ce texte a notamment allongé de deux à trois ans la durée de mariage requise pour qu’un étranger puisse bénéficier des protections prévues par le code pénal.
Il convient de souligner que l’apparition dès 1998, puis la consécration en 2003 et en 2006 de la notion d’« étranger protégé » sont conformes aux évolutions de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme dans ce domaine. Ainsi, si la Cour de Strasbourg n’a pas jugé la peine d’ITF contraire à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, elle a néanmoins précisé qu’un certain nombre de conditions devaient être respectées, afin de ne pas porter atteinte à la vie privée et familiale, telle qu’elle est garantie par l’article 8 de cette convention.
L’article 3 instaure, à l’article 131-30 du code pénal, des peines minimales d’ITF pour les personnes de nationalité étrangère qui, d’une part, ne peuvent justifier d’un séjour régulier en France depuis au moins dix ans et qui, d’autre part, ont été déclarées coupables de crimes ou délits punis d’une peine d’emprisonnement supérieure ou égale à cinq ans.
L’article 4 prévoit explicitement que l’expulsion peut être prononcée à l’encontre d’un étranger faisant l’objet d’une fiche « S », ou inscrit au fichier, créé par l’article 2 de la présente proposition de loi, des personnes radicalisées constituant une menace à la sécurité publique ou à la sûreté de l’État.
L’article 5 étend les possibilités d’expulsion au cas des étrangers coupables de tout délit ou crime passible d’au moins cinq ans d’emprisonnement.
C. RENFORCER L’ARSENAL PÉNAL ET PÉNITENTIAIRE EN MATIÈRE DE LUTTE CONTRE LE TERRORISME (articles 6 à 11)
La proposition de loi vise également à renforcer, sur le plan pénal et pénitentiaire, notre arsenal juridique de prévention et de lutte contre le terrorisme. À cet effet, elle complète la liste des infractions à caractère terroriste par un nouveau délit de séjour intentionnel sur un théâtre d’opérations de groupements terroristes (1), elle améliore la prise en charge et le suivi des détenus terroristes ou islamistes (2) et autorise le placement en rétention ou surveillance de sûreté des criminels terroristes demeurant particulièrement dangereux à leur sortie de prison (3).
1. Compléter notre législation anti-terroriste par un nouveau délit de séjour intentionnel sur un théâtre d’opérations terroristes (article 7)
Notre législation anti-terroriste comporte, sur le plan pénal, de nombreuses infractions, permettant de couvrir un large spectre des actes à caractère terroriste.
Les dernières lois votées en matière de lutte contre le terrorisme ont ajouté à ces infractions de nouveaux délits, notamment l’entreprise individuelle terroriste, la consultation habituelle de sites internet faisant l’apologie du terrorisme ou provoquant au terrorisme et l’entrave au blocage de tels sites. Elles ont également aggravé les peines encourues, la loi du 21 juillet 2016 prorogeant l’état d’urgence et renforçant la lutte antiterroriste ayant par exemple porté la sanction de la participation à une association de malfaiteurs terroriste criminelle de 20 à 30 ans de réclusion et la direction d’une telle association de 30 ans de réclusion à la réclusion criminelle à perpétuité.
Ainsi que l’ont relevé la commission d’enquête de l’Assemblée nationale (17) – présidée par votre rapporteur – et celle du Sénat (18) sur la lutte contre les réseaux et individus djihadistes, l’association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste constitue le pivot de la législation française en matière de lutte contre le terrorisme. Cette infraction permet une action judiciaire préventive au stade de la préparation d’actes terroristes, notamment à l’encontre des personnes de retour d’une zone de combat djihadiste.
Toutefois, l’association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste ne permet pas de poursuivre tous les individus de retour du djihad, pour quatre raisons principales :
– la clandestinité croissante de ces personnes rend plus difficile d’apporter la preuve des trois éléments constitutifs de l’infraction : l’existence d’indices matériels d’un groupement ou d’une entente de personnes décidées à agir de concert, la poursuite d’une entreprise de trouble grave à l’ordre public par l’intimidation ou la terreur et, surtout, l’adhésion volontaire au groupement avec la volonté d’y apporter son aide ;
– nombre de femmes qui quittent la France pour une zone de djihad n’ont pas de rôle actif dans les combats ;
– certaines personnes rejoignent des groupes rebelles qui ne revêtent parfois pas un caractère terroriste ;
– un motif strictement religieux ou humanitaire est souvent mis en avant pour justifier ces séjours.
C’est la raison pour laquelle l’article 7 incrimine, au sein d’un nouvel article 421-2-7 du code pénal, « le fait d’avoir séjourné intentionnellement à l’étranger sur un théâtre d’opérations de groupements terroristes afin d’entrer en relation avec un ou plusieurs de ces groupements, en l’absence de motif légitime ». Ce nouveau délit, qui serait puni de cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende, permettrait de sanctionner pénalement les personnes qui se rendent volontairement sur un théâtre d’opérations de groupements terroristes sans qu’il soit nécessaire de rapporter la preuve d’une intention criminelle, de la fréquentation d’un groupement ou de la participation à ses actions.
Conséquence et manifestation de la menace terroriste, les prisons et l’administration pénitentiaire, troisième force de sécurité intérieure, sont en première ligne dans la prise en charge des détenus terroristes et la prévention des comportements ou discours islamistes. Le nombre et le profil des détenus terroristes ou islamistes en détention, ainsi que leur caractère parfois prosélyte, appellent plusieurs réponses de la part des pouvoirs publics.
a. La suppression des réductions de peine supplémentaires pour les personnes condamnées pour terrorisme (article 8)
L’article 8 exclut les personnes condamnées pour terrorisme du bénéfice des crédits de réduction supplémentaires de peine octroyés à tous les « condamnés qui manifestent des efforts sérieux de réadaptation sociale » en application de l’article 721-1 du code de procédure pénale.
L’exclusion du bénéfice de ces réductions de peine se justifie par, d’une part, la dangerosité particulière des personnes condamnées pour terrorisme et, d’autre part, l’art de la dissimulation (taqîya) dont usent certaines de ces personnes pour se présenter sous un jour très favorable au juge de l’application des peines ou aux travailleurs sociaux.
Cette disposition s’inscrit dans le prolongement de celle votée par le Parlement dans la loi du 21 juillet 2016 prorogeant l’état d’urgence et renforçant la lutte contre le terrorisme, qui a également exclu les personnes condamnées pour terrorisme du bénéfice des crédits « automatiques » de réduction de peine prévus à l’article 721 du même code.
Comme l’ont rappelé à votre rapporteur les syndicats de l’administration pénitentiaire qu’il a entendus, la présence en nombre de détenus terroristes ou prosélytes en prison fait peser des menaces graves sur le maintien du bon ordre de l’établissement et la sérénité de la détention.
Par ailleurs, le nombre total d’objets prohibés saisis en prison – téléphones, armes, explosifs, argent, alcool, projections extérieures… – ne cesse d’augmenter depuis plusieurs dernières années, passant de 13 852 en 2007 à 56 149 en 2014.
Dans ce contexte, l’article 9 assouplit les modalités selon lesquelles il est possible, depuis juin 2016, de procéder à des fouilles indépendantes de la personnalité des détenus. En effet, la loi du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé et le terrorisme a autorisé le chef d’établissement à ordonner des fouilles sans qu’il soit nécessaire d’individualiser cette décision au regard de la personnalité du détenu. Cette faculté, qui constitue une dérogation à la règle posée par l’article 57 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire, n’est possible que dans des lieux et pour une période de temps déterminés, « [l]orsqu’il existe des raisons sérieuses de soupçonner l’introduction au sein de l’établissement pénitentiaire d’objets ou de substances interdits ou constituant une menace pour la sécurité des personnes ou des biens ». Ces fouilles doivent être strictement nécessaires et proportionnées.
À ces conditions, le législateur a ajouté l’exigence de motivation spéciale de la décision de procéder à de telles fouilles et l’obligation de transmettre un rapport circonstancié au procureur de la République territorialement compétent et à la direction de l’administration pénitentiaire. L’article 9 supprime ces deux dernières conditions afin de faciliter l’organisation des fouilles sur des individus présentant une dangerosité pour la sécurité de la détention. Ces conditions, qui freinent l’organisation de telles fouilles, ne s’imposent pas juridiquement : toute fouille doit, par définition, être précédée d’une décision la justifiant et la motivant ; de surcroît, la transmission d’un rapport constitue simplement une obligation d’information sans incidence sur le déroulement des opérations.
c. Le renforcement du régime de détention au sein des unités dédiées à la prise en charge des détenus islamistes (article 10)
En réponse à la radicalisation croissante observée dans les prisons françaises, la direction de l’administration pénitentiaire a mis en place des unités dédiées à la prise en charge spécifique des détenus islamistes. Il apparaît toutefois que les critères d’affectation au sein de ces unités et le régime de détention qui s’y applique ne permettent pas d’atteindre les objectifs poursuivis par leur création.
Ces unités se sont déployées dans plusieurs établissements et selon des modalités diverses, à titre expérimental dans un premier temps, à partir de l’expérience lancée en octobre 2014 au centre pénitentiaire de Fresnes. Leur existence est désormais inscrite à l’article 726-2 du code de procédure pénale créé par la loi du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé et le terrorisme, ce qui n’empêche pas la poursuite des expérimentations.
Aujourd’hui, les quatre principales unités dédiées comptent 117 places réparties de la manière suivante : 26 à Fresnes, deux unités de 20 places à Fleury-Mérogis, 23 à Osny et 28 à Lille-Annœullin.
L’article 10 ne remet pas en cause l’économie générale du dispositif récemment entré en vigueur mais étend le champ d’application de ces unités et en précise le fonctionnement afin de renforcer l’isolement dont font l’objet les personnes qui y sont affectées.
Si le placement de détenus au sein de ces unités est aujourd’hui possible « lorsqu’il apparaît que leur comportement porte atteinte au maintien du bon ordre de l’établissement », l’article 10 l’autorise également dès lors qu’ils « exercent des pressions graves ou réitérées sur autrui en faveur d’une religion, d’une idéologie ou d’une organisation violente ou terroriste ».
Cet article pose l’encellulement individuel comme règle de détention au sein de ces unités afin d’isoler le plus possible la personne des autres détenus et de faciliter son travail d’introspection. C’est d’ailleurs cette règle qui s’applique déjà dans les unités mises en place au sein des quatre établissements précédemment mentionnés.
Par ailleurs, il supprime la prise en charge spécifique dont font l’objet ces détenus. En effet, les programmes de prise en charge aujourd’hui mis en place dans les unités dédiées apparaissent disparates, ont un contenu contestable et poursuivent des objectifs insuffisamment définis, ne permettant pas d’en inscrire l’existence dans la loi.
Enfin, dans le même souci de réduire le prosélytisme à l’égard des autres détenus, cet article prévoit que les activités proposées en détention devront s’exercer, pour les personnes concernées, à l’écart de tout autre détenu, sauf décision contraire du chef d’établissement. C’est le principe inverse qui prévaut aujourd’hui.
Le dernier volet pénitentiaire des mesures portées par la proposition de loi visent à conférer valeur législative à l’interdiction, aujourd’hui réglementaire, des téléphones portables en prison.
Le droit de téléphoner aux membres de leur famille reconnu aux personnes condamnées et, sur autorisation de l’autorité judiciaire, aux prévenus, ainsi que la possibilité d’être autorisés à téléphoner à d’autres personnes pour préparer leur réinsertion, sont reconnus par l’article 39 de la loi pénitentiaire de 2009. Ce droit et cette possibilité s’exercent par l’intermédiaire de terminaux de téléphone filaire fixe, autrement dits des « points-phone ».
La reconnaissance de ce droit d’accès au téléphone, destinée à réduire la tentation de se procurer un téléphone portable et à diminuer les trafics et pressions, n’a pas empêché l’explosion du nombre de téléphones portables saisis en détention ces dernières années. Alors que moins de 5 000 étaient saisis en 2007, ce sont plus de 31 000 téléphones et accessoires qui ont été saisis en 2015.
L’article 11 vise à inscrire dans la loi l’interdiction de ces téléphones ainsi que de tout autre terminal de communications électroniques, règle aujourd’hui fixée par des circulaires ou des règlements d’établissements. Une telle consécration législative interdira toute tentative d’autoriser leur usage en détention par voie réglementaire, ainsi que le propose par exemple, sous certaines conditions, la Contrôleure générale des lieux de privation de liberté. Seraient concernés par cette interdiction tous les équipements terminaux permettant de passer des communications, qu’il s’agisse « d’équipements terminaux radioélectriques d’accès à un service de téléphonie » ou « d’équipements terminaux d’accès à un service de communications électroniques ».
3. Placer en rétention ou sous surveillance de sûreté les criminels terroristes particulièrement dangereux à leur sortie de prison (article 6)
La lutte contre le terrorisme ne saurait être complète et efficace si aucune réponse n’est apportée à la question des criminels terroristes qui continuent de présenter une dangerosité particulière après avoir purgé leur peine. À défaut de mesures particulières de surveillance à leur sortie de détention, il est fort à craindre que certains d’entre eux passent de nouveau à l’acte et exposent la société à d’importantes menaces.
Un constat similaire était dressé il y a près de dix ans quant au devenir, à leur sortie de prison, des personnes condamnées pour des crimes sexuels présentant une particulière dangerosité en raison de troubles graves de la personnalité et d’un risque élevé de récidive. À l’époque, notre droit ne comportait pas de dispositif suffisamment protecteur pour prémunir la société de la dangerosité de ces criminels :
– le suivi socio-judiciaire, mesure prononcée par la juridiction de jugement, ne soumet la personne concernée qu’à certaines obligations (injonctions de soins, placement sous surveillance électronique mobile, assignation à domicile…) pour une durée fixée par la décision de condamnation ;
– l’inscription au fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes (FIJAISV) n’oblige les personnes qui y sont inscrites qu’à justifier régulièrement de leur résidence après leur condamnation ;
– la surveillance judiciaire permet au juge de l’application des peines de continuer à surveiller une personne à sa sortie de prison, en lui imposant le cas échéant une injonction de soins et une surveillance électronique mobile, mais pendant une durée qui ne peut excéder celles des réductions de peines accordées.
En 2008 et 2010, le législateur avait alors créé, aux articles 706-53-12 à 706-53-22 du code de procédure pénale, deux mesures de sûreté. Il s’agit, d’une part, de la rétention de sûreté, permettant le placement, sous certaines conditions mais sans limitation de durée, au centre socio-médico-judiciaire de sûreté de Fresnes, des personnes condamnées pour certains crimes sexuels ou violents qui « présentent une particulière dangerosité caractérisée par une probabilité très élevée de récidive parce qu’elles souffrent d’un trouble grave de la personnalité ». Il s’agit, d’autre part, de la surveillance de sûreté, mesure de milieu ouvert permettant le prolongement des mesures prévues dans le cadre de la surveillance judiciaire, sans limitation de durée, à l’égard de personnes présentant une moindre dangerosité mais un risque de commettre de nouveau certaines infractions.
L’article 6, qui crée de nouveaux articles 706-25-15 à 706-25-24 au sein du code de procédure pénale, vise à étendre à certains criminels terroristes la rétention et la surveillance de sûreté. Seraient concernées par ces mesures les personnes « condamnées à une peine de réclusion criminelle d’une durée égale ou supérieure à quinze ans pour les crimes prévus au 1° de l’article 421-1 (19)et aux articles 421-5 (20) et 421-6 (21) du code pénal ».
Le placement sous l’une de ces deux mesures de sûreté serait soumis à des conditions similaires à celles prévues pour les criminels sexuels ou violents mais en adaptant le dispositif au profil des condamnés terroristes, qui ne présentent pas nécessairement de troubles médicaux.
Strictement encadrée et soumise à la décision d’une juridiction, susceptible de recours, l’application de l’une de ces mesures aux personnes radicalisées condamnées pour terrorisme est conforme à la jurisprudence du Conseil constitutionnel telle qu’elle résulte de sa décision n° 2008-562 DC du 21 février 2008 (22). Elle s’inscrit également dans le cadre juridique posé par le Conseil d’État dans l’avis qu’il a rendu sur la constitutionnalité et la conventionalité de certaines mesures de prévention du risque de terrorisme, le 17 décembre 2015 (23).
Pour votre rapporteur, la rétention de sûreté, qui ne sera applicable qu’au terme de l’exécution de leur peine par les personnes qui commettront des infractions postérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi, n’est pas une « mesure miracle » mais contribuera, le temps venu, à mieux protéger nos concitoyens de criminels terroristes dangereux. Ainsi que l’évoquait M. François Molins, procureur de la République de Paris, à propos de la fonction de réadaptation et de resocialisation de la prison, « on ne fait pas boire un âne qui n’a pas soif. Lorsqu’on tombe sur des individus imprégnés par cette idéologie mortifère, les maintenir enfermés n’est peut-être pas la mission la plus noble, elle a au moins l’impérieuse vertu de protéger la société » (24).
L’absence actuelle de cadre légal de l’usage de la force armée met les policiers en situation d’insécurité juridique et peut les amener à hésiter à se défendre en cas d’agression violente, par crainte de poursuites administratives ou judiciaires sévères. Devant ce constat, trois options s’offrent au législateur :
— une modification du code pénal afin de créer une présomption de légitime défense à raison du statut de représentant des forces de l’ordre. C’est une solution que votre rapporteur écarte, observant d’ailleurs qu’elle ne fait plus l’objet de fortes attentes ;
— le statu quo, qui ne semble pas acceptable à votre rapporteur : laisser les policiers démunis sur le terrain reviendrait à s’accommoder d’une insécurité juridique dont ils continueraient à payer le prix ;
— le rapprochement des conditions d’usage des armes entre la police et la gendarmerie, cette dernière bénéficiant d’un cadre légal défini à l’article 2338–3 du code de la défense.
C’est la troisième option que retient l’article 12, qui propose d’appliquer aux policiers les règles aujourd’hui en vigueur pour l’usage de la force armée par les militaires de la gendarmerie. Il s’agit d’une doctrine d’emploi des armes et non d’une modification des règles de la légitime défense.
Lors de sa réunion du mercredi 5 octobre 2016, la commission des Lois procède à l’examen de la proposition de loi renforçant la lutte contre le terrorisme (n° 3997) (M. Éric Ciotti, rapporteur).
M. Éric Ciotti, rapporteur. « La France est en guerre », déclarait le Président de la République devant le Congrès réuni à Versailles le 16 novembre 2015. Nous partageons naturellement ce constat, mais nous en concluons aussi que toutes les dispositions devant permettre de nous adapter à ce climat de guerre n’ont pas été adoptées. La situation inédite que connaît notre pays nous impose de changer de cadre et d’adopter des mesures exceptionnelles. Force est de constater que les dispositions déjà adoptées sont certes nécessaires, mais qu’elles demeurent très largement insuffisantes.
La présente proposition de loi vise à pallier résolument ces lacunes et à appliquer un dispositif global de lutte et de prévention contre le terrorisme. À ce titre, et contrairement à ce que l’on a pu entendre dans les médias, notre droit nous offre des outils juridiques pour faire face à cet état de guerre ; encore faut-il avoir la volonté d’adopter ces dispositions. Dans son célèbre arrêt Dames Dol et Laurent de 1919, le Conseil d’État a donné une définition très claire des circonstances exceptionnelles, hélas réunies aujourd’hui : « les limites des pouvoirs de police dont l’autorité publique dispose pour le maintien de l’ordre et de la sécurité […] ne sauraient être les mêmes dans les temps de paix et pendant la période de guerre où les intérêts de la défense nationale donnent au principe de l’ordre public une extension plus grande et exigent pour la sécurité publique des mesures plus rigoureuses ».
Sur des sujets aussi essentiels, qui impliquent et conditionnent la sécurité des Français, il nous faut naturellement dépasser les clivages politiques traditionnels. C’est la raison pour laquelle le groupe Les Républicains a systématiquement soutenu les textes législatifs soumis ces dernières années à notre Assemblée en la matière. Lors de l’examen de chacun de ces textes, la majorité présidentielle a pourtant repoussé la plupart de nos propositions, alors même qu’elles n’étaient destinées qu’à mieux prévenir et réprimer le terrorisme sur un plan administratif et judiciaire. J’observe qu’après avoir rejeté certaines de ces propositions, le Gouvernement et la majorité les ont plusieurs fois acceptées ultérieurement selon une stratégie de petits pas que nous jugeons préjudiciable à l’efficacité de notre mécanisme de lutte contre le terrorisme. L’action conduite s’est en effet souvent résumée à réagir aux événements, non à les anticiper. Comment, dès lors, ne pas s’interroger sur le temps perdu et sur les rendez-vous manqués dans la construction d’une véritable législation efficace et pragmatique contre le terrorisme, à la hauteur des dangers auxquels notre pays est aujourd’hui durablement confronté ?
La présente proposition de loi contient donc un dispositif ambitieux, global et pérenne visant à mieux appréhender et réprimer le phénomène djihadiste dans son ensemble. Elle s’articule parfaitement avec le texte que Mme Kosciusko-Morizet défendra dans quelques instants.
L’article 1er instaure un contrôle administratif des individus qui représentent une menace grave pour la sécurité et pour l’ordre public mais à l’encontre desquels il est impossible d’ouvrir une enquête judiciaire faute d’éléments suffisants. Dans ce cas précis, le ministre de l’intérieur pourrait prendre trois types de mesures : l’assignation à résidence, le placement sous surveillance électronique mobile, si possible géolocalisée, et le placement en centre de rétention spécialisé – c’est ce dernier dispositif qui fera sans doute le plus débat.
L’article 2 autorise la création d’un fichier de personnes radicalisées constituant une menace pour la sécurité publique ou la sécurité de l’État. Lors de son audition, le procureur de la République de Paris a exprimé son intérêt pour ce fichier nouveau au contenu resserré, qui centraliserait les fichiers existants et fournirait une base pertinente justifiant les mesures administratives prévues à l’article 1er.
L’article 3 instaure des peines minimales d’interdiction du territoire français pour les personnes de nationalité étrangère qui ne peuvent justifier d’un séjour régulier en France depuis au moins dix ans et qui auraient été déclarées coupables de crimes ou de délits punis d’une peine d’emprisonnement supérieure ou égale à cinq ans.
L’article 4 prévoit explicitement que l’expulsion peut être prononcée à l’encontre d’un étranger faisant l’objet d’une fiche « S » ou inscrit au fichier créé par l’article 2.
L’article 5 étend les possibilités d’expulsion aux étrangers coupables de tout délit ou crime passible d’au moins cinq ans d’emprisonnement.
Enfin, la lutte contre le terrorisme ne saurait être complète si aucune réponse n’est apportée à la question essentielle et très préoccupante des criminels terroristes qui continuent de présenter une dangerosité particulière après avoir purgé leur peine. Lors des auditions auxquelles nous avons procédé, le procureur de la République de Paris, M. François Molins, et Mme Camille Hennetier, vice-procureure, responsable du pôle antiterroriste, nous ont indiqué en toute clarté que, selon eux, le principal danger tenait actuellement à la situation explosive qui règne dans les prisons ; le garde des Sceaux, quant à lui, a plusieurs fois cité le chiffre de 1 400 détenus radicalisés – ils seraient même deux à trois mille selon les syndicats de l’administration pénitentiaire. Les tensions sont particulièrement inquiétantes dans certains établissements, où des actions concertées de prise de contrôle auraient été envisagées. La menace est donc grave.
Dans ce contexte, il faut aborder la situation de ceux qui sont appelés à sortir de détention et prendre des mesures claires de surveillance afin d’éviter que les intéressés – parfois radicalisés en prison – ne passent de nouveau à l’acte. Un constat similaire avait été dressé il y a près de dix ans sur un autre sujet également grave, celui des délinquants et criminels sexuels. En 2008 et 2010, le législateur avait adopté deux mesures de sûreté, l’une de rétention et l’autre de surveillance, applicables aux personnes présentant une dangerosité particulière caractérisée par une probabilité très élevée de récidive en raison d’un trouble grave de la personnalité. Nous voulons instaurer un dispositif similaire en matière de terrorisme, fondé sur deux notions juridiques distinctes : celle de la peine qui punit et celle de la sûreté qui protège la société.
C’est dans cet esprit que l’article 6 vise à étendre à certains terroristes ces deux mesures de sûreté, qui seraient strictement encadrées et soumises à la décision d’une juridiction susceptible de recours. Je précise que cette disposition est parfaitement conforme à la jurisprudence du Conseil constitutionnel et au cadre juridique établi par le Conseil d’État dans son avis du 17 décembre 2015. Cette rétention de sûreté contribuera à mieux protéger nos concitoyens contre les criminels terroristes dangereux. « On ne fait pas boire un âne qui n’a pas soif », rappelait le procureur Molins. « Lorsqu’on tombe sur des individus imprégnés par cette idéologie mortifère », poursuivait-il, « les maintenir enfermés n’est peut-être pas la mission la plus noble, mais elle a au moins l’impérieuse vertu de protéger la société. » C’est cet objectif qui nous guide.
L’article 7 incrimine le fait d’avoir séjourné intentionnellement à l’étranger sur un théâtre d’opérations de groupements terroristes afin d’entrer en relation avec l’un ou plusieurs d’entre eux, en l’absence de motif légitime. Nous reprenons là une mesure proposée par la commission des lois du Sénat. Je proposerai des amendements visant à améliorer ce dispositif à la suite des auditions auxquelles nous avons procédé, pour préciser notamment l’échelle des sanctions en alignant les peines encourues pour ce nouveau délit sur celles applicables au délit d’association de malfaiteur en relation avec une entreprise terroriste, soit dix ans d’emprisonnement.
L’article 8 exclut les personnes condamnées pour terrorisme du bénéfice des réductions de peine supplémentaires. La loi du 21 juillet 2016 relative à l’état d’urgence avait supprimé les crédits de réduction « automatiques » ; conformément aux positions que nous avons exprimées tout au long de nos débats sur le terrorisme, nous souhaitons y ajouter les réductions supplémentaires. Les syndicats de l’administration pénitentiaire, que nous avons entendus, ont insisté sur la présence de détenus terroristes et prosélytes qui font peser des menaces très graves sur le maintien du bon ordre des établissements pénitentiaires. D’autre part, le nombre total d’objets prohibés saisis en prison – téléphones, armes, explosifs, argent – n’a cessé d’augmenter, passant de 13 852 en 2007 à 56 149 en 2014.
Dans ce contexte, l’article 9 assouplit les modalités selon lesquelles il est possible, depuis juin 2016, de procéder à des fouilles indépendantes de la personnalité des détenus. C’est là aussi une mesure très importante pour mieux sécuriser nos établissements pénitentiaires.
En réponse à la radicalisation islamiste croissante que l’on observe dans les prisons françaises, la direction de l’administration pénitentiaire (DAP) a créé des unités de prévention de la radicalisation dans les établissements de Fleury-Mérogis, de Fresnes, de Lille-Annœullin et d’Osny. Leur mise en place a fait débat, mais, selon moi, leur utilité est avérée. Il apparaît toutefois que leur régime actuel ne permet pas d’atteindre les objectifs qui leur sont assignés. C’est pourquoi l’article 10 vise à étendre le champ de ces unités et à en préciser le fonctionnement afin, notamment, de renforcer l’isolement, aujourd’hui virtuel, des personnes qui y sont placées.
L’article 11 confère une valeur législative à l’interdiction, de nature réglementaire, des téléphones portables en prison, pour favoriser un renforcement de l’isolement électronique des détenus, comme l’a défendu notre collègue M. Philippe Goujon.
L’article 12 a trait à une question sur laquelle le groupe Les Républicains revient sans cesse : la légitime défense des forces de l’ordre. Il vise à rapprocher les conditions d’usage des armes dans la police et dans la gendarmerie.
Je présenterai plusieurs autres amendements visant à étendre l’accès aux fichiers à certains services de renseignements qui – chose incompréhensible – ne peuvent pas y recourir aujourd’hui, ou encore à informer les collectivités locales de la situation de personnes parties sur des théâtres de guerre afin que celles-ci ne puissent plus bénéficier de prestations sociales en France.
En somme, cette proposition de loi globale, responsable et exhaustive respecte nos principes fondamentaux tout en tenant compte de la situation exceptionnelle dans laquelle nous nous trouvons. Elle vise à démontrer que le cadre actuel n’est plus pertinent pour lutter face au terrorisme, compte tenu de l’ampleur et de la gravité de la menace qui pèse sur notre pays et dont attestent les attentats qui, depuis janvier 2015, nous ont frappés au cœur en faisant 240 victimes.
M. Sébastien Pietrasanta. La lutte contre le terrorisme nécessite unité – comme vous l’avez rappelé, monsieur le rapporteur –, sérieux et sang-froid. Nous devons refuser l’outrance et les caricatures. Le débat sur ce sujet est légitime, et je salue le groupe Les Républicains pour le dépôt de cette proposition de loi qui aura au moins le mérite de prolonger cette réflexion.
Ce texte, néanmoins, n’apporte guère de propositions nouvelles. Toutes les mesures qu’il contient ont déjà été débattues à l’occasion de précédents projets de loi. Il ressemble à une compilation de vieux disques rayés qui, sur le plan juridique, ne tournent plus vraiment.
Le groupe Socialiste, écologiste et républicain est opposé à cette proposition de loi. J’aurai l’occasion de l’expliquer sur le fond lors de l’examen des articles, dans le seul souci de l’efficacité et de la défense de notre État de droit qui, vous le savez, n’est pas qu’une simple argutie juridique. Je me contenterai donc en guise de propos liminaire de dire ceci : il ne s’agit pas de sectarisme de notre part, comme en atteste le fait que nous avons déjà – récemment encore, lors du débat sur la prolongation de l’état d’urgence en juillet – adopté de très nombreux amendements provenant de l’opposition.
Certaines des dispositions figurant dans votre proposition de loi sont déjà satisfaites, tandis que les autres sont juridiquement incertaines et inefficaces, voire contre-productives. Certaines sont même contraires à la Convention européenne des droits de l’homme ainsi qu’à la jurisprudence du Conseil constitutionnel. Le procureur de la République de Paris vous l’a d’ailleurs expressément rappelé lors de son audition, monsieur le rapporteur. Vous faites également abstraction de l’avis du 17 décembre 2015 dans lequel le Conseil d’État a analysé certaines de vos propositions et jugé qu’elles n’étaient pas juridiquement valables.
Deux écueils sont à éviter dans la lutte contre le terrorisme : prétendre que tout a été fait, céder à une fuite en avant. Dans le rapport de la commission d’enquête sur les attentats de 2015, M. Fenech et moi-même avons considéré que, depuis 2012, nous avons fait énormément. Nous avons légiféré de manière importante, renforcé nos effectifs, donné des moyens supplémentaires à nos services de renseignement. J’estime cependant que nous pouvons aller plus loin encore, notamment grâce aux quarante propositions que j’ai formulées. Aller plus loin ne signifie pas céder à une fuite en avant. Or c’est précisément ce que semble être votre proposition de loi, comme une manière pour vous de montrer que vous occupez le terrain – mais ce ne sont parfois que gesticulations.
Nous combattons un fanatisme meurtrier et nous gagnerons, je n’ai aucun doute à cet égard, mais ce ne sera pas grâce à des propositions telles que celles dont nous débattons ce matin, qui ne fait pas même l’unanimité dans votre propre famille politique.
M. Philippe Goujon. Nous attendions depuis longtemps une proposition de loi qui améliore notre dispositif de lutte contre le terrorisme. L’occasion nous est ici présentée, et nous pourrions faire preuve d’unité – comme nous l’avons fait en votant en faveur de tous les textes du Gouvernement en la matière, par esprit de responsabilité davantage que par conviction, tant ces propositions étaient insuffisantes sur bien des points.
Il ne s’agit pas par cette proposition de loi – dont je félicite les auteurs – de prolonger un débat intellectuel sur le terrorisme, mais de renforcer notre dispositif répressif et pénal. Les spécialistes le disent : la France est la première cible de Daech et la principale filière alimentant le djihad irako-syrien. Il faut aujourd’hui changer la nature des moyens consacrés à la lutte contre le terrorisme.
Comme l’a justement analysé M. Alain Bauer, cette forme de terrorisme se caractérise par une logique à deux vitesses : une dimension internationale prenant la forme d’attentats commis dans divers pays, l’autre spécifiquement française, les crimes étant perpétrés par des opérateurs francophones, voire français, installés depuis longtemps sur notre sol. À ce terrorisme pluriel, il convient d’apporter des réponses multiples pour affronter les délinquants fanatisés et les « lumpenterroristes » présentant des troubles psychiatriques.
Nous devons donc impérativement adapter notre réponse pénale. Il est vrai que nous avons examiné près d’une dizaine de lois antiterroristes depuis 2012. Ne prétendez pas qu’il n’est pas nécessaire d’envisager des mesures nouvelles, chers collègues, puisque vous nous avez vous-mêmes présenté de nombreuses lois sécuritaires et antiterroristes, ce qui signifie bien que vous n’aviez pas envisagé d’emblée toutes les situations. Chaque fois, je le répète, nous avons voté en faveur de ces textes, par esprit de responsabilité et d’unité, tout en regrettant que nos propositions soient rejetées avec mépris ou adoptées avec un temps de retard à l’occasion d’une loi ultérieure, alors qu’il faut avoir un temps d’avance : plutôt que de réagir à l’attentat précédent, mieux vaut anticiper l’attentat suivant. Le temps considérable qui a été perdu ne se rattrapera pas ; prémunissons-nous au moins pour l’avenir.
C’est l’objet de la présente proposition de loi, dont l’article 1er apporte une réponse indispensable concernant les individus susceptibles de passer à l’acte. Prétendre comme vous l’avez fait, monsieur Pietrasanta, que cette mesure est inconstitutionnelle serait faire fi de l’adaptation de la jurisprudence du Conseil constitutionnel au changement de circonstances qui s’est produit dans le cadre de son contrôle de constitutionnalité. C’est ainsi qu’il a jugée constitutionnelle la rétention de sûreté pour les criminels dangereux, l’hospitalisation d’office – et je n’oublie pas l’arrêt historique Dames Dol et Laurent du Conseil d’État. Notre rapporteur proposera des amendements à cet article 1er afin de mieux articuler les procédures administratives et judiciaires et de préciser l’assignation à résidence.
D’autre part, l’expulsion des étrangers faisant l’objet d’une fiche S ou auteurs de délits et de crimes passibles d’une peine de cinq ans d’emprisonnement, comme nous l’avions déjà prôné dans une proposition de loi défendue avec M. Ciotti dès la précédente législature, est une mesure de bon sens ; un amendement permettra en outre d’interdire l’accès de ces personnes au territoire national.
De même, il est légitime de prévoir – comme c’est le cas aux articles 6 à 8 – le durcissement du traitement des terroristes, actuellement très insuffisant, et d’aller plus loin que la seule suppression de l’automaticité des mesures de réduction de peine, qu’a obtenue l’opposition lors de la troisième prorogation de l’état d’urgence – un texte que nos amendements ont permis de rendre utile.
Quant à l’univers carcéral, chacun sait qu’il est le terreau du terrorisme et que tout doit être fait pour isoler réellement – j’insiste sur cet adverbe – les détenus radicalisés afin d’éviter les phénomènes de contagion. MM. Larrivé, Ciotti et moi-même nous sommes rendus, récemment, à la prison d’Osny suite à l’agression de deux surveillants par un djihadiste pourtant placé dans une unité de déradicalisation et faisant prétendument l’objet d’une surveillance particulière : nous avons constaté que cet individu avait pu entretenir en toute impunité des complicités et des contacts avec Daech et avec ses codétenus grâce à des moyens de communication électronique clandestins, entre autres. C’est pourquoi nous vous exhortons à adopter les préconisations que je vous proposais déjà l’année dernière dans une proposition de loi que vous avez rejetée – M. Pietrasanta était l’orateur de la majorité à cette occasion –, qui visait à renforcer les moyens du renseignement pénitentiaire, domaine dans lequel des avancées très importantes ont heureusement été réalisées depuis, et surtout à garantir l’isolement électronique des détenus, même si, là encore, le dispositif a été amélioré. De même, il est indispensable de faciliter les fouilles de détenus condamnés pour des faits de terrorisme ainsi que des individus prosélytes, et de les appuyer sur une base légale permettant d’isoler les détenus radicalisés prosélytes.
Enfin, il faut établir dans la loi, et non plus dans une simple circulaire, le principe de l’interdiction des téléphones portables et des terminaux de connexion à internet en détention. Aujourd’hui, en effet, tous les détenus possèdent ces matériels.
J’espère que cette proposition de loi pourra aller jusqu’à son terme, car il serait particulièrement malvenu que la majorité interdise la discussion et censure en quelque sorte l’opposition de sorte que nous ne puissions pas débattre en séance publique de chacun des articles et des amendements proposés.
M. Jacques Bompard. Je tiens d’emblée à dire que les propositions de MM. Ciotti et Larrivé, que nous avons beaucoup entendus, sont souvent excellentes. Ils font la preuve qu’une droite libérée des ornières du « médiatiquement correct » pourrait faire le plus grand bien à notre pays.
S’agissant du texte, je regrette quelques lacunes. La première concerne une nouvelle fois la laïcité : l’histoire politique montre que la loi de 1905 ne fut pas une partie de plaisir, loin de là ; je ne rappelle ni les inventaires, ni les autres exactions commises. Il serait bon que quelques idéologues se souviennent que, il y a un siècle, la République assassinait des croyants catholiques devant le parvis de l’église Saint-Roch. En France, faire de la laïcité une idéologie, c’est toujours réveiller des violences qui ont profondément divisé notre peuple.
C’est aussi refuser de nommer l’ennemi – et non pas l’adversaire. Aujourd’hui, l’ennemi est l’islamisme politique sous toutes ses formes : l’Union des organisations islamiques de France (UOIF), les arcanes venus d’Algérie ou du Qatar, l’islam totalitaire de M. Erdoğan ; rien de tout cela ne doit pouvoir poser un pied dans notre pays, parce qu’en réalité, notre ennemi n’est pas le terrorisme, mais l’islamisme politique qui l’enfante. Nous ne parviendrons à rien tant que nous ne l’aurons pas vaincu ici et maintenant.
M. Georges Fenech. Je rejoins en partie M. Pietrasanta : la lutte contre le terrorisme ne doit donner lieu ni à des surenchères, ni à une fuite en avant, ni à un concours Lépine comme on l’entend parfois. Cependant, il ne faut pas non plus céder à l’immobilisme ; nous devons continuer de renforcer nos dispositifs de sécurité.
À cet égard, Monsieur le président, vous nous avez désignés, M. Pietrasanta et moi-même, pour assurer le suivi des quarante préconisations issues de la commission d’enquête relative aux moyens mis en œuvre par l’État pour lutter contre le terrorisme. Je peux d’ores et déjà vous annoncer que nous avons adressé une demande à chacun des ministres concernés pour savoir ce qu’il en est de nos propositions, dont certaines sont déjà en application tandis que d’autres – je pense à la réorganisation de nos services de renseignement – méritent d’être prises en compte davantage.
J’en viens à la proposition de loi. Elle vise pour l’essentiel à considérer la notion d’état dangereux, déjà inscrite dans nos lois, notamment celle sur la rétention de sûreté adoptée en 2008 – j’en étais le rapporteur, et je me souviens parfaitement des débats très animés qui avaient opposé la majorité et l’opposition d’alors. La rétention de sûreté a fini par être adoptée, puis validée par le Conseil constitutionnel, comme l’a rappelé M. Ciotti – à cette réserve près qu’elle ne s’appliquerait qu’à l’avenir, étant entendu qu’il s’agit en effet d’une mesure qui porte atteinte à la liberté fondamentale d’aller et de venir. Quoi qu’il en soit, la notion d’état dangereux figure dans notre droit, comme elle figure dans le droit néerlandais, canadien, allemand. Elle a trait à la dangerosité criminologique, et non à la dangerosité psychiatrique, laquelle peut également donner lieu à des mesures de placement et d’internement d’office qui portent atteinte à la liberté d’aller et de venir. La dangerosité criminologique concerne les individus capables de récidiver ou de passer à l’acte. La rétention de sûreté après la peine – ou post-sentencielle – vise précisément à éviter la récidive.
La mesure proposée dans le présent texte est totalement novatrice et je comprends qu’elle puisse faire débat, puisqu’il s’agit là encore d’une atteinte importante aux libertés fondamentales. J’ai souhaité observer de près le seul dispositif de ce type qui existe dans le monde : je me suis donc rendu en Israël pour assister à des audiences de rétention administrative et constater comment les choses se passent dans le centre pénitentiaire d’Ofer, en Cisjordanie. Certes, le contexte géopolitique israélien n’a rien à avoir avec le nôtre, puisque nous ne sommes pas dans une juridiction militaire, mais civile. Je retiens néanmoins la prise en compte de la notion d’état dangereux : que devons-nous faire face à des individus qui, en réalité, sont très peu nombreux ? Il ne s’agit en effet pas de priver de libertés tous les individus faisant l’objet d’une fiche S, mais simplement ceux – quelques dizaines tout au plus – qui sont susceptibles de passer à l’acte à un moment ou à un autre et au sujet desquels nos services de renseignement détiennent une source fiable, mais dont l’intention criminelle ne peut pas être judiciarisée faute d’éléments. Nous sommes là au stade des actes préparatoires, et non à celui du commencement d’exécution, qui permettrait de saisir un juge. Que devons-nous faire ?
Nous proposons l’intervention d’une autorité administrative encadrée, sous le contrôle du juge des libertés et de la détention, dans un temps extrêmement limité, avec toutes les garanties procédurales – notamment l’intervention de l’avocat – et avec accès aux sources d’information du juge chargé de statuer sur la validité de la mesure de rétention administrative qui serait prise par le ministre de l’intérieur – lequel est déjà habilité par les textes que vous avez présentés, et que nous avons votés, à prendre des mesures attentatoires aux libertés, l’assignation à résidence par exemple, étant entendu que les contrôles juridictionnels prévus par la loi s’appliquent.
Encore une fois, cette mesure ne concernerait que quelques personnes, sur lesquelles nous disposerions d’éléments précis concernant la possibilité d’un passage à l’acte, plutôt que de mobiliser en permanence les fonctionnaires des services de renseignement affectés à leur surveillance. Un placement en centre de rétention assorti d’un examen approfondi de l’état de dangerosité par une équipe pluridisciplinaire, comme cela se fait pour la rétention de sûreté, permettrait dans un temps restreint – et la procédure contradictoire étant garantie – d’empêcher un éventuel passage à l’acte. Tel est le débat que nous devons avoir, sans considérer qu’il s’agit d’outrance. Il s’agit simplement de reconnaître l’état dangereux dans notre droit et de prévoir sa prise en compte par l’administration sous le contrôle du juge des libertés et de la détention.
Voilà l’essentiel de cette proposition de loi. Les Français apprécieront : je ne doute pas que ce texte sera, hélas, rejeté par notre commission, puisque nous n’y disposons pas de la majorité, mais un véritable débat aura lieu le 13 octobre en séance publique et – je le dis sans esprit partisan – le sujet fera partie du débat de la campagne électorale. Étant donné le niveau de la menace, nous ne pouvons pas nous permettre de rester les bras ballants face à des individus susceptibles de commettre un attentat tel que celui de Nice.
Mme Colette Capdevielle. La proposition de loi de M. Ciotti est à mon sens inutile, démagogique et dangereuse. Ce texte est inapplicable – son auteur le sait. Cette proposition de circonstance est destinée à alimenter le débat de la primaire du groupe Les Républicains la semaine prochaine. C’est aussi et surtout une provocation politique et juridique, à commencer par l’article 1er, dont les auteurs n’ont pas tardé à s’apercevoir qu’il était incohérent : pour tenter d’y remédier, ils ont, aujourd’hui, déposé un amendement, lequel est lui-même inconstitutionnel et inconventionnel, puisqu’il prévoit, hors état d’urgence, une assignation à résidence et une mesure de rétention que la jurisprudence analyse comme des mesures privatives de liberté. Quinze jours sans le contrôle d’un juge et avec un seul recours devant le Conseil d’État : excusez du peu ! Ce type de mesure n’est même pas souhaité par les personnes que vous avez auditionnées.
Vous reniez l’État de droit et, pour cela, il est vrai que votre imagination est sans limites. Adieu, présomption d’innocence ! Adieu, liberté de circulation ! Adieu, indépendance de la justice ! Adieu, séparation des pouvoirs ! La Constitution du 4 octobre 1958, la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne sont pas des paillassons, mais bien un socle de valeurs. Le Patriot Act et Guantanamo n’ont rien changé aux États-Unis – au contraire – et la fin ne peut jamais justifier tous les moyens, contrairement à ce que vous prétendez. Comme l’a récemment rappelé le Président de la République, c’est bien l’État de droit qui est en jeu. Nous ne pouvons accepter que celui-ci soit ainsi foulé aux pieds.
M. Sergio Coronado. Depuis le début du quinquennat, notre assemblée a adopté cinq textes de lutte contre le terrorisme : je ne suis pas sûr que l’on puisse parler de modération législative. Ce serait plutôt une prolifération. Certes, des évaluations ont eu lieu, mais elles ont parfois été défaillantes et n’ont pas eu de conséquences déterminantes sur le comportement législatif de l’Assemblée. Je rappelle par exemple que, le 13 janvier dernier, Jean-Jacques Urvoas – devenu depuis ministre de la justice – avait présenté une évaluation de la mise en place de l’état d’urgence, qui concluait que ce régime n’était efficace qu’une dizaine, voire une quinzaine de jours. Or nous sommes toujours en état d’urgence. Les textes prolifèrent donc, sans que leur efficacité soit réellement étudiée.
Nous examinons ce matin une proposition de loi du groupe Les Républicains. Au-delà du phénomène de compilation, je constate que les propositions régulières de l’opposition en matière de lutte contre le terrorisme visent à la fois à alimenter une forme de populisme pénal et à préparer la primaire de la droite et du centre. Mais elles sont aussi l’esquisse de ce que pourrait être un projet pénal, si l’opposition venait à remporter les élections. Depuis une vingtaine d’années, en effet, nous avons entrepris de basculer d’un droit pénal qui punit la commission de faits à un droit pénal prédictif, avec les dangers que cela implique. Si, dans notre assemblée où de trop rares voix s’élèvent contre cette tendance, l’opposition à ce mouvement de privation de libertés et de contournement du juge judiciaire est très minoritaire, elle existe bel et bien, tant dans la société civile que dans les instances internationales, très inquiètes de la dérive française.
J’espère qu’il se trouvera une majorité dans cette commission pour s’opposer aux propositions de l’opposition. Sans esprit polémique, j’ai pourtant l’impression que, depuis plusieurs mois, la majorité a parfois cédé très facilement aux propositions pour le moins contradictoires ou répressives de M. Ciotti. Je rappellerai la proposition qui avait été faite, lors du débat sur la première prorogation de l’état d’urgence, d’un état d’urgence élargi et prorogé à six mois : le Gouvernement s’y était opposé. Or nous sommes toujours en état d’urgence.
La meilleure façon de s’opposer aux propositions démagogiques de l’opposition est de camper fermement sur une ligne de crête. Je ne suis pas sûr que la privation et la restriction de nos libertés garantissent notre sécurité. Je crois même que les Français sont conscients que ce n’est pas le cas.
M. Alain Tourret. Cette proposition de loi est certes intéressante, mais il s’agit d’un texte de circonstance qui se verra sans doute opposer une motion de procédure. Il y a donc peu de chances que nous en discutions au fond.
C’est pourquoi je souhaiterais d’ores et déjà attirer votre attention sur la question spécifique des pouvoirs du procureur de la République en matière de terrorisme, lorsque ce magistrat fait appel d’une décision du juge des libertés et de la détention (JLD) remettant en liberté un individu. À plusieurs reprises dans le Calvados, bien que le procureur de la République ait fait appel, des individus ont profité du fait que la décision du JLD était immédiatement applicable pour disparaître dans la nature. Ne serait-il pas bon de songer à donner un caractère suspensif à l’appel du procureur de la République en la matière – ce dernier étant quand même le défenseur de la société ? Cela me semble important, car, encore une fois, dans nombre de cas, l’individu disparaît – conscient du danger qu’il court de voir la cour d’appel réformer la décision du JLD.
Certes, il ne faut pas que cela soit contraire au principe global de remise en liberté. Aussi faudrait-il, je crois, enserrer cette mesure dans un délai très bref, en contraignant la cour d’appel à statuer dans les quarante-huit ou les soixante-douze heures après l’appel ainsi formé par le procureur de la République, et prévoir l’impossibilité de remettre en liberté, pendant ce délai, l’individu en question. Un rapprochement de l’ensemble des députés de la majorité et de l’opposition serait-il possible en faveur d’une mesure qui me paraît à la fois respecter les libertés, et empêcher, comme cela vient de se passer, l’utilisation abusive de la remise en liberté, malgré l’appel du procureur de la République ?
M. Guillaume Larrivé. Si le groupe Les Républicains a choisi d’inscrire à l’ordre du jour réservé de la semaine prochaine et la proposition de loi d’Éric Ciotti, et celle de Nathalie Kosciusko-Morizet, c’est parce que nous pensons qu’il est absolument nécessaire de continuer à faire ce que nous faisons depuis 2012 : être force de propositions techniques et solides sur le sujet – ô combien important – de la lutte contre le terrorisme islamiste qui frappe la France depuis plusieurs années. Nous le faisons dans un esprit de responsabilité, non pour alimenter je ne sais quel débat polémique, mais parce que nous pensons en conscience qu’il est de notre responsabilité – comme parti de Gouvernement et comme premier parti d’opposition – d’être une force de proposition. Nous l’avons fait depuis 2012, parfois avec un certain succès, lorsque nous avons réussi à convaincre la majorité d’adopter certaines mesures de bon sens.
Il y a quelques années, la majorité socialiste refusait qu’on introduise dans le code pénal un délit de consultation habituelle des sites faisant l’apologie du terrorisme : après en avoir rejeté l’idée à plusieurs reprises, elle l’a finalement adoptée il y a quelques mois. De même, elle a refusé plusieurs fois de suspendre toute mesure d’aménagement automatique de peines pour les détenus terroristes : après avoir d’abord rejeté nos amendements et propositions de loi, elle les a finalement acceptés en juillet, lors des débats sur la loi prolongeant l’état d’urgence. De même, entre 2012 et 2014, elle a totalement refusé – notamment par la voix de la garde des Sceaux d’alors, Mme Taubira, – la perspective de créer un service de renseignement pénitentiaire pour finir par s’y rallier en adoptant un amendement du groupe Les Républicains – identique d’ailleurs à un amendement présenté il y a quelques mois par M. Tourret.
Nous ne comprendrions pas que, aujourd’hui, la majorité rejette d’office notre proposition de loi, par une motion de procédure. Je le dis avec une certaine solennité : nous souhaitons qu’il y ait, tant en commission des Lois que dans l’hémicycle, en présence du ministre de l’intérieur ou du garde des sceaux, un vrai débat de fond sur chacun des articles des propositions de loi d’Éric Ciotti et de Nathalie Kosciusko-Morizet.
Sur le fond, je m’associe aux propos d’Éric Ciotti et voudrais concentrer mon intervention sur l’article 1er, sans doute le plus novateur de ce texte, qui introduit un mécanisme de rétention. Je veux dire avec fermeté qu’il ne s’agit aucunement pour nous de déroger à l’État de droit. Nous sommes tous ici des républicains, attachés au bloc de constitutionnalité et à la hiérarchie des normes. Nous tenons à respecter le cadre général de cet État de droit. Mais l’État de droit n’est pas l’état de faiblesse ni le renoncement à toute évolution juridique d’adaptation du droit au fait. Si l’État de droit est faible, il n’est plus l’État, il n’y a plus de droit. C’est la loi de la jungle djihadiste qui l’emportera.
Une fois que l’on a dit cela – considération de principe –, entrons dans le détail du texte. Nous n’entendons pas, contrairement à ce qu’on lit parfois, écarter le juge pénal de la matière antiterroriste. Cela n’aurait aucun sens. Il va de soi que les individus les plus dangereux – ceux dont le dossier est judiciarisé, ceux qui ont commis des actes délictuels, voire criminels, dans le champ du code pénal – doivent faire l’objet d’une procédure judiciaire pour les mettre hors d’état de nuire, c’est-à-dire, concrètement, les mettre sous écrous, puis les condamner. Il faut les écarter le plus durablement possible de la société. Le volet pénal doit donc être renforcé et il nous faut sans doute progresser vers des formes de perpétuité réelle et la suspension de mesures de réduction de peine. Il est évidemment toute une matière pénale que nous tenons non seulement à préserver, mais à consolider. Il est une zone grise à l’intérieur de laquelle des individus dont le dossier n’est pas judiciarisé à ce stade doivent faire l’objet d’une mesure de police administrative renforcée, une mesure de rétention.
Je rappelle que des mesures de police administrative analogues existent déjà dans le droit positif actuel, notamment en matière d’hospitalisation sous contrainte à la demande de tiers, certaines personnes étant retenues dans un cadre fermé pour une durée déterminée, sous le contrôle de l’autorité juridictionnelle, en matière d’éloignement des étrangers en situation irrégulière, avec le placement en centre de rétention administrative sous le double contrôle du juge administratif et du juge des libertés et de la détention, ou sous l’empire de l’état d’urgence, avec l’assignation à résidence dont quatre-vingt-neuf individus font aujourd’hui l’objet.
Avec l’article 1er, le ministre de l’intérieur aurait la faculté – non pas l’obligation – de prononcer à l’égard d’un public identifié comme susceptible, par son comportement, de constituer une menace grave pour la sécurité et l’ordre public, une décision d’assignation à résidence ou de placement en centre de rétention sous le contrôle de l’autorité juridictionnelle – un régime procédural devant naturellement préciser certains délais.
Reste à prévoir une articulation entre ce régime de rétention et un régime judiciaire. S’il apparaît que le dossier de ces personnes placées pour une durée limitée en centre de rétention est suffisamment dense pour être judiciarisé, il va de soi qu’elles devraient être transférées du centre de rétention vers un régime judiciaire. Un excellent amendement du rapporteur prévoit cette articulation nécessaire.
M. Bernard Gérard. Je suis choqué que l’on puisse prétendre que nous ferions fi des valeurs fondamentales de la République. Aujourd’hui même, en France, des centaines de personnes se trouvent en centre de rétention, uniquement parce qu’elles n’ont pas le papier qui convient, et alors même qu’elles n’ont commis aucune infraction pénale. Par égard pour les Français qui se sentent en danger, il faudrait que l’on puisse considérer comme une menace ceux qui – par leurs actions, la consultation de sites, les menaces verbales ou écrites qu’ils ont proférées – ont montré qu’ils étaient prêts à commettre des actes terroristes. Je ne vois pas de quel droit nous pourrions considérer qu’il n’y a pas d’analogie à faire entre ces deux cas. C’est une réaction de bon sens et l’opposition est tout à fait dans son rôle en proposant un texte de loi de cette nature.
M. Sébastien Huyghe. Je regrette que, chaque fois qu’il est question de lutte contre le terrorisme, l’opposition soit caricaturée et brocardée par la majorité. On nous dit –nous l’avons entendu aujourd’hui même, que, avec nos propositions, nous serions en dehors de l’État de droit. C’est au contraire parce que nous nous situons dans l’État de droit que nous déposons cette proposition de loi : nous souhaitons en passer par la loi et non pas par des mesures sortant de son champ ! Cette accusation fallacieuse est devenue la ritournelle de la majorité pour masquer son trouble et son incapacité à trouver les solutions nécessaires à la lutte contre le terrorisme.
Le deuxième argument qui nous est opposé est que nous faisons ces propositions dans la perspective de la primaire de la droite et du centre. Remontez un peu dans le temps et vous verrez que nous les avons déjà formulées bien avant le début de la primaire. Encore une fois, cet argument est totalement fallacieux.
Le Président de la République, le Gouvernement et certains membres de la majorité font des appels quasi permanents à l’unité nationale : elle ne doit pas être à deux vitesses, n’être invoquée que lorsqu’il s’agit de demander à l’opposition de voter les textes proposés par la majorité, et ne plus exister quand les propositions viennent des rangs de l’opposition. Ce mode de fonctionnement, assez récurrent et pathétique, consiste, pour la majorité, à refuser a priori toute proposition de l’opposition en matière de lutte contre le terrorisme. Puis survient un attentat qui endeuille la France et, du jour au lendemain, les mesures qui étaient impossibles deviennent souhaitables. Guillaume Larrivé a dressé la liste des propositions qui étaient impossibles à mettre en œuvre, puis qui, comme par magie, ont été adoptées au lendemain d’actes terroristes. Je regrette ce mode de fonctionnement qui consiste à caricaturer l’opposition et à en appeler aux grands principes pour finir par comprendre, à la suite d’un drame national, que les préventions d’hier ne sont plus de mise. Je vous invite à dépasser la politique politicienne afin que nous examinions ensemble, de façon constructive, les propositions de l’opposition. Et surtout, de grâce, évitez ces motions de procédure qui empêcheraient d’avoir un débat de fond dans l’hémicycle.
La Commission en vient à l’examen des articles de la proposition de loi.
Chapitre Ier
Dispositions relatives au suivi et au contrôle des individus radicalisés constituant une menace à la sûreté de l’État
Article 1er
Contrôle des individus constituant une menace grave pour la sécurité et l’ordre public
Le présent article permet au ministre de l’intérieur, lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser qu’un individu constitue par son comportement une menace grave pour la sécurité et l’ordre public, de prononcer un certain nombre de mesures administratives, parmi lesquelles l’assignation à résidence, le placement sous surveillance électronique mobile ou le placement en centre de rétention spécialisé.
1. Les limites des procédures judiciaires en matière de lutte contre le terrorisme
Les procédures judiciaires concernant les personnes soupçonnées de préparer un attentat se fondent sur deux qualifications juridiques :
–– l’association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste (AMT), définie à l’article 421–2–1 du code pénal, qui suppose l’existence d’un groupement ou d’une entente constitués par des faits matériels en vue de la préparation d’actes terroristes ;
–– l’entreprise terroriste individuelle, définie à l’article 421–2–6 du même code, qui suppose le fait de préparer, en relation avec une entreprise individuelle et dans un but terroriste, la commission de certaines infractions terroristes (atteintes aux personnes, atteintes aux biens les plus graves et actes graves de terrorisme écologique). L’infraction est caractérisée par le fait « de détenir, de rechercher, de se procurer ou de fabriquer des objets ou des substances de nature à créer un danger pour autrui » et par un second élément matériel (repérages, entraînement au maniement des armes ou explosifs, consultation habituelle de sites internet provoquant au terrorisme, séjour à l’étranger sur un théâtre d’opérations de groupements terroristes).
Ces qualifications nécessitent que l’infraction soit constituée. Il faut, par exemple, apporter la preuve qu’une personne s’est rendue en Syrie et en Irak et l’a fait pour rejoindre un groupe terroriste, ce qui peut être complexe, du fait de la situation dans la zone irako-syrienne, où combattent plusieurs groupes, dont l’armée syrienne libre (ASL) qui n’a pas de caractère terroriste. Ainsi, en mai 2016, environ un quart des individus parvenus en Syrie sont rentrés en France, soit 244 personnes. Sur ceux–là, 147 font l’objet d’une procédure judiciaire, soit 60 % seulement. 97 autres individus, soit les 40 % restants, ne peuvent faire l’objet d’une judiciarisation immédiate, faute d’éléments suffisants (25).
2. La législation d’urgence permet d’assigner à résidence les personnes constituant une menace pour la sécurité et l’ordre public
Le soir des attentats du 13 novembre, le Président de la République a décrété l’état d’urgence sur l’ensemble du territoire national. Par une loi du 20 novembre 2015 (26), le Parlement a autorisé, une première fois, sa prolongation pour trois mois et également renforcé le cadre juridique de l’état d’urgence. Cette légalité d’exception a été, ensuite, prorogée pour trois mois supplémentaires par la loi du 19 février 2016 (27), pour deux mois par la loi du 20 mai 2016 (28) et enfin pour six mois par la loi du 21 juillet 2016 (29).
En période d’état d’urgence, le ministre de l’intérieur peut prononcer l’assignation à résidence, dans le lieu qu’il fixe, de toute personne à l’égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace pour la sécurité et l’ordre publics. Cette personne peut également être astreinte à demeurer dans le lieu d’habitation déterminé par le ministre de l’intérieur, pendant la plage horaire qu’il fixe, dans la limite de douze heures par vingt-quatre heures.
Le ministre de l’intérieur peut lui prescrire :
–– l’obligation de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, selon une fréquence qu’il détermine dans la limite de trois présentations par jour, en précisant si cette obligation s’applique y compris les dimanches et jours fériés ou chômés ;
–– la remise à ces services de son passeport ou de tout document justificatif de son identité.
En outre, cette personne peut se voir interdire de se trouver en relation, directement ou indirectement, avec certaines personnes, nommément désignées, dont il existe des raisons sérieuses de penser que leur comportement constitue une menace pour la sécurité et l’ordre publics.
Lorsque la personne assignée à résidence a été condamnée à une peine privative de liberté pour un crime qualifié d’acte de terrorisme ou pour un délit recevant la même qualification puni de dix ans d’emprisonnement et a fini l’exécution de sa peine depuis moins de huit ans, le ministre de l’intérieur peut également ordonner qu’elle soit placée sous surveillance électronique mobile. Ce placement est prononcé après accord de la personne concernée.
Entre le 14 novembre 2015 et le 21 juillet 2016, le ministre de l’intérieur a prononcé 554 assignations à résidences – dont 553 obligations de pointer au commissariat, et 97 assignations à résidence depuis le 22 juillet 2016.
3. Un renforcement récent mais limité de l’arsenal administratif permanent
Les lois n° 2014–1353 du 13 novembre 2014 renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme et n° 2016–731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale ont introduit dans notre droit plusieurs dispositifs permanents destinés à protéger le territoire en entravant les mouvements et les activités des personnes présentant un danger pour la sécurité nationale :
–– L’interdiction de sortie du territoire (IST)
Issu de l’article premier de la loi du 13 novembre 2014 précitée, l’article L. 224-1 du code de la sécurité intérieure autorise le ministre de l’intérieur à prononcer une IST à l’encontre d’un Français lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser qu’il projette un déplacement à l’étranger « ayant pour objet la participation à des activités terroristes » ou « sur un théâtre d’opérations de groupements terroristes, dans des conditions susceptibles de le conduire à porter atteinte à la sécurité publique lors de son retour sur le territoire français ».
Prise pour une durée maximale de six mois, la mesure peut être renouvelée par décision expresse et motivée sous réserve que sa durée n’excède pas deux ans. Elle est levée aussitôt que les conditions justifiant sa mise en œuvre ne sont plus réunies.
La loi punit de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende le fait de quitter ou de tenter de quitter le territoire français en violation d’une interdiction de sortie du territoire.
D’après les informations transmises par le ministère de l’intérieur à la commission d’enquête relative aux moyens mis en œuvre pour lutter contre le terrorisme, « trois cent huit décisions initiales d’IST avaient été prises au 14 avril 2016. Cinquante-six avaient été renouvelées une première fois, et deux une deuxième fois. » (30) Toutefois, d’après le ministère de l’intérieur, une vingtaine de personnes concernées par une IST n’ont pas restitué l’intégralité de leurs titres d’identité et six individus ont enfreint l’interdiction de sortie du territoire prononcée à leur encontre, parmi lesquels deux seulement avaient été condamnés à une peine d’emprisonnement.
–– Le contrôle des retours sur le territoire national des personnes qui ont séjourné sur un théâtre d’opérations de groupements terroristes
L’article L. 225–1 du code de la sécurité intérieure, introduit par la loi du 3 juin 2016 précitée, définit les situations de nature à justifier la mise en œuvre d’un contrôle administratif d’une personne de retour sur le territoire national. Ainsi, ce nouveau dispositif concerne toute personne qui a quitté le territoire national et dont il existe des raisons sérieuses de penser que ce déplacement avait pour but de rejoindre un théâtre d’opérations de groupements terroristes dans des conditions susceptibles de la conduire à porter atteinte à la sécurité publique lors de son retour sur le territoire français.
Le ministre de l’intérieur peut, après en avoir informé le procureur de la République de Paris, faire obligation à l’intéressé, dans un délai maximal d’un mois à compter de la date certaine de son retour sur le territoire national, de :
–– résider dans un périmètre géographique déterminé lui permettant de poursuivre une vie familiale et professionnelle normale et, le cas échéant, l’astreindre à demeurer à son domicile ou, à défaut, dans un autre lieu à l’intérieur de ce périmètre, pendant une plage horaire fixée par le ministre, dans la limite de huit heures par vingt-quatre heures ;
–– se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, dans la limite de trois présentations par semaine, en précisant si cette obligation s’applique les dimanches et jours fériés ou chômés.
Ces obligations sont prononcées pour une durée maximale d’un mois, renouvelable deux fois (31) par décision motivée.
Ce dispositif a constitué un indéniable progrès, même s’il faut déplorer que le Gouvernement n’ait pas repris l’idée, plus simple et plus efficace, de créer un délit de séjour intentionnel sur un théâtre d’opérations de groupements terroristes – qui fait l’objet de l’article 7 de la présente proposition de loi.
4. Une impérieuse nécessité : assurer la sécurité des Français
Le dispositif créé par la loi du 3 juin 2016 précitée témoigne de l’importance d’organiser, même hors état d’urgence, un contrôle administratif pour les personnes dont il existe des raisons sérieuses de penser qu’elles seraient dangereuses pour la sécurité et l’ordre public. Il est donc absurde d’entendre affirmer ci et là que le groupe « Les Républicains » remettrait en cause l’état de droit en élargissant le contrôle administratif à l’encontre de ces personnes.
Il paraît important, par exemple, d’exercer un contrôle sur les individus qualifiés de « velléitaires », c’est-à-dire ceux qui souhaitent rejoindre un théâtre d’opérations mais n’y sont pas parvenus. Comme l’a montré le rapport d’information de la commission d’enquête de l’Assemblée nationale sur la surveillance des filières et des individus djihadistes, « ils peuvent passer à l’acte par représailles si leur départ a été empêché ou par frustration. Cela a été évoqué dans le cas de Michael Zehaf-Bibeau, auteur de l’attentat commis à Ottawa le 22 octobre 2014, ou s’agissant de la France, de Moussa Coulibaly, qui a attaqué le 3 février 2015 trois militaires à Nice » (32).
Tous les individus qui constituent, par leur comportement, une menace grave pour la sécurité et l’ordre public, mais pour lesquels il n’existe pas suffisamment d’éléments pour ouvrir une enquête judiciaire doivent pouvoir faire l’objet d’un contrôle administratif.
Le premier alinéa du présent article prévoit que le ministère de l’intérieur pourra prononcer, à l’encontre de ces personnes, les mesures suivantes :
–– l’assignation à résidence avec obligation de présentation périodique aux services de police et de gendarmerie ;
–– le placement sous surveillance électronique mobile ;
–– le placement en centre de rétention spécialisé.
Les recours contre ces décisions devront être portés devant le Conseil d’État.
Aux termes du second alinéa, et sur le modèle du dispositif organisé par l’article L. 552–1 code du séjour et de l’entrée des étrangers et du droit d’asile, quand un délai de quinze jours s’est écoulé depuis la décision du ministre, le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention, qui ne peut toutefois pas excéder soixante jours – soit soixante–quinze jours maximum. À l’issue de ces soixante–quinze jours, le ministre peut prendre une nouvelle décision d’assignation, de placement dans un centre de rétention ou de placement sous surveillance électronique.
*
* *
La Commission est saisie des amendements identiques CL3 de M. Sergio Coronado et CL16 de M. Sébastien Pietrasanta.
M. Sergio Coronado. Les auteurs de la proposition de loi souhaitent que nous autorisions le pouvoir exécutif, en dehors de l’état d’urgence, à accomplir certains actes gravement attentatoires aux libertés individuelles, sans aucun contrôle du pouvoir judiciaire.
En effet, l’article 1er vise à transcrire, en dehors de l’état d’urgence, l’article 6 de la loi du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence qui dispose que « le ministre de l’intérieur peut prononcer l’assignation à résidence, dans le lieu qu’il fixe, de toute personne résidant dans la zone fixée par le décret mentionné à l’article 2 et à l’égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace pour la sécurité et l’ordre publics dans les circonscriptions territoriales mentionnées au même article 2 ».
L’adoption de l’article 1er priverait l’autorité judiciaire de son rôle de garante des libertés individuelles, parachevant ainsi un vaste mouvement de contournement de l’autorité judiciaire, pourtant garante des libertés individuelles, selon les dispositions de la Constitution.
En indiquant par ailleurs que seul le Conseil d’État sera compétent pour connaître de la légalité de cette décision, les auteurs de la proposition de loi manifestent leur souhait de contourner l’autorité judiciaire et de transférer au juge administratif le contrôle de ces garanties. Or le Conseil d’État fait une lecture extrêmement restrictive de l’article 66 de la Constitution et le contrôle de celui-ci s’effectuerait a posteriori et de manière non systématique, au gré d’éventuelles saisines.
Enfin, cet article est contraire à l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme.
Pour toutes ces raisons, j’appelle mes collègues de la majorité à voter la suppression de cet article.
M. Sébastien Pietrasanta. Monsieur le rapporteur, vous le savez bien, cet article n’est pas constitutionnel. Vous le savez d’autant plus que, lors de son audition, le procureur de la République de Paris vous l’a rappelé expressément. En effet, le Conseil constitutionnel considère que la rétention administrative est une mesure privative de liberté et que, au-delà de cinq jours, elle ne peut être autorisée que par le juge judiciaire. La loi de 1955 dispose également qu’en aucun cas l’assignation à résidence ne pourra avoir pour effet la création de camps où seraient détenues les personnes. Le Conseil d’État, dans son avis du 17 décembre 2015, a indiqué qu’il n’était pas possible d’autoriser par la loi, en dehors de toute procédure pénale, la rétention, dans des centres prévus à cet effet, de personnes radicalisées présentant des indices de dangerosité et connues comme telles par les services de police, sans pour autant avoir déjà fait l’objet d’une condamnation pour des faits de terrorisme. Cet article 1er est également contraire à l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme.
Dans son avis du 17 décembre 2015, le Conseil d’État a rappelé que le placement sous surveillance électronique n’était envisageable que sous réserve que la dangerosité de l’intéressé soit établie sur la base de critères précisément définis et d’éléments suffisamment consistants, d’une procédure d’autorisation et de contrôle permettant de vérifier la réalité de la dangerosité et des risques encourus, de l’accord de l’intéressé, et à défaut d’autre moyen légal de prévenir la menace liée à la présence d’un individu dans certaines zones. À l’évidence, la conception englobante de la menace grave pour la sécurité nationale retenue par la proposition de loi ne répond pas à de tels critères.
En ce qui concerne l’assignation à résidence, dans le même avis du 17 décembre 2015, le Conseil d’État a précisé que, lorsque les contraintes imposées à l’intéressé excèdent par leur rigueur une restriction de la liberté de circulation, au point de le confiner en pratique en un lieu déterminé, fût-il son domicile, l’assignation à résidence est assimilable à une privation de liberté. Hors période d’état d’urgence, une assignation à résidence « préventive » contraignante, impliquant un confinement durable en un lieu déterminé, serait assimilable à une détention et est impossible en dehors de toute condamnation ou de tout contrôle judiciaire lié à une procédure pénale. Cette assignation à résidence porterait en effet atteinte à la liberté individuelle, au sens de l’article 66 de la Constitution, des personnes concernées.
Enfin, au-delà des arguments juridiques qui, je le sais, ne sont pas les vôtres, je reprendrai à mon compte les propos du procureur de la République de Paris qui se posait la question de l’efficacité de votre proposition : à quoi sert une assignation pour deux fois soixante-quinze jours ? Que fait-on le cent cinquante et unième jour ?
Par ailleurs, et cela a été dit devant notre commission d’enquête, il y a une hostilité de nos services à prévenir des individus qu’ils sont surveillés et qu’ils seront placés dans des centres de rétention. Cela pourrait mettre fin à certaines enquêtes.
Enfin, regrouper en un même lieu des personnes considérées comme dangereuses reviendrait à faire vivre en réseau des individus qui se parleront et s’organiseront avant de sortir de ces centres, ce qui augmenterait leur dangerosité.
M. le rapporteur. Il est vrai que, avec l’article 1er, nous voulons changer le cadre et l’ampleur de la lutte contre le terrorisme en recourant à un nouvel outil de police administrative qui serait une mesure de précaution. Ce dispositif repose sur trois piliers : l’assignation à résidence – qui ne devrait pas être de nature à vous choquer puisque vous l’avez approuvée dans le cadre de l’état d’urgence –, le placement sous surveillance électronique et – ce que vous semblez contester de façon prioritaire – le placement dans des centres de rétention fermés.
Nous voulons sortir de la caricature qui a souvent accompagné ce débat. Il ne s’agit pas, comme vous le répétez, de placer en rétention tous ceux qui sont inscrits au fichier des personnes recherchées dans la catégorie S – ils sont plus de 11 000 à 12 000. Ce que nous disons, c’est qu’il convient de compléter notre dispositif juridique en permettant à l’autorité administrative – en l’occurrence, le ministre de l’intérieur –, dans une situation de gravité particulière et d’urgence absolue, de prendre une mesure de précaution concernant quelques dizaines, voire quelques centaines d’individus dont la dangerosité est connue, notamment par les services de renseignement, sans permettre toutefois la judiciarisation de la procédure.
C’est un dispositif de précaution que, au mois de juin, quelques jours avant l’attentat de Nice, Christian Jacob, Guillaume Larrivé et moi-même avons présenté au Premier ministre, accompagné du garde des Sceaux et du ministre de l’intérieur. Je suis convaincu que nous en viendrons un jour ou l’autre à appliquer ce dispositif. Guillaume Larrivé a rappelé tout à l’heure les oppositions que vous aviez formulées depuis 2012 à beaucoup de nos amendements relatifs à la consultation de sites faisant l’apologie du terrorisme, au renseignement pénitentiaire, au délit d’entrave au blocage des sites, aux modalités d’aménagement des peines, à la perpétuité réelle, aux fouilles de véhicules et aux contrôles d’identité ordonnés par le préfet sous l’état d’urgence. Chaque fois, vous y êtes venus après des événements tragiques. Il s’agit aujourd’hui d’anticiper les choses grâce à une mesure de précaution.
Vous nous dites que cette mesure est inconstitutionnelle : saisissons donc le Conseil constitutionnel ! Quelle arrogance juridique que de prétendre d’emblée que ce dispositif n’est pas conforme à la Constitution ! J’ai rappelé la théorie des circonstances exceptionnelles qui est un principe fondamental du droit dégagé dans l’arrêt Dames Dol et Laurent. L’anecdote sous-tendant cette décision a rejoint l’histoire : le préfet du Var ayant interdit l’exercice du plus vieux métier du monde dans le port de Toulon, deux dames concernées par cette interdiction s’y étaient opposées jusque devant le Conseil d’État. Le juge administratif a alors affirmé que l’on pouvait adapter le droit en situation de guerre.
Aujourd’hui, cet état de guerre est difficilement appréciable sur le plan juridique : il n’y a pas eu de déclaration, nous sommes dans un conflit asymétrique, ce n’est pas un État que nous avons face à nous, mais le Président de la République et le Premier ministre répètent en permanence que nous sommes en état de guerre. S’il y a état de guerre, qui peut nier que nous soyons dans des circonstances exceptionnelles ? À circonstances exceptionnelles, mesure de précaution exceptionnelle. Quant à l’amendement CL46 que j’ai déposé, il prévoit l’intervention du juge judiciaire en amont – avec une information du procureur de la République de Paris – et en aval – avec la saisine du juge des libertés et de la détention au bout de quinze jours, et l’abrogation des mesures administratives dès lors que des poursuites judiciaires sont engagées.
Comme l’a dit Guillaume Larrivé, qui peut nier qu’il y ait des dispositifs analogues ? Aujourd’hui, 70 000 personnes font l’objet chaque année d’une hospitalisation sous contrainte. Dans ce cadre, le JLD peut intervenir au bout de douze jours.
Mme Sandrine Mazetier. Nous avons changé cette disposition !
M. le rapporteur. Il existe également un dispositif de rétention administrative pour les étrangers.
On peut discuter du délai à partir duquel intervient le JLD. Nous l’avons fixé à quinze jours : il pourrait être réduit. Mais le principe doit être posé. Cette réalité juridique s’applique déjà dans le cadre de dispositifs analogues. Pourquoi, d’emblée, vous opposer à ce dispositif de façon idéologique ?
Georges Fenech rappelait que cette mesure existe dans un pays confronté au quotidien au terrorisme – 2 000 attentats en Israël – et qu’il a fait la preuve de son utilité. Face à l’ampleur de la menace, il faudra que vous fassiez preuve un jour d’une plus grande lucidité. Je ne pense pas que ce soit vous qui adopterez ce dispositif. Mais nous considérons, nous, que ce dernier est conforme au droit. Je rappellerai aussi que la loi du 3 juin 2016, qui réforme la procédure pénale, qu’a présentée le garde de Sceaux et que vous avez adoptée, prévoit la possibilité d’assigner à résidence les personnes qui reviennent de théâtres d’opérations de groupements terroristes – pendant trois mois sans l’intervention du JLD. Je ne comprends donc pas pourquoi ce qui existe en droit – qu’il s’agisse de l’hospitalisation sous contrainte, de la rétention des étrangers ou de l’assignation à résidence des personnes retournant de théâtres d’opérations de groupements terroristes – serait conforme à la Constitution tandis que ce que nous proposons serait une aberration juridique. Sur le plan pratique, comment pouvez-vous justifier que l’on n’intervienne pas au préalable contre des personnes dont on connaît l’extrême dangerosité et qui sont quelquefois sur le point de passer à l’acte ? Il faut intervenir en amont, prévenir la menace et l’anticiper – et non pas agir après. C’est ce qui motive aujourd’hui cet article essentiel et qui me conduit à émettre un avis défavorable à ces amendements de suppression.
La Commission adopte les amendements.
En conséquence, l’article 1er est supprimé.
L’amendement CL46 du rapporteur n’a plus d’objet.
Article 2
Création, à titre expérimental, d’un fichier des personnes radicalisées constituant une menace à la sécurité publique ou à la sûreté de l’État
Le présent article autorise, à titre expérimental, la création d’un fichier des personnes radicalisées constituant une menace à la sécurité publique ou à la sûreté de l’État.
1. L’ampleur croissante du phénomène de la radicalisation
En mai 2016, le Gouvernement indiquait, à l’occasion du lancement du plan d’action contre la radicalisation et le terrorisme, que près de 9 300 personnes étaient signalées pour radicalisation. Les chiffres évoqués aujourd’hui font état d’environ 15 000 personnes suivies à un titre ou à un autre parce qu’elles sont engagées dans un processus de radicalisation (33).
Les données fournies dans le cadre du dispositif de repérage et de signalement des situations individuelles inquiétantes de l’Éducation nationale montrent par ailleurs l’ampleur inquiétante du phénomène de radicalisation chez les jeunes :
–– 857 situations signalisées pour vérification ou levée de doute en 2014–2015 ;
–– 617 pour le seul premier trimestre 2015–2016 (34).
Ces chiffres ne tiennent en outre pas compte du quasi–doublement depuis 2007 de l’instruction à domicile, dont certains évènements récents ont montré qu’elle pouvait constituer l’antichambre d’écoles coraniques illégales.
Radicalisation et types de prévention (35)
La radicalisation exprime la conjugaison de l’adhésion à une idéologie extrême et d’une action violente. Elle relève fréquemment d’un processus de rupture avec l’environnement familial, social ou professionnel.
Les signalements recueillis par le numéro vert créé en avril 2014 par les services déconcentrés confirment la diversification des profils des personnes qui basculent. Le phénomène touche toutes les régions et toutes les catégories sociales, ce qui amène certains acteurs à parler d’épidémie. Parmi les 3 600 individus détectés, engagés dans un processus de radicalisation, on compte d’abord une majorité de jeunes de moins de 25 ans (65 %). La tranche d’âge des 18–25 ans est la plus concernée et s’y ajoute 25 % de mineurs. De plus, il faut relever que l’on trouve 40 % de femmes, 55 % de convertis et que 50 % des individus signalés n’étaient pas connus des services de police et de gendarmerie.
On distingue trois types de prévention :
– la prévention primaire, générale et collective, qui intervient avant le basculement, à travers des dispositifs qui n’ont pas nécessairement comme finalité première de lutter contre la radicalisation mais qui peuvent utilement y concourir. L’éducation, la formation de l’esprit critique, l’accès aux valeurs du sport ou à la culture en font partie ;
– la prévention secondaire, ciblée en direction des personnes repérées comme en voie ou en situation de radicalisation, qui s’exerce à travers un accompagnement individualisé dans la durée ;
– la prévention tertiaire, correspond à la prévention de la réitération ou de la récidive. Elle relève principalement de l’autorité judiciaire, dans un parcours de réparation, d’amendement, de repentance.
2. La multiplicité des fichiers, un obstacle à une action résolue des pouvoirs publics
Il est urgent de pouvoir renforcer l’action publique permettant d’assurer un suivi adéquat en fonction de leur dangerosité des personnes radicalisées. Il faut surveiller, entraver et neutraliser les individus représentant une menace pour l’ordre public.
La commission d’enquête précitée visant à tirer les leçons des attentats de 2015 a mis en lumière les difficultés pour obtenir le nombre d’individus, identifiés comme représentant une menace pour la sécurité nationale, faisant l’objet d’un suivi de la part de l’ensemble des services en charge de la lutte antiterroriste (36). Les services de police et de gendarmerie mettent en effet en œuvre différents fichiers pour recueillir, conserver et analyser les informations qui concernent des personnes dont l’activité individuelle ou collective indique qu’elles peuvent porter atteinte à la sécurité publique :
–– la police nationale dispose d’un fichier de prévention des atteintes à la sécurité publique (PASP), déployé depuis le 16 juin 2014. Partagé notamment par le service du renseignement territorial (SCRT) et la direction du renseignement de la préfecture de police de Paris (DRPP), il comprend 49 000 individus inscrits, dont 7 200 pour repli identitaire – qui comprend les personnes radicalisées ;
–– la gendarmerie nationale met pour sa part en œuvre un fichier comparable, le fichier de gestion de l’information et de prévention des atteintes à la sécurité publique (GIPASP), prévu par un décret du 29 mars 2011 (37) ;
–– le seul traitement automatisé de données à caractère personnel commun aux services de renseignement et aux services de police et de gendarmerie est le fichier des personnes recherchées (FPR), qui existe depuis 1969. Comprenant environ 400 000 fiches, il recense à la fois les personnes recherchées par les forces de l’ordre mais aussi celles dont la situation doit être vérifiée par les autorités (38). Le FPR est divisé en vingt et un sous-fichiers regroupant les personnes concernées en fonction du fondement juridique de la recherche ;
L’article 2 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010
relatif au fichier des personnes recherchées
I. Sont inscrites dans le fichier les personnes faisant l’objet des décisions judiciaires mentionnées à l’article 230-19 du code de procédure pénale.
II. Sont inscrites dans le fichier, à la demande des services et unités de police judiciaire ou des autorités judiciaires, les personnes faisant l’objet d’une recherche pour les besoins d’une enquête de police judiciaire :
1° Soit dans le cadre d’une enquête préliminaire, d’une enquête de flagrance ou d’une commission rogatoire ;
2° Soit dans le cadre de la mission d’animation et de coordination des recherches criminelles sur tout le territoire national dévolue à la direction centrale de la police judiciaire ;
3° Soit en cas de disparition de personnes dans des conditions inquiétantes ou suspectes ;
4° Soit en cas de découverte de personnes décédées ou vivantes non identifiées.
III. Peuvent être inscrits dans le fichier à la demande des autorités administratives compétentes :
1° Les étrangers pour lesquels il existe, eu égard aux informations recueillies, des éléments sérieux de nature à établir que leur présence en France constituerait une menace pour l’ordre public susceptible de justifier que l’accès au territoire français leur soit refusé ;
2° Les ressortissants d’un Etat non membre de l’Union européenne faisant l’objet d’une mesure restrictive de voyage, interdisant l’entrée sur le territoire ou le transit par le territoire, adoptée par l’Union européenne ou une autre organisation internationale et légalement applicable en France ;
3° Les personnes mineures faisant l’objet d’une opposition à la sortie du territoire ;
4° Les personnes mineures ayant quitté leur domicile ou s’étant soustraites à l’autorité des personnes qui en ont la garde ;
5° Les personnes faisant l’objet d’un signalement en qualité de débiteurs de l’Etat, des collectivités locales ou de leurs établissements publics, ainsi que les redevables de pensions alimentaires faisant l’objet d’un recouvrement public ;
6° Les personnes recherchées en vue de l’exécution d’une décision de placement d’office en établissement psychiatrique ou évadées d’un tel établissement ;
7° Les personnes disparues faisant l’objet de recherches à la demande d’un membre de leur famille (…) ;
8° Les personnes faisant l’objet de recherches pour prévenir des menaces graves pour la sécurité publique ou la sûreté de l’Etat, dès lors que des informations ou des indices réels ont été recueillis à leur égard ;
9° Les personnes faisant l’objet d’une mesure administrative d’interdiction de stade.
IV. Peuvent également être inscrits dans le fichier à l’initiative des autorités administratives compétentes :
1° Les personnes faisant l’objet de recherches en vue de la notification de mesures administratives concernant leur permis de conduire ;
2° Les personnes faisant l’objet d’une mesure administrative de retrait d’un permis de conduire obtenu indûment ;
3° Les personnes qui n’ont pas restitué au préfet du département de leur lieu de résidence leur permis de conduire invalidé pour solde de points nul (…) ;
4° Les personnes qui font l’objet d’une décision de retrait d’une carte nationale d’identité ou d’un passeport obtenus ou détenus indûment (…) ;
5° Les étrangers faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français non exécutée (…) ;
6° Les étrangers faisant l’objet d’une interdiction de retour en application du III de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pendant sa période de validité ;
7° Les étrangers faisant l’objet d’un arrêté de reconduite à la frontière pris depuis moins de trois ans (…), alors même que la mesure de reconduite a été exécutée ;
8° Les étrangers faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion (…) ;
9° Les étrangers faisant l’objet d’une assignation à résidence (…) ;
10° Les personnes qui font l’objet d’une décision d’interdiction de sortie du territoire ;
11° Les personnes auxquelles a été notifiée une décision d’interdiction de sortie du territoire et qui n’ont pas procédé à la restitution de leur passeport et de leur carte nationale d’identité ;
12° Les étrangers qui font l’objet d’une interdiction administrative du territoire (..).
V. En tant que de besoin (…), le fichier est également constitué de données à caractère personnel issues de traitements gérés par des organismes de coopération internationale en matière de police judiciaire ou des services de police étrangers.
–– le fichier des signalés pour la prévention et la radicalisation à caractère terroriste (FSPRT) est mis en œuvre depuis mars 2015 au sein de l’Unité de coordination de la lutte antiterroriste (UCLAT). Le FSPRT a été récemment réformé afin d’être élargi aux autres acteurs du ministère de l’intérieur et recenser ainsi l’ensemble des individus radicalisés présents sur le territoire national pour éviter les lacunes et les redondances entre les services. Le FSPRT comprendrait aujourd’hui un peu plus de 13 000 noms (39). Il regroupe des signalements émanant de trois sources :
–– les groupes d’évaluation départementaux (GED), qui réunissent de manière hebdomadaire, sous l’autorité du préfet de département, les services de police et de renseignement pour passer en revue les différents individus radicalisés, proposer une inscription au fichier et désigner un service « chef de file » pour chaque nouvel individu inscrit ;
–– la plate-forme nationale d’appel gérée par l’UCLAT, créée en 2014 pour recueillir les signalements d’individus radicalisés ;
–– les différents services de renseignement.
Le dispositif national de prévention de la radicalisation (40)
En France, c’est l’unité de coordination de la lutte antiterroriste (UCLAT) du ministère de l’intérieur qui a été chargée de mettre en œuvre la lutte contre la radicalisation. À cet effet, l’UCLAT a mis en place, le 29 avril 2014, une plateforme de signalement gérée par le Centre national d’assistance et de prévention de la radication (CNAPR). Le CNAPR met à la disposition du public un numéro vert (0 800 005 696) et un formulaire en ligne sur le site du ministère de l’intérieur, permettant de signaler la situation inquiétante d’un proche.
Au-delà de sa mission première d’assistance aux familles, le CNAPR recueille également du renseignement opérationnel dans le but de détecter ou de confirmer le profil d’individus susceptibles de partir combattre à l’étranger et / ou de passer à l’acte terroriste.
La doctrine d’emploi du FSPRT précise que « l’intégration d’un signalement dans le FSPRT constitue l’aboutissement d’un processus d’évaluation rigoureux relevant de la responsabilité des services opérationnels en charge de la lutte contre la radicalisation violente pouvant mener au terrorisme. Si les critères (…) restent soumis à la libre appréciation des services, (…) certains indicateurs objectifs de radicalisation, le plus souvent cumulatifs, sont susceptibles de fonder a minima l’inscription : velléités ou départ effectif vers un théâtre (de guerre), apologie et adhésion à des discours et théories subversives et violentes, ritualisation extrême, soudaine et militante, stratégies de dissimulation et de prosélytisme, comportement de ruptures sociales et familiales… ».
Dès réception des informations transmises par la plateforme téléphonique, il appartient aux préfets d’en aviser le procureur de la République. Ce dernier peut, lorsqu’il s’agit de mineurs, mettre en œuvre des mesures d’assistance éducative. En concertation avec le parquet, les préfets informent le maire de la commune concernée au titre de ses compétences dans la prévention de la délinquance.
Des cellules de suivi mises en place par les préfets mobilisent les services de l’État et les opérateurs concernés : police, gendarmerie, éducation nationale, protection judiciaire de la jeunesse, Pôle emploi, missions locales, collectivités territoriales – outre la mairie concernée et les services sociaux du conseil général – et le réseau d’associations, notamment celles qui interviennent en direction des familles et des jeunes.
Entre le 29 avril 2014, date de sa création, et le 21 mai 2015, la plateforme nationale a pris en compte 2 154 signalements concernant 2 075 personnes. Avec plus de 300 signalements recueillis en janvier et février, le début de l’année 2015 a enregistré un pic en nombre de signalements qui s’explique aisément par les évènements survenus à Paris du 7 au 9 janvier.
Ce sont majoritairement les familles des individus en voie de radicalisation qui appellent le CNAPR (56,2 %), les appels des connaissances, des organismes institutionnels ou les appels anonymes constituant 43,8 % des signalements.
3. L’expérimentation d’un fichier des personnes radicalisées constituant une menace à la sécurité publique
Afin de remédier aux lacunes précédemment décrites, le premier alinéa du présent article autorise le ministre de l’intérieur à mettre en œuvre, à titre expérimental et pour une durée de trois ans, un traitement automatisé de données à caractère personnel dit « fichier des personnes radicalisées constituant une menace à la sécurité publique ou à la sûreté de l’État ».
Le deuxième alinéa du présent article précise les finalités de ce fichier. Il doit permettre de prévenir les actes de terrorisme spécifiquement liés à une radicalisation en :
–– facilitant les contrôles effectués par les services de la police nationale, de la gendarmerie nationale ainsi que des agents de douanes exerçant des missions de police judiciaire ou des missions administratives ;
–– permettant au ministre de l’intérieur, pour les individus constituant une menace grave pour la sécurité et l’ordre public, de prononcer l’interdiction de la fréquentation de certaines personnes, l’assignation à résidence, le placement sous surveillance électronique mobile ou le placement en centre de rétention spécialisé.
Les modalités de création et de consultation du fichier sont renvoyées à un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
*
* *
La Commission examine les amendements identiques CL4 de M. Sergio Coronado et CL17 de M. Sébastien Pietrasanta.
M. Sergio Coronado. La proposition de loi ne précise pas les catégories de données à caractère personnel enregistrées ; elle est également trop floue sur l’identité des personnes autorisées à accéder à ces données. Tout est renvoyé à un décret en Conseil d’État ; celui-ci sera consulté, mais l’exécutif ne sera pas tenu de suivre son avis.
Le législateur n’interviendrait donc nullement sur le contenu et les critères d’inscription à ce fichier, alors même qu’on se trouverait hors de l’état d’urgence.
M. Sébastien Pietrasanta. Le fichier prévu par cet article n’apporterait en réalité aucune plus-value ; bien au contraire, tel qu’il est prévu, il serait contre-productif en informant les personnes fichées qu’elles font l’objet d’une surveillance.
La seule inscription à ce fichier pourrait, en outre, permettre de prendre des mesures de police administrative. Une telle disposition dérogerait à l’article 6 de la loi du 6 janvier 1978, qui interdit qu’une décision produisant des effets juridiques à l’égard d’une personne puisse être prise sur le seul fondement d’un traitement automatisé de données destinées à définir le profil de l’intéressé ou à évaluer certains aspects de sa personnalité.
M. le rapporteur. Avis défavorable. Ce fichier serait très utile. Vous auriez pu, monsieur Pietrasanta, citer à nouveau le procureur de la République de Paris et souligner qu’il y était favorable. Aujourd’hui, il existe différents fichiers, très disparates. Le fichier de traitement des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste (FSPRT), créé récemment, rassemble des profils très divers : cela va de jeunes qui ont contesté la minute de silence après les attentats de janvier 2015 à des personnes qui ont procédé à des décapitations sur les théâtres de guerre.
Nous proposons un fichier recentré sur les personnes pouvant présenter une menace grave pour la sécurité et l’ordre publics. On procéderait à l’inscription sur la base d’éléments objectifs. À partir de cette inscription, on pourrait en effet prendre des mesures de police administrative évoquées à l’article 1er : notre dispositif est cohérent. Les auditions que nous avons menées, comme les contacts que nous pouvons avoir avec les services de police ou de renseignement, nous ont confirmé que cet instrument était assez unanimement considéré comme utile.
La Commission adopte les amendements.
En conséquence, l’article 2 est supprimé.
Chapitre 2
Dispositions applicables aux étrangers menaçant l’ordre public ou coupables de délits et crimes passibles de cinq ans de prison
Article 3
(art. L. 131–30 du code pénal)
Peine complémentaire d’interdiction du territoire français à l’encontre des étrangers déclarés coupable d’un crime ou d’un délit puni d’une peine d’au moins cinq ans d’emprisonnement
Le présent article prévoit que la peine complémentaire d’interdiction du territoire français (ITF) soit prononcée par principe pour les étrangers qui ne séjournent pas régulièrement sur le sol français depuis au moins dix ans et qui se seraient rendus coupable d’un crime ou d’un délit puni d’une peine d’au moins cinq ans d’emprisonnement.
1. La peine complémentaire d’interdiction du territoire français
Dans sa rédaction actuelle, l’article 131-30 du code pénal dispose que, « lorsqu’elle est prévue par la loi, la peine d’interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable d’un crime ou d’un délit ».
Cette peine complémentaire a été introduite dans le code pénal par la loi n° 70-1320 du 31 décembre 1970 relative aux mesures sanitaires de lutte contre la toxicomanie et à la répression du trafic et de l’usage illicite de substances vénéneuses. Appliquée au départ aux étrangers condamnés pour des infractions à la législation sur les stupéfiants, elle a ensuite été étendue par le législateur à certaines infractions parmi les plus graves – en particulier le crime contre l’humanité, le meurtre, le viol, le vol avec violences, l’acte de terrorisme, l’émission de fausse monnaie.
L’ITF est une peine complémentaire, qui s’ajoute à la peine principale prononcée par la juridiction. C’est pour cette raison qu’elle a pu être qualifiée de « double peine », alors qu’elle n’est en réalité qu’une peine complémentaire au même titre, par exemple, que la suspension du permis de conduire. Le prononcé par le juge de la peine d’ITF est facultatif.
Les articles 131-30-1 et 131-30-2 du code pénal déclinent les cas où la peine d’ITF ne peut pas être prononcée ou bien doit être spécialement motivée.
Les restrictions légales au prononcé de la peine complémentaire d’ITF
1. Cas dans lesquels l’ITF ne peut être prononcée
L’article 131-30-2 du code pénal énumère cinq cas dans lesquels la juridiction correctionnelle ou criminelle ne peut infliger l’interdiction du territoire en raison de la situation personnelle de l’intéressé. Il en est ainsi lorsque sont en cause :
– un étranger qui justifie par tous moyens résider en France habituellement depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans ;
– un étranger qui réside habituellement en France depuis plus de vingt ans ;
– un étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui, ne vivant pas en état de polygamie, est marié depuis au moins quatre ans avec un ressortissant français ayant conservé la nationalité française, à condition que ce mariage soit antérieur aux faits ayant entraîné sa condamnation et que la communauté de vie n’ait pas cessé depuis le mariage, ou, sous les mêmes conditions, avec un ressortissant étranger qui justifie par tous moyens résider en France habituellement depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans (41) ;
– un étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui, ne vivant pas en état de polygamie, est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an (42) ;
– un étranger qui réside habituellement en France sous couvert du titre de séjour temporaire délivré à l’étranger résidant en France dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans le pays dont il est originaire.
Aux termes du dernier alinéa de l’article 131-30-2 du code pénal, les cas d’exclusion précités ne sont pas applicables aux :
– atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation : trahison et espionnage, attentat et complot, mouvement insurrectionnel, usurpation de commandement, levée de forces armées et provocation à s’armer illégalement, atteintes à la sécurité des forces armées et aux zones protégées intéressant la défense nationale, atteintes au secret de la défense nationale ;
– infractions en matière de groupes de combat et de mouvements dissous ;
– actes de terrorisme ;
– infractions en matière de fausse monnaie.
Ainsi, l’étranger condamné pour l’une des infractions précitées peut être interdit du territoire même s’il se trouve dans l’un des cas énumérés aux cinq premiers alinéas de l’article 131-30-2 du code pénal.
2. Cas dans lesquels l’ITF doit être spécialement motivée
L’article 131-30-1 du code pénal énumère cinq cas dans lesquels l’interdiction du territoire ne peut être prononcée que par une décision spécialement motivée au regard de la gravité de l’infraction et de la situation personnelle et familiale de l’étranger. Il faut souligner que ces dispositions ne s’appliquent qu’en matière correctionnelle. Il en est ainsi lorsque sont en cause :
– un étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ;
– un étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que ce mariage soit antérieur aux faits ayant entraîné sa condamnation, que la communauté de vie n’ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française ;
– un étranger qui justifie par tous moyens qu’il réside habituellement en France depuis plus de quinze ans, sauf s’il a été, pendant toute cette période, titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » ;
– un étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s’il a été, pendant toute cette période, titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » ;
– un étranger titulaire d’une rente d’accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français à raison d’un taux d’incapacité permanente égal ou supérieur à 20 %.
L’article 131-30-2 du code pénal énumère cinq cas dans lesquels la juridiction correctionnelle ou criminelle ne peut infliger l’interdiction du territoire en raison de la situation personnelle de l’intéressé. Il en est ainsi lorsque sont en cause :
– un étranger qui justifie par tous moyens résider en France habituellement depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans ;
– un étranger qui réside habituellement en France depuis plus de vingt ans ;
– un étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui, ne vivant pas en état de polygamie, est marié depuis au moins quatre ans avec un ressortissant français ayant conservé la nationalité française, à condition que ce mariage soit antérieur aux faits ayant entraîné sa condamnation et que la communauté de vie n’ait pas cessé depuis le mariage, ou, sous les mêmes conditions, avec un ressortissant étranger qui justifie par tous moyens résider en France habituellement depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans (43) ;
– un étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui, ne vivant pas en état de polygamie, est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an (44) ;
– un étranger qui réside habituellement en France sous couvert du titre de séjour temporaire délivré à l’étranger résidant en France dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans le pays dont il est originaire.
Aux termes du dernier alinéa de l’article 131-30-2 du code pénal, les cas d’exclusion précités ne sont pas applicables aux :
– atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation : trahison et espionnage, attentat et complot, mouvement insurrectionnel, usurpation de commandement, levée de forces armées et provocation à s’armer illégalement, atteintes à la sécurité des forces armées et aux zones protégées intéressant la défense nationale, atteintes au secret de la défense nationale ;
– infractions en matière de groupes de combat et de mouvements dissous ;
– actes de terrorisme ;
– infractions en matière de fausse monnaie.
Ainsi, l’étranger condamné pour l’une des infractions précitées peut être interdit du territoire même s’il se trouve dans l’un des cas énumérés aux cinq premiers alinéas de l’article 131-30-2 du code pénal.
3. Cas dans lesquels l’ITF doit être spécialement motivée
L’article 131-30-1 du code pénal énumère cinq cas dans lesquels l’interdiction du territoire ne peut être prononcée que par une décision spécialement motivée au regard de la gravité de l’infraction et de la situation personnelle et familiale de l’étranger. Il faut souligner que ces dispositions ne s’appliquent qu’en matière correctionnelle. Il en est ainsi lorsque sont en cause :
– un étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ;
– un étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que ce mariage soit antérieur aux faits ayant entraîné sa condamnation, que la communauté de vie n’ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française ;
2. La systématisation du prononcé de cette peine complémentaire, un impératif pour la sécurité publique
Comme votre rapporteur l’avait déjà noté dans l’exposé des motifs d’une proposition de loi visant à renforcer la répression de la délinquance étrangère : « En 2010, près de 80 000 condamnations prononcées concernaient des personnes de nationalité étrangère, soit autour de 13 %, alors que la proportion d’étrangers dans la population française ne dépasse pas 4,5 %. En matière d’atteintes aux biens, les étrangers représentent plus de 17 % des 305 000 personnes mises en cause par la police et la gendarmerie en 2007 selon une étude publiée par l’ONDRP. Force est de constater qu’il y a une considérable surreprésentation des étrangers dans les personnes condamnées (45) ».
Le présent article rend, par principe, obligatoire le prononcé de la peine complémentaire d’ITF par la juridiction de jugement à l’encontre des personnes de nationalité étrangère qui soit résident irrégulièrement en France, soit y résident régulièrement mais depuis moins de dix ans, et qui se seront rendus coupables d’un crime ou d’un délit puni d’une peine de cinq ans d’emprisonnement.
La juridiction disposera toujours de la possibilité de ne pas prononcer cette peine par une décision spécialement motivée, au regard notamment « des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci ».
Il convient en outre de souligner que les restrictions légales au prononcé de cette peine, prévues aux articles 131-30-1 et 131-30-2 du code pénal en vue de tenir compte de la situation personnelle et familiale de la personne condamnée, continueront à s’appliquer de plein droit.
Il faut souligner que le dispositif envisagé par le présent article est pleinement conforme aux principes constitutionnels de nécessité et d’individualisation des peines, tels qu’ils ont été consacrés et garantis par le Conseil constitutionnel.
S’agissant tout d’abord du principe de nécessité des peines, le Conseil constitutionnel a jugé, dans sa décision du 9 août 2007 sur la loi renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs, que « lorsque les faits ont été commis en état de récidive légale, les peines minimales sont applicables aux crimes ainsi qu’aux délits punis d’au moins trois ans d’emprisonnement ; que cependant la juridiction peut prononcer une peine inférieure, notamment en considération des circonstances de l’infraction ; que, dès lors, il n’est pas porté atteinte au principe de nécessité des peines » (46) . À l’instar des peines plancher applicables en cas de récidive légale et conformément à la jurisprudence du Conseil constitutionnel, le présent article prévoit, d’une part, que les peines minimales d’interdiction du territoire français ne concernent que les crimes ou délits punis d’une peine d’au moins cinq ans d’emprisonnement, que l’on peut considérer comme présentant objectivement une particulière gravité, et que, d’autre part, la juridiction de jugement dispose toujours de la possibilité de prononcer cette peine pour une durée inférieure aux seuils fixés par la loi.
Par ailleurs, le dispositif prévu par le présent article respecte pleinement le principe d’individualisation des peines(47), dans la mesure où la juridiction de jugement peut, à la lumière des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur, de sa situation personnelle et familiale ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci, soit ne pas prononcer la peine d’interdiction du territoire, soit la prononcer pour une durée inférieure aux seuils prévus par la loi.
*
* *
La Commission examine les amendements identiques CL6 de M. Sergio Coronado et CL18 de M. Sébastien Pietrasanta.
M. Sergio Coronado. L’égalité devant la loi pénale constitue l’un des principes fondamentaux de la République. Étrangers et Français doivent encourir strictement les mêmes peines.
M. Sébastien Pietrasanta. L’article 422-4 du code pénal, introduit par la loi du 21 juillet 2016, rend déjà automatique la peine complémentaire d’interdiction de territoire français pour les personnes étrangères condamnées pour terrorisme, sauf décision spécialement motivée. L’extension de cette peine aux infractions de droit commun ne se justifie pas ; elle peut déjà être prononcée chaque fois qu’elle est justifiée, dans les limites prévues par la loi, et il n’est pas utile de fixer des durées minimales d’interdiction de territoire.
Il faut également rappeler que près de 2 000 interdictions de territoire sont prononcées chaque année par les tribunaux, dont près de 500 à titre définitif.
M. le rapporteur. Avis défavorable. Cet article propose une mesure de bon sens. Nous parlons d’étrangers qui viennent sur le territoire national et ne respectent pas les lois de la République : lorsqu’ils sont lourdement condamnés – pour un crime ou un délit passible au minimum de cinq ans d’emprisonnement –, il est logique qu’ils ne puissent plus résider sur notre sol.
M. Philippe Houillon. Nous discutons ici d’individus dangereux, fichés comme tels. Si nous ne faisons rien, que se passera-t-il le jour où des plaintes seront déposées contre le ministre de l’intérieur pour mise en danger de la vie d’autrui ? Il n’y a pas encore de jurisprudence à ce sujet, mais vous devriez y réfléchir : tôt ou tard, cela arrivera, et le ministre de l’intérieur devra répondre devant une juridiction pénale.
La Commission adopte les amendements.
En conséquence, l’article 3 est supprimé.
Article 4
(art. L. 521–1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)
Expulsion des étrangers faisant l’objet d’une fiche « S » ou inscrits au fichier des personnes radicalisées constituant une menace à la sécurité publique ou à la sûreté de l’État
L’article 4 prévoit explicitement que l’expulsion peut être prononcée à l’encontre d’un étranger faisant l’objet d’une fiche « S », ou inscrit au fichier, créé par l’article 2 de la présente proposition de loi, des personnes radicalisées constituant une menace à la sécurité publique ou à la sûreté de l’État.
1. L’expulsion d’un étranger si sa présence en France constitue une grave menace pour l’ordre public
L’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) prévoit que l’administration peut expulser un étranger si sa présence en France constitue une grave menace pour l’ordre public. Cette mesure vise à préserver l’ordre public, en précipitant le départ d’une personne dont l’attitude a pu révéler une menace pour la sécurité des biens et des personnes. L’appréciation du risque d’atteinte grave à l’ordre public relève du préfet même si les infractions pénales éventuellement commises par l’étranger permettent d’évaluer ce risque. À titre d’exemple, des violences physiques particulièrement graves peuvent révéler une menace pour l’ordre public. Les violences conjugales ou sexuelles graves, en particulier sur les mineurs, ainsi que le trafic de stupéfiants, peuvent également caractériser la menace justifiant l’expulsion.
Certaines catégories d’étrangers sont protégées contre les expulsions par les dispositions de l’article L. 521-2 du CESEDA : les parents d’enfants mineurs résidant en France, les conjoints de Français, les étrangers vivant depuis plus de dix ans régulièrement en France ne peuvent être expulsés que si cette expulsion constitue une « nécessité impérieuse pour la sûreté de l’État et la sécurité publique». Ce motif permet une expulsion en « urgence absolue ».
De même, en application de l’article L. 521-3 du même code, l’expulsion d’étrangers vivant depuis vingt ans en France ou depuis l’âge de treize ans, des conjoints de Français depuis plus de quatre ans et des parents, résidant en France depuis plus de dix ans, d’enfants mineurs résidant en France, ne peut avoir lieu qu’en cas de « comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’État, ou liés à des activités à caractère terroriste ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes ».
Enfin, en application de l’article L. 521–4 du même code, l’étranger mineur de dix-huit ans ne peut pas faire l’objet d’une mesure d’expulsion.
En cas d’expulsion en urgence absolue, l’article R. 522-2 du même code précise que l’autorité administrative compétente est le ministre de l’intérieur. Dans les autres cas, le préfet de département ou, à Paris, le préfet de police est compétent, en application de l’article R. 521-1 du même code.
L’article L. 522-1 du même code prévoit que, sauf en cas d’urgence absolue, l’expulsion d’un étranger ne peut être prononcée qu’après qu’il a été convoqué devant une commission composée de trois magistrats qui l’entendent avant de rendre un avis au préfet. Cette commission, dite « commission d’expulsion », est composée du président du tribunal de grande instance du chef-lieu du département, d’un magistrat désigné par l’assemblée générale du tribunal de grande instance du chef-lieu du département et d’un conseiller de tribunal administratif.
La commission rend son avis, qui ne lie pas le préfet, dans le délai d’un mois à compter de la remise à l’étranger de la convocation mentionnée au premier alinéa. Toutefois, lorsque l’étranger demande le renvoi pour un motif légitime, la commission prolonge ce délai, dans la limite d’un mois maximum à compter de la décision accordant ce renvoi. À l’issue du délai d’un mois ou, si la commission l’a prolongé, du délai supplémentaire qu’elle a fixé, les formalités de consultation de la commission sont réputées remplies.
2. L’extension du dispositif d’expulsion aux étrangers faisant l’objet d’une fiche « S » ou inscrits au fichier des personnes radicalisées constituant une menace à la sécurité publique ou à la sûreté de l’État
Afin de faciliter la prise d’arrêtés d’expulsion, le présent article prévoit de compléter le fondement de la menace grave pour l’ordre public par deux autres critères, non cumulatifs, très objectifs. Il s’agit du fait pour un étranger d’être répertorié :
–– dans la catégorie « S » du fichier des personnes recherchées ;
–– au fichier des personnes radicalisées constituant une menace à la sécurité publique ou à la sûreté de l’État, créé par l’article 2 de la présente proposition de loi.
*
* *
La Commission se saisit des amendements identiques CL19 de M. Sébastien Pietrasanta et CL28 de M. Sergio Coronado.
M. Sébastien Pietrasanta. L’expulsion immédiate d’un étranger est déjà possible, dès lors qu’il constitue une menace grave pour l’ordre public. Le Gouvernement n’a d’ailleurs pas hésité à y recourir : depuis 2012, près de 90 expulsions d’étrangers radicalisés ont été réalisées, dont 16 depuis le début de l’année 2016.
L’actuel article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) dispose que, sous certaines réserves, « l’expulsion peut être prononcée si la présence en France d’un étranger constitue une menace grave pour l’ordre public ». La loi du 7 mars 2016 a en outre restreint les exceptions à cette règle. Les dispositions actuelles sont donc suffisantes.
M. Sergio Coronado. L’adoption de cet article est en effet inutile : toutes les dispositions nécessaires existent déjà dans le droit actuel.
M. le rapporteur. Il s’agit au contraire d’une mesure de bon sens, d’un principe élémentaire de précaution. Nous connaissons la dangerosité de certains individus, inscrits au fichier des personnes recherchées dans la catégorie « S ». Nous proposons également la création d’un fichier destiné à recenser les personnes les plus dangereuses. Comment concevoir que des individus de nationalité étrangère demeurent sur le territoire national alors qu’ils présentent une menace très grave, qu’ils s’apprêtent peut-être à commettre un attentat ? J’avoue ne pas comprendre votre refus d’une telle mesure : dès lors que le ministre de l’intérieur a connaissance de la dangerosité de ces personnes, peut-il rester immobile, impuissant, inactif ? Notre législation doit évoluer. On peut expulser aujourd’hui, mais nous souhaitons que cette expulsion soit systématique.
S’agissant de l’hospitalisation sous contrainte que nous évoquions tout à l’heure, le JLD intervient en effet, comme Mme Mazetier l’a rappelé, au bout de huit jours.
La Commission adopte les amendements.
En conséquence, l’article 4 est supprimé.
Article 5
(art. L. 521–1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)
Extension des possibilités d’expulsion au cas des étrangers coupables de tout délit ou crime passible d’au moins cinq ans d’emprisonnement
Le présent article, comme le précédent, complète l’article L. 521–1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il étend les possibilités d’expulsion au cas des étrangers coupables de tout délit ou crime passible d’au moins cinq ans d’emprisonnement.
Cet article s’inscrit dans la logique de l’article L. 521–2 du même code, qui exclut du bénéfice du dispositif des personnes protégées les personnes ayant été condamnées définitivement à une peine d’emprisonnement ferme au moins égale à cinq ans.
*
* *
La Commission se saisit des amendements identiques CL8 de M. Sergio Coronado et CL20 de M. Sébastien Pietrasanta.
M. Sergio Coronado. Sébastien Pietrasanta l’a rappelé, il est aujourd’hui possible d’expulser un étranger qui représente une menace grave à l’ordre public, et nous ne sommes pas opposés à ces expulsions. Ce que vous dites est faux, monsieur le rapporteur : vos propositions n’apportent rien au droit existant. Les mensonges et les tirades démagogiques ne peuvent être laissés sans réponse.
Quant à l’expulsion administrative, objet de cet article, elle doit demeurer une mesure exceptionnelle, réservée aux atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation, ne pouvant frapper un étranger ayant en France des attaches personnelles ou familiales ; elle doit être prononcée après un avis conforme de la commission d’expulsion, et les recours doivent être suspensifs.
Cette mesure existe depuis longtemps dans notre droit et a pu servir dans des cas très variés. Vous savez tous que Daniel Cohn-Bendit a fait l’objet d’une telle décision. Je ne suis pourtant pas sûr qu’il représentait, en 1968, un trouble grave à l’ordre public.
Contre l’avis défavorable du rapporteur, la Commission adopte les amendements.
En conséquence, l’article 5 est supprimé.
La Commission examine l’amendement CL45 du rapporteur.
M. le rapporteur. L’amendement prévoit que les services de l’État informent systématiquement le président du conseil départemental – qui verse notamment le revenu de solidarité active (RSA) – de tout départ vers la zone irako-syrienne. À la tête du département des Alpes-Maritimes, j’ai été confronté à des cas où cette information, connue des autorités administratives, ne nous était pas parvenue. Nous ne pouvions donc pas suspendre, ou interrompre, le versement du RSA à ces personnes qui ne respectaient pourtant pas l’obligation de ne pas quitter le territoire national pendant plus de trois mois.
La Commission rejette l’amendement.
Elle se saisit ensuite de l’amendement CL43 du rapporteur.
M. le rapporteur. Cet amendement vise à permettre aux policiers municipaux de procéder à des contrôles d’identité.
La Commission rejette l’amendement.
Puis elle examine l’amendement CL44 du rapporteur.
M. le rapporteur. Cet amendement permet au préfet d’autoriser la fouille des bagages et la visite des véhicules, hors état d’urgence. Il pérennise ainsi une possibilité ouverte par la loi du 21 juillet 2016.
La Commission rejette l’amendement.
Elle se saisit alors de l’amendement CL40 du rapporteur.
M. le rapporteur. Dans le même esprit, cet amendement vise à autoriser les perquisitions administratives même hors état d’urgence.
La Commission rejette l’amendement.
Puis elle examine l’amendement CL42 du rapporteur.
M. le rapporteur. Cet amendement permet, sur le modèle du passport ban instauré au Royaume-Uni, d’interdire l’entrée sur le territoire à des personnes qui se seraient rendues sur des théâtres d’opérations de groupements terroristes et dont on peut penser qu’elles pourraient porter atteinte à la sécurité publique.
La Commission rejette l’amendement.
Elle se saisit ensuite de l’amendement CL41 rectifié du rapporteur.
M. le rapporteur. Cet amendement vise à permettre aux services spécialisés de renseignement d’accéder à des fichiers d’autres administrations – ainsi, aujourd’hui, ces services n’ont pas accès aux données des caisses d’allocations familiales. On en reste pantois.
La Commission rejette l’amendement.
Chapitre III
Dispositions relatives à la création d’une rétention de sûreté pour les personnes condamnées pour crime terroriste, et d’un délit de séjour à l’étranger sur un théâtre d’opérations de groupements terroristes
Article 6
(art. 362, 706-25-15 à 706-25-24 [nouveaux], 723-37-1 [nouveau]
et 723-38 du code de procédure pénale)
Rétention et surveillance de sûreté pour les personnes
condamnées pour un crime terroriste
L’article 6 étend aux auteurs de certains crimes terroristes le régime de la rétention et de la surveillance de sûreté, créé en 2008, puis élargi en 2010, dans le but de protéger la société contre certains criminels ayant purgé leur peine mais qui demeurent, à leur sortie de prison, particulièrement dangereux.
1. La rétention et la surveillance de sûreté, des mesures de protection de la société contre certains criminels particulièrement dangereux ayant purgé leur peine
La rétention de sûreté et la surveillance de sûreté, mesures de sûreté mises en œuvre respectivement en milieux fermé et ouvert, ont été créées par la loi n° 2008-174 du 25 février 2008 relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental.
Destinées à prémunir la société de la dangerosité de certains criminels qui ont fini de purger leur peine, elles sont nées de l’insuffisance des dispositifs existants destinés à la prise en charge de ces personnes : suivi socio-judiciaire (48), inscription au fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes (FIJAISV), surveillance judiciaire (49)...
Leur inscription dans notre droit faisait suite aux travaux de la Commission Santé-Justice présidée par Jean-François Burgelin (50), de la mission d’information sénatoriale sur les mesures de sûreté concernant les personnes dangereuses (51) et de la mission parlementaire conduite par M. Jean-Paul Garraud sur l’évaluation de la dangerosité des auteurs d’infractions pénales atteints de troubles mentaux (52).
La rétention et la surveillance de sûreté sont régies par les articles 706-53-13 à 706-53-22 du code de procédure pénale, figurant au chapitre III du titre XIX du livre IV de ce code, relatif à la procédure applicable aux infractions de nature sexuelle et à la protection des victimes.
a. La rétention de sûreté
L’article 706-53-13 dispose que la rétention de sûreté « consiste dans le placement de la personne intéressée en centre socio-médico-judiciaire de sûreté dans lequel lui est proposée, de façon permanente, une prise en charge médicale, sociale et psychologique destinée à permettre la fin de cette mesure ». Prononcée « [à] titre exceptionnel », elle est strictement encadrée :
–– elle est réservée aux « personnes dont il est établi, à l’issue d’un réexamen de leur situation intervenant à la fin de l’exécution de leur peine, qu’elles présentent une particulière dangerosité caractérisée par une probabilité très élevée de récidive parce qu’elles souffrent d’un trouble grave de la personnalité » ;
–– seules sont concernées les « personnes (…) condamnées à une peine de réclusion criminelle d’une durée égale ou supérieure à quinze ans pour les crimes, commis sur une victime mineure, d’assassinat ou de meurtre, de torture ou actes de barbarie, de viol, d’enlèvement ou de séquestration » ainsi que « pour les crimes, commis sur une victime majeure, d’assassinat ou de meurtre aggravé, de torture ou actes de barbarie aggravés, de viol aggravé, d’enlèvement ou de séquestration aggravé », ou, depuis 2010, « lorsqu’ils sont commis en récidive, de meurtre, de torture ou d’actes de barbarie, de viol, d’enlèvement ou de séquestration » ;
–– la cour d’assises doit avoir expressément prévu dans sa décision de condamnation que la personne peut faire l’objet à la fin de sa peine d’un réexamen de sa situation en vue d’une éventuelle rétention de sûreté.
Si la cour d’assises le décide, la personne condamnée fait l’objet d’un examen par la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté au moins un an avant la date prévue de sa libération « afin d’évaluer [sa] dangerosité ».
Composition de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté
(article R. 61-8 du code de procédure pénale)
1° Un président de chambre à la cour d’appel désigné pour une durée de cinq ans par le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle siège la commission, président ;
2° Le préfet de région, préfet de la zone de défense dans le ressort de laquelle siège la commission, ou son représentant ;
3° Le directeur interrégional des services pénitentiaires compétent dans le ressort de la cour d’appel où siège la commission, ou son représentant ;
4° Un expert psychiatre ;
5° Un expert psychologue titulaire d’un diplôme d’études supérieures spécialisées ou d’un mastère de psychologie ;
6° Un représentant d’une association d’aide aux victimes ;
7° Un avocat, membre du conseil de l’ordre.
Après observation de la personne dans un service spécialisé durant six semaines au moins, la commission rend un avis motivé sur la dangerosité du condamné et peut proposer qu’il fasse l’objet d’une rétention de sûreté à la double condition que les obligations résultant de son inscription au FIJAISV ou d’un placement sous surveillance électronique mobile soient insuffisantes pour prévenir la commission d’infractions et que « cette rétention constitue (…) l’unique moyen de prévenir la commission, dont la probabilité est très élevée, de ces infractions ». À défaut, la commission peut aussi renvoyer le dossier au juge de l’application des peines en vue d’un placement sous surveillance judiciaire (article 706-53-14).
La décision de placement en rétention est prise par une juridiction spécialisée, la juridiction régionale de la rétention de sûreté (JRRS), composée d’un président de chambre et de deux conseillers de cour d’appel. Cette juridiction statue après un débat contradictoire par une décision spécialement motivée, susceptible d’un recours devant la juridiction nationale de la rétention de sûreté (JNRS), composée de trois conseillers à la Cour de cassation désignés pour une durée de trois ans par le premier président de cette cour et dont la décision est elle-même susceptible d’un pourvoi en cassation (article 706-53-15).
Valable pour une durée d’un an, la décision de rétention peut être renouvelée dans les mêmes conditions et selon la même procédure que la décision initiale (article 706-53-16).
Les articles 706-53-17 et 706-53-18 précisent les conditions dans lesquelles la JRRS peut mettre fin à la mesure, d’office ou à la demande de la personne concernée.
Le centre socio-médico-judiciaire de sûreté est installé depuis 2008 au sein de l’établissement public de santé national de Fresnes et dispose d’une capacité de 10 places. En 2015, le centre avait accueilli 5 personnes depuis sa création : 2 en 2012, 2 en 2013 et 1 en 2014.
b. La surveillance de sûreté
Mesure de sûreté en milieu ouvert, la surveillance de sûreté peut constituer une alternative à la rétention de sûreté ou lui faire suite dans les conditions fixées par l’article 706-53-19.
Elle est décidée, pour une durée de deux ans renouvelable, par la JRRS, « [s]i la rétention de sûreté n’est pas prolongée ou s’il y est mis fin (…) et si la personne présente des risques de commettre les infractions mentionnées à l’article 706-53-13 ». Elle comprend les mêmes obligations que celles prévues dans le cadre de la surveillance judiciaire, en particulier une injonction de soins, et, après vérification de la faisabilité technique de la mesure, le placement sous surveillance électronique mobile. La décision de placement sous surveillance est susceptible des mêmes recours que ceux prévus pour la rétention de sûreté. La mainlevée de la mesure peut être demandée dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 706-53-17 (premier et deuxième alinéas).
La méconnaissance par la personne surveillée de ses obligations, en particulier « le fait pour celle-ci de refuser de commencer ou de poursuivre le traitement prescrit par le médecin traitant et qui lui a été proposé dans le cadre d’une injonction de soins », peut conduire à la rétention de sûreté. En effet, si la personne « présente à nouveau une particulière dangerosité caractérisée par une probabilité très élevée de commettre à nouveau l’une des infractions mentionnées à l’article 706-53-13 », le président de la JRRS peut ordonner en urgence le placement provisoire de la personne dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté, qui doit être confirmé dans un délai maximal de trois mois par la juridiction régionale statuant selon la procédure prévue à l’article 706-53-15 (troisième alinéa). Le placement en rétention « ne peut être ordonné qu’à la condition qu’un renforcement des obligations de la surveillance de sûreté apparaisse insuffisant pour prévenir la commission des infractions » (quatrième alinéa).
Le placement sous surveillance électronique mobile n’est possible qu’avec l’accord de l’intéressé ; à défaut ou si ce dernier ne satisfait pas ses obligations, le placement en rétention peut être ordonné (avant-dernier alinéa). Si la personne ne respecte pas ses obligations, il peut être décerné mandat d’arrêt ou d’amener contre elle afin qu’elle soit présentée devant le président de la JRRS (dernier alinéa).
La surveillance de sûreté peut aussi être prononcée directement à l’issue d’une surveillance judiciaire, en vertu de l’article 723-37 du code de procédure pénale, ou d’un suivi socio-judiciaire, conformément à l’article 763-8 du même code, afin de prolonger tout ou partie des obligations auxquelles est astreinte la personne.
La première décision de placement sous surveillance de sûreté a été rendue le 6 avril 2009 par la JRRS de Paris et, depuis, une cinquantaine de décisions de placement ont été prononcées.
2. L’extension de la mesure aux auteurs de certains crimes terroristes qui présentent une « particulière dangerosité »
Le I de l’article 6 élargit le dispositif de la rétention et de la surveillance de sûreté aux personnes condamnées pour une infraction terroriste. À cette fin, le 2° complète le titre XV du livre IV du code de procédure pénale, relatif à la poursuite, à l’instruction et au jugement des actes de terrorisme, par une nouvelle section 4 comprenant les articles 706-25-15 à 706-25-24 qui adaptent aux personnes condamnées pour terrorisme la procédure fixée par les articles 706-53-13 à 706-53-22.
a. La rétention de sûreté
Aux termes du nouvel article 706-25-15, seraient concernées par la rétention de sûreté les « personnes (…) condamnées à une peine de réclusion criminelle d’une durée égale ou supérieure à quinze ans pour les crimes prévus au 1° de l’article 421-1 et aux articles 421-5 et 421-6 du code pénal », qui visent :
– lorsqu’elles sont intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur, les atteintes volontaires à la vie, les atteintes volontaires à l’intégrité de la personne, l’enlèvement et la séquestration ainsi que le détournement d’aéronef, de navire ou de tout autre moyen de transport ;
– la direction ou l’organisation du groupement ou de l’entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’un acte de terrorisme ;
– le fait de participer à un tel groupement ou à une telle entente en vue de la préparation d’un ou de plusieurs crimes d’atteintes aux personnes, d’une ou de plusieurs destructions par substances explosives ou incendiaires dans des circonstances de temps ou de lieu susceptibles d’entraîner la mort, ou en vue d’introduire dans l’atmosphère, sur le sol, dans le sous-sol, dans les aliments ou les composants alimentaires ou dans les eaux, y compris celles de la mer territoriale, une substance de nature à mettre en péril la santé de l’homme ou des animaux ou le milieu naturel dans des conditions susceptibles d’entraîner la mort d’une ou de plusieurs personnes.
Comme pour les crimes sexuels et violents, cette rétention de sûreté devrait avoir un caractère exceptionnel et ne concerner que des personnes « dont il est établi, à l’issue d’un réexamen de leur situation intervenant à la fin de l’exécution de leur peine, qu’elles présentent une particulière dangerosité caractérisée par une probabilité très élevée de récidive ». À la différence des crimes sexuels et violents, cette rétention n’aurait cependant pas, pour les personnes condamnées pour crime terroriste, de caractère médical : c’est la raison pour laquelle le premier alinéa du nouvel article 706-25-15 ne lie pas la particulière dangerosité de la personne à l’existence de troubles graves de la personnalité.
Elle ne pourrait être prononcée que si la cour d’assises a expressément prévu, au moment de rendre sa décision de condamnation, que la personne peut faire l’objet d’un réexamen de sa situation en vue d’une rétention. Le 1° procède aux coordinations nécessaires à l’article 362 du code de procédure pénale pour prévoir que la cour d’assises statue, le cas échéant, sur l’opportunité de réexaminer la situation du condamné pour le rendre éligible à la rétention de sûreté.
La procédure de placement en rétention, fixée aux nouveaux articles 706-25-16 à 706-25-20, est identique à celle prévue pour le placement en rétention de sûreté des auteurs d’actes criminels sexuels ou violents : évaluation pluridisciplinaire préalable de la personne, avis d’une commission pluridisciplinaire sur l’opportunité du placement, compétence des juridictions de la rétention de sûreté pour décider du placement, durée de la mesure, voies de recours…
Toutefois, le dispositif proposé diffère de celui prévu pour les auteurs de crimes sexuels ou violents sur trois points, compte tenu du profil des condamnés terroristes :
–– l’évaluation pluridisciplinaire de dangerosité dont doit faire l’objet la personne préalablement à la décision de placement ne serait pas assortie d’une expertise médicale ;
–– avant de proposer le placement en rétention, la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté devrait vérifier « que la personne condamnée a effectivement été mise en mesure de bénéficier, pendant l’exécution de sa peine, d’une prise en charge adaptée » : le dispositif ne fait pas référence à la nature médicale, sociale et psychologique de cette prise en charge, ni à son caractère adapté au trouble de la personnalité dont l’individu souffre ;
–– la commission pourrait proposer, par un avis motivé, le placement en rétention de la personne si « [l]es obligations résultant de l’inscription dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes, ainsi que, le cas échéant, les obligations résultant d’un placement sous surveillance électronique mobile, susceptible d’être prononcé dans le cadre d’un suivi socio-judiciaire ou d’une surveillance judiciaire, apparaissent insuffisantes pour prévenir la commission des infractions mentionnées à l’article 706-25-15 » et, comme pour les auteurs de crimes sexuels ou violents, « si cette rétention constitue ainsi l’unique moyen de prévenir la commission, dont la probabilité est très élevée, de ces infractions ».
b. La surveillance de sûreté
Le nouvel article 706-25-21 étend, dans des conditions similaires à celles posées pour les auteurs de crimes sexuels ou violents, la surveillance de sûreté aux personnes condamnées pour les mêmes crimes terroristes.
À l’instar des auteurs de crimes sexuels ou violents, la surveillance de sûreté comprendrait des obligations identiques à celles prévues dans le cadre de la surveillance judiciaire – à l’exception de l’injonction de soins – et le placement sous surveillance électronique mobile.
Le placement sous surveillance de sûreté ne pourrait être décidé, pour une durée de deux ans renouvelable, que par la JRRS « [s]i la rétention de sûreté n’est pas prolongée ou s’il y est mis fin (…) et si la personne présente des risques de commettre les infractions mentionnées à l’article 706-25-15 ».
En cas de méconnaissance par la personne de ses obligations ou si elle refuse le placement sous surveillance électronique mobile, la personne pourrait être placée en rétention de sûreté, dans les mêmes conditions que celles prévues pour les auteurs de crimes sexuels ou violents. La rétention et la surveillance de sûreté ne revêtant pas nécessairement, pour les condamnés terroristes, de caractère médical, il n’est pas précisé que constitue une méconnaissance de ses obligations par la personne placée sous surveillance de sûreté le fait de refuser de commencer ou de poursuivre le traitement prescrit par le médecin traitant et qui lui a été proposé dans le cadre d’une injonction de soins.
Comme pour les crimes sexuels ou violents, la surveillance de sûreté peut également être prononcée directement à l’issue d’une surveillance judiciaire, pour une durée de deux ans renouvelable. Tel est l’objet du 3° du I qui insère à cet effet un nouvel article 723-37-1 au sein du code de procédure pénale.
La décision est prise par la JRRS, saisie six mois avant la fin de la surveillance judiciaire, après expertise constatant la persistance de la dangerosité, dans le cas où « [l]es obligations résultant de l’inscription dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes apparaissent insuffisantes pour prévenir la commission des infractions mentionnées à l’article 706-25-15 » et « si cette mesure constitue l’unique moyen de prévenir la commission, dont la probabilité est très élevée, de ces infractions ». En cas de méconnaissance par la personne de ses obligations, un placement en rétention de sûreté peut être décidé selon la procédure prévue aux quatre derniers alinéas de l’article 706-25-21.
Dans le prolongement de ce qui existe déjà pour les auteurs de crimes sexuels ou violents, le dernier alinéa du nouvel article 723-37-1 permet que la surveillance de sûreté intervienne immédiatement à la suite de l’exécution de la peine de réclusion, à la libération du condamné, dans l’hypothèse où la personne, précédemment libérée sous surveillance judiciaire, se serait vu retirer toutes les réductions de peine à la suite d’une violation des obligations auxquelles elle était soumise « dans des conditions qui font apparaître des risques qu’elle commette à nouveau l’une des infractions mentionnées à l’article 706-25-15 ». Cette disposition vise à réduire les hypothèses de sortie sèche d’un condamné terroriste réincarcéré après une méconnaissance de ses obligations de surveillance judiciaire, signe d’une dangerosité ou d’un risque de récidive.
Le 4° du I procède à la coordination nécessaire à l’article 723-38 du code de procédure pénale. Il prévoit que, dans le cadre d’une surveillance judicaire assortie d’un placement sous surveillance électronique mobile, qui a été prolongée à l’encontre d’une personne relevant du champ d’application de la rétention de sûreté pour crime terroriste, le placement sous surveillance électronique mobile peut être renouvelé aussi longtemps que la personne reste placée sous surveillance judiciaire.
c. Les dispositions communes
Les nouveaux articles 706-25-22 à 706-25-24, créés par le 2° du I, qui reprennent les articles 706-53-20 à 706-53-22 applicables aux auteurs de crimes sexuels ou violents, posent les règles communes à la rétention et à la surveillance de sûreté lorsqu’elles s’appliquent aux auteurs de crimes terroristes :
–– la rétention et la surveillance seraient applicables aux personnes dont la particulière dangerosité n’aurait permis aucune libération anticipée, mais également aux personnes dont la libération conditionnelle aurait été révoquée (article 706-25-22) ;
–– elles seraient suspendues par toute détention intervenue au cours de leur exécution, la reprise de la mesure devant être confirmée par la JRRS « au plus tard trois mois après la cessation de la détention » si celle-ci dure plus de six mois (article 706-25-23) ;
–– le pouvoir réglementaire serait compétent pour préciser les modalités d’application de cette nouvelle section, en particulier « les conditions dans lesquelles s’exercent les droits des personnes retenues dans un centre judiciaire de sûreté » (article 706-25-24).
3. Un dispositif conforme à l’État de droit
Transposition du dispositif figurant au sein du code de procédure pénale pour les auteurs de crimes sexuels ou violents, le présent article s’inscrit en conformité avec la jurisprudence constitutionnelle relative aux mesures de sûreté telle que le Conseil constitutionnel l’a établie en 2008 dans sa décision n° 2008-562 DC sur la loi relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental.
Dans cette décision, le Conseil constitutionnel a notamment jugé conforme à la Constitution la rétention de sûreté au motif qu’elle répondait à une triple exigence d’adéquation au but recherché, de nécessité et de proportionnalité. Seule différence avec le régime déclaré conforme à la Constitution en 2008, la dimension médicale de la personnalité des personnes concernées et de la procédure de placement en rétention n’est pas expressément mentionnée par le présent article afin de tenir compte de la nature particulière de la dangerosité des condamnés terroristes.
Votre rapporteur relève que cet article se conforme également aux conditions posées par le Conseil d’État dans l’avis qu’il a rendu le 17 décembre 2015 sur la constitutionnalité et la compatibilité avec les engagements internationaux de la France de certaines mesures de prévention du risque de terrorisme. Dans cet avis, le Conseil d’État a subordonné l’extension de la rétention de sûreté aux condamnés terroristes à deux séries de conditions.
Sur le plan juridique, il a estimé qu’« [u]n dispositif particulier de rétention de personnes radicalisées condamnées pour acte de terrorisme et dont la personnalité en fin de peine présenterait encore une grande dangerosité ne pourrait être établi par la loi, afin de prévenir la récidive par des individus encore radicalisés, que si, en premier lieu, ce dispositif comportait les mêmes garanties juridiques que celles prévues par les articles 706-53-13 et suivants du code de procédure pénale, telles qu’explicitées et complétées par le Conseil constitutionnel :
– cette rétention de sûreté ne pourrait concerner que les personnes radicalisées condamnées pour un crime constituant un acte de terrorisme et dont la personnalité en fin de peine présenterait encore une grande dangerosité ;
– la rétention de sûreté en matière de terrorisme ne pourrait être ordonnée que si la décision de condamnation a prévu le réexamen, à la fin de sa peine, de la situation de la personne condamnée en vue de l’éventualité d’une telle mesure ;
– des procédures offrant les mêmes garanties que celles prévues par les articles 706-53-13 et suivants du code de procédure pénale devraient être prévues pour vérifier la dangerosité de l’intéressé ;
– la rétention de sûreté ne pourrait être décidée à titre exceptionnel par une juridiction qu’à défaut d’autre mesure efficace moins attentatoire à la liberté individuelle et qu’après que cette juridiction aurait vérifié que la personne condamnée a été mise en mesure de bénéficier pendant l’exécution de sa peine d’une prise en charge adaptée ;
– elle devrait être décidée pour une durée limitée, ses renouvellements étant soumis à une appréciation juridictionnelle » (53).
Tel est l’objet des nouveaux articles 706-53-13 à 706-53-22 du code de procédure pénale.
Par ailleurs, le Conseil d’État recommandait de mettre au point des dispositifs d’évaluation de la menace persistante et de prise en charge de la dangerosité des personnes radicalisées condamnées pour acte de terrorisme afin de tenir compte de la différence de situation qui existe entre, d’une part, la rétention de sûreté prévue en application des articles 706-53-13 et suivants du code de procédure pénale, « conçue pour les personnes à troubles graves de la personnalité » pour « favoriser, après expertise médicale, un traitement par des soins adaptés tendant à la réinsertion par la guérison » et, d’autre part, la situation des personnes radicalisées condamnées pour crimes de terrorisme qui persistent dans la dangerosité, relevant d’une autre logique et d’un autre type de prise en charge.
Votre rapporteur observe que la mise au point de tels dispositifs d’évaluation, qui fait déjà l’objet d’expérimentations (54) et de travaux de recherche initiés par le Gouvernement, ne relève pas du domaine de la loi mais du pouvoir réglementaire. Le nouvel article 706-25-24 a précisément pour objet de confier à un décret en Conseil d’État le soin de préciser les modalités d’application de la rétention de sûreté aux condamnés terroristes.
Enfin, le dispositif proposé est conforme à la jurisprudence constitutionnelle relative aux modalités d’entrée en vigueur de la rétention de sûreté. Le II de l’article 6 prévoit que les personnes exécutant, à la date d’entrée en vigueur de la loi, une peine privative de liberté pour les crimes terroristes précédemment mentionnés pourraient être soumises, à l’issue de leur peine, dans le cadre de la surveillance judiciaire puis, le cas échéant, de la surveillance de sûreté, à une assignation à domicile sous le régime du placement sous surveillance électronique mobile.
Cette disposition vise à renforcer la surveillance dont pourraient faire l’objet les personnes qui exécuteraient une peine de réclusion criminelle prononcée antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi. En effet, ces personnes ne pourraient pas se voir appliquer la rétention de sûreté créée par la loi, mesure qui, pour le Conseil constitutionnel, « eu égard à sa nature privative de liberté, à la durée de cette privation, à son caractère renouvelable sans limite et au fait qu’elle est prononcée après une condamnation par une juridiction, ne saurait être appliquée à des personnes condamnées avant la publication de la loi ou faisant l’objet d’une condamnation postérieure à cette date pour des faits commis antérieurement » (55). En revanche, le Conseil constitutionnel a admis que ces personnes puissent faire l’objet d’une surveillance de sûreté, qui relève des mesures de sûreté « classiques » immédiatement applicables.
*
* *
La Commission examine les amendements identiques CL21 de M. Sébastien Pietrasanta et CL29 de M. Sergio Coronado.
M. Sébastien Pietrasanta. Aujourd’hui, la rétention de sûreté revêt un caractère exceptionnel et ne peut être prononcée par la juridiction régionale de la rétention de sûreté qu’après le placement de la personne concernée, pendant six semaines au moins, dans un service spécialisé chargé d’évaluer sa dangerosité de façon pluridisciplinaire. Deux expertises médicales sont en outre nécessaires. Le Conseil constitutionnel n’avait d’ailleurs validé ce dispositif que sous la double condition de sa subsidiarité et de l’évaluation médicale de la dangerosité.
La rétention de sûreté est prononcée pour une durée d’un an, renouvelable tant que la dangerosité perdure. Sa nature juridique demeure incertaine : aux yeux du Conseil constitutionnel, ce n’est pas une peine ; la Cour européenne des droits de l’homme est d’un avis contraire.
Vous proposez de rendre la rétention et la surveillance de sûreté applicables aux personnes condamnées pour un crime terroriste, même en l’absence de circonstance aggravante de droit commun. Dans son avis du 17 décembre 2015, le Conseil d’État s’était déclaré favorable à la mise en place d’un système reposant sur une autre logique : celle de la déradicalisation.
La rétention de sûreté porte atteinte aux libertés fondamentales ; pour l’appliquer, il est indispensable de respecter les principes de proportionnalité et de nécessité. Elle doit notamment être limitée aux crimes, être prononcée par la cour d’assises et sa nécessité doit être évaluée en fin de peine.
Son extension à tous les actes terroristes punis d’une peine supérieure ou égale à quinze ans de réclusion criminelle n’est pas envisageable. L’article reprend en effet, sans l’adapter, le dispositif de la rétention de sûreté, créé dans une autre logique : celle du soin.
M. Sergio Coronado. Le législateur est déjà allé très loin en empêchant la libération des personnes condamnées à perpétuité pour des crimes terroristes : nous avons ainsi prévu une sorte de perpétuité réelle. Concrètement, l’espoir d’une libération ne pourra naître qu’après trente ans de détention, et il pourra être tué dans l’œuf si l’on estime que la levée du caractère incompressible de la période de sûreté, préalable indispensable à toute possibilité d’aménagement de peine, est susceptible de causer un trouble grave à l’ordre public. En outre, l’avis des victimes sera recueilli, ainsi que celui d’une commission composée de cinq magistrats de la Cour de cassation.
Nous sommes très loin des traditions françaises en matière de droit pénal. Comme le dit Denis Salas, « il n’y a pas de différence entre une détention en attendant l’exécution et une détention en attendant la mort » : nous sommes ici aux frontières du droit pénal.
M. le rapporteur. Il s’agit là d’une question absolument essentielle. Il faut éviter que des personnes dont on connaît l’extrême dangerosité ne recommencent leurs crimes en sortant de prison. Nous connaissons les failles du système actuel : tous les travaux menés sur le terrorisme islamiste ont mis en lumière la dangerosité de certaines personnes, et leur incapacité à sortir du djihadisme et de la radicalisation. Comment imaginer que des individus qui rejettent nos institutions et les valeurs de la République, et dont nous savons qu’ils resteront des menaces, puissent être remis en liberté ?
Il faut protéger notre société. Nous ne considérons pas ce dispositif comme contraire aux libertés fondamentales, bien au contraire : il est la garantie de la protection des libertés fondamentales de chaque citoyen à ne pas être menacé par ceux dont l’État connaît la dangerosité.
Les outils mis en place aujourd’hui – suivi socio-judiciaire, notamment – ont montré leur inutilité. Quant aux centres de déradicalisation, le Premier ministre en parle beaucoup, mais ils ne fonctionnent toujours pas : depuis 2012, rien de concret n’a été fait. Un centre est annoncé, mais combien de personnes y seront placées ? Qu’y fera-t-on ? Au bout de quatre ans, le bilan est pour le moins mitigé.
Enfin, le tribunal de l’application des peines conserve toujours la possibilité de prononcer, après une durée de réclusion de trente ans, un aménagement de peine.
Je ne comprends pas votre logique. Et je suis prêt à parier que vous nous rejoindrez pour prendre ces mesures si, par malheur, des tragédies nous frappent à nouveau.
La Commission adopte les amendements.
En conséquence, l’article 6 est supprimé.
L’amendement CL32 du rapporteur n’a plus d’objet.
Article 7
(art. 421-2-7 [nouveau] et 421-5 du code pénal)
Délit de séjour intentionnel sur un théâtre
d’opérations de groupements terroristes
L’article 7 vise à sanctionner le séjour sur un théâtre d’opérations terroristes par la création d’un délit terroriste, défini au nouvel article 421-2-7 du code pénal et puni de cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende.
Cette nouvelle infraction se distinguerait de l’association de malfaiteurs en vue d’une entreprise terroriste, définie à l’article 421-2-1 du même code comme « le fait de participer à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’un des actes de terrorisme » mentionnés aux articles 421-1 et 421-2. Cette incrimination sert aujourd’hui de fondement aux poursuites engagées à l’encontre des personnes de retour d’une zone de combats d’un groupement terroriste. L’infraction est constituée lorsqu’il peut être apporté la preuve de trois éléments distincts :
–– l’existence d’un groupement ou d’une entente de personnes, constitués par des faits matériels (achat de matériel militaire, échanges opérationnels…) ayant la résolution d’agir en commun ;
–– la poursuite d’une entreprise ayant pour finalité de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur ;
–– l’adhésion volontaire à ce groupement en connaissance de cause, avec la volonté d’y apporter une aide effective.
La commission d’enquête de l’Assemblée nationale sur la surveillance des filières et des individus djihadistes, présidée par votre rapporteur, rappelait que les juges devaient « apporter la preuve que les personnes s’étant rendues en Syrie et en Irak l’ont fait pour rejoindre un groupe terroriste, principalement Jabhat al-Nosra ou Daech, ce qui peut être complexe, du fait de la situation en Syrie, où combattent plusieurs groupes, dont l’armée syrienne libre (ASL) qui n’a pas de caractère terroriste » et parce que « [l]es djihadistes cherchent (…) souvent à dissimuler les raisons de leur voyage derrière des motifs humanitaires ou religieux (l’émigration en terre d’islam, la hijra) ».
Tout en notant que « le recueil des preuves ne pose pas pour le moment de difficulté majeure, les djihadistes se mettant fréquemment en scène sur les réseaux sociaux, tandis que d’autres sont reconnus par des personnes arrêtées à leur retour », elle relevait que, « [d]ans l’hypothèse d’une évolution de leur comportement vers la clandestinité, une plus grande complexité dans la conduite des enquêtes serait à redouter pour l’avenir ».
La commission d’enquête soulignait que « des difficultés spécifiques se posent s’agissant des femmes ayant quitté la France pour une zone de djihad. En effet, celles-ci ne semblent pas avoir de rôle actif dans les combats mais plutôt être accompagnatrices d’un mari combattant ou future épouse d’un djihadiste rencontré sur les réseaux sociaux. Elles semblent le plus souvent cantonnées près de la frontière turco-syrienne où elles vivent en communauté avec leurs enfants et assurent un soutien d’ordre familial. Cette situation explique le nombre peu élevé de dossiers judiciaires concernant des femmes : les 14 femmes actuellement mises en examen l’ont été en raison de preuves concernant une aide logistique ou financière à une filière de combattants djihadistes » (56).
Un constat similaire était dressé par la commission d’enquête du Sénat sur l’organisation et les moyens de la lutte contre les réseaux djihadistes en France et en Europe. L’association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste permettrait « sans difficulté particulière d’appréhender les agissements des combattants revenus sur le territoire national après un séjour sur zone, ceux des recruteurs nationaux qui propagent la propagande djihadiste ou des facilitateurs qui procurent l’aide matérielle et logistique aux départs au sein de filières d’acheminement structurées ». Elle permettrait aussi « d’incriminer la simple appartenance à une organisation terroriste déterminée, telle l’État Islamique ou le Jahbat Al Nosra (Al-Qaïda), dès lors que l’affilié connaissait la visée du groupe et y a adhéré volontairement » (57). Néanmoins, la commission d’enquête relevait plusieurs limites dans le traitement judiciaire des individus de retour du djihad, en particulier :
–– la difficulté de rapporter la preuve de l’entente ou du groupement en dehors d’une adhésion à un groupe terroriste identifié ;
–– le cas des personnes qui rejoignent des groupes rebelles qui ne revêtent pas un caractère terroriste, tels l’Armée syrienne libre, ou la Coalition nationale des forces de l’opposition et de la révolution, reconnue comme le gouvernement légitime de la Syrie par le Gouvernement français le 13 novembre 2012 ;
–– l’habillement de ces séjours d’un but humanitaire ou religieux.
En conséquence, le nouveau délit de séjour intentionnel à l’étranger sur un théâtre de groupements terroristes permettrait de compléter la réponse pénale susceptible d’être apportée aux personnes revenant de la zone irako-syrienne et dont le comportement ne relève pas en totalité de l’incrimination d’association de malfaiteurs.
Il ne serait pas nécessaire de prouver une quelconque intention criminelle, ni de rapporter la preuve d’une fréquentation de l’entente ou du groupement, ou d’une participation à ses agissements. Seul serait incriminé, au nouvel article 421-2-7 du code pénal (1°), le séjour intentionnel « à l’étranger sur un théâtre d’opérations de groupements terroristes afin d’entrer en relation avec un ou plusieurs de ces groupements, en l’absence de motif légitime ». Cette dernière précision vise à exclure du champ de la répression les personnes qui se rendraient sur ces théâtres d’opérations dans un but valable, par exemple à des fins universitaires ou journalistiques.
Le 2° précise, à l’article 421-5 du même code, que cette nouvelle infraction serait punie de cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende, peines identiques à celles prévues en matière de provocation à commettre des actes terroristes ou d’apologie de tels actes. Sur le plan procédural, la peine d’une durée de cinq ans d’emprisonnement permet la prolongation de l’enquête de flagrance pour une durée de huit jours (58), la réalisation de perquisitions sans l’assentiment de la personne concernée (59) et le placement de la personne mise en examen en détention provisoire (60). Serait punie des mêmes peines la tentative de ce délit.
*
* *
La Commission examine l’amendement CL22 de M. Sébastien Pietrasanta.
M. Sébastien Pietrasanta. Cette disposition, déjà proposée à plusieurs reprises, a toujours été rejetée par le Parlement. Le procureur de la République de Paris a été très clair lors de son audition : le délit d’association de malfaiteurs à caractère terroriste (AMT) permet l’incrimination de tous ceux qui reviennent de Syrie ou d’Irak.
L’Espagne, qui a adopté une mesure similaire en 2014, rencontre de nombreuses difficultés pour l’appliquer, en raison des recours de la défense.
En outre, abandonner l’AMT ne permettrait pas l’utilisation de techniques spéciales de renseignement, comme l’a rappelé le procureur de la République de Paris.
Il s’agit donc là d’une fausse bonne idée.
M. le rapporteur. Ce dispositif a été débattu au Sénat. Nous conservons la conviction qu’il est pertinent et qu’il offrirait un outil supplémentaire. Pour autant, nous avons pris note des remarques du procureur de la République, et c’est pour cela que j’ai déposé un amendement, CL34, qui aligne les peines encourues pour ce nouveau délit sur celles prévues pour l’infraction d’association de malfaiteurs en vue de commettre un acte de terrorisme. Il faut en effet éviter qu’une incrimination ne chasse l’autre.
Mais ce délit permettrait d’incriminer des gens pour le seul fait d’être sur place, sauf motivations professionnelles particulières. En 2012, beaucoup de gens prétendaient partir pour des raisons humanitaires – il y a chez eux beaucoup de dissimulation. Avec ce dispositif, une action pénale pourrait être déclenchée contre ces personnes.
La Commission adopte l’amendement.
En conséquence, l’article 7 est supprimé.
Les amendements CL33 du rapporteur, CL2 de M. Georges Fenech et CL34 du rapporteur n’ont plus d’objet.
M. Georges Fenech. Je voudrais faire part ici de ma frustration : mon amendement CL2 est tombé sans être débattu, alors qu’il résulte d’un travail très important mené avec des magistrats et des avocats. Il est cosigné par plus de soixante-dix députés, y compris par une candidate à l’élection présidentielle.
Il visait à incriminer toute intention de se rendre sur une zone de combat djihadiste, afin d’intervenir le plus en amont possible et d’éviter ainsi que le projet terroriste ne se réalise.
Certains des individus qui adhèrent à l’idéologie criminelle de Daech, lorsqu’ils ne peuvent se rendre en Syrie, essayent de commettre des attentats sur le territoire national. Ainsi, Sid Ahmed Ghlam voulait s’attaquer à une église de Villejuif parce qu’il n’avait pu se rendre en Syrie ; Adel Kermiche, de la même façon, ne pouvant sortir de France, a décidé de passer à l’acte sur le territoire national.
Ce texte présente toutes les garanties nécessaires à un État de droit, et je regrette qu’il soit passé à la trappe sans même avoir été évoqué.
M. le président Dominique Raimbourg. Vous aurez la possibilité de présenter à nouveau votre amendement en séance. Je comprends fort bien votre frustration, que nous connaissons tous quand nos amendements sont balayés par des arguments qui ne nous semblent pas convaincants. Je vous exprime donc toute ma compassion, mais nous ne faisons que suivre le règlement de l’Assemblée.
La Commission se saisit de l’amendement CL35 du rapporteur.
M. le rapporteur. Il s’agit là encore de traiter d’un sujet dont nous avons souvent débattu – j’avais notamment défendu un amendement sur ce thème qui avait été rejeté d’une seule voix dans l’hémicycle, et qui avait reçu des soutiens sur tous les bancs. L’amendement vise à sanctionner les opérateurs de téléphonie mobile ou d’internet qui refusent de coopérer à une enquête judiciaire, notamment pour déchiffrer des données cryptées – le cryptage empêche en effet aujourd’hui l’avancée de nombreuses enquêtes.
L’amendement aggrave donc les amendes encourues par la personne morale qui refuse de communiquer à l’autorité judiciaire des données protégées par un moyen de cryptologie qu’elle a construit ou fourni, ainsi que par la personne morale qui s’abstient de répondre dans les meilleurs délais à une réquisition du procureur de la République ou du juge d’instruction aux fins de remise de tout document intéressant l’enquête ou l’information judiciaire. Il permet également d’interdire la commercialisation de produits ou de services de l’entreprise qui refuse de coopérer avec la justice : cette peine serait extrêmement dissuasive.
Nous signifierions ainsi à ces opérateurs qu’ils ne sont pas, contrairement à ce que leur puissance financière leur fait parfois croire, supérieurs à nos lois.
La Commission rejette l’amendement.
La Commission se saisit de l’amendement CL36 du rapporteur.
M. le rapporteur. J’avoue ne pas comprendre pourquoi la majorité s’oppose au renforcement des sanctions contre les entreprises qui refusent de coopérer avec la justice.
M. Pascal Popelin. Nous avons déjà eu ce débat, arrêtez donc ces effets de tribune !
M. le rapporteur. Nous avons déjà eu le débat, mais il n’est pas clos. Votre refus est-il simplement dû au fait que cette mesure est proposée par l’opposition ? Vous semblez considérer comme normal que des multinationales refusent de coopérer avec la justice. Dont acte.
M. Pascal Popelin. Ne caricaturez pas !
M. le rapporteur. L’amendement CL36 renforce les sanctions encourues lorsque l’entreprise ne retire pas avec la célérité nécessaire un contenu faisant l’apologie du terrorisme sur internet. C’est un problème majeur ! L’idéologie terroriste se propage sur les réseaux, et les opérateurs doivent être plus responsables. Pour cela, il faut accroître les sanctions qu’ils encourent.
La Commission rejette l’amendement.
Chapitre IV
Dispositions relatives aux droits et obligations des personnes détenues
La Commission examine l’amendement CL14 de M. Guillaume Larrivé.
M. Guillaume Larrivé. Il s’agit de supprimer les réductions automatiques de peine, pour tous les détenus.
Contre l’avis favorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement.
Article 8
(art. 721-1-1 du code de procédure pénale)
Suppression des crédits de réduction de peine supplémentaire
pour les personnes condamnées pour terrorisme
L’article 8 exclut les personnes condamnées pour terrorisme du bénéfice des crédits de réduction supplémentaire de peine prévus à l’article 721-1-1 du code de procédure pénale au bénéfice des condamnés manifestant des gages de réinsertion sociale.
1. Les réductions de peine « automatiques » et supplémentaires
a. Les crédits « automatiques » de réduction de peine
En vertu de l’article 721 du même code, tout condamné bénéficie, en principe, de crédits « automatiques » de réduction de peine calculés sur la durée de la condamnation prononcée, à raison de 3 mois pour la première année, 2 mois pour les années suivantes et 7 jours par mois pour une peine de moins d’un an ou pour la partie de peine inférieure à une année pleine. Pour les peines supérieures à un an, le total de la réduction correspondant aux 7 jours par mois ne peut toutefois excéder 2 mois.
Ces crédits peuvent être retirés, à hauteur de 3 mois maximum par an et de 7 jours par mois :
–– en cas de mauvaise conduite du condamné en détention ;
–– « lorsque la personne a été condamnée pour les crimes ou délits, commis sur un mineur, de meurtre ou assassinat, torture ou actes de barbarie, viol, agression sexuelle ou atteinte sexuelle et qu’elle refuse pendant son incarcération de suivre le traitement qui lui est proposé » ;
–– lorsque le condamné ne suit pas de façon régulière le traitement qui lui a été proposé ;
–– après avis médical, lorsque la personne condamnée, alors qu’elle était atteinte, au moment des faits, d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes, refuse les soins adaptés à son état ;
–– « [e]n cas de nouvelle condamnation à une peine privative de liberté pour un crime ou un délit commis par le condamné après sa libération pendant une période égale à la durée de la réduction [de peine] ».
b. Les réductions supplémentaires de peine
En plus de ces crédits « automatiques », l’article 721-1 du même code permet d’octroyer une réduction supplémentaire de la peine « aux condamnés qui manifestent des efforts sérieux de réadaptation sociale ».
Cette réduction supplémentaire ne peut excéder 3 mois par année d’incarcération ou 7 jours par mois lorsque la durée d’incarcération restant à subir est inférieure à une année. Lorsque la personne a été condamnée pour les crimes ou délits, commis sur un mineur, de meurtre ou d’assassinat, de torture ou d’actes de barbarie, de viol, d’agression sexuelle ou d’atteinte sexuelle, la réduction ne peut excéder 2 mois par an ou 4 jours par mois, dès lors qu’elle refuse les soins qui lui ont été proposés.
Sauf décision contraire du juge de l’application des peines (JAP), aucune réduction supplémentaire de la peine ne peut être accordée à une personne condamnée pour un crime ou un délit pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru et qui refuse pendant son incarcération de suivre le traitement qui lui est proposé ou ne le suit pas de façon régulière et, après avis médical, lorsque la personne condamnée, alors qu’elle était atteinte, au moment des faits, d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes, refuse les soins adaptés à son état.
Sauf décision du JAP, prise après avis de la commission de l’application des peines, aucune réduction supplémentaire de la peine ne peut être accordée aux personnes condamnées pour une infraction de nature sexuelle si, lorsque leur condamnation est devenue définitive, le casier judiciaire faisait mention d’une telle condamnation.
2. L’exclusion des personnes condamnées pour terrorisme du bénéfice de ces réductions
a. La suppression des crédits « automatiques » de réduction de peine par la loi prorogeant l’état d’urgence du 3 juin 2016
Depuis juillet 2016 (61), les personnes condamnées pour terrorisme sont exclues du bénéfice des dispositions de l’article 721 précité relatives aux crédits « automatiques » de réduction de peine. En adoptant cette règle, le législateur a suivi les recommandations de la commission d’enquête de l’Assemblée nationale relative aux moyens mis en œuvre par l’État pour lutter contre le terrorisme depuis le 7 janvier 2015 (62).
Cette règle a été inscrite à l’article 721-1-1 du même code. Par exception, continuent de bénéficier de ces dispositions ceux qui se rendent coupables des délits de provocation au terrorisme ou d’apologie du terrorisme, d’entrave au blocage de sites provoquant au terrorisme ou en faisant l’apologie et de consultation habituelle de tels sites.
b. La modification proposée par l’article 8
Toutefois, les personnes condamnées pour terrorisme demeurent susceptibles de bénéficier des réductions de peine supplémentaires prévues à l’article 721-1, ainsi que le prévoit la seconde phrase de l’article 721-1-1 précité.
Le présent article, qui supprime cette seconde phrase, vise à exclure également les condamnés terroristes de ces réductions de peine, conditionnées à la manifestation d’efforts sérieux de réadaptation sociale. Continueraient de pouvoir bénéficier, sous certaines conditions, de ces réductions de peine supplémentaires les personnes condamnées pour provocation au terrorisme ou apologie du terrorisme, entrave au blocage de sites provoquant au terrorisme ou en faisant l’apologie et consultation habituelle de tels sites.
La suppression du bénéfice de ces dispositions se justifie par la nature particulière des infractions terroristes, la gravité des atteintes qu’elles ont portées à l’ordre public et au corps social. Les personnes qui s’en rendent coupables doivent purger l’intégralité de leur peine d’incarcération.
Cela est d’autant plus nécessaire que, comme l’avait indiqué Mme Camille Hennetier, vice-procureure de la République au pôle antiterroriste du TGI de Paris devant la commission des Lois du Sénat dans le cadre des travaux préparatoires à l’adoption de la loi du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, certains de ces individus « pratiquent la taqîya, la théorie de la dissimulation, et savent se présenter sous un jour très favorable au JAP ou aux travailleurs sociaux » (63), ce qui leur permettrait de manifester des efforts sérieux de réadaptation sociale.
*
* *
Contre l’avis défavorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement CL23 de M. Sébastien Pietrasanta.
En conséquence, l’article 8 est supprimé.
Les amendements CL37 du rapporteur, CL12 et CL13 de M. Guillaume Larrivé n’ont plus d’objet.
La Commission examine l’amendement CL11 de M. Guillaume Larrivé.
M. Guillaume Larrivé. Cet amendement répond à une demande fortement exprimée par les personnels de l’administration pénitentiaire, à tous les niveaux hiérarchiques. Il est nécessaire que, sur décision du chef d’établissement, les personnels puissent procéder à des palpations de sécurité avant l’accès au parloir. Il ne s’agit naturellement pas d’une fouille au corps, mais de vérifications tout à fait similaires aux contrôles que nous connaissons à l’entrée d’un stade de football. Il est anormal que ces palpations n’existent pas à l’entrée d’un établissement pénitentiaire : elles pourraient éviter l’introduction de téléphones portables, mais aussi de drogue.
Contre l’avis favorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement.
Article 9
(art. 57 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire)
Assouplissement des modalités de fouilles
des détenus terroristes ou prosélytes
L’article 9 tend à faciliter les fouilles des personnes détenues pour terrorisme ou prosélytes en détention par l’assouplissement du régime juridique des fouilles tel qu’il est prévu par l’article 57 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire.
1. Le régime des fouilles en prison
Avant 2009, le régime des fouilles était défini par des dispositions réglementaires. Celles-ci étaient obligatoires lors des entrées et sorties et à l’occasion de tout contact avec l’extérieur ; les détenus pouvaient également être fouillés sur décision du chef d’établissement, sans exigence de motivation.
Ce régime était fortement critiqué. Il était jugé à la fois insuffisant, dans la mesure où il mettait en cause une liberté fondamentale, le droit à l’intimité, et imprécis, en laissant une marge discrétionnaire trop importante à l’administration pénitentiaire.
Outre les disparités importantes constatées dans les pratiques suivies par les établissements, les fouilles étaient parfois considérées comme vexatoires, en raison de leur caractère répétitif, voire systématique, et humiliantes lorsqu’elles impliquaient des investigations corporelles internes.
À plusieurs reprises, la France avait été condamnée par la Cour européenne des droits de l’homme en raison des insuffisances de sa réglementation et des pratiques des fouilles corporelles. C’est la raison pour laquelle le législateur a défini, à l’article 57 de la loi pénitentiaire de 2009, un régime juridique d’encadrement des fouilles :
–– « justifiées par la présomption d’une infraction ou par les risques que le comportement des personnes détenues fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l’établissement », les fouilles doivent être, par leur nature et leur fréquence, « strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues » ;
–– les fouilles intégrales ne sont possibles qu’à titre subsidiaire, « si les fouilles par palpation ou l’utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes » ;
–– les investigations corporelles internes sont proscrites ; seul un impératif spécialement motivé peut les justifier mais elles ne peuvent alors être réalisées que par un médecin n’exerçant pas au sein de l’établissement pénitentiaire et requis à cet effet par l’autorité judiciaire.
2. Les fouilles indépendantes de la personnalité des détenus justifiées par l’introduction d’objets interdits ou constituant une menace pour la sécurité
a. Le droit issu de la loi du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé et le terrorisme
Face à la prolifération du nombre d’objets et de substances interdits en détention, susceptibles de porter atteinte au maintien du bon ordre dans l’établissement et à la sécurité publique de manière générale, les moyens juridiques à la disposition de l’administration pénitentiaire pour procéder à des fouilles plus générales ont été récemment renforcés par la loi (64).
Le législateur a autorisé le chef d’établissement à ordonner des fouilles sans qu’il soit nécessaire d’individualiser cette décision au regard de la personnalité du détenu, mais dans des lieux et pour une période de temps déterminés, dès lors qu’il existe « des raisons sérieuses de soupçonner l’introduction au sein de l’établissement pénitentiaire d’objets ou de substances interdits ou constituant une menace pour la sécurité des personnes ou des biens ». Ces fouilles doivent demeurer strictement nécessaires et proportionnées, conformément à la jurisprudence européenne telle que le Conseil d’État l’applique depuis qu’il s’est reconnu compétent, en 2008, pour connaître des décisions de fouilles (65).
b. La modification proposée par l’article 9
Le deuxième alinéa de l’article 57 précise que ces fouilles doivent être spécialement motivées et faire l’objet d’un rapport circonstancié transmis au procureur de la République territorialement compétent et à la direction de l’administration pénitentiaire.
Le présent article supprime cette exigence lorsque les fouilles concernent des personnes condamnées ou mises en examen pour terrorisme ou des personnes « exerçant des pressions graves ou réitérées sur autrui en faveur d’une religion, d’une idéologie ou d’une organisation violente ou terroriste ».
Ni l’obligation de motivation spéciale, ni celle de transmettre un rapport au procureur de la République ou à la direction de l’administration pénitentiaire ne paraissent nécessaires pour garantir le respect des conditions de nécessité, d’adaptation au motif poursuivi et de proportionnalité des moyens employés. En effet, l’exigence générale de justification et d’adaptation des fouilles aux nécessités qui les expliquent constitue une motivation suffisante ; la transmission d’un rapport relève simplement d’une obligation d’information a posteriori du procureur et de l’administration pénitentiaire sans conséquence sur la mise en œuvre de ces fouilles.
L’assouplissement des modalités de fouilles proposé par cet article demeure conforme à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme. Ainsi, dans l’affaire Frérot contre France, la Cour avait jugé que les fouilles devaient « être menées selon des "modalités adéquates", de manière à ce que le degré de souffrance ou d’humiliation subi par les détenus ne dépasse pas celui que comporte inévitablement cette forme de traitement légitime ». Elle reconnaissait cependant qu’elles pouvaient être justifiées par des considérations de sécurité car « des fouilles corporelles, même intégrales, peuvent parfois se révéler nécessaires pour assurer la sécurité dans une prison – y compris celle du détenu lui-même –, défendre l’ordre ou prévenir les infractions pénales » (66).
Un tel assouplissement permettrait de mieux prévenir et contrôler l’entrée et la circulation d’objets ou de substances interdits en détention, généralement propices à la préparation d’actes de délinquance, voire de terrorisme.
*
* *
Contre l’avis du rapporteur, la Commission adopte l’amendement CL 24 de M. Sébastien Pietrasanta.
En conséquence, l’article 9 est supprimé.
L’amendement CL15 de M. Sébastien Huyghe n’a plus d’objet.
Article 10
(art. 726-2 du code de procédure pénale)
Renforcement du régime de détention des détenus radicalisés ou prosélytes
L’article 10 a pour objet d’étendre et de durcir le régime de détention au sein des unités de prévention de la radicalisation (UPRA), en cours d’expérimentation par le Gouvernement et dont l’existence a été récemment inscrite dans la loi.
1. Le régime actuel des unités dédiées à la lutte contre la radicalisation en prison
a. Des unités initialement créées à titre expérimental…
Depuis deux ans, les pouvoirs publics tentent d’apporter une réponse au phénomène de radicalisation islamiste dans les prisons françaises. Cette réponse a évolué au fil du temps en fonction des expériences conduites dans plusieurs établissements, notamment franciliens.
En octobre 2014, une première expérience de regroupement de personnes détenues islamistes radicales a été lancée au centre pénitentiaire de Fresnes par le directeur de l’établissement. Elle était justifiée par l’augmentation du nombre des personnes incarcérées dans cet établissement pour des faits de terrorisme, la progression des pratiques de prosélytisme et les pressions croissantes exercées par certains détenus sur d’autres. Dans un premier temps, il s’était agi d’une simple modification des affectations de cellule.
L’échec de cette première initiative a conduit la direction à opérer un regroupement des personnes mises en cause ou condamnées pour des faits en lien avec une entreprise terroriste dans un espace dédié afin de garantir des conditions de détention plus sereines et réduire l’influence des détenus prosélytes. Ces personnes étaient soumises à un régime de détention sui generis, certaines étant affectées en cellule triple ou double, d’autres bénéficiant d’un encellulement individuel. Les promenades n’étaient possibles que de manière groupée alors que la participation à des activités socioculturelles était possible avec les autres détenus. Les personnes regroupées pouvaient communiquer entre elles et exercer leurs droits familiaux.
Le 21 janvier 2015, dans le cadre du premier plan de lutte contre le terrorisme, le Premier ministre a annoncé la création, à titre expérimental, de cinq quartiers dédiés au regroupement des personnes détenues radicalisées ou sensibles au prosélytisme religieux : une unité d’évaluation des détenus au centre pénitentiaire de Fresnes, une unité d’évaluation et une unité de prise en charge à la maison d’arrêt de Fleury-Merogis, et deux unités de prise en charge, l’une à la maison d’arrêt d’Osny et l’autre au centre pénitentiaire de Lille-Annœullin.
D’après un rapport d’enquête de la Contrôleure générale des lieux de privation de liberté de juin 2016 (67), l’état des expérimentations en cours ou à venir serait le suivant :
–– dans les maisons d’arrêt d’Osny et de Fleury-Mérogis, avec la participation de l’Association française des victimes de terrorisme et de Dialogues citoyens ;
–– au centre pénitentiaire de Fresnes et dans la maison d’arrêt de Villepinte, aux fins de réhabilitation psychologique, sociale et religieuse des détenus condamnés pour terrorisme ;
–– au centre pénitentiaire de Lille-Annœullin, pour les détenus les plus ancrés dans l’islamisme ;
–– au centre pénitentiaire sud-francilien de Réau, en vue d’un programme de prévention de la radicalisation à destination des détenus de moyennes et longues peines ;
–– au sein de la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis et de l’établissement pour mineurs de Lavaur, afin de repérer et de prévenir la radicalisation des mineurs incarcérés.
Dans le cadre du plan d’action contre la radicalisation et le terrorisme, deuxième volet du plan de lutte contre le terrorisme, le Premier ministre a annoncé, le 9 mai 2016, de nouvelles mesures, en particulier le développement des programmes de prise en charge des personnes détenues après leur passage en unité dédiée et la création d’une grille d’indicateurs de sortie de la radicalisation.
b. … inscrites dans la loi en 2016
Aujourd’hui, les quatre principales unités dédiées comptent 117 places au total : 2 unités de 20 places à Fleury-Mérogis, 26 places à Fresnes, 28 places à Lille-Annœullin et 23 places à Osny. L’encellulement individuel est la règle. L’affectation se fait en fonction du degré d’ancrage de la personne dans le processus de radicalisation, les personnes les plus accessibles à une remise en question étant affectées à Osny ou Fleury-Mérogis, les plus radicalisées à Lille-Annœullin.
Alors que les expérimentations se poursuivent dans les quatre établissements précités, l’existence de ces unités a été inscrite à l’article 726-2 du code de procédure pénale par la loi de 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé. Cet article dispose que, « [l]orsqu’il apparaît que leur comportement porte atteinte au maintien du bon ordre de l’établissement, les personnes détenues exécutant une peine privative de liberté peuvent, sur décision du chef d’établissement, faire l’objet d’une évaluation ou bénéficier d’un programme spécifique de prise en charge au sein d’une unité dédiée ». La décision d’affectation au sein de l’unité n’est donc pas liée expressément à la radicalisation ou au prosélytisme du détenu et seules les personnes déjà condamnées – et non celles prévenues – peuvent être concernées par cette mesure.
La décision est susceptible de recours devant le juge administratif. Les activités proposées en prison à ces personnes peuvent être suivies à l’écart des autres détenus, « sur décision prise par le chef d’établissement après avis de la commission pluridisciplinaire unique ».
La commission pluridisciplinaire unique
Instituée auprès du chef de chaque établissement pénitentiaire pour une durée de cinq ans, la commission pluridisciplinaire unique (CPU) est une commission consultative d’échange institutionnel et de partage d’informations qui regroupe l’ensemble des intervenants de l’établissement. La commission est composée :
– du directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation ;
– d’un responsable du secteur de détention du détenu ;
– d’un représentant du service du travail ;
– d’un représentant du service de la formation professionnelle ;
– d’un représentant du service d’enseignement ;
– du psychologue chargé du parcours d’exécution de la peine (voix consultative) ;
– d’un membre du service de la protection judiciaire de la jeunesse (voix consultative) ;
– d’un représentant des équipes soignantes de l’unité de consultations et de soins ambulatoires ou du service médico-psychologique régional (voix consultative).
Cette commission a principalement vocation à aider le chef d’établissement dans sa mission d’organisation du parcours d’exécution de la peine de toute personne détenue condamnée.
Afin de mieux encadrer le fonctionnement de ces unités, la direction de l’administration a récemment élaboré un document-cadre précisant la doctrine d’emploi de ces structures.
2. Les modifications proposées par l’article 10
Le présent article étend le champ d’application de ces unités et en précise le fonctionnement afin de permettre une véritable détention à l’écart des autres détenus des personnes affectées dans ces unités.
Outre celles dont le comportement porte atteinte au maintien du bon ordre de l’établissement, seraient également susceptibles d’être affectées dans une unité dédiée les personnes qui « exercent des pressions graves ou réitérées sur autrui en faveur d’une religion, d’une idéologie ou d’une organisation violente ou terroriste », c’est-à-dire les personnes se distinguant par un prosélytisme religieux ou idéologique de nature à affecter la détention d’autres détenus (premier alinéa).
Toujours au premier alinéa, il est précisé que, dans ces unités, la règle serait l’encellulement individuel des détenus, conformément à la pratique aujourd’hui observée à Fleury-Mérogis, Fresnes, Lille-Annœullin et Osny. C’est ce que prévoit aussi le document-cadre établi par la direction de l’administration pénitentiaire pour laquelle l’affectation en unité dédiée implique automatiquement un encellulement individuel de manière à respecter le principe de séparation des prévenus et des condamnés et à permettre l’introspection et la liberté individuelle face à la pression du groupe.
Le présent article a également pour conséquence de supprimer la possibilité de proposer à ces détenus « un programme spécifique de prise en charge ». Les programmes de prise en charge aujourd’hui proposés dans les unités dédiées ne sont pas clairement définis quant à leur contenu et à leurs finalités, ce qui laisse une trop large autonomie aux équipes dans la définition des ateliers proposés. Cela génère de grandes disparités dans l’offre de prise en charge des détenus et conduit à de nombreuses improvisations, comme a pu le constater la Contrôleure générale des lieux de privation de liberté dans son rapport sur l’ouverture des unités dédiées en 2016 (68). C’est aussi le constat formulé par votre rapporteur lors de sa visite de la maison d’arrêt d’Osny, où plusieurs personnes ont également évoqué le statut de « VIP » que conférait aux détenus djihadistes ou radicalisés ce type de programme individualisé aux yeux des autres détenus.
Enfin, sans remettre en cause les activités proposées en détention, le deuxième alinéa pose comme règle qu’elles devraient s’exercer à l’écart de tout autre détenu, sauf décision contraire prise par le chef d’établissement après avis de la commission pluridisciplinaire unique. L’exercice des activités mentionnées à l’article 22 de la loi pénitentiaire à l’écart des autres détenus est, dans le droit actuel, une simple faculté laissée à l’appréciation du directeur de l’établissement après avis de la même commission. Il importe de renverser ce principe compte tenu des spécificités du régime de détention en unité dédiée et de son objet, la mise à l’écart des détenus prosélytes.
*
* *
Contre l’avis du rapporteur, la Commission adopte l’amendement CL 25 de M. Sébastien Pietrasanta.
En conséquence, l’article 10 est supprimé.
Article 11
(art. 39 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire)
Interdiction en prison des équipements permettant
de passer des communications électroniques
L’article 11 vise à renforcer l’« isolement électronique » des détenus, dans un contexte de prolifération en prison des terminaux permettant de procéder à des communications électroniques entre détenus et entre détenus et leur entourage extérieur.
1. Les modalités de communication en détention
L’article 39 de la loi pénitentiaire n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 reconnaît à toutes les personnes détenues, qu’elles soient prévenues ou condamnées, « le droit de téléphoner aux membres de leur famille » et la possibilité d’être autorisées à téléphoner à d’autres personnes pour préparer leur réinsertion. Toutefois, pour pouvoir téléphoner, les prévenus doivent obtenir l’autorisation de l’autorité judiciaire (premier alinéa).
Ce droit n’interdit pas le refus, la suspension ou le retrait de l’accès au téléphone « pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions et, en ce qui concerne les prévenus, aux nécessités de l’information » (deuxième alinéa).
En toute hypothèse, l’exercice de ce droit se fait par l’intermédiaire de terminaux de téléphonie filaire fixe, autrement dits des « points-phone ». Sont en conséquence interdites toutes les autres communications électroniques, notamment les communications sans fil transitant par les technologies « GSM », « GPRS », « Bluetooth », « Wifi » « Wimax », ce qui couvre le cas des terminaux de téléphonie mobile ou offrant un accès à internet (smartphone). Cette interdiction est posée par voie réglementaire, notamment la circulaire du 9 avril 2009 relative à l’accès à l’informatique pour les personnes placées sous main de justice et par les règlements intérieurs des établissements pénitentiaires.
2. L’explosion du nombre de téléphones portables saisis en détention
Dans l’intention du législateur, le renforcement, en 2009, du droit d’accès au téléphone en détention devait contribuer à « réduire la tentation pour certaines personnes détenues de se procurer un téléphone portable et à diminuer les trafics et pressions liés à la possession de ces téléphones » (69).
Tel n’a pas été le cas, comme l’atteste le nombre de téléphones portables saisis en prison ces dernières années.
De manière générale, le nombre d’objets saisis dont la détention est interdite dans les établissements pénitentiaires est en constante augmentation depuis 2007, année de mise en place du système de recensement statistique des saisies. C’est particulièrement le cas des téléphones et de leurs accessoires, dont le nombre de saisies a augmenté de manière exponentielle. En 2014, les téléphones et accessoires représentaient près de 50 % de l’ensemble des objets interdits et saisis, contre 35% en 2007. Entre 2007 et 2014, le nombre de téléphones et accessoires saisis aurait été multiplié par 5,5, soit une augmentation de 450 %. En 2015, plus de 31 000 téléphones et accessoires ont été saisis en détention.
ÉVOLUTION DU NOMBRE D’OBJETS INTERDITS SAISIS EN DÉTENTION (2007-2014)
Années |
Téléphones et accessoires |
Stupéfiants |
Armes |
Explosifs |
Argent |
Alcool |
Autres |
Projections extérieures |
Total |
2007 |
4977 |
5177 |
413 |
2 |
365 |
483 |
2435 |
13 852 | |
2008 |
6661 |
6069 |
305 |
4 |
486 |
621 |
3165 |
17 311 | |
2009 |
7341 |
5757 |
364 |
0 |
550 |
488 |
3885 |
18 385 | |
2010 |
10 990 |
6661 |
512 |
0 |
706 |
523 |
4776 |
24 168 | |
2011 |
16 487 |
7795 |
705 |
0 |
872 |
850 |
5759 |
32 468 | |
2012 |
20 532 |
8755 |
705 |
0 |
1234 |
930 |
7296 |
40 693 | |
2013 |
23 495 |
8998 |
766 |
2 |
1293 |
760 |
7809 |
6157 |
49 280 |
2014 |
27 524 |
9895 |
1017 |
1 |
1479 |
847 |
8545 |
6841 |
56 149 |
Source : Ministère de la justice
3. La consécration législative de l’« isolement électronique » des détenus
Pour votre rapporteur, qui n’avait pas voté la loi pénitentiaire de 2009, cet état de fait est profondément préoccupant. Il est susceptible de porter atteinte au maintien du bon ordre dans l’établissement et de faciliter la préparation de projets d’évasion ou d’actes de délinquance, voire de criminalité, grâce au maintien de la continuité de certains réseaux de délinquance s’organisant depuis la prison.
Ce n’est que tardivement que les pouvoirs publics ont pris la mesure du problème, en élargissant les possibilités de contrôle administratif de l’ensemble des communications électroniques en détention depuis 2015.
Outre la surveillance réalisée par les services de renseignement, dans les conditions prévues par le code de la sécurité intérieure, un contrôle des communications est également possible en vertu du pouvoir de police administrative reconnu à l’administration pénitentiaire par l’article 727-1 du code de procédure pénale, récemment élargi par la loi du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé. Ce contrôle des communications peut s’opérer « [s]ous le contrôle du procureur de la République territorialement compétent et aux fins de prévenir les évasions et d’assurer la sécurité et le bon ordre des établissements ». Effectué par des agents individuellement désignés et habilités appartenant à l’administration pénitentiaire, il peut avoir pour objet :
–– le recueil des données techniques de connexion, via la plate-forme nationale des interceptions judiciaires (PNIJ) (1°) ou par IMSI catcher (70) (2°) ;
–– les interceptions de correspondances, via la PNIJ (3°) ou par IMSI catcher (4°) ;
–– l’accès aux données informatiques dans les différents formats sous lesquels elles peuvent exister (5° à 7°) ;
–– la détection des connexions non autorisées (8°).
En outre, l’administration pénitentiaire poursuit le perfectionnement des systèmes de brouillage des téléphones portables afin de les moderniser – les plus anciens ne brouillent que la 2G alors que les derniers portables émettent en 3G ou 4G – et de mieux les adapter aux spécificités de l’architecture pénitentiaire (troubles sur le voisinage immédiat, interactions avec les autres systèmes de sécurité).
Malgré tout, le nombre de téléphones circulant en détention n’a jamais été aussi élevé. Cette situation est d’autant plus préoccupante que certains, constatant les difficultés à faire respecter l’interdiction, sont tentés de proposer la légalisation sous contrôle de l’usage des téléphones portables en détention (71), au motif qu’« on ne pourra pas continuer à les interdire indéfiniment » (72).
Votre rapporteur estime, pour sa part, qu’une telle évolution n’est ni nécessaire, ni souhaitable. L’accès à un point de téléphonie fixe demeure suffisant à garantir le respect du droit à la vie privée des détenus et au maintien des relations avec leur famille. Par ailleurs, le régime d’incarcération doit demeurer fondé sur l’isolement, sauf à priver de son sens la peine de prison.
Dans ces conditions, le caractère réglementaire de l’interdiction des téléphones portables en prison paraît insuffisant. D’une part, il s’articule difficilement avec la reconnaissance au niveau législatif du droit d’accès au téléphone, sans précision sur la nature du terminal susceptible d’être utilisé. D’autre part, cette interdiction pourrait, à tout moment, être levée par le pouvoir exécutif sans que le législateur soit invité à se prononcer, ce qui n’est pas acceptable.
C’est pourquoi le présent article inscrit dans la loi pénitentiaire, au deuxième alinéa de son article 39, la règle selon laquelle « [l]es détenus ne sont autorisés à disposer ni d’équipements terminaux radioélectriques d’accès à un service de téléphonie, ni d’équipements terminaux d’accès à un service de communications électroniques ». Seraient couverts par l’interdiction tous les types d’équipements mobiles permettant des communications électroniques, qu’il s’agisse d’un téléphone portable « de base » ou d’un smartphone.
*
* *
La Commission examine l’amendement CL26 de M. Sébastien Pietrasanta.
M. Sébastien Pietrasanta. Défendu.
M. Philippe Goujon. M. Pietrasanta indique, dans l’exposé sommaire de son amendement, que l’utilité pratique des mesures prévues à l’article 11 n’est pas évidente. Il me semble que cet argument est un peu faible pour s’opposer à un article aussi important, ayant pour objet de pérenniser l’interdiction des téléphones portables et des équipements électroniques dans les prisons. Je vous invite donc, mes chers collègues, à ne pas voter cet amendement de suppression.
M. le rapporteur. Avis très défavorable. Comme vient de le dire Philippe Goujon, il est aujourd’hui indispensable de renforcer les mesures d’isolement électronique des détenus, et je ne comprends pas que certains souhaitent s’y opposer.
M. Pascal Popelin. L’isolement électronique est déjà prévu par la loi, il ne reste à faire que le plus difficile, en appliquant ce dispositif !
La Commission adopte l’amendement.
En conséquence, l’article 11 est supprimé.
Chapitre V
Dispositions relatives à la légitime défense des policiers
Article 12
(art. L. 315–3 du code de la sécurité intérieure)
Doctrine d’emploi de l’usage de la force armée par les fonctionnaires de la police nationale
Le rapprochement des deux forces de sécurité intérieure – dans le respect de leur identité – a été engagé par le législateur avec la loi n° 2009-971 du 3 août 2009 relative à la gendarmerie nationale. Le présent article consacre, dans le même esprit, un rapprochement des conditions d’emploi des armes à feu par les deux forces.
1. Un cadre légal de l’emploi de l’usage de la force armée qui diffère entre la police et la gendarmerie
Pour la police nationale, la seule autorisation donnée par la loi de faire usage des armes résulte de la situation de légitime défense, prévue par les articles 122-5 à 122-7 du code pénal.
L’article 122-5 de ce code prévoit ainsi l’irresponsabilité pénale de « la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d’elle-même ou d’autrui, sauf s’il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l’atteinte ».
Ce même article prévoit l’irresponsabilité pénale de la personne qui, « pour interrompre l’exécution d’un crime ou d’un délit contre un bien, accomplit un acte de défense, autre qu’un homicide volontaire, lorsque cet acte est strictement nécessaire au but poursuivi dès lors que les moyens employés sont proportionnés à la gravité de l’infraction ».
De même, l’article 122-7 du même code prévoit l’irresponsabilité pénale de la personne qui, « face à un danger actuel ou imminent qui menace elle-même, autrui ou un bien, accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du bien, sauf s’il y a disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace ».
Outre le droit commun de la légitime défense, les militaires de la gendarmerie peuvent déployer la force armée en application des dispositions particulières prévues par le code de la défense. Il convient de souligner que ces dispositions sont certes anciennes puisqu’elles figuraient à l’article 174 du décret du 20 mai 1903 portant règlement sur l’organisation et le service de la gendarmerie, mais qu’elles ont été codifiées par l’ordonnance n° 2004-1374 du 20 décembre 2004 relative à la partie législative du code de la défense, que le Parlement a ratifiée par la loi n° 2005-1550 du 12 décembre 2005 modifiant diverses dispositions relatives à la défense.
Ainsi, l’article L. 2338-3 du code de la défense permet aux officiers et sous-officiers de gendarmerie de « déployer la force armée » en l’absence de l’autorité judiciaire – qu’il s’agisse d’un magistrat du parquet ou du siège – ou administrative – c’est-à-dire le préfet de département ou, éventuellement, un sous-préfet – dans quatre cas clairement délimités :
— lorsque des violences ou des voies de fait « sont exercées contre eux ou lorsqu’ils sont menacés par des individus armés ». Ce premier cas de figure peut s’apparenter aux cas prévus par le code pénal en matière de légitime défense ;
— lorsqu’ils ne peuvent « défendre autrement le terrain qu’ils occupent, les postes ou les personnes qui leur sont confiés ou, enfin, si la résistance est telle qu’elle ne puisse être vaincue que par la force des armes » ;
— lorsque les personnes invitées à s’arrêter par des appels répétés de « Halte gendarmerie » faits à haute voix cherchent à échapper à leur garde ou à leurs investigations et ne peuvent être contraintes de s’arrêter que par l’usage des armes ;
— lorsqu’ils ne peuvent immobiliser autrement les véhicules, embarcations ou autres moyens de transport dont les conducteurs n’obtempèrent pas à l’ordre d’arrêt.
L’article 56 du code des douanes prévoit également différents cas autorisant les douaniers à faire usage de la force, avec une rédaction proche de celle de l’article L. 2338-3 du code de la défense.
2. La doctrine d’emploi de l’usage de la forme armée n’a été modifiée par la loi du 3 juin 2016 que pour prendre en compte le cas spécifique du « périple meurtrier »
L’article 51 de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale a introduit un nouveau cas d’irresponsabilité pénale, à l’article 122–4–1 du code pénal, dans l’hypothèse de l’emploi de la force lors d’un périple meurtrier. Les terroristes radicalisés commettent en effet des actions débutant, la plupart du temps, par des assassinats de masse et des prises d’otages meurtrières s’achevant quasi–systématiquement par un retranchement afin de mener une confrontation armée volontaire avec les unités d’intervention.
Ce régime bénéficie au fonctionnaire de la police nationale ou militaire de la gendarmerie nationale qui fait un usage de son arme rendu absolument nécessaire pour empêcher l’auteur d’un ou plusieurs homicides volontaires ou tentatives d’homicides volontaires dont il existe des raisons réelles et objectives de penser qu’il est susceptible de réitérer d’autres crimes dans un temps rapproché.
3. La jurisprudence restrictive des cours européennes et nationales
La Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) interprète strictement la condition d’« absolue nécessité » en cas d’atteinte à la vie posée par l’article 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales.
L’utilisation de la force meurtrière a été examinée pour la première fois dans l’arrêt du 27 septembre 1995 Mc Cann et autres c. Royaume–Uni. La Cour a jugé que l’article 2 n’admet des exceptions au droit à la vie que si le recours à la force est « absolument nécessaire », ces termes indiquant qu’il fallait appliquer un critère de nécessité plus strict et impérieux que celui normalement employé pour déterminer si l’intervention de l’État est « nécessaire dans une société démocratique » au sens du paragraphe 2 des articles 8 à 11 de la Convention (73).
De manière générale, elle estime que s’il peut s’avérer justifié, dans certaines conditions, tout usage de la force meurtrière doit être strictement proportionné aux circonstances, qui font l’objet d’un examen particulièrement attentif, comme en témoigne l’abondante jurisprudence en la matière (74).
Elle a par ailleurs réitéré le devoir primordial pour l’État d’assurer le droit à la vie en mettant en place un cadre juridique et administratif approprié définissant les circonstances limitées dans lesquelles les représentants de l’application des lois peuvent recourir à la force et faire usage d’armes à feu, compte tenu des lignes directrices internationales en la matière. Conformément au principe de proportionnalité, le cadre juridique national régissant les opérations d’arrestation doit subordonner le recours aux armes à feu à une appréciation minutieuse de la situation et, surtout, à une évaluation de la nature de l’infraction commise par le fugitif et de la menace qu’il représente.
Les juridictions nationales exigent également que le recours aux armes à feu soit absolument nécessaire au regard des circonstances de l’espèce (75). Même dans le cadre légal de l’usage des armes, la juridiction vérifie que les critères d’existence d’un danger actuel, de l’absolue nécessité et de la proportionnalité de la riposte sont réunis.
En outre, il faut noter que la Cour de cassation refuse le bénéfice du régime de l’article L. 2338–3 du code de la défense aux gendarmes exerçant en tenue civile lorsqu’ils sont en service et utilisent leur arme de dotation (76).
4. Un rapprochement des règles d’usage des armes par les deux forces de sécurité intérieure parait nécessaire
Le présent article complète le chapitre relatif au « Port et transport des armes » du code de la sécurité intérieure, par un nouvel article L. 315–3 qui reprend largement les conditions d’emploi des armes définies à l’article L. 2338–3 du code de la défense.
Ainsi, les forces de police pourraient, en l’absence de l’autorité judiciaire ou administrative et en application de la jurisprudence européenne, si cela est absolument nécessaire (alinéa 4 du présent article), faire usage des armes :
–– lorsque des violences ou des voies de fait sont exercées contre eux ou lorsqu’ils sont menacés par des individus armés (1° du présent article) ;
–– lorsqu’ils ne peuvent défendre autrement le terrain qu’ils occupent, les postes et les personnes qui leur sont confiées ou, enfin, si la résistance est telle qu’elle ne puisse être vaincue que par la force des armes (2° du présent article) ;
–– lorsqu’ils ne peuvent immobiliser autrement les véhicules, embarcations ou autres moyens de transport dont les conducteurs n’obtempèrent pas à l’ordre d’arrêt (4° du présent article) ;
–– lorsque des personnes armées refusent de déposer leur arme après deux injonctions (3° du présent article). Cet alinéa restreint l’usage de la force armée à l’encontre de personnes elles–mêmes armées.
Les 1°, 2° et 4° reprennent à l’identique la formulation employée à l’article L. 2338–3 du code de la défense.
Cette mesure, réclamée avec force depuis plusieurs mois par l’opposition et en particulier par votre rapporteur (77), est très attendue sur le terrain. Elle s’inscrirait assez logiquement dans le prolongement d’une autre disposition de bon sens proposée par Les Républicains et à laquelle le Gouvernement a fini par se rallier par étapes : le port de leur arme de dotation hors du service par les fonctionnaires actifs des services de la police nationale. Le ministre de l’intérieur a, par un arrêté du 4 janvier 2016 (78), permis ce port d’armes hors du service pendant la période de l’état d’urgence, avant de l’autoriser de manière permanente en juillet 2016 (79).
*
* *
Contre l’avis du rapporteur, la Commission adopte l’amendement CL 27 de M. Sébastien Pietrasanta.
En conséquence, l’article 12 est supprimé.
L’ensemble des articles ayant été rejetés, la proposition de loi est rejetée.
*
* *
En conséquence, la commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République vous demande de rejeter la proposition de loi renforçant la lutte contre le terrorisme (n° 3997).
___
Dispositions en vigueur ___ |
Texte de la proposition de loi ___ |
Conclusions de la Commission ___ |
Proposition de loi renforçant la lutte contre le terrorisme |
Proposition de loi renforçant la lutte contre le terrorisme | |
Chapitre Ier |
Chapitre Ier | |
Dispositions relatives au suivi et au contrôle des individus radicalisés constituant une menace à la sûreté de l’État |
Dispositions relatives au suivi et au contrôle des individus radicalisés constituant une menace à la sûreté de l’État | |
|
Article 1er | |
|
Supprimé amendements CL3 et CL16 | |
|
||
|
Article 2 | |
|
Supprimé amendements CL4 et CL17 | |
|
||
|
||
Chapitre II |
Chapitre II | |
Dispositions applicables aux étrangers menaçant l’ordre public ou coupables de délits et crimes passibles de cinq ans de prison |
Dispositions applicables aux étrangers menaçant l’ordre public ou coupables de délits et crimes passibles de cinq ans de prison | |
Code pénal |
|
Article 3 |
Art. 131-30. – Lorsqu’elle est prévue par la loi, la peine d’interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable d’un crime ou d’un délit. |
|
Supprimé amendements CL6 et CL18 |
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
L’interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement ou de réclusion. |
||
Lorsque l’interdiction du territoire accompagne une peine privative de liberté sans sursis, son application est suspendue pendant le délai d’exécution de la peine. Elle reprend, pour la durée fixée par la décision de condamnation, à compter du jour où la privation de liberté a pris fin. |
||
L’interdiction du territoire français prononcée en même temps qu’une peine d’emprisonnement ne fait pas obstacle à ce que cette peine fasse l’objet, aux fins de préparation d’une demande en relèvement, de mesures de semi-liberté, de placement à l’extérieur, de placement sous surveillance électronique ou de permissions de sortir. |
||
Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile |
|
Article 4 |
Art. L. 521-1. – Sous réserve des dispositions des articles L. 521-2, L. 521-3 et L. 521-4, l’expulsion peut être prononcée si la présence en France d’un étranger constitue une menace grave pour l’ordre public. |
|
Supprimé amendements CL19 et CL28 |
|
Article 5 | |
|
Supprimé amendements CL8 et CL20 | |
|
||
Chapitre III |
Chapitre III | |
Dispositions relatives à la création d’une rétention de sûreté pour les personnes condamnées pour crime terroriste, et d’un délit de séjour à l’étranger sur un théâtre d’opérations de groupements terroristes |
Dispositions relatives à la création d’une rétention de sûreté pour les personnes condamnées pour crime terroriste, et d’un délit de séjour à l’étranger sur un théâtre d’opérations de groupements terroristes | |
|
Article 6 | |
Code de procédure pénale |
|
Supprimé amendements CL21 et CL29 |
Art. 362. – En cas de réponse affirmative sur la culpabilité, le président donne lecture aux jurés des dispositions des articles 130-1, 132-1 et 132-18 du code pénal. La cour d’assises délibère alors sans désemparer sur l’application de la peine. Le vote a lieu ensuite au scrutin secret, et séparément pour chaque accusé. |
||
La décision sur la peine se forme à la majorité absolue des votants. Toutefois, le maximum de la peine privative de liberté encourue ne peut être prononcé qu’à la majorité de six voix au moins lorsque la cour d’assises statue en premier ressort et qu’à la majorité de huit voix au moins lorsque la cour d’assises statue en appel. Si le maximum de la peine encourue n’a pas obtenu cette majorité, il ne peut être prononcé une peine supérieure à trente ans de réclusion criminelle lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité et une peine supérieure à vingt ans de réclusion criminelle lorsque la peine encourue est de trente ans de réclusion criminelle. Les mêmes règles sont applicables en cas de détention criminelle. Si la cour d’assises a répondu positivement à la question portant sur l’application des dispositions du second alinéa de l’article 122-1 du même code, les peines privatives de liberté d’une durée égale ou supérieure aux deux tiers de la peine initialement encourue ne peuvent être prononcées qu’à la majorité qualifiée prévue par la deuxième phrase du présent alinéa. |
||
Si, après deux tours de scrutin, aucune peine n’a réuni la majorité des suffrages, il est procédé à un troisième tour au cours duquel la peine la plus forte proposée au tour précédent est écartée. Si, à ce troisième tour, aucune peine n’a encore obtenu la majorité absolue des votes, il est procédé à un quatrième tour et ainsi de suite, en continuant à écarter la peine la plus forte, jusqu’à ce qu’une peine soit prononcée. |
||
Lorsque la cour d’assises prononce une peine correctionnelle, elle peut ordonner à la majorité qu’il soit sursis à l’exécution de la peine avec ou sans mise à l’épreuve. |
||
La cour d’assises délibère également sur les peines accessoires ou complémentaires. |
||
|
Dans les cas prévus par l’article 706-53-13, elle délibère aussi pour déterminer s’il y a lieu de se prononcer sur le réexamen de la situation du condamné avant l’exécution de la totalité de sa peine en vue d’une éventuelle rétention de sûreté conformément à l’article 706-53-14. |
|
|
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
Art. 723-38. – Lorsque le placement sous surveillance électronique mobile a été prononcé dans le cadre d’une surveillance judiciaire à l’encontre d’une personne condamnée à une réclusion criminelle d’une durée égale ou supérieure à quinze ans pour l’une des infractions visées à l’article 706-53-13, il peut être renouvelé tant que la personne fait l’objet d’une surveillance judiciaire ou d’une surveillance de sûreté. |
|
|
|
||
|
Article 7 | |
|
Supprimé amendement CL22 | |
|
||
|
||
Code pénal |
||
Art. 421-5. – Les actes de terrorisme définis aux articles 421-2-1 et 421-2-2 sont punis de dix ans d’emprisonnement et de 225 000 euros d’amende. |
|
|
Le fait de diriger ou d’organiser le groupement ou l’entente défini à l’article 421-2-1 est puni de trente ans de réclusion criminelle et de 500 000 euros d’amende. |
||
La tentative du délit défini à l’article 421-2-2 est punie des mêmes peines. |
||
L’acte de terrorisme défini à l’article 421-2-6 est puni de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende. |
||
|
||
|
||
Chapitre IV |
Chapitre IV | |
Dispositions relatives aux droits et obligations des personnes détenues |
Dispositions relatives aux droits et obligations des personnes détenues | |
Code de procédure pénale |
|
Article 8 |
Art. 721-1-1. – Les personnes condamnées à une peine privative de liberté pour une ou plusieurs des infractions mentionnées aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal, à l’exclusion de celles définies aux articles 421-2-5 à 421-2-5-2 du même code, ne bénéficient pas des crédits de réduction de peine mentionnés à l’article 721 du présent code. Elles peuvent toutefois bénéficier d’une réduction de peine dans les conditions définies à l’article 721-1. |
|
Supprimé amendement CL23 |
Loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire |
|
Article 9 |
Art. 57. – Les fouilles doivent être justifiées par la présomption d’une infraction ou par les risques que le comportement des personnes détenues fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l’établissement. Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. |
Supprimé amendement CL24 | |
Lorsqu’il existe des raisons sérieuses de soupçonner l’introduction au sein de l’établissement pénitentiaire d’objets ou de substances interdits ou constituant une menace pour la sécurité des personnes ou des biens, le chef d’établissement peut également ordonner des fouilles dans des lieux et pour une période de temps déterminés, indépendamment de la personnalité des personnes détenues. Ces fouilles doivent être strictement nécessaires et proportionnées. Elles sont spécialement motivées et font l’objet d’un rapport circonstancié transmis au procureur de la République territorialement compétent et à la direction de l’administration pénitentiaire. |
|
|
Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l’utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes. |
||
Les investigations corporelles internes sont proscrites, sauf impératif spécialement motivé. Elles ne peuvent alors être réalisées que par un médecin n’exerçant pas au sein de l’établissement pénitentiaire et requis à cet effet par l’autorité judiciaire. |
||
|
Article 10 | |
Code de procédure pénale |
|
Supprimé amendement CL25 |
Art. 726-2. – Lorsqu’il apparaît que leur comportement porte atteinte au maintien du bon ordre de l’établissement, les personnes détenues exécutant une peine privative de liberté peuvent, sur décision du chef d’établissement, faire l’objet d’une évaluation ou bénéficier d’un programme spécifique de prise en charge au sein d’une unité dédiée. |
|
|
L’exercice des activités mentionnées à l’article 27 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire par les personnes détenues au sein d’une unité dédiée peut s’effectuer à l’écart des autres personnes détenues, sur décision prise par le chef d’établissement après avis de la commission pluridisciplinaire unique. |
|
|
La décision d’affectation au sein d’une unité dédiée peut faire l’objet d’un recours devant le juge administratif dans les conditions prévues au code de justice administrative. |
||
Loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire |
|
Article 11 |
Art. 39. – Les personnes détenues ont le droit de téléphoner aux membres de leur famille. Elles peuvent être autorisées à téléphoner à d’autres personnes pour préparer leur réinsertion. Dans tous les cas, les prévenus doivent obtenir l’autorisation de l’autorité judiciaire. |
|
Supprimé amendement CL26 |
L’accès au téléphone peut être refusé, suspendu ou retiré, pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions et, en ce qui concerne les prévenus, aux nécessités de l’information. |
|
|
Le contrôle des communications téléphoniques est effectué conformément à l’article 727-1 du code de procédure pénale. |
||
Chapitre V |
Chapitre V | |
Dispositions relatives à la légitime défense des policiers |
Dispositions relatives à la légitime défense des policiers | |
|
Article 12 | |
Code de la sécurité intérieure |
|
Supprimé amendement CL27 |
Chapitre V Port et transport |
|
|
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
PERSONNES ENTENDUES PAR LE RAPPORTEUR
• M. François Molins, procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris, accompagné de Mme Camille Hennetier, vice-procureure, chef de la section antiterroriste
Table ronde des centrales syndicales de police
• Confédération CFDT, ALTERNATIVE POLICE
–– M. Pascal Jakowlew, secrétaire national en charge de l’investigation et du renseignement
Affilié
• Syndicat des cadres de la sécurité intérieure (SCSI)
–– M. Jean-Marc Bailleul, secrétaire général
–– M. Christophe Dumont, secrétaire national
–– M. Christophe Rouget, chargé de mission
Affiliés FO
• Union des officiers
–– M. Hervé Emo, secrétaire général
–– M. Laurent Massonneau, secrétaire général adjoint
• Unité SGP POLICE-FO
–– M. Daniel Chomette, secrétaire général délégué
–– M. Nicolas Comte, secrétaire général adjoint
–– M. Yves Lefebvre, sécrétaire général
• SNIPAT-FO (Syndicat national indépendant des personnels administratifs et techniques)
–– M. Georges Knecht, secrétaire général
–– M. Régis Felten, secrétaire national chargé de la coordination à Épinal
Affiliés CFE-CGC
• SYNERGIE-OFFICIERS
–– Mme Isabelle Trouslard, secrétaire national
–– Mme Audrey Colin, conseiller technique
–– M. David Alberto, conseiller technique
• SICP
–– M. Olivier Boisteaux, président
• ALLIANCE SNAPATSI
–– Mme Claire Couyoumdjian, secrétaire nationale adjointe des personnels scientifiques
UNSA-FASMI
• UNSA POLICE
–– M. Olivier Varlet, secrétaire général adjoint
• SCPN
–– Mme Céline Berthon, secrétaire générale
–– M. Jean-Luc Taltavull, secrétaire général adjoint
• UNSA INTÉRIEUR ATS
–– M. Bertrand Tourillon, délégué adjoint
• SNPPS
–– Mme Frédérique Girardet, secrétaire nationale
• ALLIANCE POLICE NATIONALE
–– M. Frédéric Lagache, secrétaire général adjoint
–– M. Stanislas Gaudon, secrétaire administratif général adjoint
Table ronde syndicats de la pénitentiaire
• SPS (Syndicat Pénitentiaire des Surveillants)
–– M. Philippe Kuhn, délégué régional
–– M. Pascal Goulard, délégué régional
–– M. Joseph Paoli, délégué régional
• CFTC JUSTICE Fédération des Agents de l’État
–– M. Armand Minet, président
–– M. Sègla Gangbazo, secrétaire général
–– Mme Latifha Mhamdi, conseiller technique
–– Mme Maridza Maurin, conseiller technique
–– M. Michaël Rambaut, conseiller technique
• Syndicat national pénitentiaire FO-personnels de surveillance et personnels de direction
–– M. Jimmy Delliste, secrétaire général