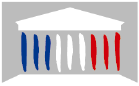N° 4399
______
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 24 janvier 2017.
RAPPORT
FAIT
AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES SUR LA PROPOSITION DE LOI visant à agir concrètement en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes,
Par Mme Marie-George BUFFET,
Députée.
——
Voir le numéro :
Assemblée nationale : 4347.
___
Pages
INTRODUCTION 5
I. ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE : DES AVANCÉES QUI SE FONT ATTENDRE 6
A. LE TRAVAIL À TEMPS PARTIEL, UN FLÉAU QUI CONDAMNE LES FEMMES À LA PRÉCARITÉ 7
1. Les femmes restent les principales « variables d’ajustement » de l’organisation du temps de travail dans l’entreprise 7
2. Les dérogations aux vingt-quatre heures, des pratiques scandaleuses 8
B. DES INÉGALITÉS ENCORE FLAGRANTES DANS L’ACCÈS À L’EMPLOI ET DANS LE DÉROULEMENT DE LA CARRIÈRE DES FEMMES 10
1. « À travail égal, rémunération inégale » : inégalités salariales et autres discriminations à l’égard des femmes 10
2. La conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle et familiale, une problématique qui concerne encore principalement les femmes 11
C. LE DIALOGUE SOCIAL SUR L’ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES DANS LES ENTREPRISES : UNE OCCASION MANQUÉE ? 12
1. Les entreprises ne remplissent pas leurs obligations de négociation sur l’égalité professionnelle 13
2. Les petites et très petites entreprises restent un angle mort des politiques d’égalité professionnelle 14
II. AMÉLIORER CONCRÈTEMENT L’ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES : LE CONTENU DE LA PROPOSITION DE LOI 15
A. SANCTIONNER LES ENTREPRISES QUI MÉCONNAISSENT LEURS OBLIGATIONS DE NÉGOCIER 15
B. LUTTER CONTRE LE RECOURS ABUSIF AU TEMPS PARTIEL 16
C. RÉÉQUILIBRER LE TEMPS PARENTAL 17
D. LUTTER CONTRE LES DISCRIMINATIONS À L’EMBAUCHE 17
TRAVAUX DE LA COMMISSION 19
DISCUSSION GÉNÉRALE 19
EXAMEN DES ARTICLES 30
TITRE PREMIER – RENDRE EFFECTIVE L’ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES 30
Article premier (Art. L. 241-13 du code de la sécurité sociale) : Suppression des allégements de cotisations patronales en cas d’absence d’accord d’entreprise portant sur la rémunération ou sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes 30
Article 2 (Art. L. 2242-9 du code du travail) : Pénalité en cas de défaut de production des données relatives à la situation comparée entre les femmes et les hommes 37
TITRE II – ENCADRER LE TEMPS PARTIEL IMPOSÉ 41
Article 3 (Art. L. 241-13 du code de la sécurité sociale) : Diminution de la réduction sur les cotisations patronales en cas d’embauche à temps partiel 42
Article 4 (Art. L. 3123-7 du code du travail) : Majoration de la rémunération des heures effectuées dans le cadre d’un contrat à temps partiel inférieur à 24 heures hebdomadaires 44
Article 5 (Art. L. 3123-21 et L. 3123-29 du code du travail) : Majoration de la rémunération des heures complémentaires 50
Article 6 (Art. L. 3123-22 du code du travail) : Majoration obligatoire de la rémunération des compléments d’heures 53
Après l’article 6 55
TITRE III – PARTAGER LA PARENTALITÉ 56
Article 7 (Art. L. 1225-17 du code du travail) : Allongement de la durée du congé de maternité 56
Article 8 (Art. L. 1225-35 du code du travail) : Allongement de la durée du congé de paternité 59
TITRE IV – LUTTER CONTRE LES DISCRIMINATIONS À L’EMBAUCHE 63
Article 9 (Art. L. 1221-6 et L. 1221-13 du code du travail) : Améliorer l’information en matière de discrimination 63
Article 10 : Compensation des charges pour les organismes de sécurité sociale 69
ANNEXE LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES PAR LA RAPPORTEURE 71
La loi « Roudy » du 13 juillet 1983 représente l’un des premiers pas de la longue marche vers l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Depuis, de nombreuses lois ont été votées pour garantir l’égalité des droits, dans l’entreprise, entre les femmes et les hommes. Et pourtant rien, ou si peu, n’a changé.
Qu’il s’agisse des écarts salariaux, de l’avancement de carrière, de l’accès à l’emploi, les inégalités entre les femmes et les hommes dans le monde du travail sont encore frappantes. Selon le dernier rapport du Forum économique mondial, la France n’est ainsi qu’au 134e rang mondial sur 144 pays en matière d’égalité salariale.
Les femmes subissent des différences de rémunération pouvant aller jusqu’à 24 %. Elles sont davantage touchées par la précarité, le temps partiel et le chômage que les hommes. Leurs carrières sont également davantage plafonnées, et elles accèdent moins souvent aux postes à responsabilité que les hommes.
Les femmes sont également davantage discriminées en raison de leur genre ou de la maternité, alors même que ces différences de traitement sont prohibées par la loi. Elles s’occupent encore davantage des tâches domestiques et de l’éducation des enfants que les hommes, sacrifiant de facto plus souvent leur carrière, avec les conséquences que l’on sait.
Au sein de l’entreprise, la problématique de l’égalité professionnelle est censée être un thème incontournable du dialogue social depuis des décennies alors que dans les faits, 60 % des entreprises assujetties à l’obligation de négocier s’en exonèrent, sans pour autant être sanctionnées.
Il aurait été tentant, au regard des maigres évolutions constatées ces dernières années, de créer de nouveaux dispositifs contraignants pour faire progresser l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Force est de constater, pourtant, que l’accumulation de mesures nouvelles qui viennent s’ajouter aux mesures existantes n’ont pas d’effet tant qu’elles ne sont pas appliquées.
Cette proposition de loi propose donc d’inverser la logique des lois passées pour imposer à l’ensemble des acteurs des obligations de résultat.
La priorité est donnée à la lutte contre le recours excessif au temps partiel, devenu un mode courant de gestion de la main d’œuvre féminine, alors même que le temps partiel est une grande source de précarité pour les femmes.
La mise en place de mesures contraignantes visant à changer concrètement le comportement des entreprises est également proposée : il n’est pas acceptable de tolérer que les entreprises ne respectent pas leurs obligations en matière de négociation collective.
La proposition de loi vise également à allonger la durée des congés de maternité et de paternité, afin de promouvoir un meilleur partage de la parentalité. Des mesures complémentaires en matière de lutte contre les discriminations à l’embauche sont également prévues.
Les données globales relatives à l’activité professionnelle des femmes laissent penser que les inégalités professionnelles se réduisent. Certes, le taux d’emploi continue de progresser en France. Certes, l’écart de taux d’activité des hommes et des femmes n’a cessé de se réduire depuis 20 ans ; il était de 17 points en 1990 avec un taux d’activité de 76 % pour les hommes et de 59 % pour les femmes ; il n’est plus que de 9 points en 2010 : 66 % pour elles, 75 % pour eux. Les écarts de salaire diminuent deux fois plus vite en France que dans la moyenne de l’Union européenne.
Pourtant, ces données doivent être largement nuancées. Selon un récent rapport du Conseil économique, social et environnemental, consacré à la précarité des femmes, entre 1975 et 2008, sur les près de 4 millions d’emplois créés dans notre économie, les deux tiers l’ont été à temps partiel. Or ces emplois à temps partiel, qui concernent très majoritairement les femmes, condamnent très souvent ces dernières à des horaires atypiques, non choisis, et à la précarité économique (A).
D’autre part, alors que les femmes sont plus diplômées que les hommes, elles sont souvent qualifiées dans des domaines moins bien rémunérés, et n’exercent pas les mêmes métiers ni n’ont les mêmes carrières. À travail égal, et toutes choses égales par ailleurs, elles continuent d’être moins bien payées que les hommes. Dès lors, il ne faut pas s’y tromper : les inégalités professionnelles persistent entre les femmes et les hommes (B).
Dans les entreprises également, la marche vers l’égalité professionnelle est encore longue. Certes, neuf entreprises de plus de mille salariés sur dix sont désormais couvertes par un accord ou par un plan d’action sur l’égalité professionnelle. Mais 60 % de l’ensemble des entreprises de cinquante salariés et plus ne le sont pas, alors qu’il s’agit d’une obligation prévue par le code du travail. Certes, des démarches positives émergent, de la part de certaines entreprises, branches ou organisations professionnelles (label « égalité professionnelle et diversité », publication de guides de bonnes pratiques, etc.). Mais pour une entreprise qui a compris la nécessité de faire progresser l’égalité entre les femmes et les hommes, combien n’abordent jamais cette problématique (C) ?
1. Les femmes restent les principales « variables d’ajustement » de l’organisation du temps de travail dans l’entreprise
Alors que le travail à temps partiel ne concernait que 5,9 % des actifs occupés en 1973, cette proportion est passée à 9,2 % en 1982, à 12,1 % en 1991 puis à 15,6 % en 1995, pour atteindre, en 2011, près de 4,2 millions de salariés, soit 18,6 % des salariés. Dans les années 1980 et 1990, les mesures d’allégements de charges sociales ont fortement encouragé ce développement du travail à temps partiel. Bien que ces incitations aient été pour la plupart supprimées au début des années 2000, le travail à temps partiel, qui confère de la flexibilité dans l’organisation du temps de travail de l’entreprise, est dans l’intervalle devenu un mode de gestion de la main d’œuvre.
Or, selon les données de la Direction de l’animation, de la recherche, des études et des statistiques (DARES) publiées en juin 2013, le temps partiel concerne surtout les femmes : 82 % des salariés à temps partiel sont des femmes, et 31 % des femmes salariées sont à temps partiel, contre 7 % des hommes (1).
• Les femmes sont surreprésentées dans les secteurs ayant habituellement recours au travail à temps partiel
Cette prédominance des femmes dans les emplois à temps partiel s’explique par plusieurs facteurs.
Les femmes sont plus souvent à temps partiel lorsqu’elles ont des enfants à charge : ainsi, près de la moitié des femmes ayant au moins trois enfants travaillent à temps partiel (45 %).
Les femmes et les hommes se répartissent de manière inégale dans les secteurs et métiers ayant recours de manière habituelle au travail à temps partiel : l’enquête emploi de l’INSEE de 2011 a par exemple montré que les femmes représentent 87 % des salariés à temps partiel dans l’éducation, la santé et l’action sociale.
Les femmes occupent également plus souvent des emplois non-qualifiés, notamment dans le secteur des services à la personne, ou de la grande distribution, où le recours au temps partiel est trop souvent devenu la norme : les femmes représentent ainsi 95 % de l’effectif total dans trois métiers de services aux particuliers : assistantes maternelles, aides à domicile et employées de maison. Dans ces métiers où les femmes sont surreprésentées, le travail à temps partiel est d’ailleurs très développé.
• Un temps partiel souvent subi et facteur de précarité
Selon la DARES, 30,7 % des femmes déclarent être à temps partiel faute d’avoir trouvé un travail à temps plein. Ainsi, en 2013, 9,7 % des femmes – contre seulement 3,5 % des hommes – sont en situation de sous-emploi, c’est-à-dire qu’elles souhaiteraient travailler davantage et sont disponibles pour le faire, mais qu’elles ne trouvent pas d’emploi adéquat (2).
Cette forte proportion de temps partiel dit « subi » trouve logiquement une explication dans la normalisation du recrutement à temps partiel dans certains secteurs d’activité, déjà évoqués : commerce, hôtellerie, restauration, services à la personne, notamment. Dans ces secteurs, le temps partiel est le plus souvent décidé par l’employeur, dès l’embauche ; par crainte du chômage et faute de trouver un emploi à temps plein, les femmes préfèrent en effet accepter un emploi à temps partiel.
Or, compte tenu des secteurs d’activité principalement concernés, les femmes travaillant à temps partiel effectuent souvent des horaires atypiques – tôt le matin, tard le soir, ou avec un faible nombre d’heures dans la journée. Dans le secteur du nettoyage, les femmes ont souvent des durées de travail courtes et cumulent plusieurs employeurs et lieux de travail. Les personnes employées dans le secteur des services à la personne travaillent également régulièrement le week-end, dimanche compris.
• Le temps partiel condamne les femmes à la précarité
Pour les femmes à temps partiel, les difficultés tendent à se cumuler : horaires atypiques et instables difficilement compatibles avec une vie personnelle et familiale, faible niveau de rémunération entraînant parfois une dépendance financière vis-à-vis de leur conjoint, mais aussi des conséquences à plus long terme, telles que des droits à la retraite amputés ou un moindre accès, au cours de la carrière, à la formation professionnelle.
Dès lors, comme l’a souligné le rapport du CESE précité, « pour nombre de femmes, il en résulte une précarité accrue à la fois plus grande que celle des hommes et qui s’est amplifiée dans le temps. Cette précarité prend la forme d’instabilité et de discontinuité de l’insertion sur le marché du travail – c’est la définition traditionnelle de la précarité – mais aussi, de plus en plus, de stabilité dans le sous-emploi ».
Compte tenu de l’ensemble des effets néfastes du travail à temps partiel, les partenaires sociaux ont souhaité, par l’accord national interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2013, mieux encadrer cette modalité d’organisation du temps de travail, en vue d’améliorer la protection des salariés contraints de travailler à temps partiel. Cette protection s’est traduite par la fixation d’une durée minimale de travail de vingt-quatre heures hebdomadaires, retranscrite dans la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi.
À de rares exceptions près – secteurs de la restauration rapide, entreprises de propreté, cafétérias –, les travailleurs à temps partiel ne bénéficiaient pas, jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi du 14 juin 2013, d’une durée minimale de travail hebdomadaire.
L’objectif poursuivi était d’assurer une garantie de rémunération aux salariés à temps partiel, et de lutter contre les abus de certains employeurs ayant régulièrement recours aux contrats à temps partiel de courte, voire très courte durée.
Une faille subsistait pourtant dans le dispositif initial, faille dans laquelle les branches professionnelles se sont empressées de s’engouffrer : la possibilité de déroger, par convention ou accord de branche étendu, à la durée minimale de vingt-quatre heures hebdomadaires.
Cette possibilité de dérogation, prévue par la loi du 14 juin 2013 et consacrée par la loi « travail » du 8 août 2016 – qui a relégué la durée minimale au rang de simple « disposition supplétive » s’appliquant à défaut d’accord de branche étendu, revient, lorsqu’elle est utilisée, à réduire à néant les efforts visant à mieux protéger les salariés à temps partiel grâce à une durée minimale de travail.
Ainsi, la quasi-totalité des branches parvenues à la conclusion d’un accord sur le temps partiel se sont emparées de la possibilité de déroger à la durée minimale de vingt-quatre heures hebdomadaires.
Selon le bilan de la négociation collective pour l’année 2015 publié par la Direction générale du travail (DGT) du ministère du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, sur 50 branches ayant conclu un accord sur le temps partiel, seules cinq d’entre elles ont négocié une durée égale ou supérieure à vingt-quatre heures hebdomadaires pour l’ensemble des emplois. Toutes les autres branches ont négocié des durées inférieures, parfois seulement une, deux ou trois heures minimales obligatoires pour certains emplois.
En définitive, alors que l’ensemble des salariés à temps partiel devraient pouvoir bénéficier d’une durée de travail hebdomadaire de vingt-quatre heures minimum, a fortiori dans les secteurs d’activité ayant largement recours au travail à temps partiel, l’on se trouve face à une situation dans laquelle les dérogations sont devenues la règle, et les vingt-quatre heures l’exception.
La majoration des heures complémentaires – c’est-à-dire les heures effectuées en plus de celles prévues par le contrat de travail – a subi le même sort que la durée minimale de travail à temps partiel : le renvoi à la négociation collective de branche pour la fixation du taux de la majoration s’est soldé, dans la majorité des cas, par une négociation a minima. Alors que la loi prévoit un minimum de 10 % dès la première heure complémentaire − un taux de majoration bien inférieur à celui de la majoration des heures supplémentaires effectuées par les salariés à temps plein −, selon la DGT, seuls onze accords de branches étendus fixent des taux supérieurs.
Pire encore : le mécanisme des compléments d’heures par avenant, introduit dans la loi de sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013, qui permet à l’employeur, si un accord de branche étendu le permet, d’imposer temporairement au salarié à temps partiel, par voie d’avenant, une modification de ses horaires de travail. Certaines branches ont d’ores et déjà négocié la possibilité d’utiliser de ce dispositif, jusqu’à huit fois par an. Cette exigence de flexibilité à outrance à l’encontre des salariés à temps partiel, qui repose dans ce cas précis sur la seule volonté de l’employeur, est, hélas, une preuve de plus de l’insuffisante protection des travailleurs à temps partiel.
B. DES INÉGALITÉS ENCORE FLAGRANTES DANS L’ACCÈS À L’EMPLOI ET DANS LE DÉROULEMENT DE LA CARRIÈRE DES FEMMES
Outre le temps partiel, de nombreuses autres formes de discrimination directe ou indirecte à l’égard des femmes persistent dans le monde du travail.
1. « À travail égal, rémunération inégale » : inégalités salariales et autres discriminations à l’égard des femmes
L’une des principales inégalités professionnelles entre les femmes et les hommes demeure le salaire. En 2013, lorsque l’on prend en compte la totalité des emplois, tous types de contrats confondus, les femmes gagnent en moyenne 24 % de moins que les hommes ; cet écart est encore de 19 % lorsque la comparaison porte sur l’ensemble des salariés à temps plein. Une partie de cet écart s’explique, comme on l’a dit, par la durée moyenne de travail moins élevée pour les femmes. Cependant, toutes choses égales par ailleurs, c’est-à-dire à secteur d’activité, âge, catégorie socioprofessionnelle et temps de travail identique, l’écart de salaire entre les femmes et les hommes est d’environ 10 % en 2013 (9,9 %) (3).
Selon la DARES, une partie de l’écart de salaire horaire entre les femmes et les hommes s’explique par « des différences de caractéristiques » : niveau de diplôme, expérience professionnelle, catégorie socioprofessionnelle, interruptions de carrières, niveau de responsabilité…). Mais la partie « non expliquée » de cet écart « peut être le reflet de pratiques de discrimination salariale ou de processus inégalitaires jouant en défaveur des femmes à divers moments de la carrière, voire en amont de la vie professionnelle ».

![]()

![]()
Écart de rémunération entre les femmes et les hommes :
le poids de chaque composante en 2012 (4)
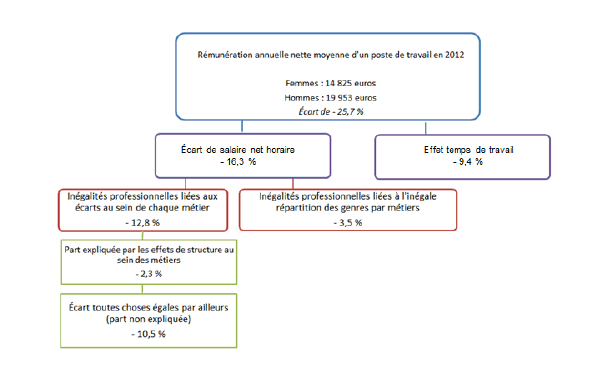
De fait, les femmes continuent d’occuper une place à part dans le monde du travail. Les femmes exercent presque deux fois plus souvent que les hommes des postes peu qualifiés d’employés ou d’ouvriers (27 % des femmes contre 15 % des hommes). Les femmes se trouvent également plus souvent que les hommes au bas de l’échelle des salaires, et ont plus difficilement accès aux emplois les mieux rémunérés : ainsi, dans 73 des 76 familles de métiers étudiées par la DARES en novembre 2015, plus de 50 % des femmes sont rémunérées sous le salaire horaire net médian (hommes et femmes confondus), alors que c’est le cas de moins de 50 % des hommes.
Quant aux femmes diplômées, plus nombreuses que les hommes, elles sont souvent qualifiées dans des secteurs d’activité moins rémunérateurs que ceux où les hommes sont majoritairement présents. Cette ségrégation professionnelle est également responsable des inégalités salariales entre les femmes et les hommes.
2. La conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle et familiale, une problématique qui concerne encore principalement les femmes
En dehors de la sphère professionnelle, et même si les nouvelles générations revendiquent davantage d’égalité dans le couple, les femmes continuent d’assumer l’essentiel des tâches domestiques et s’occupent davantage des enfants que les pères.
L’observatoire des inégalités a ainsi montré, en s’appuyant sur les données « Enquête emploi 2009-2010» de l’INSEE, que les femmes consacrent, chaque jour, en moyenne 1 heure et 26 minutes (3 heures 26) de plus que les hommes (2 heures) aux tâches domestiques (ménage, courses, soins aux enfants…). Or, les inégalités de partage des tâches ont des répercussions directes sur la vie professionnelle des femmes : elles expliquent notamment de moindres évolutions professionnelles ainsi que le développement du temps partiel féminin.
Les femmes sacrifient également davantage leur carrière pour se consacrer à l’éducation de leurs enfants : les statistiques relatives aux congés parentaux de longue durée qui, dans plus de neuf cas sur dix, sont pris par les femmes, en sont une excellente illustration.
Relevons enfin que les femmes font l’objet de discriminations particulières liées à l’état de grossesse ou à la maternité. Ces discriminations, qui existent dès le stade de la candidature à un emploi, interviennent également pour les femmes en emploi.
Au cours des auditions préparatoires à l’examen de la présente proposition de loi en commission des affaires sociales, les organisations syndicales de salariés ont ainsi attiré l’attention de la rapporteure sur la problématique des conditions de travail des femmes enceintes.
Plusieurs affaires récentes ont ainsi douloureusement rappelé que les femmes enceintes ne bénéficiaient le plus souvent d’aucun aménagement spécifique pendant leur grossesse – à l’exception des femmes travaillant de nuit ou manipulant des produits chimiques. Or, dans nombre de secteurs d’activité, les conditions de travail peuvent être difficiles pour une femme enceinte : travail en position debout (coiffure, commerces), absence de réduction du temps de travail hebdomadaire, etc. Bien que cette problématique ne soit pas directement abordée dans la proposition de loi, il paraît essentiel de faire progresser les droits des femmes sur ce point.
C. LE DIALOGUE SOCIAL SUR L’ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES DANS LES ENTREPRISES : UNE OCCASION MANQUÉE ?
La loi « Roudy » du 1er juillet 1983 a posé les premiers jalons de la lutte contre les inégalités professionnelles entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise. Dans le prolongement des lois « Auroux » de 1982, qui ont souhaité développer la place donnée à la négociation collective dans l’entreprise, la loi « Roudy » a désigné les entreprises comme les acteurs centraux de la mise en œuvre de l’égalité professionnelle (5).
Cette loi imposait pour la première fois à certaines entreprises – celles de plus de cinquante salariés ayant signé un contrat avec l’État – de publier un état des lieux de la parité professionnelle en matière d’embauche, de formation, de promotion, de qualification, de classification, de conditions de travail et de rémunération, au sein du rapport de situation comparée.
Depuis, de nombreuses lois (notamment la loi n° 2001-397 du 9 mai 2001 relative à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, dite loi « Génisson », la loi n° 2006-340 du 23 mars 2006 relative à l’égalité salariale entre les femmes et les hommes, dite loi « Ameline », ou encore la loi n° 2014-873 pour du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes), ont développé et renforcé les obligations qui incombent aux entreprises en matière de lutte contre les inégalités professionnelles entre les femmes et les hommes. En pratique, pourtant, la mobilisation des entreprises est encore très inégale – pour ne pas dire inexistante dans certains cas.
1. Les entreprises ne remplissent pas leurs obligations de négociation sur l’égalité professionnelle
La loi oblige toute entreprise de cinquante salariés et plus à engager chaque année des négociations sur l’égalité professionnelle – un thème ajouté à celui sur la qualité de vie au travail par la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi. Or, seules 40 % des entreprises assujetties sont effectivement couvertes par un accord ou, à défaut, par un plan d’action sur l’égalité professionnelle. De surcroît, parmi ces accords et plans d’action, beaucoup se contentent d’un simple rappel de la loi, sans prévoir de mesure visant à réduire les écarts salariaux, par exemple.
Dans son ouvrage relatif à l’égalité professionnelle (6), la sociologue Jacqueline Laufer analyse les résultats d’une enquête menée en Bourgogne auprès 36 organisations (entreprises, associations, coopératives, mutuelles) de 50 salariés et plus, dont 44 % de plus de 250 salariés. Si deux tiers des organisations concernées sont couvertes soit par un accord, soit par un plan d’action, 14 % des organisations considèrent que l’égalité professionnelle n’est pas un sujet important ; 25 % d’entre elles considèrent que les obligations qui leur incombent sont avant tout une contrainte.
Les sanctions financières prévues par la loi sont en outre très insuffisamment appliquées – à peine plus d’une centaine de sanctions financières prononcées pour défaut d’accord ou de plan d’action, sur un total de seulement deux mille mises en demeure adressées aux entreprises assujetties. Il en va de même de la sanction, prévue par la loi du 4 août 2014, visant à interdire aux entreprises non couvertes par un accord ou un plan d’action, de soumissionner à un marché public : aucune des personnes auditionnées par la rapporteure n’a été en mesure de dresser un état des lieux des sanctions éventuellement appliquées sur ce fondement.
Lorsque l’on sait que 60 % des entreprises ne remplissent pas leurs obligations, cette impunité pose évidemment question.
Lorsque la négociation sur l’égalité professionnelle est tout de même engagée, à l’initiative de l’employeur ou sur demande des syndicats représentatifs dans l’entreprise, cette négociation est censée s’appuyer sur les indicateurs et données contenus dans la base de données économiques et sociales (BDES), qui s’est substituée, depuis la loi du 17 août 2015, au rapport de situation comparée (RSC) instauré par la loi « Roudy ». Cette évolution, présentée comme une mesure de simplification nécessaire – une seule base de données réunit l’ensemble des informations relatives à l’entreprise –, pourrait avoir tendance à entraîner une dilution de la question de l’égalité professionnelle dans l’entreprise.
De l’avis des personnes auditionnées par la rapporteure dans le cadre de la préparation de l’examen de la proposition de loi en commission, le contenu de la BDES a perdu en clarté par rapport au RSC et, surtout, les informations transmises ne comportent plus d’analyse qualitative des données renseignées. Dans ces conditions, la BDES se présente davantage comme une agrégation de données brutes – lorsqu’elles sont effectivement renseignées – qu’il est plus difficile d’exploiter que le RSC.
2. Les petites et très petites entreprises restent un angle mort des politiques d’égalité professionnelle
Il faut rappeler que les politiques publiques en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes concernent encore dans leur quasi-totalité les entreprises de cinquante salariés et plus.
Les petites et très petites entreprises sont, dans la très grande majorité des cas, exonérées des obligations imposées par la loi. Certains secteurs d’activité, notamment les services à la personne, ne relèvent pas du code du travail et ne sont donc pas non plus soumis à ces obligations.
L’on peut arguer que les branches professionnelles sont, justement, censées pallier l’absence de dialogue social dans les petites et très petites entreprises en définissant des garanties au niveau professionnel ou interprofessionnel : comme les entreprises de cinquante salariés et plus, les branches ont en effet l’obligation de négocier sur l’égalité professionnelle. Pourtant, dans les branches comme dans les entreprises, le thème de l’égalité professionnelle est très peu abordé, proportionnellement aux autres thèmes de négociations. Plus inquiétant encore, comme le montre le tableau ci-après, le nombre d’accords professionnels portant spécifiquement sur l’égalité professionnelle ne cesse de diminuer : à peine 5 accords en 2015, contre 37 en 2010.
NOMBRE D’ACCORDS DE BRANCHE ABORDANT LE THÈME DE L’ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE ET SALARIALE PAR RAPPORT AU NOMBRE TOTAL DE TEXTES (INTERPROFESSIONNELS, PROFESSIONNELS, NATIONAUX OU INFRANATIONAUX)
Années |
Accords spécifiques égalité professionnelle |
Accords de branches abordant le thème de l’égalité, à l’exclusion des accords spécifiques |
Nombre et % d’accords de branche abordant le thème de l’égalité |
Nombre total d’accords |
2007 |
9 |
24 |
33 (3,2 %) |
1 038 |
2008 |
19 |
34 |
53 (4,3 %) |
1 215 |
2009 |
35 |
75 |
110 (9,5 %) |
1 161 |
2010 |
37 |
112 |
149 (12,8 %) |
1 161 |
2011 |
27 |
140 |
167 (13,45 %) |
1 241 |
2012 |
19 |
164 |
183 (14,4 %) |
1 264 |
2013 |
9 |
113 |
122 (12,1 %) |
1 006 |
2014 |
6 |
134 |
140 (13,9 %) |
1 007 |
2015 |
5 |
162 |
167 (15,2 %) |
1 094 |
Source : Direction générale du travail (DGT) du Ministère du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.
Ces données montrent bien que dans les faits, et sauf à de rares exceptions, la problématique de l’égalité professionnelle n’est jamais abordée dans la plupart des entreprises françaises.
II. AMÉLIORER CONCRÈTEMENT L’ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES : LE CONTENU DE LA PROPOSITION DE LOI
Comme il a été dit en préambule, cette proposition de loi souhaite prendre le contre-pied des dernières lois adoptées en matière d’égalité professionnelle en proposant, non pas de créer de nouveaux dispositifs venant se juxtaposer à ceux qui existent déjà, mais de faire appliquer une fois pour toutes les dispositifs prévus par notre droit.
En matière d’égalité professionnelle, « force est de constater que sans le “bâton”, les choses n’avancent pas » : telle a été la réponse de Mme Lydie Recorbet, chargée des questions d’égalité femmes-hommes à l’Observatoire de la responsabilité sociétale des entreprises (ORSE), lorsqu’elle a été interrogée par Mme Catherine Coutelle, présidente de la Délégation aux droits des femmes de l’Assemblée nationale (7), sur la question de savoir s’il fallait être favorable aux sanctions à l’égard des entreprises en matière d’égalité professionnelle.
S’agissant des obligations de négociation instaurées par la loi, le constat est sans appel : la majorité des entreprises tenues de négocier – c’est-à-dire les entreprises de cinquante salariés et plus – ne le font pas. Cela signifie qu’il n’existe aucun moyen, dans ces entreprises, de s’entendre sur des objectifs de réduction des inégalités professionnelles, notamment sur les écarts de salaires.
Pour ces raisons, le titre Ierde la proposition de loi propose de sanctionner les entreprises qui ne respectent pas leurs obligations en matière de dialogue social. En premier lieu, l’article 1erpropose de sanctionner les entreprises qui ne respectent pas leurs obligations de négocier sur les rémunérations et sur l’égalité professionnelle, via une réduction de l’allégement sur les cotisations patronales.
L’article 2 vise pour sa part à sanctionner les entreprises qui ne renseignent pas la base de données économiques et sociales avec les indicateurs relatifs à la situation comparée entre les femmes et les hommes.
Sans revenir sur les possibilités de dérogation aux vingt-quatre heures hebdomadaires de travail à temps partiel, le titre II vise à dissuader les entreprises d’avoir recours de manière excessive au travail à temps partiel de courte durée, tout en améliorant la rémunération des salariés travaillant dans le cadre d’un contrat à temps partiel prévoyant un faible nombre d’heures par semaine. Ainsi :
– l’article 3 vise à pénaliser financièrement les entreprises qui ont recours de manière habituelle au travail à temps partiel, en diminuant de 20 % la réduction sur les cotisations patronales dès lors que l’effectif moyen par catégorie d’emploi compte en moyenne, sur une année civile, plus de 15 % de salariés à temps partiel ;
– l’article 4 propose de majorer la rémunération de chaque heure travaillée lorsque la durée de travail à temps partiel hebdomadaire prévue par le contrat de travail est inférieure à vingt-quatre heures ;
– l’article 5 majore la rémunération des heures complémentaires, c’est-à-dire les heures effectuées en plus de celles prévues par le contrat de travail ;
– l’article 6, enfin, propose de majorer la rémunération des heures effectuées dans le cadre d’un complément d’heures prévu par avenant.
La répartition actuelle des congés autour de la naissance laisse paraître une flagrante inégalité entre le père et la mère : alors que pour cette dernière le congé est obligatoire – pour au moins huit semaines – et d’une durée en général au moins égal à seize semaines, les pères ne bénéficient que d’un congé facultatif de onze jours, à prendre dans les quatre mois suivant la naissance de leur enfant. Or, c’est dans ce type d’inégalités que naissent, par la suite, les inégalités professionnelles : les femmes s’absentant plus longuement de l’entreprise en raison de la maternité que les hommes, la parentalité se révèle être plus un frein pour la carrière des femmes que pour celle des hommes.
Ce partage des congés au moment de la naissance n’est, en outre, plus nécessairement en phase avec les souhaits des jeunes générations, parmi lesquelles de nombreux pères souhaitent passer davantage de temps avec leurs enfants.
Le titre III de la proposition de loi propose en conséquence d’allonger la durée des congés de maternité et paternité.
L’article 7 propose de relever la durée du congé de maternité à dix-huit semaines, comme le recommande l’Organisation internationale du travail (OIT).
L’article 8 relève la durée du congé de paternité à quatre semaines pour la naissance d’un enfant.
Le titre IV propose enfin de s’attaquer à la problématique des discriminations, en se concentrant sur les discriminations à l’embauche.
Une enquête récente réalisée par le Défenseur des droits sur les discriminations liées à l’origine montre en effet que les discriminations se produisent à tout moment au cours du recrutement : 40 % lors du premier contact (lettre de motivation ou envoi du curriculum vitae), 43 % lors de l’entretien d’embauche, 10 % lors de la période d’essai, contre 7 % pour d’autres raisons (8). Cette enquête a également montré que faute de connaître leurs droits ou de savoir à qui s’adresser, les personnes victimes de discriminations n’engagent que rarement des démarches pour faire reconnaître la discrimination.
Parmi les principaux motifs de discrimination à l’embauche régulièrement invoqués figure en premier chef la discrimination liée aux origines, mais le genre, la maternité ou encore l’âge font partie des motifs courants de discrimination à l’embauche.
L’article 9 propose donc de renforcer la connaissance des discriminations, en obligeant les entreprises à inscrire, dans le registre unique du personnel, les coordonnées personnelles des personnes candidates à un emploi. Il propose également de renforcer la connaissance des voies de recours contre les discriminations, en obligeant les employeurs à remettre, au cours de l’entretien d’embauche, une fiche rappelant le droit à la non-discrimination et listant les personnes auxquelles les personnes victimes de discrimination peuvent faire appel.
La Commission des affaires sociales examine, sur le rapport de Mme Marie-George Buffet, la proposition de loi visant à agir concrètement en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (n° 4347) au cours de sa séance du mardi 24 janvier 2017.
Mme la présidente Catherine Lemorton. Je rappelle que la proposition de loi de Mme Marie-George Buffet, objet de la présente réunion, sera examinée en séance publique le jeudi 2 février prochain, dans le cadre de l’ordre du jour réservé au groupe Gauche démocratique et républicaine (GDR).
Mme Marie-George Buffet, rapporteure. Les femmes représentent aujourd’hui environ 48 % de la population active. Avec un taux d’activité de 66 %, l’écart n’est plus que de neuf points avec les hommes. Ces chiffres témoignent d’une volonté des femmes d’être de plain-pied dans le travail. Pourtant, l’égalité professionnelle ne leur est pas assurée.
Les femmes gagnent en moyenne 24 % de moins que les hommes. À niveau de compétence égal et dans une même catégorie socioprofessionnelle, d’âge et d’expérience, l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes – ce que l’on appelle l’écart « inexpliqué » – s’élève encore à 10 %. Sur 144 pays, la France détient ainsi une triste 134e place en matière d’égalité salariale entre les femmes et les hommes.
En raison d’une ségrégation professionnelle persistante, les femmes sont également exposées à une plus grande précarité : 82 % des emplois à temps partiel sont occupés par des femmes, tandis que 31 % des femmes salariées le sont à temps partiel. Les femmes sont également deux fois plus nombreuses que les hommes à occuper des emplois peu qualifiés d’employés ou d’ouvriers ; elles représentent plus des deux tiers des travailleurs pauvres.
Dans l’entreprise, l’accès aux postes à responsabilité et aux rémunérations les plus élevées est également plus difficile pour les femmes, davantage sujettes aux discriminations, directes ou indirectes. En raison du genre ou de la parentalité, les femmes ont des déroulements de carrières moins favorables et se heurtent de plein fouet au fameux « plafond de verre ».
Ces données interrogent. Comment pouvons-nous tolérer qu’en France, les inégalités professionnelles soient toujours aussi vives entre les femmes et les hommes ? Mais l’interrogation porte surtout sur le fait que ces inégalités demeurent alors que le combat pour l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes n’est pas récent. L’un des premiers jalons de ce combat, et non des moindres, est sans conteste la loi Roudy du 13 juillet 1983 qui a, pour la première fois, imposé aux entreprises de dresser un état des lieux de la parité dans le monde de l’entreprise, via notamment l’obligation d’établir un rapport de situation comparée. L’on peut d’ailleurs regretter que ce rapport ait été supprimé, au cours de la législature, par la loi Rebsamen.
Depuis trente ans, pas moins de huit lois ont proposé des mesures visant à réduire les inégalités entre les femmes et les hommes. Mais les faits sont têtus, et les inégalités demeurent. Soit les mesures proposées dans ces lois ne sont pas efficaces, soit elles ne s’appliquent pas dans l’entreprise et sont donc insuffisamment contraignantes. De fait, lorsque l’on regarde dans le détail l’état d’application des mesures visant à lutter contre les inégalités professionnelles, il apparaît clairement que les mesures prévues par la loi ne sont pas suffisamment appliquées dans les entreprises.
Il en est ainsi de la négociation annuelle obligatoire relative à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. En application de l’article L. 2242-8 du code du travail, toute entreprise de cinquante salariés et plus doit négocier chaque année sur ce thème et être couverte, a minima, par un plan d’action définissant notamment des objectifs précis de suppression des écarts de rémunération. Or 60 % des entreprises assujetties à cette obligation ne sont couvertes ni par un accord ni par un plan d’action. Ce chiffre s’élève même à 69 % pour les entreprises entre 50 et 300 salariés.
Les sanctions, quand elles existent, ne sont que très rarement mises en œuvre : à peine plus d’une centaine d’entreprises ont été sanctionnées financièrement pour manquement à leurs obligations, soit une infime partie des entreprises concernées. Comment, dans ces conditions, peut-on faire progresser les droits des femmes et réduire les inégalités dans les entreprises ? C’est la question à laquelle la présente proposition de loi propose de répondre.
Notre groupe n’a pas souhaité créer de nouveaux dispositifs qui viendraient s’ajouter à l’existant sans qu’on puisse s’assurer que ces dispositifs soient effectivement mis en place. La ligne directrice de ce texte est de faire appliquer les mesures prévues par le code du travail, et de renforcer les droits des femmes salariées lorsque notre droit n’est pas suffisamment protecteur – je pense essentiellement au travail à temps partiel.
À cet égard, permettez-moi de contester la philosophie des amendements de suppression déposés par Mme Marie-Françoise Clergeau et ses collègues, qui nous renvoient aux équilibres trouvés dans les lois ou accords passés. Si ceux-ci sont peu efficaces, comme en témoignent les données recueillies dans mon rapport, voter les amendements de suppression reviendrait à s’arrêter en chemin dans le combat pour l’égalité professionnelle.
J’en viens à la présentation des articles de cette proposition de loi.
Le titre Ier, tout d’abord, vise à inciter les entreprises qui ne respectent pas leurs obligations en matière de dialogue social à bouger. L’article 1er propose ainsi d’inciter les 60 % d’entreprises ne respectant pas leurs obligations de négocier sur les rémunérations et sur l’égalité professionnelle à le faire, en supprimant la réduction de l’allégement sur les cotisations patronales. Je présenterai un amendement qui permettra de prendre en compte la situation des entreprises qui disposent d’un plan d’action et ne sont, à ce titre, pas concernées. Quant à l’article 2, il vise à faire réagir les entreprises qui ne renseignent pas la base de données économiques et sociales avec les indicateurs relatifs à la situation comparée entre les femmes et les hommes.
Le titre II, ensuite, est le cœur de la proposition de loi, puisqu’il s’attaque à la problématique du temps partiel. Soyons clairs : le temps partiel est un aménagement du temps de travail contraire à l’égalité professionnelle. N’oublions pas que temps partiel signifie salaire partiel et retraite partielle. Il faut donc absolument encadrer le recours à ce mode de gestion du temps de travail, qui est devenu habituel dans certains secteurs comme la grande distribution ou les entreprises de propreté. Les efforts réalisés au début de la législature pour encadrer le travail à temps partiel, grâce à l’instauration d’une durée minimale hebdomadaire de 24 heures, ont été malmenés à cause des très nombreuses dérogations accordées. Résultat, aujourd’hui, les 24 heures ne sont absolument pas devenues la norme dans les entreprises ; elles constituent plutôt l’exception dans certains secteurs, qui n’ont pas hésité à négocier des accords prévoyant une durée minimale de travail bien inférieure à 24 heures, parfois seulement deux ou trois heures dans certaines branches.
Les dérogations accordées par le législateur sont contestables, car non seulement elles ont vidé de sens la durée minimale de 24 heures, mais elles ont aussi permis de limiter au minimum la rémunération des travailleurs à temps partiel, en accordant des majorations de rémunération bien inférieures à celles qui prévalent pour les salariés à temps complet. Les articles 3 à 6 de la proposition de loi ont donc vocation à freiner les recours abusifs au travail à temps partiel, en pénalisant les entreprises qui y ont massivement recours, et en accordant une juste rémunération pour les salariés qui n’ont d’autre choix que d’accepter les contrats à temps partiel avec un faible quota d’heures hebdomadaires.
Ainsi, l’article 3 pénalise financièrement les entreprises qui ont recours de manière habituelle au travail à temps partiel, en diminuant de 20 % la réduction sur les cotisations patronales dès lors que l’effectif moyen par catégorie d’emploi compte en moyenne, sur une année civile, plus de 15 % de salariés à temps partiel. L’article 4 propose de majorer la rémunération de chaque heure travaillée lorsque la durée de travail à temps partiel hebdomadaire prévue par le contrat de travail est inférieure à 24 heures. Pour faire suite aux auditions, je présenterai un amendement visant à simplifier le calcul de la majoration, en limitant la mesure à deux taux : un taux de 25 % quand la durée de travail est comprise entre 15 et 24 heures ; un taux de 50 % pour une durée de travail inférieure ou égale à 15 heures par semaine. L’article 5 majore la rémunération des heures complémentaires, c’est-à-dire les heures effectuées en plus de celles prévues par le contrat de travail. L’article 6, enfin, propose de majorer la rémunération des heures effectuées dans le cadre d’un complément d’heures prévu par avenant. Je vous proposerai un amendement pour harmoniser toutes les majorations.
Je proposerai également un article additionnel après l’article 6, visant à rétablir le délai de sept jours de prévenance. Tous les syndicats et associations féministes entendus ont insisté sur ce besoin.
Le titre III propose ensuite de mieux répartir les congés autour de la naissance, qui sont aujourd’hui très inégalement répartis entre le père et la mère. En France, seuls 4 % des parents qui prennent un congé parental sont des hommes, soit l’un des taux les plus bas de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). L’Observatoire français des conjonctures économiques (OFCE) a par ailleurs proposé de contraindre les pères à prendre leur congé de paternité.
L’article 7 propose d’allonger de deux semaines la durée de congé de maternité, afin de mettre notre droit en conformité avec les recommandations de l’Organisation internationale du travail (OIT). L’article 8 propose d’allonger la durée du congé de paternité à quatre semaines consécutives, contre seulement onze jours aujourd’hui.
Enfin, le titre IV propose de s’attaquer à la problématique des discriminations, en se concentrant sur les discriminations à l’embauche.
Régulièrement, le Défenseur des droits nous rappelle que les discriminations à l’embauche, quel qu’en soit le motif, sont une plaie pour les demandeurs d’emplois, mais aussi pour les entreprises qui se privent ainsi de talent. Les études du Défenseur des droits montrent aussi que la grande majorité des personnes s’estimant victimes de discrimination n’osent pas entreprendre de démarches pour la faire reconnaître, souvent faute de connaître leurs droits. L’article 9 propose donc de renforcer la connaissance des discriminations, en demandant aux entreprises d’inscrire dans le registre unique du personnel les coordonnées personnelles des personnes candidates à un emploi. Il propose de renforcer la connaissance des voies de recours contre les discriminations en obligeant les employeurs à remettre, au cours de l’entretien d’embauche, une fiche rappelant le droit à la non-discrimination et listant les personnes auxquelles les personnes victimes de discrimination peuvent faire appel.
Cette proposition de loi vise à une plus grande efficacité de la lutte pour l’égalité professionnelle. C’est pourquoi, afin de permettre un véritable débat sur toutes ces mesures, j’émettrai un avis défavorable aux amendements de suppression proposés par nos collègues.
Mme Marie-Françoise Clergeau. L’égalité entre les femmes et les hommes est une politique qui a progressé depuis plusieurs dizaines d’années en France. Les formations de gauche ont largement joué un rôle moteur dans chaque avancée en faveur d’une égalité, non seulement de principe, mais de réalité. Depuis 2012, plusieurs lois ont ainsi intégré l’objectif d’égalité et ont prévu des sanctions en cas de manquement. Ces lois furent adoptées à l’initiative du Gouvernement ou des parlementaires, et souvent sous l’aiguillon bien utile de la délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes de notre assemblée. Elles le furent aussi grâce à la combativité et à la présence active des femmes élues.
Notre collègue Marie-George Buffet souhaite « agir concrètement en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ». Or, je l’ai dit, il y a eu des avancées sur l’égalité professionnelle entre femmes et hommes depuis 2012, et des avancées concrètes, même si l’arsenal répressif qui y est attaché peut lui sembler trop doux.
Notons aussi, au passage, qu’à un mois de la fin de la législature, la discussion en première lecture d’une proposition de loi permet, ne serait-ce que par le jeu de la navette entre les assemblées, de douter sérieusement de son caractère concret, même si les intentions en sont tout à fait louables et sincères. C’est pourquoi, tout au long de l’examen de ce texte, le groupe Socialiste, écologiste et républicain (SER) prônera la responsabilité et la cohérence avec ses travaux lors de cette législature.
Ainsi, nous rejetterons les articles 1 à 6 et l’article 9 qui remettent en cause les équilibres récemment trouvés, soit par les partenaires sociaux dans le cadre des accords nationaux interprofessionnels, soit par le législateur dans le cadre de dispositions législatives récemment adoptées.
Pour ce qui est de l’article 1er, il introduit une obligation de résultats sur la négociation annuelle obligatoire relative à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail. Or le principe même de négociation est incompatible avec l’idée d’obligation de résultats. La négociation ne peut aboutir qu’à deux hypothèses : soit un accord est conclu entre les parties, soit aucun accord n’est conclu et un procès-verbal de désaccord est établi.
L’article 2 propose une pénalité à l’encontre des entreprises de cinquante salariés et plus qui ne transmettent pas d’informations permettant d’apprécier la situation comparée des femmes et des hommes dans l’entreprise ; or une telle pénalité existe déjà.
Les articles 3, 4, 5 et 6 remettent en cause les équilibres conclus par les organisations syndicales et patronales et encadrés et améliorés par le législateur, ou adoptés par lui.
Quant à l’article 9, le groupe de travail, lancé à l’automne 2014, sur la lutte contre les discriminations dans le monde du travail a émis, dans son rapport remis en mai 2015, de fortes réserves concernant la proposition d’instauration d’un registre d’embauche. Il préconise plutôt de poursuivre la réflexion avant toute mise en œuvre, « si on veut déboucher sur des mesures crédibles, car opérationnelles ». Ce même article 9 crée une obligation de notification des droits garantis dans le code du travail en matière de lutte contre les discriminations. Or cette obligation existe par l’article L. 1142-6 du code du travail, qui dispose que, dans les lieux de travail ainsi que dans les locaux ou à la porte des locaux où se fait l’embauche, les candidats sont informés, par tout moyen, des dispositions pénales existant en matière de discrimination.
Toutefois, toujours dans un souci de cohérence, nous adopterons l’article 7 étendant le congé maternité. Il anticipe des dispositions européennes à venir ; il s’inscrit dans un mouvement d’amélioration de la protection des femmes enceintes, dans la continuité, notamment, de la loi travail qui a porté de quatre à dix semaines la période de protection contre le licenciement.
Enfin, concernant l’article 8, l’allongement du congé de paternité, devenu, grâce à notre majorité en 2012, « congé de paternité et d’accueil de l’enfant », nous paraît opportun. Mais cet allongement doit rester réaliste et raisonnable au regard des dépenses qu’il engendre. C’est pourquoi nous nous abstiendrons pour le vote en commission et proposerons, en séance publique, un amendement cohérent avec ce que nous proposions dans une précédente proposition de loi en 2010, soit un allongement de trois jours, portant ce congé de onze à quatorze jours et de dix-huit à vingt et un jours en cas de naissances multiples. Notons également que les trois jours de naissance s’ajoutent à ce congé.
Vous l’avez compris, le groupe SER ne pourra pas voter en l’état ce texte.
Mme Isabelle Le Callennec. Malgré une surproduction législative – Mme la rapporteure a dénombré huit lois –, force est de constater la réalité : un écart de salaire net moyen entre les femmes et les hommes de 19 %, dont 10 % non expliqués ; davantage de femmes que d’hommes au chômage ; 80 % des emplois à temps partiel occupés par des femmes. L’on ne peut donc que souscrire à l’objectif de la proposition de loi qui prétend en finir avec les inégalités professionnelles. Pour autant, l’on ne peut vous suivre sur des mesures qui auraient pour conséquence d’alourdir encore un peu plus les charges qui pèsent sur les entreprises et donc, à terme, de créer du chômage.
Notre groupe a toujours soutenu activement l’égalité professionnelle et n’est pas contre le principe de sanctions. C’est bien dans la loi Woerth de 2010 qu’a été voté le principe de 1 % de la masse salariale applicable aux entreprises de plus de cinquante salariés non couvertes par un accord ou un plan d’action relatif à l’égalité professionnelle. Plutôt que d’alourdir les pénalités, veillons déjà à appliquer la loi. Le 14 décembre dernier, la Direction générale du travail (DGT) a confirmé que les entreprises se mettaient majoritairement en règle après une mise en demeure. D’après le ministère en charge des droits des femmes, en août 2016, 85 % des entreprises de plus de mille salariés sont couvertes par un accord. Il est juste de rappeler que c’est moins dans les entreprises de moins de mille salariés : 70 % entre 50 et 300 salariés. Pas moins de 2 270 mises en demeure ont été prononcées depuis 2013 et 107 pénalités ont été appliquées. D’où la nécessité de continuer à sensibiliser et à inciter au respect de la loi, par le dialogue social, au plus près de l’entreprise.
Nous vous rejoignons sur l’idée de lutter contre le temps partiel subi, mais reconnaissez que le travail partiel choisi existe aussi. Notre groupe n’a pas voté la mise en place du plancher de 24 heures dont les multiples dérogations, que vous avez évoquées, illustrent les difficultés d’application pour certains métiers. Lors de son audition, la DGT a clairement affirmé que la majorité des branches ayant négocié avaient fait des 24 heures le principe, et de la dérogation l’exception. Dont acte. Mais j’entends, madame la rapporteure, que vous ne partagez pas forcément cette analyse.
Quant au rapport de situation comparée, il a été fondu dans la base de données unique, censée s’appliquer aux entreprises de plus de cinquante salariés. Si la base de données donne la visibilité nécessaire sur l’évolution de la politique d’égalité entre hommes et femmes dans l’entreprise, qui sert de base à la négociation collective, c’est satisfaisant. Si elle n’est pas renseignée ou pas communiquée annuellement, il convient, en effet, de maintenir les sanctions.
Sur la parentalité, nous pouvons tout à fait débattre de l’idée d’allonger la durée du congé de maternité et du congé de paternité. À titre personnel, j’y suis favorable. Pour mémoire, en Europe, les situations sont très disparates : cinquante-deux semaines à 40 % du salaire au Royaume-Uni, seize semaines à 60 % du salaire en France environ, quatorze semaines à 100 % du salaire en Allemagne. Mais, pour débattre, il faudrait disposer de toutes les données. L’allongement que vous proposez a un coût. Il n’est pas chiffré et vous ne dites pas par qui et comment il serait financé. Les indemnités journalières sont prises en charge par la branche maladie de la sécurité sociale. Comment couvrirez-vous ces dépenses nouvelles ?
Enfin, l’on ne peut qu’être perplexe devant l’article 10, qui crée un « registre d’embauche » au sein du registre unique du personnel. Je n’en comprends pas l’objectif. Et la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) estime que les données personnelles ne doivent être a priori conservées que pendant le temps de présence dans l’entreprise. Quel est l’intérêt de les conserver davantage ?
En conclusion, le groupe Les Républicains partage l’intention d’une égalité professionnelle réelle entre les femmes et les hommes, et l’on voit bien qu’il y a encore beaucoup de chemin à faire. Mais nous doutons de l’efficacité des mesures qui sont proposées. Nous pensons qu’il convient d’explorer aussi d’autres pistes : formations conciliables avec le mode de vie et les contraintes des femmes, développement du télétravail, mais aussi lutte contre le travail partiel subi.
M. Francis Vercamer. Agir pour l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est un combat permanent pour ceux qui luttent contre les discriminations, qu’elles se fondent sur l’origine, le sexe, la situation de famille ou encore la grossesse, et qui sont condamnées et dans le code pénal et dans le code du travail. Ces articles sont anciens et les lois sont nombreuses pour essayer de lutter contre l’inégalité professionnelle. Malheureusement, cette inégalité a la vie dure. Même s’il s’agit de principes constitutifs de notre république, il faut constater que les entreprises, et la société elle-même, n’avancent sur ce sujet qu’à vitesse très réduite. Des rappels, des règlements et des lois, peuvent donc être nécessaires pour atteindre ce principe d’égalité consacré par les lois constitutives de la république.
Gestion des carrières, temps de travail, rémunération, mais aussi discrimination à l’embauche : les motifs d’insatisfaction dans le milieu professionnel sont nombreux. Les femmes sont surreprésentées dans certaines professions puisque 47 % des femmes se concentrent sur une douzaine de métiers. Au contraire, elles sont quasiment absentes de certains autres.
Je suis celui qui avait réussi à faire passer le CV anonyme dans la loi. Il permettait de choisir les salariés en fonction de leur compétence et de leur expérience, non en fonction de leur origine, de leur sexe ou de leur famille. Malheureusement, François Rebsamen a supprimé ce dispositif pendant la législature, au cours de laquelle nous aurons donc ainsi reculé un peu dans la lutte contre les discriminations. Il faut ajouter les attitudes sexistes dans les entreprises au nombre des difficultés qu’y connaissent les femmes.
Les chiffres soulignent que l’égalité professionnelle est une question toujours légitime. Pourtant, malgré des intentions louables, il faut reconnaître que certaines mesures de cette proposition de loi ne semblent pas opportunes. Les dispositions relatives au recrutement apparaissent davantage comme des mesures d’affichage, dans la mesure où notre arsenal législatif permet déjà de condamner les recruteurs, si jamais ils se livraient à des pratiques discriminatoires. Le code pénal contient aussi des possibilités de sanction.
Il ne semble pas non plus opportun de créer de nouvelles obligations pour l’ensemble des entreprises ; il conviendrait plutôt, sur ce sujet, d’encourager les bonnes pratiques et la publication des statistiques en matière de recrutement – ou d’éviter que la discrimination puisse se développer, comme j’avais essayé de le faire à travers le CV anonyme.
S’agissant des mesures relatives au temps partiel, les députés du groupe UDI restent très prudents. Face à la crise économique que connaît encore notre pays et au chômage de masse, il serait davantage utile de développer la flexibilité du travail plutôt que de multiplier les mesures restrictives à l’embauche.
Si nous partageons la volonté de réduire le recours excessif au temps partiel et de lutter contre le temps partiel subi, nous estimons également que cet objectif ne doit pas, une nouvelle fois, mettre en danger l’équilibre d’entreprises, de secteurs d’activité et de branches professionnelles qui ont besoin du temps partiel. Vous avez d’ailleurs remarqué que des accords ont été trouvés en leur sein.
Ces remarques formulées, nous estimons toutefois que les dispositions relatives à la parentalité et à l’allongement du congé maternité sont intéressantes et nécessiteraient un débat. Je suis heureux que le groupe socialiste ait décidé de maintenir ces articles, ce qui nous permettra de le tenir effectivement, en commission ou en séance.
Le droit en la matière n’est pas figé, comme en témoigne la prolongation de la période légale d’interdiction de rupture du contrat de travail à l’initiative de l’employeur pour les femmes à l’issue de leurs congés liés à la grossesse et à la maternité. Cette mesure fut soutenue par le groupe UDI et inscrite dans la loi relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.
Mme Dominique Orliac. La problématique de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes n’est pas nouvelle. La loi pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes, votée par notre majorité, a renforcé l’arsenal législatif, mais le parti radical de gauche estime que des mesures plus coercitives doivent être prises afin d’arriver à la plus parfaite égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes.
À nos yeux, cette égalité professionnelle et salariale est un véritable impératif. Les dispositifs de sanction financière à l’encontre des discriminations salariales doivent être étendus à toutes les entreprises. Ainsi, cette proposition de loi, qui formule des mesures très concrètes en faveur de l’égalité salariale entre les femmes et les hommes, nous semble très intéressante.
D’après l’Observatoire des inégalités, le salaire mensuel net moyen des hommes, pour un poste à temps plein, était d’environ 2 410 euros en 2014, alors que celui des femmes s’approchait péniblement de 1 962 euros. L’Observatoire pointe, à juste titre, que l’écart ainsi constaté de 448 euros représente presque un demi-SMIC. Toujours selon lui, les femmes recevaient en 2014, en moyenne et en équivalent temps plein, un salaire inférieur d’environ 20 % à celui des hommes, selon les diverses méthodologies employées pour le calcul. L’on peut donc estimer qu’il y a une énorme inégalité professionnelle et qu’il faut absolument arriver à résoudre enfin le problème.
Mais les inégalités de salaire ne s’arrêtent pas là. L’on pourrait penser que, plus le salaire est important, plus l’écart se resserre : il n’en est absolument rien. Cette différence est notamment due au fait que les femmes sont beaucoup moins nombreuses en haut de l’échelle salariale, et donc savent beaucoup moins se défendre et faire entendre et valoir leurs droits.
De plus, la proposition de loi souligne très justement, dans son exposé des motifs, la réalité qu’aujourd’hui les entreprises ont souvent recours au temps partiel. Pour les radicaux de gauche, l’activité à temps partiel, quand elle est subie par les femmes, doit être évitée par des incitations à d’autres nouvelles façons de travailler, comme le télétravail et le travail à domicile, tant auprès des entreprises qu’auprès des administrations.
L’article 7 propose d’étendre le congé de maternité à dix-huit semaines, en citant les recommandations de l’OIT et de la Confédération européenne des syndicats. Cet article s’inscrit bien dans l’idée que les radicaux de gauche avaient portée dans le cadre de l’ordre du jour réservé à leur groupe, il y a tout juste un an, lors de la discussion sur le projet de loi relatif au travail. Il portait sur des mesures législatives destinées à mieux protéger les femmes à l’issue de leur congé maternité, en prolongeant la période légale pendant laquelle elles ne pouvaient être licenciées. Cette proposition de loi avait été adoptée à l’unanimité. Elle protégeait aussi, pour le même temps, les hommes, ce qui représentait une avancée importante dans ce domaine. La discussion avait d’ailleurs été assez dure pour faire comprendre que l’égalité entre hommes et femmes s’entendait ainsi de manière réciproque.
Quant au partage de la parentalité, nous sommes totalement ouverts sur la question, et bien évidemment d’accord avec la proposition de nos collègues du groupe de la gauche démocratique et républicaine, qui vise à allonger, à l’article 8, le congé de paternité de onze jours à vingt-huit jours, voire à quarante-deux jours en cas de naissances multiples.
Enfin, nous saluons l’esprit de l’article 9, visant à instaurer un registre d’embauche et imposant à l’employeur de remettre à chaque candidat une notification des droits.
Le groupe des radicaux de gauche attend de voir la tournure que vont prendre nos débats en commission. D’ores et déjà, je regrette les amendements de suppression portés par nos collègues du groupe SER. Notre groupe apporte son soutien de principe à ce texte qui est, certes, coercitif, mais franchement bienvenu, tant les disparités n’arrivent pas à être réglées dans notre pays, et ce malgré bientôt quarante ans de lois sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Mme la rapporteure. Nous sommes tous d’accord sur le constat que beaucoup de lois relatives à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes se sont succédé, sous la droite comme sous la gauche. Mais les faits sont toujours là. Ces lois n’ont pas trouvé leur pleine efficacité.
Sur le temps partiel, la loi a, par ailleurs, peu fait. Certes, elle a posé le principe d’un plancher de 24 heures, mais cette notion est malmenée par les accords de branche. Il n’en reste, pour ainsi dire, rien. Or ce sujet est au cœur de l’inégalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Enfin, il ne s’agit pas d’alourdir, par les dispositions proposées, les charges qui pèsent sur les entreprises. Au contraire, il s’agit d’user plus de l’incitation que de la sanction. Les réductions de cotisations sociales dont les entreprises bénéficient sont des appels à faire des pas en avant. Si elles n’en font pas, pourquoi ces réductions leur seraient-elles maintenues ? Selon les chiffres dont je dispose, seulement 2 000 mises en demeure ont été prononcées pour 37 000 entreprises assujetties aux obligations de respect de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. C’est très peu.
Madame Clergeau, vous dites que le texte n’aura pas le temps de faire la navette entre les deux chambres parce que nous sommes en fin de législature. Mais cela est vrai aussi des textes que vous présenterez lors de la séance consacrée à l’ordre du jour réservé à votre propre groupe, qui se tiendra encore après la nôtre. Il s’agit aussi de mettre le débat dans l’actualité. Il faut se donner les moyens de faire progresser la loi dans une future mandature, d’aller plus loin dans ce domaine.
TITRE PREMIER
RENDRE EFFECTIVE L’ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES
La Commission adopte l’amendement de coordination AS12 de la rapporteure.
*
* *
Article premier
(Art. L. 241-13 du code de la sécurité sociale)
Suppression des allégements de cotisations patronales en cas d’absence d’accord d’entreprise portant sur la rémunération ou sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Cet article vise à supprimer la réduction générale de cotisations patronales lorsque l’entreprise n’est pas couverte par un accord sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise, ou par un accord sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.
I. L’ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES, UNE PROBLÉMATIQUE TROP SOUVENT NÉGLIGÉE DANS LES ENTREPRISES EN DÉPIT DES OBLIGATIONS DE NÉGOCIATION
1. L’égalité professionnelle, une thématique en principe incontournable des négociations obligatoires en entreprise
La loi n° 83-635 du 13 juillet 1983, dite « loi Roudy », a posé l’un des premiers jalons de la longue lutte contre les inégalités professionnelles entre les femmes et les hommes, en incitant les entreprises à négocier des « plans d’égalité » avec les partenaires sociaux, assortis d’une aide financière de l’État, en contrepartie de l’instauration du rapport de situation comparée.
Cette incitation s’étant révélée inefficace, le législateur l’a progressivement remplacée par des négociations obligatoires. Au premier chef, la loi n° 2001-397 du 9 mai 2001 relative à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, dite « loi Génisson », a proposé de « développer le dialogue social sur le thème de l’égalité professionnelle », en créant une obligation de négocier sur l’égalité professionnelle, au niveau de l’entreprise comme au niveau des branches, qui s’est ajoutée aux autres obligations de négocier prévues par le code du travail.
Toutefois, seules les entreprises plus de cinquante salariés sont tenues d’engager ces négociations. Si elles n’ont pas l’obligation d’être couvertes par un accord collectif ou un plan d’action, les entreprises de moins de cinquante salariés sont néanmoins tenues de « prendre en compte les objectifs en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l’entreprise et les mesures permettant de les atteindre ».
Plus récemment, la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi a regroupé les différentes obligations de négocier en entreprise en trois négociations annuelles obligatoires, mentionnées à l’article L. 2242-1 du code du travail. Il s’agit :
– de la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise (L. 2242-5 du code du travail) ;
– de la négociation relative à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail (L. 2242-8 du même code) ;
– de la négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels (L. 2242-13 du même code).
La périodicité des négociations obligatoires en entreprise est annuelle pour les deux premières négociations, et triennale pour la négociation relative à la gestion des emplois.
Cependant, en vertu de l’article L. 2242-20 du code du travail, dans les entreprises satisfaisant à l’obligation d’accord relatif à l’égalité professionnelle ou, à défaut, de plan d’action sur l’égalité professionnelle, un accord d’entreprise peut modifier la périodicité de chacune des négociations, dans la limite de trois ans pour les négociations annuelles et de cinq ans pour la négociation triennale.
Si la négociation relative à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail porte, de toute évidence, directement sur les problématiques d’égalité professionnelle, dans chacune des deux autres négociations, la problématique de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes doit également être prise en compte (cf. encadré ci-après).
● La négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise (articles L. 2242-5 à L. 2242-7 du code du travail)
Aux termes de l’article L. 2242-5 du code du travail, cette négociation doit permettre d’aborder : les salaires effectifs, la durée effective et l’organisation du temps de travail – et notamment la mise en place du temps partiel, l’intéressement, la participation et l’épargne salariale, et le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes. Parmi ces domaines, les entreprises de plus de trois cents salariés ont l’obligation d’en choisir quatre ; celles de moins de trois cents salariés doivent en sélectionner trois. Dans tous les cas, la rémunération doit faire partie des thèmes retenus.
● La négociation relative à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail (articles L. 2242-8 à L. 2242-12 du même code)
Selon l’article L. 2242-8, cette négociation doit aborder :
– les questions d’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle des salariés (1°) ;
– les objectifs et mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, « notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d’accès à l’emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d’emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois » (2°) ;
– les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle (3°) ;
– ainsi que les modalités d’exercice, par le salarié, de son droit à la déconnexion, et la mise en place par l’entreprise de dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques, en vue d’assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale (7°).
Les autres thématiques abordées au sein de cette négociation (mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés, modalités de définition d’un régime de prévoyance et exercice du droit d’expression directe et collective des salariés) peuvent également être l’occasion d’aborder les thématiques d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
● La négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels (articles L. 2242-13 à L. 2242-19 du même code)
Cette négociation triennale obligatoire doit notamment porter sur la mise en place d’un dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, sur les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne, sur les perspectives de recours par l’employeur aux différents contrats de travail, et notamment au travail à temps partiel : autant de thématiques susceptibles d’être abordées du point de vue de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
• Une obligation de négocier, mais pas d’obligation de résultat
L’engagement de chacune de ces négociations est obligatoire ; en revanche, la conclusion d’un accord ne l’est pas.
S’agissant de la négociation relative à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail, plusieurs dispositifs tentent de pallier l’absence d’accord.
Ainsi, à défaut d’accord sur les objectifs et les mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, l’employeur a l’obligation d’établir un « plan d’action » destiné à assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes – c’est-à-dire les mesures qu’il entend appliquer unilatéralement. Ces mesures, ainsi que les propositions respectives des parties, doivent être inscrites dans un procès-verbal de désaccord, comme en dispose l’article L. 2242-4 du code du travail. Le plan d’action doit fixer des objectifs de progression, des actions permettant d’atteindre ces objectifs, ainsi que des indicateurs chiffrés pour les suivre dans plusieurs domaines d’action. Une synthèse de ce plan doit être portée à la connaissance des salariés.
De même, en l’absence d’accord sur l’utilisation des outils numériques et le droit à la déconnexion, l’employeur est tenu d’élaborer une charte définissant les modalités d’exercice de ce droit, et prévoyant la mise en œuvre d’actions de formation et de sensibilisation à un usage raisonnable des outils numériques.
Or, force est de constater que les dispositifs existants n’incitent pas suffisamment les entreprises à mettre en place par voie de négociation collective des mesures concrètes en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
2. Le taux de couverture conventionnelle des entreprises en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est encore faible
Selon les représentants de la Direction générale du travail (DGT) (9) du ministère du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, au 15 août 2016, le taux de couverture conventionnelle des entreprises assujetties à l’obligation de négocier sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes – c’est-à-dire les entreprises de plus de 50 salariés – était de 40 % (contre 37 % en 2015).
Ce taux de couverture, très inférieur à ce que l’on pourrait attendre compte tenu du caractère impératif de l’obligation de négocier prévue par la loi, cache d’importantes disparités en fonction de la taille des entreprises. En effet, 91 % des entreprises de plus de 1 000 salariés sont couvertes, contre seulement deux tiers (67 %) des entreprises de 300 à 1 000 salariés, et à peine plus d’un tiers des entreprises dont l’effectif est compris entre 50 et 299 salariés.
Au total, sur l’ensemble des thèmes abordés par les accords d’entreprise, l’égalité professionnelle en tant que telle n’en représente qu’une faible proportion : seuls 12 % de l’ensemble des accords abordent cette question, contre 38 % des accords abordant la question des salaires et des primes, 24 % s’agissant du temps de travail, ou 19 % s’agissant de la participation, de l’intéressement et de l’épargne salariale.
THÈMES DE NÉGOCIATION EN 2015 PARMI LES ACCORDS SIGNÉS PAR DES DÉLÉGUÉS SYNDICAUX OU SALARIÉS MANDATÉS
Thèmes abordés dans les accords signés par des syndicats |
Nombre d’accords |
% de textes abordant chaque thème (*) |
Salaires et primes |
11 853 |
38 % |
Temps de travail |
7 424 |
24 % |
Emploi |
3 348 |
11 % |
Égalité professionnelle |
3 788 |
12 % |
Prévoyance collective, complémentaire santé, retraite supplémentaire |
2 554 |
8 % |
Droit syndical, institutions représentatives du personnel, expression des salariés |
2 806 |
9 % |
Conditions de travail |
833 |
3 % |
Formation professionnelle |
447 |
1 % |
Classification |
416 |
1 % |
Participation, intéressement, épargne salariale |
5 886 |
19 % |
Total des accords |
31 449 |
(*) Le tableau recense la fréquence des différents thèmes, sachant qu’un texte peut en aborder plusieurs. Le total des thèmes est donc nécessairement supérieur à 100 %.
Source : Direction générale du travail (DGT), Bilan de la négociation collective pour l’année 2015.
Selon Mme Bénédicte Ravache, secrétaire générale de l’Association nationale des directeurs.trices de ressources humaines (ANDRH) (10), entendue dans le cadre de la même audition par la délégation aux droits des femmes de l’Assemblée nationale, cette insuffisante couverture des entreprises peut s’expliquer par le regroupement des thèmes de négociations opéré par la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi. Elle estime dès lors qu’ « il est important de sensibiliser les organisations syndicales au fait que l’égalité professionnelle est un sujet aussi important que les autres : quand plusieurs thèmes sont sur la table des négociations, il faut s’assurer que ce sujet ait l’importance qu’il mérite ».
3. Un régime de sanctions insuffisamment dissuasif ?
Un régime de sanctions existe déjà à l’encontre des entreprises qui ne respectent pas leurs obligations : ainsi, pour les entreprises de plus de 50 salariés, l’absence d’accord relatif à l’égalité professionnelle ou de plan d’action unilatéral de l’employeur portant sur le même thème et comportant des objectifs et des indicateurs chiffrés intégrant obligatoirement la question des inégalités de rémunération, est sanctionnée par une pénalité financière pouvant aller jusqu’à 1 % de la masse salariale (article L. 2242-9 du code du travail).
La loi n° 2014-873 du 14 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes a ajouté à cette sanction l’interdiction de se porter candidat à un marché public ou à une convention de partenariat public-privé pour les entreprises ne remplissant pas leurs obligations.
Au 15 août 2016, plus de 2 000 mises en demeure ont été adressées à des entreprises sur le fondement de ces dispositions. L’on peut souligner que le nombre de mises en demeure prononcé semble encore faible compte tenu du nombre d’entreprises qui ne sont pas couvertes par un accord ou par un plan d’action unilatéral (60 %). Cependant, elles s’inscrivent dans un cadre plus général, encouragé par la DGT, d’accompagnement des entreprises par les directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) : 80 % des mises en demeure concernent en effet des entreprises de moins de 300 salariés. Selon la DGT (11), dans les six mois qui suivent une mise en demeure, 60 % des entreprises se mettent en conformité
– c’est-à-dire qu’elles concluent un accord ou, à défaut, élaborent un plan d’action sur l’égalité professionnelle.
Lorsque ce n’est pas le cas, des pénalités financières sont appliquées : au 15 août 2016, plus d’une centaine de sanctions ont d’ores et déjà été prononcées par les DIRECCTE. Dans 90 % des cas, les sanctions concernent des entreprises qui n’avaient signé aucun accord, ni présenté aucun plan d’action. Les autres sanctions visent des accords ou des plans qui ne sont pas conformes à la loi. Selon la DGT (12), près de la moitié des entreprises se mettent en conformité avec leurs obligations conventionnelles suite à l’application de pénalités financières.
Pour reprendre les propos de M. Régis Bac, chef du service des relations et des conditions de travail de la direction générale du travail (DGT), les pénalités ne sont donc pas qu’une menace : « l’accompagnement et, en dernier ressort, la sanction, peuvent servir de corde de rappel, pour [inciter les entreprises] à se mettre en conformité ».
II. PROMOUVOIR UNE OBLIGATION DE RÉSULTAT EN MATIÈRE DE DIALOGUE SOCIAL DANS L’ENTREPRISE
Cet article propose donc de renforcer le régime de sanctions applicables à l’encontre des entreprises qui ne remplissent pas leurs obligations, en instaurant une obligation de résultat en matière de négociations sur l’égalité professionnelle et sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
L’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale prévoit que plusieurs cotisations à la charge de l’employeur – notamment les cotisations dues au titre des assurances sociales et des allocations familiales ainsi que les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles assises sur les gains et rémunérations inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 60 % –, peuvent faire l’objet une réduction dégressive, dont le montant est calculé par voie réglementaire.
Cet article propose le rétablissement d’un VII à l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, qui vise à supprimer la réduction lorsque l’employeur, au cours d’une année civile considérée, n’a conclu aucun accord portant :
– soit sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée (article L. 2242-5 du code du travail) ;
– soit sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail (article L. 2242-8 du même code).
Cette mesure va résolument plus loin que les dispositifs de sanction actuels, en proposant de sanctionner non seulement les entreprises qui n’auraient pas engagé les négociations obligatoires, mais aussi – et surtout – celles qui ne sont pas parvenues à un accord. Les employeurs seront dès lors plus incités à négocier avec les organisations syndicales de salariés des mesures favorables aux droits des salariés, afin de conclure un accord.
La rapporteure espère ainsi rendre l’échec des négociations plus dissuasif qu’il ne l’est actuellement, l’absence d’accord se traduisant le plus souvent par un statu quo en matière d’inégalités professionnelles entre les femmes et les hommes.
À défaut d’accord, la pénalité imposée aux entreprises via la suppression de la réduction générale de cotisations patronales aura un effet vertueux pour les comptes sociaux.
*
La Commission est saisie de l’amendement AS1 de Mme Marie-Françoise Clergeau.
Mme Marie-Françoise Clergeau. Par le présent article, vous assortissez d’une obligation de résultat une négociation obligatoire, alors que les deux notions sont incompatibles. La négociation ne peut avoir que deux issues : la conclusion d’un accord ou un désaccord constaté par procès-verbal. L’article va même plus loin en sanctionnant financièrement, non pas l’absence de négociation, mais l’absence de résultat de la négociation. Personne ou presque ne saurait remettre en cause l’existence d’un droit des salariés à la négociation collective depuis 1971, ni l’obligation de négocier depuis 1982. Toutefois, il apparaît tout à fait inopportun de transformer cette dernière en obligation de conclure, car « ne négocie qui ne veut ». Pour cette raison majeure, il est proposé de supprimer cet article.
Mme la rapporteure. Avis défavorable. L’obligation de résultat ne doit pas s’entendre comme une obligation de conclure une négociation. On ne peut pas imposer à des parties de conclure un accord, a fortiori un mauvais accord ; ce serait, en effet, remettre en cause la liberté contractuelle. Mon amendement AS13 suivant clarifie justement ce point, en précisant que la sanction est applicable à défaut d’accord ou de plan d’action relatif à l’égalité professionnelle. L’intention de l’article 1er est bien de sanctionner les entreprises qui n’engagent jamais de négociation sur l’égalité professionnelle, c’est-à-dire 60 % des entreprises de cinquante salariés et plus.
Dans la mesure où notre droit a fait de l’entreprise l’un des acteurs principaux de l’égalité professionnelle, tant qu’il n’y aura pas de dialogue social sur le sujet et surtout d’accord visant à réduire concrètement les écarts salariaux entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise, ces inégalités persisteront. C’est en ce sens que nous fixons une obligation de résultat. C’était d’ailleurs le sens de la loi Ameline de 2006, qui fixait une date butoir à partir de laquelle les entreprises avaient l’obligation de « supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes ».
Sur le choix de la sanction, dont j’ai dit qu’elle est en réalité une incitation, nous ne proposons pas une pénalité financière mais une réduction des exonérations de cotisation.
La Commission adopte l’amendement.
En conséquence, l’article 1er est supprimé, et l’amendement AS13 de Mme Marie-George Buffet tombe.
*
* *
Article 2
(Art. L. 2242-9 du code du travail)
Pénalité en cas de défaut de production des données relatives à la situation comparée entre les femmes et les hommes
Cet article vise à instaurer une pénalité lorsque les employeurs ne renseignent pas, au sein de la base de données économiques et sociales, les informations et indicateurs relatifs à la situation comparée entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise.
1. Les indicateurs de la base de données économiques et sociales relatifs à la situation comparée entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise
En application de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 de sécurisation de l’emploi, l’employeur est tenu de mettre à la disposition du comité d’entreprise
– ou, à défaut, des délégués du personnel – et du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), une base de données économiques et sociales (BDES), qui doit être régulièrement mise à jour. La BDES est obligatoire pour les entreprises d’au moins trois cents salariés depuis le 14 juin 2014, et depuis le 14 juin 2015 pour les entreprises d’au moins cinquante salariés.
Cette base de données, mentionnée à l’article L. 2323-8 du code du travail, comporte par exemple des indicateurs relatifs aux investissements de l’entreprise, à la rémunération des salariés et des dirigeants, ou encore à la sous-traitance.
L’article 18 de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi a introduit, au 1° bis au sein de l’article L. 2323-8, une nouvelle catégorie d’informations relatives à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise qui doivent figurer dans la base de données. Ces informations doivent comporter au minimum :
– un diagnostic et une analyse de la situation respective des femmes et des hommes pour chacune des catégories professionnelles de l’entreprise en matière d’embauche, de formation, de promotion professionnelle, de qualification, de classification, de conditions de travail, de sécurité et de santé au travail, de rémunération effective et d’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle ;
– une analyse des écarts de salaires et de déroulement de carrière en fonction de l’âge, de la qualification et de l’ancienneté ;
– ainsi qu’une évolution des taux de promotion respectifs des femmes et des hommes par métiers dans l’entreprise.
Du rapport de situation comparée à la base de données économiques et sociales
La loi n° 83-635 du 13 juillet 1983 prévoyait la production d’un rapport annuel sur la situation comparée des conditions générales d’emploi et de formation des femmes et des hommes (RSC) dans les entreprises. Ce rapport devrait inciter ces dernières à négocier plus facilement des accords, ou à mettre en place des plans d’égalité professionnelle.
La loi n° 2001-397 du 9 mai 2001, dite « loi Génisson », exigeait que le RSC intègre des indicateurs chiffrés définis par décret et prévoyait une obligation de négocier pour les branches et les entreprises. Ce rapport visait à mesurer les écarts de situation entre les femmes et les hommes, à analyser les causes directes et indirectes de ces écarts, et à recenser les actions menées par le passé et à mener, pour le futur, pour corriger ces écarts.
La loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi a substitué la banque de données économiques et sociales au RSC. Ce dispositif, présenté comme une mesure de simplification, ne fait pourtant pas consensus. La délégation aux droits des femmes de l’Assemblée nationale, dont la rapporteure est membre, considère notamment que la BDES ne permet aucunement d’établir un bilan qualitatif des données renseignées dans la base de données.
2. Le défaut de production de ces indicateurs n’est sanctionné par aucune disposition spécifique
En matière d’égalité professionnelles entre les femmes et les hommes, les manquements des entreprises à leurs obligations législatives sont le plus souvent passibles de sanctions (cf. commentaire de l’article premier).
Pourtant, en l’état du droit, aucune sanction particulière n’est prévue à défaut de fourniture des données prévues au 1° bis de l’article au sein de la base de données. Cette absence de sanction particulière est regrettable, car l’inscription des données relatives à la situation comparée des femmes et des hommes au sein de la BDES est un préliminaire indispensable à l’élaboration d’une politique active de lutte contre les inégalités entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise.
Lorsqu’elle est bien renseignée, la base de données permet en effet d’établir un véritable état des lieux de la situation et des actions déjà mises en place pour réduire, le cas échéant, les inégalités constatées. À l’inverse, lorsque les informations de la base de données sont incomplètes, il n’est pas possible d’établir un diagnostic précis de la situation et, le cas échéant, des inégalités qui existent dans les pratiques de l’entreprise. Une situation qu’a regrettée M. Michel Miné, professeur de droit du travail et membre du Conseil supérieur de l’égalité professionnelle, lors de son audition par la Délégation aux droits des femmes le 7 décembre 2016 : « les négociations s’appuient sur des données partielles, sans un état des lieux complet de la politique salariale, en particulier sur le travail de valeur égale effectué par les femmes et par les hommes. Or, c’est là que viennent se nicher les inégalités et les discriminations – au sens juridique du terme » (13).
3. Le dispositif proposé
Afin que les données relatives à la situation comparée des femmes et des hommes au sein de l’entreprise soient effectivement renseignées au sein de la base de données, conformément au 1° bis de l’article L. 2323-8 du code du travail, le présent article propose de sanctionner les entreprises qui s’exonéreraient de cette obligation, en leur appliquant la pénalité prévue à l’article L. 2242-9 du même code.
Le montant de cette pénalité est fixé au maximum à 1 % des rémunérations et gains au sens du premier alinéa de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime au titre desquelles l’entreprise n’est pas couverte par un accord ou un plan d’action – il conviendrait d’ajouter ici que ces périodes s’entendent également en l’absence d’indicateurs au sein de la base de données.
*
La Commission examine l’amendement AS2 de Mme Marie-Françoise Clergeau.
Mme Marie-Françoise Clergeau. L’article 2 propose de pénaliser les entreprises de plus de quarante-neuf salariés qui ne transmettent pas d’informations permettant d’apprécier la situation comparée des femmes et des hommes dans l’entreprise. Or une telle pénalité existe déjà ; son montant est apprécié par le directeur de la DIRECCTE et peut atteindre jusqu’à 1 % de la masse salariale. Dans le cadre de la loi dite Rebsamen, nous avons renforcé les informations devant être fournies annuellement dans la base de données économiques et sociales. Ces informations sont mises à la disposition du comité d’entreprise ou des délégués du personnel ainsi que du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), et permettent de préparer la consultation annuelle sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.
Par le présent article, vous élargissez le champ de la pénalisation prévue à l’article L. 2242-9 du code du travail aux manquements liés, non pas à la négociation annuelle obligatoire, mais aux obligations d’information de l’employeur vis-à-vis des institutions représentatives du personnel. Or ce défaut de transmission est déjà pénalement sanctionné. Pour ces différentes raisons, nous proposons de supprimer cet article.
Mme la rapporteure. Avis défavorable. Le premier problème dans la mise en œuvre des politiques d’égalité professionnelle est lié à l’identification des inégalités. Dans de nombreuses entreprises, le diagnostic est incomplet. Les négociations démarrent en s’appuyant sur des données partielles. Il s’agit d’un frein à la réalisation de l’égalité professionnelle. Bien souvent, les entreprises raisonnent « toutes choses égales par ailleurs » et excluent des variables de leur diagnostic. Elles ne prennent en compte que les temps pleins, les métiers comparables à ceux effectués par les hommes, excluant les métiers exercés principalement par les femmes, le salaire de base, excluant les primes et les variables. Elles passent alors à côté des causes structurelles des inégalités.
La suppression par la loi Rebsamen du rapport de situation comparée n’a fait qu’aggraver les difficultés liées à l’identification des inégalités. Ce rapport avait le mérite d’être un outil connu et bien identifié par les acteurs de l’entreprise. Des pratiques s’étaient installées. Désormais, les indicateurs sur l’égalité sont dilués dans une base de données unique, ce qui nuit à la réalisation des diagnostics.
Sans revenir sur cette évolution, l’article 2 vise à inciter les employeurs à produire les informations sur l’égalité professionnelle qui sont le support indispensable et préalable à la négociation sur ce thème.
Enfin, vous avez raison, le défaut de transmission par l’employeur des informations destinées aux représentants du personnel est déjà sanctionné pénalement. Toutefois, il ne s’agit pas ici de sanctionner le défaut de transmission, caractéristique d’une entrave, mais le défaut de production de ces données, ce qui n’est pas la même chose.
La Commission adopte l’amendement.
En conséquence, l’article 2 est supprimé, et l’amendement AS11 de Mme Marie-George Buffet tombe.
*
* *
TITRE II
ENCADRER LE TEMPS PARTIEL IMPOSÉ
Le travail à temps partiel est sans doute l’une des modalités d’organisation du travail les plus responsables de la précarisation des femmes – qui occupent 80 % des emplois à temps partiel. Moindre rémunération par rapport à une activité à temps plein, horaires atypiques et souvent non choisis, accès limité à certaines prestations sociales, voire limitation des perspectives professionnelles : tel est trop souvent le lot des salariés à temps partiel.
Alors que la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 de sécurisation de l’emploi avait réalisé une avancée majeure en prévoyant de mieux encadrer le travail à temps partiel, grâce à la fixation d’une durée minimale hebdomadaire de vingt-quatre heures visant à limiter les effets négatifs du temps partiel, depuis, les très nombreuses dérogations consacrées par le législateur ont fortement affaibli le caractère impératif de cette durée minimale.
Les articles du présent titre visent donc à dissuader les entreprises à recourir au temps partiel en proposant, d’une part, de renforcer les sanctions à l’égard des entreprises qui ont recours au temps partiel de manière excessive (article 3) et, d’autre part, d’améliorer la rémunération des heures prévues par le contrat (article 4), des heures complémentaires (article 5) ou des compléments d’heures par avenant (article 6) lorsque la durée de travail hebdomadaire est inférieure à la durée de vingt-quatre heures instaurée par la loi de sécurisation de l’emploi.
*
* *
Article 3
(Art. L. 241-13 du code de la sécurité sociale)
Diminution de la réduction sur les cotisations patronales en cas d’embauche à temps partiel
Cet article vise à pénaliser les entreprises de plus de vingt salariés qui ont recours de manière habituelle au travail à temps partiel.
En l’état actuel du droit, il n’existe aucune restriction particulière au recours au temps partiel : ainsi, toute entreprise est libre de proposer des contrats de travail à temps partiel sans avoir à justifier de motifs particuliers, et le recours systématique au contrat de travail à temps partiel n’est pas répréhensible, à condition toutefois qu’un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord collectif de branche étendu le prévoit (article L. 3123-17 du code du travail). À défaut d’accord, l’employeur peut avoir recours à temps partiel sous réserve d’avoir sollicité l’avis du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, ou sous réserve d’en avoir informé l’inspecteur du travail, en cas d’absence de représentation du personnel dans l’entreprise.
Compte tenu de cette facilité du recours au temps partiel, certaines entreprises imposent de manière systématique à leurs salariés, dès l’embauche, des postes à temps partiel. Or, pour les salariés concernés, souvent contraints d’accepter un emploi à temps partiel faute de mieux, le travail à temps partiel rime souvent avec de maigres rémunérations et des horaires atypiques imposés, a fortiori lorsque la durée hebdomadaire de travail est inférieure à vingt-quatre heures.
Sans revenir sur la possibilité de recourir au temps partiel sans contrainte, le présent article vise à dissuader les entreprises d’y avoir recours lorsque ce type d’organisation du temps de travail n’est pas indispensable. Il crée à cette fin un VII bis à l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, qui vise à diminuer de 20 % la réduction sur les cotisations patronales prévue à cet article (14), dès lors que l’effectif moyen par catégorie d’emploi compte en moyenne, sur une année civile, plus de 15 % de salariés à temps partiel.
*
La Commission est saisie de l’amendement AS3 de Mme Marie-Françoise Clergeau.
Mme Marie-Françoise Clergeau. Dès l’été 2012, la grande conférence sociale a mis en lumière que le temps partiel subi était un facteur de précarisation et une source de contraintes majeures pour les salariés concernés, en particulier pour les femmes qui représentent 80 % des salariés employés à temps partiel. C’est pourquoi les partenaires sociaux ont décidé de formaliser des mesures concrètes dans le cadre de l’accord national interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2013.
L’instauration du seuil minimal de 24 heures hebdomadaires, par la loi de sécurisation de l’emploi adoptée au printemps 2013, permet de lutter contre le temps partiel subi en faisant de l’accord de branche le pivot pour l’organisation du temps partiel. En effet, les modalités d’organisation du travail, notamment lorsque la branche entend déroger à la durée minimale de 24 heures par semaine ou mettre en place le complément d’heures, sont déterminées par les partenaires sociaux.
L’article 12 de la loi de sécurisation de l’emploi est le fruit d’un compromis qui définit un équilibre général sur la prévisibilité de leur emploi pour les salariés à temps partiel. De plus, cet article renvoie à l’équilibre de l’accord collectif, la définition des souplesses et des contreparties. Nous avions constaté, lors de l’évaluation de la loi, que des branches ne négociaient pas. C’est pourquoi, dans la loi sur la formation professionnelle de 2014, nous avons décidé de prolonger le délai pour parvenir à des accords, ce qui a eu des effets notables.
L’instauration du principe de la durée minimale a permis une réforme structurelle de l’organisation du travail à temps partiel : prévisibilité des plannings, organisation des coupures, majoration des heures complémentaires... Or, par l’article 3 de votre texte, vous proposez de remettre en cause le pivot qu’est l’accord de branche pour imposer une sanction fiscale. Outre le fait que vous revenez, une fois encore, sur des dispositions voulues par les organisations patronales et syndicales lors de la signature de l’ANI, vous remettez en cause un équilibre fruit de la négociation. Il ne nous apparaît pas opportun de remettre en cause la philosophie même du dispositif récemment adopté. C’est pourquoi nous vous proposons de supprimer cet article.
Mme la rapporteure. Avis défavorable. Je ne reviens pas sur le poids du temps partiel dans les inégalités professionnelles entre les femmes et les hommes, et sur la précarité des femmes. Depuis trente ans, le temps partiel s’est développé sans qu’aucune loi ne le freine ; au contraire, certaines lois l’ont encouragé.
On sait très bien que le défaut de formation fait que, dans les accords de branche, les questions d’égalité professionnelle ne sont pas traitées au niveau qui convient. Et parfois les rapports de force sont inégaux. On a vu le résultat de la loi sur les 24 heures et des accords de branche : selon les branches, la durée minimale hebdomadaire est « de 8 à 10 heures », « 17 heures », « de 5 à 16 heures », « 3 heures 45 », « 12 heures », « de 2 à 24 heures », « de 7 à 24 heures », de « 5 à 24 heures », « de 5 à 10 heures ». Une infime majorité applique les 24 heures. Si les accords de branche sont à ce point défavorables aux intérêts des femmes et à l’égalité professionnelle, il faut que la loi limite le recours abusif au temps partiel. Sans remettre en cause la négociation collective, la loi peut poser des bornes pour que les femmes, qui représentent 82 % des travailleurs à temps partiel, ne soient pas les premières victimes des accords de branche.
Les syndicats le disent eux-mêmes, ainsi que Mme le professeur Jacqueline Laufer dans son remarquable livre L’Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, pour des raisons de mentalité et de formation, la question de l’égalité professionnelle n’est pas un sujet prioritaire dans les négociations syndicales.
La Commission adopte l’amendement.
En conséquence, l’article 3 est supprimé.
*
* *
Article 4
(Art. L. 3123-7 du code du travail)
Majoration de la rémunération des heures effectuées dans le cadre d’un contrat à temps partiel inférieur à 24 heures hebdomadaires
Cet article vise à lutter contre le caractère précaire des contrats de travail à temps partiel proposant un faible quota d’heures hebdomadaires.
Il propose ainsi de majorer la rémunération des heures effectuées dans le cadre d’un contrat de travail à temps partiel, dès lors que la durée hebdomadaire de travail à temps partiel est fixée à un niveau inférieur au seuil de vingt-quatre heures fixé par la loi du 14 juin 2013 de sécurisation de l’emploi.
I. UNE DURÉE MINIMALE LÉGALE DE TRAVAIL À TEMPS PARTIEL ASSORTIE DE NOMBREUSES DÉROGATIONS
1. La loi du 14 juin 2013 a fixé un socle minimal de vingt-quatre heures de travail hebdomadaire
Afin de mieux encadrer le recours au temps partiel, les partenaires sociaux ont souhaité fixer, dans l’accord national interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2013, une durée minimale hebdomadaire de travail pour les salariés à temps partiel.
La loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 de sécurisation de l’emploi, dont la vocation était de transposer cet ANI dans la loi, a ainsi fixé dans le code du travail un socle minimal de vingt-quatre heures hebdomadaires : jusqu’alors, il n’existait pas d’horaire minimal légal de travail, bien qu’une durée minimale puisse être fixée par convention collective ou par accord de branche.
La loi du 14 juin 2013 a néanmoins prévu plusieurs dérogations à la durée minimale de vingt-quatre heures. Il est ainsi possible de déroger à cette durée :
– lorsqu’une convention ou un accord de branche étendu le prévoit (article L. 3123-19 du code du travail). Un tel accord dérogatoire doit néanmoins apporter impérativement des garanties relatives à la mise en œuvre d’horaires réguliers ou à la possibilité, pour le salarié, de cumuler plusieurs activités lui permettant d’atteindre une durée au moins égale à vingt-quatre heures ou à un temps plein ;
– lorsque le salarié en fait la demande, de manière écrite et motivée, pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles. Cette disposition visait à permettre aux salariés à temps partiel qui le souhaitent de limiter leur temps de travail afin que ce dernier soit compatible avec les contraintes de leur vie personnelle et familiale (article L. 3123-7 du même code) ;
– lorsque le salarié en fait la demande, de manière écrite et motivée, pour cumuler plusieurs activités à temps partiel et ainsi atteindre une durée équivalente à un temps plein ou, a minima, une durée au moins égale au socle minimal de vingt-quatre heures. Il s’agit dans ce cas de ne pas pénaliser les salariés ayant accepté un travail à temps partiel de faible durée et qui souhaiteraient bénéficier d’un complément d’activité et de rémunération (article L. 3123-7 du même code).
De plus, la durée minimale de vingt-quatre heures hebdomadaires n’est pas applicable :
– aux contrats d’une durée inférieure ou égale à sept jours ;
– aux contrats à durée déterminée (CDD) conclus pour le remplacement d’un salarié absent ;
– et aux contrats de travail intérimaire conclus pour le même objet.
2. Les nombreuses dérogations au socle minimal contribuent pourtant à la précarisation des salariés à temps partiel
Alors que ces dérogations avaient été pensées initialement pour protéger les salariés à temps partiel, en leur permettant notamment de ne pas effectuer un nombre d’heures supérieur à leurs souhaits, en pratique, ces dérogations ont surtout pénalisé les salariés en permettant aux entreprises de proposer des emplois à temps partiel de très courte durée, sans compensation salariale, ou avec de faibles niveaux de compensation.
La plupart des secteurs d’activité ont en effet consacré par accord de branche des durées minimales de travail à temps partiel très inférieures au socle fixé par la loi du 14 juin 2013, le minimum recensé étant d’une heure par semaine seulement.
Selon le bilan de la négociation collective pour l’année 2015 élaboré par la Direction générale du travail, sur un total de dix-sept branches professionnelles « recourant structurellement au temps partiel », seules trois branches ont négocié une durée minimale hebdomadaire égale au seuil fixé par la loi (vingt-quatre heures). Une branche a négocié une durée minimale supérieure (vingt-six heures). Dans les autres branches, la durée minimale de travail à temps partiel s’étend de deux heures (gardiens et employés d’immeubles) à dix-sept heures trente par semaine. La situation est encore pire dans les autres branches, celles qui, selon la terminologie de la DGT, ne recourent pas « structurellement » au temps partiel : les contrats de deux heures sont autorisés dans au moins quatre branches (sanitaire, social et médicosocial à but non lucratif ; agences générales d’assurances ; animation ; sociétés et coopératives HLM), et la plupart des branches ont négocié des accords inférieurs à la durée légale de vingt-quatre heures.
DURÉE MINIMALE HEBDOMADAIRE DE TRAVAIL À TEMPS PARTIEL DÉFINIE PAR ACCORD DE BRANCHE (*)
Branches recourant structurellement au temps partiel |
Durée minimale hebdomadaire |
Restauration rapide |
24 heures |
Foyers et services pour jeunes travailleurs |
De 8 à 10 heures |
Établissements d’enseignement privé sous contrat |
17 heures 30 |
Entreprises de propreté |
16 heures |
Cabinets dentaires |
17 heures |
Commerces succursaliste de la chaussure |
21 heures |
Succursalistes de l’habillement |
24 heures, sauf pour certains emplois |
Exploitations cinématographiques |
24 heures |
Sport |
De 2 à 24 heures |
Laboratoires d’analyses médicales |
De 8 à 16 heures |
Cabinets et cliniques vétérinaires |
16 heures (8 heures mensuelles pour certains types de personnels) |
Cabinets médicaux |
De 5 à 16 heures |
Commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire |
26 heures |
Gardiens et employés d’immeubles |
De 2 à 14 heures |
Enseignement privé hors contrat |
De 6 à 12 heures |
Pharmacie d’officine |
De 5 à 16 heures |
Organismes de formation |
De 3 à 15 heures 50 |
Autres branches |
Durée minimale hebdomadaire |
Pôle emploi |
3 heures 45 |
Organisations professionnelles de l’habitat social |
24 heures |
Acteurs du lien social et familial |
De 1 à 24 heures |
Édition |
18 heures 28 |
Sanitaire, social et médical social (à but non lucratif) |
De 2 à 17 heures 30 |
Bijouterie, joaillerie, orfèvrerie |
De 16 à 24 heures |
Agences générales d’assurances |
De 2 à 16 heures |
Hôtellerie de plein air |
De 7 à 24 heures |
Hospitalisation privée |
De 16 à 24 heures |
Répartition pharmaceutique |
24 heures |
Location et maintenance de matériels agricoles |
12 heures |
Praticiens vétérinaires salariés |
11 heures |
Négoce de l’ameublement |
De 16 à 24 heures |
Animation |
De 2 à 24 heures |
Sociétés et coopératives HLM |
De 2 à 24 heures |
Enseignement privé à distance |
24 heures sauf pour les enseignants exerçant des permanences dans les locaux (1 heure) |
Personnel sédentaire des entreprises de navigation |
De 10 à 17 heures 50 |
Immobilier |
De 8 à 24 heures |
Services de l’automobile |
De 12 heures 30 à 24 heures |
Articles de sports et loisirs |
De 7 à 24 heures |
Commerce de détail non alimentaire |
De 6 à 24 heures |
Personnels PACT et ARIM |
De 5 à 24 heures |
Cordonnerie multiservice |
14 heures |
Bricolage |
24 heures |
Entreprises techniques de la création et de l’événement |
17 heures 30 |
Esthétique-cosmétique parfumerie |
24 heures sauf dans le cadre de « face à face pédagogique » (1 heure) |
Mutualité |
De 7 à 24 heures |
Commerce de détail de l’horlogerie-bijouterie |
De 3 à 24 heures |
Navigation de plaisance |
De 10 à 24 heures |
Industries du commerce de la récupération et du recyclage |
10 heures |
Organismes de tourisme |
De 5 à 24 heures |
Cabinets d’expertise automobile |
24 heures |
Boulangerie et boulangerie-pâtisserie |
De 6 à 24 heures |
Coopération maritime, salariés non naviguant |
De 7 à 24 heures |
(*) Accords conclus au 31 décembre 2015.
Source : DGT, Bilan de la négociation collective pour l’année 2015.
Or, comment garantir à un salarié effectuant seulement une ou deux heures de travail par semaine, même s’il travaille pour le compte de plusieurs employeurs, une rémunération lui permettant de subvenir de manière satisfaisante à ses besoins ? Les femmes, qui sont les principales concernées par le temps partiel, subissent logiquement de plein fouet les conséquences de ces accords a minima, qui vont clairement à l’encontre de la volonté exprimée conjointement par les partenaires sociaux, en 2013, d’encadrer le temps partiel.
La loi du 8 août 2016 a, de surcroît, contribué à affaiblir un peu plus encore la portée du socle minimal de vingt-quatre heures, en confirmant le caractère « supplétif » de cette durée, qui n’a vocation à s’appliquer qu’à défaut d’accord de convention ou d’accord de branche étendu.
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
En l’état actuel du droit, aucune contrepartie financière n’est prévue lorsque la durée minimale de travail est inférieure à vingt-quatre heures.
Pourtant, pour les salariés, cette faible quotité de travail n’est pas sans effet – en particulier lorsqu’elle leur est imposée par l’employeur et non « choisie » : elle se traduit plus souvent par des horaires atypiques et par de faibles revenus, qui condamnent les femmes à la précarité.
En conséquence, cet article prévoit de mieux rémunérer les heures de travail à temps partiel effectuées lorsque la durée minimale de travail prévue par le contrat de travail est inférieure à vingt-quatre heures.
Il est ainsi proposé de compléter l’article L. 3123-7 du code du travail, en vue de préciser le taux de majoration salariale applicable pour chaque heure de travail effectuée, lorsque la durée totale hebdomadaire est en deçà de vingt-quatre heures. Les taux de majoration horaire proposés sont de :
– 10 % lorsque la durée hebdomadaire de travail est supérieure à quinze heures et inférieure à vingt-quatre heures ;
– 15 % lorsque la durée hebdomadaire de travail est supérieure à huit heures et inférieure à quinze heures ;
– 25 % pour toute durée hebdomadaire de travail inférieure à huit heures par semaine.
Une majoration de 25 % supplémentaires pour chaque heure de travail travaillée dès lors que la période de travail est inférieure à deux heures dans une même journée. Le taux de majoration horaire cumulé pourrait par exemple atteindre 40 % par heure en cas de durée de travail de 10 heures hebdomadaires réparties sur 6 jours.
● L’objectif poursuivi par cet article est double.
Il vise en premier lieu à mieux encadrer le travail à temps partiel inférieur à vingt-quatre heures hebdomadaires, en offrant une contrepartie concrète aux salariés grâce à la majoration de la rémunération de ces heures. Le dispositif proposé n’a pas vocation à pénaliser les salariés qui sont contraints de travailler un faible nombre d’heures par semaine, notamment les femmes qui souhaitent concilier leur activité professionnelle et leur vie personnelle et familiale. Pour cette raison, cet article ne remet nullement en cause les dérogations autorisées par la loi, ni la primauté de l’accord de branche pour la détermination d’une durée minimale de travail à temps partiel.
Il vise d’autre part à dissuader les branches professionnelles de conclure des accords prévoyant une durée inférieure à vingt-quatre heures hebdomadaires, pour remédier aux abus constatés dans certains secteurs d’activités.
*
La Commission examine l’amendement AS4 de Mme Marie-Françoise Clergeau.
Mme Marie-Françoise Clergeau. Le système de la loi de 2013 prévoit une protection sous la forme d’une durée minimale hebdomadaire de travail de 24 heures. À partir de là, une dérogation est possible, cette dérogation étant elle-même assortie d’une protection : l’obligation de regrouper les horaires de travail du salarié par demi-journées. C’est un progrès majeur, car les horaires de travail dispersés sont un fléau bien connu. Nous ne saurions être contre les dérogations à la durée minimale, sous réserve de cette protection.
Vous souhaitez remettre en cause l’équilibre qui a été voulu par les organisations syndicales et patronales, amélioré et adopté par le législateur, et en cours de déploiement. Forts des arguments rappelés lors de la discussion de l’article précédent et de notre volonté de respecter le souhait des partenaires sociaux, nous proposons de supprimer cet article.
Mme la rapporteure. Avis défavorable. À la suite de nos auditions des organisations syndicales, j’ai déposé l’amendement AS16 pour réduire les majorations à 25 % pour un temps de travail hebdomadaire inférieur à 24 heures et à 50 % pour un temps de travail inférieur à 15 heures. Cet article vise à décourager les temps très partiels et à faire en sorte que les heures complémentaires soient indemnisées correctement.
La Commission adopte l’amendement.
En conséquence, l’article 4 est supprimé, et l’amendement AS16 de Mme Marie-George Buffet tombe.
*
* *
Article 5
(Art. L. 3123-21 et L. 3123-29 du code du travail)
Majoration de la rémunération des heures complémentaires
Cet article propose d’augmenter le taux de majoration de la rémunération des heures complémentaires, c’est-à-dire les heures effectuées au-delà de la durée de travail à temps partiel mentionnée dans le contrat de travail (15).
1. Les modalités actuelles de majoration des heures complémentaires
Le régime des heures complémentaires est strictement encadré par les articles L. 3123-8 à L. 3123-10 du code du travail. Ainsi, chacune des heures complémentaires accomplies doit donner lieu à une majoration de salaire. De plus, les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail du salarié au niveau de la durée légale du travail ou de la durée fixée conventionnellement. Le salarié doit être informé trois jours à l’avance des heures complémentaires qu’il aura à effectuer. Dans le cas contraire, ou si les heures complémentaires excèdent les limites fixées par le contrat de travail du salarié, le refus de ce dernier d’accomplir les heures complémentaires proposées par l’employeur ne constitue ni une faute, ni un motif de licenciement.
Une convention ou un accord d’entreprise ou, à défaut, une convention ou un accord de branche étendu peut porter la limite dans laquelle peuvent être accomplies des heures complémentaires jusqu’au tiers de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans le contrat du salarié à temps partiel (article L. 3123-20 du même code). À défaut d’accord, le nombre d’heures complémentaires accomplies par un salarié à temps partiel au cours d’une même semaine ou d’un même mois ne peut être supérieur au dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans le contrat de travail (article L. 3123-28 du même code).
Le taux de majoration de chacune des heures complémentaires relève par priorité de la négociation collective de branche : le cas échéant, le taux de majoration fixé par convention ou par accord de branche ne peut être inférieur à 10 % (article L. 3123-21 du même code).
À défaut d’accord, les dispositions supplétives prévues par l’article L. 3123-29 disposent que le taux de majoration des heures complémentaires est égal à « 10 % pour chacune des heures complémentaires accomplies dans la limite du dixième des heures prévues au contrat de travail », et « 25 % pour chacune des heures accomplies entre le dixième et le tiers des heures prévues au contrat de travail ».
2. Le dispositif proposé
En pratique, selon la Direction générale du travail (DGT) (16),au 31 décembre 2015, seuls onze accords de branche fixaient des taux supérieurs à 10 % dès la première heure complémentaire. Cette donnée confirme bien qu’en matière de temps partiel, les négociations de branche donnent souvent lieu à des accords a minima.
C’est pourquoi le 1° du présent article propose, en premier lieu, de modifier l’article L. 3123-21 du code du travail afin de relever de 10 à 25 % le taux minimum de majoration des heures complémentaires déterminé par une convention ou un accord de branche étendu.
Le 2° propose ensuite de modifier l’article L. 3123-29 du même code afin d’harmoniser les taux de majoration applicables à défaut de convention ou d’accord de branche. Ainsi, quel que soit le nombre d’heures complémentaires effectuées, la rémunération de celles-ci serait majorée de 25 % – sans distinction selon que ces heures sont effectuées dans la limite du dixième des heures prévues au contrat de travail ou non.
TAUX MINIMAL DE MAJORATION DES HEURES COMPLÉMENTAIRES
Droit existant |
Droit proposé | ||
Accord de branche étendu (art. L. 3123-21 du code du travail) |
10 % |
25 % | |
Dispositions supplétives (art. L. 3123-29 du code du travail) |
Heures accomplies dans la limite de 1/10e des heures prévues au contrat de travail |
10 % |
25 % |
Heures accomplies entre le 1/10e et le tiers des heures prévues au contrat de travail |
25 % |
Les heures complémentaires effectuées par les salariés à temps partiel seraient ainsi majorées au même niveau que le niveau applicable de manière supplétive aux huit premières heures supplémentaires effectuées par un salarié à temps plein (17), ce qui est une avancée considérable en termes d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. En effet, la moindre rémunération des heures complémentaires par rapport aux heures supplémentaires est susceptible de constituer, selon la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, une discrimination indirecte à l’égard des femmes, largement majoritaires parmi les salariés à temps partiel (CJCE, 6 décembre 2007, Ursula Voβ, C-300/06, Rec. CJCE, I-10573) (18).
La mesure proposée à cet article permettrait donc de mettre en conformité les dispositions du code du travail relatives aux heures complémentaires de notre code du travail avec le droit de l’Union européenne.
*
La Commission est saisie de l’amendement AS5 de Mme Marie-Françoise Clergeau.
Mme Marie-Françoise Clergeau. Le présent article vise à faire passer le taux minimal de majoration des heures complémentaires de 10 à 25 %. Rappelons que les heures complémentaires sont majorées d’au moins 10 % dès la première heure effectuée, depuis l’adoption par notre majorité de la loi de sécurisation de l’emploi. Par ailleurs, les heures effectuées au-delà du dixième de la durée de travail prévue au contrat, et dans la limite du tiers, sont majorées de 25 %. Notre majorité croit à la négociation collective et lui donne la priorité en l’encadrant. Il appartient, selon nous, à la négociation de fixer le taux de majoration, en respectant le minimum défini par le législateur. Nous proposons donc de supprimer cet article.
Mme la rapporteure. Avis défavorable. On dénombre seulement onze accords de branche avec des majorations d’heures complémentaires supérieures à 10 %. Outre la précarité qu’engendrent ces dispositions pour les femmes à temps partiel, elles entraînent une rupture d’égalité vis-à-vis des salariés à temps plein, qui peuvent bénéficier de taux de majoration d’heures supplémentaires supérieurs. C’est une grave rupture de l’égalité : les salariés à temps partiel n’ont pas les mêmes droits que les salariés à temps plein.
La Commission adopte l’amendement.
En conséquence, l’article 5 est supprimé.
*
* *
Article 6
(Art. L. 3123-22 du code du travail)
Majoration obligatoire de la rémunération des compléments d’heures
Cet article propose de rendre obligatoire la majoration de salaire des compléments d’heures prévus par avenant.
1. Les compléments d’heures, un dispositif peu protecteur pour les salariés à temps partiel
La loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 de sécurisation de l’emploi a créé un nouveau dispositif de compléments d’heures par avenant au contrat de travail, en vertu duquel une convention ou un accord de branche étendu peut prévoir la possibilité d’augmenter temporairement, par un avenant au contrat de travail, la durée de travail prévue par le contrat (article L. 3123-22 du code du travail). Le cas échéant, le complément se substitue temporairement à la durée prévue au contrat.
La convention ou l’accord de branche étendu détermine le nombre maximal d’avenants pouvant être conclus, dans la limite de huit par an et par salarié, en dehors des cas de remplacement d’un salarié absent nommément désigné (1°). Cette convention ou cet accord doit définir également les modalités selon lesquelles les salariés peuvent bénéficier prioritairement des compléments d’heures (3°).
En outre, il est précisé au 2° de cet article que la convention ou l’accord en question « peut prévoir la majoration salariale des heures effectuées dans le cadre de cet avenant ».
Selon le bilan de la négociation collective publié par la Direction générale du travail (DGT) pour l’année 2015, la très grande majorité des branches professionnelles ont eu recours à ce nouveau dispositif de complément d’heures. Vingt-huit accords ont limité à moins de huit le nombre d’avenants permettant d’augmenter la durée du travail, et les heures effectuées dans le cadre de l’avenant temporaire font l’objet d’une majoration dans dix-neuf accords. La majoration rendue possible par le législateur est donc loin d’être systématique, puisque dans la plupart des cas, les accords ne majorent que les heures effectuées au-delà de la durée du travail fixée par l’avenant.
2. Le dispositif proposé
Le présent article propose donc de transformer la possibilité de majoration en obligation. Il modifie en conséquence le 2° de l’article L. 3123-22, afin de préciser que la convention ou l’accord « détermine » la majoration salariale, et que celle-ci ne peut être inférieure à 15 %.
Il s’agit ici de garantir, pour les salariés à temps partiel, une contrepartie financière obligatoire en échange de la modification temporaire de leur contrat de travail par l’employeur. Car, si le dispositif du complément d’heures s’inscrivait initialement dans une démarche censée permettre aux salariés à temps partiel de compléter leur activité, en réalité, les modalités de recours de l’employeur à ce dispositif peuvent être déstabilisantes pour le salarié. Il convient en effet de souligner que la durée de l’avenant n’est pas limitée par le code du travail : la modification « temporaire » de la durée hebdomadaire de travail peut ainsi durer aussi bien une semaine que plusieurs mois.
De même, le nombre d’avenants déterminés par l’accord ou la convention de branche peut être problématique. Dans les branches professionnelles prévoyant le recours à ce système de compléments d’heures, un salarié à temps partiel peut ainsi tout à fait se voir imposer plusieurs avenants dans une année, de durées diverses, ce qui l’oblige alors à adapter continuellement ses horaires, sans forcément avoir la possibilité de rechercher un emploi complémentaire compte tenu du caractère fluctuant de son temps de travail. Il est donc logique, dans de telles circonstances, de prévoir une contrepartie financière obligatoire.
*
La Commission étudie l’amendement AS6 de Mme Marie-Françoise Clergeau.
Mme Marie-Françoise Clergeau. L’article 6 propose de revoir les règles de majoration des heures effectuées dans le cadre d’un complément d’heures par avenant. L’équilibre trouvé en 2013 a ouvert la possibilité d’augmenter de manière temporaire la durée de travail des salariés à temps partiel par avenant, à condition que ce dispositif soit expressément prévu par un accord de branche étendu. Ce dispositif est largement sollicité depuis sa création, et l’examen des accords conclus permet d’observer que le taux de majoration varie de 10 à 25 %. Aussi, nombreuses sont les branches dans lesquelles il a été décidé de limiter à huit le nombre d’avenants permettant d’augmenter temporairement la durée du travail. Pour toutes ces raisons, nous proposons la suppression de cet article.
Mme la rapporteure. Avis défavorable. Les compléments d’heures étaient encore considérés il y a peu par la Cour de cassation comme des fraudes visant à contourner la législation sur le travail à temps partiel. La loi de sécurisation de l’emploi de 2013 a tenté d’encadrer ce dispositif. En pratique, le dispositif retenu permet surtout aux employeurs d’éviter de payer des heures complémentaires. D’ailleurs, plusieurs branches aujourd’hui ne prévoient aucune majoration des compléments d’heures.
Ces compléments d’heures ont des conséquences dramatiques : ils placent les salariés dans une précarité psychologique, ceux-ci ne sachant pas à l’avance quels seront leurs horaires de travail. Dans certaines branches, l’employeur peut imposer jusqu’à huit avenants par an, c’est-à-dire huit modifications substantielles de la durée du travail du salarié au cours d’une seule année. Comment, dans ces conditions, un salarié à temps partiel peut-il concilier ses heures de travail avec ses contraintes personnelles et familiales ? Cette précarité psychologique est accentuée par la possibilité de réduire les délais de prévenance à trois jours.
En outre, les compléments d’heures complexifient une législation sur le temps partiel déjà très compliquée. Les syndicats, pendant les auditions, nous ont d’ailleurs alertés sur le fait qu’il est devenu de plus en plus difficile d’expliquer les droits des femmes salariées à temps partiel.
Cet article vise donc à rendre la majoration obligatoire, et l’amendement AS15 suivant propose de relever à 25 % minimum le taux de majoration.
La Commission adopte l’amendement.
En conséquence, l’article 6 est supprimé, et l’amendement AS15 de Mme Marie-George Buffet tombe.
*
* *
La Commission examine l’amendement AS14 de la rapporteure.
Mme la rapporteure. Cet amendement vise à relever à sept jours ouvrés le délai minimum de prévenance pouvant être défini par accord d’entreprise en cas de changement de la répartition de la durée du travail d’un salarié à temps partiel. La loi du 8 août 2016 relative au travail a, en effet, permis à un accord d’entreprise de négocier un délai de prévenance de trois jours. Il faut bien imaginer ce que cela implique pour le salarié de devoir prévoir à trois jours des horaires de garde pour les enfants, une organisation de travail, des temps de repos différents. Nous pensons que sept jours sont un délai minimal, qu’il faut reconduire.
Mme Marie-Françoise Clergeau. Nous voterons contre cet amendement, restant en cohérence avec les accords qui ont été passés entre les organisations syndicales et patronales.
La Commission rejette l’amendement.
*
* *
TITRE III
PARTAGER LA PARENTALITÉ
Article 7
(Art. L. 1225-17 du code du travail)
Allongement de la durée du congé de maternité
Le code du travail permet à toute salariée enceinte de bénéficier d’un congé de maternité indemnisé. La durée de ce congé varie en fonction du nombre d’enfants à naître ou déjà à charge (cf. tableau ci-dessous).
DURÉE DU CONGÉ DE MATERNITÉ
(en semaines)
Durée du congé de maternité |
dont congé prénatal |
Dont congé postnatal | ||
Naissance simple |
Jusqu’au 2e enfant (Art. L. 1225-17 du code du travail) |
16 |
6 |
10 |
À partir du troisième enfant (Art. L. 1225-19 du code du travail) |
26 |
8 |
18 | |
Naissances multiples |
Jumeaux |
34 |
12 |
22 |
Triplés ou plus |
46 |
24 |
22 |
Pour une naissance simple, et jusqu’à un enfant déjà à charge, la durée du congé est de 16 semaines. Dans ce cas, le congé débute six semaines avant la date présumée de l’accouchement et s’interrompt dix semaines après la date de celui-ci. Toutefois, sur demande de la salariée et sous réserve de l’avis du professionnel de santé qui suit la grossesse, le congé pris préalablement à la date de l’accouchement peut être réduit à une durée de trois semaines, ce qui a pour effet d’augmenter proportionnellement le congé pris après l’accouchement.
Pendant le congé de maternité, le contrat de travail est seulement suspendu, et la période du congé est considérée comme une période de travail effectif pour la détermination des droits de la salariée. Cela signifie qu’au retour de son congé, la mère bénéficie de l’ensemble des droits auxquels elle aurait pu prétendre si elle était restée dans l’entreprise : augmentations générales de salaire accordées pendant son absence, congés, droit individuel à la formation, etc. De plus, le congé de maternité n’a pas d’incidence sur le calcul des droits à retraite.
● Le présent article propose de modifier l’article L. 1225-17 du code du travail afin de porter à dix-huit semaines – soit deux semaines supplémentaires par rapport au droit actuel –, dont sept semaines avant la date présumée de l’accouchement, la durée du congé maternité pour les femmes ayant jusqu’à un enfant déjà à charge. Cette durée de sept semaines continuera de pouvoir être réduite à trois semaines, sur demande de la salariée, et dans les conditions ci-dessus décrites.
Cet allongement de la durée du congé de maternité permettrait de rapprocher notre droit des préconisations internationales, et des pratiques observées chez nos voisins.
La recommandation n° 191 de la convention n° 183 de l’Organisation internationale du travail (OIT) recommande ainsi aux membres de l’organisation de porter cette durée à au moins dix-huit semaines (19), alors que la période minimale de congé prévue par la convention n° 183 est actuellement de quatorze semaines.
De plus, au sein de l’Union européenne (cf. encadré ci-dessous), la durée moyenne du congé de maternité est de 20 semaines.
Le congé maternité, un droit peu harmonisé au sein de l’Union européenne
La directive européenne maternité date de 1992 (20). Elle fixe à un minimum de quatorze semaines le congé maternité, dont deux semaines obligatoires avant la date prévue de l’accouchement.
Cette directive européenne a créé des situations totalement différentes au sein de l’Union européenne : à titre d’exemple, le Royaume-Uni offre 52 semaines rémunérées à hauteur de 40 % ; la France accorde 16 semaines avec une rémunération de 60 % en moyenne ; l’Allemagne accorde 14 semaines à 100 %.
En 2010, la députée européenne Edite Estrela a proposé une nouvelle directive (21) imposant un congé maternité de 20 semaines, avec une compensation de 100 % du salaire de la mère. Cette directive n’a néanmoins jamais vu le jour.
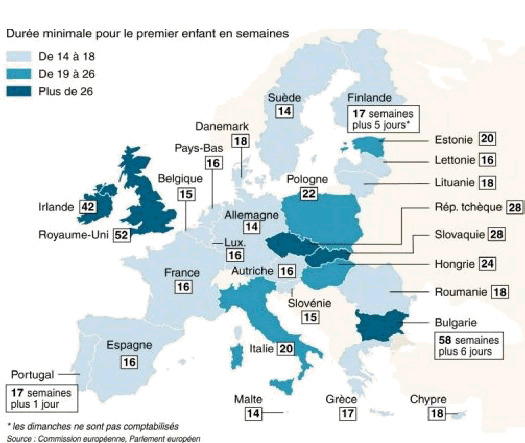
Associée avec la mesure d’allongement de la durée du congé de paternité, proposée à l’article 8 de la présente proposition de loi, cette mesure doit également permettre de rééquilibrer les temps consacrés à la parentalité entre les femmes et les hommes et, par extension, permettre d’améliorer l’égalité professionnelle entre ces derniers.
*
La Commission adopte l’article 7 sans modification.
*
* *
Article 8
(Art. L. 1225-35 du code du travail)
Allongement de la durée du congé de paternité
Cet article propose d’allonger significativement la durée du congé de paternité.
1. Le congé paternité, un dispositif plébiscité par deux tiers des pères
Créé par la loi n° 2001-1246 du 21 décembre 2001 de financement de la sécurité sociale pour 2002, le congé de paternité et d’accueil permet aux pères (22) qui travaillent ou qui ont perçu une allocation chômage au cours des douze derniers mois, de bénéficier d’un congé indemnisé suite à la naissance ou à l’adoption d’un ou de plusieurs enfants (article L. 1225-35 du code du travail).
Ce congé a une durée maximale de onze jours calendaires consécutifs, étendus à dix-huit jours en cas de naissances ou d’adoptions multiples. Il doit être pris dans les quatre mois suivant la naissance ou l’adoption, et il est cumulable avec les trois jours d’absence – minimum – accordés par l’employeur pour une naissance ou une adoption (article L. 3142-1 du code du travail).
Le congé de paternité s’applique à l’ensemble des salariés du secteur privé, aux travailleurs indépendants, aux travailleurs agricoles, aux fonctionnaires et aux chômeurs indemnisés au cours des douze derniers mois précédant la naissance.
Le montant de l’indemnisation du congé dépend du secteur d’activité du père : pour les salariés relevant du régime général, le montant maximum de l’indemnité journalière versée pendant le congé est de 84,90 euros par jour au 1er janvier 2016 – sauf lorsqu’une convention ou un accord de branche prévoit le maintien intégral du salaire ; pour le régime agricole, le père perçoit des indemnités journalières (s’il est salarié) ou une allocation de remplacement (s’il est exploitant) ; pour les fonctionnaires, le salaire est intégralement maintenu.
Depuis sa mise en place au 1er janvier 2002, le congé de paternité a rencontré un relatif succès puisque près de sept pères sur dix éligibles au dispositif (68 %) y ont eu recours en moyenne (23). De plus, 95 % des pères ayant pris un congé de paternité ont consommé l’ensemble des jours de congé qui leur étaient accordés.
NOMBRE DE BÉNÉFICIAIRES DU CONGÉ DE PATERNITÉ
(en milliers)
Nombre de bénéficiaires |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
Congé paternité |
396 |
384 |
390 |
395 |
387 |
382 |
376 (*) |
366 (*) |
(*) La diminution du nombre de congé paternité entre 2013 et 2015 doit être analysée au regard de la diminution du nombre de naissances sur ces deux années.
Source : Programme de qualité et d’efficience « Famille », Annexe 1 au projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2017.
D’après la sociologue Jacqueline Laufer, « les motivations expliquant la prise du congé par les pères tendent à montrer qu’ils prennent essentiellement le congé de paternité pour être présents auprès de la mère et pour l’aider » (24).
2. L’allongement de la durée du congé de paternité : un « impératif d’égalité » (25)
De toute évidence, si l’on s’en tient aux données globales, le congé de paternité est désormais relativement bien entré dans les mœurs.
Pour autant, le détail des données relatives au recours au congé paternité révèle d’importantes disparités en fonction du statut du père. Ainsi, alors que neuf pères fonctionnaires sur dix prennent leur congé de paternité, seuls 32 % des indépendants et 48 % des salariés en contrat à durée indéterminée ont recours au congé de paternité.
TAUX DE RECOURS AU CONGÉ DE PATERNITÉ SELON LES CONFIGURATIONS PROFESSIONNELLES
(en %)
Catégorie socioprofessionnelle du père |
Agriculteur, artisan, chef d’entreprise |
28 |
Cadre, profession intellectuelle supérieure |
79 | |
Profession intermédiaire |
81 | |
Employé |
78 | |
Ouvrier |
70 | |
Statut de l’emploi occupé par le père |
Salarié en contrat à durée indéterminée (CDI) du secteur privé |
80 |
Fonctionnaire ou agent titulaire d’un contrat à durée indéterminée du secteur public |
88 | |
Indépendant |
32 | |
Salarié en contrat à durée déterminée (CDD), autres contrats des secteurs privés ou publics |
48 |
Source : DREES, « Le congé de paternité : un droit exercé par sept pères sur dix », Études et résultats, n° 957, mars 2016.
Le recours relativement élevé au congé de paternité ne doit pas non plus dissimuler les dysfonctionnements des autres types de congés parentaux, dont la durée est plus élevée. Le congé parental d’éducation, par exemple, bien que réformé en 2014 (26), peine toujours à attirer les pères, qui ne représentaient en 2015 que 5,1 % de l’ensemble des bénéficiaires de ce congé (27).
Selon le type de congé considéré, les motifs régulièrement invoqués par les pères pour justifier de cette réticence sont :
– d’une part, la perte de revenus problématique pour la situation financière de la famille – lorsque le père occupe un poste mieux rémunéré que sa conjointe –, s’agissant du congé parental d’éducation ;
– et, d’autre part, la crainte que ce congé soit un frein à leur carrière (28).
Ce sentiment que les congés de parentalité seraient surtout préjudiciables au déroulement de la carrière des hommes – et, dans une moindre mesure, à celle des femmes – est malheureusement bien ancré dans les mentalités. Dans une note de janvier 2017 (29), l’OFCE souligne ainsi que « les hommes ne peuvent pas se permettre d’ajuster leur carrière à leur vie familiale car ce comportement atypique envoie un signal négatif à leur employeur », alors que l’interruption de carrière d’une femme pour se consacrer à ses enfants est socialement plus acceptée, renvoyant dès lors les femmes à leur seul rôle de mère. En effet, contrairement aux pères, les mères sont obligées de s’interrompre en cas de maternité, pour une durée de huit semaines au moins (article L. 1225-29 du code du travail).
En définitive, ce sont donc les femmes qui supportent le plus souvent le « coût », en termes de parcours professionnel, de la parentalité.
À rebours de ces carcans culturels, le succès manifeste du congé de paternité traduit une volonté des pères – et notamment des plus jeunes d’entre eux, proportionnellement plus nombreux à y avoir recours – de passer plus de temps avec leur enfant, dès la naissance.
Cette présence du père auprès de sa conjointe et de ses enfants dans les premières semaines après la naissance permet sans conteste un certain rééquilibrage des tâches domestiques au sein du couple. Mais ce n’est pas tout : elle peut également permettre, selon Mme Laufer (30), de « mettre en place un nouveau construit culturel de la paternité qui sortirait définitivement le père de son statut de subrogé parent ou de parent de substitution, en superposant à la figure du père gagne-pain de la famille, qui imprègne encore les esprits, celle du père éducateur et dispensateur de soins aux enfants ».
Le recours au congé de paternité traduit également la volonté des pères de mieux concilier leur vie professionnelle et leur vie familiale ; à ce titre, le congé de paternité doit résolument être encouragé.
Pour autant, la durée actuelle du congé de paternité, très courte par comparaison avec celle du congé maternité, ne permet pas d’inverser la tendance actuelle de l’inégale répartition du temps parental auprès des jeunes enfants. L’OFCE estime dès lors qu’ « un congé paternité obligatoire et plus long rééquilibrerait entre les deux parents l’impact d’une naissance sur la carrière » (31).
3. Le dispositif proposé
Le présent article propose en conséquence de modifier l’article L. 1225-35 du code du travail afin d’allonger la durée de congé de paternité et d’accueil à :
– quatre semaines consécutives (soit vingt-huit jours) en cas de naissance ou d’adoption d’un seul enfant ;
– à six semaines consécutives (soit quarante-deux jours) en cas de naissances ou d’adoptions multiples.
Le congé de paternité pourrait dès lors représenter un véritable levier pour garantir une meilleure répartition de la parentalité et contribuer à réduire, en conséquence, les inégalités professionnelles.
*
Mme Marie-Françoise Clergeau. Nous allons nous abstenir sur le vote de l’article 8 aujourd’hui, car je présenterai un amendement en séance afin d’augmenter de trois jours la durée du congé de paternité et d’accueil de l’enfant. On reviendra ainsi dans le cadre de la proposition de loi que nous avons présentée en 2010 et cela représente un bon compromis par rapport à la durée très longue que vous proposez.
Mme la rapporteure. Il est temps que la France se mette au goût du jour sur les questions de parentalité et notamment le congé de paternité. La France est à la traîne.
Nous n’avons pas souhaité élargir le champ du texte mais j’appelle aussi votre attention sur les questions de la grossesse. Notre droit est très restrictif s’agissant de la protection des femmes enceintes, dans la mesure où il dresse une liste des raisons permettant leur protection. Nous avons vu dans l’actualité de ces derniers mois que des femmes, dans le secteur du commerce par exemple, avaient perdu leurs bébés à cause de postes qui ne convenaient pas. Il faudra retravailler ces questions.
Mme Isabelle Le Callennec. Avez-vous commencé à chiffrer concrètement les conséquences de ces articles 7 et 8 pour la branche maladie de la sécurité sociale ?
Mme la rapporteure. Nous avons commencé et nous vous donnerons les chiffres d’ici à la séance.
La Commission adopte l’article 8 sans modification.
*
* *
TITRE IV
LUTTER CONTRE LES DISCRIMINATIONS À L’EMBAUCHE
Article 9
(Art. L. 1221-6 et L. 1221-13 du code du travail)
Améliorer l’information en matière de discrimination
Afin de renforcer la lutte contre les discriminations, cet article propose, d’une part, de créer une partie spécifique consacrée aux candidats à l’embauche au sein du registre unique du personnel et, d’autre part, d’améliorer l’information des candidats à l’embauche en matière de discriminations.
I. LES DISCRIMINATIONS À L’EMBAUCHE, UN FLÉAU LARGEMENT RÉPANDU
1. Des discriminations multiformes, qui n’épargnent pas les femmes
Le droit du travail prohibe toute forme de discrimination dans l’entreprise : qu’il s’agisse des discriminations à l’embauche – à l’encontre d’un candidat à un poste, à un stage ou à un apprentissage –, ou des discriminations intervenant au cours de la carrière d’un salarié (promotion, formation, mutation, sanctions, licenciement…), et ce quel que soit le motif, fondé sur des éléments extérieurs au travail (sexe, religion, apparence physique, nationalité, origine, âge, état de santé…).
La problématique des discriminations à l’embauche ne peut évidemment pas être réduite aux seules discriminations liées au genre. Pourtant, celles-ci représentent une part non négligeable des discriminations ressenties, notamment au cours du processus de recrutement.
Ainsi, selon les résultats d’une enquête de l’Ifop de janvier 2015 réalisée auprès de demandeurs d’emploi, « parmi les discriminations liées au genre, la maternité, à savoir être enceinte (85 %) et le fait d’avoir des enfants (50 %) sont les premières situations citées, et ce avant le fait d’être une femme, qui présente tout de même un inconvénient à l’embauche pour plus d’un tiers des personnes interrogées (37 %) » (32).
Les discriminations liées au genre sont même exacerbées lorsque d’autres motifs entrent en jeu. Un récent rapport du Conseil économique, social et environnemental (CESE) (33) a par exemple montré que le taux d’activité des femmes reconnues handicapées était très inférieur à celui de la population âgée de 15 à 64 ans (46 % contre 71 %), et que les femmes reconnues handicapées sont moins actives que leurs homologues masculins. Ces derniers sont d’ailleurs beaucoup plus souvent en emploi en milieu ordinaire (55 %) que les femmes (45 %).
2. Compléter le registre unique du personnel pour mieux connaître l’état des discriminations dans l’entreprise
Le registre unique du personnel (RUP), prévu à l’article L. 1221-13 du code du travail doit être mis en place dans tout établissement où sont employés des salariés. Les noms et prénoms de tous les salariés doivent être y inscrits au moment de l’embauche. De même, les noms et prénoms des stagiaires accueillis dans l’établissement sont inscrits sur ce registre, dans une partie spécifique.
Ce registre est constamment tenu à la disposition des délégués du personnel ainsi que des agents et fonctionnaires chargés de veiller à l’application du code de la sécurité sociale et du code du travail.
Le 1° propose de compléter l’article L. 1221-13 par un alinéa créant, au sein du RUP, une partie spécifique consacrée aux candidats à l’embauche. Ainsi, toute candidature reçue pour un poste ouvert au recrutement devra être inscrite dans cette partie spécifique. Les informations personnelles relatives au candidat, c’est-à-dire le nom, le prénom, le sexe, le lieu de résidence ainsi que la date et le lieu de naissance devront être explicitement mentionnés.
Il est en outre précisé que les curriculum vitae devront être conservés pendant cinq ans par l’entreprise.
Les données relatives aux candidats à l’embauche peuvent être consultées dans les mêmes conditions que celles prévues actuellement par le code du travail. L’on peut ainsi imaginer qu’en cas de soupçon de discrimination en matière de recrutement, les délégués du personnel ou les services de contrôle pourraient constater le caractère avéré ou non de la discrimination, en se fondant notamment sur les données relatives aux candidats renseignées dans le registre.
II. LES CANDIDATS À L’EMBAUCHE DÉMUNIS FACE AUX DISCRIMINATIONS DONT ILS S’ESTIMENT VICTIMES
1. Les candidats à l’embauche s’estimant victimes de discrimination méconnaissent les voies de recours, ou hésitent à y avoir recours
Il existe de multiples voies de recours en cas de discrimination. Celles-ci demeurent pourtant très peu mobilisées par les personnes s’estimant victimes et ce, quel que soit le motif de discrimination concerné. Ainsi, selon le baromètre de l’Ifop publié en janvier 2015, sur l’ensemble des demandeurs d’emploi, la proportion d’entre eux ayant entrepris des démarches pour faire reconnaître la discrimination est de seulement 15 %. Le fait d’engager ces démarches varie cependant assez nettement selon la nature de la discrimination.
Le 19 septembre 2016, le Défenseur des droits a par exemple présenté les résultats de son appel à témoignages sur les discriminations subies par des personnes d’origine étrangère dans l’accès à l’emploi. L’analyse des réponses a mis en évidence la fréquence des discriminations liées aux origines, lors de recherche de stage ou d’emploi – pour 60 % des répondants, ces discriminations se produisent « souvent » voire « très souvent ». Or, les résultats de cet appel à témoignages révèlent également que moins d’un répondant s’estimant victime sur dix a engagé des démarches pour faire reconnaître ses droits.
Les discriminations liées au genre ou à la maternité ne sont pas en reste : la sociologue Jacqueline Laufer (34) note ainsi qu’en dépit d’une forte perception des discriminations en raison du sexe ou de la maternité, « on a pu toutefois souligner le faible nombre de plaintes en discrimination de la part des femmes en raison de ces motifs par comparaison avec les plaintes au motif de l’origine et de l’âge ».
Ces discriminations non reconnues peuvent pourtant avoir des effets dévastateurs sur les victimes : le baromètre de l’Ifop déjà cité estime ainsi qu’à la suite d’une discrimination à l’embauche, 43 % des victimes ont abandonné leurs recherches d’emploi, tandis que 34 % d’entre elles revoient à la baisse leurs exigences en termes de rémunération ou de fonction recherchée.
2. Le dispositif proposé vise à améliorer l’information des candidats à l’embauche en matière de discrimination
Selon le huitième baromètre de l’Ifop, la faible proportion de démarches engagées par les victimes de discrimination s’explique principalement par le fait que celles-ci se sentent « particulièrement démunies face à la discrimination ». Dès lors, ces victimes « sont en attente de solutions de la part des pouvoirs publics pour pallier les inégalités de traitement dont ils peuvent faire l’objet ».
Le baromètre de l’Ifop révèle également que la proportion de victimes ayant entrepris des démarches pour protester contre la discrimination est beaucoup plus élevée (50 %, soit 35 points de plus par rapport à l’ensemble des victimes) lorsque les personnes sont informées de leurs droits. Ces dernières sont également plus nombreuses que les autres à avoir demandé l’appui d’un professionnel du recrutement (41 %, soit 12 points de plus).
Partant de ce constat, cet article propose donc, en second lieu, de renforcer l’information des candidats à l’embauche en matière de discrimination.
● À cette fin, le 2° complète l’article L. 1221-6 du code du travail par un alinéa qui impose à l’employeur de remettre à chaque candidat à un poste, au cours de l’entretien d’embauche, une notification de ses droits reprenant les dispositions prévues à l’article L. 1132-1 du code du travail.
Cet article interdit les mesures discriminatoires, directes et indirectes, à l’égard des candidats à un stage ou à un emploi, ainsi qu’à l’égard des salariés déjà dans l’entreprise, lorsque ces mesures se fondent sur l’un des critères de discrimination prohibés par la loi, et notamment par l’article premier de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations (cf. encadré ci-dessous).
Extrait de l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations
● Critères de discrimination directe
« Constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de son origine, de son sexe, de sa situation de famille, de sa grossesse, de son apparence physique, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son patronyme, de son lieu de résidence, de son état de santé, de sa perte d’autonomie, de son handicap, de ses caractéristiques génétiques, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales, de sa capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée, une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne l’aura été dans une situation comparable ».
● Critères de discrimination indirecte
« Constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d’entraîner, pour l’un des motifs mentionnés ci-dessus, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d’autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés. »
La forme et le contenu de cette notification des droits seront fixés par décret.
● La notification des droits remise au candidat lors de l’entretien d’embauche devra également comporter une liste des personnes à saisir en cas de non-respect de ses droits.
Deux types de recours existent pour les victimes et témoins de discriminations :
– le recours pénal : toute personne faisant l’objet d’une discrimination peut déposer plainte auprès du Procureur de la République, du commissariat de police, de la gendarmerie ou du doyen des juges d’instruction du tribunal de grande instance, afin que les agissements dont elle est victime soient pénalement sanctionnés ;
– le recours civil : les salariés victimes ou témoins de discriminations disposent également d’un recours devant le conseil de prud’hommes, en vue de faire annuler la décision fondée sur un motif discriminatoire et demander réparation du préjudice subi.
Depuis la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, une nouvelle forme de recours est offerte aux victimes de discrimination : l’action de groupe. En application de ces dispositions, une organisation syndicale de salariés représentative au sens des articles L. 2122-1, L. 2122-5 ou L. 2122-9 du code du travail peut agir devant une juridiction civile afin d’établir que plusieurs candidats à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou plusieurs salariés font l’objet d’une discrimination, directe ou indirecte, fondée sur un même motif figurant parmi ceux prohibés par la loi (l’origine, le sexe, l’âge, le handicap…) et imputable à un même employeur.
Pour exercer, le cas échéant, l’un de ces recours, le candidat à l’embauche s’estimant victime d’une discrimination peut solliciter :
– les agents de contrôle de l’inspection du travail, qui sont compétents pour se faire communiquer tout document ou tout élément d’information utile à la constatation de faits susceptibles d’être constitutifs d’une discrimination ;
– les organisations syndicales représentatives au plan national ou dans l’entreprise, qui peuvent exercer en justice toute action relative à des agissements discriminatoires en faveur d’un candidat à un emploi ;
– les associations de lutte contre les discriminations régulièrement constituées depuis au moins cinq ans, qui sont compétentes pour exercer en justice toute action relative à des agissements discriminatoires ;
– les délégués du personnel, en vertu de leur droit d’alerte ;
– ou encore, le Défenseur des droits, qui est notamment chargé d’orienter vers les autorités compétentes toute personne signalant une alerte (« lanceur d’alerte ») dans les conditions fixées par la loi, et de veiller aux droits et libertés de cette personne.
*
La Commission est saisie de l’amendement AS9 de Mme Marie-Françoise Clergeau.
Mme Marie-Françoise Clergeau. Le Gouvernement a lancé, à l’automne 2014, un groupe de travail sur la lutte contre les discriminations dans le monde du travail. Et pour cause, comme l’a rappelé le Défenseur des droits dans son rapport d’activité de 2015, « 54 % des dossiers de réclamation dans le domaine de la lutte contre les discriminations concernent l’emploi ».
Depuis 2012, nous sommes passés à l’attaque pour lutter contre les discriminations à l’embauche. En avril 2015, suite aux conclusions rendues par le groupe de travail, nous avons engagé la promotion de nouvelles méthodes de recrutement – immersion, recrutement par simulation, CV vidéo… –, nous avons lancé et soutenu une campagne de testing et créé une action de groupe spécifique aux discriminations au travail dans le cadre de la loi « Justice du XXIe siècle » adoptée en octobre. Au passage, le CV anonyme dont a parlé M. Vercamer n’a jamais été appliqué, le Gouvernement, de 2006 à 2012, n’ayant jamais pris les décrets d’application.
M. Francis Vercamer. Ce n’est pas une raison pour le supprimer !
Mme Marie-Françoise Clergeau. Le présent article propose d’instaurer un registre des candidatures adossé au registre unique du personnel. Dans son rapport remis en mai 2015 au Gouvernement, le groupe de travail présidé par M. Sciberras a émis de fortes réserves sur la mise en œuvre d’une telle mesure et préconise d’approfondir les réflexions sur le sujet. Ainsi peut-on lire en page 9 du rapport : « L’analyse de certaines propositions telles que la création d’un registre des candidatures a montré que les réflexions méritaient d’être approfondies si on veut déboucher sur des mesures crédibles car opérationnelles. » Il ne semble donc pas opportun d’adopter cette disposition en l’état, mais plutôt d’attendre la remise des travaux engagés par le groupe de travail.
L’article 9 crée une obligation de notification de l’employeur au candidat qu’il reçoit pour un entretien des droits garantis dans le code du travail en matière de lutte contre les discriminations. Or cette obligation est déjà garantie par l’article L. 1142-6 du code du travail qui dispose que, dans les lieux de travail ainsi que dans les locaux ou à la porte des locaux où se fait l’embauche, les candidats sont informés, par tout moyen, des dispositions pénales existant en matière de discriminations. Telles sont les raisons pour lesquelles nous proposons la suppression de cet article.
Mme la rapporteure. Avis défavorable. La citation de M. Sciberras est un appel à travailler sur cette question, ce que propose cet article. Rendons cette mesure opérationnelle et nous pourrons plus tard en tirer le bilan. Une information individuelle, par notification à chaque personne, serait plus efficace qu’une information par affichage.
La Commission adopte l’amendement.
En conséquence, l’article 9 est supprimé.
*
* *
Article 10
Compensation des charges pour les organismes de sécurité sociale
Cet article vise à prévoir un mécanisme de compensation, pour les organismes de sécurité sociale, des charges qui résulteraient de la mise en place des dispositions des articles 1er à 9 de cette proposition de loi.
Le dispositif proposé repose sur une augmentation à due concurrence des droits pesant sur les tabacs mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts et qui concernent : les cigarettes, cigares, cigarillos, tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes ainsi que les autres tabacs à fumer, priser et mâcher.
*
La Commission adopte l’article 10 sans modification.
Puis elle adopte l’ensemble de la proposition de loi modifiée.
*
* *
En conséquence, la Commission des affaires sociales demande à l’Assemblée nationale d’adopter la présente proposition de loi dans le texte figurant dans le document annexé au présent rapport.
ANNEXE
LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES PAR LA RAPPORTEURE
(par ordre chronologique)
Ø Table ronde d’organisations représentatives des employeurs :
– Mouvement des entreprises de France (MEDEF) (*) – Mme Carol Lambert, présidente du comité Égalité et parité, Mme Céline Micouin, directrice Entreprises et société, et Mme Marine Binckli, chargée de mission à la direction des affaires publiques
– Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME) – M. Jean-Michel Pottier, vice-président, en charge des affaires sociales et de la formation, et Mme Sabrina Benmouhoub, chargée de mission affaires publiques et organisation
Ø Table ronde d’organisations syndicales représentatives des salariés :
– Confédération générale du travail (CGT) – Mme Sophie Binet, secrétaire générale de l’UGICT, en charge des questions d’égalité professionnelle à la CGT et Mme Sylvie Vachoux
– SUD-travail – Mme Martine Devillers, directrice adjointe, responsable d’unité de contrôle, et Mme Astrid Toussaint, appui et instruction du contentieux droit du travail et des sanctions administratives
Ø Table ronde de spécialistes :
– M. Michel Miné, juriste, professeur de droit du travail
– Mme Jacqueline Laufer, professeur émérite de sociologie HEC
Ø Table ronde d’associations féministes :
– Femmes solidaires – Mme Sabine Salmon, président
– Osez le féminisme (OLF) – Mme Raphaëlle Rémy-Leleu, porte-parole
– Collectif national pour le droit des femmes (CNDF) – Mme Suzanne Rojtman, porte-parole, et Mme Odile Merckling, membre du collectif
(*) Ces représentants d’intérêts ont procédé à leur inscription sur le registre de l’Assemblée nationale, s’engageant ainsi dans une démarche de transparence et de respect du code de conduite établi par le Bureau de l’Assemblée nationale.
1 () Mme Mathilde Pak, « Le travail à temps partiel », Direction de l’animation, de la recherche, des études et des statistiques (DARES), Synthèse.Stat n° 4, juin. 2013.
2 () DARES Analyses, « Femmes et hommes sur le marché du travail », mars 2015, n° 17.
3 () DARES Analyses, « Femmes et hommes sur le marché du travail », mars 2015, n° 17.
4 () DARES Analyses, « Ségrégation professionnelle et écarts de salaires femmes-hommes », novembre 2015, n° 82.
5 () Mme Jacqueline Laufer, « L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes », Repères, 2014.
6 () Mme Jacqueline Laufer, Ibid.
7 () Délégation aux droits des femmes de l’Assemblée nationale, audition du 7 décembre 2016.
8 () Défenseur des droits, « Accès à l’emploi et discriminations liées à l’origine », septembre 2016.
9 () Compte rendu de l’audition par la Délégation aux droits des femmes de l’Assemblée nationale de M. Régis Bac, chef du service des relations et des conditions de travail de la direction générale du travail (DGT), du ministère du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, de Mme Claire Scotton, adjointe au sous-directeur des relations individuelles et collectives du travail, au service des relations et des conditions de travail, et de Mme Catherine Pernette, cheffe du bureau du pilotage du système d’inspection du travail, au service de l’animation territoriale de la politique du travail et de l’inspection du travail de la DGT, sur la mise en œuvre des dispositions adoptées en matière d’égalité professionnelle, mercredi 14 décembre 2016.
10 () Cf. compte rendu de l’audition de la Délégation aux droits des femmes de l’Assemblée nationale du 14 décembre 2016.
11 () Cf. compte rendu de l’audition de la Délégation aux droits des femmes de l’Assemblée nationale du 14 décembre 2016.
12 () Idem.
13 () Délégation aux droits des femmes de l’Assemblée nationale, audition sur l’égalité professionnelle de Mme Bénédicte Ravache, secrétaire générale de l’Association nationale des directeurs.trices des ressources humaines (ANDRH), Mme Géraldine Fort, déléguée générale de l’Observatoire de la responsabilité sociétale des entreprises, Mme Lydie Recorbet, chargée des questions d’égalité femmes-hommes à l’ORSE, et M. Michel Miné, professeur de droit du travail au Conservatoire national des arts et métiers (CNAM), membre du Conseil supérieur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (CESP), mercredi 7 décembre 2016.
14 () Cf. Commentaire de l’article premier.
15 () Le régime des heures complémentaires doit être distingué de celui du « complément d’heures » (cf. commentaire de l’article 6 du présent rapport).
16 () Bilan de la négociation collective pour l’année 2015.
17 () Aux termes de l’article L. 3121-36 du code du travail, à défaut d’accord, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire de travail ou de la durée considérée comme équivalente donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des premières heures supplémentaires, et de 50 % pour les heures suivantes.
18 () Michel Miné, Droit des discriminations dans l’emploi et le travail, 2016.
19 () La période de congé minimale prévue par la convention n° 183 de l’OIT est de quatorze semaines.
20 () Directive 92/85/CEE du Conseil du 19 octobre 1992, concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail.
21 () Résolution législative du Parlement européen du 20 octobre 2010 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil portant modification de la directive 92/85/CEE du Conseil concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail (COM(2008)0637 – C6-0340/2008 – 2008/0193(COD)).
22 () Le congé de paternité peut également être pris par le conjoint salarié de la mère, ou par la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité, ou par la personne vivant maritalement avec elle.
23 () Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES), « Le congé de paternité : un droit exercé par sept pères sur dix », Études et résultats, n° 957, mars 2016.
24 () Jacqueline Laufer, L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, Repères, 2014.
25 () Observatoire français des conjonctures économiques (OFCE), Hélène Périvier, « Le partage du congé parental : un impératif d’égalité », septembre 2013.
26 () Loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes.
27 () Dans les familles ayant un seul enfant en charge. Données issues de la Lettre de l’observatoire national de la petite enfance, septembre 2016.
28 () INSEE, Enquête Emploi et module complémentaire sur la conciliation entre vie familiale et vie professionnelle, 2010.
29 () OFCE, Hélène Périvier, « Réduire les inégalités professionnelles en réformant le congé paternité », Policy Brief n° 11, janvier 2017.
30 () Jacqueline Laufer, Ibid.
31 () OFCE, Ibid.
32 () Ifop, 8e baromètre Défenseur des droits/ Organisation internationale du travail de perception des discriminations dans l’emploi, enquête auprès des demandeurs d’emploi, janvier 2015.
33 () CESE, « Femmes et précarité », étude présentée par Mme Éveline Duhamel et M. Henri Joyeux, rapporteurs au nom de la délégation aux droits des femmes et à l’égalité, janvier 2013.
34 () Jacqueline Laufer, L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, Repères, 2014.