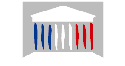______
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 31 janvier 2017.
RAPPORT
FAIT
AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES SUR LE PROJET DE LOI autorisant l’adhésion de la France au deuxième protocole relatif à la convention de La Haye de 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé,
PAR M. Philippe BAUMEL
Député
——
ET
ANNEXE : TEXTE DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
Voir le numéro :
Assemblée nationale : 4263
___
Pages
INTRODUCTION 5
I. LE CADRE GÉNÉRAL DE LA PROTECTION INTERNATIONALE DES BIENS CULTURELS EN TEMPS DE GUERRE 7
A. LA PROTECTION DES BIENS CULTURELS EN TEMPS DE GUERRE, UNE PRÉOCCUPATION CROISSANTE 7
B. LES INSTRUMENTS INTERNATIONAUX 9
1. La convention de La Haye pour la protection des biens culturels 10
2. Les conventions de l’UNESCO 10
3. Le statut de la Cour pénale internationale 11
C. LES LIMITES DES INSTRUMENTS EXISTANTS 11
1. La « nécessité militaire », une exception inévitable, mais difficile à délimiter 12
2. Le poids des enjeux politiques 12
3. La dispersion des initiatives et des instruments 12
4. Des instruments qui ne sont pas universels 13
5. Un contexte encore compliqué par la multiplication des « États faillis » 13
II. LES APPORTS DU DEUXIÈME PROTOCOLE À LA CONVENTION DE 1954 15
A. LES DISPOSITIONS GÉNÉRALES 15
B. UNE PRÉVENTION RENFORCÉE POUR LA SAUVEGARDE DES BIENS CULTURELS 16
C. UN ENCADREMENT PLUS STRICT DES UTILISATIONS MILITAIRES OU ATTAQUES « LICITES » DES BIENS CULTURELS 17
D. DE LA PROTECTION « SPÉCIALE » À LA PROTECTION « RENFORCÉE » 17
E. DES OBLIGATIONS NOUVELLES EN MATIÈRE DE POURSUITE DES AUTEURS D’ATTEINTES AUX BIENS CULTURELS 19
F. UN DISPOSITIF ÉTENDU, SOUS CONDITIONS, AUX CONFLITS NON INTERNATIONAUX 20
G. UN DISPOSITIF INSTITUTIONNEL RENFORCÉ 21
H. LES DISPOSITIONS FINALES 22
III. LES ENJEUX DE L’ADHÉSION DE LA FRANCE AU DEUXIÈME PROTOCOLE À LA CONVENTION DE 1954 25
A. UN INSTRUMENT AUQUEL N’ONT PAS ADHÉRÉ LES AUTRES MEMBRES PERMANENTS DU CONSEIL DE SÉCURITÉ 25
B. UN INSTRUMENT ENCORE MODÉRÉMENT SOLLICITÉ 26
1. Un recours limité à la « protection renforcée » 26
2. Deux exemples d’application à des pays en guerre : le Mali et la Libye 26
C. UNE VOLONTÉ D’EXEMPLARITÉ ET D’ENTRAÎNEMENT 27
D. UN DISPOSITIF QUI CONTRAINDRA NOTRE PAYS À DES ADAPTATIONS 29
1. En matière de gestion des actions militaires 29
a. Des moyens militaires qui permettent de respecter les exigences du protocole 29
b. Toutefois, des réserves interprétatives destinées à protéger nos combattants en opérations extérieures 29
i. La confirmation de l’exception de « nécessité militaire impérative » 30
ii. La clarification de la notion de « légitime défense immédiate » 30
2. En matière de droit pénal 31
a. Un droit pénal français qui satisfait déjà la plupart des exigences du protocole 31
b. Mais des aménagements nécessaires dans certains domaines 33
i. Vers un élargissement limité des incriminations en matière d’atteintes aux biens culturels 33
ii. Vers un élargissement mesuré de la compétence extraterritoriale de la justice française s’agissant des atteintes les plus graves aux biens culturels 33
3. En matière de protection de notre patrimoine culturel 36
a. Le renforcement ou l’actualisation des plans de sauvegarde des monuments 36
b. Vers l’élaboration d’une liste française de biens bénéficiant de la « protection renforcée » ? 37
ANNEXE N° 1 : TEXTE ADOPTÉ PAR LA COMMISSION 43
ANNEXE N° 2 : LISTE DES ÉTATS PARTIES AU DEUXIÈME PROTOCOLE À LA CONVENTION DE LA HAYE 45
Mesdames, Messieurs,
Depuis 2012, des dégradations sans précédent ont été commises à l’encontre de monuments prestigieux ou de sites archéologiques célèbres dans plusieurs pays, tels que le Mali, la Syrie et l’Irak. Ces dégradations sont survenues à l’occasion de conflits armés internes. Elles dépassent largement les simples « dégâts collatéraux » résultant d’actions militaires : à Tombouctou, à Palmyre, à Nimrud et dans bien d’autres lieux, des monuments remontant parfois à la plus haute antiquité ont été vandalisés et détruits à l’explosif de manière délibérée, car ils étaient du point de vue des vandales des symboles honnis du « paganisme » ou de formes soi-disant déviantes de la religion dont ils se revendiquent. Dans le même temps, le pillage et le trafic international des objets archéologiques transportables sont devenus une véritable industrie mise au service du financement de groupes terroristes.
Même si les atteintes, accidentelles ou délibérées, aux biens culturels ne sont pas une nouveauté – elles ont toujours été inhérentes aux guerres –, il y a donc bien une situation d’urgence liée à l’actualité.
La communauté internationale a développé progressivement des instruments juridiques pour sanctionner les atteintes injustifiées aux biens culturels durant les conflits armés, en particulier la convention pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé adoptée à La Haye en 1954. Les instruments existants sont certes plus ou moins efficaces, mais ils ont permis aux tribunaux internationaux, par exemple lors du conflit en ex-Yougoslavie ou plus récemment lors du conflit au Mali, de prononcer des condamnations pénales sur le fondement de la destruction de biens culturels.
La convention de La Haye a été complétée, en 1999, par un deuxième protocole qui en renforce de manière conséquente les prescriptions, notamment : en prenant en compte les conflits non internationaux ; en encadrant beaucoup plus strictement la notion de « nécessité militaire impérative », laquelle permet seule des atteintes « licites » aux biens culturels en temps de guerre ; en instituant un régime de « protection renforcée » plus protecteur pour les biens culturels les plus précieux ; enfin, en obligeant précisément ses signataires à incriminer, poursuivre au pénal, le cas échéant extrader les auteurs d’atteintes graves aux biens culturels en temps de conflit armé.
Dans un premier temps, la France n’a pas adhéré à ce deuxième protocole, suivant en cela la position de nombreux grands pays, dont tous les membres permanents du Conseil de sécurité des Nations-Unies.
Mais, on l’a dit, il existe aujourd’hui une situation d’urgence spécifique concernant les destructions et pillages de biens culturels. La France, au regard de l’exceptionnelle richesse de son patrimoine culturel et de l’ancienneté de ses traditions de protection de celui-ci, se doit d’être exemplaire dans la lutte internationale contre les destructeurs, pillards et trafiquants de biens culturels. C’est dans ce contexte qu’il est envisagé pour notre pays d’adhérer au deuxième protocole de 1999 à la convention de La Haye de 1954. L’objet du présent projet de loi est d’autoriser cette adhésion.
Même si les pratiques de nos forces armées en opérations extérieures, qui disposent d’armes de précision, et notre droit pénal sont déjà conformes à l’essentiel des stipulations du protocole de 1999, les contraintes très précises qu’il comporte obligeront notre pays à certains ajustements en matière de droit pénal, ainsi qu’à actualiser les plans de sauvegarde établis en temps de paix pour protéger les biens culturels dans l’hypothèse d’un conflit armé. Par ailleurs, l’adhésion envisagée devrait être accompagnée du dépôt par la France de plusieurs réserves interprétatives destinées à protéger nos combattants en opérations extérieures et à éviter d’avoir à donner à la justice française une compétence quasi-universelle pour la répression des atteintes les plus graves aux biens culturels.
La communauté internationale a progressivement développé des instruments juridiques destinés spécifiquement à la protection du patrimoine culturel en temps de guerre. Ces instruments restent toutefois d’une efficacité relative, alors même que les atteintes aux biens culturels semblent devenir de plus en plus systématiques dans les conflits les plus récents.
On considère en général que les biens culturels sont exposés durant les conflits armés à trois types de dommages :
– la destruction ou la dégradation par « dommage collatéral », que ces biens aient été touchés par erreur ou bien délibérément au cas où ils auraient été utilisés à des fins militaires ;
– la destruction ou dégradation délibérée dans le cadre d’une opération d’épuration culturelle, idéologique ou religieuse ;
– le vol et le pillage.
Dans son récent rapport sur la protection du patrimoine de l’humanité (1), M. Jean-Luc Martinez, président du Louvre, signale un quatrième danger : l’abandon des sites et/ou l’interruption du fonctionnement normal des administrations.
Les « dommages collatéraux » constituent la figure la plus classique des atteintes aux biens culturels dans les guerres du XXème siècle.
Toutefois, il est parfois difficile de distinguer « dommage collatéral » et destruction délibérée de monuments, voire de villes d’art, ayant pour l’adversaire une forte valeur symbolique. En septembre 1914, l’opinion publique française a ainsi été aisément convaincue que c’est délibérément que l’artillerie allemande avait incendié la cathédrale de Reims. Plus récemment, le pilonnage par les forces serbes de la vieille ville de Dubrovnik, en Croatie, fin 1991, a suscité une vive émotion ; le débat s’est inévitablement centré sur l’utilité militaire de cette agression (qui serait alors restée un « dommage collatéral ») ou non : la justice internationale a plutôt conclu qu’il y avait bien eu dévastation délibérée de biens culturels sans justification militaire, ce qui justifiait de lourdes peines d’emprisonnement (2).
Puis les destructions effectuées au nom d’une version radicalisée et déviante de l’islam ont illustré, d’une manière encore plus incontestable, la rémanence de la destruction systématique de biens culturels en tant que tels, pour des raisons de type idéologique. On a ainsi assisté à la destruction, en mars 2001, des Bouddhas géants de la vallée de Bâmiyân par les talibans afghans, puis en juillet 2012 à celle d’une partie des mausolées de Tombouctou au Mali, enfin, tout dernièrement, aux multiples et très médiatisés dynamitages de Daech à Palmyre ou dans les sites assyriens d’Irak et de Syrie. Au total, selon l’UNESCO, le conflit syrien a, d’une manière ou d’une autre, affecté la totalité des six biens inscrits au Patrimoine mondial dans ce pays et des onze sites inscrits sur sa « liste indicative » (liste de biens proposés à l’inscription au Patrimoine mondial). Il faut cependant observer que les extrémistes se réclamant de l’islam n’ont pas, dans notre monde contemporain, le monopole des destructions de biens culturels pour des motifs pseudo-religieux : le 6 décembre 1992, à Ayodhya en Inde, c’est une foule fanatisée par des extrémistes hindouistes qui a entrepris la démolition de la mosquée Babri Masjid sous prétexte qu’elle aurait été construite à l’emplacement d’un ancien temple hindou.
On pouvait aussi croire que le pillage des antiquités et œuvres d’art, massivement pratiqué dans le passé, il faut bien l’admettre, par les armées européennes, appartenait justement à ce passé. Les déboires du musée de Bagdad et d’autres musées irakiens suite à l’intervention américaine de 2003 nous ont malheureusement rappelé que les situations de conflit offraient de terribles opportunités aux pillards. Puis, un pas a été franchi avec Daech, qui a institutionnalisé le pillage des objets archéologiques transportables et vendables. Début 2015, l’organisation contrôlait 2 500 sites archéologiques en Irak et 4 500 en Syrie. D’après les estimations recueillies par la mission d’information sur les moyens de Daech (3) de nos collègues Jean-Frédéric Poisson et Kader Arif, les revenus tirés par cette organisation du trafic d’objets archéologiques représenteraient entre quelques millions et 150 millions de dollars par an, l’exploitation de cette ressource étant limitée par les méthodes peu sophistiquées de « fouilles » employées. La mission observe que « se considérant comme un État, l’organisation terroriste s’est attribuée des prérogatives en matière d’exploitation du sol qu’il occupe et a mis en place un véritable "département des antiquités". Daech délivre ainsi des autorisations de fouilles à des trafiquants contre rétribution. Si le trafic d’œuvres d’art dans cette région du monde n’est pas né avec Daech, force est de constater que Daech l’a, en quelque sorte, industrialisé ».
Enfin, la simple situation d’abandon des sites et de non-application des règles de protection qui résulte souvent des conflits armés, notamment dans les « États faillis », peut aussi avoir de graves conséquences pour les biens culturels. Le rapport précité de M. Jean-Luc Martinez évoque plusieurs exemples significatifs, tels que l’urbanisation non contrôlée qui grignote le site antique d’Apollonia en Libye.
Ces constats de plus en plus inquiétants démontrent que la protection des biens culturels en temps de conflit armé doit bien être une préoccupation croissante de la communauté internationale.
La communauté internationale a progressivement mis en place des instruments destinés à introduire le respect des biens culturels dans le droit de la guerre.
Les instructions données en 1863 (pendant la Guerre de sécession) aux armées américaines, connues sous le nom de Lieber Code, sont souvent citées comme le premier ou l’un des premiers règlements militaires à avoir prescrit la préservation, autant que possible, de diverses catégories de biens culturels, ce même lorsqu’ils étaient situés dans une place forte assiégée ou bombardée.
Ces principes ont ensuite été étendus au niveau international. Les conférences internationales de la paix réunies à La Haye en 1899 et 1907 ont débouché sur l’adoption de plusieurs conventions, dites de La Haye, qui forment la base du droit moderne de la guerre (et sont considérées comme ayant une valeur coutumière, donc s’imposant même aux non-signataires). L’article 27 de la convention concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre (4) stipule ainsi que, « dans les sièges et bombardements, toutes les mesures nécessaires doivent être prises pour épargner, autant que possible, les édifices consacrés aux cultes, aux arts, aux sciences et à la bienfaisance, les monuments historiques, les hôpitaux et les lieux de rassemblement de malades et de blessés, à condition qu’ils ne soient pas employés en même temps à un but militaire. Le devoir des assiégés est de désigner ces édifices ou lieux de rassemblement par des signes visibles spéciaux qui seront notifiés d’avance à l’assiégeant ». Le principe du respect des biens culturels est donc posé, avec les réserves du « possible » et de leur non-utilisation à des fins militaires. Le principe de la signalisation de ces biens est également présent.
Pour autant, le moins que l’on puisse dire est que les biens culturels n’ont pas été particulièrement respectés durant les deux guerres mondiales, marquées par des destructions sans précédent, même si cette préoccupation a parfois été prise en compte dans des décisions militaires (avec, par exemple, le retrait de l’ancienne capitale impériale japonaise Kyôto de la liste des cibles potentielles des premières bombes atomiques américaines).
La convention pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé a été adoptée à La Haye en 1954 à la suite des destructions massives de la Seconde guerre mondiale. Elle constitue le premier instrument international à vocation universelle qui soit exclusivement axé sur la protection du patrimoine culturel.
La convention de 1954 prévoit principalement :
– la mise en place en temps de paix de mesures préventives de sauvegarde ;
– le « respect » des biens culturels en s’abstenant de tout acte d’hostilité à leur encontre, mais aussi en s’interdisant toute utilisation qui pourrait les exposer à des dommages, avec toutefois une exception en cas de « nécessité militaire (…) impérative ». La convention engage donc toutes les parties aux conflits, non seulement les attaquants, mais aussi les défenseurs, qui doivent renoncer à un usage militaire des biens culturels ;
– la mise en place d’un régime spécifique de « protection spéciale » pour des abris de protection de biens culturels ou pour des biens culturels immobiliers « de très haute importance », lesquels doivent alors bénéficier d’une immunité inconditionnelle de toute attaque ;
– le marquage, par le signe du « bouclier bleu », des biens culturels à protéger ;
– le principe d’une pénalisation dans les droits nationaux des contrevenants à la convention.
Le premier protocole à la convention, signé également en 1954, vise à prohiber l’exportation de biens culturels depuis des territoires occupés.
Le deuxième protocole, signé en 1999, est l’objet du présent rapport. On y reviendra donc plus longuement.
Deux textes adoptés dans le cadre de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) ne sont pas centrés sur la protection du patrimoine culturel en temps de conflit armé, mais concernent des questions connexes et méritent d’être cités en raison notamment de la valorisation du patrimoine culturel qu’ils ont favorisée.
La convention de 1972 concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel, en faisant émerger la notion de « patrimoine mondial », a contribué considérablement à valoriser, de manière quasi-universelle, les biens culturels les plus prestigieux. On sait l’importance prise, dans la plupart des pays, par les procédures tendant à l’inscription de sites et monuments sur la fameuse « liste du patrimoine mondial » au titre de leur « valeur universelle exceptionnelle ».
La question des conséquences des conflits armés est incidemment mentionnée dans la convention de 1972 : ces conflits font partie, selon son article 11, paragraphe 4, des motifs possibles d’inscription d’un bien sur la « liste du patrimoine mondial en péril ». L’inscription d’un bien sur cette liste permet notamment de bénéficier, le cas échéant, d’une assistance dans le cadre du Fonds du patrimoine mondial.
La convention de 1970 concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l’importation, l’exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels est importante dans l’optique de la lutte contre les trafics consécutifs aux situations de conflit armé. Elle comprend pour ses signataires divers engagements complémentaires : mettre en place un régime de certificats d’exportation pour les biens culturels ; prendre toutes mesures pour empêcher l’acquisition, par les musées et autres institutions similaires, de biens culturels exportés illicitement ; interdire l’importation des biens culturels volés dans un musée ou une institution similaire ; prendre les mesures appropriées pour saisir et restituer à l’État d’origine les biens culturels volés.
Plus récemment (1998), il faut signaler que la prohibition des attaques contre des bâtiments culturels est intégrée au statut de Rome de la Cour pénale internationale, dont l’article 8 qualifie notamment de crime de guerre « le fait de diriger intentionnellement des attaques contre des bâtiments consacrés à la religion, à l’enseignement, à l’art, à la science ou à l’action caritative, des monuments historiques, des hôpitaux et des lieux où des malades ou des blessés sont rassemblés, à condition qu’ils ne soient pas des objectifs militaires ».
Cette disposition a en effet reçu une application tout dernièrement. C’est sur cette base que la Cour pénale internationale a condamné le 27 septembre 2016 à neuf ans de prison M. Ahmad Al Faqi Al Mahdi, djihadiste malien, pour son rôle dans la destruction, en 2012, de plusieurs mausolées de Tombouctou.
Malgré l’adoption de ces divers instruments internationaux, on doit souvent faire le constat qu’il est difficile pour les États ou les organisations internationales, confrontés à des atteintes majeures et délibérées au patrimoine culturel commun, de dépasser le stade de la condamnation verbale et de l’incantation pour agir effectivement et efficacement.
De fait, les instruments existants se heurtent à de nombreuses limites.
Une première limite tient au choix fait par les États signataires des différents textes de préserver, pour d’évidentes raisons de souveraineté en politique étrangère, l’exception de « nécessité militaire » pour justifier, dans certains cas, les atteintes au patrimoine culturel. Cette notion pose un évident problème de définition.
Un deuxième frein au déploiement de la protection internationale du patrimoine tient bien sûr aux enjeux politiques, qui pèsent sur les décisions. C’est ainsi qu’en 1972 la demande de « protection spéciale » exprimée par le Cambodge en guerre civile au bénéfice des sites d’Angkor s’était heurtée à l’opposition des pays du bloc soviétique ou proches de lui. Dans l’actualité, il est clair que le blocage relatif à l’ONU résultant de l’implication active d’un membre permanent du Conseil de sécurité dans le conflit syrien ne facilite pas la prise de mesures de protection du patrimoine de ce pays…
Le manque de coordination entre la mise en œuvre des différents instruments existants est souvent critiqué. Les appels au développement des « synergies » entre eux sont une figure récurrente des résolutions adoptées dans le cadre des réunions solennelles des États adhérents aux uns et aux autres.
Par exemple, la 3ème Réunion des États parties à la convention de 1970, tenue en mai 2015, a appuyé l’objectif de promotion des synergies avec les autres conventions culturelles de l’UNESCO dans l’une de ses résolutions. Une décision avait en outre déjà été adoptée à cet égard, dans une optique globale, visant à garantir que les conventions culturelles se renforcent mutuellement, en décembre 2014, lors de la 9ème réunion du Comité pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, qui est lié à l’application du deuxième protocole à la convention de La Haye de 1954 : le comité a invité la direction générale de l’UNESCO à tenir, au moins une fois par an, des réunions de consultation avec les présidents des organes statutaires établis par les conventions culturelles, dans cet objectif de développement de synergies. Cette réunion s’est tenue le 26 septembre 2016.
Une autre limite intrinsèque à tous les instruments internationaux tient bien sûr au fait qu’ils n’engagent que leurs signataires. Or, aucun n’est universel.
C’est ainsi, par exemple, que la convention de La Haye de 1954 ne compte (en janvier 2017) que 127 États parties, dont, il est vrai, l’essentiel des grands pays, même si certains d’entre eux n’ont déposé que tardivement leur instrument d’adhésion ou de ratification (la Chine l’a fait en 2000, les États-Unis en 2009…).
S’agissant du deuxième protocole à cette convention, qui est l’objet du présent rapport, il ne compte à ce jour, on y reviendra, que 69 États parties, et de très nombreux « grands pays » en sont absents.
Par ailleurs, des instruments internationaux comme ceux présentés supra s’adressent d’abord, par construction, aux États (qui en sont les négociateurs et les signataires). Et ils couvrent d’abord les situations classiques de conflits interétatiques ; par exemple, la convention de 1954 ne s’applique que très partiellement aux conflits ne présentant pas un caractère international.
Or, de plus en plus souvent, les conflits les plus destructeurs ravagent des « États faillis » qui ne contrôlent plus qu’une partie limitée de leur territoire, pour autant qu’ils disposent encore d’un gouvernement bénéficiant d’une reconnaissance internationale générale (ce qui n’est plus le cas de la Syrie, notamment). Pour le reste, les territoires de ces États sont largement contrôlés par des organisations non-étatiques qui ne sont ni sujets, ni objets du droit international classique, a fortiori lorsqu’il s’agit d’organisations terroristes…
Le deuxième protocole à la convention de La Haye de 1954, dont la ratification est l’objet un présent rapport, remonte à 1999 et constitue donc l’instrument de lutte pour la protection du patrimoine culturel le plus récent.
Il répond à plusieurs ambitions : renforcer la protection des biens culturels telle qu’établie par la convention de 1954 ; adapter le dispositif aux réalités des conflits contemporains, qui présentent de plus en plus souvent la forme de guerres civiles ou de guerres atypiques (sans déclaration de guerre) ; prendre en compte les autres évolutions du droit international, notamment la création de la Cour pénale internationale.
Ses principaux apports sont :
– la prise en compte des conflits non internationaux ;
– une plus grande exigence quant aux mesures préventives (en temps de paix) de protection du patrimoine culturel ;
– un encadrement juridique beaucoup plus strict de la notion de « nécessité militaire impérative », laquelle permet seule des atteintes « licites » aux biens culturels en temps de guerre ;
– la création d’une nouvelle catégorie de protection, la « protection renforcée » ;
– l’instauration d’obligations strictes en termes de poursuites pénales des auteurs d’atteintes graves aux biens culturels et de coopération internationale à cette fin (entraide judicaire et extradition).
Comme il se doit, le bref préambule du présent protocole en fixe les objectifs. Il s’agit « d’améliorer la protection des biens culturels en cas de conflit armé et d’établir un système renforcé de protection en faveur de biens culturels spécialement désignés » et de s’adapter aux évolutions du monde et du droit : « les règles régissant la protection des biens culturels en cas de conflit armé devraient refléter les développements du droit international ».
L’article 1er est consacré aux définitions. Il comprend notamment celle des « objectifs militaires », qui est très importante dans une optique d’encadrement strict des situations où des biens culturels peuvent licitement être l’objet d’opérations militaires. Un « objectif militaire » est « un objet qui, par sa nature, son emplacement, sa destination ou son utilisation, apporte une contribution effective à l’action militaire et dont la destruction totale et partielle, la capture ou la neutralisation offre en l’occurrence un avantage militaire précis ».
Les articles 2 à 4 définissent le champ d’application du présent protocole et précisent son insertion dans le droit international et sa combinaison avec les autres instruments en vigueur :
– il « complète » la convention de 1954 ;
– l’application du régime de « protection renforcée » créé par le protocole (voir infra) ne porte pas atteinte aux autres dispositions de protection des biens culturels contenues dans la convention de 1954 ou le présent protocole lui-même. Toutefois, pour un bien qui serait placé sous les deux types de protection, la « protection spéciale » prévue par la convention de 1954 et la nouvelle « protection renforcée », seule cette dernière serait applicable ;
– le présent protocole s’appliquera en temps de paix pour ses dispositions ad hoc, de conflit armé international ou d’occupation (du fait du renvoi aux articles 18, paragraphes 1 et 2, et 22, paragraphe 1, de la convention de 1954) ;
– le fait que l’une des parties à un conflit armé ne soit pas liée par le présent protocole n’empêche pas qu’il demeure applicable aux autres parties du conflit adhérentes au protocole dans leurs rapports réciproques ;
– un État non adhérent mais qui accepte et applique effectivement les dispositions du protocole peut l’invoquer dans ses relations avec un État adhérent (et partie au même conflit).
L’article 5 du protocole précise ce que sont les mesures préventives à prendre, le cas échéant, en temps de paix pour la sauvegarde des biens culturels contre les effets prévisibles d’un conflit armé (l’article 3 de la convention de 1954 se contentait de les mentionner de manière générale) :
– « l’établissement d’inventaires » ;
– « la planification de mesures d’urgence pour assurer la protection des biens contre les risques d’incendie ou d’écroulement » ;
– « la préparation de l’enlèvement des biens culturels meubles ou la fourniture d’une protection in situ adéquate desdits biens » ;
– « la désignation d’autorités compétentes responsables de la sauvegarde des biens culturels ».
C. UN ENCADREMENT PLUS STRICT DES UTILISATIONS MILITAIRES OU ATTAQUES « LICITES » DES BIENS CULTURELS
Les articles 6 à 9 portent sur le respect des biens culturels en cas de conflit armé. Ils précisent les cas dans lesquels peut être invoquée par une partie l’exception de « nécessité militaire impérative » au sens de l’article 4, paragraphe 2, de la convention de 1954 (article 6 du protocole), les précautions devant être prises dans la conduite des opérations militaires (article 7), les précautions devant être prises pour préserver les biens culturels des effets des attaques (article 8) et les règles de protection des biens culturels en territoire occupé (article 9).
Il faut relever que la convention de 1954 ne définit pas la « nécessité militaire impérative » qui est seule susceptible de justifier l’utilisation ou le ciblage militaires de biens culturels. L’article 6 du présent protocole répond à cette lacune en déterminant les cas de « nécessité militaire impérative » : pour viser un bien culturel, il faut qu’il ait été « par sa fonction (…) transformé en objectif militaire » et qu’« il n’existe pas d’autre solution pratiquement possible pour obtenir un avantage militaire équivalant à celui qui est offert par le fait de diriger un acte d’hostilité contre cet objectif ». L’exigence d’absence de solution donnant un « avantage militaire équivalent » est posée également pour justifier l’utilisation éventuelle d’un bien culturel à des fins militaires.
De plus, la décision d’invoquer une nécessité militaire impérative ne doit être prise que « par le chef d’une formation égale ou supérieure en importance à un bataillon ». Enfin, en cas d’attaque contre un bien culturel, un avertissement doit être envoyé en temps utile. Les « circonstances » autorisent cependant à déroger à ces deux dernières obligations.
L’article 9, concernant les situations d’occupation, est également important en ce qu’il rend responsable la puissance occupante de tout transfert ou exportation illicites de biens culturels, de tout changement d’usage de ces biens et de toute fouille archéologique qui ne serait pas « absolument indispensable » à des fins de sauvegarde. Fouilles et changements d’usage devraient s’opérer en étroite coopération avec les autorités du pays occupé. Il est à noter que la convention de 1954 comprend bien déjà, à son article 5, des dispositions concernant les situations d’occupation, mais ne mentionne pas spécifiquement les problèmes liés aux fouilles archéologiques et aux changements d’usage de biens culturels.
Le chapitre III du protocole traite du régime applicable à la « protection renforcée », innovation majeure du texte, car plus exigeant que celui de la « protection spéciale » institué par la convention de 1954 pour des biens culturels particulièrement importants.
L’article 10 définit les biens susceptibles de bénéficier de ce nouveau régime. Ils doivent, cumulativement :
– revêtir « la plus haute importance pour l’humanité » ;
– bénéficier dans le système juridique et administratif interne des pays d’une protection adéquate (un classement patrimonial accompagné d’une protection effective) ;
– ne pas être utilisés à des fins militaires.
L’article 11 établit la procédure d’inscription des biens culturels sur la liste de ceux bénéficiant de la « protection renforcée ». Cette procédure relève du « Comité pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé » (créé par les articles 24 et suivants du présent protocole : voir infra). Cette inscription doit être demandée par les États concernés ; elle peut éventuellement être l’objet de recommandations du comité lui-même ou d’ONG spécialisées.
Il est à noter que les décisions d’inscription sont prises à la majorité des quatre cinquièmes des membres votants du comité, alors qu’en pratique les décisions relatives à l’inscription sur la liste des biens bénéficiant de la « protection spéciale » au sens de la convention de 1954 doivent se faire par consensus, du fait du droit d’opposition dont dispose toute partie à cette convention.
L’article 12 prévoit l’immunité des biens sous « protection renforcée » : les parties au protocole doivent s’interdire toute attaque ou utilisation militaire de ces biens et de leurs abords immédiats.
L’article 13 détermine les cas de perte de l’immunité afférente à la protection renforcée, c’est-à-dire de dérogations aux obligations susmentionnées. C’est notamment le cas lorsque le bien placé sous protection devient un « objectif militaire » – la définition d’un tel objectif étant donnée à l’article 1erdu présent protocole (voir supra).
Dans ce cas de figure, le bien peut être attaqué, mais seulement à condition que cette attaque soit « le seul moyen pratiquement possible de mettre fin à l’utilisation » militaire en cause et que « toutes les précautions pratiquement possibles [aient été] prises quant au choix des moyens et des méthodes d’attaque en vue de mettre un terme à cette utilisation et d’éviter ou, en tout cas, de réduire au minimum les dommages causés à ce bien culturel ».
Il est à noter que l’on trouve la même exigence de précaution pour l’attaque des biens culturels en général à l’article 7 du présent protocole ou encore, plus généralement, pour tout risque concernant les dommages aux civils et à leurs biens, à l’article 57,§ 2-a-ii, du protocole additionnel I aux conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux, mais avec une nuance significative : ces textes ne concernent que les dommages « qui pourraient être causés incidemment », c’est-à-dire les dommages dits collatéraux. Cette limitation n’apparaît pas dans le présent article 13.
Par ailleurs, l’attaque éventuelle d’un bien sous « protection renforcée » devenu un « objectif militaire » est également conditionnée à ce que l’ordre d’attaquer soit donné « au niveau le plus élevé du commandement opérationnel » et ait été précédé d’un avertissement et d’un délai raisonnable de prévenance. Il est toutefois possible de déroger à ces dernières obligations « en raison des exigences de la légitime défense immédiate ».
L’ensemble de ces dispositions concernant la levée de l’immunité des biens sous « protection renforcée » sont beaucoup plus contraignantes que celles inscrites à l’article 11 de la convention de 1954 s’agissant de la levée de l’immunité des biens sous « protection spéciale », laquelle est selon ce texte possible, de manière générique, en tous « cas exceptionnels de nécessité militaire inéluctable » constatée par un officier ayant au moins rang de général de division.
Enfin, l’article 14 du présent protocole prévoit que la « protection renforcée » d’un bien peut être suspendue, voire annulée (retrait de la liste) dans les cas les plus graves, par le comité susmentionné en cas notamment d’utilisation militaire du bien concerné.
Le chapitre IV du protocole, comprenant les articles 15 à 21, institue des obligations strictes et précises pour les États adhérents en matière de poursuites pénales contre les auteurs d’atteintes aux biens culturels. Ce dispositif va bien au-delà de celui de la convention de 1954, dont l’article 28 pose simplement une obligation générique aux parties de « prendre (…) toutes mesures nécessaires pour que soient recherchées et frappées de sanctions pénales ou disciplinaires les personnes, quelle que soit leur nationalité, qui ont commis ou donné l'ordre de commettre une infraction à la présente convention ».
L’article 15 du protocole fait obligation aux États parties d’incriminer dans leur droit pénal interne les infractions au protocole, qualifiées de « violations graves », que sont les faits :
– d’attaquer un bien culturel sous protection renforcée ;
– d’utiliser un bien culturel sous protection renforcée ou ses abords immédiats à l’appui d’une action militaire ;
– de détruire ou s’approprier sur une grande échelle des biens culturels protégés par la convention et le protocole ;
– d’attaquer un bien culturel couvert par la convention et le protocole ;
– de voler, piller, détourner, vandaliser des biens culturels protégés par la convention.
L’article 16 oblige les États adhérents à adopter une compétence large de leur justice pour la répression des atteintes aux biens culturels susmentionnées : cette compétence doit s’étendre non seulement aux actes commis sur leur territoire, mais aussi à ceux commis (à l’étranger) par leurs ressortissants et même, pour les trois premières infractions susmentionnées (atteintes aux biens placés sous « protection renforcée » ou à « grande échelle »), à ceux commis par des personnes « présentes » sur leur territoire.
Cependant, il est précisé que cette obligation de compétence élargie ne s’applique pas dans le cas de ressortissants et militaires d’un État qui ne serait pas partie au protocole.
L’article 17 institue une obligation d’engager les poursuites pénales dans les cas susmentionnés et comprend une clause générique de droit au « procès équitable » pour les personnes mises en cause.
L’article 18 institue des obligations en matière d’extradition s’agissant des trois premières infractions susmentionnées (atteintes aux biens placés sous « protection renforcée » ou à « grande échelle ») : ces infractions sont réputées incluses dans tout traité d’extradition conclu entre États parties et doivent l’être dans tout traité d’extradition futur ; en l’absence d’un tel traité, la commission de ces infractions doit justifier l’extradition entre États parties, sauf si leur droit interne subordonne celle-ci à l’existence d’un traité ad hoc (auquel cas l’État requis peut considérer le protocole comme fondant en droit une extradition, mais n’y est pas tenu).
L’article 19 prévoit l’entraide judiciaire la plus large entre les États parties concernant les atteintes aux biens culturels.
Selon l’article 20, l’extradition et/ou l’entraide judiciaire en matière d’atteintes aux biens culturels ne devraient pas pouvoir être refusées en arguant du caractère « politique » des actes justifiant les poursuites. En revanche, elles peuvent l’être si les procédures en cause apparaissent discriminatoires.
Enfin, l’article 21, concernant les « autres infractions » (que les « infractions graves » traitées supra), prévoit de manière plus vague que les États parties doivent adopter des mesures pour faire cesser les utilisations et exportations depuis un territoire occupé de biens culturels en violation de la convention de 1954 ou du présent protocole.
Le texte de la convention de 1954 est peu exigeant s’agissant des conflits armés ne présentant pas un caractère international (les guerres civiles) : il prévoit seulement (à son article 19) une obligation d’appliquer les dispositions générales de respect des biens culturels, mais pas les mesures spécifiques telles que la « protection spéciale » ou la signalisation des biens à protéger.
L’article 22 (chapitre V) du présent protocole apparaît donc novateur en prévoyant l’applicabilité du protocole « en cas de conflit armé ne présentant pas un caractère international et surgissant sur le territoire de l’une des parties ».
Pour information, des pays tels que la Libye et le Mali ont adhéré au protocole (mais pas la Syrie ou l’Irak…).
Il faut toutefois signaler la présence de plusieurs clauses, destinées à préserver la souveraineté des États, qui limitent la portée de l’article 22 :
– le protocole ne s’applique pas « aux situations de tensions internes, de troubles intérieurs, comme les émeutes, les actes isolés et sporadiques de violence et autres actes analogues » ;
– il ne porte pas atteinte à la responsabilité des gouvernements dans le maintien de l’ordre et la défense de l’unité nationale par des « moyens légitimes » ;
– il ne saurait servir de prétexte « à une intervention directe ou indirecte, pour quelque raison que ce soit, dans le conflit armé ou dans les affaires intérieures ou extérieures » du pays concerné par le conflit civil…
Les articles 23 à 28 prévoient la gouvernance du présent protocole. Il est institué une « Réunion des parties », laquelle élit en son sein un « Comité pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé ».
Le comité comporte douze membres, élus pour quatre ans et immédiatement rééligibles une seule fois ; il doit assurer une « représentation équitable » des différents continents et cultures. Le comité se réunit en session ordinaire une fois par an et s’est réuni à ce jour onze fois depuis sa première session en 2006. Il doit coopérer avec les ONG internationales spécialisées et s’appuie sur le secrétariat de l’UNESCO.
Le comité, outre des missions générales de détermination de principes directeurs, suivi et supervision, a notamment pour attribution d’accorder (et retirer éventuellement) la « protection renforcée » aux biens culturels (voir supra).
L’article 29 institue un « Fonds pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé ». Ce fonds est alimenté par des contributions volontaires des États, de l’UNESCO et de divers organismes, organisations ou personnes. Son utilisation est décidée par le Comité pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé. Il est destiné à financer, soit des mesures préventives de sauvegarde du patrimoine, soit des mesures d’urgence et de protection en période de conflit armé, soit enfin des mesures de rétablissement immédiatement après la fin des hostilités.
Le fonds est opérationnel depuis 2009, mais, mi-2012, son alimentation restait modeste : un peu plus de 265 000 dollars provenant de quatre pays donateurs (Estonie, Finlande, Pays-Bas et Slovaquie) (5).
L’article 30 promeut la sensibilisation au respect des biens culturels et, plus particulièrement, la diffusion de la connaissance du présent protocole.
Les articles 31 à 33 concernent la coopération et l’assistance internationales :
– l’article 31 pose un principe général de coopération internationale en cas de violations graves du protocole ;
– l’article 32 régit les demandes d’assistance internationale que les parties peuvent soumettre au Comité pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé pour leurs biens culturels placés sous « protection renforcée » ou l’élaboration et l’application de lois de protection ;
– l’article 33 prévoit que le concours de l’UNESCO peut également être demandé (concours que l’organisation n’apportera toutefois que « dans les limites de son programme et de ses possibilités »).
Les articles 34 à 36 établissent des procédures de conciliation sur l’interprétation et l’application du présent protocole dans les situations de conflit armé entre des États parties. Il peut être recouru aux bons offices du directeur général de l’UNESCO, ou, s’il y en a, aux « puissances protectrices ». Les « puissances protectrices » sont des États neutres ou du moins non engagés dans le conflit armé en cause qui sont désignés comme telles par l’un des belligérants et acceptés par l’autre. Les « puissances protectrices » jouent un rôle de bons offices entre les parties en conflit pour assurer le respect du droit international humanitaire dans le système des conventions de Genève de 1949 et de la convention de La Haye de 1954.
L’article 37 stipule que tous les quatre ans les États parties soumettent un rapport sur la mise en œuvre du protocole.
L’article 38 rappelle que le protocole, traitant notamment de la responsabilité pénale des individus, n’affecte pas la responsabilité des États en droit international, en particulier l’obligation de réparation.
Les articles 39 à 47 comportent les habituelles dispositions finales (signature, ratification, entrée en vigueur, dénonciation, etc.).
On relève notamment que le texte est établi en six versions faisant également foi, en anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe, car il appartient au dispositif onusien et ce sont les langues officielles des Nations-Unies (article 39). Dans le même esprit, les instruments de ratification sont à déposer auprès du directeur général de l’UNESCO (article 41) et le protocole est enregistré au secrétariat général de l’ONU (article 47).
Conformément à son article 43, selon lequel il devait entrer en vigueur trois mois après le dépôt du vingtième instrument de ratification, le présent protocole est en force depuis le 9 mars 2004.
Par rapport à la convention de 1954 qu’il complète, le deuxième protocole de 1999 constitue un véritable progrès car il pose des obligations juridiques précises, donc contraignantes. C’est notamment le cas quant à la définition des situations de « nécessité militaire impérative » qui seules peuvent justifier qu’un bien culturel ne soit pas pleinement respecté en temps de guerre. C’est aussi le cas quant à l’obligation de poursuivre pénalement, avec une compétence juridictionnelle large, ou, le cas échéant, d’extrader les auteurs d’atteintes graves au patrimoine culturel.
Ceci fait l’intérêt du texte, mais explique aussi que l’adhésion à ses dispositions ne puisse être envisagée à la légère. De fait, le protocole a suscité jusqu’à présent une adhésion internationale limitée, en particulier dans le cercle étroit des puissances qui conduisent parfois des interventions militaires extérieures.
Dans ce contexte, l’adhésion de la France aura une vraie valeur d’exemplarité. Mais il faut aussi être conscient des enjeux qui s’y attachent et des adaptations qu’elle exigera dans notre droit et notre fonctionnement administratif.
Le présent protocole reste pour le moment signé et ratifié par une minorité d’États du monde. D’après l’UNESCO, ils seraient aujourd’hui 69 à être liés par le texte. Leur liste est donnée en annexe du rapport, car elle est très significative. On peut en dégager quelques lignes de force :
– le protocole a surtout rencontré du succès dans ces continents plutôt « pacifiés » que sont l’Europe (30 adhérents sur le continent) et l’Amérique latine (17 adhérents) ;
– notamment, 20 États membres de l’Union européenne ont adhéré au protocole, dont la plupart des « grands » pays (Allemagne, Italie, Espagne, Pologne…) ;
– toutefois, ce n’est pas le cas du Royaume-Uni, qui serait en cours d’adhésion, comme l’est la France. Chine, États-Unis et Russie n’étant pas non plus signataires, aucun membre permanent du Conseil de sécurité des Nations-Unies n’est pour le moment tenu par les dispositions du protocole. Or, pour le meilleur ou pour le pire, ces membres permanents sont aussi les principales puissances militaires « interventionnistes »…
– d’autres puissances majeures, comme l’Inde, sont également dans la même situation ; de manière générale, les pays d’Asie orientale et méridionale, zone de fortes tensions, sont absents du protocole, à quelques exceptions près, comme le Japon et le Cambodge ;
– au Moyen-Orient, un certain nombre de pays ont adhéré (notamment l’Arabie Saoudite, l’Égypte et l’Iran), mais pas tous (l’Irak et la Syrie restent en-dehors). La Palestine est également signataire, tandis qu’Israël ne l’est pas ;
– enfin, une dizaine de pays africains seulement sont parties au protocole, dont certains directement concernés par des situations de conflit armé interne (notamment la Libye, le Mali et le Nigeria).
Il faut par ailleurs admettre que les outils de protection mis à disposition par le deuxième protocole restent pour le moment assez peu sollicités. Il est vrai que le texte n’est en vigueur que depuis 2004 et est donc encore récent.
Pour le moment, la « protection renforcée », apport parmi les plus significatifs du deuxième protocole, n’a été accordée qu’à douze sites, tous inscrits sur la « liste du patrimoine mondial » de l’UNESCO, répartis entre sept pays : l’Azerbaïdjan, la Belgique, Chypre, la Géorgie, l’Italie, la Lituanie et le Mali.
Parmi les États parties au deuxième protocole, on trouve notamment deux pays aujourd’hui frappés par des conflits armés internes, le Mali et la Libye. L’examen de leur cas montre l’intérêt, mais aussi les limites du texte.
Confrontées depuis mars 2012 à un conflit armé interne sur leur territoire, les autorités maliennes ont décidé, alors même que le conflit était en cours et que des biens culturels avaient été détruits par les belligérants, de devenir partie au deuxième protocole.
Cela a permis au pays de solliciter et d’obtenir l’aide du Fonds pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, aide toutefois modeste – 35 000 dollars – du fait de l’alimentation limitée du fonds. Le Mali a ainsi pu dresser un inventaire des biens culturels menacés et mettre certains de ceux-ci à l’abri.
Par ailleurs, dans le cadre de sa mission de renforcement des capacités et d’appui à ses États membres, l’UNESCO organise, en collaboration avec le gouvernement malien, plusieurs ateliers de sensibilisation et de formation des forces armées, afin de les familiariser avec les outils mis à leur disposition pour assurer la protection des personnes et des biens. Par exemple, les 16 et 17 novembre 2016, des représentants des différentes forces armées et de sécurité maliennes se sont réunis au Musée national du Mali à Bamako dans le cadre d’un atelier portant sur la protection des biens culturels en temps de guerre.
Le Conseil de sécurité des Nations-Unies a, quant à lui, intégré la protection du patrimoine culturel au mandat de la mission de maintien de la paix au Mali (MINUSMA), tout en condamnant fermement les destructions du patrimoine culturel et historique commises au Mali. La MINUSMA a ainsi reçu un mandat d’appui à la sauvegarde du patrimoine culturel par les autorités maliennes.
Le patrimoine culturel libyen bénéficie aussi de la mobilisation de la communauté internationale dans le cadre des instruments existants, avec cependant une effectivité limitée sur le terrain tant que le pays restera divisé entre de multiples milices.
C’est ainsi que le Conseil exécutif de l’UNESCO a adopté le 21 avril 2015 une résolution sur les patrimoines irakien, syrien et libyen : « La culture dans les zones de conflit : une question humanitaire et de sécurité – Rôle et responsabilité de l’UNESCO ». L’organisation a également organisé, en mai 2016, une réunion sur la sauvegarde du patrimoine culturel libyen, laquelle visait à construire une vision commune de sa préservation.
En juillet 2016, le Comité du patrimoine mondial a inscrit les cinq sites libyens du patrimoine mondial (Cyrène, Leptis Magna, Sabratha, les sites rupestres du Tadrart Acacus, Ghadamès) sur la « liste du patrimoine mondial en péril » du fait des dégâts subis et des risques encourus.
En décembre 2016, enfin, le Fonds pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé a attribué 50 000 dollars à la Libye.
La procédure d’adhésion engagée par la France traduit une volonté d’exemplarité et d’entraînement.
Il s’agit d’affirmer que les atteintes au patrimoine culturel en temps de conflit armé sont aujourd’hui devenues, avec les événements du Mali, de Libye, d’Irak et de Syrie, d’une telle gravité qu’elles doivent constituer une priorité.
Il s’agit aussi de montrer qu’une puissance militaire qui assume ses responsabilités peut aujourd’hui, compte tenu de ce que sont ses opérations militaires, s’inscrire dans un cadre juridique particulièrement strict quant à la protection du patrimoine culturel commun.
Cette procédure d’adhésion s’inscrit dans un ensemble d’actions de la France qui manifestent cette orientation forte de sa politique. On peut citer, entre autres :
– l’initiative ou le coparrainage de diverses résolutions internationales telles que la résolution 2199 du Conseil de sécurité des Nations-Unies condamnant le pillage, la destruction et le trafic du patrimoine culturel irakien et syrien, ou la première résolution sur la protection du patrimoine irakien adoptée par le Conseil exécutif de l’UNESCO à l’automne 2014 ;
– la rédaction, confiée au président du Louvre, M. Jean-Luc Martinez, d’un rapport (6) sur la protection du patrimoine de l’humanité, lequel recommande notamment l’adhésion au présent protocole, afin de « permettre non seulement de renforcer la position de la France dans les instances institutionnelles internationales, mais aussi d’encourager d’autres États à la ratification universelle et à la mise en œuvre des instruments juridiques existants » (cette adhésion est également recommandée par l’avis de la Commission nationale consultative des droits de l’homme sur la protection des biens culturels en période de conflit armé de juillet 2015) ;
– l’adoption, dans le cadre de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine, de plusieurs mesures spécifiquement destinées à lutter contre le trafic international des objets d’art et à faciliter leur mise à l’abri (notamment l’interdiction de l’importation de biens culturels dépourvus de certificat d’exportation depuis des pays qui sont parties à la convention de 1970 sur l’exportation illicite de ces biens ; l’interdiction de toute détention ou tout commerce de biens culturels visés par une résolution du Conseil de sécurité des Nations-Unies ; la faculté donnée à l’État de recevoir provisoirement en dépôt dans des locaux sécurisés des biens culturels menacés en raison d’un conflit armé ou d’une catastrophe dans leur pays d’origine ou de dépôt habituel) ;
– l’organisation, aux côtés des Émirats-Arabes-Unis, de la conférence internationale sur le patrimoine en péril d’Abou Dhabi des 2 et 3 décembre 2016, à laquelle le Président de la République a pris part. Cette conférence s’est conclue par l’adoption d’une déclaration solennelle, par laquelle les participants se sont engagés sur deux objectifs : la création d’un fonds international pour la protection du patrimoine en danger dans les zones en conflit, avec pour objectif une levée de fonds de 100 millions de dollars ; la mise en place d’un réseau international de refuges de biens culturels en danger, en réponse aux demandes des États souhaitant mettre à l’abri leurs œuvres en péril. Ces éléments devraient être repris dans une prochaine résolution de portée générale du Conseil de sécurité sur la protection du patrimoine culturel en péril.
Dans un premier temps, notre pays, bien qu’ayant participé aux négociations qui ont débouché sur le présent protocole en 1999, n’y a pas adhéré.
Il envisage maintenant de le faire, au regard des enjeux particulièrement graves qui s’attachent présentement à la préservation du patrimoine culturel, mais aussi compte tenu de l’évolution de ses moyens militaires, de son droit interne et de son fonctionnement administratif : l’adhésion au protocole impliquera quelques adaptations législatives et administratives, et devrait être assortie de l’émission de plusieurs réserves interprétatives, mais, pour l’essentiel, la France est préparée à assumer les obligations qui en découleront.
Selon l’exposé des motifs du présent projet de loi, « sur les plans opérationnel et juridique, ce second protocole ne pose désormais plus de difficulté, car il est appliqué par la France dès lors que cette dernière est engagée dans des conflits armés à l’extérieur de son territoire ».
Le Gouvernement considère que les moyens technologiques (armes de précision notamment) que les forces armées ont à leur disposition et les modes opératoires mis en œuvre sur les théâtres d’opération sont désormais pleinement compatibles avec les exigences du protocole. Il s’agit notamment, dans l’hypothèse où il faudrait attaquer un bien culturel pourtant antérieurement placé sous « protection renforcée », mais devenu un objectif militaire légitime, de pouvoir garantir que « toutes les précautions pratiquement possibles ont été prises quant au choix des moyens et des méthodes d’attaque en vue de mettre un terme à cette utilisation [militaire du bien] et d’éviter ou, en tout cas, de réduire au minimum les dommages causés à ce bien culturel » (paragraphe 2.b. de l’article 13 du protocole).
b. Toutefois, des réserves interprétatives destinées à protéger nos combattants en opérations extérieures
L’adhésion française au deuxième protocole devrait être accompagnée, selon l’étude d’impact annexée au présent projet de loi, de la formulation de « déclarations » du gouvernement français, lesquelles constitueront en fait des réserves interprétatives.
Deux de ces déclarations envisagées portent sur la licéité de l’utilisation, dans certains cas de figure, de moyens militaires à l’encontre de biens culturels. Il s’agit bien sûr de protéger juridiquement les combattants français lors des opérations extérieures.
L’article 15 du présent protocole prohibe l’attaque, l’utilisation à des fins militaires, la destruction, la dégradation et le vol de biens culturels, « en violation de la convention [de 1954] ou du présent protocole », et intime aux États parties de les réprimer pénalement. Cet article ne fait donc pas explicitement référence à la licéité des atteintes aux biens culturels quand elles relèvent de la « nécessité militaire impérative », licéité reconnue pourtant pas l’article 4 de la convention de 1954 et l’article 6 du présent protocole. Cependant, la référence à la « violation » de la convention et du protocole signifie implicitement que ces atteintes aux biens culturels ne sont prohibées et ne doivent être sanctionnées qu’en l’absence de « nécessité militaire impérative ».
Afin d’éviter toute ambiguïté sur ce point clair mais implicite, le Gouvernement déclare envisager de formuler la déclaration suivante : « le Gouvernement de la République française comprend que tout bien culturel qui devient un objectif militaire au sens du protocole peut être attaqué selon une dispense pour nécessité militaire impérative en vertu de l’article 4, paragraphe 2, de la convention [de 1954] ».
Il est à noter qu’une déclaration interprétative similaire a été émise par le Canada au moment de son adhésion au protocole en 2005.
L’article 13 du présent protocole porte sur les cas de figure où des biens culturels pourraient perdre la « protection renforcée » qu’ils auraient acquise en vertu du texte et pourraient donc être l’objet d’une attaque militaire licite. Plusieurs conditions sont posées pour cela, telles que le fait que le bien en cause soit devenu un « objectif militaire », qu’il n’y ait pas d’autre moyen de mettre fin à l’utilisation militaire de ce bien par l’ennemi et que toutes les précautions aient été prises pour minimiser les dommages.
Le paragraphe 2.c. de l’article 13 y ajoute des conditions supplémentaires : l’ordre d’attaquer ne peut être donné qu’« au niveau le plus élevé du commandement opérationnel » ; un avertissement doit avoir été donné aux forces adverses ; un « délai raisonnable » doit leur avoir été laissé « pour redresser la situation » (cesser d’utiliser le bien culturel concerné à des fins militaires). Toutefois, ces trois conditions n’ont pas à être respectées lorsque « les circonstances ne le permettent pas, en raison des exigences de la légitime défense immédiate ».
Afin de lever toute difficulté d’interprétation de cette notion de « légitime défense immédiate », le Gouvernement indique dans l’étude d’impact qu’il envisage la déclaration qui suit : « le Gouvernement de la République française comprend la référence (…) à la "légitime défense immédiate", comme n’affectant en rien le droit de légitime défense tel que prévu par l’article 51 de la Charte des Nations Unies, et déclare qu’il appliquera les stipulations [en cause] dans la mesure où l’interprétation de celles-ci ne fait pas obstacle à l’emploi, conformément au droit international, des moyens qu’il estimerait indispensables pour riposter à une menace immédiate en situation de conflit armé ». La référence à la « légitime défense » au sens de la Charte des Nations unies permet de clarifier le texte en renvoyant à un concept qui a donné lieu à une « jurisprudence » sur la conformité des actions militaires au droit international.
Le présent protocole pose à ses signataires des exigences précises en matière de droit pénal interne.
L’article 15 du protocole intime aux signataires d’incriminer, dans leur droit pénal, un ensemble d’atteintes graves aux biens culturels, qu’il liste. L’article 21, un peu moins précis, leur demande de prendre « les mesures législatives, administratives ou disciplinaires qui pourraient être nécessaires pour faire cesser » d’autres atteintes à ces biens.
Selon l’étude d’impact annexée au présent projet de loi, le droit positif français satisfait déjà l’essentiel de ces prescriptions, bien qu’il n’y existe pas d’incrimination spécifique pour des faits criminels ou délictueux portant sur les biens culturels en général en cas de conflit armé.
Il est de plus à noter que cet arsenal pénal a été renforcé récemment par la loi du 7 juillet 2016 susmentionnée relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine.
Par ailleurs, l’exception de « nécessité militaire », qui peut justifier dans certains cas, selon le protocole, des atteintes aux biens culturels, apparaît également dans notre droit pénal, même si ce n’est pas exactement dans les mêmes termes.
En effet, en matière criminelle, selon l’article 461-13 du code pénal, « le fait de lancer des attaques délibérées contre des bâtiments consacrés à la religion, à l’enseignement, à l’art, à la science ou à l’action caritative, des monuments historiques, des hôpitaux (…), pour autant que ces bâtiments ne soient pas alors utilisés à des fins militaires, est puni de vingt ans de réclusion criminelle ». On peut considérer que les biens culturels sont a priori couverts par l’énumération donnée. Une exception est prévue en cas d’utilisation de ces biens à des fins militaires.
En matière délictuelle, l’article 311-4-2 du même code sanctionne de sept ans de prison et/ou 100 000 euros d’amende le vol de certaines catégories de biens culturels (objets classés, découvertes archéologiques et biens culturels mobiliers appartenant au domaine public ou déposés dans un musée, une bibliothèque ou un lieu de culte), catégories qui paraissent recouvrir les biens culturels susceptibles de protection au sens du présent protocole. La destruction, la dégradation ou la détérioration des mêmes biens est punie des mêmes peines selon l’article 322-3-1 du même code. De plus, en application des dispositions combinées des articles 461-16 et 462-1, ces vols ou destructions, lorsqu’ils sont commis en temps de guerre (« à l’encontre d’une personne protégée par le droit international des conflits armés »), sont même sanctionnés plus sévèrement (peines portées de sept à dix ans de prison), « à moins [que ces infractions] ne soient justifiées par des nécessités militaires ». L’exception de « nécessité militaire » est donc bien prévue.
S’agissant enfin du trafic de biens culturels volés ou pillés, l’article 322-3-2 du code pénal punit de sept ans de prison et/ou 100 000 euros d’amende toute importation, exportation, transit ou commerce de biens culturels soustraits d’un territoire constituant un théâtre d’opérations de groupements terroristes (sauf à pouvoir justifier de la licéité de l’origine de ces biens). Le code du patrimoine comporte également des dispositions sanctionnant le trafic des biens culturels (à ses articles L. 111-9 et L. 114-1), mais dans un cas un peu différent, « lorsqu’ils ont quitté illicitement le territoire d’un État dans les conditions fixées par une résolution du Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies », et avec des pénalités différentes (deux ans de prison/450 000 euros d’amende).
Selon l’article 18 du présent protocole, les infractions les plus graves contre les biens culturels « sont réputées incluses comme infractions pouvant donner lieu à extradition dans tout traité d’extradition conclu entre parties avant l’entrée en vigueur du présent protocole. Les parties s’engagent à inclure de telles infractions dans tout traité d’extradition qui pourrait ultérieurement être conclu entre elles ».
L’étude d’impact relève que le droit français n’établit pas de liste détaillée des infractions pour lesquelles l’extradition peut être demandée ou accordée. Les accords d’extradition conclus par la France ne font donc pas l’inventaire des infractions pour lesquelles une telle remise peut être envisagée. Il est toutefois des exigences posées par le code de procédure pénale pour qu’une extradition soit possible. Notamment, les faits en cause doivent être passibles de deux ans de prison au moins (ou avoir donné lieu à une condamnation effective à deux mois de prison au moins) et bien sûr être punissables en droit français (article 696-3). Ces conditions ne devraient pas poser problème au regard des peines sévères déjà prévues par notre droit pénal pour les diverses atteintes aux biens culturels (voir supra) : l’extradition par la France des auteurs d’atteintes graves aux biens culturels devrait généralement être possible.
Par ailleurs, l’article 696-4 du même code interdit toute extradition pour les crimes et délits « à caractère politique ». Cette disposition devra être conciliée avec les stipulations de l’article 20 du protocole, lequel prétend en quelque sorte contourner la prohibition, commune dans le droit des pays démocratiques, de l’extradition d’auteurs d’infractions « politiques », en prescrivant que les atteintes aux biens culturels « ne doivent être considérées ni comme des infractions politiques (…) ni comme des infractions inspirées par des mobiles politiques », de sorte qu’« une demande d’extradition ou d’entraide judiciaire fondée sur de telles infractions ne peut être refusée pour la seule raison qu’elle concerne une infraction politique (…) ».
Pour l’essentiel, notre droit pénal actuel paraît donc répondre aux stipulations du présent protocole, sous deux réserves développées infra et en gardant à l’esprit que l’emploi, dans les différents textes, de termes différents est susceptible d’entraîner des distorsions.
Notre droit pénal devra cependant connaître quelques aménagements, lesquels relèveront inévitablement de la compétence du législateur.
L’étude d’impact constate que le droit pénal français ne permet pas de sanctionner, aujourd’hui, le seul fait d’« utiliser un bien culturel sous protection renforcée ou ses abords immédiats à l’appui d’une action militaire » (sauf bien sûr si cette utilisation est accompagnée de pillages, dégradations ou destructions, qui tombent déjà sous le coup de diverses incriminations). Or, le paragraphe §1.b. de l’article 15 du protocole qualifie d’infraction ce comportement, infraction qui doit être incriminée par le droit national des signataires. Sur ce point, la législation française devra donc être complétée suite à notre adhésion au protocole.
ii. Vers un élargissement mesuré de la compétence extraterritoriale de la justice française s’agissant des atteintes les plus graves aux biens culturels
Par ailleurs, l’article 16 du présent protocole impose une conception très large de la compétence des juridictions nationales en matière d’atteintes aux biens culturels, afin de faciliter la répression de ces actes qui ne sont en pratique souvent susceptibles d’être jugés que dans des pays autres que leur lieu de commission (puisque, malheureusement, les pays ravagés par des conflits armés sont souvent dépourvus des moyens juridiques et matériels d’exercer une justice efficace).
C’est pourquoi le protocole demande à ses adhérents d’établir leur compétence juridictionnelle non seulement pour les actes commis sur leur territoire, mais aussi pour tous actes commis par leurs nationaux, voire, pour les infractions les plus graves (atteintes à des biens sous « protection renforcée » ou destructions et pillages à grande échelle), par toute personne « présente » sur leur territoire.
Ces stipulations, en particulier la dernière, vont au-delà des règles de compétence territoriale et personnelle posées par notre droit pénal, rappelées dans l’encadré ci-après.
Le champ de compétence du juge pénal français
Les règles de base de compétence juridictionnelle en droit pénal sont exposées aux articles 113-1 à 113-8 du code pénal :
– d’abord, de manière générale, la justice française est par principe compétente pour les faits commis sur le territoire national (article 113-2) ;
– pour des faits survenus hors du territoire national, la loi pénale française est également applicable pour les crimes et délits punis d’emprisonnement dont sont victimes des personnes de nationalité française au moment des faits (article 113-7) ;
– toujours pour des faits survenus hors du territoire national, les coupables présumés relèvent de la justice française quand ils sont de nationalité française, mais seulement, lorsqu’il s’agit de délits, sous condition de double incrimination – il doit s’agir aussi de faits délictueux dans le pays de commission (article 113-6) ;
– de plus, pour les faits survenus hors du territoire national impliquant des victimes ou des prévenus de nationalité française, le monopole des poursuites appartient au parquet et leur déclenchement doit être précédé d’une plainte ou bien d’une dénonciation par les autorités du pays en cause (article 113-8).
Il est à noter que, pour certains actes, soit très graves, soit susceptibles d’être commis par des Français principalement, voire exclusivement, à l’étranger, tels que le terrorisme, le mercenariat ou les activités pédophiles, les conditions restrictives susmentionnées (double incrimination, plainte préalable, etc.) sont écartées par le code pénal.
Par ailleurs, dans certains cas, correspondant à la répression d’actes très graves sanctionnés par des textes internationaux, la loi française donne à notre justice une forme de compétence universelle : en application des articles 689 à 689-13 du code de procédure pénale, « les auteurs ou complices d’infractions commises hors du territoire de la République peuvent être poursuivis et jugés par les juridictions françaises (…) lorsqu’une convention internationale ou un acte [européen] donne compétence aux juridictions françaises pour connaître de l’infraction ». Les engagements internationaux visés sont ensuite listés : il s’agit d’un ensemble de conventions concernant la répression du terrorisme et de son financement, de la piraterie, du détournement d’avions, du trafic de matériaux nucléaires, de la torture, des disparitions forcées, des crimes relevant de la Cour pénale internationale, etc., ainsi que de certains engagements européens.
Selon l’article 689-1 du même code, « en application des conventions internationales visées aux articles suivants, peut être poursuivie et jugée par les juridictions françaises, si elle se trouve en France, toute personne qui s’est rendue coupable hors du territoire de la République de l’une des infractions énumérées par ces articles » : le critère de compétence territoriale de la justice française est donc, dans ce cas de figure, très étendu, puisque cette compétence s’étend à des infractions commises par des étrangers à l’étranger, sous la seule limitation que la personne poursuivie « se trouve en France ».
L’article 689-11, relatif au cas particulier des poursuites exercées contre les criminels de guerre (les personnes qui pourraient relever de la Cour pénale internationale), catégorie dont relèvent a priori les auteurs d’atteintes graves aux biens culturels en temps de conflit armé, est toutefois plus restrictif sur le critère de compétence : « peut être poursuivie et jugée par les juridictions françaises toute personne qui réside habituellement sur le territoire de la République et qui s’est rendue coupable à l’étranger de l’un des crimes relevant de la compétence de la Cour pénale internationale (…) si les faits sont punis par la législation de l’État où ils ont été commis ou si cet État ou l’État dont elle a la nationalité est partie à la convention précitée. La poursuite de ces crimes ne peut être exercée qu’à la requête du ministère public si aucune juridiction internationale ou nationale ne demande la remise ou l’extradition de la personne (…) ». Il est donc exigé que le prévenu « réside habituellement sur le territoire de la République » (et non pas seulement qu’il s’y « trouve »). Par ailleurs, sont posées deux conditions habituelles pour la poursuite de faits commis à l’étranger : le monopole d’engagement des poursuites du parquet ; la double incrimination (les faits en cause doivent tomber sous le coup de la loi du pays de commission, soit directement, soit indirectement du fait de l’adhésion de ce pays ou du pays de nationalité du prévenu à la Cour pénale internationale).
De manière générale, la poursuite pénale en France de faits commis à l’étranger est possible lorsqu’ils impliquent des personnes de nationalité française, mais, sauf exceptions, sous diverses conditions restrictives – telles que la double incrimination et le monopole de poursuite du parquet – qui n’apparaissent pas dans le texte du présent protocole.
Quant aux poursuites, pour des faits commis à l’étranger, à l’encontre de personnes n’ayant pas la nationalité française, elles sont envisagées avec encore plus de restrictions, même si elles sont possibles dans certains cas lorsque les faits tombent sous le coup de conventions internationales, ce qui correspond au présent cas de figure.
Enfin, s’agissant de ces personnes étrangères, le fait que la justice nationale soit compétente seulement pour celles qui résident habituellement en France – solution retenue par le droit national pour les criminels susceptibles de relever de la Cour pénale internationale – ou bien pour toutes celles qui sont « présentes » sur le territoire national – selon la formule du présent protocole –n’est bien sûr pas neutre. Un certain nombre d’incidents ont en effet montré les enjeux d’une extension des compétences des justices nationales aux étrangers de passage (dans le cas de faits commis à l’étranger) : cette forme de compétence « quasi-universelle » permet certes de faire progresser la cause de la justice, mais au prix de sérieuses difficultés diplomatiques. En témoignent par exemple les péripéties de l’arrestation du général Augusto Pinochet lors d’un voyage à Londres en 1998, suite à un mandat délivré par la justice espagnole pour des crimes liés à sa dictature.
Dans ce contexte, le Gouvernement est prêt à proposer la modification législative qui permettra à la justice française de poursuivre dans certains cas des étrangers auteurs présumés d’atteintes graves à des biens culturels commises à l’étranger, puisque cette possibilité existe pour la mise en œuvre d’autres conventions internationales. Mais il souhaite inscrire cette extension de compétence dans un cadre restrictif, de fait en-deçà de la lettre du présent protocole.
En effet, selon l’étude d’impact, la déclaration suivante pourrait être formulée par la France dans le cadre du processus d’adhésion : « (…) le Gouvernement de la République française indique que les juridictions françaises pourront poursuivre toute personne, ressortissant d’un État partie au présent protocole, qui réside habituellement en France et qui s’est rendue coupable des [infractions les plus graves : atteintes aux biens sous « protection renforcée » ou destructions et pillages à grande échelle de biens protégés]. La poursuite de ces infractions ne pourra être exercée qu’à la requête du ministère public ».
Dans la ligne de ce que prévoit notre droit pénal dans des cas de figure proches, trois restrictions sont donc souhaitées par le Gouvernement pour l’éventuelle poursuite en France d’étrangers pour atteintes graves à des biens culturels :
– les personnes poursuivies devraient être ressortissantes d’un État partie au protocole, ce qui mettra en œuvre le principe de double incrimination (les États parties au protocole sont tenus de pénaliser dans leur droit interne les atteintes aux biens culturels) ;
– elles devraient résider habituellement en France (donc pas seulement y être de passage) ;
– autre garantie contre les initiatives susceptibles d’entraîner des crises diplomatiques, le parquet aurait le monopole du déclenchement des poursuites.
En tout état de cause, cette extension de compétence du juge pénal devra faire l’objet d’une disposition législative.
Des adaptations de nos pratiques administratives devraient également découler de l’adhésion au deuxième protocole.
L’article 5 du présent protocole précise ce que devraient être les mesures de sauvegarde des biens culturels à prendre en temps de paix « contre les effets prévisibles d’un conflit armé », qui n’étaient qu’évoquées dans la convention de 1954 : établissement d’inventaires, planification de mesures d’urgence pour assurer la protection des biens contre les risques de destruction, préparation de l’enlèvement des biens culturels meubles, désignation d’autorités compétentes responsables…
Or, il apparaît certes que notre pays est bien doté en plans d’urgence à vocation « généraliste », sous des acronymes bien connus : plan ORSEC, Vigipirate… Mais s’agissant spécifiquement des biens culturels, du retard a été pris, sans doute parce que le territoire national, du moins métropolitain, n’a pas été l’objet de menaces militaires massives et immédiates depuis 1945, même s’il a connu son lot de catastrophes naturelles, accidents industriels et attentats terroristes. C’est ainsi qu’un plan national pour l’évacuation des œuvres des musées de France avait été élaboré et décliné en six circulaires, échelonnées de 1952 à 1976, avant d’être abandonné en 1980 pour obsolescence, sans jamais être remplacé…
Au sein du ministère de la culture et de la communication, un travail de mise à jour ou d’adaptation des plans de sauvegarde des biens culturels (immeubles et mobiliers) s’impose donc. Il a été relancé en 2016 par une note du directeur général des patrimoines.
L’une des mesures les plus significatives du présent protocole consiste dans la faculté donnée à ses signataires de faire placer leurs biens culturels les plus importants sous « protection renforcée ».
La France a initié une réflexion afin d’identifier les biens qui pourraient être concernés. La logique serait de proposer les 38 biens culturels français inscrits sur la « Liste du patrimoine mondial » de l’UNESCO.
Cependant, certains de ces biens couvrent des superficies très importantes et la totalité de leur emprise ne pourrait pas être sous « protection renforcée ». En effet, il faut que l’emprise et les abords immédiats des biens proposés à la « protection renforcée » ne soient en aucun cas utilisés à des fins militaires, ce qui constituerait une contrainte lourde pour des biens très étendus (par exemple, le Val de Loire) ou des centres historiques qui sont aussi des centres politico-administratifs devant être défendus dans l’hypothèse d’un conflit (par exemple, les rives de la Seine dans le centre de Paris). Dans un certain nombre de cas, la « protection renforcée » pourrait donc être limitée à certains monuments faisant partie des sites inscrits.
Par ailleurs, elle pourrait aussi être demandée pour des biens non-inscrits.
C’est donc toute une réflexion qui devra être engagée, en lien avec celle sur l’actualisation des plans de sauvegarde des monuments en cas de conflit.
L’adhésion au deuxième protocole de 1999 à la convention de La Haye de 1954 représente assurément un défi pour un pays qui est amené à conduire fréquemment des opérations militaires extérieures. Nos forces armées devront continuer à ajuster leurs pratiques pour garantir le respect du protocole. Les réserves interprétatives émises par la France devraient contribuer à les protéger juridiquement.
Cette adhésion obligera aussi notre pays à actualiser ses plans de sauvegarde des musées et monuments, ce qui est de toute façon une nécessité, et à aménager son droit pénal, tout en évitant une dérive vers une « compétence universelle » de notre justice en matière de crimes contre les biens culturels.
Ces contraintes et ces adaptations doivent être acceptées, vue la gravité exceptionnelle des atteintes aux biens culturels que l’on constate dans les plus récents conflits. La France se doit d’être exemplaire et il faut espérer que l’adhésion d’un membre permanent du Conseil de sécurité des Nations-Unies aura un effet d’entraînement sur d’autres grands pays. Votre rapporteur vous invite donc à adopter le présent projet de loi.
Au cours de sa séance du mardi 31 janvier 2017, la commission des affaires étrangères examine, sur le rapport de M. Philippe Baumel, le projet de loi autorisant l’adhésion de la France au deuxième protocole relatif à la convention de La Haye de 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé (n° 4263).
Après l’exposé du rapporteur et suivant son avis, la commission adopte le projet de loi sans modification.
Est autorisée l’adhésion de la France au deuxième protocole relatif à la convention de La Haye de 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, signé à La Haye le 26 mars 1999, et dont le texte est annexé à la présente loi.
NB : Le texte de la convention figure en annexe au projet de loi (n° 4263).
(d’après le site internet de l’UNESCO)
États |
Date du dépôt de l'instrument |
Type d'instrument |
Afrique du Sud |
11/02/2015 |
Adhésion |
Allemagne |
25/11/2009 |
Ratification |
Arabie Saoudite |
06/11/2007 |
Adhésion |
Argentine |
07/01/2002 |
Adhésion |
Arménie |
18/05/2006 |
Ratification |
Autriche |
01/03/2002 |
Ratification |
Azerbaïdjan |
17/04/2001 |
Ratification |
Bahreïn |
26/08/2008 |
Adhésion |
Barbade |
02/10/2008 |
Adhésion |
Bélarus |
13/12/2000 |
Ratification |
Belgique |
13/10/2010 |
Ratification |
Bénin |
17/04/2012 |
Adhésion |
Bosnie-Herzégovine |
22/05/2009 |
Adhésion |
Brésil |
23/09/2005 |
Adhésion |
Bulgarie |
14/06/2000 |
Ratification |
Cambodge |
17/09/2013 |
Ratification |
Canada |
29/11/2005 |
Adhésion |
Chili |
11/09/2008 |
Adhésion |
Chypre |
16/05/2001 |
Ratification |
Colombie |
24/11/2010 |
Adhésion |
Costa Rica |
09/12/2003 |
Adhésion |
Croatie |
08/02/2006 |
Ratification |
Egypte |
03/08/2005 |
Ratification |
El Salvador |
27/03/2002 |
Adhésion |
Equateur |
02/08/2004 |
Ratification |
Espagne |
06/07/2001 |
Ratification |
Estonie |
17/01/2005 |
Approbation |
Macédoine |
19/04/2002 |
Adhésion |
Finlande |
27/08/2004 |
Acceptation |
Gabon |
29/08/2003 |
Adhésion |
Géorgie |
13/09/2010 |
Adhésion |
Grèce |
20/04/2005 |
Ratification |
Guatemala |
04/02/2005 |
Adhésion |
Guinée équatoriale |
19/11/2003 |
Adhésion |
Honduras |
26/01/2003 |
Adhésion |
Hongrie |
26/10/2005 |
Ratification |
Iran |
24/05/2005 |
Adhésion |
Italie |
10/07/2009 |
Ratification |
Japon |
10/09/2007 |
Adhésion |
Jordanie |
05/05/2009 |
Adhésion |
Libye |
20/07/2001 |
Adhésion |
Lituanie |
13/03/2002 |
Adhésion |
Luxembourg |
30/06/2005 |
Ratification |
Mali |
15/11/2012 |
Adhésion |
Maroc |
05/12/2013 |
Ratification |
Mexique |
07/10/2003 |
Adhésion |
Monténégro |
26/04/2007 |
Notification de succession |
Nicaragua |
01/06/2001 |
Adhésion |
Niger |
16/06/2006 |
Adhésion |
Nigéria |
21/10/2005 |
Ratification |
Norvège |
05/09/2016 |
Adhésion |
Nouvelle-Zélande |
23/10/2013 |
Adhésion |
Oman |
16/05/2011 |
Ratification |
Palestine |
22/03/2012 |
Adhésion |
Panama |
08/03/2001 |
Adhésion |
Paraguay |
09/11/2004 |
Adhésion |
Pays-Bas |
30/01/2007 |
Acceptation |
Pérou |
24/05/2005 |
Ratification |
Pologne |
03/01/2012 |
Adhésion |
Qatar |
04/09/2000 |
Ratification |
République dominicaine |
03/03/2009 |
Adhésion |
République tchèque |
08/06/2007 |
Adhésion |
Roumanie |
07/08/2006 |
Ratification |
Serbie |
02/09/2002 |
Adhésion |
Slovaquie |
11/02/2004 |
Ratification |
Slovénie |
13/04/2004 |
Adhésion |
Suisse |
09/07/2004 |
Ratification |
Tadjikistan |
21/02/2006 |
Adhésion |
Uruguay |
03/01/2007 |
Adhésion |