N° 2226 N° 204
____ ___
ASSEMBLÉE NATIONALE SÉNAT
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
TREIZIÈME LÉGISLATURE SESSION ORDINAIRE DE 2009 - 2010
____________________________________ ___________________________
Enregistré à la présidence de l’Assemblée nationale Enregistré à la présidence du Sénat
le 15 janvier 2010 le 15 janvier 2010
________________________
OFFICE PARLEMENTAIRE D'ÉVALUATION
DES CHOIX SCIENTIFIQUES ET TECHNOLOGIQUES
________________________
Face à la grippe A(H1N1) et à la mutation des virus,
que peuvent faire chercheurs et pouvoirs publics ?
(compte rendu de l’audition publique du 1er décembre 2009)
Par M. Jean-Pierre Door, Député, et
Mme Marie-Christine Blandin, Sénatrice
__________ __________
Déposé sur le Bureau de l'Assemblée nationale Déposé sur le Bureau du Sénat
par M. Claude BIRRAUX, par M. Jean-Claude ÉTIENNE,
Président de l'Office Premier Vice-Président de l'Office
_________________________________________________________________________
de l’Office parlementaire d’évaluation
des choix scientifiques et technologiques
Président
M. Claude BIRRAUX
Premier Vice-Président
M. Jean-Claude ÉTIENNE
Vice-Présidents
M. Claude GATIGNOL, député Mme Brigitte BOUT, sénatrice
M. Pierre LASBORDES, député M. Christian GAUDIN, sénateur
M. Jean-Yves LE DÉAUT, député M. Daniel RAOUL, sénateur
|
SÉnateurs | |
|
M. Christian BATAILLE M. Claude BIRRAUX M. Jean-Pierre BRARD M. Alain CLAEYS M. Pierre COHEN M. Jean-Pierre DOOR Mme Geneviève FIORASO M. Claude GATIGNOL M. Alain GEST M. François GOULARD M. Christian KERT M. Pierre LASBORDES M. Jean-Yves LE DÉAUT M. Michel LEJEUNE M. Claude LETEURTRE Mme Bérengère POLETTI M. Jean-Louis TOURAINE M. Jean-Sébastien VIALATTE |
M. Gilbert BARBIER M. Paul BLANC Mme Marie-Christine BLANDIN Mme Brigitte BOUT M. Marcel-Pierre CLÉACH M. Roland COURTEAU M. Marc DAUNIS M. Marcel DENEUX M. Jean-Claude ÉTIENNE M. Christian GAUDIN M. Serge LAGAUCHE M. Jean-Marc PASTOR M. Xavier PINTAT Mme Catherine PROCACCIA M. Daniel RAOUL M. Ivan RENAR M. Bruno SIDO M. Alain VASSELLE |
SOMMAIRE
___
Pages
Ouverture PAR M. CLAUDE BIRRAUX, DÉPUTÉ, PRÉSIDENT DE L’OPECST 11
PREMIERE PROBLEMATIQUE : COMMENT PEUT-ON RALENTIR LA PROPAGATION DES VIRUS ? 15
I. En a-t-on les moyens scientifiques ? 15
II. La vaccination est-elle la meilleure solution ? 31
Conclusion : M. Jean-François Delfraissy, directeur de l’Institut Microbiologie et Maladies infectieuses (IMMI), INSERM 51
I. Pouvoirs publics et gestionnaires des pandémies 55
Mme Marie-Christine Blandin, sénatrice, présidente, co-rapporteure 55
M. Didier Houssin, directeur général de la santé 57
M. Christian Lajoux, président du LEEM – les entreprises du médicament 60
M. Claude Le Pen, économiste, université de Paris Dauphine 62
Mme Françoise Weber, directrice générale de l’Institut national de veille sanitaire 64
M. Patrick Zylberman, historien, Centre de recherche médecine, sciences, santé et société 72
II. Acteurs de terrain, praticiens et citoyens 79
M. Martial Olivier-Koehret, président de MG France 84
M. Thierry Amouroux, secrétaire général du Syndicat des personnels infirmiers 87
Mme Marianne Buhler, porte-parole du Réseau Environnement Santé 89
M. Dominique Tricard, Inspection générale des affaires sociales (IGAS), INSERM 91
Dans le cadre de leur rapport sur la mutation des virus et la gestion des pandémies, M. Jean-Pierre Door, député et Mme Marie-Christine Blandin, sénatrice, ont organisé le mardi 1erdécembre une audition publique de l’office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques sur le thème : « Face à la grippe A(H1N1) et à la mutation des virus, que peuvent faire chercheurs et pouvoirs publics? »
Cette audition publique a permis d’aborder deux questions : Comment peut-on ralentir la propagation des virus ? Comment peut-on garantir les bons choix dans la lutte contre des virus potentiellement dangereux ?
Les débats, très riches, ont permis un dialogue entre parlementaires, professeurs de médecine, chercheurs, réseaux de médecins, syndicats et représentants des autorités sanitaires : ministère de la Santé, Institut de veille sanitaire, Établissement de Préparation et de Réponse aux Urgences Sanitaires. Ces intervenants ont été confrontés à plusieurs regards croisés du terrain.
I. PEUT-ON RALENTIR LA PROPAGATION DES VIRUS DE LA GRIPPE ?
A. L’état des connaissances scientifiques
La structure des virus est connue. Mais leur mutation est imprévisible.
Les virus de la grippe sont répertoriés selon trois classes : A, B et C. Ils sont composés d’hémagglutinine (H) et de neuraminidase (N). Ils peuvent être très différents, puisqu’il existe 16 formes connues de H et 9 de N.
Le virus pandémique actuel est un virus de type A(H1N1). Il a pour l’instant tendance à dominer les deux autres virus de la grippe qui circulent en cette saison : un H1N1 classique et un H3N2.
Ce virus pandémique, détecté d’abord au Mexique, associe des brins d’ARN de trois sources différentes : aviaire, humaine, mais aussi porcine. C’est pour cette raison que la grippe a été appelée dans un premier temps grippe porcine ou grippe mexicaine.
La virulence du A(H1N1) fait l’objet d’un constat unanime des scientifiques.
Ce virus n’est pas aussi dangereux que le H5N1 (le virus de la grippe aviaire). Mais il est davantage contagieux.
Il peut entraîner des formes graves d’infections respiratoires aigues qui restent inexpliquées et qui peuvent entraîner la mort. Les décès ne correspondent pas à ceux causés par une grippe saisonnière. La moitié d’entre eux concerne des populations qui ne présentent pas de risque particulier. Les jeunes sont ainsi particulièrement frappés.
La manière dont le virus se transmet reste inconnue : les membres d’une même famille ne seront pas tous atteints ni atteints de la même façon.
Les antiviraux sont, en cas d’infection, généralement efficaces, mais sous certaines conditions.
Le seul antiviral qui soit vraiment utilisé n’a d’effet que s’il est pris dans les 48 heures suivant l’apparition des premiers symptômes. C’est la raison pour laquelle ce traitement, relativement récent, suscite parfois des réticences de la part de certains médecins.
Le médicament anti-viral idéal n’est pas encore trouvé.
L’OMS sait sélectionner le virus contre lequel il faut lutter, chaque année, de manière prioritaire.
Après prélèvement sur des patients contaminés, et identification par des centres de références (CMR), l’OMS dispose de souches sélectionnées.
L’OMS choisit le « virus candidat vaccin » et met à la disposition des entreprises pharmaceutiques travaillant sur oeufs embryonnés des semences vaccinales.
Un laboratoire travaille sur cellules avec le virus entier inactivé, obtenu directement à partir du virus sauvage.
Tous les nouveaux vaccins sont préparés en quelques mois, au cours desquels ils sont soumis à des essais cliniques, et aux procédures d’autorisation de mise sur le marché. Les techniques sont connues. Elles consistent notamment à utiliser des vaccins maquettes ou des vaccins prépandémiques.
Des vaccins différents sont alors produits par divers laboratoires. Ces différences sont répertoriées. Elles portent notamment sur la technique de production des vaccins, sur les conservateurs (comme le thiomersal), sur les excipients et sur l’utilisation d’adjuvants (généralement de l’aluminium, du mercure et du squalène) afin d’augmenter les quantités produites et d’élargir leurs effets.
B. Le débat scientifique sur la vaccination
Pour la plupart des virologues, la vaccination est la meilleure et la seule solution pour lutter contre la propagation de la pandémie.
C’est la mesure efficace qui permet une protection nettement supérieure aux mesures d’hygiène classiques.
C’est le moyen de diminuer l’intensité du pic de pandémie à venir, et de diminuer la durée pendant laquelle la contagion est la plus élevée.
Ses effets ont été quantifiés sur des pathologies éradiquées dans le monde (variole).
On peut évaluer ce qui se passe en cas de vaccination, ou ce qui se passerait si la population ne se faisait pas vacciner.
Tenants et adversaires de la vaccination A/H1N1 continuent de s’opposer.
Il est possible d’approfondir certains arguments.
La vaccination continue de faire l’objet des débats scientifiques.
Ces débats existaient déjà à l’époque de Pasteur, ce qui pose la question de comparer les bénéfices et les risques de la vaccination. Il faut désormais s’interroger sur la mise en œuvre des principes de précaution et de prévention.
Les recherches ne permettent pas pour l’instant d’apporter des réponses absolues aux questions que certains posent sur la mesure de l’efficacité « barrière » des vaccins au niveau sociétal, sur leurs effets secondaires et sur leur mode optimal de production.
Le lien entre vaccination et syndrome de Guillain-Barré donne lieu à des appréciations contradictoires, d’autant que la grippe peut provoquer ce syndrome.
II. COMMENT PEUT-ON GARANTIR LES BONS CHOIX DANS LA LUTTE CONTRE DES VIRUS POTENTIELLEMENT DANGEREUX ?
A. L’action des pouvoirs publics et des gestionnaires des pandémies
Les choix des autorités sanitaires n’ont pas été confidentiels contrairement à ce qui s’était passé lors du virus H5N1
C’est un progrès par rapport à la situation qui avait prévalu lors de la grippe aviaire. Les autorités sanitaires ont publié la liste des mesures qu’elles envisageaient de prendre.
Ces mesures sont une mise en œuvre du plan national de prévention et de lutte « Pandémie grippale », élaboré pour réagir à une grippe aussi dangereuse que celle causée par le H5N1.
Leur logique est claire : les mesures prises ont essentiellement pour but d’écrêter le pic attendu de la grippe, afin d’éviter la multiplication des cas graves, l’embouteillage du système de santé et la désorganisation de notre société.
En revanche, le choix des vaccins et leur achat n’ont pas été débattus.
Le passage aux mesures maximales est inférieur au stade 6 décrété par l’OMS, ce qui présente le grand avantage de s’adapter à la gravité de la pandémie, et d’éviter de prendre trop rapidement des mesures de limitation des libertés individuelles qui ne sont prévues qu’en situation extrême.
La veille et la surveillance sanitaire sont efficaces
Elles reposent sur des mesures coordonnées par l’Institut de veille sanitaire, sur la base des observations des réseaux Sentinelles, des GROG (groupements régionaux d’observation de la grippe), de SOS médecins et du réseau Oscour.
Les méthodes utilisées par ces divers réseaux spécifiques et non spécifiques sont différentes, mais les résultats obtenus sont cohérents et complémentaires pour les spécialistes formés aux méthodes de statistiques et de probabilité. Ces résultats déconcertent les patients et même certains médecins qui considèrent que seule l’analyse biologique est une preuve.
Un rapprochement des réseaux GROG et Sentinelles sera un acquis intéressant de cette grippe pandémique.
Les choix des autorités sanitaires ont résulté de consultations au sommet mais pas de larges concertations. Il n’y a pas de consensus dans la société.
C’est la cause de multiples critiques, dans un contexte où la situation est moins grave que prévu.
La multiplicité des acteurs impliqués dans la gestion de cette pandémie rend parfois difficile le message public. Les rôles du ministère de la Santé et du ministère de l’Intérieur mériteraient d’être précisés.
B. Les observations d’acteurs de terrain, de praticiens et de citoyens
La campagne de vaccination est critiquée sous plusieurs angles: pertinence, organisation, coût, mode d’association ou non des professionnels.
Certaines des mesures mises en place pour organiser la campagne de vaccination sont contestées par les professionnels de santé qui n’ont pas été associés à leur définition et à leur mise en œuvre.
Les médecins souhaitent par exemple pouvoir, sur la base du volontariat, vacciner eux-mêmes leurs patients. Certains d’entre eux estiment que la campagne de vaccination en aurait été facilitée, et des patients sensibles mieux repérés.
Son organisation ne permet pas toujours l’efficacité souhaitée
La vaccination dans des centres dédiés a souvent entraîné de longues files d’attente.
Les vaccins n’étaient pas encore, au 1er décembre, disponibles en quantité suffisante pour vacciner les personnes qui ne sont pas prioritaires.
La décision de n’injecter qu’une seule dose de vaccin plutôt que deux pour les plus de neuf ans a néanmoins réduit le besoin en vaccins.
La réquisition de médecins et d’internes suscite des polémiques.
La communication publique n’a pas créé la confiance.
Les informations sont parfois contradictoires. Certains élus s’en plaignent.
Des professionnels de santé souhaiteraient recevoir davantage d’information de la part des pouvoirs publics. Ils regrettent d’apprendre par la télévision ou par les journaux des éléments qui leur permettraient de mieux conseiller leurs patients. Ils constatent qu’ils n’ont pas reçu une formation semblable à celle qui leur avait été donnée lors de la grippe aviaire.
La communication publique doit être repensée en fonction du développement d’Internet et de la multiplication des blogs. L’information ne suffit plus à remporter l’adhésion.
L’information sur les vaccins reste insuffisante pour de nombreux observateurs
Peut-être aurait-on dû rendre publics de manière spontanée les contrats entre l’État et les laboratoires.
Il faut remédier à cette insuffisance de l’information, qui est la source des rumeurs.
En l’absence de données certaines, il convient de promouvoir les recherches sur les effets secondaires des vaccins et les adjuvants. Il est souhaitable de développer les recherches en sciences sociales et humaines pour analyser et comprendre les réticences de la population.
Si le vaccin reste facultatif, il est nécessaire qu’il soit accepté si l’on estime que la vaccination reste le meilleur moyen pour prévenir les effets graves de cette grippe pandémique.
M. Claude Birraux, député, président de l’OPECST. Je suis heureux d’ouvrir cette audition publique organisée par Mme Marie-Christine Blandin, sénatrice, et M. Jean-Pierre Door, député. Je souhaite la bienvenue à l’ensemble des intervenants qui évoqueront, avec la grippe A(H1N1), un thème dont l’actualité était déjà patente en juin dernier lorsque la Commission des affaires culturelles, familiales et sociales de l'Assemblée nationale nous a saisis d’une demande d’étude sur la mutation des virus.
La grippe A, alors dite porcine ou mexicaine, était perçue différemment : nous savions en effet qu'elle était contagieuse, mais nous ignorions jusqu'à quel point elle pouvait être dangereuse. Chacun se souvenait des dangers encourus par les personnes qui avaient été infectées par la grippe aviaire deux ans auparavant et les informations dont nous disposions faisaient craindre une désorganisation profonde du pays. En outre, la nouvelle grippe frappait et tuait de jeunes personnes n'appartenant à aucune des catégories à risque. Enfin, résultant d'une recomposition de trois virus respectivement d’origine aviaire, porcine et humaine, le virus responsable de la pandémie que venait de décréter l'Organisation mondiale de la santé (OMS) était nouveau – les virus se transformant et mutant en permanence, certaines mutations étaient marginales et d'autres avaient des conséquences majeures.
Le thème de nos débats peut paraître austère, mais si la mutation des virus est bien un phénomène scientifique analysé par les théoriciens qui donne lieu à des recherches compliquées effectuées parfois dans des conditions d'extrême sécurité, son étude n’en demeure pas moins fondamentale pour qui veut comprendre les risques épidémiques encourus par notre société et mesurer la pertinence des dispositions prises par les pouvoirs publics. Selon ses procédures habituelles, l'OPECST a désigné deux rapporteurs – M. Jean-Pierre Door, député, et Mme Marie-Christine Blandin, sénatrice – qui ont déjà travaillé ensemble sur le risque épidémique. Ils ont engagé une étude de faisabilité définissant le cadre de travaux qui s'étendront sur plusieurs mois, et c’est ainsi que l'Office a finalement décidé, le 13 octobre dernier, de traiter le thème : « Mutation des virus et gestion des pandémies ».
Cette étude, réalisée à partir de premières auditions et d'une recherche documentaire approfondie, a montré combien les pouvoirs publics prennent au sérieux ce risque et ont tiré les conséquences organisationnelles de l'expérience vécue lors de la grippe aviaire mais, également, de la canicule de 2003. Le plan de lutte contre les pandémies de 2007 a ainsi été actualisé en février 2009 et ses dispositions ont commencé à être systématiquement mises en œuvre par l'État. Sous la conduite des ministères de l'intérieur et de la santé, une coordination interministérielle concernant aussi bien le ministère de l'éducation nationale que celui des affaires étrangères ou des transports a été mise en place. Des circulaires ont également été envoyées aux préfets dès la fin du mois d’août afin d'organiser un plan de grande envergure, les ministres associant à leurs efforts les élus locaux ainsi que le corps médical. La lecture de ces textes – disponibles sur Internet – est extrêmement intéressante et montre combien les pouvoirs publics, in fine, se sont efforcés de combiner les principes de précaution et de prévention : le problème, en effet, n’est pas seulement de gérer une crise sanitaire, mais de limiter ses manifestations les plus aiguës et de freiner sa progression. En l’occurrence, cette dernière peut être limitée par des vaccins et la pathologie peut être quant à elle soignée par des antiviraux, les uns et les autres donnant lieu à de nombreuses études. Ainsi, lors de l'apparition d'un nouveau virus, de nouveaux vaccins doivent-ils être trouvés, testés et autorisés, qui peuvent être proches – ou non – des vaccins précédents et comporter – ou pas – des adjuvants. Les techniques de production, enfin, évoluent en permanence – que l’on songe à la culture embryonnaire ou cellulaire.
Par ailleurs, notre étude tend à créer un pont entre les connaissances scientifiques les plus récentes et les légitimes interrogations de nos concitoyens dans un contexte nouveau lié notamment à l’importance de plus en plus grande d'Internet dans notre vie quotidienne : si, en effet, l'information y est surabondante et immédiate, elle génère aussi parfois des réactions pouvant affecter la mise en œuvre des mesures prises par les pouvoirs publics. Le débat est ainsi foisonnant concernant l’opportunité ou non de la vaccination ou la nature du vaccin et des adjuvants, mais il peut aussi engendrer des effets secondaires en colportant de fausses rumeurs ou en nourrissant des théories du complot qui n'ont évidemment rien de scientifiques, au point que je n’hésiterai pas à parler en la matière de véritable « pandémie des rumeurs » !
L'Office se situe à la croisée des chemins scientifique, politique, juridique et médiatique. Ses trente-six membres étant députés ou sénateurs, il constitue une instance politique parlementaire mais également de réflexion et d'évaluation sur la base de liens tissés depuis plus de vingt-cinq ans avec la communauté scientifique. Ses travaux ont toujours été marqués par une exigence de rigueur. Ses rapports résultent d'auditions et de déplacements sur le terrain tant en France qu'à l'étranger. De surcroît, son comité de pilotage constitué à l’occasion de chaque étude lui permet de se saisir de toutes les questions essentielles. Dans le contexte que nous connaissons, il peut donc être le lieu où s'organise un débat raisonné et apaisé sur les questions que se posent nos concitoyens, il peut en outre servir de « courroie de transmission » avec la communauté scientifique et, enfin, présenter en termes compréhensibles les choix et les explications qui sont formulés par les chercheurs les plus en pointe.
L'audition publique d'aujourd'hui est représentative de cette démarche puisqu’elle rassemble des responsables politiques, des scientifiques éminents, des concepteurs et des maîtres d'œuvre de l'action publique mais aussi des hommes et des femmes de terrain qui témoigneront de la complexité de la situation. Les journalistes ici présents pourront bien entendu poser des questions s’ils le souhaitent. Les débats s'organiseront autour de deux grands thèmes : comment peut-on ralentir la propagation des virus ? Comment peut-on garantir que nous faisons les bons choix dans la lutte contre des virus potentiellement dangereux ? Le premier permettra ainsi de mieux comprendre la nature des virus, de leur mutation et des moyens permettant de les combattre – la question de vaccins et des réactions qu'ils suscitent y sera abordée ; le second sera l’occasion de présenter la politique menée par les pouvoirs publics afin de freiner la pandémie, et de la confronter aux réactions d'acteurs de terrain et de praticiens. Enfin, retranscrits et publiés, ces débats constitueront l'une des bases de l'étude de l'Office parlementaire et permettront aux deux rapporteurs de préciser leur analyse et de poser de nouvelles questions aux dizaines de personnes qu'ils ont l'intention d'auditionner.
PREMIERE PROBLEMATIQUE :
COMMENT PEUT-ON RALENTIR LA PROPAGATION DES VIRUS ?
I. EN A-T-ON LES MOYENS SCIENTIFIQUES ?
M. Jean-Pierre Door, député, président, co-rapporteur. Nos travaux porteront donc sur les connaissances scientifiques dont nous disposons concernant les virus, les vaccins et les médicaments antiviraux, mais également sur l'organisation de la vaccination ainsi que sur les choix qui peuvent être faits entre différents vaccins. Connaître les virus et leur mutation n'est pas une tâche facile même si de nombreuses études portent sur la structure du virus de la grippe, sur la manière dont il pénètre dans une cellule, s'y reproduit et en sort – ainsi savons-nous différencier les vingt-cinq virus répertoriés de cette pathologie grâce à leurs composantes en hémagglutinine et en neuraminidase, ce qui permet de distinguer le HlNl du H3N2, mais aussi le HlNl pandémique du HlNl saisonnier.
Parmi les objectifs de nos travaux, il nous faut d’abord adopter un langage clair, précis et rigoureux à destination du grand public dans un domaine où le discours scientifique peut très vite devenir difficilement compréhensible. Ensuite, il convient de mettre en évidence les travaux menés sur les virus et sur les moyens de les combattre, ainsi que nous avons d’ailleurs commencé à le faire avec Mme Marie-Christine Blandin dans le cadre de l'étude de faisabilité que nous avons réalisée. Nous avons à cet égard tenu à prendre en compte l'apport des sciences humaines et sociales, car il est illusoire de parler de vaccins sans aborder la manière dont la vaccination est perçue et acceptée. À ce propos, je suis frappé du changement d'attitude qui s'est produit la semaine dernière lorsque les médias ont commencé à relater la mutation du virus qui s’est produite en Norvège : jusqu'alors, les centres de vaccination étaient peu fréquentés ; depuis, ils ne désemplissent pas comme j’ai pu moi-même le constater.
Les premières auditions d'historiens, de politologues et d'économistes ont également été particulièrement instructives. En effet, faire référence à la grippe espagnole, aux grippes de 1957, de 1968, de 1976 ou à la grippe aviaire de 2007 et, surtout, les replacer dans leur contexte, permet de prendre du recul et de mieux analyser la situation présente. En outre, s'interroger sur les discours tenus lorsque l’on aborde les questions de santé publique favorise la compréhension des réticences qu'ils sont susceptibles de générer.
Pluridisciplinaire, notre approche est également comparative : il est en effet essentiel de comprendre pourquoi d'autres pays ont fait des choix différents et quelles en sont les conséquences – que l’on songe, par exemple, à la décision des autorités américaines de recourir à des vaccins sans adjuvant et à la pénurie à laquelle ce pays est désormais confronté. Tout choix présentant des avantages et des inconvénients, nous veillons avec une extrême attention à la valeur scientifique des arguments présentés – ce qui explique la nécessité de bénéficier d’avis différents et de recouper les informations, souvent contradictoires. Leur accessibilité sur le réseau Internet est d’ailleurs proportionnelle à la diversité de leur qualité : si certaines doivent être prises en compte – même si nous ne partageons pas le point de vue de leurs auteurs –, d'autres relèvent de la rumeur ou du café du commerce.
Nous avons commencé notre étude au début du mois de septembre, mais, depuis, le contexte a changé :
Le plan gouvernemental de prévention et de lutte "Pandémie grippale" tendait à faire vacciner la majeure partie de la population – c’est pourquoi avait été passée aux laboratoires pharmaceutiques la commande de 94 millions de doses de vaccins, chaque personne devant être vaccinée deux fois. Le risque de forte contagiosité avait par ailleurs été pris en compte –, même si le gouvernement français avait décidé de ne déclarer que l'étape 5 du plan et non l'étape 6, contrairement à l'OMS, se réservant ainsi la possibilité de moduler sa réaction à la crise sans limiter les libertés publiques si cela n'était pas nécessaire ;
En outre, lors de l'hiver austral, il est apparu que la grippe était moins virulente qu'on ne l'avait craint : les chiffres provenant de l'hémisphère Sud et, notamment, de La Réunion et de la Nouvelle-Calédonie ont ainsi montré qu’elle était certes contagieuse mais pas autant que prévu, données qui ont été rapidement confirmées en France métropolitaine ; le pic attendu à la mi-octobre n'est toujours pas atteint et le nombre des personnes infectées reste maîtrisable ;
Le nombre de cas graves est quant à lui relativement bas à ce jour, de même que celui des décès. Néanmoins, il n’est pas question de baisser la garde, la grippe A présentant parfois des formes graves qui concernent des personnes jeunes et apparemment en bonne santé – en l’occurrence, les critères traditionnels d'âge et de populations à risque ne s'appliquent pas ;
À cela s’ajoute de la part du Gouvernement un choix essentiel que personne ne remet du reste en cause, à savoir le caractère volontaire de la vaccination. Celle-ci, en effet, relève de la « responsabilité » de chacun – j'emploie le mot à dessein car une personne qui se fait vacciner protège de ce fait son entourage, la vaccination étant aussi un acte altruiste.
Au cours de cette audition, nous entendrons des virologues éminents, des professeurs de médecine, des spécialistes passionnés par leur travail qui nous feront part de leurs interrogations et de leurs découvertes, voire, de leurs doutes ou de l'impossibilité dans laquelle ils se trouvent de prévoir des mutations virales. Nous souhaitons également qu'ils nous donnent un aperçu de leurs recherches et qu'ils n'hésitent pas à nous dire si notre pays – qui reste un des grands producteurs de vaccins et de médicaments – fournit un effort suffisant dans ce domaine comparativement aux grandes nations disposant d'une industrie pharmaceutique puissante. Je donnerai donc successivement la parole à François Bricaire, chef du service des maladies infectieuses et tropicales à La Pitié Salpêtrière, Thierry Pineau, chef du département de santé animale à l’Institut national de la recherche agronomique (INRA) à Toulouse, Brigitte Autran, professeur d'immunologie et codirectrice de l'institut fédératif de recherche Immunité-Cancer-Infection, et, enfin, à Jean-Claude Manuguerra, qui dirige la cellule d'intervention biologique d'urgence de l'Institut Pasteur. Ces interventions seront suivies d'un débat.
M. François Bricaire, chef du service des maladies infectieuses et tropicales à la Pitié Salpêtrière. Les épidémies et les pandémies, notamment infectieuses, sont l’occasion de garder en mémoire que si la médecine est une science, elle n’en reste pas moins également un art avec ce que cela suppose d’incertitudes. À cet égard, dispose-t-on des moyens scientifiques permettant d’évaluer avec précision la situation que nous connaissons ? Le clinicien que je suis est tenté de répondre à la question à la fois par l’affirmative et par la négative.
Par l’affirmative d’abord, car nous disposons d’une surveillance épidémiologique grippale remarquable tant sur le plan international – avec l’OMS – que sur le plan national au moyen notamment des groupes régionaux d’observation de la grippe (GROG) mis en place par le docteur Jean-Marie Cohen, lesquels permettent de signaler l’arrivée de tel ou tel virus, mais également sa progression et son éventuelle mutation.
Par ailleurs, certains critères permettent de mesurer scientifiquement l’efficience des mesures générales qui sont prises – je songe, par exemple, au nombre de fermetures de classes ou d’établissements, la limitation des contacts permettant d’éviter la transmission du virus et d’entraver l’extension d’une épidémie. Il en va de même s’agissant de la traçabilité des virus, grâce en particulier au repérage puis au contact d’un certain nombre de sujets au sein des aéroports.
Il est également attesté que les « mesures barrière » qui ont été appliquées permettent d’éviter une transmission respiratoire ou tactile du virus – je pense, notamment, au lavage des mains et, plus particulièrement, à l’utilisation de solutions hydro-alcooliques, mais aussi à celle de masques FFP2 ou chirurgicaux.
Les antiviraux – essentiellement inhibiteurs de la neuraminidase – ont également fait preuve de leur efficacité à condition, toutefois, d’être utilisés au plus tard dans les 48 heures après la survenue des premiers symptômes grippaux comme nous avons pu le constater dans des services de réanimation ou, en Égypte, sur des sujets atteints par le virus H5N1.
Enfin, outre que la vaccination est particulièrement efficace et bien tolérée, le rapport entre bénéfices et risques, sur le plan tant individuel que collectif, est tout à fait favorable. Mieux : c’est elle seule qui, selon moi, permet de lutter contre les épidémies virales et de les vaincre.
Mais je répondrai également à la question par la négative en raison de l’imprévisibilité des épidémies et des pandémies, qu’il s’agisse de leur survenue dans le temps ou de la définition précise des virus. Ce « flou artistique » ne manque d’ailleurs pas de créer des problèmes : outre que nos concitoyens comprennent parfois mal que l’on crie au loup sans raison apparente, le passage de la grippe aviaire à la grippe porcine a été l’occasion de nombreuses interrogations. Plus spécifiquement, la grande imprévisibilité des virus de la grippe quant à leur virulence ou à leurs mutations rend délicate l’adaptation des moyens visant à les combattre.
Par ailleurs, les mesures que j’ai évoquées peuvent être ambivalentes. Ainsi le degré précis d’efficacité des antiviraux – dont le Tamiflu – est-il difficile à établir : sa prescription s’impose-t-elle pour réduire de moitié la durée des symptômes quand cette dernière s’élève à quarante-huit heures seulement ?
De la même manière les diagnostics ne peuvent pas être posés de façon assez rapide : ainsi la mise au point d’un test et la production en nombre pour un coût acceptable se révèlent-t-elle assez délicates.
S’agissant des vaccins, outre que la sûreté prévisionnelle de leur fabrication est liée à la détermination précise de la nature des virus – laquelle n’est donc pas aisée –, la rapidité de leur mise au point et des délais de diffusion suscite des attitudes ambiguës : « Il le faut rapidement » ; « Il a été fabriqué trop vite ». J’ajoute que la recherche d’un vaccin universel n’en est qu’à ses balbutiements.
Enfin, des incertitudes demeurent quant aux structures de prises en charge médicales : à l’hôpital, faut-il établir des zones de haute et de basse densité virales ? Ou bien une zone dédiée aux malades de la grippe doit-elle être mise en place dans chaque service ? Comment, dans le secteur libéral, réduire l’extension du phénomène infectieux ? Enfin, quid de l’isolement à domicile ?
M. Thierry Pineau, chef du département de santé animale à l’INRA. L’INRA se doit de mener des recherches sur les grippes animales, son champ d’intervention étant complémentaire de celui des autres acteurs de la recherche publique et privée. Nous la conduisons en l’occurrence à l’échelle d’un consortium réunissant à l’INRA, entre autres structures, le Centre international en recherche agronomique pour le développement (CIRAD) ainsi que les écoles vétérinaires de manière que l’ensemble des moyens publics soit utilisé d’une façon aussi cohérente que possible. Nous travaillons également avec les autres instituts de recherche publique au sein de l’Institut thématique multiorganismes (ITMO) "Microbiologie et maladies infectieuses".
Plus spécifiquement, nous nous interrogeons sur la transmission et les éventuelles recombinaisons des virus de la grippe entre les animaux et les êtres humains, ce qui implique une recherche pluridisciplinaire en matière d’épidémiologie moléculaire des virus, de physiopathologie animale – la volaille et le porc étant, en l’occurrence, particulièrement affectés –, d’immunologie ou encore d’infectiologie expérimentale en milieu très confiné – notamment à l’installation nationale protégée pour la recherche sur les encéphalopathies spongiformes transmissibles (INPREST) de Tours – et, enfin, des études internationales, en particulier dans le Sud-Est asiatique, creuset des départs et des recombinaisons des virus infectieux.
En outre, nous travaillons avec des organismes européens ou internationaux sur un ensemble de projets communs : nous avons ainsi répondu à un appel d’offres de l’Union européenne concernant la pathogénécité des virus chez les porcs. Une sorte de partie de ping-pong se prépare ainsi entre cette espèce et la nôtre, une expérimentation du Friedrich Loeffler Institut ayant par ailleurs montré que si les porcs s’infectaient entre eux, aucune transmission avec des volailles – et c’est rassurant – n’avait pu être démontrée. Nous avons également noué des liens avec l’Université de Wageningen, le ministère de l’agriculture des États-Unis (USDA) ainsi que des grands industriels tels que Pfizer.
Nous avons également observé à l’unité de Nouzilly, dédiée à l’adaptation des virus à la volaille, que le processus de transmission des palmipèdes migrateurs à la volaille d’élevage se caractérise par le raccourcissement de la tige de neuraminidase, lequel est symptomatique d’une plus grande pathogénicité. Nous avons alors transmis cette information aux réseaux de surveillance de manière à essayer de prévoir l’arrivée de virus particulièrement pathogènes et à mettre en place des mesures de gestion efficaces. C’est ainsi qu’à la biologie de l’observation peut succéder une biologie prédictive, si difficile soit-elle à élaborer quoi qu’en pensent nos concitoyens : il s’agit non seulement, en effet, des jeux du hasard et de la nécessité, mais d’un véritable « tirage au sort » quant aux espèces touchées et au degré de pathogénicité.
Nous travaillons également sur les questions de l’immunité. Depuis la pandémie grippale de 1918 nous savons que l’intensité du déluge inflammatoire touchant les poumons est révélatrice de l’importance des atteintes. De nouvelles pistes de recherches s’offrent à nous, au moyen en particulier de l’utilisation de petits peptides permettant de contrôler la sévérité de la réaction inflammatoire dans le poumon. À terme, les patients devraient pouvoir passer le cap de ce déluge.
Sur le plan épidémiologique, nous collaborons avec les pays d’Asie du Sud-Est puisque c’est là que la promiscuité entre les espèces est la plus grande – en particulier entre les volailles et les porcs – et où les évolutions virales sont les plus prégnantes. Plus précisément, nous travaillons avec la Thaïlande ainsi qu’avec l’institut Pasteur de Phnom Penh ; nous envisageons également de nouer des liens avec la Chine et le Vietnam.
Nous étudions aussi les déterminants de pathogénicité du virus à travers l’examen des génomes viraux afin de déterminer les protéines qui entraînent les infections les plus virulentes et de mieux cibler les espèces concernées.
Enfin, je tiens à souligner combien les chercheurs sont outrés face aux réactions de certains confrères ou collègues qui jugent bon de faire la fine bouche quant à la vaccination. Une bonne communication s’impose : il s’agit là d’un acte civique responsable et militant d’un point de vue individuel et collectif. J’ajoute qu’il convient également de faire preuve de civisme et de responsabilité dans l’usage de certains médicaments, notamment du Tamiflu : le pharmacologue de formation que je suis vous assure que nous devons avoir une politique d’usage raisonné en la matière si nous voulons, le cas échéant, faire face à une crise de grande ampleur et éviter les phénomènes bien connus de résistance. Il ne faut pas que, comme au Japon, des molécules de Tamiflu – fût-ce en quantités infimes – se retrouvent dans les eaux de rivière et entrent en contact avec des palmipèdes sauvages.
Mme Brigitte Autran, professeur d’immunologie, codirectrice de l’institut fédératif de recherche Immunité-cancer-infection à Paris. Immunologie et infection vont ensemble. Il n’y a pas de système immunitaire qui ne se soit créé sans environnement infectieux. Dans le cas particulier de la grippe, les réponses immunitaires se constituent immédiatement après l’atteinte virale. En quelques jours ces réponses immunitaires permettent d’assurer une mémoire durable. La pandémie va s’installer grâce à l’émergence d’un virus mutant pour lequel la population ne dispose pas de mémoire immunitaire. La première infection sera donc potentiellement grave.
Cette mémoire immunitaire, quand elle existe, peut durer toute la vie, ce qui a été étudié et montré dans le cas pour la variole. Mais le virus de la variole ne mute pas, contrairement à celui de la grippe, qui mute de manière aléatoire.
Seules les mutations victorieuses vont émerger. Ce sont elles qui confèrent la possibilité au virus de se reproduire. Mais il ne peut se reproduire que chez des individus –hommes, porcs ou oiseaux- qui ont une immunité.
L’immunité constituée face aux virus grippaux peut quant à elle être conçue comme une sorte de tamis au travers duquel, en bonne logique écologique, les virus mutants vont devoir passer afin de se développer. Les mutants accrochés par un anticorps vont être bloqués. Seuls les mutants ne correspondant à aucun anticorps présent sur la planète vont pouvoir émerger.
Lors d’une nouvelle création d’espèce virale, la population ne dispose pas d’immunité et surgit la pandémie. Le virus doit créer les conditions de sa propre survie dans un environnement. L’espèce humaine fournit cet environnement.
Plus généralement, il n’est pas étonnant que les petits enfants soient particulièrement exposés aux virus grippaux faute de disposer d’une mémoire immunitaire suffisamment vaste – les complications infectieuses pouvant être très importantes pour eux –, de même que les personnes très âgées dont l’immunité est parfois déficiente.
La configuration est différente avec le H1N1. Dans le cas de la pandémie que nous connaissons, la population – si l’on excepte ceux qui parmi nous sont nés avant 1957, date de la disparition du virus dit de la « grippe espagnole » de 1918 dont le H1N1 est un lointain descendant – ne dispose pas de cette mémoire immunitaire en raison du virus mutant qui en est à l’origine. Cela explique d’ailleurs que ce soit essentiellement les adultes de moins de cinquante ans qui sont victimes des formes les plus graves de cette pathologie.
Que sait-on en termes de recherche ? La grippe est une infection bien connue. La France le mérite d’avoir mis en place un remarquable système de surveillance de la grippe qui a contribué à maintenir un haut niveau de connaissance de ce virus, même si l’on peut regretter que les instances dirigeantes des organismes de recherche n’aient pas toujours été sensibles à la nécessité d’accroître davantage le potentiel de recherche – de ce point de vue, nous sommes par exemple en retard par rapport à la Grande-Bretagne. Quoi qu’il en soit, nous avons pu organiser, avec les instituts thématiques et l’Institut de microbiologie et de maladies infectieuses (IMMI), des recherches complémentaires à celles des centres nationaux de référence afin, notamment, de mieux comprendre la réponse immunitaire aux virus mutants en fonction de l’âge et des vaccinations antérieures des sujets.
Si le système immunitaire protège, il peut également tuer, la symptomatologie des infections étant très souvent due à l’intensité de la réponse immunitaire – certaines maladies, en effet, sont plus lourdes chez les patients qui disposent de bonnes défenses, comme c’est sans doute le cas des victimes les plus gravement atteintes par la grippe H1N1. La réponse immunitaire par le biais de l’inflammation peut créer des désordres. Ces mécanismes sont sans doute impliqués dans les formes graves de la grippe. Ils ne sont pas encore totalement connus, et la recherche doit jouer son rôle.
Les formes dangereuses de cette grippe sont dues à une infection très profonde des poumons, mais également à un déluge d’inflammation dans les poumons conduisant à une fibrose accélérée de cet organe – d’où la nécessité d’une oxygénothérapie extracorporelle. En l’état, nous ne savons pas s’il faut alourdir le traitement antiviral ou limiter l’immunité, limiter l’inflammation. Un important programme de recherche a été mis en place par l’IMMI, les laboratoires et les services de réanimation et de virologie afin de comprendre si les formes graves de la maladie sont dues à des virus mutants spécifiques, comme on l’a vu en Norvège, à un terrain génétique particulier ou à d’autres mécanismes qui pourraient être contrôlés avec des thérapeutiques mieux adaptées.
Les vaccins, quant à eux, visent à constituer une mémoire immunitaire avant la contamination virale. À ce propos et à l’instar de mon collègue, le déluge de désinformation auquel nous sommes soumis me fait mal au cœur alors que la vaccination est l’une des armes les plus fantastiques que les hommes aient inventées et, aujourd’hui, la seule pratique médicale capable d’éliminer certaines maladies de la planète. Nos concitoyens réagissant parfois en enfants gâtés, je suis particulièrement sensible aux efforts de communication de l'Assemblée nationale en la matière.
Outre qu’il permet de vacciner rapidement le plus grand nombre de personnes possible, l’adjuvant au vaccin a quant à lui été nécessaire parce que nous sommes face à cette pandémie comme un bébé de six mois face à une grippe saisonnière. Nous avons besoin de constituer à toute allure une immunité. Dans le cas de la grippe saisonnière, il suffit d’une seule injection de vaccin sans adjuvant. Ce n’est pas le cas pour une grippe pandémique, où il faut éduquer le système immunitaire, ce qui suppose deux à trois doses de vaccin. Or, si l’on réfléchit au plan mondial, la quantité de vaccins disponibles ne serait pas suffisante pour vacciner toute la population en trois mois.
C’est en l’occurrence grâce aux injonctions des pouvoirs publics aux scientifiques et aux industriels à l’occasion de la grippe H5N1 que cet adjuvant a pu être élaboré. C’est de là qu’est née la réflexion sur l’adjuvant : Comment faire plus de vaccination avec le vaccin ? Comment avoir une couverture plus rapidement ? L’adjuvant est la seule réponse.
J’affirme qu’il n’y a pas d’autres réponses efficaces pour nous adapter au besoin de couverture vaccinale. Les Américains n’en ont pas voulu, suite à leur histoire récente, mais les Français et l’ensemble des Européens, en leur âme et conscience, ont eu selon moi raison de travailler avec les industriels sur un produit susceptible d’accélérer la mise en place de la réponse immunitaire nécessaire afin de faire face à des situations d’urgence et de réduire les quantités d’antigène vaccinal nécessaire pour pouvoir vacciner la totalité des populations. J’ajoute que non seulement les effets secondaires de l’adjuvant sont minimes et maîtrisés, mais qu’il est utilisé depuis plus de cinq ans dans des produits commercialisés.
Si l’on ne devait retenir qu’une chose de cette intervention, c’est l’impérieuse nécessité de se faire vacciner, seule façon de se protéger contre cette épidémie.
M. Jean-Claude Manuguerra, responsable de la Cellule d’intervention biologique d’urgence à l’Institut Pasteur. Je m’intéresserai, pour ma part, aux accidents viraux qui affectent le patrimoine héréditaire des virus, avec des conséquences sur leurs propriétés et leur possible impact sur les moyens de lutte contre les effets de la pandémie grippale. Je reviendrai d’abord sur le mot « mutation ». Il convient d’être précis à cet égard, car plusieurs accidents génétiques peuvent frapper les virus.
Si l’on a eu du mal à nommer le virus en question, nous savons maintenant que nous avons affaire à un virus de type A – l’un des trois types de virus grippaux –, le plus important en termes de création d’épidémie et d’impact sur la santé publique. Ce type A est lui-même divisé en sous-types, dont celui qui nous intéresse : le H1N1, que l’on connaissait déjà pour être un virus saisonnier.
La genèse des nouveaux virus se fait par des mécanismes de variation, qui peuvent être de deux ordres principaux : les réassortiments et les mutations.
Les réassortiments sont des échanges génétiques de gènes entiers. Ce sont des changements brutaux, pouvant avoir un impact fondamental sur les propriétés du virus. Ce mécanisme nécessite des virus différents chez un même individu infecté, sachant que si les virus sont semblables, il n’interviendra pas grand-chose en termes de propriété les concernant. En revanche, s’ils sont dissemblables, il peut en résulter la genèse d’un cocktail viral complètement nouveau. C’est sur la base de cette nouvelle équipe de gènes, assortis différemment, que se créera alors un virus neuf, aux propriétés complètement différentes de celles que l’on avait pu observer auparavant.
Un tel mécanisme a présidé à la genèse, par la nature, du génotype Z après que le virus aviaire H5N1 hautement pathogène eut fait l’objet de multiples événements de réassortiments. Ces derniers ont ainsi abouti, depuis les premières alertes du passage du H5N1 chez l’homme en 1997, à des virus qui ont changé nos connaissances en matière de grippe ou de peste aviaire. Plus récemment, la genèse des virus que l’on a appelés porcins, puis mexicains, puis A(H1N1), a résulté de nombreux réassortiments, lesquels ont collecté des gênes toujours, semble-t-il, par l’intermédiaire du porc. Le phénomène est beaucoup plus fréquent qu’on ne le pensait auparavant.
Les mutations, quant à elles, sont des erreurs de copiage lors de la synthèse des patrimoines héréditaires des virus « fils ». Ce sont des changements discrets. Mais ils sont cumulatifs et peuvent entraîner une modification importante des propriétés du virus et se produire à plusieurs endroits. Là encore, des mutations peuvent, en dépit d’un contexte connu, faire apparaître des propriétés inattendues. Ces mutations ne nécessitent pas des virus différents chez un même individu infecté. Enfin, c’est un phénomène que l’on constate très fréquemment.
À propos justement de cette fréquence, on entend souvent dire que le virus mute. Certes, mais il n’a jamais cessé de muter ! C’est même l’une des caractéristiques des virus à ARN, puisque c’est l’ARN – ou acide ribonucléique – qui porte le patrimoine génétique des virus grippaux. Les taux de mutation de ces virus sont estimés de 1 sur 1 000 à 1 sur un million par an, et si l’on prend un constituant basique de ce code génétique du virus, ce taux oscille entre 1 sur 10 000 et 1 sur 100 000. Cela signifie que si l’on a un patrimoine génétique de plus de 10 000 unités – sachant qu’en la matière la molécule repose sur un code de quatre éléments : A, U, G, C –, on assiste mécaniquement, en cas de multiplication – in vitro ou chez l’individu, homme ou animal – à un mélange de génomes viraux. Un tel mécanisme introduit donc de la diversité et, éventuellement, de nouvelles propriétés au sein de la population virale. Le fait que ces populations de virus soient en compétition et en évolution n’est pas un phénomène strictement limité aux virus grippaux. On l’observe avec le virus de la polio chez l’homme, avec le virus de la fièvre aphteuse chez l’animal, ou encore avec le virus du sida. C’est dans ce contexte général que s’inscrit le virus de la grippe.
Cette fréquence d’évolution signifie-t-elle que le virus mute ? Si l’on prend le domaine le plus variable de l’hémagglutinine des virus saisonniers H3N2, le taux d’évolution entre 1984 et 1996 a été estimé à environ 6 dix puissance moins trois par site et par an, soit, pour chaque site, 1 sur 10 000 par semaine, soit 1,3 mutation en moyenne, par semaine, pour un génome de la taille du virus grippal. Si l’on prend le taux de mutation par cycle viral – soit dix à douze heures –, le taux est de 1,4 dix puissance trois mutation par semaine.
Bien sûr, des études seraient nécessaires pour quantifier ces fréquences de manière plus précise et pour les adapter au nouveau virus A(H1N1). Mais en restant sur ces ordres de grandeur, le réseau des GROG ayant estimé, pour la semaine 47, que 712 000 individus avaient été infectés, cela signifie, pour cette seule semaine, qu’en France seulement, des milliers de mutations sont apparus. Le phénomène a donc lieu partout autour de nous. Il faudrait, pour observer ces milliers de mutations, procéder au séquençage du génome de tous les virus. Les efforts faits en ce domaine par les deux centres nationaux de référence sont énormes, mais ils concernent les segments les plus importants, notamment l’hémagglutinine et la neuraminidase. Heureusement, la majorité de ces mutations n’ont pas d’impact. Mais pour les virus grippaux, notamment lorsqu’ils passent la barrière de l’espèce, on assiste, globalement, à une sélection positive de type darwinien.
Certaines mutations, que l’on appelle non synonymes, auront un impact sur la constitution des protéines. Elles peuvent affecter une fonction enzymatique, par exemple la neuraminidase. Une mutation peut donc entraîner la résistance à un, voire à plusieurs antiviraux. S’il s’agit de la fonction d’attachement du virus aux cellules CIF, c’est-à-dire si l’on change la clé d’entrée du virus dans les cellules en lui permettant de pénétrer davantage de types cellulaires, cela peut provoquer un changement de tropisme – notamment la fameuse mutation annoncée en Norvège, puis dans d’autres pays comme la France – et prédisposer le virus à coloniser des parties plus profondes de l’appareil respiratoire et donc prendre éventuellement un caractère pathogène plus important.
Les mutations peuvent affecter d’autres segments. Elles peuvent toucher des sites antigéniques – les cibles des anticorps –, suscités soit par l’infection soit par la vaccination, et avoir un impact plus ou moins grand sur l’efficacité vaccinale. J’en profite pour dire que les adjuvants type émulsion, tels qu’ils ont été développés, ont comme avantage d’offrir non seulement une réponse plus intense, mais aussi un spectre beaucoup plus large, ce qui nous affranchit des mutations qui nous obligent à adapter le vaccin saisonnier.
Dispose-t-on des moyens de ralentir la propagation du virus ? Selon moi, il est beaucoup trop tard pour arrêter sa transmission. Toutes les études menées sur le virus de la grippe aviaire hautement pathogène H5N1 n’ont-elle pas conclu qu’il fallait agir au moment de l’introduction du virus dans les populations humaines ? Une fois que le virus est adapté – ainsi qu’on a pu malheureusement le constater avec le nouveau virus A(H1N1) –, il est déjà trop tard. Dès lors qu’il a colonisé tous les continents en quelques semaines, il est illusoire de penser que l’on peut arrêter sa propagation. En revanche, il est possible d’en limiter les effets sur la santé publique.
Sachant que si l’on veut la paix, il faut préparer la guerre, il faut donc se doter d’armes, même si l’on sait bien que celles-ci peuvent être prises en défaut. Le virus peut en effet trouver une parade. C’est ainsi qu’une mutation sur la neuraminidase peut tout d’un coup entraîner une diminution de sensibilité à un antiviral et rendre inutile un stock de plusieurs millions de traitements. De même, une mutation peut très bien modifier le tropisme du virus pour entrer et infecter le poumon tandis qu’une ou plusieurs mutations peuvent diminuer l’efficacité du vaccin sans adjuvant. Par ailleurs les mutations peuvent se produire sur tous ces éléments en même temps. Cela dit, plus on dispose d’armes – traitement antiviral, vaccins avec ou sans adjuvant en fonction des populations, mesures d’hygiène et mesures barrière –, moins on est susceptible d’être pris en défaut pour lutter contre les virus.
Si l’on ne peut sans doute pas ralentir la propagation du virus, il faut en revanche éviter qu’il ne passe à des populations animales et ne s’y installe. Le virus que l’on a appelé « porcin » au départ et qui n’en était pas tout à fait un, pourrait le devenir un jour ou l’autre. Il faut donc empêcher le passage d’une espèce vers une autre.
Il est très difficile d’adapter des plans établis de manière un peu théorique pour lutter contre une pandémie : comment mettre en perspective les données publiées dans les bulletins épidémiologiques ou virologiques ? Si l’on annonce qu’une mutation a été observée chez deux ou trois patients en Norvège puis dans d’autres pays tels que la France, quelles conclusions doit-on en tirer ? Il est très difficile de conseiller un décideur pour la mise en pratique des dispositions d’un plan. On manque toujours de recul, d’autant que les mutations peuvent être délétères pour le virus, voire ne pas se fixer et disparaître.
Nous nous interrogeons à cet égard, au sein du Comité de lutte contre la grippe, sur la façon de résister à un article, publié dans un journal prestigieux, qui remet en cause une disposition figurant dans un plan. Un article ne fait pas en effet la vérité scientifique. Il faut sans doute deux observations, effectuées par des équipes diverses selon des approches différentes, pour s’assurer qu’un fait correspond à une réalité et n’est pas une illusion d’optique. Or, les journaux scientifiques ont tendance à privilégier les publications en avant-première, avant même que les scientifiques qui travaillent sur le sujet n’aient accès aux documents. Cela complique d’autant l’expertise avant toute prise de décision.
Il conviendrait, enfin, de profiter de la crise pour en tirer des éléments innovants. Nous verrons bien, avec le recul, ce qu’auront donné les adjuvants. Peut-être nous permettront-ils de disposer dans l’avenir de types de vaccins un peu différents. En tout cas, s’agissant du vaccin antigrippal saisonnier, la France s’est installée dans une relative quiétude avec des vaccinations saisonnières et des populations cibles, tandis qu’au niveau mondial cet outil est limité aujourd’hui à quelques pays développés, alors que le fardeau est très important dans les pays en voie de développement où une immunisation annuelle n’est pas toujours possible. Là encore, il faudrait profiter de la crise pour innover.
M. Jean-Pierre Door, député, président, co-rapporteur. J’invite maintenant chacun à faire vivre le débat.
M. Jean-Marie Cohen, coordinateur national du réseau des GROG. Monsieur Pineau, êtes-vous sûr que l’on puisse appliquer le modèle des antibiotiques aux antiviraux ? Les virologues m’ont toujours affirmé le contraire.
M. Thierry Pineau. Il semblerait que ce soit possible pour certains types de médicaments : l’application d’une pression de sélection est à même de faire évoluer la population des agents pathogènes qui sont exposés. M. Manuguerra parlait de fixation de caractères apparus de manière aléatoire. L’exposition à l’agent de sélection, quand il est modélisé d’un point de vue mathématique, est de nature à fixer des caractères de résistance. A priori, donc, l’usage raisonné des antiviraux est à recommander, tout comme l’usage raisonné des antibiotiques.
M. François Bricaire. L’utilisation de Tamiflu est elle au Japon si importante que l’on peut vraiment retrouver des traces significatives de ce produit dans les eaux usées ?
M. Thierry Pineau. La particularité du Tamiflu est qu’il est très faiblement métabolisé par l’organisme. Usuellement, les molécules sont dégradées par des systèmes enzymatiques, principalement ceux situés au niveau du foie et de la barrière intestinale. Leurs métabolites, c’est-à-dire leurs formes dégradées, peuvent donc accéder à l’environnement, sachant que, pour une large part, la capacité thérapeutique du médicament a été perdue avec la dégradation. Pour ce qui est du Tamiflu, il semblerait qu’une très large fraction de la molécule quitte l’organisme humain sous sa forme native et soit apte à perdurer dans l’environnement, avec une faible sensibilité vis-à-vis de l’environnement bactérien, par exemple dans une station d’épuration. C’est ainsi que de récents articles publiés dans la littérature spécialisée ou par des instances de surveillance internationale semblent indiquer qu’une part considérable du Tamiflu pris par les individus gagne l’environnement une fois l’eau recyclée.
M. Antoine Flahault, directeur de l’École des hautes études de santé publique. Je m’interroge sur l’idée de Thierry Pineau selon laquelle il conviendrait de réserver le Tamiflu à des situations d’extrême gravité.
D’abord, il n’existe ni essai clinique ni d’indication de l’AMM réservant le Tamiflu à des formes cliniques graves. Les seuls essais cliniques qui ont eu lieu ont porté sur une utilisation du Tamiflu soit à titre curatif soit à titre préventif, donc pour des formes relativement bénignes. On n’a pas d’évidence scientifique sur l’utilité du Tamiflu dans les formes très graves. Dans les formes graves, bien entendu, on fait tout ce que l’on peut et on utilise les antiviraux à disposition – d’ailleurs moins le Tamiflu que le Relenza, à ma connaissance.
Ensuite, si on limitait l’utilisation du Tamiflu aux formes graves, on l’administrerait très tardivement dans le cours de la maladie. Or François Bricaire a très clairement rappelé qu’il ne s’agit pas d’un virucide, mais plutôt d’un virustatique, d’un inhibiteur de la neuromidase, et donc que la prise tardive de ce produit risque de ne pas avoir l’efficacité attendue lorsque les formes graves surviennent.
Enfin, la plupart des études de modélisation que vous avez mentionnées étaient en faveur d’une utilisation précoce et massive du Tamiflu au tout démarrage de la pandémie pour essayer d’en bloquer l’émergence et le potentiel pandémique.
Un vrai problème existe selon moi avec l’utilisation du Tamiflu, qui peut être préventif – en tout début d’une épidémie, dans une zone précise, par exemple insulaire, ce qui risque en effet d’entraîner l’apparition de ses métabolites dans l’environnement. L’utilisation en post-exposition pose aussi problème. Cette utilisation consiste, lorsqu’il y a un cas avéré dans une famille, à traiter l’ensemble de ses membres. Or, on sait que dans un tel cas, 30 % de la cellule familiale sont contaminés, le plus souvent sans le savoir. On va donc procéder à une prophylaxie à demi-dose alors que certains membres de la famille se trouvent en pleine phase de multiplication virale et donc, probablement, dans cette période à haut risque de mutation, d’acquisition de résistance. C’est cette demi-dose préconisée en post-exposition qui, en l’occurrence, me pose problème.
M. Thierry Pineau. Quand je parlais de formes graves, c’était dans une perspective de danger pandémique – par exemple H5N1 devenant transmissible. C’est en ce sens que je parlais de choix ou d’absence de choix dans l’utilisation du Tamiflu. Je ne faisais pas référence à la sévérité de l’infection. Il faut évaluer le risque de diffusion du virus.
M. Bruno Lina, directeur du Centre national de référence contre la grippe pour le Sud de la France. Je voudrais revenir sur deux éléments présentés par les orateurs de ce matin – que j’ai pris un plaisir immense à écouter s’agissant en particulier de la remarquable qualité de l’information diffusée.
La notion de « tamis immunologique » explique très bien ce qui se passe s’agissant du tri des virus. Mais il existe aussi un tamis général, comme l’expliquait M. Manuguerra, permettant ou ne permettant pas aux virus d’émerger.
S’agissant des virus virulents ou plus dangereux qui pourraient émerger, on voit bien que l’on est aujourd'hui face à une machine à fabriquer des mutants, issus de mutations qui peuvent soit toucher des protéines qui n’ont rien à voir avec la réponse immunitaire, soit engendrer des variants immunologiques. Or, celui que l’on appellera bientôt le mutant norvégien ne relève en aucun cas de cette dernière variété.
Il faut aussi bien comprendre que le virus de la grippe est imprévisible et que nous sommes totalement démunis devant son évolution possible. Heureusement, face à ce qui peut apparaître comme un scénario catastrophe, de bonnes nouvelles apparaissent. À cet égard, non seulement l’évolution du virus vers des formes graves n’est pas obligatoire, mais la vaccination existe également.
Celle-ci, se demandent certains, est-elle utile ? En pratique, une vaccination n’est efficace que lorsqu’elle a été faite. C’est un acte préventif. Quand on va se faire vacciner, on n’est pas encore protégé. Il faut donc admettre que l’on puisse ouvrir des centres de vaccination alors qu’il n’y a pas encore de virus en circulation.
Mme Brigitte Autran. Pour revenir sur la notion de tamis, c’est aujourd’hui, 1er décembre, la Journée mondiale du sida. Or, chaque jour, le VIH génère beaucoup plus de mutants que le virus influenza sur toute la planète en une année. Il faut donc proportion garder. Certes, le virus influenza est potentiellement meurtrier, mais nous avons la chance remarquable, malgré ses mutations, de disposer d’un vaccin. Vingt-cinq ans après la découverte du VIH, nous sommes incapables d’avoir un vaccin parce qu’il continue à muter encore plus.
M. Jean-Pierre Door, député, président, co-rapporteur. Merci, madame, de rappeler que c’est aujourd’hui la Journée mondiale du sida, et qu’une différence existe entre les deux virus en question.
Monsieur Pineau, vous avez évoqué le problème de la promiscuité dans le monde animal entre les volailles et les porcs. Qu’en est-il de la promiscuité entre l’animal et l’homme, notamment dans les sociétés de l’Asie du Sud-Est ? Comment faire pour éviter le passage de la barrière des espèces ?
M. Thierry Pineau. Les cartes de surveillance épidémiologique font apparaître des superpositions troublantes entre les zones de prévalence du passage à l’homme du virus H5N1 et les zones d’élevage combiné porc/volailles dans des conditions de promiscuité. Outre l’Asie du Sud-Est, la vallée du Nil a enregistré un nombre assez considérable des cas d’infection de l’homme par le virus H5N1. De mémoire, on dénombrait voilà quelques mois 462 infections humaines caractérisées par le virus H5N1 pour 260 décès. L’apparition du virus, qui est très sévère, est favorisée par les élevages volailles/porc en contact à la fois avec la faune sauvage et les éleveurs et leurs familles, puisqu’il s’agit essentiellement de petits élevages familiaux.
M. François Bricaire. On constate dans nos structures hospitalières, s’agissant des formes graves qui, si elles sont peu nombreuses, sont extrêmement marquantes et instructives, que l’excrétion du virus chez ces malades se prolonge très longtemps, en dépit de l’utilisation, à des doses beaucoup plus élevées, d’antiviraux comme le Tamiflu – qui est plutôt utilisé à la Salpêtrière – ou le Zanamivir. Quand les malades vont mieux sur le plan clinique et que l’on peut les sevrer des appareils respiratoires, en particulier de la circulation extracorporelle pour ceux qui ne peuvent plus respirer, ils excrètent encore du virus. Je n’en connais pas la qualité, mais cela démontre tout de même les capacités extrêmement limitées, dans ces circonstances, de l’antiviral. Ce constat doit nous faire réfléchir et inciter à la vaccination.
M. Abdenour Benmansour, chef de département à l’INRA. Je reviendrai, en ma qualité de chercheur, sur les effets néfastes de la segmentation, non pas cette fois du virus, même si ce dernier est segmenté, mais, d’une part, des instituts de recherche, car on a parfois du mal à mettre en cohérence nos recherches respectives, et, d’autre part, des études des virus influenza de type A.
Alors que ces derniers forment un espace évolutif, continu et commun, de l’animal à l’homme, le sentiment dominant est que l’on passe, sans autre forme de procès, d’un sous-type à l’autre : ainsi, après que H5N1 a occupé le terrain, l’apparition de H1N1 donne l’impression que H5N1 n’existe plus. Or il continue à circuler et à évoluer dans de nombreux pays, notamment en Égypte, où l’on rencontre des cas graves.
L’étude des virus influenza ne doit pas conduire à une telle segmentation car celle-ci se révèle dévastatrice : telle année, les chercheurs ne toucheront de l’argent, en réponse à un appel d’offres, que s’ils travaillent sur le H5N1, tandis que telle autre l’argent ne sera versé que s’ils travaillent sur le H1N1 ! Or ces virus évoluent, je le répète, dans un espace commun.
M. Jean-Pierre Door, député, président, co-rapporteur. À cet égard, les recherches se poursuivent-elles concernant le vaccin contre le H5N1 ?
M. Abdenour Benmansour. Absolument.
M. Jean-Claude Manuguerra. Des vaccins humains contre le H5N1 ont obtenu leur autorisation de mise sur le marché. Le Comité de lutte contre la grippe (CLCG), qui est suivi par le Comité technique de vaccination (CTV) et le Haut conseil de santé publique (HCSP), a recommandé, dès la phase 3, la vaccination des personnels de laboratoire. Le Pandemrix et le Prepandrix existent aussi dans la version H5N1, mais ils ne sont pas encore sur le marché. Peut-être arrivera-t-on un jour à se faire vacciner ?
II. LA VACCINATION EST-ELLE LA MEILLEURE SOLUTION ?
M. Jean-Pierre Door, député, président, co-rapporteur. Je propose que nous en venions justement à la question de savoir si la vaccination est la meilleure solution. C’est notre second sujet d’étude de la matinée, sachant que les composants, les essais cliniques voire l’autorisation de mise sur le marché ont alimenté les media et les rumeurs sur le vaccin.
J’accueille donc M. Antoine Flahaut, directeur de l’École des hautes études de santé publique (EHESP), M. Bruno Lina, directeur du Centre national de référence contre la grippe, pour le Sud de la France, M. Jean-François Delfraissy, directeur de l’Institut de microbiologie et de maladies infectieuses (IMMI), M. Thierry Blanchon, responsable adjoint du réseau Sentinelles, et M. Jean-Marie Cohen, coordinateur national du réseau des GROG.
M. Antoine Flahaut, directeur de l’École des hautes études de santé publique. Peut-on ralentir la propagation du virus ? Je souscris totalement à cet égard à ce qu’a dit M. Jean-Claude Manuguerra tout à l’heure : selon le réseau Sentinelles qui, depuis 1984, suit les épidémies de syndromes grippaux dans le pays, on n’a jamais réussi à combattre le pic épidémique unique que l’on observe chaque année. Personne d’ailleurs dans le monde n’essaie de les éliminer, ni les organismes de recherche, ni les organismes chargés de la gestion. On se contente simplement de protéger les personnes à risque.
En données non consolidées, le Réseau Sentinelles a établi 693 cas pour 100 000 habitants, ce qui, pour l’instant, n’est pas du tout exceptionnel si l’on se rapporte aux vingt-cinq dernières années de l’épidémiologie des syndromes grippaux.
Sur le plan géographique, on n’est pas non plus capable de ralentir la propagation d’une épidémie de grippe en France. Même si l’Aquitaine a semblé assez épargnée au début par le virus – pour des raisons qui nous échappent totalement –, aujourd’hui, tout le pays est concerné par le problème.
Aux États-Unis, on observe, entre 1990 et 2000, une corrélation très claire entre l’épidémie de grippe saisonnière et l’augmentation très nette, lorsqu’il s’agit alors d’une grippe H3N2, de la mortalité. Ces épidémies très meurtrières y font apparaître un excès de mortalité évalué à 36 000 personnes par an en moyenne – contre 6 000 en France, voire probablement un peu plus dans la mesure où la population a vieilli depuis – et une augmentation très conséquente de la morbidité hospitalière.
Ce qui me gêne – nous avons d’ailleurs eu l’occasion d’en discuter entre experts, notamment lors d’un récent colloque à l’OMS – c’est que l’on change l’instrument de mesure de la mortalité en comptant les décès qui sont rapportés. Or, le décompte de la mortalité par grippe ne peut se faire ainsi. Il ne peut être fondé que sur le concept de l’excès de mortalité, à savoir celle qui est supérieure à la mortalité saisonnière attendue. Seuls la France, par l’intermédiaire de l’Institut de veille sanitaire (InVS), le Royaume-Uni et les États-Unis établissent, quasiment en temps réel, un décompte de cette surmortalité. Ainsi, la courbe publiée hier par le CDC d’Atlanta, ou plus exactement l'ensemble des Centers for disease control and prevention, montre un excès de mortalité dans son échantillon de 122 villes. La directrice de l’InVS nous dira certainement que tel n’est pas encore le cas en France.
Pouvait-on espérer ralentir la propagation du virus lorsqu’au mois d’avril les scientifiques britanniques et français ont publié des articles sur son taux de reproduction au Mexique ? On entend par taux de reproduction le nombre de nouveaux cas générés par un cas index, sachant que la propagation est exponentielle. Ce qui est attendu pour la grippe, c’est un intervalle de génération de trois jours entre deux cas – durée de la période contagieuse de la grippe en moyenne. Si tel est le cas, on ne peut dès lors qu’être doublement rassuré parce que l’on sait que l’on affaire à une grippe et donc à une maladie transmissible dont on peut espérer ralentir la propagation. Avec la grippe saisonnière, on avait un magnifique laboratoire d’essai pour se préparer à lutter contre des épidémies, mais personne, et pas seulement les Français, ne l’a utilisé. On est là pourtant dans le champ de maladies dont on pourrait espérer réduire la propagation.
La carte de l’OMS, qui a été publiée voilà quelques jours, montre que tous les pays du monde ou presque comptent aujourd’hui des cas de grippe H1N1, voire des morts dus à cette maladie.
On ne peut pas réduire la propagation du virus chez certains malades – sans savoir très bien pourquoi – au point qu’une circulation extracorporelle devient nécessaire. Mais si la radiographie ou le scanner de malades néo-zélandais ou australiens pendant l’hiver austral montraient des poumons équivalents à ceux de noyés – ce qui était le signe de cas gravissimes –, ces malades ont survécu sans séquelles.
Cette maladie, tout en étant la grippe, n’a pas le profil de celle que l’on connaissait. Normalement, l’hospitalisation en soins intensifs en cas de grippe H1N1 confirmée aurait dû être très faible dans les plus basses classes d’âge et très importante – 90 % de l’ensemble – chez les plus de soixante-cinq ans. Or, c’est tout le contraire qui s’est passé, toujours en Nouvelle-Zélande et en Australie : ce sont les enfants d’un à deux ans qui ont été le plus fréquemment hospitalisés en soins intensifs pendant l’hiver austral.
Mais si les personnes âgées de plus de soixante-cinq ans n’ont pas été le plus souvent atteintes par la grippe pandémique H1N1, leur taux de mortalité est le même, voire supérieur à celui des petits enfants. C’est ce qui ressort d’une courbe établie en Californie. Les petits enfants sont beaucoup plus souvent hospitalisés en soins intensifs aujourd’hui à cause de cette grippe, qui a peu diffusé chez les personnes très âgées. Mais lorsque les personnes adultes, âgées ou très âgées, sont atteintes, leur taux de mortalité est supérieur.
Au mois d’août dernier, nous avons établi des scénarios pour cette pandémie, à partir de travaux menés entre juin et juillet. La vague que nous avions prévue pour l’hémisphère Sud correspond à peu près à ce qui s’est passé au cours de l’hiver austral. C’est plutôt une demi-vague que l’on pense voir réapparaître entre juin et septembre 2010, toujours en l’absence de vaccination. Pour l’hémisphère Nord, notre modèle privilégie un scénario ne comportant qu’une seule vague, deux fois supérieure à celle observée dans l’hémisphère Sud.
Toutefois, si la vague a été faible dans l’hémisphère Sud pendant l’hiver austral, elle a été deux à trois fois plus importante que celle habituellement observée. Dans les petites îles du Pacifique, peu peuplées, le virus H1N1 – bien que reçu tardivement dans la saison – a entraîné une épidémie deux à trois fois plus importante – avec, en Nouvelle-Calédonie, un taux d’attaque de l’ordre de 15 %.
L’impact de l’immunisation par modélisation, c'est-à-dire par un travail purement théorique, montre que si l’on immunisait 15 % de la population mondiale, soit 1 % par jour durant quinze jours, on pourrait limiter le pic de l’épidémie, et probablement amortir le choc qu’elle pourrait avoir sur le système de soins et sur l’organisation sociale. L’efficacité sur le pic épidémique de l’immunisation serait totale si 30 % de la population était immunisée (ce qui correspondrait peut-être à 50 % de vaccinés). Je précise que « immunisée » ne signifie pas « vaccinée », car la vaccination n’est pas efficace à 100 %. Dans ce contexte, la vague de l’hémisphère Sud n’aurait pas été impactée, puisque c'est en octobre qu’a commencé la vaccination dans cette simulation sur ordinateur ; la vague de l’hémisphère Nord et la deuxième vague de l’hémisphère Sud auraient pu ne pas apparaître du tout. On pourrait tenter face à des épidémies saisonnières – c’est peut-être la leçon à retenir pour la prochaine – d’appliquer ce type de mesure.
S’agissant des scénarios pour cet hiver, et sachant que nous avons avec les États-Unis un décalage dans le temps que l’on peut évaluer à un mois, peut-être conviendrait-il d’y examiner la situation même si l’on ne peut être sûr qu’elle se répétera chez nous. La courbe des CDC qui est l’équivalente de celle du Réseau Sentinelles montre que le pic semble passé, un peu d’ailleurs comme cela semble être le cas en Ile-de-France.
Selon le premier scénario, la vague aurait un profil type bosse de chameau, pendant quelques semaines encore. « L’hiver n’est pas fini, l’hiver va être long » : telle est la remarque du docteur Anne Schuchat du CDC.
Le deuxième scénario serait celui d’une véritable deuxième vague, après un délai inconnu, au cours du même hiver. Encore une fois, cela n’a jamais été constaté depuis vingt-cinq ans avec les épidémies de grippe saisonnière. Mais nous avons affaire à un nouveau virus, et donc une deuxième vague peut très bien apparaître amenant soit un virus légèrement muté, sur le plan immunologique, soit le même virus.
Dans le troisième scénario, la vague ne réapparaîtrait pas, le problème étant reporté à l’année suivante avec un virus qui n’a pas forcément besoin de muter, comme le disent les virologues avec parfois un peu d’anthropomorphisme.
Enfin, je voudrais m’associer à ce qu’ont dit mes prédécesseurs : pour éclairer la décision, les besoins de recherche sont immenses. Nous n’avons pas aujourd’hui de bonnes connaissances sur les modes de transmission : personne ne connaît, par exemple, la proportion de transmission manu-portée. De même, on manque d’une bonne évaluation de la virulence : l’incertitude règne quant au taux de mortalité indirecte – la mortalité directe si elle est de mieux en mieux cernée, ne l’est pas encore très bien pour des raisons qui tiennent à la fois au numérateur, c’est-à-dire au décompte de cette mortalité, et au dénominateur, c’est-à-dire au nombre de personnes infectées. On sait combien de personnes ont une grippe clinique, mais on ne sait pas combien de personnes ont été infectées.
S’agissant des mesures de prévention, on ne parle plus des masques dont on avait tout de même commandé un milliard. Personne n’en porte parce qu’ils n’ont jamais été véritablement testés. Seule l’utilisation des masques FFP2 l’a été dans des blocs de réanimation, chez des personnels de santé. Concernant la population générale, aucune étude n’a été effectuée.
On dispose bien de quelques études très fragmentaires quant au lavage des mains, mais quel peut être l’impact de ce dernier si l’on n’y pense qu’une fois de temps en temps ? Dans ce domaine également, aucun plan de bataille n’a été élaboré.
Concernant la fermeture des écoles – sujet sur lequel nous avons publié plusieurs études –, son efficacité est très claire : une telle fermeture pendant quinze jours, en période épidémique, diminue même la mortalité des personnes âgées. Pour autant, faute de tests englobant des phénomènes épidémiques ou pandémiques, on ne peut donner un ordre de grandeur ni de la durée de la fermeture nécessaire, ni même de l’impact économique collatéral.
Pour ce qui est des stratégies vaccinales, je ne m’associe pas à l’idée que la vaccination soit un geste civique et collectif. Aucun élément de preuve ne permet de l’affirmer. La seule idée à laquelle je m’associe très volontiers, c’est que le rapport bénéfices/risques de la vaccination est très en faveur du vaccin. Non seulement ses risques sont très faibles et très limités, si l’on s’en tient à l’expérience menée actuellement, mais nous accueillons des malades en réanimation que l’on n’avait jamais ou quasiment jamais vus avec la grippe : cinq syndromes de détresse respiratoire aiguë (SDRA) grippaux ont ainsi été rapportés dans le programme de médicalisation des systèmes d'information (PMSI) de l’année dernière – on en compte entre un et cinq chaque année depuis cinq ans. Le profil de la grippe n’est donc pas le même que d’habitude. Je m’associe donc à l’idée que la vaccination a un clair rapport individuel bénéfices/risques, mais, sur le plan collectif, cela n’a jamais été démontré.
Très peu d’études existent concernant la vaccination des personnels de santé : aucune chez les médecins généralistes, aucune en milieu hospitalier. Seuls quatre essais randomisés, aux résultats plus ou moins discutés d’ailleurs, ont porté sur les personnels de santé des maisons de retraite. Avant de vouloir culpabiliser les gens quant à leur manque de civisme ou de sens altruiste, encore faudrait-il disposer d’éléments de preuve.
Je ne reviendrai pas sur la place des antiviraux ni sur le traitement des formes sévères, dont on a beaucoup parlé.
En termes de veille sanitaire, les États-Unis ont multiplié par quatre, du jour au lendemain, leurs estimations reconnaissant qu’ils s’étaient trompés jusqu’alors : en fait, 22 millions d’Américains ont été contaminés par le H1N1. Cela signifie que les temples de la veille sanitaire internationale que sont le CDC ou l’InVS se heurtent à un manque de précision en matière d’estimations, même si, probablement, d’énormes progrès ont été effectués.
Nous tentons, avec l’Institut de veille sanitaire et avec l’aide de l’Institut Microbiologie et Maladies infectieuses (IMMI), en partenariat avec l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM), de pallier le manque d’études de séroprévalence. Très novatrices en Europe, elles permettront d’avoir dans notre pays une sorte de « juge de paix » en la matière.
Pour les pays du Sud, ce n’est pas là une priorité. Certes, qu’il s’agisse de l’Afrique, de l’Amérique latine ou encore de l’Asie du Sud-Est, ces pays ont des problèmes majeurs à résoudre tels que le sida ou les diarrhées. Pourtant, les infections respiratoires de l’arbre supérieur représentent la première cause de mortalité en Afrique subsaharienne, sans que l’on sache quels en sont les agents responsables. Pour savoir si la grippe représente 1 %, 10 % ou 30 %, voire plus, de ces infections respiratoires qui touchent les enfants et les jeunes, il conviendrait donc d’y lancer des études – le professeur Marc Gentilini, spécialiste des maladies infectieuses, y insiste particulièrement –, avec autant de soin qu’on l’a fait dans les pays du Nord.
Concernant, enfin, la perception de la pandémie, les rumeurs et les craintes, peut-être n’a-t-on pas tenu en effet suffisamment compte des réactions de la société vis-à-vis des propositions avancées, avec l’aide des experts, par les autorités de santé. On a probablement par trop négligé les études dans le domaine des sciences sociales.
M. Bruno Lina, directeur du Centre national de référence contre la grippe, pour le Sud de la France. Ma présentation des différentes étapes de préparation d’un vaccin se fera en deux parties : je retracerai d’abord l’évolution des virus, laquelle a un impact sur la composition vaccinale, et, ensuite, les étapes qu’un vaccin doit subir avant d’être utilisé.
Sachant que si l’on a affaire à plusieurs virus, seuls trois nous intéressent en termes de vaccin saisonnier – le virus de type B et les deux virus de type A –, l’objectif de la vaccination est de mettre en place une réponse immunitaire. C’est essentiellement une réponse humorale qui semble protectrice – en tout cas, c’est la plus étudiée. Dans le cadre de l’évaluation de l’efficacité vaccinale, on utilise des corrélats de séroprotection, qui sont déterminés par la réponse vis-à-vis de l’hémagglutinine. Ce sont donc les deux protéines de surface qui sont la cible de la réponse immunitaire, laquelle est indispensable pour permettre la guérison : les patients immunodéprimés qui ne sont pas capables de monter une réponse humorale ont besoin de beaucoup plus de temps pour guérir. Bien entendu, d’autres protéines sont la cible de la réponse immunitaire, mais je n’insisterai pas sur ce point.
Les virus influenza sont capables de mutations d’échappement, ce qu’on appelle la variation antigénique, qui sont le fruit de la combinaison d’un niveau de réplication important et d’une pression immunitaire qui sélectionne les variants d’échappement.
En termes de réponse immunitaire, deux structures sont presque similaires : d’une part l’hémagglutinine dans sa forme monomérique, qui comprend un site d’attachement au récepteur et, d’autre part, un anticorps qui est collé sur la molécule. Les tailles respectives d’une hémagglutinine et d’un anticorps se ressemblent, ce qui signifie que lorsqu’un anticorps colle sur une hémagglutinine dans des zones proches du site d’attachement, l’hémagglutinine ne peut plus jouer le rôle qu’elle a au sein du virus, à savoir permettre à ce dernier d’entrer à l’intérieur de la cellule. Cette réponse immunitaire et humorale est très efficace, notamment du fait du ciblage de ces hémagglutinines par les anticorps.
C’est par le biais de mutations génétiques, qui confèrent secondairement des modifications antigéniques, que le virus, qui est préalablement neutralisé par un anticorps qui vient se coller sur l’extrémité de l’hémagglutinine, ne reconnaît plus sa cible et retrouve son potentiel infectieux.
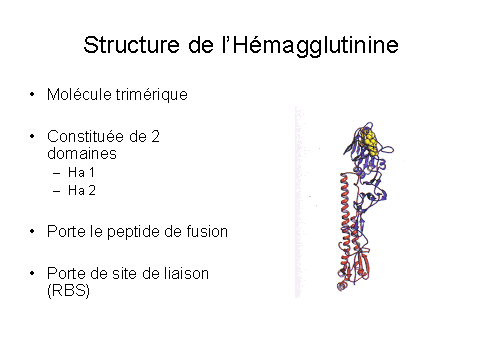
La structure de l’hémagglutinine est subdivisée en domaines fonctionnels extrêmement précis qui ont chacun leur rôle. La molécule comprend une tige rouge, structure qui permet la fusion, ce qui permet au virus d’entrer. La partie globulaire bleue permet l’attachement. La partie jaune de la partie globulaire bleue permet la liaison avec le récepteur. Tout ce qui concerne la réponse immunitaire est essentiellement porté par la partie bleue de la molécule, avec un impact sur l’attachement.
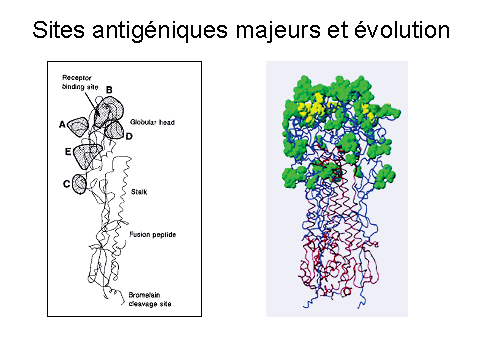
Lorsque l’on regarde plus précisément où surviennent les modifications antigéniques au fil du temps, le panneau de gauche montre les régions qui portent des mutations d’échappement. En regard, vous avez une molécule trimérique – l’hémagglutinine – où sont pointées en bleu et vert l’ensemble des mutations observées entre 1968 et 2008 sur les virus H3N2. On constate une modification pratiquement complète d’un certain nombre d’acides aminés qui aboutit à ce que les anticorps qui étaient présents au fil des infections perdent leur efficacité du fait de ces mutations. En revanche, on voit très bien que la zone jaune, qui est la zone d’attachement au récepteur, est parfaitement respectée. Ce n’est pas une zone antigénique.
Si vous vouliez faire une analyse génétique du virus, et que vous ne regardiez que la séquence, vous seriez incapables de dire, en prenant par exemple un hiver de H1N1 aux États-Unis et en effectuant l’analyse génétique des virus, ce que les mutations signifient. Et lorsque vous essayez de cibler la diversité génétique considérable qui peut exister au sein d’un hiver de grippe saisonnière dans un pays comme les États-Unis, pour savoir si elle correspond à une diversité géographique, vous constatez que rien ne colle. Cela signifie que les mutants apparaissent partout, et que des mutants similaires peuvent apparaître à des endroits différents, de façon totalement désordonnée
Toujours en matière de diversité génétique, si je vous montrais un arbre phylogénétique et si je vous disais qu’il y avait un mutant, vous seriez également incapables de comprendre ce que cela signifie. En effet, la lecture des mutations doit se faire sur la base non pas uniquement de la séquence, mais aussi des protéines, des épitopes et de ce que ces mutations ont potentiellement comme conséquences sur les protéines. Une mutation est donc génétique, et une modification antigénique est protéique.
Lorsque l’on suit H3N2 au fil du temps, on voit apparaître, pratiquement tous les ans, des mutants d’échappement à la réponse immunitaire. Ces mutants sont passés à travers le tamis et font que le virus est capable de réinfecter une population considérée comme immunologiquement naïve vis-à-vis du nouveau mutant. Pour en revenir à la vaccination, tout cela nous impose de modifier en permanence le contenu vaccinal de façon à suivre l’évolution des virus, en sachant bien que nous sommes des « suiveurs ».
On essaie, pour simplifier, d’avoir des représentations graphiques de l’évolution des virus pour rendre plus simple la lecture de l’évolution des virus. Ainsi peut-on constater que dans certaines situations le virus évolue lentement, et que dans d’autres il évolue plus vite. Si la courbe d’évolution est plate, c’est qu’il évolue lentement. Si elle est ascendante, c’est qu’il évolue de façon plus rapide.
Forts de cette connaissance de l’évolution des virus et de leur diversité d’émergence, comment peut-on, au sein d’une expertise collective, procéder à des choix de composition vaccinale ?
C’est d’abord par le fruit d’une surveillance intense menée par l’ensemble des centres de référence répartis de par le monde, et d’une collaboration avec un certain nombre de structures, que l’on est capable de proposer des candidats vaccins et in fine, de produire des vaccins. Un peu moins de 200 centres de référence nationaux répartis partout dans le monde font à cet égard de la surveillance clinique et récupèrent des échantillons biologiques de patients grippés. Une fois l’analyse génétique et antigénique effectuée, ils transmettent un certain nombre de virus qu’ils ont isolés à un deuxième niveau de laboratoires, celui des centres mondiaux de référence qui, au lieu de gérer un pays, gèrent un continent ou plus. En recevant des échantillons de virus venant des centres nationaux de référence, ils font une intégration de l’information qui leur permet d’avoir une vision planétaire de l’évolution des virus et donc de sélectionner le candidat vaccin.
C’est finalement à l’OMS de définir la souche qui sera retenue pour être introduite dans la composition vaccinale parce qu’elle aura émergé dans différents endroits, présentera le potentiel épidémique le plus important et sera significativement différente du virus qui circulait précédemment.
La transformation de ce virus en vaccin a également lieu dans le périmètre de l’OMS, au sein de « laboratoires essentiels de régulation », structures qui vont modifier le virus pour le transformer en candidat vaccin, en supprimant tous ses caractères de virulence potentiels. Bref, il s’agit de transformer ce virus en virus vaccinal à haut potentiel de multiplication. Ce candidat vaccin sera alors transmis aux producteurs par l’OMS, pour fabrication et distribution des doses vaccinales.
En pratique, la stratégie de production des semences vaccinales est une modification du virus qui avait été sélectionné, pour en faire un candidat vaccin, lequel s’obtient par réassortiment. C’est ainsi qu’on enlève ses potentiels facteurs de virulence et que l’on introduit potentiellement le haut niveau de réplication.
Quand vous mettez deux virus dans une cellule, ils se multiplient, et par le jeu de réassortiments génétiques, ils sont potentiellement capables de fabriquer de nouveaux virus qui vont comporter, du moins l’espère-t-on, les deux protéines de surface du candidat vaccin. C’est en effet ce que l’on attend pour avoir la réponse immunitaire adaptée au nouveau virus qui va circuler ainsi que les segments de gêne internes du virus qui vont lui donner la capacité d’être à haut niveau de réplication de façon à disposer d’un maximum de vaccin.
Ensuite, ce candidat vaccin est mis dans des œufs pour être multiplié. Ce réassortiment, ce mélange, ainsi que la production, se font ensuite essentiellement dans l’œuf.
Les différentes étapes de production comprennent donc une composante OMS et une composante Producteurs. La première prend en moyenne entre un et deux mois : il s’agit de sélectionner le virus, de fabriquer le candidat vaccin réassortant et de vérifier que ce dernier est bien adapté, puis de le transmettre aux producteurs de vaccin. Ceux-ci adaptent alors le candidat vaccin à leur système de production avant de lancer une production de masse qui aboutira à une commercialisation du vaccin, ce qui prend de trois à quatre mois. Le timing de cette production est exactement le même pour un vaccin saisonnier et le vaccin pandémique.
Il serait possible de faire évoluer cette stratégie de production en utilisant des systèmes de cultures cellulaires, ce qui permettrait d’éviter les cinq premières étapes de production du candidat vaccin. En effet, on pourrait partir directement de la souche sélectionnée, qui serait ensuite utilisée en culture cellulaire. Mais comme on doit aussi mettre en place toute une série de contrôles, il n’est pas sûr que, finalement, on pourrait gagner trois ou quatre mois avec cette production sur cellules. On ne gagnerait en fait qu’un mois par rapport à la culture sur œufs.
S’agissant du calendrier de production des souches, depuis l’évolution du candidat vaccin en une semence vaccinale puis en un vaccin monodose administrable au patient, le schéma classique de production pour un vaccin saisonnier dans l’hémisphère Nord commence en février avec le choix du candidat vaccin pour finir mi ou fin septembre avec le début de la vaccination, lorsque l’ensemble des essais cliniques est terminé. Ces derniers interviennent un à deux mois après le début de la production des vaccins, lorsque l’on dispose des lots précliniques. Ces derniers permettent, avant la commercialisation du vaccin, de procéder à la validation clinique des vaccins, de vérifier leur immunogénéicité et leur innocuité et de s’assurer qu’ils correspondent aux critères de tri des vaccins qui peuvent être retenus par la Food and drug administration (FDA) et l’Agence européenne du médicament (EMEA).
M. Thierry Blanchon, responsable adjoint du réseau Sentinelles à l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM). Je voudrais tout d’abord souligner que la médecine libérale souhaite être plus impliquée dans la vaccination à toutes les étapes.
Dans le cadre du réseau Sentinelles et en partenariat avec l’InVS, 1 300 médecins généralistes libéraux , répartis sur l’ensemble du territoire métropolitain, effectuent bénévolement depuis de nombreuses années un travail de fourmi. Le réseau est né au même moment que celui des GROG, en 1984, mais ce n’est que récemment, à la faveur de la pandémie, qu’ils se sont rapprochés. Dans quelques semaines, et pour la première fois, ils publieront des données communes.
Dix indicateurs font l’objet d’une surveillance continue, dont les syndromes grippaux : fièvre à début brutal, température supérieure à 39 °C avec myalgies et signes respiratoires.
La transmission des données se fait via l’Internet, sur un site sécurisé. Ces données sont recueillies, analysées et redistribuées en temps réel. La communication interne, au travers des forums, permet aux médecins de donner leur ressenti. La médecine générale est très peu informée des recommandations formulées par le Comité de lutte contre la grippe ou par le ministère. L’information n’est pas toujours optimale : ainsi, des interrogations continuent de se faire jour sur l’opportunité de la vaccination en centres et sur le choix des multidoses.
Les données les plus récentes montrent que l’épidémie est bien présente, et en constante augmentation. Si le pic semble être passé aux États-Unis, ce n’est pas le cas en France, où un accroissement des syndromes grippaux est à noter.
L’espace éthique/AP-HP, qui est la structure d’éthique de l’Assistance publique–Hôpitaux de Paris, a lancé une enquête d’opinion entre le 27 juillet et le 6 septembre auprès des professionnels de santé – réseaux de médecine de ville et centres hospitaliers, soins intensifs, anesthésiologie – tendant à recueillir leur avis avant la publication des recommandations sur la vaccination en septembre : 4 752 personnes ont répondu, dont 2 304 médecins et 275 généralistes. Les résultats ont conduit à soumettre quatorze propositions aux instances en charge de la rédaction de l’avis sur la stratégie vaccinale contre le virus H1N1. Les médecins généralistes ont ainsi souhaité leur plus grande implication tant dans la réflexion sur la vaccination que dans la recherche.
En matière de recherche, l’étude d'immunogénéicité EFFIVAC a pour objectif principal d’estimer l’efficacité vaccinale de terrain (EVT) des vaccins anti-grippaux pandémique et saisonnier de l’hiver 2009-2010 ; elle vise aussi à comparer la mesure de l'EVT avec les données d’immunologie et de réactivité obtenues en laboratoire. D’autres études existent, telle l’étude de cas témoins, plus lourde, lancée par les GROG. La méthode utilisée dans le cadre d’EFFIVAC – le screening – a été mise en place depuis plusieurs années : elle permet d’évaluer les vaccins de deux façons à raison de la proportion de patients vaccinés soit parmi les cas observés soit parmi la population. Cette étude, menée les années précédentes sur le vaccin saisonnier, a permis d’adapter en temps réel les stratégies vaccinales. Mais alors que seuls les syndromes grippaux étaient l’objet de l’étude, les grippes confirmées, cet hiver, font également partie de l’analyse. Il s’agit d’observer les différences entre les deux.
La recherche ne doit pas hésiter à s’appuyer sur la médecine générale. Non seulement celle-ci souhaite être associée aux travaux en la matière, mais la recherche clinique a montré ces dernières années qu’elle pouvait être de qualité à ce niveau de la médecine générale et pas seulement à celui des centres hospitaliers, même s’ils sont le plus souvent partenaires de la recherche. Je prendrai à cet égard deux exemples d’essais menés l’année dernière pendant la grippe saisonnière à partir de la médecine générale.
Le premier, GripMask, relatif à l’impact du port de masques distribués par la médecine générale, a montré que mettre un masque lors d’une grippe saisonnière n’était a priori pas efficace. Bien évidemment, la façon de se comporter doit sans doute être très différente lors d’une grippe saisonnière que lors d’une grippe pandémique. Il est donc dommage non seulement que le port du masque ne soit pas devenu systématique, mais, de plus, que son efficacité ne soit pas étudiée pendant la grippe pandémique cette année.
Le second essai, intitulé Bivir, a porté sur l'effet virologique et clinique de l'association de deux inhibiteurs de la neuraminidase, afin de savoir s’il fallait associer le Tamiflu et le Relenza. Or ses résultats, qui ont été transmis au ministère et à l’OMS et qui sont fondés sur un sous-type différent du virus H1N1, ne seront pas réétudiés cette année, pour des raisons de priorité, à l’aune de la grippe pandémique, alors que les structures de chercheurs, de médecine générale, en partenariat avec les laboratoires pharmaceutiques, sont prêtes. C’est d’autant plus dommage que la pandémie offrait, du point de vue de la recherche, une chance unique pour faire progresser nos connaissances.
M. Jean-Marie Cohen, coordinateur national des GROG. Le temps dont je dispose ne me permettra que de faire passer trois messages, essentiels aux yeux du médecin que je suis, posté à mi-chemin entre les praticiens et les autorités.
Il faut tout d’abord rappeler que le problème est essentiellement de nature économique : va-t-on pouvoir ne pas perturber la production nationale à cause des arrêts de travail ?
Quelques chiffres : si l’on cumule le nombre hebdomadaire d’infections respiratoires aiguës (IRA), celui d’IRA non grippales – dues aux virus respiratoires saisonniers – et l’estimation des cas de grippes H1N1 faite à partir du réseau des GROG, nous avoisinons la barre des trois millions d’individus concernés par semaine, ce qui est déjà considérable. Le système de santé va-t-il tenir ? Pour le moment, les généralistes et les pédiatres traitent six IRA par jour, alors que leur capacité maximale de prise en charge est de onze. En cas de deuxième vague, nous serions confrontés à d’importantes difficultés. Pour l’instant, le système tient. Le nombre d’arrêts de travail est en faible augmentation, certainement parce que la grippe touche surtout des personnes jeunes.
Mon premier message, s’agissant des mesures barrière, c’est qu’il nous faut porter ceinture et bretelles. Ces mesures ne permettent pas d’éviter la grippe, mais d’éviter que nous soyons tous grippés en même temps. Forcément imparfaites quand elles sont prises indépendamment, elles deviennent efficaces lorsqu’elles sont conjuguées. Paradoxalement, la communication n’a insisté que sur certaines d’entre elles et successivement – port du masque, puis lavage des mains, antiviraux puis vaccin.
Mon deuxième message, c’est que le vaccin est un privilège. De ce point de vue, les pays développés devront assumer sur la scène internationale le fait de ne pas avoir aidé les pays moins développés. Aider ces pays est un bon investissement pour la France.
Nous savons désormais qu’il existe des formes graves chez les personnes sans facteur de risque. Après une première phase de déni, les Français s’aperçoivent que la pandémie existe bel et bien, ce qui coupe court aux dénégations que l’on a pu entendre au début : grippe « bidon », écran de fumée servant à masquer la crise financière et le chômage. Pour la première fois de notre histoire, nous avons la chance – extraordinaire – de pouvoir combattre une pandémie avec des vaccins et des médicaments. Il nous faut lutter contre les rumeurs qui affirment que les produits stockés sont inefficaces, voire dangereux, que les experts sont vendus, du moins sous influence.
Prenons le syndrome de Guillain-Barré (SGB). On compte chaque année en France 1 700 cas nouveaux, soit quatre par jour : si les médias traitaient de la même façon tous les cas de SGB, ils annonceraient quatre fois par jour un nouveau cas chez une personne non vaccinée contre la grippe pandémique ! Un article publié dans The Lancet montre que si l’on administrait un placebo à dix millions de personnes, au moins vingt et un cas de SGB seraient observés dans les six semaines suivant cette administration. J’ai relu toute la littérature sur ce syndrome associé à la vaccination, en particulier un article paru dans Langmuir en 1979. Tout part d’une grande campagne de vaccination en 1976 – 48 millions d’Américains étaient concernés –, à la suite de l’infection de soldats par des virus grippaux porcins. Un système de vaccino-vigilance exceptionnel a été mis en place : le nombre de déclarations de SGB chez les vaccinés était comparé au nombre attendu de cas dans un contexte habituel. Au bout de deux mois, on a observé une augmentation des déclarations de SGB chez les personnes vaccinées. En l’absence de pandémie, il a alors été décidé d’arrêter la campagne. Mais il a finalement été démontré que le nombre des cas de SGB chez les personnes vaccinées – 517 – correspondait à ce qui était attendu – 513. Il n’y a donc pas de quoi s’inquiéter.
Mon troisième message, c’est que nous avons besoin d’antiviraux maintenant. L’antiviral est un frein à l’extraordinaire multiplication virale, d’autant plus efficace qu’il est administré très tôt : chaque minute compte. Passé un certain temps, il ne sert plus à rien de l’administrer. Des études cliniques crédibles mettent en évidence l’effet des antiviraux sur la mortalité, la réduction de la transmission, la fréquence des complications. Le réseau des GROG a mis en place un système de surveillance des prescriptions d’antiviraux, qui a permis de constater que la quasi-totalité des cas de grippe n’était pas traitée par antiviral. Je ne suis pas juriste, et je m’interroge : un patient qui n’aurait pas reçu d’antiviraux et aurait fait une forme grave ne serait-il pas en droit de poursuivre son médecin pour perte de chances ?
Une étude a été publiée dans PLoS le 29 octobre sur les exemples chilien et argentin. Au Chili, où il est fait une utilisation très large des antiviraux, comme en Grande-Bretagne, la mortalité a été beaucoup plus faible qu’en Argentine, pays où les inhibiteurs des neuraminidases n’étaient prescrits qu’aux patients hospitalisés présentant une forme grave de la pathologie. Après le pic épidémique, les Argentins ont modifié leur stratégie et ont recommandé l’administration d’antiviraux chez les femmes enceintes. Cela a permis de diviser le taux de létalité par trois chez ces patientes ! La France n’aurait-elle pas intérêt à adopter une stratégie de ce type ?
Je regrette qu’une partie du discours sur les inconvénients des antiviraux soit d’ordre fantasmatique. Le réseau de lutte contre les résistances aux médicaments antiviraux, Virgil, a pourtant mis en évidence le fait que les virus grippaux résistants émergeaient sans lien avec une pression de sélection. En Grande-Bretagne, où la consommation d’antiviraux est très importante, le pourcentage de résistance n’est que de 0,4 %. Ce n’est donc pas un usage large qui fera émerger des résistances. Pour combattre ces a priori et améliorer la communication entre experts, autorités et soignants, nous avons eu l’idée avec l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé (INPES) de créer un site, que je vous invite à consulter : http://www.pegasus.openrome.org.
M. Jean-Pierre Door, député, co-rapporteur. Merci d’avoir insisté sur la nécessité de lutter contre ce déni de la réalité pour le moins frappant.
Mme Brigitte Autran. Je me réjouis de cette audition publique qui me donne notamment l’occasion de contester les affirmations d’Antoine Flahault selon lesquelles le vaccin n’a pas d’efficacité prouvée.
Il est vrai qu’aucune étude clinique, portant sur des dizaines de milliers de volontaires dont une partie serait immunisée et l’autre non, n’a été réalisée. Mais il faut savoir que des essais cliniques évaluent chaque année les nouveaux vaccins sur des critères qui sont des substituts d’efficacité, certes contestables mais reconnus, portant sur le taux d’anticorps qui permettent d’assurer une protection. L’attention accordée aux nouveaux vaccins pandémiques, cette année, a été redoublée.
Par ailleurs, il existe des méta-analyses, des combinaisons d’évaluation d’efficacité, qui permettent de dire qu’a priori les vaccins confèrent environ 80 % d’efficacité contre une infection grippale qui serait due au même virus que le virus contre lequel on a été vacciné. L’efficacité est évidemment plus faible si l’on prend en compte tous les symptômes grippaux, quel que soit le virus en cause.
M. Antoine Flahault. Je n’ai jamais voulu dire qu’il n’y avait pas d’efficacité de ce vaccin, y compris clinique ; j’ai simplement indiqué que le vaccin n’avait jamais été utilisé comme barrière et que l’on ne pouvait pas laisser reposer toute une stratégie sur la base d’une théorie et de modèles mathématiques.
L’efficacité du vaccin contre la grippe saisonnière n’est pas excellente sur le symptôme grippal. Les méta-analyses de Stevenson dans The Lancet ont montré une très mauvaise efficacité clinique chez les personnes âgées. En revanche, une majorité d’articles souligne que la protection conférée par le vaccin contre la mortalité serait intéressante, ce que toutefois, d’autres équipes américaines des National Institutes of Health (NIH) contestent. L’efficacité est certaine chez les jeunes et chez les adultes, elle est moins bonne chez les personnes âgées, à qui est pourtant réservé le vaccin saisonnier.
Mme Brigitte Autran. Je suis d’accord pour dire qu’il n’y a pas d’efficacité barrière de la vaccination. Si les personnes âgées sont moins protégées par le vaccin, c’est qu’elles y répondent moins bien qu’un sujet de moins de cinq ans. Comme l’a dit Jean-Claude Manuguerra, la société mondiale s’est endormie sur la vaccination antigrippale, considérant que la grippe n’était pas une maladie grave, ce qui empêché le développement de vaccins plus efficaces. Aujourd’hui, nous cherchons à protéger la population de moins de soixante ans, qui n’a pas d’immunité. La vaccination sera à même de lui conférer cette protection.
Cet épisode grippal est une illustration formidable du besoin que nous avions en France de coordonner les recherches. On voit se développer des recherches sur l’immunogénéicité vaccinale, dans les créneaux délaissés par l’industrie. Chaque année, les industriels évaluent l’efficacité vaccinale sur des populations sans maladie sous-jacente. Or, la fraction d’individus que nous souhaiterions protéger est relative aux patients présentant des déficits immunitaires – infectés par le VIH, transplantés, sous immunodépresseurs. L’Institut des maladies infectieuses a aidé à la mise en place d’études évaluant les anticorps et la capacité de ces vaccins à protéger contre des épisodes grippaux authentifiés. Cette pandémie stimule de nouvelles recherches, j’espère que cela sera durable.
M. Abdenour Benmansour. Le vaccin vivant atténué n’est-il pas une solution pour améliorer l’efficacité de la vaccination ? Les États-Unis l’utilisent ; pourquoi cela n’est-il pas le cas en Europe ?
M. Bruno Lina. Les États-Unis et l’Europe ont en effet adopté une approche très différente. Le FluMist est commercialisé depuis trois ou quatre ans aux États-Unis ; il est désormais recommandé pour les enfants, mais pas pour les personnes de plus de soixante-cinq ans. En Europe, les vaccins vivants atténués n’ont pas d’autorisation de mise sur le marché. Il a donc paru illusoire de mettre en place, dans le cadre de la pandémie, de façon rapide, une AMM pour les vaccins atténués.
Par ailleurs, toute une série de questions ont été soulevées par l’Agence européenne du médicament, notamment sur la potentielle réversion du virus, comme virus sauvage, pour les vaccins vivants atténués : les producteurs ne semblent pas totalement maîtriser les déterminants génétiques d’atténuation. Enfin, il existe un risque théorique de transmission du virus vaccinal à l’entourage, qui peut comprendre des personnes à qui le vaccin n’est pas recommandé, comme les personnes immunodéprimées. Pour toutes ces raisons, il nous a semblé qu’un contexte de pandémie n’était pas le meilleur moment pour introduire ce type de vaccin.
M. Jean-Claude Manuguerra. La remarque de Jean-Marie Cohen relative à l’utilisation des anti-viraux est très importante. La doctrine, qui valait aussi pour le virus H5N1 aviaire, n’a jamais été modifiée : il faut traiter tous les patients infectés. Cependant, au cours du temps, son application a été modulée, notamment aux mois de septembre et octobre où l’incidence importante des IRA était due à d’autres virus que ceux de la grippe. Pourquoi ? Il n’était alors pas question de résistance – en l’absence de H1N1 ; il s’agissait plutôt d’éviter que l’antiviral, qui n’a aucune action contre les autres virus, voie sa réputation ternie. Après discussion, le Comité de lutte contre la grippe a donc adopté une formulation invitant à reprendre l’utilisation des antiviraux dès que la circulation du H1N1 deviendrait prépondérante. La fiche C5 « Stratégie et modalités d’utilisation des antiviraux » du plan national « Pandémie grippale », a été réactualisée et sera mise en ligne prochainement ; L’application sera désormais en conformité avec la doctrine.
Pour prolonger la comparaison avec le Chili et l’Argentine, il semble en effet que la létalité ait été plus faible dans les pays où les antiviraux ont été utilisés précocement.
M. François Bricaire. Le principe est qu’un sujet, dès qu’il est symptomatique, « peut » recevoir du Tamiflu. Auparavant, il « devait ». Cet assouplissement tient au fait que les formes étant majoritairement bénignes, le gain procuré par la prescription de Tamiflu n’apparaissait pas si évident. Mais on s’aperçoit, avec l’augmentation du risque de formes graves – ce que Mme Bachelot appelle la « loterie morbide » – que la prudence doit être de mise. Les médecins doivent donc prescrire de manière plus large le Tamiflu.
Les exemples chilien et argentin montrent bien que l’utilisation des antiviraux permet de réduire la létalité. Dès que le sujet commence un symptôme dont la forme paraît inquiétante au clinicien – une dyspnée, par exemple – celui-ci doit impérativement lui prescrire du Tamiflu.
M. Bruno Lina. Il est important de ne pas galvauder ce médicament, important pour la gestion des cas graves. Son administration précoce permet en outre de réduire le coût sociétal de la grippe, puisqu’elle allège le service de santé en évitant les formes graves et l’hospitalisation. Une étude française montre qu’il est « coût-efficace » de traiter et qu’il n’est pas « coût-efficace » de ne pas traiter.
Depuis le début du mois d’avril, date à laquelle a émergé le H1N1, on a scruté la résistance, avec un nombre phénoménal de tests de sensibilité : soixante cas de résistances seulement ont été dénombrés, parfois liés à un mésusage des antiviraux ou à des conditions cliniques de patients immunodéprimés. Alors que la pression de sélection est importante, il n’y a pas de résistances émergeant de façon subite.
Que signifie la résistance ? Aujourd’hui, on voit des patients qui vont bien, puis dont l’état se dégrade en trois ou quatre jours avant d’être emmenés en réanimation. Nous ne savons pas les identifier. Les patients qui sont hospitalisés d’emblée n’évoluent que lentement vers la guérison. Les prélèvements à J+3 ou J+4 montrent que ces patients, même sous traitement, ont encore du virus. La biologie du virus influenza, dans le contexte immunologique dans lequel il se développe, fait qu’il a une durée d’excrétion plus longue.
De ce fait, un certain nombre de corrélats fixes de prise en charge avec antiviraux ne sont peut-être pas bien adaptés ; pour le virus pandémique, il faudrait sans doute moduler. Lorsque l’on parle d’échec, il faut distinguer entre l’échec clinique – un patient qui s’aggrave sous traitement, ce qui peut être dû à autre chose qu’à une résistance – et des inefficacités théoriques sur la mesure des charges virales détectées chez un patient qui s’améliore parce que la dynamique d’évolution de l’infection virale traitée n’est pas la même que pour les virus influenza classiques.
Il existe un consensus pour une prescription plus large des antiviraux, qui seraient utilisés de façon raisonnée, avec des indications précises. Les formes graves, dans la plupart des pays de l’hémisphère Sud, sont apparues dans la deuxième partie de l’épidémie. Il est donc encore temps de réagir.
M. Jean-Marie Cohen. Lorsqu’un médecin prescrit du Zanamivir ou de l’Oseltamivir, c’est la Sécurité sociale qui paie. En tant que contribuable, je trouve dommage que l’on ne puise pas dans les stocks constitués en prévision du H5N1.
M. Jean-Pierre Door. Il s’agit de conditionnement en poudre, et les stocks ont été placés à l’abri.
M. Antoine Flahault. Je voudrais évoquer un sujet qui n’a pas encore été traité, celui des surinfections bactériennes : celles-ci seraient la cause de 20 à 30 % des décès.
Une grande partie de ces surinfections est due au pneumocoque. À cet égard, les recommandations vaccinales contre le pneumocoque concernant les petits enfants doivent être rappelées aux praticiens et aux familles. Les personnes fragiles, présentant un asthme ou du diabète – ces pathologies n’étaient jusque-là pas reconnues comme facteurs de risque – sont également concernées.
On avait sans doute tort de penser que les antibiotiques permettraient de faire disparaître ces surinfections bactériennes dans les pandémies du XXIe siècle : on s’aperçoit qu’elles sont redoutables, fulminantes, et malheureusement mortelles.
M. François Bricaire. Sauf erreur de ma part, il faudrait passer en phase 6 pour utiliser le Tamiflu sur la grande réserve. Les surinfections sont dues au pneumocoque, mais aussi aux staphylocoques et aux streptocoques non pneumococciques. Peut-être la vaccination anti-pneumococcique a-t-elle enfin trouvé grâce aux yeux du corps médical ?
Mme Françoise Weber, directrice générale de l’Institut de veille sanitaire. Je veux rendre hommage aux réseaux de surveillance de médecins généralistes, sans lesquels l’InVS ne pourrait pas mener sa surveillance.
Au début de la pandémie, nous avons comparé, parmi les patients avec facteurs de risque hospitalisés, ceux qui connaissaient une évolution favorable et ceux qui évoluaient vers des formes très graves, en réanimation et sous oxygénation extracorporelle (ECMO). Les premiers, dans une très grande majorité, avaient reçu du Tamiflu dans les premières quarante-huit heures. Les seconds avaient eu du Tamiflu dans 26 % des cas seulement. C’est une indication de l’efficacité de la prescription précoce et de la difficulté pour les patients, même présentant des facteurs de risque, de se voir prescrire un antiviral.
Enfin, je tiens à souligner que chez les trois derniers patients décédés – des personnes jeunes sans facteurs de risque – du streptocoque A a été retrouvé. Le paysage bactérien est peut-être en train de se transformer.
Mme Brigitte Autran. Je voudrais revenir sur le déni de gravité. Je ne parvenais pas à convaincre les membres du personnel de mon laboratoire, à la Pitié Salpêtrière, de se faire vacciner. Mais lorsque sont apparues les formes graves à la fin du mois d’octobre et que nous avons reçu les lavages alvéolaires des dix-huit personnes placées sous ECMO, ils ont fait vacciner jusqu’aux membres les plus éloignés de leur famille. Toute la difficulté d’une communication de qualité consiste à ce que la collectivité ait conscience de la gravité, sans pour autant prendre peur.
M. Alain Perez, journal les Échos. Il me semble que la désinformation ou le déni ne sont pas seulement le fait de la population ou des journalistes qui feraient mal leur métier, mais aussi celui des médecins, notamment les pédiatres. En août et en septembre, les généralistes ont joué en sous-main un rôle de dénigrement de la campagne de vaccination ; aujourd’hui encore, une partie d’entre eux avoue ses réticences. Pourquoi une telle attitude ?
M. Jean-Pierre Door, député, co-rapporteur. Nous n’avons pas accusé les journalistes. Il est vrai qu’il existe un réflexe franco-français qui consiste à toujours interroger les bienfaits d’une vaccination. Nous entendrons cet après midi un historien, Patrick Zylberman, sur cette dimension. S’agissant de l’attitude des médecins, peut-être M. Patrick Romestaing, du Conseil national de l’ordre des médecins, pourrait-il vous répondre.
M. Patrick Romestaing, président de la section Santé publique du Conseil national de l’Ordre des médecins. Dans un premier temps, les médecins généralistes ont été tenus à l’écart de la prise en charge de la pandémie ; ils ne se sont donc pas sentis très concernés. Ensuite, certaines grandes voix de la médecine se sont exprimées de manière inappropriée, en parlant notamment de « grippette ». Enfin, nul n’ignore la charge de travail des médecins. Les généralistes sont débordés de demandes de soins, et même si on entend quelques responsables syndicaux revendiquer encore une prise en charge de la vaccination en cabinet qui pose des problèmes pratiques, les échanges avec les médecins de terrain montrent qu’ils n’ont pas très envie de le faire. Ils ne sont plus en capacité de le faire. Sans parler du fait qu’il serait illogique de faire cohabiter dans les salles d’attente surpeuplées des personnes potentiellement porteuses du virus et des personnes qui viendraient se faire vacciner.
M. François Bricaire. La surcharge de travail des médecins fait qu’ils s’informent sans doute plus au 20 heures que dans le New England Journal of Medicine. Ils subissent donc, comme tout citoyen, les analyses, les remarques et les critiques, les font leurs et les transmettent à leurs patients.
M. Thierry Blanchon. Ce qui leur manque, c’est une information claire et simple. Les messages des experts et des autorités leur parviennent par courrier, dans des lettres longues et complexes. De ce fait, les généralistes relaient les informations alarmistes auprès de la population ; parfois même, ils n’en ont connaissance qu’après puisque ce sont leurs patients eux-mêmes qui leur transmettent les informations entendues au 20 heures.
M. Jean-Marie Cohen. Les médecins du réseau des GROG nous expliquent qu’ils doivent répondre chaque jour à une vingtaine de questions pratiques, précises. Or la grippe est un sujet très subtil : si l’on adopte des schémas simplistes, on peut très vite dire des bêtises. On a vu de grands professeurs proférer des énormités parce qu’ils avaient projeté ce qu’ils savaient déjà sur un domaine qu’ils connaissaient mal.
M. Antoine Flahault. Ces réticences ne sont pas nouvelles. Dès sa mise en place en 1984, le réseau Sentinelles a été chargé de surveiller la rougeole, une maladie à déclaration obligatoire et à prévention vaccinale. Alors que les déclarations faisaient état de 300 cas, le réseau estimait à 400 000 – la moitié de la cohorte de naissance – le nombre de cas de rougeole. Il s’agissait bien d’une maladie extrêmement meurtrière dans les pays en développement et à même d’entraîner de très graves complications ; mais les médecins français n’étaient pas convaincus et ne vaccinaient pas. Aux États-Unis, au même moment, on dénombrait moins de 500 cas. Il a fallu fournir de grands efforts pour responsabiliser les familles et les praticiens.
Récemment, nous avons eu un grand débat au comité technique de vaccination sur la varicelle. La vaccination n’est pas systématique, et pourtant elle permettrait d’éviter soixante-dix décès par an. Aux États-Unis, la campagne contre la varicelle est menée tambour battant.
Le corps médical, dans une attitude latine, semble considérer que les maladies infantiles sont des étapes initiatiques, qui permettent à ces futurs adultes de s’armer contre les agressions à venir.
M. Thierry Pineau. J’ai toujours été frappé par la connexion directe que les médias américains établissent avec l’information scientifique. Au 20 heures, on fait état des articles parus dans le New England Journal. Du coup, l’acceptation sociétale de l’innovation médicale est plus grande.
M. Bruno Lina. Malheureusement, les journalistes ont aussi leur part dans la désinformation. Ils sont soumis à un schéma catastrophique, leurs questions appartenant toujours au registre de la peur. Parfois, je trouve quelques articles de fond intéressants, mais eux non plus n’échappent pas à cette perception négative. Le choix des mots est de ce point de vue significatif : on parlera par exemple d’ « inoculer » un vaccin au lieu d’ « administrer » un vaccin. Accumulées, ces inexactitudes traduisent un inconscient, voire la volonté de vendre du papier.
M. Jean-Pierre Door, député, co-rapporteur. Monsieur Delfraissy, vous accompagniez à l’hôpital Henri Mondor la ministre de la recherche, dans le cadre de la journée de lutte contre le sida. Bien que vous n’ayez pu assister à cette matinée de débats, je vous invite à la conclure.
Conclusion
M. Jean-François Delfraissy, directeur de l’Institut Microbiologie et Maladies infectieuses (IMMI), INSERM. C’est un art difficile que de parler de propos que l’on n’a pas entendus ! Je m’en tiendrai à quelques remarques, si vous le voulez bien.
On dit souvent que la France n’est pas réactive. Dans le cas du H1N1, les différents organismes ont fait la preuve de leur réactivité. Il faut que cela continue.
Il est sans doute un peu tôt pour dresser un bilan de la campagne de vaccination. Les Français ont beaucoup entendu parler les experts, mais jusqu’à la mi-novembre ils n’avaient pas perçu physiquement ce qu’était la grippe. Depuis, chacun connaît une personne qui a été touchée et les bons de vaccination commencent à parvenir. Les attitudes changent donc – en témoigne l’affluence dans les centres de vaccination.
Il faudra aussi tirer les leçons de la relation avec les médias. Peut-être la couverture a-t-elle été trop importante.
Enfin, je n’arrive toujours pas à comprendre l’attitude de certains de mes confrères, qu’ils soient médecins de ville ou grands professeurs. Leurs prises de positions sont irresponsables : peut-être faut-il mettre cette inconscience sur le compte de la méconnaissance ? Là encore, il faudra tirer les conclusions qui s’imposent. La démocratie peut tuer la démocratie.
M. Jean-Pierre Door, député, co-rapporteur. Je partage votre conclusion. Ce déni de la réalité a gagné aussi les instances politiques. Certains ne savent plus si on a eu raison, qu’on parle des masques ou des doses de vaccin.
DEUXIEME PROBLEMATIQUE :
COMMENT PEUT-ON GARANTIR LES BONS CHOIX DANS LA LUTTE CONTRE DES VIRUS POTENTIELLEMENT DANGEREUX ?
Propos d’ouverture
M. Jean-Claude Étienne, sénateur, premier vice-président de l’OPECST. : La pandémie de grippe H1N1 pose le problème de la réactivité des pouvoirs publics et de l’attitude de nos concitoyens devant de tels risques. Après avoir analysé ce matin le comportement des chercheurs en cas de virose de ce type, vous vous pencherez cet après-midi sur ce que peuvent faire, ou plutôt ce que doivent faire les pouvoirs publics. Il s’agit de savoir comment offrir à nos concitoyens les meilleurs choix pour lutter contre la virose H1N1 et, partant de cet exemple, de déterminer les mesures que les pouvoirs publics doivent prendre et les comportements que les populations doivent adopter en réaction à des pandémies potentiellement dangereuses et tenues pour telles. Françoise Barré-Sinoussi, prix Nobel de médecine, nous rappelait que, au moment où elle a identifié le virus du sida, on ne parlait que de groupes à risques relativement localisés sans avoir aucune idée de l’ampleur de la pandémie, et cela en dépit des avertissements des chercheurs.
Le premier des deux thèmes abordés cet après-midi, à savoir « Pouvoirs publics et gestionnaires des pandémies », sera l’occasion d’examiner les approches bénéfice-risque et coût-avantage qui ont suscité la polémique, d’aucuns, parlementaires, médecins, parlant de « grippette » et mettant en doute le bien-fondé d’investir pour l’endiguer. Il faudra aussi se demander, comme l’avait fait, déjà, Jean-François Mattei au moment des étés très chauds, quelles sont les situations qui justifient de contraindre nos concitoyens à respecter le principe de prévention et le principe de précaution. Ce dernier, posé dès la loi Barnier du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement, est devenu constitutionnel depuis. Il laisse les chercheurs perplexes car il ne saurait exclure le devoir d’innovation, même si ce dernier n’est pas d’égale valeur juridique, sinon à risquer d’entraver une action salvatrice, voire préventive. L’Office d’évaluation des choix scientifiques et technologiques réfléchit à ce dilemme et à la façon dont ces deux principes doivent s’articuler entre eux au service du progrès.
Une autre problématique sera abordée, non moins intéressante : le rapport entre la connaissance que procure la recherche au scientifique penché sur sa paillasse et la représentation que les citoyens s’en font au travers du prisme de la médiatisation. C’est un des défis des sociétés contemporaines. Nous devons éviter de laisser libre le champ de ce qui n’est pas connu aux esprits imaginatifs susceptibles de propager des contre-vérités qui peuvent induire nos concitoyens en erreur, à leurs dépens.
Ma collègue sénatrice, Marie-Christine Blandin, animera les débats de cet après-midi, et elle succède dans cette fonction au député Jean-Pierre Door. Ils ont été désignés par l’Office pour élaborer un rapport sur la mutation des virus et la gestion des pandémies. Je me réjouis donc qu’ils soient chargés de faire la synthèse de travaux auxquels sont associés de si éminents spécialistes que je remercie d’être présents.
I. POUVOIRS PUBLICS ET GESTIONNAIRES DES PANDÉMIES
Mme Marie-Christine Blandin, sénatrice, co-rapporteure. Nous consacrerons l’après-midi à la gestion de la pandémie, d’une part par les pouvoirs publics et, d’autre part, par les acteurs de terrain, c'est-à-dire les maires et les soignants, dont la proximité avec les citoyens en fait les porte-voix. Un représentant d’un grand groupe industriel nous expliquera également le point de vue de l’entreprise.
Depuis deux mois, Jean-Pierre Door et moi-même avons été mandatés pour observer les mesures prises afin de lutter contre la pandémie de la grippe H1N1 et pour en suivre l’évolution. La situation a beaucoup changé. Au début, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) avait déclaré le niveau maximal d’alerte en raison du nombre de décès constatés au Mexique et de la vitesse de propagation du virus. Ayant en mémoire le cas du virus de la grippe aviaire, les autorités sanitaires tant nationales qu’internationales étaient sur leurs gardes : les vols avec le Mexique avaient été suspendus quelques jours, les premières personnes atteintes hospitalisées et mises sous haute surveillance, cela afin d’identifier les nouvelles souches. Mais le temps a passé et la grippe est moins virulente et moins dangereuse qu’on ne le craignait, même si le virus a des effets inattendus sur des populations qui, au départ, présentent peu de risques. Nous souhaitons donc prendre du recul, et notre rapport ne sera pas prescriptif. Il s’agira d’une étude sereine sur la façon dont la pandémie aura été gérée.
La situation est complexe, en partie imprévisible : le virus varie et nous progressons en marchant, au fur et à mesure des études. Ainsi, j’espère que M. le directeur général de la santé pourra commenter les remarques qui ont été faites ce matin sur l’opportunité d’utiliser très vite le Tamiflu, désormais prescrit par les médecins généralistes et remboursé par la Sécurité sociale, dont les stocks énormes sont bloqués à cause du protocole de niveau VI. De même, on nous a cité une étude sur le masque selon laquelle il ne constituerait pas une panacée. Pourtant, nombre de collectivités en ont acheté à grands frais. Par ailleurs, certaines recommandations sont moins relayées que d’autres : le port des lunettes en même temps que du masque, ne pas cracher au sol,...
La plus grande transparence doit être faite sur la manière dont sont testés et mis sur le marché les vaccins en cours de fabrication, car c’est elle qui est le terreau de la confiance. Les conditions de l’autorisation de mise sur le marché doivent être irréprochables pour éviter la suspicion, les rumeurs et même, selon l’expression du président de l’Office, M. Claude Birraux, « la pandémie des rumeurs ». De nouvelles techniques de production de vaccin sont apparues, notamment la culture cellulaire, sans avoir été validées par les protocoles de l’OMS. La variété de l’offre de vaccins – en une ou deux doses, avec ou sans adjuvant, de telle ou telle marque, obtenu à partir d’œufs embryonnés ou de cellules,… – suscite des questions de la part de nos concitoyens : selon quels critères le choix a-t-il été effectué ? Qui a choisi ? Avons-nous le choix du type de vaccin ? Et l’adjonction de mercure, d’aluminium ou de squalène est discutée sur Internet. Nos concitoyens sont devenus plus experts que nous ne l’étions il y a quelques mois tant est grande leur soif de savoir. Quand, dans le cadre de l’Office, des scientifiques nous ont donné des renseignements en avant-première, ils faisaient la Une des journaux le lendemain. Nous sommes entrés dans l’ère de la volonté de co-décision. Sans aller jusque-là, nous devons répondre à la soif de comprendre.
Quant au processus conduisant à l’autorisation de mise sur le marché, il est connu. Il résulte principalement de l’intervention de deux organismes : l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS) et l’Agence européenne des médicaments, (EMEA). Ces deux organismes publient leurs conclusions, les étayent et chacun peut vérifier les fiches techniques disponibles sur Internet – mais elles ne font guère recette.
L’organisation de la vaccination est particulièrement importante. Une fois leurs doutes levés, certains concitoyens se précipitent le bon à la main et ils mesurent la contrainte que représente la vaccination de 30 millions de personnes dans un laps de temps très court. Les préfets ont installé des centres ad hoc autour d’équipes de dix personnes, dont un médecin, plusieurs infirmières et infirmiers et du personnel administratif. L’ensemble du processus doit durer trente minutes, mais ce n’est pas toujours le cas, et les files s’allongent parfois. Il faut quelquefois attendre plusieurs heures avec de jeunes enfants. Et le doute fait alors place à l’exigence d’un service efficace.
Le choix français du vaccin du laboratoire britannique GSK conditionné par dix doses, avec mélange a posteriori de l’adjuvant, nous prive d’une très grande réactivité, complique le transfert de la prise en charge aux cabinets médicaux et rend nécessaire le contesté Thiomersal pour éloigner toute contamination.
Tels sont les termes du débat citoyen qui va s’ouvrir et qui, nous l’espérons, répondra à une double préoccupation : comment rassurer sur la pertinence des choix publics et construire la confiance à partir d’un débat serein sur une question controversée qui ne peut être évacuée d’un revers de main ? Comment organiser un aller-retour entre le vécu de terrain, la connaissance scientifique et l’administration – direction de la santé et Établissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires (EPRUS) – de sorte de susciter un élan national autour des bons choix plutôt que la défiance révélatrice d’une défaillance de la société ?
Les propos des intervenants seront intégralement retranscrits et chacun pourra réagir après les exposés. Si vous avez des messages à faire passer, ils seront les bienvenus. Les rapports de l’Office servent aussi à faire écho aux recommandations des professionnels.
M. Didier Houssin, directeur général de la santé Aux questions du rôle des pouvoirs publics face à la pandémie, de la mise en œuvre du principe de précaution, de la restriction des libertés publiques et de l’analyse bénéfice-risque, ma contribution apportera trois éléments de réponse.
Le premier est que la situation relève typiquement du vieux principe stoïcien de la préméditation des maux. Nous avons identifié le caractère récurrent des pandémies grippales, leur dangerosité potentielle extrême. Dans une société qui a aujourd'hui les moyens à la fois scientifiques, thérapeutiques et logistiques de faire face, il en découle une responsabilité de préparation. De la même façon que l’on dispose d’une armée pour se défendre et de pompiers pour lutter contre les incendies et les inondations, l’administration sanitaire est là pour nous préparer aux épidémies, en l’occurrence, par chance, une épidémie connue et prouvée.
La grippe aviaire a été l’occasion de mieux anticiper : des plans ont été conçus, des produits stockés, des actions de formation engagées, notamment en direction des personnels de santé, ou encore d’information. Une loi a créé un établissement public, l’EPRUS, chargé de mettre au point la logistique, de gérer la réserve sanitaire. Nous nous sommes efforcés de trouver comment mieux mobiliser la recherche. Et, si j’ai une seule préconisation à faire, c’est d’aller au-delà des progrès accomplis et de mieux mobiliser en urgence la recherche. Le plan de lutte contre les pandémies a été évalué et testé à l’occasion d’exercices. Tout ce travail de préparation constitue un acquis, et les pouvoirs publics n’ont pas manqué à leur responsabilité. Nous sommes clairement en phase de prévention, plutôt que de précaution, car le risque s’est concrétisé, même s’il subsiste bien des incertitudes.
Le plan devait envisager la continuité de l’activité, y compris de la justice et de l’économie. Cela suppose de prendre en compte des contraintes très fortes. Et ce que certains ont considéré comme une restriction inacceptable des libertés publiques ne faisait que traduire la volonté de faire fonctionner la justice dans les meilleures conditions dans des circonstances extrêmes. Il faut savoir que se préparer au pire, c’est envisager tout ce que sa survenance impliquerait, et pas seulement pour le ministère de la santé. C’est la raison de la création du comité interministériel de crise Grippe A(H1N1) qui rassemble tous les ministères et dont les décisions sont relayées sur le terrain par les préfets.
La campagne de vaccination n’avait pas été préparée dans la mesure où elle n’était pas réalisable. Il a fallu des circonstances très favorables – un virus isolé très vite, un séquençage rapide et des industriels très réactifs – pour pouvoir envisager de disposer d’un vaccin avant la première vague épidémique. Du coup, l’été a été consacré à cette hypothèse.
Mon deuxième élément de réponse est que cette pandémie a montré la nécessité de s’adapter en permanence et de graduer les interventions. L’une des grandes erreurs commise au moment de la menace de pandémie aux États-Unis en 1976, et analysée par l’Institute of Medicine, a été de rendre le Président prisonnier de la décision qui avait été prise au mois d’avril. Nous avons donc tout fait pour que la décision reste ouverte au fur et à mesure de l’évolution de la pandémie : transfert de la prise en charge du milieu hospitalier au secteur ambulatoire, diversification des approvisionnements pour minimiser les risques et garder la faculté de changer de fabricant. Il fallait éviter de s’enfermer dans une seule décision, et surtout regarder ce que faisaient les autres. Nous avons tiré beaucoup d’enseignements de nos contacts permanents avec nos collègues européens et nord-américains. C’est ainsi que nous avons compris les difficultés qui attendaient les services de réanimation. Nous avons donc acquis des ventilateurs et autres appareils d’assistance respiratoire. Espérons que ces décisions seront efficaces, et peut-être même inutiles.
Pour en venir à l’approche coût-avantage, une décision politique très importante et très difficile a été prise en juin dernier, celle d’acquérir une grande quantité de vaccins pour protéger la population d’une menace très grave à un moment où deux doses par personne paraissaient nécessaires. Plusieurs pays ont fait de même. Plus tard, on pourra remettre en cause cette décision. Aujourd'hui, l’adhésion de la population est plus faible que celle que nous avions anticipée puisque nous nous étions calés sur un taux de 75 % correspondant à la moyenne entre le taux de vaccination contre la grippe saisonnière et celui contre la méningite, menace considérée comme grave. Les choses sont en train d’évoluer, mais, jusqu’à présent, le risque était perçu comme faible. Entre-temps, la science a conclu que, dans certaines catégories d’âge, une dose suffirait. C’est une bonne nouvelle, mais elle contrarie quelque peu les analyses en vigueur en juin. La pandémie n’est pas terminée et elle peut se manifester par vagues successives. La vaccination reste donc cruciale et de nombreux pays, qui n’ont pas anticipé comme nous, nous sollicitent pour acquérir les vaccins dont nous allons disposer prochainement.
Le troisième élément de réponse, enfin, a trait à la question de l’analyse bénéfice-risque qui est bien au cœur de la décision en matière de sécurité sanitaire. Les produits qui sont utilisés aujourd'hui ont franchi toutes les étapes de l’évaluation. On peut même dire que, pour les vaccins adjuvantés disponibles, le processus aura été plus long que celui du vaccin contre la grippe saisonnière. Cette analyse bénéfice-risque est de la responsabilité des pouvoirs publics. Mais ils ne peuvent pas tout et chaque individu y participe aussi en tant qu’acteur rationnel. Il est certain que, jusqu’à ces dernières semaines, la grippe était, dans l’esprit de nos concitoyens, lointaine et bénigne, ce qui faisait apparaître le vaccin comme inutile, voire dangereux. Il suffit d’aller voir sur Internet toutes les fariboles qui ont circulé à ce propos. C’est un fait de société qui mériterait d’être analysé en profondeur et nous devrons faire en sorte que ce média ne soit pas la seule source d’information du public, et même de certains professionnels. Mais un revirement soudain s’est produit, sans doute sous l’effet d’une modification de la perception du risque, en particulier chez les professionnels de santé.
Un général allemand, Helmut von Moltke, avait déclaré qu’aucun plan stratégique ne résistait au premier contact avec l’ennemi. C’est sans doute vrai dans les conflits humains, mais nous espérons, s’agissant de la lutte contre les virus, le démentir. Aussi inattendus et insaisissables soient-ils, ils ne sont tout de même pas aussi malins qu’ils puissent anéantir une préparation sérieuse, comme celle à laquelle nous travaillons.
Mme Marie-Christine Blandin, sénatrice, co-rapporteure. Plusieurs types de vaccin sont-ils disponibles dans les centres de santé ? Sont-ils réservés, selon leurs caractéristiques, à certaines catégories de personne ?
M. Didier Houssin. Oui. Nous disposons aujourd'hui de quatre types de vaccin qui sont arrivés progressivement et en quantité variable. Le plus courant, pour le moment, est le Pandemrix adjuvanté de la firme GSK qui est arrivé le plus tôt, conformément aux prévisions. Nous disposons depuis peu de temps, et en quantités beaucoup plus limitées, ce qui empêche son déploiement dans les centres de vaccination, du vaccin Focetria de la firme Novartis qui avait été commandé de longue date dans le cadre des contrats passés lors de la préparation à la grippe aviaire. Il sera en conséquence destiné en priorité aux Français installés à l’étranger car sa présentation s’y prête mieux. Nous avons commencé à recevoir en quantité utile le vaccin Panenza de Sanofi-Pasteur, qui est non adjuvanté et permet de proposer la vaccination aux femmes enceintes et aux très jeunes enfants. Nous espérons disposer rapidement d’une quantité complémentaire significative de ce vaccin pour poursuivre la campagne. Enfin, nous avons une quantité très limitée du vaccin Celvapan de la firme Baxter qui peut être proposé aux personnes allergiques aux protéines aviaires. Le robinet d’approvisionnement coule faiblement, mais il coule.
Mme Marie-Christine Blandin, sénatrice, co-rapporteure. Il n’est pas question de faire de la publicité dans la presse, mais il est bon que la représentation parlementaire sache à quoi s’en tenir.
M. Jean-Pierre Door, député, co-rapporteur. À ma connaissance, 94 millions de doses environ ont été achetés. Or il avait été prévu d’en distribuer 20 % aux pays les plus pauvres, ce qui nous laisse entre 70 et 75 millions de doses. En tablant sur une double injection, cela signifie que l’on ne pourra vacciner que la moitié de la population. Pourriez-vous nous rappeler les chiffres pour couper court à toute contestation ?
M. Didier Houssin. L’estimation pour la commande des 94 millions de doses se fondait sur l’hypothèse d’une double dose pour tout le monde, en vertu de laquelle il aurait fallu 128 millions d’unités pour toute la population. Nous avons formulé une autre hypothèse, à savoir qu’une dose pourrait suffire pour une petite fraction de la population, notamment les personnes âgées. Nous étions partis, en effet, d’un taux de non-adhésion à la vaccination de 25 % sur les bases que je vous ai expliquées.
Je précise que l’engagement pris par le Président de la République envers les pays pauvres est de 10 %, et non de 20 %. Le ministère des affaires étrangères a déjà engagé des discussions avec l’Organisation mondiale de la santé pour que notre pays participe au plus vite à l’aide aux pays en développement à la hauteur de ce à quoi nous nous sommes engagés. L’idée est de fournir le plus vite possible, tout en étant assurés de nos livraisons. Il faut en effet offrir ce qui est nécessaire à la population française.
M. Jean-Claude Étienne, sénateur, premier vice-président de l’OPECST. L’adjuvant utilisé dans les trois vaccins est-il le même ? Est-ce du squalène ? Y a-t-il d’autres adjuvants ? Le vaccin sans adjuvant assure-t-il d’une aussi bonne résistance à l’infection ? Bref, les petits inconvénients de l’adjuvant sont-ils pleinement justifiés ?
M. Didier Houssin. Pour vous répondre sur l’adjuvant, je ne suis pas le plus compétent ici, mais je vous donnerai le point de vue des pouvoirs publics. L’option prise en Europe, qui était celle au départ de l’OMS, était de se procurer des vaccins avec adjuvant. Ce dernier permettant de diminuer la dose d’antigènes nécessaire, nous aurions ainsi disposé plus rapidement d’une quantité suffisante de vaccin, ce qui est un point crucial pour la santé publique.
Ensuite, le virus de la grippe dérive génétiquement, comme l’a prouvé le virus H5N1 apparu au Vietnam : dans ce cas, le vaccin adjuvanté déclenchait des réactions immunitaires même avec un certain degré d’évolution génétique. Aujourd'hui, le virus n’a pas beaucoup changé si bien que l’avantage de l’adjuvant n’est pas flagrant, du moins pour le moment.
Les adjuvants sont à base de squalène – encore que, s’agissant de celui de Novartis, je n’en sois pas sûr. En gros, les vaccins se valent ; les essais cliniques ont prouvé leur efficacité même si certains ont un peu plus d’avantages en termes d’immunogénéicité, d’autres en termes de tolérance ou de réactogénéicité. En dehors des catégories pour lesquelles des recommandations précises ont été formulées par le Haut conseil de la santé publique, aucun vaccin ne peut être jugé très supérieur à un autre.
M. Christian Lajoux, président du LEEM – les entreprises du médicament. Le rôle des industriels du médicament est multiple. Depuis l’apparition du virus H5N1, nous nous préparons au développement de nouveaux vaccins. Nous avions ainsi envisagé avec M. Houssin un exercice de simulation qui devait avoir lieu au mois de septembre, mais il a été annulé à cause de la pandémie. Le LEEM représente non seulement les fabricants du vaccin, mais aussi ceux qui produisent les antibiotiques, les antiviraux ou les antalgiques. Dans cette phase d’incertitude, nous nous sommes efforcés de répondre aux demandes des autorités de santé et du Gouvernement, tout en continuant à fournir les médicaments destinés aux patients souffrant de pathologies chroniques, tels les cancéreux ou les cardiaques, qu’il faut continuer à soigner. Nous avons envisagé aussi la possibilité de surinfection en cas de grippe – c’est d’ailleurs ce qui se produit –, ce qui suppose de fournir suffisamment d’antibiotiques pour répondre aux besoins. De même, il faut des antalgiques. Les industriels se sont donc efforcés de répondre à la demande et, à ce jour, la chaîne de santé fonctionne. Les relations entre les industriels, les grossistes distributeurs, les pharmaciens et les médecins permettent de répondre à toutes les attentes thérapeutiques qui se sont manifestées dans le pays.
Nous avons également mis en place des plans de continuité dès le mois d’avril dans la perspective d’une aggravation de la pandémie, qui pourrait même être plus sévère. Nous avons envisagé le cas où la moitié de nos collaborateurs serait dans l’incapacité de travailler.
Pour la fabrication du vaccin, c’est l’OMS qui a remis la souche des virus aux industriels fin juin ou début juillet. Depuis, la fabrication a été lancée même si des incertitudes subsistaient. La première portait sur l’intensité de la grippe, la seconde sur la réaction que provoqueraient les antigènes utilisés, ce qui nous a conduits à émettre plusieurs hypothèses quant à la quantité à introduire dans un vaccin et au nombre d’injections nécessaire. Il n’était pas possible de répondre alors à ces deux interrogations, car on ignorait comment réagirait l’organisme humain. La décision d’incorporer un adjuvant avait un objectif de productivité : être en mesure de fournir le plus rapidement possible des doses efficaces. Heureusement, à ce jour, il semble que la pandémie soit moins virulente qu’on ne le craignait – mais il ne faut pas en sous-estimer le danger –, et que les organismes humains réagissent mieux au vaccin qu’on ne l’espérait. Des vaccins avec des doses plus faibles ont ainsi été mis au point. Cependant, la question de la deuxième injection n’est toujours pas tranchée et nous attendons la décision des autorités de santé.
Les industriels répondent dans les temps qui leur ont été impartis par les autorités de santé. Et Sanofi, pour qui je travaille, est plutôt un peu en avance sur son calendrier qui a été décalé parce que, en même temps que nous travaillions sur la grippe H1N1, nous devions livrer les commandes de l’hémisphère Sud qui connaissait une pointe épidémique.
Si j’ai une proposition à formuler, c’est de travailler avec toutes les parties prenantes pour combattre la désinformation qui sévit actuellement. Ce débat y contribue, mais une multitude d’informations circulent, dont certaines sont ridicules, d’autres caricaturales, voire dangereuses. Sans doute un débat citoyen à l’image de celui qui est organisé sur les nanotechnologies permettrait-il de faire de la pédagogie, même si l’urgence n’est pas la même. Nous avons le sentiment que l’opinion est en train de changer et, si nous, industriels, sommes aujourd'hui interpellés à propos du vaccin, c’est en des termes bien différents de ce qu’ils étaient il y a deux ou trois semaines. Le besoin d’information est énorme et, en tant qu’industriel, je rappelle que c’est en totale transparence et pour contribuer à un climat de confiance que nous souhaiterions participer à ce débat citoyen.
M. Claude Le Pen, économiste, université de Paris Dauphine. Ma première remarque consistera à insister sur le caractère politique d’une pandémie. Étymologiquement, c’est la maladie du peuple, et les pandémies ont été repérées dès l’origine de la médecine, dès Hippocrate. C’est un phénomène collectif qui touche tout le monde et donc un phénomène politique. Le médecin traite les individus, le politique la collectivité, ce qui le transforme en médecin du peuple. Ainsi, la peste à Marseille au XIVe siècle a été un événement politique, comme la pandémie de choléra-morbus à Paris en 1830-1831. Les pandémies mobilisent l’action collective.
Là où il peut y avoir difficulté, c’est à la charnière entre le savant et le politique. Le second utilise la parole du premier et le premier s’abrite derrière l’autorité du second. Ils sont censés se renforcer l’un l’autre, le savant en donnant une certaine autorité à la décision politique et le politique en faisant du savant le conseiller du prince. Je crains que le mécanisme ne fonctionne à rebours et qu’ils ne se décrédibilisent l’un l’autre. L’expert apparaît porteur d’une opinion ou d’un point de vue politique, et le politique est soupçonné de vouloir transformer une option collective en prescription normative étayée par la science. D’ailleurs, quand le politique s’adresse à l’expert, c’est généralement pour lui demander ce qu’il ne sait pas. La science sert à donner une caution à ce qui sort de l’expertise. Le politique pense se renforcer, mais l’expert, lui, s’expose en dehors de son champ de compétence, et son avis prend une teinture politique qui l’affaiblit. Symétriquement, le politique a tendance à s’affirmer, nimbé d’un savoir scientifique qu’il se prête. Aujourd’hui, le fonctionnement de ce couple particulièrement sollicité reste problématique, voire vicieux, au lieu d’être vertueux.
Qui porte aujourd'hui la légitimité pour arrêter la politique de santé en France ? Les autorités publiques, bien sûr, c'est-à-dire les politiques, l’administration, les experts, mais l’impression domine, d’après ce qui circule sur le web, que le scepticisme règne. Le Faust de Goethe disait être « l’esprit qui nie ». Aujourd’hui, Internet est le média qui nie et voit de la manipulation partout. Il véhicule la contestation de toutes les superstructures sociales et s’adresse au citoyen sur le mode : « Je suis avec toi, nous sommes ensemble, nous formons une collectivité contre les autres ». D’emblée, la parole publique véhicule la tromperie, le mensonge. Tout savoir n’est qu’une opinion et toute opinion n’est qu’un intérêt. Les experts voient leur savoir nié et, s’ils ont des idées, c’est parce qu’ils sont payés. Il faut savoir à qui profite le crime. Au fond, la société n’est plus qu’un immense réseau d’intérêts plus ou moins souterrains. Il n’y a plus d’idée, il n’y a que des intérêts. Il n’y a plus d’intelligence, il n’y a que de l’argent. Cette perception est fausse, mais elle est vécue comme plus réelle que celle qui donne encore un peu de poids à la connaissance, au savoir et à la culture.
Cet état d’esprit est encore aggravé en France par une histoire spécifique. La santé publique, qui a précédé la médecine individuelle – songez aux courants hygiénistes, à la lutte contre les épidémies –, est ancienne dans notre pays, et nous sommes plutôt privilégiés en matière de vaccination. Néanmoins, la santé publique, après une longue prééminence, a été refoulée, vraisemblablement du fait de la montée en puissance de la médecine curative qui a gagné considérablement en efficacité, et d’un contexte culturel : dans une société d’inspiration catholique, la prévention ne semble pas relever d’un effort individuel alors que les pays puritains marquent une appétence plus forte pour le salut individuel, y compris de son propre corps. D’ailleurs, la santé publique n’est pas très développée dans les pays du Sud.
En France, nous avons aussi été marqués par le choc du sida qui fait que, en matière de santé publique, un politique ne peut jamais en faire trop. Il vaut mieux qu’il encoure le risque d’en avoir trop fait, ce qui ne l’entraînera jamais devant un tribunal. Au contraire, ne pas en avoir fait assez le conduira devant la Cour de justice de la République. Dans un tel contexte, il est normal que la ministre ait traité le problème de la grippe H1N1 au plus haut niveau de gravité et d’alerte de la population, quitte à se voir reprocher d’avoir affolé inutilement les populations. Elle doit aujourd'hui savourer sa revanche.
J’insisterai enfin sur le fait que le coût n’a pas été, en l’espèce, une variable de décision. Aujourd'hui, on fait ce qu’il faut et on paiera parce qu’on a les moyens de payer. En plus, ce n’est pas très cher, puisque les 94 millions de doses de vaccin ont coûté 900 millions d’euros environ, pour des dépenses de santé de l’ordre de 210 milliards d’euros et un Objectif national de dépenses d’assurance maladie (ONDAM) de 165 milliards d’euros. Finalement, nous sommes dans un pays où, même si on négocie les prix, le raisonnement économique n’entre pas dans la décision. C’est une chance parce que tout le monde n’est pas logé à la même enseigne.
Enfin, la situation actuelle n’est pas exceptionnelle. Elle est sans doute un prélude à ce qui va suivre, c'est-à-dire de grandes crises sanitaires qui vont se multiplier parce que les virus voyagent et mutent au gré des flux de populations. Internet offre une plate-forme à l’expression collective anonyme, ce qui est nouveau. C’est ainsi que s’est développée cette sorte de connivence négationniste. Nous devrions connaître à nouveau des situations de ce type où des politiques mal à l’aise auront à gérer des phénomènes prévisibles sous les yeux d’une opinion publique sceptique. Nous avions tous les moyens de prévenir le risque, mais celui qui s’est concrétisé n’était pas celui qui était attendu ; et la capacité à prédire n’enlève rien à la surprise quand le prévisible survient. Il va falloir s’habituer à ces grandes peurs que l’éducation et la science ne font pas reculer et que le politique devra gérer de façon nécessairement imparfaite, oscillant entre le risque d’en faire trop ou pas assez, et sans savoir trop quel discours tenir. Nous vivons les prémices d’une société où la technologie la plus sophistiquée coexistera avec les peurs les plus archaïques.
Mme Marie-Christine Blandin, sénatrice, co-rapporteure. Si la santé publique ne compte plus les milliards, Mme Françoise Weber et ses collègues comptent, eux, les malades à l’Institut national de veille sanitaire, qui nous fournit des photographies régulières nous donnant à comprendre la pandémie.
Mme Françoise Weber, directrice générale de l’Institut national de veille sanitaire. Tous les spécialistes et experts en épidémiologie d’intervention travaillant à l’InVS ont une mission de surveillance au service de la santé publique qu’ils remplissent avec un très fort engagement.
L’Institut, mis en place par la loi de santé publique de 2004, remplit sept missions principales.
La première est d’être la vigie de la santé publique : en haut du mât, nous prévenons de la survenance de menaces. Nos systèmes de veille nationale et internationale, appelés « intelligence épidémiologique », nous permettent d’anticiper de quelques jours, parfois de quelques heures, une alerte. Ainsi, comme en matière de défense, nous avons un petit avantage sur l’ennemi.
La deuxième mission est de surveiller et de décrire quotidiennement la pandémie grippale.
La troisième est d’apporter une aide à la décision, rôle très important compte tenu du nombre de décisions à prendre afin d’adapter continuellement les politiques publiques à l’évolution de la pandémie.
La quatrième est d’évaluer l’impact des mesures prises.
La cinquième mission de l’InVS est de mettre en place des études pour répondre aux questions dont on ne connaît pas la réponse – nous avons une forte interaction avec la recherche.
La sixième est de favoriser une collaboration internationale.
La septième mission, qui se manifeste au quotidien, est d’assurer la transparence de l’information.
L’alerte, qui est donc notre première mission, se construit à partir de signaux que nous recevons de deux sources. D’abord, des praticiens et des établissements de santé. Ensuite, des réseaux et des programmes de surveillance. Au sein de ces derniers, les systèmes de remontée régulière et d’analyse de l’information relèvent de deux types. D’une part, les réseaux spécifiques, dédiés à la grippe –, le réseau GROG de Jean-Marie Cohen ; le réseau Sentinelles, de l’INSERM. D’autre part, les réseaux non spécifiques, tels que Sursaut, qui, par l’intermédiaire des urgences hospitalières, de la médecine de ville et des certificats de décès, nous permettent de voir émerger une pathologie.
Entre le signal et l’alerte, une étape importante est l’évaluation du signal et l’analyse. En cette période de grande émotion, des signaux circulent, comme un décès particulièrement dramatique ou une mutation. Or tous les signaux ne sont pas des alertes, et nous devons donc les soumettre à l’analyse avant de nous prononcer. Nos concitoyens doivent comprendre que de l’information à l’alerte – ou à la prise de position des pouvoirs publics –, il y a une distance, celle de l’analyse. L’InVS a la responsabilité de ne pas se laisser noyer par des signaux et de distinguer ce qui peut être une alerte de ce qui ne l’est pas.
Qu’avons-nous fait depuis le début de cette pandémie ?
Nous avons donné la première alerte le 24 avril, légèrement en avance par rapport à l’OMS. Grâce à nos systèmes de surveillance de veille internationale, nous avons en effet immédiatement donné l’alerte s’agissant du typage par les CDC de deux virus grippaux d’allure pandémique au profil inquiétant. Le lendemain, l’alerte concernant le Mexique a été donnée. Nous avons annulé un exercice grippe programmé pour le surlendemain et, dès le 25 avril, nous avons commencé à mettre en place un système de surveillance individuelle des cas importés. Nous travaillons en très étroite coordination avec l’ensemble des gestionnaires de la pandémie – Direction générale de la santé (DGS), agences sanitaires – par des contacts quasi quotidiens où chacun joue sa partition, l’InVS donnant des recommandations, aidant à la décision, tout en gardant un certain recul par rapport aux décideurs et aux gestionnaires afin, d’une part, d’assurer l’indépendance de son évaluation et, d’autre part, d’apprécier l’impact des mesures prises pour aider à les adapter.
Nous avons donc – et ce « nous » est collectif – commencé à mettre en place un système de surveillance individuelle de façon à identifier les malades, à les isoler, à tester les virus, à observer le déroulement de la maladie dont nous ne savions pas grand-chose.
Dès lors que les cas se sont multipliés, nous avons arrêté ce système de surveillance pour mettre en place, d’une part, une surveillance des foyers et des cas groupés –d’abord pour savoir où émergeait le virus, ensuite pour surveiller les foyers susceptibles d’émerger dans des groupes à risque – et, d’autre part, une surveillance populationnelle, sachant que les réseaux GROG et Sentinelles ne montrent une évolution de l’épidémie qu’à partir de l’observation d’un certain nombre de milliers de cas. La surveillance consiste donc à adapter, à chaque phase de l’épidémie, nos mesures, nos outils. Bien sûr, depuis le début, le Centre national de référence Sud de Bruno Lina et le CNR Nord de Sylvie Van der Werf nous épaulent dans la surveillance virologique.
À présent, nous sommes dans une phase de circulation large du virus.
On nous a parfois demandé pourquoi nous ne testions pas chaque malade et ne disposions pas d’un tableau de bord de l’ensemble des malades en France. Non seulement nous n’en avons pas les moyens techniques, mais cela n’aurait aucun intérêt car ce que nous avons besoin de connaître, c’est la façon dont évolue l’épidémie, son impact en termes de nombre de personnes atteintes, mais aussi la proportion des cas graves et des décès, afin de décrire ces derniers avec le plus de précisions possibles pour pouvoir les prévenir. Ce sont ces objectifs qui nous ont guidés pour bâtir nos indicateurs, lesquels sont de plusieurs ordres.
D’abord, un indicateur de surveillance populationnelle, destiné à mesurer l’impact de l’épidémie dans la population. Le nombre des infections respiratoires aiguës liées au virus A(H1N1), toutes infections confondues, nous est fourni par le réseau des GROG tandis que celui des consultations pour grippe, en ville et aux urgences, nous est donné par le réseau Sentinelles. Cela nous permet de connaître le taux de mortalité globale.
Ensuite, un indicateur de surveillance individuelle des cas graves et des décès, dont l’objet est de décrire les caractéristiques des personnes atteintes et de mieux comprendre les facteurs de gravité.
Enfin, un indicateur de surveillance virologique. Il permet de connaître à la fois le taux de positivité – la proportion de personnes présentant des infections respiratoires et réellement porteuses de ce virus –, la résistance à l’Oseltamivir et autres antiviraux, les modifications antigéniques du virus susceptibles de modifier la sensibilité à la vaccination ainsi que les mutations.
Concernant le premier indicateur, relatif à la surveillance populationnelle, celle-ci est toujours prévue de longue date, car il est très important de ne pas mettre en place des systèmes au moment même où des événements graves se déclenchent. Si nous parvenons à être prêts pour une surveillance de cette envergure, c’est grâce à un très gros travail mené pendant plusieurs années. J’ai rendu hommage ce matin à nos deux réseaux spécifiques Sentinelles et GROG de surveillance locale de la grippe qui nous apportent des visions complémentaires sur l’évolution de la pandémie et des épidémies de grippe saisonnière. Le premier étant très spécifique et le second très sensible, ils se complètent et l’InVS leur apporte un soutien important dont il ne se désengagera pas, car ils sont aujourd’hui les outils les plus efficients pour la surveillance de l’épidémie en population. Nous n’avons d’ailleurs rien inventé, la plupart des pays développés ayant le même type de système. Non seulement les réseaux Sentinelles et GROG sont complémentaires, mais ils consentent un très gros effort d’unification pour travailler sur des critères communs et pour rassembler leurs données, avec pour objectif d’aboutir à un réseau qui ait les qualités, et non plus les limites, de chacun d’eux.
À côté de ces deux réseaux spécifiques, nous avons deux réseaux de surveillance non spécifiques. D’abord, le réseau SOS médecins, partenaire représentatif des urgences médicales de ville, nous permet d’observer le poids de la grippe parmi les autres pathologies et, surtout, nous donne une idée des tendances au jour le jour. Ensuite, le réseau OSCOUR remonte les diagnostics réalisés aux urgences de 220 hôpitaux sur l’ensemble du territoire. Les deux réseaux spécifiques nous apportant des données hebdomadaires, les deux réseaux non spécifiques ont cette qualité de nous fournir des données quotidiennes qui quantifient moins l’épidémie, mais sont plus réactifs.
Ces quatre réseaux nous permettent d’avoir une vision du profil de l’épidémie dans la population. Ainsi, la courbe de l’évolution dans la population des infections respiratoires aiguës liées à la grippe A montre, selon notre source GROG, 43 000 cas en semaine 36 et 730 000 cas en semaine 47. La courbe des grippes cliniques typiques du réseau Sentinelles fait, elle, apparaître 730 cas pour 100 000 habitants cette même semaine. Concernant les passages aux urgences, le réseau OSCOUR décrit la même tendance avec un pic précoce lié au fait que, pendant un certain temps, l’ensemble des grippes a été détourné vers les urgences pour des raisons de prise en charge et parce qu’il y avait des cas groupés et des consultations dédiées.
Le deuxième indicateur, celui portant sur la surveillance individuelle des cas graves et des décès, est exhaustif : nous avons demandé à l’ensemble des services de réanimation et de soins intensifs de nous signaler, au jour le jour, tous les cas graves, c'est-à-dire conduisant à une hospitalisation en réanimation ou en unité de soins intensifs. Notre évolution graphique du nombre hebdomadaire de cas graves confirmés A(H1N1) admis à l’hôpital demande trois semaines pour être consolidé, car nous avons souvent des signalements avec plusieurs jours, voire une ou deux semaines de retard. Néanmoins, cette évolution graphique est exactement proportionnelle à la tendance de l’épidémie dans la population.
Depuis le 30 novembre, début de l’épidémie, 461 cas graves ont été enregistrés et 137 personnes sont encore hospitalisées en réanimation. Comme cela a été dit ce matin, ces cas graves n’ont absolument pas le profil de ceux observés en grippe saisonnière. Selon notre dernière évaluation au 30 novembre, il s’agit, pour 73 %, de personnes âgées entre quinze et soixante-quatre ans, soit une moyenne d’âge plutôt jeune de trente-neuf ans, et, pour 18 %, d’enfants de moins de quinze ans. Les plus de soixante-cinq ans ne sont pas indemnes : ils sont 8 %. Sur le pourcentage total de personnes se retrouvant en réanimation avec des formes très graves, voire en circulation extracorporelle, 20 % ne présentaient pourtant aucun facteur de risque.
Les facteurs de risque en grippe saisonnière concernent généralement des gens soit très âgés, soit dont l’état de santé est très fragile. Dans cette pandémie, les principaux facteurs de risque de cas graves voire de décès sont les grossesses, les pathologies respiratoires chroniques dont l’asthme, les déficits immunitaires, le diabète et l’obésité morbide. Si certains avancent que les décès s’observent seulement chez les personnes présentant un ou plusieurs facteurs de risque, une différence importante existe néanmoins avec une grande partie des décès de la grippe saisonnière. En effet, la plupart des gens atteints par la grippe A sont jeunes : facteur de risque ou pas, ils ont un avenir devant eux et, dans la plupart des cas, vivent comme vous et moi. C’est un message important pour ceux qui auraient tendance à comparer simplement la proportion de cas graves et de décès à celle de la grippe saisonnière. Par ailleurs, de nouveaux facteurs de risque émergent.
Avec la surveillance de la gravité de la pandémie, nous comptons, c’est vrai, les morts : la mortalité directe, identifiée immédiatement et déclarée directement à l’InVS, et la mortalité indirecte, beaucoup plus importante dans ce type d’épidémie que la mortalité directe.
Concernant cette dernière, la tendance observée est la même que les cas graves. En matière de mortalité indirecte, nous surveillons l’ensemble des certificats de décès et cherchons à dépister le plus tôt possible une variation de la mortalité globale par rapport au nombre attendu de décès. Au début de l’année 2009, un deuxième pic montre un excès de mortalité globale, lié à une conjonction d’épidémies et d’une vague de froid très importante et plus longue que d’habitude. Ainsi, le froid et les épidémies conjuguées ont un impact important sur la mortalité. Par conséquent, si jamais une pandémie un peu plus forte qu’une épidémie de grippe saisonnière venait s’ajouter à une vague de froid, nous enregistrerions probablement une augmentation très significative de la mortalité globale.
Mon temps de parole étant d’ores et déjà dépassé, je ne détaillerai donc pas notre troisième indicateur, la surveillance virologique – l’identification des virus circulants et la recherche des mutations –, ni nos autres missions, si ce n’est pour rappeler que nous apportons continuellement une aide à la décision, que nous produisons de l’information en ligne sur notre site ainsi qu’un bulletin quotidien destiné aux décideurs, et que nous évaluons l’impact des mesures prises. Je m’arrêterai simplement sur ce dernier point pour formuler deux préconisations.
Afin d’évaluer la couverture vaccinale, nous allons nous appuyer sur les données de l’assurance maladie, notamment le nombre de bons envoyés. Mais ce dont nous aurions besoin, c’est de connaître le nombre de personnes présentant des facteurs de risque tels que l’asthme. Or, la structure actuelle de la protection des données en France, régie par la loi Informatique et libertés, ne nous permet pas d’avoir accès à ces éléments et d’apporter cette information, pourtant essentielle à la santé publique. Ma première préconisation est donc de faire en sorte que l’Institut de veille sanitaire et les opérateurs publics de la veille sanitaire soient considérés d’une façon un peu différente des organismes de recherche ou des chercheurs privés pour l’accès à certaines données.
Enfin, l’InVS ne pourrait pas remplir sa mission sans l’ensemble de son réseau national qui lui remonte les informations, à savoir les établissements, mais aussi les professionnels de santé, notamment libéraux, qui aujourd’hui s’engagent et travaillent dans nos réseaux bénévolement. Ma seconde préconisation est donc de réfléchir à la façon dont la France pourrait valoriser les activités de santé publique des professionnels de santé, en particulier des libéraux, pour consolider les conditions de nos partenariats et leur permettre de participer dans de bonnes conditions à la veille sanitaire et à d’autres activités de santé publique.
Mme Marie-Christine Blandin, sénatrice, co-rapporteure. Mon collègue rapporteur, M. Door, qui s’occupe régulièrement du budget de la sécurité sociale et donc de la santé ne manquera pas de réfléchir à cette dernière préconisation.
L’Établissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires – EPRUS – a fait parler de lui dans le cadre de la revendication parlementaire de transparence, et il s’y est prêté bien volontiers. Je donne maintenant la parole à M. Thierry Coudert.
M. Thierry Coudert, directeur de l’Établissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires (EPRUS). Pour ma part, pour reprendre la terminologie antérieure, je dépense les milliards et, si Mme Weber est la vigie, je suis plutôt le soutier...
Créé par une loi du 5 mars 2007, l’EPRUS travaille sur instructions du ministère de la santé, plus particulièrement du professeur Houssin, mais exerce la fonction essentielle de logisticien pour assurer le bon fonctionnement des dispositifs de crise sanitaire.
Deux missions lui sont dévolues : d’abord, gérer les stocks stratégiques nationaux en matière de crise sanitaire ; ensuite, mettre en place et gérer une réserve sanitaire. La première mission porte sur des produits, la seconde sur les moyens humains.
Premièrement, nous gérons les produits des stocks stratégiques.
Après sa création, l’EPRUS a obtenu le statut d’établissement pharmaceutique en mars 2008 – je rappelle que la grippe est arrivée en avril 2009. Nous avons pour mission de veiller à l’ensemble des crises sanitaires susceptibles de survenir, que ce soit des pandémies grippales ou des risques biologiques, chimiques ou radioactifs. C’est pourquoi cet établissement, qui gère les deuxièmes stocks nationaux de l’État après ceux des armées, possède une nomenclature extraordinairement large, avec des quantités très variables selon les produits.
S’agissant de la grippe, différents types de stocks sont concernés. Certains ont été préalablement constitués, dont une partie avait été plus qu’amorcée avant la création de l’EPRUS et lui a ensuite été transférée en gestion, tels les stocks de masques – 1 milliard de masques chirurgicaux, 700 millions de masques professionnels FFP2 – et les 33 millions de traitements par Tamiflu. En outre, l’EPRUS pouvant intervenir en fonction de la précision de telle ou telle crise sanitaire, il l’a fait au cours du mois d’août sur instruction de la Direction générale de la santé pour négocier et conclure les marchés sur les 94 millions de doses de vaccins.
En matière de produits – masques, antiviraux, vaccins –, nous avons donc un rôle de constitution et de gestion stratégique des stocks et de leur positionnement géographique en fonction de leur spécificité de stockage et de conservation et de leur dissémination le moment venu en cas de crise sur l’ensemble du territoire métropolitain et outre-mer. Nous devons également renouveler ces stocks de produits en fonction de leurs dates de péremption. Enfin, lorsque cela nous est demandé par nos autorités de tutelle, nous devons faire parvenir des produits à l’étranger dans le cadre de nos relations avec certains États, et ce au moment opportun et généralement en quelques heures.
Deuxièmement, nous gérons une réserve sanitaire.
Celle-ci se divise en deux segments. D’abord, une réserve de professionnels de santé de toutes natures – médecins, infirmiers et autres professions paramédicales – qui peut être mobilisée en renforcement des dispositifs classiques. Ensuite, en cas de saturation des dispositifs classiques, une réserve de personnes qui, soit ne sont plus en activité – médecins et infirmiers en retraite depuis moins de cinq ans –, soit s’apprêtent à entrer en activité, c’est-à-dire des étudiants très avancés dans leurs études.
Établissement relativement récent, L’EPRUS procède à une montée en puissance de ce dispositif. L’objectif était cette année de 2 500 réservistes, toutes réserves confondues ; nous avons légèrement dépassé les 1 000 dossiers de candidatures enregistrées. Dans le cadre de la crise grippale, nous intégrerons les médecins retraités qui interviendront dans les centres de vaccination.
Recourir à la réserve présente des avantages. En effet, les personnes ont un employeur clairement identifié, à savoir l’EPRUS, et bénéficient de garanties en matière de responsabilités dans leur activité, progrès notable par rapport à la situation antérieure. Cela a été le cas pour les quelques équipes médicales mobilisées pour des interventions extérieures au territoire national. Notre système est donc parfaitement sécurisé.
Lors de la création de l’établissement, certains ont guetté – comme toujours dans ces situations – les nuages qui pouvaient s’amonceler. L’affaire de la grippe A(H1N1) nous donne – heureusement ou malheureusement – l’occasion du baptême du feu, et nous espérons être les plus efficaces possibles pour faire face à cette menace.
M. Michel Combier, président de l’Union nationale des omnipraticiens français - Confédération des syndicats médicaux français (UNOF – CSMF). Parler de l’autorité de l’État est un sujet un peu difficile pour un médecin, qui la connaît souvent par le seul intermédiaire de la réquisition. J’essaierai néanmoins de l’aborder sous l’angle de l’information.
Comme l’a souligné M. Le Pen, les médecins, du fait de la circulation des informations sur Internet, sont parfois, voire de plus en plus, les derniers informés de ce qui arrive aux patients, dans la mesure où les réseaux d'observation de la grippe remontent des informations vers l’État, ce qui explique cette situation paradoxale selon laquelle il faut souvent une démarche volontaire de notre part pour les obtenir.
Ce problème du premier informé existe également en cas de retrait de médicaments du marché, que le médecin apprend souvent le matin en lisant son journal, situation également problématique dans la mesure où il est confronté aux questions de ses patients dans son cabinet.
L’État – dont l’attitude a en l’occurrence été formidable, surtout dans la première partie de la pandémie – a pris par la voix de sa ministre une décision qui est apparue logique aux experts médicaux. Néanmoins, certains experts, que l’État paie aussi, ont émis un avis contraire au discours officiel. C’est pourquoi je suis heureux que les organisations nationales de médecins, tous syndicats confondus, aient suivi, s’agissant de la vaccination, les préconisations formulées par les autorités, car nous sommes au service de nos concitoyens.
Que faudra-t-il faire la prochaine fois dans la première phase ? Il conviendra d’abord de ne pas se priver du premier média santé, à savoir les médecins de terrain. Or, actuellement, nous sommes mis un peu à l’écart. Il faudra que l’on m’explique pourquoi nous sommes compétents pour informer et incompétents pour vacciner...
Pourtant, le contrat d’amélioration des pratiques individuelles permet, aux termes de la loi, de rémunérer les médecins sur la base d’objectifs. Il faudra que la vaccination pour la grippe A(H1N1) fasse partie de ces objectifs l’an prochain.
La motivation des médecins, mais aussi des infirmiers, des pharmaciens, des professionnels de proximité a par ailleurs été insuffisante au printemps, faute, par exemple, de plan de formation. Cela avait pourtant été un grand succès dans le cas de la grippe aviaire : les professionnels s’étaient parlé entre eux pour s’organiser dans les quartiers, sur le terrain. Je crois donc qu’à l’avenir il faudra toujours essayer d’anticiper l’information à destination des professionnels de santé. Je prendrai un autre exemple dans ce cadre : au mois de juillet, lorsque la gestion des cas de grippe est passée, du jour au lendemain, sous la responsabilité des cabinets médicaux, les médecins n’ont pu que s’affoler quelque peu en se demandant s’ils seraient suffisamment protégés.
Enfin, les médecins ont pu ressentir une certaine frustration en se voyant refuser de vacciner leurs patients les plus lourds, d’autant que ces derniers font augmenter l’attente dans les centres de vaccination où le médecin préfère prendre son temps pour savoir s’ils peuvent les vacciner sans risque. Il aurait donc été possible d’organiser – ce qui serait encore possible – la vaccination de populations spécifiques dans nos cabinets de médecin.
M. Patrick Zylberman, historien, Centre de recherche médecine, sciences, santé et société. Je vous remercie, madame la sénatrice, monsieur le député, monsieur le vice-président, de m’avoir invité.
Je suis toujours rattaché à ce centre de recherche, mais suis aussi maintenant professeur d’histoire de la santé à l’École des hautes études en santé publique.
La crise sanitaire a connu, jusqu'à présent, quatre temps.
Le premier, qui s’est étalé du mois de mai au mois de juillet, a été un temps de grande inquiétude, sinon dans la population, du moins parmi les pouvoirs publics qui ont pu craindre, à un moment, le retour à la catastrophe de 1918, sans se rendre compte que cette analogie avec la situation d’il y a quatre-vingt-dix ans n’était pas réaliste. Néanmoins, tant le typage du virus que la structure par âge des formes graves et des décès ont pu donner à penser que l’on avait affaire à une pandémie vraiment virulente.
Le deuxième temps, qui a duré du mois d’août au mois de septembre, a été celui de l’adaptation du plan Pandémie grippale – qui avait plus particulièrement visé la grippe aviaire – à la spécificité du H1N1.
Le troisième temps, au cours des mois d’octobre et de novembre, a fait apparaître un obstacle inattendu, celui du scepticisme de l'opinion envers la vaccination – cela dans un pays pourtant champion du monde de la consommation de médicaments !
Aujourd'hui, nous sommes entrés dans le quatrième temps, à savoir la normalisation de la campagne de vaccination. En tout cas, le cap du million de personnes vaccinées a été dépassé et, dans l’opinion, le « on en fait trop » le cède à un « on n'en fait pas assez », dans un jeu de bascule absolument banal depuis que la vaccination existe. La situation est d’ailleurs similaire à celle qui régnait aux États-Unis à la mi-octobre. À la dénonciation d'un scepticisme, qui est moins sensible aujourd'hui même chez les médecins, succèdent des appels au civisme de chacun, notion promise à un brillant avenir pour le cas où l'épidémie irait s'aggravant.
La politique adoptée pour lutter contre le virus s'est placée d'emblée dans la ligne des plans élaborés depuis le début des années 1990 contre la menace d'une pandémie grippale. Parmi les quelques infléchissements qu’elle a subis, j'en retiendrai deux.
Le premier a porté sur la renationalisation des politiques de lutte contre le virus après la déclaration du niveau 5 d'alerte par l'OMS le 29 avril, renationalisation qui a peut-être été la condition de l'adaptation nécessaire des précédents plans à la spécificité de H1N1 2009.
Le second a tendu à surestimer l'influence des groupes anti-vaccin, ce qui a conduit à la paralysie de la communication du Gouvernement et, sans doute, à creuser un peu plus encore le fossé déjà profond entre les autorités politiques et scientifiques, d'une part, et l'opinion, d'autre part.
Aux États-Unis un premier plan anti-pandémie a été élaboré en 1978, suite à l'affaire de la grippe porcine en 1976 – laquelle ne s’est finalement pas déclarée. Révisé une première fois en 1983, il sera profondément remanié à partir de 1993. Parallèlement, le Canada se dotait d'un plan dont la mise au point est intervenue en 1988. En décembre 1992, à Courchevel, les sixièmes Rencontres européennes sur la grippe et sa prévention soulignaient l’urgence d'un plan de réponse à la prochaine pandémie. Au cours des septièmes Rencontres, toujours organisées par le Groupe d'expertise et d'information sur la grippe (GEIG), les spécialistes venus de treize pays européens se prononçaient dans le même sens à Berlin en septembre 1993. Parallèlement, l'OMS élabore son propre plan où seront définies les phases successives de la réponse à une pandémie, document que les plans nationaux se chargeront ensuite d'adapter.
Quant au plan français, il est élaboré en 1997. Mis au point dans le cadre interministériel et entré en vigueur dès l'automne 2004, il adopte l'année suivante une présentation plus conforme aux phases définies par l'OMS. Fin août 2005, il est renforcé dans l’optique non seulement d'une plus grande attention portée à l'épizootie aviaire – une originalité par rapport au plan de l'OMS –, mais aussi d'une plus grande coopération avec les gouvernements étrangers et d'un souci plus accentué de la communication publique.
La lutte sera dorénavant menée à un double niveau : ralentir la propagation du virus par des mesures dites « générales » de quarantaine et de restrictions d'activités, et limiter la mortalité par complications grâce à la vaccination. Toutefois, le principal danger soulevé par la menace épidémique demeure la désorganisation sociale.
Pour revenir sur le premier infléchissement apporté à la politique adoptée pour lutter contre le virus, à savoir la renationalisation des politiques de lutte contre le virus, l'OMS a déclenché l'alerte le 24 avril – le nouveau virus venait d'être identifié la veille par les Canadiens et les Américains. Le 27, elle relevait son niveau d'alerte en phase 4. Deux jours plus tard, elle déclarait la phase 5, « pandémie imminente ».
Le siège de l'OMS à Genève a été critiqué pour avoir réagi de manière trop alarmiste. C’est étrange, car les choses ont plutôt traîné. L'état de pandémie – c’est-à-dire la phase 6 – n’a été déclaré que le 11 juin, alors qu’il aurait dû l’être bien avant. En fait, durant le mois de mai, l'OMS a dû affronter des revendications réitérées de certains gouvernements – Royaume-Uni, Brésil, Japon, Chine –, légitimement anxieux des conséquences économiques et sociales d'une telle décision.
L'Europe, elle, est passée du « vert » au « rouge » entre le 23 et le 28 avril. Sa gestion de la pandémie a été cependant assez inexistante au point qu’en septembre, la revue Nature s'interrogeait sur la réponse européenne à la grippe pandémique, avec un article intitulé « Y a-t-il un pilote dans l'avion ? ». Bruxelles avouera ignorer en matière d’achats de vaccins, par exemple, qui a commandé quoi. La politique de santé, en bonne place dans les traités, est une prérogative exclusive des États membres, mais cette absence de contribution de la Commission de Bruxelles est préoccupante.
Les ministres de la santé des Vingt-sept rejetaient, le 30 avril, la proposition française de suspension des vols vers le Mexique – seuls Cuba et l'Argentine avaient alors pris pareille mesure. Dans cette phase « européenne » de la mobilisation gouvernementale, on s'en est le plus souvent tenu en France – mais l’analyse pourrait être faite aussi pour la Grande-Bretagne, les États-Unis, etc. – aux effets d'annonce. Un exemple : à la veille de la réunion des ministres de la santé, Bruno Le Maire, secrétaire d'État aux affaires européennes, a réclamé des procédures communes pour identifier les cas suspects : cette bonne idée n'était après tout sur la table de la Commission, à Bruxelles, que depuis octobre 2001 !
En France, le Gouvernement revient vite à des décisions hexagonales. Dès les deux premiers cas confirmés, le 1er mai, Roselyne Bachelot convoque le directeur général de la santé, le président de la conférence des directeurs des agences régionales d'hospitalisation, les médecins infectiologues et les responsables du SAMU pour une première réunion ; d’autres suivront. Tout le monde a en tête la grippe de 1918. Au soir du 29 avril, conformément au plan pandémie, le ministère de l'intérieur prend la direction des opérations. Il y aurait beaucoup à dire sur cette douloureuse question d’un fauteuil pour deux ministères et sur le manque d'autorité qui s'ensuit pour la santé – problème il est vrai structurel en France depuis la création du ministère de la santé – « de l’hygiène » – en 1920. Ce même jour, une réunion interministérielle évoque la possibilité d'une vaccination obligatoire, idée fort heureusement abandonnée début juillet.
Ainsi, dès fin avril, après que l'alerte eut été relevée par Genève au niveau 5, « pandémie imminente », la gestion de la pandémie était replacée dans un cadre national. Quand l'OMS, le 11 juin, déclare le niveau 6, « l'état de pandémie », les États suivent leur propre chemin bien qu’il soit curieux de gérer ainsi une pandémie chacun de son côté. Margaret Chan, directrice générale de l'OMS, fait contre mauvaise fortune bon cœur. Elle n'en est pas moins très seule.
J’en viens à la surestimation de l'influence des mouvements anti-vaccins.
Il ne me semble pas très judicieux d’affirmer, comme l’a fait Roselyne Bachelot, qu’« il y a toujours eu dans notre pays un mouvement anti-vaccinal important », alors qu’aucune étude n’en a démontré le poids spécifique. Croit-on vraiment que l’opinion peut être manipulée par les ligues anti-vaccinales ?
Contrairement à la Grande-Bretagne, le phénomène a toujours été en France détaché de toute tendance confessionnelle. Purement laïque, il s'insurge contre les vaccinations obligatoires. Plus encore que le vaccin, c’est l’obligation vaccinale qu’il rejette. Composé de docteurs, d'avocats, le mouvement fédère adeptes du végétarisme, partisans de la pédagogie Freinet, médecins homéopathes, etc.
Il a connu une évolution en dents de scie. Dans les années 1950, la Ligue nationale contre l'obligation des vaccinations créée en 1954 – son titre actuel est « Ligue nationale pour la liberté des vaccinations » – s'attachait à faire pression sur les parlementaires, notamment au sujet du BCG. La décennie suivante la ramenait à l'étiage sous l'effet de l'engouement de la population pour le vaccin anti-polio. Dans les années 1970, elle comptait plus de 3 500 adhérents, popularité éphémère pour la Ligue qui profitait de l'ambiance largement hostile qui prévalait alors contre le « pouvoir médical ». Au milieu des années 1990, la lutte contre le vaccin anti-hépatite B ranimait encore une fois la flamme.
Faisant son miel de l'hyper-scepticisme régnant qui, le plus souvent, fait le lit de la crédulité, le mouvement donne aujourd'hui de nouveau de la voix, relayé par certains experts ou prétendus tels, en particulier grâce à la caisse de résonance que lui offre Internet. Son influence réelle sur le public, plus apparente que profonde selon moi, n'a jamais été mesurée.
Face au déchaînement de la propagande des anti-vaccins, la stratégie de communication gouvernementale a fait preuve d'une timidité incroyable. Roselyne Bachelot dévoilait le 24 août un plan de communication, judicieux sur le fond, mais très conservateur sur la forme si on le compare au clip lancé, dès juillet, par le ministère de la santé britannique.
Aux dernières nouvelles, le site du ministère “pandémie-grippale.gouv.fr” n'est pas encore, à ce jour, abonné aux réseaux sociaux comme Facebook et Twitter, capables de toucher une population à risque particulièrement rétive aux gestes barrières et à la vaccination, à savoir les adolescents et les « adulescents ». Il n’y a pas non plus de logo accrocheur, comme en 1968 avec : « La grippe ? Étouffez-la dans l'œuf ! ». Faudra-t-il donc relancer les défilés et élever de nouvelles barricades pour donner de l'imagination à nos pâles communicateurs ?
Mme Marie-Christine Blandin, sénatrice, co-rapporteure. Toutes ces interventions très diverses vont maintenant appeler sans nul doute de nombreuses questions.
M. Jean-Marie Cohen, coordinateur national du réseau des GROG. Le réseau des GROG est engagé dans le processus européen d’évaluation en temps réel de l’efficacité du vaccin pandémique. Pour ce faire, nous devons savoir quel vaccin a été utilisé pour certains patients.
N’étant pas vaccinateurs, les médecins généralistes et les pédiatres des GROG ne peuvent connaître le nom du vaccin reçu par leurs patients que si ces derniers reviennent les voir munis du bon sur lequel tout est censé avoir été noté. Sachant que 20 % de ces patients l’auront perdu ou oublié, comment les médecins pourront-ils avoir l’information ? Ce problème est spécifique, la France étant un des rares pays à avoir plusieurs vaccins pandémiques – la Hollande, par exemple, n’en a qu’un. Une procédure est-elle prévue pour remonter aux fichiers gérés par la CNAM et savoir quel vaccin a été reçu par telle personne et à quelle date ?
M. Didier Houssin, directeur général de la santé. Non seulement le taux de 20 % ne sera peut-être pas effectif – il faudra le vérifier –, mais certaines personnes garderont le bon si une deuxième dose est prévue.
En outre, le même vaccin ayant été utilisé dans la toute première partie de la vaccination, on peut considérer que quasiment le premier million de personnes vaccinées l’a été avec le même vaccin.
Enfin, des indications nous parviennent en fonction des catégories de personnes vaccinées. Un certain type de vaccin est administré aux femmes enceintes, et on connaît le vaccin reçu par les professionnels de santé vaccinés dans les premières semaines.
Mme Françoise Weber, directrice générale de l’Institut de veille sanitaire. L’InVS ne pourrait pas remplir sa mission sans tout son réseau, dont des médecins libéraux bénévoles. Il faut réfléchir à la manière dont en France on valorise leur rôle en matière de santé publique.
M. Jean-Claude Desenclos, directeur scientifique à l’InVS. Dans nos sociétés modernes, une intervention jugée efficace d’un point de vue biomédical n’a jamais été et ne sera jamais suffisante à elle seule pour être acceptée, mise en œuvre dans de bonnes conditions et recueillir l’adhésion du public. Ce problème n’est pas spécifique à cette pandémie : il s’est posé dans d’autres champs de la santé publique, mais de manière moins médiatisée. Aujourd’hui, cette pandémie mobilise beaucoup l’ensemble de nos concitoyens, les pouvoirs publics et les médias, et impose un travail plus approfondi de compréhension, de recherche et de prospective.
C’est un élément de réflexion très important car on préfère parfois faire gagner 10 % d’efficacité à un vaccin ou à un médicament par l’innovation alors qu’une meilleure adhésion à ce vaccin ou à ce médicament pourrait, après analyse du contexte historique, social, politique et économique, avoir un impact équivalent, voire plus important en termes d’efficacité et de santé publique.
M. Didier Houssin, directeur général de la santé publique. Je remercie les intervenants qui ont essayé d’analyser les raisons pour lesquelles la France a connu cette phase d’hésitation, voire de scepticisme, avant une phase d’adhésion plus nette, même si elle est encore à mesurer. Une étude comparative avec d’autres pays mériterait d’ailleurs d’être menée.
M. Zylberman a évoqué les ligues anti-vaccinales. Ce courant traditionnel d’opposition au vaccin a peut-être été amplifié par le phénomène de l’échange d’informations sur Internet. Néanmoins, il n’est pas sûr que cela l’ait rendue plus efficace en termes de résultats.
En revanche, comme l’ont dit MM. Le Pen et Combier, la question du positionnement de certains experts a pu avoir une influence plus nette. Il me semble donc très intéressant que des sociologues et des spécialistes de la communication se penchent sur cette question.
M. Jean-Pierre Door, député, co-rapporteur. L’Europe semble être la grande absente dans la lutte contre le virus A(H1N1). L’impression prévaut que, depuis le début, chaque pays lutte seul dans son coin. C’est d’autant plus inquiétant que cela avait déjà été le cas lors de l’alerte d’H5N1. En dépit des efforts déployés par Mme Bachelot, qui avait profité de la présidence française de l’Union européenne pour taper du poing sur la table, il semble, devant cette nouvelle crise, que l’on se retrouve dans la même situation.
M. Didier Houssin. Sur ce point, je répondrai à la fois par l’affirmative et par la négative.
Il est vrai que l’urgence et l’impréparation rendaient impossible l’organisation par les États européens et la Commission d’une politique de vaccination commune. En revanche, la gestion de la crise dans sa phase initiale, de la fin du mois d’avril jusqu’au mois de juin, a été véritablement européenne : par audioconférence quasi quotidienne, le Comité de sécurité sanitaire de l’Union européenne nous informait de la situation dans chaque pays et des mesures prises par les autres États. Cette avancée incontestable est un gain de la présidence française de l’Union européenne mais aussi de Mme Bachelot avec son initiative en faveur de la coopération européenne en matière de sécurité sanitaire : ce sont elles qui ont fait du Comité de sécurité sanitaire un véritable lieu de concertation en temps réel face à une situation de crise.
M. Bruno Lina. Je fais mienne la réponse de M. Houssin sur le plan technique. Sous l’égide du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (CEPCM/ECDC), l’Europe, tirant les leçons de l’épidémie de syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS), consent depuis plusieurs années un effort important d’harmonisation des techniques, qui lui a permis de mettre en place un circuit de communication extrêmement efficace entre les laboratoires. Grâce à l’ECDC, nous avons quitté la position de suiveurs de l’information : nous avons désormais un coup d’avance par rapport aux médias et au grand public. Désormais, l’information entre les laboratoires circule rapidement et en toute transparence.
M. Claude Le Pen. Je formulerai trois remarques.
La première est pour dénoncer la façon quelque peu perverse par laquelle on prétend rendre le patient actif dans le processus de soin, tout en exigeant de lui qu’il obéisse au doigt et à l’œil aux prescriptions de santé publique. Il y a là une incohérence : le patient ne peut pas être à la fois autonome dans la sphère privée et docile dans la sphère publique. Il faudrait trouver un équilibre.
La deuxième est pour souligner l’aubaine que constitue l’Internet pour les groupes ultraminoritaires. Le réseau informatique mondial permet en effet la globalisation de l’ultraminorité : plus on est minoritaire, plus on tire profit de l’Internet, qui permet d’accéder à l’universalité.
La troisième remarque, enfin, est pour regretter le respect excessif manifesté envers l’Internet, surtout dans les milieux qui ne le connaissent pas : sous prétexte qu’il ferait l’opinion publique – n’aurait-il pas créé Obama ? –, on n’ose pas le critiquer, même quand il se trompe. Il faut se décomplexer vis-à-vis de ce média, qui dit plus de bêtises que les autres de manière générale. Les plus jeunes montrent peut-être moins de révérence envers ce média que nous, qui l’avons connu tardivement.
M. François Bricaire. Pour ce qui est de la question de l’Europe, les principaux pays ont quand même acheté des quantités importantes de vaccins. Il faut par ailleurs remarquer que la vaccination a été également critiquée par l’opinion publique des autres nations européennes, notamment en Belgique, et, plus surprenant, en Allemagne : les Allemands, qui se montrent d’ordinaire plutôt disciplinés, se sont, en cette occasion, autorisé un certain niveau de contestation. Il faut aller jusqu’aux pays nordiques pour trouver une large acceptation de la vaccination.
II. ACTEURS DE TERRAIN, PRATICIENS ET CITOYENS
Mme Marie-Christine Blandin, sénatrice, co-rapporteure. Nous allons maintenant entendre des acteurs de terrain – maire, infirmier, médecin généraliste, en cabinet ou en entreprise – afin de confronter leur vécu en matière de politique de santé publique : quels messages, quels ordres, quels conseils ont-ils reçu ? À quelles difficultés se sont-ils heurtés ? Quelles questions leur pose-t-on ?
M. Michel Bourgain, maire de l’Île-Saint-Denis. Je parlerai non seulement de la situation de ma commune de l’Île-Saint-Denis, mais également de celles d’Epinay-sur-Seine et de Villetaneuse, trois communes qui regroupent 70 000 habitants – 115 000 si on y ajoute Saint-Ouen – dépendants du même centre de santé.
Epinay-sur-Seine compte quelques cas isolés de grippe non confirmés dans le personnel communal ainsi que chez les enfants scolarisés, qui n’ont entraîné aucune fermeture de classe. À Villetaneuse, en revanche, qui compte également quelques cas non confirmés, un groupe scolaire a été fermé une semaine fin septembre. Il faut attribuer cette mesure de précaution excessive à la panique qui a régné au début : une telle décision ne serait pas prise aujourd’hui. L’Île-Saint-Denis compte aussi quelques cas isolés non confirmés, dans le personnel communal et chez les élèves – sept cas non confirmés sur mille élèves – sans qu’ils aient entraîné de fermeture de classes.
Saint-Ouen semble n’avoir aussi connu que quelques cas isolés non confirmés, tant dans le personnel de la commune que dans la population scolaire, sans fermeture de classe ni d’école.
Si l’on excepte le cas très particulier de Villetaneuse, cette population de 115 000 habitants n’a donc connu aucune fermeture d’établissement.
En ce qui concerne la communication avec l’État, la préfecture a tenu plusieurs réunions de service depuis le 8 juillet. Elle nous a par ailleurs clairement indiqué la marche à suivre par voie de nombreuses circulaires. Nous sommes donc plutôt satisfaits de l’information officielle : elle nous a permis d’acheter des masques en quantité suffisante et de les recevoir à temps, de respecter les consignes d’hygiène, de disposer d’un plan de continuité de l’activité communale, et de mettre en place une cellule de veille communale regroupant les élus, l’administration, communale et d’État, ainsi que le corps médical.
On peut en revanche déplorer une communication insuffisante entre la municipalité et les établissements scolaires. C’est ce défaut qui explique que le maire de Villetaneuse n’ait été informé que tardivement de la fermeture d’une classe dans sa commune ; j’ai moi-même beaucoup de mal à connaître les cas de grippe A dans la population scolaire, sauf à m’adresser moi-même à l’inspecteur d’académie.
Le centre de vaccination commun aux communes d’Epinay-sur-Seine, de Villetaneuse et de l’Île-Saint-Denis est ouvert, depuis le 12 novembre, deux matinées par semaine. La première semaine, le rythme de vaccination était d’une trentaine de personnes par matinée ; il est de 150 depuis le 23 novembre. Au total, 500 personnes ont été vaccinées en trois semaines, soit deux fois moins que la moyenne nationale, si j’en crois les chiffres qui ont été donnés aujourd’hui.
Même s’il est prévu que le centre ouvre six demi-journées, au lieu de deux actuellement, il faudrait, pour atteindre l’objectif de la moitié de la population vaccinée, multiplier par cinq les moyens disponibles, qui sont aujourd’hui de cinq personnels administratifs et cinq personnels médicaux, dont deux médecins, et trois postes de vaccination, dont un sans adjuvant.
En ce qui concerne l’état d’esprit ambiant, pas plus les agents communaux que les habitants ne manifestent d’affolement ni même d’inquiétude. Les uns comme les autres sont relativement bien informés des règles d’hygiène. Il ressort cependant une forme de défiance des habitants devant des informations contradictoires. Est-ce de la maturité politique et citoyenne, ou de l’insouciance ? Du bon sens ou de la résignation ? À mon avis, il y a, en la matière, une survalorisation du médical au détriment des dimensions sociétales de la question. J’y vois la marque d’une attention portée sur le curatif plus que sur le préventif, ou, d’un autre point de vue, sur le court terme plutôt que sur le long terme.
Tout en coopérant activement à l’action des pouvoirs publics, je décrirais mon état d’esprit personnel comme un état de sérénité vigilante. Concernant la question de savoir comment construire la confiance, j’y répondrai en évoquant la situation de ma commune, sise sur une île. L’aménagement après la guerre de grands lacs de régulation en région parisienne l’a préservée des inondations dont elle était jusqu’alors régulièrement victime, de sorte que la mémoire de ce risque s’est progressivement éteinte, au point d’avoir aujourd’hui pratiquement disparu.
Face à une telle situation, deux attitudes sont possibles. L’attitude « délégative » remet la gestion du risque de catastrophe dans les mains d’un régulateur – en l’occurrence les instances de régulation des grands lacs. Le processus participatif vise au contraire à faire prendre conscience aux citoyens du contexte dans lequel ils vivent. Cette « appréhension sociétale » varie selon la situation – dans le cas d’espèce, le fait d’habiter sur une île : cette localisation impose, par exemple, l’établissement d’un plan local d’urbanisme adapté. Plus largement, un tel contexte incite à militer pour la réduction des gaz à effet de serre, susceptibles de dégrader le climat et de générer des inondations. En bref, il s’agit d’une approche pluridimensionnelle au quotidien, qui, au face-à-face entre experts qui savent et citoyens soumis à des injonctions contradictoires, préfère l’éducation et la prise de conscience de ces derniers. Ce processus participatif suppose un investissement de fond, mais c’est lui que nous souhaitons promouvoir, en raison de sa dimension politique et citoyenne.
M. Bertrand Madelin, directeur du département Prévention, Santé et Sécurité au travail de Véolia Environnement. Véolia est une entreprise de services à l’environnement regroupant quatre métiers principaux : la distribution d’eau potable et l’assainissement, la collecte et le traitement des déchets, la fourniture d’énergie et le transport public. Toutes ces activités ont pour point commun d’être essentielles à la vie de la collectivité, qu’il s’agisse de collectivités publiques ou d’entreprises. Autre caractéristique, ces entreprises ou ces collectivités délèguent à Véolia la charge de gérer les risques à leur place : c’est un point qui n’est pas négligeable quand on parle de gestion des risques pandémiques.
La prise en compte du risque pandémique par le groupe Véolia remonte au début des années 2000. En 2003, l’épisode du SRAS, qui a affecté certaines de nos filiales en Extrême-Orient, a beaucoup frappé les esprits dans l’entreprise. À compter de ce moment, le groupe a cherché à s’organiser pour répondre à ce type de crise.
À partir de 2005, année de l’alerte de l’OMS sur le risque pandémique, Véolia Environnement a mis en place une organisation de type « gestion de projet », impliquant l’ensemble des fonctions nécessaires à une préparation opérationnelle et efficace de la gestion d’une crise sanitaire. Dans une collectivité telle qu’une entreprise, rien ne peut se faire en dehors d’un processus participatif : faute d’implication des personnels, les décisions « descendantes » ne permettent pas de progresser. Ainsi, des comités de préparation à la pandémie (CPP), associant les quatre métiers du groupe, ont été mis en place, afin d’harmoniser les mesures visant à protéger les salariés et à maintenir la continuité de l’activité. Tels sont en effet, en cas de pandémie, les principaux enjeux pour un groupe de cette nature et de cette taille – 340 000 salariés dans le monde, dont 110 000 en France.
S’agissant d’assurer la protection des salariés – premier principe –, un employeur ne peut demander à un collaborateur de venir à son travail s’il n’est pas en mesure de le protéger des risques auxquels son activité l’expose.
Pour ce qui est du deuxième principe, tout aussi fondamental, à savoir assurer la continuité de l’activité, les plans que nous mettons en œuvre doivent permettre d’assurer la poursuite des activités essentielles du groupe, même dans l’hypothèse d’un taux d’absentéisme de 40 %.
La préparation à la pandémie repose sur ces deux principes majeurs. Si l’usage de traitements antiviraux ou du vaccin n’en fait pas partie, c’est parce que nous voulions assurer une protection maximale avec les moyens de base, qui puisse se décliner n’importe où dans le monde et non pas seulement dans des pays développés.
Le principe de continuité des activités essentielles impose à chaque entité du groupe de déterminer ce qui, dans son activité quotidienne, est essentiel et doit être poursuivi coûte que coûte en situation de pandémie. Selon ce deuxième principe, nous devons être capables de fournir à chaque collaborateur les moyens de protection individuelle adaptés à son exposition au risque pandémique. Cela suppose d’évaluer en permanence le degré d’exposition au risque de chacun en fonction de son activité et de déterminer en fonction de cela le nombre de masques nécessaire. Ainsi, si le groupe a acheté un stock global d’équipement de protection individuelle, la logistique a été gérée au niveau de chaque entité.
Le troisième principe est de permettre autant que nécessaire l’accès à une meilleure hygiène individuelle, en assurant la mise à disposition de chaque collaborateur de points d’eau, de savons et de solutions hydro-alcooliques. En outre, les règles d’hygiène sont régulièrement rappelées.
Le quatrième principe est d’être en mesure d’informer les salariés des comportements à adopter pour se protéger. Le groupe a notamment édité une brochure rappelant les gestes essentiels de protection en cas de pandémie.
Le cinquième principe est de s’assurer de l’existence et de l’appropriation de dispositifs de gestion de crise.
Le sixième et dernier principe, mais non le moins important, nous commande d’être en permanence reliés avec les autorités de santé publique, locales ou régionales, quel que soit le pays. Cela doit nous permettre d’être informés à temps du degré de risque pandémique.
Pour ce qui est du bilan des principales actions engagées, l’année 2005 a connu la mise en place du comité de préparation à la pandémie ainsi qu’un premier recensement des stocks d’équipements de protection individuelle disponibles.
En 2006, nous avons créé un « Réseau pandémie » reliant les correspondants du CPP de chaque entité du groupe dans le monde entier. Le CPP élabore cette année-là les premières fiches réflexes et les fiches d’instruction sur la protection des collaborateurs en cas de pandémie. C’est aussi l’année de la première modélisation des plans de continuité de l’activité (PCA) qui sont obligatoires en France, et la création d’un site Extranet qui permet d’informer nos collaborateurs au jour le jour sur le risque pandémique. Ce site a vocation à s’adresser aux salariés qui ne pourraient pas se rendre sur leur lieu de travail du fait de la pandémie. 2006, enfin, a permis le lancement de la première campagne de lavage des mains et l’achat de masques pour l’ensemble du groupe.
En 2007, les principes essentiels de préparation à la pandémie ont été définis et la brochure d’information éditée. Les PCA ont été finalisés. Enfin, un kit de simulation a été mis en place, ce qui nous a permis d’effectuer, avec les pouvoirs publics, un exercice de simulation de crise dans le sud-est, ce qui était une première en France.
En 2008, une deuxième simulation de crise a eu lieu, à Paris cette fois, avec les ministères de la santé, de l’intérieur et des finances et des entreprises. Au début de cette année-là, un référentiel a été remis à chaque entité, afin que chacune puisse évaluer les moyens dont elle disposait pour faire face à la pandémie. L’ensemble de ces moyens a été activé début 2009, par le biais de questionnaires recensant les questions essentielles que chacun pouvait se poser concernant la pandémie. Au cours de l’été, les instances représentatives du personnel, qu’il s’agisse du comité de groupe France, du comité de groupe Europe ou du comité de groupe Monde, ont été consultées sur les mesures prises.
La campagne Véolia sur le lavage des mains utilisait un guide de déploiement, un poster, une carte postale et un argumentaire scientifique. Cette dernière brochure d’information a été reprise par des entreprises telles que Renault ou Bull.
M. Patrick Romestaing, président de la section santé publique du Conseil national de l’Ordre des médecins. Bien qu’il ne soit ni un lieu d’expertise scientifique, ni une instance politique, le Conseil national de l’Ordre des médecins est pourtant très sollicité depuis le début de cette crise, tant au niveau national qu’aux échelons départementaux. C’est que le Conseil, à côté de son rôle en matière de déontologie médicale, remplit incontestablement une mission de santé publique. Un des tout premiers articles du code de déontologie médicale pose d’ailleurs que le médecin exerce sa mission au service de l’individu et de la santé publique. Or la situation actuelle nous interpelle à ces deux niveaux.
Sans intervenir d’aucune façon dans le champ syndical, le Conseil de l’Ordre s’est positionné en tant qu’interlocuteur de l’ensemble de la population médicale, quel que soit son mode d’exercice – salariés hospitaliers ou extra-hospitaliers, médecins territoriaux, médecins scolaires, médecins du travail, médecins libéraux.
La situation à laquelle nous étions confrontés était caractérisée par l’excès : un excès d’information et, depuis quelques semaines, un excès d’activité des médecins. Il faut observer que la population médicale n’a pas été épargnée par le scepticisme ambiant, notamment en ce qui concerne la vaccination, alors qu’elle devrait a priori y être favorable.
Le Conseil national a participé à toutes les réunions auxquelles il a été convié, qu’il s’agisse du Comité technique des vaccinations, du Haut Conseil de la santé publique, des réunions d’experts ou de membres de sociétés savantes.
Le 22 septembre, par l’intermédiaire d’un communiqué à la presse professionnelle, le Conseil de l’Ordre a exprimé sa position officielle en ce qui concerne la vaccination, qui était alors très controversée, l’opinion publique ne s’y étant convertie que depuis quelques semaines. Par ce communiqué, le Conseil de l’Ordre appelait les médecins au respect des règles déontologiques : d’une part, être à même de satisfaire la demande de soin ; d’autre part, éviter d’être des agents de propagation du virus, ce qui leur impose d’être eux-mêmes vaccinés. Ce communiqué affirmait par ailleurs, sans ambiguïté, que les préconisations des instances nationales et européennes étaient conformes aux exigences usuelles en matière de vaccination.
Outre cette prise de position officielle, qui a recueilli l’approbation d’un certain nombre de confrères, le Conseil de l’Ordre a participé, sous l’égide de la Direction générale de la santé, à la constitution d’un diaporama, avec des sociétés savantes de pédiatrie, de pneumologie, d’hygiène hospitalière, ou encore d’infectiologie. Ce diaporama, mis en ligne sur le site du ministère de la santé et sur celui du Conseil de l’Ordre, répond aux questions des professionnels à propos du virus, de la vaccination et des mesures barrières. Il s’agit notamment de mettre fin aux inquiétudes lancinantes, même si elles tendent à s’apaiser ces derniers temps, sur les adjuvants, le Thiomersal, etc.
Sur le terrain, les conseils départementaux ont relayé l’appel au volontariat, indispensable à un bon déroulement de la vaccination. Cela nous paraît essentiel à un moment où la fréquentation des centres de vaccination augmente d’une manière plus que significative.
Tel a été le rôle que souhaitait tenir le Conseil de l’Ordre dans la gestion de cette pandémie. Il s’agissait d’abord de rappeler à nos confrères les obligations déontologiques, qui peuvent dans certains cas déboucher sur un questionnement éthique – on peut se demander par exemple si un médecin peut délivrer un message négatif sur une pratique dont l’utilité est reconnue depuis des années, comme la vaccination. Ces obligations consistent à être à même de soigner et de ne pas contaminer. Mais nous voulons aussi mettre en exergue la fonction d’exemple du médecin, qui ne doit pas être contre-productif au regard des politiques menées qui semblent justifiées sur le plan scientifique.
La faible mobilisation de la population médicale au moment de la diffusion de ce communiqué n’a pas ébranlé notre conviction de la nécessité que le Conseil de l’Ordre adopte une position officielle, contribuant ainsi, aux côtés des scientifiques et des politiques, à une action de santé publique.
M. Martial Olivier-Koehret, président de MG France. Je suis heureux de m’exprimer après vous, mon cher confrère, pour saluer la dignité qui a été celle de l’Ordre en l’occurrence, mais aussi après un maire et un représentant de l’industrie. Nous ne sommes pas en effet dans un débat médical ordinaire, où il s’agit de savoir comment soigner nos patients : nous sommes dans une crise impliquant de multiples acteurs.
Je voudrais rappeler trois éléments de contexte afin de mieux comprendre ce qui s’est passé.
Françoise Weber a rappelé que la mortalité liée à la grippe avait augmenté l’année dernière. Or les médecins généralistes avaient été, cette année-là, mis à l’écart de la campagne de revaccination grippale. Ce choix de l’assurance-maladie ( privilégiant les infirmières ) dont la finalité économique n’est pas douteuse, a abouti à une chute de 11 % de la vaccination dans la population cible. J’ai demandé à Françoise Weber de rechercher s’il y avait un lieu entre cette chute de la vaccination contre la grippe saisonnière et l’augmentation de la mortalité due à la grippe : le froid ne doit pas être la seule explication ! En revanche, cette mise à l’écart a dû singulièrement « refroidir » l’implication de mes confrères dans le dispositif vaccinal.
Le deuxième élément que je veux rappeler est le sous-équipement des cabinets des médecins généralistes de notre pays, qui souffrent d’un manque de personnels et d’une informatique balbutiante. Si ce problème a été évoqué lors des États généraux de l’offre de soins et pris en compte par la loi portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires (HPST), il n’a pas encore reçu de solution.
Il faut enfin s’interroger sur la question de la légitimité. Qui a suffisamment de crédit aux yeux de l’opinion publique pour défendre une action de santé publique ? Aucune des nombreuses instances représentatives des professionnels, syndicats, Ordre, académie, n’est à même de tenir ce rôle. Quant au champ politique, c’est la cacophonie qui y domine en l’espèce. La loi HPST n’a pas tranché la question : en confiant à l’assurance maladie la maîtrise médicalisée des dépenses de santé et l’efficience du système de soins, et aux agences régionales de santé la responsabilité de la régulation, le politique s’est privé de la possibilité d’être audible en matière de santé publique.
C’est dans ce contexte qu’est apparue la crise sanitaire actuelle. Celle-ci a été précédée d’autres crises – le chikungunya, le virus Ebola, le SRAS, la grippe aviaire, voire les scandales de la canicule ou du sang contaminé – qui ont elles-mêmes suscité des attentes, des peurs, des interrogations, compliquant encore la situation.
La nouveauté, c’est que dès le début de l’épidémie, toute l’information était disponible via Internet – jusqu’à la plaque de lit de la première victime à Mexico ! –, même ce qui est d’ordinaire réservé aux professionnels, c’est-à-dire les hypothèses, les pistes de recherche ou de réflexion. Tout cela est depuis le début mis sur la place publique, sans être canalisé par un message officiel.
Le message des pouvoirs publics a été marqué par la cacophonie. Alors qu’on ne savait déjà pas qui, du ministère de l’intérieur ou de la santé, pilotait cette affaire, on a même vu apparaître de nouveaux acteurs : même si 99 % de mes collègues ne connaissent pas l’Établissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires, cela ne l’empêche pas de s’exprimer. Dans une telle cacophonie, quel message devons-nous diffuser auprès de patients dont nous sommes les principaux interlocuteurs même s’ils sont souvent plus informés que nous ?
Nous restons pourtant de loin les premiers responsables en matière de prise en charge de la grippe, en dépit des propos de tel sénateur, qui n’a pas craint de demander en réunion de commission si les médecins généralistes sont suffisamment formés pour soigner les grippés. De tels propos n’ont fait qu’accroître notre incompréhension. Mais la réalité a fini par s’imposer et on a enfin décidé de s’appuyer sur les généralistes. En effet, en dépit d’une charge moyenne de travail de 66 heures par médecin généraliste, nous présentons cette particularité d’adapter notre activité aux besoins de la population, même lorsque le nombre de patients s’accroît sensiblement.
Ce contexte déjà difficile a été encore aggravé par la réquisition de médecins. Qui sait ici que les réquisitions sont apportées aux généralistes par des gendarmes ? Cela s’est passé aujourd’hui en Seine-Saint-Denis, avant-hier à Bordeaux. Ce n’est pas là, madame et messieurs les parlementaires, un comportement digne. Ayant moi-même été réquisitionné à plusieurs reprises, je peux vous dire que c’est un traumatisme que de voir des gendarmes surgir dans la salle d’attente pour venir vous dire au nom de la société ce que vous devez faire. Nous sommes le seul groupe professionnel à subir cette avanie, et cela parce que certains gestionnaires de centres de vaccination n’ont pas respecté les instructions qui leur prescrivaient de recourir aux internes, aux médecins retraités ou remplaçants. Il est vrai qu’il était plus difficile d’aller chercher ces derniers que d’envoyer des gendarmes réquisitionner des généralistes ! Un fonctionnement aussi inacceptable, au moment même où nous nous mobilisons pour prendre en charge les patients, nous interdit de jouer pleinement notre rôle.
Le choix même de réserver le soin de vacciner à des centres de vaccination est déjà mal perçu. Il peut certes être justifié par des arguments très nombreux, et d’abord par notre sous-équipement endémique. Il y a également des raisons qui tiennent au mode de conditionnement des vaccins. Mais comment mes collègues pourraient-ils comprendre ce choix exclusif quand tous les entretiens avec leurs patients, en consultation ou au téléphone, se terminent par la même question : « Docteur, dois-je me faire vacciner ? ». Mesurez-vous combien il peut être déstabilisant de dire à des personnes qui nous confient leur santé – ce qui n’est pas rien ! – qu’ils doivent se faire vacciner mais que nous ne pouvons pas le faire ?
Je m’inscris en faux contre l’affirmation selon laquelle l’opinion française serait désormais massivement favorable à la vaccination. Un million de vaccinés, ce n’est pas l’ensemble de la population, et les réticences, voire les résistances restent extrêmement fortes. Si les gens s’informent auprès de nous, en raison de la relation privilégiée que nous entretenons avec eux, cela ne veut pas dire pour autant qu’ils sont décidés à se faire vacciner : les convaincre demande un effort considérable.
Ce que nous souhaitons, c’est d’être mieux associés à la gestion des crises, ce qui suppose une meilleure concertation. Certes, celle-ci s’est construite progressivement avec le ministère de la santé. Grâce à l’insistance de MG France, elle a fini par se développer au niveau local. Nous avons ainsi formulé, dans chaque département, des solutions plus intelligentes que celles qui avaient été précédemment retenues, notamment en ce qui concerne les masques.
Mais il faut désormais institutionnaliser cette concertation. Celle-ci doit prendre en compte non seulement la médecine de ville, mais aussi les médecins hospitaliers. Ces derniers sont nos partenaires directs dans la gestion de cette crise, l’augmentation de l’activité des médecins de ville entraînant un basculement d’une partie de cette activité vers l’hôpital, comme Françoise Weber vient de l’expliquer. Il faudra bien préciser les conditions d’hospitalisation des patients ou encore les modalités de coopération entre médecins de ville et médecins hospitaliers.
Il nous faut une information officielle plus précise, sous la forme, par exemple, d’un point hebdomadaire sur la situation qui rappellerait les éléments de préconisation. Il nous faut aussi un dispositif d’accompagnement équivalent à celui qui avait été mis en place pour faire face au risque de grippe aviaire, et qui permette aux acteurs de terrain de contribuer à la diffusion de l’information. Les médecins, par exemple, ne savent pas ce qu’est le niveau 6.
Nous devons avoir, nous, médecins généralistes, la faculté de prescrire le vaccin aux patients qui passent entre les mailles de l’assurance maladie et de les envoyer aux centres de vaccinations. Il faut que nous puissions avoir accès au vaccin dans de bonnes conditions pour ceux de nos patients qui en ont besoin, tels les patients isolés qui ne peuvent être vaccinés qu’à domicile.
Il faut enfin que l’EPRUS se développe et se rapproche de l’Institut de Veille sanitaire. Nous devons travailler ensemble à améliorer les systèmes d’information, l’action des groupes régionaux d’observation de la grippe, bien que positive, n’étant pas suffisante. Cette insuffisance souligne la nécessité pour notre pays d’organiser un vrai dispositif de santé publique qui fasse participer les acteurs de terrain que sont les médecins généralistes. Certes, le texte que vous venez de voter affirme la place du médecin généraliste en matière de santé publique. Mais les moyens de réaliser ce principe font encore défaut. Nous ne devons plus être considérés seulement comme des individus qui soignent des patients, mais comme un groupe professionnel qui rend un service collectif au pays.
Cette crise devra nécessairement modifier le positionnement des uns et des autres. Elle sera surtout l’occasion de mettre réellement en œuvre le principe de codécision thérapeutique voté en 2002, qui laisse au patient le soin de décider après avoir pris conseil auprès de son médecin traitant.
M. Thierry Amouroux, secrétaire général du Syndicat des personnels infirmiers. Je veux d’abord remercier l’Office de donner la parole aux acteurs de terrain. Ceux-ci ont d’ordinaire du mal à se faire entendre, comme en témoigne ici même le départ précipité des représentants des pouvoirs publics et des experts ès pandémies. Une telle attitude explique à elle seule la difficulté du dialogue et la prise de décisions aussi stupides que la circulaire Hortefeux du 21 août relative aux modalités de vaccination.
Ce n’est pas en tant qu’expert, mais en qualité de praticien de terrain et citoyen que je vais essayer de vous expliquer pourquoi un médecin sur deux et deux infirmières sur trois refusent de se faire vacciner, et pourquoi seuls 20 % du personnel hospitalier se sont fait vacciner.
À écouter les interventions de la table ronde précédente, tout serait blanc ou noir : soit on approuve la vaccination massive de l’ensemble de la population, soit on s’oppose à la vaccination. Nous prônons, nous, la juste mesure : si les personnes à risque doivent impérativement être vaccinées, le reste de la population doit librement choisir entre les rares complications de la grippe et les rares effets secondaires du vaccin avec adjuvant.
On recense trois millions de personnes atteintes par le virus grippal A(H1N1) en France. Selon l’InVS, 461 ont été hospitalisées depuis le début de l’épidémie, dont 92 ne présentaient pas de facteur de risques ; 86 sont mortes, dont 6 sans facteur de risque. De tels chiffres nous inclinent à préférer un calcul du rapport bénéfice-risque à un discours incantatoire et quelque peu infantilisant.
On entend depuis ce matin des discours stigmatisant une prétendue inconscience de l’opinion, une méconnaissance des informations, un déni de la réalité, etc. Or j’observe que la position de la France n’est pas forcément partagée par les autres pays. Ainsi, l’avis émis le 7 septembre par le Haut conseil de la santé publique reconnaît que les six pays qu’il prend en exemple ont des politiques vaccinales différentes. On voit par là qu’il n’y a pas une vérité officielle fondée sur des certitudes scientifiques et que les pratiques changent selon les pays, notamment en ce qui concerne les groupes à vacciner. Il nous semble d’autant plus important de préserver une logique citoyenne du libre choix éloignée de toute infantilisation.
En outre, il est inacceptable, d’un point de vue éthique, de juger l’épidémie actuelle plus grave que les 6 000 morts victimes de la grippe saisonnière, sous prétexte que ces derniers sont des personnes âgées. La vie humaine a toujours le même prix, qu’il s’agisse d’une personne âgée ou d’un jeune.
Pour les professionnels de terrain, il n’est pas facile de maintenir une position de juste mesure entre les deux gros lobbies que sont l’industrie pharmaceutique et les ligues antivaccinales. Autre difficulté, nous avons affaire à des cas particuliers : il s’agit de conseiller le patient en fonction de ses intérêts personnels, et non de lui appliquer une logique de masse. Or le face-à-face entre le soignant et le soigné est encore compliqué en France par une mémoire collective marquée par le scandale du sang contaminé ou l’affaire de l’hormone de croissance.
La mise à l’écart des professionnels de terrain de la prise des grandes décisions aboutit aux aberrations de la fameuse circulaire Hortefeux du 21 août sur l’organisation des centres de vaccination. À l’origine, celle-ci dispensait de consultation médicale les personnes n’ayant mentionné aucun facteur de risque. Les protestations des professionnels de santé ont permis de corriger cet aspect de la circulaire.
Ce texte prévoyait également le rythme d’une vaccination toutes les deux minutes. Une cadence aussi infernale ne convient qu’à la médecine vétérinaire. Les délais d’attente dont certains se plaignent aujourd’hui prouvent néanmoins qu’on traite les patients comme des êtres humains, dignes qu’on leur consacre du temps, et non comme un troupeau à vacciner à la chaîne. Il est également important d’expliquer que la « paperasserie » imposée aux patients permet d’assurer la traçabilité, dans leur propre intérêt.
La circulaire fractionnait enfin l’acte de vaccination, un agent devant préparer l’injection, un second procédant à l’injection, et un troisième rédigeant la fiche de traçabilité. À l’hôpital, où la même personne doit obligatoirement réaliser les trois étapes, une telle procédure relèverait de la faute professionnelle. L’absence de toute concertation avec les professionnels de terrain explique l’édiction de ce genre de circulaires totalement inadaptées et l’impuissance à mobiliser des professionnels qui se refusent à travailler dans de telles conditions.
S’il y a une leçon à tirer de cette campagne, c’est bien la nécessité de ne pas laisser la technostructure décider seule et de consulter les professionnels de terrain, ceux qui sont au plus près des besoins.
Mme Marianne Buhler, porte-parole du Réseau Environnement Santé. Si je m’exprime ici au nom du Réseau Environnement Santé (RES), je suis également praticienne de terrain. En outre, en tant que maire-adjointe en charge de la santé, je participe à l’organisation du centre de vaccination de ma commune.
Il est juste de dire que l’actuelle séquence épidémique a été à son début caractérisée par le scepticisme de nos concitoyens, médecins et personnels paramédicaux compris, quant à la réalité de l’épidémie et quant aux moyens de lutter contre elle. Cette défiance est problématique – que se serait-il passé si nous avions eu affaire à une épidémie de grippe H5N1 ? – et ses causes sont multiples.
Les décisions de santé publique, qu’il s’agisse de celles de l’Organisation mondiale de la santé, de l’Agence européenne de santé ou du groupe d’expertise sur la grippe, en France, se fondent sur l’avis d’experts. Or l’expertise a fait l’objet de nombreuses controverses. Il serait nécessaire de créer une Haute autorité d’alerte et d’expertise et de la charger non pas de réaliser des expertises mais de définir et de faire respecter une déontologie de l’expertise afin de mettre fin aux soupçons qui pèsent sur ces décisions.
En qualité de médecin, j’entends tous les jours des patients me demander s’ils doivent se faire vacciner. Si je suis sincère, ma réponse est que je ne dispose pas d’éléments suffisants pour répondre de façon objective. J’ignore les risques à long terme de la maladie comme du vaccin. J’ignore même la gravité de cette maladie : le bilan de la grippe A dans l’hémisphère Sud montre que son impact n’est pas si important. Comment pouvons-nous, en tant que médecins, juger que les décès liés à l’épidémie actuelle sont plus graves que ceux dus à la grippe saisonnière ? Comme l’a dit mon collègue, ce n’est pas parce que ce sont les vieux qui meurent que c’est moins grave.
Toutes ces raisons rendent extrêmement difficile de répondre aux interrogations du patient. Alors que j’ai passé mon week-end à délivrer des bons de vaccination, je ne sais toujours pas quelles sont les contre-indications du vaccin.
Dans quelle mesure la responsabilité de l’injecteur du vaccin peut-elle être mise en cause en cas de plainte d’une personne victime d’éventuels effets secondaires ? En effet, la réquisition ne le met pas à l’abri des poursuites pénales. L’État n’a pas doté l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM), d’un budget spécifique pour indemniser les victimes de cette vaccination. La loi ne protège les médecins qu’en cas de vaccination obligatoire, ce qui n’est pas le cas ici. Il faut donc, soit changer la loi, soit étendre par décret les compétences de l’ONIAM et doter l’office d’un budget dédié à cette vaccination.
En ce qui concerne la réalité de cette épidémie, on parle de trois millions de cas en France. Comment peut-on être sûr de ce chiffre, alors que le test de dépistage, dont le prix est de 95 euros non remboursés, n’est réalisé qu’à l’hôpital et dans des cas très limités ? Comment distinguer en conséquence entre les cas de grippe A et les autres grippes ? En distribuant du Tamiflu larga manu sous prétexte de lutter contre ce virus, même dans les cas où on n’est pas sûr qu’il est en cause, ne va-t-on pas créer des résistances à ce médicament ? Même si l’InVS parle de 730 000 consultations pour infection respiratoire aiguë due au virus A(H1N1), on n’a aucune certitude à ce sujet, la plupart de ces cas n’ayant pas fait l’objet d’un test de dépistage.
Je m’interroge, en tant que maire-adjointe, ayant beaucoup travaillé avec la Direction départementale des affaires sanitaires et sociales (DDASS) à la mise en place d’actions de prévention : quand va-t-on se décider à mettre en place les mesures barrières ? Attendra-t-on la fin de l’épidémie pour utiliser les masques ? Au Japon, les barres et les rampes d’accès sont nettoyées en permanence : que font la RATP, la SNCF ? Que fait-on dans les écoles ?
Nous sommes en pleine schizophrénie : on crée la panique dans l’opinion en diffusant tous les soirs à la télévision des images de jeunes adultes en réanimation faute de s’être fait vacciner. Or ils ne peuvent pas encore se faire vacciner puisqu’ils ne font pas partie des catégories prioritaires ! Des familles dont les parents sont animés par le souci de protéger leurs enfants passent cinq heures dans l’atmosphère confinée d’un centre de vaccination, propice à la propagation du virus. J’y ai vu un nourrisson de sept jours dont la mère venait se faire vacciner ! Or, on ne fait respecter dans ces centres aucune obligation de prévention telle que le port de masques ou un lavage régulier des mains. C’est une situation inacceptable sur le plan sanitaire.
À cette incompréhension quant à l’inapplication des mesures barrières, s’ajoutent des interrogations de santé publique : la lutte contre cette maladie n’entraîne-t-elle pas des dépenses excessives, si on les compare par exemple aux crédits consacrés au Plan cancer ou à la lutte contre d’autres maladies infectieuses ?
Je terminerai par des questions que nous avons coutume de nous poser dans le cadre du RES : quelles sont les conséquences à long terme, notamment pour les femmes enceintes, d’un vaccin qui comporte notamment un dérivé mercuriel ? On me rétorquera qu’il n’y a pas de réponse à cette question. Dans ce cas, faut-il vacciner plusieurs centaines de milliers de femmes enceintes alors que le risque, comme le bénéfice, sont difficiles à évaluer ?
Mme Marie-Christine Blandin, sénatrice, co-rapporteure. Je veux rassurer les acteurs de terrain qui déplorent le départ d’une grande partie des représentants des pouvoirs publics et des gestionnaires des pandémies. Ils ont en face d’eux des personnes éminentes, comme le professeur Zylberman et le professeur Bricaire et, surtout, le représentant de M. Houssin, M. Dominique Tricard, de l’Inspection générale des affaires sociales (IGAS), à qui je vais demander maintenant de s’exprimer sur ce qui a été dit.
M. Dominique Tricard, Inspection générale des affaires sociales (IGAS), INSERM. Je ne vais pas revenir sur chacun des points évoqués par les acteurs de terrain parce qu’ils témoignent de positions particulières.
Pour suivre ce dossier depuis le démarrage, c’est-à-dire depuis la préparation à la pandémie grippale H5N1, je constate une similitude d’organisation dans la mise en place, depuis avril, de l’action contre la pandémie H1N1 : elle a consisté en des phases de mobilisation des acteurs de terrain, de réflexion sur la manière d’assurer la continuité de l’activité dans les entreprises, les collectivités, les établissements de soins, avec la mise en place de plans de continuité, et d’interrogation sur les problématiques de droit de retrait. Mais il est intéressant de noter que les discussions de 2006 et 2007 ne reviennent pas sur le devant de la scène. Beaucoup d’acteurs les ont prises en charge.
Nous craignions que la démarche n’ait été intégrée que par les grandes collectivités et les grandes entreprises. Or nous observons qu’entre juillet et l’automne, beaucoup de structures de petite taille – collectivités et entreprises – se sont mobilisées et ont créé des réseaux. Pour ne citer qu’eux, tous les boulangers se sont regroupés pour pouvoir assurer une continuité d’activité de chaque boulangerie.
Il existe un certain décalage entre le monde de la santé et le reste de la population. Les approches et les préparations sont différentes avec les acteurs, que ce soit au niveau national ou au niveau local. C’est un point à faire évoluer dans le futur.
Internet n’a pas que des effets négatifs, déstabilisants ou nocifs. De nombreux réseaux construits avant la pandémie sont aujourd’hui utilisés par les acteurs à la fois pour s’informer et pour échanger leurs expériences. Internet fournit des outils qu’il faut développer afin de faciliter l’apprentissage collectif et la dynamique collective.
Comme cela a été dit, c’est à une gestion de l’incertitude que nous sommes confrontés. Même si l’épidémie prend une ampleur semblant corroborer les prévisions, nous avons toujours à gérer une partie d’incertitude. Nous ne pouvons espérer obtenir une connaissance complète. La situation impose un travail collectif d’acquisition et de gestion.
Les acteurs – pourtant déjà très nombreux – représentés aujourd’hui ne sont pas les seuls à être associés à la réflexion : les personnes qui travaillent dans les domaines du social, de la petite enfance, du service à domicile ont également été mobilisées.
Quelles propositions pouvons-nous faire ?
Comme vous l’avez fait dans cette journée, nous devons travailler à l’élaboration d’un bilan des quatre années de préparation. Nous sommes-nous trompés ? Avons-nous oublié des paramètres ? Comment aurions-nous pu mieux faire ?
Nous devons également capitaliser les expériences menées pour la gestion des risques sanitaires. Les choix qui ont été faits ont-ils été les bons ? La cellule interministérielle de crise doit-elle être gérée par le ministère de la santé ou par le ministère de l’intérieur ? Quelles ont été les conséquences – favorables ou critiquables – des décisions qui ont été prises ? Nous devons tirer un enseignement de toutes ces expériences.
L’action de certains acteurs est restée dans l’ombre. L’évaluation des expériences doit être menée de façon très large afin de bénéficier de toutes les expertises.
Dans de nombreux endroits, la préparation en vue d’une pandémie, qu’elle ait eu lieu avant ou après avril 2009, a apporté un plus dans le fonctionnement et l’organisation de la structure concernée, comme l’a indiqué le directeur du département Prévention, santé et sécurité au travail de Véolia. Elle a notamment eu des répercussions dans la résolution de situations de crise dans la gestion quotidienne. Cet élément doit être versé au dossier, dans la case « profit ». Il y a eu un effort très lourd de mobilisation. Nous devons en tirer des bénéfices collectifs.
M. Claude Le Pen. En faisant remarquer que le profil des patients atteints par la grippe H1N1 était différent de celui des patients atteints habituellement par la grippe, Françoise Weber n’a pas laissé entendre que le décès d’une personne âgée était moins grave que celui d’une personne plus jeune. Elle a simplement fait un constat. Je souhaitais rétablir ce point car il serait grave de laisser supposer une telle pensée de la part de la directrice de l’InVS.
Bien que ma remarque dépasse le débat d’aujourd’hui, je souligne que, même si la population traite les médecins comme des experts, ceux-ci n’en sont pas. Entre la parole d’expert et la parole citoyenne, les médecins de base se solidarisent davantage avec la seconde qu’avec la première. Ils ne sont pas les porte-parole de l’expertise auprès de leurs « clients ». Il existe un malentendu sur le degré d’expertise dont la population crédite les médecins.
M. François Bricaire. Sans vouloir polémiquer sur l’âge des patients à risque, le fait que la grippe H1N1 menace les personnes jeunes doit être pris en compte. Comme cela a déjà été dit, la problématique n’est pas la même quand il s’agit d’une épidémie saisonnière ou d’une pandémie.
Par ailleurs, si l’on parvenait à augmenter le nombre de personnes qui se font vacciner contre la grippe saisonnière, on réduirait le nombre de décès dûs à celle-ci – dont tout le monde déplore l’importance. Je sais que la vaccination n’assure pas une protection à 100 % mais ce serait bien que toutes les personnes au-dessus de soixante-cinq ans, qui bénéficient gratuitement de la vaccination anti-grippale, s’y soumettent.
M. Jean-Marie Cohen. Les médecins généralistes, les pédiatres, les médecins de ville sont, selon moi, des experts. En France, ce sont même eux qui ont certainement la meilleure expertise en matière de grippe. En revanche, ils ne sont pas du tout experts concernant les décisions prises pour lutter contre la pandémie. Je reconnais qu’il n’est pas simple de leur donner ce petit élément d’expertise – très technique et très bureaucratique – qui leur manque, mais il faudrait trouver un moyen pour qu’ils soient informés des décisions prises en haut lieu en matière de santé publique avant qu’elles soient médiatisées.
Il est faux de dire qu’aucun prélèvement n’est effectué ni qu’aucune analyse n’est réalisée. La France est le pays qui en fait le plus : en trois semaines, elle a fait procéder à 2 000 prélèvements.
Il n’est pas possible de réaliser des prélèvements sur tous les malades grippés, d’une part, parce qu’il n’y a pas assez de techniciennes de laboratoire pour les analyser, d’autre part, parce que cela aurait un coût démentiel. Nous procédons par sondage, c’est-à-dire que nous faisons des analyses sur un échantillon de patients. Nous estimons à 900 000 le nombre de personnes qui ont attrapé la grippe la semaine dernière. Comme, il y a huit jours, le nombre de grippés était de 2,7 millions, cela fait quelque 3,7 millions aujourd’hui. Ces estimations sont faites à partir du nombre de personnes qui viennent consulter pour des symptômes ressemblant à ceux de la grippe. On applique ensuite à ce nombre un pourcentage de prélèvements positifs pour la grippe H1N1.
Les virus H1N1 sont séquencés, typés, analysés de façon très fine. Il y a une surveillance virologique très intense.
M. Michel Bourgain. Tout le monde, pour moi, est expert : les médecins sont experts de la médecine de ville, les habitants sont experts du quotidien. Je ne vois pas pourquoi il y aurait une expertise plus significative que l’autre.
C’est ce que j’ai voulu signifier lorsque j’ai insisté sur l’importance de la participation, du partage. Ce dernier ne concerne pas seulement les connaissances ou les informations, mais également la confiance que l’on peut avoir. Tout en traitant l’urgence, on s’interroge sur le mode de vie qui favorise l’émergence de virus à répétition. On traite également du fond du problème, de l’origine du phénomène et, dans ce cadre, les citoyens et les politiques ont leur mot à dire. C’est tout l’enjeu politique des grandes dégradations planétaires.
Mme Marianne Buhler. Le côté pratique de la lutte contre la pandémie doit être aussi pris en compte. Le week-end dernier, un médecin s’est ainsi auto-réquisitionné pour vacciner 700 personnes. M. Fillon prévoit d’augmenter le nombre de jours de vaccinations et de faire ouvrir les centres également le dimanche. On compte quinze personnes en moyenne pour trois heures. Si les centres ouvrent douze heures par jour, sept jours sur sept, je suis un peu inquiète de l’organisation que cela suppose.
S’il est vrai, monsieur Cohen, que 2 000 prélèvements ont été effectués pour 3,7 millions de personnes grippées, il se pose ensuite un problème statistique.
M. Gérard Bapt, député, rapporteur de la mission Santé de la commission des finances de l’Assemblée nationale . En tant que médecin, je suis un peu choqué d’entendre dire que les médecins ne sont pas des experts. Qui peut, dès lors, prétendre à ce titre ?
Dans un débat auquel j’ai participé, les professeurs Lina et Gentilini ont défendu deux positions totalement opposées à propos de la stratégie vaccinale. Au cours d’un échange auquel j’ai assisté ce matin, les avis étaient opposés sur l’administration du Tamiflu : d’un côté, il était déconseillé d’en donner trop, car cela pouvait développer les résistances à ce médicament et, d’un autre, il était conseillé, sur la base des expériences des pays où a sévi la pandémie, d’en donner largement et dès le début.
Je me suis rendu en Allemagne mardi dernier avec le professeur Etienne : la vaccination y est effectuée dans les centres hospitaliers et chez les médecins, sans que cela ne pose de problèmes.
M. Jacques Houssin m’a dit aujourd'hui qu’un cahier des charges avait été envoyé aux médecins pour leur permettre de vacciner, mais que ces derniers ne répondaient pas. Or, le docteur Combier, que j’ai également croisé au moment où il partait, m’a affirmé qu’il n’avait rien reçu.
Je profite de la présence d’un représentant des médecins et d’un représentant de la DGS pour poser la question : le ministère a-t-il fait des propositions aux médecins ? Quel est ce mystérieux cahier des charges que les médecins n’ont jamais vu ?
M. Martial Olivier-Koehret. Non seulement aucune proposition n’a été faite aux médecins, mais nous essuyons un refus de la part de M. Fillon qu’il a encore réitéré tout récemment. Mes collègues médecins ne comprennent pas, car ils sont prêts. En outre, comme cela a été souligné, un problème de traçabilité va se poser.
Mme Marie-Christine Blandin, sénatrice, co-rapporteure. Monsieur Tricard, pouvez-vous nous éclairer sur ce point ? Est-ce uniquement un problème postal ?
M. Dominique Tricard. Vous m’entraînez sur un terrain où chaque acteur a son point de vue.
Une discussion a lieu au ministère. La demande des médecins est forte.
Actuellement, il est demandé à ces derniers de faire des propositions concrètes en matière de gestion des différents types de vaccins, de traçabilité, de réponse à donner aux différentes situations possibles. Si les feuilles ne se remplissent pas et si les propositions restent orales, je pense que le débat ne pourra pas avancer.
M. Martial Olivier-Koehret. Je ferai pour ma part des propositions concrètes en la matière.
Mme Marie-Christine Blandin, sénatrice, co-rapporteure. Votre question était très utile, Monsieur Bapt.
Mme Marie-Christine Blandin, sénatrice, co-rapporteure : Ce matin a eu lieu une table ronde d’ordre plutôt scientifique consacrée à la mutation des virus et sur laquelle M. Door présentera une conclusion dans quelques instants.
Pour ma part, je ne conclurai pas les échanges de cet après-midi. Je ferai juste quelques remarques.
Si l’on peut, d’un certain point de vue se féliciter qu’il y ait eu le H5N1 – nous avons en effet pu profiter de travail de préparation alors effectué –, on peut également regretter ce précédent parce que la gestion de la crise a eu un côté un peu musclé, à l’image des plans secret défense des militaires. Il a manqué visiblement d’un peu de sérénité, ainsi que cela a été souligné par tous.
À propos d’Internet et des médias, on en a plutôt entendu parler comme étant le support d’une mondialisation de l’expression de groupes minoritaires. Quels que soient les qualificatifs que l’on peut employer à l’égard de ces outils, ceux-ci sont des réalités avec lesquelles nous devons composer. Les nouvelles générations seront encore plus immergées que nous dans ce mode d’information. C’est donc à nous de nous y adapter plutôt que de chercher à retarder l’inéluctable.
En tout cas, les co-rapporteurs que nous sommes, M. Door et moi-même, ne disposons en moyenne des informations que vingt-quatre heures avant leur publication dans les journaux bien que nous soyons en contact avec les plus hautes sommités en matière de grippe. C’est dire si le citoyen est quasi instantanément nourri de toute l’information.
Le président Birraux a parlé ce matin de « pandémie des rumeurs ». Puisque l’on n’a pas arrêté, en matière de pandémie, de parler de barrière, je suggère, si l’on ne veut pas de cette pandémie des rumeurs, d’élever à son encontre la barrière de la transparence...
Prenons l’exemple du choix du vaccin. Le grand public n’a jamais su les raisons qui ont fait choisir tel vaccin plutôt que tel autre, ce qui a donné lieu aux hypothèses les plus fantaisistes. Celles-ci n’auraient pas eu de raison d’être si l’opinion avait été informée tout de suite des raisons de tel ou tel choix. De même, il est dommage qu’il ait fallu un événement médiatique à l’Assemblée pour que soit révélé le contrat caché du vaccin Baxter. Le mur élevé en la matière était complètement inutile. Quand j’ai demandé des précisions à M. Houssin concernant les vaccins commandés en France, leur marque, leur quantité, celui-ci a répondu sans aucun problème. Plus de transparence permettrait donc d’apporter, je le répète, plus de sérénité aux citoyens qui n’arrêtent pas de se poser des questions en la matière.
Qui a la légitimité du choix ? Les professionnels se jugent sans voix et, pour certains, sans mode d’emploi ou sans information stabilisée. Quant au couple experts-politiques il a pu être qualifié de vicieux ! Force est en tout cas de constater que les rapports entre les experts et les politiques sont un peu compliqués. Comme M. Bourgain, je considère que nous sommes tous des experts, qu’il s’agisse de l’expertise d’usage ou de l’expertise scientifique, seuls les niveaux de légitimité pouvant différer. Nous ne sommes plus à l’ère des sachants et des ignares.
Parmi les critères d’évaluation de la crise, on pense toujours à l’épidémiologie, au nombre de décès, etc. Mais, ainsi que cela a été souligné, la désorganisation sociale et la chute brutale de l’activité ont été repoussées.
Toujours en matière de légitimité, en l’occurrence celle du citoyen, le président du LEEM a été très sévère. Le fait que parmi les informations qui circulent, certaines soient ridicules, d’autres caricaturales voire dangereuses, n’empêche pas le citoyen de poser de bonnes questions.
Quand Mme Buhler a réclamé des tests, j’ai regretté l’absence de Mme Weber qui nous avait longuement expliqué que des évaluations probabilistes pouvaient être effectuées à la place des tests, ceux-ci étant coûteux et les laboratoires encombrés.
Comme l’a fort bien remarqué un intervenant, la qualité biomédicale ne suffit pas pour créer l’adhésion. Quant au fait que les médecins et les infirmiers soient défiants, n’est-ce pas dû à une forme de réaction de leur part parce qu’ils ont été tenus à l’écart, parce qu’ils n’ont pas pu vacciner, et parce qu’ils n’ont pas de retour sur le nom du vaccin inoculé aux patients qui passent dans les centres de santé – information qui pourrait servir aux réseaux Sentinelles et des GROG pour alimenter les réseaux internationaux ?
Qui a la légitimité du pilotage ? Personnellement, je préférerais que ce soit le ministère de la santé plutôt que celui de l’intérieur, surtout après avoir appris que, dans deux départements, les gendarmes sont venus chercher les médecins ou encore qu’une circulaire de l’intérieur a failli fractionner l’acte entre celui qui prépare, qui injecte et celui qui s’occupe de la traçabilité.
Bien que le représentant des infirmiers l’ait contesté, je pense que nous assistons à deux virages.
Le premier c’est le passage d’une très grande défiance à une moindre défiance et même à une revendication de qualité de service : les gens ne veulent pas attendre et voudraient pouvoir être convoqués.
Le second virage est sociétal et historique puisque c’est l’importance croissante d’Internet. Dans quelques mois, nous aurons à faire des préconisations, non seulement sur la gestion de la grippe, mais également sur tout ce qui doit se passer avant les crises en termes de santé publique : échange d’informations, coopérations, concertation, etc. Vos suggestions en la matière nous seront précieuses.
M. Jean-Pierre Door, député, co-rapporteur. Il me revient de remercier toutes les personnes qui ont accepté notre invitation pour débattre avec nous aujourd’hui. La journée a été très enrichissante de par la multiplicité des milieux et des acteurs représentés : scientifiques, médecins, organismes publics, gens de terrain.
Nous avons eu un débat de vérité, chacun ayant eu la possibilité de dire ce qu’il avait à dire, et il me revient de présenter une conclusion sur les interventions de ce matin qui ont porté sur la mutation des virus et la vaccination.
Une idée s’impose, à savoir qu’il est possible de ralentir la propagation du virus A(H1N1). Les connaissances scientifiques sont certes intéressantes mais encore limitées sur la mutation du virus et sur ses effets sur la défense immunitaire, mais on commence à mieux comprendre la manière dont un virus pénètre dans une cellule et la façon dont il freine sa multiplication à l’intérieur de la cellule hôte. Certaines des mutations, ou plutôt des recombinaisons, sont marginales et ne posent pas de réels problèmes mais, à partir d’un certain niveau de spécificité, un nouveau virus peut nécessiter de produire un nouveau vaccin.
Les recherches sur les vaccins, notamment les vaccins maquettes ou les vaccins pluri-pandémiques, ont permis de trouver les vaccins adaptés aux types de virus en circulation. Mais, comme cela a été souligné, des efforts importants de recherche restent nécessaires en ce domaine.
Les équipes de recherche françaises sont de grande qualité, qu’elles relèvent de l’institut Pasteur, de l’INSERM, de l’INRA, du CNRS ou d’organismes plus spécifiques. Les recherches en santé animale sont tout aussi importantes que celles en santé humaine puisqu’un virus grippal est la résultante de virus animaux et de virus humains.
Les recherches sont parfois pointues. Je pense, en particulier, à celles qui sont menées au laboratoire P4 de Lyon, que Mme Marie-Christine Blandin et moi-même visiterons. Certaines sont fondamentales, d’autres appliquées. Les financements semblent à la hauteur des besoins même si, selon le professeur Delfraissy, des crédits supplémentaires doivent être dégagés pour engager une recherche plus rapide.
Les débats sur la durée des essais cliniques et sur le temps limité pour obtenir l’autorisation de mise sur le marché – la fameuse AMM – sont certes légitimes, mais les procédures employées pour cette grippe pandémique ne diffèrent pas des procédures utilisées dans d’autres cas. Il n’y a, du reste, pas eu besoin de recourir à des autorisations spéciales ou accélérées. La technique des vaccins maquettes est bien connue. Le remplacement de l’antigène H5N1 par l’antigène H1N1 ne pose pas de problème spécifique, le virus ayant été inactivé.
Les recherches sur les conséquences des adjuvants, notamment, sur le lien entre les vaccins avec adjuvants et le syndrome de Guillain-Barré ne permettent pas, pour l’instant, d’établir le moindre lien. Lors de la vaccination massive de 1976 aux États-Unis, qui a concerné plusieurs dizaines de millions de personnes, il y aurait eu probablement autant de cas de Guillain-Barré sans vaccination qu’à la suite de celle-ci. Les courbes statistiques sont particulièrement éloquentes, et le contexte politique dans lequel s’est déroulée cette vaccination reste très particulier.
Il est en revanche certain que les adjuvants permettent de produire plus de vaccins avec moins de produits, dans une proportion importante. Les États-Unis, qui ont fait le choix de vaccins sans adjuvant, sont actuellement en manque de vaccins. Ils permettent aussi une meilleure couverture vaccinale, au prix de quelques effets secondaires qui restent maîtrisés. Il serait cependant souhaitable de mieux étudier ces effets secondaires, car ils suscitent certaines craintes dans la population.
Le médicament antiviral idéal reste à inventer. Le Tamiflu n’est encore efficace que pendant les quarante-huit premières heures après les premiers symptômes. L’intérêt de ce médicament encore récent est maintenant mieux compris, tant par les professionnels de santé que par la population. Il diminue le temps de la maladie et empêche certains cas graves. Il y a, cependant, des avis contradictoires sur sa prescription à titre préventif ou simplement à titre curatif. Il serait intéressant de consacrer davantage de moyens à l’évaluation des antiviraux.
On ne comprend pas encore pourquoi le virus affecte certaines personnes et pas leur entourage immédiat. On ne sait pas encore pourquoi il entraîne des complications sévères chez certaines personnes qui n’appartiennent pas aux catégories traditionnelles qui présentent des risques particuliers en cas de grippe.
Compte tenu de tous ces éléments, la vaccination reste le meilleur moyen pour prévenir une pandémie et pour écrêter ses effets. Elle permet d’éviter l’engorgement de l’appareil médical, des cabinets médicaux et des services de réanimation et la désorganisation de la société. Mme Autran, immunologiste, n’a pas hésité à qualifier la vaccination d’acte militant.
L’apport des historiens, des sociologues – je vous remercie, monsieur Zylberman, pour votre présence –, des politologues, voire des anthropologues ou des ethnologues est essentiel pour comprendre pourquoi une campagne de vaccination est acceptée ou non par l’opinion publique. Les recherches en sciences humaines et sociales sont fondamentales pour apprécier les démarches engagées par les concepteurs des plans de santé publique, en particulier du plan pandémie – je m’adresse plus particulièrement là à la DGS.
Ces conclusions sont partielles. Elles dépendent de l’état des connaissances actuelles qui nous ont été exposées ce matin. Elles devront être vérifiées dans les prochains mois en fonction de l’évolution de la pandémie, être soumises à une critique scientifique rigoureuse et, éventuellement, donner lieu à débat public.
Enfin, il faudra lutter contre le déni du risque. Nous avions déjà constaté un tel déni lors de l’alerte causée par le H5N1. Nous devons mener un travail de conviction afin de construire la confiance.
En matière d’information, peut-être pouvons-nous tous – pouvoirs publics, parlementaires, politiques – battre notre coulpe, mais il faut absolument fournir des efforts en la matière comme sur le plan de la pédagogie. M. Tabuteau, spécialiste des questions de santé et de sécurité sociale, qui n’a pu être présent ce matin, nous avait cependant indiqué récemment qu’il voyait un intérêt à instaurer des débats citoyens dans ce domaine. Faudra-t-il aller jusque-là ? Il faut y réfléchir.
S’agissant de l’organisation des pouvoirs publics, il convient de rappeler que, tant L’EPRUS, que les ARS ou la loi HPST sont des éléments nouveaux auxquels il faut donner le temps de se mettre en place. Peut-être la pandémie H1N1 est-elle venue trop tôt par rapport à la construction imaginée par les pouvoirs publics. Mais des virus, nous en connaîtrons d’autres : comme l’a fait remarquer un intervenant, les virus sont les compagnons de l’humanité.
Pour l’instant, nous devons nous battre contre le H1N1, et c’est pourquoi Mme Marie-Christine Blandin et moi-même organiserons d’autres auditions publiques dans le cadre de la préparation de notre rapport.
Merci de notre part à tous pour votre présence à cette journée.
© Assemblée nationale